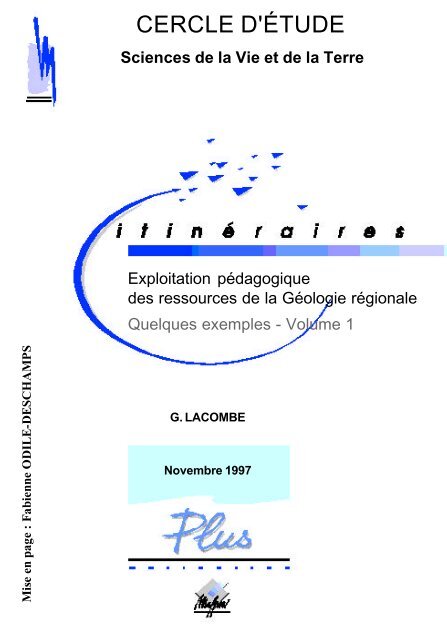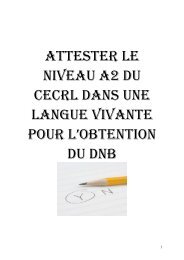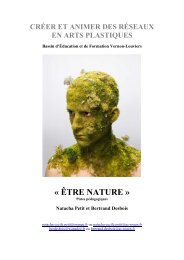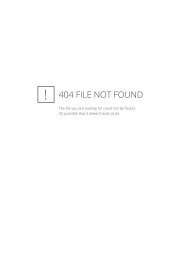CERCLE D'ÉTUDE - Académie de Montpellier
CERCLE D'ÉTUDE - Académie de Montpellier
CERCLE D'ÉTUDE - Académie de Montpellier
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Mise en page : Fabienne ODILE-DESCHAMPS<br />
<strong>CERCLE</strong> <strong>D'ÉTUDE</strong><br />
Sciences <strong>de</strong> la Vie et <strong>de</strong> la Terre<br />
Exploitation pédagogique<br />
<strong>de</strong>s ressources <strong>de</strong> la Géologie régionale<br />
Quelques exemples - Volume 1<br />
G. LACOMBE<br />
Novembre 1997
Exploitation pédagogique <strong>de</strong>s<br />
ressources <strong>de</strong> la Géologie régionale<br />
Quelques exemples - Volume 1
Préface<br />
Avant - propos<br />
Sommaire<br />
Exemple 1 : Les sables <strong>de</strong> Corneilhan<br />
I - Sur le terrain : Le cadre géologique<br />
II - Au laboratoire et en classe<br />
1 - Analyse granulométrique<br />
2 - Observations à la loupe binoculaire<br />
Conclusion et discussion<br />
III - Quelle histoire peut-on reconstituer pour la région étudiée ?<br />
Informations complémentaires tirées <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'autres exemples régionaux<br />
Documentation à consulter<br />
Exemple 2 : Le volcanisme régional<br />
I - Sur le terrain : le cadre géologique<br />
1 - Région d'Ag<strong>de</strong><br />
Synthèse et interprétation<br />
II - Informations tirées <strong>de</strong>s roches au laboratoire et en classe<br />
1 - Si on s'adresse à la nature <strong>de</strong>s roches prélevées<br />
2 - Si on s'adresse aux formations étudiées<br />
Documentation à consulter<br />
Exemple 3 : Une sortie dans le massif <strong>de</strong> la Clape<br />
Sur le terrain : trois arrêts particulièrement recommandés<br />
I - La dalle d'Armissan<br />
II - Rama<strong>de</strong>, entre le plan <strong>de</strong> Roques et Combe Longue<br />
III - Le gouffre <strong>de</strong> l'Oeil doux<br />
Documentation à consulter
Préface<br />
La diversité exceptionnelle <strong>de</strong>s ressources géologiques <strong>de</strong> l'<strong>Académie</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Montpellier</strong> justifie l'intérêt qui leur est porté. Ces richesses naturelles invitent<br />
les citoyens à rechercher les principes <strong>de</strong> la genèse <strong>de</strong> leur environnement.<br />
Cette curiosité favorise le développement <strong>de</strong> la responsabilité pour la protection<br />
du patrimoine à transmettre.<br />
Il est possible, en relation avec les programmes du premier et du second<br />
cycle, d'expliquer les évolutions <strong>de</strong> la planète Terre justifiant celles <strong>de</strong> la vie.<br />
Le décryptage <strong>de</strong>s archives géologiques, par les arguments qu'il produit, permet<br />
<strong>de</strong> raconter cette histoire <strong>de</strong> la Terre. L'explication <strong>de</strong> la formation <strong>de</strong>s<br />
roches s'appuie sur <strong>de</strong>s démarches d'investigation et débouche sur <strong>de</strong>s chroniques<br />
du temps passé liées aux transformations <strong>de</strong> la planète.<br />
L'approche dynamique <strong>de</strong> la géologie régionale se construit par la collecte<br />
d'arguments <strong>de</strong> terrain à partir <strong>de</strong>squels l'esprit construit les dimensions d'espace<br />
et <strong>de</strong> temps, sans lesquelles la géologie ne resterait qu'une science <strong>de</strong>scriptive.<br />
Monsieur Gérard LACOMBE, professeur au lycée Jean Moulin <strong>de</strong><br />
Béziers, à partir <strong>de</strong> ses pratiques <strong>de</strong> géologue <strong>de</strong> terrain, a élaboré cette première<br />
brochure susceptible d'ai<strong>de</strong>r les collègues dans l'exploitation <strong>de</strong>s faits<br />
géologiques régionaux. Qu'il soit remercié <strong>de</strong> faire partager sa passion par ce<br />
support qui laisse la liberté pédagogique aux professeurs et permet d'affiner<br />
les analyses <strong>de</strong>s réalités du terrain !<br />
Un tel outil ne doit pas rester figé. L'évolution viendra <strong>de</strong> l'usage qui en sera<br />
fait sur le terrain. Ainsi la reconnaissance valorisante, par les témoignages transmis<br />
à Monsieur LACOMBE, s'exprimera par les critiques constructives que vous<br />
lui ferez parvenir.<br />
Jean-Pierre FABIEN<br />
IPR-IA Sciences <strong>de</strong> la Vie et <strong>de</strong> la Terre
Avant - propos<br />
Les programmes du cycle central, <strong>de</strong> 1 ère S et <strong>de</strong> Terminale S comportent<br />
chacun une partie développée <strong>de</strong> Géologie.<br />
L'option complémentaire en 1 ère S et l'enseignement <strong>de</strong> spécialité en Terminale<br />
S consacrent à cette discipline près d'un tiers <strong>de</strong> l'horaire.<br />
✧ Pour le cycle central, il est indiqué que :<br />
«La Géologie étant une science <strong>de</strong> terrain, on privilégie un exemple<br />
local ou régional étudié à partir d'une sortie.»<br />
✧ Pour le second cycle, les documents d'accompagnement précisent, en<br />
les explicitant, les contenus et les limites, tout en recommandant :<br />
«L'enseignement doit s'appuyer le plus possible sur <strong>de</strong>s faits <strong>de</strong> terrain...<br />
»<br />
et «Du point <strong>de</strong> vue méthodologique, l'accent est mis sur l'analyse d'objets<br />
géologiques et <strong>de</strong> documents réels».<br />
Les termes "sur le terrain" apparaissent à trois reprises dans le programme<br />
<strong>de</strong> 1 ère S .<br />
L'enseignement sera d'autant plus dynamique, attrayant et chargé d'intérêt<br />
que ces" faits <strong>de</strong> terrain" seront proches géographiquement <strong>de</strong> la classe.<br />
Facilement accessibles au cours d'excursions, ils <strong>de</strong>meurent à la portée même<br />
d'un approfondissement personnel <strong>de</strong> l'élève qui le souhaite.<br />
Ce volume 1 présente quelques exemples, comme supports d'exploitation<br />
pédagogique <strong>de</strong> la géologie régionale dans notre <strong>Académie</strong>.<br />
Ils trouvent leurs sources, d'abord dans les observations directes, pratiques<br />
du terrain ; ils ne s'appuient qu'ensuite sur une documentation spécialisée.<br />
Dans chaque thème abordé, seront précisés :<br />
✧ Les niveaux intéressés.<br />
✧ Les contenus-notions, objectifs cognitifs concernés.<br />
✧ Le cadre géologique avec ses cartes et ses coupes.<br />
✧ Les interprétations qui découlent <strong>de</strong> son étu<strong>de</strong>.<br />
✧ Quelques activités possibles et compétences à acquérir par l'élève.<br />
✧ La documentation à consulter.<br />
Charge à chaque professeur <strong>de</strong> s'approprier ces supports, <strong>de</strong> les intégrer dans<br />
son enseignement suivant le niveau <strong>de</strong> ses élèves, ses objectifs, sa progression,<br />
les moyens dont il dispose...<br />
La formulation <strong>de</strong>s problèmes géologiques, qui <strong>de</strong>meure <strong>de</strong> la responsabilité<br />
pédagogique <strong>de</strong> chaque enseignant, amènera à exploiter ces documents <strong>de</strong><br />
diverses façons suivant les objectifs méthodologiques, cognitifs ou/et les compétences<br />
visées.<br />
Je tiens à remercier mes collègues André DIGUET, Bernard HALLEUX, et<br />
Clau<strong>de</strong> VAYSSIERE pour toute l'ai<strong>de</strong> qu'ils m'ont apportée, tout particulièrement<br />
sur le terrain.<br />
Gérard LACOMBE
Thoré<br />
Levézou<br />
L'Espinouse<br />
St Pons<br />
Durban Corbières<br />
Tuchan<br />
L '<br />
0 10 20 30 40 50 km<br />
Exemple I<br />
Exemple II<br />
Exemple III<br />
L e Ja u r<br />
St Chinian<br />
L 'O r b<br />
III<br />
L'A u d e<br />
Narbonne<br />
A g ly<br />
St Affrique<br />
Millau<br />
Montagne Noire<br />
Corbières<br />
L a T ê t<br />
L e Te ch<br />
Perpignan<br />
Graissessac<br />
Caroux<br />
I<br />
L e T a rn<br />
Bédarieux<br />
Collioure<br />
: Les sables <strong>de</strong> Corneilhan<br />
: Le volcanisme régional<br />
c<br />
L a C la p e<br />
Leucate<br />
Causses<br />
Béziers<br />
L a Jo n te<br />
Lodève<br />
Clermont<br />
l'Hérault<br />
L 'H é r a u lt<br />
Pézenas<br />
Ag<strong>de</strong><br />
: Une sortie dans le massif <strong>de</strong> la Clape<br />
L e G a rd o n<br />
Mt Aigoual<br />
Cévennes<br />
Pic St Loup<br />
L e Le z<br />
Sète<br />
GOLFE DU LION<br />
Anduze<br />
<strong>Montpellier</strong><br />
Alès<br />
Garrigues<br />
L e G a rd<br />
Sommière<br />
Les Gras<br />
L e<br />
Nîmes<br />
V is re<br />
t<br />
L e Peti<br />
Uzès<br />
Costières<br />
St M.<br />
L e R h ô n e<br />
Pont<br />
St Esprit<br />
t R h ô n e<br />
Camargue<br />
Avignon<br />
Arles<br />
Les<br />
Baux<br />
L e R h ô ne
Exemple 1 : Les sables <strong>de</strong> Corneilhan<br />
Niveaux intéressés :<br />
Cycle central : dans :<br />
Les roches sédimentaires sont <strong>de</strong>s archives permettant <strong>de</strong> reconstituer <strong>de</strong>s<br />
éléments <strong>de</strong> paysages anciens.<br />
✧ Les fossiles, restes ou traces dans les roches d'êtres vivants du passé,<br />
apportent <strong>de</strong>s informations sur les milieux <strong>de</strong> vie.<br />
✧ L'empilement <strong>de</strong>s matériaux sédimentaires successifs rend possible la<br />
reconstitution d'une suite <strong>de</strong> paysages ou d'événements.<br />
L'histoire <strong>de</strong> la vie est marquée par la succession et le renouvellement <strong>de</strong>s<br />
espèces et <strong>de</strong>s groupes.<br />
1 ère S : dans :<br />
De la roche au sédiment :<br />
✧ L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s roches sédimentaires fournit <strong>de</strong>s renseignements sur les<br />
conditions d'altération, <strong>de</strong> transport et <strong>de</strong> sédimentation passés.<br />
Terminale S : dans :<br />
Les roches, produits et témoins du temps (Terminale S avec spécialité S.V.T.).<br />
Disparition, apparition, expansion et diversification <strong>de</strong>s espèces et <strong>de</strong>s groupes.<br />
Objectifs méthodologiques :<br />
Pour le cycle central :<br />
I : I<strong>de</strong>ntification, lors d'une sortie, <strong>de</strong>s éléments d'un paysage local.<br />
C : Réalisation et rédaction d'un texte soulevant les problèmes tirés d'observations<br />
effectuées sur le terrain.<br />
I : Détermination <strong>de</strong> fossiles à l'ai<strong>de</strong> d'une clé <strong>de</strong> détermination.<br />
Ra : Comparaison <strong>de</strong> fossiles avec les êtres vivants actuels apparentés pour<br />
déterminer leur milieu <strong>de</strong> vie passé.<br />
Ra : Comparaison avec l'actuel pour déterminer les conditions et le milieu<br />
<strong>de</strong> dépôt d'un sédiment.<br />
Pour le second cycle :<br />
I : Saisir <strong>de</strong>s informations et les mettre en relation logique.<br />
C : Effectuer une synthèse.<br />
Re : Utiliser divers instruments : loupe, microscope ...<br />
Re : Réaliser un tri sous ces instruments, après avoir sélectionné les sujets<br />
d'intérêt.<br />
Ra : Lecture et interprétation <strong>de</strong>s documents, cartes, coupes ...<br />
C : Résoudre un problème par un <strong>de</strong>ssin.<br />
C : Présenter son travail avec un souci d'ordre et <strong>de</strong> soin.
Compétences :<br />
Pour le cycle central :<br />
✧ Reconstituer un paysage du passé à partir <strong>de</strong> roches sédimentaires et<br />
<strong>de</strong>s fossiles qu'elles contiennent.<br />
✧ Mettre en relation les caractéristiques d'une roche sédimentaire (strates,<br />
fossiles) et les grands traits du milieu <strong>de</strong> sédimentation.<br />
✧ I<strong>de</strong>ntifier un fossile grâce à une clé <strong>de</strong> détermination et émettre une<br />
hypothèse sur le milieu <strong>de</strong> vie ancien.<br />
Pour le second cycle :<br />
✧ Savoir utiliser les micro et macrofossiles pour résoudre les problèmes.<br />
✧ Etablir une corrélation faunistique entre <strong>de</strong>ux enregistrements<br />
paléontologiques géographiquement séparés.
I - Sur le terrain : Le cadre géologique<br />
Corneilhan, village situé à 5 km au N O <strong>de</strong> Béziers est bâti sur <strong>de</strong>s sables<br />
Pliocène. Localement consolidés, ils donnent par endroit, <strong>de</strong>s grès très tendres,<br />
formant <strong>de</strong>s talus dans lesquels les habitants ont creusé facilement <strong>de</strong>s cavités<br />
<strong>de</strong>stinées à abriter leur matériel agricole.<br />
La roche très friable est sujette à éboulements.<br />
La formation d'une trentaine <strong>de</strong> mètres d'épaisseur au total affleure sur environ<br />
3,5 km (N S) et 3 km (E O).<br />
On peut noter, par endroit, un pendage légèrement incliné vers le Nord.<br />
Elle repose à sa base sur du Miocène argilo-sableux riche en coquilles <strong>de</strong><br />
Lamellibranches et en particulier d'huîtres. Bien développé dans le Biterrois,<br />
le Miocène peut se présenter suivant les endroits avec <strong>de</strong>s faciès différents :<br />
conglomératique, molassique, marneux avec nombreuses huîtres (ostréa<br />
crassissima), calcaire à Polypiers (Autignac)...<br />
Au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s sables <strong>de</strong> Corneilhan, on peut observer vers l'Est (Ribaute)<br />
<strong>de</strong>s formations limoneuses rougeâtres et <strong>de</strong>s cailloutis associés, à galets siliceux,<br />
bien développés dans les régions <strong>de</strong> Bassan - Montblanc - Bessan et connues<br />
sous le nom <strong>de</strong> «Cailloutis Villafranchien». Elles correspon<strong>de</strong>nt à du Pliocène<br />
terminal continental et du Pléistocène. Les contacts peuvent être observés<br />
à l'Est d'Astiès et à l'Est <strong>de</strong> Corneilhan (cf carte).<br />
Dans les zones observées, on ne peut mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> discordance<br />
angulaire bien nette.<br />
La coupe synthétique est facile à réaliser.<br />
Sur le terrain, après avoir repéré la disposition <strong>de</strong>s différentes couches, on<br />
pourra effectuer <strong>de</strong>s prélèvements dans Corneilhan même, à l'embranchement<br />
<strong>de</strong> la D 39 et <strong>de</strong> la D 154 (1 à 2 kg suffisent) et à 150 m au S E du bois <strong>de</strong><br />
Nouguié (sommet du Pliocène marin) : on recherchera <strong>de</strong>s coquilles (assez rares).<br />
On prélèvera <strong>de</strong>s marnes sableuses du Miocène à coquilles d'huîtres abondantes<br />
(à environ 1 km au SE <strong>de</strong> Thézan (cf carte).<br />
Il sera également intéressant <strong>de</strong> se procurer <strong>de</strong>s marnes sableuses situées<br />
bien plus à l'Est, riches en coquilles d'huîtres Pliocène (face à la Pommière,<br />
à 2 km au Nord <strong>de</strong> Florensac).<br />
Enfin on disposera <strong>de</strong> sables actuels : Sérignan Plage, pour établir <strong>de</strong>s comparaisons<br />
avec les échantillons précé<strong>de</strong>mment récoltés.
Sables <strong>de</strong> Corneilhan : gisement
A<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0 m<br />
0<br />
A<br />
O rb<br />
Thézan<br />
Asties<br />
P<br />
Lignan<br />
P<br />
P<br />
P<br />
Corneilhan<br />
Marnes Sables Cailloutis<br />
Coupe A. B.<br />
Bois <strong>de</strong> Nouguié<br />
P<br />
Ribaute<br />
L ib r n<br />
0 1 2 3 km<br />
Miocène Pliocène «Villafranchien» Alluvions<br />
Colluvions Prélèvement<br />
Libron<br />
o<br />
?<br />
Bassan<br />
P<br />
B<br />
E<br />
B
II - Au laboratoire et en classe<br />
L'explication <strong>de</strong> la formation du transport et du dépôt <strong>de</strong>s sédiments peut<br />
s'argumenter.<br />
1 - Analyse granulométrique<br />
Elle est réalisée pour tenter d'apporter <strong>de</strong>s précisions sur les origines <strong>de</strong>s<br />
sables étudiés.<br />
Elle pourra être effectuée avec colonnes <strong>de</strong> tamis et balances pour donner<br />
un exemple d'une technique utilisée en géologie. Les comparaisons <strong>de</strong>s résultats<br />
traduits sous forme <strong>de</strong> courbes <strong>de</strong> fréquence, <strong>de</strong> courbes cumulatives, n'apportent<br />
pas dans ce cas d'éléments déterminants dans la compréhension <strong>de</strong>s<br />
«faits <strong>de</strong> terrain».<br />
Son principal intérêt sera <strong>de</strong> concentrer les microfossiles <strong>de</strong>s sables Pliocène<br />
dans le tamis à maille <strong>de</strong> 0,25 mm (étudiés dans 2).<br />
Exemples <strong>de</strong> résultats obtenus : poids <strong>de</strong>s échantillons = 100 g.<br />
Sables <strong>de</strong><br />
Maille Corneilhan Bois <strong>de</strong> Nouguié Sérignan Plage<br />
(Pliocène) (Pliocène) (Actuel)<br />
(en mm) (en g) (en g) (en g)<br />
2,000 00,7 00,0 03,3<br />
1,000 03,6 00,4 04,9<br />
0,500 07,0 20,0 20,6<br />
0,250 08,6 44,1 50,8<br />
0,125 45,7 22,3 18,5<br />
0,061 24,3 08,8 00,6<br />
Fond 08,2 02,0 00,0<br />
aux imprécisions <strong>de</strong> pesées près.<br />
Dans les trois cas étudiés, les courbes sont unimodales, symétriques, ce qui<br />
peut être interprété en faveur d'une origine unique <strong>de</strong> chaque sédiment avec<br />
triturations dans <strong>de</strong>s directions variées.<br />
2 - Observations à la loupe binoculaire : (x 20 et x 40)<br />
Contenus minéralogiques et biologiques<br />
a - Le sable <strong>de</strong> Sérignan Plage : (actuel)<br />
Nombreux éléments <strong>de</strong> taille et <strong>de</strong> nature variées avec beaucoup <strong>de</strong><br />
grains <strong>de</strong> quartz subanguleux luisants, <strong>de</strong>s paillettes <strong>de</strong> mica, <strong>de</strong>s fragments<br />
<strong>de</strong> schistes, <strong>de</strong> grès, <strong>de</strong> calcaires à teintes variées (attaqués par<br />
HCl dilué, dans un verre <strong>de</strong> montre).<br />
On note la présence <strong>de</strong> grains <strong>de</strong> basalte (proximité <strong>de</strong>s volcans <strong>de</strong> la<br />
basse vallée <strong>de</strong> l'Hérault).
Beaucoup <strong>de</strong> fragments <strong>de</strong> coquilles <strong>de</strong> Lamellibranches que l'on peut<br />
d'ailleurs récolter entières : Clovisse, Telline, Vénus, Cardium Couteau,<br />
Peigne, Pecten... pas <strong>de</strong> foraminifères.<br />
b - Les sables <strong>de</strong> Corneilhan et du bois <strong>de</strong> Nouguié : (Pliocène)<br />
Pas <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s différences dans la variété <strong>de</strong>s minéraux déterminés,<br />
avec le sable précé<strong>de</strong>nt, si ce n'est l'absence <strong>de</strong> grains <strong>de</strong> basalte et une<br />
proportion plus importante <strong>de</strong> particules argileuses. La couleur ocre<br />
jaune résulte <strong>de</strong> la présence d'hydroxy<strong>de</strong>s <strong>de</strong> fer.<br />
Les rares coquilles récoltées ont été déterminées par les paléontologues<br />
: Gryphaea virleti, Ostréa serresi, O. perpiniana,.<br />
Nombreux microfossiles, très bien dégagés, que l'on pourra trier, isoler,<br />
observer, <strong>de</strong>ssiner, déterminer par comparaison avec <strong>de</strong>s planches et<br />
<strong>de</strong>s photographies fournies en T P.<br />
Un simple lavage <strong>de</strong> ces sables dans le tamis O,25 mm permet une concentration<br />
<strong>de</strong>s formes à observer.<br />
Ce sont essentiellement <strong>de</strong>s Foraminifères appartenant aux familles <strong>de</strong>s<br />
Globigérinidés, <strong>de</strong>s Anomalinidés, <strong>de</strong>s Lagénidés, <strong>de</strong>s Rotalidés.<br />
On trouve également <strong>de</strong>s carapaces d'Ostraco<strong>de</strong>s.<br />
Pas <strong>de</strong> différences notables entre les <strong>de</strong>ux sables.<br />
c - Les marnes sableuses <strong>de</strong> la Pommière : (2 km au Nord <strong>de</strong> Florensac)<br />
Dans un mélange argilo-sableux à particules fines, on dégagera facilement<br />
les nombreuses coquilles d'huîtres entières attribuées à Gryphaéa<br />
virleti, Ostréa serresi, O. perpiniana (Pliocène). On les déterminera.<br />
Très peu <strong>de</strong> microfossiles visibles.<br />
d - Les marnes sableuses d'Astiés : (S E <strong>de</strong> Thézan)<br />
De couleur claire, riches en particules argileuses très fines, elles font<br />
effervescence car elles contiennent aussi une certaine proportion <strong>de</strong><br />
calcaire.<br />
On dégagera les coquilles <strong>de</strong> Lamellibranches très abondantes et variées<br />
par endroits ; notamment la remarquable Ostréa crassissima bien<br />
représentée dans le Miocène régional. On les déterminera en utilisant<br />
un atlas <strong>de</strong>s fossiles.<br />
Conclusion et discussion<br />
✧ Les roches étudiées résultent <strong>de</strong> l'altération, <strong>de</strong> la fragmentation <strong>de</strong> roches<br />
préexistantes ; les débris plus ou moins grossiers ont été transportés<br />
et ils se sont ensuite déposés en milieu marin formant <strong>de</strong>s couches<br />
superposées fossilifères. Ce sont <strong>de</strong>s roches sédimentaires détritiques.<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> leurs contenus minéralogique et biologique fournit <strong>de</strong>s renseignements<br />
sur leurs genèses.<br />
✧ Les sables <strong>de</strong> Corneilhan, du bois <strong>de</strong> Nouguié et les marnes sableuses<br />
<strong>de</strong> la Pommière, bien que différents d'aspects contiennent cependant<br />
les mêmes macrofossiles : on peut penser qu'il s'agit <strong>de</strong> la même formation<br />
(Ex. <strong>de</strong> corrélation à distance).
✧ On ne retrouve pas les mêmes faunes dans les différentes formations<br />
étudiées. Pourquoi ?<br />
Les êtres vivants évoluent : certaines formes disparaissent : Ex. : Ostréa<br />
crassissima du Miocène moyen et supérieur n'est plus retrouvée actuellement ;<br />
certaines formes apparaissent : Ex. Gryphaea virleti au Pliocène n'existe pas<br />
antérieurement. Cardium édule apparaît au Pliocène supérieur et se développe<br />
encore <strong>de</strong> nos jours.<br />
Des fossiles peuvent donc être <strong>de</strong>s marqueurs chronologiques.<br />
✧ Certaines formes vivantes apparaissent diversifiée : Ex :. les Foraminifères<br />
du Pliocène : nombreuses formes différentes observées. Rappeler<br />
qu'à la limite Crétacé -Tertiaire une extinction massive a frappé les Foraminifères.<br />
A partir <strong>de</strong>s quelques groupes rescapés, <strong>de</strong> nouvelles formes se développent<br />
et se diversifient, en occupant à nouveau les niches écologiques<br />
laissées vacantes.<br />
✧ On ne retrouve pas quantitativement les mêmes formes à Corneilhan et<br />
à Pommière. Pourquoi ?<br />
Hypothèse : à la même époque, suivant les lieux, les conditions <strong>de</strong> sédimentation<br />
sont différentes : profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> la mer, éloignement du rivage, estuaire,<br />
reliefs environnants...
Foraminifères et Ostraco<strong>de</strong>s (x40)<br />
Pliocène<br />
Ostréa crassissima<br />
Miocène<br />
Gryphaéa virleti (x2/3)<br />
(x1/4)
Remarques :<br />
III - Quelle histoire peut-on reconstituer<br />
pour la région étudiée ?<br />
✧ On peut connaître les variations <strong>de</strong>s profon<strong>de</strong>urs <strong>de</strong>s mers, les lignes <strong>de</strong><br />
rivages anciens, grâce à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> sondages dans les sédiments, mais<br />
également grâce aux traces laissées par les êtres vivants :<br />
Ex. : - les récifs coralliaires frangeants du Miocène à Autignac.<br />
- les trous <strong>de</strong> Phola<strong>de</strong>s observés en différents endroits sur les côtes<br />
rocheuses <strong>de</strong> l'époque (ex : bords <strong>de</strong> l'étang <strong>de</strong> Thau).<br />
Informations complémentaires tirées <strong>de</strong> l'étu<strong>de</strong> d'autres<br />
exemples régionaux<br />
✧ Les changements sont à mettre en relation avec l'évolution du Bassin<br />
Méditerranéen au tertiaire, plus particulièrement avec la constitution<br />
du Golfe du Lion, sous l'effet <strong>de</strong>s déplacements <strong>de</strong>s plaques africaine et<br />
eurasiatique. Les mouvements relatifs <strong>de</strong>s blocs, ibérique d'une part, et<br />
corso-sar<strong>de</strong> d'autre part, ont eu une gran<strong>de</strong> influence sur l'histoire géologique<br />
<strong>de</strong> notre région.<br />
En bref et <strong>de</strong> façon très schématique :<br />
✧ A l'Eocène (- 65 M. A. à - 34 M. A.)<br />
Les rapprochements successifs <strong>de</strong> la plaque africaine vers la plaque<br />
eurasiatique provoquent <strong>de</strong>s phases <strong>de</strong> compression et <strong>de</strong> serrage, maximales<br />
dans notre région vers - 40 M. A. à - 35 M. A., avec mise en place<br />
du complexe chevauchant : Nappe <strong>de</strong>s Corbières orientales, chaînon <strong>de</strong><br />
Saint-Chinian, la Gardiole - pli <strong>de</strong> <strong>Montpellier</strong>.<br />
Au-<strong>de</strong>là l'ensemble <strong>de</strong> la chaîne pyrénéo-provençale, d'un seul tenant<br />
est bien développé puisqu'il occupe l'actuel Golfe du Lion.<br />
✧ A l'Oligocène (- 34 M. A. à - 23 M. A.)<br />
Sous l'effet, semble-t-il, d'une subduction active sous la plaque eurasiatique<br />
(?), <strong>de</strong>s distensions entraînent <strong>de</strong>s failles normales ainsi que la<br />
constitution <strong>de</strong> fossés d'effondrement comblés par une sédimentation<br />
lacustre ou lagunaire : (Armissan - Nissan). L'érosion <strong>de</strong> la chaîne<br />
pyrénéo-provençale se poursuit activement. Sa partie centrale, qui se<br />
trouvait à la place <strong>de</strong> l'actuel Golfe du Lion, s'effondre.<br />
✧ Au Miocène (- 23 M. A. à - 6 M. A.)<br />
Plusieurs faits géologiques importants se succè<strong>de</strong>nt :<br />
◆ dérive <strong>de</strong> la microplaque corso-sar<strong>de</strong> vers le Sud-Est et ouverture<br />
du bassin méditerranéen occi<strong>de</strong>ntal.<br />
◆ large transgression d'une mer Miocène dont les limites correspondaient<br />
à peu près aux dépôts que l'on peut observer,<br />
aujourd'hui, sur le terrain (voir carte). C'était une mer peu profon<strong>de</strong><br />
(Ostréa crassissima) et chau<strong>de</strong> (récifs coralliaires<br />
d'Autignac).
Remarque :<br />
◆ au Miocène supérieur : importante régression et, selon certains<br />
auteurs, assèchement <strong>de</strong> la Méditerranée occi<strong>de</strong>ntale entre - 6 M.<br />
A. et - 5 M. A. par fermeture du Détroit <strong>de</strong> Gibraltar : (mouvements<br />
du bloc ibérique, <strong>de</strong> la plaque africaine, variation du niveau<br />
<strong>de</strong> la mer ?).<br />
◆ intense creusement d'un réseau hydrographique.<br />
✧ Au Pliocène (- 5 M. A. à - 2 M.A.)<br />
La remise en eau du bassin méditerranéen par réouverture du Détroit <strong>de</strong><br />
Gibraltar permet une nouvelle transgression qui envahit les vallées constituées<br />
lors <strong>de</strong> la précé<strong>de</strong>nte régression. L'avancée <strong>de</strong> la mer laisse dans<br />
ces golfes <strong>de</strong>s dépôts sableux à Corneilhan et <strong>de</strong>s marnes sableuses à<br />
Gryphaea virleti à Pommière.<br />
La fin du Pliocène est marquée par un soulèvement du Sud du Massif<br />
central ; par une régression.<br />
✧ Au Pléistocène (- 2 M. A.)<br />
Un épandage <strong>de</strong>s «Cailloutis villafranchiens» mêlés d'argile rouge, recouvre<br />
notre région. Ils proviennent <strong>de</strong> l'érosion <strong>de</strong>s reliefs <strong>de</strong> la Montagne<br />
Noire.<br />
Tandis qu'un volcanisme actif s'exprime à la faveur <strong>de</strong> failles Pliocène<br />
(coulées <strong>de</strong> Caux-Nizas : - 1,7 M. A.. Volcan d'Ag<strong>de</strong> : - 0,7 M. A.). Le bas<br />
Languedoc va acquérir peu à peu sa configuration actuelle.<br />
Plusieurs phénomènes y concourent :<br />
◆ une érosion intense en particulier karstique (la Clape, Chaînon<br />
<strong>de</strong> Saint-Chinian, la Gardiole, Causses.. ;<br />
◆ une succession <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s glaciaires (au moins 4) alternant avec<br />
<strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> réchauffement, va entraîner <strong>de</strong>s fluctuations du<br />
niveau <strong>de</strong> la mer, <strong>de</strong>s surcreusements dans les vallées fluviatiles,<br />
<strong>de</strong>s remblaiements d'où l'établissement <strong>de</strong> terrasses sur plusieurs<br />
niveaux (vallées <strong>de</strong> l'Orb et <strong>de</strong> l'Hérault) ;<br />
◆ le niveau <strong>de</strong> la mer qui s'était abaissé, au moment <strong>de</strong> la <strong>de</strong>rnière<br />
glaciation, remonte pendant l'interglaciaire actuel.<br />
Au cours <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers millénaires les dépôts alluvionnaires <strong>de</strong>s fleuves<br />
côtiers, sans cesse remaniés par les courants marins, les vagues, les vents,<br />
établissent notre côte avec ses cordons littoraux, ses étangs.<br />
L'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s cartes anciennes <strong>de</strong>puis l'époque romaine est à ce sujet riche<br />
d'enseignement (voir notice <strong>de</strong> la carte géologique <strong>de</strong> Narbonne).<br />
Lacus Rubrensus* : Lac rouge : il <strong>de</strong>vait sa couleur à la terra-rossa que l'Au<strong>de</strong> et les<br />
pluies torrentielles concentraient en cet endroit.
Montagne Noire<br />
St Chinian<br />
Narbonne<br />
La<br />
Clape<br />
Béziers<br />
Bassan<br />
Epandage <strong>de</strong>s "cailloutis Villafranchiens" puis volcanisme ~ (-2 à 0,7 M.A.)<br />
Montagne Noire<br />
Montagne Noire<br />
Chainon<br />
<strong>de</strong><br />
St Chinian<br />
Narbonne<br />
Chainon<br />
<strong>de</strong><br />
St Chinian<br />
Clape<br />
La<br />
La<br />
Ag<strong>de</strong><br />
Maximum d'extension <strong>de</strong> la mer Pliocène ~ (-3 M.A.)<br />
Narbonne<br />
Thézan<br />
Clape<br />
Corneilhan<br />
La<br />
Béziers<br />
Autignac<br />
Béziers<br />
Ag<strong>de</strong><br />
Pommière<br />
Ag<strong>de</strong><br />
Maximum d'extension <strong>de</strong> la mer Miocène ~ (-15 M.A.)<br />
Sète<br />
Sète<br />
Sète<br />
La<br />
Gardiole<br />
La<br />
Gardiole<br />
Gardiole<br />
La
ATAX<br />
Epoque Gallo-Romaine<br />
Au<strong>de</strong><br />
Barrage<br />
VIA AQUITANIA<br />
VIA DOMITIA<br />
La<br />
Berre<br />
Narbonne<br />
Ile <strong>de</strong><br />
l'Aute<br />
Port<br />
<strong>de</strong>s<br />
galères<br />
Roc <strong>de</strong><br />
Conillac<br />
Narbo<br />
Ile<br />
Ste<br />
Lucie<br />
Rubrensus<br />
Roc <strong>de</strong><br />
Gruissan<br />
Ile St<br />
Martin<br />
* Oppidum<br />
d'Enserune<br />
Insula Laci<br />
"Montagne"<br />
<strong>de</strong> la Clape<br />
Lacus Rubrensus * : Lac Rouge : Il <strong>de</strong>vait sa couleur à la terra-rossa que<br />
l'Au<strong>de</strong> et les pluies torrentielles concentraient en cet endroit.<br />
l'Orb<br />
Voie domitienne<br />
Lit actuel <strong>de</strong> l'Au<strong>de</strong><br />
Zone lagunaire<br />
Lacus<br />
*<br />
Etg<br />
Lagune<br />
Pech<br />
Maynaud<br />
Les Exals<br />
Rocher<br />
Vendres<br />
Portus<br />
veneris<br />
Béziers<br />
Biterrae<br />
Littoral<br />
actuel
Documentation à consulter<br />
➝ Carte géologique au 1/80 000 ème : Bédarieux.<br />
➝ Cartes géologiques au 1/50 000 ème : Saint-Chinian - Béziers - Ag<strong>de</strong> -<br />
Pézenas.<br />
➝ Gui<strong>de</strong> géologique régional : Languedoc méditerranéen - Montagne<br />
Noire :<br />
➝ B. GEZE.<br />
➝ Contribution à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la sédimentation détritique dans le Bas-Languedoc<br />
pendant l'ère tertiaire : P. DEMANGEON.<br />
➝ Traité <strong>de</strong> paléontologie : J. PIVETEAU.<br />
➝ Atlas <strong>de</strong>s fossiles : G. DENIZOT.<br />
➝ Les microfossiles : G. BIGNOT.<br />
➝ Il était une fois la Méditerranée : CRDP Nice - Corse.<br />
➝ La recherche n° 71 - 107 - 229 : (<strong>de</strong>stin <strong>de</strong> la Méditerranée).<br />
➝ La Clape antique : André Bonnery<br />
➝ Notice <strong>de</strong> la carte géologique : Narbonne au 1/50 000 ème