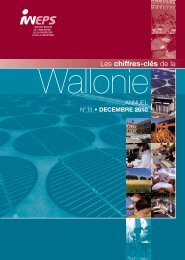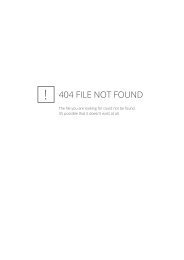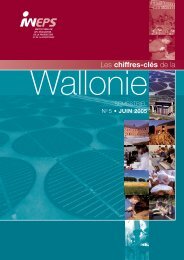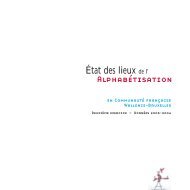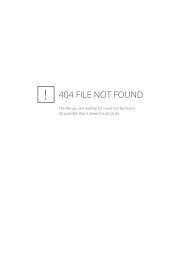Construction d'indicateurs de développement territorial - IWEPS
Construction d'indicateurs de développement territorial - IWEPS
Construction d'indicateurs de développement territorial - IWEPS
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Working Paper<br />
<strong>de</strong> l’<br />
<strong>Construction</strong> d’indicateurs <strong>de</strong> <strong>développement</strong> <strong>territorial</strong><br />
: étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la localisation rési<strong>de</strong>ntielle récente<br />
et analyse au regard <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> <strong>développement</strong><br />
<strong>territorial</strong> durable<br />
RÉSUMÉ<br />
Le sujet <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> est d’analyser la localisation <strong>de</strong>s rési-<br />
<strong>de</strong>nces construites récemment au regard <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> dével-<br />
oppement <strong>territorial</strong> durable.<br />
La localisation <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces construites entre 2001 et 2008 (8<br />
années) sur le territoire wallon a été permise grâce à l’utilisation<br />
<strong>de</strong> données géographiques issues <strong>de</strong> l’administration du<br />
cadastre (AGDP-SPF Finances). Entre le 01/01/2001 et le<br />
31/12/2008, on a construit en Wallonie environ 73 000 loge-<br />
ments sur 57 000 parcelles.<br />
Deux approches ont été privilégiées pour analyser l’évolution<br />
récente <strong>de</strong> cette urbanisation rési<strong>de</strong>ntielle : 1) au sein <strong>de</strong>s noy-<br />
aux d’habitat et 2) autour <strong>de</strong>s gares.<br />
L’objectif <strong>de</strong> la première approche est d’estimer la part <strong>de</strong><br />
l’urbanisation rési<strong>de</strong>ntielle récente localisée au sein <strong>de</strong>s noyaux<br />
d’habitat tels que définis par Y. Delforge et G. Géron (2008).<br />
Cette approche combine trois types <strong>de</strong> critères : <strong>de</strong>s critères<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> population, d’aménagement du territoire et<br />
d’environnement. Elle ne prend pas en compte l’accessibilité<br />
aux arrêts <strong>de</strong> bus.<br />
Parmi les près <strong>de</strong> 73 000 logements créés en Wallonie entre<br />
le 01/01/2001 et le 31/12/2008, 32% ont pris place au sein<br />
d’un noyau d’habitat, tel que défini par Y. Delforge et G. Géron<br />
(2008).<br />
L’objectif <strong>de</strong> la secon<strong>de</strong> approche est <strong>de</strong> voir si les nouvelles<br />
habitations se sont localisées à proximité <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> forte<br />
n°2 Août 2011<br />
accessibilité en transports en commun. Plusieurs tests ont été<br />
réalisés afin <strong>de</strong> définir un critère <strong>de</strong> proximité pertinent pour<br />
une accessibilité aux gares ferroviaires à pied ou à vélo et dif-<br />
férentes distances aux gares ont été considérées. L’analyse<br />
s’est faite par cercle concentrique (distances théoriques à vol<br />
d’oiseau) autour <strong>de</strong>s gares. Une variation <strong>de</strong>s distances en<br />
fonction d’une hiérarchie <strong>de</strong>s gares a été introduite dans les<br />
analyses, ainsi que l’accessibilité aux points d’arrêts <strong>de</strong> bus<br />
très bien <strong>de</strong>sservis.<br />
L’analyse montre notamment que 51% <strong>de</strong>s nouveaux loge-<br />
ments créés en Wallonie entre le 01/01/2001 et le 31/12/2008<br />
ont pris place dans un rayon <strong>de</strong> 3500 mètres autour <strong>de</strong>s gares<br />
ferroviaires passagers IC-IR ou dans un rayon <strong>de</strong> 1000 mètres<br />
<strong>de</strong>s autres gares ou <strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>sservis, alors<br />
que ces zones concentrent 64,7% <strong>de</strong>s logements existants.<br />
En plus <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux principales approches, l’urbanisation rési-<br />
<strong>de</strong>ntielle récente est analysée au regard <strong>de</strong> la structure urbaine<br />
du territoire wallon.<br />
Enfin, les indicateurs communaux construits sont étudiés au<br />
regard du <strong>développement</strong> durable. L’objectif est alors d’évaluer<br />
pourquoi le fait <strong>de</strong> concentrer l’habitat à proximité <strong>de</strong>s gares<br />
et arrêts <strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>sservis s’inscrit dans les principes du<br />
<strong>développement</strong> durable.<br />
L’<strong>IWEPS</strong> est un institut scientifique<br />
public d’ai<strong>de</strong> à la prise <strong>de</strong> décision à<br />
<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s pouvoirs publics. Par sa<br />
mission scientifique transversale, il met<br />
à la disposition <strong>de</strong>s déci<strong>de</strong>urs wallons,<br />
<strong>de</strong>s partenaires <strong>de</strong> la Wallonie et <strong>de</strong>s<br />
citoyens <strong>de</strong>s informations diverses qui<br />
vont <strong>de</strong> la présentation <strong>de</strong> statistiques<br />
et d’indicateurs à la réalisation d’étu<strong>de</strong>s<br />
et d’analyses approfondies dans les<br />
champs couverts par les sciences<br />
économiques, sociales, politiques et<br />
<strong>de</strong> l’environnement. Par sa mission<br />
<strong>de</strong> conseil stratégique, il participe<br />
activement à la promotion et la mise<br />
en œuvre d’une culture <strong>de</strong> l’évaluation<br />
et <strong>de</strong> la prospective en Wallonie.<br />
Julien CHARLIER, Isabelle REGINSTER et Julien JUPRELLE<br />
L’ensemble <strong>de</strong> ce travail doit permettre d’alimenter la réflexion<br />
sur la localisation optimale <strong>de</strong>s activités en Wallonie et plus<br />
particulièrement sur la notion <strong>de</strong> noyaux d’habitat.
Remmerciemments<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 2<br />
Les auteuurs,<br />
Julien Chharlier,<br />
Isabell le Reginster eet<br />
Julien Jupr relle (<strong>IWEPS</strong>), remercient FFrançois<br />
Pirard d (LEPUR-<br />
CPDT) poour<br />
son ai<strong>de</strong> sur le traitem ment <strong>de</strong>s donnnées,<br />
Pierre Neri (CREAT-CPDT),<br />
Julieen<br />
Radoux (UC CL-CPDT),<br />
Nadia Neevens<br />
(SRWT), , Marc Debuis sson (<strong>IWEPS</strong>), Jean-Paul Du uprez (<strong>IWEPS</strong>) ), David Moreelle<br />
(cabinet du<br />
Ministre<br />
Henry), MMichel<br />
Dachelet<br />
(cabinet du d Ministre HHenry),<br />
Thoma as Chevau (c cabinet du Miinistre<br />
Henry) ), Ghislain<br />
Géron et Bruno Groynnne<br />
(SPW-DGO4).<br />
Ils remerccient<br />
égaleme ent l’Administr ration Généralle<br />
<strong>de</strong> la Documentation<br />
Patrimoniale<br />
du SPF FFinances,<br />
en particulier Moonsieur<br />
Miche el Dechef, po our les donnéées<br />
précieuses<br />
mises à<br />
dispositioon.<br />
Ils remerrcient<br />
plus pa articulièremennt<br />
Jean-Marc c Lambotte (LEPUR-CPDT)<br />
( T) et Sébastie en Brunet<br />
(<strong>IWEPS</strong>) ppour<br />
leur releccture<br />
attentive e et leurs commmentaires.
TABLLE<br />
DESS<br />
MATIERES<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 3<br />
1. Intrroduction<br />
................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 5<br />
2. Donnnées<br />
et mmétho<strong>de</strong><br />
... ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6<br />
2.1. LOCALISER LA NOUVELL LE URBANISAATION<br />
RÉSID DENTIELLE ... ................... ................... ........... 6<br />
2.1.11.<br />
Sourcess<br />
<strong>de</strong>s données s ................... .................... ..................... ..................... .................... ............. 6<br />
2.1.22.<br />
Limites s dans l’utilisat ation <strong>de</strong>s donnnées<br />
cadastral les et approch hes possibles pour étudier la<br />
locaalisation<br />
<strong>de</strong> la nouvelle résid <strong>de</strong>nce ............ .................... ..................... ..................... .................... ............. 7<br />
2.1.33.<br />
Autres ddonnées<br />
<strong>de</strong> ca adrage .......... .................... ..................... ..................... .................... ........... 10<br />
2.2. CRITÈRES DDE<br />
LOCALISA ATION ........... ................... ................... ................... ................... ......... 10<br />
2.2.11.<br />
Proximiité<br />
d’un centre e multifonction onnel ............. ..................... ..................... .................... ........... 11<br />
2.2.22.<br />
Accessiibilité<br />
par les alternatives a à la voiture ..... ..................... ..................... .................... ........... 14<br />
2.3. COMPARAISSON<br />
DES CRITÈRES<br />
DE LLOCALISATION<br />
ET CONST TRUCTION DEE<br />
DIFFÉRENT TES<br />
ALTERRNATIVES<br />
.... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ......... 21<br />
2.3.11.<br />
Critère « gares-3500 0m » et noyauxx<br />
d’habitat .... ..................... ..................... .................... ........... 21<br />
2.3.22.<br />
Affinagee<br />
du critère « gare » .......... .................... ..................... ..................... .................... ........... 22<br />
2.3.33.<br />
Tableauu<br />
récapitulatif. f..................... .................... ..................... ..................... .................... ........... 26<br />
3. Réssultats<br />
..... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ....... 26<br />
3.1. LOCALISATION<br />
DE LA NOUVELLE<br />
RÉÉSIDENCE<br />
ET T NOYAUX D’H HABITAT ...... ................... ......... 26<br />
3.1.11.<br />
Noyaux x d’habitat san ns la contraintte<br />
du PASH .... ..................... ..................... .................... ........... 26<br />
3.1.22.<br />
Noyaux x d’habitat ave ec la contraintte<br />
du PASH .... ..................... ..................... .................... ........... 29<br />
3.1.33.<br />
Tableauux<br />
récapitulati ifs ................. .................... ..................... ..................... .................... ........... 29<br />
3.2. LOCALISATION<br />
DE LA NOUVELLE<br />
RÉÉSIDENCE<br />
PA AR RAPPORT À L’OFFRE EEN<br />
TRANSPO ORT EN<br />
COMMMUN<br />
............. ................... ................... ................... ................... ................... ................... .............<br />
................. ................... ................... ................... ................... ................... ................... ......... 30<br />
3.2.11.<br />
Critère dd’accessibilité<br />
é aux gares SSNCB<br />
sans hié érarchisation .. ..................... .................... ........... 30<br />
3.2.22.<br />
Critère dd’accessibilité<br />
é aux gares SSNCB<br />
avec hié érarchie .......... ..................... .................... ........... 33<br />
3.2.33.<br />
Critère dd’accessibilité<br />
é aux gares SSNCB<br />
avec hié érarchie et crit tères d’accesssibilité<br />
aux arr rrêts TEC ..<br />
........... ..................... ..................... .................... ..................... ..................... .................... ........... 34<br />
3.2.44.<br />
Autres iindicateurs<br />
fo onction <strong>de</strong> l’élooignement<br />
au ux gares ......... ..................... .................... ........... 37<br />
3.3. LOCALISATION<br />
DE LA NOUVELLE<br />
RÉÉSIDENCE<br />
ET T CARTES D’A ACCESSIBILITTÉ<br />
DU LEPUR R-CPDT<br />
39<br />
3.4. LOCALISATION<br />
DE LA NOUVELLE<br />
RÉÉSIDENCE<br />
ET T COMPLEXES S RÉSIDENTIIELS<br />
URBAIN NS ...... 40<br />
3.4.11.<br />
Approchhe<br />
par l’évolut tion <strong>de</strong> la poppulation<br />
......... ..................... ..................... .................... ........... 40<br />
3.4.22.<br />
Nombree<br />
<strong>de</strong> nouveaux x logements .. .................... ..................... ..................... .................... ........... 42<br />
3.5. LOCALISATION<br />
DE LA NOUVELLE<br />
RÉÉSIDENCE<br />
PA AR RAPPORT À LA HIÉRARRCHIE<br />
URBAI INE .... 42<br />
3.5.11.<br />
Approchhe<br />
par l’évolut tion <strong>de</strong> la poppulation<br />
......... ..................... ..................... .................... ........... 42<br />
3.5.22.<br />
Nombree<br />
<strong>de</strong> nouveaux x logements .. .................... ..................... ..................... .................... ........... 43<br />
4. Anaalyses<br />
: indicateurs/<br />
/critères eet<br />
développ pement <strong>territorial</strong><br />
duurable<br />
..... ....... 44<br />
4.1. ANALYSE AU<br />
REGARD DES D DOCUMEENTS<br />
D’AMÉNAGEMENT<br />
DU TERRITOIIRE<br />
: SDER ET E<br />
CWATUPE<br />
............ ................... ................... ................... ................... ................... ................... ......... 44
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 4<br />
4.2. ANALYSE AU<br />
REGARD DU D DÉVELOPPPEMENT<br />
DUR RABLE : QUELS<br />
SONT LESS<br />
ÉCLAIRAGE ES DES<br />
DIFFÉRRENTS<br />
INDICCATEURS<br />
PRO OPOSÉS? ..... ................... ................... ................... ................... ......... 45<br />
4.2.11.<br />
Constattations<br />
généra ales ............... .................... ..................... ..................... .................... ........... 45<br />
4.2.22.<br />
Méthodologie<br />
d’analy yse <strong>de</strong>s éclairrages<br />
sur le dé éveloppement t durable ....... .................... ........... 51<br />
5. Connclusions<br />
................ ................ ................ ................ ................ ................ ....... 54<br />
6. Bibbliographiee<br />
.............. ................ ................ ................ ................ ................ ....... 58
1. Inntroducction<br />
Comme ttous<br />
les territtoires,<br />
le terr ritoire wallon évolue, se tr<br />
menées ppar<br />
l’ensemblle<br />
<strong>de</strong>s acteurs s. Alors que laa<br />
Belgique et<br />
du dévelooppement<br />
durrable<br />
au trave ers <strong>de</strong> documeents<br />
officiels<br />
<strong>territorial</strong> <strong>de</strong> la Wallonie<br />
suit égalem ment cette voi<br />
<strong>territorial</strong> durable, l’Obbservatoire<br />
du u Développem<br />
Prospectiive<br />
et <strong>de</strong> la SStatistique<br />
(IW WEPS) tente d<br />
objectifs <strong>de</strong> développeement<br />
durable e.<br />
1 ransforme au moyen <strong>de</strong> ddémarches<br />
et d’actions<br />
la Région wa allonne se sonnt<br />
engagées sur s la voie<br />
, il parait impo ortant d’évaluuer<br />
si le <strong>développement</strong><br />
ie. En mettant<br />
au point un set d’indicateeurs<br />
<strong>de</strong> <strong>développement</strong><br />
ment Territoria al (ODT) <strong>de</strong> l’I Institut Wallonn<br />
<strong>de</strong> l’Evaluat tion, <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong> cerner la dynamique d te erritoriale wallonne<br />
aux reg gards <strong>de</strong>s<br />
Dans ce cadre, l’ODT a déjà traité é <strong>de</strong> la consoommation<br />
d’es space par la fonction résid<strong>de</strong>ntielle<br />
au travers t <strong>de</strong><br />
l’indicateur<br />
<strong>de</strong> l’évoluution<br />
<strong>de</strong> la su uperficie résid<strong>de</strong>ntielle<br />
moy yenne par ha abitant. Ce traavail<br />
a montré<br />
qu’une<br />
tendancee<br />
au <strong>de</strong>sserreement<br />
rési<strong>de</strong>n ntiel avait lieu<br />
sur le territoire<br />
wallon. Après avoir étudié la co omposante<br />
quantitatiive<br />
sur la coonsommation<br />
en ressourcee<br />
foncière, no ous tentons dans d ce travaail-ci<br />
d’appré éhen<strong>de</strong>r la<br />
composaante<br />
spatiale ppar<br />
<strong>de</strong>s indicat teurs <strong>de</strong> posittionnement<br />
da ans la ressour rce foncière.<br />
Le positioonnement<br />
est une notion re elative, il dépeend<br />
<strong>de</strong> la référence<br />
que l’on n choisit. L’obbjectif<br />
<strong>de</strong>s ind dicateurs à<br />
construiree<br />
est d’évaluuer<br />
la localisa ation <strong>de</strong> l’urbbanisation<br />
rés si<strong>de</strong>ntielle réc cente en termmes<br />
<strong>de</strong> <strong>développement</strong><br />
durable ddu<br />
territoire. IIl<br />
est donc né écessaire aupparavant<br />
<strong>de</strong> définir d <strong>de</strong>s critères<br />
<strong>de</strong> locaalisation<br />
optim male <strong>de</strong> la<br />
rési<strong>de</strong>ncee<br />
dans une opptique<br />
<strong>de</strong> déve eloppement duurable.<br />
La note <strong>de</strong> recherchee<br />
<strong>de</strong> la CPD DT (2009) « VVers<br />
un déve eloppement <strong>territorial</strong> te dura rable : Critère es pour la<br />
localisatio ion optimale d<strong>de</strong>s<br />
nouvelles activités » list ste une série <strong>de</strong> d critères qu ui pourraient êêtre<br />
pris en co ompte. De<br />
même, l’aanalyse<br />
multicritères<br />
<strong>de</strong> localisation<br />
durrable<br />
<strong>de</strong> la rés si<strong>de</strong>nce développée<br />
dans l’ ’expertise CPDT-<strong>IWEPS</strong><br />
sur le plaan<br />
<strong>de</strong> secteurr<br />
durable (pro ogramme <strong>de</strong> travail 2009- 2010 et 2010 0-2011) repreend<br />
toute une e série <strong>de</strong><br />
critères qqui<br />
pourraient être utilisés pour p évaluer lee<br />
caractère durable<br />
<strong>de</strong> l’urbanisation<br />
réssi<strong>de</strong>ntielle<br />
réc cente.<br />
Dans la pprésente<br />
étud<strong>de</strong>,<br />
nous nous s intéressonss<br />
essentiellem ment à <strong>de</strong>ux types t <strong>de</strong> critèères<br />
<strong>de</strong> localisation<br />
qui<br />
semblentt<br />
essentiels à prendre en co ompte dans laa<br />
localisation <strong>de</strong>s d activités :<br />
lla<br />
proximité dd’un<br />
centre mu ultifonctionnel<br />
;<br />
ll’accessibilitéé<br />
par les altern natives à la vooiture.<br />
La localissation<br />
rési<strong>de</strong>nntielle<br />
récente e est égalemment<br />
observée e au regard <strong>de</strong> d la structurre<br />
urbaine du u territoire<br />
wallon.<br />
Dans un premier tempps,<br />
les donnée es et la méthoodologie<br />
utilis sées pour loca aliser la nouveelle<br />
rési<strong>de</strong>nce e et définir<br />
les critèrees<br />
<strong>de</strong> localisaation<br />
sont prés sentées. Des iindicateurs<br />
à différentes éc chelles territorriales<br />
sont éla aborés sur<br />
base <strong>de</strong> ces critères et les résulta ats obtenus ssur<br />
le territoir re wallon sont<br />
alors analyssés,<br />
principal lement au<br />
niveau ccommunal.<br />
A cette échelle,<br />
les données<br />
d’urbanisation<br />
sont<br />
complétéees<br />
par <strong>de</strong>s données<br />
démograpphiques.<br />
Enfin,<br />
les indicat teurs construits<br />
sont confr rontés aux ob bjectifs wallons<br />
d’aménagement<br />
du<br />
territoire tels que rensseignés<br />
dans les l documentts<br />
réglementa aires et d’orien ntation. Parcee<br />
que le <strong>développement</strong><br />
durable couvre plusieeurs<br />
piliers (économique,<br />
(<br />
environnemental,<br />
social, , gouvernancce)<br />
et leurs interfaces<br />
(équitablee,<br />
viable, vivaable),<br />
il est utile u et nécesssaire<br />
<strong>de</strong> con nstruire une analyse qui rrévèle<br />
la cap pacité <strong>de</strong>s<br />
indicateurs<br />
à rencontrer<br />
les différentes<br />
dimenssions<br />
du <strong>développement</strong><br />
<strong>territorial</strong> t durrable.<br />
La mét thodologie<br />
proposéee<br />
pour évalueer<br />
la durabilité<br />
d’un indicaateur<br />
est déc crite dans la Brève <strong>de</strong> l’IWWEPS<br />
« Dével loppement<br />
d’indicateeurs<br />
locaux d<strong>de</strong><br />
développe ement territorrial<br />
durable et e évaluation <strong>de</strong> leurs écla lairages » (Reginster<br />
et<br />
Charlier, 2010). L’application<br />
à un <strong>de</strong>s d indicateurrs<br />
est détaillée e dans la <strong>de</strong>rn nière partie <strong>de</strong>e<br />
la présente étu<strong>de</strong>.<br />
é<br />
1<br />
Voir notammment<br />
le texte caadre<br />
<strong>de</strong> la stratégie<br />
nationale <strong>de</strong> <strong>développement</strong> durable<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 5
2. Doonnéess<br />
et mé étho<strong>de</strong>e<br />
2.1. LOCCALISER<br />
LA NNOUVELLE<br />
URBANISATIO<br />
U ON RÉSIDENT TIELLE<br />
2.1.1. SSources<br />
<strong>de</strong>s ddonnées<br />
Les donnnées<br />
les plus ffines<br />
nous permettant<br />
<strong>de</strong> loocaliser<br />
les nouvelles<br />
urbanisations<br />
résii<strong>de</strong>ntielles<br />
trouvent<br />
leur<br />
origine à l’Administratiion<br />
Générale <strong>de</strong> d la Documeentation<br />
Patrim moniale du SP PF Finances (AAGDP/SPFF).<br />
Il I s’agit <strong>de</strong><br />
travailler à l’échelle <strong>de</strong>e<br />
la parcelle ca adastrale.<br />
Depuis qquelques<br />
annéées,<br />
le travail<br />
dans un sysstème<br />
d’infor rmation géographique<br />
(SIGG)<br />
est facilité grâce au<br />
<strong>développement</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>uux<br />
produits qu ui proviennentt<br />
tous <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> e la digitalisati ion <strong>de</strong>s plans cadastraux papiers<br />
:<br />
lle<br />
cadastre nuumérique,<br />
CadMap,<br />
qui estt<br />
réalisé par l’AGDP<br />
et mis à jour chaquue<br />
année (au 1<br />
d<strong>de</strong>puis<br />
2004. Il couvre l’ensemble<br />
<strong>de</strong> la Belgique ;<br />
lle<br />
Plan <strong>de</strong> Loccalisation<br />
Info ormatique (PLII)<br />
<strong>de</strong> la Région<br />
wallonne qu ui est mis à joour<br />
annuellem ment par la<br />
ddirection<br />
<strong>de</strong> la Géomatiq que <strong>de</strong> la DGGO4,<br />
en par rtenariat avec c l’Administraation<br />
du cad dastre, <strong>de</strong><br />
ll'enregistremeent<br />
et <strong>de</strong>s dom maines du SPPF<br />
Finances (S SPFF/AGDP). La L plus anciennne<br />
version du<br />
PLI date<br />
ddu<br />
01/01/20001.<br />
A chaquee<br />
parcelle caddastrée<br />
du te erritoire sont aassociées<br />
plu usieurs inform mations contenues<br />
dans ce e que l’on<br />
appelle laa<br />
matrice cadaastrale,<br />
propriété<br />
<strong>de</strong> l’AGDPP.<br />
Dans ces différents<br />
attrib buts, on trouvve<br />
notamment t :<br />
uun<br />
champ « nnature<br />
», indiquant<br />
la <strong>de</strong>stinnation<br />
principa ale la plus app propriée <strong>de</strong> laa<br />
parcelle (ex. : maison,<br />
fferme,<br />
jardin, pré, bois…) ;<br />
uun<br />
champ « aannée<br />
<strong>de</strong> cons struction du bbâtiment<br />
», ind diquant l’anné ée <strong>de</strong> construcction<br />
<strong>de</strong> la pa arcelle par<br />
uun<br />
premier bââtiment<br />
;<br />
uun<br />
champ « nnombre<br />
<strong>de</strong> logements<br />
».<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 6<br />
Une fois associés aux plans parcellaires<br />
cadastrraux<br />
numériques,<br />
ces diffé érents champss<br />
permettent alors une<br />
localisatioon<br />
<strong>de</strong>s parcellles<br />
ou logeme ents en fonctiion<br />
<strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> d construction<br />
<strong>de</strong> la parceelle.<br />
Il est alors<br />
possible<br />
<strong>de</strong> suivree<br />
spatialementt<br />
l’évolution <strong>de</strong><br />
l’urbanisatioon<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
<strong>de</strong>puis 193 31.<br />
L’<strong>IWEPS</strong> a obtenu <strong>de</strong> l’AGDP <strong>de</strong>s données séleectives<br />
issues<br />
<strong>de</strong> la matr rice cadastralle<br />
pour la Wallonie<br />
au<br />
01/01/20009.<br />
Les données<br />
reçues so ont l’année <strong>de</strong>e<br />
construction n, le nombre <strong>de</strong> d logements eet<br />
la nature cadastrale.<br />
L’associaation<br />
<strong>de</strong> l’information<br />
matricielle<br />
aux plaans<br />
parcellaires<br />
cadastraux x numériquess<br />
n’était pas évi<strong>de</strong>nte é à<br />
réaliser eet<br />
<strong>de</strong>mandait un certain ne ettoyage <strong>de</strong> laa<br />
base <strong>de</strong> do onnées. Ce tra avail <strong>de</strong> nettooyage<br />
a été réalisé r par<br />
certainess<br />
équipes <strong>de</strong> la CPDT (LEP PUR et CREATT)<br />
qui nous ont o cordialement<br />
transmis leur savoir-faire<br />
en la<br />
matière.<br />
La <strong>de</strong>rnièère<br />
version duu<br />
PLI disponib ble en avril 22010<br />
étant la situation au 01/01/2008 ( (PLI-v07), il n’était n pas<br />
possible <strong>de</strong> coupler lees<br />
information ns <strong>de</strong> la matrrice<br />
au 01/01/2009<br />
avec ce c fond vectooriel.<br />
Ayant eu<br />
l’accord<br />
d’obtenir le CadMap aau<br />
01/01/2009,<br />
nous avonns<br />
donc décid dé d’utiliser ce e <strong>de</strong>rnier pouur<br />
réaliser not tre travail.<br />
Nous cheerchons<br />
à étuudier<br />
la localis sation <strong>de</strong> l’urrbanisation<br />
ré ési<strong>de</strong>ntielle « récente ». Daans<br />
cette optique,<br />
nous<br />
avons décidé<br />
d’étudierr<br />
la localisatio on <strong>de</strong>s parcellles<br />
rési<strong>de</strong>ntielles<br />
bâties entre<br />
le 01/01/22001<br />
et le 31/12/2008,<br />
soit une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 8 ans. Cette pé ério<strong>de</strong> corresppond<br />
notamm ment à la pério o<strong>de</strong> utilisée paar<br />
l’<strong>IWEPS</strong> po our étudier<br />
l’évolution<br />
<strong>de</strong> la superrficie<br />
rési<strong>de</strong>nt tielle par habbitant<br />
(Charlier<br />
et Reginster,<br />
2010). Remmarquons<br />
tout tefois que<br />
1 er<br />
janvier)
selon la CCPDT<br />
sur les ca<br />
2 , la quallité<br />
géométriq<br />
artes IGN au 1/10<br />
000 3<br />
que et topologique<br />
du CadM Map est moins s bonne que ccelle<br />
du PLI, qui<br />
est calé<br />
.<br />
2.1.2. LLimites<br />
dans l’utilisation <strong>de</strong> es données ccadastrales<br />
et t approches possibles p pourr<br />
étudier la lo ocalisation<br />
<strong>de</strong> la nouuvelle<br />
rési<strong>de</strong>ncce<br />
L’informaation<br />
donnée par la matrice<br />
cadastrale<br />
sur la nature<br />
<strong>de</strong>s parc celles ne reflète<br />
pas toujo ours avec<br />
exactitu<strong>de</strong><br />
les occupattions<br />
réelles du<br />
sol car :<br />
d<strong>de</strong>s<br />
natures peuvent relev ver <strong>de</strong> la <strong>de</strong>stination<br />
d'un n bien et non<br />
<strong>de</strong> l'utilisat ation réelle (m maison <strong>de</strong><br />
ccommerce<br />
utilisée<br />
uniquem ment comme llogement<br />
par exemple) ;<br />
d<strong>de</strong>s<br />
parcelles peuvent accueillir<br />
<strong>de</strong>s acttivités<br />
différen ntes, au sein d’un même immmeuble<br />
par r exemple.<br />
CC’est<br />
la foncttion<br />
dominant te, appréciée par un exper rt selon <strong>de</strong>s termes t normaalisés,<br />
qui dét termine la<br />
nnature<br />
cadasttrale<br />
(exemple e : dans les vvilles,<br />
il est fr réquent <strong>de</strong> tro ouver <strong>de</strong>s apppartements<br />
aux a étages<br />
dd’un<br />
rez commmercial)<br />
;<br />
ccompte<br />
tenu d’une réducti ion en moyenns<br />
humains <strong>de</strong> e l’Administra ation du cadasstre,<br />
il peut y avoir <strong>de</strong>s<br />
ddélais<br />
<strong>de</strong> misse<br />
à jour entre e le changemment<br />
<strong>de</strong> fait su ur le terrain et t son inscripttion<br />
au cadast tre (CPDT,<br />
22008).<br />
Normaalement,<br />
l’inf formation caddastrale<br />
est mise à jour continuellement<br />
et les st tatistiques<br />
ggénérales<br />
acttualisées<br />
chaq que année (Brrück<br />
et al., 2005)<br />
;<br />
lles<br />
natures caadastrales<br />
et le nombre <strong>de</strong> logements ne e sont pas tou ujours mis à joour,<br />
le cadast tre n’étant<br />
pparfois<br />
pas innformé<br />
<strong>de</strong>s modifications<br />
m au sol ou <strong>de</strong>s<br />
transformat tions d’immeuubles<br />
réalisée es par les<br />
ppropriétaires.<br />
La qualité<br />
<strong>de</strong>s donnéees<br />
<strong>de</strong> la matrice<br />
cadastraale<br />
au 01/01/ 2001 a été testée<br />
par l’éqquipe<br />
en cha arge <strong>de</strong> la<br />
réalisation<br />
<strong>de</strong> la Cartoggraphie<br />
Numé érique <strong>de</strong> l’Occcupation<br />
du Sol S en Wallon nie (CNOSW, MMRW-FUSAGx<br />
x, 2007). Il<br />
ressort qque<br />
87,3% d<strong>de</strong>s<br />
parcelles s contrôlées possè<strong>de</strong>nt une<br />
nature co orrecte ou reeprise<br />
dans le même<br />
groupemeent<br />
(CPDT, 20008).<br />
Suite à cees<br />
limites, <strong>de</strong>uux<br />
approches peuvent être envisagées :<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 7<br />
éétudier<br />
l’enseemble<br />
<strong>de</strong>s pa arcelles récemmment<br />
bâties s et dont la nature n cadasttrale<br />
correspo ond à une<br />
aactivité<br />
rési<strong>de</strong>entielle<br />
(= nom mbre <strong>de</strong> bâtimments<br />
nouveau ux affectés à la rési<strong>de</strong>nce) ;<br />
éétudier<br />
l’enseemble<br />
<strong>de</strong>s parcelles<br />
récemmment<br />
bâties qui<br />
accueillent un ou <strong>de</strong>s loggements.<br />
La premièère<br />
approche ne donne pas s d’informatioons<br />
sur le nom mbre <strong>de</strong> logem ments. Pour lees<br />
nombreux logements<br />
unifamiliaaux,<br />
cela ne ppose<br />
pas <strong>de</strong> problème<br />
maiss<br />
l’imprécision n peut être gr ran<strong>de</strong> une foiss<br />
que cela con ncerne les<br />
immeublees<br />
à appartements,<br />
qui sont<br />
alors souus-estimés<br />
au u regard <strong>de</strong> la population n supplémenta aire qu’ils<br />
apportentt.<br />
De plus, ceertaines<br />
parce elles <strong>de</strong> naturee<br />
non rési<strong>de</strong>n ntielle recensé ées comme teelles<br />
dans la matrice m et<br />
qui possèè<strong>de</strong>nt<br />
<strong>de</strong>s loggements<br />
aux étages ne soont<br />
pas prises<br />
en compte (exemple : loogement<br />
au-d <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong><br />
maisons <strong>de</strong> commercee).<br />
La <strong>de</strong>uxièème<br />
approchee<br />
permet <strong>de</strong> travailler t sur lle<br />
nombre <strong>de</strong> logements et t <strong>de</strong> tenir commpte<br />
<strong>de</strong> l’ense emble <strong>de</strong>s<br />
natures ccadastrales<br />
(exemple<br />
: une parcelle <strong>de</strong> nnature<br />
cadastr rale non rési<strong>de</strong>ntielle<br />
peut aaccueillir<br />
un logement).<br />
2<br />
Note <strong>de</strong> l’ Etat du Territoiree<br />
Wallon (ETW) d’avril<br />
2010 intituulée<br />
« PLI vs CadM Map »<br />
3<br />
Les parceelles<br />
du cadastree<br />
numérique ont en effet été disssociées<br />
en planch hes lors du traite ement <strong>de</strong> l’informmation,<br />
et leur re egroupement<br />
entraine <strong>de</strong>e<br />
nombreuses errreurs<br />
topologiques<br />
au niveau <strong>de</strong>ss<br />
limites (superposition<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ux parcelles p adjacenntes<br />
ou interstice e entre <strong>de</strong>ux<br />
parcelles). Environ 300 0000<br />
erreurs <strong>de</strong> ce ty ype ont été dénombrées<br />
par l’équ uipe <strong>de</strong> l’ETW sur<br />
un total <strong>de</strong> 3,8 millions <strong>de</strong> parc celles.
Par contrre,<br />
si on veut ttravailler<br />
sur les l superficiess<br />
<strong>de</strong>s parcelle es, cette appro oche semble moins pertine ente car la<br />
superficiee<br />
totale <strong>de</strong> la parcelle qui accueille a le loogement<br />
n’est t pas uniquem ment dédiée à l’activité rés si<strong>de</strong>ntielle,<br />
et dans ccertains<br />
cas, ccette<br />
superficie<br />
est essentiiellement<br />
dédiée<br />
à l’activité é principale reecensée<br />
sur la<br />
parcelle<br />
et non à l’activité rési<strong>de</strong>ntielle<br />
(exe emple : une pparcelle<br />
accue eillant une éco ole, consommmatrice<br />
d’espa ace, et un<br />
logementt).<br />
Une troissième<br />
approchhe<br />
nous semble<br />
dès lors intéressante à envisager, particulièremment<br />
pour le calcul c <strong>de</strong>s<br />
nouvelless<br />
superficies occupées pa ar la rési<strong>de</strong>ncce.<br />
En effet, l’approche du<br />
nombre <strong>de</strong>e<br />
logements considère<br />
l’ensembble<br />
<strong>de</strong>s naturees<br />
cadastrale es qui ont acccueilli<br />
un log gement. Or, certaines <strong>de</strong> ces natures sont non<br />
rési<strong>de</strong>ntieelles<br />
et peuveent<br />
influencer r largement laa<br />
superficie <strong>de</strong> d la parcelle construite (eexemple<br />
: une e école au<br />
sein <strong>de</strong> laaquelle<br />
un loggement<br />
a été construit pouur<br />
le concierge).<br />
Il semble donc d préférabble<br />
<strong>de</strong> n’utiliser<br />
que les<br />
parcelles construites ppendant<br />
la pé ério<strong>de</strong> <strong>de</strong> réféérence<br />
qui so ont <strong>de</strong> nature rési<strong>de</strong>ntielle et qui accue eillent <strong>de</strong>s<br />
nouveauxx<br />
logements loorsque<br />
nous travaillons<br />
spéécifiquement<br />
sur s les superficies<br />
rési<strong>de</strong>nttielles.<br />
2.1.2.1.<br />
Pour locaaliser<br />
les terraains<br />
récemment<br />
urbanisés p<br />
SPF Finaances,<br />
qui coonstitue<br />
le ca adastre numé<br />
« Nature » et « Année <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong>s bâtim<br />
occupéess<br />
par l’activitéé<br />
rési<strong>de</strong>ntielle e<br />
bâties. Ennfin,<br />
l’année <strong>de</strong> constructi<br />
rési<strong>de</strong>ntieelles<br />
bâties enntre<br />
le 01/01/<br />
4 par la rési<strong>de</strong>n nce, nous som mmes partis <strong>de</strong>e<br />
la couche CadMap<br />
du<br />
érique. Nous lui avons jo oint les informmations<br />
<strong>de</strong> la<br />
matrice<br />
ments ». De là à, nous avons s pu isoler l’eensemble<br />
<strong>de</strong>s parcelles<br />
. Parmi ces parcelles rés si<strong>de</strong>ntielles, nous<br />
avons séélectionné<br />
les s parcelles<br />
on du bâtimeent<br />
<strong>de</strong> la parc celle nous a permis d’indivvidualiser<br />
les s parcelles<br />
2001 et le 31/12/2008,<br />
soit<br />
une pério<strong>de</strong> e <strong>de</strong> 8 ans.<br />
Les natuures<br />
considérrées<br />
sont les s suivantes : BARAQUEM. ; SUP.BAT.O O ; SUP.BAT.AA<br />
; TAUDIS ; GARAGE ;<br />
JARDIN ; PART.COMMM.<br />
; SUP.& P. .C. ; MAISON ; MAISON# ; BUILDING ; COUR ; P.P.IIM.AP.<br />
; PRES SBYTERE ;<br />
REMISE ; LAVATORY ; CHÂTEAU ; AB BRI ; P.IM.AP. #.<br />
Elles conncernent<br />
doncc<br />
les parcelle es qui accueiillent<br />
les loge ements mais aussi leurs aannexes<br />
bâtie es (cours,<br />
garages, remises…).<br />
Avec l’utiilisation<br />
<strong>de</strong> ceette<br />
méthodol logie, nous poouvons<br />
dire qu’entre q le 01/01/2001<br />
et le 31/12/2008,<br />
60 950<br />
bâtimentss<br />
ont été connstruits<br />
sur <strong>de</strong>s d parcelles <strong>de</strong> nature ré ési<strong>de</strong>ntielle en<br />
Wallonie, ssoit<br />
en moyenne<br />
7619<br />
bâtimentss<br />
par an.<br />
Comme eexpliqué<br />
ci-<strong>de</strong>essus,<br />
ce chif ffre ne corresspond<br />
pas au nombre <strong>de</strong> bâtiments b acccueillant<br />
<strong>de</strong>s logements<br />
puisqu’il peut s’agir <strong>de</strong>e<br />
garages, ab bris, remises……<br />
De même, il ne correspo ond pas à l’ennsemble<br />
<strong>de</strong>s bâtiments<br />
accueillannt<br />
<strong>de</strong>s logements<br />
puisque certains logeements<br />
ont pu u être constru uits sur <strong>de</strong>s pparcelles<br />
<strong>de</strong> nature n non<br />
rési<strong>de</strong>ntieelle.<br />
2.1.2.2.<br />
Approche « nombre <strong>de</strong> no ouveaux bâtimments<br />
affectés s à la rési<strong>de</strong>nc ce »<br />
Approche « nombre <strong>de</strong> log ogements »<br />
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 8<br />
Avec cettte<br />
approche, nous sélectionnons<br />
parmmi<br />
l’ensemble <strong>de</strong>s parcelles<br />
bâties entrre<br />
le 01/01/2 2001 et le<br />
31/12/20008<br />
celles où ssont<br />
répertoriés<br />
un ou plussieurs<br />
logeme ents. On ne tie ent dès lors plus<br />
compte <strong>de</strong> e la nature<br />
cadastralle<br />
principale d<strong>de</strong>s<br />
parcelles.<br />
4<br />
La catégoorisation<br />
<strong>de</strong>s natures<br />
cadastrales s rési<strong>de</strong>ntielles eest<br />
issue <strong>de</strong>s travaux<br />
<strong>de</strong> l’Etat du u territoire Walloon<br />
<strong>de</strong> la CPDT su ur les cartes<br />
d’occupatioon<br />
du sol. Référeence<br />
: CPDT, 2008.<br />
Fiche d’évol olution <strong>de</strong> l’occup pation du sol : Note N méthodologi gique et Fiche d’ ’évolution <strong>de</strong><br />
l’occupatioon<br />
du sol : Régionn<br />
Wallonne, http:/ //cpdt.wallonie.bbe/?id_page=71
WORKING PAPER DDE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 2011 2 | N°2 | 9<br />
Plusieurss<br />
inconvénientts<br />
sont cepen ndant liés à ceette<br />
approche e. L’informatio on donnée paar<br />
la matrice cadastrale c<br />
sur le noombre<br />
<strong>de</strong> logeements<br />
par parcelle p est uune<br />
approxima ation <strong>de</strong> la ré éalité. Elle peeut<br />
s’en éloigner<br />
car la<br />
situation déclarée peeut<br />
être très différente d<strong>de</strong><br />
la situatio on réelle. Le e nombre <strong>de</strong>e<br />
logements est ainsi<br />
probablemment<br />
sous-esstimé,<br />
en part ticulier en miilieu<br />
urbain, où o une croiss sance du nommbre<br />
<strong>de</strong> logem ments par<br />
bâtiment intervient soouvent<br />
sans que q l’adminisstration<br />
du ca adastre en so oit informée. Dans certain ns milieux<br />
ruraux paar<br />
contre, less<br />
logements recensés r peuuvent<br />
correspondre<br />
à <strong>de</strong>s rési<strong>de</strong>nces ssecondaires,<br />
inhabitées i<br />
pendant lla<br />
majeure paartie<br />
<strong>de</strong> l’année,<br />
ce qui ne ccorrespond<br />
pa as exactement t à la cible <strong>de</strong> notre recherc che.<br />
Le LEPURR-CPDT<br />
avait au préalable e nettoyé l’infformation<br />
con ncernant le lo ogement afin d’obtenir une e base <strong>de</strong><br />
données utilisable. Enn<br />
termes <strong>de</strong> précision, p seuules<br />
quelques erreurs ponc ctuelles subsiistent<br />
encore. . Celles-ci<br />
concerneent<br />
un nombre<br />
très limité é d’équipemeents<br />
touristiq ques. En effe et, certains ccomplexes<br />
ré ési<strong>de</strong>ntiels<br />
touristiquues<br />
sont reppris<br />
dans la nature cadastrale<br />
P.IM. .AP, nature similaire auxx<br />
réels imm meubles à<br />
appartemments<br />
(CPDT, 2010a). Tout tefois, ces quuelques<br />
erreurs<br />
(localisées s à Nassognee,<br />
Membre-su ur-Semois,<br />
Grand-Haalleux<br />
ou enttre<br />
Trois-Ponts<br />
et Staveloot)<br />
semblent négligeables en nombre <strong>de</strong> cas (CPD DT, 2010,<br />
communiication<br />
orale).<br />
Après la sélection <strong>de</strong>es<br />
parcelles, il apparaît que 1134 parcelles<br />
cons struites entree<br />
le 01/01/20 001 et le<br />
31/12/20008,<br />
qui <strong>de</strong>vvraient<br />
être occupées o par<br />
<strong>de</strong>s logem ments car elles<br />
ont une nature telle (maison,<br />
appartemment…),<br />
ne coomportent<br />
pa as <strong>de</strong> logemennt.<br />
Il est décidé<br />
d’attribuer r le nombre d<strong>de</strong><br />
1 logemen nt à toutes<br />
ces parceelles.<br />
Une autree<br />
remarque peeut<br />
être faite sur s la date doont<br />
on dispose e et qui fait réf férence à l’annnée<br />
<strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong><br />
la parcelle.<br />
Il ne s’agit<br />
donc pas <strong>de</strong> d la date <strong>de</strong>e<br />
construction n du logemen nt. Il est posssible<br />
que <strong>de</strong>s parcelles<br />
construitees<br />
avant 20011<br />
aient accuei illi <strong>de</strong>s logemeents<br />
après 20 001. Ces logem ments ne sontt<br />
donc pas rec censés.<br />
Suite à l’ensemble<br />
<strong>de</strong>e<br />
ces élémen nts, il semblee<br />
que la méthodologie<br />
cho oisie ici souss-estime<br />
le nombre<br />
<strong>de</strong><br />
logementts<br />
réellement créés entre le e 01/01/2001 et le 31/12/2 2008.<br />
Au total, après traitemments<br />
et extrac ctions, on peuut<br />
considérer que 72 921 logements<br />
ontt<br />
été créés en n Wallonie<br />
entre le 001/01/2001<br />
eet<br />
le 31/12/20 008, soit en mmoyenne<br />
911 15 par an. Plu us précisémeent,<br />
on <strong>de</strong>vrait t dire que<br />
72 921 loogements<br />
exiistent<br />
(on ne sait pas si ills<br />
ont été cré éés réellemen nt) sur 57 3655<br />
parcelles construites c<br />
pendant lla<br />
pério<strong>de</strong> connsidérée.<br />
Parmi cees<br />
57 365 parcelles,<br />
447 ne sont pas <strong>de</strong> nature rési<strong>de</strong>ntielle<br />
mais<br />
accueillennt<br />
quand mêm me un ou<br />
plusieurs logements.
2.1.2.3.<br />
Tableau <strong>de</strong> ssynthèse<br />
et approches a chooisies<br />
Tableau 1 : Tableau d<strong>de</strong><br />
synthèse <strong>de</strong>s d approchees<br />
<strong>de</strong> la localisation<br />
résid <strong>de</strong>ntielle réceente<br />
Approchees<br />
<strong>de</strong> la localisaation<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
Séélection<br />
<strong>de</strong>s parc celles<br />
Evolution eentre<br />
le 01/01/20 001 et le<br />
récentee<br />
cadastrales<br />
31/12/2008<br />
Nombre <strong>de</strong>e<br />
nouveaux bâtiiments<br />
sur <strong>de</strong>s Parcelless<br />
récemment bâties<br />
<strong>de</strong> 60 6 950 bâtimentss<br />
construits sur <strong>de</strong>s d parcelles<br />
parcelles d<strong>de</strong><br />
nature rési<strong>de</strong>entielle<br />
nature réési<strong>de</strong>ntielle<br />
<strong>de</strong> d nature rési<strong>de</strong>nntielle<br />
Nombre <strong>de</strong>e<br />
logements surr<br />
<strong>de</strong>s parcelles Parcelless<br />
récemment bâties<br />
et 72 7 921 logementts<br />
sur 57 365 parcelles<br />
récemmennt<br />
bâties<br />
accueillaant<br />
un ou <strong>de</strong>s logements<br />
construites c<br />
Superficie rési<strong>de</strong>ntielle<br />
Parcelless<br />
récemment bâties<br />
<strong>de</strong><br />
nature réési<strong>de</strong>ntielle<br />
et acc cueillant un<br />
ou <strong>de</strong>s loogements<br />
56 5 931 parcelles s construites sur 7048 ha<br />
Source : SPPF<br />
Finances-AGDPP<br />
Dans la ssuite<br />
<strong>de</strong> ce travail,<br />
les app proches du noombre<br />
<strong>de</strong> nou uveaux logeme ents et <strong>de</strong> la superficie co onsommée<br />
sont les pplus<br />
utilisées ccar<br />
elles sont plus appropriées<br />
à notre objectif. o<br />
2.1.3. AAutres<br />
donnéees<br />
<strong>de</strong> cadrage e<br />
Une autrre<br />
approche <strong>de</strong> la localisation<br />
<strong>de</strong> l’ ’urbanisation<br />
l’interméddiaire<br />
<strong>de</strong> la poopulation<br />
et <strong>de</strong><br />
ses mouvemments.<br />
Par rappoort<br />
aux données<br />
du cadastr re, nous voyonns<br />
cependant <strong>de</strong>ux limites :<br />
iil<br />
n’est pas poossible<br />
<strong>de</strong> me esurer préciséément<br />
les mouvements<br />
<strong>de</strong> population daans<br />
l’espace puisque p la<br />
pplus<br />
petite entité<br />
spatiale pour p laquelle oon<br />
dispose <strong>de</strong> e données est le secteur staatistique<br />
;<br />
ll’utilisation<br />
<strong>de</strong>e<br />
la donnée « population » nne<br />
fait plus di irectement réf férence à unee<br />
consommati ion en sol.<br />
UUne<br />
évolution<br />
positive <strong>de</strong> d la populaation<br />
n’engendre<br />
pas né écessairemennt<br />
une croiss sance <strong>de</strong><br />
ll’urbanisation<br />
ou du nomb bre <strong>de</strong> logemeents<br />
(cas d’un ne croissance e naturelle paar<br />
exemple). De D même,<br />
uune<br />
baisse d<strong>de</strong><br />
population n n’est généralement<br />
pas s accompagn née d’une baaisse<br />
<strong>de</strong> l’urb banisation<br />
ppuisqu’il<br />
s’agit<br />
d’un phénomène<br />
largemeent<br />
irréversibl le. Cependant t, dans la pluppart<br />
<strong>de</strong>s cas, les l entités<br />
qqui<br />
connaissent<br />
une croissance<br />
<strong>de</strong> leur population<br />
connaisse ent égalemennt<br />
une crois ssance <strong>de</strong><br />
ll’urbanisation,<br />
surtout si la croissance esst<br />
d’origine migratoire. m<br />
2.2. CRIITÈRES<br />
DE LOCALISATION<br />
N<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
La question<br />
à se poseer<br />
ici est la suivante s : queels<br />
sont les critères c les plus<br />
favorabless<br />
pour localis ser le plus<br />
durablemment<br />
possible la rési<strong>de</strong>nce ?<br />
La réponsse<br />
à cette question<br />
<strong>de</strong>man n<strong>de</strong> un long trravail<br />
car pou ur tous les critères<br />
<strong>de</strong> locaalisation<br />
exista ants et les<br />
seuils séélectionnés,<br />
il<br />
faudrait év valuer leur ddurabilité<br />
en tenant comp pte <strong>de</strong>s difféérentes<br />
dimen nsions du<br />
<strong>développement</strong><br />
durable.<br />
Nous avoons<br />
donc choissi<br />
<strong>de</strong> nous con ncentrer ici suur<br />
<strong>de</strong>ux group pes <strong>de</strong> critères s nous paraisssant<br />
les plus essentiels<br />
au vu nottamment<br />
<strong>de</strong>s défis climatiq ques et énerggétiques<br />
auxq quels nos sociétés<br />
sont acttuellement<br />
confrontées.<br />
Ces critèrres<br />
sont égaleement<br />
en lien avec un <strong>de</strong>s grands object tifs du SDER qui q vise à struucturer<br />
l’espac ce wallon,<br />
notammeent<br />
par une <strong>de</strong>ensification<br />
<strong>de</strong> e l’urbanisatioon<br />
autour <strong>de</strong>s lieux centraux x.<br />
Dans ce ttravail,<br />
nous aallons<br />
nous int téresser à <strong>de</strong>uux<br />
groupes <strong>de</strong> e critères <strong>de</strong> localisation<br />
:<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 10<br />
récente peuut<br />
être effec ctuée par<br />
lla<br />
proximité d’un centre multifonctionnnel,<br />
assimilé é dans ce tra avail à l’appaartenance<br />
à un noyau<br />
dd’habitat<br />
;
aautour<br />
<strong>de</strong> la mmobilité<br />
durab ble : l’accessiibilité<br />
par les alternatives à la voiture quui<br />
est synthét tisée avec<br />
ddifférentes<br />
altternatives<br />
et pondérations.<br />
p<br />
Des critères<br />
plus macrro<br />
comme la localisation<br />
paar<br />
rapport à la a hiérarchie urbaine<br />
et aux complexes ré ési<strong>de</strong>ntiels<br />
urbains ssont<br />
égalemeent<br />
étudiés à l’échelle ccommunale.<br />
A cette éche elle, nous coombinons<br />
les données<br />
« urbanissation<br />
» à <strong>de</strong>s données dém mographiques. .<br />
2.2.1. PProximité<br />
d’unn<br />
centre multif fonctionnel<br />
Un centree<br />
multifonctionnel<br />
peut être e considéré coomme<br />
un lieu u central ayan nt fonction <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s biens<br />
et/ou<br />
<strong>de</strong>s servvices<br />
variés à sa zone d’ influence et aux personnes/entreprises<br />
fréquentantt<br />
ce lieu. Le es centres<br />
fonctionnnels<br />
peuvent êêtre<br />
hiérarchisés<br />
en fonctiion<br />
<strong>de</strong> la qua alité et <strong>de</strong> la quantité <strong>de</strong>s services/bien ns fournis.<br />
Fréquemment,<br />
les biens<br />
et services s <strong>de</strong> niveau innférieur<br />
(biens<br />
et services les plus ubiqquistes)<br />
sont offerts o par<br />
les lieux qqui<br />
offrent ceux<br />
<strong>de</strong> niveau supérieur (exeemple<br />
: un ce entre qui offre un cinéma poossè<strong>de</strong>ra<br />
fréq quemment<br />
<strong>de</strong>s services<br />
<strong>de</strong> niveauu<br />
inférieur com mme une boullangerie<br />
ou un ne banque).<br />
Par extennsion,<br />
la notioon<br />
<strong>de</strong> centre multifonctionn<br />
m nel peut impliq quer, en plus <strong>de</strong> la présencce<br />
d’équipements<br />
et <strong>de</strong><br />
services ddivers<br />
et <strong>de</strong> ccommerces,<br />
la a présence <strong>de</strong>e<br />
lieux publics,<br />
d’éléments symboliques s eet<br />
patrimoniau ux.<br />
L’espace polarisé par uun<br />
centre peu ut être appelé zone d’influence.<br />
En génér ral, l’attractionn<br />
décroît régu ulièrement<br />
avec l’élooignement<br />
du centre vers la<br />
périphérie. Souvent plus un centre est t bien équipé (en quantité, qualité et<br />
mixité) auu<br />
plus son airee<br />
d’influence est vaste.<br />
La fonction<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
ne peut t être considdérée<br />
comme e fournissant <strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong>s services.<br />
Une<br />
concentraation<br />
<strong>de</strong> l’habbitat<br />
en un lieu u ne constituee<br />
donc pas un n centre fonct tionnel. Cepenndant,<br />
lorsqu’il<br />
y a une<br />
certaine cconcentration<br />
<strong>de</strong> l’habitat, on y trouve frréquemment<br />
<strong>de</strong>s d fournisseu urs <strong>de</strong> biens eet<br />
services.<br />
Il n’est paas<br />
aisé <strong>de</strong> dééfinir<br />
les centres<br />
multifoncttionnels<br />
pour l’ensemble <strong>de</strong> d la Walloniee.<br />
Cela nécess siterait un<br />
relevé prrécis<br />
<strong>de</strong> l’enssemble<br />
<strong>de</strong>s lieux<br />
fournisseeurs<br />
<strong>de</strong> biens s et services. . Les différenntes<br />
tentatives<br />
existant<br />
actuellemment<br />
pour défiinir<br />
et délimite er ces lieux ssont<br />
présentée es dans les se ections suivanntes.<br />
Dans ce travail-ci,<br />
les centrees<br />
multifonctioonnels<br />
sont approximés<br />
à lla<br />
notion <strong>de</strong> « noyaux d’hab bitat ».<br />
2.2.1.1.<br />
Le conceept<br />
<strong>de</strong> noyau dd’habitat<br />
est intiment i lié à celui d’agglo omération. On relève différeentes<br />
définitio ons et <strong>de</strong>s<br />
approchees<br />
régionales ddu<br />
concept <strong>de</strong> epuis 1975 (YY.Delforge<br />
et G.Géron, G 2008 8). Toutes les définitions s’ accor<strong>de</strong>nt<br />
pour dire qu’il s’agit d’une<br />
concentr ration <strong>de</strong> l’habbitat<br />
en oppos sition à l’habitat<br />
dispersé. Les différences<br />
portent<br />
essentielllement<br />
sur lees<br />
critères <strong>de</strong><br />
délimitationns<br />
(uniqueme ent morpholog giques ou coombinaison<br />
<strong>de</strong><br />
critères<br />
morpholoogiques<br />
et fonctionnels)<br />
et les l seuils utilisés.<br />
2.2.1.1.11.<br />
Définitionss<br />
<strong>de</strong> l’INS (Inst titut National d<strong>de</strong><br />
Statistique e 5 )<br />
Au niveauu<br />
fédéral, le cconcept<br />
corres spond à celui d’agglomérat tion morpholo ogique. Il a étéé<br />
abordé en profon<strong>de</strong>ur p<br />
par l’INS. . D’après la ddéfinition<br />
qu’e en donnait l’INNS<br />
à l’époque e (Van <strong>de</strong>r Ha aegen et al., 11981,<br />
p.266) , le noyau<br />
d’habitat ou l’aggloméération<br />
morphologique<br />
« coorrespond<br />
à une u partie du territoire cont ntenant un ens semble <strong>de</strong><br />
maisons avoisinantes et leurs jardin ns, d’édifices s publics, <strong>de</strong> petits p établisse ements indusstriels<br />
ou com mmerciaux,<br />
ainsi que e les voies <strong>de</strong> communicatio on, les parcs, les terrains <strong>de</strong> d sport, etc. Il I est délimité é par <strong>de</strong>s terre es arables,<br />
5<br />
Les différenntes<br />
définitions s et délimitatiions<br />
<strong>de</strong>s noya aux d’habitat<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 11<br />
L’INS est <strong>de</strong>venue aujourdd’hui<br />
la Direction générale Statisttique<br />
et Information<br />
économique (DGSIE) du SPF EEconomie.
<strong>de</strong>s bois, , <strong>de</strong>s terres inncultes,<br />
éven ntuellement paarsemés<br />
d’ha abitations disp persées. Les vvilles,<br />
les villa lages, tout<br />
comme lees<br />
hameaux ppeuvent<br />
const tituer <strong>de</strong>s noyyaux<br />
d’habitat t. Ceux-ci peu uvent égalemeent<br />
prendre la a forme <strong>de</strong><br />
constructtions<br />
s’étendaant<br />
en rubans s le long <strong>de</strong>s ro routes, phénom mène très cou urant dans nootre<br />
pays. » Le es travaux<br />
<strong>de</strong> l’INS oont<br />
permis <strong>de</strong>e<br />
délimiter spatialement<br />
less<br />
noyaux d’ha abitat pour 19 970, 1981 et 2001. Il s’agit<br />
d’unités<br />
morpholoogiques<br />
découulant<br />
<strong>de</strong> la réu union d’un ou plusieurs sec cteurs statistiq ques.<br />
Le critèree<br />
<strong>de</strong> délimitatiion<br />
<strong>de</strong> 1981 correspond c à uun<br />
critère <strong>de</strong> continuité c du bâti.<br />
En 2001, on a conservvé<br />
la délimitat tion <strong>de</strong> 1981 en ajoutant le es secteurs st tatistiques d’aau<br />
moins 150 habitants<br />
et en effeectuant<br />
un ratttachement<br />
aux<br />
noyaux lorrsque<br />
la continuité<br />
du bâti (200 m sans interruption) a lieu sur<br />
tout un frront<br />
<strong>de</strong> voirie oou<br />
par plusieu urs voies. (Vann<br />
Hecke et al. ., 2009)<br />
2.2.1.1.22.<br />
Au niveau régional : cod <strong>de</strong> wallon du lo logement et DPR D<br />
Un <strong>de</strong>s objectifs<br />
<strong>de</strong> la définition <strong>de</strong>s<br />
noyaux d’haabitat<br />
est lié à la politique du logement t et se retrouv ve dans le<br />
Co<strong>de</strong> Wallon<br />
du Logemment.<br />
La Région<br />
et les autrres<br />
autorités publiques p veulent<br />
mettre enn<br />
place <strong>de</strong>s actions a qui<br />
« ten<strong>de</strong>ntt<br />
à favoriser la cohésion sociale par la stimulatio on <strong>de</strong> la rén novation du ppatrimoine<br />
et t par une<br />
diversificcation<br />
et un aaccroissemen<br />
nt <strong>de</strong> l’offre d<strong>de</strong><br />
logements s dans les no oyaux d’habit itat. » (Co<strong>de</strong> Wallon W du<br />
Logemennt,<br />
version officieuse<br />
du 1 aout a 2009, artticle<br />
2).<br />
Les noyaaux<br />
d’habitat ccorrespondrai<br />
ient donc à d<strong>de</strong>s<br />
parties du u territoire qui<br />
recevraient <strong>de</strong>s ai<strong>de</strong>s. Un n article a<br />
été introdduit<br />
dans le CCo<strong>de</strong><br />
(article 19<br />
du décret ddu<br />
20 juillet 2005) 2 et définit<br />
les noyaux d’habitat com mme « <strong>de</strong>s<br />
zones gééographiques<br />
où sont renc contrés, sur lla<br />
base <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’Institut natioonal<br />
<strong>de</strong> statis stique, un<br />
nombre mminimal<br />
et uune<br />
<strong>de</strong>nsité d’habitants d arrrêtés<br />
par le Gouvernemen nt ou qui réppon<strong>de</strong>nt<br />
à <strong>de</strong> es critères<br />
environneementaux,<br />
d’aaménagement<br />
nt du territoire et d’urbanism me déterminés s par le Gouveernement<br />
».<br />
A ce jourr,<br />
aucun critère<br />
n’a encore e été adopté par un Gouve ernement mais<br />
la réflexionn<br />
est en cours s. Dans la<br />
DPR (16 juillet 2009) , le Gouverne ement prend un certain nombre n d’eng gagements enn<br />
lien avec le es noyaux<br />
d’habitat. . Les engagemments<br />
concern nent les politiqques<br />
du logem ment et <strong>de</strong> l’aménagement<br />
t du territoire.<br />
Ainsi, en matière <strong>de</strong> loogement,<br />
le Go ouvernement :<br />
ppropose<br />
<strong>de</strong> reenforcer<br />
la cré éation <strong>de</strong> logeements<br />
publics<br />
ou subventionnés<br />
tant paar<br />
la rénovatio on que par<br />
lla<br />
constructioon<br />
neuve, afin <strong>de</strong> rechercheer<br />
entre autre es la <strong>de</strong>nsifica ation <strong>de</strong>s noyaaux<br />
d'habitat urbains et<br />
rruraux<br />
existannts<br />
(p.54-55) ;<br />
cconcentrera<br />
lees<br />
dispositifs d'ai<strong>de</strong> pour eencourager<br />
les<br />
construction ns neuves danns<br />
les noyaux x d'habitat<br />
uurbains<br />
et rurraux<br />
et les zon nes d'intervenntion<br />
privilégié ées (p.56) ;<br />
vveut<br />
promouvvoir<br />
l'habitat dans d les noyauux<br />
d'habitat (p p.59).<br />
Plus conccrètement,<br />
affin<br />
<strong>de</strong> privilég gier l'usage paarcimonieux<br />
<strong>de</strong> d l'espace et e suite à la vvolonté<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>nsifier<br />
les<br />
noyaux d'habitat<br />
urbains<br />
et ruraux existants, e le GGouvernement<br />
t s'engage à :<br />
ddélimiter<br />
les nnoyaux<br />
d'habi itat sur la basse<br />
<strong>de</strong> critères objectifs et qu ualitatifs en s'inspirant<br />
<strong>de</strong>s s concepts<br />
ddu<br />
SDER et enn<br />
veillant à la cohérence avvec<br />
les outils existants e dans s les politiquees<br />
<strong>territorial</strong>isé ées ;<br />
rrenforcer<br />
les politiques <strong>de</strong> rénovation et requalificatio on urbaine. (DP PR, p.59)<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 12<br />
Cette <strong>de</strong>nnsification<br />
doiit<br />
s’accompag gner d’un renoouveau,<br />
d’un renforcement t <strong>de</strong>s villes ett<br />
<strong>de</strong>s noyaux urbains et<br />
ruraux exxistants,<br />
en less<br />
rendant attr rayants. (p.81) )
2.2.1.1.33.<br />
Tentatives s <strong>de</strong> délimitatio on au niveau wwallon<br />
: défin nition <strong>de</strong> Y. De elforge et G. Gé Géron<br />
D’après YY.<br />
Delforge et G. Géron (200 08), qui repréésentent<br />
la voix<br />
<strong>de</strong> l’administration<br />
(SPWW-DGO4),<br />
l’objectif<br />
<strong>de</strong> la<br />
définitionn<br />
du noyau d’hhabitat<br />
est essentiellementt<br />
d’éviter la di ispersion <strong>de</strong> l’habitat<br />
et <strong>de</strong>es<br />
activités en n « incitant<br />
les ménaages<br />
à s’établiir<br />
dans <strong>de</strong>s qu uartiers :<br />
ooù<br />
l’habitat n’est<br />
pas dispe ersé ;<br />
ooù<br />
les équipeements<br />
et serv vices existent t;<br />
ooù<br />
l’épurationn<br />
collective <strong>de</strong> es eaux usées s est possible ;<br />
ooù<br />
une <strong>de</strong>sseerte<br />
en transpo orts en commmun<br />
<strong>de</strong> qualité é existe ou est t envisageablee.<br />
» (Delforge et Géron.,<br />
22008,<br />
p.17)<br />
Cependannt,<br />
Y. Delforge<br />
et G.Géron précisent: « L’important n’est n pas seulement<br />
<strong>de</strong> saavoir<br />
où se tro ouvent les<br />
noyaux dd’habitat<br />
maiss<br />
également <strong>de</strong> savoir « ppour<br />
y faire quoi ? ». Les s critères <strong>de</strong> e définition <strong>de</strong> es noyaux<br />
d’habitat t sont donc éttroitement<br />
dép pendants du ttype<br />
<strong>de</strong> politiq ique que l’on veut y mener er. » (Delforge et Géron,<br />
2008, p.220).<br />
En travailllant<br />
à l’échelle<br />
<strong>de</strong>s secteu urs statistiques<br />
afin d’avoir <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> populatioon,<br />
les <strong>de</strong>ux auteurs<br />
ont<br />
proposé lles<br />
critères <strong>de</strong>e<br />
délimitation suivants :<br />
lles<br />
secteurs statistiques <strong>de</strong> d <strong>de</strong>nsité coorrigée<br />
hhabitants/ha<br />
eet<br />
500 habitan nts minimum<br />
6 : 25 habitants/ha et 2000 habiitants<br />
minimu um ou 50<br />
;<br />
lles<br />
secteurs contigus aux gares IC-IR (au moins 1 train IC/IR<br />
ssecteurs<br />
à l’intérieur<br />
d’un rayon <strong>de</strong> 3 kkm<br />
autour <strong>de</strong><br />
hheure<br />
dans chhaque<br />
sens) ;<br />
7<br />
par p heure danns<br />
chaque se ens) et les<br />
es gares princ cipales (au mmoins<br />
2 trains s IC/IR par<br />
lles<br />
secteurs cconstitutifs<br />
<strong>de</strong>s<br />
zones protéégées<br />
en matière<br />
d’urbanisme<br />
(ZPU) ;<br />
lle<br />
secteur coontenant<br />
le centre<br />
adminisstratif<br />
<strong>de</strong>s pô ôles du Schéma<br />
<strong>de</strong> Dévelloppement<br />
<strong>de</strong> e l’Espace<br />
RRégional<br />
(Gouuvernement<br />
wallon, w 1999) aainsi<br />
que les 3 secteurs con ntigus les pluss<br />
<strong>de</strong>nsément peuplés ;<br />
lle<br />
secteur <strong>de</strong>ss<br />
centres adm ministratifs <strong>de</strong> toutes les com mmunes.<br />
Tous cess<br />
secteurs ssont<br />
soumis à une conntrainte<br />
: seu ules les parties<br />
<strong>de</strong> sectteur<br />
situées en zone<br />
d’assainisssement<br />
colleectif<br />
et transitoire<br />
au Plan dd’Assainissem<br />
ment par Sous-bassin<br />
Hydroographique<br />
(P PASH) sont<br />
retenus ccomme<br />
noyaux<br />
d’habitat.<br />
Les critèrres<br />
utilisés cooncernent<br />
<strong>de</strong>s thématiques différentes :<br />
lla<br />
<strong>de</strong>nsité et le<br />
nombre d’habitants<br />
;<br />
lla<br />
mobilité (avvec<br />
la prise en n compte <strong>de</strong>s gares importantes)<br />
;<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 13<br />
6<br />
Rapport eentre<br />
nombre d’hhabitants<br />
du sect teur statistique eet<br />
surface du sec cteur statistique couverte c par unee<br />
zone d’habitat ou d’habitat<br />
à caractèree<br />
rural au plan <strong>de</strong>e<br />
secteur. Les ZA ACC mises en œœuvre<br />
ou les PCA dérogatoires aff fectant <strong>de</strong>s espac aces à la rési<strong>de</strong>nc ce n’ont pas<br />
encore pu êêtre<br />
pris en comppte.<br />
7<br />
Les trainss<br />
du service intérrieur<br />
belge peuve ent être regroupéés<br />
en différentes catégories :<br />
• lles<br />
trains InterCitty<br />
(IC) effectuent <strong>de</strong>s relations rappi<strong>de</strong>s<br />
et directes s entre les princip pales villes du paays<br />
;<br />
• lles<br />
trains InterReegio<br />
(IR) effectuent<br />
<strong>de</strong>s relations llongues<br />
distance es avec plusieurs s arrêts interméddiaires<br />
;<br />
• lles<br />
trains L sont <strong>de</strong>s omnibus qui i <strong>de</strong>sservent touss<br />
les arrêts <strong>de</strong>s différentes d lignes s ;<br />
• lles<br />
trains P sont <strong>de</strong>s trains supplé émentaires circuulant<br />
<strong>de</strong> manière non ca<strong>de</strong>ncée aux a heures <strong>de</strong> poointe.
ll’aménagemeent<br />
du territoire<br />
(avec la prrise<br />
en comp pte <strong>de</strong>s zones protégées en<br />
matière d’u urbanisme<br />
( (ZPU), <strong>de</strong>s pôles<br />
du SDER et e <strong>de</strong>s centress<br />
administratif fs) ;<br />
lla<br />
politique d’ environnemen nt <strong>de</strong> la Régioon<br />
(avec la prise<br />
en compte e <strong>de</strong>s PASH).<br />
A noter que<br />
les seuls sservices/équip<br />
pements qui ssont<br />
pris en co ompte sont le es centres admministratifs.<br />
Cependant,<br />
le critère concernant la<br />
<strong>de</strong>nsité et le l nombre d’hhabitants<br />
tient<br />
implicitement<br />
compte d’uun<br />
certain équipement.<br />
On peut en effet conssidérer<br />
qu’à partir p d’une cooncentration<br />
<strong>de</strong> 2000 habitants,<br />
<strong>de</strong>s seervices<br />
et équ uipements<br />
sont préssents<br />
dans l’ environnemen nt. Pour la mmobilité,<br />
seule es les gares IC-IR ou prinncipales<br />
sont prises en<br />
compte eet<br />
pas l’ensemmble<br />
<strong>de</strong>s autre es réseaux alteernatifs<br />
à la voiture v (bus, métro…). m<br />
Ces différents<br />
critèress<br />
ont été appliqués<br />
à la Waallonie<br />
par l’Institut<br />
<strong>de</strong> Con nseil et d’Etud<strong>de</strong>s<br />
en Développement<br />
Durable ( (ICEDD) pour le compte <strong>de</strong> la DGATLP-MMRW<br />
en 2008 8. Les donnée es <strong>de</strong> populatiion<br />
utilisées sont s celles<br />
au 01/01/2004.<br />
Les données<br />
sur le es trains dateent<br />
du 09/12/ /2007, les ZPU U du 29/01/22007<br />
et les do onnées du<br />
PASH dattent<br />
du 18/066/2007.<br />
La plu upart <strong>de</strong>s crittères<br />
permette ent la sélectio on <strong>de</strong> secteurrs<br />
statistiques s, d’autres<br />
par contrre<br />
comme ceuux<br />
liés aux ZPU<br />
ou aux PASSH<br />
ont <strong>de</strong>s lim mites différente es, ce qui commplique<br />
la démarche<br />
et<br />
entraine uune<br />
délimitatiion<br />
<strong>de</strong>s noyau ux différente dd’une<br />
agrégati ion <strong>de</strong> secteur rs statistiquess.<br />
Sans prenndre<br />
en comppte<br />
la contrain nte liée au PASSH,<br />
283 noya aux ont été délimités<br />
en Waallonie.<br />
Ils cou uvrent 754<br />
km², soit t 4,5% du terrritoire.<br />
Vu le critère c du cenntre<br />
administr ratif, chaque commune en possè<strong>de</strong> au moins un.<br />
La populaation<br />
au 01/01/2004<br />
comp prise dans less<br />
noyaux ainsi i définis était <strong>de</strong> 1 638 7933<br />
habitants, soit s 48,5%<br />
<strong>de</strong> la poppulation<br />
wallonnne.<br />
Lorsque, parmi ces nnoyaux,<br />
on ne<br />
retient quee<br />
les territoires<br />
situés en zone d’assa<br />
transitoiree<br />
au PASH, lees<br />
nouvelles formes f apparraissent<br />
fortem ment désagré égées<br />
limites <strong>de</strong>es<br />
secteurs sttatistiques.<br />
On n compte alorrs<br />
620 noyaux x et ils ne cou<br />
communees<br />
sont alors dépourvues <strong>de</strong> d tout noyau (Walhain, Bur rdinne, Héron,<br />
Nandrin, Erezée, Manhhay,<br />
Stoumont t, Amel, Gouvyy<br />
et Sainte-Od <strong>de</strong>).<br />
8 ainissement collectif c et<br />
et ne ccorrespon<strong>de</strong>nt<br />
t plus aux<br />
vrent plus quee<br />
598 km². De<br />
plus, 14<br />
, Wasseiges, MModave,<br />
Tinlo ot, Clavier,<br />
Remarquons<br />
que la proximité<br />
à un ne gare est prise<br />
en comp pte par la définition<br />
<strong>de</strong> Delforge<br />
et Géro on mais il<br />
s’agit uniquement<br />
<strong>de</strong>ss<br />
gares <strong>de</strong>sse ervies par <strong>de</strong>ss<br />
trains IC/IR. . Ce critère <strong>de</strong><br />
distance vaarie<br />
d’ailleurs s entre les<br />
gares IC/ IR en fonctionn<br />
d’une certain ne hiérarchie :<br />
lle<br />
critère <strong>de</strong> pproximité<br />
est la contigüité du secteur statistique<br />
pou ur les gares d<strong>de</strong>sservies<br />
par r un et un<br />
sseul<br />
train par heure dans chaque c sens ;<br />
lle<br />
critère <strong>de</strong> pproximité<br />
est un u cercle <strong>de</strong> 3 km autour <strong>de</strong>s d gares <strong>de</strong>sservies<br />
par auu<br />
moins <strong>de</strong>ux trains par<br />
hheure<br />
dans chhaque<br />
sens (le e secteur doitt<br />
être complèt tement inclus dans ce cerclle<br />
<strong>de</strong> 3 km).<br />
Pour rapppel,<br />
notre anaalyse<br />
vis-à-vis s <strong>de</strong> la proximmité<br />
<strong>de</strong>s trains s englobe l’en nsemble <strong>de</strong>s ggares<br />
et point ts d’arrêts<br />
du réseauu<br />
SNCB.<br />
2.2.2. AAccessibilité<br />
ppar<br />
les alterna atives à la voitture<br />
2.2.2.1.<br />
Cartes d’acccessibilité<br />
du LEPUR-CPDT T – Accessibilit ité au lieu <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce r<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 14<br />
Afin d’évaaluer<br />
la localissation<br />
<strong>de</strong> l’urb banisation réssi<strong>de</strong>ntielle<br />
réc cente vis-à-vis<br />
voiture, nnous<br />
avons uttilisé<br />
les carte es d’accessibbilité<br />
du LEPUR-CPDT<br />
9 s <strong>de</strong> l’ensembble<br />
<strong>de</strong>s alterna atives à la<br />
. Une e <strong>de</strong>s cartes ssynthétise<br />
l’in nformation<br />
8<br />
Les zoness<br />
d’assainissemeent<br />
collectif et tr ransitoire au PASSH<br />
ne couvrent pas les fleuves par exemple, cee<br />
qui scin<strong>de</strong> cert tains noyaux<br />
comme Liège<br />
ou Namur.<br />
9<br />
http://cpddt.wallonie.be/?idd_page=73<br />
, site e internet <strong>de</strong> la CCPDT,<br />
février 2011
sur l’acceessibilité<br />
en trrain,<br />
bus et mo<strong>de</strong>s m lents (mmarche<br />
+ vélo) ) au lieu <strong>de</strong> ré ési<strong>de</strong>nce, souss<br />
forme <strong>de</strong> pa art modale<br />
attendue dans le cadree<br />
<strong>de</strong>s déplacements<br />
domiciile-travail.<br />
Cette carrte<br />
correspondd<br />
à une imag ge <strong>de</strong> pixels d<strong>de</strong><br />
50 mètres s <strong>de</strong> côté couvrant<br />
l’ensemmble<br />
<strong>de</strong> la Wa allonie. La<br />
valeur quui<br />
est donnée à chaque pix xel est une esstimation<br />
<strong>de</strong> la a répartition modale m assocciée<br />
à un lieu : sur cent<br />
travailleurs<br />
résidant enn<br />
ce lieu, un nombre n X <strong>de</strong>vvrait<br />
le quitter r par une alternative<br />
à la vooiture<br />
pour se e rendre à<br />
son lieu d<strong>de</strong><br />
travail.<br />
Les données<br />
statistiquues<br />
qui ont permis<br />
la réalisaation<br />
<strong>de</strong> ces cartes c viennen nt du recensement<br />
<strong>de</strong> 1991 1 relatives<br />
aux déplaacements<br />
dommicile-lieu<br />
<strong>de</strong> travail.<br />
Le tableaau<br />
suivant reprend<br />
une série e <strong>de</strong> facteurs qui ont été ut tilisés pour réaliser<br />
les carttes<br />
d’accessib bilité.<br />
Tableau 2 : Facteurs utilisés pour r réaliser les cartes d’acc cessibilité du LEPUR-CPDTT<br />
Mo<strong>de</strong><br />
Lieu <strong>de</strong> rési<strong>de</strong> ence<br />
Bus<br />
# fréquence cu umulée <strong>de</strong>s bus aux a arrêts<br />
# distance aux x arrêts (maximu um 500 m)<br />
# dénivellation n par rapport à l'a arrêt (60 m)<br />
# distance aux x petites, moyenn nes et gran<strong>de</strong>s viilles<br />
Trains<br />
# fréquence cu umulée <strong>de</strong>s trains<br />
aux gares<br />
# distance aux x gares (maximum m 3 000 m)<br />
# dénivellation n par rapport à la gare (300m)<br />
# distance aux x gran<strong>de</strong>s villes<br />
Mo<strong>de</strong>s Leents<br />
# potentiel <strong>de</strong> population prése ente dans un rayoon<br />
<strong>de</strong> 1600 m<br />
# potentiel <strong>de</strong> population dans un rayon <strong>de</strong> 8 kmm<br />
# dénivellation n (80 m)<br />
Sources : CPDDT,<br />
document non pubblié<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 15<br />
La carte dd’accessibilitéé<br />
utilisée a été é reprise ci-<strong>de</strong>essous.<br />
Elle présente p la var riable « part mmodale<br />
attend due au lieu<br />
<strong>de</strong> rési<strong>de</strong>ence<br />
par les alternatives<br />
à la<br />
voiture » enn<br />
implantation spatialement t continue.
Carte 1 : Part modalee<br />
attendue au u lieu <strong>de</strong> résid<strong>de</strong>nce<br />
par les s alternatives s à la voituree<br />
(CPDT, 2003 3)<br />
Des infformations<br />
complémenta aires sur<br />
http://cpddt.wallonie.bee/?id_page=73<br />
2.2.2.2.<br />
L’analysee<br />
<strong>de</strong> la localisation<br />
<strong>de</strong> l’u urbanisation rési<strong>de</strong>ntielle récente est notamment rréalisée<br />
par rapport à<br />
l’ensembble<br />
<strong>de</strong>s lieux présentant une u bonne acccessibilité<br />
pa ar les alterna atives à la vooiture,<br />
et ce, <strong>de</strong> façon<br />
graduellee<br />
au fur et à mmesure<br />
<strong>de</strong> l’éloignement<br />
à cces<br />
lieux. Dan ns ce cadre, les<br />
gares ferrooviaires<br />
const tituent <strong>de</strong>s<br />
pôles d’aaccessibilité<br />
importants à prendre enn<br />
compte. Il est proposé d’analyser l’évolution ré écente <strong>de</strong><br />
l’urbanisaation<br />
autour d<strong>de</strong><br />
celles-ci. Pour<br />
ce faire, il<br />
est nécessaire<br />
<strong>de</strong> déterminer<br />
un seuil d<strong>de</strong><br />
distance par p rapport<br />
aux garees<br />
dans lequeel<br />
l’importanc ce <strong>de</strong> l’urbannisation<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
pourra<br />
être évaluuée.<br />
Ce seuil doit être<br />
déterminéé<br />
par la distannce<br />
(ou distan nce-temps) mmaximale<br />
qu’ac ccepte <strong>de</strong> par rcourir l’usageer<br />
à pied ou à vélo pour<br />
atteindre la gare.<br />
2.2.2.2.11.<br />
Bref aperççu<br />
bibliographi ique<br />
De nombbreuses<br />
étu<strong>de</strong>es<br />
ont déjà ab bordé le sujeet<br />
<strong>de</strong> l’access sibilité aux ga ares. Plusieurss<br />
travaux <strong>de</strong> la CPDT<br />
recensennt<br />
différentes étu<strong>de</strong>s ou po olitiques qui ccherchent<br />
à concentrer c l’h habitat à proxximité<br />
<strong>de</strong>s ga<br />
donnent d<strong>de</strong>s<br />
valeurs seuils<br />
pour les s distances auux<br />
gares. Des recherches bibliographiqu<br />
b ues nous ont é<br />
permis <strong>de</strong>e<br />
trouver d’auutres<br />
références,<br />
principaleement<br />
en Fran nce.<br />
10<br />
res et qui<br />
également<br />
10<br />
Accessibilitéé<br />
aux transpor rts en commuun<br />
par les mod <strong>de</strong>s alternatifs s à la voiture<br />
CPDT, 20002b,<br />
2003a, 2003b,<br />
2004, 2005 5a, 2005b, 2005cc.<br />
ces cartes s peuvent<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 16<br />
être obteenues<br />
à l’adresse l :
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 17<br />
Une <strong>de</strong>s plus pertinentes<br />
est une étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la Direction<br />
région nale <strong>de</strong> l'équipement<br />
Ile-<strong>de</strong><br />
potentiel <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsificatiion<br />
autour <strong>de</strong>s s pôles et <strong>de</strong>ss<br />
axes <strong>de</strong> transport<br />
en commun<br />
11<br />
e-France (DREIF)<br />
sur le<br />
.<br />
Dans cettte<br />
étu<strong>de</strong>, troiss<br />
périmètres d’accessibilité<br />
d é aux pôles sont<br />
définis en termes t <strong>de</strong> disstance-temps<br />
:<br />
lle<br />
périmètre « <strong>de</strong> proximité é », à partir d’ ’un parcours <strong>de</strong> 5 minutes à pied, soit uune<br />
distance parcourue<br />
d<strong>de</strong><br />
300 m ; elle<br />
permettrai it <strong>de</strong> repérer la perception <strong>de</strong> « sortie <strong>de</strong> d gare » et dd’«<br />
entrée <strong>de</strong> ville », les<br />
ffonctionnalitéés<br />
<strong>de</strong> la gare en e rapport aveec<br />
l’infrastruct ture dont elle dépend ;<br />
lle<br />
périmètre « <strong>de</strong> référence e », à partir dd’un<br />
parcours <strong>de</strong> 15 minute es à pied ou 5 minutes en vélo, soit<br />
uune<br />
distance <strong>de</strong> 1 km parcourue,<br />
qui circonscrirait le secteur ou<br />
« quartier » <strong>de</strong> la gare et qui est<br />
ccomparé<br />
à unn<br />
périmètre théorique<br />
<strong>de</strong> 1 km <strong>de</strong> rayon ;<br />
lle<br />
périmètre « étendu », à partir d’un pparcours<br />
<strong>de</strong> 15 1 minutes en e bus, soit 22,5<br />
km qui se erait l’aire<br />
dd’attraction<br />
du<br />
pôle gare à l’échelle interrcommunale.<br />
Pour chaque<br />
gare étuddiée,<br />
les périm mètres observvés<br />
sont com mparés aux pé érimètres <strong>de</strong> rréférence<br />
théorique,<br />
ce<br />
qui permet<br />
d’évaluer laa<br />
diffusion rée elle <strong>de</strong> l’accesssibilité<br />
qui es st influencée par la structuure<br />
viaire et le relief aux<br />
alentourss<br />
du pôle. Parr<br />
exemple, po our une sélecction<br />
<strong>de</strong> 9 gares,<br />
le rayon équivalent duu<br />
périmètre réellement r<br />
parcouru <strong>de</strong>puis la garre<br />
en 15 minu utes à pied varrie<br />
<strong>de</strong> 670 à 800 8 mètres.<br />
La figure suivante monntre<br />
pour 4 ga ares wallonnees,<br />
les différences<br />
d’étendu ue entre le péérimètre<br />
théor rique et le<br />
périmètree<br />
réel. Les coontraintes<br />
naturelles<br />
ou huumaines<br />
aux alentours a <strong>de</strong>s gares limitennt<br />
l’isotropie du réseau<br />
viaire qui permet d’acccé<strong>de</strong>r<br />
aux gar res. Ceci est pparticulièreme<br />
ent le cas pour<br />
les gares <strong>de</strong>e<br />
Rivage et Ma arche-les-<br />
Dames quui<br />
sont situées<br />
dans <strong>de</strong>s va allées.<br />
11<br />
DREIF, 22007.<br />
Potentiel d<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>nsification autour <strong>de</strong>s pôle les et <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> transport en n commun, étu<strong>de</strong><br />
réalisée pour la direction<br />
régionale d<strong>de</strong><br />
l’équipement d’Ile-<strong>de</strong>-France par l’agence Brrès+Mariolle<br />
ave ec GERAU Conse eil et le cartograaphe<br />
PRODIG/CN NRS, rapport<br />
final-synthèèse,<br />
51p.
Graphiquue<br />
1 : comparaison<br />
<strong>de</strong>s pé érimètres d’aaccessibilité<br />
théorique et t réel<br />
Source : IWWEPS,<br />
d’après DREEIF,<br />
Note <strong>de</strong> synth hèse, 2008<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 18<br />
A vélo, l’éétu<strong>de</strong><br />
françaisse<br />
estime que e les déplacemments<br />
se font t en moyenne à 14 km/h. A cette vitesse e, on peut<br />
parcourir r environ 3,5 kkm<br />
en 15 minutes.<br />
La figuree<br />
suivante exttraite<br />
d’une étu<strong>de</strong> é <strong>de</strong> la DDirection<br />
régio onale <strong>de</strong> l'équipement<br />
Ile-<strong>de</strong>-France<br />
ré ésume les<br />
distancess<br />
parcourues à pied, en vélo et buss<br />
en attribua ant <strong>de</strong>s vites sses moyennes<br />
à ces moyens m <strong>de</strong><br />
déplacemments.
Graphiquue<br />
2 : Distancce-temps<br />
d’a accessibilité aux gares se elon le moyen n <strong>de</strong> transporrt<br />
Graphique eextrait<br />
<strong>de</strong> DREIF, 2007<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 19<br />
D’autres travaux intéreessants<br />
sont is<br />
Le projett<br />
Bahn.Ville 2<br />
<strong>développement</strong><br />
<strong>de</strong>s o<br />
orienté vvers<br />
le rail ».<br />
gares, nootamment<br />
pou<br />
d’influencce<br />
d’une gar<br />
approchees<br />
possibles p<br />
l'analyse <strong>de</strong>s prix du fo<br />
12<br />
ssus du Projeet<br />
Bahn.Ville 1 et 2.<br />
(2006-200 09) est une reecherche-action<br />
ayant pou ur objectif la mise en oeu uvre et le<br />
orientations is ssues du proj ojet Bahn.Ville e 1 (2001-20 004) pour « faavoriser<br />
un urbanisme u<br />
Ce projet fra anco-allemandd<br />
a égalemen nt réfléchi sur<br />
les périmèttres<br />
d’accessibilité<br />
aux<br />
ur orienter l’a action foncièrre<br />
à leur prox ximité. Les au uteurs ont cheerché<br />
à défin nir la zone<br />
e afin <strong>de</strong> définir<br />
leur pérrimètre<br />
d’obse ervation et d’action.<br />
D’après<br />
eux, il ex xiste trois<br />
pour traiter ce ette question : soit par la mobilité, soit par le niveauu<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sserte e, soit par<br />
oncier :<br />
lle<br />
niveau <strong>de</strong> d<strong>de</strong>sserte<br />
ou le<br />
ppeut<br />
retrouveer<br />
dans <strong>de</strong>s d<br />
( (CERTU 19977<br />
3300<br />
mètres, u<br />
13<br />
e type <strong>de</strong> mod<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> transpo ort est associé é à <strong>de</strong>s portéées<br />
d'influence<br />
que l'on<br />
documents d'évaluation<br />
<strong>de</strong><br />
l'insertion urbaine <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> transport<br />
). Selon ces s préconisatioons,<br />
un arrêt <strong>de</strong> bus est ré éputé exercerr<br />
une influenc ce jusqu'à<br />
un arrêt <strong>de</strong> tra amway 500 ett<br />
une station <strong>de</strong> d métro 700 ;<br />
ccertaines<br />
anaalyses<br />
détaillé ées <strong>de</strong> l'évoluution<br />
<strong>de</strong>s prix du foncier (D Debrezion, Peels,<br />
et Rietveld,<br />
2007<br />
aavancent<br />
<strong>de</strong>s périmètres d'impact d signiificatif<br />
<strong>de</strong> l'ord dre <strong>de</strong> 500 à 700 mètres aautour<br />
<strong>de</strong>s ga<br />
14<br />
)<br />
ares, avec<br />
12<br />
L’Hostis A. et <strong>de</strong> nombreeux<br />
contributeurs s, 2009. Rapporrt<br />
final du Projet t Bahn.Ville 2 sur<br />
un urbanisme orienté vers le rail, octobre<br />
2009, 81p.<br />
13<br />
CERTU, 11997.<br />
Évaluationn<br />
<strong>de</strong>s transports en commun en site propre: ind dicateurs transpo ort pour l'analysee<br />
et le suivi <strong>de</strong>s s opérations.<br />
Lyon: CERTTU.<br />
14<br />
Debrezionn<br />
G., 2006. Railwway<br />
Impacts on Real R Estate Pricess,<br />
Amsterdam, Tinbergen T Institut te.
uune<br />
superpossition<br />
<strong>de</strong>s effe ets <strong>de</strong> l'accesssibilité<br />
routièr re. Mais le ca alcul <strong>de</strong>s seuills<br />
reste très dépendant d<br />
d<strong>de</strong><br />
la qualité d<strong>de</strong>s<br />
données en e entrée et d<strong>de</strong>s<br />
choix <strong>de</strong> tr raitement stat tistique ;<br />
eenfin<br />
les réféérences<br />
le plu us courantes en la matièr re renvoient à<br />
BBertolini<br />
retieent<br />
un périmè ètre basé sur une mesure temporelle d<br />
minutes pour définir le qua artier <strong>de</strong> la garre<br />
(Bertolini et t Spit, 1998<br />
Ils ont rettenu<br />
la <strong>de</strong>rnièère<br />
approche car elle est laa<br />
moins sujet<br />
<strong>de</strong> mise een<br />
œuvre et pparce<br />
qu'elle renvoie r à un uusage<br />
<strong>de</strong> l'esp<br />
<strong>de</strong> marchhe<br />
à pied, parrcouru<br />
à une vitesse v <strong>de</strong> 5 kkm/h<br />
mais fon<br />
gare en teermes<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssserte<br />
est importante<br />
à prenndre<br />
en comp<br />
15 à une analysse<br />
<strong>de</strong> la mobilité.<br />
Ainsi<br />
d'un trajet en marche à pi ied en dix<br />
). )<br />
tte à caution <strong>de</strong>s d trois, et aaussi<br />
pour sa simplicité<br />
pace urbain. Ils<br />
ont retenu uun<br />
rayon <strong>de</strong> 10<br />
minutes<br />
nt quand mêm me remarquer que l’importa ance <strong>de</strong> la<br />
pte :<br />
ggare<br />
principalle<br />
(<strong>de</strong>sserte nationale)<br />
: 10000<br />
mètres ;<br />
ggare<br />
locale (<strong>de</strong>sserte<br />
régionale)<br />
: 800 mètres.<br />
Le projet<br />
la définit<br />
étu<strong>de</strong>s 16 Bahn.Ville 1 aavait<br />
égaleme ent réfléchi suur<br />
la question. A propos <strong>de</strong> la vitesse à prendre<br />
en com mpte dans<br />
tion du rayon pé<strong>de</strong>stre, elle<br />
est estiméée<br />
entre 4 et 5 km/h en milieu urbainn<br />
<strong>de</strong>nse dans plusieurs<br />
. Pour la duréee<br />
du rayon pé é<strong>de</strong>stre, le proojet<br />
indique un<br />
minimum <strong>de</strong> d 10 minutess.<br />
Par exemple,<br />
plus <strong>de</strong><br />
60 % <strong>de</strong>ss<br />
rabattementts<br />
vers les ga ares étudiées autour <strong>de</strong> Str rasbourg sont t effectués enn<br />
10 minutes ou moins,<br />
que le dééplacement<br />
see<br />
fasse à pied d, en vélo ou eencore<br />
en voit ture. Une figu ure montre ceppendant<br />
que la marche<br />
reste trèss<br />
présente auu-<strong>de</strong>là<br />
d’un kilomètre,<br />
ce qqui<br />
correspond<br />
à une durée<br />
supérieure à 12 (à 5 km m/h) ou 15<br />
minutes ( (à du 4 km/h) .<br />
Un raisonnnement<br />
simillaire<br />
est cond duit pour définnir<br />
le périmètr re <strong>de</strong>s transpo<br />
du bus es est souvent évvaluée<br />
entre 15 1 et 20 km/hh<br />
en milieu ur rbain <strong>de</strong>nse<br />
une vitessse<br />
moyenne d<strong>de</strong><br />
vélo ou <strong>de</strong> e taxi en tissu u urbain <strong>de</strong>nse<br />
parcourt 2,5 km et à 220<br />
km/h, on pa arcourt 3,3 kmm<br />
en 10 minu<br />
17 ;<br />
e 18 orts collectifss.<br />
« La vitesse e moyenne<br />
; les 15 km/h h correspon<strong>de</strong> ent aussi à<br />
. Aussi, à une u vitesse mooyenne<br />
<strong>de</strong> 15 5 km/h, on<br />
utes. »<br />
2.2.2.2.22.<br />
Choix <strong>de</strong>s seuils <strong>de</strong> dista tance<br />
Suite à laa<br />
consultationn<br />
<strong>de</strong>s docume ents <strong>de</strong> référeence,<br />
la distan nce-temps au ux gares la plus<br />
utilisée se emble être<br />
celle <strong>de</strong> 115<br />
minutes et t correspondra ait à <strong>de</strong>s distaances<br />
<strong>de</strong> :<br />
<br />
1000 mètres pour <strong>de</strong>s dép placements à pied à une vit tesse <strong>de</strong> 4 km m/h ; ce rayonn<br />
correspond à une aire<br />
cconcentrique<br />
théorique aut tour <strong>de</strong> la garee<br />
<strong>de</strong> 314,2 ha a ;<br />
33500<br />
mètres pour les déplacements<br />
à vvélo<br />
à une vite esse <strong>de</strong> 14 km m/h ; ce rayonn<br />
correspond à une aire<br />
cconcentrique<br />
théorique aut tour <strong>de</strong> la garee<br />
<strong>de</strong> 3848,5 ha. h<br />
Ce sont cces<br />
paramètrees<br />
qui ont été choisis dans l’exercice pré ésenté ici.<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 20<br />
Dans un premier temmps,<br />
afin d’ob btenir rapi<strong>de</strong>mment<br />
<strong>de</strong>s rés sultats, une approche a par cercles conc centriques<br />
(distance à vol d’oiseaau)<br />
autour <strong>de</strong>s s lieux <strong>de</strong> bonnne<br />
accessibilité<br />
est constru uite. Il faut êtrre<br />
conscient du d fait que<br />
ces périmmètres<br />
théoriqques<br />
peuvent, dans certainss<br />
cas, être lar rgement plus étendus que lles<br />
périmètres s réels qui<br />
15<br />
Bertolini, L. & T. Spit (19998)<br />
Cities on Rails,<br />
the re<strong>de</strong>velopmment<br />
of Railway Station Areas, London<br />
& New-Yoork,<br />
Spon/Routledge<br />
16<br />
5 km/h ddans<br />
une étu<strong>de</strong> d<strong>de</strong><br />
la Ville <strong>de</strong> Par ris (2007), 5 km/ /h Jourdan (2004 4), 5 km/h pour le Réseau Pé<strong>de</strong>sstre<br />
<strong>de</strong> Genève (2 2005), 4 à 5<br />
km/h dans diverses étu<strong>de</strong>s aux USA (1976) et au Canada (2005).<br />
17<br />
15 à 20 km/h selon <strong>de</strong>nnsité<br />
urbain (Cf. Chapelon, L. 1997),<br />
22 km/h pour un Bus à Haut Niveau <strong>de</strong> Services (COST T BHNS), 10<br />
(bouchon) à 25 (circulation flui<strong>de</strong>) km/h GAR RT (http://www.ggart.org/).<br />
18<br />
Ville <strong>de</strong> PParis<br />
2007, GARTT
dépen<strong>de</strong>nnt<br />
<strong>de</strong> la structture<br />
viaire et du d relief aux aalentours<br />
<strong>de</strong> la<br />
gare. La dis stance théoriqque<br />
<strong>de</strong> 3500 mètres m est<br />
donc unee<br />
distance maxximaliste.<br />
2.2.2.2.3<br />
Dans un<br />
<strong>de</strong> l’ense<br />
<strong>de</strong> 4 km<br />
2007 19<br />
3. Sélection d<strong>de</strong>s<br />
gares<br />
premier tempps,<br />
l’analyse <strong>de</strong><br />
l’évolution d<strong>de</strong><br />
l’urbanisat tion rési<strong>de</strong>ntie elle s’est effecctuée<br />
en tenant<br />
compte<br />
emble <strong>de</strong>s garres<br />
et points d’arrêt d <strong>de</strong> la SSNCB<br />
situés sur<br />
le territoire e wallon ou à une distance <strong>de</strong> moins<br />
<strong>de</strong> ce territooire.<br />
Il s’agit <strong>de</strong>s d gares et points d’arrêt t en service pour p les voyaageurs<br />
au mo ois <strong>de</strong> mai<br />
.<br />
La prise een<br />
compte <strong>de</strong>es<br />
anciennes gares s’avèree<br />
assez complexe,<br />
étant do<br />
<strong>de</strong> donnéées<br />
géographiques<br />
localisa ant les points d’arrêts anci iens<br />
considéréée<br />
peuvent d’aailleurs<br />
être <strong>de</strong> d différents tyypes<br />
: voie vic<br />
20 onné qu’on nee<br />
recense pas s <strong>de</strong> bases<br />
. Ces po oints d’arrêts en fonction <strong>de</strong> d l’année<br />
cinale ou voie fédérale.<br />
Dans un ssecond<br />
tempss,<br />
nous avons s envisagé <strong>de</strong> tenir compte d’une certaine<br />
hiérarchie d<strong>de</strong>s<br />
gares ains si que <strong>de</strong>s<br />
arrêts <strong>de</strong> bus (TEC) bieen<br />
<strong>de</strong>sservis. La L réflexion à ce sujet fait l’objet l du poin nt suivant.<br />
2.3. COMMPARAISON<br />
ALTERNAATIVES<br />
DES CRIT TÈRES DE<br />
2.3.1. CCritère<br />
« garess-3500m<br />
» et noyaux d’habbitat<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 21<br />
LOCALISATIO ON ET CONSTRUCTIONN<br />
DE DIFFÉRENTES<br />
La carte ssuivante<br />
préseente<br />
la couverture<br />
spatiale du critère « gares-3500m<br />
g » et <strong>de</strong>s noyaaux<br />
d’habitat.<br />
19<br />
Depuis 22007,<br />
4 nouveauux<br />
points d’arrêt ts/gares ont été rouverts : Mess sancy, Halanzy et<br />
Aubange en juuin<br />
2007 sur les s communes<br />
d’Aubange et Messancy ; Hergenrath<br />
en déc cembre 2007 suur<br />
la commune <strong>de</strong> e Kelmis (source : Infrabel, commmunication<br />
écrite e).<br />
20 Des conntacts<br />
ont été prris<br />
avec la SNCB B, Infrabel, et less<br />
services cartog graphiques du SP PW mais aucun service ne dispo ose <strong>de</strong> cette<br />
informationn<br />
précisément loccalisée.
Carte 2 : Comparaisoon<br />
du critère « Gares-35000m<br />
» et <strong>de</strong>s noyaux n d’hab bitat<br />
Les cerclles<br />
autour <strong>de</strong>es<br />
gares couv vrent une supperficie<br />
<strong>de</strong> te erritoire wallon n près <strong>de</strong> 6 ffois<br />
supérieure<br />
à celle<br />
couverte par les noyauux<br />
d’habitat (3 3409 km² conttre<br />
598 km²).<br />
Plusieurss<br />
constatationss<br />
sur le croise ement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uux<br />
couverture es <strong>territorial</strong>es peuvent être faites :<br />
lles<br />
périmètres<br />
<strong>de</strong> 3500 m couvrent l’ennsemble<br />
<strong>de</strong>s principaux no oyaux d’habitaat<br />
urbains et débor<strong>de</strong>nt<br />
llégèrement<br />
auu-<strong>de</strong>là<br />
;<br />
uune<br />
gran<strong>de</strong> paart<br />
<strong>de</strong> noyaux x « ruraux » soont<br />
largement « noyés » dan ns le buffer <strong>de</strong>e<br />
3500 m ;<br />
ccertains<br />
noyaaux<br />
compris dans<br />
les périmmètres<br />
autour <strong>de</strong>s gares ne correspon<strong>de</strong>nnt<br />
pas aux qu uartiers <strong>de</strong><br />
lla<br />
gare et ne ssont<br />
donc pas s centrés sur ccelles-ci<br />
;<br />
ccertains<br />
périmmètres<br />
d’acce essibilité <strong>de</strong>ss<br />
arrêts <strong>de</strong> tr rain non IC/IR R n’englobentt<br />
pas <strong>de</strong> noy yaux. Cela<br />
cconcerne<br />
esseentiellement<br />
<strong>de</strong>s d gares ruraales<br />
(Exemple e : Gouvy, Hav versin, Chapois,<br />
Grupont, Sy y…) ;<br />
lles<br />
noyaux sittués<br />
en <strong>de</strong>hor rs d’un périmmètre<br />
sont ceu ux qui répon<strong>de</strong> ent à d’autress<br />
critères que e le critère<br />
d<strong>de</strong><br />
proximité d<strong>de</strong>s<br />
gares <strong>de</strong> la définition d<strong>de</strong>s<br />
noyaux.<br />
2.3.2. AAffinage<br />
du crritère<br />
« gare »<br />
2.3.2.1.<br />
Gares IC-IR et autres gare es<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 22<br />
Ces consstatations<br />
peuvvent<br />
amener une u réflexion sur la taille <strong>de</strong>s<br />
périmètres s d’accessibiliité<br />
et sur l’objectif<br />
qui a<br />
sous-tenddu<br />
leur définittion.
L’objectiff<br />
était <strong>de</strong> vooir<br />
si l’urbanisation<br />
rési<strong>de</strong>entielle<br />
récen nte avait pris s place à prroximité<br />
<strong>de</strong>s gares en<br />
considéraant<br />
tous les ppoints<br />
d’arrêt et gares <strong>de</strong> la même faç çon. La proxim mité a été aboordée<br />
par le fait qu’on<br />
puisse ouu<br />
non atteinddre<br />
une gare en moins <strong>de</strong> 15 minutes à pied ou à vélo, v que ce soit en milieu u rural ou<br />
urbain.<br />
Cependannt,<br />
toutes less<br />
gares n’ont<br />
pas la même<br />
importance<br />
au niveau u <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>esserte.<br />
Certa aines sont<br />
<strong>de</strong>sserviees<br />
par <strong>de</strong>s trains<br />
IC ou IR et t d’autres uniqquement<br />
par <strong>de</strong>s d trains omnibus<br />
(qui <strong>de</strong>ssservent<br />
tous les arrêts<br />
d’une lignne)<br />
et les fréqquences<br />
<strong>de</strong> pa assage <strong>de</strong> cess<br />
trains sont différentes<br />
d’une<br />
gare à l’auutre.<br />
Comme lle<br />
périmètre <strong>de</strong> 3500 m apparaît a fort éétendu,<br />
partic culièrement en e milieu ruraal,<br />
et que les gares en<br />
milieu rural<br />
ne sont quue<br />
peu <strong>de</strong>sservies<br />
par <strong>de</strong>ss<br />
trains IC-IR, nous avons retravaillé r la ccouverture<br />
sp patiale <strong>de</strong>s<br />
périmètrees<br />
<strong>de</strong> la façonn<br />
suivante :<br />
uun<br />
périmètre <strong>de</strong> 3500 m autour <strong>de</strong>s ggares<br />
<strong>de</strong>sserv vies par minimum<br />
1 trainn<br />
IC-IR par he eure dans<br />
cchaque<br />
sens. Elles sont 67 sur le territoiire<br />
wallon ;<br />
uun<br />
périmètree<br />
<strong>de</strong> 1000 m autour <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s d autres gares.<br />
Ce rayyon<br />
correspond<br />
à une<br />
aaccessibilité<br />
dd’environ<br />
15 minutes m à piedd<br />
ou 5 minute es en vélo (voi ir plus haut).<br />
La carte ssuivante<br />
préseente<br />
la situation<br />
avec ces d<strong>de</strong>ux<br />
périmètr res <strong>de</strong> taille différente.<br />
Carte 3 : Comparaisoon<br />
du critère « gares-35000<br />
m ou 1000 m » et <strong>de</strong>s no oyaux d’habiitat<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 23
Les zoness<br />
d’accessibillité<br />
<strong>de</strong>s gares ne couvrent plus que 1411<br />
km² et ont une emprise sspatiale<br />
plus proche <strong>de</strong><br />
celle <strong>de</strong>s noyaux d’habbitat.<br />
Si l’objecctif<br />
était <strong>de</strong> ddéfinir<br />
les gar res autour <strong>de</strong>esquelles<br />
l’urb banisation rés si<strong>de</strong>ntielle estt<br />
à privilégier r, d’autres<br />
critères ppourraient<br />
êtree<br />
pris en compte<br />
en fonctioon<br />
:<br />
ddu<br />
positionneement<br />
<strong>de</strong> la gare<br />
sur le résseau<br />
ferré. Pa ar exemple, la a gare <strong>de</strong> Nammur,<br />
vu la str ructure du<br />
rréseau<br />
ferré eexistant,<br />
est celle<br />
qui est laa<br />
plus accessible<br />
<strong>de</strong>puis l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s gares IC <strong>de</strong> Wallonie W et<br />
d<strong>de</strong><br />
Bruxelles eet<br />
celle d’Arlon<br />
la moins acccessible<br />
(Arno old & Sandrap ps, 1998) ;<br />
dd’une<br />
hiérarchie<br />
<strong>de</strong>s gares s, dépendant du type/nomb bre <strong>de</strong> trains qui y passentt,<br />
du nombre d’usagers<br />
qqui<br />
y prennennt<br />
le train...en n somme l’offfre<br />
<strong>de</strong> transpo ort en ce lieu.<br />
Dans ce cass,<br />
la hiérarchie<br />
dépend<br />
d<strong>de</strong>s<br />
effets d<strong>de</strong><br />
l’exploitation<br />
fonctionnnelle<br />
du rése eau ferré (ty ypes <strong>de</strong> trainn,<br />
nombre <strong>de</strong> d lignes,<br />
ffréquences……<br />
par gare) qui<br />
ont été définnis<br />
par la SNC CB ;<br />
d<strong>de</strong><br />
la structuree<br />
spatiale exis stante avec sees<br />
pôles d’em mploi et <strong>de</strong> ser rvices ;<br />
d<strong>de</strong><br />
la structuree<br />
spatiale que e l’on veut donnner<br />
à la Wall lonie.<br />
Une cartee<br />
<strong>de</strong>s distancees-temps<br />
entr re les gares eet,<br />
<strong>de</strong> façon pl lus générale, entre les pôlees<br />
wallons et extérieurs<br />
(Bruxelless,<br />
Lille, Maasttricht,<br />
Luxemb bourg…) seraait<br />
alors un ou util intéressant t.<br />
2.3.2.2.<br />
Prise en commpte<br />
<strong>de</strong> l’acce essibilité aux arrêts TEC<br />
Il est éga<br />
pertinent<br />
la SRWT 2<br />
alement possiible<br />
<strong>de</strong> tenir compte c <strong>de</strong>s ggares<br />
routière es <strong>de</strong> bus pas ssagers, ce qqui<br />
est particu<br />
pour les régioons<br />
non <strong>de</strong>sse ervies par le ttrain.<br />
En atten nte d’une défin nition du conccept<br />
<strong>de</strong> gare d<br />
1<br />
, nous avonss<br />
tenté <strong>de</strong> nous<br />
en approcheer<br />
grâce aux statistiques s <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sserte <strong>de</strong>es<br />
arrêts<br />
<strong>de</strong> mettree<br />
en évi<strong>de</strong>nce les arrêts qui<br />
sont les pluss<br />
<strong>de</strong>sservis en n nombre <strong>de</strong> bus. b<br />
22 ulièrement<br />
<strong>de</strong> bus par<br />
. L’o objectif est<br />
De façon exploratoire, nous avons décidé d <strong>de</strong> séleectionner<br />
les arrêts <strong>de</strong> bus<br />
bus par joour<br />
ouvrable een<br />
pério<strong>de</strong> sc colaire, dans lees<br />
<strong>de</strong>ux sens confondus<br />
chaque liigne<br />
passant à l’arrêt. Ces s arrêts sont évi<strong>de</strong>mment<br />
peuvent donc être coonsidérés<br />
com mme <strong>de</strong>s gares<br />
<strong>de</strong> bus.<br />
fréquemmment<br />
à <strong>de</strong>s pooints<br />
nodaux où passent pplusieurs<br />
ligne<br />
gares rouutières.<br />
Une approche plu us approfondiee<br />
permettrait<br />
milieu (uurbain/rural),<br />
ainsi qu’en fonction f du nnombre<br />
<strong>de</strong> l<br />
fréquencees.<br />
Remarquoons<br />
encore qu ue les arrêts bbien<br />
<strong>de</strong>sservis<br />
(travail, éécole,<br />
gare ferrroviaire…)<br />
qu ue <strong>de</strong>s lieux dd’origine<br />
pour<br />
23 s qui sont <strong>de</strong>ssservis<br />
par au moins 50<br />
et e en additionnnant<br />
les fréqu uences <strong>de</strong><br />
beaucoup plu us nombreux en milieu urb bain et ne<br />
En milieu ru ural, ces arrêêts<br />
correspon<strong>de</strong>nt<br />
plus<br />
es et nous semblent<br />
plus pproches<br />
du concept<br />
<strong>de</strong><br />
t <strong>de</strong> définir <strong>de</strong>s d seuils diffférents<br />
en fo onction du<br />
ignes passan nt par arrêt eet<br />
pas seulement<br />
<strong>de</strong>s<br />
s sont plus fré équemment d<strong>de</strong>s<br />
lieux <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination d<br />
les gens qui se s déplacent.<br />
Ce seuil d<strong>de</strong><br />
50 bus parr<br />
jour correspo ond à environ 3 bus par heure,<br />
les <strong>de</strong>ux sens confonddus.<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 24<br />
21<br />
En date du 04/06/2010, nous avons ren ncontré Nadia Neeven<br />
<strong>de</strong> la SRW WT (Direction <strong>de</strong> la Communicatioon<br />
- Cellule Dév veloppement<br />
Durable). LLe<br />
concept <strong>de</strong> « gare routière » <strong>de</strong>s TEC (ou nnœud<br />
TEC avec départs/croisem ments <strong>de</strong> plusieuurs<br />
lignes) est en e cours <strong>de</strong><br />
définition ppar<br />
la SRWT.<br />
22<br />
Des donnnées<br />
géographiques<br />
sur la localis sation <strong>de</strong>s arrêtss<br />
<strong>de</strong> bus du TEC et <strong>de</strong>s informati ions sur l’offre een<br />
septembre 20 009 nous ont<br />
été commuuniquées<br />
par la SSRWT<br />
– Direction<br />
Communicatioon<br />
et Développem ment Durable. Ces<br />
informations ne concernent donc d pas les<br />
arrêts du mmétro<br />
<strong>de</strong> Charlerooi,<br />
ni l’offre en tra ansports en commmun<br />
d’opérateurs<br />
externes à la Wallonie. W<br />
23<br />
La base <strong>de</strong> données géoographiques<br />
fournie<br />
par la SRWTT<br />
comporte un se eul point pour re eprésenter les <strong>de</strong>eux<br />
arrêts corres spondant au<br />
<strong>de</strong>ux sens d<strong>de</strong><br />
circulation (« <strong>de</strong>ux poteaux so ont représentés ppar<br />
un point »).
La carte ssuivante<br />
repréésente<br />
pour la a Wallonie la ssomme<br />
<strong>de</strong>s différentes<br />
zones<br />
d’accessibbilité.<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 25<br />
Comme ppour<br />
les garees<br />
non IC-IR, la distance dd’accessibilité<br />
é à ces arrêts s est fixée à 1000 mètres,<br />
distance<br />
parcouruee<br />
à pied en 155<br />
minutes.<br />
Carte 4 : Comparaisoon<br />
<strong>de</strong>s critère es d’accessibbilité<br />
aux gar res et aux arr rêts <strong>de</strong> bus bbien<br />
<strong>de</strong>sservis<br />
Au total, si on agrège les zones buf ffers autour d<strong>de</strong>s<br />
gares (350 00m et 1000m m) et les zonees<br />
autour <strong>de</strong>s s arrêts <strong>de</strong><br />
bus bien <strong>de</strong>sservis, le territoire couv vert est d’unee<br />
superficie <strong>de</strong> e 2745 km². Une U gran<strong>de</strong> paart<br />
<strong>de</strong>s buffers s bus sont<br />
compris ddans<br />
les buffeers<br />
entourant les gares. C’eest<br />
le cas dan ns les espaces<br />
urbains maais<br />
aussi dans s certaines<br />
communees<br />
rurales où les gares <strong>de</strong> chemin <strong>de</strong> feer<br />
sont accom mpagnées d’a arrêts <strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>sservis,<br />
afin <strong>de</strong><br />
créer un nœud <strong>de</strong> trransport<br />
en commun c (qui peut être un<br />
lieu <strong>de</strong> tra ansbor<strong>de</strong>mentt,<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>stination<br />
et/ou<br />
d’origine) ). Certains aarrêts<br />
<strong>de</strong> bus s bien <strong>de</strong>sseervis<br />
sont élo oignés du ré éseau ferré eexistant<br />
aujou urd’hui et<br />
constitueent<br />
<strong>de</strong>s points TEC importan nts pour certaaines<br />
communes<br />
comme Florennes, F Meettet,<br />
Perwez, Villers-le-<br />
Bouillet, La Calamine…<br />
Un certain<br />
nombre <strong>de</strong>e<br />
ces arrêts bien <strong>de</strong>sserv vis en milieu rural corresp pon<strong>de</strong>nt à<br />
d’anciennnes<br />
gares <strong>de</strong> cchemin<br />
<strong>de</strong> fer r.<br />
Par rapport<br />
aux noyaaux<br />
d’habitat, les buffers autour <strong>de</strong>s arrêts a <strong>de</strong> bus n’englobent que quelque es noyaux<br />
supplémeentaires<br />
(Jodooigne,<br />
Braives,<br />
Verlaine, VVillers-le-Bouillet,<br />
Mettet, Florennes…) ). De nombre eux autres<br />
noyaux d<strong>de</strong><br />
région ruraale<br />
ne sont pa as compris daans<br />
un <strong>de</strong>s buffers<br />
d’accessibilité.<br />
Il s’aagit<br />
essentiellement<br />
<strong>de</strong><br />
noyaux coonstituant<br />
le ccentre<br />
administratif<br />
<strong>de</strong>s communes.
2.3.3. TTableau<br />
récappitulatif<br />
Une syntthèse<br />
<strong>de</strong>s superficies<br />
<strong>de</strong> ces différentees<br />
zones calculées<br />
pour l’ensemble ddu<br />
territoire wallon w est<br />
présentéee<br />
dans le tableau<br />
suivant.<br />
3. Réésultatts<br />
3.1. LOCCALISATION<br />
DE LA NOUV VELLE RÉSIDEENCE<br />
ET NOY YAUX D’HABITAT<br />
Dans cettte<br />
partie du travail, la loc calisation <strong>de</strong> lla<br />
nouvelle ré ési<strong>de</strong>nce a ét té analysée ppar<br />
rapport au ux noyaux<br />
d’habitat tels que définis<br />
par Delforge<br />
et Géron (2008) car ce ette définition n nous apparaaît<br />
à l’heure actuelle a la<br />
plus apprropriée<br />
à la vision<br />
<strong>de</strong> déve eloppement teerritorial<br />
prôné ée par le Schéma<br />
<strong>de</strong> Déveeloppement<br />
<strong>de</strong> e l’Espace<br />
Régional (SDER). Cepeendant,<br />
comm me il a été vu, la définition <strong>de</strong> d Delforge et t Géron ne preend<br />
pas direct tement en<br />
compte lees<br />
services ett<br />
équipements s existants, plus<br />
proche <strong>de</strong> la définition d’un d centre foonctionnel,<br />
ain nsi que les<br />
réseaux d<strong>de</strong><br />
transport een<br />
commun au utres que les ggares<br />
IC/IR.<br />
3.1.1. NNoyaux<br />
d’habiitat<br />
sans la co ontrainte du PAASH<br />
3.1.1.1.<br />
Les donnnées<br />
<strong>de</strong> population<br />
peuven nt déjà nous ddonner<br />
une id dée <strong>de</strong> la ten ndance <strong>de</strong> l’urbanisation<br />
durant<br />
une<br />
gran<strong>de</strong> ppartie<br />
<strong>de</strong>s annnées<br />
2000. Le e tableau ci-d<strong>de</strong>ssous<br />
mont tre que la population<br />
walloonne<br />
se répartissait<br />
en<br />
2001 <strong>de</strong> ffaçon<br />
assez éégale<br />
entre les s noyaux et lee<br />
reste du terr ritoire. En 6 an ns cependant, , la population n hors <strong>de</strong>s<br />
noyaux a fortement auugmenté<br />
(+72 2 274 habitannts).<br />
Cette aug gmentation re eprésente 80,88%<br />
<strong>de</strong> l’accro oissement<br />
démograpphique<br />
wallonn.<br />
Tableau<br />
et 2007<br />
Dans les nooyaux<br />
Hors Noyauux<br />
Région wallonne<br />
Evolution <strong>de</strong>e<br />
la population n<br />
4 : Évolutionn<br />
<strong>de</strong> la popula ation dans ett<br />
en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s d noyaux d’habitat d enttre<br />
le 1er janvier<br />
2001<br />
Population 2001<br />
1 654 583<br />
1 691 874<br />
3 346 457<br />
Population 2007 7 Sol<strong>de</strong><br />
2007-2001<br />
1 671 731<br />
1764 4 148<br />
3435 5 879<br />
Sources : SPF F Economie-DGSIE, doonnées<br />
du registre nat ational au 1 er<br />
janvier ; ICEDD, 2008 ; calculs s <strong>IWEPS</strong><br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 26<br />
Tableau 3 : Superficiees<br />
<strong>de</strong>s différe entes zones étudiées rép pondant aux critères c <strong>de</strong> loocalisation<br />
Différentess<br />
zones <strong>de</strong> référrence<br />
Suuperficie<br />
Part <strong>de</strong> la Part <strong>de</strong> la superficie Nombre N <strong>de</strong><br />
coouverte<br />
(km²) superficie <strong>de</strong> zones dd’habitat<br />
communes c<br />
wallonne (%) au plan <strong>de</strong>e<br />
secteur<br />
(%)<br />
couvertes c<br />
Noyaux d'hhabitat<br />
sans la coontrainte<br />
PASH<br />
754<br />
4,5 4<br />
24,8<br />
262<br />
Noyaux d'hhabitat<br />
avec la coontrainte<br />
PASH<br />
598<br />
3,6 3<br />
24,1<br />
248<br />
3500 mètrees<br />
autour <strong>de</strong> touttes<br />
les gares et points p<br />
d'arrêt SNCCB<br />
3409<br />
20 0,2<br />
53,3<br />
210<br />
3500 m auttour<br />
<strong>de</strong>s IC-IR et 1000 m autour <strong>de</strong>s autres<br />
1411<br />
8,4 8<br />
34,8<br />
186<br />
3500 m auttour<br />
<strong>de</strong>s IC-IR et 1000 m autour <strong>de</strong>s autres<br />
et 1000 m autour <strong>de</strong>s arrêtss<br />
<strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>sservis<br />
Source : <strong>IWEPS</strong> PS<br />
2745<br />
16 6,3<br />
41,4<br />
198<br />
+ 17 1488<br />
+ 72 2744<br />
+ 89 4222<br />
Taux d'é évolution<br />
(2001- -2007)<br />
+ 1,0%<br />
+ 4,3%<br />
+ 2,7%
Lorsque les chiffres <strong>de</strong> population<br />
par secteuur<br />
statistique pour les an nnées 2008, 2009 et 2010<br />
seront<br />
disponibles,<br />
il sera aloors<br />
possible <strong>de</strong> e mettre à jouur<br />
ce tableau et e <strong>de</strong> voir si cette c tendancee<br />
s’est poursu uivie ces 3<br />
<strong>de</strong>rnièress<br />
années.<br />
3.1.1.2.<br />
Parmi less<br />
60 950 parccelles<br />
rési<strong>de</strong>nt tielles bâties eentre<br />
le 01/01 1/2001 et le 31/12/2008, 3 113<br />
897 appartenaient<br />
à<br />
un noyauu<br />
d’habitat, soit<br />
22,8%.<br />
Autremennt<br />
dit, 22,8% <strong>de</strong>s parcelles s construites entre le 01/0 01/2001 et le 31/12/2008 eet<br />
enregistrée es comme<br />
rési<strong>de</strong>ntieelles<br />
par le caadastre<br />
sont in ncluses dans un noyau d’ha abitat.<br />
3.1.1.3.<br />
Nombre <strong>de</strong> nouvelles con nstructions suur<br />
<strong>de</strong>s parcelle es rési<strong>de</strong>ntielle es<br />
Nombre <strong>de</strong> nouveaux loge gements<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 27<br />
Parmi less<br />
72 921 logeements<br />
créés entre le 01/001/2001<br />
et le e 31/12/2008, , 23 669 logeements<br />
(32,4% %) ont été<br />
créés au sein d’un nnoyau<br />
d’habitat<br />
sur 12 6993<br />
parcelles. Les parcelles s bâties danss<br />
les noyaux d’habitat<br />
pendant lla<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence ont t accueilli en mmoyenne<br />
1,9 logement.<br />
Au niveauu<br />
communal, la part <strong>de</strong>s logements l ouu<br />
parcelles ré écemment bât ties est largement<br />
influenc cée par la<br />
couverturre<br />
du territoirre<br />
par un noy yau d’habitat. Les commun nes qui ont <strong>de</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>s pparts<br />
<strong>de</strong> leur superficie<br />
couverte par un ou <strong>de</strong>ss<br />
noyaux auro ont plus <strong>de</strong> chhances<br />
<strong>de</strong> voir<br />
leur nouvelle<br />
urbanisationn<br />
au sein d’un n noyau. Il<br />
existe ceependant<br />
certaaines<br />
commu unes où le loggement<br />
s’est concentré au u sein <strong>de</strong>s noyyaux,<br />
même si ceux-ci<br />
sont peu étendus (Dinaant,<br />
Spa, Libra amont, Virton…).<br />
Carte 5 : Part <strong>de</strong> nouvveaux<br />
logements<br />
construuits<br />
dans un noyau n d’habitat<br />
entre 20001<br />
et 2009
Carte 6 : Part <strong>de</strong> nouuvelles<br />
parce elles bâties<br />
2009<br />
Afin <strong>de</strong> limiter<br />
l’effet <strong>de</strong> la superfi icie communaale<br />
couverte par un noyau u, on peut traavailler<br />
à l’éc chelle <strong>de</strong>s<br />
complexees<br />
rési<strong>de</strong>ntielss<br />
urbains ou <strong>de</strong>s d régions urrbaines<br />
tels qu ue définis par Van Hecke ett<br />
al., 2009.<br />
Tableau 5 : Part <strong>de</strong> nouveaux lo ogements coonstruits<br />
(ent tre le 01/01/ /2001 et le 31/12/2008) dans un<br />
noyau d’ ’habitat par ccomplexe<br />
rés si<strong>de</strong>ntiel urbaain<br />
(%)<br />
Agglomération n Bannlieue<br />
Zone <strong>de</strong> es migrants Total du com mplexe<br />
alternan nts<br />
rési<strong>de</strong>ntiel urbain u<br />
Bruxelles<br />
71,7<br />
43,5<br />
32,22<br />
42,8<br />
Charleroi<br />
70,4<br />
16,7<br />
17,55<br />
36,9<br />
Liège<br />
48,0<br />
8,6<br />
23,66<br />
30,4<br />
Mons<br />
60,2<br />
17,2<br />
12,55<br />
42,8<br />
Namur<br />
42,9<br />
3,9<br />
11,99<br />
22,8<br />
Tournai<br />
43,4<br />
4,8<br />
16,11<br />
27,8<br />
Verviers<br />
42,0<br />
8,0<br />
7,11<br />
25,2<br />
Total <strong>de</strong>s coomplexes<br />
<strong>de</strong><br />
la Région wwallonne<br />
54,5<br />
22,9<br />
24,22<br />
34,9<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 28<br />
pour le loge ement dans un u noyau d’hhabitat<br />
entre e 2001 et<br />
Dans les communes ssituées<br />
hors d’un d complexxe<br />
rési<strong>de</strong>ntiel urbain, les noyaux<br />
d’habittat<br />
ont accue eilli 27,7%<br />
<strong>de</strong>s nouveaux<br />
logemennts.
Tableau 6 : Part <strong>de</strong> nouveaux lo ogements coonstruits<br />
(ent tre le 01/01/ /2001 et le 31/12/2008) dans un<br />
noyau d’ ’habitat par rrégion<br />
urbain ne<br />
Région urbbaine<br />
:<br />
Part <strong>de</strong> nouvveaux<br />
logement ts construits Part <strong>de</strong> la supeerficie<br />
<strong>de</strong> la RU couverte<br />
dans un noyyau<br />
d’habitat (% %)<br />
par <strong>de</strong>s noyauux<br />
d'habitat (%)<br />
Bruxelles<br />
50,9<br />
11,3<br />
Charleroi<br />
46,2<br />
15,8<br />
Liège<br />
32,0<br />
10,5<br />
Mons<br />
45,6<br />
16,4<br />
Namur<br />
27,4<br />
4,5<br />
Tournai<br />
34,0<br />
7,1<br />
Verviers<br />
28,3<br />
6,2<br />
Total <strong>de</strong>s réégions<br />
urbaines wwallonnes<br />
39,4<br />
10,9<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
Pour rapppel,<br />
dans l’ensemble<br />
du te erritoire wallonn,<br />
32,4% <strong>de</strong>s s nouveaux log gements ont pris place au sein d’un<br />
noyau. Seeules<br />
les régioons<br />
urbaines <strong>de</strong> Bruxelles, Charleroi, Mo ons et Tournai i font mieux.<br />
Dans les régions urbaines<br />
<strong>de</strong> Liège, , Namur et Veerviers,<br />
plus <strong>de</strong><br />
67% <strong>de</strong>s log gements ont ppris<br />
place en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
noyaux d’habitat.<br />
La dispersion<br />
sur le territoire peeut<br />
donc être considérée co omme relativeement<br />
importante.<br />
La régionn<br />
urbaine la pplus<br />
couverte par <strong>de</strong>s noyaaux<br />
d’habitat est celle <strong>de</strong> Mons, mais cce<br />
n’est pas pour p cette<br />
raison quue<br />
l’on y trouvve<br />
la plus gran n<strong>de</strong> part <strong>de</strong> loogements<br />
con nstruits au sein<br />
<strong>de</strong>s noyauxx<br />
d’habitat. To ournai n’a,<br />
par exemmple,<br />
que 7,1% % <strong>de</strong> la super rficie <strong>de</strong> sa réégion<br />
urbaine couverte mais<br />
elle a vu unne<br />
part <strong>de</strong> 34 4% <strong>de</strong> ses<br />
nouveauxx<br />
logements cconstruits<br />
au sein s d’un noyaau.<br />
3.1.1.4.<br />
Superficies <strong>de</strong>s parcelles s construites<br />
Parmi less<br />
7048 ha <strong>de</strong> parcelles con nstruites penddant<br />
la pério<strong>de</strong> e <strong>de</strong> référence,<br />
qui sont <strong>de</strong>e<br />
nature rési<strong>de</strong>ntielle<br />
et<br />
qui accueeillent<br />
<strong>de</strong>s logements,<br />
973, 4 ha sont situués<br />
dans les noyaux n d’habit tat, soit à peinne<br />
13,8%.<br />
En nombrre<br />
<strong>de</strong> parcellees,<br />
elles sont 12 1 578, soit 222,1%<br />
<strong>de</strong>s 56 931 parcelles s considéréess.<br />
3.1.2. NNoyaux<br />
d’habiitat<br />
avec la co ontrainte du PAASH<br />
Parmi less<br />
72 921 logeements<br />
créés entre le 01/001/2001<br />
et le e 31/12/2008, , 23 219 logeements<br />
(31,8% %) ont été<br />
créés au sein d’un noyyau<br />
d’habitat sur s 12 284 paarcelles.<br />
3.1.3. TTableaux<br />
récaapitulatifs<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 29<br />
Les difféérences<br />
entree<br />
ces pourcentages<br />
montrrent<br />
que les logements construits c au sein <strong>de</strong>s no oyaux ont<br />
consommmé<br />
moins <strong>de</strong> ssuperficie<br />
au sol s que ceux cconstruits<br />
hor rs noyaux.<br />
Les <strong>de</strong>uxx<br />
tableaux suivants<br />
permet ttent <strong>de</strong> compparer<br />
la défini ition <strong>de</strong>s noya aux d’habitat, , en prenant ou o non en<br />
compte laa<br />
contrainte eenvironnement<br />
tale liée au PAASH.
Tableau 7 : Part <strong>de</strong> nouveaux lo ogements coonstruits<br />
(ent tre le 01/01/ /2001 et le 31/12/2008) dans un<br />
noyau d’ ’habitat sanss<br />
la contrainte<br />
PASH<br />
Noyaux saans<br />
contrainte PPASH<br />
Danss<br />
un noyau sans s Wallon nie<br />
Part dans un noyau<br />
conttrainte<br />
PASH<br />
(%)<br />
Superficie ddu<br />
territoire<br />
75 54 km²<br />
16 844 kmm²<br />
4,5<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
ZH (2008)<br />
44 48 km²<br />
1806 kmm²<br />
24,8<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et<br />
ZACC (20088)<br />
112,7<br />
km²<br />
792,8 kmm²<br />
14,2<br />
Nombre <strong>de</strong> parcelles bâtiess<br />
entre le 01/01/2 2001 et<br />
le 31/12/20008<br />
et comportannt<br />
au moins un<br />
logement<br />
12 1 693<br />
57 3665<br />
22,1<br />
Nombre <strong>de</strong> logements créés<br />
entre le 01/01/ /2001 et<br />
le 31/12/20008<br />
23 2 669<br />
72 9221<br />
32,5<br />
Nombre <strong>de</strong> logements existtants<br />
(2009)<br />
78 86 283<br />
1 525 0664<br />
51,6<br />
Population 2004<br />
163 38 793<br />
3 380 4998<br />
48,5<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; CPD PDT ; ICEDD ; calculs <strong>IWEPS</strong> I<br />
Tableau 8 : Part <strong>de</strong> nouveaux lo ogements coonstruits<br />
(ent tre le 01/01/ /2001 et le 31/12/2008) dans un<br />
noyau d’ ’habitat avecc<br />
la contrainte<br />
PASH<br />
Noyaux avvec<br />
contrainte PPASH<br />
Danss<br />
un noyau avec c Wallonie<br />
Part dans un u noyau<br />
conttrainte<br />
PASH<br />
(%)<br />
Superficie ddu<br />
territoire<br />
597, 8 km²<br />
16 844 kmm²<br />
3,5<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
ZH (2008)<br />
436<br />
km²<br />
1806 kmm²<br />
24,1<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et<br />
ZACC (20088)<br />
107,7km²<br />
792,8 kmm²<br />
13,6<br />
Nombre <strong>de</strong> parcelles bâtiess<br />
entre le 01/01/2 2001 et<br />
le 31/12/20008<br />
et comportannt<br />
au moins un<br />
logement<br />
12<br />
284<br />
57 3655<br />
21,4<br />
Nombre <strong>de</strong> logements créés<br />
entre le 01/01/ /2001 et<br />
le 31/12/20008<br />
23<br />
219<br />
72 9211<br />
31,8<br />
Nombre <strong>de</strong> logements existtants<br />
(2009)<br />
776<br />
005<br />
1 525 0644<br />
50,9<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; CPD PDT ; ICEDD ; calculs <strong>IWEPS</strong> I<br />
Comme il<br />
a été écrit pprécé<strong>de</strong>mment,<br />
la prise en compte <strong>de</strong> la a contrainte amène<br />
une baiisse<br />
<strong>de</strong> super rficie <strong>de</strong> la<br />
couverturre<br />
spatiale <strong>de</strong>es<br />
noyaux d’e environ 150 kkm²<br />
et 14 co ommunes n’ont<br />
alors plus aucun noyau u sur leur<br />
territoire.<br />
La compaaraison<br />
<strong>de</strong>s d<strong>de</strong>ux<br />
tableaux x permet <strong>de</strong> vvoir<br />
que les 150<br />
km² <strong>de</strong> différence<br />
conccernent<br />
en fa ait à peine<br />
10 278 loogements<br />
exisstants<br />
et 12 km² k <strong>de</strong> zoness<br />
d’habitat du plan <strong>de</strong> secte eur. La contraainte<br />
supprim me, en fait,<br />
beaucoupp<br />
<strong>de</strong> parties <strong>de</strong> secteurs statistiques s dd’habitat<br />
dispersé,<br />
qui son nt non urbanissables<br />
actuel llement. Il<br />
s’agit, paar<br />
exemple, <strong>de</strong>e<br />
cours d’eau u ou <strong>de</strong> territooires<br />
agricoles s qui répondaient<br />
au critèree<br />
<strong>de</strong> proximité é <strong>de</strong> 3 km<br />
d’une gaare<br />
mais qui nne<br />
sont pas situés s dans d<strong>de</strong>s<br />
zones en régime d’ass sainissement collectif ou en e régime<br />
d’assainisssement<br />
transsitoire.<br />
3.2.1. CCritère<br />
d’accessibilité<br />
aux gares g SNCB saans<br />
hiérarchis sation<br />
3.2.1.1.<br />
Nombre <strong>de</strong> nouvelles con nstructions suur<br />
<strong>de</strong>s parcelle es rési<strong>de</strong>ntielle es<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 30<br />
3.2. LOCCALISATION<br />
DE LA NOU UVELLE RÉSSIDENCE<br />
PAR R RAPPORT À L’OFFRE EN TRANSP PORT EN<br />
COMMUN<br />
Entre le 01/01/2001 et le 31/12/ 2008, 60 9500<br />
bâtiments ont été cons struits sur <strong>de</strong>es<br />
parcelles <strong>de</strong> nature<br />
rési<strong>de</strong>ntieelle<br />
en Wallonnie.
Nous avoons<br />
réparti cess<br />
parcelles en<br />
<strong>de</strong>s garess<br />
par pas <strong>de</strong> 500 m<br />
cercle.<br />
24<br />
n fonction <strong>de</strong> lleur<br />
localisatio on par rapport t à <strong>de</strong>s cerclees<br />
concentriqu ues autour<br />
. Une e parcelle est incluse dans le cercle lors sque son centtroï<strong>de</strong><br />
est situ ué dans le<br />
Parmi ces<br />
60 950 bâttiments,<br />
55,3% % (33 734) oont<br />
été constr ruits dans un périmètre <strong>de</strong>e<br />
3,5 kilomètr res autour<br />
<strong>de</strong>s garess<br />
en activité.<br />
Graphiquue<br />
3 : Nombbre<br />
<strong>de</strong> bâtim ments « résid<strong>de</strong>ntiels<br />
» con nstruits entr re 2001 et 22009<br />
et dist tance par<br />
rapport aaux<br />
gares enn<br />
Wallonie<br />
Nombre <strong>de</strong> bâtiments rési<strong>de</strong>ntiels construits<br />
entre 2001 et 2009<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
3.2.1.2.<br />
300000<br />
255000<br />
200000<br />
155000<br />
100000<br />
55000<br />
0<br />
Entre 0 et<br />
500 m<br />
Nombre <strong>de</strong> nouveaux loge gements<br />
Entre 500 0 et Entre 10000<br />
Entre 1500 Entre 2000 Entre E 2500<br />
1000 m<br />
et 1500 m et 2000 m et 2500 m et 3000 m<br />
DDistance<br />
à la ga are la plus proch he<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 31<br />
enntre<br />
3000<br />
ett<br />
3500 m<br />
Suite à l’analyse<br />
<strong>de</strong>s données du cadastre, onn<br />
peut consid dérer que 72 921 logemeents<br />
ont été c<br />
Wallonie entre le 01/011/2001<br />
et le 31/12/2008. 3<br />
Au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong><br />
35 500 m<br />
créés 25<br />
Parmi ces<br />
72 921 logeements,<br />
61,1%<br />
(44 532) oont<br />
été constr ruits dans un périmètre <strong>de</strong>e<br />
3,5 kilomètr res autour<br />
<strong>de</strong>s garess<br />
en activité.<br />
24<br />
Alors quee<br />
les intervalles d<strong>de</strong><br />
distance autou ur <strong>de</strong>s gares auggmentent<br />
<strong>de</strong> faço on constante (pas<br />
<strong>de</strong> 500 mètress),<br />
la superficie d’accueil d <strong>de</strong>s<br />
logements entre ces pas <strong>de</strong>e<br />
500 mètres évo olue selon une puissance<br />
2. La surface s d’accueil entre 3000 et 33500<br />
m par rappo ort au cercle<br />
<strong>de</strong> 500 m aautour<br />
<strong>de</strong> la garre<br />
est par exemp ple 15 fois plus ggran<strong>de</strong>.<br />
Cet élém ment est importa ant à prendre enn<br />
compte dans l’ ’analyse <strong>de</strong>s<br />
graphiquess<br />
3, 4 et 5.<br />
25<br />
Plus préccisément,<br />
72 921 logements exist tent sur 57 365 pparcelles<br />
qui ont t été construites entre le 01/01/22001<br />
et le 31/12/ /2008.<br />
en
Graphiquue<br />
4 : Nombrre<br />
<strong>de</strong> logeme ents sur <strong>de</strong>s parcelles co onstruites en ntre 2001 et 2009 et dist tance par<br />
rapport aaux<br />
gares enn<br />
Wallonie<br />
Nombre <strong>de</strong> logements sur <strong>de</strong>s parcelles construites entre<br />
2001 et 2009<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
3.2.1.3.<br />
300000<br />
255000<br />
200000<br />
155000<br />
100000<br />
55000<br />
0<br />
Entre 0 et Entre 50 00 Entre 10000<br />
500 m et 1000 m et 1500 m<br />
Superficies <strong>de</strong>s parcelles s construites<br />
Entre 1500<br />
et 2000 m<br />
Diistance<br />
à la gare<br />
la plus proch he<br />
Pour le ccalcul<br />
<strong>de</strong>s superficies,<br />
il nous n semble peu opportun n d’utiliser l’a approche du nnombre<br />
<strong>de</strong> lo ogements,<br />
puisqu’elle<br />
considère l’ensemble <strong>de</strong> es natures caadastrales<br />
et que certaines s natures nonn<br />
rési<strong>de</strong>ntielles<br />
peuvent<br />
influenceer<br />
largement laa<br />
superficie <strong>de</strong><br />
la parcelle cconstruite<br />
(ex xemple : const truction d’unee<br />
école sur un ne parcelle<br />
avec un logement<br />
prévvu<br />
pour le con ncierge). Il nouus<br />
semble pré éférable <strong>de</strong> n’ ’utiliser que lees<br />
parcelles construites c<br />
pendant lla<br />
pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> référence qui sont <strong>de</strong> nature<br />
rési<strong>de</strong>ntiell le et qui accueillent<br />
<strong>de</strong>s loggements.<br />
Elles sontt<br />
au total 56 9931<br />
et couvrent<br />
une superfficie<br />
<strong>de</strong> 7048 ha.<br />
Entre 2000<br />
et 2500 m<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 32<br />
Entre E 2500 enttre<br />
3000 Au‐d <strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
et e 3000 m et 3500 m 35 500 m<br />
Parmi cess<br />
7048 ha, 488,1%<br />
ont été construits c danns<br />
un périmèt tre <strong>de</strong> 3,5 kilo omètres autouur<br />
<strong>de</strong>s gares en e activité.<br />
Ce pourccentage<br />
est mmoins<br />
élevé qu ue le nombree<br />
<strong>de</strong> logement ts ou le nomb bre <strong>de</strong> parcelles<br />
construite es, car les<br />
superficiees<br />
<strong>de</strong>s parcellles<br />
bâties sont<br />
en moyennee<br />
plus gran<strong>de</strong>s s avec l’éloign nement aux gaares<br />
(voir ci-d <strong>de</strong>ssous).
Graphiquue<br />
5 : Supeerficie<br />
totale e <strong>de</strong>s parceelles<br />
rési<strong>de</strong>n ntielles cons struites entrre<br />
2001 et<br />
comprennant<br />
au moins<br />
un logemen nt et distance<br />
par rappor rt aux gares en e Wallonie<br />
Superficie totale <strong>de</strong>s parcelles (ha)<br />
40000<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
3.2.1.4.<br />
0<br />
Entre 0 ett<br />
Entre 500<br />
500 m et 1000 m<br />
Tableau réccapitulatif<br />
Entre 1000<br />
et 1500 m<br />
Tableau 9 : Statistiques<br />
concern nant les cerccles<br />
<strong>de</strong> 3500 0 mètres aut tour <strong>de</strong>s garres<br />
et points s d’arrêts<br />
passagers<br />
en servicee<br />
Superficie d<strong>de</strong><br />
territoire<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
ZH<br />
Superficie d<br />
Superficie d<br />
(2001)<br />
Superficie d<br />
Superficie d<br />
(2008)<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
Nombre <strong>de</strong><br />
Superficie t<br />
2001 et 20<br />
Sources : SPF<br />
26 (2008)<br />
<strong>de</strong>s terrains non artificialisés en ZH Z (2001)<br />
<strong>de</strong>s terrains non artificialisés en ZH Z et ZACC<br />
<strong>de</strong>s terrains non artificialisés en Z<br />
<strong>de</strong>s terrains non artificialisés en Z<br />
logements (20009)<br />
logements créés<br />
entre 2001 et 2<br />
totale <strong>de</strong>s parcelles<br />
rési<strong>de</strong>ntielles<br />
09<br />
F Finances-AGDP ; CPD PDT-ETW, 2010 ; ICED<br />
27<br />
ZH (2008)<br />
ZH et ZACC<br />
2009<br />
s bâties entre<br />
DD ; calculs <strong>IWEPS</strong><br />
Disttance<br />
à la gare la plus proche<br />
Dans un ray yon <strong>de</strong> 3500<br />
m autour <strong>de</strong> es gares en<br />
service<br />
5286 km²<br />
962 km²<br />
283,9 km²<br />
395,9 km²<br />
3.2.2. CCritère<br />
d’accessibilité<br />
aux gares g SNCB avvec<br />
hiérarchie e<br />
258,0 km²<br />
366,0 km²<br />
1 100 878<br />
44 532<br />
33,9 km²<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 33<br />
Entre 1500 Entre E 2000 En ntre 2500 enttre<br />
3000 Au‐d <strong>de</strong>là <strong>de</strong><br />
et 2000 m et e 2500 m et t 3000 m et 33500<br />
m 3500<br />
m<br />
En Wallonie<br />
16 844 kkm²<br />
1806 kkm²<br />
675,9 kkm²<br />
853,9 kkm²<br />
619 kkm²<br />
793 kkm²<br />
1 525 0064<br />
72 9921<br />
70,5 kkm²<br />
Pour rapppel,<br />
le critère envisagé ici est e la localisaation<br />
au sein d’un d cercle <strong>de</strong> e 3500 mètress<br />
autour d’une<br />
gare IC-<br />
IR ou au ssein<br />
d’un cerccle<br />
<strong>de</strong> 1000 mètres m autour <strong>de</strong> toute autre e gare ou poin nt d’arrêt passsagers.<br />
Le tableaau<br />
ci-<strong>de</strong>ssouss<br />
indique que<br />
43,8 % <strong>de</strong>es<br />
logements s créés en Wallonie W entree<br />
le 01/01/2001<br />
et le<br />
31/12/20008<br />
l’ont été à proximité <strong>de</strong>s<br />
gares, aloors<br />
que ces zo ones concentrent<br />
55,9% d<strong>de</strong>s<br />
logements s wallons.<br />
26<br />
ZH = zonnes<br />
d’habitat au pplan<br />
<strong>de</strong> secteur ; Elles sont définies<br />
aux articles 26 2 et 27 du CWA ATUPE<br />
27<br />
ZACC = zzone<br />
d’aménagement<br />
communal concerté du plaan<br />
<strong>de</strong> secteur ; elle<br />
est définie à l’ article 33 du CWWATUPE<br />
2009 et<br />
Part dans s le rayon<br />
(%)<br />
31,4<br />
53,3<br />
42,0<br />
46,4<br />
41,7<br />
46,2<br />
72,2<br />
61,1<br />
48,1
L’urbanissation<br />
rési<strong>de</strong>nntielle<br />
a conce erné plus partticulièrement<br />
la proximité <strong>de</strong>s gares IC--IR<br />
puisque 37,7% 3 <strong>de</strong>s<br />
logementts<br />
créés ont pris<br />
place à mo oins <strong>de</strong> 3500 mètres <strong>de</strong> ces<br />
gares.<br />
Si l’on coonsidère<br />
les ssuperficies<br />
<strong>de</strong> es parcelles réési<strong>de</strong>ntielles<br />
bâties entre 2001 2 et 20099<br />
(et non le nombre n <strong>de</strong><br />
logementts),<br />
ces nouveelles<br />
parcelles s bâties à prooximité<br />
<strong>de</strong>s ga ares ne comp ptent que pour<br />
27,8% <strong>de</strong> l’ ’ensemble<br />
<strong>de</strong>s nouvelles<br />
parcelles<br />
bâties.<br />
Tableau 10 : Statistiqques<br />
concern nant les cerccles<br />
<strong>de</strong> 3500 0 mètres aut tour <strong>de</strong>s garees<br />
IC-IR et <strong>de</strong> d 1000m<br />
autour <strong>de</strong>s<br />
autres gares<br />
Dans un ray yon <strong>de</strong> 3500 En Wallonie<br />
Part da ans les<br />
m ou 1000 m autour<br />
<strong>de</strong>s gares en e service<br />
buffers<br />
(%)<br />
Superficie d<strong>de</strong><br />
territoire<br />
2447 km²<br />
16 8444<br />
km²<br />
14,5<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
ZH (2008)<br />
628,4 km²<br />
18006<br />
km²<br />
34,8<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z (2001)<br />
163,5 km²<br />
675, ,9 km²<br />
24,2<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et ZACC<br />
(2001)<br />
241,8 km²<br />
853, ,9 km²<br />
28,3<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z (2008)<br />
158,7 km²<br />
619<br />
km²<br />
24,0<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et ZACC<br />
(2008)<br />
224,4 km²<br />
7933<br />
km²<br />
28,3<br />
Nombre <strong>de</strong> logements (20009)<br />
852 075<br />
15225<br />
064<br />
55,9<br />
Nombre <strong>de</strong> logements créés<br />
entre 2001 et 2009 2<br />
31 960<br />
772<br />
921<br />
43,8<br />
Superficie ttotale<br />
<strong>de</strong>s parcelles<br />
rési<strong>de</strong>ntielles s bâties entre<br />
2001 et 2009<br />
19,6 km²<br />
70, ,5 km²<br />
27,8<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; CPD PDT-ETW, 2010 ; ICED DD ; calculs <strong>IWEPS</strong><br />
3.2.3. CCritère<br />
d’accessibilité<br />
aux gares g SNCB avvec<br />
hiérarchie e et critères d’accessibilité<br />
aux arrêts TE EC<br />
Le critèree<br />
envisagé ici est la localisa ation au sein dd’un<br />
cercle <strong>de</strong> e rayon <strong>de</strong> :<br />
33500<br />
mètres autour d’une gare IC-IR ;<br />
<br />
<br />
1000 mètres autour <strong>de</strong> toute<br />
autre gare ou point d’arrêt<br />
passagers SNCB ;<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 34<br />
1000 mètres autour d’un arrêt a <strong>de</strong> bus TTEC<br />
<strong>de</strong>sservi par au moins 50 bus un joour<br />
ouvrable en e pério<strong>de</strong><br />
sscolaire.<br />
50,9% <strong>de</strong>es<br />
logements créés entre le e 01/01/2001 et le 31/12/2 2008 l’ont été à proximité d<strong>de</strong>s<br />
gares ou <strong>de</strong>s arrêts<br />
TEC bien <strong>de</strong>sservis. Laa<br />
prise en com mpte <strong>de</strong>s arrêtts<br />
TEC bien <strong>de</strong> esservis conce erne 7,1% <strong>de</strong>e<br />
logements cr réés.
Tableau 11 : Statistiiques<br />
conce ernant le critère<br />
d’acces ssibilité aux gares SNCBB<br />
avec hiérarchie<br />
et<br />
d’accesssibilité<br />
aux arrrêts<br />
TEC<br />
Dans un ray yon <strong>de</strong> En E Wallonie<br />
Part da ans le<br />
3500 m ou 1000 1 m<br />
autour <strong>de</strong>s gares en<br />
service et 1000<br />
m<br />
autour <strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong><br />
bus bien <strong>de</strong> esservis<br />
rayon (%) (<br />
Superficie d<strong>de</strong><br />
territoire<br />
2744,8 km²<br />
168444<br />
km²<br />
16,3<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
ZH (2008)<br />
748,2 km²<br />
18066<br />
km²<br />
41,4<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z (2001)<br />
197,7 km²<br />
6766<br />
km²<br />
29,2<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et ZACC<br />
(2001)<br />
292,1 km²<br />
8544<br />
km²<br />
34,2<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z (2008)<br />
179,6 km²<br />
6199<br />
km²<br />
29,0<br />
Superficie d<strong>de</strong>s<br />
terrains non artificialisés en ZH Z et ZACC<br />
(2008)<br />
270,9 km²<br />
7933<br />
km²<br />
34,2<br />
Nombre <strong>de</strong> logements (20009)<br />
986931<br />
15225064<br />
64,7<br />
Nombre <strong>de</strong> logements créés<br />
entre 2001 et 2009 2<br />
37126<br />
772921<br />
50,9<br />
Superficie ttotale<br />
<strong>de</strong>s parcelles<br />
rési<strong>de</strong>ntielles s bâties entre<br />
2001 et 2009<br />
23,5 km²<br />
70,55<br />
km²<br />
33,3<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; CPD PDT-ETW, 2010 ; ICED DD ; calculs <strong>IWEPS</strong><br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 35<br />
L’analysee<br />
par communne<br />
peut être faite f sur basee<br />
<strong>de</strong> la carte 7. De façon évi<strong>de</strong>nte, é les ccommunes<br />
qui<br />
ne sont<br />
pas couvvertes<br />
par unee<br />
zone d’acce essibilité auroont<br />
une valeur r nulle. Ces communes<br />
sont<br />
au nombre e <strong>de</strong> 64. Il<br />
s’agit donnc<br />
<strong>de</strong> commuunes<br />
non <strong>de</strong>sservies<br />
par lee<br />
train et par <strong>de</strong>s lignes <strong>de</strong><br />
bus à hautee<br />
fréquence. Elles sont<br />
essentielllement<br />
situéees<br />
dans le sud d-est <strong>de</strong> la proovince<br />
<strong>de</strong> Lièg ge, dans l’est <strong>de</strong> la provincce<br />
<strong>de</strong> Luxembourg<br />
dans<br />
les trianggles<br />
Bruxelles-Liège-Namur<br />
r et Liège-Nammur-Marche<br />
en-Famenne, dans la bottee<br />
du Hainaut et e le nord-<br />
ouest <strong>de</strong> la province d<strong>de</strong><br />
Hainaut. Parmi<br />
les 198 communes dont d une partie<br />
du territoire re est couvert te par une<br />
zone d’acccessibilité,<br />
1110<br />
ont vu plus p <strong>de</strong> logemments<br />
constru uits en <strong>de</strong>hors s <strong>de</strong>s zones qu’en <strong>de</strong>dans.<br />
Les 88<br />
communees<br />
restantes oont<br />
vu plus <strong>de</strong> e logements coonstruits<br />
au sein s <strong>de</strong> ces zones<br />
qu’en <strong>de</strong>hhors.<br />
Les commmunes<br />
ayant une gare IC-IR<br />
sont génééralement<br />
cel lles qui ont le es plus grand<strong>de</strong>s<br />
parts <strong>de</strong> nouveaux<br />
logementts<br />
bien localissés.<br />
Les zones<br />
urbanisablees<br />
<strong>de</strong> quelque es communes sont presquee<br />
intégraleme ent situées<br />
dans <strong>de</strong>ss<br />
zones d’acccessibilité<br />
et ont o donc <strong>de</strong>s s valeurs très élevées. C’est<br />
le cas pouur<br />
Liège, Sain nt-Nicolas,<br />
Herstal, QQuaregnon<br />
Booussu<br />
et Eupen.
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 36<br />
Carte 7 : Part <strong>de</strong> nouvveaux<br />
logements<br />
construuits<br />
dans les zones d’acce essibilité thééoriques<br />
Afin <strong>de</strong> rrelativiser<br />
la valeur prise par cet indiccateur,<br />
il est t intéressant <strong>de</strong> tenir commpte<br />
<strong>de</strong>s disponibilités<br />
foncièress<br />
au plan <strong>de</strong> secteur au sein<br />
<strong>de</strong>s zoness<br />
d’accessibilité<br />
<strong>de</strong> chaqu ue commune concernée. La L carte 8<br />
représentte<br />
la part <strong>de</strong> ssuperficie<br />
bât tie pour la réssi<strong>de</strong>nce<br />
entre le 01/01/200 01 et le 31/122/2008<br />
qui a pris place<br />
au sein d<strong>de</strong>s<br />
zones d’aaccessibilité.<br />
Cette valeur nn’a<br />
pas été calculée c pour les communees<br />
où les disponibilités<br />
foncièress<br />
en ZH(R) et ZZACC<br />
au 01/01/2001<br />
étaiennt<br />
faibles, c’est-à-dire<br />
inférieures<br />
aux suuperficies<br />
bâties<br />
durant<br />
la pério<strong>de</strong>e<br />
<strong>de</strong> référencce<br />
et est bien sûr nulle pouur<br />
les commu unes ne comprenant<br />
pas <strong>de</strong>e<br />
zones d’acc cessibilité.<br />
L’analysee<br />
peut alors êêtre<br />
effectuée e sur les commmunes<br />
qui av vaient <strong>de</strong>s dis sponibilités fooncières<br />
suffisantes<br />
au<br />
sein <strong>de</strong>s zones d’accessibilité.<br />
On peut p voir sur la<br />
carte que plusieurs p communes<br />
qui avvaient<br />
<strong>de</strong>s disponibilités<br />
bien locaalisées<br />
par rappport<br />
à ce crit tère ont pourttant<br />
privilégié é l’urbanisatio on rési<strong>de</strong>ntiellee<br />
loin <strong>de</strong> tout te gare ou<br />
arrêt <strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>ssservis.<br />
En Wallonie,<br />
80 coommunes<br />
ont t vu plus <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> leur superficie bâ âtie par la<br />
rési<strong>de</strong>ncee<br />
en <strong>de</strong>hors d<strong>de</strong>s<br />
zones les plus accessibbles<br />
en transp port en commun<br />
alors que ces commune es avaient<br />
les réserrves<br />
foncièrees<br />
suffisantes s pour accueeillir<br />
l’habitat dans ces zones. z Il s’aggit<br />
essentielle ement <strong>de</strong><br />
communees<br />
rurales.
Carte 8 : Part <strong>de</strong> supeerficie<br />
bâtie par p la nouvellle<br />
rési<strong>de</strong>nce e dans les zon nes d’accesssibilité<br />
théori iques<br />
3.2.4. AAutres<br />
indicateeurs<br />
fonction <strong>de</strong> l’éloignemment<br />
aux gares s<br />
3.2.4.1.<br />
Nombre <strong>de</strong> logements pa ar parcelle<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 37<br />
En utilisaant<br />
les donnéees<br />
du nombre e <strong>de</strong> logementts<br />
par parcelle,<br />
on peut également<br />
consstruire<br />
un indicateur<br />
du<br />
nombre mmoyen<br />
<strong>de</strong> logeements<br />
par parcelle<br />
constrruite<br />
entre le 01/01/2001 et e le 31/12/20008,<br />
et voir comment<br />
il<br />
évolue loorsque<br />
l’on ss’éloigne<br />
<strong>de</strong>s gares. Pour la Wallonie, le nombre moyen m <strong>de</strong> loggements<br />
par bâtiment<br />
construit entre le 01/01/2001<br />
et le 31/12/2008 3 eest<br />
<strong>de</strong> 1,3.
Tableau 12 : Nombree<br />
moyen <strong>de</strong> lo ogements paar<br />
bâtiment construit c entre<br />
le 01/01/22001<br />
et le 31/12/2008<br />
en fonctiion<br />
<strong>de</strong> la disttance<br />
aux ga ares<br />
Distance e à une gare<br />
No ombre moyen <strong>de</strong><br />
logements paar<br />
parcelles<br />
bâties entre<br />
le 01/01/20001<br />
et<br />
le 31/12 2/2008<br />
Entrre<br />
0 et 500 m<br />
2,5<br />
Entrre<br />
500 et 1000 m<br />
1,7<br />
Entrre<br />
1000 et 1500 m<br />
1,3<br />
Entrre<br />
1500 et 2000 m<br />
1,3<br />
Entrre<br />
2000 et 2500 m<br />
1,2<br />
Entrre<br />
2500 et 3000 m<br />
1,2<br />
entrre<br />
3000 et 3500 m<br />
1,1<br />
Entrre<br />
3500 et 4000 m<br />
1,1<br />
Au-d<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 4000 m<br />
1,1<br />
Totaal<br />
Wallonie<br />
1,3<br />
Les nouvveaux<br />
bâtimennts<br />
construits près <strong>de</strong>s garres<br />
accueillen nt en moyenn ne plus <strong>de</strong> loggements.<br />
On peut donc<br />
considéreer<br />
que les abbords<br />
<strong>de</strong>s ga ares ont vu uune<br />
plus gran n<strong>de</strong> proportio on d’immeubles<br />
à apparte ements se<br />
construiree.<br />
3.2.4.2.<br />
La superfficie<br />
au sol mmoyenne,<br />
par logement coonstruit<br />
entre 2001 et 200 09, est <strong>de</strong> 9733<br />
m² pour la Wallonie.<br />
Cette supperficie<br />
varie d<strong>de</strong><br />
façon impo ortante selon lla<br />
localisation n et notammen nt lorsque l’onn<br />
s’éloigne <strong>de</strong> es gares.<br />
Graphiquue<br />
6 : Superfficie<br />
moyenn ne au sol coonsommée<br />
par p logement t construit eentre<br />
2001 et t 2009 et<br />
distancee<br />
par rapport aux gares en n Wallonie<br />
Superficie moyenne par logement (m²)<br />
Superficie aau<br />
sol consom mmée par logeement<br />
14400,0<br />
12200,0<br />
10000,0<br />
8800,0<br />
6600,0<br />
4400,0<br />
2200,0<br />
0,0<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
Sources : SPPF<br />
Finances-AGDP ; calculs c <strong>IWEPS</strong><br />
Entre 0 etEntre<br />
500 0 Entre Entre Entre<br />
Entre<br />
500 m et 1000 1000 et 11500<br />
et 2000 0 et 2500 et<br />
m 1500 m 22000<br />
m 2500 0 m 3000 m<br />
Disstance<br />
à la gare e la plus proche<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 38<br />
entre<br />
3000 et<br />
3500 m<br />
Entre<br />
3500<br />
et<br />
44000<br />
m<br />
Au‐d <strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 40 000<br />
m
L’espace au sol consommé<br />
par loge ement est beaaucoup<br />
plus fa aible à proxim mité <strong>de</strong>s garess<br />
que plus loin n (l’espace<br />
consommmé<br />
par logemeent<br />
est 3,8 fois<br />
plus grand au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> 4000 4 mètres qu’à q moins <strong>de</strong>e<br />
500 m <strong>de</strong>s gares). Le<br />
gradient est fort entree<br />
0 et 4000 mètres. Au-d<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 4000 0 mètres, l’ef ffet <strong>de</strong> l’éloiggnement<br />
semble<br />
moins<br />
prononcéé.<br />
3.2.4.3.<br />
La superfficie<br />
moyennee<br />
<strong>de</strong>s parcelle es construitess<br />
entre 2001 et 2009 est <strong>de</strong> 1238 m² ppour<br />
la Wallo onie. Cette<br />
superficiee<br />
varie <strong>de</strong> faaçon<br />
importan nte selon la localisation et e notammen nt lorsque l’oon<br />
s’éloigne <strong>de</strong>s d gares<br />
(l’espace consommé ppar<br />
parcelle co onstruite est 11,7<br />
fois plus grand g au-<strong>de</strong>là à <strong>de</strong> 4000 mèttres<br />
qu’à moins<br />
<strong>de</strong> 500<br />
m <strong>de</strong>s gaares).<br />
Le gradient<br />
est cepen ndant moins pprononcé<br />
que pour la superficie<br />
par logeement,<br />
étant donné d que<br />
les parceelles<br />
construitees<br />
à proximité é <strong>de</strong>s gares acccueillent<br />
un plus p grand no ombre <strong>de</strong> logeements.<br />
Graphiquue<br />
7 : Superfficie<br />
moyenne<br />
au sol <strong>de</strong>ss<br />
parcelles construites<br />
en ntre 2001 et 2009 et dist tance par<br />
rapport aaux<br />
gares enn<br />
Wallonie<br />
Superficie moyenne par parcelle (m²)<br />
Superficie aau<br />
sol consom mmée par parccelle<br />
bâtie<br />
1600,0<br />
1400,0<br />
1200,0<br />
1000,0<br />
800,0<br />
600,0<br />
400,0<br />
200,0<br />
0,0<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
Entre 0 etEntre<br />
500 0 Entre<br />
5000<br />
m et 1000 1000 et<br />
m 1500 m<br />
Entre<br />
11500<br />
et<br />
22000<br />
m<br />
Ent tre<br />
2000 0 et<br />
2500 0 m<br />
Entre<br />
2500 et<br />
3000 m<br />
Disstance<br />
à la gare e la plus proche<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 39<br />
entre<br />
3000 et<br />
3500 m<br />
Entre<br />
33500<br />
et<br />
44000<br />
m<br />
Au‐d <strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> 40 000<br />
m<br />
3.3. LOCCALISATION<br />
DE LA NOUV VELLE RÉSIDEENCE<br />
ET CAR RTES D’ACCE ESSIBILITÉ DDU<br />
LEPUR-CP PDT<br />
Les 57 3665<br />
parcelles qqui<br />
accueillen nt les 72 921 llogements<br />
cré éés entre le 01/01/2001 0 ett<br />
le 31/12/200 08 ont été<br />
confrontéées<br />
à la carte d’accessibilité<br />
du LEPUR-CCPDT,<br />
concern nant l’ensemb ble <strong>de</strong>s alternaatives<br />
à la voi iture. Pour<br />
chaque pparcelle,<br />
nous avons calculé é sa valeur d’aaccessibilité<br />
moyenne m (par rt modale atteendue).<br />
A partir<br />
<strong>de</strong> cette<br />
valeur, unne<br />
moyenne a pu être calculée<br />
par logement<br />
pour l’e ensemble <strong>de</strong>s communes wwallonnes.<br />
Les s résultats<br />
sont préssentés<br />
à la carrte<br />
9.<br />
La valeurr<br />
<strong>de</strong> l’indicateeur<br />
est donc une u part moddale<br />
attendue moyenne : en n moyenne suur<br />
cette comm mune, sur<br />
cent habiitants<br />
résidannt<br />
dans un log gement créé eentre<br />
le 01/01 1/2001 et le 31/12/2008, 3 uun<br />
nombre X <strong>de</strong>vrait le<br />
quitter paar<br />
une alternaative<br />
à la voiture<br />
pour se renndre<br />
au travai il.
L’indicateeur<br />
sur l’accesssibilité<br />
<strong>de</strong>s nouveaux n logeements<br />
par co ommune est fo ortement influuencé<br />
par l’accessibilité<br />
moyennee<br />
<strong>de</strong> la commune<br />
: les com mmunes dont le territoire est e fortement accessible ppar<br />
les alterna atives à la<br />
voiture onnt,<br />
en généraal,<br />
<strong>de</strong>s valeurs s <strong>de</strong> l’indicateeur<br />
élevées. Il s’agit <strong>de</strong> bea aucoup <strong>de</strong> coommunes<br />
<strong>de</strong> Hainaut H et<br />
<strong>de</strong> l’ouesst<br />
du Brabantt<br />
wallon. A l’i inverse, la plupart<br />
<strong>de</strong>s communes<br />
luxe embourgeoisees<br />
ont <strong>de</strong>s va aleurs très<br />
faibles. LLes<br />
régions uurbaines<br />
<strong>de</strong> Liège<br />
et Vervieers<br />
présenten nt également <strong>de</strong> faibles vaaleurs<br />
en com mparaison<br />
avec d’auutres<br />
régions urbaines.<br />
Parfois, bbien<br />
que les ccommunes<br />
aie ent la gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong> le eur territoire peu p accessiblle<br />
par les alte ernatives à<br />
la voituree,<br />
l’indicateur est quand même<br />
élevé, caar<br />
au sein mê ême <strong>de</strong> la com mmune, les nnouveaux<br />
loge ements se<br />
sont localisés<br />
dans <strong>de</strong>ss<br />
lieux access sibles. C’est lee<br />
cas par exem mple à Spa, Bertrix B ou Eupeen.<br />
Carte 9 : Indicateur d’accessibi ilité <strong>de</strong>s loggements<br />
con nstruits entre<br />
2001 et 22009<br />
par le es mo<strong>de</strong>s<br />
alternatifs<br />
à la voiturre<br />
Afin <strong>de</strong> relativiser<br />
les valeurs <strong>de</strong> l’ indicateur paar<br />
commune, il pourrait êtr re intéressantt<br />
<strong>de</strong> le pondé érer par la<br />
valeur mooyenne<br />
d’acccessibilité<br />
<strong>de</strong>s logements eexistants<br />
ou <strong>de</strong>s<br />
zones d’ha abitat existanttes.<br />
Les logements<br />
qui<br />
présentennt<br />
<strong>de</strong>s parts mmodales<br />
attendues<br />
élevées pourraient ég galement être mis en évi<strong>de</strong>nce.<br />
3.4. LOCCALISATION<br />
DE LA NOUV VELLE RÉSIDEENCE<br />
ET COM MPLEXES RÉ ÉSIDENTIELSS<br />
URBAINS<br />
3.4.1. AApproche<br />
par l’évolution <strong>de</strong> e la populationn<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 40<br />
Entre le 1<br />
habitants<br />
er<br />
janvier 20001<br />
et le 1<br />
s, soit <strong>de</strong> 3,3%<br />
er<br />
janvier j 2008, la population n wallonne a connu une ccroissance<br />
<strong>de</strong> e 110 318<br />
% (source : SP PF Economie-DDGSIE).
60,8% <strong>de</strong>e<br />
cette croisssance<br />
a eu lieu<br />
en <strong>de</strong>hors d<strong>de</strong>s<br />
7 régions s urbaines wa allonnes (ou ppartie<br />
<strong>de</strong> régio on urbaine<br />
pour Bruxxelles)<br />
et a doonc<br />
pris place au sein <strong>de</strong> villles<br />
<strong>de</strong> plus pe etites tailles ou o <strong>de</strong> communnes<br />
moins urb baines.<br />
Les taux <strong>de</strong> croissancce<br />
ont été les plus importaants<br />
en <strong>de</strong>hors<br />
<strong>de</strong>s agglom mérations et pprincipalement<br />
t dans les<br />
banlieuess<br />
et les périphéries<br />
éloigné ées <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
villes (+5 5,2% dans les<br />
zones résid<strong>de</strong>ntielles<br />
<strong>de</strong>s s migrants<br />
alternantss).<br />
Tableau 13 : Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
la populati ion dans les différentes parties p <strong>de</strong>s complexes c réési<strong>de</strong>ntiels<br />
wallons w et<br />
hors commplexes<br />
entree<br />
2001 et 200 08<br />
Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> e population 20011-<br />
Taux d'évolution d 2001-2008<br />
Part rt dans la croissa ance totale<br />
2008<br />
(%)<br />
(%) )<br />
Agglomérattions<br />
18 983<br />
+1,5<br />
17,2<br />
Banlieues<br />
224<br />
305<br />
+4,2<br />
22,0<br />
Zones résid<strong>de</strong>ntielles<br />
<strong>de</strong>s<br />
migrants allternants<br />
227<br />
959<br />
+5,2<br />
25,3<br />
Hors compllexes<br />
339<br />
071<br />
+4,0<br />
35,4<br />
Total Wallonie<br />
110<br />
318<br />
+3,3<br />
100,0<br />
Sources : SPF F Economie-DGSIE, doonnées<br />
du registre nat ational au 1 er<br />
janvier ; VVan<br />
Hecke, 2009 ; ca alculs <strong>IWEPS</strong><br />
Dans les 3 parties <strong>de</strong>ss<br />
complexes rési<strong>de</strong>ntiels r urbains,<br />
ce sont<br />
les zones <strong>de</strong> d migrants aalternants,<br />
soit<br />
les plus<br />
éloignéess<br />
<strong>de</strong>s noyaux urbains, qui ont connu lees<br />
plus fortes hausses <strong>de</strong> population avvec<br />
+27 959 habitants.<br />
Une grann<strong>de</strong><br />
part <strong>de</strong> ccette<br />
augment tation a eu lieu<br />
dans la zone<br />
<strong>de</strong> migra ants alternantts<br />
attachée à la région<br />
urbaine d<strong>de</strong><br />
Bruxelles, qqui<br />
est d’ailleu urs la plus éteendue<br />
avec 22 2 communes (tableau suivaant).<br />
Tableau 14 : Evolutioon<br />
<strong>de</strong> la popu ulation dans les différente es parties <strong>de</strong> es complexess<br />
rési<strong>de</strong>ntiels s wallons<br />
entre 20001<br />
et 2008<br />
Evolution <strong>de</strong><br />
la Agglommération<br />
Banlieue<br />
Zone <strong>de</strong>ss<br />
population<br />
migrantss<br />
2001-20088<br />
alternantts<br />
Sol<strong>de</strong><br />
%<br />
Sol<strong>de</strong><br />
%<br />
Sol<strong>de</strong><br />
%<br />
Bruxelles<br />
2814<br />
4,4 11 535 5<br />
6,3<br />
15 392<br />
7,4<br />
Charleroi<br />
1667<br />
0,6<br />
943 3<br />
0,8<br />
3415<br />
3,1<br />
Liège<br />
8668<br />
1,8<br />
6135 5<br />
4,0<br />
5074<br />
5,2<br />
Mons<br />
-275<br />
-0,1<br />
1368 8<br />
3,1<br />
185<br />
1,1<br />
Namur<br />
2691<br />
2,6<br />
2965 5<br />
6,7<br />
3099<br />
6,0<br />
Tournai<br />
966<br />
1,4<br />
396 6<br />
2,0<br />
463<br />
1,2<br />
Verviers<br />
2452<br />
3,2<br />
963 3<br />
5,1<br />
331<br />
3,1<br />
Total compplexes<br />
18 983<br />
1,5 24 305 5<br />
4,2<br />
27 959<br />
5,2<br />
Sources : SPF F Economie-DGSIE, doonnées<br />
du registre nat ational au 1 er<br />
janvier ; VVan<br />
Hecke, 2009 ; ca alculs <strong>IWEPS</strong><br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 41<br />
Autour <strong>de</strong>es<br />
aggloméraations<br />
<strong>de</strong> Brux xelles, Namurr<br />
et Liège, la population a connu <strong>de</strong> forte<br />
croissance<br />
relative,<br />
renforçannt<br />
ainsi les périphéries.<br />
Remarquons<br />
que danss<br />
les périphéries<br />
<strong>de</strong>s aggllomérations<br />
<strong>de</strong>s d principale es villes walloonnes<br />
définies<br />
par Van<br />
Hecke et al. (2009), il existe <strong>de</strong>s pe etites villes quui<br />
sont, à leur r niveau, polarisantes<br />
pour les espaces alentours.<br />
Afin d’enn<br />
tenir compte,<br />
la localisat tion rési<strong>de</strong>ntielle<br />
par rapp port à la hiéra archie urbainee<br />
<strong>de</strong>s communes<br />
sera<br />
étudiée à la section 3.55.
3.4.2. NNombre<br />
<strong>de</strong> noouveaux<br />
logem ments<br />
Parmi less<br />
72 921 logements<br />
créés entre e le 01/011/2001<br />
et le 31/12/2008, 3 47 4 810 soit 655,5%<br />
ont été construits<br />
au sein dd’un<br />
<strong>de</strong>s compplexes<br />
rési<strong>de</strong>n ntiels urbains wallons (voir tableau suiva ant) et, <strong>de</strong> façoon<br />
plus précis se, 46,4%<br />
au sein <strong>de</strong>s<br />
régions urbaines<br />
(agglomérations<br />
et banlieues).<br />
Tableau 15 : Nombree<br />
<strong>de</strong> logemen nts construitss<br />
(entre le 01 1/01/2001 et le 31/12/20008)<br />
et localis sation par<br />
rapport aaux<br />
complexes<br />
rési<strong>de</strong>ntie els urbains<br />
Nombre <strong>de</strong> logements Agglomération<br />
Bannlieue<br />
Zone <strong>de</strong>s<br />
migrants Total du com mplexe<br />
construits eentre<br />
le<br />
01/01/20011<br />
et le<br />
31/12/20088<br />
alternants<br />
rési<strong>de</strong>ntiel urbain<br />
Bruxelles<br />
2 165<br />
6 084<br />
62455<br />
14 494<br />
Charleroi<br />
2 543<br />
2 083<br />
2 2211<br />
6 847<br />
Liège<br />
6 599<br />
4 499<br />
26766<br />
13 774<br />
Mons<br />
2 288<br />
1 178<br />
3211<br />
3 787<br />
Namur<br />
2 205<br />
1 462<br />
15588<br />
5 225<br />
Tournai<br />
1 097<br />
354<br />
7588<br />
2 209<br />
Verviers<br />
752<br />
510<br />
2122<br />
1 474<br />
Total compplexes<br />
<strong>de</strong> la<br />
Région wallonne<br />
17 649<br />
16 6 170<br />
13 9911<br />
47 810<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; callculs<br />
<strong>IWEPS</strong><br />
Parmi less<br />
complexes, ceux <strong>de</strong> Liège e et <strong>de</strong> Bruxeelles<br />
ont vu un n grand nomb bre <strong>de</strong> logemeents<br />
se constr ruire. Pour<br />
le compleexe<br />
<strong>de</strong> Bruxeelles<br />
en Wallo onie, les logemments<br />
ont su urtout pris pla ace dans la bbanlieue<br />
et la zone <strong>de</strong>s<br />
migrants alternants et pas dans l’ag gglomération cconstituée<br />
uniquement<br />
<strong>de</strong> Waterloo W et BBraine-l’Alleud<br />
d.<br />
A l’échellle<br />
communalee,<br />
il est peut- -être plus perttinent<br />
d’étudier<br />
directemen nt l’évolution <strong>de</strong> la populat tion ou du<br />
nombre d<strong>de</strong><br />
ménages.<br />
3.5. LOCCALISATION<br />
DE LA NOUV VELLE RÉSIDEENCE<br />
PAR RA APPORT À LA A HIÉRARCHIIE<br />
URBAINE<br />
3.5.1. AApproche<br />
par l’évolution <strong>de</strong> e la populationn<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 42<br />
Entre 20001<br />
et 2008, les<br />
communes<br />
qui ont acc<br />
essentielllement<br />
les coommunes<br />
non n urbaines<br />
que celles-ci,<br />
au nombbre<br />
<strong>de</strong> 221, ra<br />
28<br />
cueilli la maje eure partie <strong>de</strong> e la croissancce<br />
démograph hique sont<br />
, aavec<br />
une part t <strong>de</strong> 59% <strong>de</strong> la<br />
croissance. . Remarquons s toutefois<br />
assemblent paas<br />
moins <strong>de</strong> 55,7% 5 <strong>de</strong> la po opulation walllonne<br />
au 01/0 01/2008.<br />
Durant laa<br />
pério<strong>de</strong> conssidérée,<br />
la part<br />
dans le totaal<br />
<strong>de</strong> la population<br />
<strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
villes et t <strong>de</strong>s villes rég gionales a<br />
diminué aalors<br />
que celles<br />
<strong>de</strong>s comm munes non urbbaines<br />
moyen nnement et faiblement<br />
équipées<br />
a augm menté. Ces<br />
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rrniers<br />
types <strong>de</strong> commune es, qui rasseemblent<br />
171 entités et accueillent a 322,7%<br />
<strong>de</strong> la population p<br />
wallonne,<br />
ont contribué<br />
à 44,5% <strong>de</strong> e la croissancee<br />
démographique<br />
wallonne.<br />
28<br />
Les commmunes<br />
non urbbaines,<br />
au contraire<br />
<strong>de</strong>s villes, ne disposent pa as d’un centre morphologique m<br />
uurbain<br />
multifonctionnel<br />
(Van<br />
Hecke, 19998).<br />
Au nombre d<strong>de</strong><br />
221, elles con ncernent <strong>de</strong>s commmunes<br />
très variées<br />
allant <strong>de</strong> communes<br />
d’aggglomération<br />
ou <strong>de</strong> e banlieue à<br />
<strong>de</strong>s commuunes<br />
beaucoup pplus<br />
rurales.
Tableau 16 : Evolution<br />
<strong>de</strong> la population<br />
2001-22008<br />
en fonc ction <strong>de</strong> la hié érarchie <strong>de</strong>s villes et com mmunes<br />
Communess<br />
selon la hiérarchie<br />
Part <strong>de</strong> d la PPart<br />
<strong>de</strong> la Sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> Part du ssol<strong>de</strong><br />
Taux<br />
urbaine<br />
population<br />
au ppopulation<br />
au population dans le ttotal<br />
d'évo olution<br />
01/01 1/2001 (%) 001/01/2008<br />
(%) 2001-2008 <strong>de</strong> croisssance<br />
(%)<br />
2001- -2008 (%)<br />
Gran<strong>de</strong> villee<br />
11,5<br />
11,3 3 6 912<br />
6,3<br />
1,8<br />
Ville régionale<br />
12,5<br />
12,3 3 8 485<br />
7,7<br />
2,0<br />
Petite ville bien équipée<br />
5,6<br />
5,6 6 8 586<br />
7,8<br />
4,6<br />
Petite ville moyennement éqquipée<br />
3,7<br />
3,8 8 7 516<br />
6,8<br />
6,1<br />
Petite ville ffaiblement<br />
équippée<br />
11,2<br />
11,2 2 13 694<br />
12,4<br />
3,7<br />
Commune nnon<br />
urbaine bienn<br />
équipée<br />
22,9<br />
22,6 6 16 047<br />
14,5<br />
2,1<br />
Commune nnon<br />
urbaine<br />
moyennement<br />
équipée<br />
24,8<br />
25,0 0 32 179<br />
29,2<br />
3,9<br />
Commune nnon<br />
urbaine faiblement<br />
équipée<br />
7,9<br />
8, 1 16 899<br />
15,3<br />
6,4<br />
Total Wallonie<br />
100,0<br />
100,0 0 110 318<br />
100,0<br />
3,3<br />
Sources : SPF F Economie-DGSIE, doonnées<br />
du registre nat ational au 1 er<br />
janvier ; VVan<br />
Hecke, 1998 ; ca alculs <strong>IWEPS</strong><br />
Cette évoolution<br />
démoographique<br />
différenciée<br />
seelon<br />
la struct ture spatiale tend à monttrer<br />
que la population p<br />
wallonne connaît une croissance plus importannte<br />
en <strong>de</strong>hor rs <strong>de</strong>s centres<br />
urbains muultifonctionnels<br />
ou <strong>de</strong>s<br />
communees<br />
bien équipées.<br />
L’analyse e <strong>de</strong>s flux miggratoires<br />
perm mettrait <strong>de</strong> déterminer<br />
le seens<br />
et l’impor rtance <strong>de</strong>s<br />
mouvemeents<br />
rési<strong>de</strong>ntiels<br />
par rappor rt aux mouvemments<br />
naturel ls.<br />
3.5.2. NNombre<br />
<strong>de</strong> noouveaux<br />
logem ments<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 43<br />
Entre 20001<br />
et 2009, 61,3% <strong>de</strong>s nouveaux n logeements<br />
<strong>de</strong> Wallonie W ont pris<br />
place danns<br />
<strong>de</strong>s comm munes non<br />
urbaines alors que ces<br />
communes ne représenttent<br />
que 53,5 5% <strong>de</strong>s logem ments existantts.<br />
Les comm munes non<br />
urbaines moyennement<br />
et faiblem ment équipéess<br />
ont particulièrement<br />
acc cueilli beaucooup<br />
<strong>de</strong> logem ments par<br />
rapport aau<br />
parc existannt.<br />
Cette tendance<br />
correspoond<br />
bien à celle<br />
observée <strong>de</strong> d l’évolution <strong>de</strong> la population.<br />
Les gran<strong>de</strong>s<br />
villes quue<br />
sont Liège et Charleroi ont vu cepe endant un nom mbre non négligeable<br />
<strong>de</strong> nouveaux<br />
logementts<br />
sur leur teerritoire<br />
si on tient comptee<br />
<strong>de</strong>s plus fa aibles disponibilités<br />
foncièrres<br />
<strong>de</strong> ces communes c<br />
(Lepers & Morelle, 20008).<br />
Enfin, les<br />
petites villes<br />
ont conn nu une croisssance<br />
<strong>de</strong> le eur parc supérieure<br />
à laa<br />
moyenne wallonne,<br />
particulièèrement<br />
les peetites<br />
villes moyennement<br />
ééquipées.
Tableau 17 : Nombree<br />
<strong>de</strong> logemen nts construitss<br />
(entre le 01 1/01/2001 et le 31/12/20008)<br />
et localis sation par<br />
rapport à la hiérarchie<br />
<strong>de</strong>s villes et e communes<br />
Communess<br />
selon la hiérarchie<br />
Nou uveaux Paart<br />
<strong>de</strong> Nombre N <strong>de</strong> No ombre <strong>de</strong> PPart<br />
<strong>de</strong> Nombre N <strong>de</strong><br />
urbaine<br />
logements<br />
noouveaux<br />
nouveaux n<br />
log gements loogements<br />
logement l<br />
entre<br />
le loogements<br />
lo ogements ex xistants au ex existants par p<br />
01/ /01/2001 (% %)<br />
par p<br />
31/12/2008<br />
(% %)<br />
parcelle p<br />
et le<br />
31/ /12/2008<br />
parcelle p<br />
Gran<strong>de</strong> villee<br />
2 957<br />
4,1 1,7 192 890 12,6 1,5<br />
Ville régionale<br />
7 183<br />
9,9 1,6 198 155 13,0 1,3<br />
Petite ville bien équipée<br />
4 966<br />
6,8 1,5 87 526<br />
5,7 1,2<br />
Petite ville moyennement éqquipée<br />
4 327<br />
5,9 1,7 63 110<br />
4,1 1,4<br />
Petite ville ffaiblement<br />
équippée<br />
8 811 12,1 1,4 167 085 11,0 1,1<br />
Commune nnon<br />
urbaine bienn<br />
équipée 15 295 21,0 1,3 343 331 22,5 1,1<br />
Commune nnon<br />
urbaine<br />
moyennement<br />
équipée<br />
20 824 28,6 1,1 358 588 23,5 1,1<br />
Commune nnon<br />
urbaine faiblement<br />
équipée<br />
8 558 11,7 1,1 114 163<br />
7,5 1,0<br />
Total Wallonie<br />
72 921 100,0 1,3 1 525 064 100,0 1,2<br />
Sources : SPF F Finances-AGDP ; Vann<br />
Hecke, 1998 ; calcu uls <strong>IWEPS</strong><br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 44<br />
Le nombre<br />
<strong>de</strong> logemeents<br />
par parc celle nous donnne<br />
une indic cation sur l’im mportance <strong>de</strong>es<br />
immeubles s collectifs<br />
dans les communes. Par rapport au a parc existtant,<br />
le nomb bre d’immeub bles collectifs construits ré écemment<br />
serait pluus<br />
important. LLes<br />
commune es non urbaines<br />
sont logiqu uement celles s où on trouvee<br />
le moins d’im mmeubles<br />
collectifs.<br />
4. Annalysees<br />
: ind dicateuurs/crit<br />
tères et e déveeloppem<br />
ment<br />
<strong>territorial</strong><br />
ddurable<br />
Afin <strong>de</strong> mmieux<br />
cerner le <strong>développement</strong><br />
<strong>territorial</strong><br />
<strong>de</strong> la résid <strong>de</strong>nce lors <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>rnières aannées,<br />
<strong>de</strong>s critères c <strong>de</strong><br />
localisatioon<br />
ont été utilisés.<br />
Les <strong>de</strong>u ux principaux critères sont un critère <strong>de</strong> proximité auux<br />
gares SNCB B et arrêts<br />
<strong>de</strong> bus biien<br />
<strong>de</strong>sservis, et un critère « multifonctioonnel<br />
», à savoir<br />
le positionnement<br />
<strong>de</strong> la nouvelle rési<strong>de</strong>nce<br />
par<br />
rapport aaux<br />
centres foonctionnels,<br />
approximés a aux<br />
noyaux d’ habitat. Ces critères ont éété<br />
sélectionn nés car ils<br />
paraissennt<br />
centraux dans<br />
la réflexi ion sur la loccalisation<br />
opti imale <strong>de</strong> la rési<strong>de</strong>nce,<br />
nottamment<br />
au regard <strong>de</strong><br />
certains ddéfis<br />
en matièère<br />
d’énergie, <strong>de</strong> changemeent<br />
climatique e et <strong>de</strong> mobilit té.<br />
4.1. ANAALYSE<br />
AU REEGARD<br />
DES DOCUMENTS<br />
D S D’AMÉNAG GEMENT DU TERRITOIRE T : SDER ET CW WATUPE<br />
En Région<br />
wallonne, les<br />
<strong>de</strong>ux docu uments <strong>de</strong> réfférence<br />
en matière m d’aménagement<br />
du territoire son nt le Co<strong>de</strong><br />
Wallon <strong>de</strong>e<br />
l’Aménagemment<br />
du Territo oire, <strong>de</strong> l’Urbaanisme,<br />
du Pa atrimoine et <strong>de</strong><br />
l’Energie (CCWATUPE)<br />
pou ur la partie<br />
réglemenntaire<br />
et le Schhéma<br />
<strong>de</strong> Déve eloppement d<strong>de</strong><br />
l’Espace Ré égional (SDER)<br />
pour la partiie<br />
orientation.<br />
Un <strong>de</strong>s oobjectifs<br />
majeurs<br />
du projet <strong>de</strong> développeement<br />
spatial l prôné par le e SDER conceerne<br />
la structu uration <strong>de</strong><br />
l’espace wallon. Dans les mesures d’aménagemment<br />
du territoire<br />
qui perme ettront <strong>de</strong> conccrétiser<br />
cet objectif,<br />
on<br />
retrouve l’option <strong>de</strong> « sstructurer<br />
les villes et les vvillages<br />
». « Po our éviter la di ispersion <strong>de</strong> ll’habitat<br />
et ren nforcer les<br />
villes et lles<br />
villages, iil<br />
est nécessa aire d’accroîtrre<br />
la <strong>de</strong>nsité d’urbanisation n, particulièreement<br />
autour r <strong>de</strong>s lieux<br />
centraux. . (…) Dans les villages, on évitera l’ ’urbanisation en ruban le long <strong>de</strong>s rou outes ; on lui préférera<br />
l’organisaation<br />
d’ensemmbles<br />
structur rés autour du centre ainsi qu’une q <strong>de</strong>nsifi fication <strong>de</strong> cellui-ci<br />
en harm monie avec<br />
les caract ctéristiques loccales.<br />
» (SDER R, pp.152-1533).
Le SDERR<br />
privilégie ddonc<br />
le renfo orcement <strong>de</strong>ss<br />
lieux centra aux. Le critère<br />
<strong>de</strong> l’évoluution<br />
<strong>de</strong> l’urb banisation<br />
rési<strong>de</strong>ntieelle<br />
dans et hoors<br />
<strong>de</strong>s noyau ux d’habitat teente<br />
<strong>de</strong> montrer<br />
le renforcement<br />
ou non <strong>de</strong> ces lieux centraux. c<br />
Concernaant<br />
le critère <strong>de</strong> proximité aux gares, lee<br />
SDER n’accor<strong>de</strong><br />
pas une e place priviléégiée<br />
à une lo ocalisation<br />
proche d<strong>de</strong>s<br />
gares maais<br />
à <strong>de</strong> nom mbreuses repprises,<br />
<strong>de</strong>s mesures m concernent<br />
l’acceessibilité<br />
<strong>de</strong>s fonctions<br />
centraless<br />
et l’accès aaux<br />
transport ts en commuun.<br />
Une <strong>de</strong>s options est <strong>de</strong> « maîtrisser<br />
la mobilit té en vue<br />
d’atteindr dre un équilibrre<br />
entre la sa atisfaction <strong>de</strong> e la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> déplacem ment et la prééservation<br />
du u cadre <strong>de</strong><br />
vie ». Danns<br />
ce cadre, lee<br />
SDER envisa age une diminnution<br />
du volu ume <strong>de</strong> déplac cement qui immplique<br />
<strong>de</strong> :<br />
« freiner la ddispersion<br />
<strong>de</strong>s s fonctions paar<br />
leur regrou upement dans s les centres s urbains et le es noyaux<br />
dd'habitat<br />
;<br />
rrapprocher<br />
lees<br />
unes <strong>de</strong>s autres a les fonc nctions complé émentaires, c'est-à-dire c l'hhabitat,<br />
le tra avail et les<br />
ééquipements,<br />
, notamment en e pratiquant t une mixité ra aisonnée <strong>de</strong>s fonctions. f » (SSDER,<br />
pp.205) )<br />
Il envisagge<br />
égalemennt<br />
<strong>de</strong> « mieux x circuler » een<br />
privilégiant<br />
l’utilisation <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transport t les plus<br />
appropriéés,<br />
c’est-à-dirre<br />
souvent ceu ux qui sont less<br />
plus respect tueux <strong>de</strong> l’env vironnement eet<br />
du cadre <strong>de</strong> e vie. Pour<br />
les déplaacements<br />
<strong>de</strong> personnes, le SDER veuut<br />
favoriser par p ordre <strong>de</strong> priorité la mmarche<br />
à pied<br />
et les<br />
déplacemments<br />
à vélo, puis les tran nsports en coommun<br />
et en nfin les dépla acements en voiture. Ceci doit bien<br />
entendu ss'accompagner<br />
d'une strat tégie <strong>de</strong> localisation<br />
<strong>de</strong>s log gements et ac ctivités favorissant<br />
cette hiér rarchie.<br />
C’est pouurquoi<br />
nous avons travail llé avec une définition <strong>de</strong> e noyaux d’h habitat et <strong>de</strong>ss<br />
zones d’accessibilité<br />
piétonne et cyclables aautour<br />
<strong>de</strong>s gares<br />
(tous les ppoints<br />
d’arrêts s) et <strong>de</strong>s arrêt ts <strong>de</strong> bus bienn<br />
<strong>de</strong>sservis.<br />
En ce quii<br />
concerne le CWATUPE, no ous pouvons faaire<br />
référence e à son article premier :<br />
« Art. 1err.<br />
§ 1er. Le terrritoire<br />
<strong>de</strong> la Région R wallonnne<br />
est un pat trimoine comm mun <strong>de</strong> ses haabitants.<br />
La Régionn<br />
et les autress<br />
autorités pu ubliques, chaccune<br />
dans le cadre c <strong>de</strong> ses compétences c eet<br />
en coordina ation avec<br />
la Régionn,<br />
sont gestionnnaires<br />
et gar arants <strong>de</strong> l’amménagement<br />
du d territoire. Elles E rencontreent<br />
<strong>de</strong> manièr re durable<br />
les besooins<br />
sociaux, économiques s, (<strong>de</strong> mobilit ité, – Décret t du 15 févrie er 2007, art. t. 1er) patrim moniaux et<br />
environneementaux<br />
<strong>de</strong> la collectivité é par la gestion on qualitative du d cadre <strong>de</strong> vie, v par l’utilisa sation parcimo onieuse du<br />
sol et <strong>de</strong> e ses ressourcces<br />
(, par la performance p éénergétique<br />
<strong>de</strong> d l’urbanisatio on et <strong>de</strong>s bâttiments<br />
– Déc cret du 20<br />
septembrre<br />
2007, art. 1er, al. 1er) et e par la conse servation et le développeme ent du patrimo moine culturel, naturel et<br />
paysagerr.<br />
» (DGO4-SPWW,<br />
2009, pp.1 17)<br />
L’objectiff<br />
est donc d’aménager<br />
le e territoire <strong>de</strong>e<br />
façon dura able en répon ndant aux beesoins<br />
multip ples <strong>de</strong> la<br />
collectivitté.<br />
Comme noous<br />
le verrons s plus loin, lees<br />
indicateurs s mis en place e touchent, à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>grés divers, d les<br />
différentss<br />
aspects que<br />
sont la gestion<br />
qualitattive<br />
du cadre e <strong>de</strong> vie, l’ut tilisation parccimonieuse<br />
du<br />
sol, les<br />
dépensess<br />
énergétiquess<br />
liées à la loc calisation <strong>de</strong> ll’urbanisation<br />
ainsi que la conservation c d<strong>de</strong>s<br />
patrimoines.<br />
4.2. ANAALYSE<br />
AU RREGARD<br />
DU DÉVELOPPEEMENT<br />
DURABLE<br />
: QUEL LS SONT LEES<br />
ÉCLAIRAG GES DES<br />
DIFFÉREENTS<br />
INDICATTEURS<br />
PROP POSÉS?<br />
4.2.1. CConstatations<br />
générales<br />
4.2.1.1.<br />
Proximité à un centre mu ultifonctionnell<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 45<br />
La notionn<br />
<strong>de</strong> centre mmultifonctionne<br />
el a ici été appprochée<br />
par celle <strong>de</strong> noya aux d’habitat ttelle<br />
que définie<br />
par Y.<br />
Delforge et G. Géron. Celle-ci tien nt compte <strong>de</strong>e<br />
critères <strong>de</strong> concentration n <strong>de</strong> populatiion,<br />
d’accessibilité<br />
aux<br />
gares, d’aaccès<br />
aux serrvices<br />
adminis stratifs et d’asssainissement<br />
t <strong>de</strong>s eaux usées.
De nombbreuses<br />
étu<strong>de</strong>es<br />
ont déjà dé émontré en qquoi<br />
le renforcement<br />
<strong>de</strong> la a structure sppatiale<br />
autour <strong>de</strong>s lieux<br />
centraux était un <strong>de</strong>s constituants d’un développpement<br />
terri itorial durable e. Les lieux ccentraux<br />
perm mettent en<br />
effet d’offfrir<br />
une variétté<br />
d’activités dans d un espacce<br />
restreint et t donc <strong>de</strong> limiter<br />
les déplaccements,<br />
<strong>de</strong> fa aciliter les<br />
déplacemments<br />
doux oou<br />
d’organiser r <strong>de</strong>s servicees<br />
<strong>de</strong> transpo ort en commu un performannts.<br />
Leur renf forcement<br />
permet dd’économiser<br />
l’espace et <strong>de</strong> d réduire les coûts d’équipement.<br />
Au total, t cette strructuration<br />
pe ermet une<br />
diminutioon<br />
<strong>de</strong> la consoommation<br />
d’es space, <strong>de</strong> la cconsommation<br />
n d’énergie, <strong>de</strong>s<br />
coûts indivviduels<br />
et collectifs.<br />
4.2.1.2.<br />
Proximité d’ ’une gare ou d’un d arrêt <strong>de</strong> bbus<br />
bien <strong>de</strong>ss servis<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 46<br />
La question<br />
à la base d<strong>de</strong><br />
la construc ction <strong>de</strong> cet inndicateur<br />
est d’i<strong>de</strong>ntifier po ourquoi le fait <strong>de</strong> concentre er l’habitat<br />
à proximité<br />
<strong>de</strong>s gares et arrêts <strong>de</strong> bus bien <strong>de</strong>ssservis<br />
plutôt que <strong>de</strong> le lais sser s’éparpilller<br />
ou <strong>de</strong> le concentrer c<br />
ailleurs s’inscrit<br />
dans lles<br />
principes du d développemment<br />
durable.<br />
Pour se ffaire,<br />
il est immportant<br />
<strong>de</strong> so ouligner préallablement<br />
les défis majeur rs qui ont <strong>de</strong> ffortes<br />
relation ns avec le<br />
territoire et ses habitannts<br />
:<br />
ddans<br />
le cadree<br />
du Protocole<br />
rréduire<br />
ses émmissions<br />
<strong>de</strong> g<br />
à l’année <strong>de</strong> référence<br />
aapparaît<br />
que<br />
éémissions<br />
wa<br />
éémissions<br />
<strong>de</strong><br />
( (tels que déf<br />
eeuropéenne<br />
e<br />
vvoire<br />
<strong>de</strong> 30%<br />
mesures com<br />
pp.164).<br />
La Dé<br />
ppour<br />
objectif<br />
rrécemment<br />
(<br />
nnotamment<br />
d<br />
WWallonie<br />
en 2<br />
ll’augmentatio<br />
ccroissance)<br />
q<br />
ggénérale<br />
qui<br />
lles<br />
données d<br />
nniveau<br />
du tra<br />
ffossiles,<br />
notam<br />
29 e <strong>de</strong> Kyoto, l’o<br />
gaz à effet <strong>de</strong><br />
(IW WEPS, 2010,<br />
cet objectif va v vraisembla<br />
allonnes <strong>de</strong> GES G pour la<br />
1990 (SPW- DGARNE, 201<br />
finis par le « paquet Ene<br />
en décembre 2008, 2 à savoi<br />
en cas d’accord<br />
internatio<br />
mplémentaires s (en partie e<br />
éclaration <strong>de</strong> politique régi<br />
<strong>de</strong> réduire les émissions<br />
(décembre 2010)<br />
par le<br />
ans le secteu ur général du<br />
2008, est le secteur prése<br />
on d’émission ns <strong>de</strong> GES la<br />
ue du point <strong>de</strong> d vue absolu<br />
elle est en re ecul <strong>de</strong> 12,5%<br />
<strong>de</strong> l’Agence Wallonne W <strong>de</strong> l<br />
ansport routie er<br />
mment dans l<br />
30<br />
objectif <strong>de</strong> la<br />
serre (GES) d<br />
p.164). Sur b<br />
ablement être<br />
pério<strong>de</strong> 2008<br />
10, p.87). En<br />
ergie/Climat »<br />
r réduire les é<br />
onal post-Kyot<br />
envisagées da<br />
onale 2009-2<br />
s wallonnes<br />
GW. Des e<br />
transport ; ce<br />
entant l’évolu<br />
a plus consé<br />
u (+3 054 kt é<br />
% sur la pério<br />
l’Air et du Cli<br />
, est liée à une augme<br />
le chef <strong>de</strong>s ménages<br />
31 Wallonie (i<strong>de</strong>ntique<br />
à celuii<br />
<strong>de</strong> la Belgique)<br />
est <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> 7,5% duran nt la pério<strong>de</strong> 22008-2012<br />
par<br />
rapport<br />
base <strong>de</strong>s résu ultats obtenuss<br />
jusqu’à maintenant,<br />
il<br />
atteint car se elon les projeections<br />
(avril 2009), 2 les<br />
8-2012 <strong>de</strong>vra aient être infférieures<br />
<strong>de</strong> 7,2% aux<br />
ce qui conce erne les objecctifs<br />
à plus lo ong terme<br />
» approuvé par p les Etats membres <strong>de</strong> d l’Union<br />
émissions <strong>de</strong> GES <strong>de</strong> 20% en unilatéral d’ici 2020<br />
to), ils ne pourront<br />
être atteeints<br />
sans l’ad doption <strong>de</strong><br />
ans le projet <strong>de</strong> Plan Air-Climat)<br />
(IWEP PS, 2010,<br />
2014 du Gouv vernement Waallon<br />
(GW) a également é<br />
<strong>de</strong> GES <strong>de</strong> 30% d’ici 20020,<br />
objectif confirmé<br />
fforts importants<br />
restent cependant à fournir,<br />
e <strong>de</strong>rnier qui émet é 21% <strong>de</strong>es<br />
émissions <strong>de</strong> d GES en<br />
tion la plus dommageable<br />
d e : en effet, il l présente<br />
équente, tant du point <strong>de</strong>e<br />
vue relatif (43% <strong>de</strong><br />
éq. CO2), tend dance en oppposition<br />
avec l’évolution<br />
<strong>de</strong> 1990-2008<br />
(<strong>IWEPS</strong>, 20010,<br />
p.165-16 66 d’après<br />
mat, 2010). Cette C croissannce,<br />
principal lement au<br />
ntation <strong>de</strong> co onsommation globale <strong>de</strong> carburants c<br />
;<br />
29<br />
Le total d<strong>de</strong>s<br />
émissions annnuelles<br />
est divis sé par le total <strong>de</strong>es<br />
émissions <strong>de</strong> l’année <strong>de</strong> référe ence (1990 pour r les gaz non fluo orés et 1995<br />
pour les gaaz<br />
fluorés). Depuiis<br />
2007, les émis ssions officielless<br />
<strong>de</strong> l’année <strong>de</strong> ré éférence ont été définitivement aapprouvées<br />
dans s le cadre du<br />
Protocole d<strong>de</strong><br />
Kyoto.<br />
30<br />
Le transpport<br />
routier repréésente<br />
à lui seul<br />
environ 94% d<strong>de</strong>s<br />
émissions <strong>de</strong> e CO2 du secteu ur <strong>de</strong>s transportss<br />
en Belgique. (S Source : SPF<br />
SPSCAE, Inventaires<br />
GES 20008,<br />
Common re eporting format ; Calculs <strong>IWEPS</strong>)<br />
31<br />
Bien quee<br />
les véhicules neufs mis en circulation<br />
consoomment<br />
en moy yenne moins <strong>de</strong> carburant et rej ejettent moins <strong>de</strong><br />
CO2 dans<br />
l’atmosphère<br />
qu’auparavannt<br />
(FEBIAC, 2010 0), la croissance du parc wallon <strong>de</strong> voitures particulières<br />
(+13,9% % entre 2000 et t 2010 alors<br />
que la popuulation<br />
wallonne n’a augmenté que<br />
<strong>de</strong> 4,8% penddant<br />
la même pé ério<strong>de</strong>), ainsi que l’augmentation du nombre <strong>de</strong> véhicules-km<br />
parcourus par les voituress,<br />
sont les cause es principales d<strong>de</strong><br />
l’augmentation<br />
<strong>de</strong> consomma ation <strong>de</strong> carburaants.<br />
(Source <strong>de</strong> es données :<br />
<strong>IWEPS</strong>, 20110,<br />
pp. 146-147 ; DGSIE)
à l’avenir, le<br />
iintégrer<br />
les r<br />
ffossile<br />
i<br />
W<br />
d<br />
l<br />
é<br />
32<br />
<strong>développement</strong><br />
<strong>de</strong>s infraastructures<br />
<strong>de</strong><br />
transport et e <strong>de</strong> l’urbanisation<br />
doit également é<br />
risques que fait f peser à moyen terme e la pénurie potentielle d<strong>de</strong><br />
carburants d’origine<br />
(Juprrelle,<br />
2009). Le L pétrole qui est à la base e du fonctionn nement <strong>de</strong> la majorité <strong>de</strong>s véhicules<br />
individuels enn<br />
Wallonie est<br />
une ressoource<br />
non ren nouvelable qu ui tendrait à s’épuiser (D Duvivier et<br />
Wautelet, 20009).<br />
Une étu<strong>de</strong> e récente <strong>de</strong> la<br />
CPDT (2010 0b) s’est penc chée sur la quuestion<br />
comple exe du pic<br />
<strong>de</strong> pétrole et <strong>de</strong> ses impac cts sur le territoire.<br />
En raiso on d’un déséq quilibre entre l’offre qui sta agnerait et<br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> qqui<br />
continue à augmenter, on peut s’atte endre à ce qu ue les prix péttroliers<br />
soient t bien plus<br />
élevés dans lees<br />
années à venir. v<br />
En tenantt<br />
compte <strong>de</strong> cces<br />
<strong>de</strong>ux principaux<br />
élémeents<br />
<strong>de</strong> contex xte, il est possible<br />
<strong>de</strong> metttre<br />
en avant le es raisons<br />
qui pourrraient<br />
pousserr<br />
à concentrer r l’habitat prèss<br />
<strong>de</strong>s gares da ans un périmè ètre accessiblle<br />
à pied ou à vélo :<br />
32<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 47<br />
LLa<br />
marche à pied et le vél<br />
bbien<br />
les coûtts<br />
à charge d<br />
ccoûtent<br />
très ppeu<br />
directem<br />
ddépasse<br />
mêmme<br />
dans cert<br />
ssouplesse<br />
d'uutilisation,<br />
d'e<br />
même service,<br />
ni le mêm<br />
pprononcé.<br />
Poour<br />
effectuer<br />
ccombinables<br />
avec les trans<br />
AAu<br />
sein <strong>de</strong>s périmètres d<br />
pprivilégiés<br />
vu leurs nombr<br />
ppour<br />
la collectivité<br />
et mê<br />
pprogrammes<br />
européens<br />
iimpacts<br />
liés à<br />
ddéplacement<br />
dd’ailleurs<br />
un<br />
ccomparaison<br />
AAngleterre<br />
es<br />
34<br />
o sont <strong>de</strong>s m<br />
<strong>de</strong> l’usager q<br />
ent à l’individ<br />
taines condit<br />
space occupé<br />
me niveau <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> plus long<br />
sports en com<br />
’accessibilité<br />
reux bénéfice<br />
ême pour l’in<br />
ont été réali<br />
à l’usage du vélo v ; certains<br />
actifs a un effet e positif su<br />
rapport coût-bénéfice<br />
<strong>de</strong> m<br />
le rapport pour p la cons<br />
t estimée <strong>de</strong> 1-2 à 1-3) 35<br />
moyens <strong>de</strong> loco omotion très<br />
que les coûts s externes<br />
du mais auss<br />
tions les tran<br />
é et <strong>de</strong> conso<br />
e confort nota<br />
gues distance<br />
mmun.<br />
aux gares, le<br />
es pour le sys<br />
ndividu : en e<br />
isés ou sont<br />
s démontrent,<br />
ur la santé et<br />
mesures en f<br />
struction d’un<br />
. En outre, vu<br />
33 peu polluantss<br />
et pour lesquels<br />
aussi<br />
sont s très faibbles.<br />
C'est-à-d dire qu’ils<br />
i à l’ensemble<br />
<strong>de</strong> la sociéété.<br />
L’efficacit té du vélo<br />
nsports en co ommun, en ttermes<br />
<strong>de</strong> ra apidité, <strong>de</strong><br />
mmation d'én nergie. Cepenndant,<br />
il n'assure<br />
pas le<br />
amment en cas c d'intempééries<br />
ou <strong>de</strong> relief trop<br />
es, la marche e à pied et lee<br />
vélo sont également é<br />
es déplaceme ents à pied oou<br />
à vélo peu uvent être<br />
stème <strong>de</strong>s dé éplacements en général mais m aussi<br />
effet, à travers<br />
l’Europe, uune<br />
série d’é étu<strong>de</strong>s ou<br />
en cours, visant v à apprréhen<strong>de</strong>r<br />
les différents<br />
par exemple, , que l’usage quotidien <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
l’espérance <strong>de</strong> vie ; l’Univversité<br />
d’Oxfo ord estime<br />
faveur <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>s<br />
actifs enttre<br />
1-10 et 1-20<br />
(pour<br />
ne infrastructure<br />
en faveuur<br />
<strong>de</strong> l’autom mobile en<br />
la difficulté pour<br />
certains d<strong>de</strong><br />
pouvoir eff fectuer un<br />
Au niveaau<br />
mondial, en 20005,<br />
environ 50% % du pétrole estt<br />
utilisé dans les s transports. Et le es transports repposent<br />
à 98% su ur le pétrole.<br />
(Wautelet, 22009,<br />
p.131)<br />
33<br />
« La sati tisfaction <strong>de</strong>s bessoins<br />
en matière e <strong>de</strong> mobilité s’ac accompagne <strong>de</strong> pressions p indésir rables sur l’envirronnement.<br />
Certa aines <strong>de</strong> ces<br />
pressions ssont<br />
supportées non pas par les s usagers qui les s occasionnent (v via une contrepa artie financière) mmais<br />
par <strong>de</strong>s tie ers, voire par<br />
l’ensemble e <strong>de</strong> la société. LLeurs<br />
effets et le es coûts corresppondants<br />
sont alors al qualifiés d’e externes. » (SPWW,<br />
DGARNE, 2010 0, p.41) Les<br />
coûts exterrnes<br />
du transporrt<br />
correspon<strong>de</strong>nt donc à la monéétarisation<br />
<strong>de</strong>s dommages<br />
subis par les usagerss<br />
ou la collectivit té se situant<br />
hors du sysstème<br />
<strong>de</strong> transpoort<br />
(Nayes et Arnold,<br />
2010). Il s’aagit<br />
par exemple <strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts, <strong>de</strong> d la pollution atmmosphérique,<br />
<strong>de</strong> es nuisances<br />
sonores, <strong>de</strong>e<br />
la congestion……<br />
Le concept doit<br />
cependant êtree<br />
pris avec certa aines réserves éta ant donné qu’il nn’est<br />
pas toujour rs évi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong><br />
convertir ceertaines<br />
inci<strong>de</strong>ncces<br />
en coût mon nétaire. Les ouvrrages<br />
pris en référence<br />
ici (nota amment INFRAS/ /IWW, 2004) fon nt cependant<br />
l’objet <strong>de</strong> consensus,<br />
notammment<br />
car ils util lisent <strong>de</strong>s méthoo<strong>de</strong>s<br />
validées au niveau européen n.<br />
34<br />
Liste nonn<br />
exhaustive d’étu<strong>de</strong>s<br />
et projets : http://www.euroo.who.int,<br />
www.coo.hhealth.usyd.edu.<br />
au/pdf/2005_cre eating_healthy_eenvironments.pd<br />
d, http://data.euro.who.int/PhysiccalActivity,<br />
www w.thepep.org,<br />
http://wwww.transformscotlaand.org.uk/GetFile.aspx?ItemId=1108<br />
http://www. dft.gov.uk/cyclingengland/,<br />
wwww.shapes-ssd.be<br />
35<br />
Extraits d<strong>de</strong><br />
rapports <strong>de</strong> mmissions<br />
rédigés <strong>de</strong> d la SPW-DGMVVH<br />
et <strong>IWEPS</strong> en lien l avec le cong grès Velocity ayannt<br />
eu lieu à Brux xelles en mai<br />
2009.
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 48<br />
rreport<br />
modal complet, il co onvient <strong>de</strong> favvoriser<br />
à tout le moins la comodalité<br />
mo<strong>de</strong>s actifs et le mo<strong>de</strong> ferroviaire.<br />
LLe<br />
fait <strong>de</strong> privvilégier<br />
l’urban nisation à proxximité<br />
<strong>de</strong>s ga ares plutôt qu’<br />
nnécessité<br />
<strong>de</strong> relier les polarités<br />
entre elles par un moyen <strong>de</strong> tr<br />
llongues<br />
distaances.<br />
Le trai in relie les poolarités<br />
<strong>de</strong> différents<br />
nive<br />
iirréaliste<br />
<strong>de</strong> penser que chacun c puissee<br />
trouver du travail dans<br />
ééquipements<br />
publics et communautair<br />
c res d’un nive eau élevé soi<br />
( (Dachelet, 20009).<br />
Le cho oix du train comme mod <strong>de</strong> <strong>de</strong> déplac<br />
aarguments<br />
quui<br />
suivent.<br />
LL’analyse<br />
<strong>de</strong>ss<br />
coûts extern nes liés au trransport<br />
<strong>de</strong> personnes p (Na<br />
22004)<br />
par voiture,<br />
bus/car, , moto et trainn<br />
montre que le train prése<br />
aau<br />
km les pluus<br />
faibles. L’étu<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Nayees<br />
et Arnold (2 2010) pour la<br />
eexternes<br />
<strong>de</strong>s acci<strong>de</strong>nts, <strong>de</strong><br />
la pollutionn<br />
atmosphériq que hors effe<br />
nnuisances<br />
sonores,<br />
<strong>de</strong> la consommatioon<br />
d’espace et e <strong>de</strong> la cong<br />
ssonores<br />
où lee<br />
train engend dre <strong>de</strong>s coûtss<br />
externes unitaires<br />
supéri<br />
nniveau<br />
du trannsport<br />
<strong>de</strong> pers sonnes, le moo<strong>de</strong><br />
le moins coûteux c pour<br />
Dans l’ensemmble<br />
<strong>de</strong>s coûts<br />
externes étudiés, int téressons-nou<br />
cclimatique,<br />
c’est-à-dire<br />
ce eux liés aux rrejets<br />
<strong>de</strong> GES S. Par voyage<br />
ll’avion,<br />
la voiture<br />
est le mo<strong>de</strong><br />
qui produuit<br />
le plus d’é émissions <strong>de</strong><br />
uunitaire<br />
externe<br />
du change ement climatiqque<br />
le plus él levé. Ce coût<br />
aau<br />
train et 2 ffois<br />
supérieur r au bus (Nayees<br />
et Arnold, 2010 2 ; INFRAS<br />
pp.25),<br />
les dépplacements<br />
en n train émettrraient<br />
5 à 20 fois moins <strong>de</strong><br />
PPourtant,<br />
commme<br />
cité en note <strong>de</strong> bas <strong>de</strong> page n°3 31, le parc a<br />
kkilomètres<br />
paarcourus<br />
en vo oiture ne cesssent<br />
<strong>de</strong> croitre e, ce qui s’exp<br />
uusagers<br />
ne coonnaissent<br />
so ouvent pas (oou<br />
n’ont pas conscience) c e<br />
eengendrés<br />
paar<br />
l’usage <strong>de</strong> la<br />
voiture.<br />
EEn<br />
2010, le parc wallon <strong>de</strong> véhicules s particuliers était à 99,4%<br />
ll’essence,<br />
au diesel et au LPG et donc c <strong>de</strong> carburants<br />
d’origine fo<br />
22010).<br />
Aucunne<br />
alternative n’a donc enccore<br />
émergé et séduit le c<br />
ttermes,<br />
il semble<br />
que no ous <strong>de</strong>vons faaire<br />
face à l’impossibilité<br />
ééquivalente<br />
par un arse enal d’énergies<br />
renouvela ables vu leu<br />
médiocres. LL’utilisation<br />
d’agrocarburannts<br />
pose enc core beaucou<br />
pproduction<br />
ddans<br />
le cadre<br />
du dévelloppement<br />
durable d (espa<br />
ll’alimentation…)<br />
et, au niv veau mondial, , elle ne perm mettrait <strong>de</strong> sub<br />
d<strong>de</strong><br />
pétrole (DDuvivier<br />
et Wautelet, W 20099).<br />
Pour ce qui est <strong>de</strong>s<br />
aautonomies<br />
eet<br />
vitesses lim mitées, ce qui<br />
en feraien nt <strong>de</strong>s voiture<br />
( (Duvivier et WWautelet,<br />
2009 9). Ce qui est souligné par plusieurs étud<br />
uun<br />
avenir à mmoyen<br />
terme consommer autant d’éne ergie et se dé<br />
36 ett<br />
par exemple e entre les<br />
au sein d’autrres<br />
polarités vient v <strong>de</strong> la<br />
ransport relattivement<br />
rapid <strong>de</strong> sur <strong>de</strong><br />
aux entre ellees<br />
car il peu ut sembler<br />
la polarité oùù<br />
il rési<strong>de</strong>, ou<br />
que les<br />
ent disposés dans chaque<br />
polarité<br />
cement inter-polarités<br />
déc coule <strong>de</strong>s<br />
ayes et Arnoldd,<br />
2010 ; INF FRAS/IWW,<br />
ente les coûts s externes par r voyageur<br />
Région walloonne<br />
a estimé é les coûts<br />
et <strong>de</strong> serre, d<strong>de</strong><br />
l’effet <strong>de</strong> serre, s <strong>de</strong>s<br />
estion. A l’exxception<br />
<strong>de</strong>s nuisances<br />
eurs à ceux ddu<br />
bus, le tra ain est, au<br />
la société et l’environneme<br />
ent.<br />
us à ceux qqui<br />
concernen nt le défi<br />
eur au kilomèètre<br />
et à l’exc ception <strong>de</strong><br />
CO2, et doncc<br />
le mo<strong>de</strong> qui i a le coût<br />
unitaire est pprès<br />
<strong>de</strong> 3 fois supérieur<br />
S/IWW, 2004) ). Selon la SNCB<br />
(2010,<br />
e CO2 que ceuux<br />
réalisés en n voiture<br />
automobile wwallon<br />
et le n<br />
plique entre aautres<br />
par le fa<br />
t ne paient paas<br />
la totalité<br />
% composé d<strong>de</strong><br />
véhicules<br />
ossile et non renouvelable<br />
consommateuur.<br />
A court et<br />
<strong>de</strong> remplaceer<br />
le pétrole<br />
urs ratios coombustion/per<br />
up <strong>de</strong> questioons<br />
en lien<br />
ace nécessaiire,<br />
compétit<br />
bstituer qu’un maximum <strong>de</strong><br />
voitures élecctriques,<br />
elles<br />
es <strong>de</strong> ville ouu<br />
<strong>de</strong> faibles<br />
<strong>de</strong>s, c’est qu’ on ne pourra<br />
éplacer en vééhicule<br />
individ<br />
37<br />
.<br />
ombre <strong>de</strong><br />
ait que les<br />
<strong>de</strong>s coûts<br />
roulant à<br />
es (<strong>IWEPS</strong>,<br />
t à moyen<br />
<strong>de</strong> façon<br />
rformance<br />
avec leur<br />
tion avec<br />
e 4 à 10%<br />
s ont <strong>de</strong>s<br />
distances<br />
plus dans<br />
duel <strong>de</strong> la<br />
36<br />
Pour la CCommission<br />
euroopéenne,<br />
la comodalité<br />
est définie<br />
comme "le re ecours efficace à différents mo<strong>de</strong>es<br />
<strong>de</strong> transport isolément<br />
ou<br />
en combinaaison<br />
dans le butt<br />
d'obtenir une ut tilisation optimalle<br />
et durable <strong>de</strong>s s ressources".<br />
37<br />
Exemple du calcul SNCB : « En 2008, un n usager du train n produisait en moyenne m 27,5 g <strong>de</strong> d CO2 par kilommètre<br />
parcouru (ou ( voyageur<br />
kilomètre – vkm). Pour unee<br />
voiture comptan nt en moyenne 11,4<br />
personne à son s bord, cela rep présente 156 g/vvkm,<br />
soit environ n 5 fois plus.<br />
Durant la ppointe<br />
et compte e tenu d’un taux d’occupation maaximal<br />
<strong>de</strong>s trains s, ces émissions s par vkm sont pr presque 4 fois mo oins élevées<br />
pour un usaager<br />
du train, et donc 20 fois plu us efficaces qu’unn<br />
trajet moyen en e voiture aux heu ures <strong>de</strong> pointe. GGrâce<br />
à un taux d’occupation d<br />
moyen pluss<br />
élevé, le train à gran<strong>de</strong> vitesse e (TGV) est encorre<br />
moins énergiv vore qu’un train moyen. m L’impact t <strong>de</strong>s émissions <strong>de</strong> d CO2 d’un<br />
voyage en TTGV<br />
est 10 fois mmoins<br />
important que le trajet équuivalent<br />
en avion.<br />
» (SNCB, 2010, p.25)
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 49<br />
même façon qu’à l’heure actuelle, c’es<br />
22008).<br />
Ne saachant<br />
pas encore e quand<br />
qqu’aucune<br />
altternative<br />
à la a voiture indiv<br />
aactuelle,<br />
il semble<br />
précaut tionneux d’ada<br />
ddécisions<br />
prisses<br />
en aména agement du t<br />
qqu’à<br />
moyen-loong<br />
terme.<br />
« La gran<strong>de</strong> ccapacité<br />
<strong>de</strong> tr ransport et la<br />
rroues<br />
et les ra rails en acier ren<strong>de</strong>nt r le tran<br />
vvue<br />
énergétiqque<br />
» (SNCB, 2010, p.22).<br />
ppour<br />
se déplaacer<br />
puisque 76% 7 du maté<br />
vvoyageurs<br />
remmorqués<br />
en traction t électr<br />
22010).<br />
Souliggnons<br />
que le<br />
réseau fe<br />
ll’accroissemeent<br />
du confort t du voyageur<br />
uune<br />
augmenttation<br />
<strong>de</strong> la consommation<br />
771%<br />
<strong>de</strong> la coonsommation<br />
totale d’énerg<br />
ppersonnes<br />
(SPW-DGO4,<br />
20 010. p. 12). T<br />
dd’occupation<br />
moyens, 2 à 9 fois<br />
lla<br />
journée et ddonc<br />
<strong>de</strong>s taux<br />
ssecteur<br />
pétroolier<br />
mais dép<br />
aactivités<br />
adapptées<br />
(au vu<br />
ggares,<br />
on favoorise<br />
l’usage d<br />
ddiminuer<br />
la coonsommation<br />
LLa<br />
voiture inddividuelle<br />
telle<br />
ééquipés.<br />
Quannd<br />
il n’y a pas<br />
à peu près paartout<br />
sur le t<br />
ss’organiser<br />
avvec<br />
d’autres<br />
rrési<strong>de</strong>nce<br />
et <strong>de</strong> nombreu<br />
ffonctionnemeent<br />
<strong>de</strong> l’organ<br />
cconduite<br />
autoomobile<br />
(Halle<br />
ss’aperçoit<br />
quu’elle<br />
engendr<br />
cclimatique<br />
et énergétique<br />
ssociale<br />
<strong>de</strong> l’acccès<br />
à la mob<br />
cce<br />
qui peut ppar<br />
exemple<br />
ll’urbanisation<br />
sur le territ<br />
tterritoires<br />
bieen<br />
accessibles<br />
êêtre<br />
pratiquéss,<br />
n’ont pratiq<br />
LLe<br />
coût social<br />
d’un déplace<br />
vvu<br />
plus haut, les coûts ex<br />
ttrain<br />
et du bus.<br />
Qu’en est<br />
marchand ? CCes<br />
coûts peu<br />
39 st-à-dire avec c rapidité, con nfort, large au<br />
le renchéris ssement <strong>de</strong>s produits pétr<br />
viduelle offran nt les mêmes avantages n<br />
apter les polit tiques au plus s vite, d’autan<br />
territoire pren nd un certain temps et n’a<br />
faible résista ance au roulem ment au nivea<br />
nsport par che emin <strong>de</strong> fer ex xtrêmement é<br />
Les trains on nt principalem ment recourt à<br />
ériel <strong>de</strong> la SNC CB est à tract tion électrique<br />
rique est pas ssée <strong>de</strong> 89% à 93% entre<br />
rroviaire belg ge s’électrifie e un peu p<br />
r ainsi que le nombre <strong>de</strong> trains<br />
à grand<br />
n d’électricité <strong>de</strong> traction. En Wallonie,<br />
gie pour la tra action <strong>de</strong>s trains<br />
Toujours selo on la SNCB, l<br />
moinss<br />
énergivore que q la voiture<br />
x d’occupationn<br />
<strong>de</strong>s trains. Le L mo<strong>de</strong> ferro<br />
pend par conttre<br />
fortement t <strong>de</strong> la produc<br />
<strong>de</strong> leur profill<br />
<strong>de</strong> mobilité ; CPDT, 2005<br />
<strong>de</strong>s trains, cee<br />
qui permet d’augmenter d le<br />
d’énergie parr<br />
personne et par kilomètre<br />
e qu’usitée à l’heure actuelle<br />
offre un co<br />
s <strong>de</strong> congestioon<br />
ou <strong>de</strong> mau uvaises condit<br />
territoire en uun<br />
temps reco ord, sans avoi<br />
personnes (CCPDT,<br />
2003b). . Elle a d’aille<br />
ses activités dans les périphéries<br />
et<br />
nisation du teerritoire<br />
est d’ailleurs d main<br />
eux, 2005). MMalheureusem<br />
ment, au vu<br />
re <strong>de</strong> nombrreux<br />
coûts et t qu’elle ne p<br />
qui atten<strong>de</strong>ntt<br />
la Wallonie. Ces coûts é<br />
bilité. Certainss<br />
ménages n’o ont pas les mo<br />
poser <strong>de</strong>s diifficultés<br />
dans s la recherch<br />
toire. D’autrees<br />
ménages, parce qu’ils<br />
s aux transpoorts<br />
en comm mun au vu <strong>de</strong>s<br />
uement pas dd’autre<br />
alterna ative à l’usage<br />
ement compreend<br />
les coûts monétaires e<br />
xternes unitairres<br />
totaux <strong>de</strong> e la voiture so<br />
t-il alors <strong>de</strong>s coûts monét taires, c'est-à<br />
uvent être scinndés<br />
en coûts s à charge <strong>de</strong><br />
38<br />
utonomie... (B Brocorens,<br />
roliers aura lieu l et vu<br />
n’est au point à l’heure<br />
nt que l’applic cation <strong>de</strong>s<br />
a généralemen nt d’effets<br />
au du contact t entre les<br />
économique du d point <strong>de</strong><br />
à la traction électrique<br />
e. La part <strong>de</strong>s s trains <strong>de</strong><br />
e 1990 et 200 09 (SNCB,<br />
plus chaque année et<br />
<strong>de</strong> vitesse ont provoqué<br />
l’électricité représente r<br />
, dont 499%<br />
pour le tra ansport <strong>de</strong><br />
e train seraitt,<br />
en fonction <strong>de</strong>s taux<br />
et cela en foonction<br />
<strong>de</strong> la pério<strong>de</strong> p <strong>de</strong><br />
oviaire est donnc<br />
moins dépendant<br />
du<br />
ction électriquue.<br />
En conce entrant les<br />
5a) et la rési<strong>de</strong>nce<br />
à prox ximité <strong>de</strong>s<br />
e taux d’occuupation<br />
et également<br />
<strong>de</strong><br />
e.<br />
onfort non néggligeable<br />
aux x ménages<br />
tions climatiques,<br />
elle perm met d’aller<br />
ir à partager uun<br />
espace co ommun ou<br />
eurs permis lee<br />
développem ment <strong>de</strong> la<br />
même dans les milieux ruraux. r Le<br />
ntenant largeement<br />
dépend dant <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong> ce qui a été vu plus haut, on<br />
permet pas d<strong>de</strong><br />
répondre aux défis<br />
levés posent également la a question<br />
oyens <strong>de</strong> s’éqquiper<br />
en auto omobile(s),<br />
he d’un emplooi<br />
vu l’organisation<br />
<strong>de</strong><br />
n’ont pas ppu<br />
s’installer dans <strong>de</strong>s<br />
s prix immobbiliers<br />
élevés pouvant y<br />
e <strong>de</strong> la voituree<br />
pour se dépl lacer.<br />
et les coûts exxternes.<br />
Comm me il a été<br />
ont largementt<br />
supérieurs à ceux du<br />
à-dire <strong>de</strong>s cooûts<br />
qui font l’échange<br />
e l’usager (ce que paie l’us sager pour<br />
38<br />
La consommation<br />
spécifiqque<br />
d’électricité <strong>de</strong> traction <strong>de</strong> laa<br />
Wallonie est d’a ailleurs supérieur re à la moyenne nationale.<br />
39<br />
Exemple du calcul SNCB : « Par rapport à un déplacemennt<br />
moyen en voit iture, un déplace ement en train nee<br />
nécessite que la moitié <strong>de</strong><br />
l’énergie : sseulement<br />
2,5 littres<br />
d’équivalent t diesel pour 1000<br />
km. Compte ten nu <strong>de</strong> l’occupatio on moyenne d’unne<br />
voiture par 1, 4 personnes<br />
(Source : Fe Febiac), cela est ccomparable<br />
à un ne voiture ayant t une consommat tion moyenne réelle<br />
<strong>de</strong> seulemen ent 3,4 l/100 km. . Aux heures<br />
<strong>de</strong> pointe, aavec<br />
une occupaation<br />
du train 3 à 4 fois supérieur ure (LF = load fac ctor, taux d’occu upation) et seulemment<br />
1,2 personne<br />
dans une<br />
voiture, le ttrain<br />
se révèle 7 à 9 plus économ mique. » (SNCB, 22010,<br />
p.23)
sson<br />
déplacemment)<br />
et en coûts<br />
publics. C<br />
NNamur<br />
<strong>de</strong> gaare<br />
à gare en ntre train et<br />
ddécembre<br />
2010,<br />
le prix d’ un billet 2<br />
ccertaines<br />
hyppothèses<br />
sur l<br />
magazine « lee<br />
moniteur <strong>de</strong><br />
kkilomètre<br />
minnimum<br />
(prix d<br />
uun<br />
trajet <strong>de</strong> 660<br />
km, ce prix<br />
een<br />
train. En ccas<br />
<strong>de</strong> covoit<br />
pprésent<br />
coût estimé au k<br />
ccarburant,<br />
taxxe<br />
<strong>de</strong> roulage<br />
à l’utilisation <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnie<br />
ttrain<br />
se justifiant<br />
par l’oblig<br />
een<br />
matière <strong>de</strong>e<br />
tarification e<br />
éégalement<br />
teenir<br />
compte<br />
ddépenses<br />
<strong>de</strong> transport en B<br />
ppermettant<br />
laa<br />
comparaison<br />
lles<br />
coûts pubblics<br />
pour le t<br />
ttenir<br />
compte également <strong>de</strong><br />
ppopulation.<br />
DDans<br />
le cas d<br />
( (construction, , entretien, po<br />
rrecettes<br />
publiiques<br />
(taxes)<br />
lla<br />
voie ferréee<br />
implique <strong>de</strong>s<br />
jjustement<br />
less<br />
différents m<br />
ttransport,<br />
il eest<br />
nécessair<br />
marginaux soociaux<br />
<strong>de</strong>s t<br />
pproducteurs,<br />
ssur<br />
les revenu<br />
A l’heure acttuelle,<br />
les pé<br />
ppossè<strong>de</strong>nt<br />
une<br />
certaine mi<br />
oou<br />
à vélo, à condition<br />
que l<br />
LLes<br />
mo<strong>de</strong>s aactifs<br />
(march<br />
ppermettent<br />
unne<br />
économie d<br />
dd’encombremment<br />
et <strong>de</strong> con<br />
d<strong>de</strong><br />
stationnemment),<br />
aux pol<br />
ème<br />
Comparons les s coûts à charge<br />
<strong>de</strong> l’usageer<br />
pour un tra ajet Liège-<br />
voiture, soit une distance d’environ 600<br />
km. En tra ain, au 31<br />
classe sans réduction r est <strong>de</strong> 8,1 euross.<br />
En voiture, en faisant<br />
la voiture connsidérée<br />
et su ur les coûts fixes<br />
et variabbles<br />
qui y son nt liés<br />
e l’automobilee<br />
» n°1413 (2 20 février 2008)<br />
a estiméé<br />
un prix <strong>de</strong> r<br />
ont a raremennt<br />
conscience e l’usager) pour<br />
une voituree<br />
à 0,23 euro<br />
x minimum doonne<br />
ainsi un coût <strong>de</strong> 14 eu uros, soit pressque<br />
le double<br />
turage, ce cooût<br />
par perso onne au km est e évi<strong>de</strong>mmeent<br />
réduit. Bi<br />
ilomètre en vvoiture<br />
intègre e différentes taxes payéess<br />
à l’Etat (tax<br />
…) alors que le prix du billet<br />
<strong>de</strong> train ne représente qqu’une<br />
partie d<br />
r car en partie<br />
subventionn né par l’Etat ; ce transfert d’argent pub<br />
gation <strong>de</strong> servvice<br />
public ren ndu à la collec ctivité (à savoiir<br />
contraintes<br />
et <strong>de</strong> service uuniversel).<br />
Pour<br />
comparer au a mieux les <strong>de</strong>ux mo<strong>de</strong>s,<br />
<strong>de</strong>s coûts ppublics.<br />
Malhe eureusement, les étu<strong>de</strong>s qui ont env<br />
Belgique (Nauutet,<br />
2008a et t 2008b) ne fo ournissent pass<br />
<strong>de</strong> données<br />
n <strong>de</strong>s coûts puublics<br />
par voy yageur-kilomè ètre entre le ttrain<br />
et la voit<br />
train, en plus <strong>de</strong>s coûts lié és aux infrast tructures et aau<br />
personnel,<br />
es subventionns<br />
accordées à ce transport<br />
considéré ccomme<br />
un se<br />
e la voiture, il faut tenir compte c <strong>de</strong>s dépenses d pubbliques<br />
liées à<br />
olice, sécuritéé<br />
routière…). Pour le trans sport <strong>de</strong> perso sonnes par la<br />
seraient supéérieures<br />
aux dépenses d alors<br />
que le transsport<br />
<strong>de</strong> pers<br />
s dépenses ssupérieures<br />
au ux recettes (N Nautet, 2008bb).<br />
Pour comp<br />
mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transport<br />
et don nc juger <strong>de</strong> manière m adéqquate<br />
une po<br />
re <strong>de</strong> réaliserr<br />
une analyse e coûts-béné éfices sociauxx<br />
(basée sur<br />
transports), mmesurant<br />
l’im mpact <strong>de</strong> ce ette <strong>de</strong>rnière sur les usa<br />
us <strong>de</strong>s pouvoirs<br />
publics et sur s les externalités<br />
(Hoornaaert<br />
et al. 200<br />
rimètres autoour<br />
<strong>de</strong>s gares s sont déjà souvent s <strong>de</strong>s zzones<br />
plus d<br />
xité <strong>de</strong>s foncttions.<br />
Cette st tructuration fa avorise déjà lees<br />
déplaceme<br />
les infrastructtures<br />
viaires soient s bien adaptées.<br />
he à pied, vvélo…),<br />
seuls s ou en com mpléments aux<br />
transports<br />
d’énergie et dd’espace<br />
car ils<br />
apportent en e partie une rréponse<br />
aux p<br />
ngestion du rééseau<br />
(la voitu ure est consommatrice<br />
d’eespace<br />
<strong>de</strong> circ<br />
itiques plus reestrictives<br />
en matière <strong>de</strong> st tationnement, , etc.<br />
40 , le<br />
revient au<br />
/km 41 . Sur<br />
e du trajet<br />
en sûr, le<br />
xes sur le<br />
du coût lié<br />
blic vers le<br />
imposées<br />
il faudrait<br />
visagé les<br />
explicites<br />
ture. Dans<br />
il faudrait<br />
ervice à la<br />
à la voirie<br />
route, les<br />
onnes par<br />
parer plus<br />
olitique <strong>de</strong><br />
les coûts<br />
agers, les<br />
09).<br />
enses qui<br />
ents à pied<br />
s publics,<br />
problèmes<br />
culation et<br />
Les avantages<br />
liés au développeme ent d’une struucturation<br />
spa atiale centrée sur l’utilisatioon<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s<br />
actifs et<br />
<strong>de</strong>s trainss<br />
pour les dééplacements<br />
inter-polaritéss<br />
apparaissent<br />
clairement dans l’ensemmble<br />
<strong>de</strong> ces arguments,<br />
surtout loorsque<br />
l’on tieent<br />
compte <strong>de</strong>s<br />
défis qui attten<strong>de</strong>nt<br />
notre société.<br />
40<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 50<br />
Selon la FEBIAC, en 20088,<br />
l’âge moyen du<br />
parc <strong>de</strong> voiturees<br />
belges est <strong>de</strong> 7,9 ans. Nous avons a donc pris ddans<br />
le tableau du d magazine<br />
un amortisssement<br />
<strong>de</strong> la vooiture<br />
sur 8 ans. Selon les chiffrres<br />
du SPF Mobilité<br />
et Transport,<br />
on peut estimmer<br />
le nombre <strong>de</strong> e kilomètres<br />
moyen parccouru<br />
par voituree<br />
particulière et par p an à environ 18 000 km (IWE EPS, 2010). Nous s avons donc priss<br />
en compte dan ns le tableau<br />
du « Monitteur<br />
<strong>de</strong> l’Automobile<br />
» une dist tance <strong>de</strong> 15 0000<br />
km par an, 30 3 000 et 40 00 00 km apparaisssant<br />
comme distance<br />
trop<br />
importante.<br />
41<br />
Ce prix d<strong>de</strong><br />
revient du km <strong>de</strong> 0,23 euro es st celui d’une Cittroën<br />
C1 diesel. Pour P une Renault<br />
Mégane, modèèle<br />
le plus vendu en 2009 en<br />
Belgique, lee<br />
prix <strong>de</strong> revient minimum est <strong>de</strong> e 0,30 euro/km.
4.2.2. MMéthodologie<br />
d’analyse <strong>de</strong>s s éclairages ssur<br />
le développ pement durab ble<br />
La méthoodologie<br />
déveeloppée<br />
et ad daptée du CEERTU<br />
est déc crite dans la Brève <strong>de</strong> l’IWWEPS<br />
« Développement<br />
d’indicateeurs<br />
locaux d<strong>de</strong><br />
développe ement territorrial<br />
durable et e évaluation <strong>de</strong> leurs écllairages<br />
» (Re eginster &<br />
Charlier, 2010). Dans cette partie, l’analyse <strong>de</strong>es<br />
éclairages sur le dévelo oppement durrable<br />
est effe ectuée sur<br />
l’indicateur<br />
« part <strong>de</strong> logements<br />
réc cemment construits<br />
dans <strong>de</strong>s d zones d’a accessibilité (tthéorique)<br />
aux x gares et<br />
arrêts <strong>de</strong>e<br />
bus bien <strong>de</strong>esservis<br />
». No ous tentons ddonc<br />
<strong>de</strong> répon ndre à la que estion <strong>de</strong> savvoir<br />
pourquoi le fait <strong>de</strong><br />
concentreer<br />
l’habitat à pproximité<br />
<strong>de</strong>s gares et arrêêts<br />
<strong>de</strong> bus bien<br />
<strong>de</strong>sservis plutôt<br />
que <strong>de</strong> lee<br />
laisser s’éparpiller<br />
ou<br />
que <strong>de</strong> lee<br />
concentrer ailleurs s’ins scrit dans less<br />
principes du u développem ment durable. L’indicateur « part <strong>de</strong><br />
logementts<br />
récemmentt<br />
construits da ans un noyau d’habitat » n’ ’est pas l’obje et <strong>de</strong> cette parrtie<br />
<strong>de</strong> l’analy yse car les<br />
argumentts<br />
utilisés nouus<br />
apparaissent<br />
fort prochees<br />
<strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> l’indicateur <strong>de</strong><br />
proximité auux<br />
gares.<br />
La premmière<br />
étape <strong>de</strong> l’analyse consiste à construire sept interrog gations autouur<br />
<strong>de</strong>s quat tre piliers<br />
(environnnemental,<br />
écoonomique,<br />
soc cial et <strong>de</strong> goouvernance)<br />
du d développem ment durablee<br />
et <strong>de</strong> trois interfaces<br />
(équitablee,<br />
viable, vivaable).<br />
La <strong>de</strong>uxième<br />
étape est constitué ée <strong>de</strong> la réponse<br />
aux quesstions<br />
pour l’ indicateur<br />
avec l’élaaboration<br />
d’unne<br />
échelle d’appréciation<br />
coohérente<br />
et pe ertinente.<br />
Pour l’inddicateur<br />
consiidéré<br />
ici, voici<br />
l’appréciatioon<br />
avec un ccommentaire<br />
explicatif :<br />
42 donnée pour<br />
chaque question<br />
(Reginster<br />
& Charl lier, 2010)<br />
Questions<br />
EEchelle<br />
dd’appréciation<br />
1. Gouvernnance<br />
+<br />
2. Social<br />
3. Econommique<br />
+<br />
42<br />
+<br />
Commenntaires<br />
Au vu <strong>de</strong>s<br />
défis auxqu uels nos sociét tés doivent et vont <strong>de</strong>voir fa aire face, il<br />
semble qque<br />
l’indicateur<br />
informe <strong>de</strong> manière<br />
positivee<br />
sur la gouvern nance mise<br />
en placee<br />
aux différents s niveaux <strong>de</strong> pouvoir.<br />
Une cooncentration<br />
plus<br />
forte <strong>de</strong><br />
l’habitat dans les lieu ux les plus accessibles<br />
en transports en n commun<br />
apparaît comme une st tructuration du territoire à valloriser<br />
pour fair re face aux<br />
défis cliimatiques<br />
et énergétiques.<br />
é<br />
Il s’agit pour les pouvoirs publics en<br />
charge d<strong>de</strong>s<br />
politiques d’aménageme ent du territoirre<br />
d’avoir une vision qui<br />
dépasse e le court terme e. Cette concen ntration permet t également une<br />
meilleure<br />
gestion <strong>de</strong>s ressource es naturelles et e <strong>de</strong>s coûts ccollectifs<br />
assur rés par les<br />
pouvoirss<br />
publics. L’indicateur<br />
n’inform me pas encoree<br />
sur une concertation<br />
ou<br />
une partticipation<br />
citoye enne.<br />
Le fait dd’habiter<br />
hors d’une d zone très<br />
accessible een<br />
transports en<br />
commun<br />
peut imppliquer<br />
un isole ement social im mportant ou unee<br />
dépendance à la voiture<br />
associéee<br />
à une forte baisse du po ouvoir d’achatt.<br />
Certaines couches<br />
<strong>de</strong><br />
populatioon<br />
moins mobi iles dont notam mment <strong>de</strong>s perssonnes<br />
plus âg gées ou qui<br />
n’ont paas<br />
les moyens d’acquérir une automobile soont<br />
alors partic culièrement<br />
fragiliséees.<br />
Les déplac cements à pied d, à vélo ou een<br />
transport en<br />
commun<br />
semblennt<br />
plus favorab bles aux renco ontres, aux écchanges<br />
et aux<br />
relations<br />
sociales que l’utilisation<br />
<strong>de</strong> la voiture particulière.<br />
Les coûtts<br />
<strong>de</strong> l’usage du d vélo ou <strong>de</strong> la marche à piied<br />
sont très fa aibles, tant<br />
pour l’inndividu<br />
que pou ur la collectivité é. Il a été vu éégalement<br />
préc cé<strong>de</strong>mment<br />
que les coûts à charg ge <strong>de</strong> l’usager du train étaiennt<br />
inférieurs aux<br />
coûts à<br />
charge d<strong>de</strong><br />
l’usager <strong>de</strong> la voiture lorsque<br />
celui-ci esst<br />
seul dans so on véhicule<br />
(section 4.2.1.2). Les s effets exter rnes monétarissés<br />
<strong>de</strong> la vo oiture sont<br />
largement<br />
supérieurs à ceux du train n. A propos <strong>de</strong>es<br />
coûts public cs, il serait<br />
intéressaant<br />
<strong>de</strong> compare er les coûts liés<br />
aux réseaux routiers <strong>de</strong> Wa allonie avec<br />
les coûtss<br />
du rail.<br />
++ iinforme<br />
substanttiellement<br />
<strong>de</strong> ma anière positive paar<br />
rapport aux ob bjectifs du dévelo oppement durable<br />
+ iinforme<br />
<strong>de</strong> manièère<br />
positive par rapport r aux objecctifs<br />
du développ pement durable<br />
0 hhors<br />
sujet ou neuutre<br />
- iinforme<br />
<strong>de</strong> manièère<br />
négative par rapport aux objeectifs<br />
du dévelop ppement durable<br />
-- iinforme<br />
substanttiellement<br />
<strong>de</strong> ma anière négative ppar<br />
rapport aux objectifs<br />
du <strong>développement</strong><br />
durabble<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 51
4. Environnemental<br />
+ ++<br />
5. Equitabble<br />
0<br />
6. Viable<br />
7. Vivable<br />
+ ++<br />
+<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 52<br />
L’utilisattion<br />
<strong>de</strong>s transp ports en comm mun, la marchee<br />
à pied et le vélo v ont un<br />
impact ttrès<br />
faible sur l’environnemen nt. L’impact duu<br />
train est <strong>de</strong> 3 à 10 fois<br />
moins immportant<br />
que celui <strong>de</strong> la voiture<br />
en termmes<br />
d’émission ns <strong>de</strong> GES<br />
(section 4.2.1.2). Entre<br />
1990 et 2008,<br />
le secteurr<br />
du transport routier en<br />
Walloniee<br />
(marchandise es compris) a connu c une auggmentation<br />
<strong>de</strong> 47,7% <strong>de</strong><br />
ses émisssions<br />
<strong>de</strong> GES alors que la Be elgique a <strong>de</strong>s oobjectifs<br />
<strong>de</strong> réd duction <strong>de</strong>s<br />
GES <strong>de</strong> 220<br />
à 30% pour r 2020 par rapp port à 1990 (AWWAC,<br />
2010, do onnées non<br />
publiéess).<br />
Si l’on tient compte <strong>de</strong> la ressource « sool<br />
», il apparaît clairement<br />
que struucturer<br />
le déve eloppement <strong>de</strong> e la rési<strong>de</strong>nce et <strong>de</strong>s activit tés sur les<br />
gares peermet<br />
d’économ miser beaucoup<br />
d’espace. Laa<br />
valorisation <strong>de</strong>s d mo<strong>de</strong>s<br />
actifs et t <strong>de</strong> l’usage du u train permette ent en outre <strong>de</strong><br />
répondre en partie aux<br />
problèmes<br />
d’encombre ement et <strong>de</strong> co ongestion du rréseau<br />
<strong>de</strong> voir ries dus en<br />
gran<strong>de</strong> ppartie<br />
aux nombreux<br />
véhicules s particuliers.<br />
L’accès au logement à proximité (15 5 minutes à vvélo)<br />
<strong>de</strong>s gares s n’est pas<br />
toujours aisé car les pr rix fonciers peu uvent être plus élevés que dan ns les lieux<br />
plus pérriphériques.<br />
Le es terrains sont<br />
plus petits eet<br />
plus chers à l’unité et<br />
ren<strong>de</strong>nt donc l’accès au logement difficile pour une certaine part <strong>de</strong> la<br />
populatioon.<br />
Par contre, , la proximité <strong>de</strong> d la gare, la mmarche<br />
à pied,<br />
le vélo et<br />
l’utilisatiion<br />
<strong>de</strong>s transports<br />
en commun<br />
offrent unee<br />
mobilité finan ncièrement<br />
accessibble<br />
au plus gran nd nombre et permet p une inddépendance<br />
à la a voiture et<br />
à ses ccoûts<br />
élevés aujourd’hui<br />
et peut-être p encoore<br />
probablement<br />
plus à<br />
l’avenir. Si le relief à pr roximité <strong>de</strong>s ga ares est trop immportant,<br />
les mo<strong>de</strong>s<br />
actifs<br />
sont forttement<br />
pénalis sés. De plus, le es mo<strong>de</strong>s actiffs<br />
nécessitent une bonne<br />
santé. L’équité n’est t donc pas toujours posssible.<br />
En milieu<br />
rural,<br />
l’augmenntation<br />
<strong>de</strong> l’utilisation<br />
<strong>de</strong> la voiture particuulière<br />
a favoris sé la perte<br />
d’infrastructures<br />
locale es et la centra alisation d’actiivités<br />
(CPDT, 2004, 2 p.8),<br />
rendant d’autant plus difficiles l’accè ès aux servicees<br />
<strong>de</strong> proximité é et isolant<br />
d’autant plus les personnes<br />
peu mobiles.<br />
Vu l’utiliisation<br />
intense actuelle <strong>de</strong>s combustibles fossiles et la raréfaction<br />
attenduee<br />
<strong>de</strong>s réserves encore dispon nibles, la localisation<br />
proche <strong>de</strong>s gares<br />
ou bien accessible pa ar <strong>de</strong>s alternatives<br />
à la voituure<br />
réduit la dépendance<br />
énergétiqque.<br />
Cela pe ermet aux ha abitants <strong>de</strong> cees<br />
zones d’ê être moins<br />
vulnérabbles<br />
aux évolutions<br />
du prix du u pétrole et <strong>de</strong> contribuer à l’ ’effort pour<br />
réduire les<br />
émissions <strong>de</strong> d GES. L’urban nisation rési<strong>de</strong>nntielle<br />
dans ces s zones est<br />
donc bieen<br />
viable. Le principe p <strong>de</strong> précaution<br />
seraitt<br />
<strong>de</strong> limiter fo ortement la<br />
construcction<br />
<strong>de</strong> logem ments dans <strong>de</strong> es zones difficcilement<br />
acces ssibles aux<br />
alternativves<br />
à la voitur re. De plus, la concentration autour <strong>de</strong>s gares<br />
permet<br />
d’éviter la dispersion <strong>de</strong> d l’urbanisation<br />
et ses consééquences<br />
néfas stes (CPDT,<br />
2002).<br />
L’indicatteur<br />
informe pe eu sur une amé élioration du caadre<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s<br />
habitants<br />
ou sur les effets su ur la santé. Cependant, onn<br />
peut estimer<br />
que le<br />
développpement<br />
du loge ement à proxim mité <strong>de</strong>s gares ffavorise<br />
la mar rche à pied<br />
et le véélo,<br />
<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong> es <strong>de</strong> déplace ements actifs qui impliquen nt peu <strong>de</strong><br />
nuisancees<br />
sonores et qui q permettent une dépense physique béné éfique pour<br />
la santéé.<br />
Si le relief à proximité <strong>de</strong>s<br />
gares est tro rop important, le vélo en<br />
particulieer<br />
sera forteme ent pénalisé et <strong>de</strong>s solutions alternatives <strong>de</strong> evront alors<br />
être trouuvées<br />
(transports<br />
en commun<br />
légers…). CCes<br />
mo<strong>de</strong>s act tifs limitent<br />
aussi less<br />
rejets <strong>de</strong> pollu uants toxiques pour la santé hhumaine.<br />
Les coûtts<br />
externes unit taires <strong>de</strong>s nuisances<br />
sonores s du train sont inférieurs i à<br />
ceux <strong>de</strong> la voiture (Nayes<br />
et Arnold, 2010). Il appaaraît<br />
donc que l’usage du<br />
train s’avvère<br />
plus bénéfique<br />
au niveau u sonore que ceelui<br />
<strong>de</strong> la voitur re même si<br />
<strong>de</strong> façonn<br />
très locale, la forte prox ximité d’une vvoie<br />
ferrée implique<br />
une<br />
nuisancee<br />
importante.<br />
L’améliooration<br />
du cadre<br />
<strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s habitants danns<br />
un milieu plus p <strong>de</strong>nse<br />
dépend fortement <strong>de</strong>s s mesures urba anistiques et dd’aménagemen<br />
nt qui sont<br />
prises. LLaisser<br />
moins <strong>de</strong> place à la<br />
voiture permmettrait<br />
par exemple<br />
<strong>de</strong><br />
dégager <strong>de</strong> l’espace pour les piét tons, les cycllistes,<br />
les tran nsports en<br />
communn,<br />
<strong>de</strong> la verdure e, <strong>de</strong>s lieux <strong>de</strong> rencontre… r
Les résuultats<br />
<strong>de</strong> l’évvaluation<br />
<strong>de</strong>s éclairages ssont<br />
soumis à un groupe<br />
restreint dd’experts<br />
cho oisis dans<br />
l’administration,<br />
les caabinets<br />
ministériels<br />
et danss<br />
les milieux académiques.<br />
a<br />
Graphiquue<br />
8 : Radar présentant les<br />
éclairagess<br />
<strong>de</strong> l’indica ateur « Part <strong>de</strong> d nouveaux logements construits c<br />
dans unee<br />
zone d’acceessibilité<br />
aux x transports een<br />
commun » sur le déve eloppement ddurable<br />
Interface<br />
vivable<br />
Dimen nsion<br />
environnemen<br />
tal le<br />
Interfaace<br />
viablee<br />
Gouvernance e<br />
++<br />
+<br />
0<br />
-<br />
--<br />
Dimensio on<br />
sociale<br />
Dimension<br />
économique<br />
Interface<br />
équitab ble<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 53<br />
La troisièème<br />
étape <strong>de</strong>e<br />
la méthodologie<br />
est la cconstruction<br />
d’un d graphiqu ue <strong>de</strong> type « radar » prése entant les<br />
éclairagees<br />
sur le <strong>développement</strong><br />
durable<br />
(graphiqque<br />
8).<br />
Le graphique<br />
radar moontre<br />
que con ncentrer les nnouvelles<br />
cons structions rés si<strong>de</strong>ntielles à pproximité<br />
<strong>de</strong>s s gares ou<br />
<strong>de</strong>s arrêtts<br />
<strong>de</strong> bus bien<br />
<strong>de</strong>sservis rencontre<br />
les objectifs <strong>de</strong> développeme<br />
d nt durable daans<br />
presque toutes t ses<br />
dimensions.<br />
Bien sûrr,<br />
cette conc centration nee<br />
doit pas se<br />
faire <strong>de</strong> façon<br />
irréflécchie<br />
mais <strong>de</strong> evrait être<br />
accompaagnée<br />
par <strong>de</strong>s mesures com mplémentairess<br />
afin <strong>de</strong> la rendre<br />
enviable :<br />
lla<br />
plupart <strong>de</strong>s<br />
nouvelles s implantations<br />
qui enge endrent <strong>de</strong> nombreux n dééplacements<br />
<strong>de</strong>vraient<br />
éégalement<br />
êttre<br />
mieux loc calisées par rapport à ce e critère. En effet, en pluus<br />
<strong>de</strong>s lieux d’origine<br />
( (domicile), less<br />
lieux <strong>de</strong> <strong>de</strong>s stination (travaail,<br />
écoles, se ervices…) <strong>de</strong>v vraient autantt<br />
que possible e se situer<br />
ddans<br />
les zonees<br />
d’accessibi ilité afin <strong>de</strong> faavoriser<br />
l’usag ge <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s s doux et du trrain.<br />
A l’heure e actuelle,<br />
ccertains<br />
lieuxx<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>stinatio on peu accesssibles<br />
en tran nsports en co ommun ne peermettent<br />
pas un report<br />
modal pour ceertains<br />
déplac cements malggré<br />
une localis sation rési<strong>de</strong>ntielle<br />
dans <strong>de</strong>es<br />
zones accessibles<br />
en<br />
TTC.<br />
Les foncctions<br />
visitées<br />
fréquemmeent<br />
par une population nombreuse n ett<br />
dispersée et qui se<br />
ccontentent<br />
<strong>de</strong>e<br />
peu d’espace<br />
<strong>de</strong>vraient d’ailleurs<br />
avoir r la position la a plus accessiible,<br />
préalable ement à la<br />
ffonction<br />
résid<strong>de</strong>ntielle<br />
;<br />
ll’accessibilitéé<br />
aux gares pa ar les transporrts<br />
en commu un (métros, tra ams, bus…), les vélos et le es piétons<br />
d<strong>de</strong>vrait<br />
être aaméliorée<br />
par<br />
<strong>de</strong>s aménaagements<br />
ada aptés, notamm ment en mattière<br />
<strong>de</strong> sécurité<br />
et <strong>de</strong><br />
ffluidité.<br />
Lorsqque<br />
le relief est e trop pronooncé,<br />
les itiné éraires cyclab bles <strong>de</strong>vraientt<br />
pouvoir être e suppléés<br />
ppar<br />
un mo<strong>de</strong> alternatif non polluant ;<br />
lles<br />
abords <strong>de</strong>es<br />
gares doive ent être repennsés<br />
et urbani isés <strong>de</strong> maniè ère réfléchie aafin<br />
d’offrir un n cadre <strong>de</strong><br />
vvie<br />
agréable eet<br />
en réponda ant aux objectifs<br />
<strong>de</strong> dévelop ppement dura able. Les aménnagements<br />
à envisager<br />
cconsistent<br />
à la<br />
fois à mettre<br />
en œuvre lees<br />
potentiels fonciers f non valorisés v et à aaméliorer<br />
le patrimoine p<br />
eexistant<br />
(recoonstruction,<br />
ré énovation…). La CPDT (20 005c) a d’aille eurs fourni <strong>de</strong>e<br />
précieux élé éments <strong>de</strong><br />
rréflexion<br />
quant<br />
à <strong>de</strong>s structurations<br />
poossibles<br />
<strong>de</strong>s quartiers q <strong>de</strong> gares. g L’objecctif<br />
était <strong>de</strong> définir d <strong>de</strong>s
sstratégies<br />
d’aaffectation<br />
du sol pour favooriser<br />
le repo ort <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>. Les gares IC/ /IR et les futu ures gares<br />
RRER<br />
<strong>de</strong> Walloonie<br />
ont ainsi été classées en différentes s catégories selon s leurs rôlles<br />
principaux x <strong>de</strong> façon<br />
à pouvoir défiinir<br />
<strong>de</strong>s stratégies<br />
différencciées<br />
;<br />
aafin<br />
<strong>de</strong> garanntir<br />
l’équité, le es abords <strong>de</strong>ss<br />
gares doiven nt être <strong>de</strong>s lie eux <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>ence<br />
accessibles<br />
à tous<br />
lles<br />
citoyens, qquelques<br />
soie ent leur niveauu<br />
socio-écono omique. Il sem mble donc impportant<br />
que les s pouvoirs<br />
ppolitiques<br />
offrrent<br />
<strong>de</strong>s possi ibilités aux mooins<br />
aisés d’a accé<strong>de</strong>r au log gement près d<strong>de</strong>s<br />
gares ;<br />
aafin<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>sseervir<br />
une plu us gran<strong>de</strong> paartie<br />
du territo oire et notam mment <strong>de</strong>s esspaces<br />
moins<br />
<strong>de</strong>nses,<br />
dd’anciennes<br />
llignes<br />
<strong>de</strong> che emins <strong>de</strong> fer ou d’ancienn nes gares pou urraient être rremises<br />
en service.<br />
Le<br />
rréseau<br />
<strong>de</strong> cheemin<br />
<strong>de</strong> fer actuel<br />
serait alors<br />
complété é par un résea au <strong>de</strong> trains léégers.<br />
C’est l’ ’ensemble<br />
d<strong>de</strong><br />
l’offre en transport pub blic qui <strong>de</strong>vraait<br />
être amélio orée. Les trains<br />
<strong>de</strong>vraient également être ê mieux<br />
ééquipés<br />
et adaptés<br />
à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, d nootamment<br />
en ce qui concerne<br />
l’accès pour les per rsonnes à<br />
mobilité réduiite,<br />
les famille es (landaus…),<br />
les cyclistes…<br />
5. Coonclussions<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 54<br />
Ce travaill<br />
a permis <strong>de</strong> localiser l’urb banisation réssi<strong>de</strong>ntielle<br />
réce ente (parcelle es construites entre le 01/0 01/2001 et<br />
le 31/12/ /2008) sur le tterritoire<br />
wallo on et <strong>de</strong> la connfronter<br />
à diff férents critère es <strong>de</strong> localisattion.<br />
Deux appproches<br />
ont étté<br />
testées : un ne approche bbasée<br />
sur la proximité p d’un n centre foncttionnel<br />
et une approche<br />
basée suur<br />
les critèress<br />
d’accessibil lité aux transsports<br />
en com mmun (soit avec a la carte d’accessibilit té par les<br />
alternativves<br />
à la voiturre<br />
du LEPUR- CPDT, soit daans<br />
un certain n rayon autour<br />
<strong>de</strong>s gares eet<br />
<strong>de</strong>s principa aux arrêts<br />
<strong>de</strong> bus).<br />
Dans la ppremière<br />
approche,<br />
le critè ère « proximitté<br />
d’un centre e fonctionnel » a été approoché,<br />
vu le manque m <strong>de</strong><br />
données, par la notionn<br />
<strong>de</strong> « noyaux x d’habitat ». La localisation<br />
<strong>de</strong>s nouvea aux logementss<br />
a été confro ontée à la<br />
délimitatiion<br />
<strong>de</strong>s noyaaux<br />
d’habitat <strong>de</strong> Delforge et Géron. Ce ette première e approche ccombine<br />
trois types <strong>de</strong><br />
critères : <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> e population, d’aménagement<br />
du territoire<br />
et d’enviroonnement.<br />
Ell le ne tient<br />
cependannt<br />
pas compte<br />
<strong>de</strong> l’access sibilité aux arrêts<br />
<strong>de</strong> bus. Les résultats ont montré qque,<br />
parmi le es près <strong>de</strong><br />
73 000 loogements<br />
crééés<br />
en Wallonie<br />
entre le 011/01/2001<br />
et le 31/12/200 08, 32% ont ppris<br />
place au sein d’un<br />
noyau d’hhabitat<br />
(avec ccontrainte<br />
PAS SH).<br />
Pour la secon<strong>de</strong> appproche,<br />
l’analyse<br />
<strong>de</strong>s réssultats<br />
du cro oisement ent tre les localiisations<br />
<strong>de</strong>s nouvelles<br />
rési<strong>de</strong>ncees<br />
et la carte d’accessibilit té par les alteernatives<br />
à la a voiture du LEPUR-CPDT L mmontre<br />
que le es valeurs<br />
par commmune<br />
étaient fortement dé épendantes <strong>de</strong>e<br />
l’accessibili ité moyenne <strong>de</strong> d la commuune.<br />
C’est ainsi<br />
que les<br />
communees<br />
dont le teerritoire<br />
présente<br />
<strong>de</strong> fortees<br />
valeurs d’accessibilité<br />
auront plus <strong>de</strong> chance que leurs<br />
nouvelless<br />
habitations ssoient<br />
bien ac ccessibles.<br />
L’autre pprincipal<br />
critèrre<br />
<strong>de</strong> localisa ation permet d<strong>de</strong><br />
voir si l’ur rbanisation ré ési<strong>de</strong>ntielle réécente<br />
s’est lo ocalisée à<br />
proximitéé<br />
<strong>de</strong>s gares feerroviaires.<br />
Plu usieurs tests oont<br />
été réalisé és, afin <strong>de</strong> déf finir un critèree<br />
<strong>de</strong> proximité é pertinent<br />
pour une accessibilité aux gares à pied p ou à véloo.<br />
Une distance-temps<br />
<strong>de</strong> 15<br />
minutes a éété<br />
jugée pert tinente sur<br />
la base dd’un<br />
relevé bibbliographique.<br />
Cette distannce-temps<br />
cor rrespond à un ne distance d’ ’environ 3500 0 mètres à<br />
vélo et 1000<br />
mètres à pied. Pour l’instant, nous<br />
n’avons pu p travailler qu’avec q une aapproche<br />
<strong>de</strong> distances<br />
théoriquees<br />
autour <strong>de</strong>s gares (distances<br />
à vol d’oiiseau).<br />
Il a également<br />
semb blé pertinent d<strong>de</strong><br />
ne pas ten nir compte<br />
<strong>de</strong> toutess<br />
les gares d<strong>de</strong><br />
la même façon f car certaines<br />
sont mieux <strong>de</strong>sservies<br />
en termmes<br />
<strong>de</strong> fréquences,<br />
<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stinatioons<br />
et <strong>de</strong> types<br />
<strong>de</strong> train s’y<br />
arrêtant. AAfin<br />
<strong>de</strong> réalise er une premiè ère hiérarchie,<br />
nous avons choisi <strong>de</strong><br />
distingueer<br />
les gares oùù<br />
s’arrête un minimum <strong>de</strong> trains IC-IR <strong>de</strong>s d autres ga ares. Ensuite, nous avons également é<br />
tenu commpte<br />
<strong>de</strong>s arrêtts<br />
<strong>de</strong> bus TEC C bien <strong>de</strong>sserrvis<br />
(au moins s 50 bus par jour scolaire) ) afin <strong>de</strong> ne pas p limiter
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 55<br />
l’analyse au réseau ferré,<br />
qui ne concerne qu’une<br />
partie du d territoire. Pour P ces <strong>de</strong>uux<br />
critères, l’ indicateur<br />
construit ne couvre paas<br />
l’ensemble e <strong>de</strong>s commuunes<br />
car toute es celles-ci ne n bénéficientt<br />
pas <strong>de</strong> la lo ocalisation<br />
d’une garre<br />
ferroviaire oou<br />
d’un arrêt <strong>de</strong> bus bien d<strong>de</strong>sservi,<br />
ce qui<br />
peut être une<br />
critique <strong>de</strong>e<br />
l’indicateur.<br />
Pour l’enssemble<br />
<strong>de</strong> la Wallonie, le principal p résulltat<br />
est que 51 1% <strong>de</strong>s nouve eaux logemennts<br />
créés (ou 33% 3 <strong>de</strong> la<br />
superficiee<br />
rési<strong>de</strong>ntiellee<br />
bâtie) ont pris place daans<br />
un rayon <strong>de</strong> 3500 mètres<br />
autour <strong>de</strong>s gares fe erroviaires<br />
passagerrs<br />
IC-IR ou dans<br />
un rayon <strong>de</strong> d 1000 mètrres<br />
<strong>de</strong>s autres s gares ou <strong>de</strong>s s arrêts <strong>de</strong> buus<br />
bien <strong>de</strong>sse ervis, alors<br />
que ces zzones<br />
concenntrent<br />
65% <strong>de</strong> es logements existants. Au utrement dit, les habitants <strong>de</strong> 49% <strong>de</strong> logements<br />
construitss<br />
en Wallonie entre le 01/01/2001<br />
et le 331/12/2008<br />
(d <strong>de</strong> même que e les habitantss<br />
<strong>de</strong> 35% <strong>de</strong> logements<br />
existants) ) seraient dépendants<br />
d’un<br />
arrêt <strong>de</strong> buus<br />
faiblement t <strong>de</strong>sservi (m moins <strong>de</strong> 3 buus/heure<br />
lors d’un jour<br />
ouvrable scolaire) ou d’un transpor rt individuel (v (voiture, moto o…) pour se déplacer au-d<strong>de</strong>là<br />
d’une distance<br />
<strong>de</strong><br />
1000 à 33500<br />
mètres <strong>de</strong> leur dom micile. Notons cependant que q si leur lie eu <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinaation<br />
n’est pa as situé à<br />
proximitéé<br />
d’un nœudd<br />
<strong>de</strong> transpo ort, ils sont <strong>de</strong> toute faç çon dépendants<br />
d’un traansport<br />
individuel.<br />
Les<br />
disponibilités<br />
foncièress<br />
au sein <strong>de</strong>s s rayons d’acccessibilité<br />
éta aient <strong>de</strong> 292 km², k soit enviiron<br />
34% <strong>de</strong> la réserve<br />
foncière ttotale<br />
<strong>de</strong> la réégion,<br />
<strong>de</strong> quoi offrir <strong>de</strong>s posssibilités<br />
pour développer le e logement daans<br />
ces espac ces.<br />
L’analysee<br />
du même inndicateur<br />
au niveau commmunal<br />
montre e <strong>de</strong> fortes différences<br />
ent ntre les comm munes. 64<br />
communees<br />
ne bénéficient<br />
pas du to out <strong>de</strong> la proxiimité<br />
d’une ga are ou d’un ar rrêt <strong>de</strong> bus bieen<br />
<strong>de</strong>sservis. Certaines<br />
ont une partie <strong>de</strong> leur<br />
territoire couverte c maiis,<br />
en 2001, n’y disposai ient pas en suffisance <strong>de</strong><br />
terrains<br />
disponibles<br />
pour la rési<strong>de</strong>nce.<br />
L’a analyse n’a ddonc<br />
pas été é réalisée sur<br />
ces commuunes.<br />
Dans les l autres<br />
communees,<br />
il a été mmis<br />
en évi<strong>de</strong>nc ce que 80 d’eentre<br />
elles on nt vu plus <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> leur r superficie bâ âtie par la<br />
rési<strong>de</strong>ncee<br />
en <strong>de</strong>hors d<strong>de</strong>s<br />
zones les plus accessibbles<br />
en transp port en commun<br />
alors que ces commune es avaient<br />
les réservves<br />
foncières suffisantes po our accueillir l’habitat dans s ces zones.<br />
Il est impportant<br />
<strong>de</strong> raappeler<br />
que le es chiffres prrésentés<br />
sont t indicatifs en n raison <strong>de</strong> laa<br />
qualité <strong>de</strong>s s données<br />
utilisées. Les donnéess<br />
sur la localis sation <strong>de</strong>s logements<br />
et l’â âge <strong>de</strong> constru uction <strong>de</strong>s parrcelles<br />
proviennent<br />
<strong>de</strong>s<br />
bases <strong>de</strong> données du cadastre (mat trice cadastraale)<br />
qui dépen n<strong>de</strong>nt essentie ellement <strong>de</strong> cee<br />
qui est décl laré par le<br />
citoyen. EElles<br />
ne sont ddès<br />
lors pas exhaustives e ett<br />
vérifiées pou ur chaque nou uveau logemeent.<br />
A ce sujet t, le projet<br />
OSIRIS duu<br />
programme Agora (Politiq que scientifiquue<br />
fédérale) permettra p d’ob btenir <strong>de</strong>s infoormations<br />
sur la fiabilité<br />
<strong>de</strong>s donnnées<br />
gérées paar<br />
l’Administra ation Généralee<br />
<strong>de</strong> la Docum mentation Patr rimoniale (AGDP-SPF<br />
Finan nces).<br />
Comme oon<br />
l’a vu, l’indicateur<br />
cons struit dans l’aapproche<br />
« pro oximité <strong>de</strong>s gares g » semble<br />
bien inform mer sur un<br />
<strong>développement</strong><br />
territoorial<br />
durable puisque il coouvre<br />
<strong>de</strong> man nière assez forte f les difféérentes<br />
dimensions<br />
du<br />
<strong>développement</strong><br />
durablle.<br />
D’après l’a analyse effecttuée<br />
sur le te erritoire wallon n, la construcction<br />
rési<strong>de</strong>ntielle<br />
entre<br />
2001 et 22009<br />
n’a été que <strong>de</strong> façon très mitigée vers un déve eloppement du urable du terrritoire<br />
puisqu’ environ la<br />
moitié (551%)<br />
<strong>de</strong>s nouuveaux<br />
logem ments ont priis<br />
place à pr roximité d’une<br />
gare ou d’un<br />
arrêt <strong>de</strong> bus bien<br />
<strong>de</strong>sserviss.<br />
Cette propoortion<br />
est moindre<br />
que les 65% <strong>de</strong> logements<br />
existan nt en 2009 auu<br />
sein <strong>de</strong> ces s zones <strong>de</strong><br />
bonne acccessibilité<br />
enn<br />
transport en n commun. LL’habitat<br />
a do onc eu plus te endance à s’ééloigner<br />
<strong>de</strong>s lieux bien<br />
accessiblles<br />
par les trransports<br />
en commun qu’ à s’en rappro ocher alors que q les disponnibilités<br />
fonci ières bien<br />
situées apparaissaientt<br />
suffisantes. Plusieurs P causses<br />
peuvent expliquer e ce bilan<br />
mitigé :<br />
lles<br />
choix résid<strong>de</strong>ntiels<br />
<strong>de</strong>s ménages m qui ss’efforcent<br />
<strong>de</strong> e maximiser le eur bien-être individuel (ou u « utilité »<br />
ddans<br />
le domaaine<br />
économiq que), tenant coompte<br />
<strong>de</strong>s co ontraintes du coût c (avec <strong>de</strong>uux<br />
grands pos stes : coût<br />
ddu<br />
logement, coût <strong>de</strong> la mobilité) m (cf mmodèle<br />
d’économie<br />
spatial le d’Alonso (11964),<br />
amélio oré <strong>de</strong>puis<br />
nnotamment<br />
par<br />
Anas et al. . (1998) ou Brrueckner<br />
et al.(1999)). a Les s choix rési<strong>de</strong>nntiels<br />
sont do onc le fruit<br />
d<strong>de</strong><br />
compromiss<br />
ou arbitrage e entre une séérie<br />
<strong>de</strong> critère es liés à la loc calisation et à <strong>de</strong>s critères non liés à<br />
lla<br />
localisationn,<br />
comme le e confort et la taille du logement. Pendant P longttemps,<br />
l’offre e foncière<br />
ppériphérique<br />
abondante, les faibles ccoûts<br />
<strong>de</strong> la mobilité individuelle<br />
et lle<br />
<strong>développement</strong><br />
<strong>de</strong>s<br />
iinfrastructurees<br />
<strong>de</strong> commu unication ont t permis aux x ménages d’élargir<br />
leur espace-temp ps. Citons
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 56<br />
nnotamment<br />
travaux<br />
<strong>de</strong> Du ubois (2001) et Dubois et t Halleux (200 03) qui monttrent<br />
que les nouvelles<br />
llocalisations<br />
rési<strong>de</strong>ntielles s, liées aux contraintes du d marché dans d les commmunes<br />
wallonnes<br />
<strong>de</strong><br />
ll’agglomératioon<br />
<strong>de</strong> Bruxell les, engendreent<br />
une distanciation<br />
crois ssante entre llieux<br />
d’activit té et lieux<br />
dd’habitation.<br />
Dans les choix<br />
<strong>de</strong>s ménagges<br />
actuellement,<br />
les critèr res d’accessibbilité<br />
aux tran nsports en<br />
ccommun<br />
ou d<strong>de</strong><br />
proximité aux a noyaux d’hhabitat<br />
(et leurs<br />
équipemen nts) ne sont paas<br />
(encore) do ominants.<br />
lles<br />
politiquess<br />
d’aménagem ment du territtoire,<br />
aussi bien b au niveau u régional quue<br />
communal,<br />
qui sont<br />
ggénéralementt<br />
peu contraignantes<br />
vis-àà-vis<br />
<strong>de</strong>s dév veloppements s rési<strong>de</strong>ntiels s à l’écart <strong>de</strong> es centres<br />
multifonctionnnels<br />
et <strong>de</strong>s gares, g ainsi que<br />
l’offre fon ncière périphé érique qui resste<br />
abondante e dans <strong>de</strong><br />
nnombreuses<br />
ssous-régions<br />
(Lepers & Moorelle,<br />
2008) ;<br />
lla<br />
rétention fooncière<br />
et le manque <strong>de</strong> ppolitiques<br />
per rmettant <strong>de</strong> mobiliser m facilement<br />
<strong>de</strong> la ressource<br />
ffoncière<br />
danss<br />
les lieux bien n accessibles afin <strong>de</strong> répon ndre à la <strong>de</strong>ma an<strong>de</strong> ;<br />
ll’état<br />
actuel d<strong>de</strong><br />
l’urbanisation<br />
en Wallonnie<br />
et la locali isation <strong>de</strong>s ac ctivités (emplooi,<br />
écoles, commerces,<br />
sservices…)<br />
qqui<br />
dans certa ains cas, vu leeurs<br />
positions éloignées <strong>de</strong> es lieux accesssibles<br />
en tran nsports en<br />
ccommun,<br />
n’inncitent<br />
alors pas p à utiliser ces transpor rts en commu un et/ou à loccaliser<br />
sa rési<strong>de</strong>nce<br />
<strong>de</strong><br />
ffaçon<br />
optimalle<br />
par rapport à ce critère.<br />
Afin d’invverser<br />
la tenddance<br />
et <strong>de</strong> diriger<br />
le déveeloppement<br />
du u territoire vers<br />
la durabilitté,<br />
les pouvoirs<br />
publics<br />
peuvent aagir<br />
sur la loccalisation<br />
<strong>de</strong>s activités et sur<br />
le système e <strong>de</strong> transport t. Pour ce fairre,<br />
ils disposent<br />
d’outils<br />
qui relèveent<br />
<strong>de</strong> quatre catégories :<br />
lla<br />
planification<br />
(révision <strong>de</strong> e plan <strong>de</strong> sectteur,<br />
investissements<br />
dans les transportss<br />
en commun n, dans les<br />
llogements<br />
sociaux<br />
à proxim mité <strong>de</strong>s garess…)<br />
;<br />
lles<br />
normes ett<br />
réglementations<br />
(normes <strong>de</strong> produits, co<strong>de</strong> c <strong>de</strong> la rou ute…) ;<br />
lla<br />
fiscalité (ttaxe<br />
sur les logements innoccupés<br />
et les parcelles s non bâties, , avantage fi iscal à la<br />
rrénovation,<br />
taaxe<br />
<strong>de</strong> mise en n circulation, taxe <strong>de</strong> circul lation, accises s, Eurovignettte…)<br />
;<br />
ll’information<br />
eet<br />
la sensibilis sation (Courbee,<br />
2009).<br />
De nombbreuses<br />
mesures<br />
pour favoriser<br />
les choixx<br />
rési<strong>de</strong>ntiels centraux <strong>de</strong>s s ménages onnt<br />
déjà été développées<br />
dans difféérentes<br />
étu<strong>de</strong>es<br />
(CPDT, 2004,<br />
pp. 44-47) .<br />
L’analysee<br />
<strong>de</strong> l’évolutioon<br />
<strong>de</strong> cet indicateur<br />
dans les 8 ou 10 années à ven nir permettra d’observer la a direction<br />
prise par le <strong>développement</strong><br />
rési<strong>de</strong>nt tiel en Wallonie.<br />
De manièère<br />
à approfoondir<br />
ces rés sultats et anaalyses,<br />
voici une u liste d’am méliorations oou<br />
<strong>de</strong> nouvelles<br />
pistes<br />
d’analysee<br />
à creuser :<br />
dd’autres<br />
critères<br />
pour une localisation ooptimale<br />
<strong>de</strong> l’ urbanisation rési<strong>de</strong>ntielle vvers<br />
un <strong>développement</strong><br />
t<strong>territorial</strong><br />
duraable<br />
pourraien nt également être envisagé és. La note <strong>de</strong> recherche <strong>de</strong>e<br />
la CPDT (2009)<br />
« Vers<br />
uun<br />
développeement<br />
territor rial durable : CCritères<br />
pour la localisatio on optimale <strong>de</strong> <strong>de</strong>s nouvelles activités »<br />
lliste<br />
une sérrie<br />
<strong>de</strong> critère es qui pourraaient<br />
notamm ment être pris s en comptee.<br />
De même, l’analyse<br />
multicritère d<strong>de</strong><br />
localisation n durable <strong>de</strong> la rési<strong>de</strong>nce développée dans d l’expertiise<br />
CPDT-IWE EPS sur le<br />
pplan<br />
<strong>de</strong> secteeur<br />
durable (p programme d<strong>de</strong><br />
travail 200 09-2010) repr rend toute unne<br />
série <strong>de</strong> cr ritères qui<br />
ppourraient<br />
êtrre<br />
utilisés pour<br />
évaluer la durabilité<br />
<strong>de</strong> l’ urbanisation rési<strong>de</strong>ntielle r réécente<br />
;<br />
iil<br />
pourra être envisagé plu us tard une appproche<br />
tenant<br />
compte <strong>de</strong> es distances rréelles<br />
par les s voies <strong>de</strong><br />
ccommunicatioon<br />
existantes et tenant évventuellemen<br />
nt compte <strong>de</strong> leur déclivitté.<br />
Cette app proche est<br />
bbeaucoup<br />
pluus<br />
proche <strong>de</strong> e la réalité, taant<br />
on a vu que l’utilisation<br />
<strong>de</strong>s distaances<br />
théoriques<br />
à vol<br />
dd’oiseau<br />
sureestime<br />
l’acces ssibilité aux ggares.<br />
Cette approche s’a accompagne ccependant<br />
d’ ’un travail<br />
aassez<br />
conséqquent<br />
qui néc cessite notammment<br />
l’obtention<br />
d’une co ouche d’informmations<br />
géographiques<br />
ooptimale<br />
reprenant<br />
l’ensem mble <strong>de</strong>s voiriees<br />
et chemins s <strong>de</strong> Wallonie sans discontinuité<br />
;
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 57<br />
aau<br />
sein <strong>de</strong>s zzones<br />
d’acce essibilité, d’auutres<br />
statistiques<br />
pourraien nt être calcullées<br />
et <strong>de</strong>s valeurs v <strong>de</strong><br />
d<strong>de</strong>nsités<br />
<strong>de</strong> loogements/pop<br />
pulation donnéées<br />
en fonctio on <strong>de</strong> la distan nce aux gares s et du type <strong>de</strong> e gares ;<br />
lles<br />
indicateurrs<br />
étudiés ne e sont pas diirectement<br />
<strong>de</strong> es mesures <strong>de</strong> d l’étalemennt<br />
urbain puisqu’ils<br />
ne<br />
ccomparent<br />
paas<br />
les localis sations rési<strong>de</strong>entielles<br />
entre e elles. Des mesures m spéccifiques<br />
<strong>de</strong> l’ étalement<br />
uurbain<br />
pourraaient<br />
être effec ctuées à l’aveenir<br />
;<br />
ccomme<br />
on l’aa<br />
vu, afin que le système sooit<br />
efficace et t limite notre dépendance d aaux<br />
ressources<br />
fossiles,<br />
ll’ensemble<br />
<strong>de</strong>es<br />
activités génératrices<br />
<strong>de</strong><br />
déplacemen nts <strong>de</strong>vraient être localisé à proximité <strong>de</strong>s d gares.<br />
EEn<br />
effet, la rési<strong>de</strong>nce<br />
ne co onstitue pas l’ ’activité qui né écessite la me eilleure accesssibilité,<br />
au co ontraire <strong>de</strong><br />
ddifférents<br />
serrvices.<br />
Les in ndicateurs poourraient<br />
dès s lors être ap ppliqués à dd’autres<br />
fonct tions, afin<br />
dd’évaluer<br />
si leeur<br />
localisation<br />
a été optimaale<br />
par rapport<br />
aux principe es <strong>de</strong> développpement<br />
durable.
6. Biibliogrraphie<br />
Alonso WW.,<br />
1964, Locaation<br />
and land d use, Cambriddge<br />
(Mass.), Harvard H University<br />
Press.<br />
Anas A,,<br />
1464.<br />
Arnott R, & Small<br />
KA., 199 98, Urban spaatial<br />
structure in Journal of f Economic Litterature,<br />
36: pp. p 1426–<br />
Arnold P. . & Sandraps S, 1998. Rés seau ferroviaire<br />
et accessibilité<br />
en Wallo onie : structure<br />
spatiale et t structure<br />
fonctionnnelle<br />
in Acta GGeographica<br />
Lovaniensia, Lo 377,<br />
pp.417-429 9.<br />
Bertolini L. & Spit T., 1998. Cities on o Rails, the re<strong>de</strong>velopmen nt of Railway Station Areass,<br />
London & New-York, N<br />
Spon/Rouutledge.<br />
Brocorens<br />
P., 2008. Lee<br />
Pic du Pétro ole, un tournaant<br />
pour l'hum manité. Somm mes-nous prêtts<br />
? in Chimie e nouvelle,<br />
97, pp. 2-14,<br />
Société rroyale<br />
<strong>de</strong> chim mie, Bruxelless.<br />
Brueckneer<br />
JK,, Thisse JF,, & Zenou Y., 1999, Why<br />
is central Pa aris rich and downtown d Deetroit<br />
poor? An n amenity-<br />
based Thheory<br />
in Europpean<br />
Economic c Review, 43: pp. 91–107.<br />
CERTU, 11997.<br />
Évaluation<br />
<strong>de</strong>s transports<br />
en commmun<br />
en site propre: indica ateurs transpport<br />
pour l'ana alyse et le<br />
suivi <strong>de</strong>s opérations. LLyon:<br />
CERTU.<br />
Charlier J. & Reginstter<br />
I, 2010. L’évolution d<strong>de</strong><br />
la superfic cie rési<strong>de</strong>ntie elle par habita tant : un indi icateur <strong>de</strong><br />
développpement<br />
territorrial<br />
durable ?, , Discussion ppapers<br />
– IWEP PS, n°1001, ja anvier 2010, 338<br />
p.<br />
Courbe PP.,<br />
2009. Taaxer<br />
PLUS & taxer MIEUX UX : Plaidoyer r pour une fiscalité f autom omobile au service s <strong>de</strong><br />
l’environnnement,<br />
dossier<br />
<strong>de</strong> la Fédé ération Inter-environnement<br />
t Wallonie, 63 3 p.<br />
CPDT, 20002a.<br />
Les coût ûts <strong>de</strong> la désur rbanisation, Ettu<strong>de</strong>s<br />
et docu uments 1, CPD DT-MRW, 1355<br />
p.<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 58<br />
CPDT, 20002b.<br />
Thème e 1 : Mutation ns spatiales eet<br />
structures <strong>territorial</strong>es, Volume V 2 : Ev Evolution <strong>de</strong>s profils <strong>de</strong><br />
mobilité eet<br />
propositionns<br />
d’aménage ement en vue e <strong>de</strong> renforcer r la structure spatiale et <strong>de</strong> favoriser le e report <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>, rapport<br />
final <strong>de</strong> la subvention n 2002.<br />
CPDT 20003a,<br />
Observa vatoire <strong>de</strong>s mutations m spat atiales, L’habit itat, Conférence<br />
Permanennte<br />
<strong>de</strong> Développement<br />
Territoriaal,<br />
Thème 1.1, Région wallo onne, Rapport final <strong>de</strong> la subvention<br />
2002-2003,<br />
septeembre<br />
2003<br />
CPDT, 20003b.<br />
Contribuution<br />
du déve eloppement ter erritorial à la ré éduction <strong>de</strong> l’ ’effet <strong>de</strong> serree,<br />
Partie I, Éva aluation <strong>de</strong><br />
mesures à prendre en aménagemen nt du territoiree<br />
pour limiter la croissance e <strong>de</strong> la mobilité té – voiture, Conférence<br />
Permanente<br />
<strong>de</strong> Dévelooppement<br />
Territorial,<br />
Thèmme<br />
2, Région wallonne, Ra apport final d<strong>de</strong><br />
la subvention<br />
2002-<br />
2003, sepptembre<br />
20033<br />
CPDT, 20004.<br />
Contribut ution du dével loppement terrritorial<br />
à la réduction r <strong>de</strong> l’effet l <strong>de</strong> serrre,<br />
Partie 2, Mesures M à<br />
prendre een<br />
matière dd’urbanisme<br />
pour p améliorer er les perform mances énergé étiques, Conféérence<br />
Perma anente <strong>de</strong><br />
Développpement<br />
Territtorial,<br />
Thème 2, Région wwallonne,<br />
Ra apport proviso oire <strong>de</strong> la ssubvention<br />
20 003-2004,<br />
septembrre<br />
2004<br />
CPDT, 20005a.<br />
Protocoole<br />
<strong>de</strong> Kyoto : aménagemennt<br />
du territoire re, mobilité et t urbanisme – Mesures pou ur faciliter<br />
l’adhésioon<br />
<strong>de</strong> la région on wallonne au Protocole d<strong>de</strong><br />
Kyoto et po our limiter les s émissions d<strong>de</strong><br />
gaz à effet t <strong>de</strong> serre,<br />
Etu<strong>de</strong>s ett<br />
documents 66,<br />
CPDT-MRW W, 230 p.<br />
CPDT, 20005b.<br />
Thème 1 : Mutations s spatiales et t structures te erritoriales, Vo olume 2 : Straatégies<br />
d'affe ectation du<br />
sol en vuue<br />
<strong>de</strong> favoriserr<br />
le report <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>, rapporrt<br />
final proviso oire <strong>de</strong> la subv vention 2004 --2005
CPDT, 20005c.<br />
Thème 1 : Mutations s spatiales et sstructures<br />
ter rritoriales, Volu ume 2 : Référrence<br />
spatiale e pour une<br />
stratégie en vue <strong>de</strong> fa favoriser le re eport <strong>de</strong> mod<strong>de</strong><br />
– Structure e du réseau voyageur, v acc ccessibilité et mixité du<br />
quartier d<strong>de</strong><br />
gare, Atlas <strong>de</strong>s gares, se eptembre 20005<br />
CPDT, 2008.<br />
Fiche dd’évolution<br />
<strong>de</strong> d l’occupatioon<br />
du sol : Note méthod dologique et<br />
l’occupattion<br />
du sol : RRégion<br />
Wallonn ne, http://cpdtt.wallonie.be/<br />
/?id_page=71<br />
CPDT, 20009.<br />
Vers un développeme ent <strong>territorial</strong> durable : Crit itères pour la localisation ooptimale<br />
<strong>de</strong>s nouvelles<br />
activités, Notes <strong>de</strong> recherche<br />
numéro<br />
7, janvier 22009.<br />
CPDT, 20010a.<br />
Expertisse<br />
spécifique 1 sur les impllantations<br />
com mmerciales, ra apport final, mmai<br />
2010.<br />
CPDT, 20010b.<br />
Rapportt<br />
final du thèm me 2A – Les eeffets<br />
du pic pétrolier sur le l territoire, raapport<br />
final + annexes,<br />
octobre 22010.<br />
CPDT (enn<br />
collaboratioon<br />
avec l’IWE EPS), 2010c. Expertise Ve eille - Etat du u Territoire WWallon,<br />
Rappo ort final +<br />
annexes, octobre 20100.<br />
Dachelet M., 2009. Piic<br />
du pétrole : impasse <strong>de</strong>es<br />
politiques d’aménageme<br />
d ent du territoiire<br />
in Revue Etiopia, E 6,<br />
Avril 20099,<br />
pp. 145-1880.<br />
Debrezionn<br />
G., 2006. Ra Railway Impact ts on Real Esttate<br />
Prices, Am msterdam, Tin nbergen Instituute.<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 59<br />
Fiche d’évo olution <strong>de</strong><br />
Delforge Y. et Géron GG.,<br />
2008. Les noyaux n d’habitat<br />
en Wallon nie : je t’aime,<br />
moi non pluss<br />
! dans Les cahiers c <strong>de</strong><br />
l'Urbanism sme, n°67, Maars<br />
2008, MRW W-DGATLP, ppp.<br />
16-20.<br />
DGO4-SPPW,<br />
2009. Cod<strong>de</strong><br />
Wallon <strong>de</strong> l'Aménagemeent<br />
du Territoire,<br />
<strong>de</strong> l'Urban nisme, du Pattrimoine<br />
et <strong>de</strong> e l'Énergie<br />
(CWATUPPE),<br />
coordinaation<br />
officieu use mise à jour au<br />
http://mrww.wallonie.bee/dgatlp/dgatlp<br />
p/<br />
4 octobre 2010 connsultable<br />
à l’adresse<br />
DREIF, 20007.<br />
Potentieel<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>nsifica ation autour d<strong>de</strong>s<br />
pôles et <strong>de</strong>s d axes <strong>de</strong> tr ransport en co commun, étud <strong>de</strong> réalisée<br />
pour la direction<br />
régionale<br />
<strong>de</strong> l’équipement<br />
d’Ile-<strong>de</strong>-France<br />
pa ar l’agence Brès+Mariolle<br />
avec GERAU Conseil et<br />
le cartogrraphe<br />
PRODIGG/CNRS,<br />
rappo ort final-synthhèse,<br />
51p.<br />
Dubois OO.,<br />
2001. La cconstruction<br />
rési<strong>de</strong>ntielle r een<br />
Wallonie: analyse spati tiale multiscala laire et logiqu ues socio-<br />
économiqques<br />
<strong>de</strong> locallisation,<br />
Thèse e présentée een<br />
vue <strong>de</strong> l'obtention<br />
du gra<strong>de</strong> g <strong>de</strong> doctteur<br />
en enviro onnement,<br />
IGEAT, ULLB,<br />
inédit.<br />
Dubois O.<br />
& Halleux J-M.,<br />
2003, Ma archés immobbiliers<br />
rési<strong>de</strong>n ntiels et étalem ment urbain ccontraint.<br />
L'accessibilité<br />
au logemment<br />
au sein <strong>de</strong><br />
la région mé étropolitaine bbruxelloise<br />
in Revue Belgéo o, 3, pp 303-3327.<br />
Duvivier DD.<br />
& Wautelett<br />
M., 2009. Le es transports du futur, quel ls véhicules dans d l’après-ppétrole<br />
? Minis stère <strong>de</strong> la<br />
Région WWallonne<br />
(MRWW)<br />
et Universit té <strong>de</strong> Mons, bbrochure<br />
liée à l’exposition du même nomm,<br />
59 p.<br />
FEBIAC, 22010.<br />
La rédduction<br />
du CO O2 <strong>de</strong>s voiturres<br />
neuves s’ ’accélère, article<br />
mis en lligne<br />
le 7/11/ /2010 sur<br />
http://wwww.febiac.be/ppublic/pressre<br />
eleases.aspx? ?ID=407&lang g=FR, site in nternet <strong>de</strong> laa<br />
Fédération belge <strong>de</strong><br />
l'Industriee<br />
<strong>de</strong> l'Automoobile<br />
et du Cyc cle<br />
GOUVERNNEMENT<br />
WALLON,<br />
1999.<br />
Schéma d<strong>de</strong><br />
Développe pement <strong>de</strong> l’Espace<br />
Réggional,<br />
adopté<br />
par le<br />
Gouverneement<br />
wallon le 27 mai 199 99, 233 p. + aannexes.<br />
Halleux JJ.-M.,<br />
2005. Le rôle <strong>de</strong>s promotions p fooncières<br />
et im mmobilières dans d la produuction<br />
<strong>de</strong>s périphéries<br />
:<br />
applicatioon<br />
à la Belgique<br />
et à ses no ouveaux espaaces<br />
rési<strong>de</strong>ntie els, in Revue Géographiquee<br />
<strong>de</strong> l'Est, Tom meXLV, 3-<br />
4/2005, ppp.<br />
161-174.
INFRAS/IWWW,<br />
2004. Exxternal<br />
Costs of o Tranport. UUpdate<br />
study, Zürich/Karlsru uhe, 168 p.<br />
<strong>IWEPS</strong>, 2010.<br />
Les chifffres-clés<br />
<strong>de</strong> la a Wallonie, n° °11, décembre e 2010, 206 p. p<br />
WORKING PAPER DEE<br />
L’<strong>IWEPS</strong> | AOUT 20 011 | N°2 | 60<br />
Hoornaerrt<br />
Bruno, Mayyeres<br />
I., Nau utet M., 20099.<br />
Les compt tes satellites <strong>de</strong>s transpor orts et les ex xternalités,<br />
Working PPaper<br />
15-09, Bureau Fe<strong>de</strong>ral<br />
du Plan, déécembre<br />
2009,<br />
32 p.<br />
ICEDD, 22008.<br />
Noyauxx<br />
d’habitat, Document D nonn<br />
publié réal lisé pour le compte c du MMinistère<br />
<strong>de</strong> la Région<br />
wallonne-DGATLP,<br />
80pp.<br />
Juprelle JJ.,<br />
2009. Les infrastructure es <strong>de</strong> transporrt<br />
en Wallonie,<br />
Brève <strong>de</strong> l’IW WEPS n°9, Avvril<br />
2009.<br />
Lepers E.<br />
& Morelle DD.,<br />
2008. Occupation<br />
et afffectation<br />
du sol s : empreint tes <strong>de</strong> la struucture<br />
du terr ritoire ? in<br />
Territoiree(s)<br />
Wallon(s), 2, pp.43-58.<br />
L’Hostis AA.<br />
et <strong>de</strong> nombbreux<br />
contribu uteurs, 2009. . Rapport fina al du Projet Ba ahn.Ville 2 sur<br />
un urbanism me orienté<br />
vers le raail,<br />
octobre 20009,<br />
81p.<br />
MRW et CCPDT,<br />
2003. TTableau<br />
<strong>de</strong> bo ord du développpement<br />
territ itorial 2003, MRW-DGATLP,<br />
M , 212 p.<br />
Nayes E. et Arnold P. 2010. Evalu uation <strong>de</strong>s coûûts<br />
externes liés au transp port en Régioon<br />
wallonne – Mise en<br />
oeuvre. RRapport<br />
final d<strong>de</strong><br />
convention.<br />
SPW – DGARRNE,<br />
CIEM. 95 5 p.<br />
Nautet Maud,<br />
2008a. CComptes<br />
sate ellites <strong>de</strong>s trannsports<br />
en 200 000 - Activités <strong>de</strong> support à la politique fé édérale <strong>de</strong><br />
mobilité eet<br />
transport, PPlanning<br />
Pape er 106, Bureauu<br />
fédéral du Plan, P août 200 08, 80 p.<br />
Nautet MMaud,<br />
2008b. Analyse <strong>de</strong>s dépenses d et rrecettes<br />
publi iques <strong>de</strong> trans sport, Workingg<br />
Paper 20-0 08, Bureau<br />
fédéral duu<br />
Plan, novemmbre<br />
2008, 98 8 p.<br />
Reginsterr<br />
I. & Charlierr<br />
J., 2010. Dé éveloppement nt d’indicateur rs locaux <strong>de</strong> développeme<br />
d ent <strong>territorial</strong> durable d et<br />
évaluatioon<br />
<strong>de</strong> leurs écllairages,<br />
Brèv ve <strong>de</strong> l’<strong>IWEPS</strong> n°12, Février 2010.<br />
SNCB, 20010.<br />
Rapport d<strong>de</strong><br />
développem ment durable e 2009, Août 2010, 2 71 p.<br />
SPW-DGAARNE,<br />
2010. TTableau<br />
<strong>de</strong> bo ord <strong>de</strong> l’enviroonnement<br />
wal llon 2010, 232 2 p.<br />
SPW-DGOO4-DEBD<br />
& ICCEDD,<br />
2010. Bilan Energéétique<br />
<strong>de</strong> la Région R Wallon nne, Bilan <strong>de</strong>e<br />
la consomm mation <strong>de</strong>s<br />
transportts<br />
V.2., septemmbre<br />
2010.<br />
Van <strong>de</strong>r HHaegen<br />
H., Paattyn<br />
M., Rou usseau S., 19981.<br />
Dispersio on et relations s <strong>de</strong> niveau éélémentaire<br />
<strong>de</strong> es noyaux<br />
d’habitat t en Belgique – Situation en e 1980, Bulletin<br />
<strong>de</strong> Statis stique, n°5-6 – mai-juin, 667ème<br />
année e, pp.265-<br />
284.<br />
Van <strong>de</strong>r Haegen H., Van Hecke E. et Juchtmmans<br />
G., 199 98, Les régi ions urbainess,<br />
Monograph hie n°11A<br />
"Urbanisaation"<br />
du Recensement<br />
Général G <strong>de</strong> laa<br />
Population et <strong>de</strong>s Logem ments au 1eer<br />
mars 1991 (sous la<br />
direction <strong>de</strong> Mérenne-Schoumaker<br />
B., Van <strong>de</strong>r Haaegen<br />
H. et Van V Hecke E.), Ministère <strong>de</strong>ss<br />
affaires éco onomiques<br />
- Institut National <strong>de</strong> SStatistique<br />
/ SS STC, Bruxelless,<br />
pp.79-148.<br />
Van Heckke<br />
E., 1998. Actualisation <strong>de</strong> la hiérarcchie<br />
urbaine en Belgique dans Bulletinn<br />
du Crédit Communal, C<br />
n°205, 19998/3,<br />
pp. 455-76.<br />
Van Heckke<br />
E., Halleuux<br />
JM., Decro oly J.-M., Mérenne-Shoum<br />
macker B., 2009. 2 Noyauxx<br />
d’habitat et e Régions<br />
urbaines dans une BBelgique<br />
urba anisée, Bruxellles<br />
: SPF Ec conomie, P.M.E.,<br />
Classes moyennes et t Energie,<br />
Enquête ssocio-économmique<br />
2001, Monographie M nn°9<br />
Wautelet M., 2009. Lee<br />
transport et la localisationn<br />
<strong>de</strong>s entreprises<br />
dans l’ap près-pétrole inn<br />
Revue Etiop pia, 6, Avril<br />
2009, pp.<br />
127-144.