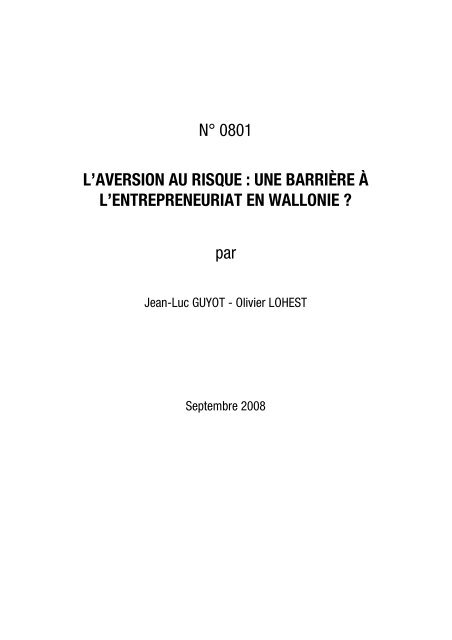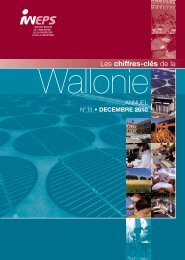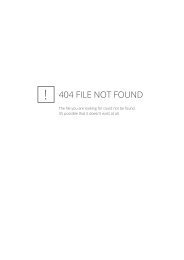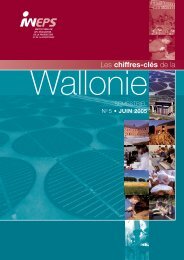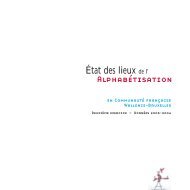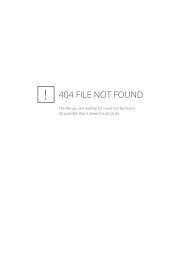L'aversion au risque : Une barrière à l´entrepreneuriat en ... - IWEPS
L'aversion au risque : Une barrière à l´entrepreneuriat en ... - IWEPS
L'aversion au risque : Une barrière à l´entrepreneuriat en ... - IWEPS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
N° 0801<br />
L’AVERSION AU RISQUE : UNE BARRIÈRE À<br />
L’ENTREPRENEURIAT EN WALLONIE ?<br />
par<br />
Jean-Luc GUYOT - Olivier LOHEST<br />
Septembre 2008
L’AVERSION AU RISQUE : UNE BARRIÈRE À<br />
L’ENTREPRENEURIAT EN WALLONIE ?<br />
Jean-Luc Guyot 1 - Olivier Lohest 2,3<br />
Résumé 4 : De nombreuses recherches <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat se sont<br />
p<strong>en</strong>chées sur les mécanismes qui sous-t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t la création d’<strong>en</strong>treprises.<br />
Certaines ont essayé d’id<strong>en</strong>tifier les freins <strong>en</strong> la matière. En dépit de ces<br />
trav<strong>au</strong>x, notre connaissance demeure limitée, notamm<strong>en</strong>t <strong>au</strong> nive<strong>au</strong><br />
europé<strong>en</strong>. Le propos de ce texte est d’examiner, dans le cas précis de la<br />
Wallonie, la nature des élém<strong>en</strong>ts perçus comme constituant des <strong>barrière</strong>s<br />
<strong>au</strong> passage <strong>à</strong> la primo-création d’<strong>en</strong>treprise. Cet exam<strong>en</strong> se base sur deux<br />
<strong>en</strong>quêtes originales : la première a été m<strong>en</strong>ée <strong>au</strong>près de primo-créateurs<br />
wallons et la seconde réalisée sur un échantillon de candidats <strong>à</strong> la création<br />
qui n’ont pas m<strong>en</strong>é leur projet <strong>à</strong> terme. Cet article poursuit un double<br />
objectif. Dans un premier temps, nous t<strong>en</strong>tons de mettre <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce les<br />
différ<strong>en</strong>ces observables <strong>en</strong> la matière <strong>en</strong>tre ces deux populations<br />
distinctes. Dans un second temps, la question des obstacles <strong>à</strong> la création<br />
est considérée du point de vue d’un frein fréquemm<strong>en</strong>t mis <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce<br />
dans la littérature, <strong>à</strong> savoir l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. In fine, les analyses<br />
réalisées laiss<strong>en</strong>t apparaître une hiérarchisation nette <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts<br />
freins. Il s’avère que la lourdeur des démarches administratives, la<br />
faiblesse des structures d’aide <strong>à</strong> la création et la complexité des<br />
réglem<strong>en</strong>tations constitu<strong>en</strong>t des obstacles majeurs lors du processus de<br />
création.<br />
3
Nos estimations laiss<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trevoir une influ<strong>en</strong>ce de la position<br />
sociale et de la trajectoire biographique des individus sur leur rapport <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong>, et, par voie de conséqu<strong>en</strong>ce, sur leur prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> s’<strong>en</strong>gager dans<br />
un processus de création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
Mots-clés : <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat, frein, <strong>au</strong>to-emploi, <strong>risque</strong>, création<br />
d’<strong>en</strong>treprise<br />
_________________________<br />
1 Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique,<br />
Rue du Fort de Suarlée 1,<br />
5001 Belgrade, Belgique<br />
jl.guyot@iweps.wallonie.be<br />
2Institut<br />
wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique,<br />
Rue du Fort de Suarlée 1,<br />
5001 Belgrade, Belgique<br />
3<br />
Dexia Banque S.A., Research departm<strong>en</strong>t<br />
olohest@hotmail.com<br />
4 Les <strong>au</strong>teurs remerci<strong>en</strong>t D.Defays et J.P. Duprez pour la relecture critique de ce texte et<br />
leurs suggestions.<br />
4
1. Introduction<br />
De nombreuses recherches <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat se sont p<strong>en</strong>chées sur les<br />
mécanismes qui sous-t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t la création d’<strong>en</strong>treprises, tant sur le plan<br />
macro-économique que sur le plan individuel. Certaines ont essayé<br />
d’id<strong>en</strong>tifier les élém<strong>en</strong>ts susceptibles de freiner la création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
C’est le cas <strong>en</strong> particulier des trav<strong>au</strong>x de Libecap (1998), de Verzele et<br />
Crijns (2001), de l’IFOP et de l’Ag<strong>en</strong>ce pour la création d’<strong>en</strong>treprises (1999)<br />
qui mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> exergue l’impact négatif de certains cadres juridiques et<br />
administratifs ainsi que celui des taxes. Van de V<strong>en</strong> (1995) met <strong>en</strong><br />
évid<strong>en</strong>ce que les dim<strong>en</strong>sions matérielles impliquées dans le processus de<br />
création, notamm<strong>en</strong>t les infrastructures et les technologies, peuv<strong>en</strong>t<br />
égalem<strong>en</strong>t constituer des obstacles <strong>au</strong> développem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat<br />
et <strong>à</strong> l’émerg<strong>en</strong>ce de nouvelles firmes. Bartik (1989), Veltz (1993), Massey<br />
(1995) et Maillat (1994, 1999) mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> avant, quant <strong>à</strong> eux, le rôle du<br />
contexte matériel de la création <strong>en</strong> termes d’infrastructures disponibles et<br />
de spécialisation spatiale comme frein <strong>à</strong> la création. D’<strong>au</strong>tres chercheurs<br />
ont abordé la thématique des <strong>barrière</strong>s <strong>à</strong> la création <strong>en</strong> considérant les<br />
facteurs liés <strong>à</strong> l’int<strong>en</strong>sité technologique de l’activité, comme chez<br />
Mukhopadhyay (1985), Acs et Audretsch (1988), ou <strong>à</strong> sa branche<br />
économique, comme Duestch (1984), Austin et Ros<strong>en</strong>b<strong>au</strong>m (1990), Evans<br />
et Siegfried (1992), Ferguson et Ferguson (1994), Audretsch (1995). Quant<br />
<strong>au</strong>x classiques de la littérature économique, ils mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce que la<br />
perception du <strong>risque</strong> lié <strong>à</strong> la création constitue <strong>au</strong>ssi un frein majeur par<br />
rapport <strong>à</strong> celle-ci. De fait, si le <strong>risque</strong> perçu est trop élevé, le processus de<br />
création ne sera pas lancé. Les individus qui s’<strong>en</strong>gag<strong>en</strong>t dans de tels<br />
processus prés<strong>en</strong>terai<strong>en</strong>t de ce fait une aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> plus faible que<br />
celle des <strong>au</strong>tres ag<strong>en</strong>ts économiques.<br />
La plupart des études empiriques se sont conc<strong>en</strong>trées sur les freins<br />
matériels ou financiers, ignorant fréquemm<strong>en</strong>t les freins liés <strong>à</strong> l’individu <strong>en</strong><br />
tant que tel (perception du <strong>risque</strong>, manque de confiance <strong>en</strong> soi, etc...) ou <strong>à</strong><br />
son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t relationnel (opposition du conjoint ou de la famille). De<br />
plus, ces études utilis<strong>en</strong>t ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t des données américaines ou<br />
anglaises. En ce qui concerne la situation de la Wallonie, notre<br />
connaissance empirique des facteurs susceptibles d’agir comme des freins<br />
<strong>à</strong> la création demeure <strong>en</strong>core limitée. Notre objectif sera ici d’examiner les<br />
freins <strong>à</strong> la création <strong>en</strong> utilisant une <strong>en</strong>quête originale <strong>au</strong>près d’un<br />
5
<strong>en</strong>semble de primo-créateurs et de candidats <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs1 wallons.<br />
Cette <strong>en</strong>quête a la particularité de recueillir des données détaillées sur,<br />
d’une part, les créateurs et les candidats créateurs et, d’<strong>au</strong>tre part, les<br />
freins <strong>à</strong> la création tels qu’ils sont id<strong>en</strong>tifiés par les répondants.<br />
Sur la base de ces données, nous aborderons plusieurs points.<br />
Premièrem<strong>en</strong>t, nous id<strong>en</strong>tifierons et classifierons les obstacles r<strong>en</strong>contrés<br />
par les créateurs et les candidats créateurs, <strong>en</strong> distinguant les freins liés <strong>à</strong><br />
l’individu de ceux liés <strong>au</strong> contexte relationnel, <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
économique ou <strong>en</strong>core <strong>au</strong> contexte administratif. Deuxièmem<strong>en</strong>t, la<br />
question de l’impact des freins sur le processus de création sera analysée<br />
sous l’angle particulier du rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, celui-ci étant id<strong>en</strong>tifié par la<br />
littérature comme jouant un rôle important <strong>en</strong> matière d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat.<br />
L’objectif sera d’étudier les élém<strong>en</strong>ts qui sont <strong>à</strong> l’origine du passage <strong>à</strong> la<br />
création, le rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong> <strong>en</strong>couru lors de cette transition et<br />
l’articulation <strong>en</strong>tre ces deux élém<strong>en</strong>ts.<br />
Notre article sera donc organisé comme suit. La première section<br />
esquissera les principales référ<strong>en</strong>ces théoriques qui trait<strong>en</strong>t du li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre<br />
<strong>risque</strong> et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat. La deuxième section prés<strong>en</strong>tera les dispositifs<br />
analytiques qui ont été utilisés pour id<strong>en</strong>tifier les freins <strong>à</strong> la création. Dans<br />
la dernière section, les résultats relatifs <strong>à</strong> ces freins et <strong>au</strong> processus de<br />
création seront prés<strong>en</strong>tés et interprétés. En particulier, dans cette section<br />
nous examinerons, d’une part, quels sont les freins les plus fréquemm<strong>en</strong>t<br />
r<strong>en</strong>contrés et, d’<strong>au</strong>tre part, dans quelle mesure l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> ou, du<br />
moins, la perception du <strong>risque</strong> influ<strong>en</strong>ce le comportem<strong>en</strong>t du créateur.<br />
Cette dernière analyse reposera sur la modélisation, sous la forme d’un<br />
modèle Probit Bivarié, des effets de cette aversion et de la position socioéconomique<br />
des individus sur leur prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> créer une <strong>en</strong>treprise<br />
1 Dans le cadre de notre travail, les primo-créateurs sont définis comme étant des individus<br />
qui cré<strong>en</strong>t pour la première fois une <strong>en</strong>treprise <strong>à</strong> forme juridique. Quant <strong>au</strong>x candidats<br />
créateurs, il s’agit d’individus qui ont eu le projet de créer une <strong>en</strong>treprise et ont <strong>en</strong>tamé ou<br />
non des démarches dans ce s<strong>en</strong>s sans concrétiser ce projet de création.<br />
6
2. Risque et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat : référ<strong>en</strong>ces théoriques<br />
2. 1. Risque et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat : un binôme depuis longtemps reconnu<br />
<strong>en</strong> économie<br />
Le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>risque</strong> et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat est un des élém<strong>en</strong>ts fondam<strong>en</strong>t<strong>au</strong>x<br />
de la littérature sur l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat et a donné lieu <strong>à</strong> de nombreux<br />
trav<strong>au</strong>x. Déj<strong>à</strong>, <strong>en</strong> 1755, Cantillon définit l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur comme « toute<br />
personne qui pr<strong>en</strong>d le <strong>risque</strong> de m<strong>en</strong>er une affaire commerciale <strong>à</strong> son<br />
propre compte dans un but de profit ». Cet <strong>au</strong>teur établit ainsi un li<strong>en</strong><br />
indissociable <strong>en</strong>tre <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur, <strong>risque</strong> et incertitude, sans toutefois<br />
distinguer ces deux dernières notions. L’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur fait, selon cet <strong>au</strong>teur,<br />
partie de la classe de ceux qui viv<strong>en</strong>t dans l’incertitude. Il est am<strong>en</strong>é <strong>à</strong><br />
pr<strong>en</strong>dre des décisions dans l’incertitude, et les <strong>risque</strong>s qu’il <strong>en</strong>court ne<br />
sont pas précisém<strong>en</strong>t connus. Comme Cantillon le formule, l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur<br />
« buy at a certain price and sell at an uncertain price, therefore operating<br />
at a risk » (cité par Hisrich et Peters, 1998 : 7). L’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur se place<br />
dans la catégorie des « g<strong>en</strong>s <strong>à</strong> gage incertain » et fait partie des<br />
« dép<strong>en</strong>dants », comme les salariés. La catégorie des « indép<strong>en</strong>dants »<br />
regroupe, quant <strong>à</strong> elle, les aristocrates et les propriétaires terri<strong>en</strong>s.<br />
Say (1841) prolonge ces réflexions <strong>en</strong> associant égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur et<br />
prise de <strong>risque</strong>. Cep<strong>en</strong>dant, les <strong>risque</strong>s pris par l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur sont liés <strong>à</strong> la<br />
nouve<strong>au</strong>té qu’il introduit, alors que ceux <strong>au</strong>xquels s’expose l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur<br />
de Cantillon sont liés <strong>au</strong>x aléas du marché. Pour Say, « l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur<br />
déplace les ressources économiques d’un nive<strong>au</strong> de productivité et de<br />
r<strong>en</strong>dem<strong>en</strong>t donné vers un nive<strong>au</strong> supérieur » (cité par Drucker, 1985 : 45).<br />
L’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur combine et organise les facteurs de la production pour<br />
créer une utilité nouvelle. Il est l’ag<strong>en</strong>t principal de la production. Il met <strong>en</strong><br />
œuvre les facteurs de la production, leur donne une impulsion utile pour <strong>en</strong><br />
tirer de la valeur. Il organise, planifie la production, et supporte tous les<br />
<strong>risque</strong>s susceptibles de freiner le processus de création.<br />
Pour Knight (1921), une situation de <strong>risque</strong> implique la possibilité<br />
d’effectuer un calcul de probabilité connue, tandis que la notion<br />
d’incertitude, qui <strong>en</strong>globe celle de <strong>risque</strong>, r<strong>en</strong>voie égalem<strong>en</strong>t <strong>à</strong> des<br />
événem<strong>en</strong>ts non prévisibles, dont la distribution des probabilités est<br />
inconnue. Le jugem<strong>en</strong>t personnel <strong>en</strong>tre, dès lors, davantage <strong>en</strong> jeu. Selon<br />
Knight, « est un <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur pot<strong>en</strong>tiel l’individu qui, compte t<strong>en</strong>u de ses<br />
7
jugem<strong>en</strong>ts, accepterait d’assumer l’incertitude liée <strong>à</strong> la production de bi<strong>en</strong>s<br />
et services » (cité par Dejardin, 2000 : 23).<br />
Plus récemm<strong>en</strong>t, plusieurs chercheurs se sont p<strong>en</strong>chés sur les li<strong>en</strong>s <strong>en</strong>tre<br />
choix occupationnels et aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> (par exemple, Kihlstrom et<br />
Laffont, 1979 ; Brockh<strong>au</strong>s, 1980 ; Blanchflower et Oswald, 1998), tandis<br />
que d’<strong>au</strong>tres poursuivai<strong>en</strong>t la réflexion sur l’articulation <strong>en</strong>tre <strong>risque</strong> et<br />
<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat, comme Juli<strong>en</strong> et Marchesnay (1996).<br />
2. 2. Prise de <strong>risque</strong> et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat : vers une lecture sociologique<br />
Parallèlem<strong>en</strong>t <strong>à</strong> ces trav<strong>au</strong>x issus de la littérature économique, des<br />
recherches de nature plus sociologique ont égalem<strong>en</strong>t apporté un<br />
éclairage intéressant sur le li<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre <strong>risque</strong> et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat. Ainsi, la<br />
mise <strong>en</strong> perspective historique opérée par Vérin (1982) apporte un<br />
éclairage plus nuancé sur la conduite de l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur dans sa relation<br />
avec le <strong>risque</strong> et permet d’<strong>en</strong> montrer le caractère ambival<strong>en</strong>t, cette<br />
relation combinant, dans une certaine mesure, raison et exaltation.<br />
L’analyse de l’évolution historique des significations et des différ<strong>en</strong>ts<br />
usages de la terminologie permet, <strong>en</strong> effet, de relever une constante :<br />
l’<strong>en</strong>treprise est invariablem<strong>en</strong>t l’action risquée, ou même parfois l’action<br />
<strong>en</strong> tant que <strong>risque</strong>. Les modalités de la prise de <strong>risque</strong>, quant <strong>à</strong> elles,<br />
diffèr<strong>en</strong>t selon qu’<strong>à</strong> « l’élan courageux » s’accorde ou non une « conduite<br />
raisonnée » principalem<strong>en</strong>t basée sur le calcul économique. Le rapport<br />
<strong>en</strong>tre <strong>en</strong>treprise et <strong>risque</strong> est donc foncièrem<strong>en</strong>t complexe. L’<strong>en</strong>treprise<br />
requiert <strong>à</strong> la fois un calcul raisonné, une action délibérée et maîtrisée, et «<br />
un élan courageux » qui, dans une certaine mesure, fait fi du <strong>risque</strong> et<br />
procède de la transformation du hasard <strong>en</strong> raison, de l’occasion<br />
accid<strong>en</strong>telle <strong>en</strong> occasion de réaliser une fin visée, <strong>en</strong> moy<strong>en</strong> de se faire<br />
remarquer, de se réaliser comme « cas », de se singulariser.<br />
Ces propos nous amèn<strong>en</strong>t dans le cadre de cette publication <strong>à</strong> considérer<br />
l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat et l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> dans une perspective<br />
principalem<strong>en</strong>t sociologique. Pour ce faire, nous partirons du concept de<br />
logique d’action tel que développé par Bernoux seul (1995) et puis avec<br />
ses collègues Amblard et al. (1996). Ce concept se réfère <strong>à</strong> l’articulation<br />
<strong>en</strong>tre l’acteur, <strong>à</strong> la fois stratégique et historiquem<strong>en</strong>t et culturellem<strong>en</strong>t<br />
constitué, d’une part, et la situation d’action, d’<strong>au</strong>tre part.<br />
8
En ce qui concerne l’acteur, il s’agit de « [le] lester (...) de dim<strong>en</strong>sions<br />
historiques, culturelles, qui sont trop rapidem<strong>en</strong>t exogénéisées par le<br />
raisonnem<strong>en</strong>t stratégique » (Amblard et al., 1996 : 188). Il se caractérise<br />
par une dim<strong>en</strong>sion stratégique et est doté d’une composante id<strong>en</strong>titaire qui<br />
est le produit de sa trajectoire personnelle et de son <strong>en</strong>racinem<strong>en</strong>t social,<br />
culturel et historique. La situation d’action, quant <strong>à</strong> elle, est <strong>à</strong> la fois<br />
mom<strong>en</strong>t historique et espace culturel et symbolique. C’est une <strong>en</strong>tité<br />
circonstanciée et singulière qui fait interv<strong>en</strong>ir <strong>à</strong> la fois des objets et de<br />
sujets, ainsi que les modes de régulation institutionnelle et symbolique des<br />
rapports qui exist<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre eux. C’est <strong>à</strong> partir de la r<strong>en</strong>contre de l’acteur<br />
avec la situation d’action que se développ<strong>en</strong>t les interactions qui<br />
permettront <strong>au</strong>x logiques d’action de se matérialiser.<br />
A notre s<strong>en</strong>s, du point de vue du passage <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise et de<br />
l’<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t dans la carrière <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriale, le concept de logique<br />
d’action permet d’approcher les rapports complexes <strong>en</strong>tre (1°) les<br />
caractéristiques sociologiques du créateur, <strong>en</strong>visagées <strong>en</strong> termes de<br />
position sociale et de sédim<strong>en</strong>tation biographique résultant de la trajectoire<br />
personnelle et des expéri<strong>en</strong>ces vécues et constitutive de son id<strong>en</strong>tité<br />
sociale, (2°) les particularités de son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t (la situation d’action),<br />
(3°) le processus stratégique vis-<strong>à</strong>-vis de la création d’<strong>en</strong>treprise et (4°) le<br />
déroulem<strong>en</strong>t et l’issue de celle-ci 2<br />
.<br />
L’exam<strong>en</strong> de ces élém<strong>en</strong>ts est intéressant du point de vue de l’étude du<br />
rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong> dans la mesure où on peut présumer que les<br />
caractéristiques de l’individu ne sont pas étrangères <strong>au</strong>x mécanismes de<br />
traduction du réel et <strong>au</strong>x systèmes de représ<strong>en</strong>tation qui sont constitutives<br />
de ce rapport. L’analyse de la composante culturelle et id<strong>en</strong>titaire et de la<br />
composante stratégique pourrait assurer l’intelligibilité de la diversité des<br />
rapports <strong>au</strong> <strong>risque</strong> adopté par des acteurs différ<strong>en</strong>ts inscrits dans une<br />
situation d’action similaire. Elle permettrait de compr<strong>en</strong>dre pourquoi, par<br />
exemple, tous les wallons sans emploi ne s’ori<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t pas vers l’<strong>au</strong>toemploi.<br />
D’<strong>au</strong>tres modèles peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être évoqués. Selon Hisrich et Peters<br />
(1998), le passage <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat doit se concevoir comme un<br />
processus décisionnel portant sur un changem<strong>en</strong>t de mode de vie. Chaque<br />
2<br />
Pour plus de détails sur ce cadre théorique, consultez Guyot J.L., Vandewattyne J. (2008)<br />
9
transition résulte d’un processus individuel unique mais partage,<br />
cep<strong>en</strong>dant, des caractéristiques communes avec les <strong>au</strong>tres. A chaque fois,<br />
il s’agit d’un changem<strong>en</strong>t d’un mode de vie vers un <strong>au</strong>tre. Ce passage est<br />
influ<strong>en</strong>cé par des facteurs qui r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t ce changem<strong>en</strong>t désirable, <strong>à</strong> savoir<br />
les modèles culturels, et d’<strong>au</strong>tres qui le r<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t possible (notamm<strong>en</strong>t sur<br />
le plan des compét<strong>en</strong>ces et des ressources disponibles). La décision de<br />
changem<strong>en</strong>t peut s’<strong>en</strong>raciner dans deux élém<strong>en</strong>ts : la rupture dans le<br />
mode de vie (mise <strong>à</strong> la retraite, perte d’emploi, déménagem<strong>en</strong>t, divorce…)<br />
ou les opportunités offertes par l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. En ce qui concerne la<br />
désirabilité de la transition, la valorisation sociale de l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat et de<br />
la prise de <strong>risque</strong> et les attitudes par rapport <strong>à</strong> ceux-ci jou<strong>en</strong>t un rôle<br />
primordial 3 . La décision de changer de carrière ou de mode de vie sera<br />
<strong>en</strong>couragée par une perception positive de la prise de <strong>risque</strong>. Cette<br />
perception est socialem<strong>en</strong>t élaborée, suivant les valeurs et les référ<strong>en</strong>ts<br />
culturels <strong>en</strong> vigueur dans le milieu social. Ce milieu n’est pas<br />
nécessairem<strong>en</strong>t homogène et fait interv<strong>en</strong>ir différ<strong>en</strong>tes composantes<br />
interdép<strong>en</strong>dantes, de micro <strong>à</strong> macro sociales. Le milieu socioculturel<br />
immédiat r<strong>en</strong>voie <strong>au</strong>x interactions avec la famille et <strong>à</strong> celles avec les pairs.<br />
A un nive<strong>au</strong> « supérieur », c’est le milieu éducatif, <strong>en</strong> tant que véhicule de<br />
valeurs et de modèles culturels, qui intervi<strong>en</strong>t. Ces influ<strong>en</strong>ces s’articul<strong>en</strong>t<br />
avec les cadres normatifs, symboliques et idéologiques produits par<br />
l’<strong>en</strong>semble du système social <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> national, voire supra-national. Les<br />
<strong>au</strong>teurs <strong>en</strong>trevoi<strong>en</strong>t, néanmoins, la possibilité de modèles alternatifs,<br />
portés par des sous-cultures particulières. Celles-ci peuv<strong>en</strong>t correspondre<br />
<strong>à</strong> l’appart<strong>en</strong>ance de classe, <strong>à</strong> l’origine ethnique ou <strong>à</strong> la localisation<br />
géographique. Les <strong>au</strong>teurs cit<strong>en</strong>t, <strong>à</strong> ce propos, l’exist<strong>en</strong>ce de telles souscultures<br />
dans certaines régions des Etats-Unis où la prop<strong>en</strong>sion <strong>au</strong><br />
passage <strong>à</strong> la création serait plus élevée que dans le reste du pays.<br />
Pour dépasser les idées de Hisrich et Peters, on pourrait introduire,<br />
complém<strong>en</strong>tairem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x concepts de désirabilité et de faisabilité, celui de<br />
préférabilité. De fait, le fait de pouvoir <strong>en</strong>visager positivem<strong>en</strong>t le passage <strong>à</strong><br />
la création et celui de disposer du cadre propice <strong>à</strong> ce passage sont une<br />
chose. Les avantages comparatifs de ce passage <strong>en</strong> sont une <strong>au</strong>tre,<br />
notamm<strong>en</strong>t si l’on fait interv<strong>en</strong>ir la notion de <strong>risque</strong> et de bénéfice att<strong>en</strong>du<br />
dans le choix. On pourrait, par exemple, poser l’hypothèse que, dans un<br />
3<br />
Le rôle du système symbolique relatif <strong>à</strong> l’échec est égalem<strong>en</strong>t important.<br />
10
système national où la sécurité sociale est très performante pour les<br />
salariés, les avantages comparatifs du passage <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise<br />
soi<strong>en</strong>t minimisés et que, pour le créateur pot<strong>en</strong>tiel, « le jeu n’<strong>en</strong> vaille pas<br />
la chandelle ».<br />
L’exam<strong>en</strong> des modèles culturels et des référ<strong>en</strong>ts normatifs véhiculés et<br />
produits dans l’<strong>en</strong>tourage de l’acteur fait écho <strong>à</strong> la composante id<strong>en</strong>titaire<br />
de l’acteur, telle que décrite par la théorie des logiques d’action. A ce<br />
propos, les apports théoriques de la sociologie de Pierre Bourdieu<br />
concernant le concept d’habitus et de disposition, peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être<br />
activés. Pour rappel, le concept d’habitus r<strong>en</strong>voie <strong>à</strong> la capacité acquise par<br />
l’individu <strong>au</strong> cours des processus de socialisation d’adopter le<br />
comportem<strong>en</strong>t, <strong>au</strong> s<strong>en</strong>s large du terme, adéquat face <strong>au</strong>x diverses<br />
situations qu’il est susceptible de r<strong>en</strong>contrer (Bourdieu : 1980, 1987). Cette<br />
adoption ne s’effectue pas de manière réfléchie mais comme s’il s’agissait<br />
de la réponse « naturelle » qui s’impose, de la réaction instinctive face <strong>à</strong><br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t. L’habitus résulte d’un long travail inconsci<strong>en</strong>t de<br />
socialisation et d’appr<strong>en</strong>tissage social mais il n’est cep<strong>en</strong>dant pas<br />
réductible <strong>à</strong> l’habitude car il incorpore, <strong>à</strong> la différ<strong>en</strong>ce de cette dernière, les<br />
principes d’inv<strong>en</strong>tion et d’adaptation pratique <strong>à</strong> des situations inédites.<br />
C’est pourquoi le concept d’habitus est p<strong>en</strong>sé <strong>en</strong> termes dynamiques : les<br />
ajustem<strong>en</strong>ts des réponses <strong>à</strong> la nouve<strong>au</strong>té et <strong>à</strong> l’imprévu de ces situations<br />
peuv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drer des modifications durables de ce dernier. L’habitus<br />
assure donc <strong>à</strong> l’acteur un code de conduite « naturel » et non figé<br />
permettant de poser devant la multitude des différ<strong>en</strong>ts événem<strong>en</strong>ts de la<br />
vie sociale le bon choix, c’est-<strong>à</strong>-dire celui respectueux du système culturel<br />
et normatif qu’il a intégré. Le positionnem<strong>en</strong>t individuel par rapport <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong> peut donc être interprété <strong>à</strong> la lumière de l’habitus. L’acteur pr<strong>en</strong>dra<br />
plus facilem<strong>en</strong>t un <strong>risque</strong> si celui-ci s’inscrit dans le respect de son habitus<br />
et est considéré comme « allant de soi ».<br />
Les dispositions, quant <strong>à</strong> elles, correspond<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x inclinations <strong>à</strong> percevoir<br />
et <strong>à</strong> agir d’une certaine façon, acquises et intériorisées, le plus<br />
fréquemm<strong>en</strong>t inconsciemm<strong>en</strong>t, par chaque individu, du fait de ses<br />
conditions objectives d’exist<strong>en</strong>ce. Les dispositions sont durables, c’est-<strong>à</strong>dire<br />
fortem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>racinées dans l’individu, et transférables d’une sphère<br />
d’expéri<strong>en</strong>ce <strong>à</strong> une <strong>au</strong>tre. Dès lors, elles concern<strong>en</strong>t, notamm<strong>en</strong>t, la<br />
perception des élém<strong>en</strong>ts objectifs impliqués dans le positionn<strong>en</strong>t face <strong>à</strong><br />
une <strong>risque</strong> év<strong>en</strong>tuel. Telle situation sera considérée comme risquée par tel<br />
11
acteur alors qu’elle ne le sera pas par un <strong>au</strong>tre. Dans ce contexte, telle<br />
situation constituera un frein pour tel acteur alors qu’elle ne le sera pas<br />
pour un <strong>au</strong>tre.<br />
Ces deux concepts permett<strong>en</strong>t de dépasser le cadre proposé par Hisrich et<br />
Peters <strong>en</strong> intégrant <strong>à</strong> la réflexion des composantes génétiques, c’est-<strong>à</strong>-dire<br />
qui permett<strong>en</strong>t de compr<strong>en</strong>dre l’initiation, <strong>au</strong>x deux s<strong>en</strong>s du terme, <strong>au</strong>/du<br />
choix du passage <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>treprise. De fait, ces concepts incorpor<strong>en</strong>t les<br />
dim<strong>en</strong>sions culturelles et normatives soulignées par les deux <strong>au</strong>teurs<br />
américains mais, <strong>en</strong> plus, permett<strong>en</strong>t de compr<strong>en</strong>dre pourquoi, chez<br />
certains individus, l’option du passage <strong>à</strong> la création et la prise de <strong>risque</strong><br />
qui l’accompagne ne peut s’<strong>en</strong>visager : elle n’est pas incorporée <strong>au</strong><br />
registre subjectif des possibles objectivables défini par leur habitus.<br />
La prise <strong>en</strong> compte de l’habitus et des dispositions permett<strong>en</strong>t, <strong>en</strong> outre,<br />
de considérer la composante stratégique de la logique d’action d’une<br />
manière plus satisfaisante que celle classiquem<strong>en</strong>t admise. La stratégie ne<br />
doit pas être <strong>en</strong>visagée uniquem<strong>en</strong>t dans cette optique classique, comme,<br />
par exemple le fait Crozier (1963) (importance accordée <strong>au</strong>x rapports de<br />
force, <strong>au</strong> calcul et <strong>à</strong> une rationalité de type purem<strong>en</strong>t économique…) mais<br />
plutôt comme : « le produit du s<strong>en</strong>s pratique comme s<strong>en</strong>s du jeu, d’un jeu<br />
social particulier, historiquem<strong>en</strong>t défini (...) ni un programme inconsci<strong>en</strong>t<br />
(...), ni un calcul consci<strong>en</strong>t et rationnel » (Bourdieu P., 1987 : 79, cité par<br />
Amblard et al., 1996 : 207).<br />
Le rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong> adopté par l’acteur devrait, dès lors, être examiné <strong>en</strong><br />
t<strong>en</strong>ant compte de l’<strong>en</strong>semble de ses expéri<strong>en</strong>ces et de ses appr<strong>en</strong>tissages<br />
antérieurs. L’individu, <strong>en</strong> tant qu’acteur stratégique, pr<strong>en</strong>dra, <strong>en</strong> contexte,<br />
telle ou telle décision, comme par exemple celle de mettre <strong>en</strong> œuvre (ou<br />
de ne pas mettre <strong>en</strong> œuvre) une série d’actions destinées <strong>au</strong> passage <strong>à</strong> la<br />
création, suivant les intérêts perçus, la réalité appréh<strong>en</strong>dée, les chances<br />
qu’il estime être si<strong>en</strong>nes, les ressources objectivem<strong>en</strong>t disponibles et<br />
subjectivem<strong>en</strong>t mobilisables et les contraintes effectives imposées par la<br />
situation d’action. Ses choix seront déterminés par sa rationalité, ses<br />
motivations, plus ou moins précises, et son interprétation des règles avec<br />
lesquelles il joue. Sa stratégie sera développée <strong>en</strong> fonction de ce qu’il<br />
perçoit de la situation (le passé, le prés<strong>en</strong>t et le futur de celle-ci) et<br />
s’articulera avec l’<strong>en</strong>semble des référ<strong>en</strong>ts symboliques et normatifs, ainsi<br />
qu’avec les expéri<strong>en</strong>ces et appr<strong>en</strong>tissages antérieurs.<br />
12
Par ailleurs, les choix individuels sont toujours porteurs de s<strong>en</strong>s. Chaque<br />
comportem<strong>en</strong>t, y compris la passivité ou l’att<strong>en</strong>tisme, doit, par<br />
conséqu<strong>en</strong>t, être considéré comme une action. Ce principe est d’<strong>au</strong>tant<br />
plus intéressant <strong>à</strong> intégrer <strong>à</strong> la réflexion que l’on s’interroge sur les<br />
stratégies professionnelles et que l’on t<strong>en</strong>te de compr<strong>en</strong>dre le pourquoi<br />
d’un choix individuel négatif par rapport <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat et <strong>à</strong><br />
la prise de <strong>risque</strong>.<br />
Des propositions théoriques qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t d’être esquissées, il ressort que<br />
plusieurs articulations peuv<strong>en</strong>t être mises <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce :<br />
a. le passage <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise est le fruit d’une décision qui<br />
s’<strong>en</strong>racine dans une rupture et/ou dans une opportunité ;<br />
b. la nature des ruptures et des opportunités n’est pas étrangère <strong>à</strong> la<br />
situation objective de l’individu (caractéristiques sociologiques et<br />
trajectoire personnelle); il <strong>en</strong> est de même <strong>en</strong> ce qui concerne la<br />
fréqu<strong>en</strong>ce et l’int<strong>en</strong>sité d’occurr<strong>en</strong>ce des ruptures et des<br />
opportunités ;<br />
c. ce passage comporte des <strong>risque</strong>s ;<br />
d. outre l’objectivité de ces élém<strong>en</strong>ts (opportunités, ruptures et<br />
<strong>risque</strong>s), c’est <strong>au</strong>ssi leur traduction subjective qui influ<strong>en</strong>ce cette<br />
décision ;<br />
e. les modalités de traduction et de construction du réel étant des<br />
productions socioculturelles et étant liées <strong>au</strong>x caractéristiques<br />
sociales de l’individu et <strong>à</strong> sa trajectoire biographique, le rapport<br />
<strong>au</strong>x ruptures, <strong>au</strong>x opportunités et <strong>au</strong>x <strong>risque</strong>s est donc<br />
sociologiquem<strong>en</strong>t conting<strong>en</strong>t : un même élém<strong>en</strong>t peut être investi<br />
de significations différ<strong>en</strong>tes suivant ces caractéristiques<br />
sociologiques et cette trajectoire ;<br />
f. in fine, ces caractéristiques et cette trajectoire influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t donc la<br />
prop<strong>en</strong>sion <strong>au</strong> passage <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
Nous allons maint<strong>en</strong>ant examiner si ces propositions se vérifi<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ce qui<br />
concerne le cas de la primo-création d’<strong>en</strong>treprise <strong>en</strong> Wallonie. Etant donné<br />
les limites imposées par la disponibilité des données, cet exam<strong>en</strong> se<br />
limitera <strong>au</strong>x relations <strong>en</strong>tre aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, caractéristiques<br />
sociologiques et passage <strong>à</strong> la primo-création. Au préalable, un exam<strong>en</strong><br />
descriptif de l’<strong>en</strong>semble des freins <strong>à</strong> ce passage sera réalisé.<br />
13
3. Sources des données<br />
Il n’existe pas, <strong>en</strong> Région wallonne, de répertoire des créateurs<br />
d’<strong>en</strong>treprise et <strong>en</strong>core moins des « nouve<strong>au</strong>x » <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs ou primocréateurs<br />
d’<strong>en</strong>treprises. Les systèmes administratifs et statistiques<br />
pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t le plus souv<strong>en</strong>t les <strong>en</strong>treprises <strong>en</strong> tant qu’<strong>en</strong>tité juridique ou les<br />
employeurs comme unités d’observation, faisant ainsi abstraction des<br />
individus créateurs. Tout projet de recherche sur les primo-créateurs se<br />
trouve donc confronté <strong>à</strong> un problème d’id<strong>en</strong>tification opérationnelle de<br />
cette population. Pour surmonter cette car<strong>en</strong>ce de données, il a fallu<br />
procéder par étapes.<br />
Un premier travail a concerné toutes les nouvelles <strong>en</strong>treprises, quelle que<br />
soit l’origine de leur création (reprise, fusion, création ex nihilo, scission,<br />
filialisation). Ces nouvelles <strong>en</strong>treprises ont été id<strong>en</strong>tifiées <strong>à</strong> partir de la<br />
base de données COFACE, qui regroupe des informations, principalem<strong>en</strong>t<br />
issues du registre de commerce et de l’Office National de Sécurité Sociale<br />
(ONSS), concernant l’<strong>en</strong>semble des <strong>en</strong>treprises localisées <strong>en</strong> Belgique.<br />
COFACE <strong>en</strong>visage la notion d’<strong>en</strong>treprise <strong>au</strong> s<strong>en</strong>s le plus large. Elle<br />
répertorie, <strong>en</strong> effet, tant les personnes morales que les personnes<br />
physiques, <strong>à</strong> la condition qu’elles rempliss<strong>en</strong>t <strong>au</strong> moins une des conditions<br />
suivantes :<br />
être inscrites <strong>au</strong> registre du commerce ;<br />
être assujetties <strong>à</strong> la taxe <strong>à</strong> la valeur ajoutée ;<br />
être assujetties <strong>à</strong> la loi comptable ;<br />
être assujetties <strong>à</strong> l’Office national de la sécurité sociale.<br />
Les informations fournies par COFACE permett<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t de mesurer<br />
des flux <strong>à</strong> travers les dates de constitution et de disparition des<br />
<strong>en</strong>treprises. Plus finem<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core, elles <strong>au</strong>toris<strong>en</strong>t le suivi de l’évolution<br />
juridique de chaque <strong>en</strong>treprise créée.<br />
L’id<strong>en</strong>tification des nouvelles <strong>en</strong>treprises s’est finalem<strong>en</strong>t faite sur la base<br />
d’une période de référ<strong>en</strong>ce de deux ans allant du 1 er juin 1998 <strong>au</strong> 31 mai<br />
2000. Outre le problème de disponibilité de l’information, le choix de ces<br />
dates répond <strong>à</strong> une volonté de favoriser l’homogénéité de la situation<br />
d’action tout <strong>en</strong> pouvant travailler sur une population suffisamm<strong>en</strong>t<br />
conséqu<strong>en</strong>te de nouvelles <strong>en</strong>treprises. Après nettoyage de la base de<br />
données fournie par COFACE, 12.748 <strong>en</strong>treprises ont été id<strong>en</strong>tifiées<br />
comme des nouvelles <strong>en</strong>treprises.<br />
14
Dans un deuxième temps, les <strong>en</strong>treprises id<strong>en</strong>tifiées comme étant<br />
nouvelles ont été systématiquem<strong>en</strong>t contactées, <strong>en</strong>tre le 15 septembre et<br />
le 30 octobre 2001 4<br />
, afin, d’une part, d’isoler les <strong>en</strong>treprises créées ex<br />
nihilo 5<br />
et, d’<strong>au</strong>tre part, d’id<strong>en</strong>tifier, pour ces dernières, le(s) créateur(s) et<br />
de savoir s’il(s) avai(<strong>en</strong>)t ou non une expéri<strong>en</strong>ce antérieure <strong>en</strong> matière de<br />
création.<br />
Les <strong>en</strong>treprises qui ont répondu <strong>à</strong> cette <strong>en</strong>quête d’id<strong>en</strong>tification des primocréateurs<br />
sont <strong>au</strong> nombre de 4.562, ce qui correspond <strong>à</strong> un t<strong>au</strong>x de<br />
réponses de 35,8 %. L’analyse des questionnaires r<strong>en</strong>trés a conduit <strong>à</strong><br />
retirer neuf <strong>en</strong>treprises de l’échantillon de départ pour des raisons de<br />
localisation de leur siège social. Elle a <strong>au</strong>ssi mis <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce la similarité<br />
<strong>en</strong>tre le profil des <strong>en</strong>treprises ayant répondu <strong>au</strong> questionnaire et celui de la<br />
population de départ, du moins pour les variables dont la distribution était<br />
connue. Autrem<strong>en</strong>t dit, les conclusions tirées <strong>à</strong> partir de la population des<br />
répondants peuv<strong>en</strong>t donc être considérées, dans une certaine mesure,<br />
comme généralisable <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>semble de la population de départ. Dans<br />
l’<strong>en</strong>semble, il convi<strong>en</strong>t cep<strong>en</strong>dant de rester prud<strong>en</strong>t. Certains biais peuv<strong>en</strong>t<br />
être prés<strong>en</strong>ts, dont ceux liés plus particulièrem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x caractéristiques des<br />
personnes n’ayant pas retourné le questionnaire.<br />
Parmi les <strong>en</strong>treprises ayant répondu <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>quête d’id<strong>en</strong>tification des primocréateurs,<br />
un peu plus de sept sur dix sont des créations ex nihilo. Les<br />
<strong>au</strong>tres ont été créées par fusion, filialisation ou scission.<br />
Au total, 6.392 créateurs ont participé <strong>à</strong> la fondation des <strong>en</strong>treprises<br />
créées ex nihilo, soit une moy<strong>en</strong>ne de 1,96 créateur par <strong>en</strong>treprise. Parmi<br />
ceux-ci, 4.322 ont été déclarés comme étant des primo-créateurs, soit un<br />
peu plus de sept créateurs sur dix.<br />
Dans un troisième temps, <strong>en</strong> septembre et octobre 2004, l’<strong>en</strong>semble des<br />
primo-créateurs id<strong>en</strong>tifiés lors de la phase précéd<strong>en</strong>te a été invité <strong>à</strong><br />
participer <strong>à</strong> une <strong>en</strong>quête de type socio-économique destinée <strong>à</strong> faire<br />
ressortir certaines caractéristiques des logiques d’action développées lors<br />
de la création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
4<br />
Les différ<strong>en</strong>tes <strong>en</strong>quêtes réalisées dans le cadre de cette recherche ont été effectuées par<br />
le bure<strong>au</strong> d’études Sonecom-sprl.<br />
5<br />
C’est-<strong>à</strong>-dire les créations <strong>au</strong> s<strong>en</strong>s strict. Ne sont pas concernée les <strong>en</strong>treprises créées<br />
suite <strong>à</strong> une fusion, scission, changem<strong>en</strong>t d’appellation...<br />
15
Le questionnaire destiné <strong>au</strong>x primo-créateurs a été structuré <strong>en</strong> quatre<br />
grands volets. Le premier volet portait sur l’id<strong>en</strong>tification de l’<strong>en</strong>treprise <strong>au</strong><br />
mom<strong>en</strong>t de sa création, c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>en</strong>tre le 1 er<br />
juin 1998 et le 31 mai<br />
2000. Le deuxième volet concernait la stratégie et le processus de création<br />
de l’<strong>en</strong>treprise. Ce volet visait plus particulièrem<strong>en</strong>t <strong>à</strong> id<strong>en</strong>tifier la<br />
temporalité <strong>en</strong>tre l’idée de création d’une <strong>en</strong>treprise et le passage <strong>à</strong> l’acte,<br />
les décl<strong>en</strong>cheurs personnels et professionnels ayant joué dans le passage<br />
<strong>à</strong> l’acte, le type de démarches effectuées, les souti<strong>en</strong>s obt<strong>en</strong>us et<br />
souhaités, et les freins év<strong>en</strong>tuellem<strong>en</strong>t r<strong>en</strong>contrés par les primo-créateurs.<br />
Le troisième volet abordait les ressources financières mobilisées lors de la<br />
création de l’<strong>en</strong>treprise et les grandes ori<strong>en</strong>tations stratégiques prises.<br />
Enfin, le quatrième et dernier volet était c<strong>en</strong>tré sur le créateur et son<br />
<strong>en</strong>tourage immédiat. Les questions portant sur le créateur concernai<strong>en</strong>t<br />
différ<strong>en</strong>tes dim<strong>en</strong>sions id<strong>en</strong>titaires telles que son âge, ses titres scolaires,<br />
sa situation socio-professionnelle et socio-économique <strong>au</strong> mom<strong>en</strong>t de la<br />
création de l’<strong>en</strong>treprise. <strong>Une</strong> question portait sur les motivations<br />
personnelles poursuivies par le primo-créateur <strong>à</strong> travers l’acte de création.<br />
Quant <strong>au</strong> nive<strong>au</strong> de l’<strong>en</strong>tourage immédiat, l’<strong>en</strong>quête a surtout cherché <strong>à</strong><br />
cerner la situation socio-professionnelle de trois figures clés : le père, la<br />
mère et l’év<strong>en</strong>tuel part<strong>en</strong>aire du primo-créateur.<br />
16
Ce questionnaire a été adressé <strong>à</strong> 3.520 primo-créateurs sur les 4.322<br />
primo-créateurs id<strong>en</strong>tifiés comme tels lors de la phase précéd<strong>en</strong>te. Cette<br />
différ<strong>en</strong>ce résulte de l’abs<strong>en</strong>ce des coordonnées personnelles de près de<br />
800 primo-créateurs. Après une phase de relance téléphonique, 538<br />
questionnaires valides ont finalem<strong>en</strong>t été réceptionnés, ce qui correspond<br />
<strong>à</strong> un t<strong>au</strong>x de réponse de 15,3 %.<br />
Dans un quatrième temps, une <strong>au</strong>tre <strong>en</strong>quête a été réalisée <strong>au</strong>près d’un<br />
échantillon représ<strong>en</strong>tatif de la population wallonne âgée de 18 ans et plus<br />
constitué de 8000 particuliers. L’objectif de cette <strong>en</strong>quête était de m<strong>en</strong>er<br />
un travail comparatif avec les primo-créateurs afin de mettre <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce<br />
leurs spécificités. Deux thèmes ont été particulièrem<strong>en</strong>t approfondis : les<br />
freins <strong>à</strong> la création et les caractéristiques individuelles. Dès lors, alors que<br />
le questionnaire destiné <strong>au</strong>x primo-créateurs comportait 56 questions<br />
fermées, celui adressé <strong>au</strong>x particuliers n’<strong>en</strong> cont<strong>en</strong>ait que 27. Le nombre<br />
de questionnaires valides réceptionnés a été de 2.277. Parmi ceux-ci,<br />
2.037 émanai<strong>en</strong>t de personnes n’ayant jamais créé d’<strong>en</strong>treprise. C’est <strong>au</strong><br />
sein de cette population qu’ont été id<strong>en</strong>tifiés les candidats créateurs.<br />
Ceux-ci sont <strong>au</strong> nombre de 398, soit près d’un non créateur sur cinq.<br />
La confrontation de ces deux dernières <strong>en</strong>quêtes s’avère donc être<br />
particulièrem<strong>en</strong>t utile dans le cadre de la prés<strong>en</strong>te analyse, notamm<strong>en</strong>t<br />
parce qu’elles comport<strong>en</strong>t une partie commune sur les <strong>barrière</strong>s <strong>à</strong> la<br />
création. Cette partie compr<strong>en</strong>d notamm<strong>en</strong>t 24 questions qui serviront ici<br />
de base <strong>à</strong> notre travail analytique 6 . Nous utiliserons égalem<strong>en</strong>t la partie<br />
commune consacrée <strong>à</strong> la situation socio-professionnelle et socioéconomique<br />
des individus.<br />
6<br />
Ces 24 questions ont été posées <strong>au</strong>x primo-créateurs et <strong>au</strong>x candidats créateurs. Parmi<br />
ces questions, l’une porte explicitem<strong>en</strong>t sur le « s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de projet trop risqué ».<br />
17
4. Analyses et discussions<br />
4.1. Les freins <strong>à</strong> la création du point de vue des individus<br />
Sur la base de ces deux <strong>en</strong>quêtes, nous discutons dans cette section des<br />
princip<strong>au</strong>x obstacles <strong>à</strong> la création r<strong>en</strong>contrés par les primo-créateurs <strong>en</strong><br />
comparaison avec ceux id<strong>en</strong>tifiés par les candidats créateurs 7<br />
.<br />
Quatre catégories de freins sont distinguées. La première catégorie se<br />
rapporte principalem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x obstacles liés <strong>au</strong>x s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>ts et craintes de<br />
l’individu. La deuxième catégorie d’obstacles fait écho <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t<br />
relationnel du créateur d’<strong>en</strong>treprise. La troisième catégorie traduit les<br />
craintes du candidat créateur quant <strong>à</strong> son <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t économique. La<br />
dernière catégorie de freins fait directem<strong>en</strong>t référ<strong>en</strong>ce <strong>au</strong>x obstacles<br />
(principalem<strong>en</strong>t administratifs) r<strong>en</strong>contrés lors du processus de création.<br />
L’analyse approfondie de ces quatre catégories permet de mettre <strong>en</strong><br />
évid<strong>en</strong>ce plusieurs élém<strong>en</strong>ts intéressants sur l’importance et sur la nature<br />
des obstacles r<strong>en</strong>contrés par les primo-créateurs et les candidats<br />
créateurs.<br />
Les résultats, détaillés <strong>au</strong> graphique 1, indiqu<strong>en</strong>t une hiérarchisation <strong>en</strong>tre<br />
les freins : 13 % des primo-créateurs interrogés considèr<strong>en</strong>t que la<br />
lourdeur des démarches administratives, la faiblesse des structures d’aide<br />
<strong>à</strong> la création et la complexité des réglem<strong>en</strong>tations constitu<strong>en</strong>t des<br />
obstacles majeurs lors du processus de création d’une <strong>en</strong>treprise. A ces<br />
facteurs institutionnels vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t s’ajouter les freins liés <strong>à</strong> la difficulté<br />
d’accès <strong>à</strong> l’emprunt ou <strong>au</strong> capital <strong>à</strong> <strong>risque</strong> : 8 % des primo-créateurs<br />
estim<strong>en</strong>t que cet élém<strong>en</strong>t constitue un frein très important. En outre,<br />
l’appréciation de l’importance de ces freins doit t<strong>en</strong>ir compte du fait que<br />
les personnes interrogées ont créé leur <strong>en</strong>treprise, c’est-<strong>à</strong>-dire qu’elles<br />
sont, <strong>en</strong> quelque sorte, parv<strong>en</strong>ues <strong>à</strong> surmonter ces difficultés.<br />
7 Les résultats prés<strong>en</strong>tés dans cette sous-section ont, pour la plus part, été obt<strong>en</strong>us, sous la<br />
direction de Capron H., par les chercheurs du DULBEA (Départem<strong>en</strong>t d’économie appliquée<br />
de l’Université libre de Bruxelles) et sont développés dans un rapport de recherche<br />
(Calay V., Capron H., Cincera M., Desmarez P., De Waeghe N., Greunz L., Guyot J.L., Houard<br />
J., Lohest O., Vandermott<strong>en</strong> C., Vandewattyne J., Van Hamme G. : 2005) Les nouve<strong>au</strong>x<br />
créateurs d’<strong>en</strong>treprise <strong>en</strong> Région wallonne et les conditions de leur réussite, mimeo,<br />
DULBEA-ULB, Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique,<br />
Bruxelles-Jambes).<br />
18
Les freins sont égalem<strong>en</strong>t hiérarchisés <strong>au</strong> sein de chacune des catégories.<br />
Sur le plan individuel, les freins les plus souv<strong>en</strong>t cités concern<strong>en</strong>t la crainte<br />
du primo-créateur quant <strong>à</strong> la « faiblesse des moy<strong>en</strong>s financiers propres »<br />
et la « crainte de l’instabilité des rev<strong>en</strong>us ». Ces facteurs sont jugés<br />
comme « importants » ou « très importants » par près de 20 % des primocréateurs.<br />
Peu de primo-créateurs considèr<strong>en</strong>t que le manque<br />
d’expéri<strong>en</strong>ce, de connaissance et ou de formation, le manque de temps ou<br />
l’âge les ont fait hésiter <strong>à</strong> poursuivre leur projet de création : seulem<strong>en</strong>t<br />
15 % des primo-créateurs ont id<strong>en</strong>tifié ces élém<strong>en</strong>ts comme des freins<br />
importants ou très importants. Pour ce qui est de la perception du <strong>risque</strong><br />
associé <strong>au</strong> projet, elle ne semble pas avoir un impact majeur sur la<br />
poursuite du projet dans la mesure où seulem<strong>en</strong>t 5 % des primo-créateurs<br />
jug<strong>en</strong>t ce facteur comme « important » ou « très important ».<br />
Sur le plan de l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t relationnel, rares sont les primo-créateurs<br />
qui estim<strong>en</strong>t que leur <strong>en</strong>tourage ou leur conjoint les ont freinés dans leur<br />
processus de création. De fait, 82,8 % des primo-créateurs n’ont pas dû<br />
faire face <strong>au</strong> manque de souti<strong>en</strong>, de conseil ou <strong>à</strong> l’opposition de leur<br />
conjoint. Toutefois, près de 32 % des primo-créateurs témoign<strong>en</strong>t du fait<br />
que les contraintes familiales constitu<strong>en</strong>t un frein « peu ou moy<strong>en</strong>nem<strong>en</strong>t<br />
important », ce résultat étant lié <strong>au</strong> nombre d’<strong>en</strong>fants qui font partie du<br />
ménage.<br />
Sur le plan du contexte économique, le frein le plus important est la<br />
« concurr<strong>en</strong>ce importante et le marché pot<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t limité ». Pour<br />
<strong>en</strong>viron 50 % des primo-créateurs, cet élém<strong>en</strong>t les a fait hésiter <strong>à</strong><br />
poursuivre leur projet même si, pour 30 % d’<strong>en</strong>tre eux, ce facteur n’a joué<br />
que très faiblem<strong>en</strong>t. Les primo-créateurs sembl<strong>en</strong>t peu préoccupés par<br />
l’économie internationale : près de 70 % d’<strong>en</strong>tre eux déclar<strong>en</strong>t que ce<br />
facteur n’est « pas du tout important ». Un chiffre similaire <strong>à</strong> ce dernier est<br />
observé <strong>en</strong> ce qui concerne les t<strong>au</strong>x d’intérêt et la disponibilité de maind’œuvre<br />
qualifiée.<br />
19
Graphique 1. Importance des freins chez les primo-créateurs<br />
Source :Calay et al. (2005 : 314) - Données <strong>IWEPS</strong> - Calculs et graphique DULBEA (Université libre de<br />
Bruxelles)<br />
20
Comparativem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x primo-créateurs, le graphique 2 relève que les<br />
candidats créateurs ress<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t plus int<strong>en</strong>sém<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble des freins <strong>à</strong><br />
l’exception, toutefois, du frein relatif <strong>au</strong> « manque de main-d’œuvre<br />
qualifiée ». Cette observation pourrait suggérer que lorsqu’un individu a<br />
concrétisé son projet de création, son évaluation de l’importance des freins<br />
est nettem<strong>en</strong>t plus faible que celle d’une personne pour laquelle le projet<br />
n’a pas abouti. D’<strong>au</strong>tres hypothèses peuv<strong>en</strong>t être avancées <strong>à</strong> ce nive<strong>au</strong>,<br />
comme, par exemple, celle d’un rapport <strong>au</strong>x freins a priori intrinsèquem<strong>en</strong>t<br />
différ<strong>en</strong>t dans les deux populations et <strong>à</strong> l’origine de la (non) concrétisation<br />
de la création, ou celle d’une estimation de ces freins plus forte chez les<br />
candidats car source pour eux de rationalisation a posteriori de la non<br />
finalisation du projet.<br />
21
Graphique 2. Scores moy<strong>en</strong>s des freins – primo-créateurs et candidats créateurs<br />
Source : Calay et al. (2005 : 317) - Données <strong>IWEPS</strong> - Calculs et graphique DULBEA (Université libre de<br />
Bruxelles)<br />
22
Chez les candidats créateurs, la faiblesse des moy<strong>en</strong>s financiers propres<br />
ressort comme un frein majeur : 64 % de ces individus jug<strong>en</strong>t que cette<br />
faiblesse constitue un frein important ou très important. D’<strong>au</strong>tres<br />
obstacles, tels que la faiblesse des structures d’aide, la lourdeur des<br />
réglem<strong>en</strong>tations ainsi que l’<strong>en</strong>semble des facteurs liés <strong>au</strong>x aspects<br />
financiers (l’importance des moy<strong>en</strong>s financiers requis, la difficulté d’accès<br />
<strong>à</strong> l’emprunt et <strong>au</strong> capital <strong>à</strong> <strong>risque</strong>, le nive<strong>au</strong> élevé du t<strong>au</strong>x d’intérêt et la<br />
crainte de l’instabilité des rev<strong>en</strong>us) atteign<strong>en</strong>t des scores élevés. En outre,<br />
près de 27 % des candidats considèr<strong>en</strong>t que la perception du <strong>risque</strong><br />
associé <strong>au</strong> projet constitue un frein « important » ou « très important » pour<br />
la poursuite du projet.<br />
4.2. L’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> et la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> la primo-création<br />
Le rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong> constitue, chez les candidats créateurs, un obstacle<br />
plus fréquemm<strong>en</strong>t invoqué que chez les primo-créateurs. Pour près de<br />
64 % des candidats, le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de <strong>risque</strong> lié <strong>au</strong> projet est id<strong>en</strong>tifié<br />
comme un frein (peu important, important ou très important), contre<br />
seulem<strong>en</strong>t 32 % pour les primo-créateurs. Nous allons maint<strong>en</strong>ant<br />
apporter un éclairage supplém<strong>en</strong>taire sur ce frein spécifique. Son<br />
importance est analysée <strong>au</strong> moy<strong>en</strong> d’un modèle de type Probit Bivarié. Il<br />
s’agit, par ce modèle, d’estimer dans quelle mesure les caractéristiques<br />
sociologiques des individus influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t leur rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong> ou, du<br />
moins, leur perception du <strong>risque</strong> associé <strong>au</strong> projet de création, et, par voie<br />
de conséqu<strong>en</strong>ce, leur prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> s’<strong>en</strong>gager dans un processus de<br />
primo-création d’<strong>en</strong>treprise. Pour ce faire, nous travaillons sur l’<strong>en</strong>semble<br />
de l’échantillon des primo-créateurs et des candidats créateurs, soit, <strong>au</strong><br />
total, 493 individus <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant compte des données manquantes pour<br />
l’<strong>en</strong>semble des variables du modèle utilisé.<br />
<strong>Une</strong> telle estimation n’est pas sans poser problèmes <strong>en</strong> raison du caractère<br />
<strong>en</strong>dogène de « l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> » dans l’articulation <strong>en</strong>tre celle-ci, les<br />
caractéristiques sociologiques et la transition vers l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>ariat. En<br />
effet, les primo-créateurs ont des caractéristiques spécifiques qui les<br />
distingu<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>semble des <strong>au</strong>tres individus, y compris leur aversion <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong>, comme le montre le table<strong>au</strong> de l’annexe 2. Ensuite, les facteurs<br />
explicatifs de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> peuv<strong>en</strong>t égalem<strong>en</strong>t être des<br />
23
déterminants de l’accès <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise. Dans ce contexte, si la<br />
probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> n’est pas estimée, le rôle des<br />
déterminants propres <strong>à</strong> l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> ne peut être distingué de celui<br />
des déterminants de la création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
Pour t<strong>en</strong>ir compte du caractère <strong>en</strong>dogène de la perception du <strong>risque</strong> lors<br />
du passage vers l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>ariat nous estimons simultaném<strong>en</strong>t la<br />
probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> et la probabilité d’être primo-créateur<br />
sur la base d’un modèle Probit Bivarié 8<br />
. En particulier on s’intéresse, <strong>au</strong><br />
travers de cette spécification, <strong>à</strong> deux variables bi-modales : d’un côté, la<br />
prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> ( y 1),<br />
de l’<strong>au</strong>tre la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> créer<br />
une <strong>en</strong>treprise ( y 2 ), la première étant modélisée comme facteur explicatif<br />
de la création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
Le table<strong>au</strong> de l’annexe 2 fournit une synthèse des résultats. La partie<br />
g<strong>au</strong>che du table<strong>au</strong> (modèle 1) prés<strong>en</strong>te les résultats pour le modèle relatif<br />
<strong>à</strong> la probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, la partie droite (modèle 2) r<strong>en</strong>voie <strong>à</strong><br />
la probabilité d’être primo-créateur.<br />
Les résultats du table<strong>au</strong> de l’annexe 2 sont discutés <strong>en</strong> deux temps. Les<br />
déterminants de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> sont d’abord analysés. Ensuite l’effet<br />
de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> sur la probabilité de passage <strong>à</strong> la création est<br />
abordé.<br />
Les variables explicatives ret<strong>en</strong>ues pour expliquer la perception du <strong>risque</strong><br />
associé <strong>au</strong> projet de création (modèle 1) se rapport<strong>en</strong>t <strong>à</strong> la fois <strong>au</strong>x<br />
caractéristiques individuelles et <strong>au</strong>x caractéristiques de l’<strong>en</strong>tourage<br />
familial.<br />
Concernant les caractéristiques individuelles de l’individu (créateur ou non<br />
créateur) sont ret<strong>en</strong>ues l’âge, le g<strong>en</strong>re (masculin), 3 nive<strong>au</strong>x de diplôme<br />
(sans diplôme ou maximum diplôme secondaire inférieur, diplôme<br />
secondaire supérieur, diplôme universitaire ou post-universitaire ou<br />
8<br />
Pour une prés<strong>en</strong>tation détaillée de ce modèle, nous r<strong>en</strong>voyons le lecteur <strong>à</strong> Wooldridge<br />
(2002). F<strong>au</strong>te de place, nous n’abordons pas la question des déterminants pot<strong>en</strong>tiels du<br />
modèle. Dans notre modèle, la variable aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> est traitée comme une variable<br />
binaire, les modalités de l’échelle initiale 1 et 2, d’une part, et 3 et 4, d’<strong>au</strong>tre part, ayant été<br />
regroupées. Les variables relatives <strong>à</strong> la position socio-économique du créateur concern<strong>en</strong>t<br />
son état <strong>au</strong> mom<strong>en</strong>t du passage <strong>à</strong> la création.<br />
24
doctorat), la situation familiale 9 et le statut professionnel. Pour ce dernier,<br />
différ<strong>en</strong>tes variantes ont été testées. Au regard des résultats obt<strong>en</strong>us, nous<br />
avons distingué dans le modèle final trois états <strong>à</strong> savoir le fait que le<br />
(candidat) créateur était soit (1) salarié du secteur public, (2) travailleur<br />
indép<strong>en</strong>dant (<strong>à</strong> titre principal). Le groupe de référ<strong>en</strong>ce qui constitue le<br />
troisième état, regroupe quant <strong>à</strong> lui l’<strong>en</strong>semble des <strong>au</strong>tres statuts<br />
professionnels id<strong>en</strong>tifiables dans l’<strong>en</strong>quête (salarié secteur privé, chômeur,<br />
retraité ou <strong>au</strong> foyer). Les caractéristiques de l’<strong>en</strong>tourage familial, quant <strong>à</strong><br />
elles, sont appréh<strong>en</strong>dées par l’intermédiaire du diplôme des par<strong>en</strong>ts (3<br />
nive<strong>au</strong>x de diplôme) mais égalem<strong>en</strong>t par le statut professionnel des<br />
par<strong>en</strong>ts. Le choix <strong>en</strong>tre les différ<strong>en</strong>ts statuts professionnels a été<br />
s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t étoffé par rapport <strong>au</strong>x statuts distingués pour le (candidat)<br />
créateur (p<strong>en</strong>sionné ou <strong>au</strong> foyer, chômeur, salarié du secteur public,<br />
salarié du secteur privé, indép<strong>en</strong>dant), ces dim<strong>en</strong>sions étant <strong>en</strong> effet<br />
systématiquem<strong>en</strong>t significatives pour l’<strong>en</strong>tourage familial.<br />
Au vu des résultats (modèle 1 du table<strong>au</strong> de l’annexe 2), on observe que le<br />
nive<strong>au</strong> du diplôme de l’individu (<strong>en</strong> particulier pour les diplômés du<br />
supérieur), le g<strong>en</strong>re et la profession antérieure du créateur influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t<br />
significativem<strong>en</strong>t (<strong>au</strong> seuil de 6%) l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> des candidats<br />
créateurs.<br />
Plus spécifiquem<strong>en</strong>t, les hommes témoign<strong>en</strong>t, <strong>au</strong> regard des résultats,<br />
d’une s<strong>en</strong>sibilité significative plus importante <strong>au</strong> <strong>risque</strong> que les femmes. La<br />
représ<strong>en</strong>tation sociale de l’homme dans la société actuelle et le coût social<br />
lié <strong>à</strong> un échec pour un homme peuv<strong>en</strong>t expliquer <strong>en</strong> partie ce résultat. Par<br />
ailleurs, on constate égalem<strong>en</strong>t que l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> est plus<br />
importante et significative chez les candidats et primo-créateurs masculins<br />
qui dispos<strong>en</strong>t d’un diplôme de nive<strong>au</strong> supérieur (universitaire ou non<br />
universitaire). Les individus qualifiés masculins sont plus s<strong>en</strong>sibles <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong> lié <strong>au</strong> processus de création que ceux qui dispos<strong>en</strong>t d’un nive<strong>au</strong> de<br />
qualification intermédiaire (secondaire supérieur). Dans la mesure où les<br />
personnes qualifiées ont accès <strong>à</strong> des emplois plus rémunérateurs que ceux<br />
disposant d’un nive<strong>au</strong> de qualification plus faible, il s’<strong>en</strong> suit que le <strong>risque</strong><br />
9 Sur la base des informations disponibles dans l’<strong>en</strong>quête, seulem<strong>en</strong>t trois situations<br />
familiales distingues peuv<strong>en</strong>t être mises <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce : (1) si la personne vivait <strong>en</strong> couple,<br />
(2) si la personne était isolée avec <strong>en</strong>fant(s), (3) si la personne était isolée sans <strong>en</strong>fant.<br />
25
lié <strong>à</strong> un échec pot<strong>en</strong>tiel lors du processus de création sera plus important<br />
pour un individu qualifié que pour un individu plus faiblem<strong>en</strong>t qualifié.<br />
De toute évid<strong>en</strong>ce, la situation professionnelle n’est pas neutre sur la<br />
relation <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. De fait, on constate que les candidats créateurs (et<br />
primo-créateurs) qui occupai<strong>en</strong>t une activité comme indép<strong>en</strong>dant ont une<br />
aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> plus faible que les salariés ou les chômeurs. Ce résultat<br />
s’explique sans doute par le fait que ce sont les individus les moins<br />
averses <strong>au</strong> <strong>risque</strong> qui occup<strong>en</strong>t une activité d’indép<strong>en</strong>dant. Dans ce<br />
contexte, une sélection sur le <strong>risque</strong> s’est déj<strong>à</strong> opérée chez ceux-ci. Ils<br />
seront donc, de facto, moins s<strong>en</strong>sibles <strong>au</strong> <strong>risque</strong>.<br />
La situation familiale exerce une influ<strong>en</strong>ce significative <strong>au</strong> seuil de 7 % sur<br />
la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. Les individus isolés avec <strong>en</strong>fants<br />
témoign<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet d’une aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> plus élevée que celle de notre<br />
groupe de référ<strong>en</strong>ce (couple avec ou sans <strong>en</strong>fant). De toute évid<strong>en</strong>ce, la<br />
charge financière qui pèse sur un individu isolé avec <strong>en</strong>fants est<br />
proportionnellem<strong>en</strong>t plus marquée que pour un couple. En cas d’échec lors<br />
du processus de création, le conjoint <strong>au</strong> sein du couple peut toujours<br />
théoriquem<strong>en</strong>t contribuer <strong>à</strong> l’assise financière du ménage (le coût du<br />
<strong>risque</strong> est distribué sur les deux conjoints) alors que dans le cas d’un<br />
ménage isolé avec <strong>en</strong>fants cela n’est pas possible.<br />
Par ailleurs, la nationalité a <strong>au</strong>ssi un impact <strong>au</strong> seuil de 5 % sur la<br />
prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> : les individus de nationalité étrangère<br />
sont moins averses <strong>au</strong> <strong>risque</strong> que les belges.<br />
Les caractéristiques de l’<strong>en</strong>tourage familial direct (père ou mère), <strong>en</strong><br />
particulier <strong>en</strong> ce qui concerne le statut professionnel, exerc<strong>en</strong>t une<br />
influ<strong>en</strong>ce significative sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. En ce qui<br />
concerne les pères, l’exercice d’une activité professionnelle a un impact<br />
négatif significatif sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> par rapport <strong>au</strong>x<br />
individus dont les pères sont inactifs. L’exercice d’une profession par le<br />
père semble réduire s<strong>en</strong>siblem<strong>en</strong>t la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong><br />
par rapport <strong>à</strong> ceux dont le père ne travaille (ait) pas. Ce résultat s’explique<br />
peut-être par le fait que les (candidats) créateurs dont le père exerçait (ou<br />
exerce <strong>en</strong>core) une activité professionnelle dispose d’un patrimoine familial<br />
plus conséqu<strong>en</strong>t qui, dans une certaine mesure, constitue une certaine<br />
garantie contre les <strong>risque</strong>s pot<strong>en</strong>tiels liés <strong>à</strong> la création.<br />
26
Parallèlem<strong>en</strong>t, on constate égalem<strong>en</strong>t que le statut professionnel occupé<br />
par la mère peut égalem<strong>en</strong>t influ<strong>en</strong>cer la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong> du (candidat) créateur. Ce résultat est <strong>en</strong> effet significatif si la mère<br />
était salariée du secteur privé comparativem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x candidats dont la<br />
mère était femme <strong>au</strong> foyer : comparativem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x individus dont la mère<br />
est, ou était, femme <strong>au</strong> foyer, ceux dont la mère exerce, ou exerçait, une<br />
profession dans le secteur privé affich<strong>en</strong>t une aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> plus<br />
élevée. Par contre, le fait d’avoir une mère qui exerce, ou exerçait, une<br />
activité comme indép<strong>en</strong>dante ne semble pas influ<strong>en</strong>cer significativem<strong>en</strong>t la<br />
prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>.<br />
Dans la mesure où nous avons constaté une influ<strong>en</strong>ce significative du<br />
nive<strong>au</strong> de diplôme sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, il était<br />
égalem<strong>en</strong>t intéressant de s’interroger sur l’impact du nive<strong>au</strong> de<br />
qualification des par<strong>en</strong>ts sur cette aversion. Force est de constater,<br />
contrairem<strong>en</strong>t <strong>au</strong> statut professionnel des par<strong>en</strong>ts, que le nive<strong>au</strong> de<br />
diplôme de ces derniers n’a pas d’impact significatif sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong> des candidats créateurs et des primo-créateurs. Ainsi, toute chose<br />
égale par ailleurs, que les par<strong>en</strong>ts soi<strong>en</strong>t qualifiés ou non n’influ<strong>en</strong>c<strong>en</strong>t pas<br />
la relation <strong>au</strong> <strong>risque</strong>.<br />
Au sein de notre modèle empirique, nous avons égalem<strong>en</strong>t estimé<br />
simultaném<strong>en</strong>t les déterminants du passage <strong>à</strong> la création <strong>en</strong> t<strong>en</strong>ant<br />
compte de l’influ<strong>en</strong>ce de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. Pour ce faire, différ<strong>en</strong>tes<br />
variables ont été croisées dans notre modèle Probit Bivarié avec notre<br />
mesure d’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. On retrouve ainsi les variables reprises dans<br />
le modèle d’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> comme les caractéristiques individuelles<br />
(âge, sexe, statut familial), le statut professionnel de l’individu, les<br />
caractéristiques des par<strong>en</strong>ts (diplômes et statuts professionnels<br />
antérieurs). En complém<strong>en</strong>t <strong>à</strong> ces déterminants, d’<strong>au</strong>tres variables<br />
explicatives ont été introduites exclusivem<strong>en</strong>t dans l’équation relative <strong>au</strong>x<br />
déterminants de la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> passer <strong>à</strong> la création 10 . Ces variables<br />
port<strong>en</strong>t sur la taille de l’organisme dans lequel l’individu exerce (pour les<br />
candidats) ou exerçait (pour les primo-créateurs) son activité<br />
10 Ces variables n’ont pas été introduites dans le modèle relatif <strong>à</strong> l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> car<br />
nous n’avons pas trouvé dans la littérature d’élém<strong>en</strong>ts laissant <strong>à</strong> p<strong>en</strong>ser qu’elles pouvai<strong>en</strong>t<br />
influ<strong>en</strong>cer cette aversion.<br />
27
professionnelle antérieure, sur l’attitude de l’<strong>en</strong>tourage familial <strong>à</strong> l’égard de<br />
la création d’<strong>en</strong>treprise et sur la nature des r<strong>en</strong>trées financières.<br />
Pour l’<strong>en</strong>semble des traitem<strong>en</strong>ts effectués, l’influ<strong>en</strong>ce de la variable g<strong>en</strong>re<br />
apparaît significative <strong>au</strong> seuil de 6 %. Comparativem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x femmes, les<br />
hommes ont une probabilité supérieure de créer une nouvelle <strong>en</strong>treprise<br />
dès que l’on contrôle pour le caractère <strong>en</strong>dogène de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>.<br />
Ce résultat confirme d’<strong>au</strong>tres trav<strong>au</strong>x qui démontr<strong>en</strong>t que les hommes<br />
prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une probabilité supérieure de créer une <strong>en</strong>treprise, ceteris<br />
paribus (Caputo et Dolinsky, 1998 ; Van Gelder<strong>en</strong> et al., 2001 ; Ritsliä et<br />
Tervo, 2002 ; Cincerra et al., 2005).<br />
Concernant le diplôme de l’individu (le plus h<strong>au</strong>t diplôme obt<strong>en</strong>u <strong>au</strong><br />
mom<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>quête), sans réelle surprise, le nive<strong>au</strong> d’éducation exerce,<br />
sous contrôle de la variable mesurant l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, une influ<strong>en</strong>ce<br />
significative sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> dev<strong>en</strong>ir créateur. Nos résultats dévoil<strong>en</strong>t<br />
deux élém<strong>en</strong>ts. D’une part, ils indiqu<strong>en</strong>t que les individus diplômés du<br />
primaire ou du secondaire inférieur ont une probabilité inférieure (<strong>au</strong> seuil<br />
de 5 %) de se lancer dans la création par rapport <strong>à</strong> un diplômé du<br />
secondaire supérieur. D’<strong>au</strong>tre part, les résultats montr<strong>en</strong>t que les<br />
personnes qui dispos<strong>en</strong>t d’un diplôme universitaire ont, par contre, une<br />
probabilité supérieure de créer une <strong>en</strong>treprise (<strong>au</strong> seuil de 10 %). Ces<br />
résultats sont <strong>en</strong> accord avec d’<strong>au</strong>tres comme ceux de Fritsch (1992) et<br />
d’Armington et Acs (2002). Ainsi, le nive<strong>au</strong> de diplôme exerce une<br />
influ<strong>en</strong>ce négative sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> mais par<br />
contre il a une influ<strong>en</strong>ce positive sur le processus de création dès que l’on<br />
contrôle pour le caractère <strong>en</strong>dogène de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. Cette<br />
dichotomie dans les résultats est <strong>à</strong> mettre <strong>en</strong> relation avec l’exist<strong>en</strong>ce<br />
d’<strong>au</strong>tres freins majeurs comme les contraintes de liquidités, les démarches<br />
administratives qui, sans doute, sont plus difficiles <strong>à</strong> gérer chez les<br />
individus moins diplômés que chez les individus diplômés 11 .<br />
En ce qui concerne l’âge, les résultats indiqu<strong>en</strong>t que, ceteris paribus, la<br />
probabilité de passage <strong>à</strong> la création est globalem<strong>en</strong>t indép<strong>en</strong>dante de l’âge<br />
de l’individu. Ceci semble conforter les trav<strong>au</strong>x de Evans et Leighton<br />
(1989) mais va <strong>à</strong> l’<strong>en</strong>contre des trav<strong>au</strong>x de Jovanovic (1979), de Reynolds<br />
11<br />
La prise <strong>en</strong> compte de ces freins dépasse l’objet de cet article. D’<strong>au</strong>tres trav<strong>au</strong>x <strong>en</strong> ce<br />
s<strong>en</strong>s sont actuellem<strong>en</strong>t m<strong>en</strong>és par les <strong>au</strong>teurs. Cette analyse complém<strong>en</strong>taire devrait<br />
permettre d’apporter un éclairage sur ces élém<strong>en</strong>ts d’explication.<br />
28
(1997) et de Blanchflower et al. (2001) et Cincera et al. (2005). De même,<br />
l’influ<strong>en</strong>ce de la composition familiale sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> créer une<br />
<strong>en</strong>treprise n’est pas significative, toute chose égale par ailleurs.<br />
De nombreux <strong>au</strong>teurs (Le 1999 ; Aschcroft, Love et Malloy 1991 ; Van<br />
Gelder<strong>en</strong> et al., 2001) constat<strong>en</strong>t que le statut professionnel est un facteur<br />
déterminant sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> créer une <strong>en</strong>treprise. Selon ces <strong>au</strong>teurs, le<br />
type d’emploi occupé avant le passage <strong>à</strong> la création, de même que le<br />
rev<strong>en</strong>u <strong>au</strong>quel on r<strong>en</strong>once, sont des facteurs déterminants pour<br />
l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat. Les résultats de nos estimations t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t <strong>à</strong> sout<strong>en</strong>ir ce<br />
constat, <strong>en</strong> particulier <strong>en</strong> ce qui concerne les indép<strong>en</strong>dants et les<br />
travailleurs du secteur public. Ainsi, les indép<strong>en</strong>dants sont nettem<strong>en</strong>t plus<br />
<strong>en</strong>clins <strong>à</strong> se lancer dans la création que les <strong>au</strong>tres statuts. Il est égalem<strong>en</strong>t<br />
intéressant de constater que, ceteris paribus, les individus issus du secteur<br />
public prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> la création significativem<strong>en</strong>t inférieure<br />
<strong>à</strong> celle ces répondants occupant d’<strong>au</strong>tres types d’emploi.<br />
Par ailleurs, il ressort que la taille de l’organisme dans lequel l’activité<br />
professionnelle est exercée apparaît comme exerçant un effet négatif et<br />
significatif sur la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> la primo-création, ce qui fait écho <strong>au</strong>x<br />
trav<strong>au</strong>x de Garofoli (1994), Audretsch et Vivarelli (1996).<br />
En ce qui concerne le milieu familial d’origine, les résultats vari<strong>en</strong>t suivant<br />
les variables considérées. Le diplôme obt<strong>en</strong>u par les par<strong>en</strong>ts, tout comme<br />
le statut professionnel de la mère, n’apparaît pas influ<strong>en</strong>cer la probabilité<br />
de créer une <strong>en</strong>treprise. Par contre, le statut professionnel du père, pour<br />
<strong>au</strong>tant que celui-ci corresponde <strong>à</strong> une activité d’indép<strong>en</strong>dant ou un emploi<br />
de salarié dans le secteur public, a un impact positif et significatif sur la<br />
prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> créer une <strong>en</strong>treprise. Notons égalem<strong>en</strong>t que l’attitude de<br />
l’<strong>en</strong>tourage exerce une influ<strong>en</strong>ce sur la probabilité de création, une attitude<br />
défavorable ayant un effet négatif. Un individu <strong>au</strong>ra t<strong>en</strong>dance <strong>à</strong> avoir une<br />
probabilité plus faible <strong>à</strong> se lancer dans un processus de création si ce<br />
dernier doit faire face <strong>à</strong> d’importantes résistances <strong>au</strong> sein de son<br />
<strong>en</strong>tourage.<br />
Finalem<strong>en</strong>t, le fait que les individus soi<strong>en</strong>t averses <strong>au</strong> <strong>risque</strong> joue<br />
fortem<strong>en</strong>t sur leur prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> se lancer dans la création dès que l’on<br />
contrôle le caractère <strong>en</strong>dogène de la variable. Selon ce dernier résultat, les<br />
chances de création sont plus élevées chez les individus peu averses <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong>. Nonobstant la question de la mesure du <strong>risque</strong> adoptée pour notre<br />
29
analyse, nos résultats t<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t <strong>à</strong> conforter les trav<strong>au</strong>x mettant <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce<br />
la plus faible aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> des <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs.<br />
5. Conclusions<br />
Sur la base d’une <strong>en</strong>quête originale <strong>au</strong>près d’un <strong>en</strong>semble de primocréateurs<br />
d’<strong>en</strong>treprise et de candidats créateurs, nous nous sommes, dans<br />
un premier temps, attelés <strong>à</strong> brosser un table<strong>au</strong> général des freins <strong>à</strong> la<br />
primo-création tels que perçus par ces individus. La lecture de ce table<strong>au</strong><br />
nous a permis de mettre <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce que ce sont les facteurs d’ordre<br />
institutionnel qui constitu<strong>en</strong>t pour les primo-créateurs les freins les plus<br />
importants lors du processus de création. Près de deux tiers des créateurs<br />
considèr<strong>en</strong>t <strong>en</strong> effet que la lourdeur des démarches administratives, la<br />
faiblesse des structures d’aide <strong>à</strong> la création et la difficulté de l’accès <strong>à</strong><br />
l’emprunt sont des obstacles « importants » ou « très importants » <strong>à</strong> la<br />
création. Parallèlem<strong>en</strong>t, les résultats mett<strong>en</strong>t <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce que les freins ne<br />
se limit<strong>en</strong>t pas <strong>au</strong>x facteurs d’ordre institutionnel. En effet, il apparaît que<br />
d’<strong>au</strong>tres freins exist<strong>en</strong>t, par exemple, sur le plan individuel ou relationnel.<br />
Ainsi, sur le plan de l’individu, la crainte quant <strong>à</strong> la « faiblesse des moy<strong>en</strong>s<br />
financiers propres » ou la « crainte de l’instabilité des rev<strong>en</strong>us » est<br />
fréquemm<strong>en</strong>t mise <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce comme étant un frein « important » ou<br />
« très important ». Nous montrons égalem<strong>en</strong>t que les car<strong>en</strong>ces <strong>en</strong> matière<br />
de capital humain personnel ne sont pas perçues comme des <strong>barrière</strong>s<br />
importantes pour la création.<br />
Concernant les candidats <strong>à</strong> la création qui n’ont pas m<strong>en</strong>é leur projet <strong>à</strong><br />
terme, ces derniers ress<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t, comparativem<strong>en</strong>t <strong>au</strong>x primo-créateurs,<br />
plus int<strong>en</strong>sém<strong>en</strong>t l’<strong>en</strong>semble des freins <strong>à</strong> l’exception, toutefois, du frein<br />
relatif <strong>au</strong> « manque de main-d’œuvre qualifiée ».<br />
Dans un second temps, nous avons t<strong>en</strong>té d’éclairer les articulations <strong>en</strong>tre<br />
caractéristiques sociologiques individuelles, aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> et passage<br />
<strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise. Deux hypothèses sous-t<strong>en</strong>dai<strong>en</strong>t notre<br />
démarche : d’une part, celle portant sur une aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> plus faible<br />
chez les primo-créateurs et, d’<strong>au</strong>tre part, celle d’une influ<strong>en</strong>ce des<br />
caractéristiques des individus sur leur rapport <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, et, par voie de<br />
conséqu<strong>en</strong>ce, sur leur prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> s’<strong>en</strong>gager dans un processus de<br />
création d’<strong>en</strong>treprise.<br />
30
Malgré les limites des données utilisées, ces deux hypothèses se sont vues<br />
confirmées par nos analyses. Nos résultats préliminaires sont donc<br />
<strong>en</strong>courageants. Comme le soulign<strong>en</strong>t Cramer et al. (2002), trop peu<br />
d’études empiriques ont démontré que le nive<strong>au</strong> d’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> est<br />
plus faible chez les <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs ; non seulem<strong>en</strong>t notre analyse y parvi<strong>en</strong>t<br />
mais, <strong>en</strong> outre, elle met <strong>en</strong> évid<strong>en</strong>ce des articulations <strong>en</strong>tre aversion,<br />
position socio-économique et <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat tout <strong>en</strong> mettant <strong>en</strong> exergue<br />
les effets directs et indirects des variables explicatives sur l’aversion <strong>au</strong><br />
<strong>risque</strong>, d’une part, et la prop<strong>en</strong>sion <strong>à</strong> la primo-création, d’<strong>au</strong>tre part.<br />
Ces résultats demand<strong>en</strong>t sans nul doute <strong>à</strong> être approfondis. Il serait<br />
pertin<strong>en</strong>t de traiter l’év<strong>en</strong>tuel biais de sélection et de compléter les<br />
analyses <strong>en</strong> améliorant la mesure de l’aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>, par exemple <strong>en</strong><br />
utilisant des tests psychométriques. Il serait égalem<strong>en</strong>t intéressant<br />
d’introduire dans nos équations d’<strong>au</strong>tres déterminants. Comme nous<br />
l’avons précisé, il serait pertin<strong>en</strong>t de pr<strong>en</strong>dre <strong>en</strong> compte dans nos<br />
équations les freins r<strong>en</strong>contrés par les candidats créateurs et les primocréateurs<br />
lors du processus de création comme les freins financiers, les<br />
freins administratifs, etc. La prise <strong>en</strong> compte du type d’activité concerné<br />
par le projet de création serait égalem<strong>en</strong>t judicieuse car on peut poser<br />
l’hypothèse que, toute chose égale par ailleurs, la nature du projet peut<br />
influ<strong>en</strong>cer le nive<strong>au</strong> de <strong>risque</strong> attribué <strong>à</strong> celui-ci. En outre, dans une<br />
démarche similaire <strong>à</strong> celle que nous avons adoptée, on pourrait examiner<br />
les articulations <strong>en</strong>tre les caractéristiques individuelles, la nature du projet<br />
et l'aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong>. Ceci permettrait peut-être de mieux compr<strong>en</strong>dre,<br />
par exemple, pourquoi les hommes prés<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t une s<strong>en</strong>sibilité <strong>au</strong> <strong>risque</strong> lié<br />
<strong>au</strong> projet de création plus élevée que celle des femmes.<br />
Il serait égalem<strong>en</strong>t pertin<strong>en</strong>t de recourir <strong>à</strong> des méthodes qualitatives,<br />
mieux adaptées pour l’étude des logiques d’action des acteurs. Ces<br />
méthodes permettrai<strong>en</strong>t de mieux compr<strong>en</strong>dre, <strong>à</strong> la lumière de la<br />
composante id<strong>en</strong>titaire de ces logiques, les mécanismes de construction<br />
du <strong>risque</strong> et de la gestion de celui-ci chez les créateurs. C’est dans cette<br />
perspective que nous développons actuellem<strong>en</strong>t nos recherches.<br />
Malgré ces limites et le caractère exploratoire de ces analyses, leurs<br />
<strong>en</strong>jeux pour les décideurs publics sont multiples. Tout d’abord, dans la<br />
perspective d’un développem<strong>en</strong>t économique basé notamm<strong>en</strong>t sur la<br />
création et le développem<strong>en</strong>t de l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat, il est de plus <strong>en</strong> plus<br />
31
nécessaire d’id<strong>en</strong>tifier les facteurs clefs <strong>à</strong> l’origine de la création<br />
d’<strong>en</strong>treprises si l’on veut promouvoir et r<strong>en</strong>forcer celle-ci. Ensuite dans une<br />
perspective d’accompagnem<strong>en</strong>t des projets, il est important d’id<strong>en</strong>tifier les<br />
facteurs susceptibles d’agir comme des freins <strong>à</strong> la création afin d’assurer<br />
<strong>au</strong> mieux la concrétisation des projets. Enfin, les constats établis nous<br />
amèn<strong>en</strong>t <strong>à</strong> avancer l’idée, sur la base des résultats des <strong>en</strong>quêtes, que les<br />
actions publiques <strong>en</strong> vue de dynamiser l’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat ne devrai<strong>en</strong>t pas<br />
se limiter <strong>au</strong> champ de la formation mais viser <strong>au</strong>ssi le cadre institutionnel<br />
et les dim<strong>en</strong>sions financières du processus de création, la lourdeur des<br />
réglem<strong>en</strong>tations, la faiblesse des structures d’aide <strong>à</strong> la création et le poids<br />
des variables financières constituant les freins <strong>à</strong> la création perçus comme<br />
les plus importants.<br />
32
Référ<strong>en</strong>ces<br />
Acs Z., Audretsch D. (1989) “Small-Firm Entry in US Manufacturing”, Economica,<br />
56/222, pp. 255-265.<br />
Amblard H., Bernoux Ph., Herreros G., Livian Y.-F. (1996) Les nouvelles approches<br />
sociologiques des organisations, Paris, Seuil.<br />
Armington C., Acs Z.J. (2002) “The Determinants of Regional Variation in New<br />
Firm Formation”, Regional Studies, vol.36, n°1, pp. 33-45.<br />
Ashcroft B., Love J. H., Malloy E. (1991) “New Firm Formation in the British<br />
Counties with Special Refer<strong>en</strong>ce to Scotland”, Regional Studies, vol.25,<br />
n°5, pp. 395-409.<br />
Audretsch D., Vivarelli M. (1995) “New-firm formation in Italy: A first report”,<br />
Economics Letters, vol.48, pp. 77-81.<br />
Audretsch D.B. (1995) “Innovation and Industry Evolution”, The MIT Press,<br />
Cambridge. Mass.<br />
Austin J.S., Ros<strong>en</strong>b<strong>au</strong>m D.I. (1990) “The Determinants of Entry and Exit Rates Into<br />
U.S. Manufacturing Industries”, Review of Industrial Organization, vol. 2,<br />
n°5, pp. 211-221.<br />
Bartik T.J. (1989) “Small business start-ups in the United States: Estimates of the<br />
Effects of characteristcs of States”, Southern Economic Journal, 55, pp.<br />
1004-1018.<br />
Bernoux Ph. (1995) La sociologie des <strong>en</strong>treprises, Paris, Seuil.<br />
Blanchflower D., Oswald A., Stuzer A. (2001) “Lat<strong>en</strong>t Entrepr<strong>en</strong>eurship across<br />
nations”, European Economic Review, vol. 45, pp. 680-691.<br />
Blanchflower D.G., Oswald A.J. (1998) “What makes an <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eur?”, Journal of<br />
Labor Economics, vol. 16, n° 1, pp. 26-60.<br />
Bourdieu P. (1980) Questions de sociologie, Paris, Editions de Minuit.<br />
Bourdieu P. (1987) Choses dites, Paris, Editions de Minuit.<br />
Brockh<strong>au</strong>s R. H. (1980) “Risk Taking Prop<strong>en</strong>sity of Entrepr<strong>en</strong>eurs”, Academy of<br />
Managem<strong>en</strong>t Journal, vol. 23, pp. 509-520.<br />
Calay V., Capron H., Cincera M., Desmarez P., De Waeghe N., Greunz L., Guyot<br />
J.L., Houard J., Lohest O., Vandermott<strong>en</strong> C., Vandewattyne J., Van Hamme<br />
G. (2005) Les nouve<strong>au</strong>x créateurs d’<strong>en</strong>treprise <strong>en</strong> Région wallonne et les<br />
conditions de leur réussite, mimeo, Dulbea-ULB, Institut wallon de<br />
l’évaluation, de la prospective et de la statistique, Bruxelles-Jambes.<br />
Cantillon R. (1755) Essai sur la nature du commerce <strong>en</strong> général, Londres, Fetcher<br />
Gyler.<br />
Caputo R. K., Dolinsky A. (1998) “Wom<strong>en</strong>’s choice to pursue self-employm<strong>en</strong>t: The<br />
role of financial and human capital of household members”, Journal of<br />
Small Business Managem<strong>en</strong>t, vol. 36, pp. 8-17.<br />
Cincera M., Greunz L., Guyot J.L., Lohest O. (2005) “Trajectoires individuelles et<br />
profils de compét<strong>en</strong>ces : le cas des primo-créateurs d’<strong>en</strong>treprise wallon”,<br />
33
Relief - Echanges du Céreq, 8, mai 2005, pp. 267- 280<br />
Colombier N., D<strong>en</strong>ant-Boémont L., Loheac Y., Masclet D. (2005) “<strong>Une</strong> Etude<br />
expérim<strong>en</strong>tale du goût pour le risqué et pour l'<strong>au</strong>tonomie des travailleurs<br />
indép<strong>en</strong>dants”, working paper du CREM, R<strong>en</strong>nes.<br />
Cramer J. S., Hartog J., Jonker N., Van Praag M. (2002) “Low Risk Aversion<br />
Encourages the Choice for Entrepr<strong>en</strong>eurship: an Empirical Test of a<br />
Truism”, Journal of Economic Behavior and Organization, vol. 48, n° 1, pp.<br />
29-36.<br />
Crozier M. (1963) Le phénomène bure<strong>au</strong>cratique, Paris, Seuil.<br />
Dejardin M. (2000) “Entrepr<strong>en</strong>euriat et croissance, une conjonction évidemm<strong>en</strong>t<br />
favorable ?”, Reflets et perspectives de la vie économique, tome 34, 4, pp.<br />
19-31.<br />
Drucker P. (1985) Les <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs, trad. Franç., Paris, Hachette.<br />
Duestch L. (1984) “Entry and the Ext<strong>en</strong>t of Multiplant Operations”, Journal of<br />
Industrial Economics, vol. 32, June, pp. 477-488.<br />
Ekelund J., Johansson E., Jarvelin M.R., Lichtermann D. (2005) “Self-employm<strong>en</strong>t<br />
and risk aversion - evid<strong>en</strong>ce from psychological test data”, Labour<br />
Economics, 12, pp.649-659.<br />
Evans D.S., Leighton L.S. (1989) “Some Empirical Aspects of Entrepr<strong>en</strong>eurship”,<br />
The American Economic Review, vol.79, n° 3, pp.529-535.<br />
Evans L.B., Siegfried J.J. (1992) “Entry and Exit in United States Manufacturing<br />
Industries from 1977 to 1982” in Audretsch D.B., Siegfried J.J. (eds)<br />
Empirical Studies in Industrial Organization: Essays in Honor of Leonard W.<br />
Weiss, Kluwer Dordrecht, Academic Publishers Group, pp. 253-273.<br />
Ferguson P.R., Ferguson G.J. (1994) “Industrial Economics. Issues and<br />
Perspectives”, London, MacMillan.<br />
Fritsch M. (1992) “Regional Differ<strong>en</strong>ces in New Firm Formation: Evid<strong>en</strong>ce from<br />
West Germany”, Regional Studies, vol. 26, n° 3, pp. 233-241.<br />
Garofoli G. (1994) “New Firm Formation and Regional Developm<strong>en</strong>t: The Italian<br />
Case”, Regional Studies, vol.28, n° 4, pp. 381-393.<br />
Guyot J.L., Vandewattyne J. (2008) La création d’<strong>en</strong>treprise sous l’angle des<br />
logiques d’action, Working Paper, 1/2008, C<strong>en</strong>tre de Recherche Warocqué,<br />
Université de Mons-Hain<strong>au</strong>t, Mons.<br />
Hisrich R. D., Peters M. P. (1998) Entrepr<strong>en</strong>eurship, Chicago, Irwin.<br />
IFOP et Ag<strong>en</strong>ce pour la Création d’Entreprises (1998) “La création d’<strong>en</strong>treprise <strong>en</strong><br />
France”, Paris, APCE, mimeo.<br />
Jovanovic B. (1979) “Job Matching and the theory of turnover”, Journal of political<br />
Economy, vol. 87, n° 4, pp. 972-990.<br />
Juli<strong>en</strong> P. A., Marchesnay M. (1996) L’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>euriat, Paris, Economica.<br />
Kihlstrom R. E., Laffont J. J. (1979) “A G<strong>en</strong>eral Equilibrium Entrepr<strong>en</strong>eurial Theory<br />
of Firm Formation Based on Risk Aversion”, Journal of Political Economy,<br />
vol. 87, n° 4, pp. 719-748.<br />
34
Knight F. (1921) Risk, Uncertainty and Profit, New York, Houghton Mifflin.<br />
Le A.T. (1999) “Empirical Studies of Self-Employm<strong>en</strong>t”, Journal of Economic<br />
Surveys, vol. 13, n° 4, pp. 381-416.<br />
Libecap G.D. (Ed.) (1998) “Advances in the Study of Entrepr<strong>en</strong>eurship, Innovation<br />
and Economic Growth (vol. 10) Legal, Regulatory and Policy Changes that<br />
Affect Entrepr<strong>en</strong>eurial Midsize Firms”, Stamford - London, Jai Press.<br />
Maillat D. (1994) “Comportem<strong>en</strong>ts spati<strong>au</strong>x et milieux innovateurs” in Auray J.P.,<br />
Bailly A., Derycke P.H., Huriot J.M. (Eds) Encyclopédie d’économie spatiale,<br />
Paris, Economica, pp. 255-262.<br />
Maillat D. (1999) “Interactions <strong>en</strong>tre système urbain et système de production<br />
localisé” in Bailly A., Huriot J.M. (Eds.) Villes et croissance. Théories,<br />
modèles, perspectives, Paris, Anthropos, pp. 187-206.<br />
Massey D. (1995) “Spatial divisions of labour : Social structures and the<br />
geography of production”, London, Macmillan.<br />
McGrath R. G., MacMillan I. C., Scheinberg S. (1992) “Elitists, Risk-takers, and<br />
Rugged Individualists? An Exploratory Analysis of Cultural Differ<strong>en</strong>ces<br />
betwe<strong>en</strong> Entrepr<strong>en</strong>eurs and Non-<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurs”, Journal of Business<br />
V<strong>en</strong>turing, vol. 7, n° 2, pp. 115-135.<br />
Mukhopadhyay A.K. (1985) “Technological Progress and Change in the Market<br />
Conc<strong>en</strong>tration in the U.S., 1963-1977”, Southern Economic Journal, vol.<br />
52, pp. 141-149.<br />
Palich L., Bagby R. (1995) “Using cognitive theory to explain <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>eurial risktaking:<br />
chall<strong>en</strong>ging conv<strong>en</strong>tional wisdom”, Journal of Business V<strong>en</strong>turing,<br />
10, pp. 425-438.<br />
Reynolds P. (1997) “Who starts New firms? Preliminary explorations of Firms in<br />
gestation”, Small Business Economics, vol. 9, pp. 449-462.<br />
Ritsilä J., Tervo H. (2002) “Effects of <strong>Une</strong>mploym<strong>en</strong>t on New Firm Formation:<br />
Micro-level Panel Data Evid<strong>en</strong>ce from Finland”, Small Business Economics,<br />
vol. 19, pp. 31-40.<br />
Say J.B. (1841) Traité d’Economie politique ou simple exposition de la manière<br />
dont se form<strong>en</strong>t, se distribu<strong>en</strong>t et se consomm<strong>en</strong>t les richesses, Paris,<br />
Guill<strong>au</strong>min.<br />
Van de V<strong>en</strong> H. (1995) “The Developm<strong>en</strong>t of an Infrastructure for Entrepr<strong>en</strong>eurship”<br />
in Bull I., Willards G. (Eds) Entrepr<strong>en</strong>eurship: Perspectives on Theory<br />
Building, Oxford, Pergamon.<br />
Van Gelder<strong>en</strong> M., Bosma N., Thurik R. (2001) “Setting up a Business in the<br />
Netherlands: Who starts, who gives up, who is still trying?”, Research<br />
Report of the EIM business & Policy Research, pp. 1-39.<br />
Veltz P. (1993) “Logiques d’<strong>en</strong>treprise et territoires : les nouvelles règles du jeu” in<br />
Savy M., Veltz P. (Eds) Les nouve<strong>au</strong>x espaces de l’<strong>en</strong>treprise, Paris,<br />
Datar/éditions de l’<strong>au</strong>be.<br />
Vérin H. (1982) Entrepr<strong>en</strong>eurs, <strong>en</strong>treprise. Histoire d’une idée, Paris, PUF.<br />
35
Verzele F., Crijns H. (2001) “Les freins <strong>à</strong> la création d’<strong>en</strong>treprise”, Fondation Roi<br />
B<strong>au</strong>douin, Fonds Lionel Van d<strong>en</strong> Bossche. Bruxelles.<br />
Wooldridge J.M (2002), Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data,<br />
MIT Press, Ma.<br />
36
Annexe 1. Principales statistiques descriptives relatives <strong>au</strong>x freins et obstacles r<strong>en</strong>contrés<br />
par les primo-créateurs lors de la création d’<strong>en</strong>treprise<br />
Nombre<br />
d’observations<br />
Moy<strong>en</strong>ne Médiane Mode Minimum Maximum<br />
sur le plan personnel<br />
Crainte de l'instabilité des rev<strong>en</strong>us 529 1,79 2 1 1 4 0,90<br />
Expéri<strong>en</strong>ce, connaissances et/ou formations<br />
insuffisantes<br />
Ecart<br />
type<br />
526 1,31 1 1 1 4 0,60<br />
Faiblesse des moy<strong>en</strong>s financiers propres 527 1,79 2 1 1 4 0,89<br />
Manque de confiance <strong>en</strong> soi 526 1,22 1 1 1 4 0,47<br />
Problèmes de santé 524 1,08 1 1 1 4 0,32<br />
S<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d'être trop jeune / trop vieux 525 1,16 1 1 1 4 0,45<br />
S<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t de projet trop risqué 524 1,37 1 1 1 4 0,60<br />
Manque de temps 527 1,31 1 1 1 4 0,63<br />
sur le plan de l'<strong>en</strong>tourage<br />
Contraintes familiales 529 1,45 1 1 1 4 0,72<br />
Manque de conseil dans l'<strong>en</strong>tourage 526 1,21 1 1 1 4 0,55<br />
Manque de souti<strong>en</strong> dans l'<strong>en</strong>tourage 529 1,23 1 1 1 4 0,57<br />
Opposition du conjoint 527 1,15 1 1 1 4 0,46<br />
37
Nombre<br />
d’observations<br />
Moy<strong>en</strong>ne Médiane Mode Minimum Maximum<br />
sur le plan du contexte économique<br />
Concurr<strong>en</strong>ce importante / marché pot<strong>en</strong>tiel limité 529 1,69 1 1 1 4 0,84<br />
Contexte économique international défavorable 525 1,37 1 1 1 4 0,70<br />
Contexte économique local défavorable 528 1,56 1 1 1 4 0,82<br />
Manque de main-d'oeuvre qualifiée 527 1,45 1 1 1 4 0,84<br />
T<strong>au</strong>x d'intérêt élevés 524 1,46 1 1 1 4 0,83<br />
sur le plan du processus de création<br />
Démarches administratives trop lourdes 532 2,18 2 1 1 4 1,04<br />
Difficulté d'accès <strong>à</strong> l'emprunt 527 1,70 1 1 1 4 0,99<br />
Difficulté d'accès <strong>au</strong> capital <strong>à</strong> <strong>risque</strong> 513 1,56 1 1 1 4 0,94<br />
Faiblesse des structures d'aide <strong>à</strong> la création 525 1,86 1 1 1 4 1,07<br />
Importance des moy<strong>en</strong>s financiers requis 527 1,82 2 1 1 4 0,92<br />
Infrastructure(s) inadéquate(s) 522 1,30 1 1 1 4 0,66<br />
Réglem<strong>en</strong>tations lourdes 521 1,78 1 1 1 4 1,03<br />
Source : Calay et al. (2005 : 321) - Données <strong>IWEPS</strong> - Calculs DULBEA (Université libre de Bruxelles)<br />
Ecart<br />
type<br />
38
Annexe 2 : résultats du modèle Probit Bivarié<br />
Aversion <strong>au</strong> <strong>risque</strong> (projet<br />
trop risqué)<br />
Modèle 1 : Probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> Modèle 2 : Probabilité de créer une <strong>en</strong>treprise<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique<br />
(1 si l’individu est averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>)<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique (1 si l’individu est un<br />
primo-créateur)<br />
Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur<br />
- - - -2.458 0.142 0.000<br />
G<strong>en</strong>re (Masculin) 0.319 0.174 0.062 0.261 0.143 0.063<br />
Age -0.006 0.009 0.510 0.012 0.006 0.118<br />
Statut Prof de l’individu Indép<strong>en</strong>dant -0.537 0.180 0.003 0.897 0.189 0.000<br />
Statut Prof.<br />
Du Père<br />
Secteur Public 0.022 0.206 0.913 -0.439 0.171 0.010<br />
Père travaillant dans le<br />
secteur privé<br />
Père <strong>au</strong> foyer, chômeur ou<br />
retraité<br />
Père travaillant dans le<br />
secteur Public<br />
-0.839 0.192 0.000<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce**<br />
-0.711 0.249 0.004 0.386 0.209 0.065<br />
Père indép<strong>en</strong>dant -0.708 0.202 0.000 0.317 0.171 0.064<br />
-<br />
39
Statut Prof. De la<br />
Mère<br />
Attitude <strong>à</strong> l’égard<br />
De la création<br />
Mère travaillant dans le<br />
secteur privé<br />
Mère <strong>au</strong> foyer, chômeur ou<br />
retraitée<br />
Mère travaillant dans le<br />
secteur Public<br />
Modèle 1 : Probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> Modèle 2 : Probabilité de créer une <strong>en</strong>treprise<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique<br />
(1 si l’individu est averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>)<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique (1 si l’individu est un<br />
primo-créateur)<br />
Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur<br />
0.394 0.196 0.045<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce**<br />
-0.174 0.307 0.569 -0.116 0.210 0.583<br />
Mère indép<strong>en</strong>dante -0.002 0.284 0.993 0.042 0.261 0.872<br />
Pas d’avis - - -<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Attitude fam. défavorable - - - -0.310 0.155 0.045<br />
Attitude fam. favorable - - - 0.110 0.140 0.434<br />
40
Diplôme de<br />
L’individu<br />
Modèle 1 : Probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> Modèle 2 : Probabilité de créer une <strong>en</strong>treprise<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique<br />
(1 si l’individu est averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>)<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique (1 si l’individu est un<br />
primo-créateur)<br />
Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur<br />
Primaire + second. inf. -0.590 0.281 0.036 -0.555 0.242 0.022<br />
Secondaire sup.<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Supérieur + université 0.064 0.163 0.695 0.256 0.158 0.100<br />
Diplôme du Père Primaire + second. inf. 0.123 0.188 0.512 0.193 0.176 0.274<br />
Secondaire sup.<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Supérieur + université 0.092 0.193 0.632 --0.093 0.179 0.605<br />
Diplôme de la Mère Primaire + second. inf. 0.165 0.182 0.363 0.104 0.168 0.536<br />
Secondaire sup.<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
Supérieur + université -0.240 0.207 0.246 0.241 0.191 0.208<br />
41
Propriétaire ou<br />
Locataire<br />
Statut Familial<br />
Propriétaire<br />
Modèle 1 : Probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> Modèle 2 : Probabilité de créer une <strong>en</strong>treprise<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique<br />
(1 si l’individu est averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>)<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique (1 si l’individu est un<br />
primo-créateur)<br />
Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
0.178 0.095 0.061<br />
Locataire 0.246 0.154 0.102 - -<br />
Prés<strong>en</strong>ce d’indép<strong>en</strong>dants<br />
dans l’<strong>en</strong>tourage familial<br />
proche<br />
Couple<br />
- - -<br />
- - - -0.290 0.116 0.013<br />
Groupe de référ<strong>en</strong>ce<br />
- -<br />
Isolé sans <strong>en</strong>fants 0.219 0.187 0.242 - - -<br />
Isolé avec <strong>en</strong>fants 0.549 0.312 0.07 - - -<br />
Taille organisme - - - -0.224 0.054 0.000<br />
Rev<strong>en</strong>u m<strong>en</strong>suel net - - - 0.115 0.087 0.189<br />
Nbre de personnes <strong>à</strong> charge - - - 0.011 0.042 0.788<br />
Nature des rev<strong>en</strong>us Rev<strong>en</strong>u du chômage - - -0.836 0.247 0.000<br />
42
Modèle 1 : Probabilité d’être averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong> Modèle 2 : Probabilité de créer une <strong>en</strong>treprise<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique<br />
(1 si l’individu est averse <strong>au</strong> <strong>risque</strong>)<br />
Variable dép<strong>en</strong>dante dichotomique (1 si l’individu est un<br />
primo-créateur)<br />
Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur Coeffici<strong>en</strong>t Ecart-type* P-valeur<br />
Nat. Etrangère -0.833 0.313 0.008 0.333 0.252 0.186<br />
Né <strong>à</strong> l’étranger 0.282 0.269 0.294 -0.701 0.268 0.009<br />
Constante -0.766 0.432 0.07 -0.084 0.383 0.827<br />
ρ 0.847 0.135 0.001<br />
Test de Wald : ρ = 0<br />
0.000<br />
Log de Vraisemblance -393.638<br />
Nbre. Obs 493<br />
* Ecart type corrigé pour l’hétéroscédasticité, Ref= groupe de référ<strong>en</strong>ce, **Dans le cadre du modèle 2, certaines modalités ont été agrégées afin<br />
de constituer le groupe de référ<strong>en</strong>ce.<br />
43
Dans la même collection<br />
N° Auteurs Titre Date<br />
9301 Hecq A., Urbain J.-P. Misspecification Tests, Unit Roots and<br />
Level Shifts<br />
06/93<br />
9302 Docquier F. Transferts publics et transition<br />
démographique <strong>en</strong> Belgique : une<br />
approche par l'équilibre général<br />
07/93<br />
9303 Hecq A., IGARCH Effect on Autoregressive Lag<br />
L<strong>en</strong>gth Selection and C<strong>au</strong>sality Tests<br />
12/93<br />
9304 Hecq A. , Urbain J.P. Impact d'erreurs IGARCH sur les tests<br />
de racine unité<br />
12/93<br />
9401 Docquier F., Michel Ph. Education et croissance :<br />
conséqu<strong>en</strong>ces économiques d'un choc<br />
démographique<br />
01/94<br />
9402 Thisse J.-F. Concurr<strong>en</strong>ce sur le marché du travail,<br />
capitalisation foncière et<br />
développem<strong>en</strong>t régional<br />
02/94<br />
9403 R<strong>en</strong><strong>au</strong>lt E., Sekkat K., Testing for Spurious C<strong>au</strong>sality (with an 04/94<br />
Szafarz A.<br />
Application to Exchange Rates)<br />
9404 Scotchmer S., Thisse J.-F. Space in Theory of Value : Some Notes 04/94<br />
9405 Florês R<strong>en</strong>ato G., Szafarz<br />
A.<br />
An Enlarged Definition of Cointegration 06/94<br />
9406 Beine M. L'UEM <strong>à</strong> la lumière de la théorie des<br />
zones monétaires optimales : une<br />
revue de la littérature<br />
10/94<br />
9407 Hecq A. Unit Root Tests with Level Shift in the<br />
Pres<strong>en</strong>ce of GARCH<br />
12/94<br />
9501 Hecq A., Mahy B. Testing for the Price- and Wage-Setting<br />
Model in Belgium Using Multivariate<br />
Cointegration Tests<br />
01/95<br />
9502 Puig J.-P., Thisse J.-F., Enjeux économiques de l'organisation 03/95<br />
Jayet H.<br />
de l'espace français<br />
9503 Beine M., Hecq A. Codep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ce and Real Converg<strong>en</strong>ce :<br />
an Application to the EC Economies<br />
04/95<br />
9504 Bismans F., Docquier F. Critères d'<strong>en</strong>dettem<strong>en</strong>t public et<br />
vieillissem<strong>en</strong>t démographique<br />
10/95<br />
9505 Beine M., Hecq A. Testing for Long Run Productivity<br />
Adjusted PPP for the Rec<strong>en</strong>t Floating<br />
Period<br />
11/95<br />
9601 Docquier F. Optimal p<strong>en</strong>sion funding and b<strong>en</strong>efits in<br />
a small op<strong>en</strong> economy with savers and<br />
myopes<br />
01/96<br />
44
N° Auteurs Titre Date<br />
9602 Bismans F., Docquier F. Consommation, épargne et<br />
accumulation dans la transition<br />
démographique<br />
01/96<br />
9603 Drèze J., Guio A.-C., Mortality, Fertility and G<strong>en</strong>der Bias, The 02/96<br />
Murtyi M.<br />
Case of India<br />
9604 Hecq A., Mahy B. Testing for Long Run Wage<br />
Relationships in OECD Countries<br />
05/96<br />
9605 Beine M., Hecq A. Infer<strong>en</strong>ce in Codep<strong>en</strong>d<strong>en</strong>ce 09/96<br />
9606 Beine M., Docquier F. A stochastic simulation model of an<br />
optimum curr<strong>en</strong>cy area<br />
10/96<br />
9701 Docquier F. Réformer le système de retraite <strong>en</strong><br />
Belgique.<strong>Une</strong> question de solidarité<br />
inter et intra générationnelle<br />
01/97<br />
9702 Debuisson M. La diminution de la mortalité infantile<br />
dans les arrondissem<strong>en</strong>ts belges <strong>au</strong><br />
tournant du 20e siècle<br />
02/97<br />
9703 Ruyters C. Laffut M. La place des statistiques régionales<br />
dans le système statistique ,<br />
Application <strong>à</strong> l’emploi et <strong>à</strong> la population<br />
active<br />
02/97<br />
9704 Beine M. Docquier F. Fédéralisme fiscal dans un modèle de<br />
zone monétaire optimale<br />
04/97<br />
9705 Docquier F. Rapoport H. Are migrants really self-selected ? A<br />
note on the possibility of strategic<br />
remittances<br />
04/97<br />
9706 Docquier F. LiégeoisP. Comptabilité générationnelle et 09/97<br />
Stijns J.P.<br />
vieillissem<strong>en</strong>t, démographique : les<br />
<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts d’un modèle d’équilibre<br />
général calculable calibré pour la<br />
Belgique<br />
9707 Vander Stricht V. Les t<strong>au</strong>x de chômage <strong>en</strong> Belgique 10/97<br />
9708 Docquier F. , L<strong>au</strong>r<strong>en</strong>t S, Capital humain, emploi et rev<strong>en</strong>us du 11/97<br />
Perelman S.<br />
travail : Belgique, 1992<br />
9801 Beine M., Docquier F, Converg<strong>en</strong>ce des groupes : une 01/98<br />
Hecq A.<br />
analyse sur données régionales<br />
9802 Docquier F., Liegeois Ph. Simulating computable overlapping<br />
g<strong>en</strong>erations model with TROLL<br />
01/98<br />
9803 Beine M. L’union économique et monétaire <strong>à</strong> la<br />
lumière de la théorie des zones<br />
monétaires optimales : une revue de la<br />
littérature<br />
01/98<br />
45
N° Auteurs Titre Date<br />
9804 Debuisson M, Houard J.,<br />
Laffut M., Ruyters Ch.,<br />
Vander Stricht V., Lejeune<br />
D., Gavray C.,<br />
Le marché du travail <strong>en</strong> Wallonie 06/98<br />
9805 Beine M, Docquier F, Brain Drain and Economic<br />
06/98<br />
Rapoport H<br />
Developm<strong>en</strong>t : Theory and Evid<strong>en</strong>ce<br />
9806 Cattoir P., Docquier F., Finances Publiques, Solidarités 08/98<br />
Beine M<br />
Intergénérationnelle et Interrégionale :<br />
une Analyse Prospective<br />
9901 Guio-A.C., Weiserbs D. Dép<strong>en</strong>ses et Rev<strong>en</strong>us des ménages :<br />
Etude économétrique de l’<strong>en</strong>quête<br />
1995-96<br />
08/99<br />
9902 Beine-M. , Candelon B. , Stabilization Policy and Business Cycles 08/99<br />
Sekkat K.<br />
Phases in Europe : A Markov Switching<br />
Var Analysis<br />
9903 Guyot J.L. L’analyse statistique des populations<br />
scolaires : Prés<strong>en</strong>tation des principes<br />
de base<br />
09/99<br />
9904 Beine M. , Cal<strong>en</strong>don B. , Assessing a Perfect European Optimum 09/99<br />
Hecq A.<br />
Curr<strong>en</strong>cy Area : A Common Cycles<br />
Approach<br />
2001 Docquier F., Paddison O. Growth and Equality Effects of P<strong>en</strong>sion<br />
Plans<br />
10/00<br />
2002 Guyot JL Capital Humain : Perspective ou<br />
Prospective ?<br />
10/00<br />
2003 Broze L. , Gavray C. , Dualisme, Mobilité et Déterminants 07/00<br />
Ruyters C.<br />
Famili<strong>au</strong>x : <strong>Une</strong> Analyse des Transitions<br />
sur le Marché du Travail<br />
2004 De Broucker P. , Déterminants Scolaires et Analyse de la 11/00<br />
G<strong>en</strong>sbittel M.H. ,<br />
Mainguet C.<br />
Transition<br />
2005 De Wasseige Y., Laffut M., Bassins d’Emploi et Régions<br />
12/00<br />
Ruyters C., Schleiper P. Fonctionnelles Méthodologie et<br />
Définition des Bassins d’Emploi Belges<br />
0101 De Wasseige Y., Laffut M., Bassins d’Emploi et Régions<br />
02/01<br />
Ruyters C., Schleiper P. Fonctionnelles Méthodologie et<br />
Définition des Bassins d’Emploi<br />
Wallons<br />
0102 De Wasseige Y., Laffut M., Bassins d’Emploi et Régions<br />
03/01<br />
Ruyters C., Schleiper P. Fonctionnelles Inv<strong>en</strong>taire et Synthèse<br />
des Territoires Sous-Région<strong>au</strong>x<br />
0103 Lohest O., Van Haeper<strong>en</strong> Evaluation du Fonctionnem<strong>en</strong>t du 04/01<br />
B.<br />
Parcours d’Insertion <strong>en</strong> Région<br />
wallonne<br />
46
N° Auteurs Titre Date<br />
0104 Van Haeper<strong>en</strong> B. Pénuries de main-d’œuvre et <strong>au</strong>tres<br />
t<strong>en</strong>sions sur le marché du travail :<br />
quelques balises théoriques<br />
11/01<br />
0201 Guyot.JL., Van<br />
Entrepr<strong>en</strong>euriat et création<br />
05/02<br />
Rompaey.B.<br />
d’<strong>en</strong>treprise : Revue de la littérature et<br />
état de la recherche<br />
0202 Guio. A.C. La p<strong>au</strong>vreté <strong>en</strong> Belgique et <strong>en</strong> Wallonie 05/02<br />
0203 De Wasseige Y., Laffut M., Bassins d’Emploi et Régions<br />
05/02<br />
Ruyters C., Schleiper P. Fonctionnelles Elaboration d’une<br />
Vand<strong>en</strong> Door<strong>en</strong> L. Typologie Socio-Economique des<br />
Bassins d’emploi Wallons<br />
0204 Albessart C., Duprez J.P., Le Tissu Productif Wallon dans son 06/02<br />
Guyot J.L.<br />
Contexte National : une T<strong>en</strong>tative<br />
d’Analyse Démographique<br />
0205 Albessart C. , Duprez J.P., Structure et Dynamique du Tissu 06/02<br />
Guyot J.L<br />
Productif Wallon : une Approche<br />
Démographique<br />
0206 Lambert A. Des Dynamiques Economiques et<br />
Démographiques Génératrices de<br />
Viol<strong>en</strong>ce ? Petites Réflexions <strong>à</strong> partir du<br />
cas du Pakistan<br />
07/02<br />
0208 Deprez A. Compét<strong>en</strong>ces et Qualifications<br />
Mise <strong>en</strong> perspective et positions<br />
d’acteurs<br />
08/02<br />
0401 Guio-A.C. La p<strong>au</strong>vreté monétaire <strong>en</strong> Belgique, <strong>en</strong><br />
Flandre et <strong>en</strong> Wallonie<br />
02/04<br />
0402 Debuisson M., Docquier Immigration and adging in the Belgian 03/04<br />
F., Noury A., Nantcho M. regions<br />
0403 Van Haeper<strong>en</strong> B. Formes d’emploi et durée du travail :<br />
évolution comparée de la Belgique, de<br />
ses régions et des pays voisins <strong>au</strong><br />
cours de la période 1992-2002<br />
08/04<br />
0404 Cardelli R., Nibona M. Les trajectoires professionnelles des<br />
salariés des secteurs industriels <strong>en</strong><br />
Région wallonne : de la précarité de<br />
l’emploi <strong>à</strong> l’insatisfaction du travail<br />
10/04<br />
0501 Weickmans G.,<br />
<strong>Une</strong> estimation des dép<strong>en</strong>ses publiques 01/05<br />
Deschamps R.<br />
de formation professionnelle continue<br />
<strong>en</strong> Belgique<br />
0502 Dussart L., Lefèvre M. L’id<strong>en</strong>tification des crédits budgétaires<br />
publics affectés <strong>à</strong> la recherche &<br />
développem<strong>en</strong>t : regard critique <strong>au</strong><br />
départ du cas de la Région wallonne<br />
01/05<br />
47
N° Auteurs Titre Date<br />
0503 Callay V., Guyot J.L., Primo-créateurs d’<strong>en</strong>treprise et 09/05<br />
Vanhamme G.<br />
contextes loc<strong>au</strong>x : analyse empirique<br />
de la situation wallonne<br />
0504 De Wasseige Y., Laffut M., Bassins d’emploi et régions<br />
11/05<br />
Ruyters C., Vand<strong>en</strong> fonctionnelles<br />
Door<strong>en</strong> L.<br />
Analyse structurelle des bassins<br />
d’emploi majeurs <strong>en</strong> Région wallonne :<br />
évolution de l’emploi salarié <strong>en</strong>tre 1993<br />
et 2002<br />
0505 A. Baye, G. Hindrickx, C. Mesurer la transition <strong>en</strong>tre l’école et la 12/05<br />
Libon et S. Jaspar vie active <strong>en</strong> Wallonie : Cadre<br />
conceptuel et canevas d’indicateurs<br />
internation<strong>au</strong>x<br />
0601 Ruyters C., Vander Stricht Estimation de la population active par 08/06<br />
V., Vand<strong>en</strong> Door<strong>en</strong> L. commune : 30 juin 2003 et 2004<br />
0602 Lefèvre M.,<br />
Evaluation des couveuses<br />
11/06<br />
Van Haeper<strong>en</strong> B. d’<strong>en</strong>treprises, des<br />
coopératives d’activités et des<br />
incubateurs <strong>en</strong><br />
économie sociale <strong>en</strong> Région wallonne<br />
0604 Guio A.C. P<strong>au</strong>vreté monétaire <strong>en</strong> Belgique, <strong>en</strong><br />
Flandre et<br />
<strong>en</strong> Wallonie<br />
11/06<br />
0701 Collet S., Weickmans G., <strong>Une</strong> estimation des dép<strong>en</strong>ses publiques 02/07<br />
Deschamps R.<br />
d’emploi et de formation<br />
professionnelle continue <strong>en</strong> Wallonie<br />
0702 Eggerickx T., Debuisson Le baromètre des conditions de vie 04/07<br />
M., Hermia J.P., dans les communes bruxelloises et<br />
Sanderson J.P. et Vander<br />
Stricht V.<br />
wallonnes<br />
0703 V. Vander Stricht Les estimations de la population active 08/07<br />
L. Vand<strong>en</strong> Door<strong>en</strong> par commune : une pièce importante<br />
dans le puzzle des statistiques du<br />
marché du travail<br />
0704 Dussart L. Dégradation de la « clé IPP » pour la<br />
Wallonie : t<strong>en</strong>tative d’interprétation <strong>au</strong><br />
regard de l’évolution et de la<br />
composition du rev<strong>en</strong>u imposable <strong>à</strong><br />
l’impôt des personnes physiques<br />
09/07<br />
48