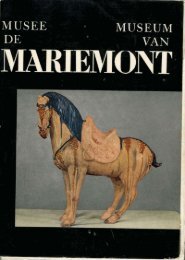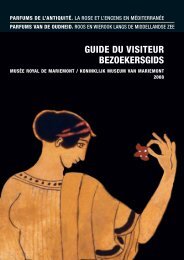Mémoires d'Orient. Du Hainaut à Héliopolis - Musée Royal de ...
Mémoires d'Orient. Du Hainaut à Héliopolis - Musée Royal de ...
Mémoires d'Orient. Du Hainaut à Héliopolis - Musée Royal de ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Émile PRISSE d’AVESNES (Avesnes 1807 – Paris 1879)<br />
Destiné initialement <strong>à</strong> une carrière au barreau qui ne lui plait guère, Émile Prisse d’Avesnes<br />
fait ses étu<strong>de</strong>s <strong>à</strong> l’École royale d’Arts et Métiers <strong>de</strong> Paris. Il perd son père en 1814, son<br />
grand-père maternel en 1815. Le décès <strong>de</strong> son grand-père paternel en 1826 le laisse pauvre<br />
et orphelin.<br />
Il prend alors part <strong>à</strong> la guerre d’indépendance <strong>de</strong> la Grèce contre l’occupant turc et occupe<br />
ensuite le poste <strong>de</strong> secrétaire du gouverneur général <strong>de</strong>s In<strong>de</strong>s. Après avoir démissionné,<br />
il part en Palestine et est nommé chevalier du Saint-Sépulcre pour avoir sauvé le temple <strong>de</strong><br />
Jérusalem.<br />
De 1827 <strong>à</strong> 1844, on le retrouve en Égypte et en Nubie qu’il parcourt et explore. Le vice-roi<br />
d’Égypte, Mohamed-Ali, dont il gagne l’estime, lui confie les fonctions d’ingénieur civil et<br />
d’hydrographe, <strong>de</strong> professeur <strong>de</strong> topographie <strong>à</strong> l’École <strong>de</strong> la marine. Il <strong>de</strong>vient aussi professeur<br />
<strong>de</strong> fortifications <strong>à</strong> l’École d’infanterie <strong>de</strong> Damiette et gouverneur <strong>de</strong>s jeunes Princes,<br />
enfants d’Ibrahim Pacha, fils <strong>de</strong> Mohamed-Ali. Dès 1836, il renonce <strong>à</strong> ces fonctions officielles<br />
pour s’adonner exclusivement <strong>à</strong> sa passion, l’égyptologie.<br />
<strong>Du</strong>rant les dix-sept années <strong>de</strong> son séjour en Orient, il parcourt, sous le nom d’Idris effendi,<br />
la Turquie, la Perse, la Palestine, l’Arabie, la Haute et Basse-Égypte, la Nubie, l’Éthiopie,<br />
l’Abyssinie, la Syrie et recueille une abondante moisson d’inestimables trésors qui viennent<br />
enrichir le patrimoine français. On peut ainsi admirer au Louvre la « chambre <strong>de</strong>s rois » ou<br />
« salle <strong>de</strong>s ancêtres » <strong>de</strong> Thoutmosis III et la « Stèle <strong>de</strong> Bakhtan ». À la bibliothèque<br />
royale, il donne un papyrus mis au jour <strong>à</strong> Thèbes et vieux <strong>de</strong> 4.600 ans. Il rentre au pays<br />
en 1844. De ses voyages, il ramène d’innombrables documents, <strong>de</strong>ssins, aquarelles, photographies,<br />
plans, croquis et <strong>de</strong> retour en France, publie une quantité <strong>de</strong> mémoires, <strong>de</strong> notices.<br />
On lui doit aussi l’une <strong>de</strong>s premières <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong> l’époque d’Akhénaton<br />
découvert sur <strong>de</strong>s blocs <strong>de</strong> pierre remployés <strong>à</strong> Karnak.<br />
Envoyé en mission scientifique par Napoléon III, il retourne en Égypte <strong>de</strong> 1858 <strong>à</strong> 1860, accompagné<br />
d’A. Jarrot, un jeune photographe. Il revient avec un véritable reportage, trois<br />
cents nouveaux <strong>de</strong>ssins, huit mètres <strong>de</strong> calques et <strong>de</strong> nombreuses photos.<br />
On retiendra également <strong>de</strong> lui trois œuvres maitresses : Les monuments égyptiens (1847),<br />
Histoire <strong>de</strong> l’art égyptien d’après les monuments <strong>de</strong>puis les temps les plus reculés jusqu’<strong>à</strong><br />
la domination romaine (1858-1879) et L’Art arabe d’après les monuments du Kaire (1877).<br />
Ces éditions d’envergure, en grand format, sont illustrées par <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins et <strong>de</strong>s estampes<br />
<strong>de</strong>s reliefs réalisés par Prisse d’Avesnnes.<br />
Ogier Ghiselin <strong>de</strong> BUSBECQ (1522 – 1592)<br />
Ogier Ghiselin <strong>de</strong> Busbecq fait <strong>de</strong> brillantes étu<strong>de</strong>s <strong>à</strong> l’université <strong>de</strong> Louvain. Il part ensuite<br />
fréquenter plusieurs universités <strong>de</strong> France et d’Italie. Grand érudit, il parle sept langues, le<br />
latin, l’italien, l’espagnol, le français, l’allemand, le flamand et l’esclavon, langue slave utilisée<br />
<strong>de</strong> la Pologne <strong>à</strong> la Bulgarie.<br />
En 1554, il est envoyé par Ferdinand I er d’Autriche comme ambassa<strong>de</strong>ur auprès <strong>de</strong> Soliman<br />
II dit le Magnifique. Il le rejoint <strong>à</strong> Amasya, en Turquie, après un périple qui lui fait traverser<br />
la Basse-Hongrie, la Serbie, la Bulgarie et la Thrace. Il est fort mal accueilli par le<br />
sultan.<br />
En novembre 1555, Ogier <strong>de</strong> Busbecq retourne en Turquie. Il arrive <strong>à</strong> Istanbul au commencement<br />
<strong>de</strong> 1556. Pendant ce séjour, il est en butte <strong>à</strong> <strong>de</strong>s menaces terribles. Confiné dans<br />
une étroite prison et privé <strong>de</strong> visite, contraint <strong>de</strong> rester en ville quand la peste sévit, luttant<br />
sans cesse contre les tracasseries infligées par la diplomatie française et le mauvais vouloir<br />
<strong>de</strong>s ministres <strong>de</strong> la Sublime Porte, il s’obstine. Malgré ces déboires, son travail <strong>de</strong> diplomate<br />
amène <strong>à</strong> une trêve <strong>de</strong> huit ans entre l’empereur Ferdinand et Soliman II et <strong>à</strong> la libération<br />
<strong>de</strong> trois capitaines.<br />
Il quitte Istanbul <strong>à</strong> la fin du mois d’août 1562. À partir <strong>de</strong> 1563, il mène une carrière <strong>de</strong><br />
courtisan dans nos contrées. Il occupe la fonction <strong>de</strong> précepteur <strong>de</strong> l’archiduc Albert, <strong>de</strong><br />
préfet <strong>de</strong> la Bibliothèque impériale, <strong>de</strong> majordome <strong>de</strong> l’archiduchesse, Elisabeth d’Autriche,<br />
<strong>de</strong>venue reine <strong>de</strong> France.<br />
Ses missions d’ambassa<strong>de</strong> l’amènent <strong>à</strong> découvrir en Orient diverses plantes qu’il va ramener<br />
dans nos contrées, notamment la tulipe, le lilas et le marronnier d’In<strong>de</strong>. Il offre <strong>de</strong>s semences<br />
<strong>de</strong> tulipes <strong>à</strong> Charles <strong>de</strong> l’Écluse qui les met en culture et les étudie dans ses ouvrages.<br />
Dans le Rarorium plantarum historia <strong>de</strong> 1601, il ne consacre pas moins <strong>de</strong> quinze<br />
pages <strong>à</strong> cette plante et plus <strong>de</strong> vingt gravures.<br />
Outre sa contribution <strong>à</strong> la botanique, c’est grâce <strong>à</strong> lui que la bibliothèque impériale <strong>de</strong><br />
Vienne s’enrichit <strong>de</strong> manuscrits grecs et <strong>de</strong> médailles antiques acquises lors <strong>de</strong> ses séjours<br />
en Turquie. Il communique au mon<strong>de</strong> savant <strong>de</strong> l’époque quantité d’inscriptions grecques<br />
qu’il a le loisir d’observer au cours <strong>de</strong> ses pérégrinations.<br />
Il laisse <strong>de</strong>s récits <strong>de</strong> ses voyages et <strong>de</strong> ses missions en tant qu’ambassa<strong>de</strong>ur. Quatre lettres<br />
en latin sont publiées. Ces lettres, agrémentées <strong>de</strong> l’opuscule De re militari contra Turcas<br />
et <strong>de</strong> l’allocution adressée <strong>à</strong> Ferdinand I er , en 1562, par l’envoyé du sultan, Ibrahim<br />
Strozeni sont traduites en français en 1748 par Louis-Etienne <strong>de</strong> Foy, chanoine <strong>de</strong> Meaux,<br />
qui y ajoute <strong>de</strong> nombreuses notes historiques et géographiques.