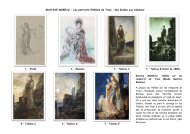Extrait 1 - FONTENELLE, Entretiens sur la pluralité des ... - proplus
Extrait 1 - FONTENELLE, Entretiens sur la pluralité des ... - proplus
Extrait 1 - FONTENELLE, Entretiens sur la pluralité des ... - proplus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
NewValues – Isabelle Roquemaure<br />
[Niveau Première]<br />
<strong>Extrait</strong> 1 - <strong>FONTENELLE</strong>, <strong>Entretiens</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>pluralité</strong> <strong>des</strong> mon<strong>des</strong> – 4 ème soir (« Ah !, Madame…qu’on doit avoir »)<br />
Thème 1 : Exposé scientifique – Théorie <strong>des</strong> tourbillons<br />
de Descartes appliquée à l’astronomie<br />
Répétition du mot-clé : tourbillon – Thème essentiel du texte ; mot<br />
polysémique (plusieurs sens) : sens scientifique / mais aussi<br />
métaphorique (tourbillon de l’amour = thème 2) et philosophique<br />
(tourbillon du pouvoir = thème 3) /<br />
Champ lexical de l’astronomie : [Vénus, Mercure, Mars, Jupiter,<br />
Saturne, Terre, p<strong>la</strong>nètes, Soleil, Lune, étoiles, céleste,<br />
Référence à Descartes (Physicien, mathématicien et philosophe) :<br />
vulgarisation de son œuvre, Théorie <strong>des</strong> tourbillons qui vient d’être<br />
publiée héliocentrisme + itération de ce système à tous les<br />
niveaux : système so<strong>la</strong>ire, ga<strong>la</strong>xie… (notion de quantité)<br />
Expressions utilisées pour introduire une définition : « Ce qu’on<br />
appelle un tourbillon… » « un tourbillon, c’est… » « Voilà quel est le<br />
grand tourbillon… » - Définition <strong>des</strong> tourbillons : « une infinité de<br />
petites parties d’air » (périphrase explicative)<br />
Répétition de « matière » : terme de physique – terme-clé de <strong>la</strong><br />
philosophie matérialiste selon <strong>la</strong>quelle toute vie est faite de <strong>la</strong><br />
même « matière » (libertinage de pensée ≠ créationnisme)<br />
Répétition du terme « mouvement » + champ lexical [se meuvent –<br />
agitation – tourne, tourner ) : <strong>des</strong>cription du phénomène physique<br />
dynamique : dép<strong>la</strong>cement et rotation géométrique<br />
Utilisation <strong>des</strong> connecteurs logiques : [ainsi – parce que – mais – si –<br />
au lieu que] discours argumentatif<br />
Discours didactique professeur / élève : « si vous saviez… » « il est<br />
beau de savoir » « croyez-vous… ? » « il est vrai que… » « dont je<br />
commençai à vous parler… »<br />
TR : le discours de Fontenelle est didactique ; il expose à <strong>la</strong><br />
Marquise une théorie récente en employant le vocabu<strong>la</strong>ire<br />
adéquat pour qu’elle le comprenne, mais en mê<strong>la</strong>nt son<br />
enseignement de métaphores p<strong>la</strong>isantes <strong>des</strong>tinées à faciliter son<br />
enseignement.<br />
Thème 2 : Evocation métaphorique de <strong>la</strong> cour<br />
qu’effectuent les hommes auprès <strong>des</strong> femmes<br />
qu’ils courtisent<br />
Antithèse : « si terrible » ≠ « si agréable »<br />
caractérisation de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion amoureuse <br />
métaphore de <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion amoureuse = tourbillon qui<br />
emporte les êtres humains « pour le meilleur et pour le<br />
pire » (personnification <strong>des</strong> p<strong>la</strong>nètes et <strong>des</strong> astres)s<br />
Re<strong>la</strong>tion intime : « Ah ! Madame » « donnons-nous… »<br />
« en riant » ambigüité présente dans les paroles de<br />
<strong>la</strong> Marquise : vocabu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> passion amoureuse (« <strong>la</strong><br />
tête… me tourne » - « achevez de me rendre folle » -<br />
« je ne me ménage plus » - « plus de retenue » -<br />
« donnons-nous »…) + lyrisme (ponctuation expressive)<br />
« emportement » + allusion à <strong>la</strong> passion amoureuse<br />
qu’elle devrait éprouver pour lui : « c’est dommage…<br />
pour objet » (et non pas lui…)<br />
Champ lexical de <strong>la</strong> valse : (tourbillon, tourner, en rond,<br />
en un même sens] mime le mouvement universel <strong>des</strong><br />
hommes autour <strong>des</strong> femmes : <strong>la</strong> « danse » de <strong>la</strong><br />
séduction attraction = désir<br />
Position centrale de <strong>la</strong> femme : comparaison avec le<br />
soleil (« milieu », « entre ») métaphore précieuse :<br />
beauté qui rayonne et attire tous les regards<br />
En même temps, critique voilée de <strong>la</strong> vanité féminine<br />
qui se centre <strong>sur</strong> sa propre personne (« autour d’elle »,<br />
« <strong>sur</strong> elle-même »)<br />
Idée d’emprisonnement de l’homme dans l’aura<br />
féminine : vision du couple (« enveloppement »,<br />
« renferme », « engloutis ») + préposition « en »,<br />
« dans » + vocabu<strong>la</strong>ire de l’anéantissement :<br />
« emportant avec soi », « tombe », « emportée par »…<br />
TR : De façon implicite, le philosophe fait allusion<br />
au pouvoir qu’ont les femmes de mener les homes selon<br />
leur volonté (principes courtois et précieux) f<strong>la</strong>tte<br />
<strong>la</strong> vanité de <strong>la</strong> Marquise pour obtenir son attention et<br />
susciter sa réflexion.<br />
[Evaluation – Bac B<strong>la</strong>nc]<br />
Thème 3 : Représentation symbolique de <strong>la</strong><br />
société – re<strong>la</strong>tions de pouvoir et de hiérarchie à<br />
tous les niveaux<br />
Domination <strong>des</strong> puissants <strong>sur</strong> les faibles champ lexical<br />
du pouvoir : [domine - maître – puissant] + verbes<br />
d’obligation : [les fait tourner – veut – il faut que –<br />
forcés à – assujettit – permis]<br />
≠ Vocabu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> soumission : [dépendance – suivre x3]<br />
+ termes dépréciatifs : « moindre », « petit/petites »,<br />
« ne serions que… »<br />
Analogie entre le soleil et le Roi Soleil (= Louis XIV) <br />
symbole de <strong>la</strong> monarchie absolue, centre du pouvoir<br />
De + : « tourbillons » en // avec les courtisans<br />
o Gravitent autour du roi<br />
o Ont une liberté « particulière » mais doivent<br />
obéir au Roi : restent dans sa « sphère<br />
d’influence » qui les limite<br />
o Ont eux-mêmes leur propre cour hiérarchie,<br />
ils reproduisent le schéma à leur échelle<br />
Le fonctionnement de l’univers figure celui de <strong>la</strong><br />
société : « grands amas de matière céleste » -<br />
« matières céleste » subtilité, agitation incessante de<br />
ses constituants (= le peuple)<br />
« Jupiter » = allégorie allusion à une puissance<br />
étrangère (germanique ?) qui pourrait altérer <strong>la</strong> liberté<br />
de <strong>la</strong> France conseil : il faut se tenir éloigné <strong>des</strong><br />
sources de pouvoir si on veut garder son autonomie (≠<br />
force d’attraction) leçon de stratégie // Europe<br />
Morale (phrase finale) : on est heureux ou malheureux<br />
selon <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce qu’on occupe dans <strong>la</strong> société : fatalisme lié<br />
à l’astrologie (« fortune » de <strong>la</strong> naissance) + présent de<br />
vérité générale<br />
SY : F. montre <strong>la</strong> société de son temps comme un<br />
microcosme de l’Univers (macrocosme) [voir <strong>Extrait</strong> 2]<br />
et en profite pour en analyser, voire critiquer<br />
implicitement l’organisation et les principes <br />
précurseur <strong>des</strong> Lumières
NewValues – Isabelle Roquemaure<br />
[Niveau Première]<br />
<strong>Extrait</strong> 2 - <strong>FONTENELLE</strong>, <strong>Entretiens</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>pluralité</strong> <strong>des</strong> mon<strong>des</strong> – 4 ème soir (« Nous en étions à Vénus »)<br />
Thème 1 : Exposé scientifique – Etude comparée <strong>des</strong><br />
p<strong>la</strong>nètes Vénus, Mercure et <strong>la</strong> Terre<br />
Champ lexical de l’observation : [astronomes – lunettes d’approche<br />
– voir x8 – observer – distinguer – paraître]<br />
Vocabu<strong>la</strong>ire scientifique de l’astronomie : [p<strong>la</strong>nète/p<strong>la</strong>nètes – Vénus<br />
– Mercure – Terre – Soleil – firmament]<br />
Expressions spécifiques : « tourne <strong>sur</strong> elle-même » - « <strong>sur</strong> son<br />
centre »<br />
Thème : <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e du temps et de l’espace<br />
o Le temps : [temps, mois, jours, années] + idée de durée :<br />
« huit mois » - « trois mois » - « en peu de temps »<br />
o L’espace : « deux tiers de <strong>la</strong> distance » - « proche » //<br />
« de près » ≠ « de loin »<br />
Vocabu<strong>la</strong>ire didactique : re<strong>la</strong>tion de maître à élève entre le<br />
philosophe et <strong>la</strong> marquise – « est bien sûr » « saviez-vous que… ? »<br />
+ emploi du conditionnel (exposé d’une hypothèse : « si… »)<br />
+ modalisation : « sans doute » - « peut-être » - « apparemment » -<br />
« je crois » - « doivent »<br />
Comparaison <strong>des</strong> habitants avec ceux de <strong>la</strong> terre (anthropologie)<br />
o Vénus « Mores grenadins » - « Petit peuple noir » -<br />
« brûlé du soleil »<br />
o Mercure « Africains du Sud » - « fous de vivacité »<br />
Illustration de <strong>la</strong> théorie <strong>des</strong> climats<br />
Un exposé de type argumentatif : structure apparente, composée<br />
de deux gran<strong>des</strong> parties en antithèse (« mais ») une sorte de<br />
dissertation orale avec thèse et antithèse<br />
TR : Le philosophe propose une sorte de leçon à <strong>la</strong> Marquise<br />
<strong>sur</strong> le thème de l’astronomie, en y mê<strong>la</strong>nt <strong>des</strong> théories alors à <strong>la</strong><br />
mode comme <strong>la</strong> théorie <strong>des</strong> climats, en choisissant bien sûr une<br />
p<strong>la</strong>nète particulière : Vénus, qui lui permettra de tenir un<br />
<strong>la</strong>ngage plus ga<strong>la</strong>nt<br />
Thème 2 : Conversation ga<strong>la</strong>nte - Vénus et<br />
Mercure, p<strong>la</strong>nètes « chau<strong>des</strong> » qui représentent<br />
<strong>la</strong> passion amoureuse<br />
Vénus : nom d’une p<strong>la</strong>nète d’après le nom mythologique<br />
de <strong>la</strong> déesse de <strong>la</strong> beauté (= Aphrodite), mère de<br />
l’amour (le dieu Cupidon = Eros) allégorie<br />
Vénus : incite les hommes au péché (exemple implicite<br />
de Pâris, le héros troyen ayant enlevé Hélène et<br />
provoqué <strong>la</strong> guerre de Troie) : histoire très connue <strong>des</strong><br />
c<strong>la</strong>ssiques allusion culturelle<br />
Vénus = étoile du berger (périphrase) : étoile <strong>la</strong><br />
première levée le soir, <strong>la</strong> plus bril<strong>la</strong>nte, celle qui guide<br />
les marins et protège les amoureux<br />
Personnification de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète Vénus + caractérisation<br />
paradoxale :<br />
o « de loin » : positive : [jolie – c<strong>la</strong>ire – bril<strong>la</strong>nte – air<br />
ga<strong>la</strong>nt – éc<strong>la</strong>t – vivacité – agréable]<br />
o « de près » : négative : [affreuse – sèches è<br />
pointues]<br />
// avec <strong>la</strong> femme en général (point de vue<br />
« machiste » qui est fait pour choquer <strong>la</strong> Marquise…)<br />
Habitants de Vénus : perfection de courtoisie avec <strong>des</strong><br />
qualités physiques (énergie, vivacité) et intellectuelles<br />
(esprit, imagination)<br />
≠ Habitants de Mercure : trop près du Soleil <br />
exécrables, défauts physiques (animalité, sauvagerie,<br />
réflexes) et mentaux (absence de réflexion et de<br />
raison) folie : « petites maisons » (= asiles)<br />
Allusion à <strong>la</strong> préciosité : le roman l’Astrée d’Honoré<br />
d’Urfé (amours de bergers et de bergères : Cé<strong>la</strong>don,<br />
Silvandre, Clélie]<br />
TR : La p<strong>la</strong>nète Vénus est donc présente sous ses<br />
différents aspects, avec toujours une connotation<br />
sensuelle et amoureuse ; le philosophe va jusqu’à<br />
proposer <strong>des</strong> idées un peu « choquantes » pour<br />
intéresser <strong>la</strong> Marquise…<br />
[Evaluation – Bac B<strong>la</strong>nc]<br />
Thème 3 : Réflexion philosophique – La re<strong>la</strong>tivité<br />
<strong>des</strong> points de vue entraîne un changement d’opinion<br />
appel à <strong>la</strong> tolérance<br />
Référence à <strong>des</strong> éléments terrestres analogies avec<br />
<strong>des</strong> éléments extra-terrestres<br />
o « habitants<br />
Mores… »<br />
de Vénus ressemblent aux<br />
o « nos Mores grenadins … Lapons »<br />
o « chaleur … Afrique … g<strong>la</strong>ciation »<br />
Structures super<strong>la</strong>tives hyperboles :<br />
o « les plus communes » ≠ « les plus belles »<br />
o « plus beaux jours » ≠ « très faibles<br />
crépuscules »<br />
o « les plus c<strong>la</strong>ires que l’on connaisse »<br />
comparaison par rapport à un ensemble<br />
Différences de point de vue : « de près » ≠ « de loin » /<br />
« ici » ≠ « chez eux » re<strong>la</strong>tivité <strong>des</strong> opinions d’un<br />
monde à un autre<br />
Nombreuses structures comparatives :<br />
o « grosses comme <strong>la</strong> terre » (égalité)<br />
o « plus petites » - « plus vives » - « plus de<br />
chaleur » (comparatif de supériorité)<br />
o absence de comparatif d’infériorité<br />
Utilisation de chiasmes (système antithétique ABBA) –<br />
pour mettre en re<strong>la</strong>tion les p<strong>la</strong>nètes et renverser le<br />
point de vue :<br />
Terre (A) Vénus<br />
Vénus (B) « nous paraît »<br />
« pour nous »<br />
<br />
SY : Toutes ces comparaisons permettent à<br />
Fontenelle de nous faire réfléchir (avec ses<br />
personnages) <strong>sur</strong> l’idée de re<strong>la</strong>tivité (voir <strong>la</strong> même idée<br />
dans Micromégas) qui apparaît à partir de <strong>la</strong> révolution<br />
copernicienne
NewValues – Isabelle Roquemaure<br />
[Niveau Première]<br />
<strong>Extrait</strong> 3 - Support : <strong>FONTENELLE</strong>, <strong>Entretiens</strong> <strong>sur</strong> <strong>la</strong> <strong>pluralité</strong> <strong>des</strong> mon<strong>des</strong> – 6 ème soir (« Cependant…de <strong>la</strong> Lune »)<br />
Thème 1 : Exposé scientifique – Les changements<br />
géologiques <strong>sur</strong> <strong>la</strong> terre et <strong>sur</strong> <strong>la</strong> lune<br />
Lieux géographiques : Terre ≠ Lune (lieux essentiels de <strong>la</strong><br />
conversation) + [Espagne – Afrique – Méditerranée – Europe –<br />
Sicile – Chypre – Syrie – Italie – Naples]<br />
Vocabu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> géographie physique : [montagnes – mer – golfe –<br />
Océan – îles – rivières – voûtes souterraines – terres]<br />
Champ lexical de <strong>la</strong> vue : [voir – observer – apercevoir – figure –<br />
lunette (astronomique) – astronomes – spectacle] observation<br />
scientifique<br />
Rapport élève / professeur discours didactique : questions<br />
/réponses « Que me contez-vous là ? » « Ne semble-t-il pas… ? »<br />
« arrivera-t-il… ? » apprentissage par <strong>la</strong> maïeutique<br />
Connecteurs logiques : [cependant – car - mais – si] discours<br />
argumentatif<br />
Champ lexical de <strong>la</strong> géologie : [rochers – pointes – pierres – terres]<br />
+ périphrases : « lits de coquil<strong>la</strong>ges » (sédiments) « poissons<br />
pétrifiés » (fossiles) « gran<strong>des</strong> voûtes… soufre » (volcans :<br />
« Vésuve », « Etna »)<br />
Evocations de différentes catastrophes naturelles sous forme de<br />
périphrases : « morceaux de montagne » (météorites)<br />
« tremblement de terre » « les voûtes ne seront plus assez<br />
fortes… » (éruption volcanique) « <strong>la</strong> Sicile a été séparée… »<br />
« tectonique <strong>des</strong> p<strong>la</strong>ques)<br />
Remise en cause <strong>des</strong> mythes = « fables » // « ignorance » <br />
dévalorisation : « ce<strong>la</strong> n’est pas trop croyable » / « mais » ≠ / « je<br />
le croirais sans beaucoup de peine » explication scientifique<br />
valorisée<br />
SY : Discours scientifique fondé <strong>sur</strong> les observations <strong>des</strong><br />
astronomes et <strong>des</strong> chercheurs <strong>des</strong> XVI° et XVII° siècles :<br />
réflexions sue les bouleversements géologiques à l’échelle de <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nète et de l’univers<br />
Thème 2 : Ga<strong>la</strong>nterie – L’imagination permet de<br />
voir partout le visage <strong>des</strong> êtres qui nous sont<br />
chers<br />
Périphrases : « une certaine demoiselle » « une tête de<br />
femme » « <strong>des</strong> visages de demoiselles » allusions à <strong>la</strong><br />
Marquise<br />
≠ « visages d’hommes »<br />
Champ lexical du visage : [visage, joues, nez, front,<br />
menton, tête] personnification <strong>des</strong> rochers lunaires<br />
Vocabu<strong>la</strong>ire de <strong>la</strong> beauté : « beau » « agréments »<br />
« beauté » « embellissant » « beaux » valorisation<br />
du physique éloge indirect de <strong>la</strong> Marquise<br />
« Quelque visage que les gens de <strong>la</strong> lune y voient » « Y<br />
verraient de beaux visages » « Si je ne vous y verrais<br />
point » : projection <strong>sur</strong> <strong>la</strong> lune de <strong>la</strong> représentation de<br />
<strong>la</strong> personne aimée vision précieuse de l’amour :<br />
« Chacun transporte <strong>sur</strong> soi les idées dont il est<br />
rempli » : énoncé de cette règle courtoise<br />
« Moi, Madame, je ne sais… » « J’avoue… » « Etre<br />
obligée à qui me trouverait là » : échange ga<strong>la</strong>nt entre<br />
deux personnes qui se courtisent sans se déc<strong>la</strong>rer<br />
personnellement<br />
Métaphore filée de l’amour passion : « voûtes …<br />
remplies de soufre » « ne fondent » « les voûtes ne<br />
seront plus assez fortes pour résister aux feux<br />
qu’elles referment » « qu’elles exhalent par <strong>des</strong><br />
soupiraux… » double interprétation<br />
possible (géologique et amoureuse)<br />
SY : Discours amoureux sous-jacent qui permet au<br />
philosophe de f<strong>la</strong>tter <strong>la</strong> Marquise par allusions, et de<br />
lui signifier l’intérêt qu’il lui porte afin qu’elle y<br />
réponde avant qu’il soit trop tard…<br />
[Evaluation – Bac B<strong>la</strong>nc]<br />
Thème 3 : Philosophie – Epicurisme : nécessité<br />
de profiter du temps présent car tout change,<br />
tout passe (« carpe diem »)<br />
Théorie du changement universel : « branle perpétuel »<br />
+ répétition de « changement » / « change » / « ont<br />
changé »… + « diversifier »<br />
//<br />
Idée de modification liée au temps (retour en arrière :<br />
analepse) : « il y a quarante ans » « il en est arrivé »<br />
« autrefois couvertes » « n’y a pas été » « <strong>des</strong> temps<br />
reculés » « du temps de » « quelquefois » expression<br />
du passé // au présent<br />
Projection dans l’avenir (prolepse) : « craindre…ne<br />
fonde quelque jour » « ne seront plus… » expression<br />
du futur // au présent (« présentement »)<br />
Application de cette théorie à l’être humain avec le<br />
vocabu<strong>la</strong>ire du vieillissement : « vieillie » « vieille » « on<br />
craint pour ses jours » et de l’en<strong>la</strong>idissement :<br />
[enfoncée, allongé, avancés, évanouis]<br />
« Les philosophes nous font craindre… » : mise en<br />
garde contre les changements géologiques //<br />
changements physiques : invitation à profiter du temps<br />
présent<br />
« Une <strong>des</strong>tinée malicieuse » : allégorie = représentation<br />
personnifiée du <strong>des</strong>tin avec caractérisation<br />
dépréciative : « qui en veuille à…. » « qu’elle a été<br />
attaquer » vision athée du <strong>des</strong>tin traité avec ironie<br />
(responsabilité de l’homme)<br />
SY : Cette conversation est l’occasion d’une leçon<br />
de philosophie épicuriste, à travers une vision<br />
universelle et intemporelle du changement, comme<br />
prncipe fondateur de toute création