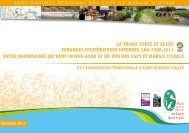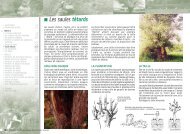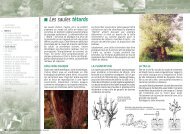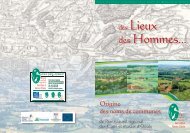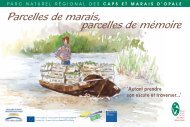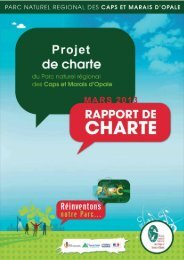PATRIM. BATI/Part.1 - Parc naturel régional des Caps et Marais d ...
PATRIM. BATI/Part.1 - Parc naturel régional des Caps et Marais d ...
PATRIM. BATI/Part.1 - Parc naturel régional des Caps et Marais d ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Patrimoine I Conseils I<br />
Terre I Briques I Craie I Pierre I<br />
Guide technique<br />
Le patrimoine rural bâti<br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale
Sommaire<br />
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie <strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sècheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
2 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Editorial<br />
Ce guide technique paraît<br />
dans un contexte où l'architecture<br />
rurale est menacée, du<br />
fait du manque d'entr<strong>et</strong>ien,<br />
<strong>des</strong> vicissitu<strong>des</strong> du temps, de<br />
l'oubli <strong>et</strong> de l'inadaptation aux<br />
notions actuelles de confort <strong>et</strong><br />
d'habitabilité.<br />
Parfois aussi <strong>des</strong> transformations hâtives provoquent <strong>des</strong><br />
dommages irrémédiables.<br />
Face aux dangers de la disparition de ce riche patrimoine<br />
bâti rural, il était urgent de porter un regard avisé sur ce<br />
patrimoine dont les éléments gardent notre identité<br />
commune.<br />
Dans ce cadre, la mobilisation <strong>des</strong> acteurs locaux de la<br />
construction était nécessaire ainsi que celle <strong>des</strong><br />
habitants du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong><br />
d'Opale.<br />
C'est à c<strong>et</strong>te action de mobilisation que contribue ce<br />
guide, synthèse d'une longue étude réalisée par <strong>des</strong><br />
passionnés <strong>et</strong> <strong>des</strong> professionnels.<br />
Vous y découvrirez les richesses du patrimoine bâti local,<br />
ainsi qu'une étude <strong>des</strong> modèles les plus représentatifs.<br />
Ce travail de référence est complété par de nombreuses<br />
actions de sensibilisation <strong>et</strong> de formation initiées par le<br />
<strong>Parc</strong> avec <strong>des</strong> partenaires professionnels, institutionnels<br />
ou associatifs : journées de formation, stages techniques,<br />
documents de référence, aide aux porteurs de proj<strong>et</strong>s.<br />
D’autres inventaires, du patrimoine religieux, industriel,<br />
militaire ou public, pourront compléter ce premier travail.<br />
Et désormais, le Conseil <strong>régional</strong> Nord-Pas de Calais,<br />
collectivité tutélaire du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>, finance une<br />
campagne de sauvegarde <strong>et</strong> de restauration du<br />
patrimoine bâti rural <strong>et</strong> culturel, animée par la Fondation<br />
du patrimoine.<br />
Puisse ce guide contribuer à faire revivre ce riche<br />
héritage, <strong>et</strong> à m<strong>et</strong>tre ainsi en valeur un territoire<br />
d'exception, au cadre de vie de qualité.<br />
Dominique DUPILET<br />
Président du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Rédaction : Philippe GODEAU / PNR <strong>des</strong> <strong>Caps</strong><br />
<strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale d'après Ellen CAZIN <strong>et</strong><br />
Pierre-Marie CARBON <strong>et</strong> ALFA<br />
Suivi d'édition : François MULET / PNR <strong>des</strong><br />
<strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Photos : Ellen CAZIN, Pierre-Marie CARBON,<br />
François MULET, Frédéric EVARD, Samuel<br />
DHOTE, Michel MARCHYLLIE<br />
Dessins, croquis : Ellen CAZIN, Pierre-Marie<br />
CARBON<br />
Mise en page : Stéphane DESCAMPS<br />
Remerciements aux responsables de "Maisons<br />
Paysannes de France", "Campagnes Vivantes"<br />
<strong>et</strong> Willy Flour pour leur apport.<br />
Imprimé sur papier recyclé<br />
© PNR <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale – Juin 2003
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale<br />
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale est né en mars<br />
2000 du regroupement <strong>des</strong> <strong>Parc</strong>s du Boulonnais <strong>et</strong> de l'Audomarois.<br />
Ni réserve <strong>naturel</strong>le, ni espace aménagé pour les loisirs, le <strong>Parc</strong> est un<br />
vaste territoire (152 communes) habité, vivant, à dominante rurale,<br />
mais aussi fragile, à la recherche d'un équilibre entre son développement<br />
<strong>et</strong> la protection de ses richesses patrimoniales.<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
B.P. 55 – 62510 ARQUES<br />
tél. 03 21 87 90 90<br />
fax 03 21 87 90 87<br />
info@parc-opale.fr<br />
• il protège le patrimoine sans interdictions<br />
arbitraires mais dans la concertation<br />
avec l'ensemble <strong>des</strong> propriétaires <strong>et</strong> gestionnaires<br />
;<br />
• il accompagne les mouvements du<br />
paysage <strong>et</strong> de l'urbanisation pour préserver<br />
l'identité culturelle ;<br />
• il favorise le développement de l'agriculture,<br />
de l'artisanat, du commerce <strong>et</strong> de<br />
l'industrie, tout en respectant la qualité de<br />
l'environnement ;<br />
• il s’ouvre à l'accueil sans pour autant<br />
vendre le pays au tourisme <strong>et</strong> bouleverser<br />
la vie <strong>des</strong> habitants ;<br />
• il fait comprendre, respecter, découvrir<br />
les richesses <strong>naturel</strong>les <strong>et</strong> culturelles<br />
que ses habitants ont su préserver.<br />
C<strong>et</strong>te ambition est partagée par les 152<br />
communes, les 6 intercommunalités, les 5<br />
chambres consulaires, le Conseil Général<br />
du Pas-de-Calais <strong>et</strong> le Conseil Régional<br />
Nord-Pas de Calais, qui se sont unis pour<br />
créer le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>Marais</strong> d'Opale, label attribué par le<br />
Ministère chargé de l'environnement. De<br />
nombreux représentants <strong>des</strong> organismes<br />
socioprofessionnels <strong>et</strong> associatifs participent<br />
à ce proj<strong>et</strong>.<br />
Expérimentation, partenariat, sensibilisation,<br />
éco-citoyenn<strong>et</strong>é, développement durable,<br />
sont les maîtres mots de l'action du <strong>Parc</strong>. Le<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> ne peut ni obliger ni<br />
interdire. Son travail passe par la sensibilisation,<br />
la persuasion, la concertation avec un<br />
maximum de partenaires.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 3
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
4 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
L'implantation <strong>des</strong> maisons, <strong>des</strong><br />
hameaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> villages, présente une<br />
extrême variété de formes : de la dissémination<br />
complète <strong>des</strong> habitations à<br />
leur regroupement en grosse bourgade,<br />
en passant par de nombreuses situations<br />
intermédiaires… La grande diversité <strong>des</strong><br />
établissements humains peut être perçue<br />
comme la résultante de l'histoire, <strong>des</strong><br />
traditions maintenues par l'éducation <strong>et</strong><br />
la législation, <strong>et</strong> de l'influence <strong>des</strong> pratiques<br />
agraires.<br />
LES ORGANISATIONS VILLAGEOISES<br />
La notion de village associe diversement les<br />
acteurs de la vie communautaire rurale : agriculteurs,<br />
commerçants, artisans, enseignants…<br />
à la population <strong>des</strong> paysans sur un mode d'implantation<br />
concentrée ou, à l'inverse, dispersée.<br />
Une majorité d'implantations dispersées<br />
<strong>des</strong> foyers villageois émerge dans la partie<br />
boulonnaise <strong>et</strong> la partie flamande du <strong>Parc</strong><br />
alors que la partie artésienne tend à les voir se<br />
concentrer.<br />
L’implantation dispersée fixe la population<br />
sur l'ensemble du territoire communal. Elle<br />
correspondrait aux coutumes de partage<br />
égal de la propriété. Ce système, s'il comporte<br />
une appropriation individuelle du<br />
foyer, laisse subsister<br />
le caractère communautaire<br />
par l'agglomération<br />
<strong>des</strong> familles<br />
<strong>et</strong> l'usage commun<br />
d'une partie du territoire<br />
(le communal).<br />
L'implantation dispersée<br />
est caractérisée<br />
par <strong>des</strong> «écarts» ou<br />
<strong>des</strong> hameaux périphériques reliés entre-eux<br />
par un réseau complexe de chemins.<br />
Le degré de dissémination est très variable.<br />
L'origine historique du morcellement tient<br />
aussi dans les conditions physiques qui orientent<br />
la production agricole vers l'élevage. Dans<br />
c<strong>et</strong>te disposition, typique du pays bocager<br />
boulonnais, chaque exploitation possède sa<br />
pâture ou trône au milieu <strong>des</strong> terres qu'elle<br />
exploite. Leur implantation obéit, à la fois, à<br />
une orientation géographique <strong>et</strong> à une orientation<br />
climatique sans mesure coercitive d'alignement.<br />
La présence d'un point d'eau, puits<br />
ou source justifie leur établissement<br />
(Alincthun, Audinghen, Bazinghen, Samer,<br />
Brunembert, Crémarest, Quesques, Réty,<br />
Selles…).<br />
L'importance <strong>des</strong> "écarts" peut égaler ou<br />
même dépasser le chef-lieu communal<br />
(Séquières à Lacres, Menty à Verlincthun,<br />
Course à Doudeauville…).<br />
L'implantation concentrée s'articule autour<br />
d'un «noyau» (cœur du village), généralement<br />
composé d'une place, d'une église <strong>et</strong> son<br />
cim<strong>et</strong>ière, d'une école ou d'un café, plus simplement<br />
d'une propriété communale, pré ou<br />
puits. Elle peut identifier certaines communes<br />
dont l'occupation humaine est absente sur<br />
une très large surface du territoire.<br />
L'établissement en domaines isolés, à l'origine<br />
<strong>des</strong> implantations concentrées, correspondrait<br />
au maintien de la propriété par transmission<br />
intégrale à l'un <strong>des</strong> héritiers ou à la communauté<br />
de la famille. Dans ce système, le<br />
domaine fait vivre <strong>et</strong> maintient l'unité de la<br />
famille par le travail commun.<br />
Sur le territoire du <strong>Parc</strong>, l'implantation concentrée<br />
revêt aujourd'hui plusieurs formes :<br />
-> le village-noyau<br />
Il n'offre qu'un seul<br />
foyer d'habitat sur le<br />
territoire communal,<br />
sur une forme<br />
ramassée.<br />
Le plus souvent résultat<br />
d'une implantation<br />
sur un site géographiquement<br />
étroit, il ne<br />
se rencontre que dans<br />
certaines zones :<br />
- frange côtière,<br />
Equihen-Plage,<br />
Audresselles,<br />
Dannes, Wimereux,<br />
Wissant…<br />
- vallée encaissée,<br />
Desvres, Affringues,<br />
Nielles-les-Bléquin…<br />
- versant, Bainghen…<br />
- bois <strong>et</strong> forêts, Bonningues-les-Ardres…<br />
-> le village à double noyau<br />
Deux foyers d'habitations concentrés sont distincts<br />
sur le territoire formant la commune<br />
(Leulinghem avec Etrehem, Halinghen avec<br />
Haut-Pichot, Helfaut avec Bilques, Campagneles-Wardrecques<br />
avec Baudr<strong>et</strong>hun, Leulinghen-<br />
Bernes, Manninghen-Henne…).<br />
Dans c<strong>et</strong>te catégorie, il faut encore distinguer<br />
les communes formées par le regroupement de<br />
deux paroisses, chacune identifiées notoirement<br />
par une église ou une chapelle (Mentque-<br />
Nortbécourt, Ouve-Wirquin, Remilly-Wirquin,<br />
Acquin-Westbécourt, Belle-<strong>et</strong>-Houllefort,<br />
Sangatte Blériot-Plage, Clerques Audenfort…).
Enfin, la création <strong>des</strong> stations balnéaires, en<br />
bord de mer, a dédoublé certains villages à la<br />
fin du XIX ème siècle (Neufchatel <strong>et</strong> la station<br />
d'Hardelot, Ambl<strong>et</strong>euse avec la ruralité de<br />
Raventhun, tandis que Wimereux est née de la<br />
scission d'une partie du territoire côtier de<br />
Wimille…).<br />
-> le village en long ou village-rue<br />
Celui-ci s'organise le<br />
long d'une voie unique,<br />
généralement un<br />
axe de circulation privilégié,<br />
qui lui-même<br />
peut suivre le cours<br />
d'une vallée, un cours<br />
d'eau, une topographie<br />
accidentée<br />
(Bouvelinghem, Elnes, Tatinghem, Beuvrequen,<br />
Colembert, Hervelinghen, Hesdigneul-les-<br />
Boulogne, Isques, Bayenghem-les- Seninghem…).<br />
-> le village en étoile<br />
De loin, la forme la plus représentée sur le territoire<br />
du <strong>Parc</strong>. Les rues convergentes mènent<br />
jusqu'au noyau encore fort distinct. Les fermes<br />
se disposent le long<br />
<strong>des</strong> routes jusqu'à fonder<br />
quelques hameaux<br />
à l'écart. Ces écarts<br />
peuvent se raccorder<br />
plus <strong>naturel</strong>lement à<br />
une commune voisine<br />
(Escalles, Senlecques,<br />
Tingry, Wacquinghen,<br />
Wierre-Effroy, Alquines,<br />
Bouquehault, Campagne-les-Guînes,<br />
Escoeuilles…).<br />
Ces implantations villageoises concentrées<br />
peuvent elles-même se combiner entre-elles<br />
pour fonder l'identité territoriale d'un village.<br />
Les bourga<strong>des</strong><br />
Il faut distinguer du milieu rural la bourgade,<br />
chef-lieu de canton, place de marché ou centre<br />
industrieux. Le plus souvent, elle résulte d'évolutions<br />
successives d'un premier foyer de<br />
type rural. La prospérité agricole, commerciale<br />
ou artisanale, puis l'industrialisation progressive<br />
en fond de vallée, en correspondance<br />
avec le développement <strong>des</strong> lignes ferroviaires,<br />
ont pu concentrer progressivement une population<br />
plus nombreuse. Le patrimoine rural<br />
bâti y devient plus diffus, disparu, relégué dans<br />
la périphérie, parfois mêlé aux maisons de<br />
bourg, maisons d'ouvriers, ateliers industriels,<br />
commerces...<br />
Parmi les bourga<strong>des</strong>, il faut considérer la périphérie<br />
de Saint-Omer, Longuenesse, Saint-<br />
Martin-au-Laert, Arques, Saint-Etienne-au-Mont<br />
en périphérie de Boulogne-sur-Mer, Guînes,<br />
Licques, Marquise, Lumbres…<br />
Aujourd’hui<br />
C<strong>et</strong>te classification <strong>des</strong> organisations villageoises<br />
est aujourd'hui profondément bouleversée<br />
: les transformations récentes, engendrées<br />
par le développement rapide d'un habitat<br />
pavillonnaire individuel, tendent à effacer<br />
les notions d'implantations dispersées <strong>et</strong><br />
concentrées, pourtant à l'origine de l'identité<br />
propre de chaque village. Il est donc utile de<br />
mener une analyse de la forme historique du<br />
foyer villageois avant d'intervenir sur son<br />
développement futur.<br />
En expliquant les raisons de son établissement<br />
(facteurs <strong>naturel</strong>s <strong>et</strong> agraires...), en m<strong>et</strong>tant en<br />
évidence une implantation caractéristique du<br />
bâti sur la parcelle ou son rapport à la rue ou au<br />
paysage, il devient possible d'intégrer harmonieusement<br />
les nouvelles constructions, de leur<br />
assurer un meilleur confort <strong>et</strong>, pour la collectivité,<br />
de lutter contre la banalisation de son<br />
cadre de vie…<br />
LA TOPONYMIE<br />
ET L'ORIGINE DES<br />
VILLAGES<br />
La toponymie ou étude <strong>des</strong> noms de<br />
lieux nous renseigne souvent sur<br />
l’histoire <strong>des</strong> villages <strong>et</strong> sur les usages<br />
agraires de ces territoires façonnés<br />
par les hommes au fil <strong>des</strong> siècles.<br />
C’est ainsi que le suffixe « tun » ou<br />
« thun » marque l’influence <strong>des</strong><br />
peuples saxons dans le Boulonnais.<br />
Ce terme signifiait « enclos » ou<br />
« clôture ».<br />
Le suffixe « hem » ou « hen » très<br />
courant notamment à l’est du <strong>Parc</strong><br />
signifie la « maison de » <strong>et</strong> est<br />
d’origine franque.<br />
Mais, la toponymie s’applique aussi<br />
aux noms de lieux non habités <strong>et</strong> est<br />
riche d’informations sur les terroirs.<br />
Voici quelques termes relevés à<br />
Longfossé <strong>et</strong> repris sur une table de<br />
lecture toponymique conçue par le<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>.<br />
Le Quesnel : lieu planté de chênes<br />
Le Repêchoir : lieu ou chacun vient<br />
le soir venu reprendre ses bêtes que<br />
les bergers menaient paître sur les<br />
terroirs communaux.<br />
Le Croc : lieu élevé <strong>et</strong> caillouteux<br />
La vastine : terre déserte<br />
Les loups pendus : on pendait les<br />
loups chassés pour effrayer leurs<br />
congénères.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 5
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
6 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
L'organisation <strong>des</strong> villages (suite)<br />
LE VILLAGE ET SON RAPPORT<br />
AU PAYSAGE<br />
Le paysage rural, par opposition au paysage<br />
urbain, est un produit de l'agriculture. Dans<br />
c<strong>et</strong> horizon paysager, la correspondance<br />
entre facteurs <strong>naturel</strong>s, structures agraires <strong>et</strong><br />
régimes fonciers caractérise la construction<br />
rurale qu'achève d'identifier l'usage <strong>des</strong> matériaux<br />
locaux.<br />
Les facteurs <strong>naturel</strong>s<br />
L'eau, le relief, l'orientation, la végétation… peuvent<br />
déterminer <strong>naturel</strong>lement le lieu de l'implantation<br />
villageoise.<br />
Il est clair que l'eau joue un rôle primordial : son<br />
omniprésence peut expliquer la dispersion de<br />
l'habitat, chaque foyer pouvant la puiser librement.<br />
Dans certains fonds humi<strong>des</strong> où il s'agit<br />
d'échapper aux inondations passagères, elle<br />
peut conduire à la concentration de l'habitat. A<br />
contrario, sa rar<strong>et</strong>é conduit à la concentration<br />
de l'habitat autour d'un point d'eau exploité à<br />
de gran<strong>des</strong> profondeurs <strong>et</strong> collectivement.<br />
Le relief intervient également pour canaliser<br />
l'habitat dans les vallées, le fractionner dans les<br />
terroirs disséqués, le localiser de manière privilégiée<br />
sur les versants bien orientés ou à l'abri<br />
<strong>des</strong> vents.<br />
Enfin, les gran<strong>des</strong> étendues boisées ne laissent<br />
parfois que leur lisière, seul espace dégagé<br />
favorable à l'implantation <strong>des</strong> foyers humains<br />
qui trouvent leur activité dans l'exploitation du<br />
bois.<br />
Mais le milieu physique n'explique pas à lui seul<br />
les formes d'organisation qu'adoptent les groupements<br />
villageois : les pratiques agraires ou les<br />
formes de régimes fonciers viennent se combiner<br />
aux facteurs <strong>naturel</strong>s.<br />
Cadastre dit "Napoléonien" de 1835 montrant l'organisation du parcellaire autour d'un communal central.<br />
Les pratiques agraires<br />
Les organisations villageoises, qui intègrent en<br />
leur sein les constructions rurales, correspondent<br />
dans leurs propres diversifications aux rapports<br />
qu'entr<strong>et</strong>iennent les hommes avec la terre<br />
qu'ils travaillent.<br />
Les implantations isolées sont une caractéristique<br />
du pays bocager.<br />
A l'inverse, de vastes étendues peu tourmentées,<br />
sans clôtures, ni haies, forment l'essentiel<br />
du paysage dans les parties du <strong>Parc</strong> proches du<br />
Haut Pays d'Artois (Haut-Boulonnais/Val<br />
d'Acquin). Les organisations villageoises ten-<br />
dent vers la concentration selon que l'eau est<br />
plus ou moins accessible ou qu'il faille se protéger<br />
<strong>des</strong> vents.<br />
Les régimes fonciers<br />
Dans le nord de la France, au moment de la<br />
Révolution, la propriété paysanne est déjà<br />
répartie dans une multitude de mains divisée<br />
entre la noblesse, le clergé, la bourgeoisie, <strong>et</strong> les<br />
paysans. Le morcellement de la propriété a<br />
ainsi une conséquence directe sur l'occupation<br />
humaine du territoire avec <strong>des</strong> implantations de<br />
foyers d'habitat très dense, fréquemment<br />
dispersées <strong>et</strong> divisées sur le territoire.
LE SITE ET LA RUE<br />
L'orientation du logis<br />
L’orientation du logis ordonne la construction<br />
du paysage de la rue en fixant, premièrement <strong>et</strong><br />
le plus favorablement possible, la position de<br />
l'habitation. "Une règle incontournable commande<br />
l'exposition de chaque façade principale<br />
d'habitation, au sud-est ou sud" pour recevoir un<br />
maximum d'ensoleillement, tandis qu'au nord<br />
<strong>et</strong> à l'ouest, <strong>des</strong> murs massifs protègent du vent,<br />
du froid <strong>et</strong> <strong>des</strong> intempéries. Le positionnement<br />
de l'habitation conditionne ensuite l'organisation<br />
<strong>des</strong> bâtiments annexes.<br />
La rue<br />
En milieu rural, l’image de la rue dépend donc<br />
de la façon dont s'organisent les constructions<br />
sur leur parcelle créant autant d’ambiances<br />
particulières. L'alignement est également<br />
varié, beaucoup moins réglementé<br />
qu’aujourd’hui.<br />
Les variations de bâti avec l’alternance <strong>des</strong><br />
pignons <strong>et</strong> <strong>des</strong> faça<strong>des</strong>, les décrochements <strong>et</strong><br />
les discontinuités volumétriques ménagent un<br />
espace de transition où l'espace privé rejoint<br />
l'espace collectif par la perception visuelle.<br />
DOHEM COULOMBY<br />
PERNES<br />
L'orientation géographique<br />
<strong>des</strong> rues, combinée à <strong>des</strong> formes<br />
d'exploitations organisées<br />
autour de cours, peut offrir <strong>des</strong><br />
dispositions particulières :<br />
- établie sur une direction<br />
est/ouest, la rue distribue, de<br />
part <strong>et</strong> d'autre, <strong>des</strong> habitations<br />
qui cherchent à s'établir sur une<br />
ligne parallèle de sorte à orienter<br />
leur façade principale au sud <strong>et</strong><br />
à la fois préserver l'intimité du<br />
foyer<br />
- établie sur une direction nord-sud, la rue peut<br />
distribuer, de part <strong>et</strong> d'autre, <strong>des</strong> habitations<br />
établies perpendiculairement, avec toujours<br />
c<strong>et</strong>te même préoccupation d'orienter <strong>des</strong> faça<strong>des</strong><br />
principales au sud.<br />
L'implantation sur un terrain accidenté offre<br />
d'autres perspectives :<br />
- en s'implantant parallèlement au sens de la<br />
déclivité, il devient nécessaire de s'accommoder<br />
de la pente <strong>naturel</strong>le ou d'entailler le flanc<br />
de coteau pour s'établir à mi-pente. Les constructions<br />
s'organisent ensuite au mieux pour<br />
tourner la façade principale <strong>des</strong> habitations au<br />
sud.<br />
ETUDIER LE PAYSAGE<br />
POUR MIEUX GÉRER<br />
LE DÉVELOPPEMENT<br />
Pour aider les communes à faire face<br />
à de fortes deman<strong>des</strong> d'urbanisation,<br />
pour mieux sensibiliser les habitants<br />
<strong>et</strong> les élus à l'intérêt <strong>et</strong> à la fragilité <strong>des</strong><br />
paysages qui composent son<br />
territoire, le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale aide à la<br />
réalisation d'étu<strong>des</strong> paysagères <strong>et</strong><br />
environnementales.<br />
Menées dans le cadre <strong>des</strong><br />
procédures d'urbanisme, ces étu<strong>des</strong><br />
précisent les enjeux <strong>et</strong> richesses<br />
paysagères, intègrent ces enjeux dans<br />
les documents de planification (plans<br />
locaux d'urbanisme) <strong>et</strong> perm<strong>et</strong>tent la<br />
mise en œuvre d'actions concrètes<br />
d'amélioration du paysage.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 7
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
8 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les caractères de l'habitation<br />
«Pendant <strong>des</strong> siècles, le paysan a construit<br />
sa maison un peu comme l'escargot<br />
fait sa coquille en spirale… C'était<br />
en quelque sorte un travail d'instinct…<br />
parfaitement adapté aux besoins de<br />
l'occupant avec juste ce qu'il fallait de<br />
matière…» (source inconnue).<br />
UN PEU D'HISTOIRE<br />
L'exploitation agricole forme, en majorité, le<br />
corps de la construction rurale. La complexité<br />
<strong>et</strong> surtout la lenteur de diffusion <strong>des</strong> formes<br />
architecturales représente un <strong>des</strong> aspects les<br />
plus significatifs de son évolution. Dans le<br />
domaine <strong>des</strong> matériaux, comme dans celui <strong>des</strong><br />
formes architecturales rurales, dans leurs particularismes<br />
régionaux, dans les formes de l'exploitation<br />
agricole, le Moyen-âge a défini les<br />
bases d'une évolution qui se développe continuellement<br />
jusqu'au XIX ème siècle. En France,<br />
comme dans l’ensemble de l’Occident, sous la<br />
double influence de la croissance démographique<br />
<strong>et</strong> de l'évolution <strong>des</strong> pratiques agraires,<br />
phénomènes indissociables du X ème jusqu'au<br />
XII ème siècle, l'habitat rural se fixe, se regroupe <strong>et</strong><br />
se stabilise. Ces conditions socio-économiques<br />
continuent d'influer profondément sur l'architecture<br />
rurale du XII ème au XV ème siècle. A c<strong>et</strong>te<br />
époque, la maison solide <strong>et</strong> permanente se<br />
généralise <strong>et</strong> s'hérite de générations en générations.<br />
Cependant, l'usage <strong>des</strong> matériaux régionaux<br />
spécifiques s'établit <strong>et</strong> les formes particulières<br />
de charpente apparaissent. Les techniques<br />
constructives s'affinent, fréquemment produites<br />
par une corporation d'artisans spécialisés.<br />
Elles fixent <strong>des</strong> caractères architecturaux<br />
qui persistent longtemps.<br />
Durant la très large période du XV ème au XIX ème<br />
siècle, l'habitat rural continue de se transformer<br />
avec, notamment, la découverte <strong>des</strong> applications<br />
de la houille <strong>et</strong> l'industrialisation (par<br />
exemple, le passage de la structure à pans de<br />
bois, encore dit «bâti végétal», vers la construction<br />
de «maçon»)… C'est alors dans la maison<br />
d'habitation que s'exerce le plus l'influence <strong>des</strong><br />
meilleurs matériaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> nouvelles techniques,<br />
tandis que les dépendances agricoles<br />
peuvent garder <strong>des</strong> formes «archaïques» jusqu’à<br />
la seconde moitié du XIX ème siècle.<br />
Faite pour être modifiée, reconstruite, améliorée<br />
ou agrandie, la construction rurale est aussi<br />
fermement ancrée dans <strong>des</strong> organisations spatiales<br />
diversifiées dont les principales formes<br />
sont la «maison-étable» qui abrite, sous un<br />
même toit, bêtes <strong>et</strong> hommes, fourrages <strong>et</strong> récoltes,<br />
<strong>et</strong> la maison à bâtiments multiples disposés<br />
autour d'une cour progressivement fermée au<br />
cours d'une évolution finale.<br />
La construction rurale, telle qu'elle nous parvient<br />
aujourd'hui, représente donc l'achèvement<br />
d'une évolution complexe qui date, en réalité <strong>et</strong><br />
le plus souvent, du XVIII ème ou XIX ème siècle.<br />
Rarement, elle est plus ancienne…<br />
LES COMPOSANTES DE<br />
L’HABITATION-EXPLOITATION<br />
AGRICOLE<br />
A l'origine, la construction rurale abrite les fonctions<br />
essentielles d'une unité de production<br />
agricole :<br />
- le logement de l'exploitant, l'habitation. La<br />
salle commune représente la centralité d'où<br />
s'exerce la surveillance du maître <strong>des</strong> lieux. Elle<br />
est toujours la première pièce par laquelle on<br />
accède. Lieu de passage obligé, elle concentre<br />
autour du foyer toute la vie familiale <strong>et</strong> sociale.<br />
La chambre (ou les chambres) contigüe est un<br />
lieu privé consacré au repos.<br />
- les annexes proches (basse-cour, soue à<br />
cochons, laiterie, saloir, poulailler, pigeonnier<br />
<strong>et</strong> clapier, buanderie ou relavoir)…<br />
- le logement <strong>des</strong> animaux (écurie, érable, bergerie…)<br />
- le logement <strong>des</strong> récoltes (grange ou combles)<br />
- le logement du matériel («charr<strong>et</strong>il» ou porche<br />
charr<strong>et</strong>ier, auvents…).<br />
Il peut parfois s'y adjoindre une production artisanale<br />
(forge, atelier de bourrelerie…) ou une<br />
activité commerciale (estamin<strong>et</strong>…).<br />
Quelques notions architecturales<br />
Les constructions qui forment une exploitation,<br />
distinguent le rang social de son propriétaire,<br />
simple journalier, laboureur ou riche fermier,<br />
par la taille <strong>des</strong> bâtiments plutôt que par les<br />
matériaux. Ainsi, la maison à étage souligne surtout<br />
un rang social élevé également lié à l'exploitation<br />
agricole.<br />
La hauteur <strong>des</strong> bâtiments est directement liée à<br />
leur <strong>des</strong>tination : la grange demande une élévation<br />
bien supérieure à celle d'une étable ou<br />
d'une bergerie… Il est donc rare de constater
une même hauteur <strong>des</strong> lignes <strong>des</strong> faîtages : tout<br />
eff<strong>et</strong> de monotonie est écarté.<br />
Pour affronter le climat pluvieux, la toiture<br />
peut atteindre 2/3 de la hauteur totale de<br />
la construction. Son impact devient prédominant.<br />
Frontalité<br />
Tous les bâtiments d'une exploitation,<br />
dépendances agricoles ou habitation, ont<br />
une face antérieure <strong>et</strong> une face postérieure.<br />
C'est par l'opposition de ces faces que s'exprime<br />
la frontalité. Les bâtiments d'une exploitation<br />
sont exclusivement tournés sur l'intérieur<br />
de la cour avec, pour conséquence, <strong>des</strong> murs<br />
massifs fermés sur l'extérieur.<br />
Pour les bâtiments annexes, <strong>des</strong> murs gouttereaux<br />
aveugles, parfois percés par de p<strong>et</strong>ites<br />
baies pour la ventilation, ou par l'ouverture<br />
d'un grand passage charr<strong>et</strong>ier, tournés<br />
sur l'extérieur, traduit la face postérieure.<br />
L'habitation se ferme au contact de la rue<br />
ou s'ouvre sur le potager, enclos par une<br />
haie.<br />
La frontalité est donc chaque fois très<br />
affirmée.<br />
Assise au plus proche du terrain<br />
<strong>naturel</strong><br />
Chaque bâtiment composant l'exploitation<br />
s'implante toujours au plus près du terrain<br />
<strong>naturel</strong> sans gros travaux d'affouillement ou<br />
d'exhaussement :<br />
Les organisations spatiales<br />
L'habitation-exploitation dispose d'une à<br />
plusieurs constructions, produites par <strong>des</strong><br />
évolutions successives. Dans ce cadre, il<br />
n'existe pas un modèle de plan unique.<br />
L’habitat élémentaire<br />
II correspond à l'habitat <strong>des</strong> journaliers qui n'ont<br />
à m<strong>et</strong>tre à disposition <strong>des</strong> patrons que leur unique<br />
force de labeur pendant que les individus<br />
célibataires trouvent un logement chez leurs<br />
employeurs ou vivent de place en place.<br />
Ce type d'habitat peut prendre plusieurs formes :<br />
- un bâtiment unique indépendant, composition<br />
qui rassemble en deux pièces, disposées<br />
de part <strong>et</strong> d'autre d'une cheminée, un cadre de<br />
vie minimal pour la cellule familiale. En façade,<br />
elle se traduit par une porte <strong>et</strong> deux fenêtres,<br />
rarement plus.<br />
- un bâtiment unique à foyers jumelés jusqu'à<br />
trois. Les foyers sont ici distingués par le nombre<br />
de souches de cheminées, de portes <strong>et</strong> les<br />
variations dans les teintes de menuiseries. C'est<br />
une disposition souvent reprise en périphérie<br />
<strong>des</strong> bourgs <strong>et</strong> villages ou pour le logement <strong>des</strong><br />
pécheurs.<br />
COMMENT RETROUVER<br />
L'HISTOIRE D'UNE<br />
MAISON<br />
Sauvegarder un patrimoine architectural,<br />
c'est aussi savoir recueillir les<br />
témoignages de son évolution, <strong>et</strong> ses<br />
rapports avec ceux qui y ont vécu.<br />
Pour r<strong>et</strong>rouver l'histoire d'un bâti<br />
ancien,<br />
- consultez d'abord les archives familiales,<br />
les cartes postales locales <strong>et</strong><br />
anciennes, les journaux d'époque,<br />
voire les facturiers. Vous pouvez également<br />
consulter les archives de la<br />
presse locale. Elles sont souvent<br />
riches de p<strong>et</strong>ites histoires sur le patrimoine<br />
architectural.<br />
- consultez ensuite le cadastre pour<br />
rechercher notamment l'origine de<br />
propriété. Consultez en mairie ou à<br />
la section P <strong>des</strong> archives départementales<br />
(état de section puis matrice<br />
cadastrale). Vous y trouverez la référence<br />
<strong>des</strong> transferts de propriété, un<br />
état <strong>des</strong>criptif du bâti au fil <strong>des</strong> époques<br />
(depuis la Révolution).<br />
- Pour <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> plus anciennes,<br />
vous pouvez trouver <strong>des</strong> documents<br />
d'imposition <strong>des</strong> terriers, estimes…<br />
(section C <strong>des</strong> Archives<br />
Départementales).<br />
Les archives fiscales plus récentes<br />
(séries L <strong>et</strong> P <strong>des</strong> Archives<br />
Départementales), les archives notariales<br />
(dont les actes de ventes parfois<br />
versés à la section Q <strong>des</strong><br />
Archives Départementales) sont également<br />
<strong>des</strong> sources riches d'enseignements.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 9
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
10 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les caractères de l'habitation (suite)<br />
L’habitation-exploitation en ligne<br />
simple<br />
-> bâtiment unique, habitat conjoint<br />
à l’exploitation<br />
Version la plus «archaïque» de p<strong>et</strong>ite exploitation,<br />
une seule construction abrite sous un<br />
même toit <strong>et</strong> sur un seul côté d'une cour, l'ensemble<br />
<strong>des</strong> fonctions. Il<br />
peut s'agir d'une évolution<br />
sociale du journalier<br />
qui, en acquérant<br />
une vache ou un cheval,<br />
devient ménager.<br />
Son organisation générale commande que l'écurie,<br />
la grange <strong>et</strong>/ou l'étable soient disposées à<br />
l'ouest, le matériel ou la réserve, à l'est.<br />
Toutefois, c<strong>et</strong>te exploitation ne rassemble qu'un<br />
p<strong>et</strong>it nombre fort restreint de gros bétail. C<strong>et</strong>te<br />
construction peut s'adjoindre de bâtiments<br />
annexes mineurs (poulailler, soue à cochons,<br />
clapiers, buanderie ) sous une forme d'appentis.<br />
Selon la forme de la parcelle, l'orientation <strong>et</strong> la<br />
position de la construction, la cour est plus ou<br />
moins «flottante» dans l'espace jusqu'à inexister.<br />
La présence d'une haie perm<strong>et</strong>, évidemment,<br />
de la préciser.<br />
-> somme de bâtiments apignonnés (p<strong>et</strong>ites <strong>et</strong><br />
moyennes exploitations)<br />
C<strong>et</strong>te construction diffère<br />
du modèle précédent<br />
avec la distinction<br />
<strong>des</strong> différentes<br />
fonctions par le gabarit<br />
<strong>des</strong> bâtiments. Ici, il<br />
n'y a pas de toiture<br />
continue. Ainsi le volume de la dépendance<br />
peut s'élever, par exemple, plus haut que l'habitation.<br />
C<strong>et</strong>te forme peut résulter d'agrandissements<br />
successifs.<br />
L’habitation-exploitation à plusieurs<br />
bâtiments<br />
Le bâtiment unique peut parfois ne plus suffire<br />
aux fonctions de l'exploitation ( besoins de l'élevage<br />
ou de stockage). Les bâtiments se multiplient.<br />
Selon les époques <strong>et</strong> les conjonctures<br />
économiques, les matériaux de construction<br />
peuvent alors varier d'un bâtiment à l'autre.<br />
Mais l'ensemble peut aussi, dès sa construction,<br />
s'articuler autour de plusieurs bâtiments <strong>et</strong>, dans<br />
ce cas, un même matériau de construction est<br />
employé, ce qui maintient un cadre homogène.<br />
-> bâtiments sur deux lignes parallèles (p<strong>et</strong>ites,<br />
moyennes <strong>et</strong> gran<strong>des</strong> exploitations)<br />
Par leur implantation, les bâtiments commencent<br />
à cadrer l'espace central de la cour, le<br />
plus souvent suivant une forme allongée <strong>et</strong><br />
irrégulière. Les bâtiments sont peu éloignés les<br />
uns <strong>des</strong> autres.<br />
Le foyer d'habitation<br />
profite de la meilleure<br />
orientation. Il trouve<br />
en face de lui le bâtiment<br />
où l'on regroupe<br />
le bétail, la grange <strong>et</strong> la<br />
remise de matériel.<br />
Certaines fonctions,<br />
comme l'écurie ou <strong>des</strong> autres dépendances,<br />
restent accolées à l'habitation.<br />
-> bâtiments en équerre simple (p<strong>et</strong>ites <strong>et</strong><br />
moyennes exploitations)<br />
A la construction principale, orientée sur une<br />
direction est/ouest, est ajouté un r<strong>et</strong>our d’équerre<br />
abritant les fonctions<br />
annexes. La cour commence,<br />
ici, à se composer<br />
<strong>et</strong> à se cadrer.<br />
-> bâtiments en équerre double, continue ou<br />
discontinue (p<strong>et</strong>ites, moyennes <strong>et</strong> gran<strong>des</strong><br />
exploitations)<br />
C<strong>et</strong>te disposition offre de multiples variations<br />
d'échelles selon l'importance de l'exploitation.<br />
L'équerre double désigne une forme de U où<br />
l'habitation s'établit<br />
au centre.<br />
Les r<strong>et</strong>ours d'équerre<br />
abritent<br />
alors les fonctions<br />
annexes.<br />
De même que<br />
pour la disposi-
tion précédente, la volumétrie générale varie<br />
selon le rang social ou économique de l'exploitation.<br />
L'organisation de l’habitation-exploitation<br />
sur un plan quadrilatère<br />
L'évolution d'un ensemble sur cour ouverte,<br />
établi sur deux lignes parallèles, ou en équerre<br />
sur une parcelle limitée, donne une nouvelle<br />
typologie: : «la ferme à cour quadrangulaire».<br />
Toute la vie s'organise autour d'une cour «carrée»,<br />
c'est à dire refermée sur quatre côtés, <strong>et</strong><br />
irrégulière. Tantôt la grange, tantôt l'habitation<br />
s'alignent sur la rue. Les dépendances, qui abritent<br />
bétails <strong>et</strong> matériel, s'établissent sur les<br />
côtés.<br />
La forme en quadrilatère distingue deux types<br />
d'assemblages :<br />
-> bâtiments dissociés avec cour ouverte sur<br />
les angles (gran<strong>des</strong> exploitations)<br />
C<strong>et</strong>te disposition<br />
caractéristique <strong>des</strong><br />
régions d'élevage, libérée<br />
<strong>des</strong> contraintes de<br />
groupements villageois,<br />
se traduit par<br />
<strong>des</strong> exploitations qui<br />
prennent plus d'aise,<br />
se dispersent sur le ter-<br />
ritoire, étalent leurs bâtiments autour de cour<br />
de vastes dimensions, elle-même jouxtant<br />
immédiatement les herbages. Elle peut comprendre<br />
<strong>des</strong> angles fermés <strong>et</strong> <strong>des</strong> angles<br />
ouverts. Les longs bâtiments non jointifs aux<br />
angles de la cour ménagent <strong>des</strong> passages vers<br />
les pâtures parfois plantées de fruitiers. On les<br />
ferme de barrières. Dans c<strong>et</strong>te disposition, très<br />
fréquente dans le Boulonnais, l'entrée principale<br />
de la cour s'effectue <strong>naturel</strong>lement face à l'habitation,<br />
par un angle ouvert, entre deux bâtiments,<br />
parfois dans la perspective de l’échappée<br />
vers les pâtures. Au sud du <strong>Parc</strong>, c<strong>et</strong>te<br />
disposition semble emprunter quelques caractéristiques<br />
du type picard <strong>et</strong> en propose <strong>des</strong><br />
variations dictées par <strong>des</strong> principes d'orientation<br />
<strong>et</strong> de distribution par rapport à la rue : grange<br />
fermée sur rue avec un angle ouvert ou habitation<br />
sur rue avec porche indépendant.<br />
-> bâtiments contigüs sur cour fermée<br />
(gran<strong>des</strong> exploitations)<br />
C<strong>et</strong>te disposition ne<br />
laisse échapper<br />
aucun passage sur les<br />
angles, hormis l'entrée<br />
principale. Si elle<br />
est courante en<br />
Picardie où l'exploitation<br />
répond à une<br />
préoccupation de défense, elle se rencontre<br />
très rarement dans le <strong>Parc</strong>.<br />
L’évolution<br />
A la fin du XIX ème siècle (1850-1900), les théories<br />
architecturales sont progres-sivement orientées<br />
par la préoccupation de l'hygiène pour les hommes<br />
<strong>et</strong> les animaux, <strong>et</strong> par le rendement économique.<br />
Cependant, elles restent confinées <strong>et</strong> ne<br />
sont pas appliquées dans les campagnes, sauf<br />
exception, comme dans le Canton de Samer où<br />
l'influence de la Société d'Agriculture se fait ressentir<br />
avec la constructions de «fermes nouvelles».<br />
Il faut attendre les années 60 pour voir de<br />
profonds bouleversements dans l'organisation<br />
de l'exploitation agricole.<br />
Aujourd’hui, les ensembles sur cour fermée s'adaptent<br />
difficilement aux exigences techniques<br />
actuelles de l'exploitation agricole. C'est pourquoi<br />
ils sont menacés.<br />
OBSERVER<br />
L'EXISTANT POUR<br />
CONSTRUIRE<br />
DU NEUF<br />
Pour bien intégrer sa demeure neuve<br />
dans un paysage, la meilleure façon<br />
de procéder est d'observer le<br />
patrimoine bâti existant <strong>et</strong> la<br />
végétation.<br />
Voici quelques éléments à prendre en<br />
compte :<br />
- l'implantation : placez la maison au<br />
plus près du sol <strong>naturel</strong><br />
- l'orientation : placez les faça<strong>des</strong> au<br />
sud-ouest <strong>et</strong> nord-ouest <strong>et</strong> orientez<br />
votre demeure comme les<br />
bâtiments existants<br />
- les volumes : conservez les<br />
proportions <strong>et</strong> les pentes<br />
traditionnelles de toiture<br />
- les ouvertures : gardez <strong>des</strong> fenêtres<br />
plus hautes que larges (au moins 3<br />
pour 2)<br />
- les enduits : les couleurs, les détails.<br />
Les murs enduits sont souvent de<br />
couleurs simples <strong>et</strong> claires. Les<br />
menuiseries sont toujours peintes.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 11
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
12 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Histoire <strong>et</strong> géographie <strong>des</strong> matériaux<br />
La relation au sol <strong>et</strong> à ses ressources<br />
géologiques conditionne profondément<br />
la typologie <strong>des</strong> constructions<br />
rurales. Cependant, l'emploi <strong>des</strong><br />
matériaux de construction sur un<br />
territoire donné dépend non<br />
seulement de ses ressources <strong>naturel</strong>les<br />
locales, mais aussi du niveau de<br />
développement de ses voies de<br />
transports <strong>et</strong> du pouvoir d’achat <strong>des</strong><br />
individus qui y résident. En eff<strong>et</strong>,<br />
jusqu’au début du XXème siècle, l’état<br />
médiocre <strong>des</strong> voies de communication<br />
rendait fort onéreuse l’utilisation <strong>des</strong><br />
matériaux de construction de bonne<br />
qualité mais de provenances<br />
lointaines.<br />
Alembon «les deux principaux chemins<br />
d'Alembon à Licques <strong>et</strong> d'Hardinghen à<br />
Licques sont en très mauvais état <strong>et</strong> impraticables.<br />
On ne peut les améliorer qu'en les<br />
cailloutant»<br />
Licques «les chemins sont très défectueux<br />
par le grand nombre de monde <strong>et</strong> de bestiaux<br />
qui viennent au marché de Licques qui<br />
est très considérable. Pour les améliorer il<br />
faudrait au moins 1000 charées "de cailloux<br />
<strong>et</strong> 400" charées de moellons, en commençant<br />
le travail par les entrées de Licques»<br />
Hardinghen «le chemin... pour relier<br />
Guines à Desvres en débouchant (à)<br />
Hardinghen, Boursin, le Wast <strong>et</strong> Alincthun<br />
[est] inabordable 9 mois de l'année» (5)<br />
Ainsi, le bâtisseur était contraint d’employer<br />
les matériaux dont il disposait à portée de<br />
main.<br />
LES PRODUITS VÉGÉTAUX<br />
Le bois<br />
Les forêts de Flandre <strong>et</strong> de l'Artois constituent<br />
autant de réserves <strong>naturel</strong>les où chaque<br />
bâtisseur peut tirer aisément tout le bois<br />
nécessaire à chaque construction. Les essences<br />
tirées <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> forêts du Boulonnais<br />
sont, elles, réservées pour l'essentiel à la<br />
construction <strong>des</strong> charpentes <strong>des</strong> nobles<br />
bâtisses, <strong>des</strong> édifices religieux ou à la construction<br />
<strong>des</strong> charpentes de marine.<br />
Le paysan-constructeur n'a souvent d'autres<br />
ressources que celles que lui procurent ses<br />
terres. Il n’achète du bois qu’après avoir<br />
épuisé celui de ces haies, <strong>des</strong> bois durs, tirés<br />
<strong>des</strong> près <strong>et</strong> forêts <strong>des</strong> alentours : le chêne, le<br />
frêne, le hêtre <strong>et</strong> surtout l’orme, alors très<br />
abondants.<br />
Dans la construction <strong>des</strong> maisons en pans<br />
de bois <strong>et</strong> terre, l'orme est utilisé pour la<br />
structure <strong>des</strong> pans de murs, le chêne pour<br />
les sablières basses. Les bois blancs sont utilisés<br />
pour les menuiseries (portes, fenêtres,<br />
bâti) <strong>et</strong> les planchers. Des bois secondaires<br />
fendus (nois<strong>et</strong>ier…) étaient employés<br />
comme matériaux de remplissage (lattage…).<br />
Souvent, les murs <strong>des</strong> dépendances agricoles<br />
<strong>et</strong> l'un <strong>des</strong> pignons de l'habitation sont<br />
protégés par un<br />
bardage fait de<br />
planches de bois<br />
posées «à clins». Il<br />
s'agit généralement<br />
de dosses de<br />
bois ou <strong>des</strong> planches<br />
brutes qui<br />
proviennent de la<br />
scierie la plus pro-<br />
che, disposées horizontalement. Chaque clin<br />
recouvre le bord du clin inférieur, pour faciliter<br />
le ruissellement de l’eau.<br />
Applications<br />
Orme structure <strong>des</strong> colombages, poutres,<br />
planches à clin<br />
Chêne pièces horizontales (linteaux poutres),<br />
pièces exposées aux intempéries (appuis de<br />
fenêtres, sole)<br />
Aulne, Peuplier bâtis de portes <strong>et</strong> fenêtres<br />
Nois<strong>et</strong>ier, Aulne clayonnage (fendu)<br />
La paille <strong>et</strong> les paill<strong>et</strong>tes<br />
Elles entrent dans la composition <strong>des</strong> torchis<br />
pour hourdir les murs à pans de bois. La paille<br />
de blé <strong>et</strong> les paill<strong>et</strong>tes de seigle sont les résidus<br />
végétaux de la moisson les plus couramment<br />
utilisés. Les paill<strong>et</strong>tes de seigle possèdent, diton,<br />
la vertu d’écarter les rongeurs.<br />
Le chaume<br />
Il désigne, généralement,<br />
la partie de la<br />
tige d'une graminée<br />
qui reste dans les<br />
champs une fois la<br />
récolte du grain<br />
effectuée. A l'origine,<br />
le chaume entre<br />
dans la composition<br />
<strong>des</strong> couvertures <strong>des</strong><br />
constructions rurales. L'étanchéité du toit de<br />
chaume tient à sa nature, à sa pente, à sa bonne<br />
mise en oeuvre, au tassement. Le chaume de<br />
roseau ou de paille sont utilisés. La couverture<br />
de roseau est plus résistante que celle en paille,<br />
mais elle exige plus de temps, plus d’adresse <strong>et</strong><br />
plus de bois pour le clayonnage. Un toit de
chaume de roseaux peut durer une quarantaine<br />
d'années, une trentaine pour le toit de paille.<br />
Peu résistant au feu, ce type de couverture a été<br />
remplacé, dès le XIV ème siècle, par <strong>des</strong> pannes<br />
de pays en terre cuite. A sa disparition, vers le<br />
milieu du XIX ème siècle, l'inclinaison <strong>des</strong> pentes<br />
de toit ont parfois été modifiées (pignons <strong>et</strong><br />
charpente), notamment pour réaliser un comble<br />
de surcroît ou rehausser les plafonds <strong>des</strong><br />
pièces d’habitation souvent très bas à l’origine.<br />
LES PIERRES<br />
Les calcaires <strong>et</strong> les grès<br />
Trois qualités de pierre sont donc distinguées :<br />
- le calcaire dur à grains fins, dit «pierre marbrière»<br />
- le calcaire tendre <strong>et</strong> coquiller dit «pierre de<br />
Marquise»<br />
- le grès jurassique dit «pierre de Baincthun»<br />
ou «pierre de Boulogne»<br />
Chacun forme un matériau constructif de grande<br />
résistance utilisé d’abord à proximité du bassin<br />
carrier. Le transport <strong>des</strong> moellons taillés est<br />
néanmoins extrêmement coûteux. Le transport<br />
s'effectue principalement à partir <strong>des</strong> cours<br />
d'eau, notamment par le canal de Guînes pour<br />
les <strong>des</strong>tinations lointaines.<br />
Utilisations<br />
Calcaire dur dit «pierre marbrière» organes<br />
sensibles de la construction : chaînage d'angle,<br />
linteaux, soubassements, pied-droits <strong>des</strong><br />
porte, pierre de seuil, dallage de grands format,<br />
bordure de voie, jambages de cheminées,<br />
corps de maçonnerie, remplissage sous<br />
forme de moellons à proximité immédiate du<br />
bassin carrier de Marquise, pavage, bornes,<br />
tombes…<br />
Calcaire dit «pierre de Marquise» encadrements<br />
de fenêtres <strong>et</strong> portes, maçonneries de<br />
moellons près de Marquise…<br />
Grès corps de maçonnerie, remplissage, murs<br />
de clôture, pavage, soubassements d’édifices<br />
particuliers<br />
La craie ou «pierre à bâtir»<br />
La qualité de la craie<br />
est fort diverse :<br />
certains gisements<br />
contiennent du silex<br />
ou "pigeons", <strong>des</strong><br />
fossiles de coquillages<br />
<strong>et</strong> même d'oursins de<br />
mer qui peuvent<br />
gêner la taille.<br />
Certains présentent<br />
une craie plus ou moins résistante à l'humidité<br />
<strong>et</strong> au gel. Dans la construction rurale<br />
traditionnelle, la craie s'appuie toujours sur un<br />
soubassement en pierres dures (calcaires durs,<br />
silex, brique) <strong>et</strong> n'est jamais directement en<br />
contact avec les remontées capillaires. Ce<br />
matériau présente néanmoins l'intérêt de ne<br />
pas brûler : il est donc très précieux pour la<br />
construction <strong>des</strong> fours <strong>et</strong> <strong>des</strong> fourneaux, <strong>des</strong><br />
âtres <strong>et</strong> <strong>des</strong> jambages de cheminées.<br />
C<strong>et</strong>te roche est exploitée en moellons de p<strong>et</strong>it<br />
appareil, en bloc parallélépipédique, court, d'assises<br />
réglées. A l'exception <strong>des</strong> pierres <strong>des</strong>tinées<br />
au renforcement <strong>des</strong> angles <strong>des</strong> constructions<br />
(chaînage d'angle), leurs dimensions dépassent<br />
rarement les 30cm, notamment pour éviter les<br />
éventuelles cassures dues au tassement <strong>des</strong><br />
murs. Aussitôt son extraction <strong>des</strong> carrières souterraines,<br />
la craie blanche passe un an ou deux<br />
(à l'épreuve de deux hivers au moins) à l'air<br />
libre, période pendant laquelle un léger calcin<br />
se forme à leur surface. C'est encore en carrière<br />
que la taille <strong>des</strong> blocs est exécutée pour<br />
réduire le volume <strong>et</strong> le poids au transport. En<br />
moellons bruts, dits «cassons», la craie est hourdée<br />
au mortier de chaux <strong>et</strong> de sable pour bloquer<br />
le cœur <strong>des</strong> maçonneries à double parement<br />
<strong>et</strong> les fondations. L'exploitation <strong>des</strong> carrières<br />
de craie a depuis bien longtemps cessé.<br />
Utilisations<br />
Craie blanche âtres <strong>et</strong> jambages de cheminées,<br />
four, fourneaux, fertilisation <strong>des</strong> terres<br />
agricoles<br />
Craie blanche à silex pierre à chaux (voir<br />
liants)<br />
Craie grise pierre de taille, pignons, corps <strong>et</strong><br />
remplissage de maçonnerie, maçonneries<br />
voutées <strong>des</strong> caves, fertilisation…<br />
Le silex<br />
Le silex est un matériau immédiatement<br />
disponible, économique, mais il présente <strong>des</strong><br />
calibres très mo<strong>des</strong>tes <strong>et</strong> <strong>des</strong> formes totalement<br />
irrégulières. A la différence de la région<br />
voisine de la Somme, le silex n'est jamais par-<br />
DES SITES<br />
GÉOLOGIQUES<br />
REMARQUABLES<br />
Dans le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale, les roches<br />
racontent une histoire vieille de 400<br />
millions d'années.<br />
Pour découvrir c<strong>et</strong>te histoire, deux<br />
manières :<br />
- la première au travers <strong>des</strong> roches<br />
mises en œuvre dans le patrimoine<br />
bâti,<br />
- la deuxième grâce aux affleurements<br />
principalement dus aux falaises <strong>et</strong> aux<br />
carrières.<br />
Un inventaire <strong>des</strong> sites géologiques<br />
remarquables de la Région a été réalisé<br />
par le Conservatoire <strong>des</strong> Sites<br />
Naturels du Nord - Pas de Calais.<br />
Parmi les sites sélectionnés représentatifs<br />
de la géologie locale, certains ont<br />
été aménagés <strong>et</strong> ouverts au public,<br />
comme celui <strong>des</strong> carrières de Cléty.<br />
Panneaux <strong>et</strong> visites guidées vous présentent<br />
la craie sous tous ses aspects.<br />
Pour plus de renseignements, voir le<br />
document "La roche dans tous ses<br />
états" – livr<strong>et</strong> guide <strong>des</strong> sites géologiques<br />
du Nord - Pas de Calais.<br />
Conservatoire <strong>des</strong> Sites Naturels du<br />
Nord - Pas de Calais :<br />
Tél 03 28 04 53 45<br />
Fax. 03 20 71 79 20<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 13
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
14 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Histoire <strong>et</strong> géographie <strong>des</strong> matériaux (suite)<br />
faitement équarri,<br />
ni taillé en p<strong>et</strong>it<br />
moellons carrés,<br />
dans les constructions<br />
rurales du<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>Marais</strong> d’Opale.<br />
Mêlé à d’autre<br />
pierres, il perm<strong>et</strong><br />
de réaliser <strong>des</strong> fondations. Grossièrement<br />
aggloméré, assisé dans une quantité importante<br />
de mortier de chaux, il perm<strong>et</strong> de réaliser<br />
<strong>des</strong> maçonneries de soubassements, ce<br />
qui perm<strong>et</strong> d’isoler du sol humide de fragiles<br />
assises de constructions en craie ou en pans<br />
de bois <strong>et</strong> terre. Avec une face éclatée, il<br />
devient un matériau capable de former un<br />
parement tout à fait acceptable, allant même<br />
jusqu'à former un élégant motif dans la<br />
maçonnerie. Associé à d'autres matériaux,<br />
briques ou grès, il peut être monté en remplissage<br />
de mur gouttereaux, murs de clôture<br />
ou, le plus souvent, en pignons.<br />
Dans certains villages côtiers, les gal<strong>et</strong>s de<br />
mer, glanés sur la grève trouvent la même utilisation<br />
que le silex (Escalles, Sangatte)<br />
L’ardoise<br />
L'ardoise est une pierre tirée d'une roche<br />
appelée «schiste ardoisier». Plus communément,<br />
elle désigne ces p<strong>et</strong>ites dalles de schiste<br />
plates, rectangulaires ou carrées, utilisées<br />
en matériau de couverture. Sa teinte varie<br />
du gris-bleu quand elle provient du Bassin<br />
d'Angers, au vert, au viol<strong>et</strong>-rosé depuis les<br />
régions de Fumay <strong>et</strong> Rimogne (Ardennes) <strong>et</strong><br />
le pays de Galles (Penrhine-Royaume-Uni).<br />
Matériau onéreux, son utilisation se limite<br />
aux constructions nobles <strong>et</strong> bourgeoises. A<br />
la fin du XIX ème siècle <strong>et</strong> au XX ème siècle, elle se<br />
répand en coïncidant avec le développe-<br />
ment <strong>des</strong> transports <strong>et</strong> l'ère industrielle.<br />
L'ardoise devient alors un signe extérieur de<br />
prospérité.<br />
LA TERRE<br />
La terre crue<br />
Ces limons argileux, mêlés à <strong>des</strong> fibres végétales<br />
(pailles) <strong>et</strong> à une quantité suffisante d’eau,<br />
entrent <strong>naturel</strong>lement dans la composition <strong>des</strong><br />
constructions rurales du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale, employés pour<br />
hourdir les murs à ossatures de bois. L'argile<br />
provient généralement <strong>des</strong> fouilles exécutées<br />
sur place pour les besoins de la construction<br />
(fondations, cave, creusement de puits…).<br />
La terre cuite<br />
D'un usage très répandu, l’argile est utilisée<br />
pour la fabrication <strong>des</strong> briques, <strong>des</strong> matériaux<br />
de couverture comme la tuile plate, la panne<br />
flamande, la tuile mécanique <strong>et</strong> les divers accessoires<br />
de toitures, les carreaux de dallage ou de<br />
décoration....<br />
-> la brique<br />
Elle s'est généralisée<br />
en Flandre<br />
Maritime du XIIIème au XVème siècle mais<br />
les romains l'utilisaient<br />
déjà en la<br />
combinant avec la<br />
pierre par assises<br />
alternées.<br />
Introduite dans le<br />
Calaisis dans la seconde moitié du XIVème siècle,<br />
elle se propage dans le Haut-Artois <strong>et</strong> le<br />
Bas-Boulonnais au XVIème siècle. Au XIXème siècle,<br />
son emploi se généralise à l'architecture<br />
rurale <strong>et</strong> remplace progressivement le torchis<br />
<strong>et</strong> la pierre.<br />
Avant le développement <strong>des</strong> briqu<strong>et</strong>eries, les<br />
briques sont cuites sur les chantiers dans <strong>des</strong><br />
«fours à meules» à flamme directe. Toutes les<br />
opérations de leur fabrication se déroulent sur<br />
les lieux-mêmes du chantier par économie de<br />
transport. La brique offre alors <strong>des</strong> coloris<br />
variés, du jaune clair au rouge , suivant la nature<br />
géologique de l'argile dont elle est composée<br />
<strong>et</strong> la température de cuisson. En premier<br />
lieu, les briques sont traditionnellement moulées<br />
à la main, dans <strong>des</strong> cadres en bois. Leur format<br />
varie selon l'emploi de deux formes de<br />
moules : le grand moule a une taille de<br />
31x15x6cm, tandis que le p<strong>et</strong>it moule a une<br />
taille de 26x13x6cm. L'aplatissement <strong>des</strong> briques<br />
favorise le séchage de l'argile à l'air libre,<br />
à l'ombre de grands hangars. Puis, elles sont<br />
empilées par couche en intercalant du bois <strong>et</strong><br />
du charbon. L'ensemble est couvert. Il forme<br />
ainsi une meule rectangulaire orientée Est-<br />
Ouest pour activer le feu. Après une longue<br />
période de refroidissement, les briques sont triées.<br />
Les plus cuites sont conservées pour la<br />
construction. Les moins cuites, poreuse ou pulvérulentes,<br />
sont recuites ou vendues à bas prix<br />
pour construire <strong>des</strong> édifices de moindre qualité.<br />
C'est avec l'extraction du charbon à la fin du<br />
XVIII ème <strong>et</strong> au XIX ème siècle <strong>et</strong> le développement<br />
<strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites briqu<strong>et</strong>eries, que l'usage de la brique<br />
cuite se répand dans les campagnes.. A ce<br />
début d'industrialisation, ce matériau reste d'un<br />
coût élevé. C'est pourquoi, le paysan qui désormais<br />
peut y prétendre, ne l'utilise que pour<br />
les parties constructives les plus sensibles, celles<br />
qui demandent résistance <strong>et</strong> durée : le solin,<br />
les assises obliques finissant les rampants <strong>des</strong><br />
pignons de calcaires, les cheminées <strong>et</strong> fours à<br />
pains... Les murs gouttereaux restent élevés en<br />
pans de bois <strong>et</strong> torchis.
L'argile est ici cuite à une température proche<br />
<strong>des</strong> 1100°C, dans <strong>des</strong> «fours à chambres», à feu<br />
continu, cloisonnés en maçonnerie. Les briques,<br />
plus dures, deviennent aussi plus cassantes<br />
; d'une couleur sombre, elles sont moins flatteuses<br />
au regard. Une fois cuites, elles passent<br />
un hiver au dehors pour en éprouver la qualité:<br />
au delà de c<strong>et</strong>te période, elle doivent sonner<br />
clair sous le coup de truelle du maçon. Leur format<br />
se réduit à 22x11x6cm <strong>et</strong> devient parfaitement<br />
calibré. Certains éléments peuvent être<br />
aussi vernissées avec <strong>des</strong> glaçures vives. A c<strong>et</strong>te<br />
époque <strong>et</strong> avec la maîtrise du processus de<br />
fabrication, les briques deviennent un véritable<br />
produit de série.<br />
Économique, rapide au montage, <strong>et</strong> support de<br />
motifs décoratifs, la brique possède encore <strong>des</strong><br />
qualités thermiques <strong>et</strong> hygiéniques. Les matériaux<br />
traditionnels anciens sont alors délaissés.<br />
Un certain nombre de briqu<strong>et</strong>eries <strong>et</strong> tuileries<br />
artisanales ou familiales ont été dénombrées<br />
dans le territoire du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale, à Houlle, Arques,<br />
Ruminghem, Nieurl<strong>et</strong>, Lacres, Réty…<br />
-> la panne<br />
La panne est l'appellation courante de la tuile<br />
dans le Nord de la France. Elle a remplacé progressivement<br />
dès le XIV ème siècle le chaume,<br />
avec l'intérêt de<br />
réduire considérablement<br />
les risques<br />
d'incendie. Son<br />
usage ne s'étend<br />
réellement aux<br />
constructions rurales<br />
qu'au XVIII-<br />
XIX ème siècles avec<br />
l'apparition du charbon<br />
<strong>et</strong> le dévelop-<br />
pement <strong>des</strong> briqu<strong>et</strong>eries <strong>et</strong> <strong>des</strong> tuileries. C'est<br />
ainsi que le centre important pour la fabrique<br />
de pannes de Samer peut expliquer en partie le<br />
développement de l'usage <strong>des</strong> pannes flaman<strong>des</strong><br />
dans le Boulonnais. La forme variée <strong>des</strong><br />
pannes <strong>et</strong> les différentes teintes données par les<br />
argiles <strong>et</strong> la cuisson procurent aux toitures une<br />
qualité architecturale forte.<br />
Les diverses types de tuiles employées suivent<br />
l'évolution <strong>des</strong> techniques de production. Il faut<br />
r<strong>et</strong>enir :<br />
- la tuile plate ou tuileau. Employée dès le<br />
Moyen-Age, elle a pratiquement disparu du<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong><br />
d’Opale. Quelques rares exemples peuvent<br />
être observés en matériau de couverture de<br />
lucarnes à Saint-Omer, de quelques maisons du<br />
boulonnais, ou de quelques maisons de<br />
pécheurs. Elle est aussi employée en bardage<br />
pour recouvrir notamment la surface de<br />
pignons ou les jouées de lucarnes.<br />
- la panne flamande. De profil très cintré, en<br />
forme en «S» prononcé, moulée à la main, elle<br />
est très répandue dans la Flandre. Son utilisation<br />
devient plus diffuse auprès du Bas-Artois.<br />
Elle est dotée d'un croch<strong>et</strong> qui est moulé dans<br />
la masse sur la face interne. Un bourrel<strong>et</strong> de<br />
recouvrement perm<strong>et</strong> de chevaucher la panne<br />
voisine. Ses dimensions sont proches de 22cm x<br />
30cm de longueur. Deux types de tuiles étaient<br />
fabriquées par les tuileries, répondant ainsi aux<br />
exigences <strong>des</strong> vents dominants : <strong>des</strong> tuiles droites<br />
(à recouvrement droit) étaient posées sur le<br />
versant sud de la toiture <strong>et</strong> les tuiles gauches<br />
posées sur le versant nord. Le vent glissait alors<br />
sur les tuiles sans les soulever. Un <strong>des</strong> angles<br />
inférieurs est coupé en biais, facilitant l’emboîtement.<br />
Le premier rang de panne est scellé <strong>et</strong><br />
cloué.<br />
- la panne artésienne ou picarde. Variante de la<br />
panne flamande, elle apparaît au XIX ème siècle <strong>et</strong><br />
se développe sur les toits du Boulonnais. Elle<br />
s'apparente à une panne flamande aplatie, à<br />
bourrel<strong>et</strong> de recouvrement, toujours saillant<br />
mais moins prononcé. Sa forme régulière est<br />
obtenue par un moule en bois.<br />
- la tuile à emboîtement ou mécanique. Par<br />
opposition aux anciennes pannes qui se fabriquent<br />
à la main, c<strong>et</strong>te tuile est produite avec<br />
<strong>des</strong> procédés mécaniques.<br />
Les pannes peuvent être vernissées avec l'application<br />
d'une glaçure d'une jolie teinte<br />
brun-viol<strong>et</strong>. D'un coût élevé, leur emploi sur<br />
la totalité de la toiture distingue une prospérité<br />
ou le rang social élevé du propriétaire.<br />
-> les pannes accessoires<br />
La fabrication de pannes spécifiques a<br />
remplacé <strong>et</strong> amélioré les métho<strong>des</strong> de<br />
construction anciennes. Des pannes de rive<br />
présentent l'intérêt de prolonger la surface<br />
de couverture en formant le dosser<strong>et</strong> oblique<br />
du pignon <strong>et</strong> protégeant les murs pignons.<br />
Des pannes chatières ou pannes d'aération<br />
disposées ponctuellement perm<strong>et</strong>tent la<br />
ventilation <strong>des</strong> combles aveugles. Des<br />
pannes faîtières terminent <strong>et</strong> protègent les<br />
derniers lits de tuiles de la couverture, selon<br />
différentes techniques :<br />
- la panne faîtière angulaire. Crêtée <strong>et</strong> vernissée<br />
d'une glaçure, elle est, dit-on, moulée à la main<br />
sur la cuisse de l'ouvrier-tuilier., tandis que la<br />
crête denticulée est formée au doigt. En voie<br />
complète de disparition, elle reste surtout<br />
visible en association avec les couvertures en<br />
ardoises.<br />
- la panne faîtière demi-ronde. Elle est posée<br />
côte à côte, à plein bain de mortier, parfois, les-<br />
FAÏENCE<br />
DE DESVRES<br />
ET HABITAT<br />
La rencontre en 1764 de Jean-<br />
François Sta, notaire <strong>et</strong> entrepreneur<br />
faïencier <strong>et</strong> de François-Joseph<br />
Fourmaintraux, marque le début<br />
d'une activité créatrice qui a influencé<br />
la décoration mais également<br />
l'habitat. En eff<strong>et</strong>, si les manufactures<br />
Masse, Martel, Fourmaintraux se sont<br />
imposées dans la copie <strong>des</strong> grands<br />
styles français <strong>et</strong> étrangers comme<br />
Rouen, Strasbourg, Delft, Nevers…<br />
c'est au travers <strong>des</strong> carreaux que<br />
Desvres a le mieux exprimé ses<br />
créations.<br />
De la salle d'estamin<strong>et</strong> au manoir, ils<br />
furent adoptés en masse dans le<br />
Boulonnais au XIX ème siècle <strong>et</strong> jusque<br />
dans les années 1930.<br />
Aujourd'hui de nombreuses<br />
boutiques de Desvres, l'auberge de<br />
Mémère Harle à Wirwignes, ou le<br />
café Verlingue à Hesdigneul, voient<br />
leurs faça<strong>des</strong> <strong>et</strong> leurs intérieurs<br />
illuminés par ces fresques, frises ou<br />
plaques fleuries…<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 15
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
16 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Histoire <strong>et</strong> géographie <strong>des</strong> matériaux (suite)<br />
tée d'un cordon de briques maçonné chaulé.<br />
Deux ou quatre pannes faîtières demi-ron<strong>des</strong><br />
posées sur un socle de briques au somm<strong>et</strong> de<br />
la cheminée peuvent former une mitre <strong>et</strong> améliorer<br />
le tirage du foyer<br />
- la panne faîtière à bourrel<strong>et</strong> d'emboîtement. Le<br />
bourrel<strong>et</strong> d'emboîtement propose un progrès<br />
notable pour le recouvrement de la ligne de faîtage.<br />
Il existe une forme longue <strong>et</strong> une forme<br />
courte.<br />
- la panne faîtière ouvragée. Elle est décorée de<br />
motifs festonnés de formes variées, souvent à<br />
p<strong>et</strong>its fleurons trèfles, alternativement hauts <strong>et</strong><br />
courts, parfois vernissée d'une glaçure sombre.<br />
Le complexe de toiture associe d'autres accessoires<br />
en terre cuite. Parmi ceux-ci, les mitrespots<br />
de cheminée disposés selon l'orientation<br />
<strong>des</strong> vents dominants, offrent un meilleur tirage<br />
<strong>des</strong> feux au charbon. Les épis de faîtage, en<br />
terre cuite vernissée ou en zinc sont très rares<br />
dans le périmètre du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale.<br />
-> les carreaux en terre cuite <strong>et</strong> faïences<br />
Ils sont surtout <strong>des</strong>tinés aux dallages intérieurs<br />
mais peuvent aussi tapisser les murs. Le décor<br />
est estampillé dans la terre crue, avec engobe<br />
de terre blanche, virant au jaune pendant la<br />
cuisson. Parallèlement à la production industrielle<br />
de briques, <strong>des</strong> carreaux de terre cuite<br />
sont réalisés de la même façon, moulés avec un<br />
cadre en bois. A l'origine sur un format de<br />
20x20x4cm d'épaisseur, leurs dimensions se<br />
réduisent ensuite à un format carré de l4cm de<br />
côté pour 1,5cm d'épaisseur.<br />
La tom<strong>et</strong>te polygonale devient plus fréquente à<br />
partir du XIX ème siècle.<br />
Les carreaux de faïence sont de la même famille<br />
que les produits de terre cuite mais datent plu-<br />
tôt du XVII ème siècle.<br />
Ils servent à tapisser<br />
certaines parties<br />
<strong>des</strong> murs intérieurs<br />
comme les fonds<br />
de cheminée, de<br />
part <strong>et</strong> d'autre du<br />
cœur, <strong>et</strong> les dosser<strong>et</strong>s<br />
d'évier, pour<br />
protéger les murs.<br />
Leur coût élevé les<br />
rend plutôt rares en<br />
campagne. On les r<strong>et</strong>rouve donc surtout aux<br />
abords <strong>des</strong> centres de production traditionnellement<br />
réputés : Boulogne, Desvres, Saint-<br />
Omer... Au début XIX ème , les manufactures faïencières<br />
de Desvres, spécialisées dans la copie<br />
<strong>des</strong> grands styles français <strong>et</strong> étrangers<br />
(Moustiers, Rouen, Strasbourg, Nevers, Delft..)<br />
développent la production de p<strong>et</strong>ites séries de<br />
carreaux qui trouvent une place privilégiée,<br />
plus ou moins discrètement dans les constructions<br />
rurales ou les maisons de bourg. Des<br />
cabochons <strong>et</strong> rinceaux (frise) ponctuent certaines<br />
faça<strong>des</strong> tandis que <strong>des</strong> fresques illustrent la<br />
campagne boulonnaise dans l'intérieur <strong>des</strong><br />
p<strong>et</strong>its commerces. Il est encore possible de<br />
trouver <strong>des</strong> enseignes réalistes en céramique<br />
(voir la Maison de la Faïence à Desvres).<br />
LES LIANTS<br />
L’argile<br />
L’argile est également le liant le plus économique.<br />
Additionnée d'une quantité relativement<br />
faible de chaux, elle entre parfois dans la composition<br />
du mur extérieur en pierres. Ce mortier<br />
de terre, appelé par les maçons «mortier d'hirondelle»,<br />
apporte une excellente isolation thermique.<br />
Ce mortier est aussi employé pour la<br />
maçonnerie <strong>des</strong> fours <strong>et</strong> foyers.<br />
La chaux<br />
La chaux <strong>naturel</strong>le était produite en fonction<br />
<strong>des</strong> besoins <strong>et</strong> suivant les disponibilités en bois<br />
<strong>et</strong> en calcaire. Une fosse de 2 à 3 mètres de<br />
profondeur constitue le four à chaux. Remplie<br />
de bois (foyer), la fosse est couverte, dans un<br />
premier temps, de pierres à chaux, puis d'autres<br />
pierres disposées en voûte, enfin de terre.<br />
La cuisson se fait à une température de 900°<br />
environ <strong>et</strong> dure une dizaine de jours. Les blocs<br />
désagrégés par calcination en chaux vive sont<br />
transportés sur les chantiers <strong>et</strong> transformés en<br />
chaux éteinte par immersion dans <strong>des</strong> fosses<br />
d'eau. L’apparition de fours combinés avec<br />
<strong>des</strong> cheminées de briques améliore la cuisson<br />
<strong>et</strong> la qualité <strong>des</strong> chaux obtenues (Alquines).<br />
Des fours à chaux artisanaux furent longtemps<br />
exploités, jusqu'à une période récente, dans<br />
un certain nombre de p<strong>et</strong>ites carrières, notamment<br />
dans le pays de Licques, à Autingues,<br />
Landr<strong>et</strong>hun-les-Ardres, Nort-Leulinghem…<br />
Mélangée avec du sable, la chaux éteinte<br />
donne un mortier très collant qui présente l'avantage<br />
de bien adhérer à la maçonnerie<br />
pour la protéger contre la pluie <strong>et</strong> le gel <strong>et</strong> de<br />
lui perm<strong>et</strong>tre de respirer en facilitant les<br />
échanges gazeux.<br />
Les particules les plus fines, la «fleur de<br />
chaux», sont réservées à la confection <strong>des</strong><br />
badigeons (additionnées parfois de pigments<br />
<strong>naturel</strong>s).<br />
Les chaux <strong>naturel</strong>les sont plus ou moins<br />
hydrauliques suivant la présence ou non de<br />
silice dans le calcaire (argile). Les chaux les<br />
plus pures sont dites «aériennes» car elles ne<br />
réagissent qu’à l'air ; leur teneur en silice soluble<br />
est inférieure à 2%.
Le ciment<br />
Découvert en Angl<strong>et</strong>erre en 1824, son utilisation<br />
se développe très rapidement Outre-<br />
Manche. Ce ciment dît «de Portland», est obtenu<br />
par cuisson à haute température (l400°C) de<br />
calcaire mêlé à 25% d'argile très silicieuse. Les<br />
cimentiers du Boulonnais en ont été pendant<br />
très longtemps les premiers producteurs de<br />
France. Le coteau sud du Boulonnais était alors<br />
exploité à Lottinghen, Desvres, Nesles,<br />
Neufchatel-Hardelot <strong>et</strong> Dannes du fait de la présence<br />
continue de craie marneuse, de craie<br />
pure <strong>et</strong> d'une argile adéquate sous-jacente.<br />
C'est pourquoi, il est possible de remarquer la<br />
présence marquée du parpaing <strong>et</strong> de l'enduit<br />
au ciment dans l'habitat rural de ses localités<br />
depuis le début du XX ème siècle. Seule, la carrière<br />
de Dannes fonctionne encore.<br />
Depuis la fin du XIX ème siècle, le ciment <strong>et</strong> les<br />
chaux hydrauliques artificielles ont été utilisés<br />
de manière excessive sur le patrimoine ancien.<br />
Certains murs en maçonnerie ou en torchis,<br />
certains soubassements, en ont été recouverts<br />
à tort avec, en conséquence du durcissement<br />
très rapide <strong>des</strong> fissurations (aucune souplesse<br />
au durcissement) <strong>et</strong> une condensation intérieure<br />
(empêchement de tout échange gazeux <strong>et</strong><br />
emprisonnement de l'humidité circulant dans<br />
les maçonneries). Il faut donc r<strong>et</strong>enir que les<br />
ciments <strong>et</strong> chaux hydrauliques artificielles sont<br />
peu adaptés à la réhabilitation du patrimoine<br />
ancien.<br />
LES AGREGATS<br />
Le terme «agrégats» désigne les matériaux de<br />
construction telles que les sables, les graviers, la<br />
brique pilée qui entrent dans la composition<br />
<strong>des</strong> mortiers.<br />
La brique pilée<br />
La brique pilée, appelée également<br />
«chamotte», peut parfois avoir été ajoutée<br />
aux mortiers de chaux pour en augmenter la<br />
plasticité <strong>et</strong> la dur<strong>et</strong>é. Quelques rares<br />
exemples aux jolies teintes rosées peuvent<br />
être observés sur les soubassements de grès<br />
de certaines églises.<br />
Utilisations<br />
Brique pilée Agrégats pour mortie<br />
La Maison du Marbre <strong>et</strong> de la Géologie à Rinxent, une<br />
découverte <strong>des</strong> matériaux du sous-sol du boulonnais, de la<br />
geéologie, <strong>et</strong> <strong>des</strong> techniques d'extraction.<br />
Les sables <strong>et</strong> graviers<br />
Les sables proviennent de la désagrégation<br />
ou du concassage de roches <strong>naturel</strong>les. Il en<br />
existe trois groupes :<br />
- les sables siliceux, résultats de la<br />
décomposition de roches granitiques ou<br />
gréseuses<br />
- les sables calcaires, issus de la<br />
décomposition de roches calcaires<br />
- les sables de carrière, formés en général par<br />
un mélange silico-calcaire.<br />
Des carrières ont existé à Audresselles<br />
(sables du Chatillon) <strong>et</strong> Tardinghen (sables du<br />
Chatillon <strong>et</strong> du Fart), à Wissant (sables du<br />
Fart), à Samer, Verlincthun <strong>et</strong> Boursin.<br />
D'autres p<strong>et</strong>its gisements dits «trous à sable»<br />
ont été exploités de manière artisanale, au<br />
Ventu d'Alembon,, à la ferme du bois de<br />
l'Abbaye de Landr<strong>et</strong>hun-les-Ardres pour<br />
entrer dans la composition <strong>des</strong> mortiers ou<br />
plus simplement pour sabler les carrelages<br />
(sable blanc). Leur qualité inégale <strong>et</strong><br />
médiocre, leur faible extension horizontale<br />
expliquent le caractère éphémère de leur<br />
exploitation. Il existe encore quelques<br />
exploitations sur les territoires de Tingry,<br />
Verlincthun <strong>et</strong> dans le massif dunaire<br />
d'Ecault, Helfaut, zouafques, Blendecques...<br />
Utilisations<br />
Sables <strong>et</strong> graviers Agrégats pour mortiers<br />
CHAUX OU CIMENT ?<br />
Les chaux <strong>naturel</strong>les utilisées comme<br />
liant dans le rejointement, ou en<br />
enduit, se sont beaucoup développées<br />
durant le XIXème siècle, avant d'être<br />
concurrencées par le ciment.<br />
On redécouvre depuis peu leurs qualités<br />
(souplesse, respiration <strong>naturel</strong>le <strong>des</strong><br />
patine…). Les chaux <strong>naturel</strong>les aériennes<br />
sont recommandées pour la réalisation<br />
d'enduits à la fois souples <strong>et</strong><br />
résistants laissant bien respirer les<br />
matériaux supports.<br />
Les chaux de construction <strong>naturel</strong>les se<br />
répartissent en deux catégories principales.<br />
Les CHAUX AERIENNES<br />
Qui font leur prise à l'air. Elles sont<br />
obtenues par calcination de calcaire<br />
pur ou associé à du carbonate de<br />
magnésium. On trouve facilement de<br />
la chaux aérienne éteinte en poudre ou<br />
en pâte :<br />
CL 90 – CL 80 – C 70 : chaux calciques<br />
DL 85 – DL 80 : chaux dolomitiques<br />
Les CHAUX HYDRAULIQUES<br />
Les chaux hydrauliques <strong>naturel</strong>les font<br />
leur prise à l'eau. Elles sont obtenues à<br />
partir de roches calcaires argileuses.<br />
NHL : chaux hydraulique <strong>naturel</strong>le pure<br />
obtenue par cuisson<br />
Par ailleurs, les chaux sont classées en<br />
fonction de leur résistance à la composition<br />
(de 2 pour les plus faibles à 5<br />
pour les plus résistantes).<br />
Les chaux hydrauliques<br />
artificielles<br />
XHA, mélanges de clinker <strong>et</strong> de calcaire,<br />
font partie <strong>des</strong> ciments à maçonner <strong>et</strong><br />
sont à éviter absolument comme liant<br />
(mortier à maçonner) que comme enduit<br />
(elles ne laissent pas respirer le mur).<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 17
18 I Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les types de construction<br />
I PARTIE 1 I
Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> torchis<br />
Localisation <strong>des</strong> constructions rurales<br />
en pans de bois <strong>et</strong> torchis<br />
Traditionnellement construites à l'usage<br />
d'habitation ou d'exploitation, elles sont<br />
éparpillées dans la campagne <strong>et</strong> les<br />
p<strong>et</strong>its bourgs.<br />
Utilisant une technique de construction<br />
simple <strong>et</strong> peu onéreuse à base de matériaux<br />
trouvés sur place (bois, terre,<br />
paille), elles sont encore assez nombreuses<br />
dans les <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> marais d'Opale.<br />
Cependant, la fragilité de ces matériaux,<br />
le manque d'entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> la perte du<br />
savoir-faire du torchis raréfient ce patrimoine.<br />
UNE MAISON TYPIQUE<br />
EN PANS DE BOIS ET TORCHIS<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Le pignon orienté vers l'ouest, maçonné<br />
<strong>et</strong> aveugle (sans ouverture), dépassant du<br />
toit <strong>et</strong> de la façade.<br />
La toiture à deux versants identiques<br />
d'une inclinaison de 50°, recouverte de<br />
tuiles de pays de teinte rouge orangée.<br />
L'ossature bois, posée sur le soubassement,<br />
disparaît dans le torchis. Elle détermine<br />
l'emplacement <strong>des</strong> fenêtres <strong>et</strong> <strong>des</strong> portes,<br />
irrégulières dans leur forme <strong>et</strong> leur position.<br />
Le pignon orienté est, est protégé par<br />
un bardage (un assemblage) de lames de<br />
bois horizontales “planches à clin”.<br />
Le torchis, mélange de terre <strong>et</strong> de paille<br />
qui remplit <strong>et</strong> enrobe l'ossature bois, est<br />
protégé par un enduit à la chaux, peint<br />
d'un badigeon de lait de chaux le plus<br />
souvent de couleur blanche.<br />
Le soubassement de briques ou de<br />
pierres est souvent goudronné au coaltar.<br />
<br />
<br />
LE TORCHIS,<br />
UN SAVOIR-FAIRE<br />
ET UN <strong>PATRIM</strong>OINE<br />
A SAUVER<br />
Depuis 2001, le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>,<br />
la Chambre de Métiers, la CAPEB,<br />
<strong>des</strong> associations comme Maisons<br />
Paysannes de France <strong>et</strong> Campagnes<br />
Vivantes, le Conseil d'Architecture,<br />
d'Urbanisme <strong>et</strong> d'Environnement <strong>et</strong><br />
les services de l'Etat (DRAC <strong>et</strong> SDAP)<br />
se sont associés pour faire revivre ce<br />
patrimoine <strong>et</strong> les savoir-faire attenants.<br />
Une exposition itinérante présente le<br />
patrimoine torchis, sa technique de<br />
mise en œuvre, ses pathologies, ses<br />
qualités, les principaux fournisseurs<br />
de matériaux <strong>et</strong> artisans. Elle est<br />
disponible pour les communes <strong>et</strong><br />
associations, sur demande auprès du<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>.<br />
Une maqu<strong>et</strong>te au 1/10 ème d'une maison<br />
à pan de bois <strong>et</strong> torchis réalisée avec le<br />
concours de Maisons Paysannes de<br />
France constitue un outil d'animation<br />
pédagogique attractif pour déchiffrer<br />
les mystères du montage de la<br />
structure bois.<br />
suite page 21<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 19
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
20 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> torchis (suite)<br />
LA CONSTRUCTION :<br />
La construction se définit par un plan allongé,<br />
d'une largeur de 4 à 5 mètres environ.<br />
Elle comprend souvent deux pièces principales<br />
séparées par une cheminée centrale,<br />
parfois à 2 conduits <strong>et</strong> 2 âtres. La porte d'entrée<br />
s'ouvre sur la pièce commune. Les autres<br />
pièces "cabin<strong>et</strong>s" ou chambres sont commandées<br />
par ces deux pièces.<br />
La silhou<strong>et</strong>te est allongée, trapue, souvent<br />
sans étage. Les faça<strong>des</strong> basses sont écrasées<br />
par la toiture. La façade principale est<br />
orientée au Sud-Sud Est, avec pignon protecteur<br />
(souvent en maçonnerie à l'ouest).<br />
Les combles étaient <strong>des</strong>tinés au stockage de<br />
produits agricoles avec accès par un esca-<br />
LE FOUR À PAIN<br />
Souvent présent sous<br />
forme d'appentis<br />
accolé en façade<br />
arrière au droit de la<br />
cheminée.<br />
lier ou une échelle de<br />
meunier. Il existe parfois<br />
une cave enterrée.<br />
Des appentis bas<br />
(four à pain, étable...) s'accolent au bâtiment<br />
principal souvent en façade arrière,<br />
parfois au pignon avec un simple versant ou<br />
toiture.<br />
LES PIGNONS<br />
Le pignon le plus exposé aux intempéries<br />
(orienté Ouest Sud Ouest) est souvent maçonné<br />
<strong>et</strong> aveugle, <strong>et</strong> déborde les rampants au <strong>des</strong>sus<br />
de la couverte ("winbergues") <strong>et</strong> le nu <strong>des</strong><br />
murs de façade ("murs gouttereaux", la maçonnerie<br />
est variée (grés en mœllons, craie avec<br />
arase en épis de briques, briques,...).<br />
Le pignon abrité (orienté Est-Sud Est) est souvent<br />
en remplissage de torchis avec un bardage<br />
(assemblage) de planches posées à clins.<br />
L'OSSATURE BOIS ET LA CHARPENTE<br />
L'ossature de bois<br />
est porteuse <strong>et</strong><br />
posée sur le soubassement.<br />
Elle est composée<br />
de poteaux<br />
verticaux encastrés<br />
dans <strong>des</strong> sablières<br />
hautes <strong>et</strong> basses.<br />
Le torchis avant<br />
badigeon
La charpente de combles est fixée sur de plus<br />
gros poteaux d'appui <strong>et</strong> poteaux conniers (de<br />
coin).<br />
Suivant les époques, le plancher <strong>des</strong> combles<br />
est porté par <strong>des</strong> solives passantes fixées sur les<br />
poteaux ou par <strong>des</strong> solives courtes posées sur<br />
les poutres de ferme.<br />
Le torchis, mélange de terre (limon argileux) <strong>et</strong><br />
de fibres végétales (paille, foin) est posé sur un<br />
lattage d'aulne, ou de nois<strong>et</strong>ier, cloué sur l'ossature<br />
en bois. Le torchis enrobe l'ossature <strong>et</strong> est<br />
complété par un enduit lissé à base de terre,<br />
sable, chaux, courte-paille... Un badigeon de lait<br />
de chaux protège l'ensemble.<br />
LA TOITURE<br />
La toiture est à deux versants identiques en<br />
bâtière d'une inclinaison d’environ 50° (perm<strong>et</strong>tant<br />
autrefois la pose du chaume).<br />
Recouverte aujourd'hui de tuiles de pays orangées<br />
(dites pannes), elle se termine par une rupture<br />
de pente de la charpente appellée "coyau"<br />
qui adoucit le versant de toiture <strong>et</strong> éloigne le<br />
ruissellement <strong>des</strong> eaux de pluie. De rares ouvertures<br />
sous forme de lucarne rampante ou à<br />
deux versants sont présentes.<br />
LE SOUBASSEMENT<br />
Le soubassement appelé "solin" est marqué,<br />
réalisé en briques ou pierre (grès, mœllons tout<br />
venant, rognons de silex). La maçonnerie, d'une<br />
hauteur moyenne de 60 cm, est en saillie par<br />
rapport au mur <strong>et</strong> couverte d'un goudron.<br />
LES OUVERTURES<br />
Les portes sont sobres, parfois surmontées<br />
d'une imposte vitrée.<br />
Les baies plus hautes que larges sont encadrées<br />
par les poteaux d'huisseries avec <strong>des</strong> linteaux <strong>et</strong><br />
appuis de bois peu profonds arrivant au nu de<br />
la façade.<br />
Les fenêtres les plus anciennes sont à "p<strong>et</strong>its carreaux"<br />
(2x4 vitrages par battant) dites à "p<strong>et</strong>its<br />
bois".<br />
Aujourd'hui, les carreaux<br />
sont plus<br />
grands (2x3 carreaux<br />
par battant),<br />
les contrevents en<br />
bois sont à deux battants<br />
en planches<br />
verticales <strong>et</strong> traverses<br />
(sans "barre d'écharpe").<br />
Un tasseau pivotant fixé sur une traverse perm<strong>et</strong><br />
de clore les battants. Il existe aussi une traverse<br />
amovible ou barre d'accoupellement<br />
pour maintenir le volent en position ouverte.<br />
LES COULEURS<br />
• Soubassements noir ou peints en contraste<br />
de la façade (gris foncé, gris bleuté, rouge<br />
sang de bœuf, brun)<br />
• Façade badigeonnée en blanc, coloré de<br />
bleu ou de jaune<br />
• Éléments menuisés colorés de teintes franches<br />
• Bardages bois traités au goudron, grésyl ou<br />
badigeonnés au blanc<br />
LE TORCHIS,<br />
UN SAVOIR-FAIRE<br />
ET UN <strong>PATRIM</strong>OINE<br />
A SAUVER (suite)<br />
Des journées de stages, <strong>des</strong> chantiers<br />
de démonstration sont organisés<br />
pour les particuliers.<br />
Les artisans ne sont pas oubliés avec<br />
l'organisation d'un Certificat d'Identité<br />
Professionnel Patrimoine spécialisé<br />
dans la formation à la mise en œuvre<br />
du torchis.<br />
Enfin, un cahier technique du torchis<br />
(parution novembre 2003) perm<strong>et</strong>tra<br />
aux artisans <strong>et</strong> aux auto-constructeurs<br />
de disposer d'informations précises.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 21
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
22 I Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
Localisation <strong>des</strong> constructions rurales<br />
en pierres du Boulonnais<br />
Ce type d'habitation est limité à la partie<br />
boulonnaise du territoire de parc. La<br />
maison, de plan allongé, se décline en<br />
trois types de construction (voir croquis<br />
ci-contre) :<br />
• Des maisons élémentaires, basses,<br />
allongées, sans lucarne (TYPE 1)<br />
CONSTRUCTION DE TYPE 1<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
• Des maisons simples, avec un soubassement<br />
plus haut, <strong>des</strong> lucarnes à fronton<br />
de pierre en toiture. Ce type est<br />
très répandu dans le pays de<br />
Marquise. (TYPE 2)<br />
CONSTRUCTION DE TYPE 2<br />
• Des maisons élaborées au volume<br />
plus important avec un soubassement<br />
imposant sur une cave, <strong>et</strong> avec un<br />
comble "de surcroît". La maison possède<br />
ainsi trois niveaux. (TYPE 3)<br />
Une toiture à 2 pentes identiques,<br />
comprises entre 45° <strong>et</strong> 50°, recouverte en<br />
tuiles de pays. Les ardoises <strong>et</strong> les tuiles<br />
vernissées noires sont réservées aux<br />
demeures plus cossues<br />
Un pignon ouest maçonné (grès ou<br />
silex), aveugle, débordant de la toiture<br />
les lucarnes toujours axées sur les baies<br />
du rez-de-chaussée. Elles prolongent le mur<br />
de façade <strong>et</strong> comportent deux pans de<br />
toiture masqués par un fronton de pierre<br />
Les encadrements de baies larges en<br />
pierre de taille moulurée ou non, en saillie<br />
de la façade. Les baies sont plus hautes que<br />
larges, identiques <strong>et</strong> alignées.<br />
Le soubassement marqué, réalisé en<br />
matériaux durs<br />
CONSTRUCTION DE TYPE 3
LA TOITURE<br />
Elle est à deux pentes identiques comprises entre<br />
45° <strong>et</strong> 50° recouverte de tuiles de pays (panne<br />
en S). Les ardoises <strong>et</strong> tuiles vernissées noires sont<br />
réservées aux demeures plus cossues.<br />
LES PIGNONS<br />
Les encadrements en pierre de Marquise,<br />
nécessairement peints, le sont dans un ton<br />
contrastant avec le clair du mur. Les éléments<br />
menuisés apparents sont soulignés en vert ou<br />
bleu. Les bâtis de fenêtre sont couramment<br />
blanc. Les pignons ont un traitement<br />
différencié. Les pignons sont maçonnés<br />
comme les murs gouttereaux. L'arase <strong>des</strong><br />
rampants est en pierre dure taillée ou en<br />
briques disposées en épi.<br />
Le pignon est souvent percé d'une p<strong>et</strong>ite baie<br />
fermée d'un vol<strong>et</strong>.<br />
LE SOUBASSEMENT<br />
Le soubassement est important, réalisé en<br />
pierres dures, moëllons de grès, pierre marbrière,<br />
plus ou moins équarris, rarement<br />
enduits de goudron.<br />
Une pierre de seuil "gradinée" marque<br />
l'entrée.<br />
Pierre<br />
LE SENTIER<br />
à Bazinghen<br />
DE LA PIERRE<br />
À BAINCTHUN<br />
xoxox xoxox xoxox xoxox xoxox xoxxox<br />
xox xox xox xoxo xox xoxox xox<br />
xox oxx oxxoxoxox<br />
La Communauté<br />
xoxoxox x.<br />
d'Agglomération du<br />
Xoxox Boulonnais, oxxoxoxox la xox<br />
xoxxoxox commune xox de xoxo<br />
xox Baincthun xox xox <strong>et</strong> xox le <strong>Parc</strong> .<br />
Xoxox <strong>naturel</strong> xoxox <strong>régional</strong> xox <strong>des</strong> xox<br />
xox <strong>Caps</strong> xoxoxox <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> xox xox<br />
xoxo d'Opale, xox ont xox ouvert xox . Xoxox au public xoxoxox le<br />
xoxoxoxoxo sentier de la pierre xoxoxox de xoxox Baincthun. xoxoxoxox<br />
C<strong>et</strong>te pierre xoxoxoxoxoxo a été très xoxox utilisée xoxo dans xox<br />
xoxoxo l'habitat xoxox du bas-boulonnais xo. Xoox xoxoxox mais xoxo- aussi<br />
xoxoxoxxxoxox comme pavement. xoxx Au xox fil xoxox <strong>des</strong> xoxxox<br />
kilomètres xox xoxox du parcours xoxoxoxoxoxoxox pé<strong>des</strong>trexox<br />
xoxoxox balisé, plusieurs xoxoxoxo bornes xoxoxox xoxo<br />
d'interprétation perm<strong>et</strong>tent la<br />
découverte <strong>des</strong> techniques<br />
d'extraction <strong>et</strong> de taille de ce<br />
matériau. Tout doit se faire à la main,<br />
de la casse de la roche à l'angle droit<br />
du pavé ; la pierre n'accepte pas la<br />
scie <strong>et</strong> blanchit sous ses dents.<br />
Les deux dernières carrières ont<br />
fermé mais les bornes font revivre<br />
tout un patrimoine local bâti dans ce<br />
grès dur : l'église Saint-Adrien, <strong>des</strong><br />
fermes, <strong>des</strong> maisons d'ouvriers<br />
agricoles, le moulin du Boudoir…<br />
Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 23
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
24 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de grès <strong>et</strong> calcaires durs<br />
du Boulonnais (suite)<br />
LES MURS<br />
Les murs sont réalisés<br />
en pierres, tirées <strong>des</strong><br />
carrières les plus proches.<br />
On distingue<br />
deux types de parements,<br />
avec <strong>des</strong> moëllons<br />
équarris liés avec<br />
joints assistés, ou à partir<br />
de moëllons toutvenant<br />
noyés dans un<br />
bain de mortier à la<br />
chaux.<br />
Trois qualités de pierre<br />
entrent dans la construction<br />
:<br />
- le calcaire primaire dur, à grains fins, tiré du<br />
bassin carrier de Marquise ou "pierre marbrière"<br />
- le calcaire secondaire jurassique dit "pierre<br />
de Marquise", tendre mais gélif. Il est souvent<br />
protégé d'un épais badigeon de chaux.<br />
- le grès jurassique dit "pierre de Baincthun"<br />
ou "pierre de Boulogne" ; dans ce cas, la<br />
maçonnerie (comme pour la pierre marbrière)<br />
reste apparente.<br />
LES OUVERTURES<br />
Les lucarnes à frontons<br />
Réalisées en pierre de Marquise, elles sont<br />
caractéristiques de c<strong>et</strong> habitat. La forme <strong>des</strong><br />
frontons est très variée : lucarne triangulaire, à<br />
Exemple<br />
de fronton cintré<br />
Exemple<br />
de fronton triangulaire<br />
fronton cintré, à chapeau<br />
de gendarme...<br />
Les lucarnes sont<br />
toujours positionnées<br />
à l'aplomb du<br />
mur de façade <strong>et</strong><br />
situées dans l'axe <strong>des</strong><br />
baies du rez-dechaussée.<br />
Les encadrements<br />
Les encadrements de<br />
baies sont en pierre<br />
de Marquise, moulurée<br />
ou non, en saillie<br />
de la façade. Les baies<br />
sont plus hautes que<br />
larges, identiques <strong>et</strong><br />
alignées avec rigueur.<br />
Quand la maçonnerie<br />
est apparente, on
peut parfois observer au-<strong>des</strong>sus de chaque<br />
baie un arc de décharge en p<strong>et</strong>ites pierres ou<br />
briques qui perm<strong>et</strong> d'alléger le poids <strong>des</strong><br />
maçonneries sur les linteaux...<br />
LES COULEURS<br />
Les faça<strong>des</strong> badigeonnées au lait de chaux<br />
sont parfois pigmentées de jaune ou d'un<br />
bleu très léger.<br />
LES BÂTIMENTS D’EXPLOITATION<br />
AGRICOLE<br />
Imposants <strong>et</strong> massifs, ils sont souvent construits<br />
en grès avec <strong>des</strong> baies à encadrement monolithe<br />
<strong>et</strong> de gran<strong>des</strong> lucarnes rampantes.<br />
Moulin d'Echinghen<br />
TAILLER LE GRÈS<br />
La pierre de Boulogne, ou encore<br />
pierre de Baincthun, est à la base de<br />
la majeure partie de l'habitat du<br />
Boulonnais. Mais ce grès vieux de<br />
135 millions d'années n'était pas facile<br />
à tailler ! "C<strong>et</strong>te pierre est vive <strong>et</strong> vire<br />
sur le bleu ; elle est si dure <strong>et</strong> si fière<br />
qu'on ne peut la tailler ni la piquer, on<br />
ne l'équarrit que par éclats… elle se<br />
trouve en bancs ou en blocs à<br />
différentes profondeurs… comme elle<br />
ne se délite que rarement, on emploie<br />
pour fendre ses bancs <strong>et</strong> blocs en<br />
quartiers <strong>des</strong> masses de fer, les pintes<br />
<strong>et</strong> les coins ; <strong>et</strong> le plus souvent<br />
maintenant la poudre à canon. Les<br />
rompeurs cassent ensuite les quartiers<br />
pour les réduire en pierre brute que<br />
l'on appelle la pierre à parqu<strong>et</strong>s. C'est<br />
aux maçons <strong>et</strong> aux paveurs à les<br />
équarrir avec un marteau, qui leur est<br />
propre pour les m<strong>et</strong>tre en état d'être<br />
employées à la maçonnerie ou au<br />
pavé, ce qu'on appelle épincer…"<br />
Anonyme - 1753<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 25
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
26 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de craie<br />
Localisation <strong>des</strong> constructions rurales<br />
en craie<br />
A la différence du grès, la craie est un<br />
matériau tendre qui se prête à un travail<br />
de taille plus précis <strong>et</strong> plus élégant, parfois<br />
proche de la sculpture.<br />
L’usage de la craie fut longtemps réservé<br />
à l’architecture monumentale, maison<br />
seigneuriale, fermes fortifiées, églises…<br />
Mais là où l’extraction était plus facile,<br />
on n’hésita pas à construire de simples<br />
habitations à base de craie, avec cependant<br />
<strong>des</strong> matériaux de qualité diverse.<br />
La typologie de c<strong>et</strong> habitat est simple : la<br />
façade principale est toujours orientée<br />
sud/sud est <strong>et</strong> la profondeur du bâti,<br />
conditionnée par la portée de poutres<br />
est faible. La présence de corniches<br />
moulurées, l’alignement systématique<br />
<strong>des</strong> baies, aux larges ébrasures, <strong>et</strong> la présence<br />
plus courante de bâtiment à un<br />
étage sont d’autres caractéristiques marquantes.<br />
LES SOUBASSEMENTS<br />
La craie est gélive <strong>et</strong> fragile. Les soubassements<br />
sont donc constitués d’une maçonnerie plus<br />
résistante :<br />
- cassons de craie liés au mortier de chaux,<br />
- silex,<br />
- appareillage de brique.<br />
DES MURS DE CRAIE<br />
PARFAITEMENT<br />
APPAREILLÉS<br />
La craie est exploitée sous<br />
forme de moellon ou pierre<br />
de taille.<br />
La pierre de taille est<br />
« dressée » (aplanie) soi-<br />
gneusement sur toutes ses faces. Largement utilisée<br />
dans la partie artésienne du <strong>Parc</strong>, elle est<br />
maçonnée en blocs disposés en assises régulières<br />
d’une hauteur de 15 à 20 cm.<br />
Le moellon est équarri (taillé grossièrement) <strong>et</strong><br />
dressé uniquement sur sa face visible. On le<br />
trouver dans la partie ouest du <strong>Parc</strong> avec une<br />
finition plus rustique.<br />
La maçonnerie de façade est réalisée en parfaite<br />
continuité avec les angles. Les pierres d’angles,<br />
intégrées aux assises sont lisses, de plus<br />
grande longueur <strong>et</strong> assurent ainsi le chaînage.<br />
Les maçonneries sont à simple ou double parement<br />
<strong>et</strong> dans ce cas comportent un parement<br />
extérieur bien fini, un remplissage de moellons
de briques ou silex appelé « blocage » <strong>et</strong> un<br />
parement intérieur de moellons de craie.<br />
Des pierres plus longues posées en “boutisse”<br />
assurent la liaison entre les deux parois.<br />
LES ÉLÉMENTS MOULURÉS<br />
La perfection de l’appareillage est agrémentée<br />
par la présence de moulures qui composent un<br />
décor, soit entre deux lits de pierres (cordon ou<br />
appui filant qui renforce l’alignement <strong>des</strong> baies<br />
sur la longueur de la façade) ou en corniche en<br />
haut de façade pour « asseoir » la toiture.<br />
Elles peuvent être profilées en biais, en redents<br />
ou avec une moulure plus travaillée (doucine).<br />
LES MARQUES ET GRAFFITIS<br />
La craie, matériau<br />
tendre, se prête<br />
aux graffitis. Les<br />
ouvriers <strong>des</strong> carrières<br />
ou les maçonstailleurs<br />
signent<br />
certaines pierres<br />
de formes géométriques.<br />
D’autres<br />
pierres conservent<br />
la mémoire de<br />
graffitis anciens. Un cartouche est parfois<br />
intégré au pignon : il porte la date de construction<br />
parfois accompagnée de motifs<br />
sculptés.<br />
LES PIGNONS<br />
Parfois arasés sous le<br />
couvert de la toiture,<br />
les pignons sont souvent<br />
“saillants” avec<br />
une pierre<br />
- taillée “en siffl<strong>et</strong>”,<br />
- assemblée en marches<br />
dites « pas de<br />
moineau »,<br />
- associée à la brique<br />
disposée en épis<br />
pour fermer la bordure<br />
oblique du pignon<br />
ou “arase”, qui est<br />
ainsi plus solide.<br />
RESTAURER<br />
LE <strong>PATRIM</strong>OINE<br />
BÂTI...<br />
UNE BONNE IDÉE<br />
Du puits à la maison en pans de bois<br />
<strong>et</strong> torchis, de la chapelle au moulin,<br />
le patrimoine bâti traditionnel du<br />
<strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>Marais</strong> d'Opale présente une grande<br />
richesse ; mais il est parfois menacé.<br />
Vous êtes propriétaire de l'un de ces<br />
précieux éléments du patrimoine <strong>et</strong><br />
vous désirez le restaurer ou le modifier<br />
?<br />
Voici quelques conseils pour élaborer<br />
votre proj<strong>et</strong> de restauration.<br />
Bien connaître l'édifice <strong>et</strong> son environnement<br />
Une connaissance approfondie <strong>des</strong><br />
bâtiments vous guidera utilement<br />
dans vos réflexions futures.<br />
• Faites un relevé (dimensions, plans,<br />
coupes), même simplifié.<br />
• Observez, prenez <strong>des</strong> photographies<br />
<strong>des</strong> abords, de l'ensemble du<br />
bâtiment, <strong>des</strong> détails architecturaux,<br />
<strong>des</strong> problèmes (fissures, dégradations,<br />
végétation parasite…).<br />
• Identifiez les matériaux.<br />
suite page 29<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 27
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
28 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de craie (suite)<br />
Un épi de faîtage plus ou moins ouvragé est<br />
parfois installé au somm<strong>et</strong> du pignon.<br />
Des baies p<strong>et</strong>ites plus hautes que larges éclairent<br />
le rez-de-chaussée ou les combles.<br />
LES BAIES, FENÊTRES<br />
ET CONTREVENTS<br />
Les ouvertures sont systématiquement plus<br />
hautes que larges, identiques <strong>et</strong> strictement alignées<br />
sur une même façade. L’encadrement<br />
n’existe que rarement ; une feuillure périphérique<br />
est façonnée pour l’encastrement <strong>des</strong><br />
contrevents. L’appui est simple, en pierre taillée<br />
posée en saillie.<br />
Les linteaux à claveau<br />
sont droits, en<br />
blocs taillés avec<br />
une clé centrale, ou<br />
légèrement cintrés.<br />
Les contrevents<br />
(vol<strong>et</strong>s) sont pleins, à<br />
deux battants de<br />
planches verticales,<br />
raidies par <strong>des</strong> traverses<br />
horizontales.<br />
Les battants sont<br />
fixés à la maçonnerie<br />
par <strong>des</strong> pivots métalliques<br />
encastrés.<br />
On trouve aussi <strong>des</strong> contrevents panneautés<br />
avec un panneau supérieur équipé de persiennes.<br />
Les portes les plus anciennes sont pleines, surmontées<br />
d’une imposte, souvent décorée de<br />
p<strong>et</strong>its bois ou ferronneries.<br />
LES TOITURES<br />
Les toitures sont traditionnellement<br />
en<br />
bâtière avec <strong>des</strong> pentes<br />
de 45° à 50°, couvertes<br />
de pannes en<br />
« S » ou panne mécanique.<br />
Un rang de tuiles<br />
scellées couvre le<br />
mur pignon non saillant. Les faîtières sont simples,<br />
demi-ron<strong>des</strong>.<br />
LES COULEURS<br />
La maçonnerie de craie est soit nue, soit badigeonnée<br />
au lait de chaux plus ou moins coloré.<br />
Le soubassement est souvent enduit de<br />
goudron.<br />
LES ANCRES<br />
Les anciens scellements<br />
en os de<br />
mouton ont été<br />
remplacés par <strong>des</strong><br />
renforts métalliques<br />
qui solidarisent<br />
les abouts de<br />
pannes (charpentes) ou poutres avec la<br />
maçonnerie.<br />
Dessinées en X, Y, S, croix fleuronnées ou<br />
assi<strong>et</strong>tes décorées, les ancres peuvent aussi<br />
prendre la forme de chiffres.
LES ROUGES-BARRES<br />
Les murs dits « en rouges-barres » ou en « lardé »<br />
sont composés d’une succession de lits de brique<br />
<strong>et</strong> de craie, d’une hauteur généralement<br />
équivalente.<br />
C<strong>et</strong>te technique fort ancienne, héritée <strong>des</strong><br />
romains, concerne essentiellement les pignons.<br />
LES BÂTIMENTS D'EXPLOITATION<br />
AGRICOLE<br />
Le plus souvent, les dépendances agricoles<br />
d'une habitation en craie sont construites très<br />
sobrement, en pans de bois <strong>et</strong> terre, ultérieurement<br />
remplacées ou construites en briques.<br />
Plusieurs dépendances agricoles construites<br />
avec la technique d'appareillage lardé en rougebarres<br />
ont pu être observées, soit que l'habitation<br />
est elle-même construite en craie, en rougebarre<br />
ou en brique.<br />
D'une façon générale, dans les bâtiments d'exploitation,<br />
les encadrements de baies ne sont<br />
pas valorisés mais noyés dans le plan de la façade,<br />
hormis la légère saillie de l'appui. Une pièce<br />
horizontale en bois, plus ou moins équarrie,<br />
peut former un linteau de fortune. Les quelques<br />
porches, en plein cintre ou anse de panier, sont<br />
très soignés, soit qu'ils sont percés dans le corps<br />
d'une grange, soit qu'ils constituent à eux seuls<br />
un pan de mur dans le prolongement <strong>des</strong> murs<br />
gouttereaux d'autres bâtiments. Certains font<br />
même l'obj<strong>et</strong> d'un travail particulier avec un<br />
encadrement de pilastres à demi-engagés<br />
dans la maçonnerie ou <strong>des</strong> pierres particulièrement<br />
taillées.<br />
Les rares lucarnes observées peuvent résulter<br />
d'une transformation de la volumétrie d'origine<br />
de la toiture, en réponse au besoin d'engrangement<br />
<strong>des</strong> récoltes. C<strong>et</strong>te observation se vérifie<br />
par la manière dont les éléments sont intégrés<br />
(la construction de la lucarne implique<br />
une rupture de la corniche) ou par les matériaux<br />
utilisés. Hors la lucarne rampante, la<br />
lucarne-pignon en maçonnerie de briques,<br />
dans le continuité du mur gouttereau, sous<br />
couvert d'une toiture à deux versants, est particulièrement<br />
associée aux bâtiments d'exploitation<br />
en craie.<br />
RESTAURER<br />
LE <strong>PATRIM</strong>OINE<br />
BÂTI...<br />
UNE BONNE IDÉE<br />
• Procédez à une recherche documentaire<br />
(cartes postales ou photos<br />
anciennes, cadastre napoléonien,<br />
archives communes ou départementales…).<br />
Il est indispensable d'analyser les<br />
dégradations <strong>et</strong> les désordres apparus<br />
sur l'édifice <strong>et</strong>, si possible, d'en<br />
rechercher les causes. Ce travail de<br />
diagnostic doit souvent être réalisé<br />
avec un professionnel (architecte ou<br />
artisan qualifié).<br />
Réfléchir à l'ensemble du proj<strong>et</strong> avant<br />
de démarrer les travaux<br />
Définissez votre programme en vous<br />
fixant <strong>des</strong> priorités. Avec l'aide du diagnostic<br />
fait précédemment, définissez<br />
les interventions urgentes, puis la<br />
restauration, sans oublier le traitement<br />
<strong>des</strong> abords (clôtures, plantations).<br />
Avant tout, veillez à conserver<br />
l'authenticité de l'édifice. Ne cherchez<br />
pas forcément à tout restaurer<br />
ni à effacer les marques <strong>des</strong> différentes<br />
étapes de la construction.<br />
Utiliser les conseils de professionnels<br />
du patrimoine<br />
Les conseils d'un professionnel sont<br />
indispensables pour m<strong>et</strong>tre en œuvre<br />
votre proj<strong>et</strong>. Choisissez avec attention<br />
votre maître d'œuvre <strong>et</strong> les entreprises<br />
intervenant sur le chantier. Il<br />
existe un certificat professionnel<br />
"patrimoine" décerné par la CAPEB<br />
(Confédération <strong>des</strong> artisans <strong>et</strong> p<strong>et</strong>ites<br />
entreprises du bâtiment).<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 29
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
30 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de briques<br />
de type flamand<br />
Localisation <strong>des</strong> constructions rurales<br />
en briques<br />
Avec l’extraction du charbon à la fin du<br />
XVIIème siècle, la brique <strong>et</strong> la tuile, autrefois<br />
matériaux coûteux, deviennent de<br />
véritables produits de série, économiques<br />
<strong>et</strong> faciles à m<strong>et</strong>tre en œuvre.<br />
Les briques ne sont plus cuites directement<br />
sur les chantiers, dans les fours à<br />
meules artisanaux à flamme directe qui<br />
fournissaient <strong>des</strong> produits de couleur<br />
variée.<br />
De nombreuses briqu<strong>et</strong>eries s’installent<br />
alors autour <strong>des</strong> gisements locaux<br />
d’argile.<br />
LES CARACTÉRISTIQUES<br />
CONSTRUCTIVES<br />
Comme pour d’autres types, le logis reprend le<br />
principe de la juxtaposition de pièces au rez-dechaussée,<br />
éclairées par <strong>des</strong> ouvertures en façade<br />
principale exposée sud - sud-est. Mais c’est<br />
notamment par l’utilisation <strong>des</strong> combles<br />
comme volume habitable que se caractérise ce<br />
type d’habitat.<br />
LES MURS<br />
Les murs sont élevés sur un même plan, dans le<br />
même matériau, sans soubassement marqué.<br />
La brique perm<strong>et</strong> de multiples subtilités d’appareillage.<br />
En eff<strong>et</strong>, la longueur de la panneresse<br />
(le plus long côté<br />
de la brique) est<br />
égale à deux boutisses<br />
(le plus p<strong>et</strong>it<br />
côté). La technique<br />
la plus courante<br />
alterne un rang<br />
de boutisses avec<br />
un rang de panneresses.<br />
Les joints<br />
de boutisses s’alignent sur une même verticale<br />
tandis que les joints de panneresses sont décalés<br />
de sorte à ne s’aligner q’un rang sur cinq.<br />
L’eff<strong>et</strong> obtenu est celui de figures losangées<br />
superposées appelées « maçonnerie en losange<br />
» ou kruisverland.
L’appareillage « anglais-flamand » reprend la<br />
même technique mais les joints sont alignés<br />
verticalement d’une assise à l’autre.<br />
La teinte <strong>des</strong> joints est fonction de la couleur du<br />
sable utilisé. Elle tend sur le jaune, n’est jamais<br />
blanche, <strong>et</strong> fonce vers la fin du XIX ème siècle.<br />
Le p<strong>et</strong>it module de la brique perm<strong>et</strong> un jeu<br />
dans l’appareillage qui anime la construction.<br />
On peut ainsi obtenir <strong>des</strong> corniches denticulées<br />
ou en crémaillère, <strong>des</strong> linteaux plats ou cintrés.<br />
C<strong>et</strong>te décoration peut être complétée par un<br />
jeu de teintes différentes ou l’intégration de briques<br />
vernissées, <strong>des</strong> carreaux de céramique à<br />
motifs colorés (Desvres).<br />
LES PIGNONS<br />
Le p<strong>et</strong>it module de la brique perm<strong>et</strong> de monter<br />
la pointe du pignon en continuité avec l’appareillage<br />
<strong>des</strong> murs gouttereaux.<br />
Les pignons sont généralement re-couverts par<br />
la toiture. L’arase est terminée par <strong>des</strong> assises de<br />
briques disposées à<br />
chant oblique, en<br />
triangles superposés<br />
ou sans appareillage<br />
particulier.<br />
Les versants de toiture<br />
sont terminés<br />
par <strong>des</strong> tuiles de<br />
rives scellées ou<br />
sont débordants.<br />
LES ANCRES<br />
C’est souvent à la<br />
pointe <strong>des</strong> pignons<br />
LA TOITURE<br />
que les pièces de charpente<br />
sont solidarisées<br />
à la maçonnerie par<br />
<strong>des</strong> ancres métalliques<br />
à fleuron, aux branches<br />
en X, Y, S ou formant<br />
<strong>des</strong> chiffres qui indiquent<br />
la date de construction.<br />
La toiture en bâtière est la forme la plus courante<br />
avec <strong>des</strong> pentes de 45° à 50°. Mais pour<br />
augmenter la surface habitable, notamment<br />
sous influence flamande, le versant de la toiture<br />
de l’habitation au-<strong>des</strong>sus <strong>des</strong> murs de façade<br />
peut être brisé. Le tiers inférieur appelé « brisis »<br />
est redressé selon une pente proche de 80°. La<br />
partie supérieure conserve une pente de 40° à<br />
50°. C<strong>et</strong>te évolution de la charpente, dite « toit<br />
LES DEMANDES<br />
D'AUTORISATION<br />
ADMINISTRATIVE<br />
Avant toute restauration ou<br />
aménagement, il convient de se<br />
renseigner sur les servitu<strong>des</strong><br />
publiques ou privées existantes, sur<br />
les règles d'urbanisme en vigueur <strong>et</strong><br />
enfin de solliciter les autorisations<br />
nécessaires.<br />
Pour ce faire, une visite en mairie est<br />
indispensable.<br />
A CONNAÎTRE !<br />
• Le permis de démolir<br />
Il est nécessaire pour toute<br />
démolition partielle ou totale d'un<br />
bâtiment.<br />
• Le permis de construire<br />
Il est obligatoire pour<br />
- toute construction (à usage<br />
d'habitation ou non)<br />
- les travaux réalisés sur <strong>des</strong><br />
constructions existantes, s'il y a<br />
changement de <strong>des</strong>tination, <strong>et</strong>/ou<br />
modification de l'aspect extérieur,<br />
<strong>des</strong> volumes, ou création de niveaux<br />
supplémentaires.<br />
Le permis de construire, signé par le<br />
maire, est valable deux ans.<br />
suite page 33<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 31
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
32 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les constructions en maçonnerie de briques<br />
de type flamand (suite)<br />
à la Mansart » est adoptée au XIX ème siècle dans<br />
les villes <strong>et</strong> gagne ensuite progressivement les<br />
bourgs <strong>et</strong> les campagnes.<br />
La couverture est<br />
réalisée en tuiles :<br />
panne flamande ou<br />
tuile mécanique.<br />
Sur ce type de bâtiment,<br />
les gouttières en zinc,<br />
dites «pendantes» sont<br />
d’origine.<br />
Des ouvertures en toiture éclairent les pièces<br />
habitées : de p<strong>et</strong>ites tabatières à châssis<br />
basculant, <strong>des</strong> lucarnes en bois, plus hautes que<br />
larges placées à<br />
l’aplomb <strong>des</strong> murs<br />
gouttereaux, sont<br />
terminées par <strong>des</strong><br />
frontons triangulaires<br />
ou cintrés.<br />
LES BAIES<br />
Les cheminées sont<br />
placées dans l’axe du<br />
faîtage souvent au<br />
centre de l’habitation.<br />
Les baies sont<br />
homogènes sur une<br />
même façade avec<br />
<strong>des</strong> encadrements<br />
effacés, ou peu<br />
marqués avec un<br />
linteau <strong>et</strong> un appui<br />
saillants, en briques à<br />
chant, voire saillants<br />
sous forme de larges<br />
plates-ban<strong>des</strong> de<br />
quinze centimètres.<br />
Les fenêtres sont plus<br />
hautes que larges. Les<br />
contrevents sont le<br />
plus souvent panneautés<br />
réalisés en<br />
séries (avec un<br />
panneau plein, un<br />
panneau avec motif ciselé, ou <strong>des</strong> persiennes<br />
dans le tiers supérieur).<br />
Les portes sont souvent panneautées avec <strong>des</strong><br />
parties vitrées positionnées parfois en imposte,<br />
ou dans la partie supérieure de la porte.<br />
Certains exemples sont richement décorés<br />
avec notamment la présence d’une grille de<br />
fer forgé devant chaque vitrage.<br />
Les fenêtres sont posées en tableau dans<br />
une feuillure dans la maçonnerie de<br />
briques.
LES COULEURS<br />
Les briques sont parfois peintes en rouge<br />
vineux ou badigeonnées à la chaux colorée.<br />
Les menuiseries <strong>des</strong> huisseries sont peintes<br />
en teintes contrastées.<br />
LES BÂTIMENTS D'EXPLOITATION<br />
AGRICOLE<br />
Hormis dans les ensembles architecturaux<br />
exceptionnels, la maçonnerie de brique est<br />
souvent associée aux constructions rurales les<br />
plus tardives, à l'occasion de travaux de<br />
reconstruction ou d'agrandissement.<br />
Le module de la brique, en réglant<br />
parfaitement les assises, perm<strong>et</strong> de<br />
rationaliser complètement l'échelle <strong>des</strong><br />
constructions <strong>et</strong> de les optimiser selon leur<br />
fin. Il calibre <strong>et</strong> aligne très régulièrement<br />
chaque percement <strong>et</strong> offre un jeu d'ouverture<br />
très diversifié. Si les seuls eff<strong>et</strong>s ornementaux<br />
se limitent à l'association <strong>des</strong> appareillages de<br />
briques, ils sont toutefois réellement présents,<br />
complétés par les branches d'ancres<br />
métalliques.<br />
Les lucarnes présentent aussi une grande<br />
variété de forme, rampantes, à fronton<br />
triangulaire, à pignon sous le couvert d'un<br />
toit en bâtière plus ou moins débordant...<br />
Enfin, il faut remarquer que pour quelques<br />
patits bâtiments, la pointe du pignon Est<br />
peut être simplement fermée d'un bardage<br />
bois (nécessité de ventilation). Les quelques<br />
exemples de linteaux en bois associés à la<br />
construction en briques, sont sans doute un<br />
archaïsme.<br />
LES DEMANDES<br />
D'AUTORISATION<br />
ADMINISTRATIVE<br />
• La déclaration de travaux<br />
Certains travaux sont exemptés du<br />
permis de construire mais soumis au<br />
régime de la déclaration préalable :<br />
- modification limitée à l'aspect<br />
extérieur d'un bâtiment existant<br />
(pose de nouvelles huisseries,<br />
changements de badigeons ou<br />
couleurs…),<br />
- construction d'un édifice d'une<br />
surface de plancher hors œuvre<br />
brute égale ou inférieure à 20 m2 ,<br />
- clôture.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 33
34 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les abords, les dépendances<br />
<strong>et</strong> le p<strong>et</strong>it patrimoine bâti<br />
I PARTIE 2 I
Les dépendances LA FONDATION<br />
LES DÉPENDANCES AGRICOLES<br />
Chaque exploitation agricole, grande ou<br />
p<strong>et</strong>ite requiert <strong>des</strong> annexes spécialisées<br />
autour de la maison d’habitation, pour le<br />
logement <strong>des</strong> animaux <strong>et</strong> pour le<br />
stockage <strong>des</strong> récoltes.<br />
L’ensemble, en correspondance avec les<br />
surfaces exploitées, structure l’espace<br />
bâti de l’exploitation <strong>et</strong> situe<br />
socialement le statut de l’exploitant.<br />
Les bâtiments d’exploitation ont un<br />
traitement architectural plus sobre que<br />
les maisons d’habitation avec une<br />
économie de construction <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
matériaux plus courants, moins chers…<br />
La grange<br />
La grange est le lieu de remise <strong>des</strong> récoltes. Sa<br />
taille domine en hauteur tous les autres<br />
bâtiments de l'exploitation, mais elle reste<br />
toujours en rapport avec les surfaces<br />
céréalières exploitées. Par ordre de<br />
hiérarchie, elle trouve sa disposition en face<br />
de l'habitation.<br />
Quelques granges, sont intégralement<br />
charpentées <strong>et</strong> couvertes d'un bardage bois,<br />
certaines sont aussi vastes que les granges<br />
construites en «matériaux durs» (grès, craie,<br />
brique). Des exemples ont pu être observés<br />
sur le territoire du <strong>Parc</strong> (Vaudringhem...).<br />
Dans de rares cas, la pointe du pignon le<br />
moins exposé est simplement fermée par un<br />
bardage en bois. La toiture peut former<br />
auvent notamment lorsque le pignon est<br />
implanté à l’alignement de la rue (Esquer<strong>des</strong>).<br />
La grange est traditionnellement ouverte en<br />
son milieu d'une grande porte charr<strong>et</strong>ière à<br />
laquelle peut correspondre une autre porte<br />
identique sur la face postérieure, pour<br />
perm<strong>et</strong>tre d'engager les attelées <strong>et</strong> de<br />
décharger complètement les gerbes de<br />
paille <strong>et</strong> de foin à l'abri. La toiture peut être<br />
partiellement relevée pour ouvrir la porte<br />
charr<strong>et</strong>ière <strong>et</strong> mieux gagner en hauteur de<br />
passage, jusqu'à déborder <strong>et</strong> constituer un<br />
auvent. D'autres portes, à taille humaine,<br />
viennent compléter le jeu <strong>des</strong> ouvertures.<br />
Des baies situées en hauteur, dans les murs<br />
gouttereaux ou dans la pointe du pignon le<br />
moins exposé, peuvent perm<strong>et</strong>tre l'accès<br />
aux combles.<br />
Le sol intérieur est bien damé de sorte qu'on<br />
y fait les battages. Mais, en Boulonnais, l'aire<br />
à battre peut être constituée par une annexe<br />
couverte (manège) qui vient se greffer le<br />
plus souvent sur la face postérieure de la<br />
grange.<br />
Quand elle est disposée à l'alignement de la<br />
rue, la grange contribue à construire l'ambiance<br />
du village. Sur le territoire du <strong>Parc</strong>, la<br />
disposition de grange fermée sur rue se rencontre<br />
surtout en partie sud-est (rue principale<br />
à Wismes, rue de Lumbres à Ouve-<br />
Wirquin, rue <strong>des</strong> Grands Bois au hameau de<br />
Watterdal/Seninghem, rue principale au<br />
hameau de Maisnil/Dohem…).<br />
Il arrive que l’exploitation ne trouve pas la<br />
place nécessaire pour l’ensemble <strong>des</strong><br />
bâtiments de ferme notamment pour<br />
implanter en front à rue le plus volumineux<br />
d'entre eux : la grange. Celle-ci subit un<br />
glissement <strong>et</strong> devient isolée, toujours alignée<br />
sur la rue mais non plus face à l'habitation. La<br />
cour de l'exploitation reste alors ouverte sur la<br />
rue (Ouve-Wirquin ou Wismes).<br />
DU <strong>PATRIM</strong>OINE :<br />
UN ATOUT<br />
POUR SAUVER LE<br />
<strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
Sauvegarder le patrimoine bâti rural<br />
nécessite de mobiliser toutes les<br />
volontés <strong>et</strong> d'inciter les particuliers à<br />
restaurer leur patrimoine. Créée en<br />
1996, la Fondation du Patrimoine,<br />
organisme privé indépendant à but<br />
non lucratif, vise à promouvoir la sauvegarde,<br />
la connaissance <strong>et</strong> la mise en<br />
valeur du patrimoine non protégé. Elle<br />
est reconnue d'utilité publique.<br />
Elle suscite <strong>des</strong> partenariats <strong>et</strong> participe<br />
à <strong>des</strong> opérations concertées de restauration.<br />
Elle octroie dans ce cadre<br />
son label à <strong>des</strong> bâtiments répondant à<br />
certains critères (communes de moins<br />
de 2 000 habitants, visibles de la voirie<br />
publique…). Ce label entraîne une<br />
défiscalisation <strong>des</strong> travaux effectués<br />
pour la restauration.<br />
Le Conseil Régional Nord Pas-de-<br />
Calais a signé une convention avec la<br />
Fondation du Patrimoine qui perm<strong>et</strong><br />
d'octroyer à <strong>des</strong> particuliers bénéficiaires<br />
du label une aide allant jusqu'à 20 % du<br />
montant <strong>des</strong> travaux engagés.<br />
Le Conseil Régional Nord Pas-de-Calais<br />
aide également les communes rurales<br />
à restaurer églises <strong>et</strong> chapelles, suivant<br />
d'autres modalités.<br />
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>Marais</strong> d'Opale <strong>et</strong> la Fondation du<br />
Patrimoine travaillent ensemble sur le<br />
territoire du <strong>Parc</strong> à la sauvegarde du<br />
patrimoine bâti.<br />
Informations : Fondation du<br />
Patrimoine<br />
Délégation du Pas-de-Calais<br />
Maison du <strong>Parc</strong> – 62142 Le Wast<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 35
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
36 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Le chartil<br />
Pittefaux<br />
Les dépendances (suite)<br />
Le chartil, encore dit «charr<strong>et</strong>il», «charr<strong>et</strong>ier»<br />
ou «courtil» est un lieu de remisage <strong>des</strong><br />
véhicules, chariots <strong>et</strong> voitures au centre <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> outils aratoires sous les appentis, à<br />
l'écart de l'ensemble de la cour.<br />
Isolé <strong>et</strong> distinct de la grange, il est donc<br />
caractérisé par sa forme, ses poteaux <strong>et</strong> ses<br />
deux appentis.<br />
A l’origine, c’est une structure de bois avec<br />
pignons bardés <strong>et</strong> murs latéraux très bas<br />
garnis ou non de torchis. Plusieurs exemples<br />
ont pu être observés, chacun ayant<br />
conservé le plus souvent sa toiture à deux<br />
versants très abrupts (au moins 50°), sans<br />
doute témoin d'une couverture initiale en<br />
chaume.<br />
Le manège à battre<br />
Les manèges à battre sont concentrés sur le<br />
territoire du <strong>Parc</strong>, aux environs de Marquise<br />
<strong>et</strong> de Samer, présents surtout dans les<br />
fermes disposant de gran<strong>des</strong> surfaces de<br />
culture, notamment celles du XIX ème siècle.<br />
Samer<br />
C'est une aire couverte utilisée pour faire<br />
piétiner les céréales disposées au sol, par les<br />
animaux (lourds rouleaux tires par chevaux).<br />
Les premières machines à battre, à l'origine<br />
actionnées par l'homme, sont apparues vers<br />
1830 mais ne se généralisent que très<br />
lentement.<br />
Le modèle le plus simple est la “bogueuse”,<br />
mise en mouvement par le manège : les<br />
chevaux sont attelés par <strong>des</strong> traciers aux bras<br />
d'attelage. Ils tournent autour d'un axe central<br />
fixé sur une roue dentée. Une perche lie l'axe<br />
à l'embouchure du cheval pour l'obliger à<br />
marcher. La roue dentée transm<strong>et</strong> le<br />
mouvement à «l'arbre de couche» (souterrain)<br />
par l'intermédiaire d'un pignon. Un volant<br />
extérieur régularise la rotation de la poulie<br />
montée dans la grange. Une courroie la relie à<br />
la bogueuse au hache-paille, à la scie à ruban.<br />
Les manèges à battre sont greffés en<br />
appendice perpendiculaire sur le mur<br />
gouttereau d'une grange, en général sur le pré.<br />
Ils sont de plan carré, rectangulaire, polygonal<br />
ou semi circulaire. Quelques rares exemples<br />
fixent le manège à battre à l'intérieur même de<br />
la cour de l'exploitation (Alembon). Ils sont<br />
éclairés par <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites baies, souvent en<br />
demi-lunes disposées en partie supérieure sur<br />
chacun <strong>des</strong> pans de maçonnerie. Une p<strong>et</strong>ite<br />
porte peut offrir un accès extérieur.
Il est possible que certains manèges équipés de<br />
mécanismes entraînés par les chevaux aient été<br />
encore en service jusque dans les années 1930.<br />
Au delà, avec les progrès technologiques, la<br />
machine à battre est actionnée par l'énergie de<br />
moteur à vapeur (la locomobile jusqu'en 1960)<br />
avant d'être remplacée par les moissonneusebatteuses.<br />
LES AUTRES DEPENDANCES<br />
L’écurie<br />
Le cheval, pièce maîtresse du système de<br />
production par sa force de traction <strong>et</strong> de<br />
reproduction, demande beaucoup de soins.<br />
C'est pourquoi, par ordre de hiérarchie, il est<br />
placé dans une écurie généralement à côté<br />
même du logis, pour mieux le surveiller.<br />
En pays bocager, où l'élevage allié à la p<strong>et</strong>ite<br />
culture prédomine sous la forme de<br />
nombreuses p<strong>et</strong>ites exploitations, la place est<br />
comptée. Dans le Boulonnais, le nombre <strong>des</strong><br />
chevaux logés en écurie est relativement faible.<br />
Dans les régions où la culture <strong>des</strong> céréales est<br />
plus étendue (Haut Artois), l'écurie est<br />
suffisamment grande pour contenir les chevaux<br />
nécessaires au travail <strong>des</strong> terres. Ils sont alors<br />
placés sur une ligne, séparés les uns <strong>des</strong> autres<br />
par <strong>des</strong> bats-flancs mobiles. Les box sont<br />
uniquement réservés pour les juments sur le<br />
point de pouliner.<br />
L’étable<br />
Placée couramment entre la grange <strong>et</strong><br />
l'habitation, l’étable compose un côté de la<br />
cour. Son volume est relativement faible<br />
comparé à celui <strong>des</strong> granges.<br />
La largeur de l’étable équivaut à une auge + une<br />
stalle de la longueur d'un animal couché (un<br />
espace nécessaire au relevé) un passage d'une<br />
brou<strong>et</strong>te ou d’une civière. A la différence de la<br />
bergerie, l'étable est équipée de séparations<br />
fixes. La hauteur au plafond est fonction de la<br />
longueur d'une fourche pour engranger. En<br />
eff<strong>et</strong>, les combles sont utilisés pour le stockage<br />
du foin. A c<strong>et</strong>te fin, on réalise le chénel (encore<br />
dit «chenil» ou «fenil») avec <strong>des</strong> perches de bois<br />
sur lesquelles une couche de paille de colza ou<br />
de fougères est disposée pour éloigner les<br />
rongeurs. C<strong>et</strong>te couche, qui absorbe la<br />
transpiration <strong>des</strong> animaux, est remplacée<br />
chaque saison pour ne pas gâter le foin. De<br />
c<strong>et</strong>te façon, l’étable gagne en chaleur l’hiver en<br />
même temps que la ventilation est assurée par<br />
le chénel qui laisse filtrer l'air par le toit.<br />
La bergerie<br />
Selon l'importance de l'élevage ovin, la bergerie<br />
peut se confondre avec l’étable. En eff<strong>et</strong>, sa<br />
fonction de logement de bestiaux ne se<br />
distingue extérieurement pas de l’étable.<br />
Intérieurement, <strong>des</strong> parois mobiles <strong>et</strong> un rez-dechaussée<br />
surbaissé la fait différer La ventilation<br />
est de la même façon assurée par le chénel.<br />
La remise <strong>des</strong> productions maraîchères<br />
Uniquement dans la région audomaroise, il<br />
s'agit de constructions charpentées, élevées<br />
sur un soubassement en dur, généralement<br />
en briques. Le bardage en planches à clins<br />
bois, parfois ouvert en partie supérieure, offre<br />
la ventilation nécessaire au stockage <strong>des</strong><br />
légumes. Le bardage est badigeonné au<br />
goudron.<br />
CHAPELLES<br />
ET CALVAIRES<br />
Dans l'inventaire du p<strong>et</strong>it patrimoine<br />
bâti rural réalisé en 2001 par le <strong>Parc</strong><br />
<strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>, plus de 180 chapelles<br />
ont été recensées.<br />
Toutes les époques sont représentées<br />
sur le territoire du <strong>Parc</strong>. Le haut<br />
Moyen-Âge est représenté par Ste<br />
Godeleine à Wierre-Effroy-Londefort.<br />
Pour le XV ème siècle, Notre Dame de<br />
Grâce ou chapelle de Guéémy, sur la<br />
commune de Tournehem, domine le<br />
Mont Saint-Louis. Notre Dame <strong>des</strong><br />
Ardents à Seninghem a été érigée en<br />
1604.<br />
Avec le XIX ème siècle, de nouvelles<br />
édifications sont enregistrées, comme<br />
Notre Dame de Bonsecours à Journy<br />
en 1802. Enfin, la dévotion à Notre<br />
Dame de Lour<strong>des</strong> favorise<br />
l'implantation <strong>des</strong> chapelles à la fin du<br />
XIXe siècle <strong>et</strong> après la seconde guerre<br />
mondiale, les bénédictins de Wisques<br />
conçoivent <strong>et</strong> décorent <strong>des</strong> oratoires<br />
aux lignes nouvelles, en briques,<br />
béton, ou pierre. On les r<strong>et</strong>rouve en<br />
nombre dans l'Audomarois <strong>et</strong> sur les<br />
contreforts de l'Artois.<br />
L'association <strong>régional</strong>e pour l'aide à la<br />
restauration <strong>des</strong> chapelles <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
oratoires (ARARCO -<br />
Tél 03 20 55 20 28) œuvre pour leur<br />
sauvegarde <strong>et</strong> leur mise en valeur.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 37
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
38 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les pigeonniers<br />
Le pigeonnier est une construction intégrée au<br />
sein même de l’exploitation, qui abrite dans son<br />
intérieur les pigeons logés par couples <strong>et</strong> par<br />
nids. La colombiculture est l’élevage <strong>des</strong><br />
pigeons de chair <strong>et</strong> d’agrément. C<strong>et</strong> élevage<br />
présente un double intérêt pour les<br />
exploitations agricoles : d’une part, il constitue<br />
une réserve alimentaire pour la consommation<br />
domestique, d’autre part, il produit <strong>des</strong> fientes<br />
utiles pour la fertilisation <strong>des</strong> terres.<br />
Nombreux à l’ouest du <strong>Parc</strong> Naturel Régional<br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale, surtout en pays<br />
Boulonnais, dans les exploitations moyennes <strong>et</strong><br />
gran<strong>des</strong>, les pigeonniers tendent à se raréfier<br />
dans la partie sud de la région artésienne du<br />
<strong>Parc</strong>, où ils ne font plus l'obj<strong>et</strong> d'une<br />
construction spécifique. Les pigeons sont alors<br />
accueillis dans <strong>des</strong> aménagements sommaires<br />
(loges de bois, greniers).<br />
L’ORGANISATION DU PIGEONNIER<br />
Les couples de pigeons sont logés dans <strong>des</strong><br />
cases, soit qu'elles soient simplement en bois<br />
pour les caisses les plus sommaires, soit qu'elles<br />
tapissent entièrement les murs intérieurs du<br />
pigeonnier, constituant alors <strong>des</strong> «boulins».<br />
Montés sur une structure en bois, les boulins<br />
sont le plus souvent réalisés en torchis ou en<br />
bois. Il peut encore s'agir de paniers d'osier fixés<br />
à la maçonnerie ou très rarement de poteries<br />
(un exemple à Samer).<br />
Pour la visite <strong>des</strong> nids, l'emploi d'une échelle<br />
est nécessaire. Celle-ci peut être portative,<br />
fixée sur le mur extérieur d'une dépendance,<br />
ou montée sur pivot pour les constructions<br />
plus prestigieuses.<br />
L'élégance d'un pigeonnier tient d'abord dans sa<br />
forme <strong>et</strong> sa qualité constructive. Cependant, il<br />
est possible de distinguer quelques éléments,<br />
obj<strong>et</strong>s d'un soin particulier : corniche à redents,<br />
association de matériaux, date de construction<br />
gravée sur la clef de la porte du rez-de-chaussée<br />
ou inscrite dans les formes <strong>des</strong> ancres de<br />
ferronnerie, encadrements de porte ou de grilles<br />
d'envol ouvragés…<br />
LES PIGEONNIERS-CAISSES<br />
Les formes les plus sommaires ou « caisses » se<br />
rencontrent dans les exploitations mo<strong>des</strong>tes, ou<br />
celles construites en pan de bois <strong>et</strong> terre .<br />
Pigeonnier sur perche<br />
Une grosse caisse de<br />
bois couverte à deux<br />
ou quatre pans, voire<br />
même un tonneau<br />
goudronné compose<br />
un abri rudimentaire…<br />
L'ouvrage est généralement<br />
placé au milieu<br />
de la cour, à côté ou<br />
au centre du tas de fumier, son pied baignant<br />
dans la mare. Il reste très peu d'exemples de<br />
ce type dans le <strong>Parc</strong> (Nielles-les-Bléquin,<br />
Polincove, Hocquinghen, Longfossé,<br />
Bainghen…).<br />
Plus sommairement encore, <strong>des</strong> loges de bois, à<br />
plusieurs casiers juxtaposés ou superposés, sont<br />
accrochées en façade, sous un débord de<br />
toiture ou sur un pignon.<br />
LES PIGEONNIERS SOUS TOIT<br />
DITS «ATTENANTS»<br />
OU «SUR DÉPENDANCES»<br />
Lié à d'autres constructions , il est dit soit «sur<br />
dépendances», soit «attenant» à un corps de<br />
l'habitation ou de l'exploitation. Il prend<br />
couramment la forme d'une p<strong>et</strong>ite tour.<br />
Son implantation répond toutefois à certaines<br />
règles :<br />
- le pigeonnier «sur dépendances» s'établit au<br />
centre d'une dépendance agricole qu'il<br />
surmonte pour composer couramment un axe<br />
de symétrie.<br />
- le pigeonnier «attenant» est placé à l'extrémité<br />
d'une construction, qu'il finit élégamment. Dans
ce cas, il cadre l'entrée de la cour, un angle<br />
ouvert entre deux bâtiments, une échappée<br />
vers les pâtures.<br />
La partie en rez-de-chaussée peut abriter un<br />
cellier, une cave, une remise ou un poulailler.<br />
Parfois voûtée, elle compose une pièce peu<br />
ouverte sur l'extérieur (une porte). L'accès à<br />
l'étage s'effectue avec une échelle extérieure ,<br />
une échelle ou un escalier de bois intérieurs.<br />
Les plus récents, édifiés à la fin du XIX ème siècle,<br />
en briques, s'intègrent dans une typologie de<br />
construction en briques <strong>et</strong> traduisent la<br />
banalisation <strong>des</strong> styles <strong>et</strong> <strong>des</strong> techniques de<br />
c<strong>et</strong>te époque.<br />
PARTICULARITÉS<br />
Le pigeonnier-porche<br />
L'accès à la cour de<br />
l'exploitation s'effectue<br />
sous un grand<br />
porche avec arc cintré.<br />
Le pigeonnier<br />
vient prolonger l'ouvrage.<br />
A Audembert,<br />
le pigeonnier<br />
lui-même est coiffé<br />
par un p<strong>et</strong>it toit en<br />
bâtière. Il existe une<br />
p<strong>et</strong>ite porte latérale.<br />
Il vient donner de l'épaisseur<br />
au porche.<br />
A Guînes, le pigeonnier<br />
surmontant le porche tend à former une<br />
tour carrée.<br />
Le pigeonnier-tourelle de manoir<br />
Une tourelle accolée au manoir peut abriter,<br />
en dernier lieu, au <strong>des</strong>sus <strong>des</strong> pièces de<br />
services ou d'un escalier à vis, le pigeonnier.<br />
La construction est plus ou moins engagée<br />
dans la maçonnerie principale avec laquelle<br />
elle fait corps.<br />
LES PIGEONNIERS DITS AUSSI<br />
«À FUIE» OU «À VOLÉE»<br />
Établi sur palier ou sur solives, au<strong>des</strong>sus<br />
d'une étable ou d'un<br />
cellier, œ type de pigeonnier<br />
peut accueillir jusqu'à 200<br />
boulins (400 pigeons).<br />
Les trous de boulins sont<br />
pratiqués dans la partie<br />
supérieure <strong>des</strong> murs<br />
goutte-reaux <strong>des</strong><br />
bâtiments d'ex-ploitation.<br />
Quelques rares exemples<br />
montrent une série de<br />
trous de boulins,<br />
régulièrement espacés,<br />
alignés <strong>et</strong> soulignés.<br />
Un cordon larmier, sur<br />
toute la longueur d'une<br />
façade, introduit un<br />
rythme tout à fait<br />
particulier dans une<br />
construction dont le<br />
seul but est d’être fonctionnel (Ouve-<br />
Wirquin).<br />
LES PIGEONNIERS ISOLÉS DITS<br />
ENCORE «PIGEONNIERS DE PIED»<br />
Ils sont très nombreux dans les fermes du<br />
Boulonnais où ils semblent constituer un<br />
typologie particulière. Les pigeonniers les<br />
plus exceptionnels sont liés aux<br />
dépendances de châteaux, de maisons<br />
seigneuriales ou d'abbayes. Leur<br />
implantation dans la cour <strong>des</strong> fermes<br />
moyennes <strong>et</strong> gran<strong>des</strong>, répond à une<br />
composition d'ensemble ou est déterminée<br />
par les besoins de circulations usuelles au<br />
sein de l'exploitation.<br />
Le pigeonnier isolé est très souvent une<br />
solide construction en briques ou pierres<br />
couverte d'un toit à deux ou quatre versants.<br />
Couramment établi sur un plan<br />
quadrangulaire, circulaire ou<br />
polygonal, il forme une tour dont<br />
la qualité architecturale peut<br />
faire l'obj<strong>et</strong> d'une recherche<br />
d'esthétique très affirmée<br />
ou, au contraire, s'intégrer<br />
totalement au caractère<br />
frustre <strong>des</strong> autres bâtiments<br />
de l'exploitation.<br />
Il comporte au moins deux<br />
niveaux. Le rez-dechaussée<br />
peut être affecté<br />
à une autre fonction<br />
(remise d'outillage, remise<br />
de grain, puits...) pour<br />
mieux s'élever en hauteur<br />
<strong>et</strong> s'écarter <strong>des</strong> attaques<br />
<strong>des</strong> prédateurs.<br />
LES COLOMBIERS :<br />
UNE VIEILLE<br />
HISTOIRE<br />
Le droit du colombier date de<br />
l’époque carolingienne. Privilège<br />
inscrit dans le seul droit coutumier<br />
<strong>des</strong> seigneurs <strong>et</strong> <strong>des</strong> abbayes, il est<br />
proportionnel à la surface <strong>des</strong> terres<br />
possédée. De celle-ci découle le<br />
nombre de pigeons autorisés à être<br />
élevé. Plus le pigeonnier est<br />
imposant, plus grand est le nombre<br />
de pigeons qu’il accueille, plus<br />
grande est la puissance du<br />
propriétaire. C’est ainsi qu’il joue le<br />
rôle symbolique en consacrant, aux<br />
yeux de la population, la richesse <strong>et</strong><br />
la respectabilité du propriétaire.<br />
La Révolution Française a aboli le<br />
droit <strong>des</strong> colombiers mais leur<br />
construction a perduré jusqu’à la fin<br />
du XIX ème siècle pour symboliser la<br />
richesse patrimoniale. Usuellement,<br />
le terme de «pigeonnier» est préféré<br />
à celui de «colombier».<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 39
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
40 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les puits <strong>et</strong> flots<br />
LOCALISATION DANS LE PARC<br />
La présence de l'eau conditionne<br />
l’implantation de foyers humains. L’eau est le<br />
plus souvent puisée dans le sous-sol. Sur les<br />
plateaux, à sous-sol crayeux, les puits sont<br />
rares, profonds, puisqu’il faut creuser pour<br />
atteindre la nappe d'eau. Dans les vallées<br />
intérieures de l’Artois <strong>et</strong> en façade littorale, là<br />
où les p<strong>et</strong>ites nappes d’eau ne manquent pas,<br />
là où l’eau est facilement atteinte, chaque<br />
habitation-exploitation possède son puits.<br />
Certains points d'eau peuvent être partagés<br />
collectivement : un puits collectif, un flot<br />
communal… La citerne peut représenter un<br />
substitut fort utile qui évite les déplacements<br />
<strong>des</strong> porteurs d’eau.<br />
Le puits est une infrastructure simple,<br />
composé :<br />
- d’un conduit creusé, puis maçonné en soussol<br />
pour contenir les éboulements, qui<br />
atteint le niveau de l’eau<br />
- d’une margelle dépassant légèrement le<br />
niveau du sol<br />
- d’une superstructure qui supporte le<br />
mécanisme de levage (treuil, chaîne…)<br />
La forme du fût peut être circulaire ou ovoïde.<br />
Le fut peut être en maçonnerie de pierre, de<br />
briques, souvent en silex ou directement taillé<br />
dans le banc de craie ou de pierre du sous-sol<br />
(au moins à partir d’une certaine profondeur).<br />
La forme construite du puits varie selon sa<br />
localisation géographique <strong>et</strong> on peut, à ce<br />
titre, distinguer deux gran<strong>des</strong> typologies de<br />
superstructure dans le territoire du <strong>Parc</strong><br />
Naturel Régional <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale :<br />
- une simple bâtière dans l’Artois<br />
- un puits voûté en forme d’ovoïde, de cône<br />
ou de pyramide, généralement à l’ouest du<br />
territoire <strong>et</strong> plus particulièrement au nordouest<br />
- un puits construit comme un appentis ou un<br />
p<strong>et</strong>it édifice isolé.<br />
A côté de ces typologies, il existe <strong>des</strong> puits<br />
plus ouvragés.<br />
LE PUITS INDIVIDUEL<br />
Le puits est situé dans la cour de l'exploitation,<br />
proche de l'habitation. Il est construit à distance<br />
<strong>des</strong> étables, <strong>des</strong> dépôts de fumier, <strong>des</strong> latrines<br />
<strong>et</strong> fosses d’aisance pour que l’eau ne soit pas<br />
altérée par <strong>des</strong> infiltrations.<br />
Le puits en bâtière<br />
La superstructure est composée de deux<br />
versants (forme en bâtière), dont l'un est ouvert<br />
par une p<strong>et</strong>ite trappe (portillon en bois). Il peut<br />
être structuré de diverses manières :<br />
- deux pignons maçonnés avec deux versants<br />
fermés par <strong>des</strong> planches goudronnées<br />
- être maçonné totalement (briques, moellons<br />
tout-venant…)<br />
- être charpenté totalement avec une p<strong>et</strong>ite<br />
charpente en cheval<strong>et</strong> couverte de planches de<br />
bois brutes.<br />
Le puits voûté<br />
Son plan est de<br />
forme circulaire<br />
principalement. La<br />
superstructure est<br />
maçonnée, en<br />
grès ou moellons<br />
tout-venant <strong>et</strong> silex<br />
grossièrement assisés,<br />
ou en briques.<br />
Une ouverture<br />
d’accès est réservée<br />
dans le mur,<br />
éventuellement<br />
fermée par un portillon<br />
en bois.<br />
Le puits est terminé par une voûte intérieure en<br />
encorbellement ou «tas de charge», plus ou<br />
moins régulière.<br />
Les couvertures varient, ce qui perm<strong>et</strong> de distinguer<br />
différentes formes, allant de la forme<br />
d’obus à celle d’un cylindre avec une couverture<br />
conique ou bombée. Le somm<strong>et</strong> peut être<br />
terminée par un épi sculpté en pierre (boule).<br />
C<strong>et</strong>te forme peut être isolée ou intégrée à un<br />
mur de clôture, ou accolée à un bâtiment.
Le puits construit<br />
comme un<br />
appentis ou un<br />
p<strong>et</strong>it édifice isolé<br />
Son plan est de<br />
forme carré ou rectangulaire.<br />
L’édifice<br />
est maçonné, en grès<br />
ou moellons toutvenant<br />
ou en briques,<br />
percé d’une<br />
baie fermée par une<br />
porte ou un portillon en bois. La couverture<br />
est similaire aux autres dépendances qui forment<br />
l’exploitation, avec un seul versant pour<br />
un appentis accolé à une façade, à deux ou<br />
quatre pentes pour un puits isolé.<br />
Les puits ouvragés<br />
Ils sont l’obj<strong>et</strong> d’une<br />
recherche particulière<br />
d’intégration (construction<br />
similaire au<br />
reste <strong>des</strong> bâtiments<br />
d’exploitation) ou de<br />
valorisation (construction<br />
de grande échelle<br />
ou d’un style particulier).<br />
Ils sont, en général,<br />
isolés ou peuvent être<br />
attenants à d’autres<br />
bâtiments.<br />
LES ACCESSOIRES<br />
Le mécanisme de levage est souvent une<br />
simple manivelle coudée, qui sort de l’édifice.<br />
Les maçonneries peuvent être badigeonnées<br />
au lait de chaux comme le reste <strong>des</strong> bâtiments<br />
formant l’exploitation.<br />
Le portillon est peint d’une teinte qui reste, en<br />
général, coordonnée avec celle de l’ensemble<br />
<strong>des</strong> menuiseries.<br />
Aujourd'hui<br />
Après l’alimentation courante en eau<br />
potable, le puits a perdu de son<br />
importance.<br />
Devenu inutile, jugé parfois encombrant<br />
dans l’espace de circulation de<br />
l’exploitation, il est souvent arasé au niveau<br />
du sol, clos par une dalle de béton. Au<br />
mieux, une pompe à bras perm<strong>et</strong> toujours<br />
de puiser l’eau.<br />
LE PUITS COLLECTIF<br />
Dans <strong>des</strong> contextes difficiles (village sur un<br />
plateau, nappe d’eau située à grande<br />
profondeur), le puits collectif ou communal<br />
se substitue aux puits individuels en<br />
répondant à l’ensemble <strong>des</strong> besoins en eau<br />
du village. Il est donc implanté de sorte à<br />
être rapidement accessible de tous : soit à la<br />
croisée <strong>des</strong> chemins, ou à proximité d'une<br />
Quesques<br />
voie, soit en position centrale sur la place<br />
du village. Il est quelques fois associé à un<br />
réservoir.<br />
Le puits collectif est souvent établi sur un plan<br />
proche du carré, de dimensions conséquentes.<br />
Un soubassement maçonné supporte<br />
généralement une charpente en bois.<br />
La construction peut être totalement fermée sur<br />
ses quatre faces par un bardage fait de planches<br />
de bois, avec un accès par un portillon, ou<br />
laissée à l’air libre (structure apparente).<br />
La toiture est à quatre pentes ou en bâtière,<br />
symétrique ou asymétrique. Elle est couverte en<br />
chaume de paille ou de planches goudronnées.<br />
ACCESSOIRES/ELEMENTS DE<br />
DECOR/FINITIONS<br />
Le mécanisme (treuil en bois ou en fer) est<br />
souvent actionné par une double manivelle ou<br />
par une roue à bras. Dans certains cas, les<br />
lour<strong>des</strong> charges d’eau (jusqu’à 50 litres) peuvent<br />
être remontées à la surface à la force d'un cheval,<br />
tirant sa charge au collier (témoignage oral -<br />
ferme de l’Eperche à Samer).<br />
Aujourd'hui<br />
A la base, d’architecture similaire à celle<br />
<strong>des</strong> puits individuels, les puits collectifs<br />
bénéficient parfois d’une reconstruction<br />
plus ambitieuse avec une structure de<br />
pierre de taille, parfois travaillée, ou d’une<br />
structure de brique, souvent de plan carré<br />
(cf. Quercamps)<br />
LES FLOTS<br />
En pays boulonnais, l’affleurement<br />
de certaines sources perm<strong>et</strong>, en plus<br />
du puits, le creusement d’un flot à<br />
usage privé à l’intérieur même <strong>des</strong><br />
murs d’une exploitation, pour<br />
l’abreuvement <strong>des</strong> bêtes.<br />
A une échelle collective, quelques<br />
villages possèdent un flot qui<br />
constitue l'abreuvoir communal.<br />
Souvent creusé au point le plus bas<br />
de l'agglomération, pour capter au<br />
maximum le ruissellement <strong>des</strong> eaux<br />
de pluie, le flot constitue un précieux<br />
réservoir d'eau en cas d’incendie, là<br />
où ne passe pas de cours d'eau.<br />
Ces flots existaient également<br />
nombreux sur le plateau pour<br />
remédier à l’absence de puits ou<br />
cours d’eau, servant à abreuver le<br />
bétail (Quercamps, Leulinghen…).<br />
Le lieu est sommairement aménagé,<br />
le sol terrassé en deux pentes<br />
douces opposées.<br />
Les flots particuliers sont abondants<br />
dans le Boulonnais. Si le flot<br />
communal ne sert plus de point<br />
d'abreuvoir, il peut encore procurer<br />
une aide secourable lors d'incendie.<br />
Le flot communal est un obj<strong>et</strong><br />
patrimonial perdu (comblé le plus<br />
souvent). Il reste parfois encore<br />
perceptible par la présence d’un<br />
mur<strong>et</strong> maçonné qui accompagne<br />
une dépression colonisée par une<br />
végétation spontanée.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 41
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
42 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les éléments de clôture<br />
Les bâtiments d'exploitation, murs, haies<br />
se combinent pour former <strong>des</strong> clôtures<br />
qui assurent la ferm<strong>et</strong>ure de la cour de<br />
l'exploitation agricole.<br />
Dans le Boulonnais, la clôture n'est pas<br />
continue autour de la propriété : les<br />
angles entre bâtiments d'exploitation<br />
restent largement ouverts sur les pâtures.<br />
Dans le Haut-Artois, l'eff<strong>et</strong> de clôture est<br />
plus construit. Cependant, sur l'ensemble<br />
du territoire du <strong>Parc</strong>,<br />
l'exploitation est rarement complètement<br />
fermée.<br />
LES MURS DE CLOTURE<br />
Les murs de clôture sont construits dans les<br />
matériaux exploités localement (moellons de<br />
grès, silex ou briques), en harmonie avec les<br />
bâtiments de l'exploitation. Le faîte du mur est<br />
la partie la plus sensible par où les eaux de pluie<br />
peuvent s'infiltrer <strong>et</strong> faire éclater les<br />
maçonneries. Le mur est donc chaperonné par<br />
une forme en bâtière réalisée dans le même<br />
matériau qui précipite l'écoulement de l'eau.<br />
Tantôt, il est constitué de tuiles faîtière demiron<strong>des</strong><br />
ou de pannes, juxtaposées <strong>et</strong> scellées à<br />
bain de mortier de chaux. Tantôt, deux rangs de<br />
briques scellées à chant forment le<br />
couronnement en bâtière. Lorsque les murs sont<br />
hauts, <strong>des</strong> chaînages droits, en pierre de taille sont<br />
intercalés.<br />
Dans les villages, une grille de ferronnerie scellée<br />
sur un mur<strong>et</strong> bas peut clore une p<strong>et</strong>ite propriété<br />
sans la masquer depuis l'espace de la rue.<br />
Un dispositif astucieux peut perm<strong>et</strong>tre de<br />
franchir un mur<strong>et</strong> de pierre : quelques pierres<br />
plates ou, à l'inverse, <strong>des</strong> creux laissés dans le<br />
corps de la maçonnerie, aident au<br />
franchissement (cim<strong>et</strong>ière d'Audresselles).<br />
LES ENTREES<br />
L'entrée dans la cour est généralement soumise<br />
dans sa disposition pour que la surveillance<br />
puisse s'exercer depuis la salle commune de<br />
l'habitation. Elle s'effectue souvent par un angle<br />
ouvert entre deux bâtiments ou fait face à<br />
l'habitation. L'entrée de la cour est contrôlée<br />
soit par un porche charr<strong>et</strong>ier, soit par une<br />
barrière.<br />
LES PORCHES<br />
L'accès à la cour est parfois contrôlé par un<br />
porche charr<strong>et</strong>ier. S'il est assez rare dans le pays<br />
boulonnais, il devient plus courant dans le<br />
Haut-Artois.<br />
Le porche est construit à la mesure du passage<br />
<strong>des</strong> animaux <strong>et</strong> du matériel requis par la<br />
production agricole.<br />
Plusieurs types sont observés :<br />
- le porche charr<strong>et</strong>ier est un passage percé au<br />
travers le volume d'une grange, protégé par sa<br />
toiture <strong>et</strong> fermé par une barrière traditionnelle<br />
à claire voie ou un grand portail en bois. C<strong>et</strong>te<br />
disposition perm<strong>et</strong> d'engager les chariots<br />
agricoles sous le comble de la grange, d'y<br />
stationner à l'abri pour engranger la récolte sur<br />
les côtés <strong>et</strong> d'y remiser les véhicules. Le grand<br />
portail de bois, plein <strong>et</strong> opaque, peut intégrer<br />
une porte piétonnière découpée dans l'un <strong>des</strong><br />
deux vantaux <strong>et</strong>/ou un lattis à claire-voie en<br />
partie supérieure pour faciliter son ouverture<br />
par grand vent. A la fin du XIXème <strong>et</strong> début XXème siècle, le portail de bois à deux battants cède
Seninghem<br />
le pas aux portes montées sur un rail qui<br />
présentent les avantages d’offrir une<br />
moindre prise au vent <strong>et</strong> de n'empiéter ni sur<br />
l'espace de la rue, ni sur le passage<br />
charr<strong>et</strong>ier.<br />
- le porche est accolé au pignon d'une<br />
dépendance agricole ou de l'habitation.<br />
(Seninghem, Remilly-Wirquin…). Ce type de<br />
porche relie souvent <strong>des</strong> constructions<br />
présentant pignons <strong>et</strong> murs arrières sur la<br />
rue. Certains, très rares, sont construits en<br />
torchis, nécessairement abrités par une<br />
toiture en bâtière <strong>et</strong> associés à un grand<br />
portail de bois massif. D’autres, vus dans la<br />
partie artésienne du <strong>Parc</strong>, sont taillés dans<br />
un pan de maçonnerie associant briques <strong>et</strong><br />
craie, dans le prolongement <strong>des</strong> murs<br />
gouttereaux <strong>des</strong> dépendances. Ceux-ci<br />
comportent deux ouvertures : l’une très<br />
large en anse de panier pour le passage <strong>des</strong><br />
véhicules, l’autre plus réduit pour le passage<br />
<strong>des</strong> piétons.<br />
LA BARRIERE DOMESTIQUE<br />
La barrière domestique contrôle l'accès à la<br />
cour. Son dispositif à claire-voie <strong>et</strong> à hauteur<br />
d'homme laisse transparaître les activités de la<br />
cour de ferme depuis l'espace de la rue. Elle est<br />
surtout placée :<br />
- sur un angle ouvert, formé entre deux bâtiments<br />
disposés perpendiculairement<br />
- entre deux bâtiments disposés en prolongement<br />
l'un de l'autre<br />
- sous un porche charr<strong>et</strong>ier, taillé dans le volume<br />
d'une grange ou accolé à un pignon<br />
- dans le Boulonnais, il n'est pas rare de l'observer<br />
à l'entrée d'un long chemin bordé d'arbres,<br />
qui mène à la ferme située au milieu de<br />
ses terres.<br />
La barrière est traditionnellement composée de<br />
deux battants, associés à <strong>des</strong> poteaux de bois ou<br />
<strong>des</strong> pilastres maçonnés, placés sur l'angle pour<br />
optimiser l'ouverture. Elle est construite en bois<br />
avec <strong>des</strong> assemblages à tenons <strong>et</strong> mortaises.<br />
Chaque battant porte trois traverses associées à<br />
LES ABORDS DES<br />
ENSEMBLES BÂTIS :<br />
LA VÉGÉTATION<br />
Utilisé dans les clôtures, comme<br />
source de matériaux pour le<br />
chauffage, la construction, la<br />
fabrication d'outils, les essences<br />
végétales locales participent à la<br />
construction du paysage <strong>et</strong> à<br />
l'intégration du patrimoine bâti dans<br />
ce paysage.<br />
Cultivée dans le verger ou le<br />
potager, elle est étroitement<br />
associée à l'habitation-exploitation.<br />
Les fruitiers en espaliers habillent les<br />
murs du jardin, les arbres en tige ou<br />
demi-tige structurent les allées.<br />
LES HAIES ET CLÔTURES<br />
DES CHAMPS<br />
Les haies végétales, libres ou taillées<br />
contribuent à clore les vergers,<br />
potagers <strong>et</strong> plus souvent les pâtures<br />
de l'exploitation.<br />
On peut notamment citer :<br />
- les haies vives épaisses avec arbres<br />
de haut-j<strong>et</strong>, frênes <strong>et</strong> ormes, étaient<br />
régulièrement exploités en rotation<br />
de 3 à 6 ans<br />
- les haies plessées ou tressées <strong>et</strong><br />
ployées (charme, aubépine,<br />
prunellier...)<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 43
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
44 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les éléments de clôture (suite)<br />
un remplissage de lattis à claire-voie, plus dense<br />
dans la partie inférieure. La traverse haute suit<br />
<strong>des</strong> formes variées, droite, légèrement à franchement<br />
cintrée.<br />
Mais l'ouvrage peut aussi combiner le bois,<br />
pour le cadre <strong>des</strong> battants, <strong>et</strong> le fer pour le<br />
remplissage. Dans ce cas, le rideau de tiges en<br />
fer rond perce la traverse intermédiaire.<br />
L'ouvrage est complètement réalisé en<br />
ferronnerie sur le même schéma. Le système de<br />
rotation est simple, à base de ferrures : un<br />
collier plat supporte la partie haute du battant<br />
tandis qu'un sabot en fer plat pivote dans la<br />
crapaudine, au sol. Enfin, la barrière suit la<br />
couleur dominante <strong>des</strong> portes de l'exploitation.<br />
Plus ordinairement, elle est peinte en blanc.<br />
LES PILASTRES<br />
Les pilastres sont construits en pierre ou en briques<br />
<strong>et</strong> coiffés d'un traditionnel chaperon. En<br />
Artois, les pilastres de craie sont généralement<br />
<strong>des</strong> ouvrages de belle facture, avec <strong>des</strong> épis<br />
ouvragés <strong>et</strong> <strong>des</strong> pierres taillées (Landr<strong>et</strong>hun-les-<br />
Ardres, Alquines...) alors que dans le<br />
Boulonnais, les pilastres de grès sont bruts.<br />
QUELQUES PARTICULARITÉS<br />
De manière particulière, les pilastres ou porches<br />
<strong>des</strong> manoirs boulonnais affichent ostensiblement,<br />
pour certains, leur vocation défensive<br />
avec la présence de boul<strong>et</strong>s de canons posés<br />
en ornements de maçonnerie ou <strong>des</strong> fûts de<br />
canons fichés dans le sol en guise de bornes<br />
chasse-roues (Manoir d'Houlouve/Wimille).<br />
Des p<strong>et</strong>its tourniqu<strong>et</strong>s de cim<strong>et</strong>ière sont encore<br />
visibles dans quelques communes (Pernes-les-<br />
Boulogne).<br />
Aujourd'hui<br />
Les barrières standardisés, en PVC ou en<br />
acier laqué, tendent à supplanter la barrière<br />
domestique traditionnelle qui demande au<br />
même titre que les menuiseries un minimum<br />
d'entr<strong>et</strong>ien (peinture). Cependant, il existe<br />
<strong>des</strong> artisans-menuisiers locaux tout à fait<br />
capables de réaliser <strong>des</strong> barrières à. partir<br />
<strong>des</strong> modèles anciens, encore très courants.<br />
LES CLOTURES DE CHAMPS<br />
Les barrières de champs<br />
Ce type de barrière est de facture rustique à base<br />
<strong>des</strong> pièces de bois brutes récoltées aux alentours.<br />
A l'inverse de la barrière domestique, elle<br />
est constituée d'un seul battant. Le fut d'un arbre<br />
adulte pivote sur un poteau principal, lui-même<br />
un tronc d'arbre coupé. La partie de la souche en<br />
boule, lestée souvent d'une pierre , est placée en<br />
contrepoids pour équilibrer l'ensemble.
La claire-voie, au <strong>des</strong>sous, est réalisée de grosses<br />
lattes (bois fendus) à tenons mortaises dans<br />
le tronc, reliées par deux ou trois traverses horizontales.<br />
L'ensemble est raidi par une pièce en<br />
écharpe. Elle est posée sur une fourche ou un<br />
tronc d'arbre coupé.<br />
Ce système archaïque, maintenant rarement visible,<br />
a été adapté sous une forme plus travaillée :<br />
le corps de la barrière est toujours pendu sous<br />
une traverse principale horizontale, est portée<br />
par un montant vertical lui même articulé en tête<br />
<strong>et</strong> au pied sur un poteau. L'ensemble est toujours<br />
raidi par une pièce en écharpe.<br />
PARTICULARITÉS<br />
Dans les marais, on passe d'une pâture à l'autre<br />
en suivant les watergangs <strong>et</strong> en escaladant<br />
une sorte de marche-pieds de bois fait<br />
d'une planch<strong>et</strong>te traversière, par un tourniqu<strong>et</strong><br />
ou par une p<strong>et</strong>ite barrière dont l'axe<br />
oblique le fait se refermer automatiquement.<br />
Pour le passage <strong>des</strong> bateaux chargés <strong>des</strong><br />
récoltes à l'endroit où les watergangs coupent<br />
un sentier, <strong>des</strong> p<strong>et</strong>its pont-levis sont actionnés<br />
depuis la rive par un simple jeu de contrepoids.<br />
PLANTONS<br />
LE DECOR...<br />
Chaque année, le <strong>Parc</strong> propose aux<br />
particuliers, associations <strong>et</strong><br />
communes de bénéficier d'une<br />
commande groupée d'arbres,<br />
arbustes <strong>et</strong> fruitiers d'essences <strong>et</strong><br />
variétés locales.<br />
C<strong>et</strong>te opération originale perm<strong>et</strong> à<br />
chacun de restaurer ou de créer une<br />
haie traditionnelle, une bande<br />
boisée, un verger… Elle est aussi<br />
l'occasion d'obtenir <strong>des</strong> conseils<br />
gratuits, de participer à <strong>des</strong> séances<br />
de formation <strong>et</strong> d'acquérir <strong>des</strong><br />
plants à <strong>des</strong> prix très compétitifs<br />
avec la garantie qu'ils ont été<br />
produits localement.<br />
Les livraisons ont lieu en décembre<br />
<strong>et</strong> mars.<br />
Par ailleurs, le <strong>Parc</strong> a édité un guide<br />
technique du bocage où sont<br />
rassemblées les informations utiles<br />
pour connaître ce paysage<br />
particulier <strong>et</strong> les essences qui le<br />
composent.<br />
Des conseils pour entr<strong>et</strong>enir <strong>et</strong><br />
planter les haies y figurent aussi.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 45
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
46 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
La faune <strong>et</strong> la flore liées au patrimoine bâti<br />
Le patrimoine rural bâti constitue un<br />
milieu de grand intérêt pour la faune <strong>et</strong><br />
la flore locales. Les charpentes <strong>et</strong> les<br />
matériaux traditionnels (granges, pigeonniers,<br />
mur<strong>et</strong>s…) abrite une partie de ce<br />
patrimoine <strong>naturel</strong>, totalement soumis<br />
aux conditions de vie humaine. C'est<br />
qu'en eff<strong>et</strong>, certaines espèces y ont trouvé<br />
<strong>des</strong> conditions particulières, favorables à<br />
leur survie, parfois en substitution à <strong>des</strong><br />
milieux disparus ou trop éloignés (zone<br />
rocheuses, montagnes).<br />
LES CHAUVE-SOURIS<br />
Reine de nuit, la chauve-souris est un mammifère<br />
insectivore volant. Ses membres antérieurs,<br />
transformés en ailes,<br />
<strong>et</strong> sa faculté de repérage<br />
par «sonar» lui perm<strong>et</strong>tent<br />
de virevolter<br />
la nuit dans les cours,<br />
entre les massifs boisés,<br />
dans les étables…<br />
à la recherche de sa<br />
proie.<br />
LOCALISATION DANS LA<br />
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE<br />
La raréfaction <strong>des</strong> arbres-creux dans nos<br />
campagnes a poussé les chauve-souris,<br />
notamment les «oreillards», à se réfugier<br />
dans les constructions humaines. Au printemps,<br />
elles établissent leur gîte dans <strong>des</strong><br />
endroits chauds comme les greniers tandis<br />
que pendant les pério<strong>des</strong> estivales, elles<br />
recherchent un abri calme <strong>et</strong> peu sensible<br />
aux variations thermiques comme une<br />
cave ou un mur fissuré. Elles passeront<br />
l'hiver dans ces mêmes abris, plongées<br />
dans un sommeil léthargique pouvant<br />
durer près de trois mois. Les ouvertures<br />
étroites, très fréquentes dans les bâtiments<br />
anciens, leur perm<strong>et</strong>tent l'accès au<br />
gîte :<br />
- les tuiles d'aération <strong>et</strong> les tuiles faîtières<br />
- les corniches<br />
- les espaces dans <strong>des</strong> maçonneries de briques<br />
ou de pierres, sous les seuils <strong>des</strong><br />
fenêtres, derrière un vol<strong>et</strong><br />
- les revêtements appliqués sur les murs<br />
(tuileaux, bardage bois…)<br />
- les ouvertures donnants dans les combles<br />
<strong>et</strong> les charpentes traitées avec <strong>des</strong> matériaux<br />
inoffensifs (huile de lin, Auro, livos,<br />
Bio-pin, Volvox, Naturemas, sel de bore)<br />
- les fenêtres <strong>et</strong> les lucarnes condamnées<br />
avec un lattis horizontal de bois non traité,<br />
à claire-voie (5cm).<br />
Les chauves-souris ne causent aucune nuisance<br />
notable. En réalité, leur régime alimentaire<br />
en fait une alliée pour l'homme <strong>et</strong><br />
ses activités agricoles : elles débarrassent<br />
<strong>des</strong> moustiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> autres insectes indésirables<br />
les alentours <strong>des</strong> habitations.<br />
POUR MIEUX LES PROTÉGER<br />
L'éclairage <strong>des</strong> bâtiments (églises, monuments<br />
historiques…) constitue une mise en<br />
valeur du patrimoine culturel mais limite la<br />
fréquentation de ces refuges potentiels par<br />
les nombreuses espèces nocturnes dont<br />
les chauve-souris. Les traitements <strong>des</strong> bois<br />
de charpente à base de lindane <strong>et</strong> de toxaphène<br />
sont très nocifs tandis que la<br />
condamnation <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites ouvertures par<br />
du grillage à poules représente une piège<br />
mortel. Une chiroptière peut être facilement<br />
aménagée avec une loge de bois placée<br />
à mi-pente ou dans la moitié inférieure<br />
<strong>des</strong> pans de toiture.<br />
LES OISEAUX<br />
Localisation dans la construction<br />
traditionnelle<br />
Le Rouge-queue noir, l'Etourneau sansonn<strong>et</strong>, le<br />
Moineau domestique, l'Hirondelle rustique (ou<br />
hirondelle de chemin) <strong>et</strong> l'Hirondelle de fenêtre,<br />
le Martin<strong>et</strong>, le Faucon crécerelle, la Chou<strong>et</strong>te<br />
effraie, le Choucas <strong>des</strong> Tours, le Pigeon bis<strong>et</strong><br />
sont <strong>des</strong> hôtes habitués <strong>des</strong> milieux bâtis :<br />
- anfractuosités <strong>des</strong> constructions, au niveau<br />
d'un interstice sombre <strong>et</strong> étroit, entre le toit <strong>et</strong><br />
le mur porteur ( Martin<strong>et</strong> noir)<br />
- intérieur <strong>des</strong> bâtiments au niveau <strong>des</strong> pièces<br />
de charpente <strong>des</strong> dépendances (Hirondelle<br />
rustique)<br />
- contre les faça<strong>des</strong>, sous les toits ou dans les<br />
encoignures de fenêtres (Hirondelle de fenêtre)<br />
- trous de murs <strong>et</strong> combles <strong>des</strong> édifices élevés<br />
(Choucas <strong>des</strong> Tours)<br />
- clochers, hangars, greniers <strong>et</strong> pigeonniers<br />
(Faucon crécerelle, Chou<strong>et</strong>te effraie).<br />
Comme les chauve-souris, le régime alimentaire<br />
<strong>des</strong> oiseaux (insectes <strong>et</strong> p<strong>et</strong>its rongeurs<br />
pour les rapaces) en fait <strong>des</strong> alliés pour<br />
l'homme. Leurs allers <strong>et</strong> venus composent<br />
un ball<strong>et</strong> aérien <strong>et</strong> régulier toujours fort<br />
attrayant <strong>et</strong> apprécié en milieu rural.
POUR MIEUX LES PROTÉGER<br />
Les emplacements favorables à l'installation <strong>des</strong><br />
oiseaux manquent souvent dans les nouvelles<br />
constructions. De plus, les déjections liées à<br />
leur présence (salissures sur les faça<strong>des</strong>) font<br />
peu apprécier la présence de ces locataires. Il<br />
existe cependant <strong>des</strong> nichoirs bien conçus perm<strong>et</strong>tant<br />
de minimiser ce désagrément.<br />
L'imperméabilisation totale <strong>des</strong> surfaces extérieures<br />
(cour macadam…) est aussi un facteur<br />
défavorable à leur installation en rendant difficile<br />
l'approvisionnement en terre pour l'édification<br />
<strong>des</strong> nids. Surtout, l'utilisation généralisée<br />
<strong>des</strong> insectici<strong>des</strong> <strong>et</strong> le traitement <strong>des</strong> bois fragilisent<br />
les effectifs.<br />
LA FLORE<br />
Localisation dans la construction traditionnelle<br />
Sur les vieilles constructions, une végétation<br />
parfois luxuriante peut s'installer. Les lichens,<br />
étrange association d'un champignon <strong>et</strong> d'une<br />
algue, sont parmi les premiers colonisateurs<br />
<strong>des</strong> pierres <strong>et</strong> <strong>des</strong> ardoises. Ces espèces sont<br />
suivies par quelques mousses pionnières. Ces<br />
deux types d'organismes jouent une rôle prépondérant<br />
dans le lent processus de colonisation<br />
végétale. Leur décomposition apporte en<br />
eff<strong>et</strong> la matière organique nécessaire à l'installation<br />
d'espèces plus exigeantes : fougères <strong>et</strong><br />
plantes à fleurs.<br />
Les fougères plutôt rares dans la région colonisent<br />
toutefois les vieux murs présentant <strong>des</strong><br />
fissures. La Rue <strong>des</strong> murailles ou la Doradille<br />
fausse capillaire sont parmi les hôtes les plus<br />
fréquents <strong>des</strong> murs <strong>et</strong> rochers secs. La<br />
Scolopendre-Langue de cerf se développe<br />
dans les zones ombragées <strong>et</strong> humi<strong>des</strong>, notamment<br />
sur les bases <strong>et</strong> fissures de certains<br />
ouvrages hydrauliques en ruine.<br />
Le lierre, espèce à feuillage persistant, forme<br />
<strong>des</strong> lianes qui s'accrochent aux murs au moyen<br />
de p<strong>et</strong>its crampons.<br />
La valériane rouge se développe sur les rochers<br />
<strong>et</strong> les murs où ses racines puissantes parviennent<br />
à s'ancrer. Elle est souvent accompagnée<br />
de la Giroflée <strong>des</strong> murailles, communément<br />
appelée «murailler».<br />
L'Orpin acre ou poivre <strong>des</strong> murailles est assez<br />
commun sur les replats ensoleillés <strong>des</strong> vieux<br />
murs.<br />
L'intérêt de la flore <strong>des</strong> murs<br />
II est bon de r<strong>et</strong>enir que les plantes profitent de<br />
la dégradation d'un mur mais ne provoquent<br />
pas de dégradation supplémentaire. Souvent<br />
même, elles contribuent à stabiliser l'ouvrage.<br />
Le lierre joue un grand rôle esthétique lorsqu'il<br />
masque les vieux murs, mais il a tendance à<br />
accroître les fissures <strong>des</strong> murs en mauvais état.<br />
Toutes ces plantes colonisant les vieux murs<br />
présentent, certes, un intérêt ornemental.<br />
Surtout, elles offrent un vrai refuge <strong>et</strong> une<br />
source de nourriture pour une quantité d'animaux<br />
: lézard <strong>des</strong> murailles, fourmis, araignées,<br />
papillons, p<strong>et</strong>its rongeurs, hérisson,<br />
oiseaux, chauve-souris… C<strong>et</strong>te végétation particulière<br />
<strong>et</strong> spontanée participe de l'équilibre<br />
fragile de l'écosystème <strong>naturel</strong> qu'il est utile de<br />
réserver.<br />
Aujourd'hui, la population voit à tort les méfaits<br />
de c<strong>et</strong>te végétation particulière <strong>et</strong> tous les<br />
moyens sont parfois mis en oeuvre pour la supprimer<br />
: murs en crépis ou en ciment (toxique<br />
<strong>et</strong> trop dur pour la végétation). Il vaut pourtant<br />
mieux éviter tout arrachage systématique <strong>et</strong><br />
contrôler le développement <strong>des</strong> plantes les plus<br />
dynamiques. A la construction de murs, un<br />
mortier de chaux à gros sable perm<strong>et</strong> la colonisation<br />
<strong>des</strong> joints ; pour ceux remontés en pierre<br />
<strong>naturel</strong>le, <strong>des</strong> p<strong>et</strong>its trous <strong>et</strong> interstices sont<br />
utiles pour de nombreux animaux.<br />
UN PETIT COIN DE<br />
NATURE DANS LES<br />
CLOCHERS<br />
Les chauves-souris souffrent de la<br />
disparition de trois éléments vitaux :<br />
les gîtes d'été (en particulier pour la<br />
reproduction), les gîtes d'hiver (pour<br />
l'hibernation) <strong>et</strong> les terrains de chasse.<br />
La Coordination Mammalogique du<br />
Nord de la France (CMNF) s'intéresse<br />
au sort de ces mammifères volants<br />
qui sont de précieux indicateurs de la<br />
qualité de notre environnement… <strong>et</strong><br />
de p<strong>et</strong>its animaux bien inoffensifs !<br />
Sur le territoire du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>,<br />
les prospections ont été lancées<br />
dès 1997 pour mieux connaître les<br />
populations de chauves-souris.<br />
Quand ces colonies sont repérées,<br />
<strong>des</strong> aménagements sont proposés<br />
pour les protéger. Ainsi, les clochers<br />
sont équipés de sorte à perm<strong>et</strong>tre<br />
aux chauves-souris de rentrer, mais<br />
pas aux pigeons ! Parfois, on y ajoute<br />
un nichoir à chou<strong>et</strong>te effraie… Les<br />
grottes sont fermées par <strong>des</strong> grilles<br />
spéciales pour éviter le dérangement.<br />
C'est maintenant tout un réseau de<br />
gîtes d'hiver <strong>et</strong> de gîtes d'été qui est<br />
en place sur le territoire du <strong>Parc</strong>.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 47
48 I Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les bâtiments<br />
aux fonctions spécifiques<br />
I PARTIE 3 I
Les manoirs LA VALLÉE<br />
L'histoire agitée du comté d'Artois <strong>et</strong> de<br />
la province du Boulonnais, dont les<br />
frontières respectives traversaient<br />
jusqu'au XVIIème siècle l'actuel territoire<br />
du <strong>Parc</strong>, a suscité la création d'un type<br />
d'habitat particulier appelée "manoir".<br />
L'état d'insécurité permanente explique<br />
aussi la construction, jusqu'au XVIIème siècle, de manoirs ou de fermes fortifiées<br />
sous <strong>des</strong> allures de forteresses<br />
médiévales. Il faut attendre les<br />
perspectives d'une paix durable, avec le<br />
r<strong>et</strong>our de la province d'Artois dans le<br />
Royaume de France <strong>et</strong> la conclusion du<br />
traité de Nimègue (1678), pour que la<br />
noblesse mi-guerrière, mi-paysanne<br />
r<strong>et</strong>ourne à la terre. Manoirs <strong>et</strong> maisons<br />
fortes peuvent alors délaisser leurs<br />
allures défensives pour concentrer<br />
maintenant toutes les activités d'une<br />
exploitation agricole tandis que le corps<br />
de logis est transformé essentiellement<br />
pour l'apparat ou l'agrément (le confort<br />
intérieur). Les seigneurs les plus aisés, qui<br />
éprouvent le besoin de mener une<br />
existence confortable <strong>et</strong> mondaine,<br />
distribuent les mo<strong>des</strong>tes demeures de<br />
leurs ancêtres entre les fermiers à<br />
l'exception d'une seule sur laquelle ils<br />
concentrent leurs soins <strong>et</strong> dont ils font<br />
un château(1). Ceux <strong>des</strong> gentilshommespropriétaires,<br />
qui se distinguent dans<br />
l'armée <strong>et</strong> côtoient la noblesse ou qui<br />
remplissent une charge administrative <strong>et</strong><br />
fréquentent la bourgeoisie urbaine,<br />
deviennent sensibles au style<br />
architectural <strong>et</strong> à la culture de son<br />
époque qu'ils transposent dans leur<br />
propre maison.<br />
L'USAGE DES MANOIRS<br />
Le manoir est l'habitat d'une personne de rang.<br />
Son titre de propriété seigneuriale est attesté<br />
par <strong>des</strong> écrits. Le caractère rural ou semi-rural<br />
du manoir est perceptible par l'adjonction<br />
d'une activité agricole ou par la transformation<br />
<strong>des</strong> bâtiments à c<strong>et</strong>te fin.<br />
LA LOCALISATION<br />
Ils sont répartis diffusément sur l'ensemble du<br />
territoire du <strong>Parc</strong>. Une concentration <strong>des</strong><br />
manoirs est n<strong>et</strong>tement distincte sur le territoire<br />
boulonnais tandis qu'ils sont un genre peu<br />
représenté dans l'Audomarois <strong>et</strong> le Haut-Artois<br />
où quelques fermes fortifiées <strong>et</strong> mottes<br />
féodales subsistent aux côtés de demeures<br />
véritablement bourgeoises (Recques-sur-Hem :<br />
Cocove). Quelques éléments expliquent c<strong>et</strong>te<br />
répartition inégale, avec :<br />
- l'absence de gran<strong>des</strong> villes <strong>et</strong> de la bourgeoisie<br />
disposée à investir ses capitaux dans la terre <strong>et</strong><br />
la construction<br />
- le défaut de forêts giboyeuses, qui attirent la<br />
noblesse<br />
- la colonisation récente de la Plaine Maritime<br />
Flamande avec notamment la conquête <strong>des</strong><br />
terres maresques, aux environs même de<br />
Saint-Omer...<br />
- la géographie <strong>des</strong> matériaux de construction<br />
avec une bonne pierre à bâtir, rare en Artois.<br />
II faut atteindre les bordures du marais <strong>et</strong><br />
attendre les premières hauteurs pour constater<br />
l'implantation <strong>des</strong> quelques châteaux<br />
médiévaux (Tilques : château d'Ecou,<br />
Tournehem-sur-Hem, Eperlecques : Gansp<strong>et</strong>te)<br />
ou manoirs (Nordausque : Ferme de Welle) qui<br />
nous parviennent aujourd'hui..<br />
Le manoir est généralement construit sur un site<br />
géographique défensif, soit qu'il contrôle un<br />
point de vue en surplomb d’une voie de<br />
communication ou de pénétration, soit qu'il<br />
s'abrite <strong>et</strong> devient difficile à conquérir. Il est<br />
souvent isolé en campagne.<br />
POUR UNE TYPOLOGIE<br />
Un manoir peut qualifier une maison<br />
accompagnée de dépendances <strong>et</strong> dotée<br />
d'organes protecteurs rudimentaires, clôtures,<br />
fosses... Par opposition, le château est un<br />
organisme complexe <strong>et</strong> étendu, fortement<br />
armé dont l'enceinte abrite d'assez nombreux<br />
DES CHÂTEAUX<br />
La vallée du Wimereux recèle, audelà<br />
de nombreux manoirs, de<br />
superbes châteaux de plaisance<br />
édifiés à partir de la seconde moitié<br />
du XVII ème siècle.<br />
Ces châteaux sont bien<br />
reconnaissables <strong>et</strong> gardent <strong>des</strong><br />
caractéristiques semblables :<br />
simplicité <strong>des</strong> volumes, logis<br />
rectangulaire encadré de deux ailes<br />
en avancée, toit à longs pans ou toit à<br />
la Mansard, <strong>et</strong> grande symétrie <strong>des</strong><br />
faça<strong>des</strong>.<br />
Les châteaux de Souverain-Moulin,<br />
Colembert, Fouquehove,<br />
Lozembrune, Valembrune, du P<strong>et</strong>it<br />
Denacre, se découvrent parfois lors<br />
<strong>des</strong> journées du patrimoine, ou dans<br />
le guide architectural de la vallée du<br />
Wimereux, publié par le <strong>Parc</strong>.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 49
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
50 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les manoirs (suite)<br />
bâtiments dont un donjon (Château d'Hardelot<br />
à Cond<strong>et</strong>te…).<br />
Enfin, le manoir se distingue de l'habitat<br />
domestique environnant par sa taille élevée;<br />
cependant, ce critère ne suffit pas à le qualifier.<br />
C'est une sobre combinaison de signes<br />
architecturaux distinctifs qui le compose :<br />
- un étage<br />
- présence d'au moins une tour<br />
- un appareillage soigné en pierres de taille, grès<br />
ou craie, ou en briques<br />
- une qualité d'encadrement <strong>des</strong> baies<br />
- <strong>des</strong> motifs en bas relief apposés en façade<br />
principale<br />
- fortes pentes de toiture…<br />
Si les manoirs les plus archaïques évoquent très<br />
visiblement l'univers médiéval avec un aspect<br />
austère, d'autres offrent une vision moderne de<br />
la maison de plaisance. Les manoirs du<br />
Boulonnais conservent une typologie bien plus<br />
marquée <strong>et</strong> unitaire que dans le Haut-Artois <strong>et</strong><br />
dans l'Audomarois. Or ce type d'habitat nous<br />
parvient le plus souvent après reconstruction,<br />
restauration, agrandissement…<br />
L'IMPLANTATION ET L'ORIENTATION<br />
DU LOGIS<br />
Le manoir tourne généralement le dos à la<br />
nature de sorte qu'il présente <strong>des</strong> murs<br />
aveugles <strong>et</strong> protecteurs sur l'entrée ou sur<br />
l’extérieur.<br />
L'orientation de la façade principale du logis au<br />
sud ou au sud-est, sur la cour d'exploitation,<br />
reste l'expression la plus manifeste d’une<br />
économie rurale. C<strong>et</strong>te disposition vise à<br />
protéger l'exploitation agricole que le manoir<br />
commande.<br />
ORGANISATION<br />
L'organisation d'un manoir reste à l'image d'une<br />
p<strong>et</strong>ite forteresse <strong>et</strong> d'une habitationexploitation.<br />
Toutefois, l’organisation médiévale<br />
peut rester perceptible dans le plan avec une<br />
cour, une basse cour <strong>et</strong> une enceinte parfois<br />
défendue par un pont-levis, <strong>des</strong> courtines, <strong>des</strong><br />
fossés, <strong>des</strong> murailles noyées par la dérivation<br />
d'un bras d'eau ou une source...<br />
Le logis reste lui, à l'image de l'habitationexploitation<br />
traditionnelle. La porte d'entrée du<br />
manoir ouvre directement sur une seule pièce,<br />
la salle commune, réduite <strong>et</strong> obscure dont le<br />
confort rudimentaire se limite à la présence<br />
d'une vaste cheminée en pierre. C<strong>et</strong>te pièce est<br />
souvent voûtée en p<strong>et</strong>its berceaux parallèles<br />
dressés sur poutres de chêne posées en biais. A<br />
l'étage, les chambres vastes <strong>et</strong> spacieuses sont<br />
plus éclairées <strong>et</strong> aérées qu'au rez-de-chaussée;<br />
elles se commandent l'une l'autre ou donnent<br />
toutes sur une pièce centrale. Une tour abrite<br />
<strong>des</strong> pièces de service, plus communément, un<br />
escalier à vis qui <strong>des</strong>sert les chambres d'étage.<br />
Elle est occupée au point le plus haut par une<br />
pièce de service ou un colombier.<br />
LA CONSTRUCTION<br />
• les murs<br />
La composition de la maçonnerie varie selon la<br />
nature géologique du sous-sol environnant : les<br />
grès <strong>et</strong> calcaires durs dans le Boulonnais offrent
aux constructions une allure rustique tandis<br />
qu'en Artois, la craie est d'un usage courant.<br />
Chacun de ses matériaux est diversement<br />
associé au silex (soubassements) ou à la brique.<br />
Ainsi dans l'Artois, la craie peut alterner avec<br />
<strong>des</strong> assises de briques.<br />
Sur le territoire du <strong>Parc</strong>, l'utilisation exclusive<br />
de la brique semble toutefois exceptionnelle<br />
car bien moins courante que la pierre. En<br />
Boulonnais, il existe quelques manoirs<br />
reconstruits en brique à partir d'un<br />
soubassement en grès du XVI-XVII ème siècle, la<br />
brique étant ici considérée comme un<br />
matériau de prestige (Senlecques,<br />
Neufchâtel, Tingry, Doudeauville...). D'usage<br />
plus tardif, elle désigne<br />
souvent une restauration<br />
ou une reconstruction.<br />
En Artois, c'est vers<br />
1850 que l'usage de la<br />
brique tend à se<br />
substituer à celui de la<br />
craie. En grande<br />
majorité, le rapport <strong>des</strong><br />
parties maçonnées<br />
pleines dominent les<br />
parties vi<strong>des</strong> <strong>et</strong> l'élévation en hauteur du<br />
manoir, généralement sur deux niveaux,<br />
constitue l'un <strong>des</strong> premiers moyens défensifs,<br />
renforcé par d'autres : mâchicoulis,<br />
échaugu<strong>et</strong>te, épaisseur <strong>des</strong> murs, murailles,<br />
courtines… Les dépendances peuvent être<br />
simplement élevées en pans de bois <strong>et</strong> terre.<br />
• les baies<br />
L'organisation médiévale<br />
peut rester perceptible<br />
avec une<br />
rar<strong>et</strong>é <strong>des</strong> ouvertures<br />
<strong>et</strong> la présence de<br />
meurtrières ou d'archères<br />
comme<br />
moyens défensifs. La<br />
qualité d'encadrement<br />
<strong>des</strong> baies, en<br />
pierre de taille, s'exprime le plus visiblement<br />
dans la porte d'entrée, souvent en plein-cintre<br />
avec piédroits appareillés, à un vantail en<br />
bois plein.. Les quelques fenêtres du rez-dechaussée,<br />
de forme étroite, sont défendues<br />
par une solide grille de fer. Certaines baies<br />
d'étage montrent encore <strong>des</strong> croisées à<br />
meneaux. Les lucarnes architecturées sont<br />
d'époque plus tardive.<br />
• la toiture<br />
La toiture est en bâtière suivant une inclinaison<br />
comprise entre 50 <strong>et</strong> jusqu'à 60° environ,<br />
sans coyau prononcé. Les tuiles plates<br />
ont quasiment disparu au profil de la panne<br />
flamande ou de l'ardoise <strong>des</strong> Ardennes.<br />
• quelques éléments distinctifs<br />
Le signe le plus important tient dans la présence<br />
d'au moins une tour, qui témoigne<br />
souvent de la construction d'origine <strong>et</strong> porte<br />
encore les traces <strong>des</strong> dispositifs défensifs<br />
(meurtrières, mâchicoulis, échaugu<strong>et</strong>te, couleuvrières,<br />
archères...). La tour est apposée<br />
en façade sur plan polygonal, rond ou carré.<br />
Plus rarement, elle est construite en encorbellement<br />
à partir de l'étage. La présence<br />
d'autres tours, devenues dépendances agricoles<br />
ou remises, témoignent de la présence<br />
d'un éventuel mur d'enceinte.<br />
Le pigeonnier de pied, isolé au centre de la<br />
cour, constitue la dernière tour de prestige.<br />
• les annexes<br />
La manoir associe tout bâtiment relevant<br />
d'une activité agricole <strong>et</strong> propre au statut<br />
d'une exploitation-habitation: écurie, étables,<br />
granges, puits, fournil, porcherie, buanderie,<br />
jardin-potager, verger clos de mur<strong>et</strong>s... La présence<br />
d'une chapelle castrale est exceptionnelle.<br />
Le droit féodal peut encore accorder<br />
en qualité d'annexes un moulin, un pressoir…<br />
associé au manoir ou même éloigné géographiquement.<br />
Evolution<br />
Au XVIII ème siècle, les transformations du<br />
logis portent sur l'agrément <strong>et</strong> sur<br />
l'apparence. Le manoir, quand il est<br />
transfiguré en une conception moderne<br />
de la gentilhommière, offre alors un tout<br />
autre aspect avec <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> équilibrées<br />
<strong>et</strong> largement percée de luxueuses baies<br />
régulièrement ordonnées.<br />
Le logis s'agrandit, les constructions<br />
annexes à vocation défensive sont<br />
converties en dépendances <strong>et</strong> bâtiments<br />
utilitaires... De nos jours, le manoir a<br />
souvent conservé sa vocation rurale<br />
d'exploitation agricole.<br />
LE CHÂTEAU<br />
D'ACQUIN :<br />
UNE RENAISSANCE<br />
L'imposante bâtisse de craie, assise<br />
au cœur du village <strong>et</strong> appelée ferme<br />
fortifiée, est en réalité un fort édifié<br />
de 1412 à 1416 en pleine guerre de<br />
Cent Ans pour se protéger <strong>des</strong><br />
exactions <strong>des</strong> anglais. Victime <strong>des</strong><br />
conflits, délabrée, abandonnée, elle<br />
fut acquise au début de ce siècle par<br />
un particulier qui a mené avec l'aide<br />
du <strong>Parc</strong>, <strong>et</strong> l'assistance d'un architecte<br />
du patrimoine, un long travail de<br />
restauration <strong>et</strong> d'aménagement.<br />
C<strong>et</strong>te action a été labellisée par la<br />
Fondation du Patrimoine.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 51
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
52 I Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
Les marais de Guînes <strong>et</strong> de Saint-Omer<br />
sont <strong>des</strong> territoires remarquables du <strong>Parc</strong><br />
<strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>. Leurs paysages, d'une<br />
grande richesse écologique, ont<br />
pourtant été façonnés par l'homme<br />
depuis 10 siècles <strong>et</strong> leur mode de<br />
gestion a engendré un type d'habitat<br />
spécifique.<br />
L'habitat <strong>des</strong> marais :<br />
la maison du maraîcher-tourbier <strong>et</strong> de<br />
polyculteur<br />
LA DESTINATION<br />
Les maraîchers viennent se fixer dans le marais<br />
pour y cultiver <strong>des</strong> terres favorables à la<br />
production légumière. Dans ce même secteur, la<br />
tourbe est exploitée comme combustible de<br />
chauffage.<br />
LA LOCALISATION<br />
Ce patrimoine, encore très présent dans la vaste<br />
étendue du marais audomarois (communes de<br />
Claimarais, Eperlecques, Salperwick, Saint-Omer,<br />
Serques <strong>et</strong> Tilques), devient plus rare dans les<br />
marais de Guines <strong>et</strong> Andres.<br />
Les maraîchers ont fixé leur habitat dans le milieu<br />
mouvant <strong>et</strong> incertain du marais (inondabilité), sur<br />
<strong>des</strong> p<strong>et</strong>its îlots. Dans c<strong>et</strong> environnement de<br />
canaux <strong>et</strong> de fossés, la barque, est le mode de<br />
déplacement privilégié jusqu'à l'aménagement<br />
<strong>des</strong> ponts <strong>et</strong> chemins de remembrement. Dans le<br />
marais audomarois, certaines exploitations<br />
continuent d'ailleurs d'être uniquement<br />
accessibles par voie d'eau.<br />
LA TYPOLOGIE DU BÂTI<br />
La silhou<strong>et</strong>te générale de l'habitation est toujours<br />
basse <strong>et</strong> allongée.<br />
L'implantation commune au marais audomarois <strong>et</strong><br />
guînois, fixe la façade principale de l'habitation<br />
tournée vers le sud-est. L'habitation est souvent<br />
séparée de la route par un fossé ou canal qu'on<br />
franchit par un ponton.<br />
Dans le marais audomarois, l’habitation est<br />
généralement située perpendiculairement ou<br />
parallèlement au fossé. Dans le marais guînois,<br />
l’habitation est située perpendiculairement au fossé.<br />
Dans le marais audomarois, l'habitationexploitation<br />
est organisée sur une ligne simple<br />
avec une grange apignonnée à l'habitation. Un<br />
appentis appuyé en pignon de l'habitation du côté<br />
du fossé ou canal. Un autre appentis peut être<br />
ajouté sur l'arrière de l'habitation. Dans le marais<br />
guînois, l'habitation-exploitation est à ce point<br />
mo<strong>des</strong>te qu'elle peut se réduire à une habitation<br />
élémentaire avec appentis.<br />
LA CONSTRUCTION<br />
• Les fondations <strong>et</strong> murs<br />
Une semelle profonde <strong>et</strong> large compense la faible<br />
portance du sol fangeux du marais. Dans son<br />
prolongement, la force épaisseur du<br />
soubassement en briques perm<strong>et</strong> d'asseoir<br />
solidement la construction.<br />
Les murs sont élevés en pans de bois <strong>et</strong> terre, <strong>des</strong><br />
matériaux dits «pauvres» <strong>et</strong> «crus», disponibles en<br />
quantité sur le marais. Plus tardivement, dans le<br />
marais audomarois, ils sont élevés en briques.<br />
Quelques linteaux de bois encore apparents<br />
désignent les constructions les plus mo<strong>des</strong>tes.<br />
Maison audomaroise Maison guinoise
Chaque façade est badigeonnée au lait de chaux.<br />
La base <strong>des</strong> murs (soubassement) est<br />
badigeonnée de goudron. Le traitement <strong>des</strong><br />
pignons présente <strong>des</strong> différences selon la<br />
localisation géographique de la construction :<br />
- dans le marais audomarois, les pignons<br />
maçonnés <strong>et</strong> couverts supportent chacun un<br />
conduit de cheminée. Le pignon le plus exposé<br />
présente parfois <strong>des</strong> rampants saillants.<br />
- dans le marais guînois, les exemples les plus<br />
représentatifs montrent deux pignons à pans de<br />
bois <strong>et</strong> terre sous le couvert <strong>des</strong> croupes de la<br />
toiture principale.<br />
• Les baies<br />
Les fenêtres sont composées en général de deux<br />
battants à 3 carreaux, avec contrevents faits de<br />
simples planches de bois assemblées soit par 2 a 3<br />
barres transversales, soit en tête par une traverse<br />
haute, à pivot <strong>et</strong>/ou barre d'acoupellement. Les<br />
portes sont pleines, surmontées d'une imposte, <strong>et</strong><br />
peuvent parfois être composées de 2 battants<br />
superposés<br />
• La toiture<br />
Dans le marais audomarois, les toitures sont en<br />
simple bâtière à versants adoucis par un coyau,<br />
recouvertes de pannes de pays de teinte rougeorangée.<br />
Une cheminée est présente sur chaque<br />
pignon, axée sur la ligne de faîtage.<br />
Dans le marais guînois, les toitures sont à croupes,<br />
avec <strong>des</strong> versants adoucis par un large coyau. La<br />
cheminée occupe une position centrale, axée sur<br />
la ligne de faîtage.<br />
LES DÉPENDANCES AGRICOLES<br />
Sont à ossature bois posée sur un soubassement<br />
en briques. Le parement extérieur est constitué de<br />
planches à clins clouées sur une charpente en bois<br />
<strong>et</strong> badigeonnées au goudron sous le couvert de la<br />
toiture en bâtière.<br />
Dans le marais audomarois, la dépendance<br />
agricole est apignonnée à l'habitation, son pignon<br />
est fermé par <strong>des</strong> planches à clins<br />
Dans le marais guînois, quelques exemples<br />
utilisent la technique de construction en pans de<br />
bois <strong>et</strong> terre sur un soubassement en briques.<br />
LES ÉLÉMENTS DE DÉCOR<br />
- LA COULEUR<br />
L'utilisation de la couleur est le seul support de<br />
décoration possible : les murs sont badigeonnés<br />
de blanc, ocre jaune ou ocre-rouge, les<br />
menuiseries sont peintes en vert ou marron, les<br />
encadrements en bandeaux sont soulignés par un<br />
badigeon de teinte différente <strong>des</strong> murs.<br />
UNE PARTICULARITÉ : LA MAISON DU<br />
POLYCULTEUR<br />
Les maraîchers-polyculteurs pratiquent sur leurs<br />
terres les associations de cultures légumières en<br />
fonction du niveau saisonnier <strong>des</strong> eaux.<br />
L'habitation-exploitation est organisée en trois<br />
parties distinctes, disposés en U autour d'une cour<br />
qui fait face au chemin d'eau («watergang») <strong>et</strong> au<br />
marais. Les constructions ne sont pas contigües.<br />
L'habitation occupe une position centrale, les<br />
deux dépendances agricoles l'entourent.<br />
Les dépendances sont <strong>des</strong> constructions isolées, à<br />
ossature bois posée sur un soubassement en<br />
briques.<br />
Le parement extérieur est constitué de planches à<br />
clins clouées sur une charpente en bois <strong>et</strong><br />
badigeonnées au goudron sous le couvert d'une<br />
toiture en bâtière.<br />
L'exploitation peut comporter un hangar à bateau<br />
attenant aux dépendances agricoles où isolé.<br />
Maison du polyculteur<br />
Aujourd'hui<br />
La disparition <strong>des</strong> p<strong>et</strong>ites exploitations<br />
entraîne la reprise <strong>des</strong> maisons de maraîchertourbier<br />
<strong>et</strong> de polyculteur par une population<br />
non agricole. Certaines sont transformées en<br />
résidences secondaires Le milieu du marais<br />
voit donc se diversifier sa population socioprofessionnelle<br />
en même temps, il perd celle<br />
qui, à l'origine était tout entière dévouée à<br />
l'entr<strong>et</strong>ien de son cadre de vie.<br />
LE MARAIS<br />
AUDOMAROIS<br />
Cuv<strong>et</strong>te alimentée par l'Aa, le marais<br />
de Saint-Omer était une terre inculte<br />
noyée de marécages, jusqu'au VIIème siècle.<br />
Vers l'an 800, les moines de l'Abbaye<br />
Saint-Bertin firent dériver les eaux de<br />
l'Aa jusque Arques pour y construire<br />
un moulin.<br />
Vers l'an 905, la haute Meldyck, bras<br />
de l'Aa, est canalisée vers l'Abbaye.<br />
A partir du XIIème siècle, les moines<br />
encouragent la création d'une voie<br />
fluviale à travers le marais ; un canal<br />
joint Saint-Omer à Watten <strong>et</strong><br />
Gravelines, donne un rôle<br />
commercial important à Saint-Omer.<br />
A partir de c<strong>et</strong>te époque commence<br />
la mise en valeur agricole du marais.<br />
L'exploitation <strong>des</strong> terres s'est<br />
effectuée…<br />
Le marais audomarois est lié à la ville<br />
de Saint-Omer, pôle commercial<br />
médiéval important, qui assure un<br />
trafic par voie fluviale avec la Mer du<br />
Nord.<br />
La conquête <strong>des</strong> terres du marais fort<br />
ancienne s'est effectuée par<br />
défrichement <strong>et</strong> par drainage avec la<br />
création d'un dense réseau de<br />
chemins d'eau, <strong>et</strong> régulation <strong>des</strong> eaux<br />
par vannage <strong>et</strong> parfois par <strong>des</strong><br />
moulins de pompage (système <strong>des</strong><br />
casiers). Après l'arrivée du chemin de<br />
fer, la production légumière se<br />
renforce <strong>et</strong> se spécialise dans la<br />
culture du chou-fleur <strong>et</strong> de l'endive.<br />
Patrimoine bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 53
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
54 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
L'habitat <strong>des</strong> marais (suite)<br />
L'habitat <strong>des</strong> faubourgs :<br />
la maison du propriétaire-exploitant<br />
Ces maisons particulières sont à la fois l'habitat <strong>et</strong><br />
le siège d'une exploitation agricole qui emploie les<br />
journaliers vivant dans leur voisinage.<br />
LA LOCALISATION<br />
Les maisons groupées <strong>des</strong> faubourgs maraîchers<br />
se localisent à l'interface du marais cultivé <strong>et</strong> de la<br />
ville, en liaison directe avec un canal pour le<br />
transport <strong>des</strong> marchandises :<br />
- à l'entrée nord de la Commune de Guînes, au<br />
lieu-dit «Le Batelage»<br />
- dans les faubourgs du Haut-Pont <strong>et</strong> du Lyzel, à<br />
Saint-Omer.<br />
Les maisons font face au canal, en bordure de<br />
route <strong>et</strong> sont <strong>des</strong>servies à l'arrière par voie d'eau.<br />
La présence marquée de l'eau souligne<br />
l'importance portuaire <strong>et</strong> commerciale <strong>des</strong> lieux :<br />
- dans le faubourg du Haut-Pont à Saint-Omer, les<br />
bélandres(1) viennent accoster le long <strong>des</strong> quais<br />
pour charger la production maraîchère <strong>des</strong><br />
alentours.<br />
- à Guînes, l'activité portuaire est plus marquée,<br />
essentiellement tournée vers la batellerie, avec<br />
une zone cultivée dans le marais réduite.<br />
L'habitat groupé <strong>des</strong> faubourgs maraîchers<br />
juxtapose les maisons exiguës <strong>des</strong> journaliers <strong>et</strong><br />
celles, plus cossues <strong>des</strong> propriétaires-exploitants.<br />
LA TYPOLOGIE<br />
Ces habitations sont de type urbain, assimilable à<br />
la maison de bourg.<br />
Le bâti y est dense <strong>et</strong> mitoyen. Il est situé en<br />
alignement sur la rue, assurant la continuité <strong>et</strong><br />
l'homogénéité du front bâti. Toutefois le paysage<br />
de la rue reste varié par la disparité <strong>des</strong> gabarits.<br />
L'ORGANISATION<br />
L'habitation du propriétaire-exploitant se distingue<br />
de l'habitat <strong>des</strong> journaliers par un développé de<br />
façade (plusieurs travées) <strong>et</strong> un gabarit supérieurs<br />
(rez-de-chaussée + 1 étage + combles).<br />
Les plus larges faça<strong>des</strong> sont percées d'une porte<br />
cochère latérale qui s’ouvre sur la cour <strong>et</strong> les<br />
bâtiments d'exploitation à l'arrière de l'habitation :<br />
- la cuisine à légumes<br />
- la remise pour les outils<br />
- la grange <strong>et</strong> l'écurie pour le cheval<br />
- les couches <strong>et</strong> les châssis pour les semis<br />
- l'entrepôt de marchandises<br />
- le jardin potager <strong>et</strong> le verger<br />
Un fossé borde la limite séparative arrière. Au delà<br />
du fossé, la cour ouvre sur le marais cultivé plus au<br />
loin.<br />
LA CONSTRUCTION<br />
• Les murs<br />
La façade est <strong>des</strong>sinée. Elle privilégie<br />
l'ordonnancement vertical. Les baies sont<br />
organisées en travées au nombre de 2 à 5, selon<br />
l'importance de la maison. La porte cochère<br />
latérale compose une travée indépendante.<br />
La construction est une maçonnerie en brique<br />
totalement enduite. Le soubassement est marqué<br />
d'une teinte différenciée <strong>et</strong> une légère saillie par<br />
rapport au nu de la façade. Chaque façade utilise<br />
une modénature d'enduit ou d'éléments moulurés<br />
en pierre d'où une diversité d'aspect.<br />
• Les baies<br />
Les baies, toujours sont plus hautes que larges,<br />
identiques <strong>et</strong> répétées, <strong>et</strong> sont strictement<br />
superposées. Elles sont hiérarchisées avec une<br />
diminution progressive <strong>des</strong> hauteurs de baies<br />
depuis les plus hautes au rez-de-chaussée au plus<br />
basses, à l'étage. Les fenêtres sont à 2 ouvrants, à<br />
grands bois, avec ou sans imposte vitrée selon la<br />
hiérarchie <strong>des</strong> ouvertures. La grande porte du<br />
passage charr<strong>et</strong>ier est à double battant en bois<br />
• La toiture<br />
La toiture fixe la ligne de faîtage parallèle à la rue.<br />
Elle peut être :<br />
- en bâtière selon une inclinaison de 45 à 50°,<br />
couvert de pannes de pays<br />
- avec brisis, couvert d'ardoise ou de pannes <strong>et</strong><br />
terrasson couvert de pannes de pays<br />
Pour éclairer <strong>des</strong> combles habités, la toiture est<br />
toujours percée de lucarnes à fronton, réalisées en<br />
bois ou en maçonnerie enduite. Ces lucarnes font<br />
partie intégrante de la composition générale <strong>des</strong><br />
faça<strong>des</strong>: elles sont alignées au rythme <strong>des</strong> baies <strong>des</strong><br />
niveaux inférieurs. Elles sont plus hautes que larges.<br />
• Les couleurs<br />
Les parties planes enduites sont diversement<br />
teintées d'une façade à l'autre. Tous les éléments<br />
moulurés, saillants <strong>et</strong> décoratifs sont soulignés par<br />
<strong>des</strong> teintes claires proches de la pierre. Les<br />
menuiseries sont peintes de teintes pastel. Seules<br />
les portes d'entrée sont renforcées par <strong>des</strong> teintes<br />
sombres (noir, brun foncé, vert anglais...).
L'habitat <strong>des</strong> faubourgs :<br />
la maison du journalier<br />
Dans le milieu particulier du marais, les journaliers<br />
sont fouisseurs à la livre (la livre est une unité de<br />
surface qui correspond à 35,4m2 ), c'est à dire qu'ils<br />
bêchent les terres <strong>des</strong>tinées aux cultures<br />
maraîchères au printemps, se consacrent à<br />
l'extraction de la tourbe l'été, enfin, ils curent la<br />
vase <strong>des</strong> fossés l'hiver.<br />
Ce type se distingue de l'habitat du journalier<br />
agricole par son environnement tout-à-fait<br />
particulier. L'habitation est de type urbain à un<br />
étage, accolée l'une à l'autre.. Elle dispose de peu<br />
de terrain <strong>et</strong> de peu de dépendances.<br />
La largeur de chaque façade, fort restreinte, est<br />
équilibrée par une plus grande profondeur,<br />
perceptible par <strong>des</strong> versants de toiture importants.<br />
L'IMPLANTATION SUR LA PARCELLE –<br />
L'ORGANISATION<br />
La façade avant se positionne à l'alignement de la<br />
rue, lui même peu régulier. Elle est tournée vers le<br />
sud-est, parallèlement à la direction du canal.<br />
L'ORGANISATION EN PLAN<br />
Une grande salle commune occupe tout le rez-dechaussée.<br />
A Saint-Omer, les combles sont habités<br />
(chambrées), accessibles par l'intérieur.<br />
A Guînes, les combles, utilisés pour le stockage,<br />
sont accessibles par l'intérieur (échelle <strong>et</strong> trappe) ou<br />
l'extérieur (lucarne).<br />
CONSTRUCTION<br />
• Les murs<br />
Les murs en brique, très épais, s'élèvent sur un<br />
soubassement lui même fort important, en réponse<br />
au terrain mouvant. C<strong>et</strong>te maçonnerie, épouse les<br />
mouvements <strong>naturel</strong>s du sol <strong>et</strong> nous parviennent<br />
aujourd'hui avec un fruit parfois très prononcé de la<br />
façade avant, notamment à Guînes. Dans un même<br />
rang, <strong>des</strong> murs pignons prolongés en wimbergues,<br />
séparent les habitations.<br />
• Les baies<br />
Sur la largeur de la façade avant <strong>et</strong> de la façade<br />
arrière, les baies se résument à une porte <strong>et</strong> une<br />
fenêtre. Les linteaux sont droits ou très légèrement<br />
cintrés (brique à chant), les encadrement<br />
simplement soulignés par une surépaisseur<br />
maçonnée. La porte <strong>et</strong> la fenêtre sont surmontés<br />
d'une imposte vitrée. La fenêtre est protégée par<br />
<strong>des</strong> contrevents.<br />
• La toiture, charpente <strong>et</strong> couverture<br />
La couverture est en pannes de pays. La cheminée<br />
axée sur la ligne de faîtage, est adossée au mur de<br />
refend, dos à dos avec celle du voisin<br />
A Saint-Omer, la toiture comporte un brisis adouci<br />
par un coyau. Une lucarne à fronton en bois<br />
éclaire les combles.<br />
A Guînes, la toiture est en simple bâtière suivant<br />
une inclinaison proche <strong>des</strong> 45°, sous couvert de<br />
pannes de pays. Un p<strong>et</strong>it châssis vitré éclaire les<br />
combles.<br />
• Les couleurs<br />
Certaines faça<strong>des</strong> s'autorisent quelques eff<strong>et</strong>s<br />
d'appareillages (cordon, bandeau...). Les photos<br />
d'époque montrent <strong>des</strong> faça<strong>des</strong> blanchies au<br />
badigeon de chaux duquel ressort la couleur <strong>des</strong><br />
menuiseries, tandis que le soubassement est<br />
enduit de goudron noir. L'identité de chaque foyer<br />
est distingué par la variation dans les couleurs de<br />
menuiseries.<br />
Aujourd’hui<br />
La création du canal pour le passage <strong>des</strong><br />
convois à grand gabarit, <strong>et</strong> le développement<br />
du transport routier ont fait perdre aux<br />
faubourgs maraîchers leur vocation portuaire.<br />
A Saint-Omer. l'activité de maraîchage est<br />
cependant tout-à-fait présente mais le<br />
regroupement <strong>des</strong> marchandises se fait par<br />
voie routière. Certaines p<strong>et</strong>ites maisons sont<br />
transformées en remise pour le matériel.<br />
A Guînes, le bassin du Batelage, les chenaux<br />
<strong>et</strong> les fossés en eau ont disparu, pour la<br />
plupart comblés, tandis que l'activité de<br />
maraîchage ne concerne plus que quelques<br />
rares exploitants. Néanmoins, la trace de c<strong>et</strong><br />
habitat, forme un élément caractéristique <strong>et</strong><br />
identitaire qui compose toujours l'entrée nord<br />
du bourg.<br />
Les maisons de journaliers sont en grand<br />
danger de disparition, notamment à Guînes.<br />
En eff<strong>et</strong>, leur taille réduite n'est plus adaptée<br />
aux normes d'habitabilité actuelle.<br />
LE MARAIS<br />
GUINOIS<br />
Le rivage <strong>des</strong> marais littoraux borde la<br />
ville jusqu'au IV ème siècle.<br />
Au XVII ème siècle, l'aménagement du<br />
port fluvial sur la rivière de Guînes, au<br />
lieu-dit "le Batelage" crée un carrefour<br />
d'échanges avec le port de Calais<br />
pour le transport de pierre, de bois,<br />
de produits agricoles, voire de<br />
voyageurs.<br />
Quelques chemins d'eau quadrillent<br />
le territoire. Mais l'année du chemin<br />
de fer signifie la fin de la batellerie, <strong>et</strong><br />
l'activité maraîchère reste limitée.<br />
Les pâtures constituent désormais<br />
l'essentiel du paysage.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 55
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
56 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
C<strong>et</strong> habitat particulier, perché sur les<br />
falaises ou proche <strong>des</strong> grèves ou s’échouaient<br />
les bateaux de pêche est souvent<br />
regroupé en foyers mitoyens, parfois<br />
en courées (Equihen-Plage,<br />
Audresselles, Le Portel..). Ce type d’habitat<br />
a été en grande partie détruit lors de<br />
la seconde guerre mondiale.<br />
LA MAISON<br />
La maison présente un pignon perpendiculaire<br />
à la côte <strong>et</strong>/ou aux vents dominants.<br />
Construite de plain-pied, elle se réduit à<br />
deux pièces : salle commune <strong>et</strong> chambre.<br />
Quelques appentis prolongent la toiture en<br />
façade nord ou pignon.
Les combles sont utilisés pour la remise <strong>des</strong><br />
fil<strong>et</strong>s.<br />
Le soubassement est enduit au goudron.<br />
Les murs bas sont en moellons de grès tout<br />
venant couvert d’un mortier puis d’un badigeon<br />
au lait de chaux.<br />
C<strong>et</strong> habitat exposé aux intempéries est peu<br />
ouvert sur l’extérieur. Les ouvertures sont<br />
en façade principale avec baies à encadrement<br />
en pierre <strong>et</strong> fenêtres étroites à 2 vantaux<br />
à 3 ou 4 carreaux.<br />
Une lucarne passante à fronton triangulaire<br />
ou cintré en pierre de Marquise est axée<br />
sur la porte d’entrée <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> de hisser le<br />
matériel de pêche dans les combles.<br />
La toiture est en bâtière avec une inclinaison<br />
de 50 l, couverte de pannes.<br />
La cheminée est adossée au pignon <strong>et</strong> axée<br />
sur la ligne de faîtage.<br />
LES COULEURS<br />
- soubassement peint en noir (goudron)<br />
- faça<strong>des</strong> badigeonnées à la chaux<br />
- menuiseries de couleurs vives<br />
(peintes souvent avec les restes de peinture<br />
<strong>des</strong> embarcations).<br />
LES "QUILLES EN L'AIR"<br />
Equihen-Plage a longtemps conservé un type<br />
d'habitat particulier "les quilles en l'air".<br />
Les embarcations traditionnelles, bateaux d'échouage<br />
du type "flobart" ou "harenguier" usagées<br />
<strong>et</strong> désarmées devenaient, jusqu'à la fin<br />
du XIX ème siècle, un habitat sommaire, assimilable<br />
à un campement. La coque du bateau,<br />
en chêne ou en orme, r<strong>et</strong>ournée, était posée<br />
sur un soubassement de moëllons liés à la<br />
terre glaise <strong>et</strong> goudronnés. La coque passée<br />
au goudron ou couverte d'une vieille toile à<br />
voiles clouée formait ainsi un abri rudimentaire<br />
pour les familles de pauvres pêcheurs.<br />
Un flobart coupé en deux pouvait servir de<br />
remise. Une coque posée "quille en bas",<br />
disposant d'un toit, pouvait servir de remise.<br />
Aujourd'hui, la version moderne de ces quilles<br />
en l'air équipe le camping d'Equihen-Plage.<br />
HABITAT BALNEAIRE<br />
LA BELLE EPOQUE<br />
DES VILLAS DE LA<br />
CÔTE D'OPALE<br />
L'implantation du chemin de fer vers<br />
1860-1870 incita une bourgeoisie<br />
locale, parisienne <strong>et</strong> britannique à<br />
investir dans la construction immobilière<br />
<strong>et</strong> la réalisation de véritables stations<br />
balnéaires à l'image du Touqu<strong>et</strong><br />
– Paris Plage. Au début du XXè siècle,<br />
John Whitley créa ainsi la station<br />
d'Hardelot-Plage.<br />
A Wimereux, on passa de 150 villas<br />
en 1892 à plus de 800 villas en 1914.<br />
Les digues-promena<strong>des</strong> s'ornèrent de<br />
villas. Le front de mer de Wimereux<br />
est aujourd'hui celui qui a gardé le<br />
plus bel ensemble balnéaire.<br />
Hautes <strong>et</strong> étroites, ces constructions<br />
allient une grande richesse d'inspiration<br />
à <strong>des</strong> matériaux variés, colombages<br />
copie de maisons norman<strong>des</strong>,<br />
bow-windows inspirés du style<br />
anglais, balcons ouvragés, rives de<br />
dentelles menuisées, s'associent pour<br />
former un ensemble pittoresque.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 57
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
58 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les forges<br />
Le siège d'exercice de l'activité du forgeronmaréchal-ferrant<br />
est lié à une habitation ou<br />
à une exploitation. C<strong>et</strong> artisan est utile à<br />
tous : ferrage du cheval <strong>et</strong> réparation <strong>des</strong><br />
outils, <strong>des</strong> chariots, fabrication de pièces<br />
de construction. Il peut cumuler toutes<br />
ces fonctions <strong>et</strong> élever quelques bêtes.<br />
Plus rarement, la famille tient aussi le café<br />
(Recques-sur-Hem, Campagne-les-<br />
Wardrecques, Ruminghem).<br />
Ces forges sont présentes dans l’ensemble<br />
du territoire tout en étant inégalement<br />
réparties : certaines communes peuvent<br />
disposer de plusieurs forges tandis que<br />
d’autres n’en possèdent pas ou plus.<br />
Facile d’accès, la forge trouve un<br />
emplacement préférentiel au cœur du<br />
bourg, proches <strong>des</strong> lieux de<br />
rassemblement du village, notamment le<br />
café. La forge est généralement placée<br />
dans le prolongement de l'habitation ou<br />
en r<strong>et</strong>our d'équerre, avec une façade<br />
principale toujours en front à rue.<br />
L'ORGANISATION EN PLAN<br />
L’atelier est une pièce plus ou moins grande ou,<br />
plus simplement, un abri sous un large débord<br />
de la toiture (auvent), adossé à une dépendance.<br />
LA CONSTRUCTION<br />
• murs<br />
L'atelier est souvent construit en «dur» (briques ou<br />
pierres) pour limiter les risques d'incendie. Il<br />
possède sa propre cheminée qui sert au tirage du<br />
feu entr<strong>et</strong>enu incessamment par un souffl<strong>et</strong>.<br />
• baies<br />
Habitué à forger <strong>et</strong> à assembler le fer, le<br />
forgeron-maréchal-ferrant peut lui-même<br />
intégrer dans la construction de son atelier les<br />
pièces métalliques qu'il fabrique. C'est ainsi que<br />
le seul motif <strong>des</strong> cadres en fer d'une baie ou le<br />
rail coulissant de la grande porte suffisent<br />
souvent à traduire l'expression d'un métier <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> progrès métallurgiques qui<br />
l'accompagnent. L'artisan dispose surtout de<br />
linteaux métalliques suffisants pour ouvrir de<br />
plus gran<strong>des</strong> baies <strong>et</strong> supporter le poids de la<br />
maçonnerie. Ces gran<strong>des</strong> baies perm<strong>et</strong>tent une<br />
large luminosité intérieure nécessaire au travail.<br />
Parfois, l’ouverture de l’atelier se limite à la<br />
seule grande porte toujours ouverte en<br />
journée, sur la rue. Plus couramment, il s'agit<br />
d'une large porte en bois, pleine à deux<br />
battants ou montée sur coulisse métallique<br />
avec plusieurs gran<strong>des</strong> fenêtres.<br />
• toiture, charpente <strong>et</strong> couverture<br />
La toiture est en simple bâtière (ou d’une seule<br />
pente pour un atelier sous auvent), couverte de<br />
pannes de pays.<br />
LES ELEMENTS D'ACCOMPAGNEMENT<br />
Le «travers» encore appelé «travail à ferrer» est<br />
un appareil fixe charpenté en bois, plus<br />
tardivement en fer, clans lequel le maréchal-<br />
ferrant immobilise la bête qu'il doit soigner. Le<br />
travail peut aussi être installé à l'intérieur ou<br />
sous le débord d'une toiture.<br />
Aujourd'hui<br />
Les activités complémentaires du forgeron<br />
<strong>et</strong> du maréchal-ferrant ont évolué<br />
distinctement à l'arrivée de la mécanisation<br />
du matériel agricole <strong>et</strong> de l'industrie<br />
automobile au début du XX ème siècle.<br />
Le forgeron devient mécanicien automobile,<br />
garagiste délivrant le carburant, ou<br />
encore ouvrier en intégrant une p<strong>et</strong>ite<br />
usine métallurgique.<br />
Tandis que le maréchal-ferrant devient<br />
itinérant <strong>et</strong> se déplace à la rencontre d’une<br />
clientèle, elle aussi, devenue plus rare. Pour<br />
les chevaux de selle, le travers n'est plus<br />
nécessaire <strong>et</strong> il travaille à froid. Pour les<br />
chevaux de trait, il transporte le matériel.<br />
La forge est donc maintenant un bâtiment<br />
déserté, souvent transformé en remise de<br />
matériel, voire abandonné. Dans le même<br />
temps, le traditionnel «travers à ferrer»,<br />
charpenté en bois, a pratiquement disparu.
Les moulins à vent DES PARTENAIRES<br />
Les ailes <strong>des</strong> moulins, toujours tournées<br />
face au vent, captent l'énergie éolienne<br />
<strong>et</strong> transm<strong>et</strong>tent un mouvement circulaire<br />
qui actionne par <strong>des</strong> engrenages de<br />
nouveaux mouvements mécaniques.<br />
LA LOCALISATION<br />
Les moulins à vent sont généralement<br />
positionnés sur les hauteurs <strong>des</strong> dernières<br />
crêtes de l'Artois, sur les limites du plateau<br />
artésien <strong>et</strong> de la plaine maritime <strong>et</strong> sur les<br />
hauteurs littorales. Les meilleurs témoins,<br />
parvenus jusqu’à notre époque sont toutefois<br />
concentrés dans la région audomaroise :<br />
Mentque-Nortbécourt, Nort-Leulinghem, Saint-<br />
Omer, Tournehem, Moringhem, Serques, Saint-<br />
Martin-au-Laert, Louches.<br />
LA SITUATION<br />
Le plus souvent, le moulin s’inscrit dans le<br />
voisinage d'un ensemble de bâtiments qui<br />
évoque une exploitation moyenne avec <strong>des</strong><br />
dépendances rarement soudées pour ne pas<br />
couper le vent. II occupe alors le bout de la<br />
parcelle, bien distinct du groupe bâti (un<br />
centaine de mètres). L'important est que le<br />
moulin se situe dans un espace dégagé sans<br />
ligne d’arbres. Le moulin à vent peut aussi être<br />
une construction isolée dans la campagne, à<br />
l'écart <strong>des</strong> villages pour mieux profiter <strong>des</strong><br />
vents. Cependant, il reste facilement accessible<br />
par les chemins. Enfin, certains moulins sont<br />
tout-à-fait isolés : c'est le cas de certains moulins<br />
à céréales <strong>et</strong> surtout <strong>des</strong> moulins<br />
d'assèchement <strong>des</strong> marais ou d'irrigation<br />
localisés dans les zones marécageuses qui ne<br />
nécessitent pas d’intervention humaine<br />
permanente pour veiller au mécanisme.<br />
LA TYPOLOGIE<br />
Selon que le moulin pivote tout ou partie pour<br />
se m<strong>et</strong>tre face au vent, deux typologies sont<br />
distinctes :<br />
- les moulins sur pivot (l'ensemble tourne sur un<br />
pivot central)<br />
- les moulins-tour (l'ensemble formé par la<br />
toiture <strong>et</strong> les ailes tourne sur le corps fixe de la<br />
tour au moyen d'un chemin de roulement).<br />
Si les moulins sur pivot sont invariablement<br />
charpentés, les moulins-tours, maçonnés,<br />
présentent une diversité de formes.<br />
Selon la forme maçonnée, le moulin-tour est dit<br />
cylindrique, tronconique ou octogonal.<br />
Selon la qualité de son soubassement, le<br />
moulin-tour peut encore être :<br />
- à galerie circulaire en bois<br />
- à galerie maçonnée<br />
- sur tertre.<br />
Moulin sur pivot Moulin Tour<br />
Mécanisme - Villeneuve d'Ascq Mécanisme - Offekerque<br />
POUR CONSEILLER<br />
ET AIDER<br />
À RESTAURER...<br />
De nombreux organismes peuvent<br />
intervenir dans l'élaboration d'un<br />
proj<strong>et</strong> de restauration public ou privé.<br />
Plusieurs d'entre eux sont <strong>des</strong><br />
partenaires réguliers du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong><br />
<strong>régional</strong>.<br />
L'association Maisons Paysannes de<br />
France, association nationale de<br />
connaissance, sauvegarde <strong>et</strong> mise en<br />
valeur du patrimoine bâti rural est<br />
reconnue d'utilité publique. Elle<br />
organise notamment <strong>des</strong> opérations<br />
de sensibilisation, d'informations, ou<br />
<strong>des</strong> journées de démonstration.<br />
L'association Campagnes Vivantes<br />
promeut l'agriculture raisonnée <strong>et</strong><br />
valorise le patrimoine <strong>et</strong> les paysages.<br />
Elle informe <strong>et</strong> conseille les<br />
agriculteurs <strong>et</strong> initie <strong>des</strong> programmes<br />
spécifiques de conseil ou d'aide.<br />
Le Conseil d'Architecture,<br />
d'Urbanisme <strong>et</strong> Environnement <strong>et</strong><br />
un organisme d'utilité publique,<br />
départemental, d'information, de<br />
conseil <strong>et</strong> de formation. Il n'intervient<br />
prioritairement auprès <strong>des</strong><br />
collectivités mais peut également<br />
conseiller <strong>des</strong> particuliers.<br />
suite page 61<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 59
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
60 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les moulins à vent (suite)<br />
1 : Pivot<br />
2 : Dé<br />
3 : Sole<br />
4 : Lien<br />
5 : Chaise<br />
6 : Tratte<br />
7 : Maître-sommier<br />
8 : Échelle<br />
9 : Grenier à farine<br />
10 : Grenier à meules<br />
11 : Queue ou guivre<br />
12 : Potence<br />
13 : Dame<br />
14 : Treuil<br />
15 : Arbre moteur<br />
16 : Tête d'essieu<br />
17 : Mortier<br />
18 : Coll<strong>et</strong><br />
19 : Joug<br />
20 : Grand Rou<strong>et</strong><br />
21 : P<strong>et</strong>it rou<strong>et</strong><br />
22 : Lanterne<br />
23 : Gros Fer<br />
24 : Monte-sacs<br />
25 : Archure<br />
26 : Trémie<br />
27 : Anche<br />
28 : Trempure<br />
29 : Palier du gros fer<br />
30 : Ailes<br />
31 : Arbre vertical<br />
32 : Meules<br />
33 : Régulateur à boules<br />
34 : Toiture pivotante<br />
LES MÉCANISMES<br />
Les quatre ailes (dites encore «volants»)<br />
reçoivent l'entoilure (lin huilé ou gros courtil). La<br />
voile est plus ou moins développée suivant la<br />
force du vent au moyen de cordages. Le plan<br />
<strong>des</strong> ailes est incliné par rapport au sol de 10 à<br />
15° pour optimiser la prise de vent.<br />
La queue ou «guivre» forme le dispositif qui sert<br />
à faire pivoter les «ailes» face au vent : une<br />
longue perche est fixée dans les «trattes» pour<br />
le moulin à pivot ou dans les combles pour le<br />
moulin-tour. A l'origine, le meunier vire le<br />
moulin en appuyant de tout son poids sur<br />
l'extrémité de la queue. Plus tardivement,<br />
l'emploi d'un cabestan, puis d'un treuil à<br />
engrenage fixés à la queue, lui facilite la tâche <strong>et</strong><br />
perm<strong>et</strong>tent surtout de faire pivoter rapidement<br />
le moulin en cas de tempête soudaine.<br />
Pour les moulins-tours, le chemin de roulement,<br />
au somm<strong>et</strong> de la maçonnerie, fait tourner<br />
l’ensemble de la toiture <strong>et</strong> <strong>des</strong> ailes. Il est très varié<br />
<strong>et</strong> se compose de roues (dont le nombre est<br />
également variable) en bois ou en fonte au XIX ème<br />
siècle, glissant dans un rail circulaire en bois, fer<br />
ou fonte. Certaines enrayures, à patins ou à gal<strong>et</strong>s<br />
en bois, glissent dans une cannelure façonnée à<br />
même la maçonnerie coiffant la tour.<br />
Le rou<strong>et</strong> sur l'arbre-moteur actionné par les<br />
«ailes» transm<strong>et</strong> le mouvement à la meule par<br />
l'intermédiaire de la «lanterne».<br />
LA CONSTRUCTION<br />
Le parc concentre sur son territoire <strong>des</strong> moulins<br />
à vent à tour maçonnée. Le moulin à tour se<br />
répand principalement au XVII ème <strong>et</strong> surtout au<br />
XIX ème siècle. Sa forme cylindrique à l'origine,<br />
évolue jusqu'à la forme tronconique dès la fin<br />
du XVII ème siècle. Il résulte déjà d'une évolution<br />
technique en remplaçant certains moulins à<br />
pivot(4). Il faut r<strong>et</strong>enir les typologies suivantes :<br />
- (moulin-tour) cylindrique en maçonnerie de<br />
briques ou de pierre. Sa construction peut<br />
remonter au XVII ème siècle (Mentque-<br />
Nortbécourt avec deux exemples, Saint-Omer,<br />
Tournehem, Moringhem, Serques, ruines à<br />
Guînes, à Beuvrequen, à Zouafques, à Escalles,<br />
à Marquise, à Bouquehault…).<br />
- (moulin-tour) octogonal en maçonneries<br />
- (moulin-tour) à galerie circulaire en bois. Il date<br />
du XIX ème siècle, construit pour dominer son<br />
environnement (végétation <strong>et</strong> bâtiments). La<br />
galerie perm<strong>et</strong> d'entoiler les ailes. Un seul<br />
exemple compl<strong>et</strong> est encore visible en France à<br />
Saint-Martin-au-Laert.<br />
- (moulin-tour) à galerie maçonnée. Sur le<br />
même principe que précédemment, la galerie<br />
est utilisée comme remise (ruines à Marquise).
Quelques moulins à tour octogonale en bois,<br />
entièrement charpenté ont été construits du<br />
XIX ème siècle. Un exemplaire en ruine est<br />
recensé dans le marais de Saint-Omer sur les<br />
deux seuls qui existent encore dans le Pas-de-<br />
Calais.<br />
• les murs<br />
Le plus souvent, les moulins-tours utilisent la<br />
pierre à bâtir, craie ou grès dans les lieux<br />
proches <strong>des</strong> points d'extraction ou, à défaut, la<br />
brique cuite sur place. La base de la muraille<br />
peut atteindre une épaisseur comprise entre<br />
1m <strong>et</strong> 2m10. L'appareillage est plus ou moins<br />
varié :<br />
- en appareil de pierres ou de briques sur<br />
soubassement grès<br />
- en appareil lardé alternant pierre <strong>et</strong> brique<br />
(pierres disposées en soubassement, au niveau<br />
de chaque plancher, <strong>et</strong> aux embrasures de<br />
fenêtres associées à la brique)<br />
- en appareil de briques rouges <strong>et</strong> briques<br />
jaunes.<br />
Pour les formes tronconiques, chaque étage est<br />
établi légèrement en r<strong>et</strong>rait sur le précédent,<br />
chaque ressaut servant de support au plancher.<br />
L'importance de la construction se traduit sur le<br />
nombre de meules pouvant être actionnées : 2<br />
ou 3 étages peuvent supporter jusqu'à 3 paires<br />
de meules.<br />
• les baies<br />
Une porte en bois plein à 2 vantaux en rez-dechaussée,<br />
une porte au second niveau, <strong>des</strong><br />
baies de forme carrée, fermées par <strong>des</strong><br />
menuiseries en bois à 4 carreaux parfois à<br />
linteau légèrement cintré, ou <strong>des</strong> baies en<br />
forme d'oculus. Les encadrements sont rares,<br />
simplement soulignés en pierre ou par <strong>des</strong><br />
briques posées à chant.<br />
• la toiture<br />
La toiture <strong>des</strong> moulins est appelée «calotte». Les<br />
moulins sur pivot sont d'ordinaire couvert en<br />
bâtière. Les moulins-tours disposent systématiquement<br />
d'un toit mobile de forme en pavillon<br />
ou conique prolongée à l'avant <strong>et</strong> à l'arrière par<br />
deux gran<strong>des</strong> bâtières égales couvrant l'arbre<br />
moteur d'un côté <strong>et</strong> la queue de l'autre. La couverture<br />
est réalisée en tuiles plates, en bardeaux<br />
ou en ardoises.<br />
• les éléments de décor<br />
La décoration reste limitée à la présence d'une<br />
clef d'encadrement de fenêtre saillante ou<br />
sculptée, de bandeau(x) mouluré(s) en pierre,<br />
d'écusson portant une date de construction ou<br />
<strong>des</strong> motifs sculptés qui peuvent aussi bien être<br />
à l'intérieur…<br />
PARTICULARITÉS<br />
Un seul moulin à vent pour scier la pierre a<br />
existé sur la commune de Ferques. Construit<br />
par Frédéric Sauvage vers 1822, à proximité<br />
même <strong>des</strong> lieux d'extraction de la pierre de<br />
Marquise, c'était un moulin-tour en pierre qui<br />
comportait deux châssis de 15 lames au<br />
premier niveau <strong>et</strong> deux polissoirs situés au<br />
second niveau. Malheureusement, sa<br />
puissance ne perm<strong>et</strong>tait pas d'actionner à la fois<br />
les châssis <strong>et</strong> les polissoirs. La restauration du<br />
moulin «de l'Aile», à Saint-Omer est en cours<br />
d'étude ; Il est le seul témoin d'un effectif plus<br />
vaste, exploité pour l'assèchement <strong>et</strong> le<br />
drainage <strong>des</strong> terres du marais audomarois,<br />
construits sur une forme tronconique ou<br />
circulaire, en brique ou en bois. La roue<br />
actionnait l'engrenage intérieur qui entraînait<br />
une roue à pal<strong>et</strong>tes ou une vis d'Archimède.<br />
C<strong>et</strong>te dernière pouvait remonter l'eau à 3m de<br />
hauteur.<br />
L'ÉVOLUTION ACTUELLE<br />
Le moulin à vent est une construction fragile.<br />
Au risque d'effondrement sous l'eff<strong>et</strong> de vents<br />
trop violents (pour les moulins sur pivot)<br />
s'ajoutent les risques d'incendie provoqué par<br />
un échauffement excessif <strong>des</strong> meules… Au<br />
début du XX ème siècle, les moulins à vent à<br />
moudre les céréales sont vite supplantés par les<br />
moulins industriels. Certains moulins<br />
d'irrigation résistent un temps avec <strong>des</strong> ailes<br />
remplacées par une roue éolienne, avant d'être<br />
abandonnés pour laisser place aux stations de<br />
pompage…<br />
Certains, trop rares, sont restaurés par leurs<br />
propriétaires ou avec une ré-affectation<br />
domestique. Il reste certains lieux-dits qui<br />
rappellent leur existence, soit en évoquant le<br />
nom ou la qualité du meunier-propriétaire<br />
(«moulin Lartizeux» <strong>et</strong> «moulin Lartisier» à<br />
Lacres...), soit en mentionnant la présence du<br />
moulin («moulin du p<strong>et</strong>it hasard» à<br />
Ledinghem…), soit en qualifiant un site venteux<br />
(«Plaine <strong>des</strong> 4 vents» à Guînes…). Cependant,<br />
les moulins qui subsistent, peuvent encore<br />
susciter l'intérêt de la collectivité par leur qualité<br />
architecturale : silhou<strong>et</strong>te spectaculaire,<br />
repérable de loin.<br />
DES PARTENAIRES<br />
POUR CONSEILLER<br />
ET AIDER<br />
À RESTAURER...<br />
La Chambre de Métiers <strong>et</strong> la<br />
Confédération <strong>des</strong> Artisans <strong>et</strong><br />
P<strong>et</strong>ites Entreprises du Bâtiment,<br />
mandataires <strong>des</strong> artisans,<br />
interviennent dans leur formation, <strong>et</strong><br />
la prise en compte du bâti<br />
traditionnel. La CAPEB assure<br />
notamment la gestion du Certificat<br />
d'Identité Professionnelle "Patrimoine"<br />
qui qualifie <strong>des</strong> artisans reconnus<br />
dans ce domaine.<br />
Enfin, les services de l'Etat (Direction<br />
Régionale <strong>des</strong> Affaires Culturelles –<br />
Direction Départementale de<br />
l'Equipement – Service<br />
Départemental de l'Architecture <strong>et</strong><br />
du Patrimoine) concourent à<br />
l'encadrement <strong>et</strong> au contrôle <strong>des</strong><br />
réglementations mais apportent aussi<br />
leurs conseils.<br />
Le guide d'orientation pour la<br />
restauration du patrimoine bâti dans<br />
le Nord - Pas de Calais fournit les<br />
coordonnées de tous ces organismes<br />
<strong>et</strong> de bien d'autres.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 61
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
62 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les moulins à eau<br />
Le moulin à eau est un lieu de production qui<br />
utilise un dispositif de meules, actionnées par<br />
une ou <strong>des</strong> roues qui transforment l'énergie<br />
cinétique de l'eau en mouvement<br />
mécanique.<br />
LA LOCALISATION DANS LE PARC<br />
Le territoire accidenté, boisé <strong>et</strong> sillonné de nombreux<br />
cours d'eau du <strong>Parc</strong> Naturel Régional <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong><br />
<strong>Marais</strong> d’Opale a favorisé très tôt l'installation de<br />
moulins hydrauliques qui disposent, ici <strong>et</strong> facilement,<br />
d'une source d'énergie permanente. Les cours <strong>des</strong><br />
rivières la Liane, l’Aa, le Bléquin, le Wimereux, la<br />
Slack, le Crembreux, la Hem <strong>et</strong> leurs affluents<br />
respectifs concentrent leur effectif.<br />
LA SITUATION<br />
Les moulins à eau se situent sur ou au bord d'un<br />
cours d'eau présentant un débit suffisant. Il sont<br />
donc nichés au creux <strong>des</strong> vallées, dans le cadre<br />
verdoyant <strong>des</strong> berges. Le plus souvent, ils font<br />
partie intégrante d'une exploitation agricole<br />
comprenant une habitation. Ils peuvent parfois<br />
s’assembler en groupe :<br />
- disposés par deux, occupants chacun une rive<br />
(moulins de Confesse à Esquer<strong>des</strong>)<br />
- occupant l'un une rive <strong>et</strong> l'autre une dérivation<br />
(moulins Pidoux à Hallines)<br />
- égrenés en chapel<strong>et</strong> sur un même cours d'eau en<br />
exploitant la dénivellation <strong>naturel</strong>le <strong>et</strong> notamment<br />
les chutes d'eau<br />
- assemblés sur la dérivation d'un cours d'eau (poudrerie<br />
Royale d’Esquer<strong>des</strong>).<br />
LA TYPOLOGIE<br />
Les multiples transformations, adaptations technologiques<br />
rendent difficilement évidente, l'émergence<br />
d'une réelle typologie. Néanmoins, la <strong>des</strong>cription<br />
de quelques éléments équipant le moulin<br />
(localisation <strong>et</strong> positionnement sur le cours d'eau,<br />
affectation <strong>et</strong> production, nombre <strong>et</strong> qualité de ou<br />
<strong>des</strong> roues, nombre de meules actionnées…) amorcent<br />
l'idée d'une typologie liée au dispositif hydraulique<br />
extérieur <strong>et</strong> intérieur.<br />
LES MÉCANISMES<br />
T'rois types de roues sont identifiés sur le territoire<br />
du <strong>Parc</strong>. Leur dimension <strong>et</strong> leur forme sont déterminées<br />
par le débit du cours d'eau, l'exploitation<br />
de l'arrivée d'eau, le relief <strong>naturel</strong> du terrain <strong>et</strong> du<br />
cours d'eau, la nature de la production <strong>des</strong> installations<br />
<strong>et</strong> la puissance requise pour c<strong>et</strong>te production.<br />
La roue en <strong>des</strong>sous,<br />
dite aussi «roue à<br />
pal<strong>et</strong>tes» ou «roue à<br />
aubes», tourne par la<br />
seule poussée du<br />
courant.<br />
Roue en <strong>des</strong>sous<br />
La roue de côté,<br />
dite aussi «roue de<br />
poitrine», est équipée<br />
soit d’aubes planes,<br />
soit d'aug<strong>et</strong>s.<br />
Elle est alimentée<br />
Roue de côté<br />
sur le côté. Le remplissage<br />
se fait un peu au-<strong>des</strong>sus de la hauteur<br />
d'axe. L'eau agit à la fois par choc <strong>et</strong> par son poids.<br />
Ce dispositif nécessite un grand débit mais peut être<br />
implanté sur une rivière sans grande dénivellation.<br />
Roue en <strong>des</strong>sus<br />
La roue en <strong>des</strong>sus,<br />
dite aussi «roue à<br />
aug<strong>et</strong>s» ou «à pots»,<br />
tourne par la chute<br />
<strong>et</strong> le poids de l’eau.
A partir du XIXème siècle, avec l'évolution<br />
<strong>des</strong> performances<br />
<strong>des</strong><br />
engrenages, une<br />
même roue peut<br />
actionner plusieurs<br />
meules. Les<br />
installations du<br />
moulin peuvent<br />
alors être affectées<br />
à un double<br />
Moulin de Wins à Blendecques<br />
usage (moulin à<br />
farine <strong>et</strong> filature à S<strong>et</strong>ques). Les turbines inventées<br />
par Fourneyron en 1827 supplanteront progressivement<br />
le principe de la roue. Elles perm<strong>et</strong>tent d'exploiter<br />
les chutes les plus élevées <strong>et</strong> de produire,<br />
grâce à <strong>des</strong> centrales hydrauliques, de l'électricité.<br />
LA CONSTRUCTION<br />
Le moulin est composé d'un dispositif extérieur<br />
hydraulique très compl<strong>et</strong> <strong>et</strong> d'installations<br />
intérieures associant à la roue, un lieu de<br />
production, plus ou moins important. Cependant,<br />
le moulin à eau peut aussi être attaché à une forme<br />
d'exploitation agricole comprenant une habitation<br />
distincte avec ses dépendances domestiques<br />
(moulin à Wismes). Dans les deux cas, le moulin<br />
s'établit donc le long d'un cours d'eau, en même<br />
temps qu'il s'organise de l'autre côté, autour d'une<br />
cour, cernée de dépendances.<br />
Le moulin peut désigner le rang de fortune de son<br />
propriétaire en employant certains matériaux de<br />
construction. Ainsi un moulin appartenant à une<br />
noblesse locale aisée ou à une abbaye peut se<br />
distinguer par l'emploi de pierre à bâtir (moulin<br />
d'Affringues).<br />
D'autres s'apparentent, par la simplicité de leur<br />
organisation <strong>et</strong> de leur construction, à l'exploitation<br />
agricole traditionnelle (moulin de Bléquin, en<br />
torchis, brique <strong>et</strong> bois). Enfin, les moulins<br />
«d'époque moderne» sont <strong>des</strong> constructions de<br />
taille imposante qui utilisent préférentiellement la<br />
brique.<br />
Quelques grands éléments peuvent encore<br />
qualifier c<strong>et</strong>te construction :<br />
- un soubassement important, en matériaux durs,<br />
moellons de grès ou briques, en réponse au besoin<br />
de fixer <strong>et</strong> porter la roue, à l'assise en milieu<br />
humide en bordure de berge, à l'importance du<br />
poids intérieur à supporter (machinerie, meules…)<br />
- la présence répandue d'un étage (ou plusieurs),<br />
utile à la production, ou à l'entreposage tandis que<br />
les meules sont disposées au rez-de-chaussée.<br />
Il est possible d'établir deux classifications :<br />
- <strong>des</strong> moulins à eau proches dans leur<br />
configuration de l'exploitation agricole à<br />
production artisanale (moudre le blé/à céréales…)<br />
- <strong>des</strong> moulins à eau pré-industriels. Ceux-ci ont subi<br />
<strong>des</strong> transformations architecturales pour s'adapter<br />
aux progrès de la technologie.<br />
LES ÉLÉMENTS D'ACCOMPAGNEMENT<br />
EXTÉRIEURS<br />
La ventellerie ou «vannage» est un ensemble<br />
composé d'une vanne motrice, dite «vanne<br />
molleresse» qui donne sur la roue <strong>et</strong> de une ou<br />
plusieurs autres vannes de décharges qui barrent le<br />
cours d'eau. Pour bénéficier d'un maximum de<br />
force motrice, l'exploitant fait monter l’eau le plus<br />
haut possible, en amont.<br />
Le déversoir <strong>et</strong> le canal de décharge sont utiles<br />
pour corriger l'inconvénient provoqué par une<br />
ventellerie mal maîtrisée (risque de crue). Au XIX ème<br />
siècle, l'Etat obligea la construction de déversoir en<br />
maçonnerie : un seuil maçonné jusqu'à une<br />
certaine hauteur perm<strong>et</strong> au trop plein d'eau de<br />
s’échapper dans un canal de décharge qui évite la<br />
ventellerie pour rejoindre le cours d'eau en aval,<br />
dès que le niveau de celui-ci dépasse la limite<br />
réglementaire.<br />
Situé en amont du moulin, le bief forme une r<strong>et</strong>enue<br />
d'eau qui constitue la réserve d'énergie du moulin<br />
par la ferm<strong>et</strong>ure <strong>des</strong> vannes. Son étendue est<br />
variable. Il est aménagé en élargissant une berge, un<br />
méandre ou en réhaussant le lit de la rivière.<br />
L'ÉVOLUTION<br />
Les moulins à eau, dont la structure intérieure<br />
est facilement adaptable, ont souvent été<br />
réhaussés, agrandis, modifiés pour suivre les<br />
progrès techniques. Au XIX ème siècle, quelques<br />
uns constituent déjà <strong>des</strong> entreprises importantes<br />
pour la région. A l'aube du XX ème siècle, certains<br />
moulins s'orientent progressivement vers une<br />
production industrielle <strong>et</strong> désertent leur site<br />
originel. L'activité <strong>des</strong> autres moulins a<br />
néanmoins pu persister en employant <strong>des</strong><br />
énergies alternatives : vapeur, électricité, ajout<br />
d'un moteur à gaz puis diesel… pour compenser<br />
un faible débit <strong>des</strong> eaux ou améliorer le<br />
rendement du mécanisme mais elle décline<br />
inexorablement . Dans la vallée de l'Aa, les<br />
moulins à eau sont à l'origine de l'industrie<br />
pap<strong>et</strong>ière dans le Nord de la France.<br />
Aujourd'hui<br />
Les moulins à eau du <strong>Parc</strong> Naturel Régional<br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale ont tous été<br />
réaffectés ou abandonnés. Au meilleur <strong>des</strong><br />
cas, l'ensemble <strong>des</strong> bâtiments a pu être<br />
conservé pour être reconverti a usage<br />
d'habitation, d'exploitation agricole ou<br />
d'hôtellerie, mais les roues <strong>et</strong> les meules sont<br />
déposées ou disparues. De très rares roues<br />
sont encore en action (maison du papier à<br />
Esquer<strong>des</strong>).<br />
LA MAISON<br />
DU PAPIER<br />
La Maison du Papier a été édifiée par<br />
le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> sur le site du<br />
Moulin de Confosse en 1994. C<strong>et</strong><br />
équipement touristique <strong>et</strong> pédagogique<br />
fait ainsi suite à un moulin à<br />
huile, <strong>des</strong> moulins à farine, un moulin<br />
à papier qui se sont succédés sur le<br />
site depuis 1793.<br />
Sa grande roue à aubes de 7 mètres<br />
de diamètre entraîne une pile à<br />
maill<strong>et</strong> qui broie les vieux chiffons <strong>et</strong><br />
est le cœur d'un véritable atelier artisanal<br />
qui se visite.<br />
A la Maison du Papier, le visiteur<br />
jeune ou vieux peut s'improviser<br />
pap<strong>et</strong>ier, réaliser sa feuille de papier,<br />
découvrir l'histoire millénaire de ce<br />
support d'écriture mais aussi comprendre<br />
l'activité industrielle pap<strong>et</strong>ière<br />
actuelle fort présente dans la vallée<br />
de l'Aa, poursuivant ainsi une longue<br />
tradition.<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 63
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
64 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
Siège d'exercice de l'activité <strong>des</strong> caf<strong>et</strong>iers,<br />
c'est aussi son habitation. Il peut conjuguer<br />
d'autres activités :<br />
• exploitant agricole (Clerques) : le caf<strong>et</strong>ier<br />
peut m<strong>et</strong>tre à disposition son écurie.<br />
• aubergiste (Marquise) : le caf<strong>et</strong>ier offre le<br />
couvert <strong>et</strong> le lit pour la nuit.<br />
• forgeron (Campagne-les-Wardrecques,<br />
Recques-sur-Hem)<br />
• épicier (Mentque-Nortbécourt)<br />
• ou artisan (Sanghen).<br />
Le café occupe souvent une position stratégique à la<br />
croisée <strong>des</strong> chemins ou au centre, près de l'église ou<br />
de la mairie. La façade principale est tournée vers la<br />
rue ou la place, positionnée à l'alignement ; les<br />
annexes (atelier, épicerie) se placent souvent en<br />
r<strong>et</strong>our d'équerre). Quand le café occupe un angle de<br />
rue, il adopte un pan coupé (Selles) qui compose<br />
une troisième façade, avec l'entrée.<br />
L'ensemble, aux volumes spacieux s'organise autour<br />
d'une cour, parfois <strong>des</strong>servie par une large porte<br />
cochère.<br />
La construction est souvent cossue avec <strong>des</strong> ouvertures<br />
plus nombreuses que sur la façade d'une habitation-exploitation<br />
classique.<br />
Une enseigne est apposée en bandeau en partie<br />
haute de la façade principale <strong>et</strong> affiche le nom du<br />
propriétaire, un sobriqu<strong>et</strong>, la qualité de la clientèle, le<br />
nom du lieu…<br />
Des anneaux ou une barre d'accroche pour les chevaux<br />
sont souvent disponibles en façade.<br />
Selles<br />
Ecault<br />
Questrecques<br />
LES ESTAMINETS<br />
DE RANDONNÉE<br />
Pour contribuer à la revitalisation <strong>des</strong><br />
pays ruraux <strong>et</strong> au développement<br />
d'une offre de services touristiques<br />
sur son territoire, le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong><br />
<strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
a créé le label "estamin<strong>et</strong>s de<br />
randonnée". Cafés ou auberges de<br />
village, les estamin<strong>et</strong>s de randonnée<br />
sont situés à proximité <strong>des</strong> itinéraires<br />
balisés de randonnée équestre,<br />
pé<strong>des</strong>tre ou VTT. Ils offrent une halte<br />
conviviale aux randonneurs, avec une<br />
restauration simple <strong>et</strong> la possibilité de<br />
se détendre en jouant avec <strong>des</strong> jeux<br />
anciens traditionnels. Les cavaliers,<br />
cyclistes <strong>et</strong> marcheurs y trouveront<br />
également un point d'information<br />
avec documents, une trousse de<br />
premier secours <strong>et</strong> du p<strong>et</strong>it matériel<br />
de réparation pour cycle.<br />
Chaque année, en novembre, ces<br />
établissements sont animés par les<br />
Patoisa<strong>des</strong>, festival culino-musical où<br />
le patois local est roi !
Les sécheries de chicorée<br />
La première usine de chicorée a été<br />
créée à Onnaing (Nord) en 1779. La<br />
consommation s’est beaucoup accrue<br />
au début du 19è siècle du fait du blocus<br />
continental décidé en 1806<br />
Là, les racines sont n<strong>et</strong>toyées, coupées en tranches<br />
ou « coss<strong>et</strong>tes », déshydratées puis refroidies.<br />
Ces « coss<strong>et</strong>tes vertes » sont stockées une<br />
année puis acheminées vers une raffinerie, torréfiées<br />
pour transformer leur sucre en caramel<br />
<strong>et</strong> concassées.<br />
La sécherie est donc composée le plus souvent<br />
de deux à trois bâtiments : un atelier de travail,<br />
une dépendance agricole, parfois avec le logement<br />
<strong>des</strong> ouvriers <strong>et</strong> un hangar de stockage.<br />
Le tout est situé au milieu <strong>des</strong> terres agricoles,<br />
en bordure de route ou face à une voie d’eau<br />
navigable.<br />
Sur le territoire du <strong>Parc</strong>, les rares sécheries<br />
encore bien existantes sont localisées à Guînes,<br />
Balinghen, Polincôve, Recques-sur-Hem,<br />
Ruminghem…<br />
L’atelier de production est massif pour composer<br />
une masse thermique inerte conservant<br />
longtemps la chaleur. Il est ouvert par une série<br />
de baies régulières, de p<strong>et</strong>it format, percées<br />
pour optimiser la ventilation, <strong>et</strong> obturées par<br />
<strong>des</strong> vol<strong>et</strong>s de tôles mobiles. Les murs sont en<br />
maçonnerie de briques jaunes. Les systèmes<br />
d’extraction d’air sont très repérables de loin.<br />
On remarque quatre systèmes :<br />
- une série de cheminées en briques ou<br />
enduites, qui chapeaute les maçonneries,<br />
- une seule cheminée établie sur la longueur<br />
du faîtage de la toiture à fort versant. C<strong>et</strong>te<br />
cheminée est coiffée d’une p<strong>et</strong>ite toiture en<br />
bâtière inclinée à 40° avec <strong>des</strong> vol<strong>et</strong>s à lames<br />
sur les côtés.<br />
- une toiture en bâtière inclinée à 40° avec un<br />
ventilateur-turbine en pignon,<br />
- Une combinaison de cheminée <strong>et</strong> ventilateur.<br />
Les dépendances agricoles<br />
Ces bâtiments bas abritaient souvent les logis<br />
<strong>des</strong> saisonniers agricoles, souvent d’origine<br />
belge (c’est pourquoi on les appellent « chambres<br />
<strong>des</strong> belges).<br />
Ils servaient aussi à stocker au grenier les<br />
coss<strong>et</strong>tes traitées.<br />
<br />
<br />
<br />
A B C<br />
<br />
COUPE LONGITUDINALE<br />
SUR UNE SÉCHERIE DE CHICORÉE<br />
A Atelier de production/séchoir<br />
B Dépendance agricole, stockage <strong>des</strong><br />
coss<strong>et</strong>tes <strong>et</strong> logement <strong>des</strong> ouvriers<br />
saisonniers<br />
C Hangar de stockage <strong>des</strong> coss<strong>et</strong>tes<br />
Fours à coke<br />
Plateaux de séchage, grille métalliques<br />
trouées montées sur fer I<br />
Vol<strong>et</strong> intérieur d'aération - tôle d'acier<br />
Système principal d'extraction de l'air /<br />
cheminée<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
COUPE TRANSVERSALE SUR<br />
L'ATELIER DE PRODUCTION/Séchoir<br />
FAIRE CONNAÎTRE<br />
L'HISTOIRE ET LE<br />
<strong>PATRIM</strong>OINE<br />
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> s'est attaché<br />
à faire découvrir le patrimoine<br />
culturel <strong>et</strong> l'histoire de ses terroirs,<br />
villes <strong>et</strong> villages. Il aide ainsi <strong>des</strong><br />
collectivités communales ou<br />
intercommunales à m<strong>et</strong>tre en œuvre<br />
<strong>des</strong> sites ou sentier d'interprétation :<br />
- sentier de la pierre à Baincthun,<br />
- panneau d'information<br />
patrimoniale de Bayenghem-les-<br />
Seninghem,<br />
- site d'interprétation du puits de<br />
Quercamps,<br />
- Croix Pélerine à Saint-Martin-au-<br />
Laërt,<br />
- Motte castrale de Nesles.<br />
Il assure également <strong>des</strong> animations<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> expositions temporaires, par<br />
exemple avec le cabin<strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
curiosités historiques <strong>et</strong> légendaires,<br />
meuble<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 65
• Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong><br />
• L'organisation <strong>des</strong> villages<br />
• Les caractères de l'habitation<br />
• L'histoire <strong>et</strong> la géographie<br />
<strong>des</strong> matériaux<br />
LES TYPES DE CONSTRUCTION<br />
• Les constructions à pan de bois <strong>et</strong> terre<br />
• Les constructions en maçonnerie de grès<br />
<strong>et</strong> calcaires durs du Boulonnais<br />
• Les constructions en maçonnerie de craie<br />
• Les constructions en maçonnerie<br />
de briques de type flamand<br />
LES ABORDS, DEPENDANCES<br />
ET LE PETIT <strong>PATRIM</strong>OINE BÂTI<br />
• Les dépendances<br />
• Les pigeonniers<br />
• Les puits <strong>et</strong> flots<br />
• Les clôtures<br />
• La faune <strong>et</strong> la flore<br />
LES BÂTIMENTS AUX FONCTIONS<br />
SPÉCIFIQUES<br />
• Les manoirs<br />
• L'habitat <strong>des</strong> marais<br />
• Les maisons <strong>des</strong> pêcheurs<br />
• Les forges<br />
• Les moulins à vent <strong>et</strong> à eau<br />
• Les cafés, cabar<strong>et</strong>s, auberges<br />
• Les sécheries de chicorée<br />
GLOSSAIRE<br />
66 I Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
GLOSSAIRE<br />
APPAREIL - APPAREILLAGE<br />
manière de disposer les pierres <strong>et</strong> les briques<br />
qui composent une maçonnerie<br />
APPUI<br />
partie inférieure d'une baie<br />
ARBALÉTRIER<br />
pièce de bois de charpente oblique assurant<br />
la triangulation d'une ferme<br />
ARÊTIER<br />
arête de l'angle saillant formé par la rencontre<br />
de 2 versants de toiture<br />
BÂTIÈRE<br />
couverture à 2 pans<br />
BOULIN<br />
trou laissé dans un mur pour un support<br />
d'échafaudage ou trous ou cases de bois ou<br />
terre où nichent les pigeons<br />
BEURRÉ<br />
se dit d'un joint plein recouvrant largement les<br />
espaces entre les moellons<br />
BARDAGE<br />
revêtement extérieur d'un mur, réalisé avec<br />
<strong>des</strong> planches de bois<br />
BADIGEON<br />
peinture de finition extérieure constituée<br />
d'eau, chaux éteinte <strong>et</strong> parfois un colorant<br />
BOUTISSE<br />
pierre ou brique placée en bout, donc<br />
présentant sa plus p<strong>et</strong>ite face en parement<br />
BANDEAU<br />
bande moulurée, saillante en façade qui<br />
protége le mur du ruissellement <strong>des</strong> eaux<br />
CHAÎNAGE D'ANGLE<br />
rencontre de deux murs – chaîne de pierres<br />
ou brique qui structure <strong>et</strong> consolide la<br />
maçonnerie horizontalement <strong>et</strong> verticalement<br />
CONTREVENT<br />
généralement appelé "vol<strong>et</strong>"<br />
CHEVRON<br />
pièce de bois de la longueur du rampant<br />
reposant sur <strong>des</strong> pannes pour recevoir la<br />
couverture<br />
CORNICHE<br />
moulure en surplomb qui protège la façade<br />
COYAU<br />
pièce de bois en siffl<strong>et</strong>, rapportée sur le<br />
chevron pour casser la pente de toiture.<br />
Incurvation concave de la toiture avant l'égout<br />
de toiture<br />
CALCIN<br />
croûte dure qui se forme à la surface du<br />
calcaire après extraction<br />
CHAPERON<br />
ou couronnement. Faîte d'un ouvrage,<br />
notamment d'un mur, souvent réalisé en forte<br />
de p<strong>et</strong>it toit<br />
CHANLATTE<br />
latte de section trapézoïdale posée au bas <strong>des</strong><br />
chevrons pour recevoir le premier rang de<br />
tuiles<br />
CORDON<br />
bande moulurée étroite <strong>et</strong> peu saillante, en<br />
façade<br />
DOSSE<br />
planch<strong>et</strong>te de bois utilisée en bardage<br />
DOUCINE<br />
se dit d’un profil de moulure en S<br />
ENCADREMENT<br />
bordure saillante autour d'une baie<br />
ÉGOUT<br />
bas du toit<br />
ENTRAIT<br />
pièce de bois horizontale liant deux<br />
arbalétriers<br />
ÉCHARPE<br />
pièce de bois oblique dans un pan de bois, ou<br />
pièce de bois oblique composant le bâti d'une<br />
porte ou d'un contrevent<br />
FRONTON<br />
couronnement triangulaire ou arc de cercle<br />
d'un avant-corps de bâtiment, d'une lucarne,<br />
d'une porte, d'une fenêtre<br />
FAÎTAGE<br />
partie la plus élevée d'un toit<br />
FAÎTIÈRE<br />
se dit d'une tuile creuse (triangulaire ou<br />
arrondie) qui recouvre le faîtage<br />
FRUIT<br />
un mur a du "fruit" lorsqu'il est plus épais à la<br />
base qu'au somm<strong>et</strong><br />
FERME<br />
ouvrage de charpente triangulé disposé à<br />
intervalles réguliers pour soutenir les pannes<br />
FEUILLURE<br />
encoche qui accueille un battant de fenêtre,<br />
de porte ou de contrevent<br />
GOUTTEREAU<br />
se dit d'un mur qui reçoit l'égout du toit<br />
GRADINÉE<br />
se dit d'une pierre dont la surface est taillée de<br />
stries parallèles au fond en forme de U<br />
HUISSERIE<br />
dormant de porte
IMPOSTE<br />
partie de porte ou de fenêtre située au-<strong>des</strong>sus<br />
de la partie ouvrante principale<br />
JOUÉE<br />
côté d'une lucarne<br />
LATTIS<br />
lattes clouées sur les chevrons pour perm<strong>et</strong>tre<br />
l'accroche <strong>des</strong> tuiles<br />
LINTEAU<br />
traverses formant la partie supérieure d'une<br />
baie<br />
LUCARNE<br />
ouvrage construit sur un toit perm<strong>et</strong>tant<br />
d'éclairer le comble par une fenêtre verticale<br />
MODÉNATURE<br />
ensemble <strong>des</strong> profils <strong>et</strong> <strong>des</strong> moulures d'une<br />
façade<br />
MOELLON<br />
p<strong>et</strong>it bloc en pierre peu équarri<br />
MORTIER<br />
mélange de liant, de sable <strong>et</strong> d'eau qui sert à<br />
maçonner<br />
NOUE<br />
angle rentrant fermé par la rencontre de deux<br />
versants de toiture<br />
NU<br />
se dit de la surface d'un mur prise comme<br />
base par rapport à <strong>des</strong> éléments saillants<br />
NOQUET<br />
p<strong>et</strong>ite noue ou éléments de zinc servant de<br />
raccord<br />
PANNE<br />
se dit de tuiles non mécaniques utilisées en<br />
couverture<br />
PANNE<br />
pièce de bois horizontale reposant sur les<br />
fermes ou sur les murs pignons <strong>et</strong> support les<br />
chevrons. On parle d'e panne sablière pour la<br />
pièce reposant sur le somm<strong>et</strong> d'un mur<br />
gouttereau<br />
PANNERESSE<br />
pierre ou brique présentant en parement sa<br />
plus longue face<br />
PAREMENT<br />
face extérieure d'un mur<br />
PARPAING<br />
pierre occupant toute l'épaisseur d'un mur<br />
PERSIENNE<br />
contrevent comportant <strong>des</strong> lames obliques<br />
pour laisser passer l'air<br />
PIGNON<br />
couronnement triangulaire d'un mur<br />
POINÇON<br />
pièce de bois verticale où s'assemblent les<br />
arbalétriers<br />
PUREAU<br />
partie visible d'une tuile ou d'une ardoise<br />
RAMPANT<br />
pan de toiture, versant<br />
REDENT<br />
découpure en forme de dent dont la<br />
répétition constitue un ornement<br />
REFEND<br />
mur porteur formant séparation dans un<br />
bâtiment<br />
RIVE<br />
bord latéral d'un versant de toiture<br />
SABLIÈRE<br />
se dit d'une panne posant sur le mur<br />
gouttereau ou dans l'architecture à pan de<br />
bois, sur le soubassement<br />
SOLIN<br />
raccord de mortier en bande assurant<br />
l'étanchéité<br />
SOLIVE<br />
pièce de bois allant de mur en mur <strong>et</strong><br />
supportant un plancher ou s'appuyant sur <strong>des</strong><br />
poutres sommier de forte section<br />
SOUBASSEMENT<br />
partie inférieure d'un mur<br />
SURCROÎT<br />
lorsque le mur gouttereau s'élève au-<strong>des</strong>sus<br />
du plancher, se dit de c<strong>et</strong>te partie de mur<br />
TABLEAU<br />
dans les ouvertures, surface du mur comprise<br />
entre l’ébrasement <strong>et</strong> le mur extérieur<br />
TA<strong>BATI</strong>ÈRE<br />
p<strong>et</strong>ite lucarne intégrée dans le versant de la<br />
toiture<br />
TRAVÉE<br />
superposition de baies sur un même axe, qui<br />
composent une façade<br />
TORCHIS<br />
mélange de terre argileuse <strong>et</strong> de paille ou de<br />
foin – technique de construction<br />
TUILEAU<br />
tuile plate utilisée pour le revêtement<br />
extérieur en bardage<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
SOMMAIRE<br />
Moulins du Pas-de-Calais -<br />
Bréemersch <strong>et</strong> Decelle - Editions<br />
Archives du Pas-de-Calais, 1995<br />
Toujours Vivants les Moulins -<br />
Bruggeman - Editions ARAM, 1986<br />
Architecture en Boulonnais -<br />
Richesses du canton de Samer -<br />
Inventaire général - Editions<br />
Commission Départementale <strong>des</strong><br />
Monuments Historiques du Pas-de-<br />
Calais, 1981<br />
Promenade dans le marais<br />
audomarois - Editions Espace<br />
<strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>, 1985<br />
Les vieux manoirs du Boulonnais -<br />
Rodière - Editions Lafitte, 1979<br />
Le guide <strong>des</strong> châteaux de France -<br />
Pas-de-Calais - Thiébault - Editions<br />
Hermé, 1986<br />
Cahier technique du bocage -<br />
Edition PNR <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong><br />
d’Opale, 2001<br />
Patrimoine rural bâti en Boulonnais<br />
- Dumeige - Editions PNR du<br />
Boulonnais<br />
Patrimoine rural bâti de<br />
l’Audomarois - Evard - Editions PNR<br />
<strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d’Opale<br />
Guide de l’habitat <strong>des</strong> Trois Pays -<br />
Editions Communauté de<br />
Communes <strong>des</strong> Trois Pays, 2001<br />
Patrimoine rural bâti en <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale I 67
Les 152 communes du <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> :<br />
Acquin-Westbécourt<br />
Affringues<br />
Alembon<br />
Alincthun<br />
Alquines<br />
Ambl<strong>et</strong>euse<br />
Andres<br />
Arques<br />
Audembert<br />
Audinghen<br />
Audrehem<br />
Audresselles<br />
Baincthun<br />
Bainghen<br />
Balinghem<br />
Bayenghem-lez-Eperlecques<br />
Bayenghem-les-Seninghem<br />
Bazinghen<br />
Belle-<strong>et</strong>-Houllefort<br />
Bellebrune<br />
Beuvrequen<br />
Blendecques<br />
Bléquin<br />
Boisdinghem<br />
Bonningues-les-Ardres<br />
Bouquehault<br />
Bournonville<br />
Boursin<br />
Bouvelinghem<br />
Brunembert<br />
Caffiers<br />
Campagne-les-Guînes<br />
Campagne-les-Wardrecques<br />
Carly<br />
Clairmarais<br />
Clerques<br />
Cléty<br />
Colembert<br />
Cond<strong>et</strong>te<br />
Conteville-lez-Boulogne<br />
Coulomby<br />
Cours<strong>et</strong><br />
Crémarest<br />
Dannes<br />
Desvres<br />
Dohem<br />
Doudeauville<br />
Echinghen<br />
Elnes<br />
Eperlecques<br />
Equihen-Plage<br />
Escalles<br />
Escœuilles<br />
Esquer<strong>des</strong><br />
Ferques<br />
Fiennes<br />
Guînes<br />
Halinghen<br />
Hallines<br />
Hardinghen<br />
Haut-Loquin<br />
Helfaut<br />
Henneveux<br />
Herbinghem<br />
Hermelinghen<br />
Hervelinghen<br />
Hesdigneul-les-Boulogne<br />
Hesdin-l'Abbé<br />
Hocquinghen<br />
Houlle<br />
Isques<br />
Journy<br />
La Capelle-les-Boulogne<br />
Lacres<br />
Landr<strong>et</strong>hun-le-Nord<br />
Landr<strong>et</strong>hun-lez-Ardres<br />
Ledinghem<br />
Leubringhen<br />
Leulinghem-les-Estrehem<br />
Leulinghen-Bernes<br />
Le Wast<br />
Licques<br />
Longfossé<br />
Longuenesse<br />
Longueville<br />
Lottinghen<br />
Lumbres<br />
Maninghen-Henne<br />
Marquise<br />
Menneville<br />
Mentque-Nortbécourt<br />
Moringhem<br />
Moulle<br />
Nabringhen<br />
Nesles<br />
Neufchâtel-Hardelot<br />
Nielles-les-Bléquin<br />
Nordausques<br />
Nortleulinghem<br />
Offr<strong>et</strong>hun<br />
Ouve-Wirquin<br />
Pernes-lez-Boulogne<br />
Pihem<br />
Pittefaux<br />
Polincove<br />
Quelmes<br />
Quercamps<br />
Quesques<br />
Questrecques<br />
Rebergues<br />
Recques-sur-Hem<br />
Remilly-Wirquin<br />
Réty<br />
Rinxent<br />
Rodelinghem<br />
Ruminghem<br />
Saint-Etienne-au-Mont<br />
Saint-Inglevert<br />
Saint-Martin-au-Laërt<br />
Saint-Martin-Choquel<br />
Saint-Omer<br />
Salperwick<br />
Samer<br />
Sangatte<br />
Sanghen<br />
Selles<br />
Seninghem<br />
Senlecques<br />
Serques<br />
S<strong>et</strong>ques<br />
Surques<br />
Tardinghen<br />
Tatinghem<br />
Tilques<br />
Tingry<br />
Tournehem-sur-la-Hem<br />
Vaudringhem<br />
Verlincthun<br />
Vieil-Moutier<br />
Wacquinghen<br />
Wavrans-sur-l'Aa<br />
Wierre-au-Bois<br />
Wierre-Effroy<br />
Wimereux<br />
Wimille<br />
Wirwignes<br />
Wismes<br />
Wisques<br />
Wissant<br />
Wizernes<br />
Zouafques<br />
Zudausques<br />
LES GUIDES TECHNIQUES DU PARC (juin 2003)<br />
• Bâtiments agricoles <strong>et</strong> paysages - 2000<br />
• Guide du Bocage - 2001<br />
• Guide <strong>des</strong> droits <strong>et</strong> devoirs en zone humide - 2003<br />
• L’affichage publicitaire dans le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> - 2003<br />
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> <strong>des</strong> <strong>Caps</strong> <strong>et</strong> <strong>Marais</strong> d'Opale<br />
est une création du Conseil Régional Nord-Pas de<br />
Calais avec la coopération du Conseil Général du<br />
Pas-de-Calais, <strong>et</strong> la participation de l'Etat, <strong>des</strong> organismes<br />
consulaires, <strong>des</strong> intercommunalités <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
communes adhérentes.<br />
Maison du <strong>Parc</strong><br />
B.P. 55 62510 Arques<br />
Tél. 03 21 87 90 90<br />
Fax 03 21 87 90 87<br />
E-mail : info@parc-opale.fr<br />
www.parc-opale.fr