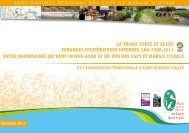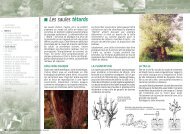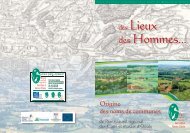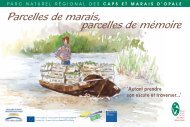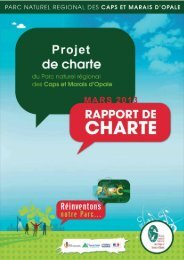Télécharger le PDF partie 2 - Parc naturel régional des Caps et ...
Télécharger le PDF partie 2 - Parc naturel régional des Caps et ...
Télécharger le PDF partie 2 - Parc naturel régional des Caps et ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
16 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ Les sau<strong>le</strong>s têtards<br />
Les sau<strong>le</strong>s (blanc, fragi<strong>le</strong>, <strong>et</strong>c.) se prêtent<br />
aisément au mode de tail<strong>le</strong> en têtard qui<br />
constitue un élément végétal caractéristique<br />
du paysage audomarois. La dénomination de<br />
« têtard » est prise en analogie à la larve de<br />
la grenouil<strong>le</strong> ou du crapaud qui ont une grosse<br />
tête <strong>et</strong> un p<strong>et</strong>it corps. C<strong>et</strong>te forme en têtard est<br />
provoquée par la coupe de la <strong>partie</strong> sommita<strong>le</strong><br />
du sau<strong>le</strong>. Le printemps suivant, l’arbre<br />
développe ses bourgeons latéraux tout en<br />
provoquant l’élargissement du somm<strong>et</strong> du<br />
tronc. Se forme ainsi progressivement un<br />
plateau globu<strong>le</strong>ux (d’où <strong>le</strong> terme de têtard),<br />
parfois large de plus d’un mètre, surmonté <strong>des</strong><br />
rameaux de repousse.<br />
RÔLE BIOLOGIQUE<br />
Outre son intérêt esthétique, voire économique,<br />
l’arbre têtard joue en vieillissant un rô<strong>le</strong><br />
écologique de premier ordre. Ainsi, <strong>le</strong>s cavités<br />
qui se forment avec l’âge de l’arbre assurent<br />
abri <strong>et</strong> lieux de reproduction à une faune<br />
cavernico<strong>le</strong>, notamment certains oiseaux<br />
comme <strong>le</strong>s mésanges ou la chou<strong>et</strong>te chevêche,<br />
mais aussi de nombreux p<strong>et</strong>its mammifères.<br />
Les branches issues de la tail<strong>le</strong> peuvent être<br />
utilisées en bois de chauffage (<strong>le</strong> diamètre<br />
“bûche” atteint pouvant par exemp<strong>le</strong><br />
déterminer la mise en œuvre de la tail<strong>le</strong><br />
d’entr<strong>et</strong>ien) ou comme piqu<strong>et</strong>s pour la<br />
réalisation de clôtures, manches d’outils… ou<br />
encore de perches pour la propulsion <strong>des</strong><br />
bateaux.<br />
Idéa<strong>le</strong>ment, une tail<strong>le</strong> d’entr<strong>et</strong>ien doit être<br />
pratiquée tous <strong>le</strong>s 5 à 10 ans afin de préserver<br />
l’arbre ou suivant l’usage souhaité <strong>des</strong><br />
branches. Sur <strong>le</strong> marais audomarois on trouve<br />
éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> chênes <strong>et</strong> <strong>des</strong> peupliers qui sont<br />
traités en têtards.<br />
LA PLANTATION<br />
Les sau<strong>le</strong>s peuvent être bouturés (plançonnage)<br />
pour accélérer la formation de têtards. Une<br />
branche d’un diamètre conséquent (10 cm par<br />
ex.) <strong>et</strong> de 2 à 3 mètres de long, coupée en biseau,<br />
peut ainsi être enfoncée dans <strong>le</strong> sol (80 cm à 1<br />
mètre de profondeur) où el<strong>le</strong> rej<strong>et</strong>tera rapidement.<br />
Les boutures doivent être faites lorsque <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s<br />
ont perdu toutes <strong>le</strong>urs feuil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> plantées entre<br />
décembre <strong>et</strong> mars afin de garantir de bonnes<br />
conditions de reprise.<br />
Principe de tail<strong>le</strong><br />
de la couronne du<br />
sau<strong>le</strong> têtard<br />
LA TAILLE<br />
El<strong>le</strong> est la c<strong>le</strong>f du succès du mode de traitement<br />
en têtard mais sa seu<strong>le</strong> singularité par rapport à<br />
une tail<strong>le</strong> classique est sa fréquence <strong>et</strong> <strong>le</strong> fait<br />
qu’el<strong>le</strong> intéresse la totalité du houppier. El<strong>le</strong> se<br />
fait au ras de la tête, sans toutefois entamer la<br />
couronne (schéma ci-<strong>des</strong>sous).<br />
Les sau<strong>le</strong>s têtards présentent souvent <strong>des</strong> branches<br />
très longues <strong>et</strong> de diamètre assez faib<strong>le</strong>. Il est alors<br />
souhaitab<strong>le</strong> de procéder à une coupe en 2 temps<br />
(de l’extrémité vers <strong>le</strong> tronc) pour éviter<br />
l’éclatement de la jonction entre <strong>le</strong> tronc <strong>et</strong> la<br />
branche trop lourde.<br />
Privilégier la tail<strong>le</strong> hiverna<strong>le</strong>.<br />
Utilisation <strong>des</strong> branches comme pieux<br />
(avec possibilité de reprise : principe du plançonnage).<br />
enfonce-pieux<br />
nappe d’eau<br />
enracinement
■ Les boisements<br />
Les boisements dans <strong>le</strong> marais sont de deux<br />
types :<br />
Des boisements <strong>naturel</strong>s (spontanés), tels<br />
<strong>le</strong>s bois tourbeux qui se développent sur<br />
un sol gorgé d’eau riche en tourbe ;<br />
Des boisements plus « artificiels », issus<br />
de plantations effectuées par l’homme au<br />
cours du temps. Les peup<strong>le</strong>raies <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
alignements de tuyas en sont <strong>des</strong><br />
illustrations caractéristiques. Ce type de<br />
plantations est fortement déconseillé car<br />
il participe à la dénaturation du marais.<br />
La gestion <strong>des</strong> ces différents boisements peut<br />
prendre différentes orientations :<br />
L’ABSENCE D’INTERVENTION<br />
De part l’inaccessibilité de certaines<br />
parcel<strong>le</strong>s ;<br />
Intégration paysagère de certains éléments<br />
inesthétiques dans <strong>le</strong> paysage (bâtiment,<br />
<strong>et</strong>c.) ;<br />
Choix conservatoire vis-à-vis de formations<br />
<strong>naturel</strong><strong>le</strong>s comme <strong>le</strong>s bois tourbeux, très rares<br />
au niveau <strong>régional</strong>, voire français, entr<strong>et</strong>ien<br />
<strong>des</strong> sau<strong>le</strong>s tétards.<br />
UNE INTERVENTION<br />
CIBLÉE DE CONTRÔLE<br />
DANS LES ROSELIÈRES ET<br />
MÉGAPHORBIAIES<br />
Les sau<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s aulnes, <strong>le</strong>s<br />
aubépines ou encore <strong>le</strong>s sureaux,<br />
envahissent rapidement<br />
<strong>le</strong>s formations herbacées peu<br />
entr<strong>et</strong>enues (voir succession<br />
caractéristique ci-<strong>des</strong>sous),<br />
notamment cel<strong>le</strong>s moins<br />
influencées par une nappe<br />
d’eau é<strong>le</strong>vée. La coupe de ces<br />
arbustes s’avère souvent<br />
nécessaire en corollaire avec<br />
une gestion par fauche.<br />
UNE INTERVENTION<br />
IMPORTANTE DANS CERTAINS CAS<br />
Par exemp<strong>le</strong>, boisements introduits (ex :<br />
peupliers), souvent inexploitab<strong>le</strong>s à <strong>des</strong> fins<br />
commercia<strong>le</strong>s, sources de nuisances<br />
présentes ou futures (faib<strong>le</strong> dégradation <strong>des</strong><br />
feuil<strong>le</strong>s dans l’eau, ombrage de parcel<strong>le</strong>s,<br />
risques de chute…).<br />
A l’inverse, <strong>des</strong> plantations peuvent être<br />
préconisées dans certains cas de figure :<br />
Création de brise-vents ;<br />
Création d’écrans visuels<br />
(ex : dissimulation de sentiers) ;<br />
Intégration paysagère.<br />
Ces plantations doivent être menées en<br />
tenant compte :<br />
Du type de sol <strong>et</strong> <strong>des</strong> essences <strong>le</strong>s plus<br />
adaptées à ce dernier ;<br />
Evolution de la végétation autour d’un plan d’eau : atterrissement progressif <strong>et</strong><br />
développement <strong>des</strong> boisements humi<strong>des</strong><br />
De contraintes écologiques <strong>et</strong> paysagères :<br />
- de privilégier <strong>le</strong>s essences loca<strong>le</strong>s aux<br />
essences non spontanées dans la région<br />
(interdites dans <strong>le</strong> site inscrit) ;<br />
- penser au devenir du boisement <strong>et</strong> au<br />
risque de ferm<strong>et</strong>ure visuel<strong>le</strong> <strong>des</strong> milieux.<br />
Eviter dans ce cadre de boiser la totalité<br />
<strong>des</strong> bordures d’étang (chute de feuil<strong>le</strong>s,<br />
forte sédimentation, ombrage néfaste aux<br />
plantes aquatiques <strong>et</strong> amphibies).<br />
Des rég<strong>le</strong>mentations en vigueur<br />
loca<strong>le</strong>ment (Site Inscrit, Plan Local<br />
d’Urbanisme…).<br />
La dynamique ultime d’une<br />
zone humide est un boisement<br />
<strong>naturel</strong>. Ce boisement est<br />
provoqué par un comb<strong>le</strong>ment<br />
progressif de la zone humide suite<br />
aux dépôts <strong>et</strong> apports successifs<br />
de matière organique. Dans notre<br />
cas, l’abaissement <strong>des</strong> niveaux<br />
d’eau provoque <strong>le</strong> même type de<br />
phénomène en favorisant <strong>des</strong><br />
végétations de type arbustives ou<br />
arborées.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 17 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
18 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ Les fossés<br />
Véritab<strong>le</strong> « système circulatoire » du Marais<br />
Audomarois, <strong>le</strong>s fossés abritent de par <strong>le</strong>ur<br />
position privilégiée entre terre <strong>et</strong> eau, une flore<br />
<strong>et</strong> une faune remarquab<strong>le</strong>.<br />
Ces milieux plus ou moins stagnants se<br />
comb<strong>le</strong>nt cependant rapidement <strong>et</strong> nécessitent<br />
un entr<strong>et</strong>ien régulier sous la forme de curages<br />
tous <strong>le</strong>s 5 à 10 ans. Le faucardage, coupe de la<br />
végétation aquatique, ou encore la fauche <strong>des</strong><br />
plantes <strong>des</strong> rives sont éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> opérations<br />
fréquentes. Quelques principes d’intervention<br />
seront favorab<strong>le</strong>s à la conservation <strong>des</strong> habitats.<br />
LE CURAGE<br />
Evaluer préalab<strong>le</strong>ment la présence éventuel<strong>le</strong><br />
de plantes ou d’animaux rares <strong>et</strong> protégés<br />
(ex : Stratiotes, Blongios nain…) ;<br />
Reprendre, dans la mesure du possib<strong>le</strong>, <strong>le</strong><br />
profil <strong>des</strong> berges en pente douce (schéma ci<strong>des</strong>sous)<br />
afin d’éviter un comb<strong>le</strong>ment rapide<br />
ultérieur <strong>et</strong> favoriser <strong>le</strong> développement <strong>des</strong><br />
plantes amphibies (avant toute intervention,<br />
tenir compte <strong>des</strong> rég<strong>le</strong>mentations en vigueur<br />
<strong>et</strong> <strong>des</strong> contextes locaux).<br />
Etat avant curage<br />
Curage<br />
Etat après curage<br />
Conserver <strong>des</strong> ilots de végétation régulièrement<br />
<strong>le</strong> long du fossé ;<br />
Réaliser <strong>le</strong> curage sans agrandir <strong>et</strong> surtout<br />
approfondir <strong>le</strong> fossé ;<br />
Réga<strong>le</strong>r (éta<strong>le</strong>r) <strong>le</strong>s boues de curage sur la<br />
plus grande <strong>partie</strong> de la parcel<strong>le</strong> (moins<br />
d’effondrements ultérieurs, moins de<br />
chardons) ;<br />
Travail<strong>le</strong>r en rotation sur un linéaire de fossé,<br />
c’est-à-dire n’intervenir que sur <strong>des</strong> p<strong>et</strong>its<br />
tronçons afin de préserver un maximum<br />
d’habitats dans un même secteur, par<br />
exemp<strong>le</strong> :<br />
- fossé ouvert riche en herbiers (intérêt pour<br />
<strong>le</strong> frai <strong>des</strong> poissons, <strong>le</strong>s plantes rares, <strong>le</strong>s<br />
libellu<strong>le</strong>s...) ;<br />
- fossé semi-ouvert, riche en végétation de<br />
bordure (roseaux, mass<strong>et</strong>tes) favorab<strong>le</strong> aux<br />
poissons (frai) <strong>et</strong> à la nidation de nombreux<br />
oiseaux ;<br />
- fossé tota<strong>le</strong>ment envahi par la végétation,<br />
favorab<strong>le</strong> à la faune mais risquant<br />
néanmoins de se comb<strong>le</strong>r tota<strong>le</strong>ment<br />
(entr<strong>et</strong>ien à prévoir). Eu égard à certaines<br />
espèces végéta<strong>le</strong>s ou aux pratiques agrico<strong>le</strong>s<br />
traditionnel<strong>le</strong>s, un curage comp<strong>le</strong>t <strong>des</strong><br />
fossés, conforme à la tradition reste<br />
pertinent.<br />
Deux outils traditionnels du marais perm<strong>et</strong>taient<br />
l’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> canaux <strong>et</strong> étangs :<br />
La baguern<strong>et</strong>te qui<br />
perm<strong>et</strong> de sortir la<br />
matière organique<br />
<strong>des</strong> fossés, sa<br />
contenance est de 20 à<br />
25kg.<br />
La grèpe qui perm<strong>et</strong> de sortir<br />
<strong>des</strong> matières soli<strong>des</strong> du fond<br />
<strong>des</strong> rivières <strong>et</strong> canaux. Le<br />
curage à la grèpe peut se<br />
pratiquer à partir <strong>des</strong><br />
berges ou du bâcove.<br />
LA FAUCHE<br />
La fauche de la végétation <strong>des</strong> rives doit r<strong>et</strong>enir<br />
<strong>le</strong>s principes énoncés précédemment (pages<br />
12 <strong>et</strong> 13).<br />
LE FAUCARDAGE<br />
Il doit être mené :<br />
Le plus tardivement possib<strong>le</strong> (août <strong>et</strong> mieux<br />
septembre) pour préserver <strong>le</strong>s nichées.<br />
En ramassant <strong>le</strong>s produits de coupe (moins<br />
de décomposition, donc réduction de<br />
l’envahissement, moins de consommation<br />
de l’oxygène de l’eau).
Les fiches techniques<br />
I PARTIE 2 I<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 19 ■
Fiche 1<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
20 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ La conduite <strong>et</strong> l’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> formations ligneuses<br />
Les formations ligneuses* font l’obj<strong>et</strong> de différents mo<strong>des</strong> de conduite<br />
dans <strong>le</strong> Marais Audomarois en fonction <strong>des</strong> objectifs de gestion mais<br />
aussi selon <strong>le</strong> type de structure végéta<strong>le</strong> concernée. Ces opérations<br />
vont de l’absence d’intervention à <strong>des</strong> travaux beaucoup plus<br />
sensib<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong> milieu dont l’un <strong>des</strong> intérêts dérivés est la fourniture<br />
de matériaux utilisés dans d’autres cadres.<br />
Quatre modalités de gestion <strong>des</strong> formations ligneuses sont pratiquées<br />
sur <strong>le</strong>s sites <strong>naturel</strong>s du Marais Audomarois :<br />
La non-intervention,<br />
La coupe rase (abattage <strong>et</strong> recépage),<br />
L’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> haies,<br />
L’étêtage.<br />
El<strong>le</strong>s correspondent à <strong>des</strong> objectifs de gestion précis qui perm<strong>et</strong>tent<br />
de répondre soit à <strong>des</strong> obligations de préservation de milieux <strong>naturel</strong>s<br />
riches (bois tourbeux par exemp<strong>le</strong>) ou à <strong>des</strong> travaux d’entr<strong>et</strong>ien<br />
traditionnels (sau<strong>le</strong> têtard).<br />
LA NON-INTERVENTION<br />
Ce choix de gestion peut être adopté pour trois raisons :<br />
L’impossibilité “physique” d’accéder aux arbres<br />
C’est <strong>le</strong> cas <strong>des</strong> secteurs restés marécageux sur <strong>le</strong>squels il est<br />
impossib<strong>le</strong> d’intervenir sauf en période de gel prolongé. A l’entrée<br />
de la réserve du Romelaëre se trouvent <strong>le</strong>s bois tourbeux*. Ils sont<br />
certainement, au moins en <strong>partie</strong>, <strong>le</strong>s reliques de ce qu’était <strong>le</strong><br />
marais quand <strong>le</strong>s moines sont arrivés au VIIe sièc<strong>le</strong>. Implantés sur<br />
<strong>des</strong> marécages impénétrab<strong>le</strong>s, où l’eau se partage l’espace avec<br />
<strong>le</strong>s arbres <strong>et</strong> <strong>le</strong>s touradons* de carex, ils sont très dangereux pour<br />
l’homme. Comment imaginer en voyant ces bois qu’ils flottent sur<br />
une masse d’eau parfois profonde de plusieurs mètres ?<br />
La contrainte paysagère : certains boisements peu intéressants,<br />
voire composés d’espèces introduites (peupliers, arbres pourpres),<br />
peuvent cependant être <strong>des</strong> éléments déterminants dans <strong>le</strong> paysage<br />
par <strong>le</strong> fait qu’ils masquent <strong>des</strong> infrastructures inesthétiques (ligne<br />
é<strong>le</strong>ctrique, usine…)<br />
La très grande qualité biologique de certaines formations : Les<br />
bois tourbeux* notamment sont <strong>des</strong> milieux très rares dans <strong>le</strong><br />
Nord-Pas de Calais ou même en France. Ils sont souvent<br />
caractérisés par une grande diversité d’arbres <strong>et</strong> d’arbustes au sein<br />
<strong>des</strong>quels vit une multitude d’autres plantes, de champignons<br />
(fonge) <strong>et</strong> d’animaux. La rar<strong>et</strong>é <strong>et</strong> la richesse de ce type de bois<br />
justifient l’absence d’intervention. Un suivi régulier doit toutefois<br />
être mis en place afin d’évaluer la conservation dans <strong>le</strong> temps<br />
du caractère humide de ces boisements
LA COUPE RASE<br />
C<strong>et</strong>te opération “radica<strong>le</strong>” a trois justifications :<br />
L’élimination d’espèces d’arbres ou d’arbustes introduites Pour<br />
préserver un milieu <strong>naturel</strong>, on s’efforce de lui perm<strong>et</strong>tre de<br />
conserver toutes <strong>le</strong>s espèces qui <strong>le</strong> composent. Toutefois, l’homme<br />
a introduit <strong>des</strong> espèces d’arbres <strong>et</strong> d’arbustes originaires de régions<br />
ou pays étrangers. Certaines de ces plantes se sont si bien<br />
acclimatées qu’el<strong>le</strong>s peuvent empêcher <strong>le</strong>s espèces autochtones*<br />
de pousser norma<strong>le</strong>ment, ou encore el<strong>le</strong>s peuvent dégrader <strong>le</strong><br />
milieu où el<strong>le</strong>s ont été plantées.<br />
Exemp<strong>le</strong> : <strong>le</strong> peuplier du Canada ou <strong>le</strong> peuplier d’Italie. Dans <strong>le</strong><br />
Marais Audomarois, quand <strong>le</strong>s maraîchers ont abandonné certaines<br />
parcel<strong>le</strong>s cultivées, <strong>des</strong> peupliers du Canada ou d’autres variétés<br />
non autochtones ont été plantés. A noter qu’il existe deux espèces<br />
loca<strong>le</strong>s de peupliers (<strong>le</strong> peuplier tremb<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong> peuplier grisard) qui<br />
sont adaptées au marais.<br />
Les peupliers non indigènes* présentent fréquemment plusieurs<br />
types d’inconvénients :<br />
- ils poussent très haut jusqu’à 20-25 mètres, ce qui <strong>le</strong>s rend très<br />
sensib<strong>le</strong>s aux forts coups de vent ;<br />
- un arbre adulte consomme, en période de végétation 250 litres<br />
d’eau par jour, soit 45m3 d’eau par an ;<br />
- quand <strong>le</strong>urs feuil<strong>le</strong>s tombent dans l’eau, el<strong>le</strong>s libèrent <strong>des</strong> substances<br />
chimiques (ex : acide phénolique) qui peuvent perturber<br />
sensib<strong>le</strong>ment la qualité <strong>des</strong> milieux aquatiques ;<br />
- la grande quantité de feuil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> de branches qui tombent à<br />
l’automne comb<strong>le</strong> progressivement <strong>le</strong>s fossés ;<br />
- l’iso<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> parcel<strong>le</strong>s du marais rend diffici<strong>le</strong>, voire impossib<strong>le</strong><br />
l’exploitation <strong>des</strong> arbres devenus matures qui sont parfois laissés<br />
à l’abandon <strong>et</strong> menacent de tomber ;<br />
- à partir de 30 ans, l’arbre se creuse <strong>et</strong> devient donc dangereux s’il<br />
n’est pas exploité ;<br />
- la création de rideaux d’arbres é<strong>le</strong>vés empêche <strong>le</strong> stationnement<br />
<strong>et</strong> la pose de certains oiseaux d’eau ….<br />
Quelques plantations matures de faib<strong>le</strong> étendue peuvent<br />
momentanément être maintenues dans <strong>le</strong>s secteurs où n’existent<br />
pas d’autres grands arbres à proximité. Ces grands arbres peuvent<br />
accueillir certaines espèces d’oiseaux intéressantes comme <strong>le</strong> Pic<br />
vert ou <strong>le</strong> Loriot d’Europe.<br />
Elimination d’arbres dangereux ou mal placés :<br />
- Certains grands arbres plantés sur <strong>des</strong> digues ou en bordure d’une<br />
berge sont menaçants car ils risquent de tomber, emportant avec<br />
eux une <strong>partie</strong> de la digue ou de la berge ; c’est notamment <strong>le</strong><br />
cas de certains peupliers ou de sau<strong>le</strong>s blancs qui n’ont jamais été<br />
entr<strong>et</strong>enus en têtards.<br />
- D’autres arbres plantés en bordure d’une rivière menacent de<br />
couper la circulation de l’eau lors de <strong>le</strong>ur chute ;<br />
- Certains arbres sont trop serrés <strong>et</strong> donc fragilisés <strong>le</strong>s uns par rapport<br />
aux autres. Il convient donc d’en r<strong>et</strong>irer quelques-uns pour n’avoir<br />
que <strong>des</strong> arbres sains <strong>et</strong> bien équilibrés (déséquilibre <strong>et</strong> fragilisation<br />
du fait d’une croissance en hauteur très rapide <strong>et</strong> disproportionnée<br />
par rapport au diamètre).<br />
Depuis l’hiver 2005 a débuté<br />
à Salperwick une opération<br />
expérimenta<strong>le</strong> d’abattage de peupliers<br />
matures sur <strong>des</strong> î<strong>le</strong>s du marais. En<br />
association avec la commune <strong>et</strong> un<br />
propriétaire privé, plusieurs bûcherons<br />
professionnels ont été invités à venir<br />
identifier <strong>des</strong> solutions d’abattage <strong>et</strong><br />
d’évacuation <strong>des</strong> bois. Ainsi, il a été<br />
évoqué <strong>le</strong> flottage <strong>des</strong> troncs (comme<br />
dans <strong>le</strong> marais poitevin), <strong>le</strong> transport<br />
par câb<strong>le</strong> d’une î<strong>le</strong> à l’autre ou encore<br />
l’héliportage. Le coût financier de ces<br />
alternatives ou l’impossibilité pratique<br />
se sont rapidement révélées. Il a donc<br />
été décidé de recourir aux services<br />
d’un bûcheron <strong>et</strong> de proposer à <strong>des</strong><br />
particuliers de débiter <strong>le</strong>s troncs <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
branches. Le transport <strong>des</strong> stères ainsi<br />
confectionnés étant réalisé par<br />
barge… Le coût de l’exploitation a<br />
confirmé l’ineptie de ces plantations<br />
dans <strong>le</strong> marais.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 21 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
22 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
L’ENTRETIEN DES HAIES<br />
L’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> haies peut se concevoir de trois manières différentes<br />
:<br />
La haie de “limite” ou de clôture :<br />
Ferme l’accès (physique <strong>et</strong> visuel) d’un secteur au public ou à <strong>des</strong><br />
animaux. Ce type de haie est taillé environ 2 à 3 fois par an, de<br />
mai à octobre, <strong>et</strong> ne dépasse pas 1,20m. El<strong>le</strong> est composée de<br />
nombreuses espèces (sau<strong>le</strong>s, aubépine, prunellier, viorne,<br />
cornouil<strong>le</strong>r sanguin…)<br />
La haie “brise-vent” ou “brise-regard” :<br />
Plus é<strong>le</strong>vée que la précédente, el<strong>le</strong> peut atteindre 2m à 2,50m ;<br />
son intérêt réside dans <strong>le</strong> fait de masquer un secteur ou de limiter<br />
l’impact du vent. Sa composition est identique à la précédente.<br />
El<strong>le</strong> est entr<strong>et</strong>enue une à trois fois par an en fonction de son<br />
emplacement.<br />
La haie à fagots :<br />
C’est une haie composée uniquement de sau<strong>le</strong>s dont <strong>le</strong> tronc atteint<br />
1,20m au maximum. El<strong>le</strong> est taillée tous <strong>le</strong>s deux ans. L’intérêt de<br />
ce type de haie peut être doub<strong>le</strong> :<br />
- masque en limite de parcel<strong>le</strong> ;<br />
- fourniture de fagots de sau<strong>le</strong>.<br />
C<strong>et</strong>te haie est généra<strong>le</strong>ment créée sur <strong>des</strong> boisements de sau<strong>le</strong>s,<br />
autres que <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s blancs, âgés d’une dizaine d’années.<br />
L’ÉTÊTAGE OU ÉCIMAGE<br />
C’est la technique traditionnel<strong>le</strong> d’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> sau<strong>le</strong>s blancs dans<br />
<strong>le</strong> Marais Audomarois. L’étêtage commence par la suppression de<br />
la cime de l’arbre ; c<strong>et</strong>te première coupe doit intervenir relativement<br />
tôt dans la vie de l’arbre (4-5 ans) <strong>et</strong> doit être faite légèrement en<br />
biseau, à 2,5 ou 3 mètres au-<strong>des</strong>sus du sol. Avec la pousse de<br />
nouvel<strong>le</strong>s branches, <strong>le</strong> somm<strong>et</strong> du tronc s’élargit en un plateau<br />
couronné de rameaux ; il devient têtard (voir fiche N°3).
Coupe d’élagage correcte Coupe d’une grosse branche en plusieurs étapes<br />
la coupe de recépage<br />
Couper <strong>le</strong> tronc, ou la cépée déjà formée, suffisamment près du<br />
sol, avec un léger biseau perm<strong>et</strong>tant l’évacuation de l’eau de pluie.<br />
ALFA<br />
PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DES TRAVAUX SUR LES<br />
BOISEMENTS<br />
la coupe d’élagage<br />
dans toute intervention de coupe ou d’élagage, il est essentiel<br />
de veil<strong>le</strong>r à faire une coupe franche, c’est-à-dire, à ne pas laisser<br />
de troncs fendus ou légèrement écorcés par la chute <strong>des</strong> branches<br />
(schémas ci contre).<br />
Les produits dévitalisateurs de souche : une utilisation exceptionnel<strong>le</strong><br />
L’utilisation de dévitalisateurs de souche, même avec un produit dit peu nocif pour l’environnement (ex : sulfamate d’ammonium) a<br />
<strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s peu connus mais potentiel<strong>le</strong>ment néfastes sur certaines composantes <strong>naturel</strong><strong>le</strong>s <strong>des</strong> milieux (microfaune du sol). La dispersion<br />
<strong>et</strong> la transformation ultérieure de ces substances chimiques sont éga<strong>le</strong>ment peu connues. Leur emploi ne peut donc se justifier<br />
qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment, par exemp<strong>le</strong> sur une parcel<strong>le</strong> d’accès très diffici<strong>le</strong> en toutes saisons. Dans ce cas, l’utilisation du produit doit<br />
être menée avec un maximum de précautions, notamment l’application au pinceau sur une souche fraîche ou rafraîchie. Il est possib<strong>le</strong><br />
d’amplifier l’eff<strong>et</strong> du produit en réalisant <strong>des</strong> trous ou <strong>des</strong> entail<strong>le</strong>s dans la souche à l’aide de la tronçonneuse ou d’une perceuse.<br />
L’utilisation d’un colorant perm<strong>et</strong> d’éviter de traiter plusieurs fois la même souche. Quand cela est possib<strong>le</strong>, la mise en place d’un<br />
pâturage extensif (particulièrement avec <strong>des</strong> moutons), pendant plusieurs années, perm<strong>et</strong> d’éviter <strong>le</strong> rej<strong>et</strong> <strong>des</strong> arbres <strong>et</strong> arbustes sans<br />
apport de produits chimiques <strong>et</strong> limite <strong>le</strong> développement de la « banque de semences » contenue dans <strong>le</strong> sol. Ce mode de gestion<br />
n’est possib<strong>le</strong> que sur <strong>des</strong> secteurs qui ont pour vocation de devenir <strong>des</strong> pairies, sur <strong>des</strong> digues ou encore <strong>des</strong> friches de faib<strong>le</strong> intérêt<br />
biologique.<br />
N’oubliez pas la<br />
sécurité !<br />
Les différents outils de tail<strong>le</strong> sont<br />
tranchants <strong>et</strong> présentent <strong>des</strong><br />
risques qui peuvent être<br />
importants pour <strong>le</strong>s personnes qui<br />
<strong>le</strong>s utilisent <strong>et</strong> <strong>le</strong>s personnes<br />
situées à proximité. Il est donc<br />
vivement conseillé de s’équiper :<br />
un casque de protection avec<br />
visière (ou <strong>des</strong> lun<strong>et</strong>tes spécia<strong>le</strong>s),<br />
<strong>des</strong> protège-oreil<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong> bruit,<br />
<strong>des</strong> chaussures de protection <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> gants. Il existe éga<strong>le</strong>ment <strong>des</strong><br />
vêtements protecteurs spécifiques.<br />
Il est aussi préférab<strong>le</strong> d’interdire<br />
la présence de toute personne à<br />
proximité, <strong>le</strong>s projections pouvant<br />
al<strong>le</strong>r très loin.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 23 ■
Fiche 2<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
24 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ La réalisation d’ écrans végétaux<br />
Les écrans végétaux rendent de précieux services dans <strong>le</strong>s secteurs<br />
sensib<strong>le</strong>s au dérangement dans <strong>le</strong>s espaces protégés, notamment<br />
dans <strong>le</strong>s zones ouvertes où tout observateur est faci<strong>le</strong>ment détectab<strong>le</strong><br />
par la faune. Ils offrent l’intérêt de la soup<strong>le</strong>sse d’utilisation <strong>et</strong> de<br />
la facilité de renouvel<strong>le</strong>ment à l’inverse <strong>des</strong> postes d’observation en<br />
bois, structures plus lour<strong>des</strong> <strong>et</strong> dont <strong>le</strong>s objectifs sont plus liés à<br />
l’accueil du public.<br />
QU’EST-CE QU’UN ÉCRAN VÉGÉTAL ?<br />
Un écran végétal peut être décrit comme un “masque”, composé<br />
de végétaux morts <strong>et</strong>/ou vivants, qui perm<strong>et</strong> de réaliser une coupure<br />
entre deux unités à vocations différentes :<br />
séparer un sentier d’une roselière ;<br />
séparer un champ d’une prairie ;<br />
limiter l’impact visuel d’un sentier en bordure d’étang …<br />
Deux types d’écrans végétaux peuvent être définis :<br />
L’écran végétal “vivant”<br />
Il s’agit d’une haie ou d’une bande boisée. Taillée régulièrement<br />
<strong>et</strong> conçue avec <strong>des</strong> espèces adaptées, el<strong>le</strong> peut remplir <strong>des</strong> rô<strong>le</strong>s<br />
divers (voir fiche N° 1) :<br />
obstac<strong>le</strong> au vent ou à la vue ;<br />
barrière contre <strong>le</strong>s animaux ou <strong>le</strong>s humains ;<br />
intégration paysagère d’équipements inesthétiques ;<br />
iso<strong>le</strong>ment de parcel<strong>le</strong>s….<br />
Dans certains cas, il est possib<strong>le</strong> de tresser ou d’intégrer (après<br />
coupe) certaines branches dans <strong>le</strong>s arbustes qui l’entourent. C<strong>et</strong>te<br />
technique, courante dans certaines campagnes, perm<strong>et</strong> de comb<strong>le</strong>r<br />
<strong>le</strong>s “trous” de la haie de manière temporaire en prenant appui sur<br />
<strong>le</strong>s troncs d’arbres <strong>et</strong> d’arbustes.<br />
C<strong>et</strong>te formu<strong>le</strong> offre l’avantage d’être pérenne, renouvelab<strong>le</strong>, <strong>et</strong><br />
efficace comme obstac<strong>le</strong>.<br />
On peut la réaliser à partir d’arbres <strong>et</strong> d’arbustes relativement jeunes<br />
(environ 10 ans) qui n’ont jamais été entr<strong>et</strong>enus <strong>et</strong> dirigés.<br />
Ne pas confondre c<strong>et</strong>te technique avec cel<strong>le</strong> de la haie palissée ou<br />
p<strong>le</strong>ssée (technique du p<strong>le</strong>ssage) qui repose sur une coupe <strong>partie</strong>l<strong>le</strong><br />
<strong>et</strong> un couchage (à environ 45°) <strong>des</strong> arbustes de façon à créer un<br />
obstac<strong>le</strong> végétal au passage (schéma ci-<strong>des</strong>sous).<br />
Open University
L’écran végétal “mort”<br />
Dans ce groupe, ne seront pas décrites toutes <strong>le</strong>s formu<strong>le</strong>s trop<br />
artificiel<strong>le</strong>s (lattis de châtaigniers, fascines tressées, cadre en<br />
roseaux,…) <strong>et</strong> dont la biodégradabilité n’est pas tota<strong>le</strong> (fils de fer,<br />
agrafes).<br />
Ces métho<strong>des</strong> peuvent néanmoins être utilisées en conjonction avec<br />
un équipement d’accueil (ex : accès intégré à un observatoire).<br />
Sur <strong>le</strong>s sites gérés ou co-gérés par <strong>le</strong> <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong>, c<strong>et</strong>te<br />
technique est utilisée comme clôture contre <strong>le</strong>s intrusions humaines<br />
<strong>et</strong> canines <strong>et</strong> éventuel<strong>le</strong>ment pour limiter <strong>le</strong>s passages d’animaux<br />
en pâturage.<br />
Utilisation comme clôture : quand <strong>le</strong>s boisements s’y prêtent<br />
(longues branches supérieures à 3 m, possibilité de confectionner<br />
<strong>des</strong> pieux de 2 m).<br />
C’est principa<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> cas sur la réserve du Romelaëre où c<strong>et</strong>te<br />
technique perm<strong>et</strong> de limiter l’accès du public à <strong>des</strong> secteurs<br />
sensib<strong>le</strong>s de la réserve en ne provoquant pas l’impact visuel négatif<br />
d’une clôture traditionnel<strong>le</strong>.<br />
Intérêt écologique : il décou<strong>le</strong> indirectement de l’utilisation <strong>des</strong><br />
écrans comme clôtures par <strong>le</strong> rô<strong>le</strong> d’abri joué par <strong>le</strong>s écrans<br />
végétaux pour <strong>le</strong>s p<strong>et</strong>its mammifères, <strong>le</strong>s amphibiens…. (contre<br />
<strong>le</strong>s prédateurs ou <strong>le</strong>s intempéries). Ces écrans sont aussi utilisés<br />
par <strong>le</strong>s insectes xylophages (consommateurs de bois) ou par<br />
d’autres invertébrés qui y trouvent <strong>des</strong> conditions de vie<br />
particulières.<br />
Tous <strong>le</strong>s écrans végétaux mis en place par <strong>le</strong> <strong>Parc</strong> <strong>le</strong> sont uniquement<br />
avec <strong>des</strong> végétaux pré<strong>le</strong>vés sur <strong>le</strong>s sites. Cela perm<strong>et</strong> d’utiliser au<br />
mieux la matière produite <strong>et</strong> de la valoriser écologiquement. C<strong>et</strong>te<br />
opération peut être conduite lord de déboisements ou de recépages<br />
réguliers en utilisant <strong>le</strong>s “mauvaises branches” pour conforter <strong>le</strong>s<br />
ouvrages existants.<br />
La disponibilité en” matériaux” végétaux peut cependant constituer<br />
un handicap sur certains sites.<br />
LES MATÉRIAUX NÉCESSAIRES À LA RÉALISATION D’UN<br />
ÉCRAN VÉGÉTAL<br />
Les pieux<br />
Ce sont généra<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> pieux de sau<strong>le</strong>s ou d’aulnes pré<strong>le</strong>vés sur<br />
place. Le sau<strong>le</strong> offre l’avantage de bouturer dès sa mise en terre.<br />
L’aulne glutineux, assez long à se décomposer, ne bouture pas<br />
lorsqu’il est utilisé sous forme de pieu.<br />
Caractéristiques<br />
<strong>des</strong> pieux :<br />
Diamètre : 6 à 12 cm<br />
Longueur : 2 m<br />
Profondeur d’enfoncement:<br />
50 à 60 cm<br />
Epointage indispensab<strong>le</strong><br />
En vous promenant sur <strong>le</strong><br />
sentier tout public de la<br />
réserve du Romelaëre, vous<br />
pourrez à loisir découvrir <strong>le</strong>s<br />
différents types d’écrans végétaux<br />
réalisés par l’équipe <strong>des</strong> gar<strong>des</strong>.<br />
Au départ, l’ensemb<strong>le</strong> <strong>des</strong><br />
matériaux était issu de la réserve<br />
(pieux <strong>et</strong> branches). Récemment<br />
il a été décidé d’utiliser <strong>des</strong> pieux<br />
de châtaignier pour obtenir une<br />
durée de vie plus longue <strong>des</strong><br />
écrans <strong>et</strong> éviter la reprise <strong>des</strong><br />
pieux de sau<strong>le</strong>s. La réserve a en<br />
eff<strong>et</strong> l’objectif global de limiter la<br />
“ferm<strong>et</strong>ure du milieu” par <strong>le</strong><br />
boisement spontanée.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 25 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
26 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
Les branchages<br />
Ils sont généra<strong>le</strong>ment issus de sau<strong>le</strong>s (toutes espèces) pour <strong>le</strong>ur<br />
élasticité <strong>et</strong> la facilité de <strong>le</strong>ur tressage, mais d’autres essences peuvent<br />
s’envisager suivant <strong>le</strong>s potentialités du milieu.<br />
Caractéristiques :<br />
Diamètre : 3 à 6 cm<br />
Longueur : 3 m au moins pour <strong>le</strong> tressage.<br />
- Branches longilignes pour éviter <strong>le</strong>s ébranchages,<br />
- branches soup<strong>le</strong>s pour la mise en place,<br />
- branches vertes (juste après recépage) pour se tresser faci<strong>le</strong>ment<br />
<strong>et</strong> se “durcir” après mise en place.<br />
INTÉRÊT DE LA TECHNIQUE<br />
Utilisation d’une matière première diffici<strong>le</strong>ment utilisab<strong>le</strong><br />
autrement ;<br />
aménagement très “nature” <strong>et</strong> n’amenant pas de matériaux<br />
étrangers ;<br />
aménagement très apprécié du public <strong>et</strong> très bien intégré dans<br />
<strong>le</strong> paysage ;<br />
perm<strong>et</strong> de conserver sur place la matière produite par <strong>le</strong> milieu ;<br />
coût très faib<strong>le</strong> (uniquement main d’œuvre) ;<br />
technique adaptée à tous types de linéaires, courbes ang<strong>le</strong>s… ;<br />
l’ensemb<strong>le</strong> est entièrement biodégradab<strong>le</strong> ;<br />
végétalisation de l’ensemb<strong>le</strong> de l’écran par <strong>des</strong> plantes loca<strong>le</strong>s<br />
(ronces, gail<strong>le</strong>ts…) <strong>et</strong> intégration de l’ensemb<strong>le</strong> dans la végétation ;<br />
<strong>le</strong>s <strong>partie</strong>s de branches <strong>et</strong> de troncs non utilisées lors <strong>des</strong> travaux<br />
peuvent être laissées sur place <strong>le</strong> long de l’écran ; el<strong>le</strong>s<br />
participeront à conforter ce dernier <strong>et</strong> procureront un couvert<br />
ou un gîte apprécié.
MISE EN ŒUVRE DE LA TECHNIQUE<br />
Précautions à prendre<br />
Faire attention, lors du battage <strong>des</strong> pieux, à ne pas <strong>le</strong>s fendre, ce<br />
qui <strong>le</strong>s fragiliserait <strong>et</strong> limiterait <strong>le</strong>ur repousse éventuel<strong>le</strong><br />
(l’enracinement conforte l’ouvrage) ; chanfreiner l’extrémité du<br />
pieu <strong>et</strong> la cerc<strong>le</strong>r d’un fil de fer perm<strong>et</strong> de limiter <strong>le</strong>s risques<br />
d’éclatement (ne pas oublier de r<strong>et</strong>irer <strong>le</strong> fil de fer une fois <strong>le</strong> pieu<br />
planté) ;<br />
couper <strong>le</strong> haut <strong>des</strong> pieux en diagona<strong>le</strong> pour perm<strong>et</strong>tre à la pluie<br />
de ruisse<strong>le</strong>r <strong>et</strong> éviter sa pénétration dans <strong>le</strong> pieu, source de<br />
pourrissement ;<br />
pour <strong>le</strong> fascinage, n’utiliser que du bois vert, beaucoup plus<br />
“élastique” ;<br />
bien tasser <strong>le</strong>s branches pour obtenir une fascine très dense, gage<br />
de meil<strong>le</strong>ure étanchéité <strong>et</strong> plus grande efficacité visuel<strong>le</strong> (rô<strong>le</strong><br />
d’écran proprement dit) ;<br />
couper à ras toutes <strong>le</strong>s p<strong>et</strong>ites branches qui sortent de l’écran (une<br />
fois celui-ci réalisé complètement), pour éviter que <strong>le</strong>s promeneurs<br />
ne <strong>le</strong>s accrochent ou <strong>le</strong>s arrachent ;<br />
ne pas hésiter à lier la dernière branche de la fascine aux pieux<br />
pour éviter son affaissement trop rapide ;<br />
réaliser ces ouvrages en repos de végétation, du 15 novembre à<br />
fin février.<br />
Technique de réalisation<br />
Les gestionnaires de la<br />
réserve appliquent depuis une<br />
quinzaine d’années une<br />
philosophie <strong>des</strong> gestionnaires<br />
hollandais. Ceux-ci considèrent<br />
en eff<strong>et</strong> que tout ce qui est produit<br />
sur l’espace <strong>naturel</strong> doit y rester<br />
car il ap<strong>partie</strong>nt au site. De c<strong>et</strong>te<br />
façon, tous <strong>le</strong>s branchages divers,<br />
<strong>le</strong>s produits de fauche… trouvent<br />
une place logique dans <strong>le</strong>s<br />
aménagements (restauration <strong>des</strong><br />
digues, écrans végétaux, chablis<br />
artificiels…). Rien n’est brûlé ou<br />
évacué de la réserve.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 27 ■
Fiche 3<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
28 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ L’entr<strong>et</strong>ien du sau<strong>le</strong> têtard<br />
Le sau<strong>le</strong> têtard est l’une <strong>des</strong> images typiques du marais où il borde <strong>et</strong> souligne <strong>le</strong>s chenaux <strong>et</strong> <strong>le</strong>s watergangs. Ce mode cultural, traditionnel<br />
de nombreux secteurs de la région, avait un rô<strong>le</strong> essentiel<strong>le</strong>ment pratique de maintien <strong>des</strong> berges, assurant par ail<strong>le</strong>urs une production de<br />
bois aux usages multip<strong>le</strong>s. Son rô<strong>le</strong> écologique est éga<strong>le</strong>ment majeur <strong>et</strong> un entr<strong>et</strong>ien bien conduit peut contribuer à maintenir c<strong>et</strong>te forme<br />
végéta<strong>le</strong> si particulière.<br />
QU’EST-CE QU’UN SAULE TÊTARD ?<br />
La forme têtard est issue de la coupe de la <strong>partie</strong> supérieure d’un arbre<br />
; c<strong>et</strong>te action s’appel<strong>le</strong> aussi étêtage ou écimage.<br />
C<strong>et</strong>te première coupe provoque la croissance <strong>des</strong> bourgeons situés à la<br />
périphérie basse de la <strong>partie</strong> étêtée. La cicatrisation <strong>des</strong> plaies (coupe)<br />
<strong>et</strong> la croissance de nouvel<strong>le</strong>s branches provoquent l’élargissement de<br />
la <strong>partie</strong> haute du tronc en un plateau couronné de rameaux ; <strong>le</strong> sau<strong>le</strong><br />
devient têtard. L’entr<strong>et</strong>ien régulier du têtard (tous <strong>le</strong>s 3 à 10 ans) perm<strong>et</strong><br />
à la tête de s’étoffer <strong>et</strong> de s’élargir créant ainsi un large plateau.<br />
Le nom de têtard est donné par analogie à la tête de la larve <strong>des</strong><br />
grenouil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> crapauds.<br />
La tail<strong>le</strong> en têtard est une technique ancienne qui se pratiquait éga<strong>le</strong>ment<br />
(<strong>et</strong> se pratique encore) sur <strong>le</strong> frêne en Boulonnais <strong>et</strong> <strong>le</strong> charme en Avesnois,<br />
parfois <strong>le</strong> chêne. Il existe de nombreuses espèces de sau<strong>le</strong>s, mais ce sont<br />
essentiel<strong>le</strong>ment <strong>le</strong> sau<strong>le</strong> blanc <strong>et</strong> <strong>le</strong> sau<strong>le</strong> fragi<strong>le</strong> qui sont cultivés en têtard.<br />
Nos ancêtres <strong>le</strong>s plantaient en bordure <strong>des</strong> rivières <strong>et</strong> <strong>des</strong> fossés d’irrigation<br />
parce qu’ils avaient compris que <strong>le</strong>urs racines enchevêtrées <strong>et</strong> traçantes<br />
maintiennent la berge.<br />
INTÉRÊT DU SAULE TÊTARD<br />
Le sau<strong>le</strong> est un régulateur <strong>naturel</strong> <strong>et</strong> “gratuit” du régime <strong>des</strong> eaux.<br />
Il joue un rô<strong>le</strong> de pompe par son réseau de racines qui aspirent l’eau,<br />
rej<strong>et</strong>ée ensuite dans l’atmosphère par transpiration <strong>des</strong> feuil<strong>le</strong>s.<br />
Un alignement de sau<strong>le</strong>s mêlés d’aubépines <strong>et</strong> autres buissons préserve<br />
la fraîcheur, favorise la dispersion <strong>des</strong> vents <strong>et</strong> modère <strong>le</strong>s variations<br />
de température .<br />
En vieillissant, <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s deviennent creux, la <strong>partie</strong> centra<strong>le</strong> se<br />
décompose. La décomposition du cœur de la couronne, l’accumulation<br />
de feuil<strong>le</strong>s, branches,… forment peu à peu un terreau, qui perm<strong>et</strong> aux<br />
graines, apportées par <strong>le</strong> vent <strong>et</strong> <strong>le</strong>s oiseaux, de prendre racines.<br />
Ces plantes qui poussent sur d’autres plantes sont dites épiphytiques.<br />
Dans nos régions, l’églantier, la morel<strong>le</strong> douce amère, la ronce mais<br />
aussi <strong>le</strong>s lichens, <strong>des</strong> mousses <strong>et</strong> <strong>des</strong> fougères sont <strong>des</strong> hôtes fréquents<br />
du têtard. Le sau<strong>le</strong> têtard<br />
peut ainsi devenir un véritab<strong>le</strong><br />
jardin suspendu.
Les cicatrices laissées par la coupe ou la chute d’une branche,<br />
<strong>le</strong> cœur de l’arbre qui se creuse, sont autant de cavités qui peuvent<br />
être occupées par <strong>le</strong>s mésanges, <strong>le</strong> troglodyte ou encore la chou<strong>et</strong>te<br />
chevêche. Des mammifères comme <strong>le</strong> lérot, la fouine, <strong>des</strong> chauvessouris<br />
ou même <strong>le</strong> lapin <strong>et</strong> <strong>le</strong> hérisson, au pied de l’arbre peuvent<br />
y trouver refuge. Les plaies de coupe sont en eff<strong>et</strong> de plus en plus<br />
<strong>le</strong>ntes à cicatriser avec l’âge de l’arbre, ce qui induit <strong>des</strong> nécroses<br />
<strong>et</strong> la formation de cavités qui peuvent gagner <strong>le</strong> cœur de l’arbre.<br />
Le grand nombre de “chatons” (f<strong>le</strong>urs) du sau<strong>le</strong> fournit <strong>le</strong> premier<br />
pol<strong>le</strong>n de la saison, aux abeil<strong>le</strong>s.<br />
Les vieux sau<strong>le</strong>s constituent par <strong>le</strong>ur majestueuse silhou<strong>et</strong>te, un<br />
atout paysager du marais <strong>et</strong> <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong>.<br />
LA TAILLE DU SAULE TÊTARD<br />
Principes généraux :<br />
Il ne faut tail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards qu’en période de repos de la<br />
végétation (de novembre à février). Une coupe trop précoce à<br />
l’automne risque de provoquer la sortie de bourgeons qui ne<br />
résisteront pas aux premières gelées. Une coupe trop tardive au<br />
printemps, risque de perturber l’installation <strong>des</strong> hôtes du têtard<br />
(mésanges, chou<strong>et</strong>te chevêche).<br />
“N<strong>et</strong>toyer” la tête du sau<strong>le</strong> avant de couper <strong>le</strong>s branches (r<strong>et</strong>irer<br />
<strong>le</strong>s églantiers, ronces... qui pourraient gêner <strong>le</strong> bûcheron <strong>et</strong> lui<br />
faire prendre <strong>des</strong> risques inuti<strong>le</strong>s).<br />
Vérifier que <strong>le</strong> sau<strong>le</strong> n’est pas complètement creux pour éviter <strong>le</strong>s<br />
accidents.<br />
Ne pas tail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s branches trop près du tronc pour faciliter la<br />
repousse <strong>des</strong> nouvel<strong>le</strong>s branches (voir schéma).<br />
Tail<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s branches avec un léger biseau pour faciliter l’écou<strong>le</strong>ment<br />
de la pluie.<br />
Toutes <strong>le</strong>s branches sont à couper en même temps pour ne pas<br />
déséquilibrer l’arbre.<br />
Toutefois, quand cela est possib<strong>le</strong>, laisser un “tire-sève” qui évitera<br />
à l’arbre <strong>des</strong> difficultés de démarrage au printemps (<strong>le</strong> tire-sève<br />
est une p<strong>et</strong>ite branche qu’on laisse sur l’arbre pour que la sève<br />
puisse monter au printemps) (voir photo ➙).<br />
Emonder <strong>le</strong> tronc, c’est-à-dire couper toutes <strong>le</strong>s branches qui<br />
poussent du pied de l’arbre jusqu’à sa couronne <strong>et</strong> ne laisser croître<br />
que <strong>le</strong>s branches qui sont sur <strong>le</strong> plateau.<br />
Couper la branche en deux temps : cela<br />
perm<strong>et</strong> d’éviter <strong>le</strong>s arrachements<br />
d’écorce si la coupe n’est pas franche.<br />
- 1. coupe à 1 m au-<strong>des</strong>sus du plateau<br />
- 2. coupe à 5-10 cm au-<strong>des</strong>sus<br />
du plateau.<br />
Si on laisse un sau<strong>le</strong> têtard sans entr<strong>et</strong>ien<br />
pendant plus de 10 ans, <strong>le</strong> poids <strong>des</strong><br />
branches peut provoquer l’éclatement<br />
du tronc <strong>et</strong> la mort de l’arbre (ceci est<br />
surtout vrai pour de très vieux sau<strong>le</strong>s).<br />
Toutefois, une fréquence peu é<strong>le</strong>vée est<br />
intéressante (>10 ans) vis-à-vis d’objectifs<br />
conservatoires. Il est préférab<strong>le</strong> de ne pas<br />
tail<strong>le</strong>r tous <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards d’un secteur<br />
la même année, afin de respecter <strong>le</strong>s<br />
paysages <strong>et</strong> garder <strong>des</strong> lieux de repli pour<br />
la faune.<br />
Avant la tail<strong>le</strong><br />
Après la tail<strong>le</strong><br />
Niveau <strong>des</strong> coupes sur la couronne<br />
d’un têtard. Selon <strong>le</strong>s<br />
réalisateurs, c<strong>et</strong>te coupe peut<br />
être menée du ras de la couronne<br />
jusqu’à quelques centimètres<br />
(parfois 20/30 cm sans dommage<br />
apparent pour l’arbre) au-<strong>des</strong>sus<br />
de c<strong>et</strong>te dernière.<br />
Un dénombrement effectué<br />
sur la réserve du Romelaëre en<br />
1996 a permis d’identifier <strong>et</strong> de<br />
localiser quelques 1 400 sau<strong>le</strong>s<br />
têtards. Les gar<strong>des</strong> doivent ainsi<br />
en étêter près de 200 par an !<br />
C<strong>et</strong>te charge trop lourde a conduit<br />
<strong>le</strong> gestionnaire à envisager la<br />
coupe pure <strong>et</strong> simp<strong>le</strong> de certains<br />
sau<strong>le</strong>s (une parcel<strong>le</strong> de 2 500 m²<br />
en possédait 170 !) pour favoriser<br />
<strong>le</strong>s arbres remarquab<strong>le</strong>s <strong>et</strong> <strong>le</strong>s plus<br />
anciens. De plus, certains<br />
alignements denses âgés de 25 ans<br />
nécessitaient que <strong>des</strong> éclaircies<br />
soient réalisées en conservant <strong>le</strong>s<br />
plus beaux suj<strong>et</strong>s.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 29 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
30 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> Milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
VALORISATION DES PRODUITS DE TAILLE<br />
Les bûches <strong>et</strong> <strong>le</strong>s pieux<br />
Si l’objectif est de produire du bois de chauffage (de faib<strong>le</strong> qualité)<br />
ou <strong>des</strong> pieux de gros diamètre, il faudra couper <strong>le</strong>s branches à l’âge<br />
de 5 ou 10 ans.<br />
Les pieux<br />
Hauteur : 2,00 à 2,50 m<br />
Diamètre : de 6 à 15 cm<br />
Biseautés sur <strong>le</strong> bas, <strong>et</strong> plats sur <strong>le</strong> haut<br />
Toujours <strong>le</strong>s utiliser avec la <strong>partie</strong> à gros diamètre sur <strong>le</strong> haut (la<br />
<strong>partie</strong> du pieu qui reste dans l’eau ne pourrit pas).<br />
Utilisation possib<strong>le</strong> éga<strong>le</strong>ment pour <strong>le</strong>” bouturage” de perches (plançonnage*)<br />
perm<strong>et</strong>tant une reconstitution plus rapide de nouveaux têtards.<br />
Les bûches<br />
Leur laisser une longueur d’au moins 1 mètre, pour faciliter <strong>le</strong><br />
transport.<br />
Les perches “à bateau”<br />
Coupe <strong>des</strong> branches entre 3 <strong>et</strong> 5 ans, alors qu’el<strong>le</strong>s ont atteint un<br />
diamètre suffisant <strong>et</strong> une longueur assez importante pour ces<br />
utilisations.<br />
Hauteur : 3,00 à 6,00m<br />
Diamètre : de 6 à 8 cm.<br />
Les fagots<br />
Longueur : 1,50 à 2,00 m<br />
Diamètre : 50 cm<br />
Coupe droite <strong>des</strong> deux extrémités.<br />
Pour réaliser un bon fagot, il faut :<br />
- <strong>des</strong> branches de 2 ou 3 ans de 3 m de longueur ;<br />
- d’un faib<strong>le</strong> diamètre (<strong>le</strong> fagot sera ainsi de forte densité <strong>et</strong> faci<strong>le</strong><br />
à travail<strong>le</strong>r) ;<br />
- peu de déch<strong>et</strong>s dans <strong>le</strong>s branchages.<br />
Pour faciliter <strong>le</strong>” serrage” du fagot <strong>et</strong> sa stabilité, il est intéressant<br />
de placer une branche de plus fort diamètre au centre du fagot<br />
lors de sa conception.
LA PLANTATION OU LE REMPLACEMENT<br />
DES SAULES TÊTARDS<br />
Pour planter, rien de plus simp<strong>le</strong>. Il suffit de couper dans un sau<strong>le</strong><br />
blanc une branche de trois mètres en choisissant de préférence <strong>des</strong><br />
bois à l’écorce encore lisse <strong>et</strong> régulière.<br />
L’étêtage initial doit se faire à au moins 2 mètres de haut, voire à 3<br />
mètres, pour éviter que <strong>le</strong>s repousses ne soient broutées par <strong>le</strong> bétail<br />
(<strong>le</strong>s chevaux en particulier).<br />
Une simp<strong>le</strong> branche taillée <strong>et</strong> mise en terre en novembre ou en<br />
mars donnera en quatre ans, si on ne la tail<strong>le</strong> pas, un arbre de 4 à<br />
8 mètres, qui pourra être étêté <strong>et</strong> former un nouveau têtard.<br />
La confection de fagots<br />
C<strong>et</strong>te plantation, dite par plançonnage*, peut s’opérer en utilisant<br />
un enfonce-pieux (ce qui peut endommager <strong>le</strong> haut de la branche)<br />
ou en préparant un trou profond (0,8 à 1 mètre en moyenne), à la<br />
barre à mine par exemp<strong>le</strong> (voir schémas). Des branches de sau<strong>le</strong><br />
ayant un diamètre allant jusqu’à 12-15cm, peuvent ainsi être<br />
bouturées avec un bon taux de reprise en sol suffisamment humide.<br />
Lors de la conception d’une<br />
haie de sau<strong>le</strong>s têtards, ne pas<br />
hésiter à <strong>le</strong>s planter très rapprochés<br />
(2 m de distance <strong>le</strong>s uns <strong>des</strong> autres).<br />
Ainsi, lors de la croissance de la<br />
haie vous pourrez progressivement<br />
éliminer <strong>le</strong>s arbres présentant <strong>des</strong><br />
défauts de croissance. Une bonne<br />
vingtaine d’années plus tard, vous<br />
ne laisserez qu’un sau<strong>le</strong> tout <strong>le</strong>s 5 à<br />
10 mètres. Ceux-là pourront ainsi<br />
s’éta<strong>le</strong>r <strong>et</strong> croître à <strong>le</strong>ur aise.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 31 ■
Fiche 4<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
32 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ La préservation <strong>des</strong> berges <strong>et</strong> <strong>des</strong> digues<br />
Le Marais Audomarois doit son origine au travail<br />
de l’homme depuis <strong>le</strong> VII e sièc<strong>le</strong>. C’est en eff<strong>et</strong><br />
l’homme qui a creusé <strong>le</strong> réseau de rivières <strong>et</strong><br />
de watergangs pour assécher <strong>le</strong> marais <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
rendre cultivab<strong>le</strong>, qui a creusé <strong>le</strong>s étangs pour<br />
en exploiter la tourbe. Il en résulte un espace<br />
composé de terre <strong>et</strong> d’eau dont l’une <strong>des</strong><br />
caractéristiques est l’existence de ruptures<br />
souvent marquées entre <strong>le</strong>s deux éléments. La<br />
protection <strong>et</strong> la restauration de ces espaces<br />
frontières peuvent contribuer à en préserver ou<br />
en améliorer l’intérêt écologique.<br />
DÉFINITIONS PRÉALABLES<br />
La berge : bord re<strong>le</strong>vé d’un cours d’eau, d’un canal, d’un chemin<br />
ou d’un fossé (synonyme : rive).<br />
La digue : longue construction <strong>des</strong>tinée à contenir <strong>le</strong>s eaux ou<br />
séparant deux masses d’eau.<br />
Dans <strong>le</strong> cas du Marais Audomarois, on peut définir :<br />
- <strong>le</strong>s digues comme étant <strong>des</strong> pièces de terre séparant un étang en<br />
deux, ou deux étangs ou encore une construction <strong>des</strong>tinée à<br />
contenir <strong>le</strong>s eaux ;<br />
- <strong>le</strong>s berges comme étant <strong>des</strong> zones de contact entre la terre <strong>et</strong> l’eau,<br />
mais n’ayant pas vocation à séparer deux masses d’eau.<br />
Toutefois, dans <strong>le</strong> Marais Audomarois, un point est commun aux<br />
digues <strong>et</strong> aux berges : <strong>le</strong>ur origine artificiel<strong>le</strong> qui a laissé une<br />
structure abrupte partant rapidement vers <strong>le</strong>s fonds importants <strong>des</strong><br />
étangs (de 2,50 m à 4 m) ou <strong>des</strong> rivières (1,50 m à 2 m).<br />
Berge abrupte
INTÉRÊTS ÉCOLOGIQUES<br />
DU CONTACT TERRE/EAU<br />
Les secteurs <strong>le</strong>s plus riches <strong>des</strong> marais sont ceux où <strong>le</strong> contact entre<br />
la terre <strong>et</strong> l’eau est <strong>le</strong> plus grand. Les berges sont à ce titre <strong>des</strong><br />
éléments importants de la vie du marais ; la végétation aérienne y<br />
est diversifiée <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> à un grand nombre d’espèces végéta<strong>le</strong>s<br />
<strong>et</strong> anima<strong>le</strong>s de trouver <strong>des</strong> conditions de vie intéressantes.<br />
Il est donc nécessaire de maintenir <strong>des</strong> contacts terre-eau étendus<br />
<strong>et</strong> de bonne qualité.<br />
Les digues offrent un doub<strong>le</strong> contact terre-eau <strong>et</strong> jouent donc un<br />
rô<strong>le</strong> très important dans <strong>le</strong> maintien d’espèces caractéristiques. El<strong>le</strong>s<br />
créent par ail<strong>le</strong>urs <strong>des</strong> conditions de milieux particulières dans <strong>le</strong>ur<br />
environnement :<br />
- zone abritée <strong>des</strong> vents dominants ;<br />
- protection <strong>des</strong> bancs de nénuphars ;<br />
- lieu de stationnement <strong>des</strong> poissons ;<br />
- <strong>et</strong>c.<br />
La protection, la préservation <strong>et</strong> la restauration <strong>des</strong> digues <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
berges sont donc <strong>des</strong> opérations très importantes pour maintenir<br />
la richesse <strong>et</strong> la diversité <strong>des</strong> animaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> plantes.<br />
La berge idéa<strong>le</strong> dans c<strong>et</strong>te optique est une berge présentant un degré<br />
de pente très faib<strong>le</strong> fournissant ainsi <strong>des</strong> conditions de vie très<br />
diversifiées au plus grand nombre d’espèces.<br />
Le gros avantage de la berge en pente douce est de s’auto-protéger<br />
de l’action <strong>des</strong> éléments (<strong>le</strong>s vagues sous l’action du vent rongent<br />
la bordure…) <strong>et</strong> de posséder la capacité à “conquérir l’étang” : la<br />
matière organique, produite en abondance par <strong>le</strong>s végétaux,<br />
s’accumu<strong>le</strong> au pied de la berge <strong>et</strong> perm<strong>et</strong> à d’autres végétaux de<br />
s’instal<strong>le</strong>r <strong>et</strong> ainsi de suite…<br />
L’important maillage de<br />
fossés (560 km), de rivières<br />
(170 km), mais éga<strong>le</strong>ment de<br />
berges sur étangs (150 ha) sont à<br />
l’origine de l’exceptionnel<strong>le</strong><br />
biodiversité du marais. L’état<br />
général <strong>des</strong> cours d’eau est très<br />
variab<strong>le</strong> : certains viennent d’être<br />
curés, d’autres sont abandonnés<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s conditions écologiques sont<br />
presque aussi nombreuses que <strong>le</strong>s<br />
fossés <strong>et</strong> berges. La multiplicité de<br />
ces conditions crée un grand<br />
nombre de lieux de vie propices<br />
à l’épanouissement d’une flore <strong>et</strong><br />
d’une faune très nombreuses.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 33 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
34 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
Si en d’autres régions (Brenne, Dombes) ce phénomène pose un<br />
problème de gestion, car <strong>le</strong>s étangs sont peu profonds <strong>et</strong> la végétation<br />
<strong>des</strong> rives devient vite envahissante, ce n’est pas <strong>le</strong> cas du Marais<br />
Audomarois dont <strong>le</strong>s berges <strong>des</strong> étangs sont abruptes.<br />
Ce phénomène dit “d’atterrissement” est très visib<strong>le</strong> néanmoins sur<br />
<strong>le</strong>s p<strong>et</strong>its fossés qui séparent <strong>le</strong>s parcel<strong>le</strong>s maraîchères <strong>et</strong> qui ne sont<br />
plus entr<strong>et</strong>enus.<br />
L’aménagement <strong>des</strong> berges est à proscrire sur <strong>le</strong>s fossés <strong>et</strong> rivières<br />
du marais où l’eff<strong>et</strong> produit serait contraire à l’eff<strong>et</strong> désiré. Rappelons<br />
une fois encore que ces interventions ne peuvent être réalisées qu’en<br />
total respect <strong>des</strong> prescriptions rég<strong>le</strong>mentaires diverses qui<br />
s’appliquent dans <strong>le</strong> marais.<br />
CRÉATION D’UNE BERGE ATTERRIE<br />
Bascu<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> berges dans l’étang<br />
Ce bascu<strong>le</strong>ment est effectué dans <strong>le</strong> but d’obtenir une pente douce<br />
favorab<strong>le</strong> à l’implantation d’une végétation étagée (aquatique à<br />
terrestre, type roselière) riche <strong>et</strong> diversifiée.
Mode opératoire du bascu<strong>le</strong>ment.<br />
Découpe linéaire de la berge au “trouspa” ou à la bêche jusqu’à<br />
atteindre <strong>le</strong> niveau de la tourbe.<br />
Il est important de veil<strong>le</strong>r au découpage fin de la berge pour ne<br />
pas avoir à forcer trop fort sur <strong>le</strong> matériel.<br />
Continuer ensuite en j<strong>et</strong>ant <strong>le</strong>s “palées” de terre <strong>et</strong> de tourbe en<br />
bordure de l’étang, jusqu’à atterrir la berge sur 3 à 5 mètres au moins.<br />
Trouspa<br />
Création de mares linéaires en front de berge<br />
Si c<strong>et</strong>te formu<strong>le</strong> présente l’intérêt d’atterrir <strong>le</strong>s berges, el<strong>le</strong> offre en<br />
plus l’avantage de créer <strong>des</strong> secteurs de mares avec une qualité<br />
d’eau différente de cel<strong>le</strong> de l’étang. Ces structures linéaires perm<strong>et</strong>tent<br />
donc potentiel<strong>le</strong>ment l’accueil d’une flore <strong>et</strong> d’une faune plus<br />
diversifiées.<br />
Pour préserver c<strong>et</strong> aménagement dans <strong>le</strong> temps, il est nécessaire de<br />
concevoir une banqu<strong>et</strong>te de séparation d’au moins un mètre de large<br />
entre la mare <strong>et</strong> l’étang.<br />
Création d’une mare en front de berge<br />
Avant atterrissement Après atterrissement<br />
Rem<strong>et</strong>tre la tourbe à nue<br />
est une opération de “génie<br />
écologique” courante dans <strong>le</strong>s<br />
tourbières quel<strong>le</strong>s qu’el<strong>le</strong>s soient.<br />
Appelée éga<strong>le</strong>ment “étrépage”, el<strong>le</strong><br />
perm<strong>et</strong> de m<strong>et</strong>tre à jour une banque<br />
de semences endormies là depuis<br />
<strong>des</strong> décennies. C’est de c<strong>et</strong>te façon<br />
qu’à la fin <strong>des</strong> années 90 la Baldélie<br />
fausse renoncu<strong>le</strong> a été redécouverte<br />
sur <strong>le</strong> Romelaëre. Mais parmi <strong>le</strong>s<br />
eff<strong>et</strong>s pervers de l’étrépage, il y a la<br />
colonisation très rapide par <strong>le</strong>s<br />
roseaux qui étouffent la Baldélie (par<br />
exemp<strong>le</strong>) ou la colonisation par <strong>le</strong>s<br />
sau<strong>le</strong>s ou <strong>le</strong>s aulnes qui, bien<br />
souvent, ne sont pas désirés…<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 35 ■
Fiche 5<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
36 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ La stabilisation <strong>des</strong> berges<br />
Le <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong> <strong>régional</strong> a toujours préféré m<strong>et</strong>tre en place <strong>des</strong><br />
techniques végéta<strong>le</strong>s de protection <strong>des</strong> berges. En eff<strong>et</strong>, s’il est<br />
parfaitement possib<strong>le</strong> de réaliser <strong>des</strong> défenses de berges de<br />
type palplanches, en planches <strong>et</strong> pieux de chêne, qui soient<br />
intégrées au milieu “marais”, ces dernières créent une coupure<br />
du lien terre-eau <strong>et</strong> sont à réserver pour <strong>le</strong>s aménagements de<br />
pontons, d’embarcadères ou de protection <strong>des</strong> habitations.<br />
Le premier objectif de ces travaux de protection est d’éviter dans<br />
certains secteurs particulièrement sensib<strong>le</strong>s (berges de pêche, sentiers<br />
de promenade, digues…) que la dégradation <strong>des</strong> berges ne<br />
m<strong>et</strong>te en péril la morphologie <strong>des</strong> parcel<strong>le</strong>s ou <strong>le</strong> cloisonnement<br />
<strong>des</strong> étangs.
LES TECHNIQUES MISES EN PLACE<br />
Le tressage<br />
C<strong>et</strong>te technique a été testée sur <strong>le</strong>s étangs <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> de B<strong>le</strong>ndecques<br />
où el<strong>le</strong> a apporté de très bons résultats. La mise en œuvre du tressage<br />
nécessite <strong>des</strong> conditions particulières :<br />
- un pied de berge de faib<strong>le</strong> hauteur (maximum 40 cm) ;<br />
- l’ensemb<strong>le</strong> de l’ouvrage doit être réalisé avec <strong>des</strong> branches de<br />
sau<strong>le</strong> fraîchement coupées (<strong>le</strong>s branches de sau<strong>le</strong>s encore vertes<br />
développent <strong>des</strong> racines <strong>et</strong> <strong>des</strong> branches nouvel<strong>le</strong>s qui contribuent<br />
au maintien de la berge) ;<br />
- <strong>des</strong> branches sont entrelacées autour <strong>des</strong> pieux de sau<strong>le</strong>s battus<br />
(enfoncés) mécaniquement (enfonce-pieux).<br />
Le résultat du tressage est un mur végétal capab<strong>le</strong> de résister à <strong>des</strong><br />
fortes contraintes hydrauliques <strong>et</strong> physiques.<br />
Le clayonnage<br />
C’est un tressage, mais il est monté à <strong>des</strong><br />
hauteurs supérieures à 40 cm. Quand on arrive<br />
en tête de berge, il peut être nécessaire<br />
d’apporter de la terre en remblai pour<br />
augmenter <strong>le</strong> contact de la terre avec <strong>le</strong>s<br />
branches <strong>et</strong> favoriser <strong>le</strong>ur reprise.<br />
Restaurer <strong>le</strong>s berges avec <strong>des</strong><br />
techniques végéta<strong>le</strong>s n’est pas<br />
sans contraintes. En dehors de la<br />
réalisation proprement dite, il faut<br />
contenir la repousse <strong>des</strong> sau<strong>le</strong>s pour<br />
éviter d’avoir <strong>des</strong> berges boisées.<br />
C<strong>et</strong>te technique est à renouve<strong>le</strong>r<br />
complètement tous <strong>le</strong>s 3 à 5 ans sur<br />
<strong>le</strong>s berges fréquentées assidûment,<br />
ce qui n’est pas sans incidence<br />
(exemp<strong>le</strong> <strong>des</strong> berges de pêche au<br />
Romelaëre).<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 37 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
38 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
Le fascinage<br />
C’est une protection en pied de berge par la mise en place d’un ou<br />
plusieurs fagots de branches de sau<strong>le</strong> fixés sur <strong>des</strong> pieux battus<br />
mécaniquement (enfonce-pieux). C’est une technique efficace pour<br />
stabiliser :<br />
- <strong>le</strong>s berges hautes <strong>et</strong> très dégradées ;<br />
- <strong>le</strong>s berges sur <strong>le</strong>squel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s variations de niveaux d’eau sont très<br />
importantes ;<br />
- <strong>le</strong>s berges irrégulières ;<br />
- une berge nouvel<strong>le</strong>ment créée.<br />
Pour faciliter <strong>le</strong> fonctionnement correct <strong>et</strong> une plus grande rapidité<br />
de la reprise de l’ensemb<strong>le</strong> du fascinage, quelques p<strong>et</strong>its travaux<br />
supplémentaires sont possib<strong>le</strong>s :<br />
- pour “souder” <strong>le</strong>s fagots, m<strong>et</strong>tre une couche de terre entre eux,<br />
cela évitera <strong>le</strong>s creux favorisant la dégradation ;<br />
- m<strong>et</strong>tre un géotexti<strong>le</strong> végétal<br />
derrière <strong>le</strong>s fagots pour éviter<br />
“l’écou<strong>le</strong>ment” de la terre avec<br />
<strong>le</strong>s pluies ou <strong>le</strong> piétinement (à<br />
noter que <strong>le</strong> géotexti<strong>le</strong> perturbe<br />
<strong>le</strong> bouturage <strong>des</strong> fagots <strong>et</strong> ne<br />
doit pas être disposé en arrière<br />
du fagot du haut) ;<br />
- poser un “tirant” tous <strong>le</strong>s 2<br />
mètres pour stabiliser l’ouvrage<br />
<strong>et</strong> éviter sa tendance à redevenir<br />
perpendiculaire au lit de la<br />
rivière ou au fond de l’étang.
GÉNÉRALITÉS ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA RESTAURATION D’UNE BERGE<br />
- Une berge doit toujours être restaurée en période de repos de la<br />
végétation ce qui améliore la reprise <strong>des</strong> végétaux utilisés.<br />
- La berge doit être “découpée” avant sa restauration pour faciliter<br />
la mise en place de l’ouvrage.<br />
- La berge doit être réalisée avec une légère inclinaison, ce qui offre<br />
une résistance physique plus importante. Les pieux doivent ainsi<br />
être battus avec un léger ang<strong>le</strong> vers la berge perm<strong>et</strong>tant d’augmenter<br />
la résistance à la pression du sol.<br />
- Les pieux <strong>et</strong> <strong>le</strong>s fagots qui sont utilisés doivent être ceux réalisés<br />
pendant l’hiver qui précède pour augmenter <strong>le</strong>urs chances de<br />
reprise.<br />
- Les pieux doivent être “battus” mécaniquement, au bélier ou à<br />
l’enfonce-pieux, pour <strong>le</strong>ur assurer une bonne tenue <strong>et</strong> éviter qu’ils<br />
ne se fendent. L’enfoncement à la masse, souvent moins efficace<br />
en profondeur, dilacère <strong>le</strong>s pieux qui peuvent se fendre sur une<br />
hauteur conséquente, limitant <strong>le</strong>s possibilités de reprise, même<br />
après tronçonnage de la tête.<br />
- On laisse environ 10 cm de pieu au-<strong>des</strong>sus de la berge pour <strong>le</strong><br />
tronçonner après <strong>le</strong> battage ; la coupe franche perm<strong>et</strong> une meil<strong>le</strong>ure<br />
reprise du pieu (c<strong>et</strong>te coupe doit être faite en diagona<strong>le</strong> pour faciliter<br />
l’écou<strong>le</strong>ment de l’eau de pluie).<br />
- Les pieux doivent être épointés pour faciliter <strong>le</strong>ur entrée dans <strong>le</strong><br />
sol <strong>et</strong> augmenter <strong>le</strong>s surfaces de contact terre-branches <strong>et</strong> donc de<br />
faciliter <strong>le</strong>ur reprise. En milieu très tourbeux, où l’enfoncement est<br />
aisé, il peut au contraire être souhaitab<strong>le</strong> de ne pas épointer <strong>le</strong>s<br />
pieux pour <strong>le</strong>ur assurer une certaine portance <strong>et</strong> éviter un<br />
enfoncement ultérieur.<br />
- Les fagots utilisés pour <strong>le</strong> fascinage doivent être très denses <strong>et</strong><br />
fortement serrés (pour éviter <strong>le</strong>ur délitement).<br />
- Le fil de fer utilisé pour <strong>le</strong>s fagots doit être du fil de fer recuit car<br />
il se dégrade plus rapidement que <strong>le</strong>s autres.<br />
- Pour finir une berge restaurée, on ajoute en surface une couche<br />
de terre que l’on peut ensemencer avec <strong>des</strong> espèces végéta<strong>le</strong>s<br />
loca<strong>le</strong>s pour augmenter sa stabilité.<br />
- Enfin, une berge restaurée s’entr<strong>et</strong>ient ; il convient donc de lui<br />
rem<strong>et</strong>tre régulièrement un fagot, de la terre, <strong>des</strong> semences…<br />
Il faut éviter <strong>le</strong>s aménagements lourds qui coupent toute relation entre la terre <strong>et</strong> l’eau.<br />
Le confortement <strong>des</strong> berges<br />
du marais a donné lieu à<br />
l’utilisation d’une multitude de<br />
matériaux. On identifiera 3<br />
gran<strong>des</strong> catégories :<br />
<strong>le</strong>s matériaux “durab<strong>le</strong>s” <strong>et</strong><br />
traditionnels tels <strong>le</strong> sau<strong>le</strong> <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
chêne qui perm<strong>et</strong>tent <strong>des</strong><br />
fascinages “verts” ou de<br />
protection pour <strong>le</strong> chêne ;<br />
<strong>le</strong>s bois traités de récupération<br />
(type traverses SNCF) ou <strong>le</strong>s bois<br />
exotiques. Ces deux types de bois<br />
ne sont pas souhaitab<strong>le</strong>s pour <strong>le</strong><br />
relarguage constaté <strong>des</strong> produits<br />
de traitement du bois dans l’eau<br />
ou pour la <strong>des</strong>truction de la forêt<br />
tropica<strong>le</strong> ;<br />
<strong>le</strong>s matériaux de récupération de<br />
tous types (tô<strong>le</strong>s métalliques ou<br />
fibrociment, briquaillons…) qui<br />
sont complètement étrangers au<br />
site <strong>et</strong> risque de provoquer <strong>des</strong><br />
pollutions diffuses. Ceci sans<br />
par<strong>le</strong>r de l’esthétique…<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 39 ■
Fiche 6<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
40 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ Aménagement de digues<br />
L’exemp<strong>le</strong> de la réserve <strong>naturel</strong><strong>le</strong> du Romelaëre<br />
Edifiées à base de matériaux durs ou maintenues au cours de<br />
l’exploitation de la tourbe, <strong>le</strong>s digues qui bordent ou séparent certains<br />
plans d’eau du Romelaëre sont menacées de disparition depuis<br />
plusieurs décennies. Outre <strong>le</strong>ur rô<strong>le</strong> de frontière entre terre <strong>et</strong> eau,<br />
el<strong>le</strong>s abritent <strong>des</strong> vents dominants une végétation aquatique origina<strong>le</strong>,<br />
où dominent notamment <strong>le</strong>s nénuphars. Ces plantes sont el<strong>le</strong>s-mêmes<br />
ORIGINE ET INTÉRÊTS DES DIGUES<br />
Les digues <strong>des</strong> étangs du Romelaëre sont<br />
issues de trois usages :<br />
dans un premier cas, el<strong>le</strong>s ont été réalisées<br />
sur <strong>des</strong> zones impropres à l’exploitation<br />
de la tourbe. Stabilisées à base de<br />
matériaux soli<strong>des</strong> (briquaillons…), el<strong>le</strong>s<br />
étaient ensuite <strong>le</strong> support de rails qui<br />
perm<strong>et</strong>taient la circulation <strong>des</strong> wagonn<strong>et</strong>s<br />
chargés de tourbe (ceci explique pourquoi<br />
l’on trouve <strong>des</strong> fonds durs sur <strong>le</strong>s anciennes<br />
digues) ;<br />
dans un second cas, <strong>le</strong>s digues étaient<br />
uniquement laissées en place lors de<br />
l’extraction de la tourbe car <strong>le</strong> substrat était<br />
autre que tourbeux ou parce qu’el<strong>le</strong>s<br />
fournissaient un accès ;<br />
enfin, <strong>le</strong>s digues servaient aussi de limite<br />
de propriété. Dans ce cas, el<strong>le</strong>s étaient<br />
réalisées sur <strong>des</strong> zones tourbeuses. Ces<br />
digues là sont très sensib<strong>le</strong>s aux<br />
phénomènes érosifs.<br />
<strong>le</strong> siège d’une vie anima<strong>le</strong> intense <strong>et</strong> diversifiée.<br />
La protection de ces structures linéaires est peu évidente dans <strong>le</strong><br />
contexte <strong>des</strong> étangs profonds qui caractérisent <strong>le</strong> site <strong>et</strong> <strong>des</strong> solutions<br />
douces sont testées depuis plusieurs années.<br />
Carte toponymique de la Réserve Naturel<strong>le</strong><br />
Volontaire du Romelaëre
INTÉRÊTS DES DIGUES<br />
Intérêts morphologiques :<br />
L’existence <strong>des</strong> digues perm<strong>et</strong> :<br />
- <strong>le</strong> maintien de zones abritées <strong>des</strong> vents dominants qui accueil<strong>le</strong>nt<br />
<strong>le</strong> repos <strong>et</strong> <strong>le</strong> stationnement <strong>des</strong> anatidés ;<br />
- d’éviter d’avoir à terme un seul grand plan d’eau, peu favorab<strong>le</strong><br />
à la diversité de l’avifaune ;<br />
- <strong>le</strong> maintien d’un paysage d’étangs nés de l’extraction de la tourbe ;<br />
- <strong>le</strong> maintien, voire l’extension, <strong>des</strong> bancs de nénuphars <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
espèces qui <strong>le</strong>urs sont associées.<br />
Populations de nénuphars <strong>et</strong> de nymphéas notamment.<br />
Intérêts biologiques :<br />
- Préservation de groupements floristiques rares <strong>et</strong> menacés dans<br />
la Région Nord- Pas de Calais ainsi que <strong>des</strong> espèces végéta<strong>le</strong>s<br />
associées.<br />
- Maintien d’une végétation très favorab<strong>le</strong> au frai du poisson.<br />
- Préservation de populations d’oiseaux caractéristiques de ces<br />
milieux comme par exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> Butor blongios (nicheur), la<br />
Rousserol<strong>le</strong> turdoïde (nicheur occasionnel), la Locustel<strong>le</strong><br />
luscinïoide (nicheur), <strong>le</strong> Grand butor (nicheur <strong>et</strong> hivernant), <strong>le</strong><br />
Héron pourpré (de passage).<br />
- Lieux de repos ou de nidification pour <strong>le</strong>s anatidés ou encore<br />
<strong>le</strong>s grèbes.<br />
- Lieux de chasse <strong>et</strong> de reproduction pour de nombreux insectes<br />
dont <strong>le</strong>s libellu<strong>le</strong>s <strong>et</strong> certains papillons.<br />
Intérêt patrimonial :<br />
- Les digues ont toutes pour origine l’exploitation de la tourbe<br />
au XVIIIème sièc<strong>le</strong>. El<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong> fruit du travail de l’homme <strong>et</strong> sont<br />
la marque de ce travail dans <strong>le</strong> paysage de la réserve.<br />
Intérêt pour l’avenir :<br />
- La préservation <strong>des</strong> digues sera la seu<strong>le</strong> garantie pour <strong>le</strong><br />
gestionnaire de la Réserve de préserver <strong>le</strong>s milieux situés sur <strong>le</strong>s<br />
faces Est <strong>et</strong> Sud Est de la Réserve qui, si <strong>le</strong>s digues continuent à<br />
se dégrader, seront rabotées d’une manière de plus en plus<br />
alarmante.<br />
La restauration en 2007 de la<br />
digue du Gascup<strong>et</strong>te (la grande<br />
digue qui coupe en 2 l’étang du<br />
Romelaere) a permis de préserver <strong>le</strong><br />
banc de nénuphars situé à l’Est. La<br />
<strong>des</strong>truction volontaire, dans <strong>le</strong>s<br />
années 50, d’une première série de<br />
digues pour augmenter la surface<br />
d’un étang a progressivement<br />
provoqué la dégradation <strong>des</strong> autres<br />
digues. En eff<strong>et</strong>, dans <strong>le</strong> sens Nord-<br />
Ouest, il est possib<strong>le</strong> aujourd’hui de<br />
tracer une trait continu de 1 km. La<br />
disparition de la première digue<br />
orientée perpendiculairement aux<br />
vents dominants, a progressivement<br />
entraîné la disparition <strong>des</strong> suivantes.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 41 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
42 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
CAUSES PROBABLES DE DÉGRADATION<br />
La présence d’arbres <strong>et</strong> d’arbustes<br />
Les arbres <strong>et</strong> arbustes qui se développent sur <strong>le</strong>s digues ont, sans<br />
doute, une bonne part de responsabilité dans <strong>le</strong> phénomène de<br />
dégradation. On remarque en eff<strong>et</strong>, que <strong>le</strong>s digues où <strong>le</strong>s<br />
boisements sont encore présents, se creusent par <strong>le</strong> <strong>des</strong>sous. Ce<br />
phénomène peut être attribué au lacis de racines qui se forme<br />
de manière superficiel<strong>le</strong> <strong>et</strong> qui laisse <strong>le</strong> batillage dégrader la zone<br />
située au niveau du marnage provoquant, après plusieurs années,<br />
<strong>le</strong> bascu<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> digues dans l’étang (exemp<strong>le</strong> de la digue de<br />
Gascup<strong>et</strong>te). Dans <strong>le</strong> même temps, <strong>le</strong>s grands arbres <strong>et</strong> arbustes :<br />
de par <strong>le</strong>ur couverture foliaire, ils empêchent l’expression d’une<br />
végétation herbacée ou de la roselière, qui, seu<strong>le</strong>, est capab<strong>le</strong><br />
de limiter l’érosion <strong>des</strong> berges.<br />
Par l’observation d’anciennes photos aériennes ou de mission<br />
I.G.N, on s’aperçoit que toutes <strong>le</strong>s digues ont été boisées. On peut<br />
citer, à titre comparatif, la dynamique <strong>des</strong> bois tourbeux, qui<br />
implantés sur un substrat peu porteur, évoluent vers un chablis*<br />
permanent.<br />
Ce phénomène peut être constaté depuis la dégradation dans<br />
années cinquante de la digue de Vangreveninge.<br />
La dégradation provoquée par la démolition d’autres digues<br />
Il s’agit ici d’un facteur aggravant. Les vents d’Ouest (NO/O/SO)<br />
qui souff<strong>le</strong>nt 205 jours/an ont pu, suite à c<strong>et</strong>te dégradation, prendre<br />
plus de force <strong>et</strong>, par <strong>le</strong>ur action sur l’eau (naissance de vagues<br />
plusimportantes), ont favorisé la dégradation <strong>des</strong> digues situées<br />
plus à l’Est. Ce phénomène est progressif car la distance “ d’élan”<br />
(propagation de l’onde de batillage) augmente.<br />
Ce phénomène de vague<strong>le</strong>tte est nommé batillage (en comparaison<br />
à la naissance de vagues consécutives au passage d’un bateau).<br />
Le non-entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> digues<br />
Hormis un essai de fascinage réalisé dans <strong>le</strong>s années cinquante,<br />
aucune autre réalisation n’a été tentée pour parvenir à assurer la<br />
pérennité <strong>des</strong> digues. La seu<strong>le</strong> tentative a été la mise en place<br />
d’une doub<strong>le</strong> rangée de ganivel<strong>le</strong>s renforcée par <strong>des</strong> pieux <strong>et</strong><br />
remplie entre <strong>le</strong>s deux rangs de fagots de sau<strong>le</strong> <strong>et</strong> de produits de<br />
fauche de mégaphorbiaies.<br />
La présence du rat musqué<br />
Si ce rongeur n’est pas étranger au “minage” de certaines digues,<br />
il a fait l’obj<strong>et</strong> de piégeages réguliers depuis de nombreuses années<br />
<strong>et</strong> ne paraît être qu’un élément supplémentaire localisé d’une<br />
action érosive d’ordre physique.<br />
LES ESSAIS DE RESTAURATION<br />
L’étêtage <strong>et</strong> l’abattage <strong>des</strong> arbres <strong>et</strong> arbustes situés sur <strong>le</strong>s digues<br />
perm<strong>et</strong> de limiter <strong>le</strong>s risques de dégradation de ces milieux<br />
sensib<strong>le</strong>s :<br />
- élimination <strong>des</strong> arbustes qui, par <strong>le</strong>urs systèmes racinaires,<br />
favorisent <strong>le</strong> passage de l’eau sous la digue ;<br />
- élimination <strong>des</strong> grands arbustes menaçant de tomber à l’eau, <strong>et</strong><br />
qui risquent d’emporter avec eux une portion de la digue.<br />
Elimination <strong>des</strong> ronciers qui poussent au détriment <strong>des</strong> hélophytes<br />
qui, el<strong>le</strong>s, assurent une bonne tenue de la digue.<br />
Abattage d’arbres laissés dans l’eau à la perpendiculaire <strong>des</strong> vents<br />
dominants pour casser <strong>le</strong>ur action, perm<strong>et</strong>tre de limiter l’érosion<br />
sur <strong>le</strong>s digues (cas du marais d’Hénocque), <strong>et</strong> ainsi favoriser<br />
l’atterrissement <strong>des</strong> berges par accumulation <strong>des</strong> végétaux <strong>et</strong> de<br />
<strong>le</strong>urs débris (voir dépôt de foin lors <strong>des</strong> fauches).<br />
Test de restauration (réalisé sur<br />
la digue de l’Enclos) par<br />
l’implantation de ballots de<br />
pail<strong>le</strong> cimentés <strong>et</strong> d’un<br />
fascinage de branches de<br />
sau<strong>le</strong>. C<strong>et</strong>te opération, réalisée<br />
durant <strong>le</strong>s étés 1988 <strong>et</strong> 1989,<br />
a montré <strong>le</strong>s limites de<br />
réalisations de ce type ; alors<br />
que <strong>le</strong>s bouturages de laîches<br />
(carex sp.) venaient de<br />
reprendre, une tempête au<br />
printemps 1991 a tout balayé.
Restauration en cours sur l’un <strong>des</strong> principes schématisés ci-<strong>des</strong>sous :<br />
- battage de pieux de chênede 3 à 4 mètres de longueur<br />
disposés en deux rangées distantes d’environ 0,40m. Les<br />
pieux d’une même rangée sont disposés tous <strong>le</strong>s 50cm ;<br />
- l’interval<strong>le</strong> entre <strong>le</strong>s deux rangées de pieux est bourré de<br />
fagots <strong>et</strong> de produits de fauche ;<br />
- une ganivel<strong>le</strong>, composée d’échalas refendus de châtaignier<br />
reliés par <strong>des</strong> fils de fer galvanisés, est disposée de part <strong>et</strong><br />
d’autre <strong>des</strong> rangées de pieux, ou d’un seul côté face aux<br />
vents dominants.<br />
La perméabilité de ce système, estimée à 50%, assure une<br />
importante perte d’énergie <strong>des</strong> vagues tout en évitant une<br />
détérioration prématurée (généra<strong>le</strong>ment rencontrée lorsque<br />
<strong>le</strong>s obstac<strong>le</strong>s sont imperméab<strong>le</strong>s).<br />
L’aménagement de 1997 est moins coûteux en matériaux de<br />
“bourrage” par l’adjonction de planches à une hauteur où<br />
la “hou<strong>le</strong>” n’est plus sensib<strong>le</strong>.<br />
Digue de type 1 Digue de type 2<br />
Une autre alternative a été<br />
envisagée dans <strong>le</strong>s années<br />
1995. El<strong>le</strong> consistait en l’étrépage<br />
<strong>des</strong> roselières situées au Nord de<br />
la Réserve. Les produits issus de<br />
ces travaux auraient été ensachés<br />
dans <strong>des</strong> boudins longs en<br />
géotexti<strong>le</strong>, d’autres boudins en<br />
jute, pré-ensemencés de roseaux,<br />
carex ou laîche avaient complété<br />
<strong>le</strong> dispositif en surface. Ainsi par<br />
un déplacement de matière sur <strong>le</strong><br />
site, il aurait été possib<strong>le</strong> de<br />
régénérer <strong>le</strong>s roselières <strong>et</strong> de<br />
restructurer <strong>le</strong>s digues. Le coût<br />
très important de c<strong>et</strong>te opération<br />
en a empêché la réalisation.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 43 ■
Fiche 7<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
44 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ L’entr<strong>et</strong>ien “doux” <strong>des</strong> fossés<br />
L’usage <strong>des</strong> canaux a toujours exigé un entr<strong>et</strong>ien<br />
constant. L’apport <strong>des</strong> alluvions par <strong>le</strong> ruissel<strong>le</strong>ment<br />
<strong>et</strong> l’eutrophisation contribue en eff<strong>et</strong> à envaser une<br />
<strong>partie</strong> <strong>des</strong> rivières <strong>et</strong> <strong>des</strong> fossés. Autrefois, l’apport<br />
de ces éléments était considéré comme une richesse.<br />
L’hiver, <strong>le</strong>s maraîchers entr<strong>et</strong>enaient soigneusement<br />
<strong>le</strong> réseau de canaux pour bénéficier de c<strong>et</strong> engrais<br />
“<strong>naturel</strong>”.<br />
C<strong>et</strong>te pratique perm<strong>et</strong>tait de conserver tous <strong>le</strong>s fossés<br />
<strong>et</strong> rivières navigab<strong>le</strong>s. Depuis <strong>le</strong>s années 50, c<strong>et</strong><br />
entr<strong>et</strong>ien n’est plus régulièrement assuré sur<br />
l’ensemb<strong>le</strong> du marais, sauf dans <strong>le</strong>s secteurs encore<br />
cultivés.<br />
Si la grue a remplacé la baguern<strong>et</strong>te, force est de<br />
constater que <strong>le</strong> marais n’est plus c<strong>et</strong> ensemb<strong>le</strong><br />
de parcel<strong>le</strong>s de terre <strong>et</strong> d’eau impeccab<strong>le</strong>ment<br />
jardinées qui faisait la fierté de ses occupants <strong>et</strong><br />
l’émerveil<strong>le</strong>ment <strong>des</strong> visiteurs jusqu’aux années 50.<br />
ORIGINES ET INTÉRÊTS DES CHENAUX ET FOSSÉS<br />
Les fossés ou watergangs font <strong>partie</strong> intégrante du Marais Audomarois.<br />
Ils ont été creusés pour favoriser l’écou<strong>le</strong>ment de l’eau vers <strong>le</strong>s<br />
rivières, puis vers la mer <strong>et</strong> aussi pour perm<strong>et</strong>tre <strong>le</strong> passage <strong>des</strong><br />
embarcations (bâcove ou escutes). Les fossés sont par ail<strong>le</strong>urs <strong>des</strong><br />
milieux très importants pour la faune <strong>et</strong> la flore :<br />
<strong>le</strong>urs faib<strong>le</strong>s profondeurs perm<strong>et</strong>tent un réchauffement rapide <strong>des</strong><br />
eaux au printemps, d’où un intérêt pour <strong>le</strong>s amphibiens, <strong>le</strong>s insectes<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s poissons (frai important à ce niveau) ;<br />
ils multiplient <strong>le</strong>s linéaires de berge (1ml de fossé = 2 ml de<br />
berges) ;<br />
<strong>le</strong>s zones de contact terre-eau sont favorab<strong>le</strong>s à l’installation d’une<br />
flore diversifiée ;<br />
certains secteurs “isolés” du reste du marais sont favorab<strong>le</strong>s aux<br />
insectes <strong>et</strong> aux amphibiens (grenouil<strong>le</strong>s <strong>et</strong> crapauds) qui sont ainsi<br />
préservés de la voracité <strong>des</strong> poissons.
LE CURAGE TRADITIONNEL<br />
Traditionnel<strong>le</strong>ment, <strong>le</strong> curage <strong>des</strong> fossés en hiver offrait plusieurs<br />
avantages :<br />
amélioration du drainage <strong>des</strong> terres ;<br />
circulation faci<strong>le</strong> <strong>des</strong> bateaux dans <strong>le</strong>s watergangs ;<br />
apport de matières organiques aux terres ;<br />
rehaussement <strong>des</strong> terres.<br />
Dans <strong>le</strong> Marais Audomarois, <strong>le</strong> curage <strong>et</strong> l’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> fossés étaient<br />
effectués à l’aide de deux outils, encore utilisés très loca<strong>le</strong>ment de<br />
nos jours :<br />
la grèpe qui perm<strong>et</strong> de sortir <strong>des</strong> matières soli<strong>des</strong> du fond <strong>des</strong><br />
rivières <strong>et</strong> canaux (<strong>le</strong> curage à la grèpe peut se pratiquer à partir<br />
de la berge ou du bâcove) ;<br />
La baguern<strong>et</strong>te qui perm<strong>et</strong> de sortir de la matière organique <strong>des</strong><br />
fossés. Sa contenance est de 20 à 25kg, ce qui donne une idée du<br />
caractère pénib<strong>le</strong> du travail après quelques heures.<br />
Utilisation de la grèpe Utilisation de la baguern<strong>et</strong>te<br />
LES CAUSES DE DÉGRADATION DES FOSSÉS<br />
La diminution de l’exploitation agrico<strong>le</strong> du marais depuis quelques<br />
décennies se traduit par une évolution sensib<strong>le</strong> <strong>des</strong> canaux <strong>et</strong> <strong>des</strong><br />
fossés par :<br />
envasement ;<br />
accumulation de matériaux qui correspond à un atterrissement<br />
<strong>naturel</strong> par évolution progressive (ex : feuil<strong>le</strong>s de peuplier ou<br />
roseaux, sau<strong>le</strong>s…).<br />
On peut éga<strong>le</strong>ment m<strong>et</strong>tre en évidence une accélération du<br />
comb<strong>le</strong>ment par effondrement <strong>des</strong> berges sous l’eff<strong>et</strong> d’un<br />
surpiétinement <strong>des</strong> bovins ou <strong>le</strong> passage <strong>des</strong> tracteurs ou autres<br />
engins lourds à proximité immédiate <strong>des</strong> berges. En résumé, seul<br />
un entr<strong>et</strong>ien régulier <strong>des</strong> canaux <strong>et</strong> <strong>des</strong> fossés perm<strong>et</strong> d’éviter <strong>le</strong>ur<br />
comb<strong>le</strong>ment progressif. Malheureusement, dans l’état actuel, un<br />
grand nombre de fossés sont complètement comblés, ce qui ne <strong>le</strong>ur<br />
perm<strong>et</strong> plus de jouer un rô<strong>le</strong> biologique <strong>et</strong> celui de voie de<br />
communication. La restauration, quand el<strong>le</strong> s’avère possib<strong>le</strong><br />
techniquement, est indispensab<strong>le</strong> pour redonner aux fossés <strong>et</strong> canaux<br />
<strong>le</strong>urs fonctions essentiel<strong>le</strong>s, notamment sur <strong>le</strong> plan conservatoire.<br />
L’histoire<br />
<strong>des</strong> Wateringues<br />
En matière de gestion <strong>des</strong> marais,<br />
<strong>le</strong>s Wateringues sont un exemp<strong>le</strong><br />
de coopération parmi <strong>le</strong>s plus<br />
anciens. C’est en 1184 que<br />
Philippe d’Alsace crée <strong>le</strong>s<br />
Wateringues afin de coordonner<br />
<strong>et</strong> d’organiser l’ouverture <strong>et</strong> la<br />
ferm<strong>et</strong>ure du système de vannes<br />
dans <strong>le</strong>s marais de Flandre en<br />
fonction <strong>des</strong> marées.<br />
Ces groupements forcés de<br />
propriétaires (forcés car obligatoires)<br />
ont été supprimés à la<br />
Révolution Française, mais<br />
rétablis dès 1801. Ils existent<br />
toujours aujourd’hui.<br />
La 7ème section de Wateringues<br />
possède son propre matériel <strong>et</strong><br />
dispose de personnel pour assurer<br />
l’entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> 170 km de rivières<br />
classées wateringues.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 45 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
46 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
LE CURAGE ET LA GESTION DES FOSSÉS<br />
Selon <strong>le</strong>s situations, <strong>et</strong> notamment la portance du sol, <strong>le</strong> curage peut<br />
être réalisé par <strong>des</strong> moyens mécaniques (grue avec god<strong>et</strong>, <strong>et</strong>c.).<br />
Toutefois, il arrive bien souvent dans <strong>le</strong> marais que l’on ne puisse<br />
pas faire accéder une machine pour procéder à c<strong>et</strong> entr<strong>et</strong>ien (sols<br />
tourbeux, nappe d’eau superficiel<strong>le</strong>, <strong>et</strong>c.).<br />
La baguern<strong>et</strong>te<br />
Dans tous <strong>le</strong>s cas, que l’on cure à la grue ou à la baguern<strong>et</strong>te, la<br />
restauration <strong>des</strong> fossés obéit à <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s strictes qu’il faut respecter.<br />
Principe N°1 : évaluer l’intérêt patrimonial <strong>des</strong> fossés avant curage.<br />
C<strong>et</strong>te évaluation préalab<strong>le</strong> évite de m<strong>et</strong>tre en péril <strong>des</strong> stations ou<br />
<strong>des</strong> populations de plantes aquatiques (flottantes ou enracinées)<br />
qui vivent dans <strong>le</strong>s fossés <strong>et</strong> qui peuvent être protégées (ex :<br />
Stratiotes aloï<strong>des</strong>).<br />
Dans ce cas, <strong>le</strong> curage est à éviter ou ne doit être mené que<br />
<strong>partie</strong>l<strong>le</strong>ment, avec beaucoup de prudence.<br />
Toutefois, un curage “radical” peut aussi s’avérer bénéfique pour<br />
la flore à moyen terme.<br />
Utilisation de la baguern<strong>et</strong>te<br />
Principe n°2 : réaliser, lors du curage, <strong>des</strong> berges en pente douce.<br />
Une berge abrupte risque en eff<strong>et</strong> de s’effondrer rapidement, d’où<br />
un comb<strong>le</strong>ment prématuré <strong>des</strong> fossés. La création de pentes douces<br />
ou de paliers perm<strong>et</strong> éga<strong>le</strong>ment de donner <strong>des</strong> conditions de vie<br />
idéa<strong>le</strong>s à la flore <strong>et</strong> à la faune. Enfin, la végétation <strong>des</strong> berges joue<br />
un rô<strong>le</strong> important dans l’épuration <strong>des</strong> eaux.
Principe n°3 : conserver <strong>des</strong> îlots de végétation régulièrement <strong>le</strong><br />
long du fossé<br />
Ces îlots végétaux perm<strong>et</strong>tront la recolonisation <strong>des</strong> berges <strong>et</strong> <strong>le</strong><br />
maintien de la plupart <strong>des</strong> espèces végéta<strong>le</strong>s <strong>et</strong> anima<strong>le</strong>s.<br />
Attention toutefois à ne pas créer de “bouchons” qui pourraient<br />
avoir <strong>des</strong> conséquences négatives.<br />
Principe n°4 : ne réaliser qu’un curage <strong>et</strong> ne pas agrandir ou<br />
approfondir <strong>le</strong> fossé.<br />
Il faut préserver <strong>le</strong> “lit” du fossé lors <strong>des</strong> travaux de curage afin<br />
d’éviter un “rééquilibrage” ultérieur de l’ensemb<strong>le</strong> berge-voie<br />
d’eau <strong>et</strong> notamment limiter <strong>le</strong>s risques de déchaussement du pied<br />
de la berge.<br />
Principe n°5 : réga<strong>le</strong>r (éta<strong>le</strong>r) <strong>le</strong>s boues de curage<br />
L’accumulation <strong>des</strong> boues de curage en bordure du fossé n’est pas<br />
souhaitab<strong>le</strong> pour plusieurs raisons :<br />
- l’effondrement <strong>et</strong> <strong>le</strong> r<strong>et</strong>our <strong>des</strong> boues de curage dans <strong>le</strong> fossé sont<br />
favorisés (bétail, ruissel<strong>le</strong>ment) ;<br />
- pas de respect de la végétation <strong>des</strong> berges qui est la plus<br />
intéressante bien souvent (végétation amphibie ou hygrophi<strong>le</strong><br />
rare).<br />
L’absence de régalage<br />
favorise <strong>le</strong> développement<br />
de plantes nitrophi<strong>le</strong>s<br />
(orties, chardons).<br />
En résumé<br />
Les curages doivent donc, dans <strong>le</strong> respect <strong>des</strong> règ<strong>le</strong>s écologiques<br />
élémentaires :<br />
respecter la végétation ;<br />
veil<strong>le</strong>r à ne r<strong>et</strong>irer que la vase <strong>et</strong> pas <strong>le</strong> fond du fossé sous peine<br />
de déstabiliser <strong>le</strong>s berges (règ<strong>le</strong> vieux fonds /vieux bords) ;<br />
ne pas stocker <strong>le</strong>s produits de curage en tas en haut de la berge ;<br />
dans la mesure du possib<strong>le</strong>, être réalisés en plusieurs tranches<br />
étalées dans <strong>le</strong> temps (plusieurs années) ;<br />
<strong>le</strong>s travaux de curage de fossés doivent être réalisés entre <strong>le</strong><br />
15 août <strong>et</strong> la fin février.<br />
En fait, en dehors de la<br />
règ<strong>le</strong> vieux fonds/vieux bords,<br />
il n’est pas de règ<strong>le</strong> si simp<strong>le</strong> à<br />
établir :<br />
. certains fossés recè<strong>le</strong>nt un<br />
patrimoine de grande qualité<br />
biologique, mais si rien n’y est<br />
fait, celui-ci est menacé à plus<br />
ou moins court terme ;<br />
. <strong>le</strong> fait de fractionner l’action du<br />
curage entraîne un coût<br />
supérieur ;<br />
. un fossé récemment curé semb<strong>le</strong><br />
fort attractif pour <strong>le</strong>s rats<br />
musqués…<br />
Divers organismes, <strong>Parc</strong> <strong>naturel</strong><br />
<strong>régional</strong>, SMAGEA, Conservatoire<br />
Botanique, Conservatoire <strong>des</strong><br />
Sites… peuvent vous apporter <strong>des</strong><br />
conseils uti<strong>le</strong>s.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 47 ■
Fiche 8<br />
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
48 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
■ Les roselières <strong>et</strong> <strong>le</strong>s mégaphorbiaies<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies constituent <strong>des</strong> formations végéta<strong>le</strong>s<br />
de grand intérêt écologique dans <strong>le</strong> Marais Audomarois. El<strong>le</strong>s abritent<br />
en eff<strong>et</strong> d’impressionnantes densités d’organismes, oiseaux <strong>et</strong> insectes<br />
notamment, <strong>et</strong> sont parmi <strong>le</strong>s milieux <strong>le</strong>s plus diversifiés du marais<br />
sur <strong>le</strong>s plans floristique <strong>et</strong> faunistique. Ces milieux, dotés d’une<br />
dynamique évolutive importante, doivent faire l’obj<strong>et</strong> de mesures<br />
de gestion actives pour limiter <strong>le</strong>ur disparition ou <strong>le</strong>ur banalisation.<br />
DÉFINITIONS PRÉALABLES<br />
La roselière : sa hauteur moyenne approche <strong>le</strong>s deux à trois mètres<br />
mais ce milieu est surtout caractérisé par la présence de l’eau, du<br />
moins une bonne <strong>partie</strong> de l’année. Généra<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s principa<strong>le</strong>s<br />
plantes qui sont présentes dans ce milieu sont <strong>le</strong> roseau à balai<br />
(ou roseau commun), encore appelé Phragmite, <strong>et</strong> <strong>le</strong>s mass<strong>et</strong>tes<br />
(Typha sp). Mais, suivant <strong>le</strong>ur situation, roselières denses ou rivulaires,<br />
de nombreuses variations sont possib<strong>le</strong>s.<br />
La roselière est caractérisée par une faib<strong>le</strong> diversité spécifique, <strong>le</strong><br />
roseau à balai pouvant pratiquement dominer toute la formation<br />
dans certains cas (monospécificité).<br />
La mégaphorbiaie : sa hauteur moyenne varie entre 1,50 m <strong>et</strong> 2,00 m ;<br />
ses caractéristiques de végétation varient fortement suivant <strong>le</strong> substrat.<br />
On la trouve généra<strong>le</strong>ment sur <strong>des</strong> secteurs tourbeux (plantes<br />
caractéristiques : Reine <strong>des</strong> prés, Eupatoire chanvrine, Consoude officina<strong>le</strong>,<br />
Lysimaque, quelques roseaux communs…). Sa diversité (richesse)<br />
floristique est beaucoup plus importante que cel<strong>le</strong> de la roselière.<br />
La friche : formation végéta<strong>le</strong> qui succède généra<strong>le</strong>ment à l’abandon<br />
d’activités agrico<strong>le</strong>s. Le passé cultural <strong>des</strong> friches <strong>et</strong> particulièrement<br />
<strong>le</strong>ur richesse en matières azotées favorisent <strong>des</strong> espèces dites<br />
nitrophi<strong>le</strong>s (qui aiment l’azote) au premier rang <strong>des</strong>quel<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s<br />
chardons <strong>et</strong> <strong>le</strong>s orties. Sur <strong>le</strong> terrain il n’est pas toujours aisé de faire<br />
la distinction entre une friche, une mégaphorbiaie ou une roselière.<br />
Ainsi, <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s de haute qualité biologique souffrent<br />
injustement d’une mauvaise réputation. La friche se développe<br />
éga<strong>le</strong>ment sur <strong>le</strong>s boues de curage déposées en tas <strong>le</strong> long <strong>des</strong> berges<br />
<strong>et</strong> qui sont un substrat riche.<br />
LES DIFFÉRENTS MODES DE GESTION DES ROSELIÈRES<br />
Le fauchage<br />
C’est la technique la plus simp<strong>le</strong> à m<strong>et</strong>tre en œuvre. El<strong>le</strong> est pratiquée<br />
avec une rotation de 3 à 5 ans qui consiste en une fauche complète<br />
de la parcel<strong>le</strong> au niveau du sol. La première fauche doit<br />
systématiquement être réalisée “manuel<strong>le</strong>ment” pour éviter de casser<br />
<strong>le</strong> matériel sur <strong>des</strong> obstac<strong>le</strong>s (pierres, souches, pieux ou autres<br />
matériaux aff<strong>le</strong>urants <strong>et</strong> non visib<strong>le</strong>s).<br />
Toutefois, il est souhaitab<strong>le</strong> d’avoir un interval<strong>le</strong> entre deux fauches<br />
<strong>le</strong> plus long possib<strong>le</strong> (ex : 5 à 10 ans) <strong>et</strong> de laisser évoluer<br />
suffisamment la roselière. C<strong>et</strong>te situation est envisageab<strong>le</strong> lorsque<br />
<strong>le</strong> développement <strong>des</strong> ligneux* est bien jugulé. Les parcel<strong>le</strong>s<br />
n’évoluent pas au même rythme, ce qui peut faire varier par<br />
conséquence <strong>le</strong> rythme de fauche.<br />
L’exportation de la matière végéta<strong>le</strong> en botte est nécessaire pour<br />
éviter la minéralisation de la matière organique qui se fait au<br />
détriment <strong>des</strong> espèces <strong>le</strong>s plus sensib<strong>le</strong>s (voir fiche n° 9). Les bottes<br />
de roseaux peuvent aussi être utilisées pour la confection de<br />
“paillassons” de roseaux ou encore pour renforcer <strong>le</strong>s digues. Sur<br />
<strong>le</strong> Romelaëre, <strong>le</strong>s zones de roselières sont accessib<strong>le</strong>s par l’eau<br />
uniquement ce qui nécessite de déplacer tracteur, faucheuse,<br />
presse… par barge.
Date de la fauche<br />
Le choix de la date de la fauche influence <strong>le</strong> développement ultérieur<br />
<strong>des</strong> roselières <strong>et</strong> l’accueil de la faune.<br />
Si la coupe est effectuée avant la fin de la période de végétation,<br />
son impact est défavorab<strong>le</strong> à la roselière :<br />
- Coupe en mai-juin : <strong>le</strong>s rhizomes sont incapab<strong>le</strong>s de reconstituer<br />
<strong>le</strong>urs réserves. Ainsi, une à deux coupes de la végétation, pendant<br />
la période de végétation, suffisent à épuiser progressivement, en<br />
2 ou 3 ans, <strong>le</strong>s réserves du lacis de rhizomes <strong>et</strong> à éliminer en grande<br />
<strong>partie</strong> une roselière ;<br />
- Coupe à la mi-août : <strong>le</strong> fauchage<br />
conduit à une réduction de 50%<br />
du nombre de tiges poussées<br />
l’année suivant <strong>et</strong> de 30% de <strong>le</strong>ur<br />
diamètre ;<br />
- Coupe à la mi-septembre :<br />
réduction de 30% de la tail<strong>le</strong> <strong>et</strong><br />
du diamètre <strong>des</strong> roseaux ;<br />
- Coupe à la mi-octobre : l’eff<strong>et</strong><br />
négatif de la fauche est alors à<br />
peu près négligeab<strong>le</strong>.<br />
Une fauche en période printanière a <strong>des</strong> conséquences catastrophiques<br />
pour la faune. El<strong>le</strong> doit donc être évitée.<br />
Le diamètre de la tige du roseau à balai est un bon indicateur de l’état<br />
de santé <strong>et</strong> de la vitalité de ce dernier.<br />
Si la coupe est effectuée après la fin de la période de végétation<br />
(chute <strong>des</strong> feuil<strong>le</strong>s), l’impact est positif sur <strong>le</strong> développement de la<br />
roselière : <strong>le</strong> dégagement du terrain améliore l’intensité lumineuse,<br />
augmente la température moyenne au sol pour <strong>le</strong>s jeunes pousses<br />
du printemps suivant, favorise conjointement la densité <strong>des</strong> tiges<br />
au m2 <strong>et</strong> <strong>le</strong>urs caractères morphologiques.<br />
Dans <strong>le</strong> cas de la réserve du Romelaëre, la période de fauche optima<strong>le</strong><br />
est septembre. En eff<strong>et</strong>, durant ce mois il est faci<strong>le</strong> de passer un tracteur<br />
sur <strong>le</strong>s zones concernées sans dégrader <strong>le</strong> sol. Le foin de la roselière<br />
pourra sécher correctement <strong>et</strong> être pressé avant d’être évacuer vers<br />
<strong>le</strong>s digues. En cas de conditions météorologiques favorab<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s<br />
opérations de fauche peuvent être poursuivies en octobre, mais cela<br />
reste alors très aléatoire.<br />
Impact sur la faune<br />
Une fauche à partir de mi-août jusqu’à février (optimal octobre) ne<br />
détruit pas <strong>le</strong>s nids de passereaux <strong>et</strong> ceux d’espèces patrimonia<strong>le</strong>s<br />
inféodées aux roseaux comme <strong>le</strong> Butor étoilé ou <strong>le</strong> Busard <strong>des</strong> roseaux.<br />
C’est pourquoi, en cas de doute, il vaut mieux attendre mi-octobre<br />
pour faucher. La fauche par rotation (à l’échel<strong>le</strong> parcellaire ou d’un<br />
ensemb<strong>le</strong> de parcel<strong>le</strong>s) sur 3 à 5 ans perm<strong>et</strong> de préserver <strong>des</strong> secteurs<br />
refuges pour <strong>le</strong>s passereaux migrateurs mais aussi <strong>le</strong>s autres espèces<br />
anima<strong>le</strong>s tout en exportant la matière organique produite par la<br />
roselière sur plusieurs années <strong>et</strong> <strong>le</strong>s éventuels “bouqu<strong>et</strong>s de sau<strong>le</strong>s”<br />
qui ont tendance à envahir <strong>le</strong> milieu.<br />
Par contre, la fauche hiverna<strong>le</strong> diminue considérab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>s quantités<br />
d’arthropo<strong>des</strong> hivernant dans <strong>le</strong>s roselières (araignées, larves d’insectes,<br />
…) qui sont une ressource importante pour <strong>le</strong>s oiseaux.<br />
En résumé sur <strong>le</strong> fauchage<br />
Fauche conseillée de mi-octobre à février avec une rotation de<br />
3 à 5 ans. Selon la tail<strong>le</strong> de la roselière à faucher, veil<strong>le</strong>r à ne<br />
pas faucher l’ensemb<strong>le</strong> de la végétation la même année pour<br />
obtenir un maximum de diversité dans <strong>le</strong>s classes d’âge <strong>des</strong><br />
roselières. Un ca<strong>le</strong>ndrier de fauchage sur plusieurs années peut<br />
être établi. Si l’objectif est de n<strong>et</strong>toyer la parcel<strong>le</strong> tous <strong>le</strong>s ans alors<br />
la fauche devra s’effectuer avant avril de façon à empêcher<br />
l’installation <strong>des</strong> oiseaux. Ce mode opératoire évite d’intervenir<br />
au printemps ou en été <strong>et</strong> de détruire <strong>le</strong>s nids construits<br />
principa<strong>le</strong>ment entre <strong>le</strong>s tiges sèches de roseaux de l’année<br />
précédente.<br />
Les premiers travaux de<br />
restauration <strong>des</strong> roselières au<br />
Romelaere ont débuté en 1978.<br />
A c<strong>et</strong>te époque, <strong>le</strong>s travaux de<br />
fauche étaient principa<strong>le</strong>ment<br />
manuels ou accompagnés par<br />
<strong>des</strong> débroussail<strong>le</strong>uses <strong>et</strong> un<br />
motoculteur. L’implication de<br />
centaines de bénévo<strong>le</strong>s a permis<br />
progressivement de faire régresser<br />
<strong>le</strong>s aulnes <strong>et</strong> arbustes à un niveau<br />
convenab<strong>le</strong>. En 1999, <strong>le</strong> Butor<br />
étoilé, espèce emblématique <strong>des</strong><br />
roselières, y chantait de nouveau.<br />
En 2003, <strong>le</strong> <strong>Parc</strong>, grâce aux<br />
financements de ses partenaires,<br />
faisait l’acquisition d’un tracteur<br />
avec <strong>des</strong> pneus basse pression<br />
capab<strong>le</strong> de passer l’étang en<br />
bateau. En 25 ans, on est passé de<br />
la faux à la barre de coupe …<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 49 ■
- Avant-Propos p 3<br />
Présentation du <strong>Parc</strong><br />
- PARTIE 1<br />
p 4<br />
Le marais audomarois p 6<br />
Des habitats <strong>naturel</strong>s diversifiés p 8<br />
Des espèces protégées<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>et</strong> gestion <strong>des</strong> végétations<br />
p 10<br />
herbacées p 12<br />
Etangs <strong>et</strong> mares p 14<br />
Sau<strong>le</strong>s têtards p 16<br />
Les boisements p 17<br />
Les fossés<br />
- PARTIE 2<br />
p 18<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> formations ligneuses p 20<br />
Réaliser <strong>des</strong> écrans végétaux p 24<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>le</strong>s sau<strong>le</strong>s têtards p 28<br />
Préserver <strong>le</strong>s berges <strong>et</strong> <strong>le</strong>s digues p 32<br />
Stabiliser <strong>des</strong> berges p 36<br />
Aménager <strong>des</strong> digues p 40<br />
Entr<strong>et</strong>enir <strong>des</strong> fossés p 44<br />
Roselières <strong>et</strong> mégaphorbiaies p 48<br />
Faucher <strong>et</strong> débroussail<strong>le</strong>r p 54<br />
Gérer <strong>des</strong> prairies humi<strong>des</strong> par pâturage p 58<br />
Creuser une mare p 61<br />
Aménager un étang p 64<br />
Gérer l’hydraulique <strong>des</strong> casiers p 68<br />
Glossaire p 70<br />
Adresses uti<strong>le</strong>s p 71<br />
Le brûlis<br />
50 I Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong><br />
Une vieil<strong>le</strong> roselière est caractérisée par la présence de roseaux secs<br />
à faib<strong>le</strong> teneur en eau, el<strong>le</strong> peut donc être incendiée toute l’année<br />
alors qu’une roselière régulièrement entr<strong>et</strong>enue ne peut être brûlée<br />
qu’à partir de la mi-novembre. La date de l’incendie, par rapport à<br />
la période de végétation est déterminante pour l’avenir de la roselière<br />
<strong>et</strong> l’impact sur <strong>le</strong>s populations faunistiques.<br />
Rappel : la législation française interdit tout brûlage de roselière<br />
sauf rég<strong>le</strong>mentation municipa<strong>le</strong> (artic<strong>le</strong>s 134-1 <strong>et</strong> 134-2 du Code<br />
<strong>des</strong> Col<strong>le</strong>ctivités Territoria<strong>le</strong>s).<br />
Un brûlage hivernal a <strong>le</strong>s mêmes eff<strong>et</strong>s positifs qu’une coupe<br />
hiverna<strong>le</strong> sur la pousse <strong>des</strong> roseaux, l’extension <strong>et</strong> la vitalité d’une<br />
roselière. Les cendres de roseau, qui constituent d’excel<strong>le</strong>nts<br />
engrais, sont, de plus, restituées au milieu. Ces nutriments<br />
supplémentaires peuvent cependant précipiter l’eutrophisation<br />
d’un plan d’eau fermé. Bien préparé <strong>et</strong> programmé, un brûlage<br />
hivernal, très rapide, <strong>et</strong> avec un film d’eau sur la roselière, porte<br />
peu atteinte à la faune du sol <strong>et</strong> favorise la qualité du roseau.<br />
Néanmoins, si <strong>le</strong> feu est une méthode de gestion généralisée sur<br />
un ensemb<strong>le</strong> de roselière, <strong>le</strong>s populations floristiques <strong>et</strong> faunistiques<br />
ne pourront trouver toutes <strong>le</strong>s conditions de préservation ; son usage<br />
doit donc rester exceptionnel <strong>et</strong> localisé, <strong>et</strong> n’est pas recommandé.<br />
Un brûlage effectué pendant la période de végétation porte toujours<br />
atteinte aux roselières (mortalité <strong>des</strong> jeunes pousses) <strong>et</strong> éga<strong>le</strong>ment<br />
à sa faune. Il n’est d’ail<strong>le</strong>urs pas reproductib<strong>le</strong> dans la saison car<br />
tout <strong>le</strong> combustib<strong>le</strong> est détruit au premier brûlage. Si c<strong>et</strong> entr<strong>et</strong>ien<br />
est répété plusieurs années de suite, il provoque l’appauvrissement<br />
généralisé du sol. Sur substrat tourbeux sec, <strong>le</strong> feu peut détruire<br />
<strong>le</strong> sol lui-même.<br />
Le feu est un outil très diffici<strong>le</strong> à “gérer”, un coup de vent <strong>et</strong> <strong>le</strong>s<br />
flammes lèchent <strong>le</strong>s roselières sur plus de 15 m. Dans tous <strong>le</strong>s cas,<br />
la prudence est de mise pour ne pas nuire aux propriétés voisines<br />
(mise en place de coupe-feux).<br />
Les feux seront démarrés avec de la pail<strong>le</strong> ou du p<strong>et</strong>it bois sec (pas<br />
de pneus, d’hui<strong>le</strong>s, d’essence ou de matières plastiques…) pour<br />
ne pas laisser de substances de synthèse sur <strong>le</strong> site.<br />
En résumé sur <strong>le</strong> brûlis : une technique à éviter si possib<strong>le</strong><br />
Il convient d’opérer un brûlis sur la roselière en hiver (septembre<br />
à mars) exclusivement, mais en aucun cas il ne doit être<br />
systématique car il affaiblit <strong>le</strong> sol <strong>et</strong> provoque l’inverse du résultat<br />
escompté (favorisation <strong>et</strong> extension du roseau). Son impact<br />
écologique est désastreux <strong>et</strong> ce mode d’entr<strong>et</strong>ien ne doit servir<br />
qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment pour restaurer <strong>des</strong> vieil<strong>le</strong>s roselières dont<br />
l’atterrissement prononcé ou la dégradation ne <strong>le</strong>ur confère qu’un<br />
intérêt écologique faib<strong>le</strong>. Le feu est démarré avec du matériel<br />
végétal.
Le traitement chimique<br />
Le traitement chimique est utilisé pour lutter contre l’envahissement<br />
<strong>des</strong> roseaux sur certains étangs <strong>et</strong> sur certaines parcel<strong>le</strong>s. Toutefois,<br />
c<strong>et</strong>te méthode se révè<strong>le</strong> extrêmement <strong>des</strong>tructrice pour la faune <strong>et</strong><br />
la flore :<br />
pas de sé<strong>le</strong>ction dans <strong>le</strong>s espèces végéta<strong>le</strong>s traitées car <strong>le</strong>s<br />
herbici<strong>des</strong> agissent par <strong>des</strong>siccation <strong>et</strong> <strong>des</strong>truction de la<br />
chlorophyl<strong>le</strong> ;<br />
<strong>des</strong>truction <strong>des</strong> populations d’insectes par contact, par ingestion<br />
<strong>et</strong> par perte de <strong>le</strong>ur habitat ;<br />
contamination possib<strong>le</strong> du sol avec persistance <strong>des</strong> eff<strong>et</strong>s néfastes<br />
<strong>et</strong> réduction de la faune du sol (vers, insectes) ;<br />
contamination possib<strong>le</strong> <strong>des</strong> eaux <strong>des</strong> étangs <strong>et</strong> <strong>des</strong> fossés avec<br />
atteinte à la flore <strong>et</strong> à la faune aquatique, en particulier ;<br />
sé<strong>le</strong>ction d’espèces résistantes : algues filamenteuses <strong>et</strong> certaines<br />
algues vertes ;<br />
risque d’accumulation de produits toxiques dans <strong>le</strong>s tissus <strong>des</strong><br />
poissons <strong>et</strong> contamination <strong>des</strong> espèces piscivores (hérons, grèbes,<br />
…) <strong>et</strong> eff<strong>et</strong>s synergiques méconnus.<br />
Les insectes sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. De plus,<br />
<strong>le</strong> traitement chimique se révè<strong>le</strong> cher <strong>et</strong> doit être complété par une fauche<br />
<strong>et</strong> un enlèvement <strong>des</strong> roseaux morts pour éviter l’accumulation de débris<br />
végétaux qui favoriseraient <strong>le</strong>s espèces nitrophi<strong>le</strong>s (chardons <strong>et</strong> orties).<br />
Les traitements doivent éga<strong>le</strong>ment être reproduits plusieurs années de<br />
suite pour être efficaces, au moins provisoirement.<br />
En résumé sur <strong>le</strong>s traitements chimiques<br />
Jugé trop dangereux <strong>et</strong> peu efficace, <strong>le</strong> traitement chimique <strong>des</strong><br />
roselières est tota<strong>le</strong>ment déconseillé.<br />
Le Butor étoilé<br />
Surnommé « <strong>le</strong> bœuf <strong>des</strong> marais »,<br />
<strong>le</strong> Butor étoilé est devenu depuis<br />
1999 nicheur dans <strong>le</strong> marais<br />
audomarois. Ses populations sont<br />
en déclin partout dans <strong>le</strong> monde<br />
<strong>et</strong> <strong>le</strong>s effectifs nationaux sont<br />
estimés à moins de 300 coup<strong>le</strong>s.<br />
très mimétique quand il est dans<br />
la roselière, <strong>le</strong>s indices de sa<br />
présence sont essentiel<strong>le</strong>ment ses<br />
« meug<strong>le</strong>ments » (d’où son<br />
surnom !) qui peuvent s’entendre<br />
à 2 kilomètres <strong>et</strong> qui ressemb<strong>le</strong>nt<br />
à s’y méprendre au son provoqué<br />
par <strong>le</strong> souff<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> goulot d’une<br />
bouteil<strong>le</strong>.<br />
Entr<strong>et</strong>ien <strong>des</strong> milieux <strong>naturel</strong>s dans <strong>le</strong>s zones humi<strong>des</strong> I 51 ■