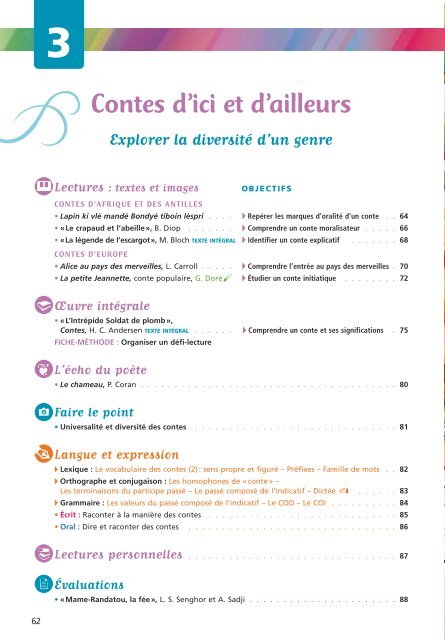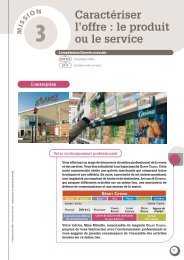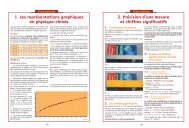Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette
Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette
Contes d'ici et d'ailleurs - Hachette
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
62<br />
3<br />
<strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
Explorer la diversité d’un genre<br />
Lectures : textes <strong>et</strong> images OBJECTIFS<br />
CONTES D’AFRIQUE ET DES ANTILLES<br />
• Lapin ki vlé mandé Bondyé tiboin lèspri . . . . Repérer les marques d’oralité d’un conte . . 64<br />
• « Le crapaud <strong>et</strong> l’abeille », B. Diop . . . . . . . Comprendre un conte moralisateur . . . . . 66<br />
• «La légende de l’escargot», M. Bloch TEXTE INTÉGRAL Identifier un conte explicatif . . . . . . . 68<br />
CONTES D’EUROPE<br />
• Alice au pays des merveilles, L. Carroll . . . . . Comprendre l’entrée au pays des merveilles . 70<br />
• La p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te, conte populaire, G. Doré Étudier un conte initiatique . . . . . . . . 72<br />
Œuvre intégrale<br />
• « L’Intrépide Soldat de plomb »,<br />
<strong>Contes</strong>, H. C. Andersen TEXTE INTÉGRAL . . . . . . Comprendre un conte <strong>et</strong> ses significations . 75<br />
FICHE-MÉTHODE : Organiser un défi-lecture<br />
L’écho du poète<br />
• Le chameau, P. Coran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80<br />
Faire le point<br />
• Universalité <strong>et</strong> diversité des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81<br />
Langue <strong>et</strong> expression<br />
Lexique : Le vocabulaire des contes (2) : sens propre <strong>et</strong> figuré – Préfixes – Famille de mots . . 82<br />
Orthographe <strong>et</strong> conjugaison : Les homophones de « conte » –<br />
Les terminaisons du participe passé – Le passé composé de l’indicatif – Dictée ✍ . . . . . . 83<br />
Grammaire : Les valeurs du passé composé de l’indicatif – Le COD – Le COI . . . . . . . . . . 84<br />
• Écrit : Raconter à la manière des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85<br />
• Oral : Dire <strong>et</strong> raconter des contes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86<br />
Lectures personnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br />
Évaluations<br />
• « Mame-Randatou, la fée », L. S. Senghor <strong>et</strong> A. Sadji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Quels personnages de contes identifiez-vous ?<br />
Quelles régions du monde sont évoquées ?<br />
De quelle manière les contes sont-ils transmis ?<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
63
1. Le lapin qui voulait demander<br />
à Dieu un peu plus d’intelligence.<br />
2. coulirous : poissons.<br />
3. Zamba : chèvre.<br />
4. coco d’Espagne : fruit<br />
du cocotier.<br />
64<br />
Pour commencer<br />
Lectures<br />
Gros plan sur un lièvre<br />
européen debout dans<br />
l’herbe haute (Lepus<br />
europeaus), droits gérés.<br />
© DEA Picture Library/<br />
G<strong>et</strong>ty Images<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
25<br />
.<br />
Citez des titres de contes.<br />
Résumez brièvement par oral un conte que vous connaissez.<br />
CONTES D’AFRIQUE ET DES ANTILLES<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
Avant de lire le texte<br />
1. Où situez-vous les Antilles ?<br />
2. Qu’est-ce que la langue créole ?<br />
Lapin ki vlé mandé<br />
Bondyé tiboin lèspri 1<br />
texte enregistré<br />
Aux Antilles, les contes étaient racontés principalement<br />
le soir à la veillée. Comme c<strong>et</strong>te pratique diminue à notre<br />
époque, des recueils de contes sont publiés pour perpétuer<br />
c<strong>et</strong>te tradition orale.<br />
«Aaah, les enfants! Vous êtes là autour de moi comme<br />
des coulirous 2 dans une boîte. Qu’est-ce que vous voulez<br />
que je vous raconte?<br />
– Aaah, eh ben, tout simplement, racontez-nous l’histoire<br />
de Compère Lapin!<br />
– Ah bon! Eh ben, bon: écoutez bien, faites bien attention.<br />
“Un jour, Compère Lapin, qui était déjà très très malin,<br />
se dit qu’il n’était pas assez malin. Alors il prit une grande échelle, <strong>et</strong><br />
il monta klik klik klik klik... Il alla trouver Dieu <strong>et</strong> il lui dit:<br />
– Mon Dieu, vous m’avez mis sur la terre, mais je suis plus bête que<br />
tout; j’aimerais que vous me donniez un peu d’intelligence.<br />
Dieu lui répondit :<br />
– Un p<strong>et</strong>it bonhomme comme toi! Tellement savant qui trompe tout<br />
le monde...<br />
– Eh bien, mon Dieu, si vous voulez bien me donner un peu d’intelligence<br />
quand même!<br />
Alors Dieu dit à Compère Lapin :<br />
– Bon : r<strong>et</strong>ourne sur la terre, <strong>et</strong> dans huit jours, tu me rapporteras : une<br />
dent de Zamba 3 , des poils de cochon marron, du lait de vache sauvage,<br />
une crotte de tigre, tout ça dans un p<strong>et</strong>it coco d’Espagne 4 où tu as déjà<br />
fait entrer une couleuvre <strong>et</strong> ses sept p<strong>et</strong>its... Bon, vas-y <strong>et</strong> reviens dans<br />
huit jours, hein?<br />
– Oui, mon Dieu.<br />
Alors Compère Lapin redescendit tout de suite sur la terre, <strong>et</strong> quand<br />
il arriva, il tomba devant un grand cocotier : un cocotier espagnol <strong>et</strong><br />
qui était chargé de singes. Il dit :
◗ Les dialogues dans le conte<br />
.<br />
.<br />
.<br />
30<br />
.<br />
– Que vous êtes laids! Qu’est ce que vous sentez!<br />
Alors les singes n’étaient pas contents! Ils commencèrent à prendre<br />
des cocos dans l’arbre <strong>et</strong> ils les envoyèrent sur Lapin : bim, bim, bim,<br />
bim, bim, bim... Lapin, qui n’attendait que ça, ramassa un coco;<br />
il le prit, lui coupa la tête <strong>et</strong> il partit.”» […]<br />
Lapin ki vlé mandé Bondyé tiboin lèspri, conte créole (conte de la Guadeloupe raconté par J.H.M.).<br />
Repérer les marques d’oralité d’un conte<br />
1. Dans les lignes 1 à 3 : a. qui parle? Quel est son rôle?<br />
b. À qui s’adresse-t-il ? Que demande-t-il à son auditoire<br />
?<br />
2. Qui est le héros du conte ? Que demande-t-il à<br />
Dieu ? Citez le texte à l’appui de votre réponse.<br />
3. Quelles épreuves Dieu lui impose-t-il ?<br />
◗ Les marques d’oralité<br />
4. « klik klik klik klik » (l. 9) : a. à quoi ces mots serventils?<br />
b. On nomme ce type de mots des «onomatopées» :<br />
relevez-en un autre exemple dans le texte.<br />
Expression orale<br />
5. a.Relevez des mots qui appartiennent à la langue<br />
orale <strong>et</strong> non à la langue écrite.<br />
b. « qui était déjà très très malin » (l. 7) : quel est le<br />
niveau de langue de c<strong>et</strong>te tournure ?<br />
c. Relevez d’autres tournures qui appartiennent au<br />
même niveau de langue.<br />
Gardons une trace écrite<br />
À quoi repère-t-on que ce conte créole appartient<br />
à la tradition orale ?<br />
Choisissez l’une des épreuves imposées à Compère Lapin <strong>et</strong> racontez-la<br />
oralement. Vous veillerez à souligner les marques d’oralité pour garder<br />
l’attention de l’auditoire <strong>et</strong> rendre le récit vivant.<br />
➜ Les niveaux de langue – p. 356<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
65
Lectures<br />
Birago Diop<br />
(1906-1989)<br />
C<strong>et</strong> écrivain sénégalais d’expression<br />
française rendit hommage<br />
à la tradition orale de son pays<br />
en publiant des contes, notamment<br />
ses <strong>Contes</strong> d’Amadou<br />
Koumba.<br />
1. m<strong>et</strong>s : plat.<br />
2. calebasse : fruit d’un<br />
arbre tropical qui, vidé,<br />
sert de récipient.<br />
3. marigot : bras de rivière<br />
ou lieu bas inondable.<br />
4. récurée : n<strong>et</strong>toyée.<br />
5. canari : en Afrique, aux<br />
Antilles, récipient en terre<br />
cuite pour l’eau potable.<br />
66<br />
texte enregistré<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
25<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
30<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
35<br />
.<br />
Avant de lire le texte<br />
On appelle « griot » un poète <strong>et</strong> musicien ambulant<br />
en Afrique noire. Lisez la biographie de Birago Diop :<br />
Les <strong>Contes</strong> d’Amadou Koumba relèvent-ils de<br />
la tradition orale ou écrite ?<br />
Le crapaud <strong>et</strong> l’abeille<br />
Griot<br />
sénégalais joueur de Kora,<br />
harpe à 21 cordes. © Michel<br />
Renaudeau/HOA-QUI/Eyedea<br />
M’ Bott-le-Crapaud saluait chacun <strong>et</strong> conversait avec certains.<br />
C’est ainsi qu’un jour, en le quittant, Yambe-l’Abeille lui dit :<br />
«M’ Bott, viens donc un jour jusqu’à la maison partager mon repas.»<br />
M’ Bott ne se fit pas répéter deux fois l’invitation, car il avait entendu<br />
dire que Yambe-l’Abeille savait préparer un m<strong>et</strong>s 1 qu’aucun être au monde<br />
ne savait faire. […] Le lendemain donc, M’ Bott-le-Crapaud s’en alla,<br />
sautillant, plein de joie <strong>et</strong> d’appétit, vers la maison de Yambe-l’Abeille.<br />
«Yambe, sa Yaram Djam? (Abeille es-tu en paix?) salua-t-il.<br />
– Djama ma rek (En paix seulement) lui fut-il répondu.<br />
– Me voici! se présenta poliment M’ Bott.<br />
– Approche», invita Yambe-l’Abeille.<br />
M’ Bott-le-Crapaud s’approcha de la calebasse 2 pleine de miel, sur<br />
le rebord de laquelle il appuya l’index de la main gauche, comme doit<br />
le faire tout enfant bien élevé. Il avança la main droite vers le repas<br />
qui paraissait si bon, mais Yambe-l’Abeille l’arrêta :<br />
«Oh! mais mon ami, tu ne peux vraiment pas manger avec une main<br />
aussi sale! Va donc te la laver!»<br />
M’ Bott-le-Crapaud s’en fut allègrement vers le marigot 3 , top-clop!<br />
top-clop! puis revint aussi allègrement, clop-top! top-clop! <strong>et</strong> s’assit<br />
près de la calebasse :<br />
«Mais elle est encore plus sale que tout à l’heure, ta main!»<br />
M’ Bott-le-Crapaud s’en r<strong>et</strong>ourna sur le sentier du marigot, un peu<br />
moins allègrement, clop-top! puis revint chez Yambe-l’Abeille, qui lui<br />
refit la même réflexion.<br />
Il repartit au marigot d’une allure beaucoup moins vive, clop-top!…<br />
top!… clop-top! Quand il revint de son septième voyage aller <strong>et</strong><br />
r<strong>et</strong>our, les mains toujours aussi crottées par la boue du sentier <strong>et</strong> suant<br />
au chaud soleil, la calebasse était vide <strong>et</strong> récurée 4 . M’ Bott-le-Crapaud<br />
comprit enfin que Yambe-l’Abeille s’était moquée de lui.<br />
Il n’en prit pas moins poliment congé de son hôte :<br />
«Passe la journée en paix, Yambe,» fit-il en rejoignant l’ombre de son<br />
vieux canari 5 .<br />
Des jours passèrent. M’ Bott-le-Crapaud, aux leçons des grands <strong>et</strong><br />
des vieux, avait appris beaucoup de choses; <strong>et</strong>, sur le sentier du marigot,<br />
il saluait toujours chacun <strong>et</strong> conversait toujours avec certains, dont<br />
Yambe-l’Abeille, à qui il dit enfin un jour :
◗ Un conte oral <strong>et</strong> merveilleux<br />
1. Qui sont les personnages du conte ?<br />
.<br />
.<br />
.<br />
40<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
45<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
50<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
55<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
60<br />
« Yambe, viens donc un jour jusqu’à la maison, nous mangerons<br />
ensemble.»<br />
Yambe-l’Abeille accepta l’invitation. Le surlendemain, elle s’en alla<br />
vers la demeure de M’ Bott-le-Crapaud, gentil <strong>et</strong> vraiment sans<br />
rancune, se disait-elle. Sur le seuil elle se posa <strong>et</strong> salua :<br />
«M’ Bott, as-tu la paix?<br />
– La paix seulement! répondit M’ Bott-le-Crapaud, qui était accroupi<br />
devant une calebasse pleine de bonnes choses. Entre donc, mon amie!»<br />
Yambe-l’Abeille entra, remplissant l’air du bourdonnement de ses ailes,<br />
vrrou! vrrou! ou!…<br />
«Ah! non! Ah! non! fit M’ Bott-le-Crapaud, Yambe mon<br />
amie, je ne peux pas manger en musique, laisse, je t’en supplie,<br />
ton tam-tam dehors.»<br />
Yambe-l’Abeille sortit, puis rentra, faisant encore plus de bruit,<br />
vrrou!… vrrou!… ou! vrrrou!…<br />
«Mais, je t’ai dit de laisser ce tam-tam dehors!» s’indigna M’ Bott-le-<br />
Crapaud.<br />
Yambe-l’Abeille ressortit <strong>et</strong> rentra, faisant toujours du bruit, vrrrou !…<br />
vrrrou !… Quand elle rentra pour la septième fois, remplissant toujours<br />
le vieux canari du bourdonnement de ses ailes, M’ Bott-le-Crapaud<br />
avait fini de manger, il avait même lavé la calebasse.<br />
Yambe-l’Abeille s’en r<strong>et</strong>ourna chez elle jouant toujours du tam-tam.<br />
Et depuis ce temps-là, elle ne répond plus au salut de M’ Bott-le-<br />
Crapaud.<br />
Birago Diop, «Les mauvaises compagnies», Les <strong>Contes</strong> d’Amadou Koumba, © Présence africaine, 1961.<br />
Comprendre un conte moralisateur<br />
2. Quels éléments du conte relèvent du merveilleux ?<br />
3. a.Sur quel continent situez-vous ce conte ?<br />
b. Relevez les mots <strong>et</strong> expressions qui vous ont permis<br />
de repérer la situation géographique.<br />
4. «top-clop! top-clop» : a. à quoi ces mots servent-ils?<br />
b. Comment nomme-t-on ce type de mots ?<br />
c. Relevez-en d’autres exemples dans le conte.<br />
5. « dit » (l. 2), « fit » (l. 4), « s’en alla » (l. 6) : a. à quel<br />
temps de l’indicatif ces verbes sont-ils conjugués ?<br />
b. Relevez au moins trois autres verbes conjugués<br />
au même temps. c. Ces verbes se situent-ils dans des<br />
passages de récit ou de dialogue ?<br />
6. a. Quels signes de ponctuation perm<strong>et</strong>tent d’identifier<br />
un dialogue dans ce récit ?<br />
b. Quelle est la part du dialogue dans ce conte ?<br />
➜ La ponctuation – p. 262<br />
◗ Un conte moralisateur<br />
7. a.Quels sont les deux grands épisodes de c<strong>et</strong>te<br />
histoire ? Donnez-leur un titre.<br />
b. Relevez les points communs à ces deux épisodes.<br />
8. Pourquoi, selon vous, Yambe-l’Abeille invite-t-elle<br />
le crapaud ? Expliquez.<br />
9. Le crapaud tire-t-il la leçon de l’aventure? Justifiez.<br />
10. À qui la sympathie du conteur va-t-elle ? Citez<br />
plusieurs passages du texte à l’appui de votre<br />
réponse.<br />
11. Quelle est la morale de ce conte ? Exprimez-la<br />
avec vos propres mots.<br />
Gardons une trace écrite<br />
En vous appuyant sur l’étude de ce conte, rédigez<br />
la définition la plus complète possible d’un conte<br />
moralisateur.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
67
Lectures<br />
TEXTE INTÉGRAL<br />
Avant de lire le texte<br />
À vos dictionnaires!<br />
Cherchez dans un dictionnaire<br />
le sens des mots : « baudrier »,<br />
« fétiche », « palabre ».<br />
Muriel<br />
Bloch<br />
1. s’il l’eût voulu :<br />
s’il l’avait voulu.<br />
68<br />
Liz Wright, Fête dans<br />
la jungle, 1993<br />
© Collection particulière/<br />
The Bridgeman Art Library/<br />
G<strong>et</strong>ty Images/DR<br />
C<strong>et</strong>te conteuse française parcourt<br />
la France <strong>et</strong> d’autres pays,<br />
pour conter aux p<strong>et</strong>its <strong>et</strong> aux<br />
grands, seule ou en musique.<br />
Elle est l’auteur de plusieurs<br />
ouvrages <strong>et</strong> livres-cd de contes.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
La légende de l’escargot<br />
L’Éléphant, chef des animaux, envoie un jour ses messagers donner<br />
partout l’ordre de se rendre immédiatement près de lui, <strong>et</strong> cela sous<br />
peine de guerre immédiate.<br />
Les animaux, ayant reçu le message, se m<strong>et</strong>tent aussitôt en demeure<br />
d’obéir. Chacun fait son paqu<strong>et</strong>, prépare ses provisions, prend sac,<br />
baudrier, fétiches <strong>et</strong> fusil, <strong>et</strong> se m<strong>et</strong> en route.<br />
Bientôt, les voilà tous devant l’Éléphant, les uns arrivant un peu<br />
plus tôt, les autres, un peu plus tard.<br />
L’Éléphant appelle chacun par son nom avant de commencer<br />
le palabre, <strong>et</strong> tous répondent : «Je suis ici.» Tous, non, car lorsque<br />
l’Éléphant appelle : «Escargot», personne ne répond.<br />
Par trois fois, l’Escargot ne dit rien; il n’était pas là.<br />
Le palabre commence sans lui, <strong>et</strong> l’Éléphant préside la réunion.<br />
Tout était réglé <strong>et</strong> sur le point d’être terminé, lorsque, au bout de<br />
la cour du village, les animaux qui étaient au fond se m<strong>et</strong>tent à crier :<br />
«Le voilà, l’Escargot, le voilà!»<br />
Le pauvre animal, tout honteux, s’approche en tremblant, car<br />
il redoutait fort la colère de l’Éléphant, <strong>et</strong> même s’il l’eût voulu 1 ,<br />
ne se sentait pas de force à lutter avec lui.
Escargot.<br />
© Kenn<strong>et</strong>h lilly Dorling<br />
Kindersley/G<strong>et</strong>ty images<br />
20<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
25<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
30<br />
◗ Un récit merveilleux<br />
1. Nommez les personnages du conte.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
2. À quel temps le récit est-il rédigé ? Citez des verbes<br />
à l’appui de votre réponse.<br />
3. Racontez oralement le conte en respectant les<br />
étapes du récit.<br />
4. Quels éléments du conte relèvent du merveilleux ?<br />
◗ La localisation <strong>et</strong> la datation<br />
5. a.Sur quel continent situez-vous ce conte ?<br />
b. Relevez des mots <strong>et</strong> expressions qui vous ont<br />
permis de repérer la situation géographique.<br />
6. Le conte comporte-t-il des éléments perm<strong>et</strong>tant de<br />
dater l’histoire ? Justifiez à partir du texte.<br />
◗ La signification du conte<br />
7. Relisez la première phrase du dernier paragraphe :<br />
a. À quel temps les verbes sont-ils conjugués ?<br />
«D’où viens-tu? lui dit l’Éléphant.<br />
– De mon village.<br />
– Et pourquoi viens-tu si tard? N’as-tu pas reçu mon messager?<br />
– Je l’ai reçu, père Éléphant, <strong>et</strong> me suis mis en route aussitôt, mais<br />
le chemin est long <strong>et</strong> tu ne m’as donné qu’un pied pour marcher;<br />
souvent les branches des arbres m’entraient dans les yeux; n’y voyant<br />
plus, cela r<strong>et</strong>ardait beaucoup ma marche; puis encore je redoute<br />
beaucoup le froid <strong>et</strong> la pluie me donne la fièvre. Alors, pour arriver ici,<br />
intact <strong>et</strong> en bonne santé, je me suis décidé à r<strong>et</strong>ourner en arrière <strong>et</strong><br />
à transporter ma case avec moi: voilà ce qui m’a r<strong>et</strong>ardé.»<br />
Le père Éléphant rit beaucoup de la défense de l’Escargot; il en rit<br />
beaucoup <strong>et</strong> longtemps. Puis après cela:<br />
«Tu as bien parlé, Escargot, tu as bien parlé, désormais tu auras les<br />
yeux au bout des cornes <strong>et</strong> ainsi les branches des arbres ne pourront<br />
plus te frapper, car r<strong>et</strong>irer tes yeux en arrière ou les porter en avant,<br />
35 ce sera ton affaire; mais aussi, pour te punir d’avoir manqué<br />
. le palabre où je t’avais convoqué, à l’avenir tu porteras<br />
. toujours ta maison sur ton dos. Va, le palabre est fini.»<br />
. Et c’est depuis ce temps-là que l’Escargot porte ses yeux<br />
. au bout de ses cornes mobiles, <strong>et</strong> que partout aussi il porte<br />
40 sa maison avec lui. Après tout, ce n’est pas une grande<br />
. punition; de c<strong>et</strong>te façon, il n’a pas à travailler pour se<br />
. construire une case.<br />
Identifier un conte explicatif<br />
Muriel Bloch, 365 contes des pourquoi <strong>et</strong> des comment,<br />
© Éditions Gallimard Jeunesse, 2002.<br />
b. Quelle est la valeur de ce temps ?<br />
8. a.Quelles sont les deux particularités physiques de<br />
l’escargot évoquées dans le conte ?<br />
b. Le récit de leur origine appartient-il au monde du<br />
merveilleux ou à celui de la science ?<br />
9. Diriez-vous de ce conte (choisissez la meilleure<br />
réponse) :<br />
– qu’il prouve qu’il y a des chefs autoritaires ?<br />
– qu’il raconte l’histoire d’un escargot malchanceux ?<br />
– qu’il explique des caractéristiques anatomiques de<br />
l’escargot ?<br />
Justifiez votre réponse à l’aide du texte.<br />
➜ Les valeurs du présent de l’indicatif – p. 322<br />
Gardons une trace écrite<br />
En vous appuyant sur l’étude de ce conte, rédigez<br />
la définition la plus complète possible d’un conte<br />
explicatif.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
69
Lectures<br />
© Selva/Leemage<br />
Lewis<br />
Carroll<br />
(1832-1898)<br />
Sous le pseudonyme de Lewis<br />
Carroll, le pasteur mathématicien<br />
anglais Charles Lutwidge<br />
Dodgson a publié le conte<br />
Alice au pays des merveilles en<br />
1865. Trois mois plus tôt, lors<br />
d’une promenade en barque<br />
sur la Tamise, il avait raconté<br />
à trois fill<strong>et</strong>tes amies, âgées de<br />
huit à treize ans, c<strong>et</strong>te histoire<br />
qu’il venait d’inventer.<br />
Margar<strong>et</strong> Winifred Tarrant,<br />
illustration Alice au pays<br />
des merveilles, 1916.<br />
© Blue lantern Studio/Corbis/DR<br />
70<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
CONTES D’EUROPE<br />
Avant de lire le texte<br />
« Ce gâteau est absolument merveilleux. La bagu<strong>et</strong>te magique est un obj<strong>et</strong><br />
merveilleux. »<br />
a. Quel est le sens de l’adjectif « merveilleux » dans chacune des phrases ?<br />
b. Quel est le sens qui convient à un conte de fées ?<br />
Rencontre<br />
avec le Lapin Blanc<br />
Alice commençait à se sentir très lasse 1 de rester à côté de sa sœur,<br />
sur le talus 2 , <strong>et</strong> de n’avoir rien à faire : une fois ou deux, elle avait j<strong>et</strong>é<br />
un coup d’œil sur le livre que sa sœur lisait : mais il ne contenait<br />
ni images ni conversations, «<strong>et</strong>, se disait Alice, à quoi peut bien servir<br />
un livre où il n’y a ni images ni conversations?»<br />
Elle se demandait (dans la mesure où elle était capable de réfléchir,<br />
car elle se sentait tout endormie <strong>et</strong> toute stupide à cause de la chaleur)<br />
si le plaisir de tresser une guirlande de pâquer<strong>et</strong>tes vaudrait la peine<br />
de se lever <strong>et</strong> d’aller cueillir les pâquer<strong>et</strong>tes, lorsque, brusquement,<br />
un Lapin Blanc aux yeux roses passa en courant à côté d’elle.<br />
Ceci n’avait rien de particulièrement remarquable; <strong>et</strong> Alice ne trouva<br />
pas non plus tellement bizarre d’entendre le Lapin dire à mi-voix:<br />
«Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Je vais être en r<strong>et</strong>ard!» (Lorsqu’elle<br />
y réfléchit par la suite, il lui vint à l’esprit qu’elle aurait dû s’en étonner,<br />
mais, sur le moment, cela lui sembla tout naturel.) Cependant, quand<br />
le Lapin tira bel <strong>et</strong> bien une montre de la poche de son gil<strong>et</strong>, regarda<br />
l’heure <strong>et</strong> se mit à courir de plus belle, Alice se dressa d’un bond, car,<br />
tout à coup, l’idée lui était venue qu’elle n’avait jamais vu de lapin<br />
pourvu d’une poche de gil<strong>et</strong>, ou d’une montre à tirer de c<strong>et</strong>te poche.<br />
Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite,<br />
<strong>et</strong> eut la chance d’arriver juste à temps pour le voir s’enfoncer comme<br />
une flèche dans un énorme terrier placé sous la haie.<br />
Un instant plus tard elle y pénétrait à son tour, sans se demander<br />
une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir.<br />
Lewis Carroll, Les Aventures d’Alice au pays des merveilles, traduit par Jacques Papy © Pauvert,<br />
département de la Librairie Arthème Fayard 1961, 2000 pour la traduction française.<br />
1. lasse : fatiguée.<br />
2. talus : p<strong>et</strong>ite montée de terre.
Gwynedd M. Hudson,<br />
illustration pour Alice au pays des merveilles,<br />
Hodder & Stoughton, 1922. The British library,<br />
Londres. Reproduction avec la permission d’Hodder<br />
and Stoughton, une division d’Hach<strong>et</strong>te children’s<br />
books © Heritage Images/Leemage<br />
◗ Un conte merveilleux<br />
Comprendre l’entrée au pays des merveilles<br />
1. Le lecteur sait-il précisément où <strong>et</strong> quand l’action<br />
se situe ?<br />
2. a.Qui est l’héroïne de l’histoire ? A-t-on des informations<br />
précises sur elle ?<br />
b. Appartient-elle au monde de la réalité ou à celui<br />
du merveilleux ?<br />
3. a.Dans quel état se trouve-t-elle dans le deuxième<br />
paragraphe ?<br />
b. En quoi c<strong>et</strong> état favorise-t-il l’apparition du merveilleux<br />
?<br />
4. a.Qui rencontre-t-elle ?<br />
b. Ce nouveau personnage appartient-il au monde de<br />
la réalité ou à celui du merveilleux ? Justifiez.<br />
5. Quelle est la première réaction d’Alice lorsqu’elle<br />
rencontre le lapin ? Justifiez.<br />
◗ Un conte de sagesse<br />
6. Relevez dans le troisième paragraphe une expression<br />
qui dévoile le caractère d’Alice.<br />
7. Alice vous paraît-elle une p<strong>et</strong>ite fille raisonnable ?<br />
Expliquez.<br />
◗ Lire l’image<br />
8. Expression orale<br />
Décrivez oralement le lapin de l’illustration. C<strong>et</strong>te<br />
illustration correspond-elle à l’image que vous vous<br />
êtes faite du lapin en lisant le texte ? Expliquez.<br />
Gardons une trace écrite<br />
❯ Grâce à quoi glisse-t-on dans le merveilleux dans<br />
ce début de conte ?<br />
❯ D’après ce début de conte, quelle image vous<br />
faites-vous du « pays des merveilles » que va découvrir<br />
Alice ?<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
71
Lectures<br />
1. à l’orée : à la lisière,<br />
au bord.<br />
2. s’amenuisait :<br />
se rétrécissait.<br />
3. demeura perplexe :<br />
hésita.<br />
4. épin<strong>et</strong>tes : plantes<br />
à épines.<br />
5. sente : sentier.<br />
6. acérées : coupantes.<br />
7. on eût dit : on aurait dit.<br />
Karl Offterdinger,<br />
Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge,<br />
lithographie 1880.<br />
© Collection Kharbine-Tapabor<br />
72<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
Avant de lire le texte<br />
1. Qu’est-ce qui caractérise le loup dans des contes que vous connaissez ?<br />
2. À vos dictionnaires! a. Cherchez le sens du mot « quête »<br />
qui convient pour un conte.<br />
b. Que signifie une initiation ?<br />
La p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te<br />
Autrefois vivait près de Tours une charmante fill<strong>et</strong>te que tout<br />
le monde adorait. Orpheline, elle était élevée par sa tante dans une<br />
maisonn<strong>et</strong>te à l’orée1 d’un bois. Or, un jour, elle entendit dire que<br />
sa grand-mère était malade <strong>et</strong> la nouvelle la remplit d’inquiétude.<br />
N’écoutant que son bon cœur, elle se mit en chemin dès le lendemain<br />
pour aller lui rendre visite, de l’autre côté de la forêt.<br />
Elle marcha longtemps. Le sentier s’amenuisait2 <strong>et</strong> ne fut bientôt<br />
plus qu’une vague trace qui serpentait entre les arbres. Et quand elle<br />
arriva au plus profond de la forêt, elle ne vit plus rien du tout <strong>et</strong><br />
demeura perplexe3 . De quel côté se tourner? Elle hésitait.<br />
Un loup passait par là, attiré sans doute en ces lieux par l’odeur de<br />
chair fraîche. La fill<strong>et</strong>te, qui ne se doutait pas qu’il ne faut jamais<br />
s’adresser à un loup, lui demanda sa route. Elle expliqua qu’elle allait voir<br />
sa grand-mère malade <strong>et</strong> que, désorientée, elle avait fini par se perdre.<br />
«Suis-moi, dit le loup, je vais t’indiquer la bonne route.»<br />
Il la conduisit, à travers les arbres, à l’embranchement de deux<br />
chemins. Celui de droite était couvert d’aiguilles de pin; à gauche,<br />
il était encombré d’épines <strong>et</strong> de ronces. Jeann<strong>et</strong>te, qui ignorait qu’on<br />
ne doit pas faire confiance à un loup, lui demanda :<br />
«Lequel des deux dois-je prendre ?<br />
– Le gauche, celui des épin<strong>et</strong>tes4 , lui répondit le loup sans hésiter, c’est<br />
le meilleur <strong>et</strong> le plus court. Tu seras vite arrivée.»<br />
La fill<strong>et</strong>te remercia son guide <strong>et</strong> s’engagea dans<br />
la sente5 hérissée de ronces. Mais plus elle avançait,<br />
plus le chemin devenait mauvais: les pierres roulaient<br />
sous ses sabots, des branches traîtresses <strong>et</strong> des épines<br />
acérées6 accrochaient ses jupes au passage. On eût<br />
dit7 .<br />
.<br />
25<br />
.<br />
.<br />
. que la forêt tout entière voulait l’empêcher<br />
. d’arriver. […]<br />
Pendant ce temps, le loup arrive rapidement chez<br />
la grand-mère, la tue, remplit une cruche de son sang<br />
<strong>et</strong> la dévore. Puis il se couche dans le lit de la grand-mère<br />
<strong>et</strong> reçoit la fill<strong>et</strong>te dans la pièce sombre.<br />
30 Comme la grand-mère avait apaisé le plus gros<br />
. de son appétit, il décida de garder l’enfant pour<br />
. son p<strong>et</strong>it déjeuner.
Gustave Doré,<br />
Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge,<br />
gravure. © Collection<br />
Kharbine-Tapabor<br />
8. en minaudant : en faisant<br />
des manières.<br />
9. huche : meuble où<br />
on m<strong>et</strong>tait le pain.<br />
10. fricassée : plat de viande<br />
coupée en morceaux, cuite<br />
dans son jus, à la poêle ou<br />
à la casserole.<br />
11. s’enquit : demanda.<br />
50<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
55<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
60<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
65<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
70<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
75<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
45<br />
«Mais je manque à tous mes devoirs, reprit-il<br />
en minaudant 8 . As-tu faim, ma chérie?<br />
35<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
– Oh oui, grand-mère! Le chemin était si<br />
mauvais, j’ai marché si longtemps!<br />
– Il y a du sang dans la cruche sur<br />
la huche 9 , je le gardais pour faire du<br />
boudin. Tu peux te faire une fricassée 10 ,<br />
40 prends la poêle, cuis-la <strong>et</strong> régale-toi!»<br />
La p<strong>et</strong>ite obéit.<br />
Pendant qu’elle fricassait, Jeann<strong>et</strong>te<br />
entendit, comme sortant de la cheminée,<br />
des p<strong>et</strong>ites voix plaintives qui disaient :<br />
.<br />
«Ah! La vilaine p<strong>et</strong>ite fille qui fricasse le<br />
sang de sa grand-mère!<br />
– Ma bonne grand-mère, que disent donc ces voix<br />
qui pépient dans la cheminée? s’enquit 11 Jeann<strong>et</strong>te.<br />
– Ne les écoute pas, ma fille, ce sont les p<strong>et</strong>its oiseaux<br />
qui chantent dans leur langage», la rassura le loup.<br />
Et la p<strong>et</strong>ite continua sa cuisine. Mais les voix reprirent bientôt :<br />
«Ah! Ce serait un grand péché que de manger une telle fricassée!»<br />
Alarmée, Jeann<strong>et</strong>te s’exclama alors :<br />
«Je n’ai plus faim, grand-mère, je ne veux pas manger de ce sang-là.<br />
– Eh bien! Viens au lit, ma fille, viens au lit.»<br />
Jeann<strong>et</strong>te se glissa à côté du loup. Mais elle ne fut pas plus tôt sous<br />
la cou<strong>et</strong>te qu’elle s’écria :<br />
«Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grands bras!<br />
– C’est pour mieux t’embrasser, ma fille, c’est pour mieux t’embrasser.<br />
– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grandes jambes!<br />
– C’est pour mieux courir, ma fille, c’est pour mieux courir.<br />
– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grands yeux!<br />
– C’est pour mieux voir, ma fille, c’est pour mieux voir.<br />
– Ah! ma grand-mère, comme vous avez de grandes dents!<br />
– C’est pour mieux manger, ma fille, c’est pour mieux manger.»<br />
Jugeant tout ceci anormal, Jeann<strong>et</strong>te prit peur <strong>et</strong> gémit :<br />
«Grand-mère, j’ai envie de faire pipi!<br />
– Fais au lit, ma fille, fais au lit.<br />
– Oh non, ma grand-mère! Je vais plutôt sortir. Si vous craignez que<br />
je m’en aille, attachez-moi un brin de laine à la jambe. Lorsque vous<br />
en aurez assez que je sois dehors, vous le tirerez, j’accourrai aussitôt.<br />
– Tu as raison, ma fille, tu as raison.»<br />
Et la méchante bête attacha un brin de laine à la jambe de<br />
Jeann<strong>et</strong>te, dont elle garda le bout dans sa patte. Quand la fill<strong>et</strong>te<br />
fut dehors, elle rompit le brin de laine <strong>et</strong> se sauva à toutes jambes.<br />
Un moment après, la fausse grand-mère sauta du lit :<br />
«As-tu fini, Jeann<strong>et</strong>te, as-tu fini?»<br />
Et les mêmes voix flu<strong>et</strong>tes sortirent de la cheminée :<br />
«Pas encore, ma grand-mère, pas encore!»<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
73
Lectures<br />
12. corolle : en forme<br />
de fleur.<br />
13. panière : grand panier<br />
à anses.<br />
74<br />
◗ Le loup<br />
80<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
85<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
90<br />
.<br />
.<br />
.<br />
1. Quels éléments du récit font apparaître le loup<br />
comme un animal : a. dans son comportement;<br />
b. dans son physique ?<br />
2. En quoi ce loup appartient-il au monde du merveilleux<br />
?<br />
3. Dans les lignes 15 à 22 : a. quel conseil le loup<br />
donne-t-il à la fill<strong>et</strong>te ?<br />
b. De quel trait de caractère fait-il preuve ?<br />
4. Quelles sont les trois épreuves successives que le<br />
loup impose à la fill<strong>et</strong>te dans les lignes 30 à 74 ?<br />
5. Quel rôle le loup joue-t-il dans ce conte par rapport<br />
à Jeann<strong>et</strong>te ?<br />
◗ Un conte initiatique<br />
6. a.Qui est l’héroïne ? b. Quel âge a-t-elle ?<br />
7. Quelle est sa quête au début de l’histoire ? C<strong>et</strong>te<br />
quête sera-t-elle couronnée de succès ? Justifiez.<br />
8. De quel trait de caractère l’héroïne fait-elle preuve<br />
dans les lignes 5 à 6 ?<br />
9. Relevez les mots qui expriment les attitudes de<br />
la fill<strong>et</strong>te dans les lignes 30 à 75 : quelle évolution<br />
constatez-vous ?<br />
10. a. Quelles ruses la fill<strong>et</strong>te imagine-t-elle pour<br />
échapper au loup ?<br />
b. Qui lui apporte de l’aide ? Ces aides sont-elles<br />
de nature merveilleuse ou réelle ? Justifiez.<br />
Le loup, alarmé, tira le brin de laine, mais il n’y avait plus rien au bout.<br />
Le redoutable animal se mit dans une belle colère : son p<strong>et</strong>it déjeuner<br />
lui échappait! Il se leva en hâte, renifla la piste <strong>et</strong> s’élança derrière<br />
la fill<strong>et</strong>te. Il pensait bientôt l’attraper lorsqu’il perdit sa trace le long<br />
d’une rivière où des laveuses trempaient leur linge. Il les interrogea :<br />
«Avez-vous vu la p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te?<br />
– Oui, répondirent les laveuses, nous avons étendu un drap sur l’eau<br />
de la rivière <strong>et</strong> elle a passé dessus. Elle est maintenant sur l’autre rive.<br />
– Ah! dit le méchant loup, étendez-en un tout de suite pour moi.»<br />
Le drap se déploya en corolle 12 blanche sur la surface de l’eau <strong>et</strong><br />
le loup s’y engagea, mais l’animal n’eut pas plutôt fait trois pas qu’il<br />
coula <strong>et</strong> ne reparut jamais plus. Jeann<strong>et</strong>te sortit alors d’une panière 13<br />
de linge où elle s’était cachée <strong>et</strong> remercia les femmes, se prom<strong>et</strong>tant<br />
de ne plus jamais écouter le loup.<br />
Version traditionnelle du P<strong>et</strong>it Chaperon rouge avant l’adaptation de Perrault <strong>et</strong> de Grimm, in <strong>Contes</strong><br />
<strong>et</strong> légendes du Loup, coll. «<strong>Contes</strong> <strong>et</strong> légendes» de Léo Lamache, © Éditions Nathan (Paris, France), 2004.<br />
Étudier un conte initiatique<br />
11. Qui l’emporte dans ce conte ?<br />
12. Que la fill<strong>et</strong>te a-t-elle appris grâce à ces épreuves ?<br />
◗ Lire l’image<br />
13. Oralement, a. indiquez les passages précis du<br />
texte qui correspondent selon vous à chacune des<br />
images. b. Justifiez votre choix.<br />
Histoire des Arts<br />
14. a.Lisez Le P<strong>et</strong>it Chaperon rouge de Charles Perrault.<br />
Quelles ressemblances <strong>et</strong> différences repérez-vous<br />
avec le conte La P<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te?<br />
b. Rendez-vous sur le site de la BnF (http://expositions.<br />
bnf/contes/gros/chaperon/indfeuill.htm), choisissez<br />
l’illustration du P<strong>et</strong>it Chaperon rouge qui correspond<br />
le mieux au conte de Perrault. Justifiez votre choix.<br />
15. Écoutez l’histoire de Pierre <strong>et</strong> le Loup mise<br />
en musique par Prokofiev. S’agit-il d’un conte initiatique?<br />
Expliquez.<br />
Gardons une trace écrite<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez ces phrases : « Un conte<br />
initiatique raconte les ... d’un personnage parti à<br />
la ... de quelque chose. Grâce à ces épreuves, le<br />
héros devient plus ... . L’histoire vise à donner une<br />
... aux lecteurs. »
Œuvre<br />
intégrale<br />
TEXTE INTÉGRAL<br />
Hans<br />
Christian<br />
Andersen<br />
(1805-1875)<br />
C<strong>et</strong> écrivain danois, célèbre<br />
pour ses contes, est né dans<br />
une famille misérable.<br />
À quatorze ans, il part tenter<br />
sa chance à Copenhague, la<br />
capitale du Danemark. Il lui<br />
faudra plus de dix ans pour<br />
sortir de la misère, voyager<br />
avec passion <strong>et</strong> connaître le<br />
succès avec ses œuvres. Mais il<br />
reste angoissé. Son œuvre est<br />
le refl<strong>et</strong> de sa vie : la peur de<br />
la misère, les déceptions amoureuses,<br />
le malaise de se sentir<br />
différent mais aussi un profond<br />
attachement à la religion.<br />
1. faisaient la même figure :<br />
avaient la même attitude.<br />
2. s’y miraient :<br />
s’y reflétaient.<br />
3. embrasure : ouverture<br />
pratiquée dans l’épaisseur<br />
d’un mur pour y placer une<br />
porte.<br />
4. linon : toile de lin très fine.<br />
5. paill<strong>et</strong>te : p<strong>et</strong>ite lamelle<br />
de matière brillante.<br />
6. tabatière : p<strong>et</strong>ite boîte<br />
pour le tabac.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
15<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
20<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
25<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
30<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
35<br />
Avant de lire le texte<br />
«Intrépide», du latin intrepidus, «qui ne tremble pas» : en vous aidant éventuellement<br />
d’un dictionnaire, choisissez parmi ces adjectifs ceux qui sont synonymes d’«intrépide»:<br />
peureux, courageux, vaillant, lâche.<br />
L’Intrépide Soldat<br />
de plomb<br />
Il y avait une fois vingt-cinq soldats<br />
de plomb. Ils étaient tous frères car<br />
ils étaient nés d’une vieille cuiller de<br />
plomb. Ils avaient le fusil au bras,<br />
faisaient la même figure 1 <strong>et</strong>, pour<br />
leur uniforme, rouge <strong>et</strong> bleu, il avait<br />
bon eff<strong>et</strong>. La première chose qu’ils<br />
entendirent en ce monde, quand le<br />
couvercle de la boîte où ils étaient couchés fut enlevé, ce fut : «Des soldats<br />
de plomb ! » : c’était ce que criait un p<strong>et</strong>it garçon en battant des mains.<br />
On les lui avait donnés pour son anniversaire <strong>et</strong> il les aligna sur la table.<br />
Chacun était le vivant portrait de l’autre, il n’y en avait qu’un pour<br />
être un peu différent : il n’avait qu’une jambe parce que c’était lui qui<br />
avait été fondu le dernier <strong>et</strong> il ne restait plus assez de plomb. Pourtant,<br />
il se tenait aussi ferme sur son unique jambe que les autres sur deux <strong>et</strong><br />
c’est précisément lui qui va mériter notre attention.<br />
Sur la table où on les avait alignés, il y avait beaucoup d’autres<br />
jou<strong>et</strong>s, mais ce qui frappait le plus le regard, c’était un joli château<br />
de carton. Par les p<strong>et</strong>ites fenêtres, on apercevait les salles. Dehors,<br />
de p<strong>et</strong>its arbres entouraient un p<strong>et</strong>it miroir qui tenait lieu de lac ; des<br />
cygnes de cire y nageaient <strong>et</strong> s’y miraient 2 . L’ensemble était charmant,<br />
mais le plus charmant était encore une p<strong>et</strong>ite demoiselle qui se tenait<br />
dans l’embrasure 3 de la porte du château. Elle aussi était découpée dans<br />
du carton, mais elle portait une jupe de linon 4 transparent <strong>et</strong> un mince<br />
p<strong>et</strong>it ruban bleu sur l’épaule qui faisait comme une écharpe, avec, au<br />
beau milieu, une paill<strong>et</strong>te 5 aussi grande que son visage. La p<strong>et</strong>ite<br />
demoiselle étendait les deux bras, car c’était une danseuse, <strong>et</strong> elle levait<br />
l’une de ses jambes si haut que le soldat de plomb ne la découvrit pas<br />
<strong>et</strong> crut qu’elle n’avait qu’une jambe, comme lui.<br />
« Voilà une femme pour moi, pensa-t-il, mais elle est distinguée, elle<br />
habite au château, moi, je n’ai qu’une boîte <strong>et</strong> nous sommes vingt-cinq<br />
dedans, ce n’est pas un endroit pour elle. Il faut tout de même que je tâche<br />
de faire sa connaissance ! » Il s’étendit de tout son long derrière une<br />
tabatière 6 qui se trouvait sur la table. Là, il put regarder la p<strong>et</strong>ite dame<br />
délicate qui continuait de se tenir sur une jambe sans perdre l’équilibre.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs 75
Œuvre<br />
intégrale<br />
7. les gens de maison : les<br />
serviteurs <strong>et</strong> les servantes de<br />
la maison.<br />
8. en être : en faire partie.<br />
9. Dans la mythologie<br />
scandinave, un troll est<br />
un être malveillant, nain<br />
ou géant ; laid, avec un gros<br />
nez, il tient de l’homme<br />
<strong>et</strong> de l’animal <strong>et</strong> habite des<br />
cavernes dans les montagnes<br />
ou les forêts.<br />
10. la bonne : la servante.<br />
11. inconvenant : qui ne<br />
convient pas, déplacé.<br />
12. dru : fort.<br />
13. une dalle : une plaque.<br />
76<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
40<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
45<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
50<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
55<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
60<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
65<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
70<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
75<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Quand la soirée fut avancée, tous les autres soldats de plomb<br />
entrèrent dans leur boîte <strong>et</strong> les gens de la maison 7 allèrent au lit. Alors,<br />
les jou<strong>et</strong>s se mirent à jouer, à organiser des réceptions, à faire la guerre,<br />
à danser. Les soldats de plomb cliqu<strong>et</strong>aient dans leur boîte, ils auraient<br />
voulu en être 8 mais ils ne parvenaient pas à enlever le couvercle.<br />
Le casse-nois<strong>et</strong>tes faisait des culbutes, le crayon écrivait des plaisanteries<br />
sur l’ardoise. C’était un tel vacarme que le canari se réveilla <strong>et</strong> entama<br />
la conversation, <strong>et</strong> en vers, qui plus est. Les deux seuls qui ne bougeaient<br />
pas, c’étaient le soldat de plomb <strong>et</strong> la p<strong>et</strong>ite danseuse: elle, se tenait<br />
bien droite sur la pointe du pied, les deux bras étendus, lui, était tout<br />
aussi intrépide sur son unique jambe, pas un instant il ne détachait<br />
d’elle son regard.<br />
Minuit sonna <strong>et</strong> clac ! le couvercle de la tabatière sauta. Or il n’y<br />
avait pas de tabac dedans, non, mais un p<strong>et</strong>it troll 9 noir, c’était une<br />
boîte à surprise !<br />
« Soldat de plomb, dit le troll, veux-tu regarder ailleurs ! »<br />
Mais le soldat de plomb fit comme s’il n’entendait pas.<br />
« Fort bien, attends demain ! » dit le troll.<br />
Quand ce fut le matin <strong>et</strong> que les enfants arrivèrent, on posa le soldat<br />
de plomb à la fenêtre, <strong>et</strong>, est-ce que ce fut le troll ou un courant d’air,<br />
la fenêtre s’ouvrit soudain <strong>et</strong> le soldat tomba, tête la première, du<br />
deuxième étage. La vitesse fut épouvantable, il avait la jambe en l’air,<br />
il se r<strong>et</strong>rouva tout droit sur sa casqu<strong>et</strong>te, sa baïonn<strong>et</strong>te enfoncée entre<br />
deux pavés.<br />
La bonne 10 <strong>et</strong> le p<strong>et</strong>it garçon descendirent aussitôt le chercher.<br />
Mais ils eurent beau manquer lui marcher dessus, ils ne l’aperçurent<br />
pas. Si le soldat de plomb avait crié : « Je suis ici ! », ils l’auraient<br />
sûrement trouvé, mais il estima inconvenant 11 de crier puisqu’il était<br />
en uniforme.<br />
Et voilà qu’il se mit à pleuvoir, les gouttes tombaient de plus en plus<br />
dru 12 , c’était une sérieuse averse. Lorsqu’elle fut passée, deux gamins<br />
arrivèrent.<br />
« Regarde donc, dit l’un, voilà un soldat de plomb ! On va le faire<br />
naviguer ! »<br />
Avec un journal, ils firent un bateau, y mirent le soldat de plomb<br />
<strong>et</strong> le voilà qui descend le caniveau. Les deux garçons couraient à côté<br />
en battant des mains. Dieu ! les vagues qu’il y avait dans ce caniveau,<br />
<strong>et</strong> quel courant ! Il faut dire aussi qu’il avait plu à verse. Le bateau de<br />
papier tanguant, virant parfois de bord, si brusquement que le soldat<br />
de plomb en tremblait. Mais il restait intrépide, ne changeait pas<br />
d’expression, regardait bien droit <strong>et</strong> gardait l’arme au bras.<br />
Tout à coup, le bateau passa sous une longue dalle 13 recouvrant<br />
le caniveau. Il y faisait aussi noir que s’il avait été dans sa boîte.
14. cingla : se dirigea à toute<br />
vitesse.<br />
15. payer la douane :<br />
autrefois, quand on changeait<br />
de pays ou de région, on<br />
payait un droit de passage<br />
à la douane.<br />
16. Le traducteur a choisi une<br />
comptine française que les<br />
enfants chantent en formant<br />
un tunnel qui se referme sur<br />
le dernier danseur car elle<br />
correspond à une comptine<br />
danoise qui accompagne<br />
un jeu de capture.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
95<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
100<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
105<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
110<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
115<br />
« Où est-ce que je vais arriver, pensa-t-il, ouais,<br />
c’est de la faute du troll ! Ah ! si seulement la p<strong>et</strong>ite<br />
demoiselle était dans ce bateau, il pourrait bien faire<br />
deux fois plus noir encore, ça me serait égal ! »<br />
À c<strong>et</strong> instant surgit un gros rat d’égout qui logeait<br />
sous la dalle.<br />
« Tu as un passeport ? demanda le rat. Montre-le ! »<br />
Le soldat de plomb se tut <strong>et</strong> serra encore plus son fusil.<br />
Le bateau cingla 14 , suivi du rat. Hou ! comme il grinçait<br />
des dents, criant aux bouts de bois, aux brins d’herbe :<br />
« Arrêtez-le ! arrêtez-le ! Il n’a pas payé la douane 15 !<br />
il n’a pas montré son passeport!»<br />
Mais le courant devenait de plus en plus fort! Le soldat de plomb<br />
apercevait déjà la lumière du jour à l’endroit où finissait la dalle,<br />
devant, mais il entendait aussi un grondement bien capable d’effrayer<br />
un brave. Pensez donc! à l’endroit où finissait la dalle, le ruisseau<br />
se précipitait dans un grand canal. Pour le soldat, ce serait aussi<br />
dangereux que, pour nous, d’être entraînés dans une grande cascade.<br />
Et il en était si près déjà qu’il ne pouvait s’arrêter. Le bateau<br />
fut proj<strong>et</strong>é, le pauvre soldat de plomb se tint aussi raide<br />
qu’il put, personne ne pourrait lui reprocher<br />
d’avoir battu des cils. Le bateau tournoya trois<br />
ou quatre fois <strong>et</strong> se remplit d’eau jusqu’au<br />
bord, il ne pouvait que couler. Le soldat<br />
de plomb avait de l’eau jusqu’au cou,<br />
le bateau ne cessait de s’enfoncer,<br />
le papier se défaisait de plus en plus.<br />
Maintenant, le soldat avait de l’eau<br />
par-dessus la tête… alors, il pensa<br />
à la charmante p<strong>et</strong>ite danseuse<br />
qu’il ne verrait jamais plus; <strong>et</strong> une<br />
chanson résonna aux oreilles du<br />
soldat de plomb :<br />
Passe, passe, passera,<br />
La dernière, la dernière,<br />
Passe, passe, passera,<br />
La dernière restera 16 !<br />
.<br />
80<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
85<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
90<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
77
Œuvre<br />
intégrale<br />
17. sylphide : génie féminin<br />
de l’air, femme gracieuse <strong>et</strong><br />
légère.<br />
18. calcinée : brûlée.<br />
78<br />
.<br />
.<br />
125<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
130<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
135<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
140<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
145<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
150<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
155<br />
.<br />
.<br />
.<br />
120<br />
.<br />
.<br />
.<br />
. Et le papier creva, <strong>et</strong> le soldat de plomb<br />
le transperça… pour être, au même instant,<br />
avalé par un gros poisson.<br />
Oh ! comme il faisait noir là-dedans ! C’était<br />
encore pire que sous la dalle du caniveau, <strong>et</strong> puis on<br />
était tellement à l’étroit. Mais le soldat de plomb était<br />
intrépide, il s’étendit de tout son long, l’arme au bras…<br />
Le poisson frétilla, il fit les mouvements les plus épouvantables;<br />
finalement, il resta tout à fait immobile, il fut traversé comme d’un<br />
éclair. Il y eut une lumière très claire <strong>et</strong> quelqu’un s’écria : «Un soldat<br />
de plomb!» Le poisson avait été pêché, apporté au marché, vendu <strong>et</strong><br />
était parvenu à la cuisine où la bonne l’ouvrait avec un grand couteau.<br />
Entre deux doigts, elle prit le soldat par la taille <strong>et</strong> le porta au salon<br />
où tout le monde voulait voir un homme aussi remarquable qui avait<br />
voyagé dans le ventre d’un poisson. Mais le soldat de plomb n’était pas<br />
fier du tout. On le posa sur la table <strong>et</strong>… vraiment, comme il peut<br />
se passer de drôles de choses en ce monde! Le soldat de plomb se<br />
r<strong>et</strong>rouvait dans le salon même où il avait déjà été, car il vit les<br />
mêmes enfants, <strong>et</strong>, sur la table, les mêmes jou<strong>et</strong>s; le joli château avec<br />
la charmante p<strong>et</strong>ite danseuse: elle se tenait encore sur une seule jambe<br />
<strong>et</strong> levait l’autre très haut, elle aussi était intrépide. Le soldat de plomb<br />
en fut ému, il fut sur le point de pleurer, mais ce n’était pas convenable.<br />
Il la regarda <strong>et</strong> elle le regarda, mais ils ne dirent rien.<br />
À c<strong>et</strong> instant, l’un des p<strong>et</strong>its garçons prit le soldat <strong>et</strong> le j<strong>et</strong>a dans<br />
le poêle, sans donner aucune raison : c’était sûrement le troll de la<br />
tabatière qui en était cause.<br />
Le soldat de plomb était tout ébloui <strong>et</strong> ressentit une chaleur<br />
épouvantable, mais sans savoir si cela venait réellement du feu ou de<br />
l’amour. Il avait perdu ses couleurs: personne n’aurait pu dire si cela<br />
s’était produit pendant son voyage ou si c’était de chagrin. Il regardait<br />
la p<strong>et</strong>ite demoiselle, elle le regardait, il se sentait fondre mais<br />
il restait encore intrépide, le fusil au bras. Alors, une porte<br />
s’ouvrit, le vent s’empara de la danseuse qui vola<br />
comme une sylphide 17 tout droit dans le poêle auprès<br />
du soldat de plomb, s’enflamma <strong>et</strong> disparut; puis<br />
le soldat de plomb fondit, devint un p<strong>et</strong>it bloc<br />
de plomb <strong>et</strong>, le lendemain, quand la bonne<br />
enleva les cendres, elle le trouva sous forme<br />
d’un p<strong>et</strong>it cœur de plomb. De la danseuse,<br />
en revanche, il ne restait que la paill<strong>et</strong>te<br />
calcinée 18 , noire comme du charbon.<br />
Andersen, <strong>Contes</strong>, «L’Intrépide Soldat de plomb»,<br />
traduit par Régis Boyer, © Éditions Gallimard, 1992.
◗ Première lecture<br />
Les personnages<br />
Comprendre un conte <strong>et</strong> ses significations<br />
1. Quels sont les personnages qui appartiennent au<br />
monde des humains ? ceux qui appartiennent au<br />
monde du merveilleux ?<br />
2. a. Qui est le héros du conte ? b. Quelle est sa quête ?<br />
3. Qui sont les opposants ? Qui est l’adjuvant ?<br />
La structure du conte (le schéma narratif)<br />
4. Que raconte la situation initiale (l. 1 à 64) ?<br />
5. « Quand ce fut le matin... pavés » : à quelle étape du<br />
schéma narratif ce passage correspond-il ? Justifiez.<br />
6. Donnez un titre aux différentes péripéties du p<strong>et</strong>it<br />
soldat entre sa chute <strong>et</strong> son r<strong>et</strong>our à la maison.<br />
7. Indiquez les lignes correspondant à l’élément de<br />
résolution.<br />
8. Quelle est la situation finale ?<br />
◗ Un conte autobiographique<br />
(qui raconte la vie de l’auteur)<br />
9. Relisez la biographie de l’auteur (p. 75).<br />
10. Quels aspects de sa vie Andersen a-t-il mis dans<br />
ce conte ?<br />
◗ Vérification de la lecture<br />
Pour vérifier la compréhension du conte, la classe<br />
va organiser un défi-lecture, c’est-à-dire élaborer <strong>et</strong><br />
échanger des questionnaires (voir la fiche-méthode).<br />
L’évaluation portera pour moitié sur le questionnaire<br />
<strong>et</strong> les réponses que vous aurez élaborées, pour moitié<br />
sur les réponses que vous apporterez au questionnaire<br />
préparé par d’autres élèves.<br />
◗ Les allusions bibliques <strong>et</strong> mythologiques<br />
Histoire des Arts<br />
Le voyage<br />
11. Dans la Bible, Jonas est puni pour avoir désobéi<br />
à Dieu : pendant un voyage en mer, il est avalé par<br />
une baleine qui le rej<strong>et</strong>te ensuite. En quoi le voyage<br />
du p<strong>et</strong>it soldat ressemble-t-il à celui de Jonas ?<br />
12. En quoi le voyage du p<strong>et</strong>it soldat ressemble-t-il à<br />
l’odyssée pleine de dangers d’Ulysse (voir p. 146) ?<br />
Le troll<br />
13. Selon la mythologie scandinave, le troll est un<br />
être malfaisant : quel est le rôle du troll dans le conte ?<br />
La descente aux Enfers<br />
14. Pour les Grecs, on accédait aux Enfers en franchissant<br />
un fleuve sombre, le Styx ; il fallait payer un<br />
passeur nommé Charon pour traverser : qui joue ce<br />
rôle dans le conte ?<br />
FICHE- MÉTHODE<br />
Organiser un défi-lecture<br />
• Préparer le questionnaire, par groupes<br />
ou individuellement, selon les indications<br />
du professeur, en posant des questions<br />
précises sur :<br />
– le héros (son identité, son physique, son<br />
caractère, son âge…) ;<br />
– l’obj<strong>et</strong> de sa quête ;<br />
– les autres personnages (adjuvants <strong>et</strong><br />
opposants) ;<br />
– le(s) lieu(x) ;<br />
– l’époque <strong>et</strong> la durée de l’histoire ;<br />
– les principales péripéties ;<br />
– le dénouement.<br />
• Préparer les réponses aux questions posées,<br />
sur une feuille séparée.<br />
• Échanger les questionnaires <strong>et</strong> répondre<br />
aux questions posées par d’autres élèves.<br />
• Confronter les réponses prévues <strong>et</strong> les<br />
réponses fournies (on peut procéder à une<br />
discussion, suivie d’un vote, pour déterminer<br />
quel est le meilleur questionnaire).<br />
Les symboles du feu<br />
15. a. « brûler d’amour,<br />
déclarer sa flamme, les<br />
feux de l’amour, avoir<br />
le cœur enflammé » : à<br />
quoi l’amour est-il comparé<br />
dans ces expressions<br />
imagées ?<br />
b. Dans la scène finale,<br />
par quels mots ces<br />
expressions sont-elles<br />
prises au sens propre ?<br />
16. a. À cause de quel<br />
personnage le p<strong>et</strong>it<br />
soldat brûle-t-il ?<br />
b. Dans la tradition chrétienne, les méchants, après<br />
leur mort, brûlaient dans les enfers : dans le conte,<br />
quel obj<strong>et</strong> peut représenter les enfers ?<br />
17. a. Que la servante découvre-t-elle dans le poêle ?<br />
Répondez en citant le texte.<br />
b. Dans la mythologie gréco-latine, le Phénix, animal<br />
mythologique, mourait incendié <strong>et</strong> renaissait régulièrement<br />
de ses cendres : en quoi le conte s’est-il inspiré<br />
de ce mythe ?<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
79
L’écho<br />
du poète<br />
80<br />
Chameau,<br />
© Éric Issele/Fotolia.com<br />
◗ Un poème en écho<br />
1. De quel conte étudié rapprocheriez-vous ce poème? Pourquoi ?<br />
2. Quel autre titre pourriez-vous proposer pour ce poème ?<br />
◗ Un poème à réciter<br />
Le chameau<br />
Un chameau entra dans un sauna.<br />
Il eut chaud,<br />
Très chaud,<br />
Trop chaud.<br />
Il sua, Sua, Sua.<br />
Une bosse s’usa,<br />
S’usa, S’usa.<br />
L’autre bosse ne s’usa pas;<br />
Que crois-tu qu’il arriva?<br />
Le chameau dans le désert<br />
Se r<strong>et</strong>rouva dromadaire.<br />
Pierre Coran, La tête en fleurs, © Le Cyclope.<br />
3. Récitez le poème en insistant sur les répétitions <strong>et</strong> en ménageant<br />
l’eff<strong>et</strong> de surprise final.
Faire le point<br />
© Dorling Kindersley/<br />
G<strong>et</strong>ty images<br />
Un genre littéraire<br />
Universalité <strong>et</strong> diversité<br />
des contes<br />
Arts <strong>et</strong> culture<br />
Un genre universel<br />
◗ Le conte est un genre universel qui se r<strong>et</strong>rouve dans toutes les cultures du monde <strong>et</strong> à<br />
travers les siècles.<br />
◗ Le conte est d’abord un récit de tradition orale. Les contes étaient dits par des conteurs<br />
(appelés griots en Afrique) ou par des conteuses, le plus souvent à la veillée. Ceci<br />
explique que bien des contes soient anonymes (d’auteurs inconnus) : c’est le cas des<br />
<strong>Contes</strong> des Mille <strong>et</strong> Une Nuits (voir p. 90 à 97).<br />
La diversité des contes<br />
◗ La plupart des contes transm<strong>et</strong>tent agréablement une leçon de sagesse grâce au récit<br />
d’une expérience. Ils s’adressent donc particulièrement aux enfants. Ce sont des contes<br />
initiatiques (ex. « La P<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te »).<br />
◗ Certains contes expliquent de manière imaginaire un phénomène naturel (la neige<br />
en hiver…) ou une particularité animale ou végétale : ce sont les contes explicatifs<br />
(ex. « La légende de l’escargot »).<br />
◗ Les contes peuvent faire allusion à des mythes anciens ou comporter des symboles<br />
(ex. « L’Intrépide Soldat de plomb »).<br />
◗ Il existe des auteurs de contes célèbres tels que Hans Christian Andersen, Lewis Carroll,<br />
Birago Diop, L. S. Senghor ou bien encore Charles Perrault <strong>et</strong> les frères Grimm (voir p. 38 à 61).<br />
Une forme de récit<br />
◗ Dans les contes, la présence du merveilleux (obj<strong>et</strong>s magiques, animaux<br />
personnifiés, êtres surnaturels, métamorphoses) dans un monde réel<br />
est considérée comme normale.<br />
◗ Le conte est une forme de récit. Il a une structure particulière nommée<br />
schéma narratif <strong>et</strong> des personnages aux fonctions caractéristiques<br />
(voir p. 53).<br />
◗ Même si les contes situent l’histoire dans un passé volontairement<br />
indéfini, le vocabulaire <strong>et</strong> les modes de vie décrits dans le conte<br />
situent celui-ci dans une époque <strong>et</strong> une région particulières.<br />
L’écriture des contes<br />
◗ Les contes, le plus souvent, comportent un récit au passé (voir p. 324)<br />
entrecoupé de dialogues rédigés au présent <strong>et</strong> au passé composé<br />
de l’indicatif.<br />
◗ Ils utilisent de nombreux indicateurs de temps, tels que un jour, alors…,<br />
pour souligner la chronologie.<br />
◗ Les contes de sagesse se terminent souvent par l’expression d’une<br />
morale finale. Les contes explicatifs se terminent par une formule<br />
telle que : « C’est pourquoi… » avec un verbe conjugué au présent<br />
de vérité générale.<br />
◗ Certains contes expriment dans leur écriture le caractère oral de leur<br />
transmission : onomatopées, interjections, langage familier.<br />
Je r<strong>et</strong>iens l’essentiel<br />
exercices<br />
Rédigez une brève définition du<br />
conte qui contienne les mots<br />
suivants : universel, diversité, oral,<br />
tradition, merveilleux, sagesse.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
81
Langue & expression Lexique<br />
➥ Sens propre <strong>et</strong> sens figuré – p. 354<br />
Quel est le sens du nom « quête » dans chacune<br />
des phrases suivantes ?<br />
1. Des bénévoles font la quête afin de récolter des<br />
fonds pour une association. 2. Ce jeune couple est en<br />
quête d’un appartement.<br />
Auquel des deux sens précédents rattacheriezvous<br />
le nom « quête » dans la phrase suivante ?<br />
Le héros se lance à la quête du trésor.<br />
➥ La dérivation : préfixes – suffixes – p. 350<br />
En employant l’un des préfixes suivants : re-, en-,<br />
con-, trouvez le mot de la famille de « quête » qui<br />
correspond à chaque définition :<br />
a. soumission par la force ou par les armes ;<br />
b. étude d’une question en réunissant des témoignages,<br />
des expériences, des documents ;<br />
c. action de séduire quelqu’un ;<br />
d. demande pressante, écrite ou verbale ;<br />
e. recherche de la vérité pour trouver le coupable<br />
d’un crime.<br />
82<br />
Distinguer les sens du nom « quête »<br />
Former des mots avec des préfixes<br />
Étudier la famille du mot « merveille »<br />
Le nom merveille vient du latin mirari, « ouvrir<br />
grand les yeux » ; la merveille est ce qui fait<br />
ouvrir grand les yeux.<br />
➥ Le radical <strong>et</strong> les familles de mots – p. 348<br />
Observez les mots suivants : merveilleux – merveilleuse<br />
– émerveiller – émerveillement.<br />
a. Quel radical commun r<strong>et</strong>rouvez-vous dans chacun<br />
de ces mots ?<br />
b. Quelle est la classe grammaticale<br />
de chacun de ces mots ?<br />
c. Quel(s) suffixe(s) sert(vent) à<br />
former des adjectifs ? un verbe ?<br />
un nom ?<br />
Quel adverbe en -ment de<br />
la famille du mot « merveille »<br />
pouvez-vous former?<br />
Patrizia La Porta,<br />
illustration pour Le P<strong>et</strong>it<br />
Chaperon rouge, 1998.<br />
© Patrizia La Porta/Leemage<br />
Le vocabulaire des contes (2)<br />
Découvrir des expressions<br />
autour du mot « loup »<br />
Faites correspondre à chaque expression de la<br />
colonne A la définition qui lui correspond dans<br />
la colonne B.<br />
A B<br />
1. à la queue leu leu 1<br />
2. être connu<br />
comme le loup<br />
blanc<br />
3. un froid de loup<br />
4. entre chien <strong>et</strong><br />
loup<br />
5. une faim de loup<br />
6. un vieux loup<br />
de mer<br />
7. une gueule-deloup<br />
8. un jeune loup<br />
9. hurler avec<br />
les loups<br />
10. crier au loup<br />
11. enfermer le loup<br />
dans la bergerie<br />
12. se j<strong>et</strong>er dans<br />
la gueule du<br />
loup<br />
1. leu : loup.<br />
a. un énorme appétit<br />
b. un marin endurci<br />
c. l’un derrière l’autre<br />
d. se joindre aux autres<br />
pour critiquer ou attaquer<br />
e. s’exposer de sa propre<br />
initiative à un grand<br />
danger<br />
f. être repéré par tout<br />
le monde<br />
g. un jeune homme<br />
ambitieux, soucieux de<br />
faire carrière<br />
h. un temps glacial<br />
i. à la tombée de la nuit,<br />
à l’heure où on ne<br />
distingue pas les formes<br />
j. une fleur dont les<br />
pétales s’ouvrent comme<br />
une mâchoire<br />
k. avertir d’un danger<br />
l. placer quelqu’un dans<br />
un lieu où il peut faire<br />
du mal<br />
Choisissez une de ces expressions que vous<br />
emploierez dans un bref paragraphe qui en expliquera<br />
le sens.
Langue & expression Orthographe <strong>et</strong> conjugaison<br />
Distinguer les homophones de « conte »<br />
➥ Les homophones – p. 344<br />
Manipuler <br />
a.Recopiez la phrase en remplaçant les mots<br />
entre parenthèses par un synonyme (attention !<br />
tous les mots à trouver appartiennent à la même<br />
famille) : Un (griot) africain (narre) des (histoires).<br />
b. Soulignez les l<strong>et</strong>tres qui forment le son [ö] (voir p. 367).<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez les phrases suivantes :<br />
a. Dans des études de comptabilité, on apprend à …,<br />
à faire des … . b. La comtesse était l’épouse d’un …<br />
qui gouvernait le … .<br />
Formuler la règle<br />
Recopiez les phrases en les complétant :<br />
« Il ne faut pas confondre un … qui est une histoire,<br />
un … qui désigne un titre de noblesse avec<br />
un … qui veut dire un calcul. »<br />
Des homophones sont des mots qui se prononcent<br />
de la … manière <strong>et</strong> qui s’écrivent de manière … .<br />
Connaître les terminaisons<br />
du participe passé<br />
➥ Reconnaître un participe passé – p. 314<br />
Observer <strong>et</strong> manipuler<br />
Observez les participes passés soulignés : de quel<br />
verbe à l’infinitif chacun d’eux provient-il ?<br />
Une histoire racontée – une mission accomplie – une<br />
leçon apprise – une l<strong>et</strong>tre reçue – une fenêtre ouverte.<br />
a.Quels sont le genre <strong>et</strong> le nombre des noms de<br />
l’exercice 4 ? b. Quelle est la voyelle finale de tous<br />
les participes passés soulignés ? Pourquoi ?<br />
Écrivez au masculin singulier les participes passés<br />
de la liste ci-dessus <strong>et</strong> soulignez la l<strong>et</strong>tre finale.<br />
En passant par le féminin, choisissez dans chaque<br />
binôme, la forme verbale qui est un participe passé.<br />
1. Prit, pris. 2. Donner, donné. 3. Finit, fini. 4. Bu, but.<br />
5. Offrit, offert. 6. Vit, vu.<br />
Formuler la règle<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase : Au masculin<br />
singulier, il existe … terminaisons possibles de participes<br />
passés : …, …., …., …. .<br />
Conjuguer le passé composé de l'indicatif<br />
➥ Le passé composé de l’indicatif – p. 316<br />
Observer<br />
Hier, l’escargot est parti, il a voyagé lentement,<br />
il a pris son temps, il n’a pas pu aller plus vite mais<br />
il a fini par arriver à bon port; ce matin, il est parmi nous.<br />
a. Pourquoi nomme-t-on le temps des formes verbales<br />
en gras un « passé composé » ?<br />
b. Quels sont les verbes auxiliaires utilisés dans c<strong>et</strong>te<br />
conjugaison ? À quel temps sont-ils ?<br />
c. Comment nomme-t-on le deuxième mot qui<br />
compose ce temps ?<br />
Transposez ces formes verbales à la personne du<br />
pluriel ou du singulier qui correspond.<br />
J’ai marché – tu as parlé – nous avons dormi – elle a<br />
surpris – ils ont rougi – vous avez porté – il a frémi –<br />
elles ont permis – j’ai entendu – elle a éprouvé.<br />
a.Dans le texte suivant, identifiez les verbes<br />
conjugués au passé composé. b. Comment les avezvous<br />
reconnus ?<br />
C<strong>et</strong>te nuit là, l’empereur a veillé. Il a attendu<br />
que le jour se lève en contemplant la lune. Mais<br />
dès le lendemain, il a donné des ordres pour<br />
qu’on construise un vaisseau de l’espace. Fou Li<br />
a fait un sourire. Des jours durant, il a calculé<br />
des trajectoires sur de longs parchemins qui<br />
traînaient à terre. Puis il a commencé à bâtir<br />
avec un acier spécial un drôle d’engin.<br />
D’après M. Piquemal, L’Empereur <strong>et</strong> l’Astronome<br />
Formuler la règle<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase : Pour former<br />
le passé composé, on emploie l’auxiliaire « … »<br />
ou « … » , conjugué au … de l’indicatif, ainsi que<br />
le participe … du verbe.<br />
✍ Préparer la dictée<br />
Pendant des mois, Lune a appris à sa belle-fille<br />
les secr<strong>et</strong>s des plantes, leur vertu médicinale <strong>et</strong><br />
tout le bien qu’on pouvait en tirer. Lune lui a<br />
offert une p<strong>et</strong>ite pioche très dure pour déterrer<br />
les racines <strong>et</strong> les plantes comestibles. Elle lui a<br />
enseigné l’art de planter les graines pour faire<br />
pousser de nouvelles graines. Un jour, en s’aventurant<br />
loin du campement, Femme Plume<br />
aperçoit un énorme nav<strong>et</strong>.<br />
D’après C. Gendrin, Tour du monde des contes sur les ailes<br />
d’un oiseau, © Rue du Monde, 2005.<br />
Relevez les verbes conjugués au passé composé<br />
en les classant par groupes.<br />
Quel est le genre du nom « vertu » ?<br />
Justifiez l’accord des adjectifs qualificatifs en italique.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
dictée sonore<br />
83
Langue & expression Grammaire<br />
➥ Les valeurs du passé composé de l’indicatif – p. 327<br />
Observer<br />
a.À quoi voyez-vous que ce passage est la transcription<br />
d’un récit oral ? Proposez deux éléments de<br />
réponse. b. Quel est le temps dominant dans ce récit<br />
oral ?<br />
84<br />
Connaître les valeurs des temps :<br />
le passé composé<br />
«N’as-tu pas reçu mon messager?<br />
– Je l’ai reçu, père Éléphant, […], mais le chemin<br />
est long <strong>et</strong> tu ne m’as donné qu’un pied<br />
pour marcher. […] : voilà ce qui m’a r<strong>et</strong>ardé.»<br />
M. Bloch, 365 contes des pourquoi <strong>et</strong> des comment,<br />
© Gallimard Jeunesse.<br />
a. À quel temps de l’indicatif le verbe «prétendre»<br />
est-il conjugué ? b. Les actions des autres verbes se<br />
situent-elles avant, pendant ou après l’action du<br />
verbe « prétendre » ? c. À quel temps de l’indicatif<br />
ces verbes sont-ils conjugués ?<br />
«Tu prétends que tu as porté ce gros caïman<br />
dans c<strong>et</strong>te natte? Comment as-tu fait?<br />
– Je l’ai enroulé dedans <strong>et</strong> j’ai ficelé la natte.»<br />
B. Diop, «Fari l’ânesse», <strong>Contes</strong> d’Amadou Koumba,<br />
Présence africaine, 1961.<br />
Formuler la règle<br />
En vous appuyant sur vos observations, recopiez<br />
<strong>et</strong> complétez les phrases suivantes :<br />
Pour raconter une histoire à l’oral, on n’utilise pas<br />
le passé simple mais le … .<br />
Le passé composé s’emploie pour exprimer une action<br />
qui se situe … une action racontée au présent.<br />
Distinguer les fonctions COD <strong>et</strong> COI<br />
(noms <strong>et</strong> groupes nominaux)<br />
➥ Les compléments d’obj<strong>et</strong> du verbe :<br />
COD <strong>et</strong> COI – p. 296 <strong>et</strong> 298<br />
Observer <strong>et</strong> manipuler<br />
Le lapin blanc croisa Alice. Elle observa l’étrange animal;<br />
elle crut à une vision <strong>et</strong> ne manqua pas de curiosité.<br />
Pouvez-vous supprimer les mots <strong>et</strong> groupes<br />
nominaux en gras sans changer le sens des phrases ?<br />
Ces mots complètent-ils des verbes ou des noms ?<br />
Quels sont ceux de ces compléments qui se construisent<br />
sans préposition ? avec une préposition ?<br />
a.Classez en deux colonnes les noms <strong>et</strong> groupes<br />
nominaux en gras selon qu’ils complètent directement<br />
ou non le verbe. b. Précisez les verbes qu’ils<br />
complètent.<br />
1. Arrivé au bord de l’eau, l’enfant déposa son<br />
fardeau, coupa les liens <strong>et</strong> délivra le caïman. 2. Le<br />
fermier tenait une bride <strong>et</strong> s’occupait de son cheval.<br />
3. L’homme rêvait à ses prochaines plantations <strong>et</strong><br />
il labourait sa terre. 4. Il ne pensait pas au crocodile<br />
qui avançait doucement <strong>et</strong> fixait sa proie.<br />
Formuler la règle<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase suivante :<br />
On nomme COD un nom ou un groupe nominal<br />
qui complète directement un … ; on nomme COI<br />
un nom ou un groupe nominal qui complète un<br />
verbe à l’aide des prépositions … ou …. .<br />
Distinguer les fonctions COD <strong>et</strong> COI<br />
(pronoms personnels de la 3 e personne du singulier)<br />
➥ Les compléments d’obj<strong>et</strong> du verbe :<br />
COD <strong>et</strong> COI – p. 296 <strong>et</strong> 298<br />
Observer <strong>et</strong> manipuler<br />
Alice vit la porte <strong>et</strong> la poussa. Elle aperçut un jardin,<br />
le contempla <strong>et</strong> l’admira. Elle croisa un animal <strong>et</strong> lui<br />
parla.<br />
a.Quelle est la classe grammaticale des mots<br />
en gras ? b. Où chacun de ces mots est-il placé par<br />
rapport au verbe ?<br />
a.Remplacez chacun d’eux par le groupe nominal<br />
qui convient. b. Quels sont ceux de ces mots en gras<br />
qui sont COD ? celui qui est COI ?<br />
a.Remplacez les noms <strong>et</strong> groupes nominaux<br />
en gras par le pronom personnel qui convient.<br />
b. Précisez la fonction de chacun d’eux.<br />
1. La p<strong>et</strong>ite fille regarda la méchante fée. 2. Les parents<br />
obéissaient à c<strong>et</strong>te sorcière. 3. Heureusement, ils<br />
rencontrèrent un magicien <strong>et</strong> parlèrent à c<strong>et</strong><br />
enchanteur. 4. C<strong>et</strong> homme aux pouvoirs magiques<br />
élevait un oiseau féerique. 5. Celui-ci protégea leur<br />
fille. 6. À l’âge de quinze ans la jeune fille rencontra<br />
c<strong>et</strong> oiseau aux plumes d’or <strong>et</strong> elle parla à l’étrange<br />
animal.<br />
Formuler la règle<br />
Recopiez <strong>et</strong> complétez la phrase suivante :<br />
Un pronom personnel COD ou COI est généralement<br />
placé … le verbe. À la troisième personne<br />
du singulier, le pronom personnel … est : le, la, l’ ;<br />
le pronom personnel COI est … .
Langue & expression Écrit<br />
1 Raconter une épreuve dans un conte<br />
SUJET : Un roi prom<strong>et</strong> sa fille <strong>et</strong> la moitié du royaume à celui qui<br />
accomplira l’action la plus incroyable. Le premier des prétendants 1<br />
s’avance <strong>et</strong> commence ainsi son récit : « Sire, je vous ai obéi… ».<br />
Imaginez <strong>et</strong> racontez l’action incroyable du prétendant.<br />
Préparation au brouillon<br />
1. Imaginez votre héros. Listez ses principales<br />
caractéristiques.<br />
2. En quel lieu <strong>et</strong> en quel temps situez-vous<br />
votre histoire ?<br />
3. Quelle chose incroyable votre héros va-t-il<br />
faire : réaliser un obj<strong>et</strong> extraordinaire ? un<br />
exploit ? …<br />
4. Le héros va-t-il recevoir l’aide d’un adjuvant ?<br />
2 Écrire un bref conte explicatif<br />
SUJET : Inventez une histoire d’une quinzaine de<br />
lignes dans laquelle vous expliquerez d’une<br />
manière amusante ou poétique l’origine d’un<br />
phénomène naturel.<br />
Préparation au brouillon<br />
•Voici une série de titres possibles :<br />
– Pourquoi les tigres ont-ils un pelage rayé ?<br />
– Pourquoi la neige tombe-t-elle en hiver ?<br />
– Pourquoi le hibou est-il un oiseau nocturne ?<br />
Choisissez un de ces titres ou inventez un titre<br />
qui vous plaît.<br />
•Faites le plan de votre conte en trois étapes :<br />
– une phrase pour la situation initiale, écrite à<br />
l’imparfait de l’indicatif <strong>et</strong> commençant par<br />
une indication de temps (Autrefois…) ;<br />
– une ou deux phrase(s) pour l’étape de transformation,<br />
écrite au passé simple de l’indicatif ;<br />
– une phrase pour la situation finale, écrite au<br />
présent de l’indicatif <strong>et</strong> commençant par une<br />
formule (Et c’est depuis ce temps-là que…).<br />
Raconter à la manière des contes<br />
1. Ceux qui désirent<br />
épouser la princesse.<br />
Consignes d’écriture<br />
•Racontez en respectant les éléments de votre<br />
préparation.<br />
•Racontez au passé composé de l’indicatif.<br />
•Veillez à utiliser des phrases simples.<br />
•Utilisez un niveau de langue courant.<br />
•Relisez-vous en faisant attention aux formes<br />
conjuguées.<br />
Lisa Berkshire, Jungle<br />
la nuit, XX e siècle. © Lisa<br />
Berkshire/Illustration<br />
Works/G<strong>et</strong>ty images<br />
Écriture du brouillon<br />
Rédigez votre conte au brouillon en développant<br />
vos trois étapes. Écrivez un paragraphe<br />
pour chaque étape : le paragraphe le plus<br />
développé est celui qui correspond à l’étape de<br />
transformation.<br />
Consignes d’écriture<br />
•Rédigez votre conte en respectant les éléments<br />
de votre préparation.<br />
•Veillez à utiliser des phrases simples.<br />
•Utilisez un niveau de langue courant.<br />
•Relisez-vous en faisant attention aux formes<br />
conjuguées <strong>et</strong> aux accords.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
85
Langue & expression Oral<br />
1 M<strong>et</strong>tre un conte en voix<br />
86<br />
SUJET : Par groupes de trois élèves, entraînez-vous à lire ce conte<br />
en vous distribuant les rôles : le conteur, le lapin, le p<strong>et</strong>it bouc.<br />
Pourquoi le lapin a-t-il de longues oreilles ?<br />
Un jour, en sortant de son terrier, un lapin a vu un p<strong>et</strong>it bouc<br />
donner des coups de corne dans un arbre. «Comme c’est une drôle<br />
de manière d’agir», se dit le lapin. Alors il a demandé au p<strong>et</strong>it bouc:<br />
– Pourquoi donnes-tu ainsi des coups de boutoir à c<strong>et</strong> arbre?<br />
– Il fait froid <strong>et</strong> je dois fendre du bois pour avoir de quoi chauffer<br />
dans la cuisine, répondit le p<strong>et</strong>it bouc.<br />
Le lapin avait bon cœur <strong>et</strong> il avait pitié de ce p<strong>et</strong>it bouc. Il a<br />
réfléchi un instant puis il lui a dit :<br />
– Attends, je vais t’aider. J’ai bien dormi <strong>et</strong> je me sens en pleine forme.<br />
Là-dessus, il prend son élan, fonce sur l’arbre <strong>et</strong> le heurte de la<br />
tête. Pauvre lapin! Voilà sa tête enfoncée profondément entre<br />
les branches, si coincée qu’il ne pouvait plus l’en r<strong>et</strong>irer. De<br />
douleur, le lapin s’est mis à pousser des cris <strong>et</strong> à prier le p<strong>et</strong>it<br />
bouc de l’aider à sortir de là. Le p<strong>et</strong>it bouc a saisi le lapin par<br />
les oreilles <strong>et</strong> il a tiré, tiré tant qu’il pouvait… Au point qu’il se<br />
disait qu’il allait lui arracher la tête, mais la tête a tenu. Seules,<br />
les oreilles se sont allongées, allongées.<br />
Et c’est depuis c<strong>et</strong>te fois-là que le lapin a de longues oreilles.<br />
Jiri Tomek, <strong>Contes</strong> arabes, traduit par Yv<strong>et</strong>te Joye, © Éditions Gründ.<br />
2 Raconter oralement un conte<br />
Dire <strong>et</strong> raconter des contes<br />
Conseils de méthode<br />
•Repérez les passages qui<br />
correspondent à votre rôle.<br />
•Écoutez bien les deux<br />
autres lecteurs.<br />
•Lisez de manière expressive<br />
en variant l’intonation <strong>et</strong><br />
le débit.<br />
SUJET : Par groupes de quatre élèves, racontez comme si vous étiez des conteurs (conteuses)<br />
le soir à la veillée, l’histoire de la p<strong>et</strong>ite Jeann<strong>et</strong>te ou celle d’un autre conte de la séquence.<br />
Préparation<br />
•Relisez le conte que vous avez choisi.<br />
•Répartissez-vous la tâche en respectant les<br />
étapes du conte :<br />
– la rencontre de Jeann<strong>et</strong>te avec le loup (l. 11<br />
à 22) ;<br />
– la progression de Jeann<strong>et</strong>te dans la forêt<br />
(l. 23 à 29) ;<br />
– Jeann<strong>et</strong>te <strong>et</strong> le loup chez la grand-mère (l. 30<br />
à 74) ;<br />
– la fuite de Jeann<strong>et</strong>te (l. 74 à la fin).<br />
Patrizia la Porta, Horoscope<br />
chinois : le signe du lapin, XX e siècle.<br />
© Patrizia La Porta/Leemage<br />
Conseils de méthode<br />
•Faites votre récit au passé composé de l’indicatif.<br />
•Racontez l’histoire avec vos propres mots.<br />
•Variez le ton quand vous faites parler<br />
Jeann<strong>et</strong>te ou le loup.<br />
•Pensez à vous adresser à votre auditoire <strong>et</strong> à<br />
le regarder.<br />
•Veillez à l’enchaînement des quatre étapes.
Lectures<br />
personnelles<br />
Marcel Aymé<br />
Les contes bleus du chat perché,<br />
© Folio Junior.<br />
Pour suivre les aventures de<br />
deux fill<strong>et</strong>tes, Delphine <strong>et</strong><br />
Marin<strong>et</strong>te, qui vivent à la ferme<br />
avec leurs parents <strong>et</strong> qui sont<br />
complices avec les animaux<br />
contre les adultes.<br />
Hans Christian<br />
Andersen<br />
La P<strong>et</strong>ite Sirène <strong>et</strong> autres contes,<br />
© Bibliocollège, Hach<strong>et</strong>te.<br />
Pour découvrir six contes<br />
d’Andersen, pleins d’émotions.<br />
Léopold Sédar<br />
Senghor<br />
La belle histoire de Leuk-le-Lièvre,<br />
© EDICEF<br />
Pour suivre les aventures de<br />
Leuk-le-Lièvre, personnage<br />
célèbre des contes africains<br />
qui triomphe grâce à son<br />
intelligence.<br />
Je poursuis<br />
mon carn<strong>et</strong><br />
de lectures<br />
personnelles<br />
(voir p. 33).<br />
Rudyard Kipling<br />
Histoires comme ça,<br />
© Folio Junior.<br />
Pour entrer dans la poésie<br />
de contes explicatifs qui<br />
se situent en différentes<br />
régions du monde.<br />
Amadou Hampâté Bâ<br />
P<strong>et</strong>it Bodiel <strong>et</strong> autres contes<br />
de la savane, © Stock, 1994<br />
Pour rire avec le p<strong>et</strong>it lièvre<br />
rusé des contes traditionnels<br />
peuls, qui trompe les grands<br />
personnages de la brousse.<br />
Birago Diop<br />
Les Nouveaux <strong>Contes</strong><br />
d’Amadou Koumba,<br />
© Présence africaine.<br />
Pour pénétrer dans l’univers<br />
tribal africain où les bêtes<br />
donnent des leçons aux<br />
hommes.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
87
Évaluations<br />
Léopold<br />
Sédar<br />
Senghor<br />
(1906-2001)<br />
C<strong>et</strong> écrivain sénégalais de langue<br />
française est un poète <strong>et</strong><br />
un homme politique. Il a été<br />
le premier président du Sénégal<br />
(1960-1980) <strong>et</strong> le premier<br />
Africain à siéger à l’Académie<br />
française.<br />
88<br />
Relisez « Faire le point » p. 81.<br />
◗ Lexique Proposez deux sens du mot « quête ». Qu’appelle-t-on des suffixes ?<br />
Voir p. 82.<br />
◗ Orthographe Avec quoi le participe passé s’accorde-t-il ? Voir p. 83.<br />
<strong>et</strong> conjugaison Donnez deux homophones de « conte ».<br />
Comment forme-t-on le passé composé d’un verbe ?<br />
◗ Grammaire Quand emploie-t-on le passé composé de l’indicatif ? Voir p. 84.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
5<br />
Apprendre à réviser<br />
Mame-Randatou, la fée<br />
Leuk-le-Lièvre, prisonnier des hommes, a réussi à s’échapper au prix de<br />
grandes souffrances physiques.<br />
Leuk a souvent entendu parler de Mame-Randatou, la fée. Tout<br />
le monde, au royaume des animaux comme au pays des hommes,<br />
connaît la renommée1 de Mame-Randatou. On dit qu’avec sa bagu<strong>et</strong>te<br />
magique elle transforme les chats en princes galants, les citrouilles en<br />
équipages2 <strong>et</strong> les souris en pages3 . On dit que, d’une simple caresse de<br />
la main, elle peut changer la forme de n’importe<br />
quel organe, guérir les maladies les plus graves. On<br />
dit… Mais qui pourrait dire tout ce qu’on raconte<br />
sur le grand pouvoir de Mame-Randatou, la fée?<br />
Après avoir soigné ses plaies <strong>et</strong> les douleurs de ses<br />
membres rompus4 .<br />
.<br />
.<br />
.<br />
10<br />
.<br />
, Leuk va trouver Mame-Randatou,<br />
. la fée.<br />
. «Je sais le but de ta visite, dit celle-ci, aussitôt que<br />
. Leuk franchit le seuil de sa porte. C’est l’Homme<br />
15 qui t’a causé les maux que je vois sur ton corps:<br />
. oreilles allongées, queue coupée, pattes de derrière<br />
. déformées.<br />
. – C’est exact, répond tristement Leuk, en baissant<br />
. la tête.<br />
20 – Je peux refaire ces membres comme tu les avais<br />
. auparavant, poursuit Mame-Randatou. Mais je peux<br />
. aussi les laisser comme ils sont, en les arrangeant de<br />
. belle façon.<br />
1. renommée : célébrité.<br />
2. équipages : carrosses.<br />
3. pages : jeunes nobles au service des princes.<br />
4. rompus : brisés.
5. traiter : soigner.<br />
.<br />
25<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
30<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
Compréhension du texte<br />
1. Peut-on dire sur quel continent l’histoire se passe ?<br />
Justifiez.<br />
2. a. Qui est le héros du conte ?<br />
b. Ce personnage a-t-il des caractéristiques humaines<br />
ou animales ? Justifiez.<br />
3. Le second personnage du conte appartient-il à la<br />
réalité ou au merveilleux ? Justifiez.<br />
4. Quelle est la quête du héros au début du texte?<br />
5. a. Que lui propose son interlocutrice ?<br />
b. Le héros fait-il preuve de sagesse ? Expliquez.<br />
6. Quelle est la quête du héros à la fin du texte ?<br />
7. Ce texte peut-il être lu comme un conte explicatif ?<br />
Justifiez.<br />
Expression écrite<br />
Choisissez l’une des missions confiées par Mame-<br />
Randatou à Leuk-le-Lièvre <strong>et</strong> racontez sa réalisation.<br />
Méthode<br />
• Relevez le passage où Mame-Randatou<br />
exprime ses exigences.<br />
• Racontez la mission que vous avez<br />
choisie en insistant sur le côté risqué<br />
de l’expédition <strong>et</strong> sur l’intelligence<br />
du héros.<br />
• Vous rédigerez votre récit au présent<br />
<strong>et</strong> au passé composé.<br />
– Que faut-il préférer? interroge Leuk.<br />
– Si tu gardes tes longues oreilles, tu entendras mieux; si tu gardes tes<br />
longues pattes, tu courras mieux; <strong>et</strong> ta queue écourtée te perm<strong>et</strong>tra<br />
de mieux sauter.<br />
– Je préfère donc conserver ces membres tels qu’ils sont maintenant.<br />
– Je te préviens, dit Mame-Randatou, que mon travail coûtera cher.<br />
Il me faut un peu de lait d’éléphant, un peu de lait de baleine, une dent<br />
de lion <strong>et</strong> une griffe de panthère. Mais la dent <strong>et</strong> la griffe que<br />
je veux ne devront pas être prises sur des cadavres.<br />
– Marché conclu!» dit Leuk, qui se fait traiter 5 <strong>et</strong> qui s’en va en répétant<br />
sa promesse.<br />
Léopold Sedar Senghor <strong>et</strong> Abdoulaye Sadji,<br />
La belle histoire de Leuk-le-Lièvre, coll. «Afrique en poche cad<strong>et</strong>», © NEA/EDICEF, 1990.<br />
Étude de la langue<br />
1. a. À quel temps les verbes du récit sont-ils conjugués<br />
? Donnez un exemple.<br />
b. À quel temps le verbe de la première phrase est-il<br />
conjugué ? Pourquoi ?<br />
2. « oreilles allongées, queue coupée, pattes de derrière<br />
déformées. », l. 16-17:<br />
a. Relevez les trois participes passés.<br />
b. De quel verbe chacun d’eux provient-il ?<br />
3. a. Quelle est la fonction grammaticale de « Mame-<br />
Randatou la fée », l. 1 ?<br />
b. L. 13-14, quel est le COD du verbe « savoir » ? celui<br />
du verbe « franchir » ?<br />
4. L. 3, a. quel est le sens du nom « bagu<strong>et</strong>te » ?<br />
b. Proposez une phrase comportant le mot «bagu<strong>et</strong>te»<br />
qui aura un sens différent de celui du texte.<br />
Lecture d’image<br />
1. Le dessin renseigne-t-il sur le lieu de l’histoire ?<br />
Justifiez.<br />
2. La représentation des personnages relève-t-elle de<br />
la réalité ? du merveilleux ? Expliquez.<br />
3 u <strong>Contes</strong> d’ici <strong>et</strong> d’ailleurs<br />
89