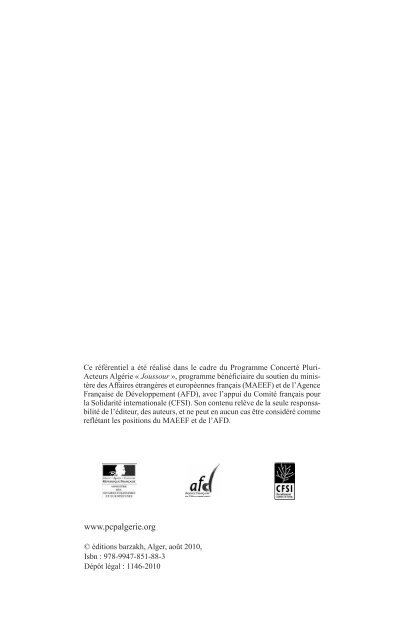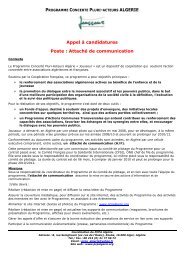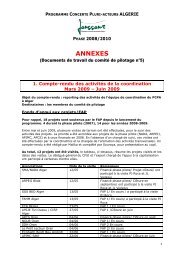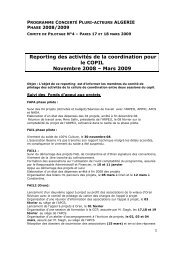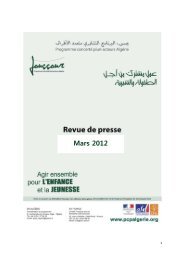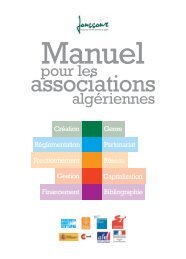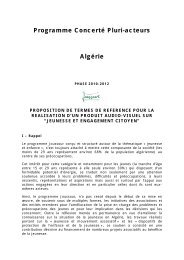ˇ - PCPA Algérie
ˇ - PCPA Algérie
ˇ - PCPA Algérie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ce référentiel a été réalisé dans le cadre du Programme Concerté Pluri-<br />
Acteurs <strong>Algérie</strong> « Joussour », programme bénéficiaire du soutien du ministère<br />
des Affaires étrangères et européennes français (MAEEF) et de l’Agence<br />
Française de Développement (AFD), avec l’appui du Comité français pour<br />
la Solidarité internationale (CFSi). Son contenu relève de la seule responsabilité<br />
de l’éditeur, des auteurs, et ne peut en aucun cas être considéré comme<br />
reflétant les positions du MAEEF et de l’AFD.<br />
www.pcpalgerie.org<br />
© éditions barzakh, Alger, août 2010,<br />
isbn : 978-9947-851-88-3<br />
Dépôt légal : 1146-2010
Bouchra Fridi Kessaï<br />
RéFéREntiEl<br />
DES DiSPoSitiFS DE PRotECtion<br />
DE l’EnFAnCE Et DE lA jEunESSE
SoMMAiRE<br />
introduction ..........................................................................................................................................07<br />
Présentation du document...........................................................................................................12<br />
la « Protection de l’enfant » dans le cadre de la<br />
Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant....................................15<br />
la « Protection de l’enfant », approche et stratégie de l’uniCEF ..................23<br />
la « Protection de l’enfant » dans le cadre législatif algérien ............................29<br />
l’accès aux soins ......................................................................................................................33<br />
l’accès à l’éducation..............................................................................................................38<br />
les dispositifs de protection de l’enfant............................................................................41<br />
les enfants privés de soins parentaux.........................................................................43<br />
Précarité et violence à l’égard des enfants ...............................................................48<br />
les enfants touchés par le ViH/SiDA,<br />
par la consommation de drogues et la toxicomanie ...........................................71<br />
le travail des enfants .............................................................................................................83<br />
les enfants ayant affaire avec la justice ....................................................................89<br />
les enfants ayant des besoins spécifiques :<br />
. les enfants en situation de handicap....................................................................96<br />
. les enfants en hospitalisation de longue durée .............................................113<br />
illustrations d’interventions de protection de l’enfant réalisées<br />
dans une dynamique de travail de réseau..........................................................................123<br />
organisations ressources ............................................................................129<br />
Références documentaires ..........................................................................................................133<br />
textes internationaux.............................................................................................................135<br />
textes législatifs nationaux................................................................................................135<br />
études et rapports.....................................................................................................................137
introduction
introduction<br />
la réalisation de ce référentiel sur les dispositifs de protection de l’enfance et de<br />
la jeunesse, répond au souci de mettre à la disposition des acteurs qui œuvrent dans<br />
le champ de l’enfance et de la jeunesse en <strong>Algérie</strong>, un outil de travail qui leur permet<br />
d’intervenir de façon adaptée au contexte local, en conformité avec une approche<br />
universelle et conventionnelle de la protection de l’enfance.<br />
Ce document est produit dans le cadre du Programme Concerté Pluri-Acteurs <strong>PCPA</strong><br />
Joussour, dispositif de coopération algéro-français qui vise à renforcer l’action des<br />
acteurs de la société civile sur le terrain, à améliorer la qualité de leur dialogue collectif<br />
avec les pouvoirs publics et à encourager le partenariat entre les associations<br />
algériennes et françaises ou européennes.<br />
Ce programme qui bénéficie du soutien financier du ministère des Affaires étrangères<br />
français et de l’Agence Française de Développement, vient concrètement<br />
en aide à des associations algériennes qui mettent en œuvre des projets tentant<br />
d’apporter une réponse à des problématiques vécues par les jeunes et les enfants,<br />
dans des domaines aussi variés que la protection et la promotion des droits des<br />
enfants, la lutte contre toute forme de maltraitance, la lutte contre la déscolarisation,<br />
le phénomène de la migration clandestine, l’insertion professionnelle des<br />
jeunes, l’éducation citoyenne, les loisirs, etc.<br />
la gestion de ces questions sensibles est, en effet, de plus en plus investie par la<br />
société civile qui, force est de le constater, dispose de peu de moyens matériels et<br />
de ressources humaines qualifiées pour mener à bien ses missions.<br />
les lois et les dispositifs/services existants qu’ils soient institutionnels ou émanant<br />
des associations sont méconnus par les acteurs associatifs qui expriment la nécessité<br />
d’améliorer leurs connaissances et développer leur savoir-faire aussi bien en matière<br />
de protection qu’en matière de prise en charge, notamment par l’accès à une<br />
information fiable et de qualité.<br />
C’est dans ce cadre et avec pour finalité de pallier ce déficit d’information qu’a été<br />
donc préconisée la mise en place de ce référentiel des dispositifs de protection de<br />
l’enfance et de la jeunesse.<br />
9
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
APPRoCHE « PRotECtion DE l’EnFAnt »<br />
la création de tout dispositif de protection de l’enfance et de la jeunesse s’inscrit<br />
dans le cadre de la reconnaissance des droits de l’enfant et plus particulièrement<br />
de son droit à une protection spéciale en lien avec sa position d’enfant, position de<br />
dépendance et de vulnérabilité.<br />
En effet, le concept « Protection » est complètement interdépendant du concept<br />
« Droit ». les droits de l’enfant sont consacrés dans la Convention internationale<br />
relative aux Droits de l’Enfant. nous ne pouvons comprendre pourquoi l’enfant a<br />
besoin d’une protection, ni envisager une action de protection de l’enfant sans nous<br />
appuyer sur la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant (CiDE).<br />
l’approche « Protection de l’enfant » adoptée pour ce référentiel est donc celle définie<br />
dans le cadre de la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant.<br />
Pour mieux comprendre comment elle fonctionne, la stratégie de sa mise en œuvre<br />
sera également présentée, telle que préconisée par l’uniCEF, Fonds des nations<br />
unies pour l’Enfance, chargé par l’Assemblée générale des nations unies de promouvoir<br />
et de veiller à l’application de la CiDE dans le monde (cf. la mission de<br />
l’uniCEF 1 ).<br />
DéFinition DES ConCEPtS<br />
« EnFAnCE » Et « jEunESSE »<br />
il est important, avant de poursuivre, de définir l’âge des populations désignées<br />
par les termes « enfance » et « jeunesse » :<br />
Dans le langage commun, « l’enfant » désigne une personne pré-pubère, de 0 à environ<br />
13 ans, tandis qu’ « un jeune » désigne une personne âgée de 13 jusque 25<br />
ans parfois même au-delà. un jeune peut être un adolescent ou un jeune adulte,<br />
une personne mineure ou une personne majeure. la limite d’âge entre jeune et<br />
jeune adulte est très diffuse.<br />
Dans le droit, aussi bien civil que pénal, il n’existe que deux termes qui distinguent<br />
les 3 catégories : enfants, jeunes et adultes. il s’agit de personnes « mineures » ou<br />
de personnes « majeures ». l’article 40 du code civil algérien fixe la majorité à<br />
l’âge de 19 ans révolus. Cependant, le code pénal en son article 49, fixe le début<br />
de la responsabilité pénale à 13 ans : « … le mineur de 13 à 18 ans peut faire<br />
l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées ».<br />
1. http://www.unicef.org/french/about/who/index_mission.html<br />
10
Dans la Convention internationale relative aux Droits de l’Enfant, le terme « enfant<br />
» désigne toute personne âgée entre 0 et 18 ans. Quand le terme « jeune » est<br />
utilisé, il concerne toujours les enfants âgés entre 13 et 18 ans. il concerne des mineurs.<br />
À cet effet, la protection ne peut concerner que des personnes mineures. Quand<br />
il s’agit des jeunes, la préoccupation à leur sujet est plutôt relative à leur insertion<br />
sociale, professionnelle et économique.<br />
le présent référentiel, considère prioritairement la protection des personnes mineures.<br />
C’est ainsi que le terme « enfant » au sens de la CiDE, sera plus souvent<br />
utilisé que le terme « jeune ».<br />
MétHoDologiE<br />
le terme référentiel utilisé ici renvoie à un ensemble de connaissances et de données<br />
d’expériences, des données relatives à un savoir et un savoir-faire, réunies et<br />
structurées de telle sorte que l’utilisateur puisse en extraire les éléments d’informations<br />
pertinents pour le traitement d’une question ou d’une problématique.<br />
Ce référentiel est à considérer comme un recueil de données strictement descriptif et<br />
informatif qui réunit de façon exhaustive les références des textes législatifs et réglementaires,<br />
les références des publications, ainsi que l’identification des services<br />
relatifs à la protection de l’enfance.<br />
Sa construction est fondée sur une double démarche : une recherche documentaire<br />
et une enquête de terrain. En effet, afin de conforter le caractère pratique visé, il<br />
est apparu pertinent d’explorer sur le terrain l’opérationnalisation concrète de<br />
quelques-uns des dispositifs institutionnels et associatifs.<br />
l’intention est de proposer un document-guide qui aide l’intervenant du milieu<br />
associatif ou institutionnel à retrouver les principales données qui permettent :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
d’intervenir conformément à une approche conventionnelle de la « Protection<br />
de l’enfant » ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
introduction<br />
d’être informé des dispositions législatives algériennes dans ce domaine ;<br />
de se familiariser avec les modalités d’opérationnalisation de la protection de<br />
l’enfant par les institutions publiques et le mouvement associatif algériens.<br />
11
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
Malgré quelques contraintes rencontrées dans l’accès à toutes les informations existantes,<br />
un nombre suffisamment représentatif d’associations membres de Joussour<br />
et de services publics ont pu faire l’objet de rencontres, dans plusieurs régions<br />
d’<strong>Algérie</strong> : Alger, Blida, Constantine, Bordj Bou Arreridj, Sétif et oran.<br />
PlAn Du RéFéREntiEl<br />
le référentiel s’articule en trois parties.<br />
une présentation explicative de la Convention Internationale relative aux Droits<br />
de l’Enfant, CiDE, est suivie de l’exposé de l’approche « Protection de l’enfant »<br />
et de la stratégie « Pour instaurer un environnement protecteur pour les enfants »,<br />
développés par l’unicef.<br />
l’<strong>Algérie</strong> a ratifié la CiDE le 19 décembre 1992. Depuis cette date, des textes de<br />
loi ont été révisés, amendés pour être conformes aux textes internationaux. l’<strong>Algérie</strong><br />
a créé, restructuré des services dans les différents secteurs d’activités en lien<br />
avec l’enfance afin qu’ils offrent des prestations mieux adaptées à la protection des<br />
enfants, de tous les enfants.<br />
Ces services sont insuffisamment exploités par les intervenants et parfois difficilement<br />
accessibles aux usagers. Afin d’explorer les dispositions législatives et les<br />
dispositifs que l’<strong>Algérie</strong> a mis en place pour promouvoir et développer une protection<br />
de l’enfant, il sera aussi fait référence au « Plan national d’Action pour les<br />
enfants, 2008-2015, « une <strong>Algérie</strong> digne des enfants ». En effet, ce document est<br />
le premier texte législatif algérien consacré exclusivement à l’enfance et traitant<br />
toutes les questions relatives aux droits des enfants en <strong>Algérie</strong>. le PnA contient<br />
une description assez exhaustive des dispositifs, en termes de textes de loi et en<br />
termes de services offerts. Ce texte définit les droits de l’enfant et la stratégie adoptée<br />
par l’état algérien pour les années 2008 à 2015. il pose comme base pour la<br />
protection de l’enfant, deux priorités : l’accès aux soins et l’accès à l’éducation.<br />
le mouvement associatif algérien est de plus en plus reconnu et légitimé dans son<br />
action par les pouvoirs publics et la société civile. il développe des activités et des<br />
projets structurés poursuivant des objectifs planifiés dans lesquels la protection de<br />
l’enfance et de la jeunesse occupe une place importante. Dans ce cadre, les associations<br />
s’emploient à proposer des services diversifiés et adaptés aux spécificités<br />
locales des populations ciblées. on peut regretter que ces actions ne soient connues,<br />
le plus souvent, qu’à une échelle locale. le référentiel vise à rendre visibles ces<br />
12
différentes offres de services, et de mettre en valeur leurs modalités particulières<br />
de fonctionnement.<br />
la description des dispositifs associatifs et institutionnels est articulée à travers la<br />
présentation des situations nécessitant une protection spéciale de l’enfant. nous<br />
avons sélectionné 6 situations en nous appuyant sur les 12 identifiées par l’uniCEF<br />
et en tenant compte des spécificités de la situation des enfants en <strong>Algérie</strong> :<br />
les enfants privés de soins parentaux<br />
les enfants victimes de violence et de précarité<br />
les enfants touchés par le ViH/SiDA, par la consommation de drogues et<br />
la toxicomanie<br />
le travail des enfants<br />
les enfants ayant affaire avec la justice<br />
les enfants ayant des besoins spécifiques<br />
introduction<br />
Sur la base de ces trois axes et de ces six clés d’entrée, des fiches ont été élaborées<br />
portant sur la réglementation internationale, puis le cadre législatif algérien suivi<br />
des dispositifs institutionnels et associatifs existants.<br />
la réalisation du référentiel s’est déroulée du mois de janvier au mois de mai 2010.<br />
il représente une version de la situation des dispositifs en termes de textes et en<br />
termes de services à un moment délimité. les textes sont appelés à être modifiés<br />
et même abrogés tandis que les pratiques évoluent. À ce titre, la sélection des 6 situations<br />
de protection de l’enfant prises en considération correspond à une réalité<br />
ponctuelle. l’on peut considérer que la nature, la qualité et la quantité des informations<br />
recueillies pour chacune d’elles reflètent en quelque sorte la nature de la<br />
mobilisation des acteurs à les prendre en charge aussi bien d’un point de vue du<br />
cadre législatif que de services offerts en ce début d’année 2010.<br />
En fait ce premier référentiel des dispositifs de protection de l’enfant pose le cadre<br />
conceptuel et législatif de la Protection de l’enfant. la proposition, qui peut être<br />
développée par ailleurs, pour qu’il corresponde au mieux à une réalité complexe<br />
et en constante évolution, est de le convertir en une version électronique interactive<br />
pouvant être questionnée, complétée et régulièrement mise à jour.<br />
Pour finir, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la<br />
production de ce référentiel en acceptant de nous rencontrer.<br />
13
la « protection de l’enfant »<br />
dans le cadre de la convention<br />
internationale relative<br />
aux droits de l’enfant (cide)<br />
2. www.unicef.org/french/crc/<br />
Extraits de la présentation de l’UNICEF 2 .
Un instrUment ayant force obligatoire<br />
la convention relative aux droits de l’enfant est le premier instrument juridique<br />
international ayant force obligatoire qui énonce toute la panoplie des droits de<br />
l’homme civils, culturels, économiques, politiques et sociaux. en 1989, les dirigeants<br />
mondiaux ont décidé que les enfants devaient avoir une convention spéciale<br />
juste pour eux, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d’une protection et d’une<br />
assistance spéciales. c’était aussi un moyen de s’assurer que le monde reconnaissait<br />
que les enfants, eux aussi, avaient des droits.<br />
Dans 54 articles et deux Protocoles facultatifs, la convention énonce les droits fondamentaux<br />
qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la survie; le droit<br />
de se développer dans toute la mesure du possible; le droit d’être protégé contre les<br />
influences nocives, les mauvais traitements et l’exploitation; et de participer à part<br />
entière à la vie familiale, culturelle et sociale. les quatre principes fondamentaux de<br />
la convention sont la non-discrimination ; la priorité donnée à l’intérêt supérieur de<br />
l’enfant ; le droit de vivre, de survivre et de se développer ; et le respect des opinions<br />
de l’enfant. la convention protège les droits des enfants en fixant des normes en<br />
matière de soins de santé, d’éducation et de services juridiques, civils et sociaux.<br />
les Droits De l’enfant<br />
Dans le caDre Des Droits De l’homme<br />
l’organisation des nations unies a défini une norme commune en matière de droits<br />
de l’homme en adoptant la Déclaration universelle des droits de l’homme en 1948.<br />
les instruments du cadre international des droits de l’homme sont :<br />
la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948)<br />
et les six principaux traités de défense de ces droits :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
convention internationale pour les droits de l’enfant<br />
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP) ;<br />
le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et<br />
culturels (PIRDESC) ;<br />
la Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE, 1989) ;<br />
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,<br />
inhumains ou dégradants (Convention sur la torture) ;<br />
17
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de<br />
discrimination raciale (Convention sur la discrimination raciale) ;<br />
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à<br />
l’égard des femmes (Convention sur les femmes).<br />
tous les pays ont ratifié au moins un, si ce n’est la majorité de ces traités. ces documents<br />
sont importants pour établir la responsabilité des gouvernements en matière<br />
de respect, de défense et d’exercice des droits individuels dans leur pays.<br />
Une convention sPécifiqUe PoUr les enfants<br />
les droits de l’homme concernent tous les groupes d’âge et les enfants ont les<br />
mêmes droits que les adultes. mais en raison de leur vulnérabilité, ils ont aussi des<br />
droits spécifiques qui reconnaissent qu’ils ont besoin d’une protection spéciale.<br />
en dépit de ces droits, les enfants souffrent de la pauvreté, du manque d’un logis,<br />
de mauvais traitements, de la négligence, de maladies évitables, d’un accès inégal<br />
à l’éducation et de procédures judiciaires qui ne tiennent pas compte de leurs besoins<br />
spéciaux. ces problèmes se rencontrent aussi bien dans les pays industrialisés<br />
que dans les pays en développement.<br />
en ratifiant la ciDe, les gouvernements déclarent leur intention de mettre cet engagement<br />
en pratique. les états parties sont tenus d’amender leur législation et<br />
d’adopter de nouvelles lois et de nouvelles politiques pour mettre pleinement en<br />
œuvre la convention. ils doivent envisager toutes les mesures à prendre en fonction<br />
de l’intérêt supérieur de l’enfant.<br />
la convention relative aux droits de l’enfant énonce les droits qui doivent être respectés<br />
pour que les enfants puissent développer tout leur potentiel, être à l’abri de la<br />
faim et du besoin, et être protégés de la négligence et des mauvais traitements. elle<br />
reflète une nouvelle vision de l’enfant. les enfants ne sont pas la propriété de leurs<br />
parents, pas plus qu’ils ne sont des bénéficiaires passifs de notre charité. ce sont des<br />
êtres humains et ils sont sujets de leurs propres droits. la convention voit l’enfant<br />
en tant qu’individu et membre d’une famille et d’une communauté, et lui reconnaît<br />
des droits et des responsabilités qui correspondent à son âge et à sa maturité.<br />
le rôle Des goUvernements, Des familles et Des enfants<br />
bien que la convention relative aux droits de l’enfant s’adresse aux gouvernements<br />
en tant que représentants du peuple, elle engage en réalité la responsabilité de tous<br />
les membres de la société. Dans l’ensemble, ses normes ne seront appliquées que si<br />
18
convention internationale pour les droits de l’enfant<br />
tout le monde les accepte – les parents et membres de la famille et de la communauté,<br />
les professionnels et les personnes qui travaillent dans les institutions publiques<br />
et privées, dans les services destinés aux enfants, au tribunal et à tous les<br />
niveaux de l‘administration – et que si chacune de ces personnes s’acquitte de son<br />
rôle ou de ses fonctions spécifiques pour les faire respecter.<br />
les gouvernements sont tenus de reconnaître l’ensemble des droits de chaque enfant,<br />
et de prendre les enfants en considération dans leurs décisions législatives et politiques.<br />
les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions et de voir leurs avis pris au sérieux.<br />
mais ils ont aussi la responsabilité de respecter les droits des autres, en particulier,<br />
ceux de leurs parents. quoique beaucoup d’états commencent à écouter sérieusement<br />
ce que les enfants ont à dire sur un grand nombre de problèmes importants, le<br />
processus du changement n’est encore qu’à ses débuts.<br />
la convention décrit spécifiquement la famille comme l’unité fondamentale de la<br />
société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres,<br />
et en particulier les enfants. la responsabilité d’élever les enfants revient en priorité<br />
aux parents. aux termes de la convention, les états reconnaissent que les parents<br />
sont principalement responsables des soins et des conseils à dispenser aux enfants.<br />
ils doivent les aider dans cette tâche en leur offrant une assistance matérielle et des<br />
programmes de soutien. les états doivent aussi empêcher que les enfants soient<br />
séparés de leur famille, à moins que cette séparation ne soit nécessaire dans l’intérêt<br />
supérieur de l’enfant.<br />
les Droits énoncés Dans la convention<br />
relative aUx Droits De l’enfant<br />
la convention relative aux droits de l’enfant a été le premier instrument à énoncer<br />
toute la gamme des droits humains internationaux – y compris les droits civils, culturels,<br />
économiques, politiques et sociaux et certains aspects du droit humanitaire.<br />
les articles de la convention peuvent être regroupés en quatre catégories de droits<br />
et un ensemble de principes directeurs. Des clauses supplémentaires (articles 43 à<br />
54) proposent des mesures de mise en œuvre de la convention, en expliquant comment<br />
les gouvernements et des organisations internationales comme l’Unicef<br />
peuvent s’assurer que les droits des enfants sont protégés.<br />
les principes directeurs de la convention sont la non-discrimination ; la priorité<br />
donnée à l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la vie, à la survie et au développement<br />
; et le droit de participer. ils représentent les conditions nécessaires à<br />
l’exercice de tous les droits.<br />
19
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
le droit à la survie et au développement : on entend par là le droit aux ressources,<br />
aux compétences et à l’aide dont un enfant a besoin pour survivre et se développer<br />
au mieux de ses capacités. il s’agit, entre autres, du droit à une alimentation adéquate,<br />
à un logis, à de l’eau propre, à une éducation conventionnelle, aux soins de<br />
santé primaire, aux loisirs et à la détente, aux activités culturelles et à des informations<br />
sur ses droits. ces droits présupposent non seulement l’existence des moyens<br />
requis pour les mettre en œuvre, et leur accessibilité. Des articles spécifiques traitent<br />
des besoins des enfants réfugiés, des enfants handicapés et des enfants de<br />
groupes minoritaires ou autochtones.<br />
le droit d’être protégé : l’enfant a le droit à une protection contre toutes les formes<br />
de sévices, de négligence, d’exploitation et de cruauté, y compris une protection<br />
spéciale en temps de guerre et une protection contre les mauvais traitements infligés<br />
dans le cadre du système de justice pénale.<br />
le droit de participer : l’enfant est libre d’exprimer des opinions et a le droit de donner<br />
son avis sur des questions qui ont une incidence sur sa vie sociale, économique, religieuse,<br />
culturelle et politique. le droit de participer recouvre le droit d’exprimer<br />
des opinions et d’être entendu, le droit à l’information et la liberté d’association. À<br />
mesure qu’ils grandissent, les enfants auxquels on reconnaît ces droits apprennent à<br />
exercer tous leurs autres droits et se préparent à jouer un rôle actif dans la société.<br />
l’égalité et l’interdépendance des droits sont soulignées dans la convention. si les<br />
gouvernements ont des obligations, les enfants et les parents ont quant à eux la responsabilité<br />
de respecter les droits d’autrui et en particulier, leurs droits mutuels. la<br />
compréhension des droits qu’ont les enfants dépendra de leur âge et les parents doivent<br />
adapter au degré de maturité de chaque enfant les questions qu’ils soulèvent avec lui,<br />
les réponses qu’ils font à ses questions et les méthodes qu’ils utilisent à cet effet.<br />
Protocoles facUltatifs À la convention<br />
relative aUx Droits De l’enfant<br />
Pour mettre fin aux mauvais traitements et à l’exploitation croissante des enfants<br />
dans le monde, l’assemblée générale des nations unies a adopté en 2000 deux protocoles<br />
facultatifs à la convention, afin de renforcer la protection des enfants contre<br />
la participation à des conflits armés et contre l’exploitation sexuelle.<br />
Le Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés fixe à<br />
18 ans l’âge minimum du recrutement obligatoire et demande aux états de mettre<br />
tout en œuvre pour empêcher que des jeunes de moins de 18 ans ne prennent part<br />
directement aux hostilités.<br />
20
Le Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie<br />
impliquant des enfants demande que ces graves violations des droits des<br />
enfants soient reconnues comme des crimes, et souligne qu’il est essentiel de sensibiliser<br />
le public et d’encourager une meilleure coopération internationale pour<br />
les combattre.<br />
mise en œUvre De la convention<br />
le comité Des Droits De l’enfant<br />
les gouvernements qui ratifient la convention ou l’un de ses protocoles facultatifs<br />
doivent soumettre des rapports au comité des droits de l’enfant. ce comité regroupe<br />
18 experts des droits des enfants issus de pays et de systèmes juridiques<br />
différents. ces experts sont nommés et élus par les états parties mais agissent à<br />
titre personnel, sans représenter leur pays. les rapports décrivent la situation des<br />
enfants dans le pays et expliquent les mesures prises pour garantir leurs droits.<br />
Dans ses analyses des rapports des états, le comité exhorte tous les niveaux du<br />
gouvernement à se référer à la convention pour l’élaboration de leur politique et<br />
de sa mise en œuvre. la convention devrait servir de point de référence et de source<br />
d’inspiration principale dans tout ce qu’entreprennent les gouvernements.<br />
les états soumettent des rapports sur la situation des droits des enfants dans leur<br />
pays au comité dans les deux ans qui suivent la ratification, et tous les cinq ans<br />
par la suite.<br />
lorsqu’il examine ces rapports, le comité cherche à savoir avec quel succès les<br />
gouvernements fixent et respectent les normes de réalisation et de protection des<br />
droits de l’enfant énoncés dans la convention ou le Protocole facultatif.<br />
le rôle De l’Unicef<br />
Dans le ProcessUs De sUrveillance<br />
convention internationale pour les droits de l’enfant<br />
la convention relative aux droits de l’enfant est le premier traité de défense des<br />
droits de l’homme à confier sa mise en œuvre à une institution spécialisée des nations<br />
Unies, en l’occurrence, l’Unicef. aux termes de la convention, l’Unicef<br />
a l’obligation juridique de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant en soutenant<br />
les travaux du comité des droits de l’enfant. outre les conseils et l’assistance<br />
qu’il apporte au comité, l’Unicef appuie la tenue de vastes consultations au sein<br />
des états pour améliorer la précision et l’impact des rapports soumis au comité.<br />
21
la « protection de l’enfant »,<br />
approche et stratégie de l’unicef<br />
Extraits des fiches d’information sur la « Protection de l’enfant »,<br />
UNICEF, mai 2006 3 .<br />
3. http://www.unicef.org/french/publications/index_34146.html
QU’EST-CE QUE LA PROTECTION DE L’ENFANT ?<br />
Par « protection de l’enfant », l’UNICEF fait référence à la prévention et à la lutte<br />
contre la violence, l’exploitation et les mauvais traitements infligés aux enfants, y<br />
compris l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, la traite et le travail des enfants<br />
et les pratiques traditionnelles préjudiciables, comme les mutilations génitales<br />
féminines/ l’excision et le mariage des enfants. Les programmes de protection de<br />
l’enfance de l’UNICEF ciblent également les enfants qui sont tout particulièrement<br />
à la merci de ces mauvais traitements, parce qu’ils vivent par exemple sans la protection<br />
de leurs parents, ont eu maille à partir avec la justice ou vivent en période de<br />
conflits armés. Les violations du droit des enfants à être protégés se produisent dans<br />
tous les pays et constituent, en plus de violations des droits fondamentaux de la personne<br />
humaine, des obstacles très importants à la survie et au développement de<br />
l’enfant, qui sont insuffisamment reconnus et signalés. Les enfants victimes de violence,<br />
d’exploitation, de maltraitance et de soins insuffisants risquent de mourir, de<br />
subir des problèmes de santé physique et mentale, de contracter le VIH/SIDA,<br />
d’avoir des problèmes éducatifs, d’être déplacés, sans-abri ou vagabonds et de ne<br />
pouvoir assumer correctement à l’âge adulte leur rôle de parent.<br />
INSTAURER UN ENVIRONNEMENT<br />
PROTECTEUR POUR LES ENFANTS<br />
L’instauration d’un environnement protecteur qui contribuera à prévenir et à combattre<br />
la violence, la maltraitance et l’exploitation des enfants comprend huit<br />
composantes essentielles :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
UNICEF<br />
Renforcer l’engagement des gouvernements et leur capacité à garantir le droit<br />
des enfants à être protégés ;<br />
Promouvoir l’adoption et l’application de législation adéquate ;<br />
Combattre les mentalités, coutumes et pratiques préjudiciables ;<br />
Favoriser, notamment à l’aide des médias et des partenaires de la société civile,<br />
un libre débat portant sur les questions relatives à la protection de l’enfance ;<br />
Renforcer les compétences, les connaissances et la participation des enfants ;<br />
Accroître la capacité d’action des familles et des communautés ;<br />
25
RéFéRENtIEl dEs dIsposItIFs dE pRotECtIoN dE l’ENFaNCE Et dE la jEUNEssE<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Fournir des services essentiels de prévention, de réadaptation et de réinsertion,<br />
notamment des soins de santé de base, une éducation et une protection ;<br />
Établir et mettre en œuvre un suivi, un compte-rendu et une surveillance<br />
continuels et efficaces.<br />
STRATÉGIE DE RENFORCEMENT DE L’ENVIRONNEMENT<br />
PROTECTEUR POUR LES ENFANTS<br />
L’action de l’UNICEF et de ses partenaires se compose des éléments suivants :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Mobilisation internationale, souvent à l’aide de mécanismes internationaux<br />
de défense des droits de l’homme ;<br />
Mobilisation nationale et instauration d’un dialogue à tous les niveaux – du<br />
gouvernement aux communautés, aux familles et aux enfants eux-mêmes – afin<br />
de promouvoir des mentalités et pratiques qui contribuent à protéger les enfants ;<br />
Intégration dans les plans de développement nationaux des questions relatives<br />
à <strong>ˇ</strong> la protection de l’enfance ;<br />
Approches axées sur la législation, soulignant qu’il est important de connaître,<br />
<strong>ˇ</strong> de comprendre, d’accepter et d’appliquer les normes juridiques relatives<br />
à la protection de l’enfance ;<br />
Approches axées sur la communauté, qui favorisent et renforcent la capacité des<br />
<strong>ˇ</strong> familles et des communautés à remédier aux problèmes de protection de l’enfance ;<br />
Partenariat avec les gouvernements, organisations non gouvernementales<br />
<strong>ˇ</strong> ou confessionnelles, d’autres organismes des Nations Unies, des associations<br />
professionnelles, les enfants et les jeunes, et les médias.<br />
LA PROTECTION DE L’ENFANT, LES OMD<br />
ET LA DÉCLARATION DU MILLÉNAIRE<br />
Les dirigeants du monde se sont engagés à respecter le droit des enfants à la survie,<br />
à la santé, à l’éducation, à la protection et à la participation – entre autres – au<br />
Sommet du Millénaire de septembre 2000, qui a abouti à la Déclaration du Millénaire<br />
et, par la suite, à l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement<br />
(OMD). La Déclaration et les OMD ont été réaffirmés lors du Sommet<br />
mondial de 2005. Fondés sur les droits humains fondamentaux, ils représentent<br />
un cadre de travail permettant à l’ensemble du système des Nations unies de poursuivre<br />
de manière cohérente une série d’objectifs concrets pour le développement<br />
humain.<br />
26
EN PROTÉGEANT LES ENFANTS,<br />
ON FAVORISE LE DÉVELOPPEMENT<br />
UNICEF<br />
La Déclaration du Millénaire aborde directement la question de la protection de<br />
l’enfant. En regardant de plus près les OMD, on s’aperçoit qu’aucun de ces objectifs<br />
ne peut être atteint si la protection de l’enfant ne fait partie intégrante des stratégies<br />
de programmation. Si l’on ne protège pas les enfants contre la violence à<br />
l’école, le travail à risque ou l’exploitation économique, les pratiques traditionnelles<br />
préjudiciables, l’absence de soins parentaux ou l’exploitation sexuelle, on gaspille<br />
les ressources les plus précieuses de la planète. En aidant les populations les plus<br />
vulnérables et les plus isolées, on contribue à la santé et au bien-être de tous, ce<br />
qui est indispensable pour réaliser les OMD :<br />
OMD 1 : éradiquer la pauvreté extrême et la faim<br />
OMD 2 : réaliser l’éducation primaire universelle<br />
OMD 3 : promouvoir l’égalité des sexes et donner aux femmes<br />
les moyens de se prendre en charge<br />
OMD 4 : réduire la mortalité infantile<br />
OMD 5 : améliorer la santé maternelle<br />
OMD 6 : lutter contre le VIH /SIDA, le paludisme et d’autres maladies<br />
OMD 7 : garantir la durabilité de l’environnement<br />
OMD 8 : créer un partenariat mondial pour le développement<br />
Les questions relatives à la protection de l’enfance sont directement liées aux objectifs<br />
du Millénaire pour le développement (OMD). La plupart des OMD ne peuvent<br />
tout simplement pas être réalisés si l’on ne remédie pas au manque de<br />
protection des enfants.<br />
Le travail des enfants dilapide le capital humain d’un pays et fait obstacle à<br />
l’élimination de la pauvreté extrême (OMD 1).<br />
Les conflits armés nuisent à la réalisation de l’enseignement primaire pour tous<br />
(OMD 2).<br />
Le mariage des enfants conduit à l’abandon scolaire des filles et empêche ainsi<br />
l’égalité des sexes (OMD 3).<br />
Les enfants séparés de leur mère risquent davantage, notamment s’ils sont placés<br />
en institution, de mourir prématurément, ce qui freine les efforts de réduction de la<br />
mortalité des enfants (OMD 4).<br />
27
RéFéRENtIEl dEs dIsposItIFs dE pRotECtIoN dE l’ENFaNCE Et dE la jEUNEssE<br />
Les mutilations génitales féminines/l’excision nuisent aux efforts d’amélioration<br />
de la santé maternelle (OMD 5).<br />
L’exploitation sexuelle et la maltraitance font obstacle à la lutte contre le VIH/SIDA<br />
(OMD 6).<br />
Les catastrophes environnementales accroissent la vulnérabilité des enfants à<br />
l’exploitation et à la maltraitance, d’où la nécessité de garantir la viabilité de<br />
l’environnement (OMD 7).<br />
Dans l’ensemble, la protection de l’enfance nécessite la coopération étroite de différents<br />
partenaires, ce qui renforce la nécessité d’un partenariat mondial pour le<br />
développement (OMD 8).<br />
LA DÉCLARATION DU MILLÉNAIRE<br />
En adoptant la Déclaration du Millénaire, les pays du monde se sont engagés à :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Soutenir la protection et la promotion des droits civils, politiques, économiques,<br />
sociaux et culturels pour tous ;<br />
Combattre toutes les formes de violence contre les femmes et faire appliquer<br />
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard<br />
des femmes ;<br />
Encourager la ratification et l’application intégrale de toutes les dispositions<br />
de <strong>ˇ</strong> la Convention relative aux droits de l’enfant et de ses Protocoles facultatifs<br />
sur l’implication d’enfants dans des conflits armés et sur la vente d’enfants, la<br />
prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.<br />
28
la « protection de l’enfant »<br />
dans le cadre législatif algérien
le cadre législatif algérien<br />
Le ministère délégué chargé de la Famille et de la Condition féminine a élaboré<br />
un Plan national d’action pour les enfants 2008-2015 (PNA), dénommé « Une <strong>Algérie</strong><br />
digne des enfants » en concertation avec différents ministères et institutions<br />
nationales, la société civile, des enfants et adolescents de différentes régions du<br />
pays et le Fonds des Nations unies pour l’enfance en <strong>Algérie</strong> (UNICEF).<br />
Le PNA a été adopté par le gouvernement algérien le 19 février 2008. Il s’inscrit<br />
dans la démarche dégagée par l’<strong>Algérie</strong> et les autres États membres des Nations<br />
unies au Sommet du millénaire pour le développement, tenu en septembre 2000,<br />
qui s’est fixé huit grands objectifs à atteindre d’ici à 2015, dont sept concernent<br />
directement les enfants.<br />
Afin de répondre au Sommet du Millénaire, l’Assemblée générale des Nations unies<br />
a organisé en mai 2002, une session extraordinaire consacrée aux enfants. Dans ce<br />
cadre, quatre priorités, relatives à la situation des enfants, ont été définies :<br />
1. Promouvoir une existence meilleure et plus saine ;<br />
2. Pour une éducation de qualité ;<br />
3. Protection contre la maltraitance, l’exploitation et la violence ;<br />
4. Lutter contre le VIH/SIDA.<br />
Les États membres, dont l’<strong>Algérie</strong>, ont souscrit aux dispositions de la Convention des<br />
droits de l’enfant et aux principes généraux qui y sont énoncés, notamment l’intérêt<br />
supérieur de l’enfant, la non discrimination, la participation, la survie et le développement.<br />
Les États membres ont également souscrit à d’autres instruments internationaux<br />
pertinents à cet égard notamment la Convention n° 138, fixant l’âge minimum d’admission<br />
à l’emploi, et la Convention sur les pires formes de travail des enfants, ratifiées<br />
successivement par l’<strong>Algérie</strong> le 30 avril 1984 et le 3 décembre 2000.<br />
C’est dans ce contexte que le PNA définit des axes stratégiques et des objectifs<br />
à l’échéance 2015, tenant compte notamment des cycles de vie de l’enfance, dont<br />
la petite enfance et l’adolescence, et avec comme perspective de développer des<br />
politiques intégrées centrées sur les enfants.<br />
Selon l’estimation de l’Office national des statistiques (ONS), l’<strong>Algérie</strong> comptait<br />
33,8 millions d’habitants en janvier 2007. La structure de la population par âge<br />
31
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
indiquait que les enfants âgés de moins de 18 ans, représentent 35% de la population.<br />
La proportion des personnes vivant avec un handicap était estimée à 2,5%<br />
de la population totale dont 0,1% sont des enfants âgés de 0 à 19 ans.<br />
En ratifiant la CIDE le 19 décembre 1992, l’<strong>Algérie</strong> considère dorénavant l’enfant<br />
comme un sujet de droit. Les droits de l’enfant tels qu’énoncés dans la CIDE sont<br />
consacrés par la Constitution et intégrés dans le corpus législatif.<br />
Le Plan national d’action (PNA) développe la stratégie de protection des droits de<br />
l’enfant en y consacrant deux priorités : l’accès aux soins et l’accès à l’éducation.<br />
Dans le PNA, les droits de l’enfant sont identifiés comme suit :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Le droit à l’identité ;<br />
Le droit à la nationalité ;<br />
Le droit à l’éducation ;<br />
Le droit à l’expression et à la participation ;<br />
Le droit à une meilleure santé possible ;<br />
Le droit aux loisirs ;<br />
Le droit à la protection contre la consommation et le trafic de stupéfiants ;<br />
Le droit à la protection contre les conséquences des actes terroristes ;<br />
Le droit à la protection contre toute forme d’exploitation ;<br />
Le droit des enfants en conflit avec la loi.<br />
Et les situations nécessitant une protection spéciale, comme suit :<br />
32<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La maltraitance et la violence à l’égard des enfants ;<br />
Le travail des enfants ;<br />
Les enfants abandonnés ;<br />
Les enfants en situation de rue ;<br />
La toxicomanie ;<br />
La pauvreté des enfants ;<br />
La protection des enfants réfugiés et migrants.
L’<strong>Algérie</strong> offre un système de soins de santé gratuit et totalement financé par le<br />
secteur public. Il repose sur les principes d’égalité et d’accessibilité. En termes<br />
d’infrastructures, le secteur dispose d’un potentiel de 264 structures hospitalières,<br />
6 335 structures extra hospitalières et 1 460 unités de dépistage et de suivi (UDS)<br />
pour les enfants scolarisés.<br />
L’État a considérablement investi et continue d’investir dans les infrastructures et<br />
les ressources humaines, portant les ratios de couverture par les professionnels à<br />
des taux remarquables. Cependant, la répartition des professionnels est très inégale<br />
au niveau territorial. Les écarts sont importants notamment en ce qui concerne les<br />
médecins spécialistes, et plus particulièrement les spécialités nécessaires au soutien<br />
des programmes mère-enfant (PMI) qui couvrent les besoins en soins des enfants<br />
de la naissance à 6 ans.<br />
LA SANtÉ EN MILIEU SCOLAIrE<br />
l’accÈs aUX soins<br />
le cadre législatif algérien<br />
La continuité des activités préventives des enfants après 5 ans est assurée par les<br />
services de santé en milieu scolaire au sein des 1 460 unités de dépistage et de suivi<br />
(UDS). 1 112 de ces unités sont localisées au niveau des établissements scolaires,<br />
336 dans les structures de santé et dans les locaux des collectivités locales. Elles<br />
constituent un véritable levier dans la protection de l’enfant et de l’adolescent. Les<br />
activités consistent essentiellement en des visites systématiques obligatoires des<br />
classes cibles, des suivis des affections dépistées, des vaccinations en milieu scolaire,<br />
la santé bucco-dentaire et l’éducation sanitaire. Cette dernière touche des domaines<br />
divers et variés tels que l’hygiène et l’environnement, le tabagisme, la<br />
toxicomanie, la santé sexuelle et procréative, les ISt, le VIH/SIDA.<br />
33
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
Personnes contact : Dr Sbaa Nacéra, médecin généraliste de santé scolaire ;<br />
Mme Tahraoui Kheira, psychologue clinicienne et thérapeute de famille.<br />
Dr Sbaa fait partie d’une UDS mobile, Mme Tahraoui travaille avec 5 UDS.<br />
L’UDS Hai Sabah, composée d’un médecin, d’un chirurgien dentiste et d’un infirmier<br />
est responsable de la santé scolaire de 6 écoles primaires, d’un collège<br />
et d’un lycée. Les classes primaires de ce quartier défavorisé sont surchargées.<br />
Les élèves de 1 ère année sont au nombre de 47 par classe, la moyenne étant de<br />
36 à 38 élèves par classe. Le règlement n’autorise un directeur d’établissement<br />
scolaire à départager une classe en deux que lorsqu’elle dépasse les 50 élèves.<br />
Environ un millier d’élèves sont consultés systématiquement chaque année. Le<br />
médecin effectue le dépistage, prescrit le traitement pour les affections relevant<br />
de la médecine générale et assure les vaccinations. En cas de nécessité, l’orientation<br />
est faite vers les médecins spécialistes du secteur ou vers la psychologue.<br />
Les orientations vers des médecins spécialistes se font comme suit : pour les<br />
élèves du primaire, la lettre est remise à l’enseignant(e) qui convoque les parents<br />
et la leur remet. Le retour d’information au médecin de l’UDS se fait par l’enseignant(e).<br />
Pour les élèves du collège et du lycée, la lettre est remise à l’élève.<br />
Quand les parents ne donnent pas suite à l’orientation prescrite, ou quand la fiche<br />
de suivi n’est pas renvoyée par le médecin spécialiste, le médecin de l’UDS n’a<br />
aucun moyen de vérifier quelle suite a été réservée à la situation de l’enfant.<br />
Les enfants sont orientés vers la psychologue qui reçoit une liste des élèves annotée<br />
par le médecin. Le directeur de l’établissement met à sa disposition un bureau<br />
pour le suivi psychologique des enfants en individuel ou en groupe. Les<br />
suivis familiaux se déroulent à la polyclinique Seddikia à laquelle est rattachée<br />
la psychologue.<br />
Les élèves qui ont d’importants retards scolaires sont orientés vers les centres<br />
de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) ou vers des associations.<br />
Les enfants qui ont des problèmes de consommation de drogues sont adressés<br />
34<br />
exemple de<br />
l’uds mobile<br />
(unité de dépistage et de suivi)<br />
de hai sabah à oran
au Centre intermédiaire de soins aux toxicomanes (CISt) d’Oran ouest affilié à<br />
l’établissement public de santé de proximité (EPSP) de Bouamama. Quand le<br />
jeune a plus de 18 ans, il est adressé au Centre de soins aux toxicomanes (CSt)<br />
de Sidi Chahmi.<br />
Il arrive que les psychologues découvrent des traces de sévices physiques sur<br />
les enfants. Si la maman déclare que l’auteur des châtiments infligés à l’enfant<br />
est le père, il est convoqué et peut faire l’objet d’un rapport voire d’une enquête<br />
de police. En général, les parents prennent peur et ne violentent plus l’enfant. Si<br />
c’est l’enseignant(e) qui est incriminé(e) par les parents, les thérapeutes font la<br />
même démarche avec l’enseignant(e), en associant le directeur (trice) en lien<br />
avec l’académie.<br />
LA SANtÉ MENtALE<br />
le cadre législatif algérien<br />
L’instruction n°13 du 24 novembre 2001 porte sur le renforcement et la décentralisation<br />
des soins de santé mentale. Elle préconise des mesures essentielles<br />
comme l’accessibilité aux soins de santé mentale, qui doivent être rapprochés le<br />
plus possible de l’usager et des malades, et la continuité des soins ou encore leur<br />
hiérarchisation. C’est ainsi que 188 centres intermédiaires de santé mentale<br />
(CISM) ont été ouverts dans des structures de soins de santé primaires (dans 46<br />
wilayas) et de petites unités de psychiatrie dans les chefs-lieux de wilaya, disposant<br />
d’un psychiatre. L’instruction n°6 du 05 mai 2002, précise les missions et le<br />
fonctionnement des CISM.<br />
35
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
Personne contact : Dr Metahri Nassima, chef de service.<br />
Téléphone : 025 41 89 63.<br />
Le service est composé d’une équipe d’une quinzaine de professionnels : psychiatres,<br />
psychologues, orthophonistes et infirmiers faisant fonction d’éducateurs.<br />
Il reçoit des enfants orientés par les professionnels des établissements de<br />
santé de proximité et par les autres services du CHU mais aussi par les écoles<br />
sur conseil des enseignants aux parents. Le service reçoit des enfants de la wilaya<br />
de Blida et des wilayas limitrophes : Médéa, tipaza, Chlef, etc.<br />
Le service propose le soutien psychologique, la guidance parentale et des suivis<br />
psychothérapeutiques en individuel associant les parents. Des activités en hôpital<br />
de jour sont proposées à des enfants âgés entre 3 et 16 ans.<br />
Les situations d’enfants victimes de maltraitance ou d’agression sont orientées<br />
par le service de médecine légale ou par l’école. Un suivi est proposé en concertation<br />
avec les parents. L’enfant et les parents sont vus au moins deux fois. La<br />
durée du suivi est variable selon les situations.<br />
36<br />
exemple du<br />
service de pédopsychiatrie<br />
au chu frantz fanon à blida
Personnes contact : Dr Alouani Mohamed Amine, psychiatre universitaire, chef d’unité ;<br />
Mr Benguerouiche Saïd, psychologue clinicien major.<br />
Adresse : Cité Tidjane.<br />
Téléphone : 036 82 08 46 ; 05 51 23 43 00.<br />
L’unité de psychiatrie est située en dehors du CHU de Sétif, à l’autre bout de la ville.<br />
Elle est mitoyenne au service de médecine du travail et au service de médecine légale.<br />
Elle reçoit des enfants orientés par les psychologues et les médecins de santé publique<br />
ou du secteur privé, des 6 centres intermédiaires de santé mentale (CISM),<br />
des UDS, ainsi que des urgences médicochirurgicales concernant certains troubles<br />
psychopathologiques (tentatives de suicide, crises d’agitation psychomotrice…).<br />
L’activité de l’unité en lien avec l’enfance et la jeunesse se décline comme suit :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
exemple de<br />
l’unité de psychiatrie<br />
du chu de sétif<br />
le cadre législatif algérien<br />
Délivrance du certificat de déficience mentale pour une inscription en centre<br />
spécialisé et pour l’obtention d’une carte d’invalidité délivrée par la direction<br />
de l’action sociale (DAS) ;<br />
Suivi des enfants présentant un handicap physique et/ou mental associé à<br />
<strong>ˇ</strong> des troubles du comportement ;<br />
Suivi de l’enfant épileptique ;<br />
<strong>ˇ</strong> Suivi de l’enfant énurétique ;<br />
<strong>ˇ</strong> Suivi de l’adolescent suicidaire ;<br />
<strong>ˇ</strong> Suivi des adolescents consommateurs de substances psychoactives ;<br />
<strong>ˇ</strong> Suivi des enfants et des adolescents présentant des difficultés scolaires ;<br />
<strong>ˇ</strong> Prise en charge des enfants victimes de violences sexuelles orientés par le<br />
service <strong>ˇ</strong> de médecine légale (qui est attenant à l’unité de psychiatrie). Les familles<br />
de ces enfants viennent pour l’établissement du certificat médical des séquelles<br />
psychologiques mais ne poursuivent en général pas le soutien psychologique<br />
au-delà de 2 ou 3 séances.<br />
37
éférentiel des dispositifs de protection de l’enfance et de la jeunesse<br />
LA PrISE EN CHArgE DE LA PEtItE ENFANCE<br />
Le ministère de l’Éducation nationale a initié une politique de généralisation de l’enseignement<br />
préscolaire à partir de l’année 2008 à l’ensemble des enfants âgés de cinq<br />
ans. Une couverture des besoins en classes préscolaires avec des effectifs de 20 enfants<br />
par classe est assurée par l’ouverture de 1 000 classes par an de 2006 à 2008.<br />
Des programmes pédagogiques du préscolaire ainsi que des documents d’accompagnement<br />
destinés aux enseignants ont été élaborés. Dans ce cadre, un guide sur<br />
le développement de l’enfant âgé de 3 à 6 ans ainsi qu’un guide méthodologique<br />
ont été réalisés. Un module et des séminaires de formation ont été mis en place au<br />
profit des inspecteurs et enseignants du préscolaire dans le cadre des programmes<br />
de formation en cours des personnels pédagogiques.<br />
LA SCOLArISAtION UNIVErSELLE<br />
DES ENFANtS DE 6 à 16 ANS.<br />
L’<strong>Algérie</strong> a consacré le droit à l’éducation pour tous. Le droit à l’enseignement<br />
est garanti par la loi. Il est dispensé gratuitement à tous les niveaux, et obligatoire<br />
dans les cycles primaire et moyen. Les infrastructures éducatives ont connu une<br />
extension considérable. On dénombre 18 799 écoles, 4 112 collèges et 1 537 lycées<br />
encadrés par 340 000 enseignants.<br />
Malgré le principe de scolarisation obligatoire et les programmes qui encouragent<br />
la scolarisation des filles et des garçons, les conditions de vie de certaines familles<br />
socialement défavorisées les empêchent le plus souvent de soutenir les efforts scolaires<br />
de leurs enfants ce qui conduit à une faiblesse du niveau scolaire et culturel<br />
déterminant pour la qualité de l’insertion sociale et économique. Ils sont donc livrés<br />
à la rue et à l’oisiveté avec tous les risques que cela peut avoir sur leur santé et leur<br />
développement. Ils se livrent souvent à des activités commerciales non déclarées<br />
et peuvent verser dans divers réseaux d’exploitation et de maltraitance.<br />
Afin d’endiguer ce phénomène, le ministère de l’Éducation nationale a pris les<br />
mesures suivantes :<br />
38<br />
<strong>ˇ</strong><br />
l’accÈs a l’édUcation<br />
La mise en œuvre du dispositif d’évaluation, qui intègre l’évaluation formative ;<br />
La pédagogie de soutien et de remédiation ;
<strong>ˇ</strong><br />
L’information et le conseil en matière d’orientation scolaire et professionnelle ;<br />
Le soutien à la scolarisation et la lutte contre la déscolarisation (cantines et<br />
transports scolaires, gratuité des manuels et fournitures scolaires pour les élèves<br />
issus de milieux défavorisés).<br />
L’AIDE à LA SCOLArISAtION<br />
DES ENFANtS VULNÉrABLES<br />
En quête d’une scolarisation universelle pour tous les enfants, les pouvoirs publics<br />
ont initié des aides matérielles à la scolarisation en faveur des enfants en situation<br />
difficile pour leur garantir un accès à l’école :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’institution, depuis la rentrée scolaire 2000-2001, d’une prime de scolarité<br />
d’un montant de 2 000 DA pour chaque enfant scolarisé ;<br />
Un effort particulier a été déployé par l’État dans le développement des cantines<br />
scolaires : avec 10 141 cantines le nombre de bénéficiaires a plus que doublé, passant<br />
de 60 1000 en 1998-99 à 2 millions d’élèves, dont la moitié sont des filles ;<br />
1 300 bus sont mobilisés pour le transport scolaire, notamment dans les zones<br />
reculées ou enclavées et s’ajoutent à un parc existant de 923 bus.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES PrOgrAMMES COMBINANt FOrMAtION ACADÉMIQUE,<br />
COMPÉtENCES DE VIE Et ÉDUCAtION ENVIrONNEMENtALE<br />
De nouvelles dimensions ont été intégrées dans les programmes scolaires à savoir<br />
: l’éducation aux Droits de l’Homme, l’éducation à la population, l’éducation<br />
sanitaire, l’éducation globale et l’éducation à l’environnement, dans le but de<br />
faire acquérir à l’enfant des comportements sains, des attitudes positives, en un<br />
mot un « savoir-être » et ce dès le premier cycle de l’enseignement primaire.<br />
L’ALPHABÉtISAtION<br />
L’année 2007 a marqué le début de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale<br />
d’Alphabétisation, adoptée le 23 janvier 2007 par le Conseil du gouvernement.<br />
Cette stratégie, intègre, entre autres :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
le cadre législatif algérien<br />
La participation d’autres organismes publics spécialisés et de la société civile ;<br />
Le recrutement de près de 19 000 animateurs ;<br />
La révision du programme des manuels scolaires.<br />
39
les dispositifs<br />
de protection de l’enfant
LES ENFANTS PRIVÉS DE SOINS PARENTAUX<br />
DÉFINITION DE L’UNICEF 4<br />
« Les enfants privés de parents risquent davantage d’être victimes<br />
de discrimination, de soins inadéquats, de maltraitance et d’exploitation,<br />
et leur situation fait rarement l’objet d’un suivi adéquat.<br />
Beaucoup d’enfants sont inutilement et pendant trop longtemps<br />
placés en institutions, où ils ne bénéficient pas de la stimulation<br />
et de l’attention individuelle nécessaires à la réalisation de leur véritable<br />
potentiel. Un cadre de soins inadéquats peut nuire au développement<br />
affectif et social de l’enfant et le laisser à la merci de<br />
l’exploitation, de la maltraitance sexuelle et de la violence physique.<br />
Des millions d’enfants grandissent sans l’un ou l’autre de<br />
leurs parents, ou les deux. Beaucoup d’autres risquent d’être séparés<br />
de leur famille, du fait de la pauvreté, de handicaps et du<br />
VIH/SIDA ou de crises telles que des catastrophes naturelles et<br />
des conflits armés. »<br />
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Les droits des enfants privés de famille, « Les enfants abandonnés<br />
» sont reconnus à travers le décret n°80-83 du 15 mai 1980<br />
portant création, organisation et fonctionnement des foyers pour<br />
enfants assistés (FEA), avec une mesure de recueil légal, la « Kafala<br />
», organisée par le code de la famille et le décret n°92-24 du<br />
13 janvier 1992, relatif au changement de nom.<br />
Sur le plan des structures, 35 FEA sont répartis à travers 26 wilayas<br />
dont 22 sont réservés pour l’accueil des 0-6 ans. Les capacités d’accueil<br />
de ces FEA sont de 2 748 personnes et le taux d’occupation<br />
effectif est de 69% soit 1 896 enfants en septembre 2006.<br />
En 2005, le Centre national d’études et d’analyses pour la population<br />
et le développement (CENEAP) a réalisé en collaboration<br />
4. Fiches d’information sur la « Protection de l’enfant », UNICEF, mai 2006. http://www.unicef.org/french/<br />
publications/index_34146.html<br />
43
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
44<br />
avec le ministère de la Solidarité nationale une « Enquête sur les<br />
enfants abandonnés pour naissance hors-mariage et les mères célibataires<br />
» ; et en 2006, une « Étude sur les foyers pour enfants<br />
assistés : état des lieux et perspectives ». Cette dernière a montré<br />
que la majorité des pensionnaires de ces établissements sont des<br />
adultes. Entre 1998 et 2001, 3 200 enfants en moyenne ont été<br />
admis dans ces établissements. Beaucoup de nourrissons restent<br />
néanmoins dans les services de maternité ou de pédiatrie des hôpitaux<br />
sans soins particuliers.<br />
Le nombre d’enfants repris par la mère biologique a progressé<br />
grâce aux actions de sensibilisation et d’information menées<br />
en leur faveur et grâce à l’allocation octroyée dans le cadre du<br />
« secours à l’enfance ».
aaefab,<br />
association algérienne enfance<br />
et familles d’accueil bénévole<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Personne contact : Taieb Annick, responsable du Centre de ressources.<br />
Téléphone : 021 56 52 68 / 07 79 09 86 17.<br />
E-mail : aaefabdz@yahoo.fr<br />
Site Internet : http://aaefab.org<br />
La mission de l’association est la prise en charge de la petite enfance (de 0 à 2<br />
ans révolus) privée de famille et l’accompagnement des familles kafil (terme<br />
utilisé pour les familles adoptantes dans la législation algérienne, la kafala étant<br />
l’adoption). Les enfants accueillis dans les pouponnières sont en majorité transférés<br />
par les hôpitaux, plus rarement amenés par la mère en lien avec la DAS ou<br />
amenés par la police quand ils sont découverts sur la voie publique. Beaucoup<br />
d’enfants sont transférés par les services de maternité de la wilaya de Blida où<br />
aucune structure n’existe pour la prise en charge de l’enfance privée de famille.<br />
L’AAEFAB recueille les enfants abandonnés définitivement ou provisoirement<br />
par leur famille. Depuis quelques temps, des enfants victimes de maltraitance<br />
ou vivant dans la rue sont placés définitivement ou temporairement par voie<br />
judiciaire.<br />
L’AAEFAB assure l’accompagnement des parents kafil en leur proposant de participer<br />
à des rencontres avec d’anciens parents kafil avant le recueil de l’enfant<br />
et à des « Kafala cafés ». Ensuite, l’enfant est choisi par l’équipe qui rencontre<br />
la famille. La famille peut choisir le sexe. L’équipe fait attention aux caractéristiques<br />
physiques de l’enfant de sorte qu’elles se rapprochent de celles de la famille<br />
kafil. Des visites des parents kafil à l’enfant sont organisées à heures fixes, chaque<br />
jour, pendant 4 à 5 jours pour un nouveau-né et pendant 10 à 15 jours pour un<br />
enfant plus âgé. Ces visites se font avec l’accompagnement de la berceuse. C’est<br />
la période de familiarisation.<br />
L’une des préoccupations ou soucis actuels de l’AAEFAB est la situation des<br />
enfants abandonnés définitivement et handicapés. Les structures qui les accueillent<br />
ne sont pas adaptées à leur prise en charge et ne leur proposent aucun projet<br />
de vie.<br />
45
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
L’AAEFAB gère 2 pouponnières : une à Hadjout avec une capacité de 24 places<br />
pour une durée de séjour moyenne de 5 mois. 2 enfants handicapés y séjournent<br />
pour une longue durée. Une deuxième à Palm Beach avec une capacité de 42<br />
places. 7 enfants handicapés y sont pensionnaires, âgés entre 1 à 8 ans.<br />
La deuxième préoccupation de l’AAEFAB est l’absence d’accompagnement des<br />
mères célibataires qui gardent leur enfant ou qui le reprennent à l’issue du délai<br />
de 3 mois fixé par la loi au-delà duquel l’enfant est considéré comme étant définitivement<br />
abandonné. À leur sortie de l’hôpital, aucun signalement n’est transmis<br />
concernant ces mères qui ont souvent très peu de moyens pour prendre en<br />
charge leur enfant. Elles gardent leur enfant mais n’ont souvent aucun projet<br />
stable à moyen ou long terme. Il n’existe aucune structure étatique ou associative<br />
dont la mission est le suivi et le soutien des mères célibataires. Quand la mère<br />
garde l’enfant et lui a même donné son nom patronymique, elle doit engager<br />
une procédure complexe en justice pour obtenir la tutelle, semblable à la kafala.<br />
Sur ce point, les juges se montrent en général assez coopératifs.<br />
Parmi les travaux réalisés par l’AAEFAB :<br />
Un numéro spécial de la publication Salem, de novembre 2006, présente l’AAE-<br />
FAB, son approche dans la prise en charge de l’enfant abandonné, son centre<br />
de formation des berceuses et le compte rendu d’une journée d’échanges sur la<br />
prévention de l’enfance abandonnée et sur la kafala.<br />
Un document regroupant des « Réflexions sur la kafala », des propositions législatives<br />
de l’AAEFAB et les textes officiels (textes cadres et textes d’application)<br />
relatifs à l’enfance abandonnée et à la kafala.<br />
Un travail de capitalisation de l’expérience des pouponnières avec la contribution<br />
des berceuses, est en cours de finalisation ; il est disponible en version papier<br />
au centre de ressources documentaires et sera ultérieurement accessible sur le<br />
site http://impe-aaefab-dz.org<br />
Une petite étude statistique sur les mères qui reprennent leur enfant sera également<br />
disponible sur le site Internet de l’AAEFAB.<br />
46
sos kdi,<br />
sos-kinderdorf international,<br />
sos village d’enfants de draria<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Personne contact : Ruot Gérard Aïssa, représentant SOS-KDI en <strong>Algérie</strong>.<br />
Téléphone : 021 35 01 34.<br />
E-mail : gerard.ruot@laposte.net<br />
Site Internet : www.sos-childrensvillages.org ; www.vesos-dz.org<br />
« Dans l’esprit de la Convention des Nations unies pour les Droits de l’Enfant,<br />
l’approche familiale dans un village d’enfants SOS repose sur quatre principes :<br />
chaque enfant a besoin d’une mère, grandit le plus naturellement possible avec<br />
des frères et sœurs, habite une maison qui est la sienne, dans un environnement<br />
propice à son épanouissement constitué par un village. »<br />
La mission de SOS Village d’Enfants International est de donner une famille<br />
aux enfants en difficulté, les aider à bâtir leur propre avenir et participer au développement<br />
des communautés locales.<br />
Le Village SOS de Draria accueille depuis 1992 des enfants sans parents, des<br />
enfants en danger moral placés par mesure judiciaire et des enfants privés de famille<br />
de façon temporaire (litige sur droits de garde, parents en détention…)<br />
âgés de 3 ans révolus jusqu’à l’insertion sociale.<br />
SOS Village d’Enfants International travaille en partenariat avec le ministère de<br />
la Solidarité nationale depuis 2005 dans le cadre du Programme de renforcement<br />
de la famille (PRF).<br />
Pour les « foyers pour enfants assistés » (FEA), le ministère a adopté l’approche<br />
Lokczi (celle de l’AAEFAB) pour les enfants privés de famille de 0 à 3 ans, et<br />
le modèle Hermann gmeiner (SOS Village d’Enfants) pour les enfants âgés de<br />
3 ans révolus jusqu’à l’autonomisation.<br />
SOS Village d’Enfants International mène aussi des actions de plaidoyer. Il utilise,<br />
dans le cadre de la protection de l’enfance, les outils pédagogiques produits<br />
par la coalition Keeping Children SAFE (Site Internet : www.keepingchildrensafe.org-uk)<br />
47
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
PRÉCARITÉ ET VIOLENCE<br />
À L’ÉgARD DES ENFANTS<br />
DÉFINITION DE L’UNICEF 5<br />
« Par “violence à l’égard des enfants”, on entend la maltraitance<br />
et le préjudice physique et mental, le défaut de soins ou le traitement<br />
inadéquat, l’exploitation et la maltraitance sexuelle. De<br />
nombreux enfants subissent des actes de violence chez eux. La<br />
violence peut également se produire dans les écoles, dans les orphelinats,<br />
dans les centres de soins résidentiels, dans la rue, sur<br />
le lieu de travail, dans les prisons et autres lieux de détention. Elle<br />
peut nuire à la santé physique et mentale de l’enfant, inhiber ses<br />
facultés d’apprentissage et de socialisation et compromettre par<br />
la suite son devenir d’adulte et de parent. Dans les cas les plus<br />
graves, la violence à l’égard des enfants est mortelle. »<br />
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
48<br />
Le PNA définit le droit à la protection des enfants dans les<br />
situations identifiées comme suit :<br />
LE DROIT À LA PROTECTION<br />
CONTRE LES CONSÉQUENCES DES ACTES TERRORISTES<br />
Ce droit a été largement garanti à travers la prise en charge par<br />
les pouvoirs publics des enfants victimes du terrorisme au double<br />
plan physique et psychologique au niveau de structures<br />
créées à cet effet. Il existe 4 foyers pour enfants orphelins<br />
victimes du terrorisme.<br />
LE DROIT À LA PROTECTION<br />
CONTRE TOUTE FORmE D’EXPLOITATION<br />
Le droit à la protection contre la maltraitance et la violence<br />
sexuelle, le droit à la protection contre l’exploitation économique,<br />
le droit à la protection contre le trafic et la vente des enfants, sont<br />
reconnus à travers diverses dispositions législatives, mesures<br />
administratives, sociales et éducatives :<br />
Le code pénal punit et condamne tout abandon ou délaissement<br />
d’enfants, l’attentat à la pudeur ou le viol d’un enfant, l’inceste et<br />
5. Fiches d’information sur la « Protection de l’enfant », UNICEF, mai 2006. http://www.unicef.org/french/<br />
publications/index_34146.html
l’incitation d’un mineur à la débauche et à la prostitution. En outre,<br />
il réprime tout abandon d’enfants nés ou à naître ou encore recueillis<br />
dans un but lucratif. Le code pénal prévoit également des sanctions<br />
relatives aux entraves à l’ordre public et aux bonnes mœurs.<br />
La loi n°90-07 du 03 avril 1990 relative à l’information, notamment<br />
son article 24, prévoit que « le directeur d’une publication<br />
destinée à l’enfance doit être assisté d’une structure éducative<br />
consultative ». L’article 26 dispose que « les publications périodiques<br />
et spécialisées nationales ou étrangères, quelles que<br />
soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration,<br />
ni récit, ni information ou insertion contraires à la<br />
morale islamique, aux valeurs nationales, aux Droits de<br />
l’Homme ou faire l’apologie du racisme, du fanatisme et de la<br />
trahison. Ces publications ne doivent, en outre, comporter aucune<br />
publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et<br />
la délinquance ».<br />
LA mALTRAITANCE ET LA VIOLENCE<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
ÀL’ÉgARD DES ENFANTS<br />
Le PNA invoque la « stratégie nationale de lutte contre la violence<br />
à l’égard des enfants » présentée en 2005 au Caire dans le cadre<br />
de l’étude des Nations unies pour le Proche Orient et l’Afrique<br />
du nord.<br />
La loi 90-17 du 31 juillet 1990 relative à la santé, stipule en son<br />
article 4 : « Les praticiens doivent dénoncer les sévices sur enfants<br />
mineurs et personnes privées de liberté dont ils ont eu connaissance<br />
à l’occasion de l’exercice de leur profession. »<br />
Le PNA préconise de renforcer les moyens juridiques, matériels<br />
et humains pour venir en aide aux enfants victimes.<br />
LES ENFANTS EN SITUATION DE RUE<br />
malgré l’absence de données officielles et la faiblesse documentaire<br />
sur le phénomène, il n’empêche que son existence, visible<br />
dans les grandes agglomérations et, particulièrement, dans certaines<br />
rues et quartiers, interpelle la famille, la société et les pouvoirs<br />
publics quant à son traitement. Une enquête a été réalisée en<br />
2000 par le CENEAP, en collaboration avec le ministère de l’Emploi<br />
et de la Solidarité nationale et l’UNICEF, sur « Le phénomène<br />
des enfants en situation de rue ».<br />
49
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
50<br />
LA PAUVRETÉ DES ENFANTS<br />
L’enquête sur le niveau de vie et la mesure de pauvreté lancée par<br />
le CENEAP, en 2005, met en évidence les progrès réalisés par<br />
l’<strong>Algérie</strong> pour atteindre les OmD. Les résultats révèlent que le<br />
seuil de pauvreté général en 2005 est de 5,7 %, alors qu’il était<br />
de 12,1% en 2000 et de 8,1% en 1988. Les résultats obtenus indiquent<br />
cependant que la pauvreté en <strong>Algérie</strong> est plus fréquente<br />
dans les ménages ruraux que dans les ménages urbains.<br />
Au titre de la solidarité nationale, l’État a mobilisé différents mécanismes<br />
d’aide sociale en faveur des populations les plus vulnérables<br />
tels que les programmes d’allocation forfaitaire de<br />
solidarité (AFS), l’indemnité d’activité d’intérêt général (IAIG) et<br />
la couverture par la sécurité sociale et l’accès gratuit aux transports<br />
terrestres et ferroviaires pour les personnes vivant avec un<br />
handicap et à l’enfance assistée.<br />
Au titre des actions de solidarité en direction des personnes en situation<br />
de rue, 76 structures d’accueil ont été ouvertes, mobilisant<br />
683 travailleurs sociaux.<br />
Au niveau de la prise en charge institutionnelle, il existe une trentaine<br />
de centres spécialisés de rééducation (CSR) placés sous l’autorité<br />
du ministère de la Justice, qui accueillent les enfants en<br />
conflit avec la loi. Conçus pour accueillir environ 2 800 jeunes,<br />
ils en hébergent prés de 2000 à l’heure actuelle. Les jeunes de 14<br />
à 21 ans sont eux placés dans un des huit centres spécialisés de<br />
protection (CSP).<br />
Le secteur de la solidarité nationale compte pour sa part 258<br />
établissements spécialisés. 42 établissements sont chargés de la<br />
sauvegarde des mineurs en conflit avec la loi ou en danger moral,<br />
répartis sur 35 wilayas, dont 9 centres spécialisés pour filles.<br />
30 centres sont spécialisés dans la rééducation et répartis sur 25<br />
wilayas avec une capacité de 3 270 places. L’effectif réel est de<br />
1934 personnes, soit 59,14%, avec un encadrement de 1 369 personnes,<br />
dont 407 personnels pédagogiques. Enfin, il existe 12 centres<br />
polyvalents de sauvegarde de la jeunesse (CPSJ) avec une<br />
capacité d’accueil de 1 246 places et un effectif réel de 814 personnes,<br />
soit un taux d’occupation de 65,33% et un encadrement<br />
de 610 personnels, dont 189 pédagogiques. 48 services d’obser-
vation en milieu ouvert (SOEMO) complètent ce dispositif<br />
(cf. Rapport sur la délinquance juvénile, 6 mai 2003, CNES).<br />
Par décret 08-228 du 15 juillet 2008 le ministère de la Solidarité<br />
nationale a créé le service d’aide mobile d’urgence sociale<br />
(SAmU sociale). Ce texte décrit les missions et le fonctionnement<br />
du SAmU sociale dans les articles 4 à 8 :<br />
art. 4. Le service d’aide mobile d’urgence sociale a pour missions, dans le cadre<br />
de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité se trouvant<br />
dans la rue, notamment :<br />
de porter secours aux personnes vulnérables se trouvant dans la rue et de les<br />
<strong>ˇ</strong> orienter vers les centres d’hébergement et les centres de soins, en coordination<br />
avec les institutions concernées et en relation avec le mouvement associatif ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
d’œuvrer à la réinsertion familiale des personnes en difficulté sociale, en<br />
détresse ou en danger moral au sein de leur famille ;<br />
d’évaluer la situation dans laquelle se trouvent les personnes en difficulté<br />
sociale ou en détresse et de déterminer leurs besoins immédiats ;<br />
d’apporter une aide adaptée et pluridisciplinaire et un soutien moral aux<br />
personnes en difficulté sociale ou en détresse ;<br />
de veiller à la mise en place des moyens humains et matériels pour une prise<br />
en charge qualitative de ces catégories de personnes.<br />
art. 5. Le siège du service d’aide mobile d’urgence sociale est situé au chef-lieu<br />
de la wilaya. Sont créés les services d’aide mobile d’urgence sociale dont la liste<br />
est jointe en annexe du présent décret.<br />
art. 6. Le service d’aide mobile d’urgence sociale comprend :<br />
l’équipe mobile qui se rend au devant des personnes en situation de précarité<br />
sociale, pour leur apporter l’aide et l’assistance d’urgence ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
la cellule d’écoute psychologique, dotée d’un numéro d’appel d’urgence gratuit,<br />
joignable de tout téléphone, 24 heures sur 24 heures ;<br />
le centre d’hébergement d’urgence dont la mission consiste à mettre les personnes<br />
en danger à l’abri pour une période limitée selon leur situation ;<br />
le centre d’accueil de post urgence qui accueille des personnes nécessitant une<br />
période de repos ou de convalescence ;<br />
le centre d’accueil de jour chargé d’établir un contact avec les personnes<br />
concernées dans le but de trouver une solution à leurs problèmes ;<br />
51
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
<strong>ˇ</strong><br />
les missions spécifiques qui consistent en la prise en charge de certaines catégories<br />
de personnes atteintes de maladies chroniques ou psychologiques, dues à<br />
des problèmes d’ordre social, conjointement avec les autres secteurs concernés ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
l’observatoire qui permet d’enregistrer et de mémoriser les différents contacts<br />
établis, ainsi que les actions mises en œuvre, d’analyser ces données et de suivre<br />
l’évolution de la situation des personnes prises en charge ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’organisation et le fonctionnement des structures citées ci-dessus, sont fixés<br />
par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre<br />
chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.<br />
art. 7. Le service d’aide mobile d’urgence sociale est composé d’une ou de plusieurs<br />
structures, citées à l’article 6 ci-dessus, en fonction des besoins de la wilaya.<br />
Il peut disposer des structures et établissements relevant du secteur de la solidarité<br />
nationale.<br />
art. 8. Il est tenu un dossier pour chaque personne prise en charge comportant les<br />
renseignements relatifs à son état civil, médical, psychologique et social.<br />
6 services d’aide mobile d’urgence sociale ont été créés par décret à Alger, Oran,<br />
Constantine, Ouargla, Béchar et Batna.<br />
52
exemple du<br />
service de médecine légale<br />
au chu frantz fanon à blida<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Personne contact : Dr Messahli Keltoum, médecin légiste, chef de service.<br />
Adresse : CHU F. Fanon Blida.<br />
Téléphone : 025 41 91 06.<br />
La médecine légale est le service auquel a recours toute victime de maltraitance,<br />
de violence, d’abus sexuel pour entamer une procédure en justice contre l’auteur<br />
des faits et pour obtenir réparation.<br />
Au service de médecine légale du CHU de Blida, quand un parent accompagne<br />
un mineur demandant un certificat médical pour agression, une pièce d’identité<br />
de l’adulte est systématiquement demandée. Les coordonnées de l’adulte sont<br />
enregistrées dans le dossier médical établi pour l’enfant. Ensuite, la gendarmerie<br />
ou le commissariat de la circonscription de résidence de l’enfant est appelé pour<br />
vérifier qu’une plainte a été déposée pour agression contre mineur et qu’un procès<br />
verbal est en cours. Si aucune plainte n’est déposée, le médecin légiste saisit<br />
le procureur de la république de la circonscription concernée et adresse un rapport<br />
de signalement médicolégal contenant les coordonnées de la personne adulte<br />
qui a accompagné l’enfant.<br />
Quand il s’agit de mineurs, le signalement est automatique. Il contient la description<br />
des lésions et atteintes et les soins que nécessite l’état de l’enfant.<br />
L’enfant est systématiquement adressé à des confrères pour des soins liés aux<br />
lésions constatées. L’orientation vers le service de pédopsychiatrie est également<br />
systématique.<br />
Le médecin légiste n’a aucun moyen de savoir quelles sont les suites réservées<br />
par la famille et par les autres services à ces orientations.<br />
53
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Maître Hammache Sihem, bénévole à la LADDH,<br />
chargée de la commission Droits de l’enfant et de la femme.<br />
Adresse : 5 rue des frères Alleg (Pierre Vialla) Didouche Mourad, Alger.<br />
Téléphone : 021 23 80 86 / 05 50 61 51 54.<br />
Dans le cadre de la promotion et la protection des droits de l’enfant la LADDH<br />
organise des sensibilisations aux Droits de l’Enfant (DDE) au siège de l’association,<br />
à l’occasion de toutes les journées de l’enfant, s’adressant à des citoyens<br />
et à des professionnels invités.<br />
La LADDH veille à la sensibilisation des juges et des intervenants de la justice<br />
à la lutte contre la violence à l’encontre des enfants et ceux-ci traitent ces affaires<br />
de façon de plus en plus sévère. Cependant, seules des sanctions pénales sont<br />
prononcées à l’encontre des auteurs alors que la loi prévoit la possibilité de sanctions<br />
complémentaires, des sanctions administratives (interdiction de travail dans<br />
la proximité des enfants…), laissées à l’appréciation du juge.<br />
Au cours des permanences assurées 2 fois par semaine par des avocats bénévoles,<br />
les demandes de conseil et d’orientation formulées par des parents concernent<br />
le plus souvent les châtiments corporels infligés aux enfants à l’école.<br />
La LADDH propose deux types d’interventions à mener conjointement :<br />
saisir l’instance administrative en adressant une lettre à l’académie accom-<br />
<strong>ˇ</strong> pagnée d’un certificat médical et du certificat de scolarité de l’enfant ;<br />
saisir l’instance judiciaire en adressant une lettre au procureur de la<br />
république. <strong>ˇ</strong><br />
La LADDH aide à rédiger ces courriers.<br />
Un projet est en discussion avec l’UNICEF au sujet de la formation d’avocats<br />
bénévoles à la défense des droits des enfants devant les instances judiciaires.<br />
La LADDH compte 22 antennes sur le territoire national, disposant chacune<br />
d’une cellule de lutte contre les atteintes à l’égard des enfants.<br />
54<br />
la laddh,<br />
ligue algérienne de défense<br />
des droits de l’homme
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
le réseau wassila,<br />
réseau de réflexion et d’action en faveur<br />
des femmes et des enfants victimes de violence<br />
Personnes contact : Pr Chitour Fadéla et Melle Ait Si Ameur Malika.<br />
Adresse : SOS Village d’enfants, tribu Zitouni, Draria, Alger, 16 003.<br />
Téléphone/Fax : 021 30 76 42.<br />
Permanence : 05 60 10 01 05.<br />
Centre d’écoute : 021 36 99 99.<br />
Le Réseau Wassila réunit des associations nationales et locales, et une association<br />
internationale (SOS-KDI qui abrite le siège du réseau) ainsi que des professionnels<br />
exerçant dans le secteur institutionnel ou privé.<br />
Les situations traitées par le réseau Wassila relèvent de la maltraitance physique<br />
et de l’abus sexuel sur les femmes et les enfants, partant du constat que les violences<br />
à l’encontre des femmes et des enfants sont souvent liées. S’agissant des<br />
enfants, et dans les affaires traitées, la justice a tendance à faire passer la cohésion<br />
de la famille avant l’intérêt de l’enfant abusé. Les conflits et les enjeux qui<br />
opposent les adultes censés protéger l’enfant sont mis en avant et non la maltraitance<br />
subie par l’enfant, qui mérite sanction pour les auteurs et protection<br />
pour l’enfant.<br />
Actuellement, l’une des préoccupations du réseau Wassila est l’inexistence de<br />
structures d’accueil pour des mères avec leurs enfants. Les enfants « en situation<br />
de rue » ou « en danger moral » sont placés par mesure judiciaire dans les foyers<br />
pour enfants assistés (FEA), les centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse<br />
(CPSJ), les centres spécialisés de protection (CSP) et dans certains cas dans les<br />
centres spécialisés de rééducation (CSR). Ils sont séparés de leur mère, même<br />
quand elle les accompagne. En fonction des disponibilités de places, ils peuvent<br />
être placés dans un centre se trouvant dans une autre wilaya parfois très éloignée<br />
de la wilaya de résidence de l’enfant.<br />
L’aide aux enfants est mise en œuvre dans les espaces suivants :<br />
L’écoute téléphonique anonyme et gratuite au 021 36 99 99, qui est assurée par<br />
une écoutante expérimentée, juriste de formation. Elle propose l’orientation et<br />
55
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
le conseil juridique. Actuellement, ce service fonctionne les dimanches, mardis<br />
et jeudis, avec une possibilité d’étendre aux autres jours de la semaine, progressivement,<br />
en fonction des besoins et de la demande. La nature de l’écoute sera<br />
diversifiée pour intégrer l’écoute psychologique et l’aide sociale. Ce centre<br />
d’écoute reçoit les appels, les traite et rappelle les appelantes pour le suivi.<br />
La permanence hebdomadaire, en binôme, par roulement tous les mardis, est<br />
assurée au niveau de SOS village d’enfants à Draria. Chaque mardi une équipe<br />
de 2 intervenantes accueille les personnes en détresse. Les situations sont<br />
présentées en réunion hebdomadaire de suivi le dimanche pour traitement et<br />
accompagnement par les personnes qui les ont accueillies.<br />
Un atelier « Action de plaidoyer » pour défendre les situations d’abus, d’exploitation<br />
et de maltraitance œuvre pour obtenir la pénalisation des actes de violence<br />
à l’encontre des enfants.<br />
Le réseau Wassila avec la participation de SOS villages d’enfants <strong>Algérie</strong> a produit<br />
des documents-outils pour soutenir son action :<br />
56<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Le « Livre Blanc », Témoignages de violences contre les femmes et les enfants ;<br />
« Le Droit de l’Enfant à la Protection : Plaidoyer pour le signalement des<br />
Violences Sexuelles sur Enfant » ;<br />
« Violence et Santé des enfants : Les violences sexuelles sur enfant », Actes<br />
de la journée d’étude du 2 octobre 2003, Alger, Institut de la magistrature ;<br />
« Le secret des perles », adaptation d’un conte dont l’objectif est de sensibiliser<br />
les enfants sur leur droit de se défendre contre la pédophilie.
Personnes contact : Hafdallah Rafika, présidente ;<br />
Hocine Hassina, coordinatrice du centre.<br />
Adresse : Cité El-Mektoub, Villa N°01, Sidi-Moussa, Alger.<br />
Téléphone / Fax : 021 76 01 36/ 07 92 23 02 00.<br />
E-mail : hafdallahrafika@yahoo.fr ; sarp.sarp@gmail.com<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
la sarp,<br />
centre d’aide psychologique et sociale<br />
de sidi moussa<br />
La SARP (association algérienne pour l’aide psychologique, la recherche et la<br />
formation) a inauguré ce centre en avril 2000. Il avait la vocation d’être un centre<br />
de proximité pour les familles victimes du terrorisme et offre aujourd’hui des<br />
consultations gratuites en psychologie, en aide sociale et en orientation administrative<br />
et juridique aux familles et aux enfants. Pour les prises en charge médicales,<br />
l’équipe travaille en collaboration avec le centre de santé de Sidi<br />
moussa, particulièrement avec la psychiatre et avec les médecins généralistes<br />
et spécialistes privés de la région qui accordent des consultations gratuites, ainsi<br />
qu’avec des pharmacies.<br />
Le problème récurrent que rencontrent les usagers ou plutôt les usagères du centre<br />
est la précarité dans laquelle vivent la majorité des familles de Sidi moussa.<br />
Celles-ci doivent parfois sélectionner parmi leurs enfants lesquels envoyer à<br />
l’école parce qu’elles ne peuvent pas assumer les charges liées à la scolarité pour<br />
l’ensemble de leurs enfants.<br />
Les intervenantes de la SARP, l’équipe est féminine, reçoivent des enfants souffrant<br />
de maltraitance tant intrafamiliale qu’en milieu scolaire. Elles reçoivent<br />
quelques fois des adolescents ayant des problèmes de toxicomanie, qu’elles<br />
orientent vers l’association de sauvegarde de la jeunesse d’El Harrach, au CHU<br />
Frantz Fanon de Blida ou au Centre El Anis à Bab El Oued.<br />
Beaucoup d’enfants présentent des difficultés scolaires et sont orientés pour<br />
soutien scolaire et pour participer à des activités de loisirs à la maison de jeunes<br />
ou au centre culturel. Les enfants en exclusion scolaire sont orientés vers les<br />
centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) de la région<br />
et des médiations sont assurées pour que des dérogations soient accordées aux<br />
57
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
enfants qui n’ont pas le niveau requis pour s’inscrire. Les intervenantes rencontrent<br />
cependant des difficultés à inscrire les enfants qui n’ont pas 16 ans.<br />
Beaucoup d’enfants exclus de l’école entre 12 et 16 ans ne trouvent donc pas<br />
d’alternatives.<br />
L’équipe organise régulièrement des séances de sensibilisation aux droits de<br />
l’enfant et des formations en psychopédagogie pour les enseignants.<br />
58
Personnes contact : Arar Abderrahmane, président ;<br />
Cheikha Malika, chargée d’étude.<br />
Adresse : 105, rue Didouche Mourad Alger.<br />
Téléphone : 021 23 79 85.<br />
E-mail : a_arar2002@yahoo.fr ; nada_radde@yahoo.fr<br />
Le réseau algérien pour la défense des droits des enfants NADA est né en 2004<br />
à l’initiative des Scouts musulmans algériens (SmA). Il est le résultat d’un travail<br />
de réflexion mené par un ensemble d’associations afin de mobiliser la société<br />
civile autour de la question de la protection des droits de l’enfant. Les missions<br />
assignées à ce réseau sont :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
le réseau nada,<br />
réseau algérien pour la défense des droits des enfants<br />
la promotion des droits de l’enfant ;<br />
la protection de l’enfant ;<br />
la création de passerelles entre la société civile et les institutions ;<br />
la vulgarisation du concept « réseau » dans le mouvement associatif.<br />
La mise en œuvre de ces objectifs est opérationnalisée dans le cadre de différents<br />
programmes :<br />
LE PROgRAmmE « JE T’ÉCOUTE »<br />
Il s’agit d’un programme qui s’appuie sur l’écoute téléphonique. Le premier<br />
contact des usagers se fait par appel au 3033, ensuite un rendez-vous est systématiquement<br />
donné au siège du réseau NADA à Alger, même pour les personnes<br />
des autres wilayas.<br />
Les usagers sont reçus par la chargée d’étude et si nécessaire avec la psychologue.<br />
Un dossier est établi au nom de la personne. Il comporte une fiche de renseignements,<br />
un résumé de la situation, les coordonnées d’une personne à contacter si<br />
besoin. En fonction de la situation, une orientation peut être proposée vers un<br />
professionnel psychologue ou psychiatre du secteur public ou privé de la région<br />
de résidence. S’il y a nécessité d’une médiation, l’équipe fait appel au médiateur<br />
social et en cas d’urgence le président du réseau NADA peut intervenir.<br />
59
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Quand il s’agit d’usagers qui habitent Alger ou ses environs, l’équipe propose à<br />
la famille d’amener l’enfant au siège de NADA autant qu’elle peut et la psychologue<br />
l’observe pour une période avant de décider d’une orientation vers un psychologue,<br />
mais souvent l’enfant va mieux dès ces premiers contacts avec<br />
l’équipe. Depuis que le centre d’animation de la maison de culture Azzedine<br />
medjoubi à Sidi m’hamed est opérationnel, les enfants peuvent y être orientés<br />
pour des activités de loisirs et/ou de soutien scolaire.<br />
Le conseil ou le suivi juridique consiste à rédiger une plainte au procureur de la<br />
circonscription de résidence de l’intéressé, rédiger une demande d’aide, une<br />
plainte ou un signalement au ministère de la Justice, au président d’une cour de<br />
justice, au président d’un tribunal. Le réseau NADA a déjà adressé des courriers<br />
au ministère de la Justice pour signaler des abus ou violence à l’encontre d’un enfant<br />
ou pour appuyer un signalement effectué par le tuteur de l’enfant ou par une<br />
personne tierce.<br />
L’extension du programme « je t’écoute » sur 9 wilayas : Tipaza, Blida, médéa,<br />
Oran, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Annaba et Ouargla est en cours.<br />
LE PROgRAmmE « ENFANTS RÉFUgIÉS »<br />
Un autre projet s’adresse également aux enfants. Intitulé « Enfants réfugiés », il<br />
est opérationnel depuis décembre 2009 dans le cadre d’une convention avec le<br />
HCR (Haut Commissariat aux réfugiés) et l’APC (Assemblée populaire communale)<br />
de Sidi m’Hamed. Le HCR adresse une liste avec les coordonnées de<br />
familles réfugiées, répertoriées par ses services, et auxquelles sont attribuées des<br />
cartes de personnes réfugiées. Le HCR prend en charge une année de loyer pour<br />
chaque famille.<br />
La première aide consiste à leur trouver du travail pour des contrats de deux<br />
mois dont le salaire est versé par le HCR.<br />
L’équipe du réseau NADA organise des activités dont bénéficient ces familles :<br />
L’équipe de NADA accompagne les familles vers les structures de soins pour<br />
leur en faciliter l’accès.<br />
Des visites à domicile aux familles réfugiées ont montré que des enfants nés en<br />
<strong>Algérie</strong> ne sont pas enregistrés à l’état civil. L’équipe NADA accompagne les<br />
familles auprès des services concernés.<br />
Des sorties en plein air réunissent des familles réfugiées et des familles algériennes<br />
Un renforcement de la langue arabe est proposé aux enfants au centre d’animation<br />
Azzedine medjoubi, mais l’éloignement des lieux de résidence de ces familles<br />
ne facilite pas une fréquentation régulière.<br />
60
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Actuellement la traduction de l’espagnol vers le français du livre « Maison pour<br />
Mamadou » est en cours. Il est destiné à être distribué à tous les élèves dans les<br />
écoles fréquentées par les enfants réfugiés.<br />
NADA a conclu un contrat avec la coopérative El Mahraz pour le montage<br />
d’une pièce de théâtre associant des enfants algériens, des enfants réfugiés et<br />
des comédiens.<br />
61
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personnes contact : Boucebci Téric, président ;<br />
Bouchaïb Imène, responsable du centre.<br />
Adresse : Lot 9 Les Bambous, Cité des Bananiers, Mohammadia 16 200 Alger.<br />
Téléphone : 021 89 66 82 / 07 96 77 56 64.<br />
E-mail : fmboucebci@yahoo.fr<br />
La Fondation mahfoud Boucebci met en oeuvre des actions d’information et de<br />
sensibilisation, de formation et de recherche dans les domaines médical, psychologique,<br />
socio-éducatif et culturel. Elle construit son intervention en santé<br />
mentale sur 2 axes :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Une activité permanente : les prestations de services offertes par le centre ;<br />
Un projet « Réduction de la violence en milieu scolaire », de novembre<br />
2009 à octobre 2012.<br />
Le centre est ouvert du dimanche au jeudi, de 9 heures à 16 heures 30. L’équipe<br />
est composée d’une dizaine de thérapeutes : 3 psychologues salariés et des thérapeutes<br />
bénévoles, psychologues et psychiatres qui interviennent une fois par<br />
semaine ou par quinzaine. Chaque année, en septembre, une planification des<br />
activités du centre est tracée.<br />
Le centre offre des consultations de prise en charge psychologique ou psychiatrique<br />
aux enfants et leurs familles et aux adultes.<br />
Des ateliers thérapeutiques animés par un animateur et deux psychologues sont<br />
proposés aux enfants : contes, photographie, dessin, mosaïque et caricature.<br />
Ces mêmes activités animées par un animateur seul sont proposées en ateliers<br />
récréatifs.<br />
Les enfants sont généralement orientés par les enseignants. Il est arrivé que<br />
des situations d’abus sexuel ou de sévices physiques soient découvertes. Il est<br />
systématiquement proposé à l’adulte qui accompagne l’enfant la possibilité<br />
de déposer plainte. La question est toujours posée à 3 reprises, surtout si<br />
62<br />
la fondation mahfoud boucebci<br />
pour la recherche et la culture,<br />
centre de prise en charge des enfants<br />
victimes de violence et de leurs familles
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
l’agresseur est toujours en contact avec l’enfant. Il n’y a jamais eu de réponse<br />
positive. Certains ne reviennent plus et ceux qui continuent à fréquenter le<br />
centre bénéficient d’un soutien psychologique tout en respectant la décision<br />
de l’adulte qui accompagne l’enfant, généralement la maman.<br />
Une réunion de synthèse est organisée une fois par mois, au cours de laquelle,<br />
des situations cliniques sont analysées, une thématique est débattue, un texte est<br />
étudié.<br />
La bibliothèque du centre, ouverte aux professionnels, dispose d’un fond documentaire<br />
livresque et vidéo, traitant de santé mentale et de problématiques<br />
sociétales plus larges.<br />
63
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Zerarka Radhia.<br />
Adresse : Cité 142 logts. Bt « G2 » N°06 (Bab Dzair) Blida 09 000.<br />
Téléphone : 025 41 88 52.<br />
E-mail : djazairouna2004@yahoo.com<br />
Entre septembre 2008 et octobre 2009, un projet « Ensemble contre les violences<br />
faites aux femmes et aux enfants » a été mis en œuvre par l’association Djazairouna<br />
dans le cadre du programme ONg2. L’association a réalisé une petite<br />
étude sur 14 écoles, touchant 340 enfants des 3 paliers de l’enseignement dans<br />
la wilaya de Blida. Un questionnaire a été élaboré par l’équipe. Il comprend des<br />
questions concernant des aspects juridiques (afin de voir si les enfants connaissent<br />
leurs droits et de connaître leur avis sur les droits des enfants) et des questions<br />
portant sur des aspects psychologiques (afin d’explorer la répercussion des<br />
violences sur les enfants touchés et s’ils ont demandé de l’aide). L’étude a été<br />
réalisée pour orienter les activités inscrites dans le projet. Elle sera publiée dans<br />
le bulletin de l’association.<br />
À la suite de l’étude, des sensibilisations aux droits de l’enfant ont été organisées<br />
dans les 14 établissements scolaires. Des prospectus et des cartes postales en<br />
arabe et en français (contenant le numéro de téléphone de l’association et proposant<br />
la prise en charge psychologique et juridique) ont été distribués aux élèves<br />
et aux parents, l’objectif étant de transmettre des informations sur les possibilités<br />
d’aide aux mères au foyer. 3 juristes et 3 psychologues proposent des consultations<br />
au siège de l’association. Celle-ci a déjà engagé les services d’un avocat<br />
pour la prise en charge de procédures judiciaires au bénéfice d’enfants ou de<br />
femmes victimes de violences.<br />
64<br />
djazairouna,<br />
association des familles victimes du terrorisme
Personne contact : Madame Djemia Aicha.<br />
Adresse : « Château Cherry » Route de Ouled Yaîch Blida.<br />
Téléphone : 025 40 51 65.<br />
E-mail : arpeij@altern.org ; dasaicha@yahoo.fr<br />
Site Internet : http://arpeij.africa-web.org/identite.htm<br />
L’ARPEIJ est une association de professionnels du champ de l’enfance et de<br />
l’adolescence. Son champ d’action recouvre le domaine de la santé mentale au<br />
sens large que lui donne l’OmS et le domaine de l’éducation spécialisée pour<br />
enfants et adolescents en échec. L’ARPEIJ mène une lutte multiforme contre<br />
l’exclusion et la marginalisation des enfants et des adolescents.<br />
Ce programme de prise en charge infanto-juvénile se déploie sur 4 « espaces » :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La crèche qui accueille 30 enfants de 3 à 6 ans, dont 20% présentant des<br />
handicaps mentaux ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’espace « enfants scolarisés » de 6 à 12 ans. Le centre est en contact avec<br />
7 écoles primaires de la commune qui transmettent la liste des enfants en situation<br />
de précarité sociale, présentant des difficultés scolaires ou des troubles<br />
du comportement. Des enfants d’autres communes sont orientés par les<br />
enseignants ou amenés par leurs parents.<br />
Un courrier est adressé aux écoles pour les enfants nécessitant une prise en<br />
charge particulière afin qu’ils soient libérés une journée entière par semaine pour<br />
participer à des activités au centre.<br />
Certains enfants ne sont pas du tout scolarisés, non admis ou exclus du système<br />
scolaire pour handicap physique ou mental. L’ARPEIJ accueille les enfants présentant<br />
un handicap mental et/ou un handicap physique léger.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
arpeij,<br />
association pour la réhabilitation<br />
psycho-éducative infanto-juvénile<br />
L’espace « adolescents » de 12 à 16 ans, destiné aux enfants non scolarisés,<br />
il arrive souvent qu’il accueille aussi des enfants scolarisés. Cet espace comporte<br />
3 axes :<br />
65
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
La préformation : 7 ateliers de préformation sont ouverts en peinture-bâtiment,<br />
couture, coiffure, menuiserie, ferronnerie, jardinage-animalerie et pâtisserieboulangerie.<br />
L’adolescent passe 15 jours dans chaque atelier sur une période de 3 mois ensuite<br />
il est aidé à faire le choix d’un atelier adapté à son niveau scolaire et au CFPA<br />
qu’il va intégrer. L’adolescent reste en préformation jusqu’à ce qu’il atteigne<br />
l’âge de 16 ans.<br />
La mise à niveau : les enfants sont regroupés par niveau après évaluation et sont<br />
inscrits au CNED (Centre National d’Enseignement à Distance). L’inscription<br />
au CNED n’est possible qu’à partir de la 7ème année d’enseignement. Les enfants<br />
sont aidés pour atteindre ce niveau et pour obtenir le certificat du CNED qui<br />
leur permettra à 16 ans de s’inscrire dans un CFPA.<br />
La socialisation : un programme de sports et loisirs est mis en place en concertation<br />
avec les adolescents : musique, théâtre, sport,…<br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’espace chantier-école : pour les jeunes de plus de 16 ans jusqu’à 25-30<br />
ans. L’objectif est l’autonomisation, l’aide à la réalisation d’un projet professionnel.<br />
Par exemple, après obtention du diplôme du CFPA, le jeune peut travailler<br />
au centre comme aide ou apprenti dans les ateliers de jardinage,<br />
couture, menuiserie et pâtisserie. Des jeunes qui n’ont pas pu suivre une formation<br />
professionnelle au CFPA pour handicap mental ont été aidés à travailler<br />
dans des pépinières.<br />
L’aide des jeunes à la recherche d’emploi est particulièrement réussie en ferronnerie,<br />
jardinage, menuiserie et coiffure dans des lieux de travail où leurs droits<br />
sont respectés.<br />
L’ARPEIJ dispose d’un centre de ressources et documentation qui accueille tous<br />
les intervenants dans le domaine « Enfance et Jeunesse ». Ce centre organise<br />
des formations généralement à la demande des 4 espaces. Les formations sont<br />
ouvertes aux intervenants de la région, d’autres associations, des écoles, des<br />
CFPA, etc.<br />
66
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
el ghaith,<br />
association de solidarité et de lutte contre<br />
la pauvreté et l’exclusion<br />
Personne contact : Izerrouken Smail.<br />
Adresse: Cherchar, commune de Hasnaoua. 34 001 Bordj Bou Arréridj.<br />
Téléphone : 035 60 36 98.<br />
E-mail : elghaithsolid@yahoo.fr<br />
L’association El ghaith déploie ses activités sur 3 axes : enfance et éducation,<br />
jeunesse et formation, femme et développement.<br />
Dans le cadre de l’axe « enfance et éducation », El ghaith a ouvert 3 crèches ou<br />
écoles préscolaires à El Annassers, Hasnaoua et Bordj Bou Arreridj pour les enfants<br />
de familles démunies et les enfants des femmes soutenues par l’association<br />
et qui participent aux ateliers de confection et de tissage. Ces crèches accueillent<br />
aussi des enfants en situation de handicap.<br />
El ghaith a lancé, avec le soutien de l’Union européenne, un projet de mise en<br />
place d’une cellule d’information et de formation sur les droits de l’enfant dans<br />
les établissements scolaires. 102 établissements pour les 3 paliers scolaires sont<br />
concernés dans 34 communes. Une formation aux droits de l’enfant est également<br />
proposée à 10 associations œuvrant dans le domaine de l’enfance, à 10 autres<br />
œuvrant dans le domaine de la jeunesse et à 10 éducateurs pairs.<br />
L’association travaille en partenariat avec la direction de l’éducation, partenariat<br />
né dans le cadre d’un projet toujours en cours et relatif à la création de cellules<br />
d’information sur les IST (Infections sexuellement transmissibles).<br />
L’association travaille en partenariat avec la direction de l’action sociale, qui assure<br />
le salaire de 7 employés des crèches, et collabore avec cette direction, depuis<br />
quelques années, à l’organisation de la journée annuelle de l’enfant en situation<br />
de handicap.<br />
La psychologue de l’ODEJ (Office des Établissements de Jeunes) est membre de<br />
l’association et membre de la cellule du projet. Elle reçoit les familles orientées<br />
67
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
par l’association ; elle a une grande notoriété auprès de la population car elle<br />
intervient souvent à la radio locale.<br />
L’association a également ouvert une école de soutien scolaire où toutes les<br />
matières sont enseignées. Cette structure emploie 16 enseignants et accueille<br />
476 enfants des 3 paliers de l’enseignement.<br />
68<br />
Une bibliothèque est mise à disposition de la population.
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
medial,<br />
association nationale médiation algérie<br />
Personne contact : Dr Korso Chahida, trésorière de l’association, chirurgien dentiste<br />
spécialiste en ODF au sein de l’UDS du lycée Lotfi.<br />
Localisation : Oran.<br />
mEDIAL anime des formations en gestion des conflits et médiation en partenariat<br />
avec deux association oranaises, l’AFEPEC et le Petit Lecteur. Les membres<br />
de mEDIAL se sont constitués en réseau des médiateurs algériens (REmA) sous<br />
l’égide de la Fédération de la jeunesse et des sports.<br />
Pour la région ouest, l’association est composée d’une douzaine de formateurs en<br />
gestion des conflits et médiation auprès des enfants, des jeunes et des intervenants<br />
(animateurs, éducateurs, enseignants, personnel soignant).<br />
L’association mEDIAL travaille en partenariat avec Terre culturelle de marseille<br />
et BAPOP en Allemagne. Chaque année, les membres de mEDIAL<br />
accompagnent des groupes de jeunes pour des échanges culturels en France.<br />
En partenariat avec la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran, 145 psychologues<br />
recrutés dans le cadre de l’emploi de jeunes ont été initiés à la gestion<br />
des conflits pour occuper des postes de conseillers d’éducation et de guidance<br />
dans les établissements scolaires.<br />
69
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Chougrani Serir Boualem, président.<br />
Adresse : 42, rue de Biskra Haï Ibn Sina (Victor Hugo), Oran.<br />
Téléphone : 041 54 03 14 / Fax : 041 54 03 15.<br />
E-mail : aprosch1997@yahoo.fr ; president@aprosch-dz.com<br />
Site : www.aprosch-dz.com<br />
L’action principale de cette association est la création d’un centre de formation<br />
pour les 13-16 ans exclus du système scolaire et qui n’ont pas atteint le niveau<br />
requis pour accéder aux centres de formation professionnelle publics.<br />
Cinq ateliers sont opérationnels dans les filières de la couture, la menuiserie, les<br />
métiers du bâtiment et la ferronnerie artistique. L’association a passé une convention<br />
avec la direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage de la<br />
wilaya pour la validation des diplômes obtenus. Elle a formé 10 formateurs : 5<br />
encadrent les ateliers de l’association et les 5 autres sont formateurs dans les<br />
centres de formations publics.<br />
L’association a réalisé entre 2000 et 2003 une étude avec le CRASC sur la situation<br />
économique, sanitaire et sociale de 45 000 familles du quartier Ibn Sina.<br />
Depuis cette étude, 1 525 familles vivant en dessous du seuil de pauvreté sont<br />
suivies régulièrement par l’association. Des cartes d’adhérents leur ont été remises<br />
qui leur ouvrent droit à une aide régulière pour l’accès aux soins de santé,<br />
à des visites médicales à domicile pour les personnes âgées et les personnes<br />
handicapées, à des médicaments gratuits et à une aide sociale.<br />
L’association a constitué son propre groupe de musique et théâtre, les « West<br />
town boys ».<br />
70<br />
chougrani aprosch,<br />
action pour la promotion sociale,<br />
culturelle et sportive
LES ENFANTS TOUCHÉS PAR LE VIH/SIDA,<br />
PAR LA CONSOmmATION DE DROgUES<br />
ET LA TOXICOmANIE<br />
DÉFINITION DE L’UNICEF 6<br />
« La pandémie de VIH/SIDA ne menace pas seulement la santé<br />
et la survie de millions d’enfants du monde entier, elle détruit<br />
également leur famille et les prive de l’amour, des soins et de la<br />
protection de leurs parents. Les préjugés et la discrimination,<br />
qui entourent souvent le VIH, peuvent entraîner exclusion et isolement<br />
et empêcher les enfants concernés de recevoir une éducation.<br />
Les enfants dont la famille est touchée par le VIH/SIDA<br />
traversent de lourdes épreuves sur le plan affectif et psychologique.<br />
Du fait de difficultés financières, liées à l’incapacité de<br />
leurs parents à travailler, ces enfants risquent de ne plus aller à<br />
l’école ou de commencer à travailler. Ils sont souvent contraints<br />
de s’occuper de leurs parents malades ou de leurs frères et sœurs<br />
plus jeunes. Les enfants orphelins à cause du VIH/SIDA sont<br />
davantage à la merci de l’exploitation, de la maltraitance et de<br />
la violence. Inversement, les enfants risquent de contracter le<br />
VIH dans de nombreuses situations dans lesquelles ils ne sont<br />
pas suffisamment protégés – y compris l’exploitation sexuelle,<br />
le trafic d’enfants, la violence, les conflits armés, le recrutement<br />
dans des forces ou des groupes armés, les déplacements de population,<br />
la détention et l’emprisonnement, le mariage des<br />
enfants et les mutilations génitales féminines/excisions. »<br />
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
LES INFECTIONS SEXUELLEmENT TRANSmISSIBLES (IST)<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
ET LE VIH/SIDA<br />
L’<strong>Algérie</strong> a engagé la lutte contre les IST, VIH/SIDA depuis plus<br />
de 20 ans. De nombreuses activités ont été réalisées. Un comité<br />
national de lutte contre le VIH/SIDA a été installé.<br />
6. Fiches d’information sur la « Protection de l’enfant », UNICEF, mai 2006. http://www.unicef.org/french/<br />
publications/index_34146.html<br />
71
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
72<br />
En matière de prévention, l’information et la sensibilisation sont<br />
des axes de travail consacrés notamment en milieu de jeunes : établissements<br />
d’éducation, de la jeunesse et les sports, universités...<br />
Pour le dépistage, un laboratoire national de référence à été créé<br />
au sein de l’Institut Pasteur d’<strong>Algérie</strong>. 51 centres de dépistage anonymes<br />
volontaires et gratuits ont été progressivement installés. Il<br />
existe par ailleurs 9 centres de référence (CDR) qui sont destinés à<br />
la prise en charge des personnes porteuses du VIH.<br />
Avec l’appui de l’ONUSIDA, l’<strong>Algérie</strong> s’est inscrite dans le processus<br />
de la planification stratégique par l’élaboration et la mise en<br />
œuvre du Plan National Stratégique 2002-2006 puis 2008-2012.<br />
LE DROIT À LA PROTECTION CONTRE LA CONSOmmATION<br />
ET LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS<br />
Ce droit est assuré par la loi n°85-05 du 16 février 1985 portant<br />
protection et promotion de la santé, qui considère comme délit tout<br />
encouragement d’un mineur à la consommation, au trafic des substances<br />
psychotropes, des plantes vénéneuses et des stupéfiants.<br />
Sous l’égide du ministère de la Santé, une commission consultative<br />
multisectorielle a été créée en 1992. Un Office national de lutte<br />
contre la drogue et la toxicomanie a vu le jour en 2002 sous l’autorité<br />
du chef du gouvernement. En 2004, la loi n° 04-18 relative<br />
à la prévention et à la répression de l’usage et du trafic illicites<br />
de stupéfiants et de substances psychotropes a été promulguée.<br />
Une stratégie nationale de lutte contre la drogue a été mise en<br />
œuvre dans ce cadre par l’Office national de lutte contre la drogue<br />
et la toxicomanie (ONLDT) pour la période allant de 2004 à 2008.<br />
Cette stratégie met l’accent sur trois axes :<br />
La prévention, la lutte contre la toxicomanie et la prise en charge<br />
des toxicomanes.<br />
Pour le premier axe, une vaste campagne de sensibilisation est<br />
menée auprès des jeunes et des familles.<br />
La lutte contre ce fléau relève de la compétence des services de<br />
sécurité et de la justice.
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Pour la prise en charge des toxicomanes, qui traduit le troisième<br />
axe de la stratégie, 53 centres de traitement sont en cours de réalisation,<br />
en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population<br />
et de la Réforme hospitalière en plus des 5 centres déjà<br />
fonctionnels.<br />
Au plan sectoriel, les actions sont cordonnées par un Comité national<br />
de lutte contre la toxicomanie. Le Plan Directeur National<br />
(PDN) consacre, au plan stratégique, la multisectorialité en incluant<br />
le mouvement associatif et les médias, l’information, l’éducation<br />
et la sensibilisation notamment en milieu scolaire et<br />
universitaire, dans les lieux de loisir des jeunes et le milieu pénitentiaire.<br />
Le PDN prévoit la création d’infrastructures spécifiques<br />
de prévention et de prise en charge impliquant notamment la formation<br />
des médecins et des professionnels concernés, l’amélioration<br />
de la collecte des données, les études et les recherches qui<br />
y sont afférentes.<br />
73
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Mme Lezzar Hadjira, sous-directrice de la prévention.<br />
Adresse : 06, avenue de l’Indépendance, Alger.<br />
Téléphone : 021 65 52 88.<br />
E-mail : hadjiralezzar@gmail.com<br />
Site : www.onlcdt.mjustice.dz<br />
L’Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLCDT) a été<br />
créé par le décret 97-212 du 9 juin 1997 et inauguré en octobre 2002. Placé<br />
sous tutelle du ministère de la Justice il a pour objectif de réunir toutes les<br />
compétences requises pour l’élaboration d’une politique nationale de prévention<br />
et de lutte contre la drogue et ses conséquences, de coordonner et de suivre<br />
l’ensemble des actions menées par les structures nationales concernées et de<br />
présenter au chef du gouvernement un rapport d’évaluation des activités liées<br />
à la lutte contre la drogue et la toxicomanie. L’Office représente par ailleurs<br />
l’<strong>Algérie</strong> et mène des actions en son nom au sein et avec les institutions internationales<br />
concernées.<br />
L’ONLCDT est en lien avec 300 associations algériennes qui œuvrent dans le<br />
domaine de l’enfance et de la jeunesse. 135 cadres issus de ces associations ont<br />
bénéficié d’une formation en montage, mise en œuvre et évaluation de projets<br />
en matière de prévention contre les drogues.<br />
Deux études ont été engagées, une étude sur la prévalence des drogues en <strong>Algérie</strong><br />
et une évaluation du Plan Directeur National (PDN) élaboré en 2004. Les<br />
rapports finaux de ces deux études sont en cours de finalisation et serviront de<br />
base pour l’élaboration du prochain PDN.<br />
Les structures de prise en charge des toxicomanes :<br />
2 centres de soins aux toxicomanes (CST) dans les CHU (centres hospitalo-<br />
<strong>ˇ</strong> universitaires) de Blida et d’Oran ;<br />
3 centres intermédiaires de soins aux toxicomanes (CIST) en ambulatoire :<br />
<strong>ˇ</strong> en médecine légale au CHU de Bab El Oued, en psychiatrie à l’hôpital El ghazi<br />
à Annaba et au CHU de Sétif ;<br />
74<br />
l’onlcdt,<br />
l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
L’ONLCDT soutient le projet du ministère de la Santé publique et de la Réforme<br />
hospitalière, (direction de la prévention) de créer 15 CST dans les CHU,<br />
185 cellules d’écoute et d’orientation dans les hôpitaux et 53 CIST.<br />
75
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : La directrice du centre.<br />
Adresse : 09 rue Ahmed Hassina, Bab El Oued.<br />
Téléphone / Fax : 021 62 09 72.<br />
Créé par décret en 1997 ce centre a ouvert ses portes le 12 mai 1999. Il est en<br />
principe destiné aux jeunes âgés entre 13 et 35 ans, mais sans réelle restriction.<br />
Les personnes souffrant de toxicomanie sont accueillies même au-delà de 35 ans.<br />
Les animateurs placés à la réception sont formés à l’accueil. Ils orientent toutes<br />
les demandes d’aide vers le service d’accueil, d’écoute et d’orientation. Les personnes<br />
qui demandent un suivi ont un rendez-vous dans les plus brefs délais ou<br />
sont reçus le jour même, selon l’urgence du problème. Les difficultés scolaires<br />
sont également prises en charge par le service psychologique. Les personnes qui<br />
ne peuvent être prises en charge par le centre sont orientées. Les personnes présentant<br />
des troubles psychiatriques et/ou des addictions sévères sont orientées<br />
après un entretien vers le service de désintoxication du CHU de Blida. Ceux qui<br />
refusent d’aller au centre de désintoxication bénéficient tout de même d’un suivi<br />
psychologique.<br />
Les consultations sont ouvertes :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
aux enfants de 10 à 13 ans, par mesure préventive, aux enfants qui présentent<br />
des difficultés d’adaptation à l’école, des troubles de l’attention, du comportement,<br />
et qui risquent d’être exclus de l’école, de consommer des drogues, de<br />
présenter des conduites de délinquance ;<br />
aux parents en difficultés avec leurs enfants, même si ces derniers refusent<br />
de <strong>ˇ</strong> les accompagner aux consultations ;<br />
aux jeunes même non accompagnés, orientés par un proche, un ancien patient,<br />
<strong>ˇ</strong> les structures de santé, les écoles, les services judiciaires de la police ou de la<br />
gendarmerie, les médias.<br />
La population qui fréquente le centre est mixte avec une proportion de garçons<br />
légèrement plus élevée.<br />
76<br />
le centre el anis,<br />
centre d’accueil, d’écoute et d’orientation pour les jeunes<br />
en danger moral à bab el oued, relevant du<br />
comité de solidarité de la wilaya d’alger.
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Le centre propose des ateliers de dessin, d’expression artistique en individuel et<br />
en groupe. L’équipe du centre participe à des journées de sensibilisation dans<br />
les écoles sur le dangers des drogues, mais aussi sur d’autres problématiques<br />
comme la violence et les relations parents-enfants. Des documentaires ont été<br />
réalisés avec la télévision et des émissions ont été montées avec les radios nationales<br />
pour présenter le centre et expliquer le travail de prise en charge des<br />
personnes en dépendance de drogues et de toxicomanies.<br />
La bibliothèque du centre est ouverte aux consultants, aux enfants mais aussi<br />
aux adultes du quartier.<br />
L’équipe est composée de 3 psychologues, 2 sociologues et 2 animateurs. Elle<br />
est appelée à s’agrandir par le recrutement de 2 à 4 animateurs et éducateurs<br />
pour diversifier les ateliers.<br />
Le centre a pour projet d’ouvrir de nouveaux ateliers en informatique, lecture,<br />
oisellerie et d’organiser des projections de films.<br />
77
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Bourouba Othmane.<br />
Adresse : 07, rue Ahcène Khemissa Alger.<br />
Téléphone : 021 74 15 28.<br />
Fax : 021 74 43 74.<br />
E-mail : contact@aidsalgerie.org<br />
Site : http://www.aidsalgerie.org<br />
L’action de l’association s’inscrit dans le cadre du Plan stratégique national<br />
de lutte contre le sida (PNS) 2008-2012, à l’élaboration duquel elle a participé<br />
avec 17 intervenants institutionnels dont des ministères et 12 associations. Le<br />
Plan définit la priorisation des populations cibles qui sont au nombre de 7 :<br />
les travailleurs du sexe, les migrants, les HSH (hommes ayant des rapports<br />
sexuels avec des hommes), les CDI (consommateurs de drogues injectables),<br />
les populations carcérales, les jeunes et les femmes.<br />
Les actions de l’association visent aussi bien les jeunes structurés (dans les<br />
écoles, les maisons de jeunes, les CFPA, les clubs sportifs,…), que les jeunes<br />
non structurés (sur les plages, dans les stades, les souks…)<br />
La stratégie en faveur des jeunes comprend des actions de proximité et un travail<br />
de recherche :<br />
Des actions de proximité par les pairs : il s’agit essentiellement de sensibilisation<br />
et de prévention utilisant du matériel IEC (Information-Éducation-Communication)<br />
conçu par l’association et adapté au contexte socioculturel avec la participation<br />
des populations cibles.<br />
La recherche : une étude, « VIH/Sida et jeunes en milieu universitaire » est en<br />
cours. C’est une étude-enquête de type CAP (Connaissances-Aptitudes-<br />
Pratiques) qui cible deux sites (l’université de Bab Ezzouar et l’école des Hautes<br />
études économiques et commerciales d’Alger). Cette étude fait suite à des actions<br />
de sensibilisation menées à travers différentes facultés d’Alger (3 sites), et<br />
réalisées par des pairs formés par l’association.<br />
78<br />
aids algérie,<br />
association pour l’information sur<br />
les drogues et le sida
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Le dernier produit de l’association est un dépliant contenant les dispositions générales<br />
de l’arsenal juridique sur les Droits de l’Homme dans le cadre du VIH/Sida.<br />
Il est rédigé en français et en anglais, vise également les populations migrantes et<br />
a été réalisé avec le soutien de l’Union Européenne et ONUSIDA. Dans le cadre<br />
du même projet, Aids <strong>Algérie</strong> réalise une cartographie des populations vulnérables<br />
au VIH/Sida avec identification des besoins.<br />
L’association reçoit beaucoup de jeunes orientés par les pairs pour une connaissance<br />
approfondie du VIH/Sida et des autres IST (Infections Sexuellement<br />
Transmissibles) ; pour la distribution de préservatifs, de matériel de sensibilisation<br />
(dépliants) et aussi pour l’orientation vers les centres de dépistage volontaire<br />
(CDV) et vers les centres de référence (CDR) pour soins, suivi médical et soutien<br />
psychologique. Il existe 7 CDR sur le territoire national : à l’hôpital El Kettar, à<br />
l’hôpital militaire de Ain Naadja, au CHU d’Oran, de Sétif, de Constantine, de<br />
Annaba et à l’hôpital de Tamanrasset.<br />
Aids <strong>Algérie</strong> partage son siège avec l’association El Hayet des personnes vivant<br />
avec le VIH (personnes infectées et affectées par le VIH/Sida). L’axe aide sociale<br />
est celui qui pose le plus de problèmes. Les personnes touchées par le VIH/Sida<br />
sont souvent – ou le deviennent suite à la contamination – des personnes vivant<br />
dans la précarité. L’association El Hayet a créé un atelier de formation professionnelle<br />
en couture et décoration, ouvert à toutes les personnes vivant dans la précarité<br />
mais qui a fini par fermer faute de financements. L’association avait organisé cette<br />
activité dans le cadre d’une convention signée avec le ministère de l’Enseignement<br />
et de la Formation professionnelle, un centre de formation professionnelle et<br />
d’apprentissage et l’agence nationale de gestion du microcrédit (ANgEm).<br />
Aids <strong>Algérie</strong> coordonne un réseau informel d’intervenants communautaires et<br />
associatifs, Algerian network against Aids (ANAA), qui active dans le domaine<br />
du VIH/Sida. Il regroupe 5 associations à thématique Sida (El Hayet, Aids <strong>Algérie</strong>,<br />
Solidarité Aids, AnisS de Annaba et APCS d’Oran) et une dizaine d’associations<br />
qui intègrent cette thématique parmi leurs actions, comme le<br />
Croissant-rouge algérien (CRA), les Scouts musulmans, le réseau NADA,<br />
Iqraa... L’objectif du réseau ANAA est de coordonner la réponse communautaire<br />
pour l’intégrer dans le cadre du PNS 2008-2012.<br />
L’ONUSIDA est un partenaire clé du CNLS (Comité national de lutte contre le<br />
Sida). Elle apporte un soutien pour une meilleure réponse nationale au VIH. La<br />
mobilisation de ressources financières est un problème majeur pour la réalisation<br />
et la mise en œuvre du PNS depuis le non-renouvellement du programme Fond<br />
mondial.<br />
79
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personnes contact : Pr Abdelaziz Tadjeddine, président ;<br />
Faiza Rahou, directrice exécutive ; Zoubida Bouzada, secrétaire générale.<br />
Adresse : 2, rue Sylvain Parent, Gambetta, (Cave Gay) Oran.<br />
Téléphone : 041 42 14 05, Tél./Fax : 041 53 05 79.<br />
E-mail : hakelwikaya10@yahoo.fr<br />
L’association de protection contre le sida « APCS » (Hak El Wikaya) a été créée<br />
le 1 er mars 1998. Sa mission est de répondre à des besoins non satisfaits en matière<br />
d’information, d’éducation, de communication et de prévention en ce qui<br />
concerne le Sida pour le grand public, en particulier les personnes en difficulté<br />
et vivant dans des conditions précaires et/ou difficiles. Le champ d’action initial<br />
de l’APCS était la wilaya d’Oran : il s’est progressivement élargi. Actuellement,<br />
l’association essaie de répondre aux besoins de personnes et de malades de 11<br />
autres wilayas de la région ouest.<br />
L’action de l’APCS se déploie sur 4 axes :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La prévention ;<br />
La prise en charge médico-psycho-sociale ;<br />
La défense des droits des personnes vivant avec le VIH et les populations<br />
vulnérables (les travailleurs du sexe et les HSH : hommes ayant des relations<br />
sexuelles avec des hommes) ;<br />
Le plaidoyer.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La prévention dite institutionnelle des collectivités structurées : collèges, lycées<br />
et universités. Il s’agit de sensibilisation, de distribution de dépliants et<br />
de préservatifs et de proposition de dépistage anonyme. L’APCS est la seule<br />
association disposant d’un centre de dépistage.<br />
La prévalence du Sida au sein de la population générale est faible, elle est de<br />
0,01% ; mais la prévalence au sein des populations vulnérables comme les travailleurs<br />
du sexe, est de 4%. C’est ce que l’on appelle une épidémie concentrée.<br />
80<br />
l’apcs,<br />
association pour la prévention<br />
contre le sida
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
L’action de l’APCS est en train d’évoluer vers la prévention auprès des collectivités<br />
non structurées, notamment les populations vulnérables. Un groupe d’une<br />
dizaine de jeunes éducateurs pairs exploitent tous les évènements de la ville<br />
et les différentes célébrations pour sensibiliser la population en général et les<br />
populations vulnérables en particulier.<br />
La prise en charge médico-psycho-sociale : l’APCS a constitué un réseau de<br />
soutien pour le suivi médical et l’accompagnement des personnes atteintes par<br />
le VIH et /ou IST en lien avec des médecins du secteur privé qui les soignent<br />
gracieusement et 5 laboratoires d’analyses pour les explorations biologiques.<br />
Un groupe de parole est organisé une fois par mois pour des femmes séropositives<br />
de différentes wilayas. L’APCS met à disposition un local, offre le café,<br />
prend en charge les frais de transport, de restauration et d’hébergement pour<br />
celles qui ne peuvent rentrer chez elles le jour même. L’APCS prend en charge<br />
également les frais de transport et les frais d’examens (charge virale) qui ne peuvent<br />
se faire qu’à Alger pour les personnes en situation de précarité. L’organisation<br />
de consultations médicales au siège de l’APCS est en projet avec des<br />
orientations vers un réseau de médecins de différentes spécialités.<br />
L’APCS suit scrupuleusement les protocoles internationaux en matière d’anonymat<br />
et de confidentialité. Il s’agit de respecter les droits de la personne et de<br />
soutenir le consentement éclairé des proches.<br />
Des cas de plus en plus nombreux d’enfants infectés par le VIH à la naissance<br />
sont diagnostiqués à l’hôpital pédiatrique Canastel et au CHU d’Oran, mais la<br />
question d’un dispositif et d’un protocole de prise en charge clairement définis<br />
concernant les enfants infectés par le VIH reste posée. Il s’agit souvent d’enfants<br />
nés de parents en grande précarité. Ils sont touchés par un fort taux de mortalité<br />
du fait qu’il n’existe pas de prise en charge codifiée. Le signalement de l’enfant<br />
est systématiquement enregistré et dés le départ aucune confidentialité n’est donc<br />
possible, particulièrement dans les petites localités.<br />
Il arrive que l’APCS soit saisie pour des dépistages auprès de mineurs sur réquisition<br />
de la police. L’association réalise assez régulièrement des campagnes de<br />
prévention au sein des 2 centres spécialisés de rééducation (CSR) de la wilaya.<br />
LA DÉFENSE DES DROITS<br />
Dès qu’une personne atteinte du VIH ou touchée par une mST est victime de<br />
discrimination dans un service public ou privé, comme un service de santé par<br />
exemple, l’association se constitue en partie civile pour dénoncer les faits et défendre<br />
la victime. Un avocat membre de l’association est soutenu dans ce travail<br />
81
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
par un cabinet d’avocats qui intervient dans le cas de dépassements concernant<br />
les populations vulnérables.<br />
Le plaidoyer : l’APCS développe des actions de plaidoyer et mobilise différentes<br />
instances pour la promotion d’une santé sexuelle et reproductive saine. Dans<br />
l’ouest algérien, des chiffres ont montré que dans la « file active » (le groupe de<br />
personnes infectées), 68 femmes sont infectées dans le cadre du mariage.<br />
Des formations en plaidoyer sont mises en place pour les membres de l’association,<br />
particulièrement les éducateurs pairs et les personnes bénévoles de manière<br />
générale, dans le cadre d’un réseau arabe (maghreb et Liban) pour la lutte<br />
contre le Sida.<br />
De même l’association est membre du réseau Afrique 2000 regroupant un ensemble<br />
d’associations de l’Afrique de l’ouest, de l’Afrique centrale et du maghreb<br />
(17 pays). Ce réseau est coordonné par AIDES France.<br />
82
LE TRAVAIL DES ENFANTS<br />
DÉFINITION DE L’UNICEF 7<br />
« Le travail des enfants et ses pires formes, telles qu’elles sont<br />
définies par les conventions de l’Organisation internationale du<br />
Travail (OIT), nuisent à la santé des enfants, compromettent leur<br />
éducation et conduisent à d’autres formes d’exploitation et de<br />
maltraitance. L’UNICEF n’est pas opposé au travail que les enfants<br />
peuvent effectuer chez eux, dans la ferme familiale ou dans<br />
une entreprise familiale, tant que ce travail ne nuit pas à leur santé<br />
et à leur bien-être, et à condition qu’il ne les empêche pas d’aller<br />
à l’école et de profiter de leur enfance. »<br />
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
La loi n°90-11 relative aux relations de travail a codifié l’âge<br />
légal du travail qui est fixé à 16 ans, sauf pour les cas de<br />
contrats d’apprentissage, et n’a autorisé le travail du mineur<br />
que sur autorisation de son tuteur légal. Cette même loi interdit<br />
l’exploitation des travailleurs mineurs dans des travaux dangereux<br />
et insalubres ou affectant leur santé ou leur moralité. Les<br />
dispositions de cette loi ont interdit également l’exploitation<br />
des personnes de moins de 19 ans dans tout travail de nuit. La<br />
législation algérienne reconnaît le droit à la protection sociale<br />
de l’enfant.<br />
En 2000, L’<strong>Algérie</strong> a ratifié la Convention n° 182 concernant<br />
l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action<br />
immédiate en vue de leur élimination, complétée par la recommandation<br />
190 adoptée par la conférence internationale du travail<br />
en 1999.<br />
En 2003, il a été installé au sein du ministère du Travail et de la<br />
Protection sociale une commission interministérielle de prévention<br />
et de lutte contre le travail des enfants, qui regroupe douze<br />
départements ministériels, un représentant de l’Union générale<br />
7. Fiches d’information sur la « Protection de l’enfant », UNICEF, mai 2006. http://www.unicef.org/french/<br />
publications/index_34146.html.<br />
83
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
84<br />
des Travailleurs <strong>Algérie</strong>ns (UgTA), et un représentant du mouvement<br />
associatif. Le rôle confié à cette commission est la mise<br />
en place d’un programme de prévention et de lutte contre le travail<br />
des enfants. Une enquête a été menée par l’inspection du<br />
travail en 2006.
Personnes contact : Mme Belhadad Nassima, sous-directrice.<br />
Mr Abdelguerfi Yacine, chef de bureau.<br />
Adresse : Les deux bassins, Ben Aknoun, Alger.<br />
Téléphone : 021 91 13 01 / 91 28 50.<br />
Site internet : www.mfep.gov.dz<br />
La mission du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels<br />
(mFEP) est d’offrir une qualification professionnelle aux jeunes par une formation<br />
initiale ou par une formation continue.<br />
Il existe 1135 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA)<br />
sur le territoire, ils dispensent :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Une formation en résidentiel ou « présentielle » à partir de l’âge de 16 ans<br />
et jusqu’à 26 ans ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Une formation par apprentissage à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à 26 ans.<br />
Il s’agit d’un enseignement ou CFPA en alternance avec un stage en entreprise.<br />
L’apprenti est lié par un contrat avec l’Assemblée populaire communale (APC),<br />
l’entreprise et le CFPA ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
la sous-direction de la formation des catégories particulières,<br />
ministère de la formation<br />
et de l’enseignement professionnels, mfep<br />
Une formation à distance, sans limitation d’âge avec un regroupement périodique<br />
une fois par semaine au CFPA dans différentes filières : comptabilité,<br />
techniques d’administration et de gestion…<br />
La nomenclature des formations évolue en fonction de l’évolution de la technologie.<br />
Elle a été révisée en 2007 et compte 20 branches professionnelles avec 301<br />
spécialités. 80 spécialités sont réservées aux jeunes qui n’ont pas le niveau requis<br />
(9 ème année fondamentale ou 4 ème année moyenne). Après une préformation de 3 à<br />
6 mois en renforcement des connaissances scolaires et une mise à niveau au CFPA,<br />
le conseiller d’enseignement professionnel reçoit le jeune, évalue son niveau, ses<br />
capacités et lui propose une orientation en formation ou en apprentissage.<br />
85
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
En 2005, un nouveau dispositif a été institué : le diplôme de l’enseignement<br />
professionnel (DEP), ouvert aux jeunes admis en classe de 1 ère secondaire pour<br />
un enseignement technique au sein des instituts d’enseignement professionnel<br />
(IEP). Deux niveaux sont prévus, le DEP1 (diplôme d’enseignement professionnel)<br />
et le DEP2 qui comprennent une formation académique dans le cadre<br />
d’une convention avec le ministère de l’Éducation nationale. Cet enseignement<br />
professionnel est mené à titre expérimental par l’ouverture de 5 à 6 IEP<br />
sur le territoire, soit un par région. Cette initiative s’inscrit dans le cadre<br />
de la loi 08-07 du 23 février 2008 portant orientation de la formation et de l’enseignement<br />
professionnels.<br />
LA FORmATION PROFESSIONNELLE<br />
DES CATÉgORIES PARTICULIèRES<br />
Le mFEP inclut dans les catégories particulières, les personnes handicapées physiques<br />
sur le plan moteur ou sensoriel, les malades chroniques, les jeunes en<br />
danger moral et les jeunes en milieu carcéral.<br />
La formation professionnelle des jeunes en situation de handicap peut être<br />
organisée selon différentes modalités :<br />
Les jeunes en situation de handicap léger sont intégrés dans les CFPA avec les<br />
jeunes valides sur tout le territoire national.<br />
Des sections spéciales peuvent être ouvertes au niveau d’un CFPA pour un<br />
groupe de jeunes handicapés comme par exemple la formation au standard pour<br />
les non voyants et la menuiserie pour malentendants à Batna.<br />
Des sections détachées sont organisées en collaboration avec les associations<br />
dans le cadre de conventions. Les formations sont assurées par des formateurs<br />
du CFPA en collaboration avec les professionnels de l’association. La validation<br />
de la formation est sanctionnée par une attestation délivrée par le CFPA.<br />
Les différentes modalités de formation sont ouvertes aux personnes handicapées<br />
sans limite d’âge.<br />
Le secteur compte 4 établissements spécialisés :<br />
Le CFPA Belaalem Saïd à Kouba, 4 chemins. C’est le plus ancien, ouvert<br />
depuis 1987.<br />
Le CFPA Tadjeouinet mohamed à Boumerdes-Corso<br />
Le CFPA de Oued Djemaa<br />
Le CFPA mahboubi Ahmed à Laghouat<br />
Les 3 derniers CFPA ont été créés en 2005. L’ouverture d’une section informatique<br />
adaptée à la déficience visuelle est prévue pour la rentrée 2010-2011.<br />
86
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Un 5 ème établissement doit ouvrir ses portes à Skikda en 2010 également, avec<br />
une capacité de 250 places pédagogiques et un internat de 120 lits (60 pour les<br />
filles et 60 pour les garçons). Il est conçu selon les normes internationales et<br />
sera doté d’une équipe qui comprend un médecin, un psychologue et un conseiller<br />
d’enseignement professionnel. Il s’adresse à des jeunes avec des handicaps<br />
plus ou moins lourds.<br />
Les formations destinées aux personnes handicapées concernent généralement<br />
l’artisanat, la sculpture sur bois, la poterie-céramique, l’horticulture, la vannerie-dinanderie,<br />
la cordonnerie, mais aussi l’informatique, le secrétariat et la<br />
peinture-lettres-décoration.<br />
Une convention signée en mars 2004 lie le ministère de la Solidarité nationale<br />
(mSN) et celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels (mFEP).<br />
Elle porte sur l’assistance du mSN dans la formation continue des formateurs<br />
du mFEP sur l’approche du handicap, organisée au centre national de formation<br />
professionnelle pour handicapés physiques (CNFPHP) de Khemisti.<br />
Une autre convention a été signée avec le mSN, le 15 mars 2010, pour l’organisation<br />
de la formation professionnelle en sections détachées dans les écoles de<br />
jeunes sourds (EJS), les écoles de jeunes aveugles (EJA) et les centres médicopsycho-pédagogiques<br />
(CmPP). Le mFEP détache les formateurs, assure les programmes<br />
pédagogiques issus de la formation professionnelle et délivre les<br />
diplômes. Un comité mixte est chargé d’élaborer les programmes et les modalités<br />
de mise en œuvre de la convention.<br />
Les jeunes en danger moral : Ils sont intégrés dans des sections détachées. Ils<br />
viennent des CSP, CSPJ, et CSR ou orientés par les SOEmO vers les CFPA.<br />
Les jeunes en milieu carcéral : chaque établissement pénitencier signe une<br />
convention spécifique avec un CFPA et des sections détachées sont ouvertes en<br />
milieu pénitencier. Il existe aussi des « Formations conventionnées » : un<br />
groupe de détenus est transporté vers un CFPA sous surveillance pour suivre<br />
une formation. Dans le cadre de la semi-liberté, les jeunes âgés entre 16 et 25<br />
ans sont autorisés à se déplacer vers le CFPA de façon autonome.<br />
Dans les dispositions spécifiques pour les femmes, le mFEP a mis en place un<br />
certain nombre de dispositifs dont le dernier, comprend la création de télé-centres<br />
au niveau des CFPA, en partenariat avec Invent. Il s’agit d’initier des<br />
femmes aux technologies de l’information et de la communication (TIC) et de<br />
87
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
leur permettre d’avoir accès aux informations sur les différents dispositifs de<br />
formation professionnelle, d’aide et de soutien à l’emploi et de procéder à la<br />
commercialisation des produits réalisés.<br />
L’émission télévisée « Mihan wa Hiraf », diffusée tous les mercredis entre 17h30<br />
et 18h à l’ENTV est réalisée avec la collaboration du mFEP.<br />
88
LES ENFANTS AYANT AFFAIRE AVEC LA JUSTICE<br />
DÉFINITION DE L’UNICEF 8<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
« L’expression “enfants ayant affaire avec la justice” » désigne<br />
toute personne de moins de 18 ans qui a affaire au système judiciaire<br />
après avoir été soupçonnée ou accusée d’avoir enfreint la<br />
loi. La plupart des enfants ayant affaire avec la justice ont commis<br />
de petits larcins ou des infractions de gravité mineure : vagabondage,<br />
absentéisme scolaire, mendicité ou consommation d’alcool.<br />
Il s’agit parfois de « délits d’état », qui ne sont pas considérés<br />
comme une infraction lorsqu’ils sont commis par des adultes. En<br />
outre, certains enfants au comportement délictueux ont été utilisés<br />
ou contraints par des adultes. Trop souvent, un enfant a affaire avec<br />
la justice en raison de préjugés liés à son origine raciale ou ethnique<br />
ou à sa condition sociale et économique, sans avoir même<br />
commis d’infraction, ou est maltraité par les forces de l’ordre à<br />
cause de ces préjugés.<br />
Dans le domaine de la justice pour mineurs, l’UNICEF vise à réduire<br />
les incarcérations, tout en protégeant les enfants de la violence,<br />
de la maltraitance et de l’exploitation. L’UNICEF encourage<br />
les programmes de rééducation faisant appel aux familles et aux<br />
communautés, moins dangereux et plus efficaces et adéquats que<br />
les mesures répressives. Les systèmes judiciaires conçus pour les<br />
adultes n’ont souvent pas les moyens de remédier adéquatement à<br />
ces problèmes et risquent de compromettre, plus souvent que<br />
d’améliorer, les possibilités de réinsertion sociale d’un enfant.<br />
Pour ces différentes raisons, l’UNICEF prône activement la réorientation<br />
(orienter l’enfant vers des solutions communautaires<br />
et non vers des procédures judiciaires), la justice réparatrice (favoriser<br />
la réconciliation, la restitution et la responsabilisation,<br />
avec la participation de l’enfant, des membres de sa famille, des<br />
victimes et de la communauté), et des solutions autres que les<br />
peines privatives de liberté (services de conseils, sursis probatoire<br />
et services d’intérêt général). »<br />
8. Fiches d’information sur la « Protection de l’enfant », UNICEF, mai 2006. http://www.unicef.org/french/<br />
publications/index_34146.html<br />
89
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
90<br />
La législation algérienne (code pénal) élaborée par et pour des<br />
adultes est projetée sur l’enfant. Elle consacre, cependant des procédures<br />
souples et prévoit des sanctions adaptées à l’enfance. L’ordonnance<br />
n°72-03 du 10 février 1972, relative à la protection de<br />
l’enfance et de l’adolescence prévoit des sanctions en milieu fermé<br />
et en milieu ouvert pour les enfants en conflit avec la loi.<br />
Il existe une trentaine de centres spécialisés de rééducation (CSR)<br />
placés sous l’autorité du ministère de la Justice, qui accueillent<br />
les enfants en conflit avec la loi. Conçus pour accueillir environ<br />
2 800 jeunes, ils en hébergent prés de 2 000 à l’heure actuelle.<br />
Concernant le placement en milieu fermé, le juge des mineurs<br />
peut confier provisoirement le délinquant à un centre d’accueil, à<br />
la section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée<br />
à cet effet, au service public chargé de l’assistance à l’enfance ou<br />
à un établissement hospitalier. Le juge peut aussi confier le mineur<br />
à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de<br />
soins, de l’État, d’une administration publique habilitée ou d’un<br />
établissement privé agréé. Concernant le placement en milieu ouvert,<br />
le mineur peut être confié provisoirement à ses parents, à<br />
son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne<br />
digne de confiance. En laissant l’enfant dans son milieu naturel,<br />
le juge peut assortir cette mesure de la mise en liberté surveillée.<br />
Concernant le placement dans un milieu pénitentiaire (détention<br />
provisoire), le législateur algérien soucieux de l’intérêt de l’enfant<br />
et de sa protection spécifique a érigé en principe la séparation<br />
entre les mineurs et les majeurs. L’enfant en conflit avec la<br />
loi et âgé entre 13 et 18 ans ne peut être placé provisoirement<br />
dans un établissement pénitentiaire. mais si cette mesure paraît<br />
indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition,<br />
ce mineur doit être retenu dans un quartier spécial et à<br />
défaut dans un local spécial. Il est autant que possible soumis à<br />
l’isolement de nuit. La détention provisoire pour un mineur de<br />
moins de 13 ans est interdite.<br />
La promulgation de la loi n°05-04 du 6 février 2005, portant sur le<br />
code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
détenus, a pour objet de consacrer des principes et des règles en vue<br />
de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l’idée de<br />
défense sociale qui fait de l’application des peines un moyen de<br />
protection de la société par la rééducation et la réinsertion sociale<br />
des détenus. La loi insiste sur le fait que les détenus sont traités de<br />
manière à préserver leur dignité humaine et à assurer l’élévation<br />
de manière constante de leur niveau intellectuel et moral sans<br />
distinction de race, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion.<br />
Ladite loi n’a pas manqué de mettre en place un régime spécial à<br />
l’intention des mineurs. Ces derniers ont droit à un traitement<br />
adapté à leur âge et à leur personnalité dans le respect de leur dignité<br />
et la garantie d’une prise en charge totale, d’avoir une nourriture<br />
équilibrée et des vêtements appropriés, des soins médicaux,<br />
des moments de loisirs au grand air et au quotidien, d’avoir droit<br />
au parloir rapproché et d’user des moyens de communication tout<br />
en mettant en place des tâches spécifiques en vue de promouvoir<br />
leur formation scolaire ou professionnelle (articles 116 à 121). Cependant,<br />
malgré ses côtés positifs, le dispositif législatif est appelé<br />
à être renforcé par la prise en charge de certains aspects tels que le<br />
renforcement de la dimension préventive et éducative des mineurs,<br />
la participation plus grande et efficiente des institutions et des personnes<br />
qui s’occupent des enfants, la poursuite de l’évolution du<br />
statut de l’enfant notamment au sein de la famille et la réduction<br />
de la tolérance sociale face à des pratiques de maltraitance envers<br />
les enfants.<br />
91
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personnes contact : Mr Boucena Djamel, chef de Service ;<br />
Melle Sahnoun Badia, éducatrice spécialisée principale.<br />
Adresse : Birkhadem, Alger.<br />
Téléphone : 021 55 32 97.<br />
La Direction de l’Action Sociale (DAS) de chaque wilaya abrite un SOEmO<br />
qui couvre l’ensemble de la wilaya. Il existe 48 SOEmO sur le territoire national.<br />
Le statut des SOEmO est défini par l’ordonnance 75-64 du 26 septembre 1975.<br />
L’équipe du SOEmO d’Alger est composée de 4 psychologues, 2 assistantes<br />
sociales, 1 éducateur polyvalent, 6 éducateurs spécialisés en sauvegarde de la<br />
jeunesse.<br />
Tous les membres de cette équipe assument la fonction d’assesseur par binômes<br />
pour chacun des 5 tribunaux d’Alger : Sidi m’hamed – Abane Ramdane, Bab El<br />
Oued, Bir mourad Rais, Hussein Dey, El Harrach. Le travail avec les tribunaux<br />
concerne les mineurs en liberté surveillée préventive (LSP) en liberté surveillée<br />
(LS) en danger moral (Dm) et pour enquête sociale (ES) dans les cas de conflit en<br />
lien avec la kafala et dans les litiges sur les droits de garde de l’enfant.<br />
Dans le travail avec la DAS, il s’agit généralement d’enquêtes sociales pour les<br />
demandes de kafala ou pour les demandes d’aides des familles démunies.<br />
Dans le cadre de la prévention, les parents peuvent, sur une demande manuscrite,<br />
obtenir le suivi éducatif et psychologique de leur enfant mineur.<br />
L’équipe dispose de moyens limités pour assumer ses missions. Elle ne dispose<br />
pas de véhicule pour effectuer les multiples déplacements, ne bénéficie que rarement<br />
de formations continues et n’a que très peu de liens avec les autres structures<br />
qui travaillent dans le même domaine. Le SOEmO se trouve dans la même<br />
enceinte que le CSP (Centre Spécialisé de Protection) mais il n’y a aucun contact<br />
entre les 2 équipes.<br />
92<br />
exemple du soemo d’alger,<br />
das (direction de l’action sociale)<br />
de la wilaya d’alger<br />
service d’observation et d’éducation en milieu ouvert
Personne contact : Mr Boutouil Mustapha, chef de bureau.<br />
Adresse : Haï Ibn Sina, Oran.<br />
Téléphone : 041 46 60 74.<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
exemple du bureau de l’insertion sociale,<br />
das (direction de l’action sociale)<br />
de la wilaya d’oran<br />
Le bureau de l’insertion sociale comprend le SOEmO et le service de l’insertion<br />
sociale des personnes âgées et des personnes handicapées.<br />
Le SOEmO est chargé du suivi des mineurs en liberté surveillée et mène des enquêtes<br />
sociales sur instruction du juge des mineurs. L’objectif étant l’insertion<br />
des jeunes en lien avec la justice, qu’ils aient commis des délits ou qu’ils soient<br />
en danger moral. Les éducateurs enquêtent sur l’entourage du mineur, sur sa famille,<br />
son voisinage, ses fréquentations. Le rapport établi est adressé au juge. Le<br />
suivi des mineurs est assuré par l’éducateur ou le psychologue. Quand le mineur<br />
est placé par le juge dans un centre spécialisé de rééducation (CSR), l’éducateur<br />
ou le psychologue qui a fait l’enquête assure le suivi et l’accompagnement du<br />
jeune. Il lui rend visite au CSR. Il existe 2 CSR à Oran, un pour les filles et un<br />
pour les garçons. La difficulté du service réside dans le fait que les déplacements<br />
sont à la charge des employés.<br />
L’équipe du SOEmO est composée de 8 éducateurs spécialisés, de 2 psychologues<br />
cliniciens titulaires et 2 psychologues issus du dispositif DAIP (Dispositif<br />
d’Aide à l’Insertion professionnelle). Le projet de la DAS pour 2010 est la<br />
création d’un SOEmO par daïra.<br />
Le SOEmO d’Oran, installé dans un quartier particulièrement défavorisé, à Ibn<br />
Sina (ex-Victor Hugo) dispose d’espaces spacieux, d’une grande salle centrale<br />
ouverte, de plusieurs bureaux et d’un petit stade mais pas de chauffage. Le responsable<br />
du service compte améliorer l’accessibilité aux différents espaces pour<br />
les personnes en situation de handicap.<br />
Le service doit disposer de 5 ordinateurs et d’une connexion Internet dont pourront<br />
bénéficier les employés mais aussi les jeunes.<br />
93
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Le bureau d’insertion sociale a mis en place une cellule d’écoute des femmes victimes<br />
de violences orientées par les associations pour un soutien psychologique<br />
et l’orientation vers la justice ou la médiation familiale.<br />
Le bureau a mis en place une cellule de coordination de l’action sociale où siègent<br />
des représentants du mouvement associatif de la wilaya d’Oran avec le<br />
chef de bureau de l’insertion sociale et le chef de bureau de la famille. Cette<br />
cellule est présidée par mr Chougrani Serir Boualem qui est président de l’association<br />
Chougrani. La cellule est chargée de la programmation et du suivi des<br />
actions de solidarité. Parmi ces actions de solidarité figure l’aide aux personnes<br />
vivant dans la rue. C’est dans le cadre de ces activités, que la DAS d’Oran a<br />
élaboré un projet de création d’un SAmU sociale pour l’intervention sociale<br />
d’urgence prévoyant un hébergement qui n’excède pas 15 jours.<br />
94
Personne contact : M. Cherdoudi, chef de service.<br />
Téléphone : 041 40 54 02.<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
exemple du service des activités de la jeunesse,<br />
direction de la jeunesse et des sports (djs)<br />
de la wilaya d’oran<br />
La DJS est chargée de proposer des activités culturelles et récréatives aux enfants<br />
pendant leur temps libre et pendant les vacances scolaires. Dans la wilaya<br />
d’Oran, il y a 17 maisons de jeunes. Une dizaine de psychologues (une par établissement)<br />
y proposent des consultations. Une dizaine de médecins animent des<br />
séances de sensibilisation dans les écoles : lutte contre la toxicomanie, hygiène<br />
sanitaire, etc. Les médecins sont chargés du suivi des sportifs adhérents des clubs<br />
de la DJS.<br />
La DJS travaille en collaboration avec le centre spécialisé de rééducation (CSR)<br />
de gdyel, relevant du ministère de la Justice et les deux centres spécialisés de<br />
protection (CSP) relevant du ministère de la Solidarité ; celui des filles à gambetta<br />
et celui des garçons à Sidi Djamel.<br />
Au CSR de gdyel, la DJS a détaché 3 éducateurs spécialisés et un TSS (technicien<br />
supérieur de sport) chargés de l’organisation des activités sportives à l’intérieur<br />
du centre. Un TSS est affecté au CSP de Sidi Djamel. Une fois par<br />
semaine, une psychologue se déplace au centre pour assurer l’écoute et le soutien<br />
psychologiques. Des caravanes culturelles présentent des spectacles de musique<br />
et de théâtre, une fois par quinzaine dans chaque établissement. Le matériel pour<br />
le sport est fourni par la DJS.<br />
En collaboration avec le secteur de l’éducation, la DJS organise des sorties de<br />
plein air en mars-avril-mai pour les enfants issus de familles démunies. En été,<br />
le « Plan bleu » est mis en place en collaboration avec les associations de proximité<br />
pour regrouper des enfants de familles nécessiteuses pour des séjours en<br />
bord de mer. Les enfants sont encadrés par des animateurs de la DJS.<br />
En cours d’année scolaire des activités d’informatique, de théâtre, de musique,<br />
de dessin et des activités de soutien scolaire et des cours de langue étrangère<br />
pour les enfants et les jeunes sont proposées au sein des maisons de jeunes.<br />
95
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
LES ENFANTS AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES :<br />
LES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP<br />
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION<br />
RELATIVE AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPÉES<br />
La Convention relative aux droits des personnes handicapées a été<br />
adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre<br />
2006. Après cinq années de gestation, elle est ouverte à signature<br />
et ratification depuis le 30 mars 2007. Un an plus tard, début<br />
avril 2008, 20 États avaient ratifié la Convention internationale relative<br />
aux droits des personnes handicapées, étape décisive ouvrant<br />
la voie à son entrée en vigueur.<br />
En son article 1er, la Convention stipule : « … Par personnes handicapées<br />
on entend des personnes qui présentent des incapacités<br />
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont<br />
l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur<br />
pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité<br />
avec les autres. »<br />
L’article 3 définit les Principes généraux de la Convention :<br />
96<br />
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle,<br />
y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance<br />
des personnes ;<br />
b) La non-discrimination ;<br />
c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;<br />
d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes<br />
handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de<br />
l’humanité ;<br />
e) L’égalité des chances ;<br />
f) L’accessibilité ;<br />
g) L’égalité entre les hommes et les femmes ;<br />
h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé<br />
et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur<br />
identité.
DANS LE CADRE DE LA LÉgISLATION ALgÉRIENNE (PNA)<br />
L’<strong>Algérie</strong> a consacré les droits des personnes en situation de handicap<br />
dans la « Loi n° 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection<br />
et à la promotion des personnes handicapées » et a ratifié la<br />
Convention relative aux droits des personnes handicapées en mai<br />
2009.<br />
L’ACCèS DES PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP<br />
À DES SERVICES INTÉgRÉS DE SOINS<br />
Les lois algériennes ne présentent aucune discrimination quant<br />
à l’accès aux soins des enfants et des adolescents, cependant<br />
l’insuffisance d’aménagements spécifiques est une véritable<br />
contrainte.<br />
Par ailleurs, l’insuffisance de personnel spécialisé, de structures<br />
adaptées (rééducation fonctionnelle, orthopédie, soins et rééducation<br />
psychomotrice, pédopsychiatrie…) est à souligner. Cela oblige<br />
les familles à des déplacements fréquents, de l’intérieur du pays<br />
vers les structures du nord, occasionnant des difficultés et des coûts<br />
financiers répétitifs et difficilement supportables. L’abandon des<br />
soins est souvent observé en raison de ces difficultés.<br />
LA SCOLARISATION DES ENFANTS<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
VIVANT AVEC UN HANDICAP<br />
Les enfants vivant avec des handicaps sensoriels (malentendants<br />
et non voyants) bénéficient d’une éducation spécialisée dans les<br />
35 écoles de jeunes malentendants et les 16 écoles de jeunes non<br />
voyants, tandis que les enfants présentant un handicap moteur<br />
sont admis dans les 8 centres médico-pédagogiques pour handicapés<br />
moteurs et les enfants présentant un handicap mental<br />
sont suivis dans les 79 centres pour inadaptés mentaux. Tous<br />
ces établissements sont sous la tutelle du ministère de la Solidarité<br />
nationale. Ce dernier, en relation avec le ministère de<br />
l’Éducation nationale, a mis en œuvre un dispositif favorisant<br />
l’intégration scolaire des enfants vivant avec un handicap léger<br />
dans les établissements scolaires de leur quartier.<br />
C’est ainsi que le nombre d’enfants vivant avec un handicap inscrits<br />
dans des écoles ordinaires est passé progressivement de 302<br />
en 2002 à 506 en 2004.<br />
97
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
98<br />
Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels<br />
a conclu une convention cadre pour améliorer et renforcer la formation<br />
des personnes ayant des besoins spécifiques. Ainsi le nombre<br />
des personnes ayant des besoins spécifiques et ayant bénéficié<br />
d’une formation professionnelle a évolué de 1306 stagiaires, dont<br />
608 filles en 2003, à 1976 dont 719 filles en 2006.
Personne contact : Mme El Mamri Atika.<br />
Adresse : Cité les Asphodéles Bt B N° 2, Ben Aknoun, Alger.<br />
Téléphone : 021 91 36 70.<br />
Fax : 021 91 31 08.<br />
E-mail : fahm01@hotmail.com<br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
la faph,<br />
fédération algérienne des personnes handicapées<br />
La Fédération <strong>Algérie</strong>nne des Personnes Handicapées fédère 60 associations sur<br />
le territoire national. Son mandat est de défendre l’accès aux droits des personnes<br />
handicapées, dans les domaines de la santé, l’éducation, la formation professionnelle,<br />
l’emploi, les loisirs, l’autodétermination et le droit de donner son opinion.<br />
La fédération veille à l’application et au suivi de la Convention relative<br />
aux droits des personnes handicapées. Elle développe ses actions à travers des<br />
projets qu’elle mène avec différents partenaires :<br />
Le ministère de la Solidarité nationale. La FAPH est associée à tous les travaux<br />
des commissions et des conseils consultatifs relatifs aux questions qui concernent<br />
les personnes handicapées.<br />
Avec le soutien de Handicap International <strong>Algérie</strong> et dans le cadre d’un projet<br />
sur la participation sociale, la FAHm a formé, depuis 2008, 18 associations à<br />
mettre en place des dispositifs :<br />
Une cellule d’information et d’orientation au niveau de chaque association.<br />
Ces cellules représentent l’activité permanente de la FAPH, elles informent<br />
les personnes handicapées sur tous leurs droits et les aident à y avoir accès.<br />
L’établissement d’un diagnostic local sur la situation des personnes handicapées.<br />
Ce diagnostic permet de dépister les personnes handicapées et de mesurer<br />
la participation sociale de la personne.<br />
La mise en place d’espaces de socialisation (EDS) pour les personnes en situation<br />
de handicap. Cet espace constitue le dispositif phare de la fédération. 102<br />
personnes ont été suivies dans ce cadre. Ces espaces visent les personnes longtemps<br />
marginalisées pour les accompagner à la participation sociale et pas nécessairement<br />
à l’insertion sociale : aller dans une maison de jeunes, s’inscrire<br />
99
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
dans un club de sport ou autre, participer à des activités sociales, des loisirs, des<br />
rencontres. Une personne est autonome quand elle évolue en dehors des EDS,<br />
quand elle n’a plus besoin d’être accompagnée par le dispositif. 60 personnes<br />
inscrites depuis 2007 ne veulent plus retrouver leur situation initiale. Un guide<br />
a été élaboré sur la mise en place des EDS. Ce dispositif a même été mis en place<br />
par des structures publiques comme certaines maisons de jeunes. Les personnes<br />
qui s’adressent à ce dispositif sont orientées par les cellules d’information et<br />
d’orientation. L’opération de diagnostic local permet aussi l’orientation vers les<br />
cellules d’information et les EDS. Ce projet doit se poursuivre jusqu’en 2011.<br />
Avec Santé Sud, dans le cadre du projet « Promotion des droits des personnes<br />
en situation de handicap mental au Liban, en Tunisie et en <strong>Algérie</strong> », la FAPH<br />
met en place :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
le dépistage précoce des troubles chez le nourrisson, en formant des professionnels<br />
du secteur de la santé, auprès de la petite enfance, à identifier dès la<br />
naissance les troubles du nourrisson. Ce dépistage permet d’organiser une prise<br />
en charge précoce sur la base du principe « dépister pour insérer ». Ce programme<br />
a lieu dans les secteurs de Bab El Oued, Béni messous et Hussein Dey ;<br />
La mise en place de groupes de parole pour les mamans d’enfants handica-<br />
<strong>ˇ</strong> pés. Un guide pour les parents a été élaboré dans ce cadre ;<br />
La formation d’une quinzaine de psychologues à l’animation de groupes<br />
de parole.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
En réponse à un appel à projet lancé par le ministère de la Jeunesse et des Sports,<br />
la FAPH a mis en œuvre un projet « Informatique adaptée, une solution pour<br />
lutter contre l’exclusion des jeunes en situation de handicap ». Il concerne 10<br />
enfants qui ne vont pas à l’école pour cause de handicap physique. Ils ne peuvent<br />
pas écrire mais ils peuvent suivre une scolarité ordinaire.<br />
Le projet consiste à :<br />
100<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
La mise à disposition d’un ordinateur adapté selon le handicap de l’enfant ;<br />
L’initiation de l’enfant à son utilisation par des jeunes sympathisants de la<br />
FAHm ;<br />
La préparation à la scolarité par immersion progressive dans l’école de son<br />
quartier pour des contacts progressifs avec les enseignants et les élèves ;<br />
L’accompagnement des enseignants par la FAPH tout au long de l’année<br />
scolaire.
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Le 5 ème partenaire est l’association Le Souk qui organise des sorties et des activités<br />
de loisir en faveur des enfants malades des services de pédiatrie et des enfants<br />
handicapés des hôpitaux de rééducation fonctionnelle de Tixeraïne, d’Azur<br />
Plage et de Ben Aknoun. En collaboration avec la FAPH, le Souk a intégré les<br />
enfants handicapés qui ne sortent pas de chez eux. Avec le Souk, une nouvelle<br />
expérience a été introduite : les sorties sont organisées pour les enfants sans les<br />
parents. Il est question de signer une convention pour un programme annuel avec<br />
cette association.<br />
Depuis 1996, le ministère de la Solidarité finance chaque année un camp de vacances<br />
de 15 jours à Chenoua, pour 250 jeunes de tout le territoire national. Ce<br />
camp est adapté aux besoins des personnes handicapées physiques et le personnel<br />
travaille en lien avec la polyclinique du secteur géographique pour le suivi<br />
médical des jeunes pendant le séjour. Au moins 200 jeunes sont en chaise roulante.<br />
Le jeune peut être accompagné par un proche jeune, un frère ou une sœur.<br />
C’est devenu un point de rencontre annuel pour plusieurs jeunes qui s’inscrivent<br />
régulièrement depuis plusieurs années.<br />
La FAPH favorise la création d’auto-écoles pour l’obtention du permis F avec<br />
l’aide du ministère de la Solidarité pour l’acquisition de véhicules aménagés.<br />
Cette opération, sous la responsabilité de la FAPH est confiée à l’Union des handicapés<br />
moteurs de la wilaya d’Alger et à l’association des handicapés moteurs<br />
de la wilaya de Constantine. 2 auto-écoles à Annaba et une à Tizi Ouzou intègrent<br />
dans leurs activités la préparation au permis F avec l’appui du ministère<br />
des Transports pour accord et autorisation. La FAPH soutient ces auto-écoles à<br />
obtenir l’autorisation du ministère du Transport. Au niveau de l’auto école de<br />
l’union d’Alger, 150 personnes handicapées moteurs obtiennent leurs permis de<br />
conduire chaque année.<br />
Enfin avec le soutien d’une entreprise privée, la FAPH a mis en place l’accessibilité<br />
pour les personnes handicapées d’un bureau d’<strong>Algérie</strong>-poste à la cité<br />
malki, dans le cadre d’une action de plaidoyer et afin que l’entreprise étende<br />
l’opération à toutes ses structures au niveau national.<br />
101
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personnes contact : Dr Sadaoui Arab, président ;<br />
Kentache Mohamed, chef de projet Éducation Inclusive.<br />
Adresse : Jardin des sports, stade Chellal Tayeb. BP 095 19 000, Sétif.<br />
Tél : 036 83 11 58.<br />
Fax : 036 83 11 58.<br />
E-mail : apimc.setif@yahoo.fr ; kent_h19@yahoo.fr (kent_h)<br />
Site Internet : http//www.apimc.setif.org/<br />
Le centre de jour de l’APImC concentre les activités permanentes de l’association.<br />
Il est animé par une équipe pluridisciplinaire : un directeur et coordinateur pédagogique,<br />
un médecin, une éducatrice spécialisée, un psychologue orthophoniste,<br />
un psychopédagogue, une psychologue clinicienne, et une institutrice auxiliaire<br />
de vie scolaire.<br />
L’objectif du Centre est de favoriser :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
la plus grande autonomie possible pour chaque enfant, par un programme individualisé<br />
de psychomotricité, kinésithérapie, ergothérapie et orthophonie. En<br />
2010, 24 enfants fréquentent le centre quotidiennement et plus de 650 autres se<br />
sont présentés, 1 à 10 fois chacun, en consultations de suivi médico-social et<br />
guidance parentale ;<br />
la préparation à la scolarité de 24 enfants de façon quotidienne et l’accompagnement<br />
<strong>ˇ</strong> de 60 enfants inscrits à l’école de leur quartier. Ils sont soutenus par<br />
des visites du directeur et de la psychopédagogue de l’APImC, pour concertation<br />
avec l’équipe de l’école et aide aux enseignants. Des demi-journées de rééducation<br />
au Centre et des cahiers de correspondance école-association-famille<br />
sont organisés ;<br />
l’insertion sociale, par l’organisation d’activités extérieures dans les centres<br />
culturels, <strong>ˇ</strong> maisons de jeunes, théâtres pour enfants, musées, piscines, stades, et par<br />
des sorties éducatives et récréatives.L’équipe éducative se réunit périodiquement<br />
pour coordination et réflexion pédagogique.<br />
En 2009, dans le cadre d’un projet en partenariat avec Handicap international,<br />
40 psychologues cliniciennes et orthophonistes bénévoles ont été formées à la<br />
102<br />
l’apimc,<br />
association des parents d’infirmes moteurs<br />
d’origine cérébrale, sétif
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
préparation des enfants à la scolarité en prévision de leur recrutement par l’agence<br />
locale de l’emploi (ALEm) dans 15 des 20 daïras de la wilaya. Il s’agit de constituer<br />
un pool de psychologues dans chaque daira, chargé de la préparation et du<br />
suivi de la scolarité des enfants ImC et myopathes.<br />
Parmi les enfants ImC qui fréquentent le centre de l’association, 2 enfants sont<br />
sourds et le centre n’a pas les moyens techniques pour les accompagner correctement.<br />
L’APImC est confrontée au problème des enfants présentant des handicaps<br />
associés, qui ont des difficultés à être admis dans les EJS, EJA et centres<br />
médico-pédagogiques affiliés à la DAS.<br />
L’association entretient des relations soutenues avec la direction de l’éducation<br />
de la wilaya de Sétif, notamment le service formation et le service scolarité et<br />
l’Inspection. Quand l’enfant a dépassé l’âge de 6 ans, une dérogation est demandée<br />
à la direction de l’éducation pour obtenir son inscription en première année.<br />
L’APImC s’appuie sur les associations de parents d’élèves, qui comptent parmi<br />
leurs membres des directeurs d’établissements scolaires et des enseignants, pour<br />
renforcer ses liens avec les établissements scolaires et les sensibiliser sur les<br />
capacités d’un enfant ImC à suivre une scolarité ordinaire.<br />
103
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Bouchelloukh Ahmed.<br />
Adresse : BP 55 Cité du 20 août 1955 25 000, Constantine.<br />
Téléphone/Fax : 0 31 66 62 67.<br />
Téléphone mobile : 0664 99 07 10 / 0559 55 78 77 / 0771 38 26 26.<br />
E-mail : adem600@yahoo.fr ; Skype : adem600<br />
Blog : ademyopathies.over-blog.com<br />
L’ADEm se définit comme étant une association à caractère humanitaire et social<br />
et non de bienfaisance. Sa mission principale est le plaidoyer : sensibiliser,<br />
interpeller et impliquer les autorités publiques dans la prise en charge des maladies<br />
neuromusculaires. L’ADEm trouve qu’il y a beaucoup de malades oubliés,<br />
marginalisés, exclus. Les malades connaissent l’ADEm par les médias, lors de<br />
journées scientifiques, par la presse écrite, la radio régionale, de malade à malade<br />
et même par l’Association française de lutte contre les myopathies l’AFm et<br />
Handicap international <strong>Algérie</strong> (HI). L’association recense les malades au fur et<br />
à mesure qu’ils la contactent.<br />
Les principales activités de l’ADEm sont :<br />
L’accompagnement à domicile des familles par une équipe de 3 psychologues à<br />
raison d’une visite tous les 21 jours par famille. Chaque psychologue assure le<br />
suivi d’un certain nombre de familles ; environ 25 par an. Le suivi se fait à la<br />
demande de la famille, du malade ou sur proposition de l’association. généralement,<br />
les familles bénéficient d’un suivi de 6 mois à un an mais il y a par exemple<br />
une famille qui est suivie depuis 4 ans.<br />
Beaucoup de familles abandonnent le suivi médical, et l’association les soutient<br />
en prenant les rendez-vous auprès des médecins du CHU de Constantine pour<br />
des consultations et pour des examens biologiques et en imagerie médicale<br />
(IRm, Emg). Des familles qui habitent des régions éloignées (Batna, les wilayas<br />
du sud, Annaba, Bejaia,…) s’adressent à l’association pour la prise de rendezvous<br />
médicaux et l’association s’assure qu’ils passent en consultation en priorité,<br />
voire en urgence, afin de leur permettre de reprendre la route le plus tôt possible.<br />
104<br />
adem,<br />
association défi et espoir contre les myopathies
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
L’association travaille sur ce point en collaboration avec le CHU de Constantine<br />
qui a organisé un pôle de consultation pluridisciplinaire, composé de neurologues,<br />
orthopédistes, médecins rééducateurs, pédiatres, cardiologues, dentiste<br />
pathologiste, psychologue, appareilleur et deux secrétaires médicales.<br />
400 malades bénéficient du suivi de l’association dont la majorité est des enfants<br />
atteints de la myopathie de Duchenne et de l’amyotrophie spinale.<br />
La distribution de dépliants en bord de mer pour sensibiliser les estivants et<br />
dépister des malades myopathes qui n’ont pas accès aux soins.<br />
L’organisation de sorties de loisirs pour les personnes myopathes et leurs familles,<br />
notamment des spectacles de théâtre en collaboration avec l’association<br />
de théâtre constantinoise Belliri.<br />
Une journée des familles est organisée une fois par an, au cours de laquelle<br />
sont présentées des communications par des psychologues et des médecins.<br />
Ces présentations sont suivies d’un cocktail ou d’un gala.<br />
En 2006, l’association a interpelé le ministère de la Santé par la mobilisation<br />
des médias et en adressant une lettre ouverte au président de la république, pour<br />
obtenir la disponibilité du « mestinon », médicament vital dans le traitement des<br />
malades myasthéniques. Ensuite, l’association a procédé à la mobilisation du<br />
ministère du Travail et de la Sécurité sociale avec copie du courrier au directeur<br />
général de la CNAS pour obtenir que le « mestinon » soit inscrit dans la liste<br />
des médicaments remboursés.<br />
L’association a mobilisé l’ONAAPH (Office National pour Appareillages et Accessoires<br />
pour Personnes Handicapées) pour la mise à disposition de fauteuils<br />
électriques, appareillages et aide technique adaptés aux personnes atteintes de<br />
myopathies.<br />
L’association n’a pas de contact avec le secteur de l’éducation. La majorité des<br />
enfants myopathes qui ont accès à l’école finissent par abandonner. Parmi les<br />
malades de l’ADEm, moins de 10 enfants sont scolarisés.<br />
105
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Guettaf Khemissi, président.<br />
Adresse : rue Fettache Amor Coopérative El Kheir n°26, Sétif.<br />
Téléphone : 07 78 29 70 84, Fax : 036 91 02 35.<br />
E-mail : myopathesetif@yahoo.fr<br />
L’ALCm fait partie du Réseau <strong>Algérie</strong>n des Associations de lutte contre les myopathies<br />
(RAAm), formalisé au cours du séminaire organisé avec l’association<br />
ADEm le 20 février 2010 à Constantine.<br />
70 % de l’activité de l’association consiste en l’assistance médicale. L’ALCm a<br />
constitué un réseau de 30 médecins pour le suivi médical composé de : neurologues,<br />
cardiologues, orthopédistes, ophtalmologues, pneumo-phtisiologues, ORL,<br />
endocrinologues, néphrologues, urologues et dentistes des secteurs public et privé,<br />
qui assurent des consultations et des interventions chirurgicales gratuitement.<br />
Le diagnostic des myopathies demande plusieurs explorations et est long à poser.<br />
Pour cela l’ALCm travaille avec des partenaires fidélisés :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Un laboratoire pour les examens biologiques à titre gratuit des cabinets<br />
d’imagerie médicale pour des échographies, des scanners à titre gratuit ;<br />
Un partenaire du secteur privé à Batna pour les IRm avec une réduction<br />
de 20%.<br />
L’ALCm assure le suivi de 250 personnes atteintes d’une maladie neuromusculaire<br />
(mNm). Des fiches ont été distribuées aux médecins concernés par cette pathologie<br />
des secteurs public et privé qui contactent l’association quand ils posent un<br />
diagnostic de mNm ou quand ils suspectent une myopathie. Quand le nombre de<br />
6 malades est atteint, l’ALCm organise une consultation conjointe par deux médecins<br />
spécialistes (un neurologue et un spécialiste en médecine physique) dans<br />
un cabinet privé afin de poser ou d’affiner le diagnostic. À chaque fois que le diagnostic<br />
de maladie neuromusculaire est posé, le malade devient membre de l’ALCm<br />
qui assure l’accompagnement pour la prise en charge médicale. L’association a<br />
106<br />
alcm,<br />
association de lutte contre les myopathies
élaboré un carnet de santé pluridisciplinaire contenant des recommandations en<br />
dernière page pour les professionnels médicaux et paramédicaux.<br />
Quand une personne atteinte de myopathie est identifiée, il s’agit souvent d’une<br />
personne issue d’une famille démunie et l’enfant est déscolarisé. 80% des malades<br />
suivis ont moins de 18 ans. 75% des malades recensés résident en zone rurale.<br />
L’association aide les familles à :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
réintégrer l’enfant à l’école et ce avec la collaboration de la direction de l’éducation,<br />
en facilitant l’accessibilité à l’école et en fournissant un fauteuil roulant<br />
électrique ou manuel selon le handicap ;<br />
faire établir une carte d’handicapé bleue ;<br />
<strong>ˇ</strong> déposer un dossier pour bénéficier de l’assurance sociale CNAS ;<br />
<strong>ˇ</strong> établir un carnet de tiers payant de la CNAS pour bénéficier de la gratuité<br />
des <strong>ˇ</strong> médicaments à 100% ;<br />
obtenir un fauteuil roulant auprès de la CNAS ;<br />
<strong>ˇ</strong> effectuer des réaménagements des toilettes et salles de bain au domicile des<br />
malades.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
Il arrive à l’association d’assurer le suivi médical même pour les autres membres<br />
des familles des myopathes qui sont souvent démunies.<br />
L’ALCm assure le suivi médical préventif pour 130 malades actuellement, sur<br />
la base d’un protocole de suivi amené de France : 1 consultation cardiologique<br />
avec une échographie cardiaque pour prévenir les cardiomyopathies tous les 6<br />
mois pour tous les malades et tous les 3 mois pour les personnes présentant une<br />
atteinte cardiologique.<br />
Suite aux sensibilisations de l’association, le CHU de Sétif envisage de mettre<br />
en place un pôle de consultation pluridisciplinaire très bientôt. Le malade sera<br />
examiné périodiquement par plusieurs pathologistes dans la même journée.<br />
En matière de sensibilisation des institutions, l’association a adressé une lettre aux<br />
60 présidents d’APC et 20 chefs de Daira de la wilaya pour leur rappeler l’obligation<br />
de veiller à l’accessibilité de l’ensemble des services publics aux personnes<br />
handicapées physiques et notamment les structures scolaires. Obligations contenues<br />
dans la loi 02-09 du 08 mai 2002, relative à la protection et à la promotion<br />
des personnes handicapées, et le décret présidentiel n°09-188 du 12 mai 2009, portant<br />
ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées,<br />
adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006.<br />
107
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personnes contact : Djebbari Houaria, présidente ; Djebbari Tarik.<br />
Adresse : 17 Bd Froment Coste Bel Air, Oran.<br />
Téléphone : 0 41 28 03 46.<br />
E-mail : tarikdje@hotmail.com<br />
L’association « NOUR » prend en charge les ImC (infirmes moteurs cérébraux)<br />
et les ImOC (infirmes moteurs d’origine cérébrale) de la wilaya d’Oran.<br />
Les ImC sont insérables à l’école avec un accompagnement de l’enfant et de<br />
l’environnement. L’ImC a des difficultés de préhension fine et présente souvent<br />
une diplégie ou une hémiplégie. L’enfant a du mal à se tenir droit assis, à se déplacer.<br />
C’est cette atteinte qui sanctionne négativement l’enfant dans la scolarité<br />
et l’insertion socioprofessionnelle.<br />
Chez l’ImOC, l’atteinte cérébrale est tellement importante que des handicaps<br />
mentaux et moteurs sont associés. Les handicaps peuvent être de nature et de<br />
niveau totalement différents d’un enfant à un autre et la prise en charge est<br />
elle aussi différente. Pour l’ImOC, l’insertion scolaire est pratiquement impossible<br />
même avec l’aide d’un auxiliaire de vie scolaire, dispositif qui<br />
n’existe pas encore en <strong>Algérie</strong>.<br />
NOUR s’occupe de ces 2 types de handicaps.<br />
L’action de l’association se déploie sur 4 axes :<br />
L’ORIENTATION ADmINISTRATIVE<br />
Des enfants de 6, 7 et même 8 ans, porteurs de handicaps, ne sont quelque fois<br />
pas identifiés par les services publics. Ils n’ont pas de carte de handicapé ouvrant<br />
droit à une indemnité de 1 000 DA par mois et par enfant handicapé démuni et<br />
un lot de couches. Ils ne sont pas inscrits à la sécurité sociale pour la gratuité des<br />
soins, des médicaments et de l’appareillage. L’association a développé un réseau<br />
de personnes ressources au niveau des services sociaux de l’APC et de la direction<br />
de l’action sociale de la wilaya vers lesquelles sont orientées les familles.<br />
108<br />
association « nour »<br />
imc/imoc
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
LE SUIVI mÉDICAL<br />
Des familles interrompent le suivi médical et la rééducation faute de moyens.<br />
NOUR assure l’accompagnement médical en lien avec le service de rééducation<br />
fonctionnelle à l’hôpital pédiatrique de Canastel. L’enfant a droit à 8 séances de<br />
rééducation à l’hôpital ce qui est nettement insuffisant. Ensuite les familles doivent<br />
s’adresser à des kinésithérapeutes dans le secteur privé. Un enfant ImC ou<br />
ImOC a besoin en moyenne de 2 à 3 séances par semaine. NOUR est dans une<br />
démarche de recherche pour le recrutement d’un kinésithérapeute spécialisé sur<br />
malade du système nerveux central ou bien pour un conventionnement avec un<br />
cabinet privé en négociant un tarif préférentiel pour les enfants de l’association.<br />
LA PRISE EN CHARgE PSYCHOPÉDAgOgIQUE<br />
À l’accueil de la famille, un rendez-vous est donné avec le médecin du secteur<br />
privé, conventionné avec l’association, qui vérifie que le diagnostic est posé,<br />
constitue le dossier médical ou le complète et examine l’état de santé et l’hygiène<br />
générale de l’enfant. Ensuite la psychologue référent de l’association reçoit l’enfant<br />
avec sa famille et établit l’anamnèse. Avec l’éducatrice, elle évalue les capacités<br />
motrices, sensorielles et mentales de l’enfant ainsi que son comportement.<br />
Cet examen permet de décider si l’enfant peut être inséré dans l’un des deux espaces<br />
: la crèche pour les enfants de 0 à 8 ans ou le centre médico-éducatif CmE<br />
pour les enfants de 8 à 20 ans.<br />
Au-delà de 20 ans des ateliers adaptés (2 après-midi par semaine) sont<br />
proposés en macramé, peinture sur soie et velours et informatique.<br />
Une commission se réunit tous les mardis, elle est composée du médecin, de<br />
l’éducatrice, de la psychologue qui ont accueilli l’enfant et du directeur du centre<br />
pour statuer. En général, la réponse est donnée dans les 2 jours.<br />
Il est arrivé que des mamans amènent leur enfant très jeune, aux environs de<br />
l’âge d’un an. Elles sont suivies, en guidance parentale, par la psychologue et<br />
l’éducatrice. Elles sont initiées à la prise en charge de l’enfant, à l’hygiène alimentaire,<br />
reçoivent des orientations pour l’appareillage et le suivi médical. La<br />
guidance parentale est proposée une à deux fois par semaine en fonction des cas.<br />
À partir de l’âge de 2 ans, une prise en charge en temps adapté est proposée.<br />
Des activités de stimulation sensorielle et de socialisation sont proposées à l enfant<br />
par une éducatrice initiée à la psychomotricité et une éducatrice de la petite<br />
enfance. Dès que l’enfant et les parents sont prêts, l’enfant est intégré à la crèche<br />
progressivement. La crèche est ouverte du dimanche au jeudi, de 7 h 45 à 16 h<br />
109
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
avec une semaine de vacances en hiver et au printemps et 2 mois de vacances<br />
en été. Le mois de juillet est consacré à la finalisation des bilans relatifs aux projets<br />
personnalisés établis tout au long de l’année et à la préparation de l’année<br />
suivante.<br />
LE SOUTIEN AUX FAmILLES<br />
Des groupes de paroles pour les mamans sont animés par une psychologue de<br />
l’association non impliquée dans le suivi des enfants des mamans concernées.<br />
Des orientations pour thérapie familiale sont adressées au centre intermédiaire<br />
de santé mentale (CISm) d’Oran.<br />
Le centre médico-éducatif de l’association est constitué de deux classes<br />
et un atelier :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Une classe de préscolaire adapté dont le programme est élaboré par une enseignante<br />
et un directeur d’école primaire à la retraite. Elle est constituée de 12<br />
enfants âgés entre 12 et 20 ans. La plupart de ces enfants ont une expérience<br />
scolaire à l’école publique. NOUR travaille à préparer la réinsertion protégée et<br />
accompagnée de ces enfants à l’école ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
Une classe de polyhandicapés qui regroupe 10 enfants, âgés entre 12 et 19<br />
ans, qui ne parlent pas, qui ont des capacités cognitives faibles. Il s’agit de travailler<br />
sur l’autonomie : l’éducation sphinctérienne, le contrôle du bavage, l’acquisition<br />
de notions spatiotemporelles, apprendre à se déplacer sans se perdre,<br />
manger proprement en un mot les rendre le plus autonomes possible ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’atelier des travaux manuels. Les jeunes viennent deux fois par semaine, ils<br />
sont tous majeurs. Certains sont arrivés à vendre quelques uns de leurs produits<br />
ce qui constitue un appoint non négligeable à la pension servie par l’État et qui<br />
les valorise par l’acquisition d’un savoir faire.<br />
L’association accueille en tout 52 enfants dans l’un ou l’autre de ces espaces.<br />
Leurs parents sont adhérents à l’association.<br />
Aujourd’hui, 13 personnes composent l’équipe :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
110<br />
4 intervenants conventionnés, ils interviennent à temps partiel<br />
. 1 médecin du secteur privé ;<br />
. 1 formatrice en macramé ;<br />
. 2 femmes pour l’entretien des locaux ;
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
9 intervenants salariés à plein temps<br />
. 1 directeur administratif et financier, pour la crèche et le CmE ;<br />
. 1 psychologue référent ;<br />
. 3 psychologues ;<br />
. 2 éducatrices dont une est initiée à la psychomotricité ;<br />
. 2 éducatrices de la petite enfance ;<br />
Les bénévoles réguliers<br />
. 1 membre de l’Église qui assure l’animation : le mime, les marionnettes,<br />
le chant…<br />
. 1 directeur d’école primaire à la retraite qui soutient les éducatrices<br />
sur le plan pédagogique et élabore les programmes d’enseignement avec<br />
l’enseignante.<br />
NOUR entretient un partenariat avec l’institut régional du travail social (IRTS)<br />
de Poitou-Charentes et reçoit des stagiaires français de l’institut pour des durées<br />
de 3 mois.<br />
111
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Hammani Imène, présidente ;<br />
Mina Brachmi Kerzabi, secrétaire générale.<br />
Localisation : Oran.<br />
Téléphone : 05 50 41 03 68 / 05 50 86 31 93.<br />
La mission de l’association est de favoriser l’accès aux formations et à l’emploi<br />
aux jeunes non voyants et malvoyants. La principale activité de l’association est<br />
d’aider les jeunes personnes non voyantes à la recherche d’emploi en faisant du<br />
porte-à-porte dans les institutions publiques.<br />
L’association a mis en œuvre un projet de réalisation d’un centre de formation<br />
professionnelle pour lequel elle a obtenu un financement du matériel par l’Union<br />
européenne mais n’a pas pu réaliser la construction par manque de financement.<br />
L’ASIPAA a mis en place les activités suivantes :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
L’initiation à l’informatique sanctionnée par des attestations délivrées<br />
par le CFPA ;<br />
La formation au macramé ;<br />
La formation d’accordeurs de pianos ;<br />
La réalisation d’annales du baccalauréat en braille. Elle projette de réaliser des<br />
cartes géographiques en relief et d’imprimer des manuels scolaires et des livres<br />
de loisirs en braille.<br />
Au baccalauréat, les sujets des différentes épreuves ne sont pas disponibles en<br />
braille pour les candidats non voyants. L’ASIPAA a obtenu que ces candidats<br />
disposent de plus de temps pour pouvoir transcrire les sujets vers le braille et<br />
ensuite avec l’aide d’un enseignant transcrire du braille vers l’écriture ordinaire.<br />
L’ASIPAA a demandé que les enseignants désignés pour aider les candidats non<br />
voyants soient des enseignants de la matière à l’épreuve afin d’éviter les erreurs<br />
de transcription et de gagner du temps. La direction de l’éducation s’est engagée<br />
pour que les sujets du bac soient disponibles en braille à la session de juin 2010.<br />
112<br />
asipaa,<br />
association sociale pour l’insertion professionnelle<br />
des aveugles et amblyopes
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
LES ENFANTS AYANT DES BESOINS SPÉCIFIQUES :<br />
LES ENFANTS EN HOSPITALISATION DE LONgUE DURÉE<br />
La scolarisation des enfants hospitalisés est réglementée par<br />
« l’Arrêté interministériel du 27 octobre 1998 portant création de<br />
classes pour enfants hospitalisés pour une longue durée dans les<br />
centres hospitaliers et les centres de cure », dont les principaux<br />
articles sont :<br />
Art.2. – Les classes spéciales pour enfants hospitalisés pour une longue durée<br />
dans les centres hospitaliers et les centres de cure accueillent les élèves en âge<br />
de scolarité obligatoire, conformément aux conditions en vigueur dans le secteur<br />
de l’éducation nationale, afin de bénéficier d’un enseignement basé sur des méthodes<br />
et moyens adaptés à leur état de santé.<br />
Art.3. – Les classes spéciales pour enfants hospitalisés (…) sont créées par arrêté<br />
entre le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé et de la<br />
population, et sont fermées ou supprimées dans les mêmes formes.<br />
Art.4. – Les classes spéciales (…) sont rattachées, au plan pédagogique et organisationnel,<br />
à un établissement d’enseignement qui sera désigné au niveau<br />
de la wilaya par décision de la direction de l’éducation et la direction de la santé<br />
et de la population.<br />
Art.6. – À l’issue de l’hospitalisation ou de la cure, les élèves seront réintégrés<br />
dans leur établissement d’origine et seront inscrits au niveau qui correspond<br />
aux résultats obtenus durant leur scolarité dans les classes spéciales.<br />
Art.7. – Les maîtres et les professeurs sont soumis aux contrôle et inspection<br />
effectués par les inspecteurs du secteur de l’éducation nationale.<br />
Art.8. – Les services du secteur de la santé et de la population fournissent le<br />
matériel et les moyens didactiques nécessaires au bon fonctionnement de ces<br />
classes.<br />
113
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Mahamdioua Ouahiba, présidente.<br />
Adresse : Maison de jeunes, Palais du peuple, 01 bd de l’indépendance, Alger.<br />
Téléphone : 021 65 76 08.<br />
E-mail : laleemh@yahoo.fr ; m_ouahiba@hotmail.com<br />
LALEEmH regroupe plus d’une dizaine d’associations qui œuvrent dans le domaine<br />
des loisirs pour enfants malades dans les hôpitaux d’Alger et ses environs.<br />
Elle est soutenue et cofinancée par la direction de la jeunesse et des sports<br />
de la wilaya .<br />
LALEEmH est liée à la DJS par un contrat programme au bénéfice des enfants<br />
hospitalisés et des enfants des quartiers précaires. Des éducateurs sont détachés<br />
par la DJS pour animer des unités de loisirs dans les services de pédiatrie. Ils<br />
disposent de matériel et d’une subvention du fonds de wilaya. La ligue compte<br />
une cinquantaine d’éducateurs. Chaque unité de loisirs est constituée en association.<br />
Au départ, la ligue coordonnait les activités de ces associations et progressivement,<br />
des associations de malades et d’enfants en situation de handicap<br />
sont devenues membres de la ligue. Les associations ont des moyens limités,<br />
elles s’adressent à la ligue quand elles ont besoin de moyens complémentaires.<br />
L’action de plaidoyer de LALEEmH auprès du partenaire principal la DJS, est<br />
d’obtenir la signature d’une convention entre la DJS et la direction de la santé<br />
et de la population (DSP) pour l’ouverture obligatoire d’une unité de loisir dans<br />
chaque service de pédiatrie, pour que l’intervention des éducateurs en milieu<br />
hospitalier soit reconnue et enfin pour que les droits de l’enfant hospitalisé aux<br />
loisirs, à l’école, à une vie sociale et à une formation professionnelle soient<br />
pleinement exercés.<br />
Une convention a été signée entre le ministère de l’Éducation nationale et le<br />
ministère de la Santé à la fin des années 1980 et n’a été mise en application<br />
que depuis quelques années. Le ministère de l’Éducation détache des enseignants<br />
dans les services de pédiatrie qui travaillent en collaboration avec<br />
114<br />
laleemh,<br />
la ligue des activités de loisirs educatifs pour enfants<br />
en milieu hospitalier
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
l’unité de loisirs. Celle-ci met à leur disposition l’espace et le matériel de travail.<br />
L’enseignement se fait sur un support ludique avec l’aide de l’équipe<br />
d’animation de loisirs.<br />
La ligue intervient dans les établissements hospitaliers suivants : les CHU d’Alger-centre,<br />
Bab El Oued, Parnet-Hussein Dey, les hôpitaux d’El Harrach-Belfort,<br />
Ain Taya, Rouiba, l’établissement hospitalier spécialisé (EHS) de Tixeraïne, l’hôpital<br />
de Birtraria, le CHU de Beni messous, l’EHS Azur Plage, les hopitaux de<br />
Bologhine, Zeralda, Douera, médéa, Koléa, et l’hôpital de cardiologie pédiatrique<br />
de Bou Ismail.<br />
Initialement, l’hôpital est un lieu qui donne droit aux soins. L’objectif de LA-<br />
LEEmH est d’œuvrer pour que l’enfant hospitalisé ne soit pas privé de son droit<br />
aux loisirs et à une scolarité. LALEEmH œuvre également à l’humanisation de<br />
l’hôpital, à la formation aux techniques d’animation des personnels prenant en<br />
charge les enfants hospitalisés et à l’alphabétisation d’enfants non scolarisés,<br />
c’est le cas surtout de jeunes filles venant de wilayas de l’intérieur du pays. En<br />
plus de l’alphabétisation, il leur est proposé une préformation professionnelle<br />
en couture et le développement de leurs talents artistiques.<br />
LALEEmH organise des actions de solidarité, en collaboration avec d’autres<br />
associations, au niveau des unités pédiatriques, notamment à l’occasion de fêtes<br />
religieuses par la distribution de cadeaux et l’animation de journées festives.<br />
LALEEmH intervient également en collaboration avec des associations pour<br />
l’obtention de médicaments au bénéfice d’enfants issus de familles démunies<br />
Toute association qui souhaite organiser une activité pour les enfants malades est<br />
mise automatiquement en lien avec LALEEmH par l’administration hospitalière.<br />
115
RéFéRENTIEL DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA jEuNESSE<br />
Personne contact : Mr Ryad Bekhchi, président.<br />
Adresse : 41, Avenue Mirauchaux, Oran.<br />
Téléphone : 07 71 40 34 66.<br />
E-mail : bekhchi.riad@smile-oran.org<br />
Site Internet : http://smile.exprimetoi.net<br />
L’association a été créée en juillet 2007 par 15 étudiants membres fondateurs<br />
qui voulaient rendre le sourire aux enfants malades. L’association organise des<br />
animations pour les enfants hospitalisés, des fêtes et des sorties-découvertes une<br />
fois par mois.<br />
Smile a pour projet d’ouvrir des salles de loisirs dans tous les services de pédiatrie.<br />
La première salle de loisirs est une pièce désaffectée que l’association rénove<br />
et équipe pour en faire une salle de loisirs et une salle scolaire à l’hôpital<br />
pédiatrique Boukhroufa Abdelkader, dans le service d’hématologie. Elle est<br />
gérée par la psychologue du service qui est membre de Smile.<br />
L’association Smile est constituée de 4 sections :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La section caritative intervient dans les hôpitaux, dans 4 foyers d’assistance<br />
aux enfants et à la pouponnière. L’association organise pour les enfants des fêtes,<br />
des sorties découvertes (avec les autorisations de la DAS et du juge des mineurs),<br />
des sensibilisations aux droits de l’enfant, aménage des espaces bibliothèques<br />
et des salles de loisirs (l’association réalise les travaux de réaménagement, la<br />
décoration et l’équipement) ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
La section santé organise des sensibilisations et des campagnes de prévention<br />
principalement contre le Sida au niveau des universités, cités universitaires, lycées<br />
et dans la rue, à l’occasion d’évènements comme les festivals. C’est ainsi<br />
que la première chanson de lutte contre le sida « anatani » a été composée. Elle<br />
est connue du tout Oran. Smile est membre fondateur du réseau Oran Stop Sida.<br />
Des formations de jeunes à la prévention contre le sida ont été organisées pour<br />
développer la sensibilisation par les pairs. Cette section a également participé<br />
avec l’UNICEF à des formations pour les enfants ;<br />
116<br />
smile
<strong>ˇ</strong><br />
La section culturelle gère le projet cinéclub mis en place avec le soutien du<br />
programme Joussour, le <strong>PCPA</strong> <strong>Algérie</strong>. Une fois par semaine, au siège de l’association<br />
que Smile partage avec l’AFEPEC, une séance cinéclub est organisée avec<br />
la participation d’une trentaine de personnes. Dans ce cadre, la formation de 12<br />
jeunes aux techniques du cinéma a été réalisée. Cette section organise également<br />
des représentations de théâtre ;<br />
<strong>ˇ</strong><br />
LES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE L’ENFANT<br />
La section Club organise des sorties et des activités en après-midi pour les<br />
membres de l’association dans le but de renforcer les liens et le sentiment<br />
d’adhésion aux mêmes valeurs.<br />
117
illustrations d’interventions<br />
réalisées dans une dynamique<br />
de travail de réseau
Afin d’illustrer les modalités de fonctionnement des services, les interactions<br />
entre services, entre associations et services publics, trois situations de prise en<br />
charge d’enfants sont exposées. Les situations des enfants nécessitant une protection<br />
spéciale sont généralement des situations de détresse familiale qui déstabilisent<br />
jusqu’à la grande famille et même l’entourage plus large de l’enfant. À<br />
ce titre, leur prise en charge nécessite la mobilisation d’un réseau plus ou moins<br />
complexe d’interventions pluridisciplinaires et pluri sectorielles.<br />
Ces trois prises en charge représentent une pratique assez peu courante, une pratique<br />
à la recherche d’une réponse adaptée à la complexité des situations traitées<br />
et à la spécificité de leurs contextes. Elles mettent en évidence :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
IllustratIons d’InterventIons<br />
différentes manières d’intervenir dans une dynamique de réseau ;<br />
la manière dont les enfants, leurs familles, les intervenants font preuve de<br />
créativité et de capacités d’adaptation à leur contexte pour identifier et activer<br />
les acteurs en mesure d’apporter aide ou soutien ;<br />
le fait qu’un réseau d’acteurs est par essence dynamique, en constante évolu-<br />
<strong>ˇ</strong> tion et donc différent d’une situation à une autre, d’une région à une autre, d’une<br />
période à une autre. Même si certaines procédures obéissent à une réglementation,<br />
la manière de les mettre en œuvre, de les articuler est fort heureusement<br />
souvent adaptée à la situation et à son contexte.<br />
121
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
Le docteur Messahli, chef de service de médecine légale au CHU de Blida, a<br />
examiné une enfant, âgée de 10 ans, amenée au service par la police. Elle présentait<br />
des blessures graves, son corps portait des traces évidentes de sévices anciens<br />
et récents. Son état général de santé était très dégradé. Les policiers qui<br />
l’accompagnaient ont rapporté que c’est un technicien réparateur que la maman<br />
avait amené à la maison qui a fait le signalement à la police. Il a vu la fillette<br />
enchaînée au radiateur, en a demandé la raison à la maman. Celle-ci répondit<br />
qu’elle faisait trop de bêtises.<br />
L’état de l’enfant et la réponse de la mère l’inquiétèrent, il en fit le signalement<br />
au commissariat de police. Les agents de police se sont présentés au domicile,<br />
personne n’ouvrait la porte. Ils avaient un mandat de perquisition, ils sont entrés<br />
de force et ont délivré la fillette. Le médecin légiste a travaillé en étroite collaboration<br />
avec le juge chargé de l’affaire. Cette enfant qui allait à l’école avec<br />
les enfants du voisinage, n’y était plus allée depuis une année. Les voisins<br />
avaient remarqué que l’enfant ne sortait plus.<br />
Au début de l’affaire, l’enfant avait été placée pendant 48 heures dans un centre<br />
à Tipaza et ensuite, faute de place dans les centres de la wilaya, le juge ordonna<br />
son placement dans un centre à Aïn Temouchent. Le docteur Messahli, convaincue<br />
qu’un placement de l’enfant aussi loin de son lieu de résidence ne pouvait<br />
que compliquer sa situation, intervint auprès du Réseau Wassila et de SOS village<br />
d’enfants à Draria où la fillette fut placée.<br />
Le juge a tenu à donner tous les moyens à la médecin légiste pour qu’elle puisse<br />
établir un rapport complet de l’histoire médicale de l’enfant. C’est ainsi qu’elle<br />
eut accès aux dossiers médicaux de l’hôpital El Kettar où la fillette avait été hospitalisée<br />
pendant 3 mois au cours de l’année précédente et de la clinique centrale<br />
où elle avait subi deux interventions chirurgicales, l’une thérapeutique et l’autre<br />
réparatrice pour une blessure grave au niveau de la partie frontale de la tête.<br />
122<br />
intervention du service de médecine légale du<br />
chu de blida en collaboration avec<br />
le réseau wassila dans une situation<br />
de maltraitance intrafamiliale 9<br />
9. Situation suivie par le docteur Messahli du service de médecine légale du CHU F. Fanon de Blida, le docteur Abed<br />
de l’Hôpital El Kettar, et le professeur Chitour du Réseau Wassila.
IllustratIons d’InterventIons<br />
Le docteur Messahli insiste sur le fait que cette enfant portait des signes évidents<br />
de sévices graves et répétés. La mère est aux arrêts mais le médecin légiste<br />
regrette que l’état de l’enfant ait dû atteindre un tel niveau de dégradation avant<br />
qu’un secours n’ait été possible. Elle déplore le fait que ni les enseignants de<br />
l’école, ni les voisins, ni les médecins qui l’ont examinée et soignée à l’hôpital<br />
El Kettar, ni ceux qui l’ont opérée à la clinique centrale, n’ont pensé à faire le<br />
signalement de sévices sur mineur. Un juge ne peut rien entreprendre pour nonsignalement.<br />
La loi fait obligation au personnel soignant de signaler aux autorités<br />
concernées toute atteinte à l’intégrité physique d’un mineur, mais ne<br />
prévoit aucune mesure en cas de non-signalement. L’obligation est morale mais<br />
non pénale (cf. art. 4 de la loi 90-17 relative à la santé).<br />
À SOS village d’enfants, le docteur Abed, membre du Réseau Wassila est saisie<br />
pour assurer le suivi médical de l’enfant en lien avec la clinique centrale où elle<br />
doit subir de nouvelles interventions réparatrices. C’est ainsi que ce médecin<br />
apprend qu’elle avait été hospitalisée au cours de l’année précédente à l’hôpital<br />
El Kettar, dans un service annexe à celui où elle-même travaille. Le docteur<br />
Abed ne comprend pas comment des confrères qui ont régulièrement examiné<br />
l’enfant au cours de l’année écoulée n’ont pas été alertés par l’origine douteuse<br />
de la plaie qu’elle a à la tête. Elle finit par reconnaître que les médecins de<br />
manière générale soignent des malades, signalent aux familles les risques mais<br />
ne se sentent pas désignés, ni tenus d’effectuer des signalements. Ils pensent<br />
sans doute qu’il appartient aux médecins légistes de faire ces signalements à<br />
la justice.<br />
Mme Rahmouni, psychologue à l’hôpital El Kettar, se souvient de cette enfant.<br />
Elle avait essayé d’assurer son suivi psychologique. La fillette était toujours accompagnée<br />
de sa mère. La psychologue avait bien remarqué que cette fillette<br />
parlait très peu et était très surveillée par sa mère. Le personnel infirmier avait<br />
également remarqué que la mère était agressive avec sa fille. Le docteur Abed<br />
et Mme Rahmouni relèvent le fait que cette enfant avait un langage et une<br />
conduite générale qui témoignaient d’une éducation de qualité.<br />
123
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
Il s’agit d’une jeune adolescente qui s’est présentée, accompagnée de sa mère<br />
au réseau NADA, en septembre 2008. Elles sont en détresse. La jeune fille, âgée<br />
de 15 ans est enceinte de 4 mois. Elle a été violée par un voisin et son père n’est<br />
pas au courant.<br />
Le président du réseau NADA reçoit la maman et la fille et réussit à convaincre<br />
la mère de revenir avec son mari. La nouvelle est annoncée au père et l’équipe<br />
l’aide à soutenir sa fille dans cette épreuve.<br />
Différentes interventions sont alors mises en place :<br />
La famille est soutenue pour déposer plainte contre le voisin auprès du commissariat<br />
de la circonscription de sa résidence. Le procureur du tribunal concerné<br />
est saisi par le commissariat. L’adolescente est placée dans une famille d’accueil<br />
jusqu’à son accouchement. La coordinatrice de programme, Mme Cheikha, envoie<br />
un courrier à l’académie pour justifier l’interruption de la scolarité à partir<br />
du mois de novembre 2008.<br />
Un courrier est adressé au procureur du tribunal pour signaler un viol sur mineur.<br />
Un autre courrier informe la section civile du même tribunal du placement de<br />
l’adolescente dans une famille d’accueil jusqu’à son accouchement. Le réseau<br />
NADA propose à la famille de confier l’enfant à naître à une des familles qui<br />
ont déposé des demandes d’adoption auprès de NADA. La famille donne son<br />
accord, la famille adoptante est sélectionnée. Les deux familles se rencontrent.<br />
Le jour de l’accouchement, la jeune fille et sa maman sont accompagnées à<br />
l’hôpital. Une fillette est née. Mme Cheikha écrit au président du tribunal pour<br />
informer la section civile de la naissance de l’enfant et de son adoption par une<br />
famille désignée par le réseau NADA. Après une période de convalescence,<br />
l’adolescente réintègre le domicile familial. La psychologue du réseau NADA,<br />
Melle Barssa, est chargée du suivi psychologique de la jeune fille depuis son<br />
124<br />
intervention du réseau nada<br />
dans une situation de viol sur mineure 10<br />
10. Cette situation est suivie par Mme Cheikha Malika, avocate, chargée d’étude au réseau NADA.
IllustratIons d’InterventIons<br />
accueil. En effet, l’équipe du réseau NADA a convenu de ne pas l’orienter vers<br />
la psychologue de la polyclinique de son quartier afin de préserver la confidentialité<br />
de sa situation.<br />
En septembre 2009, un nouveau courrier est adressé à l’académie demandant la<br />
réintégration de la jeune fille au collège. À la rentrée scolaire 2009-2010, celleci<br />
reprend ses études et les poursuit avec succès. Elle fréquente régulièrement<br />
le centre d’animation du réseau NADA.<br />
Le voisin qui a reconnu les faits a écopé d’une peine de 3 années avec sursis. Il<br />
a bénéficié de l’indulgence du juge vu son âge avancé. Il est âgé de 70 ans.<br />
La chargée d’étude assure maintenant le suivi juridique de l’affaire. Elle a introduit<br />
un recours auprès du juge des mineurs pour obtenir dommages et intérêts<br />
pour la victime. L’affaire est toujours en cours.<br />
125
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
En 2008, un médecin endocrinologue exerçant en cabinet privé à Bab El Oued<br />
reçoit une dame qui est inquiète au sujet de son petit-fils et dont la maman en<br />
détresse ne sait à qui s’adresser. La maman et le père de l’enfant sont divorcés.<br />
La mère a déposé plainte contre le père pour abus sexuel sur son fils au printemps<br />
2007. L’enfant refuse de suivre son père au cours de ses droits de visites. Le père<br />
a déposé plainte contre la mère qui refuse de contraindre son fils à aller chez<br />
son père.<br />
Durant la même période, un membre du Réseau Wassila, Mme Ouarek qui est<br />
psychologue et orthophoniste au CHU d’Alger-centre, consulte ce même médecin<br />
à titre privé. Connaissant l’activité de Mme Ouarek au sein du réseau Wassila,<br />
le médecin la saisit au sujet de cette situation. C’est ainsi que la maman se présente<br />
à la permanence du Réseau Wassila. Elle demande un suivi psychologique<br />
pour son fils et l’aide pour engager une procédure en justice inculpant le père<br />
pour abus sexuel incestueux.<br />
L’affaire impliquant le père est jugée par le tribunal d’Alger centre. L’affaire impliquant<br />
la mère est jugée par le tribunal d’Hussein Dey. Le juge des mineurs<br />
du tribunal d’Alger fait examiner l’enfant par le service de médecine légale du<br />
CHU d’Alger-centre qui délivre un certificat stipulant que l’examen de l’enfant<br />
est normal. Le père est relaxé.<br />
Le juge des mineurs du tribunal d’Hussein Dey fait à son tour examiner l’enfant<br />
par le service de médecine légale de Kouba qui établit également un certificat<br />
d’examen normal. Le juge mandate alors un huissier de justice pour être présent<br />
au moment où le père va chercher son fils pour exercer son droit de visite.<br />
L’huissier signale que c’est l’enfant qui refuse de suivre son père.<br />
Le professeur Chitour, également membre du réseau Wassila, intervient auprès<br />
des médecins légistes qui ont examiné l’enfant au CHU d’Alger-centre et à l’hôpital<br />
de Kouba pour obtenir que la mention « un examen normal n’exclut pas<br />
un abus sexuel » soit ajoutée sur le certificat médical, sans succès.<br />
126<br />
intervention du réseau wassila<br />
dans une situation d’abus sexuel incestueux 11<br />
11. Situation rapportée par le professeur Chitour et le docteur Nacer du Réseau Wassila.
IllustratIons d’InterventIons<br />
La maman avait présenté son fils au Docteur Aziez. Ce psychiatre exerçant en<br />
cabinet privé n’a pas mis en doute les propos de l’enfant à l’encontre de son père<br />
mais il n’était pas assermenté. Le professeur Chitour intervient alors auprès du<br />
directeur de l’hôpital psychiatrique de Cheraga, qui recommande une pédopsychiatre,<br />
au centre de jour pour enfants. Celle-ci voit l’enfant au cours d’un premier<br />
rendez-vous qui n’a pas donné lieu à un suivi régulier.<br />
À l’approche de la fin des 3 mois de suspension de visite du père, l’enfant présente<br />
un déséquilibre glycémique pour lequel il est hospitalisé durant 15 jours<br />
au service de pédiatrie du CHU Bab el Oued par le docteur Ladjouz par l’entremise<br />
du professeur Chitour. Il s’agit d’un diabète transitoire qui survient dans<br />
les situations de traumatisme. Au cours de son hospitalisation l’enfant est suivi<br />
par la psychologue du service.<br />
Après cette hospitalisation, au cours de l’été 2009, l’enfant participe à une colonie<br />
de vacances pendant 3 semaines, organisée par SOS village d’enfants. Durant<br />
toute cette période, la maman bénéficie de l’écoute psychologique<br />
téléphonique du centre d’écoute du Réseau Wassila.<br />
Maître Hammache, avocate bénévole auprès du Réseau Wassila, intervient auprès<br />
du juge des mineurs du tribunal d’Alger-centre et le sensibilise aux violences<br />
sexuelles sur mineur. Le juge accorde alors une audience à huis-clos à<br />
l’enfant et lui fait signer le procès-verbal de garde exclusive par la mère avec<br />
suspension du droit de visite au père jusqu’à la comparution suivante. Celle-ci<br />
interviendra à la fin de l’injonction psychothérapeutique stipulée par le juge pour<br />
l’enfant et qui durera 6 mois. La psychologue du service de pédiatrie du CHU<br />
de Bab El Oued est désignée par le juge pour assurer ce suivi.<br />
Les deux affaires, celle à l’encontre du père et celle à l’encontre de la mère, sont<br />
toujours en cours, la première au tribunal d’Alger et la seconde au tribunal<br />
d’Hussein Dey.<br />
127
orGanisations ressourCes
unicef algérie<br />
Personne contact : Doria Merabtine.<br />
Adresse : 25 rue Mohamed Khoudi, El Biar, Alger.<br />
Téléphone : 021 92 72 98.<br />
Fax : 021 92 57 51.<br />
E-mail : dmerabtine@unicef.org<br />
Site internet : www.unicef.org<br />
orGanIsatIons ressources<br />
Les programmes de santé et nutrition visent à contribuer à la réalisation des objectifs<br />
nationaux, à savoir : un taux national de 90 % de vaccination contre<br />
toutes les maladies qu’il est possible d’éviter au moyen de vaccins; l’éradication<br />
de la polio; la mise en ouvre d’une stratégie intégrée de lutte contre les maladies<br />
de l’enfance (diarrhée aiguë, infections respiratoires et malnutrition); une<br />
hausse du nombre d’accouchements effectués avec l’aide d’assistantes qualifiées;<br />
la distribution de vitamine A à tous les enfants de moins de deux ans; et<br />
la réduction de la malnutrition liée au manque de protéines chez les enfants de<br />
moins de cinq ans.<br />
La contribution de l’UNICEF à la réalisation de ces objectifs nationaux se fonde<br />
sur deux stratégies complémentaires : l’appui à des programmes nationaux de santé<br />
et de nutrition des mères et des enfants, en renforçant leurs ressources; et des initiatives<br />
locales ciblant principalement les populations des zones à risque, tout en<br />
contribuant à l’élaboration de stratégies à l’échelle nationale. La lutte contre le<br />
VIH/SIDA sera renforcée, en particulier au moyen d’activités de communication<br />
à grande échelle et de mobilisation.<br />
Le programme en matière d’éducation cherche à contribuer aux efforts nationaux<br />
visant à promouvoir une éducation de qualité accessible à tous. Il se compose,<br />
d’une part, d’activités de recherche et de mobilisation et du renforcement<br />
des capacités des institutions à l’échelle nationale, et, d’autre part, d’interventions<br />
menées à l’échelle locale dans les régions défavorisées. Ces interventions<br />
permettront vraisemblablement d’améliorer les taux de scolarisation et de<br />
réduire les taux d’abandon scolaire à l’échelle nationale et peuvent servir<br />
de projets pilotes et de modèles d’approches innovatrices. L’UNICEF participera<br />
131
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
également aux efforts menés par le gouvernement dans le cadre des<br />
interventions intersectorielles, dans le domaine de la santé scolaire et de la<br />
prise en charge de l’éducation des personnes handicapées.<br />
Le programme de protection de l’enfance contribue à l’amélioration du bienêtre<br />
et de la protection des enfants en situation difficile. Il s’agit notamment de<br />
prendre en charge sur le plan psychosocial les enfants traumatisés par la violence<br />
dans leur foyer et dans leur communauté, dans les dix régions ou « wilayas »<br />
les plus durement touchées par ce problème. La stratégie de l’UNICEF consiste<br />
à fournir un appui technique et matériel et à renforcer les capacités nationales<br />
en ce qui concerne le traitement des traumatismes. En outre, l’objectif est de<br />
renforcer le système d’information et les mécanismes juridiques d’intervention<br />
et de prévention. Cela facilitera également la mise en œuvre de projets pilotes à<br />
l’échelle locale en vue d’élaborer des modèles de prise en charge et d’insertion<br />
sociale des enfants handicapés, des enfants abandonnés et des adolescents en<br />
situation précaire.<br />
132
Personne contact : Taïeb Annick.<br />
Adresse : Parc des loisirs « La Concorde » Ben Aknoun, Alger.<br />
Téléphone : 021 56 52 68.<br />
E-mail : centreressources.impe@yahoo.fr<br />
Site : www.impe-aaefab-dz.org<br />
Horaires et jours d’ouverture : sur rendez-vous de 10 heures à 16 heures,<br />
du dimanche au jeudi.<br />
Le centre documentaire, inauguré fin 2006, a été réalisé en partenariat avec des<br />
ONG européennes dans le cadre de l’Institut Méditerranéen de la Petite Enfance<br />
(IMPE).<br />
Trois idées forces animent la mise en place de cet Institut :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
le centre de ressources documentaires<br />
petite enfance<br />
de l’aaefab<br />
la recherche du meilleur maternage possible lors du passage obligé du petit<br />
enfant en institution ;<br />
la sensibilisation continue des personnes œuvrant dans ces institutions et leur<br />
formation à des pratiques de soins respectueuses des besoins des jeunes enfants ;<br />
le désir d’ouverture et de partage pour plus de savoirs et de solidarité active.<br />
Trois axes d’intervention sont mis en œuvre dans cet institut :<br />
orGanIsatIons ressources<br />
L’APPLICATION DANS LES POUPONNIèRES<br />
la démarche développée dans la prise en charge des enfants en institutions est<br />
inspirée de la démarche de l’Institut Pikler (Loczy) de Budapest, et des recherches<br />
les plus récentes relatives aux tout petits. C’est cette approche qui<br />
est développée dans les pouponnières Djenane el Kheir et Amel gérées par<br />
l’AEEFAB.<br />
LA FORMATION DANS L’éCOLE DE BERCEUSES À PALM BEACH<br />
Plus que de moyens, c’est d’un savoir faire et plus encore d’un savoir être dont<br />
les professionnels ont le plus besoin ; c’est ce savoir là en latence chez tout un<br />
chacun qui est mis en exergue dans la formation dispensée.<br />
133
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
LA RéFLExION AU CENTRE DE RESSOURCES À ALGER<br />
Ce centre de documentation et d’information s’adresse avant tout à des associations,<br />
des professionnels, des chercheurs et des étudiants spécialisés dans le domaine<br />
de la petite enfance. Lieu de rencontres et d’échanges de pratiques,<br />
d’expériences et de savoirs, il veut permettre la confrontation et l’alimentation<br />
des réflexions sur des problèmes communs. Dans ce but, il met à la disposition<br />
du public un fonds documentaire de plus de 500 références sur des thématiques<br />
de la petite enfance (le développement psychomoteur, l’attachement, les soins<br />
maternant, l’abandon, l’adoption, la kafala, …) et un pôle multimédia.<br />
134
Personne contact : Maître Ait-Zai Nadia, présidente.<br />
Adresse : 05, Rue Alfred Lettelier, Sacré Cœur, Alger.<br />
Téléphone / Fax : 021 74 34 47.<br />
E-mail : ciddefenfant@yahoo.fr<br />
Site Internet : www.ciddef-dz.com<br />
Le CIDDEF a ouvert ses portes en mai 2002. Il a pour principaux<br />
objectifs :<br />
<strong>ˇ</strong><br />
L'information et la vulgarisation de l’information sur les droits et la<br />
citoyenneté de l’Enfant et de la Femme à travers tous supports de communication<br />
(édition, audio-visuel, Internet) et destinée au grand public ;<br />
La sensibilisation des partenaires institutionnels et associatifs sur les<br />
<strong>ˇ</strong> demandes et les besoins des enfants et des femmes ;<br />
La formation à destination des professionnels, chercheurs et mem-<br />
<strong>ˇ</strong> bres des associations, à l’approche genre et développement, gestion de<br />
projets, communication, etc ;<br />
Le développement de la recherche ayant trait au domaine du genre à<br />
travers <strong>ˇ</strong> des conférences, colloques, séminaires, études et sondage ;<br />
Le renforcement institutionnel par la mise en place de partenariat intersectoriel,<br />
la consolidation de réseaux dans le pays et dans la région.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
le ciddef,<br />
centre d’information et de documentation<br />
sur les droits de l’enfant et de la femme<br />
orGanIsatIons ressources<br />
Le CIDDEF dispose d’un fond documentaire relatif à la condition<br />
féminine et aux droits de le l’enfant estimé à plus de 2000 titres. Ce<br />
fond ne cesse d’augmenter. Il peut être consulté sur le site web :<br />
www.ciddef-dz.com.<br />
Le CIDDEF publie une revue trimestrielle qui sert de tribune aux questions<br />
féminines et de l’enfance. La revue comporte entre autres, un dossier,<br />
une rubrique « événement », une rubrique « vie Associative », une<br />
revue de presse, etc.<br />
135
éférenCes doCumentaires
TExTES INTERNATIONAUx<br />
INSTRUMENTS DE DéFENSE DES DROITS DE L’HOMME<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Déclaration universelle des droits de l’homme.<br />
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIRDCP).<br />
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux<br />
et culturels (PIRDESC).<br />
Convention relative aux droits de l’enfant.<br />
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard<br />
des femmes (Convention sur les femmes).<br />
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination<br />
raciale (Convention sur la discrimination raciale).<br />
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains<br />
ou dégradants (Convention sur la torture).<br />
Convention relative aux droits des personnes handicapées.<br />
Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant.<br />
Protocole facultatif sur la participation des enfants aux conflits armés.<br />
Protocole facultatif sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie<br />
impliquant des enfants.<br />
Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes<br />
handicapées.<br />
Charte africaine des droits et du bien être des enfants.<br />
TExTES LéGISLATIFS NATIONAUx<br />
références documentaIres<br />
état des principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux Droits de<br />
l’homme ratifiés par l’<strong>Algérie</strong>. Mars 2008. Commission nationale consultative de<br />
promotion et de protection des droits de l’homme, <strong>Algérie</strong>.<br />
139
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
Recueil des textes législatifs et réglementaires relatifs aux enfants. école Supérieure<br />
de la Magistrature en partenariat avec l’UNICEF, 2004.<br />
Plan National d’Action pour les Enfants. 2008-2015. « Une <strong>Algérie</strong> Digne des Enfants<br />
». Ministère délégué chargé de la famille et de la condition féminine avec le<br />
soutien de l’UNICEF.<br />
Loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille.<br />
Plan Directeur National de prévention et de lutte contre la drogue et la toxicomanie,<br />
Office National de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie ONLCDT, 2004.<br />
MINISTèRE DE LA SOLIDARITé NATIONALE<br />
Loi 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes<br />
handicapées.<br />
Ordonnance n° 75-64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et<br />
services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence.<br />
Décret n° 80-83 du 15 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement<br />
des foyers pour enfants assistés.<br />
Décret exécutif n° 02-178 du 20 mai 2002 portant création des établissements Diar<br />
Errahma et fixant leur statut.<br />
Décret exécutif n° 04-182 du 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement<br />
des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes<br />
de violences et en situation de détresse.<br />
Décret exécutif 08-228 du 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement<br />
du service d’aide mobile d’urgence sociale.<br />
Décret exécutif n° 10-85 du 4 mars 2010 complétant la liste des services d’aide<br />
mobile d’urgence sociale.<br />
MINISTèRE DE L’éDUCATION NATIONALE<br />
Loi 08-04 du 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale.<br />
Arrêté interministériel du 27 octobre 1998 portant création de classes pour enfants<br />
hospitalisés pour une longue durée dans les centres hospitaliers et les centres de<br />
cure.<br />
140
MINISTèRE DE LA SANTé, DE LA POPULATION<br />
ET DE LA RéFORME HOSPITALIèRE<br />
Loi 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.<br />
Loi 90-17 du 31 juillet 1990 modifiant et complétant la loi 85-05.<br />
Loi 08-13 du 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi 85-05.<br />
Arrêté interministériel du 27 octobre 1998 portant création de classes pour enfants<br />
hospitalisés pour une longue durée dans les centres hospitaliers et les centres de cure.<br />
MINISTèRE DE LA FORMATION<br />
ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS<br />
Recueil de textes régissant la formation professionnelle des personnes handicapées<br />
physiques. Février 2007, Direction de la formation continue et des relations intersectorielles.<br />
éTUDES ET RAPPORTS 12<br />
éTUDES RéALISéES PAR LES INSTITUTIONS<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
références documentaIres<br />
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité nationale, UNICEF, Enquête sur le<br />
phénomène des enfants de la rue, CENEAP, 2000.<br />
Ministère de la Solidarité nationale, UNICEF, étude sur les enfants abandonnés<br />
pour naissance hors mariage et les mères célibataires, CENEAP, 2003.<br />
Office National de l’Alphabétisation et de l’éducation des Adultes, UNICEF,<br />
étude sur l’Alphabétisation des femmes et des jeunes filles, CENEAP, 2003.<br />
CNES, étude du regard sur l’exclusion sociale : le cas des personnes âgées et<br />
de l’enfance privée de famille, 17ème Session Plénière, 2001.<br />
CNES, PNUD, Rapport National sur le développement humain, <strong>Algérie</strong>, 2006.<br />
CNES, Rapport sur la Protection de la jeunesse : la délinquance des mineurs,<br />
<strong>Algérie</strong>, 2003.<br />
Ministère de la Solidarité nationale, UNICEF, Enquête sur la maltraitance des<br />
enfants en <strong>Algérie</strong>, CREAD, 1999.<br />
Doumandji Gamra, Ziane Saïd, Déscolarisation, pauvreté et travail des enfants<br />
et jeunes adolescents en <strong>Algérie</strong>, Revue des sciences humaines n°25, Juin 2006.<br />
12. Bibliographie du Plan National d’Action pour les Enfants, 2008-2015, « Une <strong>Algérie</strong> Digne des Enfants ».<br />
141
éférentIel des dIsposItIfs de protectIon de l’enfance et de la jeunesse<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Gouvernement <strong>Algérie</strong>n, Deuxième rapport périodique de l’<strong>Algérie</strong> au Comité<br />
International des Droits de l’enfant, Genève, Décembre 2003.<br />
Gouvernement <strong>Algérie</strong>n, Rapport national de l’<strong>Algérie</strong> sur le suivi des Objectifs<br />
du Millénaire pour le Développement, Juillet 2005.<br />
Gouvernement <strong>Algérie</strong>n, Rapport national sur le suivi du sommet mondial<br />
pour les enfants, Décembre 2000.<br />
Gouvernement <strong>Algérie</strong>n, Réponse écrite du Gouvernement de l’<strong>Algérie</strong> à la<br />
liste des points à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’<strong>Algérie</strong><br />
par le Comité International des Droits de l’enfant, Août 2005.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Ministère de l’éducation nationale, UNICEF, étude sur la violence en milieu<br />
scolaire, CREAD, Juin 2004.<br />
Ministère de l’éducation nationale, UNICEF, étude sur l’égalité entre les<br />
sexes dans le domaine de l’éducation, Novembre 2004.<br />
Ministère de l’éducation nationale, UNICEF, étude sur les coûts et le Financement<br />
du Système éducatif, Sadek Bakouche, Mohamed Belmihoub Chérif,<br />
Rabah Mohamadi, Décembre 2006.<br />
Ministère de l’éducation nationale, UNICEF, étude sur le préscolaire en <strong>Algérie</strong>,<br />
<strong>ˇ</strong> CRASC, Novembre 2003.<br />
Ministère de la Solidarité nationale, UNICEF, étude sur les foyers pour enfants<br />
assistés <strong>ˇ</strong> : état des lieux et perspectives, Badra Mimouni, Décembre 2006.<br />
Ministère de la Justice, UNICEF, Diagnostic du système de justice juvénile<br />
<strong>ˇ</strong> en <strong>Algérie</strong>, Nygel Cantwell, Mai 2006.<br />
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Projection<br />
<strong>ˇ</strong> du développement du secteur de la santé : perspective décennale, Juillet 2003.<br />
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Office<br />
<strong>ˇ</strong> National des Statistiques, Enquête <strong>Algérie</strong>nne sur la santé de la famille, PAP-<br />
FAM, 2002.<br />
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, UNICEF,<br />
<strong>ˇ</strong> Enquête de prévalence du psycho traumatisme chez les enfants scolarisés âgés<br />
de 12 à 18 ans, Janvier 2007.<br />
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Office<br />
<strong>ˇ</strong> National des Statistiques, Enquête nationale sur le suivi de la situation des enfants<br />
et des femmes, MICS3 2006, Rapport préliminaire, Juin 2007.<br />
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, Institut<br />
<strong>ˇ</strong> National de Santé Publique, Enquête sur l’ampleur et l’impact des événements<br />
traumatiques liés à la violence terroriste chez l’enfant, Mai 2000.<br />
Ministère délégué chargé de la Famille et de la Condition féminine, Rapport<br />
<strong>ˇ</strong><br />
142
National sur la déclaration solennelle sur l’égalité entre les Hommes et les<br />
Femmes, Juin 2006.<br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
<strong>ˇ</strong><br />
Organisation de la Conférence Islamique, UNICEF, Investir en faveur des enfants<br />
du monde islamique, 2005.<br />
Save the children, UNICEF, Les capacités évolutives de l’enfant, 2005.<br />
Save the children, Guide « Préparer l’avenir d’un pays avec les enfants et les<br />
jeunes », Septembre 2002.<br />
UNICEF, Centre de recherche Innocenti, La pauvreté des enfants en perspective :<br />
vue d’ensemble du bien-être des enfants dans les pays riches, 2007.<br />
UNICEF, L’impact de la CDE sur le droit interne <strong>Algérie</strong>n, 2003.<br />
UNICEF, La situation des enfants dans le monde 2007, Femmes et enfants :<br />
le double dividende de l’égalité des sexes, 2007.<br />
éTUDES RéALISéES PAR LES ASSOCIATIONS<br />
références documentaIres<br />
« Les droits de l’enfant en <strong>Algérie</strong> », rapport alternatif (40ème pré-session du comité<br />
des droits de l’enfant, 08 juin 2005), Nations-Unies Genève. Nadia Ait-Zai,<br />
directrice du CIDDEF, juin 2005.<br />
« Identifier les problèmes concernant l’accès à l’éducation des enfants en situation<br />
de handicap de la wilaya de Boumerdes afin que ces derniers bénéficient<br />
d’une meilleure prise en charge », Association école Famille et Prise en Charge<br />
Psycho-Sociale AEFPPS, Boumerdes, mai 2009, avec le soutien de Handicap<br />
International.<br />
143