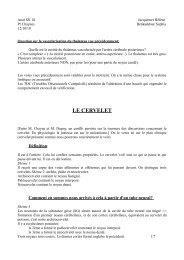Ronéo 3 - 27-09.pdf
Ronéo 3 - 27-09.pdf
Ronéo 3 - 27-09.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Ronéo</strong> numéro 3<br />
errata histologie endo 3 et 4<br />
→ syndrôme de SEEHAN ou Sheehan<br />
→ thyroïdite de Hashimoto<br />
Image manquante histo endo 3 et 4<br />
Image manquante du cours sur les gonades:<br />
errata anat SN 7 et 8<br />
– moelle épinière: diamètre 14mm cervical 8mm thoracique 12 mm lombaire<br />
– sur la coupe médiale, schéma 2 l'uncus est inversé
GRILLE de la SEMAINE DU 4 Octobre<br />
Grille de la Semaine du 11 Octobre
Anat endo corrigée par Monsieur Rongières<br />
I. Généralités<br />
La thyroïde<br />
La thyroïde est une glande exclusivement endocrine (ses produits de sécrétion sont déversés<br />
dans le sang) située au niveau du cou. Elle produit deux types d'hormones :<br />
- les hormones thyroïdiennes sont sécrétées par des îlots cellulaires constituant la majeure partie<br />
de la thyroïde ;<br />
- la calcitonine est sécrétée par quelques cellules plus éparses. Elle est hypocalcémiante (elle fait<br />
rentrer le calcium du sang dans les tissus qui en ont besoin). Il est à noter que la parathormone,<br />
hypercalcémiante, est sécrétée par les quatre parathyroïdes.<br />
L'iode est essentiel dans la synthèse de la thyroxine, c'est pourquoi la thyroïde peut être<br />
explorée par scintigraphie à l'iode, mais cela fait aussi de la thyroïde l'organe le plus sensible lors<br />
d'une contamination de l'air par de l'iode radioactif lors d'accidents. On comprend alors pourquoi, en<br />
cas de suspicion d'accident, on fait ingurgiter aux personnes concernées de l'iode : cet iode sature la<br />
thyroïde, qui ne fixera pas l'iode radioactif présent dans l'air.<br />
La thyroïde est richement vascularisée. Bilobée, elle mesure 5cm de hauteur, 6cm de<br />
largeur et pèse 30g. Située à la partie ventrale du cou en avant des premiers anneaux trachéaux (les<br />
lobes montent un peu plus haut), elle est palpable et mobile. L'isthme s'étend d'un lobe à l'autre et<br />
mesure 2cm de hauteur. La thyroïde est concave en arrière (elle se moule sur le système laryngotrachéal)<br />
et convexe en avant.<br />
Ses rapports sont importants sur le plan chirurgical, avec notamment en position postéromédiale<br />
les nerfs laryngés inférieurs et les parathyroïdes, qui doivent être préservés (on dose le<br />
calcium après une thyroïdectomie afin de s'assurer qu'il reste suffisamment de tissu des<br />
parathyroïdes pour assurer la production de parathormone). Ces rapports seront étudiés en détails<br />
plus loin.<br />
II. Embryologie<br />
La thyroïde dérive des 2 ème et 3 ème arcs branchiaux. En arrière de ce qui deviendra la<br />
langue apparaît un bourgeon thyroïdien. Les ébauches des parathyroïdes migrent et se placent en<br />
arrière de la thyroïde. D'origine rétroglosse, le bourgeon thyroïdien subit une migration verticale<br />
vers le cou. Pendant cette migration, il y a persistance d'un trou en arrière de la langue, et du tractus<br />
thyréoglosse, qui peut persister au niveau de l'isthme et devenir le lobe pyramidal (qui peut parfois<br />
être double, ou à l'origine de petites glandes thyroïdes accessoires qui peuvent être sécrétantes).<br />
III. Examen clinique<br />
La thyroïde est mobile avec la déglutition, et elle se projette en regard d'un losange délimité<br />
par les muscles sterno-cléido-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens.<br />
Pour examiner la thyroïde, on se place derrière le patient et on lui demande de déglutir. Une<br />
thyroïde normale n'est pas palpable. On recherche une tumeur, un kyste liquidien, un nodule plein...<br />
Un goitre est une tumeur très grosse de la thyroïde, parfois plongeante vers le thorax, ce qui peut<br />
aller jusqu'à entraîner des troubles respiratoires.
IV. Fixation<br />
La thyroïde est fixée au système laryngo-trachéal (ce qui explique le suivi du mouvement<br />
lors de la déglutition) par un ligament médian qui suspend l'isthme et deux ligaments latéraux qui<br />
suspendent les lobes.<br />
Il faut préciser qu'elle est suspendue à l'axe laryngo-trachéal, et non collée à celui-ci. Elle se situe<br />
dans un espace dissécable (on l'opère avec la tête en hyperextension afin qu'elle soit saillante).<br />
V. Rapports<br />
A. Rapports de la face ventrale<br />
La thyroïde est très superficielle en avant, très accessible, avec d'avant en arrière :<br />
- la peau ;<br />
- le plathysma (muscle peaucier du cou) ;<br />
- des muscles engainés par des éléments de l'aponévrose du fascia moyen du cou ;<br />
- les muscles sterno-cléido-mastoïdiens, qui divergent ;<br />
- les muscles sterno-cléido-hyoïdiens, qui divergent également ;<br />
- les muscles sterno-thyroïdiens ;<br />
- le cartilage thyroïdien ;<br />
Les muscles sterno-hyoïdiens et sterno-thyroïdiens délimitent le losange de la<br />
trachéotomie. Il est important de noter que, au-dessus de l'isthme, la trachée se situe à 1,5cm de la<br />
peau, et que, en-dessous de l'isthme, on trouve beaucoup de veines, notamment le tronc veineux<br />
brachio-céphalique gauche. La région sus-isthmique étant peu vasculaire, le triangle supérieur du<br />
losange permet la trachéotomie sans risque de toucher des vaisseaux.<br />
B. Rapports des faces postéro-latérales<br />
En arrière, la thyroïde est en rapport avec les pédicules vasculaires comprenant chacun une<br />
veine jugulaire en dehors, une artère carotide principale en dedans, un nerf vague (X) en avant, et<br />
une anse du nerf hypoglosse (XII) en arrière.<br />
Plus en arrière, on trouve les ganglions sympathiques.<br />
C. Rapports de la face postéro-médiale<br />
Avec la thyroïde dans la loge viscérale, la trachée, et l'oesophage à gauche.<br />
Le nerf laryngé inférieur gauche se situe en arrière de l’artère thryroïdienne inférieure (car il arrive<br />
de plus bas en formant une crosse sous la crosse aortique).<br />
Le nerf laryngé inférieur droit (qui forme une crosse sous l'artère sous-clavière droite), se<br />
situe entre la glande et l'artère thryroïdienne inférieure, et doit donc être isolé avec prudence lors de<br />
la chirurgie.<br />
Les glandes parathyroïdes sont très petites. Il y en a deux paires situées en arrière des nerfs<br />
laryngés. Les parathyroïdes supérieures sont très proches des nerfs laryngés et ne doivent pas être<br />
retirées.
VI. Vascularisation<br />
A. Artères<br />
La vascularisation se fait via deux gros pédicules artériels :<br />
- l'artère thyroïdienne supérieure, qui naît de l'artère carotide externe, tombe sur le sommet du lobe,<br />
et se divise en trois branches (supérieure, ventrale et dorsale) qui s'anastomosent avec les branches<br />
de l'artère thyroïdienne supérieure contro-latérale ;<br />
- l'artère thyroïdienne inférieure, qui naît du tronc thyro-bicervico-scapulaire ou tronc thyro-cervical<br />
(lui-même étant l'une des premières branches de l'artère sous-clavière). Elle aborde la thyroïde et<br />
donne des branches qui s'anastomosent avec celles de l'artère thyroïdienne supérieure.<br />
- l'artère thyroïdienne IMA est inconstante. Elle naît de la crosse aortique et vascularise la partie<br />
isthmique.<br />
B. Veines<br />
Le drainage veineux est satellite et draine la sécrétion hormonale.<br />
La veine thyroïdienne supérieure se jette directement dans la veine jugulaire interne, le sang qu'elle<br />
transporte chargé d'hormone.<br />
La veine thyroïdienne moyenne s'amarre également dans la jugulaire interne.<br />
La veine thyroïdienne inférieure qui se jette soit (50%) dans la jugulaire interne, soit (50%) dans la<br />
veine brachio-céphalique.<br />
C. Lymphatiques<br />
Le drainage lymphatique est jugulo-carotidien. Les ganglions qui drainent cette zone doivent<br />
être palpés en même temps que la thyroïde lors de l'examen clinique.
TD VIROLOGIE numéro 2<br />
Cas n°1 : Mme L., 71 ans, a présenté il y a quelques jours<br />
une douleur orbito-frontale droite. Actuellement elle<br />
présente une éruption érythémateuse se couvrant de<br />
vésicules localisées au territoire innervé par la branche<br />
nasale externe du nerf ophtalmique droit et un coryza<br />
douloureux.<br />
Que vous évoque ces symptômes ?<br />
Quels examens biologiques demandez-vous pour faire le<br />
diagnostic ?<br />
Quelles sont les autres localisations classiques de ce type<br />
d ’infection virale ?<br />
Cas n°2 : L’enfant R., 5 ans présente une conjonctivite<br />
bilatérale avec des signes hémorragiques associés à une<br />
pharyngite et une fièvre modérée. L’examen retrouve des<br />
adénopathies cervicales, mais pas d’éruption cutanée ou<br />
muqueuse. Vous l’envoyez chez un ophtalmologue.<br />
Quels sont les virus responsables de conjonctivites ou kératoconjonctivites<br />
?<br />
En l ’absence d ’orientation diagnostic, quels sont les examens<br />
virologiques permettant de confirmer la présence d ’un virus ?<br />
La présence d’un ADV est confirmée. Quels sont les<br />
sérotypes les plus régulièrement responsables de kératoconjonctivites<br />
?<br />
De quel antiviral dispose-t-on pour traiter une kératoconjonctivite<br />
à ADV ?
Conjonctivite<br />
hémorragique à<br />
Entérovirus<br />
Pharyngite à Adénovirus<br />
Cas n°3 : L’enfant K., 6 ans vous est amené parce qu’il est<br />
fébrile (39°C) et présente un catarrhe oculo-respiratoire avec<br />
toux évoluant depuis 48 heures. Il ne mange plus et il est<br />
grognon. Deux jours plus tard apparaît une éruption<br />
maculo-papuleuse, non prurigineuse, débutant à la tête et<br />
s’étendant au thorax et aux membres.<br />
Quel est le diagnostic le plus probable ?<br />
Quelle est la complication neurologique<br />
potentielle de cette infection ?<br />
Quels sont les moyens pour prévenir cette<br />
infection ?
Cas n°4 : Mme R., 43 ans, est hospitalisée pour des troubles<br />
fronto-temporaux apparus dans un contexte fébrile. Les<br />
premiers examens (imagerie et biologie du LCR) sont en<br />
faveur d’une encéphalite aiguë d ’origine virale.<br />
Quel(s) est(sont) le ou les virus le plus souvent<br />
responsable(s) d’encéphalite ?<br />
Quelles sont les évolutions spontanées possibles de cette<br />
encéphalite ?<br />
Quels moyens diagnostic utiliserez-vous pour confirmer<br />
l ’origine virale de l ’encéphalite ?<br />
Quels sont les modalités de traitement de cette encéphalite ?<br />
Cas n°5 : Pierre, 6 ans, présente dans un contexte fébrile des<br />
signes de méningites. L’examen clinique retrouve des<br />
adénopathies cervicales et sous angulomaxillaires associées à<br />
une parotidite. Une réaction méningée ourlienne est<br />
suspectée.<br />
Quels sont les virus habituellement responsables des parotidites ?<br />
Quels examens prescrivez-vous pour confirmer l’origine virale de<br />
l’infection ?<br />
Quelles sont les cibles organiques<br />
potentielles du virus ourlien ?<br />
Quels sont les complications possibles d ’une<br />
infection à virus ourlien chez l ’adulte ?<br />
Quels sont les moyens préventifs ou curatifs<br />
contre le virus ourlien ?
Cas n°6 : Au cours de l’été, Martine, 5 ans, est amenée aux<br />
Urgences pour des vomissements survenant dans un contexte<br />
fébrile avec céphalées. L’examen clinique retrouve un<br />
syndrome méningé avec raideur de la nuque et hyperesthésie<br />
cutanée. L’analyse biochimique du LCR est en faveur d ’une<br />
infection virale. Martine est à jour des vaccinations.<br />
Quels sont les virus habituellement responsables d’un<br />
syndrome méningé ?<br />
Quels sont les données épidémiologiques qui permettent<br />
d’orienter le diagnostic ?<br />
Quels examens prescrivez-vous pour confirmer l’étiologie<br />
virale de l ’infection ?<br />
Quelle est l ’évolution habituelle des ces méningites ?<br />
Quels sont les moyens préventifs ou curatifs contre ces infections ?<br />
Cas n°7 : Mr T., 35 ans, rentre d’un trek en d’Asie, où il a<br />
été en contact avec des chiens errants. Il présente depuis<br />
quelques jours des douleurs des membres supérieurs avec<br />
des paralysies progressives et ascendante des membres<br />
inférieurs. On note également une excitation psychomotrice<br />
avec fièvre, hyperesthésie cutanée et hydrophobie<br />
inexpliquée. Aucune trace de morsure n’est visible mais il a<br />
souvent des petites plaies aux mains.<br />
Que vous évoque l’histoire de Mr T ?<br />
Quels sont les moyens thérapeutiques à mettre en oeuvre ?<br />
Quelle est l’évolution spontanée de la maladie ?<br />
Conduite à tenir si on suspecte la rage chez un chien et un<br />
sujet mordu ?
L'immunisation doit être faite, en cas de voyage, par 3 injections IM à<br />
J0, J7, J21 ou plutôt J28. L'immunité est acquise pour 5 ans après un<br />
rappel à 1 an.<br />
Cas n°8 : Mr T., 43 ans, est un ancien toxicomane. Il est<br />
infecté par le HIV depuis 12 ans mais il ne se faisait pas<br />
suivre. L’aggravation de son état nécessite une<br />
hospitalisation. Cliniquement, il présente des signes<br />
d’encéphalite débutant par des troubles mentaux, de la<br />
parole et de la vision, puis de la motricité évoluant<br />
rapidement vers la démence, la cécité et la paralysie, enfin le<br />
coma.<br />
Etiologie probable ?<br />
Diagnostic virologique ?<br />
Traitement ?
Cas n°9: Mr. V. 35 ans, présente de la fièvre, une asthénie<br />
importante. A l’examen on note un syndrome méningé<br />
associé à une angine et des adénopathies cervicales.<br />
L’hémogramme note la présence de lymphocytes<br />
hyperbasophiles.<br />
1/ Quels sont les principaux virus pouvant provoquer des<br />
méningites ? Comment fait-on le diagnostic virologique ?<br />
2/ Mr V. avoue avoir eu des relations homosexuelles non<br />
protégées il y a 3 semaines : vers quel virus allez-vous<br />
orienter votre recherche ?<br />
3/ Quels examens complémentaires sont souhaitables dans<br />
ce contexte ?<br />
4/ Quel types de molécules sont disponibles pour traiter cette<br />
infection ?<br />
Cas n°10 : Mr H., 47 ans, originaire d’Afrique sub-saharienne, a<br />
présenté une pharyngite évoluant dans un contexte infectieux.<br />
Elle était associée à des signes méningés, des myalgies et une<br />
rétention d’urine. Depuis 24h, est apparue une paralysie flasque<br />
de la loge externe de la jambe droite ainsi que du quadriceps<br />
droit. Le LCR est clair avec une hypercytose modérée et une<br />
protéinorachie légèrement augmentée. Le statut vaccinal du<br />
patient est inconnu.<br />
Quel est le virus probablement en cause ?<br />
Quels examens prescrivez-vous pour faire le diagnostic ?<br />
En dehors de la forme développée par Mr.H, quelles sont les<br />
autres formes cliniques des infections à Entérovirus ?<br />
Quels sont les moyens préventifs de lutte contre l ’infection de<br />
Mr.H ?
Picornaviridae<br />
Virus à ARN<br />
Les entérovirus (#1)<br />
Virus non enveloppés (résistants)<br />
Contamination oro-pharyngée +++ (aérienne)<br />
Réservoir humain<br />
Endémies des régions sub-tropicales<br />
Epidémies saisonnières Europe (été-automne)<br />
Poliovirus (3 sérotypes), entérovirus autres (> 70 sérotypes)<br />
Le poliovirus<br />
Formes asymptomatiques prédominantes<br />
Poliomyélite (1%) : paralysie flasque, atteinte<br />
des cornes antérieures, inefficacité du SI<br />
Régression avec séquelles<br />
Diagnostic : gorge, selles, LCR<br />
isolement et séroneutralisation<br />
(typage)<br />
Vaccination :<br />
vaccin inactivé injectable<br />
vaccin atténué per os
Les entérovirus (#2)<br />
Amygdales et ganglions<br />
cervicaux<br />
TD, peau, foie<br />
Ingestion<br />
Multiplication virale<br />
pharynx et intestin<br />
Virémie<br />
Plaques de Peyer et<br />
ganglions mésentériques<br />
SNC Coeur<br />
Entérovirus autres<br />
Responsables des méningites lymphocytaires chez l’enfant +++<br />
Atteintes spécifiques :<br />
Coxsackie A : Herpangine, éruptions cutanées, main-piedbouche,<br />
conjonctivite hémorragique<br />
Coxsackie B : Myocardites, péricardites , hépatites<br />
Echo : exanthèmes de BOSTON<br />
Entéro 68-71 : conjonctivites hémorragiques, bronchiolites<br />
Atteintes non spécifiques : Méningites, diarrhées, paralysies<br />
sans séquelles, infections néonatales<br />
Infections chroniques : patho neuro-musculaires<br />
(périmyosites, DID ?)
TD BIOCHIMIE REPONSES (merci Gaspard :-) )<br />
Équilibre acido basique<br />
1 BCE<br />
2 ABCE<br />
3 ABDE<br />
4 ABCD<br />
5 ABCE<br />
6ABCD<br />
7 BCDE<br />
8 ABE<br />
9 ACDE<br />
10 ABCE<br />
11 A<br />
12 C<br />
13 E<br />
14 D<br />
15 C<br />
16 A<br />
17 C<br />
18 C<br />
19 E<br />
20 D<br />
21 A<br />
22 E<br />
23 ACE<br />
24 BDE<br />
25 BDE<br />
26 ACE<br />
<strong>27</strong> BDE<br />
28 ABC<br />
METABOLISME DU CUIVRE LITHIUM MAGNESIUM<br />
1 ACDE<br />
2 E<br />
3 CD<br />
4 ABD<br />
5 B<br />
6 BCDE<br />
7 C<br />
8 calcémie ionisé<br />
9 ACD<br />
10 B
Dr Ph.Dupui<br />
Neurophysiologie 1 et 2<br />
le 28/09/2010 Grouteau Gaspard<br />
de 10 à12h Grenier Cyrielle<br />
Cours de Neurophysiologie<br />
Ce cours est une continuité avec la première année de Médecine ( ils sont considérés comme<br />
acquis )<br />
RAPPELS: classification des fibres nerveuses des nerfs périphériques ,organisation du système<br />
nerveux somatique<br />
La plupart des nerfs périphériques sont souvent mixtes ( un contingent moteur et un<br />
sensitif).Quand on parle d'une fibre nerveuse il faut savoir si c'est une fibre afférente ou efférente,<br />
plus savoir la différence de calibre ( myélinique ,amyélinique)<br />
Schéma 1 du polycopié<br />
On remarque que le diamètre de la fibre va de 0 a 20 µm, plus à gauche on a la vitesse de<br />
conduction en m/s. Plus une fibre a un calibre grand, plus elle conduit son message ( potentiel<br />
d'action ) rapidement .Les fibres amyélinique ont un diamètre compris entre 0 et 1 µm:<br />
corrélat immédiat :la plupart des techniques faites sont pratiquées avec l'introduction d'une micro<br />
électrode en intracellulaire ,le problème avec les fibres amyéliniques est que elles sont trop petites<br />
pour permettre l'introduction de la microélectrode donc en neurophysiologie les fibres amyéliniques<br />
ainsi que les fibres dont le diamètre est inférieur a 5 µm sont mal connu .De plus ces fibres sont les<br />
plus nombreuses ( 10 fois plus) :il y a donc des progrès à faire!<br />
Pour la classification des fibres ,il y a deux lignes de compte:<br />
-la classification de Lloyd : elle est réservée aux fibres afférente en relation avec récepteur<br />
musculaire et les récepteurs tendineux ( afférence musculo tendineuse ) et des terminaisons libres<br />
-la classification d'Erlanger:elle est valable pour tout le reste ,efference et afférence de la peau ,des<br />
viceres.<br />
La classification de Lloyd:<br />
On s'appercoit que les plus grosses fibres que l'on rencontre se retrouve dans le groupe de Lloyd<br />
(groupe ɪ ) elles sont divisées en 2 : en relation avec le fuseau neuro musculaire (FNM) ce sont les<br />
ɪa et celles des organes tendineux de golgi sont les ɪ b. Elles ont aussi le seuil d'exitabilité le plus<br />
bas ( relation avec le calibre) donc elles sont plus facilement exitable.<br />
Pour le groupe II :fibres afférente de calibre plus petit ( 6-7,5 µm ) c'est aussi des terminaisons au<br />
niveau du FNM ,donc le muscle recoit des fibres Ia et II (mais elles s'ont pas la même fonction)<br />
Groupe III : fibres de très petit calibre ( ce sont aussi les A δ) ce sont des terminaison nerveuse<br />
libre ,ce sont des nocicepteurs pour le muscle.<br />
Groupe IV :terminaison nerveuse amyélinique :elles s'adressent aussi aux muscles.<br />
1
La classification d'Erlanger:<br />
On va retrouver des afférences autres que pour le muscle<br />
Aγ etAβ: fibre myélinique proche de fibre de Lloyd mais calibre moyen de 6-7µm se sont<br />
essentiellement des mécanorécepteurs cutanés.<br />
Afférence A δ: se sont nocicepteurs ou bien des récepteurs au froid<br />
Fibres amyélinique groupe C : nocicepteurs et recepteurs au chaud<br />
Ensuite nous passons aux éfferences :<br />
Motoneurone α du groupe A ,leurs calibres est d'environ 14-15 µm ,elles sont donc plus petites que<br />
les fibres de type Ia ,ces motoneurones sont les pilotes des fibres musculo striée squeletiques (MST)<br />
Cas particulier de motoneurone dans les fuseaux neuromusculaire : le motoneurone γ ou Aγ ( 5 -8<br />
µm)<br />
Neurone efferent du SNOV :petit rappel le système orthosympatique et le système parasympathique<br />
sont faits de 2 neurones successifs (pré et post ganglionnaire)<br />
Le système ortho : préganglionnaire: court et postganglionnaire: long, il se passe un relais souvent<br />
dans la chaîne laterovertébrale. Pour le para c'est l'inverse et le relais se fait souvent dans la paroie<br />
de l'organe cible. Si on considère le premier maillon de l'efference ortho ou para ce sont des fibres<br />
myéliniques de petit calibre ( 1 a3 µm) c'est le groupe B. Pour le deuxième neurone ce sont des<br />
fibres amyéliniques du groupe C de la classification d'Erlanger. On peut donc conclure que la<br />
vitesse de conduction le long de ces efférences est beaucoup plus lente que dans le système nerveux<br />
somatique ,autre remarque le parasympathique ayant un neurone préganglionnaire plus long ,il va<br />
donc plus vite que l'orthosympatique<br />
Comment va t-on aborder le cours de neurophysiologie?<br />
Nous allons voir les deux versants de l'activité somatique:<br />
-comment le système nerveux reçoit il l'information sensorielle et comment il la traite<br />
-comment le système nerveux va t-il contrôler son effecteur (le muscle striée squelettique)<br />
Généralement l'information sensorielle remonte au système nerveux centrale par le biais de fibre<br />
afférente (récepteur sensorielle >système nerveux central). Le neurone primaire est une cellule en T<br />
avec un corps cellulaire ,pas de dendrites et un prolongement axonale qui se divise. Ces<br />
informations remontent au SNC .<br />
La moelle épinière a une organisation métamérique , des racines nerveuses sortent à chaque étage<br />
des vertèbres même si la moelle épinière s'arrête en L2. Ces informations remontent par des nerfs<br />
périphériques ou nerfs crâniens aux différents étages de la moelle épinière .Il peut y avoir une<br />
connexion avec des motoneurone α à chaque étage: tout de suite l'afférence avertie le<br />
motoneurone( par un interneurone ou non) on appelle cela :un contrôle segmentaire de la<br />
motricité ,si ca se passe comme cela, le cortex cérebral( de la volonté) n'a pas de rôle a jouer ,c'est<br />
indépendant de la volonté c'est donc un REFLEXE .Ce reflexe est une boucle reflexe courte<br />
pocisynaptique (peu de synapse) .Il y a une autre possibilité c'est si l'information est conduite à<br />
l'étage supra-segmentaire ou sous corticale (base du cerveau ou au tronc cerebrale),ces structures<br />
elles mêmes peuvent influencer les motoneurones ,c'est un reflexe a boucle longue plurisynaptique.<br />
Dernière possibilité:l'information remonte jusqu'à l'étage supérieur (corticale) donc elle devient<br />
consciente. L'individu fera appel a son vécu individuel ,le cortex mais en jeu la confrontation entre<br />
l'activité et les souvenirs.<br />
2
On élabore stratégie de réponse qu'on peut classer en différente action compris entre les deux<br />
extrêmes:<br />
-rapprochement vers sensation (si rapporte bénéfique)<br />
-comportement d'éloignement quand cela nous paraît dangereux ou désagréable.<br />
La sensation<br />
Nous sommes des êtres compliqués ,l'espèce qui c'est le plus affranchie de son environnement,un<br />
être élabore ,pluricellulaire ,on peut subir un changement environnementale sans trop de dégâts.<br />
Cela nous donne une indépendance, la possibilité de choisir. Si on veut choisir il faut quand même<br />
avoir un comportement adapté à la situation environnementale,pour choisir il faut être renseigné sur<br />
l'environnement ,c'est donc qu'il faut avoir de bonnes afférences<br />
On a pu calculer que si tout nos récepteurs sensoriels fonctionnent en même temps on pourrait<br />
capter 10^7 info /seconde.<br />
Sur ces 10^7 informations ,très peu arrive au niveau de la conscience.<br />
La sensibilité consciente :c'est un fait nouveau qui ne fait pas appel à nos souvenirs<br />
cela nous permet juste de dire cette sensation sans référence est agréable ou non on peut répondre<br />
par la suite a certaines questions :ou est elle perçue quand et comment?<br />
Alors que quand on parle de perception ,ce qu'on ressent fait appel à une référence antérieur, la<br />
donnée perçue permet d'enrichir son expérience<br />
Corrélation: plus l'expérience sensorielle est importante plus on développe de circuit neuronaux<br />
,moralité :ne pas ce priver de faire des expérience diverses et variées!!<br />
Il faut aussi comprendre que les informations même si elles n'arrivent pas à notre conscience ont un<br />
rôle important à jouer.<br />
Qu'est ce qui va faire que certaines informations arrivent ou non à la conscience? C'est la<br />
dimension affective que contient l'information ( si elle nous intéresse ,si cela crée un plaisir)<br />
I Les récepteurs sensoriels<br />
A)Généralités<br />
voir schéma2<br />
Un récepteur sensoriel( au contact du monde extérieur ou dans l'organisme ) quand il reconnaît un<br />
stimulus adéquate ,il peut générer un potentiel d'action sur des neurone afférent primaire qui peut<br />
conduit l'information jusqu'au SNC.<br />
1)Les différents types de récepteurs sensoriels:<br />
voir schéma 4<br />
-soit ce sont des terminaisons nerveuses libres sensible aux stimulus.<br />
-Ce sont des terminaisons nerveuses en relation avec un élément accessoire, cet élément est souvent<br />
quelque chose de déformable ( exemple:lame conjonctive) donc ce sont souvent des<br />
mecanorecepteurs.<br />
3
-terminaisons axonale en relation avec d'autres cellules qui sont porteuses de l'élément accessoire<br />
exemple:dans l'oreille interne (pour l'équilibre) les cellules cilliées tapissent l'oreille ,ces cellules<br />
ciliées sont en relation avec terminaison nerveuse du VIII eme nerf cranien.<br />
Le récepteur sensoriel est un transducteur d'énergie ,il reçoit un stimulus ( qui contient de l'énergie<br />
chimique,mécanique,physique...),il se sert de cette énergie mais il ne l'utilise pas ( il ne la<br />
consomme pas ,elle ne disparaît pas) mais elle est suffisante pour être transformé en énergie<br />
électrique<br />
exemple: quand on regarde quelqu'un on reçoit de l'énergie physique (des photons) mais pour autant<br />
la personne regardée ne disparaît pas.<br />
2)Classification des récepteurs sensoriels<br />
voir schéma 5<br />
On classe ces récepteurs en fonction :<br />
-du type de stimulation (physique,chimique...)<br />
-si ils sont au contact de l'exterieur ( exterorécepteurs)<br />
-interorécepteurs<br />
Les exterorécepteurs ce sont les récepteurs des 5 sens :tact,audition,vision ,stimulus chaud<br />
froid,gustation ,olfaction. Il y a un 6eme sens :la proprioception (connaissance de soit même) cela<br />
sous entend que en permanence on connait le schéma corporelle plus notre situation dans l'espace ,<br />
sans le secours de la vue .Pour avoir ces deux types de renseignement il nous faut :les muscles et<br />
tendons (propriocepteurs de l'appareil locomoteur), plus les récepteurs sensoriels de l'oreille interne.<br />
Il y a aussi les viscèro récepteurs essentiels pour des régulation réflexe telle que les baro récepteurs<br />
pour la régulation de la PSA.<br />
Il y a un cas particulier qui sont les nocicepteurs (terminaison libre de petits neurones) dans la<br />
peau,les viceres ,les muscles.<br />
3)Codage du stimulus;récepteurs sensoriels=transducteurs d'énergie;le stimulus :decours temporel,<br />
codage du stimulus en fréquence impulsionnelle<br />
voir schéma6<br />
Le stimulus a deux phases :<br />
-dynamiques :la phase d'apparition et la phase de disparition<br />
-statique :la phase de maintien<br />
On va voir que certain récepteurs sensoriels sont sensibles aux aspects dynamiques alors que<br />
d'autres aux aspects statiques.<br />
Un même stimulus peut être capté par différents récepteurs mais ils vont coder différemment.<br />
Rien qu'au niveau de ces récepteurs, le système nerveux code la forme,la durée de façon précise<br />
Cas particulier :les stimulus qui ont une forme vibratoire,s inusoïdale exemple:la fréquence sonore:<br />
l'intérêt c'est que pour ces formes c'est surtout le maximum et le minimum qui seront important plus<br />
l'écart entre les deux .C'est pas le même type de récepteur qui code pour le maximum et le minimum<br />
pourtant on a besoin de tous pour percevoir ce stimulus.<br />
4
Codage du stimulus en fréquence impulsionnelle<br />
Cf schéma 7<br />
La terminaison axonale, il y a plusieurs branches terminales, certaines peuvent êtres des<br />
terminaisons classiques (avec des vésicules de neurotransmetteurs), les autres sont des récepteurs<br />
sensoriels. Ces terminaisons classiques ne sont pas en relation avec des effecteurs , mais à certain<br />
moment, elles peuvent libérer leur neurotransmetteur dans l'environnement immédiat de la<br />
terminaison. Cela favorise l'excitabilité des autres terminaisons, ça facilite la transmission du<br />
message sensoriel.<br />
Sur la terminaison axonale, on place les micro électrodes:<br />
– au niveau de la connexion des branches terminales<br />
– au niveau du premier nœud de Ranvier<br />
– au niveau de nœud de Ranvier suivant<br />
On excite par stimulus les branches terminales.<br />
Au niveau de la jonction des branches terminales cela entraine un potentiel électrotonique<br />
( phénomène de dépolarisation local qui respecte la loi d'ohm) qui est transmit aux autres branches.<br />
Au niveau des nœuds de Ranvier, il y a des canaux voltage dépendants (Na...), pour les ouvrir, il<br />
faut atteindre un certain seuil.<br />
Si le premier potentiel n'arrive pas au seuil: rien ne se passe, il n'y aura pas de potentiel d'action au<br />
nœud suivant, l'info ne remonte pas.<br />
Si le seuil est dépassé, des potentiels d'action (PA) apparaissent.<br />
Si le stimulus dépasse largement le seuil, la fréquence des PA sera plus élevée.<br />
Après un stimulus, il y a une période réfractaire, il ne peut pas y avoir de nouveau stimulus, elle<br />
dure environ 1ms (le temps que les canaux se referment,car tout les canaux Na sont ouverts). La<br />
fréquence de dépolarisation théorique maximale d'un neurone est donc de 1 Khz.<br />
4) Adaptation des récepteurs<br />
cf schéma 8: Chaque petit trait représente un potentiel d'action, cela représente la fréquence de<br />
décharge des PA.<br />
Récepteurs à adaptation lente<br />
Avant le stimulus, il y a déjà une certaine décharge. Le stimulus augmente la fréquence mais elle<br />
reste identique. Ici le récepteur est sensible au maintient de la stimulation, il ne s'adapte pas à la<br />
situation, c'est un codeur de position, statique, il code pour des durées... Les fuseaux<br />
neuromusculaires en font partis.<br />
Récepteurs à adaptation rapide<br />
Ils sont sensibles juste au moment de l'apparition de la stimulation, ils ne codent plus pour la durée.<br />
Ils codent l'aspect, la vitesse d'initiation, Ce sont des récepteurs de type « ON ».<br />
Ex: récepteurs au niveau de la peau (pacines).<br />
Récepteurs « ON-OFF »<br />
Ce sont des récepteurs à adaptation rapide. Ils codent les aspects statiques et dynamiques.<br />
5
5) Définition de la somesthésie<br />
Cf schéma 9.<br />
C'est l'ensemble des infos qui proviennent du corps ou qui s'exercent sur lui, qui permettent<br />
d'accéder au schéma corporel mais qui en plus donne des info sur ce qui s'exerce sur le corps.<br />
Classification sensibilité somesthésique, il y a différentes sensibilité. (tableau)<br />
L'humain est capable de ressentir la verticale grâce à la sensibilité proprioceptive, il y a la sensation<br />
de pression sur la plante des pied, cela permet de se tenir droit. Il faut l'accord des 2 hémicorps pour<br />
cela, certaines personnes qui ont un problème à se niveau ne se tiennent pas droite et ont ainsi des<br />
douleurs dorsales.<br />
La sensibilité profonde, l'état des viscères, c'est par exemple la tension du péritoine en post prandial.<br />
Dans l'espaces, les astronautes ne ressentent pas cela.<br />
B) Les récepteurs cutanés<br />
1) Notion d'unité sensorielle et de champ récepteur<br />
Cf schéma 10<br />
Un neurone afférent a sous sa dépendance une aire périphérique de récepteurs, elle correspond au<br />
champ récepteur. Plus ce champs est petit, plus on sera discriminatif dans le tact... le plus précis<br />
est au niveau de la pulpe des doigts.<br />
L'ensemble des terminaisons axoniques constitue l'unité sensorielle.<br />
Le compas de Weber est un compas qui a 2 pointes mousses, on mesure l'écart entre ces 2 branches.<br />
On appui le compas sur une personne et on lui demande si elle perçoit 1 ou 2 impact. Au niveau du<br />
dos, il faut faire un écart de 2-3 cm pour que le sujet perçoive 2 impact. Au niveau de la pulpe des<br />
doigts, on distingue un écart de 1 mm.<br />
Si on sectionne un neurone afférent primaire, on ne va pas perdre la sensibilité de l'aire périphérique<br />
car il y a des recouvrements par les terminaisons d'autres neurones. Pour qu'il y ait perte de<br />
sensibilité, il faut sectionner beaucoup de neurones afférents, donc un nerf par exemple, on aura<br />
donc une zone d'anesthésie.<br />
2) Les mécanorécepteurs cutanés<br />
Cf shéma 11<br />
Ils sont généralement en relation avec des neurones afférent:<br />
–myélinisés d'assez gros calibre: A β (50-60m/s), Aγ (30-50m/s)<br />
–myélinisés de plus petit calibre: Aδ (20-30m/s)<br />
Le stimulus peut être immobile: contact, pression..<br />
ou mobile:<br />
–perpendiculaire à la peau: vibrations<br />
–parallèle à la peau: frollement ou chatouillement (si il y a une tonalité affective, agréable ou non)6
Le contact, la pression, les vibrations sont des sens détectés par les même types de récepteurs<br />
(mécanorécepteurs) mais, pour le contact, il y a des récepteurs superficiels (cutanés ou<br />
immédiatement sous cutanés).<br />
Pour la pression, c'est la déformation des tissus plus profonds.<br />
Pour les vibrations, ce sont des signaux sensitif répétés rapides qui activent des récepteurs à<br />
adaptation rapide sensibles à la dynamique des choses.<br />
Il y a différents types de récepteurs en fonction des peaux et si ils sont adaptatifs ou pas.<br />
Il y a deux types de peau chez un individu, la peau GLABRE et la peau HIRSUTE.<br />
La peau glabre se trouve au niveau de la plante des pied et de la paume des main. Certains<br />
récepteurs se trouvent dans les deux types de peau et d'autres sont spécifique d'un seul. Chacun<br />
d'entre eux sont reliés à un élément accessoire.<br />
Les disques de MERKEL<br />
Ils se trouvent dans les 2 peau, mais ils n'y sont pas agencés de la même manière.<br />
C'est un récepteur d'intensité (de position) dans les 2 peau mais ils sont plus précis dans la peau<br />
glabre.<br />
Il y a une terminaison nerveuse épaissie d'une fibre nerveuse myélinisée de type Aβ.<br />
Ils transmettent d'abord un signal intense partiellement adaptatif suivi d'un signal continu plus faible<br />
qui ne s'adaptant que lentement.<br />
Ils sont responsable de la détection du contact continu d'un objet sur la peau.<br />
L'ensemble des disque forment un dôme possédant une afférence unique.<br />
Leur rôle: la localisation précise des sensation tactiles. Si l'objet est mis en mouvement, l'info sera<br />
plus précise, la forme, la consistance...<br />
Terminaison de RUFFINI<br />
Ils ne sont présent que dans la peau hirsute, dans les couches plus profondes. Ils sont enveloppés<br />
dans une lame de conjonctif et c'est la déformation de cette lame qui va engendrer des PA ou non.<br />
Il y a des connexion multiples avec des fibres myéliniques de calibre proche des Aδ.<br />
Ils s'adaptent très peu, ils permettent de coder des déformations cutanées qui durent ( même<br />
plusieurs heures).<br />
Leur rôle: dans la détection des déformation prolongées de la peau et des tissus plus profonds (ex:<br />
pression ou contact continu).<br />
Ils participent au tact grossier protopathique.<br />
Les corpuscules de MEISSNER<br />
Ils ne sont présent que dans la peau glabre. Ce sont des petits volumes capables de se déformer dans<br />
tout les sens.<br />
Ils sont reliés à des afférences de plus gros calibres Aβ.<br />
On les trouvent surtout dans les zones où la discrimination est très importante (pulpe des doigts).<br />
Ils s'adaptent très vite, codent des déformations très rapide, les aspects dynamiques.<br />
Ils sont sensibles à un stimulus qui se déplace, aux vibrations, un effleurement léger. 7
Leur rôle: La localisation précise d'un stimulus. Ils participent à la reconnaissance des objets, mais<br />
surtout de leur texture.<br />
Les récepteurs annexés aux poils<br />
La terminaison de l'afférence s'enroule à la base du follicule pileux. Chaque fois que le poil est<br />
déformé, cela met en jeu cette afférence (Aβ).<br />
Ils sont sensible à l'aspect dynamique de la sensation, pas statique. C'est pour cette raison que nous<br />
supportons nos habits.<br />
Ils sont importants lors de la marche ou de la course, importants pour les aveugles (qui ont souvent<br />
les bras nus) car le flux d'air est capté par les poils, si il change, cela signal un obstacle.<br />
Leur rôle: dans l'affleurement et le mouvement d'objets à la surface du corps ou en contact avec<br />
celui ci.<br />
Les corpuscules de PACINI<br />
Ils sont présents dans la peau hirsute et glabre. La terminaison se fait dans une capsule conjonctive<br />
fine. Ils sont sensible aux variation de poids. Il y en a beaucoup au niveau plantaire (donnent l'idée<br />
du poids du corps).<br />
Ils sont plus superficiels dans la peau glabre que dans la peau hirsute.<br />
Le tissus cutané des fesses en est riche, cela nous donne une idée de notre poids lorsqu'on est assis.<br />
Mais le niveau de sensibilité est moindre dans les fesses (car il y a le tissu adipeux donc les<br />
récepteurs sont moins en contact) qu'au niveau plantaire. Lorsqu'on est assis, il faut donc bouger<br />
pour relancer la sensation car sinon il y aura perte de la posture.<br />
Ils analysent de très faibles variation de pression.<br />
Ils sont stimulés juste par des mouvements rapides des tissus.<br />
Leur rôle: Ils détectent les changement mécaniques rapide des tissus, la déformation des tissus<br />
(plantaire +++). Ils détectent les vibrations de fréquences élevée ou d'autres changements.<br />
Ce sont de véritables micro jauge de contraintes, que la technologie n'arrive pas à égaler.<br />
8
EXPLORATION<br />
– sang , urine<br />
– spectrométrie<br />
TD biochimie LEVADE<br />
– variations chez le nouveau-né<br />
– stérilet cuivré, contraception orale, grossesse, infection<br />
peuvent augmenter la cuprémie = taux de cuivre<br />
Variations pathologiques<br />
normal Wilson Menkes<br />
Cu sérique (mmol/L) 11-24 3-10
– maladie de Menkes (et syndrôme de la corne occipitale)<br />
Transmission liée à l'X : les garçons vnt être atteints.<br />
1/250000<br />
gène = ATP7A transporteur de cuivre (atpase)<br />
sert à transporter le cuivre d'une cellule vers une autre mais pas dans les mêmes tissus.<br />
Il permet de faire sortir le cuivre de l'entérocyte pour le mettre dans la circulation. Si défaut, il reste<br />
dans l'entérocyte donc ne peut pas aller ds la circulation sanguine : il y a un défaut de cuivre, un<br />
manque.<br />
Symptomatologie: apparaît très précocément.<br />
Steely hair disease: anomalie de poils, phanères, cheveux couleur métal argenté.<br />
Trouble car dans la synthèse de mélanine, il faut du cuivre.<br />
Pb niveau collagène : pb articulaires.<br />
Atteinte neuro car cu est un cofacteur important.<br />
C'est une maladie systèmique sévère.<br />
Pas de traitement.<br />
– L'acéruloplasminémie<br />
anomalie génétique sur le gène codant pour la céruloplasmine.<br />
Elle intervient dans le métabolisme du fer.<br />
C'est une maladie exceptionnelle.<br />
-->> L'homéostasie du cuivre est très fortement régulée, Si il y en a trop ou pas assez :<br />
maladies très sévères.<br />
2
Anapath 4 Grégoire Courtiade<br />
Lundi <strong>27</strong> septembre Kévin Enard<br />
10h-11h<br />
Pr. Delisle<br />
E. 4. Atrophie tissulaire:<br />
Lésions élémentaires des tissus et organes<br />
(suite du cours précédant (oui oui!))<br />
Il s'agit d'une diminution de volume qui peut être:<br />
E. 5. Métaplasie:<br />
- physiologique (ex: atrophie thymique)<br />
- par hypoxie (ex: rein mal vascularisé)<br />
- d'inactivité (ex: muscle immobilisé)<br />
Transformation morphologique et fonctionnelle d'un tissu en un autre tissu, ce tissu étant de<br />
morphologie et de fonction différentes de celles du tissu initial:<br />
-métaplasie épithéliale (ex: bronches, col utérin)<br />
-métaplasie des tissus conjonctifs = métamorphose + métamorphisme (ex: tissu<br />
conjonctif non spécialisé devenant spécialisé (par exemple de l'os))<br />
L'une des conséquences est la présence d'un tissu a peu près normal dans sa structure mais<br />
anormal pour sa localisation (c'est une des formes d'ectopie).<br />
NB: les malformations sont des exemples d'hétérotopies ou ectopies.<br />
Ex: gastrite métaplasique intestinale due à l'helicobacter pilori: transformation de la<br />
muqueuse gastrique en muqueuse intestinale.<br />
E. 6. Nécroses tissulaires<br />
Il existe différents types de nécroses.<br />
=> Nécrose de liquéfaction (= malacie).<br />
-zone gris terne, pâteuse puis liquide.<br />
-nappes anhistes (sans cellule) faiblement colorées.<br />
- se voit surtout dans le tissu cérébral.<br />
=> Nécrose de coagulation ou d'homogénéisation.<br />
-foyer nécrotique blanc grisâtre, ferme ou semi solide.<br />
-débris cytoplasmiques acidophiles en magma parsemé de corps tingibles avec<br />
fantômes des structures préexistantes.<br />
ex: nécrose du rein et du cœur. 1
Variantes: nécrose caséeuse (aspect de fromage...), nécrose hémorragique (infarctus « rouge »),<br />
stéatonécrose (nécrose pancréatique en tâches de bougie), nécrose gangréneuse.<br />
E. 7. Dystrophies<br />
Déformation de l'architecture normale tissulaire consécutive à un trouble de la nutrition d'un<br />
tissu ou organe.<br />
-au cours du développement embryonnaire ou durant la vie.<br />
-phénomène complexe: hyperplasie, métaplasie, dégénérescence tissulaire.<br />
Ex: dytrophie mammaire (=mastopathie): -anomalie liée à des troubles hormonaux => seins<br />
plus durs, placard induré, petites granulation sous la peau.<br />
métaplasie canalaire.<br />
-fibrose du conjonctif mammaire, fibrose canalaire avec kyste,<br />
Nb: La dysplasie est d'origine génétique alors que la dystrophie est liée au milieu extérieur.<br />
2 phénomènes :<br />
II- Pathologie métabolique<br />
M. congénitales : rares, enzymopathie, maladie du lysosome, thésaurismose<br />
(« amasser des richesses »).<br />
M. acquises : relativement fréquentes.<br />
A. Surcharges LIPIDIQUES<br />
A. 1. Triglycérides: STEATOSE<br />
Vacuoles optiquement vides, de taille variable.<br />
Les gouttelettes lipidiques sont dissoutes par les techniques d'inclusion<br />
usuelles, d'où la nécessité de réaliser des coupes en congélation et des colorations<br />
spéciales.<br />
Mécanismes :<br />
i) Stéatose hépatique: -Hépatomégalie molle, foie jaunâtre.<br />
a. Apport excessif d'acides gras.<br />
-causes et mécanismes variés.<br />
b. Synthèse insuffisante des lipoprotéines par carence ou inhibition.<br />
c. Défaut d'excrétion des lipoprotéines.<br />
d. Défaut de synthèse des phospholipides.<br />
e. Diminution de la -oxydation des acides gras. 2
Causes :<br />
a. Anoxie hépatocytaire.<br />
b. Stéatose éthylique (diminution de la -oxydation des acides gras).<br />
c. Toxiques, médicaments.<br />
d. Causes nutritionnelles :<br />
. Obésité, diabète<br />
. Maladie carentielle (baisse des lipoprotéines) : kwashiorkor.<br />
e. NAFLD (Non Alcoholic Fatty Liver Desease): augmentation des glucides, augmentation<br />
des triglycérides, obésité abdominale liée à une surnutrition, sédentarité et résistance à l'insuline.<br />
ii) Stéatose extra-hépatique: Entérocytaire, myocardique.<br />
A. 2. Lipides complexes : DYSLIPIDOSES (maladie héréditaire +++)<br />
La surcharge peut intéresser diverses catégories de cellules; elle est en<br />
rapport avec une atteinte lysosomale.<br />
Différentes formes anatomocliniques sont observées avec des cibles privilégiées: foie,<br />
système nerveux, oeil, moelle osseuse.<br />
La traduction morphologique change en fonction du produit anormal accumulé:<br />
- maladie de Gaucher: histiocyte hypertrophié à noyau excentré, à cytoplasme strié<br />
(β-glucocérébrosidase, saposine C).<br />
- maladie de Fabry: grosse cellule à noyau non excentré, à cytoplasme spumeux,<br />
muriforme (α-galactosidase).<br />
- maladie de Tay-Sachs: grosse cellule à cytoplasme biréfringent, soudanophile<br />
(colorée par le rouge soudan) (hexosaminidase A).<br />
-maladie de Niemann-Pick type C (sphingomyelinase) viscérale ou neuroviscérale.<br />
3
Parasito-mycolobite 5 Kévin Courtiade<br />
Pr. Plutotforteaveccheveuxblancgrisâtres Grégoire Enard<br />
<strong>27</strong>/09/3010<br />
12h-11h<br />
Dermatophytes<br />
Dermatophyties ou Dermatophytoses<br />
Devant l'inutilité inutile de recopier ce cours nous allons simplement ajouter les (rares)<br />
commentaires (saignants) ne figurant pas sur les diapositives qu'a bêtement lu la prof. Veuillez<br />
agréez, madame monsieur, à l'expression de nos salutations les plus distinguées.<br />
« Les noms de dermatophytes (en italique sur les diapos) ne sont pas à savoir<br />
par coeur mais si on nous demande le nom d'un dermatophyte il faut savoir le<br />
dire»... oui c'est flou...<br />
=> il faut donc savoir les noms des dermatophytes!<br />
Diapo 2: -cosmopolites => il s'agit d'une notion épidémiologique<br />
- champignons filamenteux = mycélium<br />
nb: macroconidies: macro = grand (…) ; conidies = spores<br />
microconidies: micro = micro (!!!) ; conidies = sport<br />
Diapo 6: A: schéma de lésion arrondie erythémateuse squameuse (herpès circinée)<br />
B: parasitisme pilaire (ex: teigne)<br />
C: Onyxis: atteinte des ongles<br />
Diapo 7: Teigne = atteinte du cuir chevelu ou du cheveu par un dermatophyte<br />
La lampe de Wood est une lampe a UV.<br />
Diapo 11: -Teignes tondantes trichophytiques n'existent pas en France.<br />
- Wood négatif = les cheveux n'apparaissent pas fluo (au cas ou celui du fond qui<br />
dort aurait pas compris).<br />
Diapo 13: les teignes suppuratives ne sont pas du tout inter-humaines.<br />
Diapo 17: le Trichophyton rubrum n'est pas un agent de teigne.<br />
Diapo 20: La lésion hyperkératosique épaissit la peau. 1
Diapo 24: En bas a droite: Leuconychie superficielle (sur l'ongle, facile a traiter)<br />
Les 3 autres: onychomycose unguénale (sous l'ongle)<br />
Diapo 28: - Griseofulvine: prescription uniquement chez l'enfant (traitement dure entre 4 et 8<br />
semaines).<br />
- LAMISIL°: pas d'AMM pour traiter les teignes chez l'enfant.<br />
2
Biochimie 5 DALUZ Laurent<br />
28/09/2010 de 9h à 10h CATALA Hélène<br />
Pr Levade<br />
METABOLISME GLUCIDIQUE ET EXPLORATION<br />
RAPPELS<br />
Ce cours est un cours de rappel et d 'introduction pour le cours de biochimie 6.<br />
Les pathologies du métabolisme glucidique ont une place importante en santé publique.<br />
Ex: le diabète touche environ 2 millions de personnes en France<br />
I-PHYSIOLOGIE ET BIOCHIMIE<br />
1°) Introduction des sucres dans les voies métaboliques<br />
=>Il est important de noter que l'apport glucidique se fait principalement par l'alimentation.<br />
a)Origine<br />
-EXOGENE: (200-300g/jr)=1/2 des apports sous diverses formes:<br />
.sucres simples: galactose,fructose(=fruits)...<br />
.diosides: saccharose(glucose+fructose), lactose(glucose+galactose)<br />
.polyosides: amidon<br />
• Les glucides d'origine exogène vont alors subir:<br />
1.une hydrolyse salivaire via l'amylase puis une hydrolyse intestinale(majeure).<br />
2.une absorption intestinale via des transporteurs actifs qui arrivent par la<br />
circulation porte pour métaboliser les glucides.<br />
-ENDOGENE: lors de la période post prandiale et du jeûne.<br />
• Celle-ci s'exerce par 2 mécanismes:<br />
-la glycogénolyse: dégradation du glycogène=forme de stockage.<br />
-la néoglucogénèse: synthèse de glucose à partir de sources non glucidiques(lipides<br />
et protéines).<br />
• TOUS les tissus consomment du glucose+++ ,mais de manière différente:<br />
-aérobie: SNC=glucodépendant<br />
-anaérobie: GR<br />
Rq: la dépendance des tissus pour le glucose a un rôle majeur dans le contrôle de la glycémie. 1/9
)Diffusion transmembranaire du glucose<br />
• =>diffusion facilitée selon un gradient de concentration grâce aux GLUT(=transporteurs du<br />
glucose)<br />
Transporteurs Distribution tissulaire Km Diffusion du glucose<br />
GLUT 1 et 3 Ubiquitaire 1mM Période post-prandiale<br />
et jeûne<br />
GLUT 2 -Le plus important+++<br />
-Exprimé à la fois dans<br />
les cellules bêta<br />
pancréatiques et les<br />
hépatocytes<br />
GLUT 4 -Régulé par l'insuline<br />
au niveau du muscle et<br />
du tissu adipeux<br />
-Permet une action<br />
hypoglycémiante(insuli<br />
ne:captation du glucose<br />
par les muscles)<br />
GLUT 5 intestin+rein<br />
15-20mM Période d'absorption<br />
• GLUT: absorption du glucose quelque soit la valeur de la glycémie+++<br />
c)Phosphorylation du glucose= Glc-6-P<br />
• Glu-6-P est un intermédiaire métabolique.<br />
• Phosphorylation par:<br />
-l'hexokinase (non spécifique): ubiquitaire .<br />
-la glucokinase: exprimée dans les hépatocytes et les cellules bêta pancréatiques<br />
=enzyme clé de l'utilisation du Glu<br />
.activité allostérique dans les cellules bêta pancréatiques.<br />
.activité transcriptionnelle par l'insuline dans les hépatocytes.<br />
2/9
Hépatocytes sang cellules bêta pancréatiques<br />
transcription < R< insuline < insuline<br />
glucokinase<br />
granules<br />
calcium<br />
GLUT2 GLUT2 GK<br />
Glu-6-P Glu > Glu-6-P<br />
Glu<br />
• Au niveau de la cellule bêta et de l'hépatocyte:<br />
-Après avoir absorbé le Glu: la glycémie augmente.<br />
-GLUT 2 va alors transporter le glucose dans la cellule bêta pancréatique où il va être<br />
phosphorylé par la glucokinase pour se transformer en GLC-6-P qui va alors activer<br />
la glycolyse anaérobie entraînant la production d'ATP et ainsi indure une cascade<br />
d'évènements qui vont aboutir à l'expulsion par la cellule bêta de l'insuline dans la<br />
circulation sanguine.<br />
• La sécrétion d'insuline va indure une fixation de celle-ci au niveau de ses récepteurs<br />
localisés sur l'hépatocyte. Cette fixation est alors responsable d'une réponse<br />
transcriptionnelle qui touche la glucokinase. Parallèlement le glucose va entrer via les<br />
GLUT 2 dans l'hépatocyte qui va alors être phosphorylé en GLC-6-P.<br />
2°)Les grandes voies du métabolisme glucidique<br />
• Le glucose peut prendre plusieurs voies métaboliques.<br />
Apres phosphorylation en GLC-6-P,il peut suivre :<br />
-la voie de la glycolyse<br />
-la voie des pentoses phosphates<br />
-la voie de stockage sous forme de glycogène<br />
-ou bien redevenir du glucose<br />
<<br />
3/9
a)Le métabolisme du glycogène: glycogenèse et glycogénolyse<br />
• Glycogène:<br />
forme de réserve glucidique(chez les animaux) cytoplasmique au niveau du foie<br />
et des muscles squelettiques:<br />
-synthèse: glycogénèse<br />
-dégradation: glycogénolyse<br />
GLUCOSE<br />
GLC-6-P<br />
GLC-1-P<br />
GLYCOGENE<br />
-au niveau du muscle: GLYCOGENOLYSE=>production d'énergie lors de<br />
l'effort(contraction musculaire).<br />
glycogène--->glu-6-P<br />
-au niveau du foie: GLYCOGENOGENESE=>stockage pour mettre en réserve le<br />
glucose que l'on pourra relarguer dans le sang circulant via la<br />
glycolyse en dehors des repas.(voie métabolique qui ramène du<br />
glu-6-P)<br />
b)La glycolyse(voie d'Embden-Meyerof)<br />
Description:<br />
• Elle a lieu partout, notamment dans les cellules sans mitochondries(GR++).<br />
• Voie d'oxydation anaérobie du glucose.<br />
• Prédomine si la cellule fonctionne en hypoxie ou en anoxie.<br />
• Donne du pyruvate<br />
->ce pyruvate va se transformer et passer dans la voie aérobie et aller dans les<br />
mitochondries pour alimenter le cycle de Krebs.<br />
La réaction de fermentation hémolactique:<br />
• conversion du pyruvate en acide lactique grâce à la LDH.<br />
• réaction essentielle qui permet la production de NAD+ et la reconstitution de NAD+<br />
nécessaire pour faire tourner la glycolyse.<br />
• a lieu majoritairement dans le muscle squelettique en contraction:<br />
=>production de beaucoup de lactate. 4/9
c)La voie des pentoses phosphates.<br />
• Source majeure de NADPH+H+ (qui a un pouvoir réducteur très important) :<br />
-NADPH: très important pour réduire certaines molécules(important par exemple<br />
pour la synthèse des AG et des stéroïdes).<br />
-H+: réservoir de protons nécessaire pour réduire un certain nombre de molécules<br />
exerçant un cytotoxisme via les radicaux libres.<br />
d)Néoglucogénèse.<br />
Def=production de glucose à partir de sources non glucidiques.<br />
• Au niveau du foie et du rein<br />
• Sources non glucidiques:<br />
.lactate (--->pyruvate-->oxaloacétate...)<br />
.acides aminésglucoformateurs (alimentent des intermédiaires du cycle de krebs)<br />
.lipides (glycérol)<br />
• Permet l'export de glucose dans le sang pour permettre de maintenir la glycémie lors du<br />
jeûne(apport de glucose au SNC, au muscle, à la glande mammaire).<br />
e)Métabolisme du galactose.<br />
• GAL: un des constituants du lactose(glc+gal).<br />
• Le lait nourrit les nourrissons dès les 1eres heures de vie.<br />
uridine transferase galactosémie<br />
Gal-------------->Gal-1-P---------------->UDP-Gal<br />
Glu-6-P
PATHOLOGIES:(graves)<br />
• Les galactosémies (congénitales ou héréditaires) qui sont des pathologies dues à des déficits<br />
enzymatiques(uridine tranférase)dans le métabolisme du galactose.<br />
• Insuffisance hépatocellulaire et cataracte:maladie qui s'installe vite.Elle est due au fait<br />
qu'un intermédiaire du galactose va donner du galacticol qui est à l'origine de la<br />
dégénérescence du cristallin.<br />
f)Métabolisme du fructose.<br />
• Retrouvé dans les fruits, le miel, le saccharose.<br />
• Dans le muscle: Fructose-------->Fru-1-6-P------->glycolyse<br />
• Dans le foie et la cellule bêta pancréatique:<br />
Fru fru-1-P<br />
glycolysedéficit d'utilisation du fructose comme source d'énergie.<br />
3°)Voies de régulation du métabolisme du GLUCOSE.<br />
=>flux régulés selon les circonstances nutritionnelles et métaboliques par la glycémie.<br />
La régulation de la glycémie est nécessaire selon les efforts,le repos, le jeûne...<br />
• Régulation par:<br />
-les modifications covalentes des enzymes<br />
-les modifications allostériques<br />
• un système hypoglycémiant:<br />
l'insuline<br />
-produite par les cellules bêta pancréatiques des îlots de Langherans.<br />
-gène(chromosome 11)-->pré-pro-insuline-->pro-insuline-->insuline bicaténaire + peptide C<br />
-configuration spatiale: hexamère+Zn2+<br />
=immunogénicité(reconnue par le système immunitaire)<br />
• pas de système hyperglycémiant(sauf en cas d'urgence cf plus loin)<br />
6/9
Sécrétion d'insuline:<br />
-stimulée par l'augmentation de la glycémie(hyperglycémie).<br />
-stimulée par:<br />
-inhibée par:<br />
1-augmentation de la glycémie qui va aller stimuler les cellules bêta<br />
2-entrée du glucose par GLUT 2<br />
3-transformation GLC-->Glu-6-P par la glucokinase<br />
4-Glu-6-P suit la voie de la glycolyse qui aboutit à la production d'ATP<br />
5-l'ATP entraîne une cascade d'évènement:<br />
.fermeture des canaux k+<br />
.dépolarisation membranaire<br />
.ouverture des canaux Ca2+<br />
.activation des protéines kinases<br />
.contraction des microfilaments<br />
.expulsion des granules d'insuline par exocytose<br />
=>insuline dans la circulation<br />
Rq:il y a 50 ans on utilisait les sulfamides pour leur fonction hypoglycémiante<br />
(fermeture des canaux K+)<br />
.les incrétines:Gastric Inhibitory Peptide et Glucagon-Like peptide 1<br />
mis en évidence lors de la mesure de la concentration d'insuline<br />
libérée dans le sang en 2 conditions:<br />
-injection de Glu dans le sang<br />
-prise de Glu par voie orale<br />
.le mannose,la leucine<br />
.la GH,les glucocorticoïdes<br />
.la somatostatine<br />
.les catécholamines<br />
Biosynthèse stimulée par:<br />
.le glucagon<br />
.la cholécystokinine<br />
conclu=>concentration d'insuline plus importante quand on avale le<br />
sucre que quand on l'injecte. Cela est dû à la libération<br />
d'incrétines lors du passage du bol alimentaire dans le tube<br />
digestif.<br />
7/9
Effet biologique:se lie sur son récepteur membranaire à activité tyrosine kinase.<br />
2 sous unités alpha=extracellulaires<br />
2 sous unités bêta=transmembranaires comprenant le domaine tyrosine kinase<br />
qui s'autophosphoryle lors de la fixation de l'insuline ce<br />
qui entraîne une cascade de réaction qui aboutit à<br />
à l'augmentation de la transcription de certains gènes qui<br />
ont un effet sur les voies métaboliques.<br />
Action: sur le foie, le tissu adipeux, les glandes mammaires et les muscles.<br />
=>stimule la captation du glucose sauf au niveau du foie+++<br />
=>elle est hypoglycémiante, diminue les AG libres et augmente la lipogénèse.<br />
Tissus cibles Effets Effets sur la concentration dans<br />
le sang<br />
Foie<br />
muscle<br />
Augmente la captation du<br />
glucose<br />
SAUF AU NIVEAU DU<br />
FOIE+++<br />
Diminution du glucose et les<br />
AG libres<br />
Tissu adipeux Augmente la glycolyse Diminution des corps<br />
cétoniques<br />
Glande mammaire -Augmentation de la synthèse<br />
de glycogène,lipides,protéine.<br />
-Diminution de la<br />
glycogénolyse et de la<br />
néoglucogénèse.<br />
-Diminution de la lipolyse.<br />
Diminution des acides aminés<br />
8/9
• Système hyperglycémiant: SYSTEME DE L URGENCE<br />
-hormones de l'urgence:<br />
.GLUCAGON:-sécrétée par les cellules alpha des îlots de Langherans.<br />
-29 AA<br />
-sécrétion stimulée par l'hypoglycémie.<br />
-se fixe sur son récepteur: couplé à une protéine G-->activation<br />
de l'adénylate cyclase-->production d'AMPc-->activation de la<br />
Pka-->régulation transcriptionnelle. N'agit pas sur les muscles<br />
mais sur le foie et le tissu adipeux.<br />
==>dégradation du glycogène hépatique.<br />
-protéine phosphorylée<br />
-stimule la néoglucogénèse: augmentation de la glycolyse, de<br />
la cétogénèse et diminution de la lipogénèse.<br />
-au niveau des cellules bêta :<br />
.augmentation de la synthèse d'insuline(qui permet déjà<br />
un effet correcteur).<br />
.CATECHOLAMINES:-augmentent la glycogénolyse hépatique ET<br />
musculaire.<br />
-diminution de la sécrétion d'insuline.<br />
-hormones à action plus progressive:<br />
.GLUCOCORTICOIDE:-augmentation de la néoglucogénèse et lipolyse.<br />
-diminution de la protéolyse.<br />
.GH<br />
9/9
Anapath 6 ZAPATA Emilie<br />
30/09/10<br />
10h à 11h<br />
B. Surcharges glucidiques<br />
B.1. Glycogène<br />
II- PATHOLOGIE METABOLIQUE<br />
Les surcharges en glucides par accumulation de glycogène donnent des aspects très<br />
particuliers. Il y en a 2 types : acquises ou secondaires.<br />
La cellule sera hypertrophiée, d'aspect végétal (cellule quadrangulaire à renforcements<br />
périphériques) et colorée électivement en rouge par le PAS.<br />
Cela peut se retouver dans des maladies acquises, des tumeurs et des maladies congénitales. Dans<br />
ce dernier cas, la surcharge affecte surtout les hépatocytes, les cellules musculaires striées et les<br />
cellules de l'épithélium rénal.<br />
Le retentissement morphologique est variable.<br />
2 exemples :<br />
- glycogénose de type 2 : ou maladie de POMPE ou déficit en maltase acide<br />
cette maladie a une révélation néonatale et se traduit par un déficit en α-glucosidase<br />
un des signes cliniques est une cardiomégalie sans hypoglycémie (glycémie normale)<br />
on observera dans les cellules du coeur et du foie une accumulation de glycogène avec des<br />
structures pseudomyéliniques<br />
on verra donc au ME des cellules de grosses tailles, d'aspect hétérogènes, avec des vacuoles<br />
et un matériel accumulé granuleux ; la présence de formations arrondies de membrane est<br />
ce que l'on appelle les structures pseudomyélinique (reflet de phénomènes d'autophagie)<br />
cette maladie peut aussi se révéler tardivement et avoir une traduction neuro-musculaire<br />
- glycogénose de type 5 : ou maladie de Mc ARDLE<br />
elle est caractérisée par un déficit en phosphorilase<br />
la symptomatologie est variée mais on retiendra surtout une fatigue musculaire à l'effort<br />
(trouble du fonctionnement de la fibre musculaire et de la disponibilité en glycogène)<br />
ATTENTION la biopsie du tissus musculaire sera quasi normale, en effet il n'y a pas de<br />
surcharge nette ; donc le diagnostic ne peut se faire que par histoenzymologie<br />
B.2. Mucopolysaccharides<br />
L'anapath sera peu sollicitée pour le diagnostic.<br />
On observera ici :<br />
– Des anomalies du squelettte, notamment des malformations faciales. On parlera de<br />
GARGOYLISME (enfants avec têtes de gargouilles).<br />
– Un nanisme<br />
– Des lésions cérébrales plus ou moins létales<br />
Mais ce type de maladie est tout de même très rare.<br />
1
B.3. Glycoprotéines : ex mucus<br />
Dans la mucoviscidose on aura une surcharge en protéines.<br />
C'est une maladie récessive autosomique (1/2000 naissances, donc très fréquent). On peut le<br />
détecter mais le diagnostic ne se fera pas sur l'anapath.<br />
On aura de nombreuses anomalies cliniques :<br />
– maladie fibrokystique du pancréas qui se traduit par de nombreux troubles digestifs<br />
(malabsorption; diarrhées)<br />
– cela peut être extrèmement grave si c'est associé à l'iléus méconial du nouveau né : occlusion<br />
intestinale liée à l'accumulation de méconium (selles du nouveau né)<br />
doit être traité dessuite<br />
– atteinte broncho pulmonaire : anomalies de la paroi bronchique, de la muqueuse, anomalies<br />
dans les échanges ioniques → susceptibilité accrue pour les infections bronchiques<br />
C. Accumulation de pigments<br />
Ou infiltrations : présence dans les tissus d'une substance qui ne doit pas y être<br />
C.1. Hémosidérose<br />
C'est l'accumulation dans les tissus de FER provenant du sang. C'est donc un phénomène secondaire<br />
à la lyse des hématies.<br />
On aura des dépôts denses intracellulaire d'homosidérine, jaune-bruns, granulaires, bleus après la<br />
coloration de Perls.<br />
2 types :<br />
– Localisée, dans 99 % des cas<br />
la plus banales est celle secondaire à une contusion : hématome qui évoluera vers plusieurs<br />
couleurs puis réaction inflammatoire liée à l'action des macrophages.<br />
– Généralisée<br />
liée à une anomalie sanguine exceptionnelle (accident de transfusion)<br />
C.2. Hémochromatose<br />
C'est une maladie génétique autosomique récessive généralisée, le gène incriminé étant le<br />
gène HFE.<br />
Le fer s'accumulera à la fois dans les cellules conjonctives et épithéliales.<br />
Les complications sont multiples : cirrhose hépatique, diabète sucré, mélanodermie, arthralgies.<br />
C.3. Surcharge biliaire<br />
Pigment jaune vert, granulaire.<br />
On utilisera la technique de Hale : coloration verte.<br />
Signes cliniques : ictère (la première localisation est l'oeil), cholestase hépatique avec formation de<br />
calculs.<br />
2
Introduction<br />
III- INFLAMMATION<br />
C'est l'ensemble des phénomènes réactionnels se produisant au sein du tissus conjonctif à la suite<br />
d'une lésion.<br />
Il y a :<br />
– plusieurs phases<br />
– plusieurs phénomènes : locaux (commence par un panaris)<br />
régionaux (atteint le bras)<br />
généraux (atteinte générale avec septicémie)<br />
Ces phénomènes se développent en synergie.<br />
Réaction : mécanisme de défense (maintient de l'homéostasie) : cellules / médiateurs<br />
Tissus conjonctif : territoire de la réaction inflammatoire ; pas d'inflammation si atteinte<br />
superficielle de l'épithélium.<br />
Lésion : causes endogènes (mécanisme auto-immun par exemple)<br />
↨ Agression<br />
causes exogènes<br />
Les agents phlogogènes sont les substances susceptibles de provoquer une réaction inflammatoire.<br />
Inflammation n'est pas synonyme d'infection. L'infection est une inflammation septique.<br />
Le phénomène inflammatoire est ambivalent, il est parfois nocif. Il peut créer des maladies<br />
inflammatoires (PR, Cohn, RCH).<br />
3
Biochimie 6 ZAPATA Emilie<br />
30/09/10<br />
11h à 12h<br />
EXPLORATION FONCTIONNELLE HEPATIQUE<br />
Toutes les diapos du cours sont dans la ronéo de la semaine dernière.<br />
I- Fonctions hépatiques<br />
Tout ce qui est excrété par le foie est éliminé au niveau du cholédoque qui traverse le pancréas.<br />
Donc tout ce qui bloque l'écoulement retentit sur le foie.<br />
Dans le lobule hépatique on a les veines qui circulent dans un sens et la bile qui va repartir dans<br />
l'autre. Il y a des échanges au niveau des hépatocytes. En effet le foie est l'organe épurateur de<br />
l'organisme.<br />
A- Fonctions excrétrices<br />
1. Fonctions biliaires<br />
a) Pigments biliaires<br />
Le pigment biliaire dans le sang est la bilirubine. Elle s'éliminera dans les urines sous forme<br />
d'urobilinogène et d'urobiline et dans les selles sous forme de stercobilinogène – stercobiline. Ce<br />
sont ces pigments qui donneront aux urines et aux selles leur coloration.<br />
Ces pigments biliaires viennent de la rate à 80 % par dégradation des globules rouges et de<br />
protéines donnant des molécules à structure héminiques (cytochromes, myoglobine).<br />
L'hème dégradé libère la globine et le fer.<br />
Au niveau du sang la bilirubine va se lier à l'albumine. Puis elle sera conjuguée au niveau du foie et<br />
deviendra soluble. Son élimination se fera pas les voies biliaires. En arrivant au niveau du tube<br />
digestif elle subira des transformation par la flore bactérienne et deviendra stercobilinogène et<br />
stercobiline qui donnent la coloration aux selles. Une partie subira le cycle entéro hépatique et<br />
l'autre subira une élimination urinaire qui va donner l'urobilinogère et l'urobiline qui donnent la<br />
coloration à nos urines.<br />
Si la bilirubine reste dans le sang on aura ce que l'on appelle un ictère (coloration jaune de la<br />
peau). Le signe clinique qui va suivre est le prutit lié à l'accumulation de sels biliaires.<br />
Rq : quand un patient a un ictère il faut procéder à un examen des selles, qui seront décolorées (car<br />
absence de stercobiline), et à un examen des urines, qui elles seront foncées. En effet il y aura un<br />
retour par la voie entéro hépatique des pigments.<br />
Il y a 3 pathologies qui font que la bilirubine sera augmentée :<br />
– avant le foie, la bilirubine est non conjuguée insoluble dans l'eau et liée à l'albumine ; elle sera<br />
produite en très grandes quantités en cas d'hémolyse<br />
– au niveau du foie, les hépatites et les cirrhoses vont bloquer le métabolisme de la bilirubine en<br />
bloquant le fonctionnement du foie (lyse des cellules)<br />
– post foie : l'élimination est bloquée, on parle de pathologies de rétention ; ici ce sera la<br />
bilirubine conjuguée qui sera élevée 1
) Sels biliares<br />
Dérivent du cholestérol synthétisé au niveau du foie ; puis formation d'acides (cholique<br />
etc...) qui se conjugueront soit avec la taurine soit avec le glycocolle pour donner les acides biliaires<br />
conjugués.<br />
Ils se retrouvent dans la bile et favorisent la solubisation des lipides et l'hydrolyse de la lipase<br />
pancréatique.<br />
Une partie de ces sels biliaires sera éliminée et l'autre subira un cycle entéro hépatique et pourra être<br />
réutilisée.<br />
c) Enzymes de cholestase<br />
Voir schéma « localisation sub cellulaire ».<br />
On remarque que les phosphatases alcaline (PAL), les gammas GT et la 5'NU ont une localisation<br />
membranaire alors que ALAT, ASAT, LDH et CK se trouvent à l'intérieur de la cellule ; ce sont les<br />
transaminases.<br />
Donc si un calcul bloque le cholédoque et que la bile ne peut s'écouler il y aura une compression<br />
des hépatocytes et les premières enzymes libérées seront celles de la membrane. En cas de<br />
cholestase on dosera ainsi en premier les PAL et les gammas GT, qui seront plus élevées que la<br />
normale.<br />
Les transaminases seront elles retrouvées très élevées en cas de lyse cellulaire (hépatites par<br />
exemple).<br />
A retenir :<br />
- cholestase qui comprime la membrane<br />
- cytolyse qui libère le contenu cellulaire<br />
2. Fonction d'épuration plasmatique<br />
a) Ammoniémie<br />
Les protéines de l'alimentation sont à l'origine du pool d'acides aminés qui vont permettre à<br />
l'organisme de fabriquer des protéines.<br />
Quand ils seront dégradés par désamination oxydative ils libèreront de l'ammoniac qui sera éliminé<br />
par le foie grâce au cycle de l'urée.<br />
Si le catabolisme des acides aminés est augmenté il faudra augmenter l'élimination de l'ammonium<br />
par le cycle de l'urée ; ce qui ne se fera pas correctement chez une personne avec un foie atteint et<br />
sera à l'origine de nombreuses complications.<br />
Attention, l'ammonium est aussi produit par l'intestin.<br />
L'ammonium vient donc du catabolisme des tissus périphériques, est capté par le glutamate puis<br />
véhiculé dans l'organisme sous forme de glutamine.<br />
La glutamine relarguera l'ammonium au niveau du foie et se retransformera en glutamate.<br />
Il y a aussi une voie d'élimination rénale.<br />
Interprétation biologique<br />
Pour mesurer la quantité d'ammonium on utilise des techniques enzymatiques avec détection aux<br />
UV. Il est important de retenir qu'on utilise du NADH qui se transformera en NAD+ et on mesurera<br />
cette transformation qui est proportionnel à la quantité d'ammonium.<br />
C'est donc une mesure indirecte. 2
Le dosage doit être éffectué de façon stricte car de nombreux facteurs peuvent perturber les dosages<br />
(cigarette, air ambiant...).<br />
Ammoniémie<br />
Le taux normal est inférieur à 50 μmol/L<br />
Mais le prélèvement ne doit pas être hémolysé. On doit prélever sur EDTA (mauve) et héparine<br />
(vert), c'est à dire que c'est un plasma.<br />
Rappel :<br />
- le sérum est ce que l'on obtient sur tube sec<br />
- le plama est ce que l'on obtient avec anti-coagulant<br />
Il faut aussi mettre le prélèvement dans la glace pour arrêter la multiplication bactérienne, ce qui<br />
relarguerait à tort de l'ammonium.<br />
Enfin l'analyse doit être faite rapidement.<br />
On aura à sueveiller l'ammoniémie chez le nouveau né lors de troubles métaboliques du cycle de<br />
l'urée. Chez l'adulte c'est plutôt lors de troubles hépatiques (hépatites, cirrhoses).<br />
Ammoniurie<br />
C'est à dire le taux d'ammonium dans les urines. Ici les conditions sont plus difficiles car l'analyse<br />
doit se faire sur des urines de 24h après ajout d'HCl (pour éviter la contamination bactérienne).<br />
Indispensable dans certaines pathologies rénales pour évaluer les acidoses rénales de façon<br />
spécifique.<br />
Hyperammonémies<br />
Elles peuvent conduire à un coma ou des troubles de la conscience (patient confus).<br />
En fait il y aura accumulation de glutamine au niveau des astrocytes ce qui entrainera un oedème<br />
cérébral.<br />
Rappel cycle de l'urée<br />
Voie clée : celle de l'OCT (enzyme 3 sur le schéma) ; car mutations chez l'enfant causant des<br />
pathologies gravissimes.<br />
L'urée est soluble et filtrée dans le rein : élimination de 2 molécules de NH.<br />
Si foie cirrhotique la fonction épuratrice sera bloquée. Le sang va remonter et on aura ainsi une des<br />
complicaitons de la cirrhose : les varices oesophagiennes. Cela va entrainer une hémorragie et donc<br />
hémolyse et création de NH3. Celui ci ne pouvant pas être éliminé au niveau du foie, il va aller dans<br />
tous les tissus et en particulier au niveau du SNC : toubles neurologiques.<br />
2 types de comas :<br />
– celui dû aux hépatites fulminantes aigues<br />
– celui dû à la cirrhose<br />
Le seul traitement est la greffe hépatique en urgence.<br />
b) Epreuve à la BSP<br />
Ne se fait plus.<br />
Epreuve fonctionnelle.<br />
3
3. Fonction de détoxification et de conjugaison<br />
Le foie enlève les molécules avec un noyau benzoique qu'il éliminera sous forme d'acide<br />
purique qui s'élimine dans le rein.<br />
Il modifie aussi les hormones et conjugue certains éléments pour fabriquer des hormones ou de la<br />
bilirubine.<br />
Tous les médicaments ont un métabolisme qui passe par le foie et le plus souvent par le<br />
cytochrome P450. Une fois que le médicament est conjugué il devient soluble dans la bile et passe<br />
ainsi dans les voies d'élimination. Donc TOUS les médicaments ont une certaine toxicité.<br />
Un cycle entéro hépatique peut aussi se produire.<br />
B- Fonctions métaboliques<br />
Elles seront perturbées en cas d'insuffisance hépato cellulaire (stade avancé de la<br />
pathologie).<br />
Le foie est un organe capable de se régénérer, c'est ce qui permet de faire des transplantations.<br />
1. Glucidiques<br />
La glycémie diminue dans les grandes destructions hépatiques car le glycogène ne peut plus être<br />
stocké.<br />
2. Lipidique<br />
Le cholestérol est synthétisé par le foie.<br />
Au début de la pathologie, dans le cadre de cholestases, on peut avoir une augmentation de la<br />
synthèse de cholestérol.<br />
Mais quand il ne reste plus de foie fonctionnel, au contraire, on aura une diminution du cholestérol.<br />
C'est donc de très mauvais pronostic quand le cholestérol est très bas.<br />
La LCAT transforme le cholestérol en cholestérol estérifié et le cholestérol avec les TG vont<br />
être les constituants des lipoprotéines.<br />
3. Protéique<br />
En cas d'insuffisance hépato cellulaire, les protéines seront atteintes un peu avant par rapport<br />
aux glucides et aux lipides.<br />
a) Protéines totales<br />
La protéine principale est la sérum-albumine (60%). Elle est synthétisée au niveau du foie et<br />
sera le reflet de la biosynthèse hépatique. On la recherchera à un stade avancé de la pathologie (ex :<br />
cirrhose), ce n'est donc pas un examen de première intention. Dans ce cas, elle sera diminuée.<br />
b) Facteurs de la coagulation<br />
Ils sont aussi synthétisés au niveau du foie et seront diminués en cas d'insuffisance hépato<br />
cellulaire ou de cholestase. On peut les apprécier grace au temps de QUICK (TQ) qui sera ici<br />
augmenté. Mais attention si on ramène ce TQ par rapport à témoin, il sera diminué...<br />
Les facteurs de la coagulation VIT K dépendants (2, 7, 9 et 10) seront encore plus diminués. En<br />
effet la VIT K est elle même synthétisée dans le foie. 4
c) Electrophorèse des protéines<br />
C'est un examen de dépistage que l'on fait en routine. Il nous donne une orientation diagnostique.<br />
Dans le cadre d'une pathologie hépatique, on aura une augmentation des γ globulines. C'est le reflet<br />
d'infection.<br />
On peut voir les α1 α2 dans les tumeurs malignes ; mais ce n'est pas très spécifique.<br />
Par contre le bloc βγ est caractéristique de la cirrhose alcoolique.<br />
d) Schémas<br />
Métabolisme des glucides et foie<br />
On stocke le glycogène au niveau du foie, donc en cas d'insuffisance hépato cellulaire, on aura une<br />
diminution de la glycémie et une augmentation des lactates.<br />
Relation glucides – acides aminés<br />
Les transaminases interviennent quand il y a lyse de la cellule.<br />
Rq : ASAT = TGO<br />
ALAT = TGP<br />
Ces 2 enzymes se retrouvent dans le métabolisme de l'hépatocyte.<br />
Le glutamate se couple au NH3 pour donner la glutamine qui permet donc de transporter<br />
l'ammonium.<br />
Le fois participe donc à la synthèse et au catabolisme des protéines.<br />
Lors de la cytolyse, les transaminases passent dans le sang et par leur dosage on peut donc évaluer<br />
la lyse hépatique.<br />
Métabolisme des lipides et foie<br />
Rappel : au début de la stéatose augmentation du cholestétol ; et diminution quand grands troubles<br />
hépatiques (mauvais pronostic).<br />
Métabolisme protéique hépatique<br />
Le foie fabrique un grand nombre de protéines ( sérum-albumine, facteurs de la coagulation,<br />
protéine de l'inflammation comme la RBP, protéines hépatiques, protéines de la matrice).<br />
Dans la coagulation il y a 2 voies : la voie extrinsèque et la voie intrinsèque. On explore par 2 temps<br />
qui sont fait en routine : le TQ et le temps de céphaline activée. Ils mesurent 2 facteurs de la<br />
coagulation différents.<br />
En conjuguant ces 2 temps on peut estimer le stade de l'insuffisance hépato cellulaire.<br />
S'ils sont déficitaires il y a risque d'hémorragie. Le TQ ne doit donc pas être inférieur à 50%.<br />
c) Recherche d'une cytolyse<br />
C'est la destruction des hépatocytes ou les trouble de la perméabilité. Dans les 2 cas on retrouvera<br />
les enzymes dans le sang circulant.<br />
ALAT est plus spécifique du foie que ASAT car celle ci est présente en grande quantité dans le<br />
muscle cardiaque et augmente donc aussi en cas de lésion cardiaque.<br />
Dans la cytolyse on a également une libération d'OCT, mais cette enzyme est non dosée. 5
La LDH est non spécifique car présente dans de multiples organes.<br />
Au contraire la cholinestérase est très spécifique et surtout dosée lors d'intoxications.<br />
Enfin, puisqu'il y a une lyse le fer sera augmenté (atome de fer au niveau de l'hème).<br />
II- Tests hépatiques<br />
Les normes sont fonctions de la température! Donc attention lors du suivi des patients.<br />
Normes à 37°C<br />
• Bilirubine sérique 2 à 17 μmol/L<br />
• Transaminases 5 à 50 UI<br />
• γ GT 10 à 60 UI<br />
• Phosphatases alcaline<br />
(osseuses et hépatiques donc différent chez l'enfant et l'adulte)<br />
Bilirubine<br />
Le taux normal est inférieur à 20. On peut arriver à voir chez certains patients un subictère<br />
(jaunissement de la conjonctive de l'oeil à partir de 30). Selon que la bilirubine est conjuguée ou<br />
non conjuguée on peut arriver a voir quel est le type d'ictère.<br />
Transaminases (TGP)<br />
Signe une cytolyse hépatique. On peut les retouver dans de multiples affections (hépatite, nécroses<br />
ischémiques du foie etc...)<br />
γ GT<br />
Comme les phosphatases alacalines interviennent dans la cholestase.<br />
Peuvent être élevées dans les hépatites mais surtout signe de l'alcoolisme chronique.<br />
Mais c'est aussi le 1er marqueur des métastases d'un cancer secondaire.<br />
Enfin premières sensibles aux médicaments.<br />
Phosphatases alcalines<br />
C'est un des marqueurs de la cholestase.<br />
Origine hépatique et osseuse.<br />
Electrophorèse des protéines sériques<br />
γ globulines augmentées lors des hépatites et des cirrhoses.<br />
bloc βγ caractéristique des cirrhoses.<br />
5' Nucléotidase<br />
Spécifique mais non utilisée.<br />
LDH<br />
Non spécifique car présente dans le foie, le coeur, le rein et le muscle.<br />
Nous donne une orientation diagnostique.<br />
Autres<br />
Interprétation<br />
Si un seul de ces tests est perturbé, la conduite à tenir est de recontrôler. Il faut au moins 2 tests<br />
perturbés pour envisager une lésion.<br />
6
Résumé EFH<br />
Cholestase bilirubine ↑<br />
PAL >3N<br />
γ GT >3à4N<br />
Cytolyse transaminases >10N<br />
Insuffisances hépato cellulaires protéines ↓ et TQ modifié<br />
Inflammation CRP ↑<br />
Il existe d'autres tests :<br />
– immunologique<br />
– biochimique<br />
– radiologique<br />
– anatomopathologique<br />
Enfin, pour interpréter un bilan, il faut tenir compte des conditions préanalytiques et analytiques<br />
(voir diapo).<br />
7
ANAT SN 9&10 Camille Valdeyron<br />
Pr Chaynes Agathe ZK<br />
le 01/10/2010<br />
Le cours a commencé par une petite séance de réponse aux questions concernant les cours<br />
précédents.<br />
Réponse aux questions :<br />
● Les artères vertébrales donnent les 4 artères spinales :<br />
- 2 spinales ventrales<br />
- 2 spinales dorsales<br />
Les artères radiculaires naissent à chaque étage et longent les racines des nerfs spinaux .<br />
Il y en a 31 de chaque côté : donc 62 en tout.<br />
Sur ces 62, une dizaine deviennent radiculo-medullaires.<br />
Une artère radiculaire ne vascularisera jamais la moelle épinière. Celles qui vascularisent la<br />
moelle épinière sont les artères radiculo-medullaire.<br />
Les artères vertébrales peuvent être à l origine d'une artère radiculo-medullaire.<br />
● Au sujet de l'hypophyse : tige pituitaire = tige de l'hypophyse<br />
hypophyse= glande pituitaire<br />
infundibulum= angle antéro-inférieur du troisième ventricule.<br />
I. LA VASCULARISATION VEINEUSE DE LA MOELLE EPINIERE :<br />
Les veines de la moelle épinière sont satellites des artères. Elles parcourent la surface de la<br />
moelle.<br />
Les veines spinales sont situées tout autour de la moelle épinière et se jettent dans des<br />
veines radiculaires qui elles même se jettent dans les plexus veineux de l'espace épidural de la<br />
colonne vertébrale.<br />
Ces plexus remontent du sacrum jusqu'au crâne. C'est un réseau parallèle au circuit cave.<br />
Il peut s'agir d' une voie de dérivation en cas d'obstruction cave.<br />
Ce réseau a une importance majeure en raison de la mise en communication vasculaire du sacrum et<br />
du crâne.<br />
Le sacrum se situe au niveau du pelvis. Au sein de ce dernier on peut trouver :<br />
l'appareil urinaire, l'appareil génital, le rectum....<br />
Or, la prostate, les ovaires, l'utérus ... peuvent être le siège de cancers et donc de métastases.<br />
Ces métastases vont pouvoir emprunter le circuit veineux à contre courant et se drainer dans<br />
l'espace épidural de la colonne vertébrale.<br />
Les métastases au niveau du sacrum vont ainsi pouvoir atteindre les vertèbres lombaires, dorsales,<br />
cervicales puis le crâne. Elles empruntent donc la circulation veineuse épidurale. 1
Introduction :<br />
II . LA VASCULARISATION DU TRONC CEREBRAL ET DU<br />
CERVELET.<br />
Le tronc cérébral se trouve à la base du crâne, au niveau de la fosse cérébrale postérieure. Il<br />
est incliné à 20 degrés.<br />
Il est constitué du mésencéphale, du pont, de la moelle allongée. En arrière, on trouve le cervelet.<br />
1. La vascularisation artérielle : ( voir schéma 1, 2A et 2B)<br />
La vascularisation artérielle provient du tronc basilaire qui provient lui même de la réunion<br />
des 2 artères vertébrales droites et gauches.<br />
Ces 2 artères vertébrales rentrent dans le crâne à la partie postérieure du foramen magnum et<br />
se réunissent à hauteur du sillon medullo-pontique ( pas forcément sur la ligne médiane, cela peut<br />
se faire d'un coté ou de l'autre.).<br />
Ces 2 artères se réunissent pour former l'artère basilaire. Leur réunion se fait « plutôt » sur<br />
la ligne médiane en raison de la présence du sillon basilaire. ( mais, attention : ce sillon basilaire<br />
n'est pas l'empreinte de l'artère basilaire ! : ce sillon est du au développement du pont du tronc<br />
cérébral qui se fait sur les parties latérale d'où la présence d'un creux dans la partie médiale. )<br />
Cette réunion peut se faire de façon complète ou non. Avec l'âge l'artère peut se déformer, elle<br />
devient plus tortueuse.<br />
L'artère basilaire, au niveau du sillon ponto-mésencéphalique se divise à nouveau en 2<br />
artères : Les artères cérébrales postérieures droites et gauches qui vascularisent la partie<br />
postérieure du cerveau ( elles ne vascularisent pas le TC! ).<br />
En résumé : Les artères vertébrales vont former l'artère basilaire et ces dernières se divisent en 2<br />
artères cérébrales postérieures.<br />
Organisation des collatérales :<br />
La vascularisation du Tronc cérébral suit le même modèle que celui de la moelle épinière c'est à<br />
dire : une vascularisation périphérique et centrale.<br />
On trouve,donc, dans le TC : - des artères centrales perforantes,<br />
- des artères périphériques superficielles.<br />
2
a) Vascularisation du territoire profond : Les artères centrales perforantes:<br />
Les artères perforantes de la ME naissent de la partie postérieure de l'artère spinale ventrale.<br />
Donc, pour le TC, on suit le même schéma : l'artère basilaire va donner des collatérales sous forme<br />
de perforantes qui vascularisent la substance grise.<br />
Les branches rentrent dans le pont à partir de la face dorsale de l'artère basilaire.<br />
Le diencéphale et le mésencephale sont vascularisés par la terminaison de l'artère basilaire.<br />
Sur la ligne médiane, au niveau du sillon medullo-pontique, il y a des touffes d'artères<br />
perforantes. ( voir schéma 2 )<br />
Il existe donc des points très importants pour la vascularisation du Tronc cérébral.<br />
Les artères perforantes se situent :<br />
- sur toute la hauteur du pont<br />
- au niveau de la fissure médiane et du sillon medullo- pontique<br />
( schéma 1 )<br />
- au niveau de l'espace perforé postérieur. ( schéma 2 )<br />
b) Vascularisation du territoire périphérique:<br />
Les artères du territoire périphériques vont faire le tour du tronc cérébral ( même système<br />
que la ME). Ce sont les artères périphériques circonférentielles. Il en existe des courtes et des<br />
longues.<br />
Ces artères pénètrent de plus loin, avant le cervelet.<br />
Les artères circonférentielles longues vont vasculariser la surface du cervelet ( le cervelet est<br />
la paroi dorsale du métencephale donc l'équivalent de la partie dorsale du pont ); elles sont appelées<br />
artères cérébelleuses. (voir schémas 1 et 2 A et 2B ):<br />
Le cervelet possède 3 parties, donc il existe 3 artères cérébelleuses :<br />
• artère cérébelleuse postéro-inférieur,<br />
• artère cérébelleuse antéro-supérieur,<br />
• artère cérébelleuse antéro-inférieur.<br />
▪ L'artère cérebelleuse inférieure nait de l'artère vertébrale, c'est l'artère cérébelleuse postéroinférieure<br />
ou PICA ( nom donné par les neurologues) .C'est une circonférentielle longue qui<br />
vascularise la moitié inférieure du cervelet.<br />
▪ L'artère cérébelleuse antéro-supérieur . Elle nait juste avant la bifurcation des 2 artères<br />
cérébrales postérieures. Elle vascularise la moitié supérieure du cervelet.<br />
▪ L'artère cérébelleuse antéro-inférieure ( ou artère cérébelleuse moyenne ) nait de l'artère<br />
basilaire. Elle vascularise le reste.<br />
Parfois, il arrive que l'artère cérébelleuse antéro-inférieure n'existe pas ou qu'elle soit<br />
transformée en circonférentielle courte parce que le territoire cérebelleux est suffisamment<br />
vascularisé par les deux autres artères ( moitié/moitié). 3
Le plus souvent, une partie moyenne du cervelet, correspondant au nodulus et floculus est<br />
vascularisé par l'artère cérébelleuse moyenne : artère cérébelleuse antéro-inférieur. Elle ne prend<br />
que ce qu'il reste. C'est la moins importante des trois.<br />
Entre la postéro-inferieur et l'antéro supérieur c'est une véritable compétition.<br />
L'une ou l'autre domine : artère cérébelleuse supérieure dominante ou cérébelleuse inférieure<br />
dominante.<br />
Si l'artère cérebelleuse postéro-inférieur est dominante, elle va gagner en territoire sur celui<br />
de la cérébelleuse antéro-supérieure et si c'est l'antéro-supérieur qui domine, le territoire de la<br />
postéro- inferieure sera plus petit.<br />
Les artères cérébelleuses vont avoir un territoire superficiel et un territoire profond.<br />
Les noyaux du cervelet vont être vascularisés par l'artère cérébelleuse inférieure ou supérieure.<br />
Les artères perforantes naissent dès l'origine de l'artère : ce sont les premières branches collatérales.<br />
Puis développent leur territoire périphérique à la surface du cervelet.<br />
La vascularisation veineuse de l'ensemble de l'encéphale sera traité plus tard. Les veines pour le<br />
retour se jettent dans les sinus.<br />
III. LA VASCULARISATION ARTERIELLE DU CERVEAU.<br />
• Introduction :<br />
La vascularisation du cerveau est une vascularisation de type terminale.<br />
On va retrouver pour les artères cérébrales, une organisation en territoires superficielles et territoires<br />
profonds.<br />
Cette vascularisation va dépendre de 3 ou 4 artères ( cela va dépendre de la façon de compter) :<br />
➔ 2 artères carotides internes<br />
➔ (soit) une artère basilaire<br />
➔ (soit) une artère vertébrale<br />
Ces artères vont arriver au cerveau par sa face inférieure. Ceci est illustré par le schéma n°3<br />
représentant un cerveau embryonnaire.<br />
Ces artères vont donner des artères cérébrales.<br />
En effet, certaines proviendront des artères carotides internes comme les artères cérébrales<br />
antérieures et moyennes : on parle de territoire carotidien et d' autres comme les cérébrales<br />
postérieures vont provenir de l'artère basilaire et des 2 artères vertébrales : on parle de territoire<br />
vertébro-basilaire.<br />
4
On peut donc décrire 2 territoires :<br />
• un territoire carotidien: plutôt antérieur<br />
• un territoire vertébro-basilaire: plutôt postérieur<br />
Il existe 3 artères cérébrales:<br />
● artère cérébrale antérieure ( branche de division médiale de l'artère carotide interne )<br />
● artère cérébrale moyenne ( branche de division latérale de l'artère carotide interne )<br />
● artère cérébrale postérieure ( issue de la division de l'artère basilaire)<br />
A l'examen si on a à traiter la vascularisation du cerveau il faut parler dans l'ordre de : l'origine,<br />
du trajet, de la terminaison, des collatérales.<br />
Pour étudier ces 3 artères, on va se référer aux schémas n° 4 ( vue latérale du cerveau ), n° 5 ( vue<br />
médiale du cerveau ), n° 6 ( vue inférieure du cerveau ) .<br />
I. L'artère cérébrale antérieur (ACA ):<br />
( schéma n° 4, 5 et 6 )<br />
L'artère cérébrale antérieure comprend 2 territoires de vascularisation : central et périphérique.<br />
Elle mesure 2 à 3 mm de diamètre à l'origine.<br />
C'est une branche de l'artère carotide interne ( mesurant environ 10 mm de diamètre ).<br />
A- Territoire Périphérique :<br />
L'artère cérébrale antérieure est la branche médiale de l'artère carotide interne.<br />
Elle part en dedans, elle présente un premier trajet horizontal à la face inférieure du cerveau.<br />
Ce segment horizontal à la face inférieure du cerveau s'appelle : le segment A1 ( = 1ere segment<br />
de l'ACA) puis il va gagner la face médiale du cerveau et se diviser en 2 branches:<br />
○ Une branche qui se loge dans le sillon cingulaire: l'artère calloso-marginale ,<br />
○ Une branche qui se place autour du corps calleux: l'artère péricalleuse ( elle est plus loin<br />
du corps calleux).<br />
L'artère calloso-marginale va arriver au bord supérieur du cerveau et gagner la face latérale<br />
de l'hémisphère cérébrale. Elle va vasculariser 3 cm environ de la face latérale.<br />
L'ACA donne également des collatérales qui vont aller vasculariser la partie médiale de<br />
l'hémisphère : le lobe frontal et le cingulum. On parle de collatérales fronto-orbitaire. Elles ont<br />
divers noms non détaillés ici.<br />
On les retrouve également au niveau de la face latérale du cerveau, dans la mesure où l'ACA<br />
contourne le bord supérieur pour vasculariser 3 cm de la face latérale.<br />
Globalement l'ACA est l'artère de la face médiale de l'hémisphère.<br />
Remarque : Les artères se situent dans les sillons ( voir coupe sur schéma n° 7 ). L'artère cérébrale<br />
se situe au fond du sillon et est entourée de l'arachnoide. L'arachnoide a un rôle de protection.<br />
5
B.Territoire Central:<br />
Le territoire central est représenté par des petites branches naissant du segment horizontal ou<br />
segment A1. Ce sont des artères perforantes,qui sont responsables de la vascularisation de la<br />
substance grise centrale. Elles passent dans l'espace perforé antérieur et vascularisent l'intérieur du<br />
cerveau.<br />
II. L'artère cérébrale moyenne (ACM) : ( schéma n°4 )<br />
On retrouve l'organisation en territoires profonds et superficiels<br />
A. Territoire périphérique :<br />
L'ACM est la branche latérale de l'artère carotide interne. Elle a un diamètre de 6 à 8 mm.<br />
Elle présente un segment horizontal M1 à la face inférieure du cerveau puis elle va gagner le sillon<br />
latéral.<br />
Elle chemine en arrière et en haut dans ce sillon latéral pour enfin se terminer par : l' artère<br />
angulaire ( branche terminale de l' ACM ). Cette artère vascularise la région du gyrus angulaire.<br />
Elle va donner 2 types de collatérales superficielles :<br />
• les collatérales descendantes : ce sont des branches temporales.<br />
• les collatérales ascendantes : ce sont les branches frontales ou pariétales.<br />
L'ACM continue l'axe de la carotide interne. Ceci a une importance clinique. ( schéma n°8 )<br />
En effet en cas de présence d'athérome dans l'ACI ,si cet athérome se détache il va partir<br />
préférentiellement dans la circulation de l' ACM car elle continue dans l'axe de l'ACI tandis que<br />
l'ACA bifurque vers le haut.<br />
L'embolie carotidienne correspond donc plutôt au territoire de l'ACM.<br />
B.Territoire Central : ( schéma n° 6 )<br />
Le territoire central correspond au territoire M1.<br />
Les collatérales centrales naissent à partir de la portion horizontale ou segment M1. Elles<br />
atteignent le SNC par l'espace perforé antérieur.<br />
Plus précisément, les artères perforantes provenant de M1 entrent dans le cerveau au niveau de la<br />
partie latérale de l'espace perforé antérieur.<br />
6
III. L'artère cérébrale Postérieure (ACP) : ( schéma n° 5 et 6 )<br />
L'artère cérébrale postérieure va vasculariser la partie postérieure du cerveau.<br />
Elle nait de l'artère basilaire ( qui se divise au niveau du sillon ponto-mésencéphalique en 2<br />
artères cérébrales postérieures qui contourent le mésencéphale). Sa branche terminale est l'artère<br />
calcarine.<br />
A. Territoire superficiel :<br />
Ce territoire correspond à la face postérieure et inférieure du cerveau.<br />
L' ACP contourne le bord postérieur du cerveau pour aller vasculariser les 2 -3 cm de la face<br />
latérale de l'hémisphère cérébrale.<br />
B. Territoire central :<br />
Des artères perforantes rentrent dans le SNC au niveau de l'espace perforé postérieur avec<br />
les artères perforantes de l'artère basilaire. ( schéma n° 6 )<br />
IV . L'artère carotide Interne (ACI) :<br />
L'ACI a d'autre collatérales notamment une collatérale qui va vasculariser les plexus<br />
choroides ( ce qui permet la sécretion de LCR), c'est l'artère choroidienne antérieure. ( voir<br />
schéma n°6 )<br />
Cette dernière se comporte comme une artère cérébrale.<br />
C'est à dire qu'elle présente un territoire périphérique superficiel correspondant au plexus choroide<br />
( pie mère) et un territoire central, profond avec les artères perforantes pour la capsule interne.<br />
V. Le polygone de WILLIS : ( voir schéma n° 9)<br />
Les artères cérébrales antérieures sont réunies par une petite artère : l'artère communicante<br />
antérieure. Cette réunion s 'effectue après le segment horizontal: c'est une anastomose. ( schéma n°<br />
6)<br />
Les artères cérébrales sont de type terminal. Or, ici, nous avons des artères terminales<br />
anastomosées!<br />
En fait, les ACA sont de type terminal après l'anastomose.<br />
Il existe également une artère communicante postérieure qui nait de la face postérieure de la<br />
carotide interne et qui la relie à la carotide cérébrale postérieure.<br />
Sur le schéma n° 9, on a au final : une artère basilaire, 2 artères carotides internes, les artères<br />
cérébrales moyennes et postérieures, les artères cérébrales antérieures réunies et donc cela forme un<br />
cercle anastomotique artériel à la base du crâne : le polygone de WILLIS.<br />
C'est un réseau anastomotique placé à l'origine des artères cérébrales<br />
7
Il est donc constitué des 2 artères carotides internes, de l'artère basilaire qui donne les ACP, les<br />
ACA et des anastomoses (antérieures et postérieures).Cependant le cercle ne comporte pas les 2<br />
ACM.<br />
Ce réseau anastomotique va permettre la mise en place de système de suppléance :<br />
Si, par exemple, l'artère carotide interne gauche se bouche, le réseau peut rester fonctionnel. ( ici,<br />
l'artère carotide interne contro-latérale et l'artère basilaire peuvent suppléer. )<br />
Mais attention : Ce phénomène de compensation ne peut se mettre en place que si le processus<br />
visant à boucher l'artère est progressif et non brutal!<br />
Autre exemple : En cas d'occlusion de l'artère basilaire par exemple, l' ACP gauche pourra être<br />
alimentée par la carotide interne gauche.<br />
Dans la maladie athéromateuse , les artères se bouchent progressivement,et on peut voir des cas où<br />
le cerveau est vascularisé par une seule artère vertébrale( celle qui n'est pas bouchée).Il y a donc<br />
mise en route progressive d'un système de compensation.<br />
Le polygone de Willis décrit ci-dessus est de type fœtal.<br />
On peut le conserver ou il peut se modifier. Il peut y avoir de nombreuses variations.<br />
Le cercle artériel ne se développe pas de façon homogène. On peut ne pas avoir d' artère<br />
communicante postérieure ou même, d'artère communicante antérieure. Le segment initial de l'ACP<br />
( = segment P1 ) peut ne pas être présent... etc..<br />
Attention : Il y a tout de même une différence entre naissance et développement : ex: Dans le<br />
schéma n°9, dans le cas de la variation : l' ACP ne peut pas naitre de l'artère carotide interne,<br />
même si on peut en avoir l'impression avec les remaniements. Elle nait bien de l'artère basilaire.<br />
Il existe 47 configurations possibles. Attention : il faut quand même une configuration qui permette<br />
une alimentation des artères.<br />
Il existe donc des anastomoses au niveau de la base : le cercle artériel de Willis mais il<br />
existe également des anastomoses à la distalité : ce sont des anastomoses piemériennes. En effet, au<br />
niveau des artérioles et des capillaires de la distalité, il y a des communications entre le territoire de<br />
la cérébrale postérieure, de la cérébrale moyenne et de la cérébrale antérieure. (voir schéma n°4 )<br />
Ces anastomoses ne sont fonctionnelles que si des troubles s'installent de manière progressive. Des<br />
relais peuvent être mis en place.<br />
Par exemple,entre les artères cérébrales moyennes et postérieures ou encore entre les artères<br />
postérieures et antérieures.<br />
Les anastomoses pie-mériennes sont représentées par des petits capillaires pie -mériens de faible<br />
débit mais suffisant pour suppléer une thrombose.<br />
8
( voir schéma n°10 )<br />
VI. Territoires Centraux ( profond) :<br />
Sur le schéma : on retrouve les artère péricalleuses, les artères calloso-marginale dans le sillon<br />
cingulaire, les branches de l'ACM...<br />
L' ACA vascularise la face médiale et une partie de la tête du noyau caudé,une partie du<br />
Thalamus,le corps calleux.<br />
Les branches de division de l'ACP vont vasculariser la moitié supérieure du Thalamus (pas le<br />
thalamus en entier) et la partie postérieur du cerveau.<br />
Le reste du cerveau est vascularisé par l'ACM ( c'est la plus grande partie) sauf un petit endroit qui<br />
est vascularisé par l'artère choroidienne antérieure. L'artère choroidienne antérieure vascularise la<br />
capsule interne.<br />
Les artères communicantes postérieures ont également des branches pour le territoire central mais<br />
aussi pour les territoires périphériques.<br />
VII. Exemples d'occlusions et leurs conséquences<br />
Les occlusions sont représentées par des numéros sur les schémas n° 4 et 5<br />
Si il y a : - occlusion de l'artère cérébrale moyenne gauche chez un droitier en 1 puis en 2<br />
- occlusion de la carotide interne en 3 puis en 4<br />
Conséquences sur un plan clinique :<br />
En 1 : Le territoire profond est respecté, et il y a une ischémie du territoire superficiel.<br />
Le patient va présenter:<br />
● des troubles du langages ( aphasie) aires de Wernick et Broca atteintes<br />
● une hémiplégie droite à prédominance brachio-faciale qui préserve le territoire de l'ACA et<br />
donc le membre inférieur.<br />
En 2 : il y a une ischémie totale et nécrose.<br />
● des troubles du langages ( aphasie)<br />
● une hémiplégie totale<br />
_S'il y a occlusion de l'artère cérébrale antérieure:<br />
● hémiplégie crurale (membre inférieur qui est touché)<br />
_S'il y a occlusion de l'artère carotide interne à son origine il y a une hémiplégie totale droite. 9<br />
Le cours n'a pas pu être fini en raison de l'arrivée de la prof d'anapath.. Suite au prochain cours!
Anat neuro 11 et 12 ROQUES Morgane<br />
01/10/10 8h-10h THURIES Claire<br />
Pr Chaynes<br />
Schéma 1<br />
Fin de la vascularisation artérielle<br />
Si on a une lésion en 1 (cérébrale moyenne gauche) on aura une hémiplégie à prédominance<br />
brachio-faciale et une aphasie. L e territoire profond est épargné.<br />
Schémas 1 et 2<br />
En 2 c'est le territoire profond qui est atteint. Cette situation pourrait correspondre à un<br />
tabagique de 50 ans qui a les artères bouchées. On a une hémiplégie totale proportionnelle (lésion<br />
au niveau de la capsule interne) c'est à dire une paralysie Face Main Pied et une aphasie.<br />
Si le pied est le plus touché cela signifie que la lésion est au niveau de la cérébrale<br />
antérieure.<br />
Si la face est la plus touchée cela signifie que la lésion est au niveau de la cérébrale moyenne.<br />
Si la choroïdienne antérieure est lésée, on aura une hémiplégie totale proportionnelle, la différence<br />
avec le cas n°2 est qu'il n'y a pas d'atteinte du cortex et donc pas d'aphasie.<br />
1 symptôme = 1 localisation, pas besoin d'IRM !<br />
En cas de lésion entre 2 et 3 on aura aussi une hémiplégie totale proportionnelle avec<br />
quelques lésions frontales. L'étendue sera plus importante qu'en 2 et plus difficile à discerner.<br />
Si la lésion se trouve entre 3 et 4 c'est à dire lésion de la carotide interne GAUCHE, on aura<br />
une hémiplégie totale proportionnelle DROITE associée à des troubles de la vision : cécité de<br />
l'oeil GAUCHE. En effet, l'artère ophtalmique est une branche de la carotide interne, une lésion<br />
entraine donc une ischémie de l'œil responsable de la cécité.<br />
Si une plaque d'athérome se détache et va dans la circulation vers l'artère ophtalmique on<br />
aura une cécité transitoire appelée amaurose. La vision s'efface pendant 1 ou 2 minutes puis<br />
revient, c'est un signe de gravité montrant un risque d'ischémie cérébrale.<br />
Les veines<br />
Schéma 3 : coupe sagittale du crâne<br />
On retrouve la dure mère qui tapisse toute la surface, la tente du cervelet, la faux du cerveau.<br />
Schéma 4 : coupe frontale<br />
La faux est un dédoublement de la dure mère, au niveau de son insertion on trouve un espace qui est<br />
un sinus (qui n'a rien à voir avec les sinus osseux du crâne), et à l'intérieur de celui-ci il y a du sang<br />
veineux. Ce sinus est l'équivalent d'une grosse veine mais sans paroi veineuse, on a juste un<br />
endothélium. Le sang veineux circule donc dans un dédoublement de la dure mère.<br />
1
On a donc deux sortes de connecteurs veineux :<br />
– les veines<br />
– les sinus duremériens<br />
Il existe plusieurs sinus placés au niveau des replis de la dure mère :<br />
→ Dans un plan sagittal au niveau de l'insertion de la faux du cerveau on a le Sinus<br />
Sagittal Supérieur (SSS).<br />
→ Toujours dans un plan sagittal on retrouve le Sinus Sagittal Inférieur (SSI).<br />
→ La tente du cervelet a 2 bords : un libre (l'incisure) et l'insertion, fait tout le tour, part des<br />
processus chonoïdes antérieurs et sur le bord supérieur du rocher (os pétreux), et sur le bord<br />
supérieur du rocher on trouve le Sinus Pétreux Supérieur (SP).<br />
Schéma 5 : vue supérieure<br />
On retrouve la lame criblée, les processus clinoïdes antérieurs et postérieurs, le bord supérieur du<br />
rocher, le foramen magnum, les canaux optiques, la fissure orbitaire supérieure, le foramen rond, le<br />
foramen ovale, le foramen épineux, le porus acoustique,le foramen jugulaire, le canal de<br />
l'hypoglosse.<br />
→ Sur cette vue supérieure on retrouve le SSS ainsi que le SSI qui commence au niveau du<br />
processus cristanelli, passe au bord inférieur de la faux en restant dans le dédoublement de la dure<br />
mère, pour rejoindre le SSS ; cela correspond au Sinus Droit (SD).<br />
Il y a un sens d'écoulement du sang veineux, de l'avant vers l'arrière, du SSI vers le SD. Le sang va<br />
se déverser vers la veine jugulaire interne, cette dernière représentant la voie d'écoulement<br />
principale du sang veineux du crâne.<br />
→ Il existe une zone médiane correspondant au confluent des sinus. Puis, toujours dans un<br />
dédoublement de la dure mère, le sang descend vers la veine jugulaire interne. On a deux sinus<br />
sagittaux (SSS et SSI) et on aura alors un Sinus Transverse (ST) de part et d'autre, et le sinus<br />
transverse descend dans la veine jugulaire interne au niveau du Sinus Sigmoïde (S∑).<br />
Le Sinus Pétreux Supérieur rejoint le Sinus Sigmoïde pour retomber dans la veine jugulaire interne.<br />
Tous ces sinus (SSS, SSI, ST, SP, S∑) se rejoignent pour se jeter dans la veine jugulaire interne.<br />
Le Sinus Caverneux (au bord latéral de l'hypophyse) ressemble moins aux autres sinus car on n'a<br />
pas seulement de l'endothélium, on retrouve des logettes qui sont des amas de veines (comme il y a<br />
des veines qui peuvent se placer sur la dure mère).<br />
On voit les veines de la Moelle Épinière qui remontent du sacrum jusqu'à la base du crâne, ces<br />
veines remontent ensuite sur la lame quadrilatère pour se jeter dans le Sinus Caverneux (et un peu<br />
dans le Sinus Pétreux Inférieur, pas important).<br />
Le Sinus Pétreux Supérieur est en fait une anastomose entre le Sinus Caverneux et la veine jugulaire<br />
interne.<br />
Les foramens rond, ovale et épineux, et la fissure orbitaire supérieure permettent la communication<br />
entre la base du crâne et la face (orbite et région infratemporale)<br />
Donc on trouve des veines dans les deux sens mais surtout de l'intérieur vers l'extérieur, les veines<br />
partent du Sinus Caverneux par les foramens rond, ovale et épineux (accompagnées de nerfs).<br />
Par contre au niveau de la fissure orbitaire supérieure, c'est l'œil – par la veine ophtalmique<br />
supérieure – qui se draine dans le Sinus Caverneux.<br />
Il y a donc des échanges entre le crâne et la face, et donc des « cochonneries » peuvent rentrer dans<br />
le crâne. 2
Exemple : si on touche un bouton (= concentré de bactéries) situé sur l'aile du nez, en appuyant on<br />
exerce une pression et donc les bactéries peuvent passer dans les capillaires, les microbes arrivent<br />
dans le crâne et bouchent la veine → thrombophlébite du sinus caverneux. (On en meurt …)<br />
Les veines de l'encéphale se drainent donc dans ces collecteurs duremériens, que ce soit cerveau,<br />
tronc cérébral ou cervelet.<br />
Schéma 6 et 7 : vues latérale et médiale<br />
Le SS est petit devant et devient plus gros par la suite. On retrouve le SSI, SD, SD et S∑.<br />
Le sens de l'écoulement est de l'avant vers l'arrière et de haut en bas. Il n'y a pas de valvules (ces<br />
dernières empêchant le sang de redescendre du cœur vers les pieds, là le but est que justement le<br />
sang redescende au cœur).<br />
Le cerveau subit des pressions (toux par exemple) qui seront limitées par le crâne. Donc il faut une<br />
bonne tension pour compenser les résistances périphériques, afin d'éviter que lors d'efforts poussés<br />
le sang ne s'accumule ce qui provoquerait une thrombose. Il faut donc un système maintenant la<br />
pression veineuse relativement stable (lors d'un effort de toux la pression augmente et le but est de<br />
faire fuir le sang).<br />
Donc l'orientation des veines par rapport aux sinus est importante !<br />
Hormis la première des veines qui se jette dans le SSS, toutes s'orientent dans le sens de<br />
l'écoulement. Les veines du tronc cérébral se draineront dans le ST ou le S∑.<br />
On a un drainage superficiel : les veines superficielles drainent la surface du cerveau et se jettent<br />
dans le SSS ou dans le ST.<br />
Puisqu'il existe un drainage superficiel (destiné au cortex cérébral), il existe aussi un drainage<br />
profond : cependant les veines restent superficielles ... Comment être profond et rester<br />
superficiel ?! Grâce à la pie mère ! En effet la pie mère recouvre la surface du cerveau mais se<br />
retrouve en profondeur au niveau de la fissure transverse.<br />
Donc les veines profondes sont au niveau de la fissure transverse, cette dernière comportant 4 faces<br />
(horizontale supérieure, verticale postérieure, latérale droite, latérale gauche) on a alors 2 paires de<br />
veines :<br />
→ la Veine Cérébrale Interne (VCI).<br />
→ la Veine Basale (VB).<br />
On a la Veine Carotide Interne dans la portion horizontale de la fissure transverse au niveau du<br />
toit du 3 ème ventricule, la Veine Basale dans la portion latérale de la fissure transverse entre le tronc<br />
cérébral et le lobe temporal, et ces deux veines vont se rejoindre pour former la Grande Veine<br />
Cérébrale (GVC) (ou veine de Galien) qui se draine dans le Sinus Droit.<br />
Ces veines dites profondes drainent la partie profonde de l'encéphale c'est à dire les noyaux gris et<br />
le diencéphale.<br />
3
Anastomoses veineuses<br />
Schéma 6 : vue latérale<br />
Les anastomoses entre le secteur superficiel et le secteur profond se font par la veine basale et par<br />
d'autres veines :<br />
→ Une veine anastomotique supérieure (veine de Trolard) qui anastomose la veine du<br />
sillon latéral (secteur superficiel) à la veine basale (secteur profond).<br />
→ Une veine anastomotique inférieure (veine de Labbé) qui permet l'anastomose entre le<br />
SSS et le ST.<br />
Les noms propres en italique ne sont pas à savoir …<br />
Rappel sur la motricité volontaire<br />
Schéma 9<br />
Rappel de P1: il y a un système nerveux central avec un effecteur qui est la voie descendante partant<br />
du cortex cérébral (au niveau des aires motrices). Cet effecteur croise la ligne médiane et se projette<br />
sur le deuxième neurone. Il y a donc deux neurones : un neurone cortical et un motoneurone.<br />
Schéma 10 : vue latérale du cerveau<br />
L'aire motrice primaire se situe dans le gyrus précentral, l'aire motrice secondaire se situe en<br />
avant de celle ci et l'aire motrice supplémentaire en avant de la secondaire dans le gyrus frontal<br />
supérieur.<br />
Donc le neurone cortical nait du cortex cérébral (composé de six couches hétérotypiques<br />
agranulaires) et plus précisément de la 5 ème couche qui est pyramidale.<br />
La cellule pyramidale envoie donc un axone vers la moelle épinière pour constituer un tractus<br />
cortico spinal.<br />
Schéma 11: coupe frontale<br />
Le tractus cortico spinal est constitué de 1 à 2 millions de fibres dont 700 000 sont<br />
myélinisées.<br />
Sur ces 700 000 fibres myélinisées seulement 30 à 40 % proviennent de grosses cellules<br />
pyramidales qui vont vite, appelées cellules de Belt. Ces 30 à 40 % correspondent à l' aire motrice<br />
primaire.<br />
Donc le tractus cortico spinal provient pour 30 à 40 % de l'aire motrice primaire et pour 20 à 30<br />
% de l'aire motrice secondaire.<br />
Les 40 % restant proviennent de l'aire somesthésique.<br />
Donc le tractus cortico spinal est composé des voies cortico spinales allant du cortex à la moelle<br />
épinière, c'est un autoroute de voies efférentes et afférentes. Il ne faut pas dire que la sensibilité est<br />
efférente mais pourtant il y a des informations qui viennent des aires somesthésiques et qui sont<br />
efférentes, on parle de région sensoriomotrice. La sensibilité est un concept, ce n'est pas une voie<br />
(on parle de voie afférente ou efférente). En effet, on parle de sensorimotricité car un mouvement<br />
n'est pas que moteur, il doit y avoir en permanence un retour. Il est donc normal que les cellules<br />
pyramidales de la région sensoriomotrice représentent 40 % du tractus.<br />
Si il y a une lésion de ces fibres au niveau de la capsule interne, on aura un déficit moteur et non<br />
sensitif car ce sont des cellules pyramidales.<br />
La capsule interne est oblique en bas et en dedans sur la coupe frontale, les fibres descendent dans<br />
la capsule interne. Pour mieux étudier la capsule interne on fait une coupe horizontale. 4
Schéma 12 : coupe horizontale<br />
On sectionne le corps calleux à deux reprises, un fois au genou et une autre au splénium.<br />
En haut et en bas, on a le cingulum ou le gyrus parahyppocampal en fonction de l'inclinaison de la<br />
coupe puis le cortex occipital.<br />
Le noyau caudé est également sectionné à deux reprises, le thalamus est gros et oblique en bas et en<br />
dehors, on retrouve le globus pallidus et le putamen ainsi que claustrum et l'insula.<br />
Sur la ligne médiane, on a le ventricule latéral, le septum pellucidum, le troisième ventricule et la<br />
fissure transverse qui peut être sectionnée deux fois.<br />
Donc on voit que la capsule interne forme un chapeau chinois ( cf schéma 13) avec un bras avant et<br />
un bras postérieur. Entre les deux bras se trouve le genou et le tractus cortico nucléaire se trouve au<br />
niveau de ce genou. Le tractus cortico spinal se trouve lui sur la partie antérieure du bras postérieur.<br />
On a donc une rotation de la face qui était latérale et devient médiale au niveau de la capsule interne<br />
et le pied qui était médial devient latéral postérieur.<br />
5
Histologie Endocrine 5-6 Maxou Louis<br />
Lundi <strong>27</strong> Septembre 2010 Vincou Cujus<br />
8h - 10h<br />
PANCREAS ET GLANDES SURRENALES<br />
I. Le pancréas<br />
• Le pancréas est une glande annexe du tube digestif situé au niveau de rétro péritoine<br />
supérieur gauche. Il comprend plusieurs parties, il a une forme allongée et on décrit une tête,<br />
un col , un corps et une queue.<br />
• Chez l'adulte, il mesure 15 à 20 cm de long et pèse de 85 à 120 g.<br />
• La partie exocrine du pancréas est constituée par des acini séreux de forme circulaire avec<br />
une petite lumière et avec des canaux excréteurs qui amènent les sécrétions exocrines dans<br />
le tube digestif.<br />
• Au sein de ce pancréas exocrine, on trouve une multitude de petits îlots, ce sont les îlots de<br />
Langerhans. Chacun de ces îlots est un amas cellulaire de forme arrondie qui mesure 1 à 2<br />
mm de diamètre. Il y en a environ 1 million dans un pancréas et ils sont plus nombreux dans<br />
la queue du pancréas.<br />
• Chez l'adulte, ils représentent un peu plus de 1% de l'organe tandis que chez l'enfant ces<br />
îlots de Langerhans représentent environ 10% du pancréas.<br />
• Globalement les cellules de l'îlot sont de plus petite taille que les cellules glandulaires du<br />
pancréas exocrine.<br />
Schéma1 p241 du poly<br />
• La capsule limite un parenchyme exocrine au sein duquel on trouve ces amas de forme<br />
arrondie qui à l'hémalun-éosine sont détectables. On remarque la présence de capillaires<br />
sanguins de type fenêtrés au contact de cellules épithéliales agencées sous forme de<br />
cordons. Ces capillaires sanguins sont plus facilement visibles avec des techniques<br />
immunohistochimiques qui révèlent les cellules endothéliales des capillaires.<br />
• Au sein de l'îlot de Langerhans, on va distinguer 4 types cellulaires différents qui vont<br />
sécréter chacun 4 hormones différentes. Aujourd'hui, pour identifier ces différents types<br />
cellulaires, on utilise des AC dirigés contre l'hormone sécrétée par le type cellulaire que l'on<br />
cherche à identifier. Ces 4 types de cellules sont mélangés les uns avec les autres.<br />
• N.B.: Exemple de question à l'exam qui d'après le prof tombe souvent et est facile à<br />
corriger: quelle est la structure histologique et le rôle de l' îlot de Langerhans?<br />
1. Différents types cellulaires.<br />
Schéma 2 p242 du poly<br />
1/8
• On distingue donc 4 types cellulaires:<br />
➢ les cellules B ou cellules bêta: ce sont les plus nombreuses car elles représentent<br />
70% des cellules de l'îlot. Elles mesurent 12µm de diamètre et sécrètent une<br />
hormone qui est l' INSULINE.<br />
➢ Les cellules A ou cellules alpha: elles mesurent 13 à 15µm de diamètre et<br />
représentent 20% des cellules de l'îlot. L'hormone sécrétée est le GLUCAGON.<br />
➢ Les cellules D ou cellules delta: elles représentent 5% de l'îlot, mesurent environ<br />
8µm, et sécrètent une 3ème hormone qui est la somatostatine. Il y a plusieurs sortes<br />
de somatostatine sécrétée dans l'organisme, ici, la somatostaine a seulement un rôle<br />
paracrine et va agir sur les sécrétions des 2 types cellulaires précédents.<br />
➢ Les cellules PP: elles sécrètent un polypeptide pancréatique et représentent<br />
quelques % de l'îlot de Langerhans.<br />
• Il ne faut pas oublier que toutes ces cellules sont au contact de nombreux capillaires<br />
sanguins de type fenêtrés (le prof a insisté sur les capillaires fenêtrés)<br />
• Ces cellules épithéliales sont négatives avec les cytokératines mais ont une réaction<br />
positive avec l'Ac CD99 aussi appelé MIC2. On peut identifier un des 4 types cellulaires<br />
plus précisément en utilisant un Ac dirigé spécifiquement contre l'hormone sécrétée.<br />
• Les cellules de l'îlot se régénèrent grâce à des cellules souches situées dans les canaux<br />
excréteurs du pancréas exocrine.<br />
• La principale pathologie concernant les îlots de Langerhans est le DIABETE.<br />
2. Innervation.<br />
• Les îlots sont innervés par le système nerveux sympathique et parasympathique et<br />
seulement 10% des cellules sont innervées. Il existe aussi des gap jonctions entre ces<br />
divers types cellulaires pour transmettre l'information reçue par les cellules directement<br />
innervées par le système ortho et parasympathique. Il y a donc passage de l'information à<br />
toutes les cellules de l'îlot grâce à ces gap jonctions.<br />
La stimulation parasympathique:<br />
• Elle va augmenter la sécrétion d'insuline, de glucagon et du peptide pancréatique. Cette<br />
stimulation parasympthique s'observe pendant la phase céphalique de digestion.<br />
La stimulation orthosympathique:<br />
• Elle va inhiber la libération d'insuline et augmenter la synthèse de glucagon. Cette<br />
stimulation sympathique s'appelle le réflexe d'adaptation au stress.<br />
2/8
3. Histophysiologie de l'îlot de Langerhans<br />
• La sécrétion d'insuline:<br />
➢ L'insuline est une hormone hypoglycémiante. L'ALLOXANE est un produit de<br />
dégradation des bases puriques retrouvé en grande quantité dans l'organisme lors<br />
de gros traumatismes en particulier lors de phénomènes d'écrasement des tissus,<br />
et l'ALLOXANE va détruire spécifiquement les cellules à insuline, c'est pourquoi<br />
lors de gros traumatismes on a l'installation d'un diabète.<br />
➢ Il existe aussi des sulfamides qui sont de 2 types:<br />
✔ les sulfamides hyperglycémiants qui vont freiner la sécrétion d'insuline par<br />
les cellules B,<br />
✔ les sulfamides hypoglycémiants qui vont eux stimuler les cellules B, on a une<br />
multiplication des cellules B dans l'îlot et on aura également plus d'insuline<br />
synthétisée par chaque cellule. Certains de ces sulfamides sont utilisés dans le<br />
diabète en particulier dans le diabète de type 2.<br />
• Contrôle de la sécrétion d'insuline:<br />
➢ L'hyperglycémie, (c a d l'augmentation de sucre dans le sang) va stimuler la<br />
sécrétion d'insuline.<br />
➢ De même, la sécrétion de glucagon va stimuler la sécrétion d'insuline.<br />
➢ D'autres hormones, comme l'hormone de croissance (GH), la tyroxine,<br />
l'adrénaline ou les glucocorticoïdes stimulent aussi la sécrétion d'insuline car<br />
ils ont une action hyperglycémiante.<br />
➢ Le taux normal de la glycémie est compris entre 4,5 et 6,5 nanomol/L ou 1 g/L<br />
de sang.<br />
➢ L'hypoglycémie va donc déprimer l'activité des cellules à insuline.<br />
4. Pathologie des cellules de l'îlot de Langerhans<br />
• Pathologies des cellules B:<br />
La pathologie inhérente à ces cellules de type B va être le diabète dont il existe 2 types:<br />
• le diabète de type 1 (appelé diabète maigre): il correspond à une incapacité du pancréas à<br />
sécréter une quantité suffisante d'insuline. C'est en fait une maladie auto-immune dans laquelle il y<br />
a destruction plus ou moins importante par des Ac d'un certain nombre de cellules B. Le traitement<br />
passe par la nécessité absolue d'une administration d'insuline exogène<br />
• le diabète de type 2 (appelé diabète gras): il correspond à une insulino-résistance des cellules,<br />
les cellules de l'organisme deviennent résistantes à la pénétration du sucre dans l'organisme. On a<br />
alors une hyperglycémie car le taux de sucre augmente dans le sang.<br />
3/8
• Pathologie des cellules A ( sécrètent le glucagon):<br />
On peut observer dans une région donnée du pancréas un trop grand nombre de cellules A formant<br />
une petite masse, cad une petite tumeur appelée GLUCAGONOME (qui correspond à un<br />
adénome), c'est une tumeur bénigne. On observe alors une exagération de la sécrétion de glucagon,<br />
et donc une hyperglycémie.<br />
• Pathologie des cellules D (sécrètent la somatostatine):<br />
• syndrome de ZOLLINGER-ELLISON: ce syndrome est produit par un petit adénome<br />
développé par les cellules D de l'îlot de Langerhans. Les cellules ne vont pas sécréter de la<br />
somatostatine mais de la gastrine. On va avoir une hypersécrétion d'acide chloridrique à l'origine<br />
d'ulcer gastrique ou du moins d'ulcération par atteinte de la muqueuse de l'estomac et du duodénum,<br />
on va aussi avoir une diarrhée aigüe. Dans ce syndrome, 1 fois sur 2, la tumeur est une tumeur<br />
maligne à savoir un carcinome.<br />
• Pathologie des cellules PP (sécrètent le polypeptide pancréatique):<br />
Normalement ce polypeptide sert à stimuler l'activité des cellules à gastrine, il va aussi augmenter la<br />
glycogénolyse hépatique. Il peut exister des petits adénomes concernant les cellules PP, ces<br />
adénomes sont appelés des PPomes.<br />
II. Les glandes surrénales.<br />
• Organes pairs, en position rétro-péritonéale, dont la face postérieure vient se mouler sur la<br />
convexité du rebord supérieur du rein (les surrénales gauche et droite sont donc au-dessus<br />
de leur rein correspondant),<br />
• Leurs dimension sont: grand axe: 4-6 cm; hauteur: 1-2 cm; épaisseur: 0,5 cm,<br />
• Elles sont constituées de 3 parties: une tête, un corps et une queue,<br />
• La glande surrénale: droite a une forme de pyramide,<br />
gauche a une forme de croissant,<br />
• En présence d'une agénésie rénale (pas de formation d'un rein), la forme de la surrénale du<br />
côté du rein manquant se trouve modifiée: elle apparaît arrondie; la forme de cet organe est<br />
donc lié au rein.<br />
• Il y a 2 glandes dans ce même organe avec une origine embryologique et des sécrétions<br />
différentes, mais qui ne sont en aucun cas anatomiquement séparées:<br />
➢ en périphérie: le cortex ou cortico-surrénale, d'origine mésoblastique, avec une<br />
sécrétion de stéroïdes formés à partir du cholestérol,<br />
➢ au centre: la médullaire ou médullo-surrénale, d'origine neurectodermique,<br />
avec une sécrétion et un stockage de catécholamines (adrénaline et<br />
noradrénaline).<br />
4/8
• N.B.: petit point « il était une fois la vie », auparavant on parlait de capsule surrénale (le<br />
nom des artères en est encore inspiré), car les premiers anatomistes qui eussent disséqué des<br />
cadavres de dates de péremption évidemment franchies, trouvaient un organe creux à la<br />
place des surrénales; cela s'explique par la lyse de la médullo-surrénale après le trépas.<br />
1. La cortico-surrénale.<br />
• Elle est située entre la capsule conjonctive et la partie la plus périphérique de la médullosurrénale,<br />
• Elle est constituée de 3 régions: d'architecture différente, avec des cellules et des sécrétions<br />
différentes, mais dont le point commun est la présence de capillaires sanguins fenêtrés (de<br />
la périphérie vers le centre de la cortico-surrénale):<br />
➢ la zone glomérulée: sous la capsule conjonctive, peu épaisse,<br />
➢ la zone fasciculée: la plus caractéristique et épaisse, d'architecture rectiligne,<br />
➢ la zone réticulée,<br />
• N.B.: ces trois régions ne sont pas séparées physiquement.<br />
Important! Le professeur a longuement insisté sur les capillaires sanguins fenêtrés: chaque année,<br />
à l'examen, des étudiants oublient d'en parler alors qu'ils sont primordiaux dans la constitution des<br />
organes glandulaires! Pensez-y, il le prendrait mal...<br />
a. la zone glomérulée.<br />
• Elle est formée de petits amas de cellules arciformes (nous homologuons ce mot), petites,<br />
hautes et étroites, en cordon qui viennent s'arcbouter (celui-la aussi) sous la capsule,<br />
• Elle est à l'origine de sécrétions d'aldostérone (minéralo-corticoïde), qui va agir sur les<br />
cellules du tube contourné distal du rein et favoriser la réabsorption du Na,<br />
• Les sécrétions sont contrôlées non pas par l'ACTH, mais par l'angiotensine II.<br />
b. la zone fasciculée.<br />
• Elle est d'architecture peignée car les cellules sont organisées en travées rectilignes fines;<br />
• Les cellules, arrondies, s'empilent les unes sur les autres et sont les plus grosses de la<br />
cortico-surrénales,<br />
• Elles sont au contact des capillaires sanguins fenêtrés,<br />
• Un type cellulaire particulier: les spongiocytes:<br />
➢ avec un cytoplasme clair et microvacuolaire<br />
➢ dont les vacuoles sont des gouttelettes lipidiques contenant hormones<br />
(glucocorticoïdes) et cholestérol.<br />
• Elle est à l'origine de sécrétions, à partir du cholestérol, de:<br />
➢ cortisol et corticostérone, en grande quantité: à action hyperglycémiante (par<br />
stimulation de la libération de glycogène hépatique),<br />
➢ DHEA (DéHydroEpiAndrostérone), en faible quantité: avec retentissement<br />
pathologique dans le cas de dysfonctionnements de la couche fasciculée,<br />
5/8
➢ Testostérone, en faible quantité: avec retentissement pathologique dans le cas de<br />
dysfonctionnements de la couche fasciculée (hirsutisme: pilosité exagérée chez la<br />
fille; puberté précoce chez le garçon)<br />
➢ Oestradiol, en faible quantité.<br />
• Les sécrétions sont contrôlées par l'ACTH, qui se fixe sur des récepteurs membranaires des<br />
spongiocytes.<br />
c. la zone réticulée.<br />
• Elle est constituée de cellules petites disposées en travées qui vont s'anastomosées en<br />
mailles; ces dernières sont séparées par des capillaires fenêtrés,<br />
• Elle est à l'origine de sécrétions similaires à la zone fasciculée mais proportionnellement<br />
opposé: des glucocorticoïdes (cortisol et corticostérone) en faible quantité, et des stéroïdes<br />
en grande quantité,<br />
• Les sécrétions sont contrôlées par l'ACTH.<br />
• Cytokératine +<br />
• Synaptophysine +<br />
• Chromogranine -<br />
d. immunophénotype (utile pour le diagnostic).<br />
e. dysfonctionnements.<br />
• Les dysfonctionnement de la cortico-surrénale sont de 2 types et touchent préférentiellement<br />
les sécrétions de glucocorticoïde,<br />
➢ hypofonctionnement: insuffisance surrénalienne,<br />
✔ maladie d'Addison:<br />
✗ hypotension artérielle,<br />
✗ hyponatrémie,<br />
✗ pigmentation brunâtre de la peau,<br />
✗ possible choc sévère ou collapsus<br />
✗ chute des gluco et des minéralo corticoïdes,<br />
✗ étiologie: maladie auto-immune (80% des cas), tuberculose, etc.<br />
✔ arrêt brutal d'un traitement corticoïde: par un mécanisme de feed back<br />
sur l'axe hypothalamo-hypophysaire, lors d'un traitement corticoïde, les<br />
sécrétions endogènes de la couche fasciculée sont presque nulles; l'arrêt<br />
brutal d'un traitement de longue durée de ce type entraîne dès lors une<br />
insuffisance surrénalienne grave; l'arrêt se doit d'être fait par palier.<br />
➢ hyperfonctionnement: adénome ou hyperplasie,<br />
✔ si production de glucocorticoïdes: syndrôme de Cushing (du lourd)<br />
✗ obésité de la face et du tronc,<br />
✗ hirsutisme, 6/8
✗ érythème faciale,<br />
✗ HTA,<br />
✗ diabète sucré,<br />
✗ troubles mentaux,<br />
✗ hypokaliémie.<br />
✔ si production de mineralocorticoïdes: syndrôme de Conn<br />
✗ HTA,<br />
✗ hypokaliémie,<br />
✗ alcalose.<br />
2. La médullo-surrénale.<br />
• Elle est située autour de la veine centrale de la surrénale, et préférentiellement au niveau de<br />
la tête et du corps de la glande surrénale (il n'y en a pas dans la queue) dont elle occupe<br />
10 % du volume,<br />
• Elle fais moins de 2 cm d'épaisseur, et est nettement démarquée de la cortico-surrénale, sans<br />
toutefois, souvenez-vous, en être physiquement séparée,<br />
• Elle est composée de plusieurs types cellulaires, intriqués:<br />
➢ les phéochromocytes:<br />
✔ plus grosses cellules de la glande surrénales, elles sont disposées en<br />
travées courtes séparées par des capillaires fenêtrés,<br />
✔ dont le cytoplasme est basophile, granuleux et vacuolaires,<br />
✔ ce sont des neurones sympathiques post-ganglionaires qui ont perdu leurs<br />
dendrites et leur axone, et se sont transformés en cellules glandulaires.<br />
➢ les cellules sustentaculaires:<br />
✔ fusiformes, elles se moulent aux phéochromocytes,<br />
✔ mal vues en coloration standard, on les met en évidence grâce à un AC<br />
anti-protéine S100.<br />
➢ les cellules ganglionnaires nerveuses.<br />
• Les capillaires (oui, fenêtrés) se jettent dans des veinules, qui se jettent dans la veine<br />
centrale de la surrénale,<br />
• Et, lors du syndrome d'adaptation au stress, il y a libération massive et rapide des hormones<br />
(adrénaline et noradrénaline) stockées dans les cellules directement dans ce gros vaisseau<br />
qu'est la veine centrale de la surrénale (« montée d'adrénaline » dans le langage des villes et<br />
des campagnes).<br />
• Les artères sont de leur côté dites capsulaires (vous savez pourquoi), et traversent la glande<br />
pour se diriger vers le centre de celle-ci.<br />
a. particularités des phéochromocytes.<br />
• Immunophénotype (inverse de la cortico-surrénale):<br />
➢ chromogranine +<br />
➢ synaptophysine -<br />
• Physico-chimique:<br />
➢ au contact de l'O2 de l'air, ces cellules changent de couleur pour virer au brun,<br />
par oxydation des granules cytoplasmiques, 7/8
➢ elles ont une affinité au chrome et à l'argent,<br />
➢ exposées à des vapeurs de formaldéhyde ainsi qu'à des UltraViolet (comité de<br />
lutte contre les abréviations), elles donnent une fluorescence jaune verdâtre,<br />
➢ au Microscope Électronique, on trouve des granules neurosécrétoires,<br />
➢ l'adrénaline et la noradrénaline sont synthétisées et stockées (libération directe<br />
faible) en vue d'une adaptation au stress sous le contrôle du système nerveux<br />
autonome.<br />
b. organisation de la commande nerveuse.<br />
• Toutes les cellules sont reliées aux terminaisons nerveuses cholinergiques pour une<br />
libération en grande quantité dans le sang, avec des effets:<br />
➢ vasoconstriction immédiate,<br />
➢ HTA,<br />
➢ modifications du rythme cardiaque,<br />
➢ augmentation de la glycémie.<br />
c. autres localisations.<br />
• On trouve des îlots de médullo-surrénale autre part dans l'organisme, avec une structure et<br />
des sécrétions similaires: ce sont des para-ganglions, situés à proximité des ganglion du<br />
système nerveux autonome et des viscères. Ils peuvent être à l'origine de tumeurs: les<br />
paragangliomes.<br />
d. pathologies.<br />
• Phéochromocytome: entrainant hyperglycémie et HTA paroxystique (à savoir avant une<br />
anesthésie).<br />
8/8
Anat endo et SN Catala Hélène<br />
Pr Chaynes Daluz Laurent<br />
28/09/10, 8h-9h<br />
L'hypophyse<br />
Ce cours est commun avec l'anat SN, et donc à l'exam, il pourra tomber soit en anat endo, soit en<br />
anat SN, soit dans les 2, les questions étant bien sûr différentes.<br />
I- Généralités<br />
L'hypophyse est une glande endocrine couplée au système nerveux, constituée de 2 parties:<br />
– 1 nerveuse: la neurohypophyse<br />
– 1 glandulaire: l'adénohypophyse.<br />
Ce sont deux hypophyses qui fonctionnent ensemble et sont couplées à l'hypothalamus: c'est le<br />
couplage hypothalamohypophysaire. (schéma 1)<br />
La partie glandulaire provient de la bouche de l'embryon, le stomodeum, qui se replit, se détache et<br />
migre pour s'accoler au tube neural, et sera individualisé pour former une glande à la face inférieure<br />
du cerveau. Il persiste quelques cellules d'adénohypophyse sur le trajer, faisant qu'en pratique, une<br />
résection d'hypophyse est sans effet: rien ne se passe car ce sont des hypophyses accessoires. Elles<br />
peuvent être sujettes à des tumeurs bénignes: ce sont des adénomes de l'hypophyse. (schéma 2)
L'hypophyse est reliée au système nerveux par la tige pituitaire (schéma 3).<br />
On note la présence d'un trou: c'est une poche qui s'est refermée, délimitant ainsi une cavité tout le<br />
temps présente: la fente hypophysaire (cf schéma 1)<br />
La partie antérieure se développe plus que la postérieure. La fente hypophysaire a une localisation:<br />
– pour les radiologues: entre la neuro et l'adénohypophyse<br />
– pour les anatomistes: entre une partie antérieure et une partie postérieure de l'adénohypophyse.<br />
Le prof a fait la distinction car parfois, la fente est plus marquée que d'habitude sur une radio en,<br />
trauma, car elle contient un kyste, le kyste de la poche de RATHKE, qui n'est pas une tumeur: cela<br />
est tout à fait normal, il s'agit juste de variations morphologiques. Le reste peut donner des<br />
adénomes. La partie suppérieure de la neurohypophyse peut entourer la naissance de la tige, mais<br />
c'est peu important.<br />
1/8
II- Vascularisation<br />
La vascularisation de l'hpophyse est particulière. L'apport est artériel et provient de la<br />
vascularisation du système nerveux:<br />
– l'artère hypophysaire antérieure: elle donne des branches qui donnent naissance à une<br />
vascularisation périphérique en anneau, puis des branches allant à l'intérieur du tissu décrivant 2<br />
territoires, un central et un périphérique. Suivront ensuite les capillaires, puis les veines.<br />
– l'artère hypophysaire inférieure: Idem<br />
Elles proviennent toutes deux de la carotide interne. (cf schéma 3, mais refait), et se poursuivent par<br />
des veines.<br />
Attention: il n'y a pas de sang artériel qui arrive à l'adénohypophyse: les veines arrivent à<br />
l'adénohypophyse et en partent: c'est une vascularisation porte, comme le foie.<br />
Le drainage veineux se fait dans le sinus caverneux situé autour.<br />
III- Localisation et rapports<br />
L'hypophyse se trouve dans la selle turcique (qui se trouve dans l'os sphénoïde, os pneumatisé,<br />
2/8
derrière les yeux, à la base du crâne sous le cerveau). C'est une loge osseuse méningée, cad<br />
recouverte de méninge, la duremère. (schéma 4) 3/8<br />
Schéma 5 et 6: Ce qui suit est un commentaire des schémas, le prof est allé d'un schéma à l'autre.<br />
4/8
– On visualise le sphénoïde avec les sinus sphénoïdaux. La selle est relativement plate (elle<br />
apparaît cresuée sur une vue latérale ou saggitale médiane). Elle est recouverte de duremère,<br />
comme tout os de la base du crâne.<br />
– Entre les processus sphénoïdes antérieur et postérieur se trouvent les ligaments interclénoïdiens.<br />
– La tente du cervelet est tendue entre les processus clénoïdes antérieurs, son bord libre situé au<br />
niveau des processus clénoïdes antérieurs.<br />
– Entre les 2 ligaments clénoïdes se trouve la tente de l'hypophyse, percée d'un orficice laissant<br />
passer la tige pituitaire. La taille du trou n'a aucun rapport avec la taille de la tige, il peut-être<br />
de taille suffisante ou un peu plus gros.<br />
– L'hypophyse apparaît applatie car en haut se trouve la tente. Latéralement on peut trouver de la<br />
duremère, mais elle n'y est pa très résistante.<br />
– Le sinus caverneux est une portion de la paroi latérale du sphénoïde dans un dédoublement de<br />
duremère, et il contient la carotide interne, qui prend presque toute la place. Les veines forment<br />
un plexus, elles sont reliées entre elles.<br />
Il existe des morphologies hypophysaires différentes, avec des possibilités de présence d'hypophyse<br />
contre la carotide interne: elle est donc en rapport immédiat avec l'hypophyse, donnant les artères<br />
hypophysaires antérieure et postérieure.<br />
Concernant les nerfs de la région, il y a:<br />
● Le chiasma optique juste au dessus (nerf II). S'il y a un adénome de l'hypophyse, on peut<br />
avoir une compression du chiasma optique, entrainant une atteinte du champs visuel<br />
(problème dans l'exploration de l'espace). On ne voit pas ce qu'il y a sur le côté: c'est une<br />
hémianopsie (perte de la moitié du champs visuel) bitemporale (les 2 champs temporaux<br />
sont impliqués).<br />
● Le trijumeau: nerfs: V1 ophtalmique dans la fissure ophtalmique suppérieure 5/8
V2 maxillaire dans le foramène rond<br />
V3 oculomoteur dans le foramène ovale.<br />
● Entre II et le V on trouve le III oculomoteur et le IV trochléaire.<br />
On retrouve dans la fissure orbitaire suppérieure les nerfs III, IV, VI( contre la paroi de la carotide<br />
interne) et le V1<br />
Un gros adénome peut entrainer un trouble de l'oculomotricité.<br />
IV- Organisation et fonctionnement<br />
L'hypophyse est une glande qui secrète des hormones:<br />
– Prolaptine<br />
– FSH/LH: hormones sexuelles<br />
– GH ou somathormone: hormone de croissance<br />
– Ocytocine, sécrétée par la neurohypophyse<br />
– ADH: hormone anti-diurétique<br />
schémas 7 et 8: Idem pour ces 2 schémas, le prof est allé de l'un à l'autre.<br />
6/8
L'hypothalamus appartient à la paroi latérale du 3e ventricule, et est plus antérieur. Il est constitué<br />
de 2 parties:<br />
– les noyaux latéraux (petits amas de corps cellulaires)<br />
– les noyaux dans la paroi du 3e ventricule<br />
– les noyaux préoptique PO, paraventriculaire ΠV et supraoptique SO (qui sont plutôt antérieurs).<br />
Le 3e ventricule décrit une pointe: c'est l'infundibulum qui se poursuit par la tige pituitaire. Il<br />
comporte 3 noyaux: le ventromédian VM, le dorsomédian DM et l'inférieur I.<br />
Les corps mamillaires appartiennent à l'hypothalamus et en constituent les noyaux inférieurs. Il<br />
existe des noyaux postérieurs. Les noyaux antérieurs et moyens sont couplés à l'hypophyse.<br />
La neurohypophyse<br />
Les corps cellulaires des neurones se trouvent dans les noyaux optiques, supraoptique et<br />
paraventriculaire. Ils sécrètent l'ADH et l'Ocytocine. Leurs axones se situent dans la tige pituitaire<br />
et permettent sa constitution.<br />
L'adénohypophyse<br />
Les cellules sécrètent des hormones à condition de recevoir un signal, qui ne peut être donné que<br />
par l'hypothalamus. En effet, l'hypothalamus sécrète une pré-hormone, un releasing factor qui va<br />
stimuler la sécrétion hypophysaire. Leurs corps cellulaires se trouvent dans les noyaux moyens et<br />
ventromédian. La terminaison de l'axone est dans l'infundibulum au niveau de l'origine de la tige<br />
pituitaire. Or l'adénohypophyse est tout en bas! Le releasing factor devra donc emprunter la
circulation sanguine pour la rejoindre, via la vascularisation veineuse.<br />
Si la tige est sectionnée, la neurohypophyse ne fonctionne plus. Il n'y aura plus de sécrétion d'ADH,<br />
le sujet urinera énormément (devra boire jusqu'à 10L par jour). Cependant, il n'y aura aucun effet<br />
sur l'adénohypophyse car il y aura toujours une vascularisation de retour: le releasing factor<br />
rejoindra la circulation générale pour atteindre ensuite l'adénohypophyse. On n'aura donc pas<br />
d'insuffisance hypophysaire. En plus, il ne faut pas oublier l'existence des hypophyses accessoires!!<br />
En conclusion, on aura donc une insuffisance neurohypophysaire sûre, et une insuffisance<br />
adénohypophysaire non certaine. Ces 2 glandes fonctionnent en couplage, mais pas de la même<br />
façon.<br />
8/8