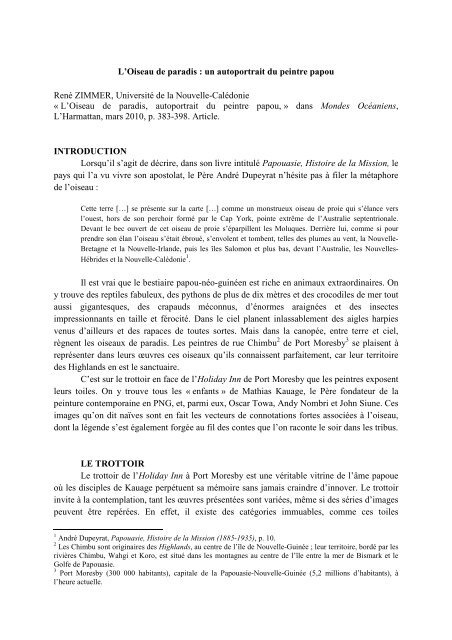CNEP L'oiseau de paradis un autoportrait du peintre papou
CNEP L'oiseau de paradis un autoportrait du peintre papou
CNEP L'oiseau de paradis un autoportrait du peintre papou
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’Oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> : <strong>un</strong> <strong>autoportrait</strong> <strong>du</strong> <strong>peintre</strong> <strong>papou</strong><br />
René ZIMMER, Université <strong>de</strong> la Nouvelle-Calédonie<br />
« L’Oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>, <strong>autoportrait</strong> <strong>du</strong> <strong>peintre</strong> <strong>papou</strong>, » dans Mon<strong>de</strong>s Océaniens,<br />
L’Harmattan, mars 2010, p. 383-398. Article.<br />
INTRODUCTION<br />
Lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> décrire, dans son livre intitulé Papouasie, Histoire <strong>de</strong> la Mission, le<br />
pays qui l’a vu vivre son apostolat, le Père André Dupeyrat n’hésite pas à filer la métaphore<br />
<strong>de</strong> l’oiseau :<br />
Cette terre […] se présente sur la carte […] comme <strong>un</strong> monstrueux oiseau <strong>de</strong> proie qui s’élance vers<br />
l’ouest, hors <strong>de</strong> son perchoir formé par le Cap York, pointe extrême <strong>de</strong> l’Australie septentrionale.<br />
Devant le bec ouvert <strong>de</strong> cet oiseau <strong>de</strong> proie s’éparpillent les Moluques. Derrière lui, comme si pour<br />
prendre son élan l’oiseau s’était ébroué, s’envolent et tombent, telles <strong>de</strong>s plumes au vent, la Nouvelle-<br />
Bretagne et la Nouvelle-Irlan<strong>de</strong>, puis les îles Salomon et plus bas, <strong>de</strong>vant l’Australie, les Nouvelles-<br />
Hébri<strong>de</strong>s et la Nouvelle-Calédonie 1 .<br />
Il est vrai que le bestiaire <strong>papou</strong>-néo-guinéen est riche en animaux extraordinaires. On<br />
y trouve <strong>de</strong>s reptiles fabuleux, <strong>de</strong>s pythons <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> dix mètres et <strong>de</strong>s crocodiles <strong>de</strong> mer tout<br />
aussi gigantesques, <strong>de</strong>s crapauds méconnus, d’énormes araignées et <strong>de</strong>s insectes<br />
impressionnants en taille et férocité. Dans le ciel planent inlassablement <strong>de</strong>s aigles harpies<br />
venus d’ailleurs et <strong>de</strong>s rapaces <strong>de</strong> toutes sortes. Mais dans la canopée, entre terre et ciel,<br />
règnent les oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>. Les <strong>peintre</strong>s <strong>de</strong> rue Chimbu 2 <strong>de</strong> Port Moresby 3 se plaisent à<br />
représenter dans leurs œuvres ces oiseaux qu’ils connaissent parfaitement, car leur territoire<br />
<strong>de</strong>s Highlands en est le sanctuaire.<br />
C’est sur le trottoir en face <strong>de</strong> l’Holiday Inn <strong>de</strong> Port Moresby que les <strong>peintre</strong>s exposent<br />
leurs toiles. On y trouve tous les « enfants » <strong>de</strong> Mathias Kauage, le Père fondateur <strong>de</strong> la<br />
peinture contemporaine en PNG, et, parmi eux, Oscar Towa, Andy Nombri et John Si<strong>un</strong>e. Ces<br />
images qu’on dit naïves sont en fait les vecteurs <strong>de</strong> connotations fortes associées à l’oiseau,<br />
dont la légen<strong>de</strong> s’est également forgée au fil <strong>de</strong>s contes que l’on raconte le soir dans les tribus.<br />
LE TROTTOIR<br />
Le trottoir <strong>de</strong> l’Holiday Inn à Port Moresby est <strong>un</strong>e véritable vitrine <strong>de</strong> l’âme <strong>papou</strong>e<br />
où les disciples <strong>de</strong> Kauage perpétuent sa mémoire sans jamais craindre d’innover. Le trottoir<br />
invite à la contemplation, tant les œuvres présentées sont variées, même si <strong>de</strong>s séries d’images<br />
peuvent être repérées. En effet, il existe <strong>de</strong>s catégories immuables, comme ces toiles<br />
1 André Dupeyrat, Papouasie, Histoire <strong>de</strong> la Mission (1885-1935), p. 10.<br />
2 Les Chimbu sont originaires <strong>de</strong>s Highlands, au centre <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Nouvelle-Guinée ; leur territoire, bordé par les<br />
rivières Chimbu, Wahgi et Koro, est situé dans les montagnes au centre <strong>de</strong> l’île entre la mer <strong>de</strong> Bismark et le<br />
Golfe <strong>de</strong> Papouasie.<br />
3 Port Moresby (300 000 habitants), capitale <strong>de</strong> la Papouasie-Nouvelle-Guinée (5,2 millions d’habitants), à<br />
l’heure actuelle.
eprésentant <strong>de</strong>s oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> que les <strong>peintre</strong>s mettent volontiers en scène. Dans la<br />
plupart d’entre elles sont représentés <strong>de</strong>ux oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> se faisant face, encadrant <strong>un</strong> nid<br />
contenant <strong>de</strong>ux, trois ou quatre œufs. Le cliché romantique est souvent brisé par la présence<br />
<strong>de</strong> geckos semblant avi<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dévorer les petits dans l’œuf. La seule ressource <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
oiseaux reste alors <strong>de</strong> crier leur impuissance, ce qu’ils semblent faire. Le drame est imminent<br />
et les œufs craquelés, indices <strong>de</strong> l’éclosion proche, rajoutent au pathétique <strong>de</strong> la scène saisie<br />
juste avant l’acte criminel. Toutefois, le caractère naïf <strong>de</strong> ces œuvres n’angoisse pas celui qui<br />
les contemple : l’image est figée, le temps est suspen<strong>du</strong> et, dans ces conditions <strong>de</strong> présent<br />
éternel, l’esprit est en paix. Les représentations sont nombreuses et offrent <strong>de</strong> nombreuses<br />
variations sur le thème ordinaire tel qu’il a été défini ci-<strong>de</strong>ssus. Voici quelques exemples :<br />
Deux <strong>paradis</strong>iers <strong>de</strong> Raggi 4 sont les figures principales d’<strong>un</strong>e toile d’Oscar Towa,<br />
peinte en 2005, avec la légen<strong>de</strong> « Tupela pisin paradais i was long kiau istap. 5 » Ils sont<br />
perchés sur <strong>un</strong> casuarina 6 et, se faisant face, semblent se dévisager ; entre eux <strong>de</strong>ux se trouve<br />
<strong>un</strong> nid contenant trois œufs. Il semblerait que l’objet <strong>de</strong> la confrontation vise à prédéterminer<br />
lequel <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux protagonistes se montrera le plus apte à perpétuer l’espèce, car il n’y aura<br />
qu’<strong>un</strong> élu désigné par la femelle. Les <strong>de</strong>ux oiseaux exhibent la parure spectaculaire <strong>de</strong>s mâles<br />
<strong>de</strong> l’espèce, comprenant <strong>de</strong>s ja<strong>un</strong>es éclatants et <strong>de</strong>s vermillons soutenus. Le panache ja<strong>un</strong>e <strong>du</strong><br />
bout <strong>de</strong> la queue est <strong>un</strong> rajout artistique. Les tons pastel et la toile <strong>de</strong> fond gris bleu donnent<br />
<strong>un</strong>e note <strong>de</strong> paix et <strong>de</strong> sérénité à cet ensemble somme toute rassurant. Chez le <strong>paradis</strong>ier <strong>de</strong><br />
Raggi, le mâle para<strong>de</strong> à partir d’<strong>un</strong> lek 7 au sommet d’<strong>un</strong> arbre. Quand les femelles se<br />
présentent, les vingt ou trente mâles en attente sont soudainement pris <strong>de</strong> frénésie et sautent<br />
dans tous les sens en claquant <strong>du</strong> bec, battant <strong>de</strong>s ailes bruyamment et gonflant leurs plumes.<br />
Ce moment intense passé, les mâles rivalisent <strong>de</strong> <strong>de</strong>xtérité et tentent d’imposer leurs para<strong>de</strong>s<br />
4 Paradisaea raggiana ; Raggiana Bird-of-<strong>paradis</strong>e.<br />
5 Tupela pisin <strong>paradis</strong> i was long kiau i stap : les <strong>de</strong>ux oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> surveillent leurs œufs.<br />
6 Casuarina (Yar en Tok pisin.) : appelé également filao ou chêne-femelle, c’est <strong>un</strong> arbre pouvant atteindre<br />
trente-cinq mètres. Le feuillage est très fin et les feuilles se présentent en écailles. Les fruits sont semblables aux<br />
cônes <strong>de</strong>s conifères et évoquent <strong>un</strong>e grena<strong>de</strong> à main.<br />
7 Lek, ou aire <strong>de</strong> para<strong>de</strong>.
spectaculaires pour influencer les femelles. Les élus sont ceux dont le plumage est le plus<br />
chatoyant et dont les para<strong>de</strong>s sont les plus spectaculaires. Les autres continueront <strong>de</strong> para<strong>de</strong>r<br />
en vain ad vitam aeternam.<br />
Sur le même trottoir, en 2008, avec <strong>un</strong>e visée plus citoyenne, Andy Nombri propose<br />
<strong>un</strong> oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> perché sur <strong>un</strong>e lance en forme <strong>de</strong> flèche faîtière. Cette œuvre baroque<br />
offre <strong>un</strong>e exubérance <strong>de</strong> formes géométriques imbriquées aux couleurs vives. Il est difficile<br />
d’i<strong>de</strong>ntifier précisément l’oiseau stylisé, mais il est certain qu’il s’agit d’<strong>un</strong> mâle appartenant<br />
aux espèces polygames, car le plumage est magnifique. La base <strong>du</strong> bec violacé est bordée <strong>de</strong><br />
noir. La calotte est ja<strong>un</strong>e mais le gorgerin et la gorge sont vert émerau<strong>de</strong>. Le ventre est d’<strong>un</strong><br />
gris clair chatoyant. Les rémiges tertiaires sont bistrées, les secondaires bleu azur et les<br />
primaires vermillon. Trois éventails successifs viennent orner la queue qui se décline en<br />
ja<strong>un</strong>e, rouge et br<strong>un</strong> olive. L’oiseau est entouré <strong>de</strong> signes apparemment disparates comme le<br />
tambour k<strong>un</strong><strong>du</strong>, la poterie lapita, le bouclier asmat, le masque <strong>du</strong>k <strong>du</strong>k <strong>de</strong> la Nouvelle-Irlan<strong>de</strong>,<br />
l’herminette et les monnaies <strong>de</strong> coquillage, mais ceux-ci figurent en fait les principaux signes<br />
i<strong>de</strong>ntitaires <strong>de</strong> la nation. Le fond bleu roi présente les motifs géométriques traditionnels <strong>de</strong>s<br />
Lapita, stylisant <strong>de</strong>s tortues. Un bilum pen<strong>du</strong> à la lance en flèche faîtière occupe le centre <strong>de</strong><br />
l’image, mais c’est bien l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>, emblème premier <strong>de</strong> la Papouasie-Nouvelle-<br />
Guinée, qui s’en dégage en personnage principal.
A quelques pas <strong>de</strong> là, John Si<strong>un</strong>e présente <strong>de</strong>s <strong>paradis</strong>iers fastueux 8 reconnaissables à<br />
leur interminable queue noire et leur bec incurvé vers le bas. L’oiseau, qui, dans la nature, se<br />
plaît entre 1300 et 2300 mètres, est endémique aux Highlands et son territoire embrasse<br />
parfaitement celui <strong>de</strong>s Chimbu. Les <strong>de</strong>ux <strong>paradis</strong>iers fastueux <strong>de</strong> l’œuvre sont perchés sur la<br />
même branche d’<strong>un</strong> casuarina et se toisent, entrecroisant leurs becs violacés. Leur parure est<br />
sombre, bleu nuit et noire. Une petite frange <strong>de</strong> rémiges secondaires roses et ja<strong>un</strong>es, créant<br />
<strong>un</strong>e irisation cuivrée, et <strong>un</strong>e rangée <strong>de</strong> rémiges tertiaires bleu azur ourlées <strong>de</strong> bleu nuit,<br />
viennent égayer l’ensemble. Les <strong>de</strong>ux acteurs ont l’œil rouge, mais semblent se défier sans<br />
gran<strong>de</strong> animosité. Dans la réalité zoologique, la femelle présente <strong>un</strong> dos br<strong>un</strong> olive et <strong>un</strong><br />
capuchon br<strong>un</strong>, <strong>un</strong> plastron noirâtre ; le corps est grisâtre avec <strong>de</strong> fines barres noires. Pour<br />
l’artiste, celle-ci présente sans doute <strong>un</strong> intérêt esthétique moindre que le mâle. Cependant, il<br />
est fort probable que l’intérêt <strong>de</strong> l’artiste ait porté, ici comme ailleurs, plus sur la lutte pour la<br />
procréation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux rivaux que sur la prise <strong>de</strong> possession <strong>de</strong> la femelle.<br />
L’IMAGE<br />
Comment les Papous <strong>de</strong> Port Moresby, dont les Chimbu sont les représentants sur le<br />
trottoir aux images, considèrent-ils cet oiseau emblème ? Quelle est la valeur réelle <strong>de</strong> la<br />
naïve image, en termes d’emblème national, <strong>de</strong> mythe occi<strong>de</strong>ntal, <strong>de</strong> castration cléricale et <strong>de</strong><br />
contagion ?<br />
Un couple d’oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> veillant sur les autres symboles <strong>de</strong> la nation figure en<br />
bonne place sur la faça<strong>de</strong> <strong>du</strong> Parlement 9 , dont la décoration motif par motif fut confiée à <strong>de</strong>ux<br />
<strong>peintre</strong>s, l’<strong>un</strong> d’eux étant Mathias Kauage, qui, pour l’occasion, s’en tint à <strong>de</strong>s motifs<br />
traditionnels 10 . Le <strong>peintre</strong>, qui avait carte blanche, présenta les oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> comme les<br />
8 Epimachus fastuosus ; Black Sicklebill.<br />
9 Tambaran : maison <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong>s villages <strong>papou</strong>s, dont le parlement <strong>de</strong> PNG est <strong>un</strong>e stylisation.<br />
10 Il imagina <strong>un</strong> hélicoptère sous la voûte étoilée à hauteur <strong>du</strong> toit qui constitue son hommage à la mo<strong>de</strong>rnité.
indiscutables gardiens <strong>de</strong> la Constitution, encadrant tous les autres animaux <strong>de</strong> la création<br />
<strong>papou</strong>e, observant les activités humaines et faisant le lien entre la mer et le ciel. A ses yeux,<br />
l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> s’était imposé au travers <strong>de</strong>s croyances et légen<strong>de</strong>s populaires comme le<br />
premier signe i<strong>de</strong>ntitaire <strong>de</strong> la nation <strong>papou</strong>e.<br />
Le mythe <strong>de</strong> l’oiseau <strong>du</strong> <strong>paradis</strong> est d’abord l’œuvre <strong>de</strong>s occi<strong>de</strong>ntaux. Quand<br />
l’expédition <strong>de</strong> Magellan accosta aux Moluques 11 , le raja <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Batjan offrit à Charles<br />
Quint, commanditaire <strong>de</strong> l’expédition, <strong>de</strong>ux dépouilles <strong>de</strong> l’oiseau <strong>de</strong> Dieu. Celles-ci étant<br />
considérées comme <strong>de</strong>s talismans <strong>de</strong> survie, le roi en fit présent à l’évêque <strong>de</strong> Valladolid. Plus<br />
tard, les marchands portugais rapportèrent <strong>de</strong>s spécimens <strong>de</strong> grand <strong>paradis</strong>ier que l’on baptisa<br />
<strong>du</strong> nom <strong>de</strong> « <strong>paradis</strong>ier apo<strong>de</strong>. » Les chasseurs locaux, soucieux <strong>de</strong> protéger le plumage <strong>de</strong><br />
l’oiseau lors <strong>de</strong>s manipulations et <strong>du</strong> transport, avaient coutume <strong>de</strong> sectionner les pattes<br />
griffues <strong>de</strong> l’oiseau qui risquaient d’abimer son plumage somptueux, d’où le mythe <strong>de</strong><br />
l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>, dont la femelle pond et couve ses œufs sur le dos <strong>du</strong> mâle qui ne se pose<br />
jamais et qui semble être <strong>de</strong>scen<strong>du</strong> <strong>de</strong>s cieux pour survoler le <strong>paradis</strong> terrestre et nicher au<br />
faîte <strong>de</strong>s grands casuarinas. Ce n’est que dans les années 1850 que les premiers scientifiques<br />
purent observer <strong>de</strong>s oiseaux vivants et rétablir <strong>un</strong>e part <strong>de</strong> vérité sur leur vie et mœurs. Mais le<br />
divin oiseau allait s’appeler l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> pour l’éternité.<br />
S’il est bien évi<strong>de</strong>nt que les <strong>peintre</strong>s <strong>de</strong> rues ont compris que le cliché romantique à<br />
l’occi<strong>de</strong>ntale se vendait bien, ils ont également revu leur vision <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> au prisme <strong>de</strong>s<br />
missionnaires et <strong>de</strong> leur conception <strong>de</strong> l’animal héritée <strong>de</strong>s cathédrales et <strong>de</strong>s bestiaires<br />
médiévaux. Ceux-ci, très au fait <strong>du</strong> pouvoir didactique <strong>de</strong> l’image, ne pouvaient guère<br />
permettre que s’exprime aux yeux <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> <strong>papou</strong>, l’image mille fois répétée d’<strong>un</strong> sé<strong>du</strong>cteur<br />
endiablé et perpétuel inassouvi. De plus, la créature est polygame et grimée et gonfle<br />
collerette et plastron pour assouvir ses instincts les plus vils par sé<strong>du</strong>ction. N’est-elle pas, <strong>de</strong><br />
surcroît, <strong>de</strong>scen<strong>du</strong>e <strong>du</strong> <strong>paradis</strong> à tire-d’aile. Sur le trottoir, les <strong>peintre</strong>s Chimbu, serviteurs <strong>de</strong><br />
l’Eglise, donnent <strong>un</strong>e version é<strong>du</strong>lcorée <strong>du</strong> bouillant animal. Il n’en reste pas moins que par le<br />
biais <strong>de</strong> l’image figée filtrent les réalités zoologiques et culturelles que les Chimbu ne<br />
manquent pas d’y associer, dans leur esprit.<br />
La correspondance entre sôma et psyché chez le Papou et l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> peut être<br />
clairement établie. Il y a <strong>un</strong>e adéquation d’ordre comportemental entre l’homme <strong>papou</strong> et le<br />
<strong>paradis</strong>ier mâle polygame. De la même façon qu’il existe <strong>un</strong>e i<strong>de</strong>ntité structurelle<br />
fondamentale <strong>du</strong> corps animal et humain, il existe <strong>un</strong>e i<strong>de</strong>ntité structurelle <strong>de</strong> la psyché<br />
animale et humaine qui, pour abstraite qu’elle soit, peut être mise en évi<strong>de</strong>nce par <strong>de</strong> simples<br />
observations d’ordre éthologiques. Il y a chez ces <strong>de</strong>ux créatures le même sens <strong>de</strong> la danse, <strong>de</strong><br />
la para<strong>de</strong>, <strong>de</strong> la peinture faciale et corporelle et <strong>de</strong> la mise en scène <strong>de</strong> l’ego en général. Chez<br />
l’<strong>un</strong> comme chez l’autre, les femmes font ban<strong>de</strong> à part. Chez l’<strong>un</strong> comme chez l’autre, non<br />
content d’être grimés, on parle, on rit et savoir bien chanter n’est pas forcément nécessaire 12 .<br />
11 Le six novembre 1521, les survivants <strong>de</strong> l’expédition Magellan atteignirent les îles Moluques et y firent<br />
provision d’épices. Un an plus tard, le 6 novembre 1522, les dix-neuf rescapés pénétrèrent dans la baie <strong>de</strong> San<br />
Lucar, confirmant la rotondité <strong>de</strong> la terre.<br />
12 « Et les cent espèces d’oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> dont, seule, la Nouvelle-Guinée peut s’enorgueillir, règnent par la<br />
beauté sur cette féerie. Parmi tous ces oiseaux, certains rient bruyamment au fond <strong>de</strong> la forêt, d’autres sonnent<br />
comme <strong>de</strong>s cloches, certains parlent comme l’homme, beaucoup croassent, tels que les rauques <strong>paradis</strong>iers, mais<br />
il en est très peu qui puissent chanter comme le plus humble <strong>de</strong> nos loriots… ». A.Dupeyrat, Papouasie, Histoire<br />
<strong>de</strong> la mission, p.15.
L’adéquation entre le Papou et l’animal s’affiche pleinement dans les contes, qui mettent en<br />
relation l’oiseau divin et le Papou grâce à la magie <strong>de</strong>s esprits <strong>de</strong> la forêt.<br />
L’ADEQUATION PAR LES CONTES<br />
Les contes <strong>de</strong> Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été recueillis par le journal Wantok <strong>de</strong><br />
1972 à 1987, au rythme d’<strong>un</strong> par semaine ou quinzaine. Ces histoires ont été tra<strong>du</strong>ites <strong>du</strong> Tok<br />
pisin en anglais dans One Thousand One Papua New Guinean Nights, Volume 1 (1972-1985)<br />
et volume 2 (1986-1987). L’ensemble comprend 1047 contes. Depuis sa création, Wantok<br />
<strong>de</strong>meure l’<strong>un</strong>e <strong>de</strong>s seules sources <strong>de</strong> lecture pour les Papous capables <strong>de</strong> lire le Tok pisin.<br />
Ceux qui maîtrisaient la lecture <strong>de</strong> la langue pouvaient lire les histoires aux non lecteurs. Les<br />
contes recueillis, très atten<strong>du</strong>s, donnèrent lieu à commentaires et discussions et les Chimbu <strong>de</strong><br />
Port Moresby, déjà porteurs <strong>de</strong> leurs contes, n’ont pas manqué <strong>de</strong> se nourrir d’histoires<br />
colportées par les narrateurs originaires <strong>de</strong> toutes les autres provinces <strong>de</strong> Papouasie-Nouvelle-<br />
Guinée.<br />
Les transformations concernant le Papou et l’oiseau sont fréquentes. La genèse <strong>de</strong><br />
l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> 13 fait l’objet <strong>du</strong> conte noté Wantok 97 14 . Le conteur raconte qu’<strong>un</strong> couple<br />
<strong>de</strong> vieux se retrouve sans <strong>de</strong>scendance et ils se font <strong>du</strong> souci pour leurs vieux jours :<br />
Quelque temps après arriva <strong>un</strong> oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> qui se percha sur <strong>un</strong> casuarina près <strong>de</strong> leur maison. Le<br />
vieil homme vit l’oiseau et le montra <strong>du</strong> doigt à la vieille femme. La vieille femme se leva et parla à<br />
l’homme. Elle dit : « Oh, vieil homme, grimpe à cet arbre et attrape cet oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>. Puis<br />
re<strong>de</strong>scend et nous nous en occuperons. » Après que la vieille femme eut prononcé ces mots, le vieil<br />
homme grimpa au casuarina. Il attrapa l’oiseau et en re<strong>de</strong>scendit. Ils emmenèrent l’oiseau chez eux et<br />
lui rendirent sa liberté, le posant sur le lit. Cette nuit, les <strong>de</strong>ux vieux dormirent. L’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong><br />
dormit avec eux dans leur lit. Ils dormirent jusqu’au matin quand ils se rendirent compte que l’oiseau<br />
n’était plus là. Mais dans le lit, ils virent <strong>un</strong> petit garçon qui dormait. Ils savaient que c’était l’oiseau <strong>de</strong><br />
<strong>paradis</strong> qui s’était transformé en garçon.<br />
Le vieux couple est à présent ravi, car le je<strong>un</strong>e garçon va s’occuper d’eux, puis celui-ci<br />
<strong>de</strong>viendra, selon leurs termes, quelqu’<strong>un</strong> <strong>de</strong> très important, avec femme et enfants. La<br />
transformation n’est cependant jamais acquise définitivement et semble réversible, comme<br />
dans Wantok 827 15 où le Chimbu O<strong>un</strong>okorokumugl ne <strong>de</strong>scendra jamais <strong>de</strong> l’arbre dans lequel<br />
son père lui a <strong>de</strong>mandé <strong>de</strong> monter pour rabattre <strong>du</strong> gibier, préférant se transformer en oiseau<br />
<strong>de</strong> <strong>paradis</strong> bleu 16 .<br />
De toutes les transformations, c’est celle <strong>du</strong> <strong>paradis</strong>ier en femme 17 qui est la plus<br />
fréquente, comme l’attestent <strong>un</strong> grand nombre <strong>de</strong> contes. Dans Wantok 669, grâce à <strong>un</strong>e danse<br />
magique, le vieux se transforme en beau je<strong>un</strong>e homme les soirs <strong>de</strong> festival et ses <strong>de</strong>ux je<strong>un</strong>es<br />
épouses restent à la maison. Un jour elles tentent <strong>de</strong> prendre au piège le pseudo je<strong>un</strong>e homme,<br />
qui se transforme sous leurs yeux et retrouve ses traits <strong>de</strong> vieillard. “When the man came<br />
13 La genèse <strong>de</strong> l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> est le propos principal <strong>de</strong>s contes Wantok 244, 523, 634 et 828.<br />
14 Wantok <strong>du</strong> 7 août 1974, p. 4, in One Thousand One Papua New Guinean Nights, p. 29. La genèse <strong>de</strong> l’oiseau<br />
<strong>de</strong> <strong>paradis</strong> est également traitée en thème principal dans Wantok 244, 529 et 639, entre autres.<br />
15 La transformation <strong>de</strong> garçon en oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> intervient également dans Wantok 144, 294 et 612.<br />
16 Blue bird of <strong>paradis</strong>e, probablement Paradisaea rudolphi.<br />
17 La transformation <strong>de</strong> femme en oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> est l’objet <strong>de</strong> Wantok 703, 850 et 913.
close, they pulled the rope and the good-for-nothing fell on top of the sward grasses. The two<br />
women held him and said, “you’re just the man that we’ve lusted for every time we’ve seen<br />
your face.” Furieuses, elles déci<strong>de</strong>nt d’abandonner le truqueur et <strong>de</strong> retrouver leur liberté.<br />
L’<strong>un</strong>e se transforme en pigeon, l’autre en oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>. Le vieil homme crie son chagrin<br />
et sa faute, mais la transformation est irrévocable.<br />
La transformation <strong>de</strong> femmes en oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> s’applique dès lors que la situation<br />
<strong>de</strong> la je<strong>un</strong>e fille, <strong>de</strong> l’épouse, <strong>de</strong> la sœur ou <strong>de</strong> la mère <strong>de</strong>vient insoutenable, comme dans le<br />
conte Wantok 703, où la femme battue se transforme en oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> afin d’échapper à sa<br />
triste vie ou dans Wantok 828, dans lequel la transformation s’opère afin que la je<strong>un</strong>e femme<br />
puisse échapper aux coups <strong>de</strong> son frère brutal. Ces contes évoquent le mythe <strong>de</strong> Procné et<br />
Philomèle, qui, fuyant Térée qui les poursuit avec <strong>un</strong>e hache, se transforment en hiron<strong>de</strong>lle et<br />
en rossignol.<br />
CONCLUSION<br />
Toutes les combinaisons sont imaginables dans les transformations entre les êtres<br />
humains et les oiseaux <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> : il n’est pas <strong>un</strong> village <strong>de</strong> Papouasie-Nouvelle-Guinée qui<br />
ne possè<strong>de</strong> <strong>un</strong> conte consacré à l’oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong>, sa genèse et ses métamorphoses ; il n’est<br />
pas <strong>un</strong> Papou qui ne se transforme en oiseau <strong>de</strong> <strong>paradis</strong> au gré d’<strong>un</strong> conte <strong>de</strong> son village. Sur<br />
les toiles <strong>du</strong> trottoir aux images <strong>de</strong> l’Holiday Inn, le <strong>peintre</strong> Chimbu peint sa conception <strong>du</strong><br />
mon<strong>de</strong>, <strong>un</strong> oiseau grimé, <strong>un</strong> œuf tacheté, <strong>un</strong> gecko affamé et transcen<strong>de</strong> l’image naïve. A<br />
travers son œuvre, c’est d’abord <strong>un</strong> simple oiseau qu’il représente avec son besoin impérieux<br />
<strong>de</strong> se protéger <strong>de</strong>s prédateurs pour pouvoir perpétuer l’espèce ; c’est également <strong>un</strong>e nation<br />
qu’il met en scène avec ses signes i<strong>de</strong>ntitaires et ses emblèmes ; mais, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s images,<br />
c’est lui-même qu’il dépeint, le Chimbu paré, exalté, magnifique, libre comme l’oiseau<br />
libertin dans son aire <strong>de</strong> para<strong>de</strong>, comme l’artiste au centre <strong>de</strong> son mon<strong>de</strong>.