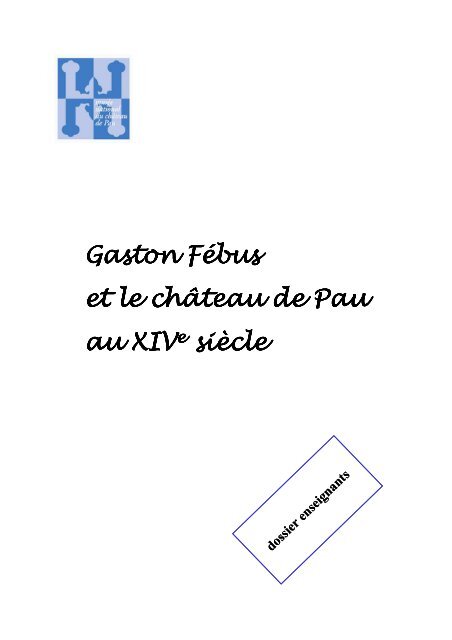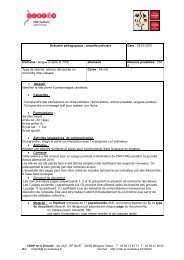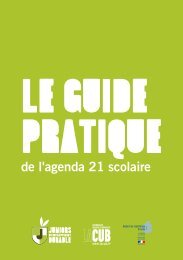Musée national du château de Pau - CRDP Aquitaine
Musée national du château de Pau - CRDP Aquitaine
Musée national du château de Pau - CRDP Aquitaine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gaston Gaston FFébus<br />
FFébus<br />
F bus<br />
bus<br />
et et le le <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong><br />
<strong>Pau</strong><br />
au au XIV XIV XIVe<br />
au au XIV XIV XIV si siècle si<br />
cle<br />
e si siècle si<br />
cle<br />
dossier dossier enseignants enseignants
GASTON GASTON FÉBUS FÉBUS ET ET LE LE CHÂTEAU CHÂTEAU DE DE DE PAU<br />
PAU<br />
AU AU XIV° XIV° SIÈCLE<br />
SIÈCLE<br />
Contexte Contexte historique historique et et géopolitique<br />
géopolitique<br />
Véronique Rébé<br />
Rébé<br />
Responsable <strong>du</strong> secteur Actions pédagoghique<br />
<strong>Musée</strong> <strong>national</strong> <strong>du</strong> <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong><br />
- En France : la guerre <strong>de</strong> Cent Ans<br />
- En Béarn : l'affirmation d'un état souverain<br />
- les origines<br />
- l'action <strong>de</strong> Gaston Fébus<br />
Transformations Transformations architecturales architecturales <strong>du</strong> <strong>du</strong> <strong>château</strong><br />
<strong>château</strong><br />
Le Le livre livre <strong>de</strong> <strong>de</strong> chasse chasse<br />
chasse<br />
Fiche Fiche élève élève : : questionnaire questionnaire à à remplir remplir après après la la visite.<br />
visite.<br />
Annexes Annexes :<br />
:<br />
Tableaux généalogiques<br />
Carte <strong>de</strong>s opérations<br />
Extraits <strong>de</strong>s « Chroniques » <strong>de</strong> Froissart et glossaire<br />
Extrait <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinée « Gaston Fébus, prince <strong>de</strong>s<br />
Pyrénées »<br />
Deux miniatures <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong> la Chasse<br />
Armes <strong>de</strong> Gaston Fébus<br />
Sources bibliographie
Contexte Contexte historique historique et et géopolitique<br />
géopolitique<br />
En France : la guerre <strong>de</strong> Cent Ans<br />
La vie <strong>de</strong> Gaston Fébus (1331-1391) et son œuvre politique s'inscrivent tout entières dans le<br />
contexte tumultueux <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> Cent Ans. La querelle dynastique entre les rois d'Angleterre et <strong>de</strong><br />
France pour la couronne <strong>de</strong> France en fut le point <strong>de</strong> départ le plus évi<strong>de</strong>nt. Lorsque Charles IV <strong>de</strong><br />
France (fils <strong>de</strong> Philippe le Bel) mourut, sa femme étant enceinte, Philippe VI <strong>de</strong> Valois, neveu <strong>de</strong><br />
Philippe le Bel et petit fils <strong>de</strong> Philippe le Hardi fut nommé régent. Puis, la princesse ayant accouché<br />
d'une fille, il fut reconnu roi (1328) par les pairs et les barons malgré les prétentions d'Edouard III, roi<br />
d'Angleterre, qui était lui-même petit-fils <strong>de</strong> Philippe IV le Bel par sa mère Isabelle <strong>de</strong> France. Les<br />
légistes français invoquèrent le principe <strong>de</strong> privilège masculin pour la succession à la couronne <strong>de</strong><br />
France, principe dont s’était prévalu pour la première fois Philippe V en 1317 pour se faire sacrer roi.<br />
Il avait réuni les Etats généraux qui déclarèrent les femmes incapables <strong>de</strong> succé<strong>de</strong>r au trône <strong>de</strong> France.<br />
(Ce n’est qu’à partir <strong>de</strong> Jean II le Bon que l’on utilise le terme <strong>de</strong> loi salique dans ce cas).<br />
Le nouveau roi <strong>de</strong> France voulut qu'Edouard III vint lui rendre l'hommage <strong>de</strong> sa vassalité pour<br />
la Guyenne et la Gascogne, conformément à la loi féodale. Ce <strong>de</strong>rnier, humilié, contesta la validité <strong>de</strong><br />
l'hommage et se mit à préparer la guerre, en nouant <strong>de</strong>s alliances avec les Flamands et l'Empereur<br />
Louis <strong>de</strong> Bavière.<br />
Dès le début <strong>de</strong>s hostilités, la flotte française fut coulée à l'Ecluse en 1340. En 1346, Edouard III<br />
envahit la France et remporta la victoire <strong>de</strong> Crécy, puis s'empara <strong>de</strong> Calais. Une trêve fut signée peu<br />
après, <strong>du</strong>rant laquelle la peste noire s'abattit sur le royaume (1348). Cette année là, Gaston III <strong>de</strong> Foix-<br />
Béarn, pas encore appelé Fébus, épousait Agnès <strong>de</strong> Navarre, sœur <strong>de</strong> Charles le Mauvais, roi <strong>de</strong><br />
Navarre. Philippe VI mourut avant la fin <strong>de</strong>s hostilités ; il avait cependant agrandi le domaine <strong>de</strong> la<br />
couronne en y ajoutant les comtés <strong>de</strong> Valois, Chartres, Anjou, Maine (<strong>de</strong> sa maison), la Champagne et<br />
la Brie (transactions avec Philippe d'Evreux, époux <strong>de</strong> Jeanne <strong>de</strong> Navarre), la seigneurie <strong>de</strong><br />
Montpellier (achat à Jacques II <strong>de</strong> Majorque), et enfin le Dauphiné, à la condition que, dans l'avenir, le<br />
fils aîné <strong>du</strong> roi porterait le titre et les armes <strong>de</strong> Dauphin (1349).<br />
Son fils aîné, Jean II le Bon lui succéda. Il fut fait prisonnier (1356) à Poitiers par le fils<br />
d'Edouard III, Edouard, Prince <strong>de</strong> Galles, le redoutable Prince Noir, appelé ainsi à cause <strong>de</strong> la couleur<br />
<strong>de</strong> son armure. La France abandonna l'<strong>Aquitaine</strong>, le Ponthieu et Calais par le traité <strong>de</strong> Brétigny (1360)<br />
qui prévoyait également le paiement d'une rançon <strong>de</strong> trois millions d'écus d'or pour la libération <strong>de</strong><br />
Jean II le Bon. Il <strong>de</strong>vait mourir en captivité, ne pouvant payer la somme <strong>de</strong>mandée. Quant au Prince<br />
Noir, il fut fait prince d'<strong>Aquitaine</strong> par son père, en 1363. Il s'installa à Bor<strong>de</strong>aux où il mena une<br />
brillante vie <strong>de</strong> cour. L'année suivante, il <strong>de</strong>mandait à Gaston Fébus son hommage pour le Béarn, le<br />
Marsan et le Gévaudan, mais ne put obtenir satisfaction en ce qui concerne le Béarn.<br />
Pendant la secon<strong>de</strong> moitié <strong>du</strong> XIV e siècle, sous Charles V, Du Guesclin reprit <strong>de</strong> nombreuses<br />
conquêtes anglaises. Charles VI succéda à son père , mais il était encore mineur et les querelles <strong>de</strong> ses<br />
oncles (<strong>du</strong>cs d'Anjou, <strong>de</strong> Berry, <strong>de</strong> Bourgogne, et <strong>du</strong> Bourbon) qui se disputaient le pouvoir<br />
fragilisaient le royaume. La France était divisée entre le clan <strong>de</strong>s Armagnac et celui <strong>de</strong>s Bourguignon.<br />
Gaston Fébus mourut en 1391, un an avant que le roi ne commence à montrer <strong>de</strong>s signes <strong>de</strong><br />
démence. Henri II, roi d'Angleterre, allié aux Bourguignon après sa victoire d'Azincourt en 1415,<br />
exploita ce fait en épousant la fille <strong>de</strong> Charles VI et en se faisant reconnaître comme héritier <strong>du</strong><br />
royaume et régent jusqu'à la mort <strong>du</strong> roi, le dauphin Charles VII étant déclaré bâtard. L'intervention <strong>de</strong><br />
Jeanne d'Arc fut le moment décisif <strong>de</strong> cette guerre qui <strong>de</strong>vait se terminer en 1453 avec la chute <strong>de</strong><br />
Bor<strong>de</strong>aux (bataille <strong>de</strong> Castillon, 1453).
En En Béarn Béarn : : l’affirmation l’affirmation d’un d’un état état souverain<br />
souverain<br />
souverain<br />
Les origines<br />
Au chapitre précé<strong>de</strong>nt, nous avons vu qu’Edouard III d’Angleterre avait refusé au roi <strong>de</strong><br />
France l’hommage <strong>de</strong> vassalité qui lui était <strong>de</strong>mandé pour la Gascogne, ce qui rendait inconfortable la<br />
situation <strong>de</strong>s vicomtes <strong>de</strong> Foix-Béarn. En effet, ils se trouvaient pris dans un réseau d’engagements<br />
vassaliques contradictoires, puisqu’ils étaient vassaux <strong>de</strong> Philippe VI, roi <strong>de</strong> France pour le Foix , le<br />
Nébouzan, le Lautrec et l’Albigeois, mais vassaux d’Edouard III, roi d’Angleterre pour le Béarn, le<br />
Marsan et le Gabardan.<br />
Le père <strong>de</strong> Gaston Fébus, Gaston II le Preux, s’était rangé <strong>du</strong> coté <strong>du</strong> roi <strong>de</strong> France dès le<br />
début <strong>du</strong> conflit. Son fils, le 26 septembre 1347, proclama publiquement qu’il se considérait en Béarn<br />
comme le seul maître après Dieu, se fondant pour cela sur l’histoire <strong>de</strong>s précé<strong>de</strong>nts vicomtes <strong>de</strong> Béarn,<br />
affranchis <strong>de</strong> tout hommage selon lui.<br />
Au début <strong>du</strong> XI e siècle, <strong>du</strong> temps <strong>de</strong> Gaston IV le Croisé, les vicomtes s’étaient émancipés <strong>de</strong><br />
la tutelle <strong>de</strong>s <strong>du</strong>cs <strong>de</strong> Gascogne, ils avaient cessé <strong>de</strong> prêter hommage dès l’époque <strong>de</strong> leur participation<br />
à la Reconquista contre les musulmans dans la vallée <strong>de</strong> l’Ebre et s’étaient même arrogé le droit <strong>de</strong><br />
battre monnaie à Morlaàs, leur capitale. Gaston IV le Croisé et ses successeurs ne prêtèrent plus<br />
hommage à quiconque pendant plus d’un siècle.<br />
Puis, les vicomtes <strong>de</strong> Béarn passèrent sous le contrôle <strong>de</strong> la monarchie aragonaise, <strong>de</strong>venue<br />
très puissante <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> son association avec la Catalogne. Lorsque la dynastie catalane <strong>de</strong>s Monca<strong>de</strong><br />
s’installa en Béarn, ses vicomtes prêtèrent hommage à l’Aragon, mais, suite au désastre <strong>de</strong> la bataille<br />
<strong>de</strong> Muret (1213) où Pierre II d’Aragon <strong>de</strong>vait trouver la mort, les liens vassaliques s’amenuisèrent<br />
jusqu’à se rompre.<br />
Le Béarn se trouvait à nouveau dans une situation d’indépendance <strong>de</strong> fait. Sa capitale fut<br />
transférée <strong>de</strong> Morlaàs à Orthez.<br />
Dès lors, les rois d’Angleterre, <strong>du</strong>cs <strong>de</strong> Gascogne <strong>de</strong>puis 1152 (mariage d’Henri II Plantagenêt<br />
et Aliénor d’<strong>Aquitaine</strong>) jusqu’au début <strong>du</strong> XIII e siècle, qui n’avaient pas voulu auparavant s’engager<br />
dans une lutte avec l’Aragon pour reprendre le contrôle <strong>du</strong> Béarn réclamèrent à son vicomte Gaston<br />
VII (1229-1290, <strong>de</strong>rnier représentant <strong>de</strong> la dynastie <strong>de</strong>s Monca<strong>de</strong>) <strong>de</strong> leur prêter hommage. Celui-ci<br />
tergiversa longtemps, et se permit même d’insulter le roi d’Angleterre, mais il fut obligé <strong>de</strong> s’incliner,<br />
après <strong>de</strong> nombreuses années <strong>de</strong> rébellion. Sur la fin <strong>de</strong> sa vie, il se con<strong>du</strong>isit en fidèle vassal, allant<br />
même jusqu’à faire promettre à ses successeurs <strong>de</strong> prêter hommage aux rois d’Angleterre.<br />
Il scella l’alliance entre les comtés <strong>de</strong> Foix et <strong>de</strong> Béarn par le mariage d’une <strong>de</strong> ses filles,<br />
Marguerite <strong>de</strong> Monca<strong>de</strong>, vicomtesse <strong>de</strong> Béarn, avec Roger-Bernard III, comte <strong>de</strong> Foix, en proclamant<br />
indissociable l’union <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux comtés. Cette union fut à l’origine <strong>de</strong> la haine qui <strong>de</strong>vait opposer les<br />
maisons <strong>de</strong> Foix-Béarn et d’Armagnac car une autre fille <strong>de</strong> Gaston VII avait épousé le comte<br />
d’Armagnac, lequel s’estimait lésé. Cette haine <strong>de</strong>vait per<strong>du</strong>rer pendant plusieurs générations, jusqu’à<br />
Gaston Fébus qui passa sa vie à le combattre, désirant se rendre maître <strong>de</strong> la Bigorre, qui séparait les<br />
comtés <strong>de</strong> Foix et <strong>de</strong> Béarn.<br />
Roger-Bernard III se rangea aux cotés <strong>du</strong> roi <strong>de</strong> France pour certaines batailles, son fils Gaston<br />
I er <strong>de</strong> Foix-Béarn (le grand-père <strong>de</strong> Gaston Fébus) mourut au cours d’une expédition contre les<br />
Flamands en tant que vassal <strong>de</strong> Philippe IV le Bel pour le comté <strong>de</strong> Foix.<br />
Après leur mort, Marguerite gouverna pendant 17 ans le Foix-Béarn en tant que régente, elle<br />
rétablit l’équilibre en se comportant en fidèle vassale <strong>du</strong> roi d’Angleterre pour le Béarn. Les Béarnais<br />
eux-mêmes, conscients d’appartenir à la communauté gasconne, sous tutelle anglaise, considéraient le<br />
royaume <strong>de</strong> France comme une terre étrangère. S’opposer aux anglais c’était mettre en péril tous les<br />
fon<strong>de</strong>ments <strong>de</strong> la vie économique <strong>de</strong> la vicomté.<br />
Le comté <strong>de</strong> Foix, lui, était pro-français.
La situation <strong>de</strong>venait malaisée, ainsi, le père <strong>de</strong> Gaston Fébus; Gaston II, petit-fils <strong>de</strong> la<br />
régente Marguerite, eut à combattre <strong>de</strong>s chevaliers béarnais engagés dans les troupes anglaises alors<br />
que lui-même commandait <strong>de</strong>s troupes françaises!<br />
Il fallait un homme <strong>de</strong> la stature politique <strong>de</strong> Gaston Fébus pour éviter l’éclatement entre le<br />
Foix et le Béarn. Non seulement il y réussit, mais il alla beaucoup plus loin encore.
La La La vie vie et et l'œuvre l'œuvre <strong>de</strong> <strong>de</strong> Gaston Gaston Fébus<br />
Fébus<br />
Né le 30 avril 1331, fils unique <strong>de</strong> Gaston II le Preux et d'Aliénor <strong>de</strong> Comminges, il reçut<br />
certainement une é<strong>du</strong>cation à la fois physique (chasse, maniement <strong>de</strong>s armes ...) et intellectuelle, mais<br />
l'on sait relativement peu <strong>de</strong> choses concernant son enfance.<br />
Son père, Gaston II le Preux, mourut à Séville alors qu'il était âgé <strong>de</strong> 13 ans. Avant <strong>de</strong> partir<br />
pour cette croisa<strong>de</strong> andalouse, il avait inscrit dans son testament qu'Aliénor serait régente et tutrice<br />
jusqu'à la majorité légale <strong>de</strong> son fils, c'est à dire 14 ans, et qu'elle continuerait, comme curatrice, à<br />
gérer ses biens jusqu'à l'âge <strong>de</strong> 21 ans. Tout se passa comme il l'avait voulu, sans que cela soulevât le<br />
moindre problème, ce qui prouve la bonne entente entre la mère et le fils.<br />
En hiver 1343, ils partirent tous <strong>de</strong>ux pour un périple dans toutes les régions <strong>du</strong> Béarn et <strong>de</strong><br />
Foix. Cette tournée d'hommage était <strong>de</strong>stinée à le présenter aux habitants et aux seigneurs <strong>de</strong>s<br />
différents domaines, à rassurer les populations sur leur avenir, en rappelant que le Foix et le Béarn (<strong>de</strong><br />
plus en plus divisés par leurs traditions et liens vassaliques différents) dépendaient d'un seul et même<br />
vicomte. A chaque fois, il <strong>de</strong>vait prêter serment le premier, et jurer <strong>de</strong> respecter et faire respecter la<br />
législation <strong>de</strong>s Fors <strong>de</strong> Béarn, après quoi ses sujets juraient à leur tour et lui promettaient ai<strong>de</strong> et<br />
obéissance. Ce premier périple terminé, il était <strong>de</strong>venu majeur, et recommença.<br />
Ayant rempli ses obligations envers son peuple, dont il s'assurait ainsi l'appui, il accomplit<br />
alors sa première action <strong>de</strong> politique extérieure par un véritable coup <strong>de</strong> maître, en déclarant<br />
publiquement au représentant <strong>du</strong> roi <strong>de</strong> France qu'il considérait le Béarn comme un pays souverain.<br />
Philippe VI, battu à Crécy et à Calais, tentait <strong>de</strong> resserrer ses alliances, il avait donc envoyé un<br />
message à Gaston III, que celui-ci reçut dans son <strong>château</strong> <strong>de</strong> Monca<strong>de</strong> à Orthez. Un acte notarié<br />
transmit la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et la réponse, qui était habile. En effet Gaston III, alors âgé <strong>de</strong> 16 ans à peine,<br />
approuvait les projets <strong>du</strong> roi ( alliance avec la Castille), semblait dire qu'il les appuierait, en tant que<br />
vassal pour le pays <strong>de</strong> Foix, où il se rendrait pour en discuter... Quant au Béarn, il en affirmait la<br />
souveraineté : "Terre <strong>de</strong> Béarn, terre qu'il tient <strong>de</strong> Dieu et <strong>de</strong> nul homme au mon<strong>de</strong> d'où il ne découle<br />
pour lui aucune obligation, si ce n'est <strong>de</strong> faire ce que bon lui semble". C’était une réponse stupéfiante<br />
pour l'époque ; cependant il proposait au roi son appui ultérieur éventuel. Celui-ci, en mauvaise<br />
posture, était obligé <strong>de</strong> le ménager. Par la suite, Gaston III <strong>de</strong>vait agir à peu près <strong>de</strong> la même manière<br />
avec tous ses interlocuteurs politiques.<br />
L'année suivante, en 1348, il prêta hommage à un nouvel envoyé <strong>de</strong> Philippe VI "pour toutes<br />
les terres situées dans les sénéchaussées d'Agen, <strong>de</strong> Toulouse et <strong>de</strong> Carcassonne", c'est-à-dire Foix,<br />
Lautrec, Nébouzan, Terres-basses <strong>de</strong> l'Albigeois. Il ne mentionna pas le Béarn, en faisant une affaire<br />
réglée. Pendant ce temps, les tractations engagées par sa mère pour son mariage avec Agnès <strong>de</strong><br />
Navarre avançaient.<br />
Lorsque son fils avait neuf ans, elle avait pensé pour lui à un mariage avec l'héritière <strong>du</strong> roi <strong>de</strong><br />
Majorque, mais l'effondrement <strong>du</strong> royaume, quelques années plus tard, avait ren<strong>du</strong> le projet<br />
impossible.<br />
Agnès <strong>de</strong> Navarre était un parti prestigieux : fille <strong>de</strong> la reine <strong>de</strong> Navarre, Jeanne, écartée <strong>du</strong><br />
trône <strong>de</strong> France par le principe <strong>de</strong> prévalence masculine déjà évoqué, petite-fille <strong>de</strong> Louis X <strong>de</strong> France<br />
et <strong>de</strong> Navarre, sœur ca<strong>de</strong>tte <strong>de</strong> Charles II <strong>de</strong> Navarre, que l'histoire retient sous le nom <strong>de</strong> Charles le<br />
Mauvais, (il avait été nommé lieutenant général en Languedoc, lors <strong>de</strong> la reprise <strong>de</strong>s hostilités contre<br />
les Anglais). La cérémonie eut lieu à Paris le 5 mai 1349.<br />
Quelques mois plus tard, Philippe VI mourut. Son successeur, Jean II le Bon donna la charge<br />
<strong>de</strong> lieutenant général <strong>du</strong> Languedoc à Jean 1 er d'Armagnac. Gaston III <strong>de</strong> Foix-Béarn, se lança<br />
immédiatement à l'assaut <strong>de</strong>s terres <strong>de</strong> son ennemi héréditaire. Celui-ci, fragilisé, obligé <strong>de</strong> dépenser<br />
ses forces, résistait moins bien à la pression anglo-saxonne. Lafrançaise menaçait <strong>de</strong> chuter, ce qui<br />
ouvrirait aux anglais la route <strong>de</strong> Toulouse. Inquiets, les Capitouls <strong>de</strong> Toulouse proposèrent un marché<br />
à Gaston III : il combattrait les anglais à Lafrançaise en échange d'une large compensation financière.
Il accepta, réussit, et en profita même pour aller ravager certaines terres <strong>de</strong> Jean 1 er d'Armagnac. Par la<br />
suite, il <strong>de</strong>vait utiliser souvent ce procédé, qui lui permit <strong>de</strong> s'enrichir considérablement.<br />
A la même époque, Jean II le Bon avait eu la mauvaise idée d'accor<strong>de</strong>r le comté d'Angoulême<br />
à un <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> la famille <strong>de</strong> Castille, Charles d'Espagne. Or, ce comté avait été promis à la mère<br />
<strong>de</strong> Charles II le Mauvais, Jeanne, reine <strong>de</strong> Navarre, en échange <strong>de</strong> la Champagne et <strong>de</strong> la Brie. Furieux<br />
<strong>de</strong> ce qu'il estimait être une provocation, ce <strong>de</strong>rnier fit assassiner Charles d'Espagne. Jean II le Bon<br />
réagit violemment en ordonnant aux comtes <strong>de</strong> Comminges et d'Armagnac <strong>de</strong> ravager la Basse-<br />
Navarre. Ceux-ci <strong>de</strong>vaient traverser les terres <strong>de</strong> Gaston III, qui ne l'entendait pas ainsi et leur rendit la<br />
chose impossible, tandis que Charles II se rapprochait d'Edouard III d'Angleterre.<br />
Affolé, le roi <strong>de</strong> France accorda finalement le comté d'Angoulême à Charles II le Mauvais qui<br />
proposa alors à Edouard III <strong>de</strong> se partager la France. Ils ourdirent un complot auquel participa Gaston<br />
III. Jean le Bon les amnistia finalement après avoir traité la paix dite <strong>de</strong> Valogne (1355) mais Gaston<br />
III avait montré qu'il prenait ses distances avec le camp français, ce qui lui permit d'échapper aux<br />
représailles anglaises après le désastre <strong>de</strong> Poitiers (1356) au cours <strong>du</strong>quel le roi <strong>de</strong> France et <strong>de</strong><br />
nombreux chevaliers étaient <strong>de</strong>venus les prisonniers <strong>du</strong> Prince Noir.<br />
Une trêve fut signée pour un an, mais la donne politique avait entièrement changé.<br />
Après avoir également refusé son hommage pour le Béarn à Jean II le Bon, Gaston III <strong>du</strong>t faire<br />
face aux exigences <strong>de</strong> Pierre IV, roi d'Aragon. Il alla donc au palais <strong>de</strong>s rois <strong>de</strong> Majorque à Perpignan<br />
lui rendre hommage pour les terres <strong>du</strong> comté <strong>de</strong> Foix qui dépendaient <strong>de</strong> lui. Ce puissant roi réclamait,<br />
<strong>de</strong> plus, l'ai<strong>de</strong> militaire <strong>de</strong> son vassal contre la Castille.<br />
Gaston Fébus gagna <strong>du</strong> temps, à son habitu<strong>de</strong>, en négociant plusieurs fois la sol<strong>de</strong> <strong>de</strong> ses<br />
hommes, assurant que la Castille avait déjà payé pour s'assurer <strong>de</strong> leur neutralité... Il n'engagea ses<br />
hommes dans cette affaire que lorsqu'il sut que <strong>de</strong>s pourparlers <strong>de</strong> paix avaient été engagés.<br />
Il choisit ce moment pour prendre <strong>du</strong> recul par rapport aux sollicitations diverses dont il était<br />
l'objet, et partit pour la Prusse participer à une croisa<strong>de</strong> contre les païens lithuaniens, pour un an. C'est<br />
<strong>du</strong>rant cette expédition qu'il décida <strong>de</strong> se faire appeler Fébus.<br />
En revenant <strong>de</strong> Prusse, il délivra la Dauphine <strong>de</strong> France ainsi que d'autres dames, à Meaux, où<br />
avait lieu une insurrection <strong>de</strong> Jacques, <strong>de</strong>s paysans révoltés. Pour le première fois, on entendit son<br />
fameux cri <strong>de</strong> guerre : "Fébus avan".<br />
Puis il reprit les hostilités contre le prince d'Armagnac, Jean 1 er . Il attaqua <strong>de</strong> tous cotés,<br />
n'hésitant pas à embaucher <strong>de</strong>s ban<strong>de</strong>s anglo-saxonnes. Finalement, aidé par ses vassaux, il écrasa les<br />
troupes <strong>de</strong> Jean 1 er d'Armagnac, à Launac (1362) et le fit prisonnier, ainsi que ses alliés (maison<br />
d’Albret entre autres), auxquels il assigna d'importantes rançons, ce qui lui rapporta une somme<br />
considérable.<br />
A l'issue <strong>de</strong> ce triomphe, il chassa son épouse, Agnès <strong>de</strong> Navarre, qui venait <strong>de</strong> lui donner un<br />
héritier légitime, sous le prétexte que la dot n'avait jamais été payée intégralement. Il la renvoya à<br />
Pampelune chez son frère, Charles II le Mauvais, dont il se fit ainsi un ennemi implacable, après avoir<br />
été son allié pendant <strong>de</strong> nombreuses années.<br />
Entre-temps, le traité <strong>de</strong> Brétigny (1360) avait accordé l'<strong>Aquitaine</strong> en toute souveraineté au<br />
Prince Noir. Il convoqua Gaston afin d'obtenir son hommage. Celui-ci temporisa bien sûr puis, obligé<br />
d'obtempérer, dit qu'il accepterait <strong>de</strong> prêter hommage pour le Béarn lorsqu'on lui prouverait<br />
juridiquement qu'il avait à le faire. C'était une manière <strong>de</strong> gagner <strong>du</strong> temps. Par la suite, les archivistes<br />
<strong>du</strong> Prince Noir ayant constitué un dossier, il continua <strong>de</strong> manifester une résistance larvée en trouvant<br />
sans cesse <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> ne pouvoir se déplacer.<br />
Finalement le Prince d'<strong>Aquitaine</strong> le somma <strong>de</strong> prêter hommage pour le Béarn "comme l'avait<br />
fait Madame Marguerite au Sénéchal en 1290". Le Prince Noir perdait patience, il pensa faire plier le<br />
Béarn en revenant d'une expédition en Castille. Mais cette expédition tourna au désastre militaire et<br />
financier, aggravé d'une épidémie. Affaibli et mala<strong>de</strong>, le Prince Noir à son retour n'était plus en<br />
mesure d'attaquer le Béarn, qui était sur le pied <strong>de</strong> guerre. Au contraire, il <strong>de</strong>manda humblement à<br />
Gaston Fébus l'autorisation <strong>de</strong> laisser passer ses troupes sur ses terres, ce qu'il obtint contre promesse<br />
<strong>de</strong> payer intégralement son ravitaillement ("jusqu’à la moindre poule").
Cependant, le pouvoir français n'avait pas dit son <strong>de</strong>rnier mot : le traité <strong>de</strong> Brétigny-Calais qui<br />
avait cédé l'<strong>Aquitaine</strong> aux Anglais en toute souveraineté fut remis en question pour vice <strong>de</strong> forme par<br />
Charles V. Puis, le Parlement <strong>de</strong> Paris assigna Edouard III à comparaître <strong>de</strong>vant sa cour. Il refusa et le<br />
Parlement prononça la confiscation <strong>de</strong> ses terres relevant <strong>du</strong> roi <strong>de</strong> France.<br />
Gaston Fébus, toujours en lutte contre le clan Armagnac pour la Bigorre et le Comminges eut<br />
alors à composer avec un pouvoir <strong>de</strong> plus en plus puissant en la personne <strong>du</strong> <strong>du</strong>c d’Anjou (second fils<br />
<strong>du</strong> roi Jean II le Bon). Celui-ci entreprit finalement <strong>de</strong> réconcilier les <strong>de</strong>ux camps par la conclusion<br />
d'un mariage entre le fils <strong>de</strong> Gaston Fébus, également prénommé Gaston comme le voulait la coutume,<br />
avec Béatrix d'Armagnac, fille <strong>de</strong> Jean II.<br />
Ce fils légitime, séparé <strong>de</strong> sa mère <strong>de</strong>puis le plus jeune âge, vivait sans doute mal la préférence<br />
affichée <strong>de</strong> son père pour ses fils bâtards, Yvain et Gratien.<br />
A l'âge <strong>de</strong> 17 ans, il fut autorisé à se rendre à Pampelune, pour voir sa mère et son oncle<br />
Charles II le Mauvais. Il semble qu'un complot, aux circonstances peu claires, se soit ourdi autour <strong>de</strong><br />
sa personne. Il était flanqué <strong>de</strong> l'évêque <strong>de</strong> Lescar qui y joua sans doute un rôle important.<br />
D'après Froissart, le roi <strong>de</strong> Navarre aurait abusé <strong>de</strong> la cré<strong>du</strong>lité <strong>de</strong> son neveu en lui remettant<br />
une poudre magique <strong>de</strong>stinée à réconcilier ses parents. Le jeune homme, qui gardait le poison dans une<br />
petite bourse autour <strong>du</strong> cou, aurait été trahi par son <strong>de</strong>mi-frère Yvain dont il partageait la chambre.<br />
Juvenal <strong>de</strong>s Ursins, pour sa part, présente un jeune prince héritier <strong>du</strong> Béarn ren<strong>du</strong> aux<br />
arguments <strong>de</strong> son oncle et déterminé à empoisonner son père. Dans cette version, on l'aurait vu faire<br />
tomber la boulette <strong>de</strong> poison, analysée ensuite par les apothicaires.<br />
Quoi qu'il en soit, l'adolescent, ayant échappé <strong>de</strong> justesse à la colère <strong>de</strong> son père qu'il fallut<br />
retenir, fut enfermé. Ensuite, les versions divergent encore. Il semble toutefois que Gaston Fébus,<br />
ayant ren<strong>du</strong> visite à son fils, l'ait tué lui-même, acci<strong>de</strong>ntellement ou dans un accès <strong>de</strong> colère que<br />
personne ne pouvait réfréner.<br />
A la suite <strong>de</strong> ce drame, il quitta Orthez et vint s'installer à <strong>Pau</strong> le 17 août 1380 où il écrivit Le<br />
livre <strong>de</strong>s oraisons afin d'obtenir le pardon <strong>de</strong> Dieu. ("Seigneur, j'ai commis l'acte par lequel tu peux me<br />
damner...") Il ne <strong>de</strong>vait retourner à Orthez que quatre ans plus tard.<br />
Pendant ces événements, le roi <strong>de</strong> France Charles V était mort, le nouveau roi Charles VI était<br />
âgé <strong>de</strong> 12 ans seulement. Ses oncles (Anjou, Bourgogne, Berry, Bourbon) prirent les rênes <strong>du</strong> pouvoir.<br />
Jean <strong>de</strong> Berry fut nommé lieutenant général <strong>de</strong> Guyenne et Languedoc. Gaston Fébus se méfiait <strong>de</strong> ce<br />
prince si puissant, qui, <strong>de</strong> plus, avait épousé une Armagnac. Lui-même, après le drame d'Orthez, avait<br />
renvoyé Béatrix dans sa belle-famille. Les intrigues reprirent <strong>de</strong> plus belle. Gaston Fébus s'installa<br />
dans son <strong>château</strong> <strong>de</strong> Mazères, en pays toulousain et se posa en défenseur auprès <strong>de</strong>s populations,<br />
qu'inquiétaient l'avidité et les dépenses somptuaires <strong>du</strong> <strong>du</strong>c <strong>de</strong> Berry. Il fit courir le bruit qu'il avait été<br />
lui-même pressenti pour être lieutenant général, proposa (contre argent) sa protection aux villes contre<br />
les exactions <strong>du</strong> <strong>du</strong>c <strong>de</strong> Berry, et alla jusqu'à tenir <strong>de</strong>s assemblées illégales.<br />
Grâce à toutes ces manoeuvres, il finit par obtenir <strong>du</strong> pouvoir royal une énorme somme<br />
d'argent ainsi que la promesse <strong>de</strong> ne pas avantager le clan Armagnac, qui se retrouvait isolé face à son<br />
ennemi acharné. Dès lors, il abandonna les populations languedociennes aux exactions <strong>du</strong> <strong>du</strong>c <strong>de</strong><br />
Berry pour concentrer ses attaques contre Jean II d’Armagnac, plus affaibli que jamais.<br />
Il reprit le scénario qui lui avait déjà permis la mainmise <strong>de</strong> fait sur la Bigorre, contre laquelle<br />
le pouvoir royal n’émettait aucune objection ; il fit donc à nouveau appel à une ban<strong>de</strong> <strong>de</strong> « routiers »,<br />
pilleurs redoutables, travaillant pour lui en sous-main. Ensuite, il se posait en protecteur auprès <strong>de</strong>s<br />
nobles <strong>de</strong> la région menacée, incitant nombreux d’entre eux à <strong>de</strong>venir ses vassaux, par le biais <strong>du</strong> fiefrente,<br />
concept qu’il avait inventé et utilisé <strong>de</strong>puis une dizaine d’années. Un seigneur pouvait s’engager<br />
à servir Fébus contre une somme d’argent sous forme <strong>de</strong> rente, au lieu d’une terre.<br />
D’octobre 1382 à mars 1383, il revient à <strong>Pau</strong>, puis retourne s’installer à Orthez jusqu’en 1389.<br />
Il utilise ce temps à administrer le Béarn, avec sa rigueur et son autoritarisme coutumiers.
Il rendait lui-même la justice, ayant limité au maximum l’activité <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong>stinées à<br />
légiférer avec lui. L’affaire <strong>du</strong> complot d’Orthez l’ayant ren<strong>du</strong> méfiant envers la Noblesse, ses plus<br />
fidèles conseillers n’en étaient plus issus.<br />
Il ne put, cependant, empêcher plusieurs centaines <strong>de</strong> chevaliers béarnais <strong>de</strong> partir apporter<br />
leur soutien à la Castille contre le Portugal. Ils n’en revinrent pas, comme il le leur avait prédit. Luimême,<br />
à cette occasion, avait opté pour la neutralité, conscient <strong>de</strong>s nombreux pièges que recelait cette<br />
affaire. Il fit cependant payer le prix fort aux troupes françaises <strong>de</strong> Charles VI, ralliées également à la<br />
cause castillane, pour traverser ses terres (Andorre et Roncevaux). Cette campagne militaire <strong>de</strong>vait<br />
<strong>du</strong>rer 3 ans, jusqu’en 1387. Durant tout ce temps, Gaston Fébus ne cessa <strong>de</strong> multiplier ses mises en<br />
gar<strong>de</strong> auprès <strong>du</strong> pouvoir royal contre les pillages alors en vigueur à l’époque et <strong>de</strong>stinés à soutenir le<br />
moral <strong>de</strong>s troupes. Mais il se fit un <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> désigner pour cet usage les troupes <strong>de</strong> ses ennemis<br />
(Armagnac notamment) à l’oncle <strong>du</strong> roi <strong>de</strong> France (Louis II <strong>de</strong> Bourbon) <strong>de</strong> retour <strong>de</strong> Castille, qu’il<br />
reçut à Orthez.<br />
Puis vint le temps où Charles VI, roi <strong>de</strong> France, décida, à 20 ans, <strong>de</strong> reprendre les rênes <strong>du</strong><br />
pouvoir en se débarrassant <strong>de</strong> la tutelle <strong>de</strong> ses oncles. Il choisit <strong>de</strong> s’entourer <strong>de</strong>s conseillers <strong>de</strong> feu son<br />
père, que leurs opposants appelaient "les Marmousets".<br />
En 1389, il fut décidé que le roi entreprendrait un grand voyage dans le sud <strong>de</strong> la France, qui<br />
avait tant souffert (à part le Foix-Béarn) <strong>de</strong>s exactions <strong>de</strong> ses oncles. Gaston Fébus était un personnage<br />
clé, incontournable, et dont il fallait s’assurer l’appui. Il avait fait élever à sa cour une petite fille,<br />
Jeanne <strong>de</strong> Boulogne, dont il était le tuteur. Un envoyé <strong>de</strong> Charles VI lui fut dépêché pour négocier le<br />
mariage <strong>de</strong> cette très jeune fille (12 ans environ) avec Jean <strong>de</strong> Berry. D’après Froissart, il aurait été<br />
question également <strong>de</strong> la légitimation <strong>de</strong> son fils bâtard préféré, Yvain.<br />
L’année suivante, en 1390, Fébus et Charles VI signaient le traité <strong>de</strong> Toulouse, par lequel le<br />
roi <strong>de</strong> France <strong>de</strong>venait l’héritier <strong>du</strong> vicomte <strong>de</strong> Foix. Celui-ci recevait une forte somme d’argent et la<br />
Bigorre à titre viager contre la promesse <strong>de</strong> ne plus attaquer les terres d’<strong>Aquitaine</strong>.<br />
On pense généralement qu’il s’agissait là encore d’une manoeuvre politique <strong>de</strong> Gaston<br />
Fébus habitué, comme on l’a vu, à signer toutes sortes <strong>de</strong> traités pour les avantages immédiats qu’il<br />
pouvait en retirer. Il ne pouvait pas imaginer qu’il mourrait brutalement, un an après, d’une attaque<br />
foudroyante d’apoplexie à un retour <strong>de</strong> chasse. Quoi qu’il en soit, l’application <strong>de</strong> ce traité remettait en<br />
cause la souveraineté <strong>du</strong> Béarn, pour laquelle il avait toujours lutté.<br />
Après sa mort, les Etats <strong>de</strong> Béarn réussirent à faire annuler ce traité et choisirent comme<br />
nouveau vicomte Mathieu <strong>de</strong> Castelbon, cousin <strong>de</strong> Gaston Fébus, qui, à son tour, jura <strong>de</strong> conserver les<br />
droits et coutumes <strong>du</strong> pays.
Gaston Fébus et le <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong><br />
Pris dans les remous <strong>de</strong> la guerre <strong>de</strong> Cent Ans, décidé à affirmer sans relâche la souveraineté <strong>du</strong> Béarn<br />
et à étendre son pouvoir sur tout le Piémont pyrénéen, Gaston Fébus entreprit <strong>de</strong> renforcer le système<br />
défensif <strong>de</strong> tous les autres <strong>château</strong>x se trouvant sur son territoire.<br />
Un effort particulier <strong>de</strong>vait être porté sur le <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong>. Avant les travaux entrepris à cette époque<br />
et dont on trouve les premières mentions en 1365, ainsi que le nom présumé <strong>de</strong> l'architecte Sicard <strong>de</strong><br />
Lordat, le <strong>château</strong> était constitué d'un mur d'enceinte, <strong>du</strong> donjon primitif (tour Montauser, XII° siècle)<br />
et <strong>de</strong>s tours d'enceinte (Mazères au Sud-Ouest, Billère au Nord-Ouest, peut-être d'autres...)<br />
Les aménagements apportés au XIV° siècle sont les suivants :<br />
- <strong>de</strong>ux niveaux <strong>de</strong> glacis en pierre <strong>de</strong> taille recouvrant l'éperon rocheux,<br />
- sur le glacis double enceinte, en avant <strong>de</strong> celle <strong>du</strong> XII° siècle, sous forme <strong>de</strong> murs crénelés (l'enceinte<br />
médiane enveloppe étroitement le <strong>château</strong> <strong>du</strong> XI° siècle),<br />
- tour <strong>de</strong> la Monnaie au sud <strong>de</strong> l'enceinte extérieure, tournée vers le passage <strong>du</strong> Gave,<br />
- porte fortifiée au nord-est vers le Hédas et la fontaine <strong>du</strong> bourg,<br />
- nouveau donjon en brique bâti sur l'angle sud-est <strong>de</strong> l'enceinte XII° siècle, - porte avec pont-levis et<br />
corps <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> au <strong>de</strong>vant <strong>du</strong> donjon, vers la ville haute, - couloir fortifié vers la ville basse au pied <strong>de</strong><br />
la tour <strong>de</strong> la Monnaie, - corps <strong>de</strong> logis : aile <strong>du</strong> midi pour le rez <strong>de</strong> cour et le premier étage (tinel),<br />
voûtes <strong>de</strong>s tours Mazères et Billère, surélévation <strong>de</strong> la tour Montauzer.<br />
d'après Bernard Voinchet, Architecte en Chef <strong>de</strong>s Bâtiments <strong>de</strong> France
Le Le Livre Livre <strong>de</strong> <strong>de</strong> la la chasse<br />
chasse<br />
Gaston Fébus était passionné <strong>de</strong> chasse et lui consacrait tous ses moments <strong>de</strong> liberté. A cette<br />
époque, le chasse représentait bien plus qu’un simple loisir car elle mettait en jeu un ensemble <strong>de</strong><br />
valeurs morales et religieuses. Elle permettait d’éviter l’oisiveté, mère <strong>de</strong> tous les vices et servait à<br />
former l’homme <strong>de</strong> guerre (art <strong>de</strong> l’équitation et <strong>de</strong> la stratégie).<br />
« Je dis donc que, puisque le veneur n’est jamais oisif, il ne peut avoir mauvaises<br />
imaginations, et s’il n’a mauvaises imaginations, il ne peut faire mauvaises oeuvres, car l’imagination<br />
va <strong>de</strong>vant ; et s’il ne fait <strong>de</strong> mauvaises oeuvres, il faut qu’il s’en aille tout droit en paradis. Par<br />
beaucoup d’autres raisons qui seraient bien longues, j’en ferais la preuve, mais celles-là me suffisent,<br />
car tout personne raisonnable sait bien que je suis dans la vérité ».<br />
Il entreprit la rédaction <strong>de</strong> son fameux manuscrit « Le livre <strong>de</strong> la chasse », entre 1387 et 1390,<br />
en langue française selon le plan suivant : une table <strong>de</strong>s matières, un prologue, cinq parties, un<br />
épilogue.<br />
La première partie consiste en une <strong>de</strong>scription minutieuse <strong>de</strong>s animaux chassés, qu’il classe en<br />
<strong>de</strong>ux catégories : les « bêtes douces », herbivores, et les «bêtes mordantes », en commençant par les<br />
omnivores, sanglier et ours. Pour lui le sanglier est l’animal le plus dangereux à chasser. Le loup fait<br />
l’objet <strong>du</strong> plus long chapitre.<br />
La secon<strong>de</strong> partie <strong>du</strong> traité est consacrée aux chiens <strong>de</strong> chasse, pour lesquels il éprouvait une<br />
véritable tendresse.<br />
« Et je leur apprends le nom <strong>de</strong>s choses que je veux qu’ils fassent, et ils me connaissent et<br />
m’aiment tant que, si parfois je suis mala<strong>de</strong> ou vais à la guerre, ou suis pour autre besogne empêché<br />
<strong>de</strong> chasser, ils ne chasseront pas avec un autre ou, s’ils le font, ce sera mal. Et parfois j’ai vu que mes<br />
chiens avaient manqué le chevreuil et étaient restés longtemps en requête, sans vouloir aller <strong>de</strong><br />
l’avant. S’ils cessaient ainsi <strong>de</strong> chasser, c’est que je n’y étais point. »<br />
Il décrit la manière <strong>de</strong> les élever et <strong>de</strong> les soigner. Il connaît tout <strong>de</strong> leurs maladies, répertoriant<br />
ainsi sept types différents <strong>de</strong> rage.<br />
La troisième partie, intitulée « Ci <strong>de</strong>vise <strong>de</strong>s manières et conditions que doit avoir celui à qui<br />
on veut apprendre à être un bon veneur », est <strong>de</strong>stinée à montrer comment on doit é<strong>du</strong>quer un enfant<br />
pour qu’il <strong>de</strong>vienne un bon chasseur.<br />
« Que tu sois grand seigneur ou petit, si tu veux faire instruire un homme pour qu’il soit bon<br />
veneur, choisis d’abord un enfant <strong>de</strong> sept ans tout au plus [...]. Il faut, en outre, à cet enfant beaucoup<br />
<strong>de</strong> choses : et d’abord un bon maître qui ait l’amour et le goût <strong>de</strong>s chiens, qui, pour l’instruire, le<br />
batte quand il n’obéira pas, afin qu’il hésite à faillir. En premier lieu, je veux lui apprendre et donner<br />
par écrit tous les noms <strong>de</strong>s chiens et lices <strong>du</strong> chenil, jusqu’à ce que l’enfant les connaisse <strong>de</strong> poil et <strong>de</strong><br />
nom ... »<br />
Dans la quatrième partie, il présente l’art <strong>de</strong> la chasse à courre, en reprenant l’ordre utilisé<br />
pour la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s animaux.<br />
« Et si le sanglier l’attaque face à face, il doit venir à sa rencontre, non au galop, mais au<br />
trot, les rênes <strong>de</strong> sa bri<strong>de</strong> bien courtes. Et il ne doit point s’occuper <strong>du</strong> sanglier ni <strong>de</strong> ce qu’il fera,<br />
mais penser et aviser par où il pourra le mieux asséner son coup. Et s’il frappe <strong>de</strong> l’épieu, il doit<br />
frapper <strong>de</strong> haut en bas aussi fort qu’il pourra, en se levant sur ses étriers. Et tout veneur doit<br />
chevaucher court plutôt que long, car il en est plus aisé et fatigue moins son cheval... «<br />
La <strong>de</strong>rnière partie est consacrée à l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s pièges et concerne surtout le loup, animal<br />
nuisible par excellence qu’il convient d’exterminer par tous les moyens, même les moins nobles.
Ce livre le fit connaître comme l’un <strong>de</strong>s plus grands chasseurs <strong>de</strong> son temps. Il connut un<br />
succès immédiat et l’on en fit <strong>de</strong> nombreuses copies dont la plus luxueuse fut commandée par le fils <strong>de</strong><br />
Philippe le Hardi, Jean sans Peur, <strong>du</strong>c <strong>de</strong> Bourgogne. Quarante-quatre manuscrits copiés sont encore<br />
conservés <strong>de</strong> nos jours. La majorité date <strong>du</strong> XVème siècle, les autres ont été copiés au début <strong>du</strong><br />
XVIème siècle.<br />
L’avènement <strong>de</strong> l’imprimerie assura au Livre <strong>de</strong> la chasse une diffusion encore plus large. Il<br />
fut publié en 1507, 1511, 1525, puis réédité en 1854 et 1897. Enfin, en 1897, il fut tra<strong>du</strong>it en français<br />
mo<strong>de</strong>rne.<br />
Deux <strong>de</strong>s quatre plus beaux manuscrits sont aujourd’hui conservés à Paris (Bibliothèque<br />
<strong>national</strong>e), un autre se trouve à Léningrad (<strong>Musée</strong> <strong>de</strong> l’Ermitage), et un à New-York (Collection Clara<br />
Peck). Le manuscrit conservé à Paris est illustré <strong>de</strong> 87 enluminures agrémentées <strong>de</strong> feuille d’or qui ont<br />
fait sa réputation. Seul, l’exemplaire <strong>de</strong> New-York peut rivaliser avec lui en beauté Ces magnifiques<br />
enluminures, d’une gran<strong>de</strong> qualité artistique (technique, composition, procédés picturaux) sont<br />
également <strong>de</strong>s témoignages iconographiques <strong>de</strong> première valeur .<br />
En 1987, le musée <strong>national</strong> <strong>du</strong> <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong> a fait l’acquisition, en vente publique d’un<br />
manuscrit <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong> la chasse datant <strong>du</strong> XV° siècle. Ce manuscrit se présente sous la forme d’un<br />
volume <strong>de</strong> cinquante-<strong>de</strong>ux folios <strong>de</strong> velin et comporte sept représentations animalières, ours, lièvre,<br />
lapin, sanglier, loup, renard et cerf. Seule cette <strong>de</strong>rnière, en grisaille à la mine d’argent, est<br />
contemporaine <strong>du</strong> volume, les six autres datant sans doute <strong>du</strong> XVII° siècle. Par ailleurs, quatre-vingtcinq<br />
gran<strong>de</strong>s initiales tracées à l’or et <strong>de</strong> très beaux encadrements à l’or et à l’encre bleue et rouge,<br />
figurant <strong>de</strong>s feuillages stylisés, ornent les pages <strong>du</strong> manuscrit.
AA AA NN NN NN NN EE EE XX XX EE EE S S S S EE EE T T T T DD DD OO OO CC CC UU UU MM MM EE EE NN NN TT TT S<br />
SS<br />
S
LA MAISON DES FOIX-BÉARN<br />
XIII°-XV° siècles<br />
Extrait <strong>de</strong> "Gaston Fébus, Prince <strong>de</strong>s Pyrénées", Pierre Tucoo-Chala
Extrait <strong>de</strong> Pierre TUCOO-CHALA, Gaston Fébus, Prince <strong>de</strong>s Pyrénées, Deucalion, J&D Editions, Biarritz, 1993.
Extrait <strong>de</strong> "Gaston Fébus, Prince <strong>de</strong>s Pyrénées", Pierre Tucoo-Chala
Extrait <strong>de</strong> "Gaston Fébus, Prince <strong>de</strong>s Pyrénées", Pierre Tucoo-Chala
Extrait <strong>de</strong> "Gaston Fébus, Prince <strong>de</strong>s Pyrénées", Pierre Tucoo-Chala
TT TT ee ee xx xx tt tt ee ee s s s s tt tt ii ii rr rr éé éé s s s s dd dd ee ee s s s s<br />
" " " " CC CC hh hh rr rr oo oo nn nn ii ii qq qq uu uu ee ee s s s s dd dd e e e e JJ JJ ee ee hh hh aa aa n n n n FFFF rr rr oo oo ii ii ss ss ss ss aa aa rr rr t t t t " " " " . . . .<br />
Portrait <strong>du</strong> Comte Gaston <strong>de</strong> Foix<br />
Le comte Gaston <strong>de</strong> Foix dont je parle pouvait avoir cinquante<br />
neuf ans d'âge, en ce temps où je fus vers lui, et je vous dis que j'ai<br />
vu en mon temps beaucoup <strong>de</strong> chevaliers, plusieurs rois, princes et<br />
autres, mais je n'en vis jamais aucun qui fût <strong>de</strong> si beaux membres,<br />
<strong>de</strong> si belle forme, <strong>de</strong> si belle taille, le visage beau, coloré et riant,<br />
les yeux verts et amoureux là où il lui plaisait <strong>de</strong> jeter ses regards.<br />
En toutes choses, il était si parfait et si bien appris, qu'on ne pouvait<br />
trop le louer. Il aimait ce qu'il <strong>de</strong>vait aimer et haïssait ce qu'il <strong>de</strong>vait<br />
haïr.<br />
Gaston <strong>de</strong> Foix aimait bien :<br />
Il aimait les chiens plus que toutes autres bêtes, et il était<br />
souvent à chasser à la campagne, en été et en hiver. Il <strong>de</strong>visait<br />
volontiers d'armes ou d'amour. Jamais il n'aima les folles entreprises,<br />
ni les folles largesses, et chaque mois il voulait savoir ce que <strong>de</strong>venait<br />
son bien. Il avait pris dans le pays, pour recevoir ses recettes ,et pour<br />
administrer ses gens, douze hommes très notables, qui changeaient <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>ux mois en <strong>de</strong>ux mois, et <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s autres reprenaient la charge.
Les gens au service<br />
<strong>de</strong> Gaston <strong>de</strong> Foix<br />
Il avait quatre clercs secrétaires pour écrire et rédiger <strong>de</strong>s lettres,<br />
et il fallait bien que ses clercs fussent toujours prêts quand il sortait <strong>de</strong><br />
sa chambre, et il ne les nommait ni Jean, ni Gautier, ni Guillaume ;<br />
mais quand on lui apportait <strong>de</strong>s lettres et qu'il les avait lues, il appelait<br />
chacun d'eux "Mal me sert !" pour écrire telle chose qu'il leur<br />
commandait.<br />
Le repas <strong>de</strong> Gaston <strong>de</strong> Foix<br />
Le comte <strong>de</strong> Foix vivait en cet état que vous enten<strong>de</strong>z. Et quand il<br />
venait <strong>de</strong> sa chambre à minuit pour souper dans sa salle, il y avait <strong>de</strong>vant<br />
lui douze torches allumées que douze valets portaient, et ces douze torches<br />
étaient tenues <strong>de</strong>vant sa table, qui donnaient une gran<strong>de</strong> clarté dans la salle,<br />
laquelle salle était pleine <strong>de</strong> chevaliers et d'écuyers, et il avait toujours là<br />
<strong>de</strong>s tables dressées à foison pour le souper à qui voulait souper. Nul ne lui<br />
parlait à sa table, s'il ne l'appelait. Il mangeait d'ordinaire beaucoup <strong>de</strong><br />
volailles, les ailes et les cuisses seulement ; au dîner, il buvait et mangeait<br />
peu. Il prenait souvent grands ébats à la musique, car il s'y connaissait très<br />
bien, et souvent il faisait chanter <strong>de</strong>vant lui, par ses clercs, <strong>de</strong>s chansons,<br />
<strong>de</strong>s ron<strong>de</strong>aux, et <strong>de</strong>s virelais. Il restait à table environ <strong>de</strong>ux heures, et il<br />
voyait volontiers servir <strong>de</strong>s entremets étrangers, qu'il envoyait ensuite aux<br />
tables <strong>de</strong>s chevaliers et <strong>de</strong>s écuyers.
Glossaire<br />
Glossaire Glossaire<br />
Glossaire : : : :<br />
Ciel Ciel Ciel : : ciel <strong>de</strong> lit, un dais placé au <strong>de</strong>ssus d'un lit pour y<br />
suspendre <strong>de</strong>s ri<strong>de</strong>aux.<br />
Dais Dais : pièce d'étoffe précieuse, ten<strong>du</strong>e sur <strong>de</strong>s montants, que<br />
l'on porte dans certaines processions religieuses ou que<br />
l'on place au-<strong>de</strong>ssus d'un trône.<br />
Ebat Ebat : plaisir.<br />
Echafaud<br />
Echafaud Echafaud : plate forme, estra<strong>de</strong> sur une charpente <strong>de</strong><br />
tréteaux.<br />
Garenne Garenne : réserve <strong>de</strong> gibier, domaine <strong>de</strong> chasse réservé.<br />
Hanap Hanap : grand vase à boire en métal, monté sur un pied et<br />
muni d'un couvercle.<br />
Litière Litière Litière : lit couvert porté par <strong>de</strong>s hommes ou <strong>de</strong>s bêtes <strong>de</strong> somme<br />
à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux brancards.<br />
Moulinet Moulinet : jeu pour enfant.<br />
Moustier Moustier : monastère.<br />
Palefroi Palefroi : cheval <strong>de</strong> para<strong>de</strong> <strong>de</strong>s souverains, <strong>de</strong>s princes, au Moyen-<br />
Age.<br />
Ramée Ramée Ramée : ensemble <strong>de</strong>s branches d'un arbre, une forêt.<br />
Ron<strong>de</strong>au Ron<strong>de</strong>au : poème à forme fixe, sur <strong>de</strong>ux rimes et à refrain.<br />
Virelai Virelai : poème médiéval sur <strong>de</strong>ux rimes, et comptant<br />
quatre strophes.
La La La La mise mise mise mise à à à à mort mort mort mort <strong>du</strong> <strong>du</strong> <strong>du</strong> <strong>du</strong> sanglier sanglier sanglier sanglier<br />
Planche extraite <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong> la Chasse, <strong>de</strong> Gaston Fébus, manuscrit français 616 <strong>de</strong> la<br />
Bibliothèque Nationale <strong>de</strong> France
De l'Ours,<br />
Planche extraite <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong> la Chasse, manuscrit français 616, Bibliothèque Nationale<br />
<strong>de</strong> France
LES ARMOIRIES DE GASTON FEBUS<br />
Gaston Fébus était l’arrière petit-fils <strong>de</strong> Roger Bernard III, comte <strong>de</strong> Foix (1290-1302)<br />
et <strong>de</strong> Marguerite <strong>de</strong> Monca<strong>de</strong>, vicomtesse <strong>de</strong> Béarn (1290-1319). Gaston VII <strong>de</strong> Béarn, père<br />
<strong>de</strong> Marguerite, avait déclaré que ce mariage rendait indissociable l’union <strong>du</strong> comté <strong>de</strong> Foix et<br />
<strong>de</strong> la vicomté <strong>de</strong> Béarn.<br />
Le blason <strong>de</strong> Gaston Fébus réunit donc les armes <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux territoires.<br />
Armes <strong>de</strong> Béarn : D’or, aux <strong>de</strong>ux vaches <strong>de</strong> gueule, colletées et clarinées d’azur.<br />
Armes <strong>de</strong> Foix : D’or aux trois pals <strong>de</strong> gueule.<br />
Ce qui donne : Ecartelé au 1 et 4 d’or aux trois pals <strong>de</strong> gueule et au 1 et 3 d’or aux<br />
<strong>de</strong>ux vaches <strong>de</strong> gueule colletées et clarinées d’azur.
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
Pierre TUCOO-CHALA, Gaston Fébus, prince <strong>de</strong>s Pyrénées, Editions Deucalion, <strong>Pau</strong>, 1991.<br />
Pierre TUCOO-CHALA, Histoire <strong>du</strong> Béarn, Presses Universitaires <strong>de</strong> France, 1962,<br />
collection que sais-je, n° 992.<br />
Raymond RITTER, Le <strong>château</strong> <strong>de</strong> <strong>Pau</strong>, étu<strong>de</strong> architecturale et historique, rééd., Librairie <strong>de</strong><br />
Pyrénées et <strong>de</strong> Gascogne et Princi Neguer Soed, <strong>Pau</strong>, 2001.<br />
Pierre TUCOO-CHALA, Christian DESPLAT, La Principauté <strong>de</strong> Béarn, Société nouvelle<br />
d'éditions régionales et <strong>de</strong> diffusion, <strong>Pau</strong>, 1980.<br />
Philippe LEBAUD, Le Livre <strong>de</strong> la chasse, Pro<strong>du</strong>ction Liber S.A., Genève, 1986.<br />
Gabriel BISE, Le Livre <strong>de</strong> la chasse, Pro<strong>du</strong>ction Liber S.A., Genève, 1987.<br />
Pierre TUCOO-CHALA, José <strong>de</strong> HUESCAR, Gaston Fébus et le Prince Noir, Editions<br />
Loubatières, Portet sur Garonne, 1985, (Ban<strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinnée).<br />
A consulter :<br />
www.expositions.bnf.fr/phebus<br />
Cédérom Le livre <strong>de</strong> chasse <strong>de</strong> Gaston Fébus, collection Bibliothèque Nationale <strong>de</strong> Francen<br />
Sources, Coéditions : Bibliothèque Nationale <strong>de</strong> France et Montparnasse Multimédia<br />
(compatible pc et Macintosh)
GASTON FÉBUS ET LE CHÂTEAU<br />
DE PAU AU XIV ème SIÈCLE<br />
PUBLIC<br />
DURÉE<br />
CE1 à CM2<br />
OBJECTIFS DE LA VISITE - Connaître Gaston Fébus,<br />
sa vie, son action politique,<br />
ses écrits.<br />
- Comprendre les<br />
modifications qu’il a<br />
apportées au <strong>château</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>Pau</strong>.<br />
- Connaître les gran<strong>de</strong>s<br />
étapes <strong>de</strong> l’histoire <strong>du</strong><br />
Béarn, <strong>de</strong> Gaston Fébus à<br />
Henri IV.<br />
- Retrouver les éléments<br />
architecturaux ou<br />
décoratifs permettant<br />
d’évoquer cette époque.<br />
DÉROULEMENT<br />
1h<br />
La visite <strong>du</strong> <strong>château</strong>,<br />
extérieure dans un premier<br />
temps, puis intérieure,<br />
permettra <strong>de</strong> faire<br />
comprendre le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie<br />
et le décor d’un <strong>château</strong> à<br />
l’époque <strong>de</strong> Gaston Fébus<br />
(1343-1391)