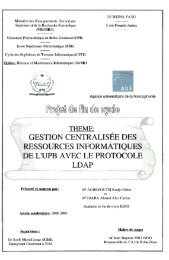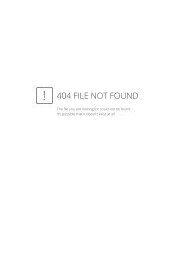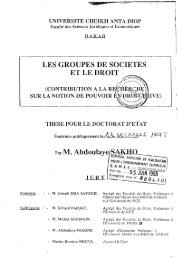THE5E
THE5E
THE5E
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ACADEMIE D'AIX-MARSEILLE<br />
ETUDE COMPAIATIVE DE L' EFFICACITE<br />
DES DIFFEREITES TECHIIOUES<br />
DE RETUCTIOI GINGIVALE<br />
El FONCTION DE LEUR TOLERAICE nSSULAIRE<br />
expérimentation animale<br />
Claude VERGNES-BONIBURINI<br />
née le 25 11 1952 à Marseille<br />
<strong>THE5E</strong><br />
présentée et publiquement soutenue<br />
devant 10 Faculté de Chirurgie Dentaire de Marseille<br />
Doyen M. le Professeur R. SANGIUOLO<br />
de "Université d'Aix Marseille Il<br />
Président M. le Professeur G. SERRATRICE<br />
le 7 Juillet 1981<br />
par<br />
Pour obtenir le grade de Docteur<br />
EnSciences Odontologiques Jeme Cycle<br />
Examinateurs de la Thèse<br />
Président<br />
Assesseurs<br />
Jean-Paul FAYOT<br />
né le 1T 10 194J à Cornille<br />
M.leProfesseur R. SANGIUOLO<br />
M.leProtesseur VITRY<br />
M. le Professeur J. FOUREL<br />
M. le l'rofeueur J. SIMON<br />
M.lePt-ofesseur P. BUNlSSBT<br />
" '
Monsieur le Professeur R. SANGIUOLO<br />
Doyen de la Faculté de Chirurgie Dentaire<br />
Chef de Service<br />
" Ave.c. nD.6 JtemeJLc..ieme.t'iM poUlt R...' honne.UIt<br />
qu.'U noM 6aJ;t de. pJtuideJL c.e. jUltIj "
RESULTATS ET INTERPRETATIONS<br />
CONCLUSION<br />
RESUME .. SUMMARY<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
000<br />
123<br />
179<br />
182<br />
l
AVANT· PROPOS
• •<br />
1 NTRODUCTION
- 2 -<br />
L'e.mpllunte, en aJL:t del'l.ttUJr.e, e.-6t cott6idéJr.ée comme étant .f.l? po.i.nt<br />
de dépall-t capLta.i de l'élaboJLa:ti.oH pILothilique.<br />
L'idéal pouJr. ILéaf1.-6 eJr. une bo nn e. e.mpILunte e.n PILothè..6 e Fixle .6 eJuu t<br />
qu'il n'ewte pa.6 de ILebolLd gingival CM la ILepILoducti.on tJtè6 pJr.éwe du<br />
UmUu ceJr.vicalu de no.6 pJr.épaJr..atiott6 - et un peu au-delà - ut ILendue<br />
d.i.6Mc.ile.<br />
OIL,de .6a pILéwion dépendlLa celle du joint dent - pJr.othùe.<br />
Seule la ILétJr.acti.on gingivale. peJrmet d' obteniJt un ILe6ouie.ment<br />
pa.6.6ageJr. et paJr.t.i.el de la genc..i.ve mMginale .6an.6 la lUe/[. Elle ut pJr.aüquement<br />
ino66ett6ive .6i toute6oi.6 ceJr.tainu pIlécauüott6 .6ont ILe.6pe.ctéu.<br />
Mai.6 ce pIlocédé e.6t - il ILéeli.e.ment e66icace ?<br />
l ntlLiguû pM le nomblLe de méthodu et de plLodw.-6 mi.6 à notJr.e<br />
di.6p0.6it.i.on pouJr. avoilr. accè6 à cette lim.i.te ceJr.vic.ale,noU.6 avott6 voulu<br />
tenteJr.,paJr. cette étude,d'e66eetueJr. leuJr. compaJr.ai.6on.<br />
Ce tJr.avail compJr.end :<br />
- d.a.n..6 une plLemiè.Jte paJr.t.i.e, une ducM.pti.on du plLlcéden.t:6 tJr.avaux<br />
nolUl ayant peJr.mi.6 de dl6iniJt notJr.e .6ujet<br />
- d.a.n..6 une .6econde paJr.:t{.e,te plLotocote pu..U t'analY.6e du ILuu..tta.t6<br />
de notJr.e expllLimentation.<br />
000
•<br />
CHAPITRE 1<br />
•• •<br />
ABORD BIBLIOGRAPHIQUE
PREMIERE PARTIE<br />
1 - EffICACITE ET TOLERANCE<br />
1 - 1 : EFFICACITE ET TOLERANCE DE LA RETRACTION<br />
1 - 1.1 : Efficacité de la rétraction<br />
1 - 1.1.1 : Déflexion gingivale<br />
Le fil lui - même<br />
Temps d'action du fil<br />
· Composition des fils<br />
· L'efficacité elle même<br />
1 - 1.1.2 : Hémostase et assèchement du sillon gingival<br />
· Hémostase<br />
· Séchage du sulcus<br />
1 - 1.2 : Tolérance de la rétraction<br />
1 - 1.2.1 : Tolérance sur le plan général<br />
· Adrénaline<br />
· Les autres produits<br />
1 - 1.2.2 : Tolérance sur le plan local<br />
1 - 2 EFFICACITE ET TOLERANCE DE L'EVICTION GINGIVALE CHIRURGICALE<br />
1 - 2.1 : Efficacité et tolérance de l'électrochirurgie<br />
1 - 2.1.1 : Le courant<br />
· Le courant d'électrocoagulation<br />
• Le courant d'électrosection<br />
· Comparaison des deux courants<br />
1 - 2.1.2 : Les électrodes<br />
· Le type d'électrode<br />
· La position de l'électrode par rapport à la dent
· La pénétration de l'électrode dans le sillon gingivo-dentaire<br />
· Le temps d'application et le nombre de passages<br />
1 - 2.1.3 : Qualité du champ opératoire<br />
· L'état gingival<br />
· Le champ opératoire<br />
1 - 2.2 : Efficacité et tolérance de l'éviction chirurgicale mécanique<br />
1 - 2.2.1 Eviction par lame<br />
1 - 2.2.2 Curetage rotatif gingival<br />
II - LES EFFETS TISSULAIRES , LA CICATRISATION LA RECESSION<br />
II - 1 : APRES RETRACTION<br />
II - 1.1 : Les effets tissulaires après rétraction<br />
II 1.1.1 Le fil de soie floche ciré non imprégné<br />
II - 1.1.2 Les fils non adrénalinés<br />
· Fil imprégné de chlorure d'aluminium<br />
· Fil imprégné de sulfate d'aluminium<br />
Fil imprégné aluminium + alun<br />
Solution de Négatan<br />
· Hydroxyde de potassium<br />
· Fil imprégné de chlorure de zinc<br />
II - 1.1.3 : Les fils adrénalinés<br />
Le soluté d'adrénaline à 1/1000<br />
Le soluté d'adrénaline à 1/4000<br />
II - 1.1.4 : Comparaison entre les différents produits<br />
II - 1.2 : La cicatrisation après rétraction<br />
II - 1.2.1 : Généralités
- 4 -<br />
La capacité des fils rétracteurs à éloigner la gencive (déplacement<br />
latéral et apical) de la préparation coronaire correspond à l'efficacité<br />
des produits et techniques et permet de déterminer une déflexion suffisante<br />
de la gencive marginale.<br />
E11 e dépend de :<br />
- la quantité de fil utilisé<br />
- leur durée d'action<br />
- leur composi ti on •<br />
• l e fi l l ui même<br />
- la longueur<br />
- le diamètre<br />
- le nombre de torons définissent ses qualités.Le fil employé est<br />
généralement un fil de coton<br />
Tous les auteurs s'accordent pour utiliser un fil légèrement plus<br />
long que la circonférence de la dent (34)(80) de longueur moyenne égale à :<br />
· 2,5cm (82)(106)(231)<br />
· 5 cm (225)(227)<br />
· 7 cm (311).<br />
- l'épaisseur du fil doit être uniforme (311)<br />
- le diamètre du fil est choisi en fonction de la largeur du sulcus(241:<br />
- les fils très torsadés sont plus satisfaisants que ceux légèrement<br />
serrés (130)( 241) •<br />
• : temps d'action du fil<br />
Pour obtenir une efficacité suffisante,tant du point de vue mécanique<br />
que chimique,le fil doit agir un certain temps:<br />
· 3 à 5 minutes (34)(80)(106)(123)(202)(225)(251)(281)<br />
· 5 à 10 minutes (31)(82)(160)(241)<br />
· 10 minutes (156)(180)(205)(311).
- 7 -<br />
D = Gingi-pak (fil imprégné avec approximativement 0,4 mg d'hydrochlorure<br />
d'adrénaline racémique par cm) . On donne a l'agent D une valeur<br />
arbitraire de 5 avec une valeur plus grande quand l'efficacité est supérieure<br />
et moins grande quand l'efficacité est moindre. Aucune rétraction est<br />
notée 0 .<br />
L'efficacité de la rétraction gingivale de douze solutions ou combinaisons<br />
des drogues est évaluée. Un fil de coton ordinaire est utilisé<br />
comme contrOle .<br />
A l'exception de l'agent B (cocaïne) , toutes les drogues ou combinaisons<br />
de drogues testées sont efficaces pour la rétraction des tissus gingivaux<br />
et , pour des conditions normales chez le patient dentaire moyen , exposent<br />
les limites des préparations de cavité suffisamment pour les procédés<br />
d'empreintes élastiques.<br />
Dans les cas difficiles qui nécessitent une quantité de rétraction<br />
supérieure a la moyenne, les drogues ou combinaisons de drogue qui ont un<br />
coefficient de 5 ou plus seront plus efficaces .<br />
Les combinaisons d'adrénaline + Alun et d'adrénaline + ZnCl sont plus<br />
efficaces que l'adrénaline, l'alun ou le ZnCl utilisés seuls.<br />
Classification des produits utilisés par ordre décroissant<br />
AGENT EFFICACITE<br />
E 6<br />
F 6<br />
H 6<br />
G 5,75<br />
L 5,6<br />
C 5,4<br />
D 5<br />
K 4,9<br />
M 4,5<br />
A 4,25<br />
J 4<br />
B 2<br />
1 1<br />
PRODUIT UTILISE<br />
Gingi-Pak + Alun (solution saturée)<br />
Fil imprégné avec 8% de ZnCl + 8% d'adrénaline<br />
Solution Négatan ° racémique<br />
Solution de Monsel (sulfate ferrique)<br />
Chlorure de Zinc (40%)<br />
Hémodent 00<br />
Gingi-Pak (0,4mg d'hydrochlorure d'adrénaline ra-<br />
Chlorure de Zinc (8%) cémique / cm<br />
Adrénaline racémique 8%<br />
Alun (solution saturée)<br />
Acide tannique 20%<br />
Cocaïne (10%) + Adrénaline (1%0)<br />
Fil de coton ordinaire<br />
° Négatan =Solution aqueuse contenant environ 45% d'un produit de condensation<br />
obtenu par réaction de l'acide méta-cresol sulfurique avec formaldéhyde<br />
00 Hémodent = Chlorure d'aluminium , sulfate d'hydroxyquinol , chlorure<br />
de phénocainium et aminobenzoate d'éthyle.
- 8 -<br />
Certains points de cette étude peuvent para1tre imprécis.On ne<br />
sait comment est appréciée l'efficacité sur les modèles par rapport à<br />
la valeur 5 arbitraire donnée au Gingi-pak.<br />
-Timberlake (287) effectue une étude conduite sur une période de un<br />
an sur cent patients.Toutes les observations de l'effet de rétraction<br />
de la solution sont enregistrées et une échelle de 1 à 5 avec degré d'efficacité<br />
établie. 5 est la meilleure rétraction possible dans la période 00 l'opérateur<br />
est prêt à procéder à l 'empreinte.Timberlake teste:<br />
- le Racord<br />
- une solution d'adrénaline à 4%<br />
- une solution d'adrénaline à 8%<br />
La concentration à 4% produit l'effet le plus grand dans le temps le plus<br />
court.La rétraction du tissu est due à deux choses :<br />
- l'effet de l'adrénaline sur le tissu<br />
- l'effet mécanique de mise en place,enfouissement du fil dans<br />
le sulcus gingival.<br />
-Wilson (308) expose une technique qui essaie de surmonter le<br />
problème du déplacement du caillot et évite les effets indésirables du<br />
contact prolongé des drogues avec les tissus créviculaires.Ce procédé est<br />
le suivant<br />
- précipitation des protéines du fluide créviculaire et coagulation du<br />
sang par applications topiques brèves d'une solution hémostatique<br />
et astringente<br />
- rétraction gingivale avec un fil non imprégné.<br />
Une solution saturée d'alun est choisie comme astringent car elle n'est<br />
pas irritative ni ne cause des torts aux tissus mous.Le fil de coton est<br />
simple,non empesé et flexible.<br />
Chaque sillon gingival est traité par un des trois produits appliqué<br />
au hasard comme suit :<br />
- solution A : solution saturée d'alun de potasse contenant 0,1%<br />
de métabisulfite de sodium suivi par la rétraction au fil ordinaire<br />
- solution B : solution saturée d'alun de potasse contenant 1% de<br />
tartrate acide adrénaline et 0,1% de métabisulfite de sodium<br />
suivi par la rétraction au fil
- aucun traitement avec solution mais rétraction avec du fil<br />
Racestyptine imprégné de chlorure d'aluminium,lignocafne,<br />
oxyquinol comme base de comparaison.<br />
- 9 -<br />
La technique de rétraction adoptée est celle dans laquelle un<br />
toron simple de fil ordinaire non imprégné est rentré dans le sillon et<br />
laissé en place pendant la prise d'empreinte.<br />
Un double toron est placé sur le premier fil dans le sillon et<br />
est enlevé juste avant d'injecter le matériau à empreinte dans les prépa<br />
-rations.<br />
Résultats : la rétraction moyenne produite par la solution<br />
adrénaline.alun est plus grande que celle due au fil Racestyptine.La comparaison<br />
du test T pour les solutions adrénaline-alun et Racestyptine est<br />
significative à P< 0,05.11 en est de même entre la solution alun +<br />
adrénaline et solution alun seule.Cependant,la comparaison des valeurs<br />
du test T Racestyptine et solution d'alun seule n'est pas significative.<br />
Discussion: la disparité dans l'efficacité des deux solutions<br />
résulte probablement de la présence ou de l'absence d'adrénaline.<br />
-Vergnes (298).dans sa thèse,a mesuré les effets de la rétraction<br />
gingivale obtenue par l'emploi de fil Racestyptine à la suite de prises<br />
d'empreinte globale. Deux empreintes globales ont été réalisées à partir<br />
d'une même préparation dentaire pour chaque patient,la première limitée<br />
à l'empreinte de la préparation des tissus environnants et dents adjacentes<br />
et la deuxième effectuée après avoir procédé à l'éviction temporaire de<br />
la gencive marginale au moyen de fil rétracteur Racestyptine.<br />
Nous avons mesuré,sur les modèles positifs unitaires,les différences<br />
de hauteur obtenues sur le plâtre au niveau de la limite cervicale<br />
à partir de points de repère placés sur la préparation.<br />
La rétraction moyenne générale trouvée est de 0,72mm pour l'échantil<br />
-lonnage choisi (patients de 53 ans).
- 10 -<br />
Notre conclusion était la suivante: une nouvelle enquête<br />
exécutée selon la nlême procédure mais concernant un nombre de sujets plus<br />
élevé et des mesures comparatives portant sur différents fils serait<br />
souhaitable.Ainsi serait établie une échelle d'efficacité des différents<br />
produits qui sont à notre disposition.<br />
Ceci est l'un des buts de notre travail.<br />
l - 1.1.2 Hémostase et assèchement du sillon gingival<br />
La plupart des matériaux élastiques ne peuvent "se glisser" dans<br />
un sillon gingival affecté d'une certaine humidité.En effet,si le sillon<br />
gingival n'est pas préservé de celle-ci ,la surface de l'empreinte ne sera<br />
pas nette.<br />
L'efficacité de la méthode peut être directement liée à sa<br />
possibilité de limiter:<br />
. d'une part,l'hémorragie résultant de la dilacération inhérente<br />
à l'instrumentation utilisée (31)<br />
. d'autre part,le flux d'exsudat créviculaire.<br />
• hémostase<br />
les fils non imprégnés contrôlent moins bien que les autres l'hémorragie(82)<br />
- les fils torsadés sont plus satisfaisants pour l'hémostase qu'un fil<br />
serré légèrement (130)<br />
les cordonnets contenant du chlorure d'aluminium et du chlorure de zinc<br />
assèchent et nettoient le tissu gingival tout en laissant des caillots<br />
sanguins lorsqu'on les enlève (82).Le chlorure de zinc est moins efficace<br />
que l'adrénaline (77).
• certains auteurs recommandent l'adrénaline:<br />
- 11 -<br />
- en faible concentration quand le saignement et le suintement sont<br />
légers (31)(123)<br />
- en concentration plus forte 4%,8%, de l'alun à 100% (123) ou une<br />
solution alun-adrénaline (202)(308) quand un saignement ou une hémorragie<br />
doivent être contrôlés.<br />
Timber1ake (287) pense qu'un fil adréna1iné à 4% et le Racord<br />
les stoppent mieux qu'un fil à 8%.En effet,l l action hémostatique de<br />
l'adrénaline est le résultat de son effet constricteur sur les petits<br />
vaisseaux.C'est pourquoi le tissu doit absorber l'adrénaline avant qu'elle<br />
n'agisse sur les vaisseaux.<br />
La concentration semble être le facteur principal dans les voies<br />
de 1 l absorption.Or la solution à 8% a un effet de choc sur la surface des<br />
tissus et donc empèche une absorption rapide.<br />
De p1us,en ôtant le fil contenant de l'adréna1ine,un saignement<br />
abondant peut survenir surtout s'il y a eu un saignement opératoire (308) .<br />
• d'autres utilisent un fil adréna1iné ou non (281).<br />
Pour Wilson (308),une solution sans adrénaline est inefficace<br />
pour une hémorragie.Une solution d 1 a1un sans adrénaline ne laisse pas prévoir<br />
son action: bien qu'elle apparaisse cliniquement efficace,un saignement<br />
arrive invariablement dès que le fil rétracteur est enlevé.<br />
On peut contrôler l'hémorragie initiale en vaporisant la surface<br />
avec un spray d'eau oxygénée à 3% pendant 2 à 3 minutes (202).<br />
L'hémostase est efficace quand le tissu adjacent aux lignes de<br />
finition devient b1anc.On peut aussi placer un fil de large diamètre<br />
trempé dans une solution dentaire hémostatique.
l - 2.1.1 : Le courant<br />
Les différents auteurs ont étudié<br />
- les courants d'électrocoagulation<br />
- les courants d'électrosection<br />
et comparé ces deux types de courant.<br />
• : le courant d'électrocoagulation<br />
- 15 -<br />
Certains (1)(220) slopposent à l'emploi de ce type de courant<br />
pour créer un sillon sous-gingival;d'autrestdans leur expérimentation t<br />
l 'utilisenttl'unit réglé sur une puissance de 1 ou 2tpour étudier la<br />
régénération et la récession gingivale (43).11 faut noter qu1un travail<br />
date de 1966 (151) .<br />
• : le courant d'électrosection<br />
Le courant d'électrosection est le seul courant utilisable dans<br />
la préparation de la gencive lors de la prise d'empreinte pour de nombreux<br />
auteurs (11)(107)(187)(188)(208)(220)(222)(230)(235)(247)(248)(262).<br />
Ils préconisent l'emploi d'units produisant un courant totalement<br />
redressé et filtré en circuits multiples.<br />
Ce courant de coupetappelé électrosectiontrésulte de la totale<br />
désintégration et volatilisation des cellules des tissus selon une ligne<br />
de clivage.Il est limité en lui-même dans sa capacité de destruction t<br />
totalement et à tout momenttpar le contrOle de l'opérateur.<br />
- si le courant est semi-redressétil se produit une légère coagulation<br />
des bords de l'incision<br />
- si le courant est totalement redressé et filtrétl'incision est<br />
libre de toute coagulationtsemblable à celle réalisée par une<br />
lame de bi stouri •
efficace<br />
- 16 -<br />
L'électrosection nécessite trois conditions pour une utilisation<br />
un courant adéquat<br />
une vitesse de coupe optimale<br />
. un mouvement sans pression.<br />
-Gombeaud (111) insiste sur l'utilisation d'un courant de coupe<br />
à haute fréquence sinusoTdal pur.<br />
Au niveau parodontal,l 'opérateur doit tenir compte de l'intensité<br />
du courant qui,trop importante,se manifeste par:<br />
- un blanchissement de la gencive<br />
- des étincelles lors du passage de l'électricité<br />
- un dégagement de chaleur latérale<br />
qui doit être limité tant en profondeur qu'au niveau des lèvres de l'incision.<br />
Si la tension utilisée est trop faible, le tissu a du mal à être incisé,<br />
il blanchit ou bien reste collé sur l'électrode.<br />
-Harrison et Kelly (126) comparent les effets tissulaires et<br />
caloriques des courants partiellement et totalement rectifiés.<br />
Celui-ci dispense une chaleur latérale sur 102 microns autour<br />
du point d'application.<br />
Il atteint 330 microns latéralement,la dispersion calorique étant<br />
plus étendue, les résultats moins bons.<br />
-Goldstein (107)"Miller et Feinberg (197) et Scrivner (262)<br />
insistent particulièrement sur le réglage du courant.<br />
Dans le réglage de la tension trois facteurs interviennent<br />
· la nature du tissu<br />
• l 'hydratation des tissus<br />
· la forme et la taille de l'électrode.<br />
clinique<br />
• comparaison de ces deux courants<br />
Friedman (91) et Friedman et coll.(92) donnent leur impression
• : la position de l'électrode par rapport â la dent<br />
- 20 -<br />
Les électrodes utilisées par Oringer (220) sont employées selon<br />
des positions et des directions semblables.Elles doivent être tenues droites,<br />
parallèlement à l'axe longitudinal de la dent,leur extrémité dirigée vers<br />
la racine ou bien former un angle de 45° avec la dent (248).<br />
La largeur de la tranchée est déterminée par l'angle de l'électrode<br />
avec la dent dans le sulcus gingival.Si la boucle de l'électrode en Uest<br />
tenue selon un angle droit par rapport à la surface de la dent,la largeur<br />
totale de la boucle se projette dans la surface interne de la gencive<br />
marginale.Mais,par contre,si la boucle est tenue selon un angle approximatif<br />
de 15° par rapport à la surface de la dent,très peu de la surface interne<br />
de la gencive marginale sera enlevée.<br />
Pour élargir le sillon,l 'électrode est tenue selon un angle moins<br />
aigu.<br />
-De Mourgues et Llory (201),Klug (151),Scrivner (262),Podshadley et<br />
Lundeen (230),Stein (282) et Fellman (76) placent l'électrode parallèlement<br />
au grand axe de la dent,évitant ainsi un élargissement néfaste du sulcus,<br />
préalablement exploré à la sonde.<br />
-La Forgia (156) tient l'électrode selon un angle de 15° par<br />
rapport à la racine.<br />
-En ce qui concerne la technique d'ouverture,Gombeaud (111) en<br />
accord avec Goldstein (107) conseille l'ouverture du sillon par la face<br />
palatine de la dent,l'électrode faisant un angle d'environ 30° avec l'axe<br />
longitudinal de la dent.<br />
-Nuckles (211) place l'extrémité de l'électrode dans le sulcus<br />
perpendiculairement à l'axe longitudinal de la dent.
- 21 -<br />
• : la pénétration de l'électrode dans le sillon gingivo-dentaire<br />
Oringer (221),Klug (151) et Nuckles (211) insèrent l'extrémité<br />
de l'électrode,après anesthésie,sous la crête de la gencive libre à la<br />
base du sillon gingival.<br />
La profondeur de la tranchée est déterminée par la profondeur<br />
à laquelle le praticien permet à l'électrode de pénétrer.<br />
Scrivner (262).Podshadley et Lundeen (230),La Forgia (156-157),<br />
Stein (282) et Ruel et coll.(248) plaçent l'électrode dans le sulcus tout<br />
en conservant la même profondeur de façon à n'éliminer que l'épithélium<br />
créviculaire.<br />
De Mourgues et Llory (201) pensent que le contrOle de la pénétration<br />
de l'électrode a un rôle capital dans la restitution de la gencive marginale.<br />
L'utilisation intempestive et trop profonde de l'électrode dans le<br />
sillon entraîne une rétraction cicatricielle irréversible et peut provoquer<br />
des brOlures du cément.<br />
L'introduction préliminaire d'un fil de soie à l'intérieur du<br />
sulcus<br />
- dégage la visibilité<br />
- limite la pénétration de l'électrode<br />
- prévient la destruction de l'attache épithéliale de la dent.<br />
Ils utilisent.pour cela,un fil de soie noire américaine (n° 2,5 ou 3).<br />
imprégné de sérum physiologique pour faciliter sa mise en place dans le<br />
sillon.<br />
A ce moment seulement les auteurs poussent l'électrode le long du<br />
mur interne en prenant appui sur le fil.<br />
Dragoo (65) utilise une électrode (Cameron-Miller) enfoncement<br />
contrôlé 1.5mm sur une préparation limitée par un épaulement •<br />
• : le temps d'application et le nombre de passages<br />
L'instrument est utilisé selon un mouvement de rotation de telle<br />
façon que la circonférence entière de la dent soit parcourue (218).
1 - 2.2.2 : Curetage rotatif gingival<br />
- 26 -<br />
-Loe (177) analyse l'influence des procédés de restauration sur<br />
les tissus parodontaux et divise cette analyse en trois parties :<br />
- la préparation de la dent<br />
- la technique d'empreinte<br />
- la restauration finale<br />
La préparation de la dent avec un instrument rotatif,en dessous<br />
de la gencive marginale,représente un traumatisme variable de l'épithélium<br />
créviculaire et du tissu conjonctif sous-épithélial.<br />
Même une cupule de caoutchouc rotative,en deux minutes,peut<br />
enlever totalement un épithélium fin.<br />
-De Rouffignac (245) a préconisé l'utilisation d'une fraise à finir<br />
pour la récupération des racines perdues.<br />
Ce procédé a été adapté à la préparation périphérique dans la<br />
mesure où il permet la mise à nu clinique et le dégagement du pourtour<br />
de la préparation prothétique.<br />
L'auteur utilise une fraise à finir en acier en forme de flamme<br />
ou encore une fraise cylindro-cOnique fine et diamantée montée sur turbine.<br />
La fraise doit travailler sous une pulvérisation d'eau abondante afin<br />
d'éviter un échauffement excessif des tissus dans lesquels elle travaille.<br />
La technique de De Rouffignac (245) rejoint donc l'esprit et les<br />
principes de la technique de curetage rotatif gingival préconisée par<br />
l'Ecole Américaine d'Ingraham (137).<br />
Le but de ce curetage est d'obtenir directement un chanfrein au<br />
degré voulu par la ligne de finition de la préparation tandis que,simul<br />
-tanément,on obtient un curetage doux et égal de l'épithélium interne<br />
du sulcus approximativement au 2/3 de sa profondeur (137).<br />
Cette méthode fournit un espace sulculaire agrandi tout en<br />
éliminant le mouvement élastique de retour des tissus;cet espace cruenté<br />
pourra recevoir le maximum de matériau d'empreinte dans la zone de<br />
finition. (schéma n03 )
Après création de l'épaulement périphérique,l'extrémité de la<br />
fraise est légêrement engagée dans le sulcus selon un axe parallêle au<br />
grand axe de la préparation.<br />
- 27 -<br />
Un ou deux passages suffisent pour obtenir l'éviction gingivale<br />
et le biseautage des épaulements.<br />
Si l'état parodontal est favorable,cette manoeuvre ne s'accompagne<br />
pas d'hémorragie et l'empreinte peut s'effectuer d'emblée mais on obtient<br />
cliniquement plus de saignement avec cette technique (65).<br />
En cas d'hémorragie1le contrOle de celle-ci se fait facilement<br />
par l'application,dans la zone cruentée,d'un fil de coton doux préalablement<br />
trempé dans une solution hémostatique puis essoré (245)<br />
-Cette technique de curetage a été décrite en France par BUGUGNANI<br />
(32) et reprise par 'ouati (288).
II - LES EFFETS TISSULAIRES,LA CICATRISATION,LA RECESSION<br />
II - 1 : APRES RETRACTION<br />
II - 1.1 : Les effets tissulaires après rétraction<br />
•<br />
- 29 -<br />
Pour Loe {177),tous les produits utilisês dans les techniques de<br />
rêtraction gingivale par fil provoquent une atteinte des cellules épithêliales.<br />
les fils.<br />
Pour Forsyth {82),la totalitê de l'atteinte est la même pour tous<br />
Dans l'étude de Leer {160),la destruction des tissus est minime<br />
avec des produits astringents doux.<br />
Ils entraînent le même degré de dilacération des tissus.<br />
Après insertion d'une cordelette de coton saturée d'une solution<br />
escarrotique,llépithélium tout entier et le tissu conjonctif adjacent sont<br />
nécrosés (177).<br />
La réaction tissulaire dépend du temps d'action des fils<br />
Harrison (124)<br />
51 10' 30'<br />
Coton 0 0 1<br />
1/10.000 0 1 1<br />
8 % 1 1 1<br />
100% Alun 0 0 2<br />
8 %ZnCl 3 3 3<br />
40 %ZnCl 3 3 3<br />
Cette atteinte (notée de 0 a 3) est d'autant plus sévère que la<br />
durée est plus grande.
- 30 -<br />
Loe et Si1ness (180) : quand les fils sont laissés dans les poches<br />
gingivales pendant 20 et 30 minutes,le fil est enfoui sous la jonction émai1cément.Dans<br />
la plupart des exemples, les cordonnets sont trouvés dans le<br />
tissu conjonctif supra a1véo1aire,à quelque distance en dessous de la jonction<br />
émail-cément.<br />
La compression purement mécanique donne,à l'échelle tissulaire,<br />
un écrasement vasculaire de la circulation capillaire et une ischémie.<br />
Après l'ablation des fils,c'est au contraire une hyperhémie en<br />
retour qui se produit.<br />
L'atteinte du tissu su1culaire est, non seulement fonction des effets<br />
mécaniques du fil, mais aussi et surtout de la concentration des agents<br />
chimiques dont il est imprégné.<br />
II - 1.1.1 : Le fil de soie floche ciré non imprégné provoque<br />
· Une déformation de la crête gingivale<br />
· Une blessure de l'épithélium su1cu1aire,fissuré jusqu'à la<br />
lamina propria et bordé d'une couche superficielle nécrosée<br />
avec de petites escarres<br />
· Le chorion présente des espaces vasculaires tantôt aplatis,<br />
tantôt agrandis et souvent remplis d'hématies<br />
· L'attache épithéliale est respectée sur une coupe et sur une<br />
autre elle est détruite dans sa totalité<br />
Le périodonte cervical et le cément paraissent intacts (117).<br />
Pe1zner (225) indique qu'un fil sec,sans vaso-constricteur, peut<br />
causer une érosion des tissus et déchirer les tissus lorsque l'empreinte<br />
est enlevée.<br />
II - 1.1.2 : Les fils non adrênalinés<br />
• : fil imprégné de chlorure d'aluminium
- 31 -<br />
Pour Grosman (117) :<br />
- l'altération tissulaire est essentiellement épithéliale;une zone<br />
de nécrose des couches superficielles apparaft avec de nombreuses ulcérations<br />
en cours d'escarrification.<br />
- l'atteinte jonctionnelle est,par contre,plus discrète et surtout<br />
visible dans la partie coronaire<br />
- le tissu conjonctif ne paraft pas altéré<br />
- le cément et le périodonte cervical sont intacts.<br />
Selon Ruel et coll. (248),immédiatement après la mise en place<br />
du fil rétracteur,les spécimens histologiques révèlent,dans presque toutes<br />
les coupes,que le cordonnet a été poussé au delâ de la jonction émail-cément<br />
avec un déplacement vestibulaire de l'unité gingivale.<br />
- l'épithélium sulculaire est présent mais déchiré<br />
- l'épithélium jonctionnel manque parfois à l'extrême bord et<br />
présente une dégénérescence hydropique<br />
- le tissu conjonctif sous-jacent est déplacé ou fendu par<br />
l'hémorragie<br />
- on remarque à une certaine distance de la zone du fil rétracteur<br />
une légère inflammation chronique sous-épithéliale<br />
- l'attache fibreuse est intacte.<br />
• Nemetz (205) conseille d'utiliser le sulfate d'aluminium.<br />
• : Leer et Gilmore (160) attribuent aux solutions diluées d'aluminium<br />
et d'alun un effet de contraction cellulaire et de déshydratation (action<br />
astringente).Il en est de même pour l'acide tannique (156).<br />
Harrison (123) constate que l'utilisation de fils saturés d'alun<br />
entraîne une atteinte tissulaire normale ou légère,immédiate et médiate.<br />
• : la solution de Négatan,fortement acide a un effet de déminéralisation<br />
sur l'émail (311).<br />
• : l'hydroxyde de potassium pénètre profondément dans les tissus et<br />
a un effet styptique (290).
- 34 -<br />
Timber1ake (287),emp10yant des fils imprégnés d'adrénaline à 4%<br />
et 8% et un fil de Racord.ne croit pas que ces produits,avec de telles<br />
concentrations,déterminent des dommages tissulaires transitoires ou permanents.<br />
Loe et Silness (180) : l'adrénaline seule n'a pas d'effet escarrotique.<br />
Hirano (130) : le fil contenant de l'adrénaline n'est pas caustique<br />
même quand il est utilisé plus de 5 minutes .<br />
• : le soluté d'adrénaline à 1/1000<br />
- son utilisation se traduit par une lyse discrète de la couche<br />
kératinisée de l'épithélium gingival<br />
- les épithé1iacrévicu1aire et jonctionnel ne révèlent aucune<br />
anomalie<br />
- le tissu conjonctif montre de nombreux vaisseaux remplis d'hématies.<br />
( 117)<br />
• le soluté d'adrénaline à 1/4000<br />
- ce soluté provoque une lyse de l'épithélium gingival près de<br />
la crête,de l'épithélium sulculaire et jonctionnel jusqu'à sa<br />
limite apicale<br />
- on note la disparition quasi totale de ce revêtement avec de<br />
petites ulcérations ou fissures<br />
- la lamina propria,mise a nu,est également altérée et présente<br />
des érosions et des plaques de nécrose<br />
- le conjonctif profond et ses fibres paratt moins atteint (117).<br />
II - 1.1.4 : Comparaison entre les différents produits<br />
Grosman (117) a montré que les atteintes tissulaires les moins<br />
importantes étaient celles produites par l'adrénaline au 1/4000 et par la<br />
solution de Racestyptine.
- 35 -<br />
L'adrénaline au 1/1000,le chlorure de zinc à 40% et à 8% entrainent<br />
des dommages 2 à 3 fois plus importants que ceux des produits précédents.<br />
Alves et coll. (3) ont montré que les altérations tissulaires<br />
produites par le fil (Gingi-Pak) sont plus discrêtes que celles dues au fil<br />
(Pascord).<br />
Pour Dilts (61), l'adrénaline racémique et l'Hémodent entrainent<br />
moinsd'atteinte tissulaire que le chlorure de zinc.<br />
Il apparaTt que le procédé de rétraction le plus sOr est le fil<br />
quand il est utilisé convenablement (123)(280).<br />
II - 1.2 : La cicatrisation aprês rétraction<br />
II - 1.2.1 : Généralités<br />
Cliniquement,les temps de guérison du Pascord et du Gingi-pak sont<br />
similaires.<br />
D'autre part,l'altération produite en utilisant les deux fils n'a<br />
pas de relation directe avec la profondeur de la gencive attachée (3).<br />
Aprês cette revue des différents auteurs,plusieurs points se<br />
détachent :<br />
- les dommages sont réversibles et ne mettent pas en cause la<br />
réalisation des prothêses et l'intégrité du sulcus gingival pour<br />
tous les produits couramment utilisês,sauf le chlorure de zinc<br />
laissé en place plus de 3 minutes.<br />
- la dilacération des tissus sulculaires favorise la diffusion<br />
des différents agents chimiques,augmentant leur causticité.<br />
Il - 1.2.2 : Temps de cicatrisation<br />
Pour chaque fil,la cicatrisation se fait en :
- 42 -<br />
Le tissu conjonctif sous-épithélial ,également atteint,présente une<br />
zone de nécrose hyaline (0,08 mm).<br />
Sous cette zone bordante,les structures tissulaires du conjonctif<br />
profond para1ssent normales.<br />
§ le passage de l'électrode en J inclinée à 30° selon l'axe de la<br />
dent entrafne une destruction de l'épithélium sulculaire selon une tranchée<br />
chirurgicale moins importante que la précédente 0,38 mm de large et 0,70 mm<br />
de profondeur.<br />
L'épithélium jonctionnel est nécrosé,sur une courte hauteur,dans<br />
sa partie coronaire et reste intact au-delà du néo-sillon.Les berges conjonctives<br />
de la tranchée sont irrégulières et bordées d'une zone de nécrose hyaline de<br />
0,08 mm environ.<br />
Le tissu conjonctif sous-épithélial buccal présente une structure<br />
normale.<br />
§ l'électrode en J,passée lentement,entrafne une destruction totale<br />
de la crête gingivale, la présence de plusieurs escarres carbonisées;la berge<br />
conjonctive est nécrosée sur une épaisseur de 0,20 mm.<br />
La face dentaire met en évidence une destruction du cément qui<br />
appara1t noirâtre et une atteinte superficielle de la dentine sous-jacente.<br />
Il ne reste plus de trace de l'épithélium sulculaire et jonctionnel.<br />
§ le double passage de l'électrode Vari-Tip linéaire détermine la<br />
section de l'épithélium sulculaire et crée un sillon profond et étroit de<br />
0,17 mm de large et de 1,2 mm de profondeur (petite escarre} ,de même que celle<br />
de la partie coronaire de l'attache épithéliale.<br />
L'épithélium gingival de la crête présente une petite zone de<br />
nécrose vacuolaire.L'épaisseur de la zone coagulée sur la berge conjonctive<br />
de la tranchée est minime (0,04 mm).<br />
Le conjonctif profond,le parodonte,le cément sont intacts sur cette<br />
coupe.
- 43 -<br />
§ le passage unique de l'électrode Vari-Tip linéaire provoque une<br />
section incomplète de l'épithélium sulculaire ( profondeur 1,06 mm,la<br />
largeur n'ayant pu être appréciée) et jonctionnel dont la partie apicale<br />
semble altérée.<br />
La zone marginale de nécrose conjonctive paraft réduite (0,05 mm).<br />
Aucune lésion du tissu conjonctif profond,ou bien du parodonte,<br />
n'apparaît pour cette électrode .<br />
• les effets produits selon la vitesse de coupe<br />
Pour un tissu coupé lentement avec l'électrode,la destruction<br />
cellulaire est subtotale par coagulation et nécrose.Seul le noyau garde une<br />
certaine structure malgré sa déshydratation (70) .<br />
• les effets produits selon les individus<br />
Arembrand et Wade (8) : l'examen histologique révèle une différence,<br />
à la fois dans le tissu conjonctif et la maturation épithéliale,entre les<br />
individus.<br />
II - 2.1.2 : Les effets histologiques<br />
Les effets au niveau des couches épithéliales du tissu conjonctif,<br />
des vaisseaux et du'tissu musculaire sont les suivants:<br />
• : tissu épithélial<br />
Les couches de kératine sont coagulées et caractérisées par coloration<br />
acidophile interne et un arrangement amorphe de kératine dégénérative (190).<br />
Immédiatement sous la couche de kératine,les couches de l'épithélium<br />
montrent une nécrose de coagulation (cellules à noyau picnotique).<br />
Dans les cellules basales,les dommages sont semblables à ceux vus<br />
dans les couches supérieures de l'épithélium (190).
- 44 -<br />
Il n'y a aucune perte évidente de la définition cellulaire ou de<br />
perturbation dans les organites cellulaires.Les desmosomes sont intacts,la<br />
menbrane cellulaire,les tono-fibrilles,les mitochondries et les granules<br />
de glycogène ne présentent aucun signe de perturbation (78)(188).<br />
Généralement,l'épithélium sur les bords de l'incision montre une<br />
déchirure légère en regard de la chirurgie;souvent,les couches épithéliales<br />
sur les bords sont coupées d'une façon propre,sans déchirure (57)(255).<br />
Lorqu'il y a altération de l'épithélium,les cellules picnotiques<br />
semblent plus prononcées pour la plaie d'électrochirurgie,les bords de<br />
l 'épithéliunl montrent des cellules mal définies et le cytoplasme est plus<br />
pale que dans les cellules adjacentes (255).<br />
• : au niveau du tissu conjonctif<br />
Les couches cellulaires montrent moins de destruction que les<br />
cellules épithéliales,mais une nécrose de coagulation (190).<br />
Le tissu conjonctif sous-jacent à la nécrose présente de la fibrine<br />
et des matériaux fibrinofdes (248).<br />
Un petit changement est apparent dans les fibres de collagène et<br />
les fibroblastes situés sur le chemin des instruments : les auteurs notent<br />
un mastocyte partiellement intact (78) sectionné par électrochirurgie.<br />
Les granules,dans ce mastocyte,ont conservé leur intégrité en dépit<br />
du contact de l 1instrument électrochirurgical (188).<br />
Le conjonctif est relativement normal avec une zone légèrement plus<br />
sombre juste en dessous de la plaie.<br />
Des parties de la lamina propria sont altérées.Les altérations<br />
consistent en une condensation des éléments du tissu conjonctif situés à la<br />
surface de la plaie dénudée et entourés de zones raréfiées.<br />
Ces condensations,qui ressemblent à du tissu hyalinisé d'apparence<br />
amorphe et lisse,vont plus profondément dans la lamina propria et ne sont pas<br />
limitées à la surface exposée du conjonctif.<br />
i<br />
! 1<br />
!<br />
1 !<br />
i<br />
J<br />
f<br />
J<br />
1
- 45 -<br />
Les condensations à la surface sont parfois en continuité avec le<br />
conjonctif normal.<br />
Ces zones de tissu conjonctif altéré ne sont pas extensives: elles<br />
ne comptent que pour une petite partie du conjonctif dénudé et du volume<br />
de la lamina propria.<br />
Loin de la zone de nécrose, les cellules deviennent plus basophiles<br />
et présentent des noyaux picnotiques.Les fibres de cette région sont basophiles.<br />
(190)<br />
• : les vaisseaux sanguins<br />
Ils sont dilatés et de nombreux érythrocytes extravasés sont mis<br />
en évidence dans la lamina propria (255);i1 n'y a apparemnent pas de dOl1l11ages<br />
au niveau des vaisseaux sanguins qui se trouvent sous la plaie.<br />
L'essaimage microbien post-opératoire après é1ectrochirurgie<br />
para,t réduit par oblitération immédiate des vaisseaux sanguins et lymphatiques<br />
(78)( 88 ).<br />
• les tissus musculaires<br />
Ils sont les moins touchés.Latéra1ement à la surface de coupe,la<br />
nécrose des cellules est normale.(190)<br />
II - 2.2 : La cicatrisation<br />
II - 2.2.1 : Généralités<br />
• : cette étape signe la guérison de l'acte chirurgical et la restitution<br />
partielle ou intégrale des éléments tissulaires et vasculaires de la gencive.<br />
Nous donnerons deux définitions celles de la régénération et de la<br />
réparation.
• la régénération<br />
- 46 -<br />
Reproduction naturelle d'une partie vivante qui a été détruite.Ceci<br />
suppose,pour les tissus observés,deux aspects différents:<br />
aspect qualitatif avec le rétablissement des constituants<br />
tissulaires<br />
. aspect quantitatif avec la répartition spatiale et l'équilibre<br />
fonctionnel de ces tissus constituants.<br />
Cette forme de régénération reste rare pour l'organisme .<br />
• la réparation<br />
C'est une forme plus simple et moins complète de la cicatrisation.<br />
Elle rétablit les constituants mais laisse persister plus ou moins longtemps<br />
un déséquilibre fonctionnel qui fait que le tissu néo-formé nlest pas identique<br />
au tissu originel.<br />
De nombreux auteurs ont orienté leurs travaux sur la cicatrisation<br />
des plaies.Il en résulte les faits suivants:<br />
Après incision,la surface du tissu conjonctif est généralement<br />
recouverte par un coagulum formé de cellules sanguines,de fibrine et de cellules<br />
mésenchymateuses.<br />
l'épithélium,sur les bords de la plaie.donne naissance à un épithélium<br />
stratifié se situant entre le conjonctif et le coagulum.<br />
Comme toutes ces cellules établissent un contact avec les cellules<br />
adjacentes,elles prennent une forme plus arrondie tandis que les cellules<br />
plus superficielles,aplaties et allongées,glissent sous elles pour répéter le<br />
même processus.<br />
le taux de migration des cellules épithéliales dans les plaies<br />
ouvertes est ralenti par 1'obstruction mécanique du coagulum.
- 48 - 1<br />
la détersion de la trace et de la zone d'altération par des<br />
cellules spécialisées et des cellules épithéliales (phagocytose)<br />
la migration cellulaire et le bourgeonnement vasculaire,cette<br />
néo-vascularisation traduit la transformation du granulome<br />
- la réorganisation de la maquette tissulaire,orientation de la<br />
fi bri nogénèse .<br />
les travaux anglo-saxons et plus particulièrement américains sur les<br />
différentes phases de la cicatrisation,après électrosection.sont relativement<br />
nombreux,nous les étudierons successivement.<br />
les travaux de Oringer (220),Kelly et Harrison (148) et Evans (74)<br />
vont tous dans le même sens,c'est à dire qu'après l'utilisation du même<br />
courant totalement redressé et filtré,les résultats sont comparables à ceux<br />
obtenus par chirurgie conventionnelle(8)(70)(139)(255),même si les délais<br />
de réparation sont relativement plus longs (58)(104)(273).<br />
II - 2.2.2 les étapes de la cicatrisation<br />
• : 12 heures après électrochirurgie/les plaies sont vides,exceptées<br />
quelques zones occasionnelles d'exsudat inflammatoire aigu ,principalement<br />
dans les parties les plus profondes.<br />
Un coagulum s'étend le long des berges de l'incision;la réponse<br />
inflammatoire est intense et sévère (207) .<br />
• : A la 16ème heure,on observe la migration de l'épithélium.Il y a<br />
toujours un tissu conjonctif vivant sous l'épithélium migrant.<br />
Schneider et Zaki (255-256) ont noté la séparation des cellules<br />
épithéliales dans les couches basales et épineuses avec des desmosomes formant<br />
des points de contact.<br />
De fines extensions cellulaires en doigt de gant s'étendent dans de<br />
larges espaces intercellulaires et souvent se joignent aux structures similaires<br />
des cellules adjacentes par les desmosomes intacts.
- 49 -<br />
Les organelles des cellules sont souvent déchirées;les noyaux sont<br />
retrécis,les tonofilaments montrent des condensations.<br />
Dans les couches superficielles épithéliales bordant la plaie,<br />
llépithélium a la même architecture.Les cellules semblent être en relation<br />
intime avec les desmosomes intacts. Leur contenu cytoplasmique semble être<br />
plus filamenteux.<br />
Les couches superficielles épithéliales sont souvent recouvertes de<br />
leucocytes polynucléaires et de débris tissulaires.<br />
Loin des bords de la plaie,les composants fibreux du conjonctif,<br />
juste sous la lame basale,sont denses et apparemment intacts.<br />
la morphologie des cellules épithéliales est inaltérée.les cellules<br />
basales ne montrent que peu de mitochondries, les ribosomes sont libres et<br />
abondants,des paquets de tonofilaments sont plus marqués dans les zones<br />
périnucléaires.<br />
Les cellules du stratum spinosum montrent de nombreux desmosomes<br />
et peu d'espaces intercellulaires élargis.<br />
Les fibres de collagène sont plus clairsemées dans ces zones.<br />
Les cellules inflammatoires,à ce stade de la cicatrisation,sont<br />
des leucocytes polynucléaires.<br />
• : A 24 heures on note :<br />
- une augmentation de la nécrose fibroblastique et une dégénérescence<br />
des faisceaux de fibres de collagène<br />
- une invasion légère de monocytes (aucun afflux de leucocytes<br />
polynucléaires) .<br />
• Au deuxième jour une légère inflammation apparaft (151).<br />
• Après 4 jours :<br />
Il n'y a plus de débris nécrotiques;la migration épithéliale paraft<br />
cesser entre le 4ème et le 7ème jour.La prolifération de l'épithélium jonctionnel<br />
s'est étendue à la région apicale de l'épithélium sulculaire.
- 58 -<br />
• électrochirurgie suivie de la pose d'un anneau souple imprégné de<br />
soluté d'adrénaline à 1/1000<br />
La section semble limitée à l'épithélium sulculaire qui présente une<br />
zone nécrosée de faible importance.<br />
L'épithélium gingival près de la crête montre une couche kératinisée<br />
réduite en épaisseur.<br />
L'attache épithéliale,au-delà de la zone nécrosée,est intacte sur<br />
toute sa longueur.<br />
Le tissu conjonctif du chorion révèle,près de la crête,une vacuolisation<br />
en rapport avec la région nécrosée.<br />
Le conjonctif profond,le périodonte et le cément ne sont pas atteints.<br />
• : électrochirurgie + solution Racestyptine<br />
Les altérations épithéliales débutent au sommet de la crête gingivale<br />
et concernent tout le revêtement sulculaire,l'attache coronaire et apicale<br />
jusqu'à sa limite cémentaire.L'ensemble de l'épithélium disparaft.<br />
Le tissu conjonctif présente une couche marginale de nécrose peu<br />
épaisse mais qui s'étend depuis le sommet du chorion jusqu'au cément.<br />
Le conjonctif profond para1t préservé dans tous ses éléments.<br />
• : électrochirurgie + solution de chlorure de zinc à 8%<br />
Des destructions considérables concernent l'épithélium gingival qui<br />
montre une exfoliation importante de la quasi totalité de l'épithélium<br />
sulculaire et jonctionnel jusqu'à la limite cémentaire.<br />
Les lésions atteignent le tissu conjonctif profond et le périodonte,<br />
le cément étant épargné.<br />
• : électrochirurgie + fil de soie floche ciré non imprégné<br />
Cette association entra1ne les altérations suivantes :<br />
• l'épithélium est détruit depuis le sommet de la crête jusqu'au<br />
cément avec de nombreuses escarres
DEUXIEME PARTIE<br />
1 - ETUDE DES EXPERIMENTATIONS ANIMAlES<br />
1 - 1 EXPERIMENTATIONS SUR LES CHIENS<br />
1 - 2 EXPERIMENTATIONS SUR LES SINGES<br />
1 - 3 EXPERIMENTATIONS SUR LES AUTRES ANIMAUX<br />
II - L'ANESTHESIE<br />
III - CHOIX DES CRITERES DE SANTE GINGIVALE<br />
III - 1 LES INDICES<br />
III - 2 SANTE GINGIVALE CHEZ L'HOMME<br />
III - 3 SANTE PARODONTAlE CHEZ L'ANIMAL<br />
IV - LES MENSURATIONS<br />
IV - 1 : DEFINITION DU SULCUS CLINIQUE ET HISTOLOGIQUE<br />
Histologiquement<br />
• Cliniquement<br />
• Différence<br />
IV - 2 : LES MENSURATIONS CLINIQUES<br />
IV - 2.1 : Etude quantitative des mensurations<br />
IV - 2.1.1 les sondes<br />
IV - 2.1.2 Amélioration de la sonde<br />
IV - 2.1.3 Les lames d'acier<br />
IV - 2.2 : Etude qualitative des mensurations<br />
IV - 2.2.1 Influence du diamètre de la sonde<br />
IV - 2.2.2 Influence de la pression exercêe lors du sondage<br />
• Avec une sonde<br />
• Avec une lame métallique
Relations: pression exercée - pénétration de l'instrument<br />
IV - 2.2.3 : Influence de la santé parodontale<br />
. Dans le cas de bonne santé<br />
En présence d'inflammation gingivale marginale<br />
En présence de maladie parodontale<br />
• Après le traitement initial<br />
IV - 3 LES MENSURATIONS PROTHETIQUES<br />
000
- 63 -<br />
Il faut cependant noter que cette anesthésie locale intervient<br />
dans les cas de chirurgie gingivale et non de rétraction gingivale et<br />
que tous les auteurs ne l 'emploient pas systématiquement.<br />
Pour une éviction gingivale simple,aucune anesthésie locale<br />
complémentaire n'est nécessaire dans la mesure où les problèmes et les<br />
risques hémorragiques peuvent être circonscrits par un simple hémostatique<br />
local.<br />
III - CHOIX DES CRITERES DE SANTE GINGIVALE<br />
Une gencive strictement saine au niveau clinique se conforme<br />
à des critères qualitatifs de :<br />
- forme<br />
- contour<br />
- volume<br />
- consistance<br />
- couleur<br />
- caractère de la surface.<br />
Le sillon gingival aussi ,doit montrer une absence totale d'inflam<br />
-mation dans les préparations microscopiques (83)(177)(216).<br />
Dans les études épidémiologiques et en recherche clinique-, il est<br />
souhaitable d'évaluer le degré d'inflammation gingivale.<br />
Les mesures d'exsudat cellulaire ont été présentées comme une<br />
méthode objective: Brill et Bjorn (216) reportent une corrélation entre<br />
le -degré de l'inflammation et le flux d'exsudat cellulaire (30).<br />
De nombreux indices ont également été utilisés.Bien que ces<br />
déterminants soient subjectifs et donc sujets à la variabilité de l'exami<br />
-nateur,leur utilisation a été très largement répandue en recherche et<br />
pratique parodontale (216).
- 65 -<br />
Hancock et coll. (120) ont établi un statut gingival présentant deux<br />
stades de moins que celui de MUhlemann (203) et indiquent seulement que la sonde<br />
est insérée dans le sulcus avec une pression de 62 g jusqu'à ce que l'opérateur<br />
ressente une résistance.<br />
- indice de saignement sulculaire (581)(203) :<br />
Cet indice,modification du PMA et sélectionné pour notre étude,se<br />
rapproche beaucoup du GI mais,par son plus grand nombre de stades,permet<br />
d'analyser plus finement les étapes initiales des atteintes gingivales.le<br />
diagnostic d'inflammation nlest fait que si le saignement apparaît à la suite<br />
d'un sondage délicat du sillon.<br />
MUhlemann (203) a démontré que le saignement du sulcus gingival est<br />
le signe clinique le plus précoce de la gingivite et qu'il précède le changement<br />
de coloration et l 1oedème .<br />
Les mesures sont effectuées , pour chaque dent<br />
- côté mésial<br />
- côté distal<br />
côté lingual<br />
- côté vestibulaire<br />
sans sécher ou nettoyer la gencive qui doit être examinée<br />
En effet ,1 'inflammatimpeut être manifeste dans le sulcus mésial ou le<br />
sulcus distal alors qu'elle ne s'est pas encore déclarée au niveau du sulcus<br />
vestibulaire.<br />
- Avantage: il permet d'analyser plus finement encore les premières<br />
atteintes du parodonte .<br />
- Inconvénient: comme le PMA , il ne tient pas compte des stades plus<br />
avancés de la maladie, inconvénient minime dans le cadre de notre expérience<br />
pour laquelle nos chiens présentent une santé parodontale relativement bonne.
- 67 -<br />
plusieurs points quant à la détermination de la santé parodonta1e :<br />
- Préparation initiale, détartrage et polissage des dents (8)<br />
- Enseignement de 1'hygiène bucco-dentaire (132)(248) (8).<br />
Les critères utilisés sont:<br />
- l'Indice Gingival (GI) (132) (159)<br />
- la Mesure de l'exsudat gingival (175) (132)<br />
- l'Indice de Plaque (PlI) (159)<br />
- l'Indice parodonta1 de Russel (PI) (248)<br />
Pour beaucoup,aucune mention de la santé parodonta1e nlest citée dans<br />
leurs articles et , cependant, il semble évident que leurs expérimentations se<br />
pratiquent en des zones où l'état parodonta1 ne peut être qu'excellent.<br />
III - 3 SANTE PARODONTALE CHEZ L'ANIMAL<br />
• De nombreux auteurs ne décrivent pas l'état de santé parodontale<br />
des animaux avant de procéder aux expérimentations (23)(151)(210)(280)(285)(311).<br />
• Certains indiquent que les chiens ont une bonne santé parodontale<br />
(117)(123)(304) et s'assurent que les prélèvements gingivaux s'effectuent en<br />
des zones où le tissu est cliniquement nonmal,sans oedème et où les surfaces<br />
des dents sont dépourvues de toute plaque dentaire (139).<br />
• Il en est qui se contentent,au début de l'anesthésie généra1e,de<br />
nettoyer simplement les dents des chiens (104) ou d'éliminer les dépôts de<br />
tartre (253).<br />
• D'autres examinent la cavité buccale et effectuent le bilan parodontal,<br />
un détartrage et un polissage de toutes les dents (10)(84).<br />
Le détartrage peut être répété 1 fois la semaine suivante (154) et<br />
même procéder ainsi toutes les semaines jusqu'au sacrifice (28)(73)(165)(182).<br />
1<br />
i
- 68 -<br />
Kelly et Harrison (14.9) ne commencent l'expérimentation proprement<br />
dite que 2 semaines plus tard et Wilhelmsen et coll. (307) 4 à 10 semaines<br />
plus tard.<br />
Selon les auteurs,une brosse à dent est employée quotidiennement (192)<br />
pendant les 14 jours suivants (154) ou 3 semaines (296) ou pendant 1 mois (10).<br />
Ericsson et coll. (73) , Lindhe (165) , Bratthal1 et coll. (28) ,<br />
pendant 8 semaines , nettoient mécaniquement, 2 fois par jour, les dents des<br />
chiens . Après la fin de la période de préparation , la santé de tous les<br />
chiens est cliniquement excellente:<br />
- aucun saignement au sondage<br />
- aucun fluide collecté à l'entrée du sulcus gingival.<br />
Lindhe et coll. (167) font de même pendant une période préparatoire de<br />
5 à 6 mois et les dents sont traitées avec un bain de bouche contenant 2 %de<br />
chlorexhidine .<br />
Armitage et coll. (lO),au bout d'un mois, en plus du brossage quotidien<br />
, appliquent un topique contenant 0,2 %de chlorexhidine ; les 3 derniers<br />
jours, le seul soin est l'application du topique.<br />
Les indices utilisés pour établir,de manière quantitative, le degré<br />
de santé parodontale sont :<br />
- les mensurations de l'exudat gingival (10)<br />
- le GI (10 et 154)<br />
- le Pl l (154)<br />
- le PI (154)<br />
Deux critères servent à contrôler l'état gingival<br />
Couleur de la gencive: 0 = pas rouge<br />
1 = rouge<br />
- Gonflement de la gencive: 0 = non gonflée<br />
1 = gonflée (296)
Définition du Su1cus Histologique et Clinique<br />
-----}<br />
- ----<br />
d'après LISGARTEN ( 169 )<br />
Su1cus<br />
histologique<br />
Su1cus<br />
clinique<br />
S c h é ma<br />
- 70 -<br />
Le su1cus histologique est mieux<br />
observé dans des sections de<br />
dent et de gencive intacte .<br />
Sa profondeur est la distance<br />
entre 2 lignes tracées perpendiculairement<br />
à la surface qui<br />
recoupent la surface libre de<br />
l'épithélium de jonction et le<br />
rebord de la gencive.<br />
Le su1cus clinique est la profondeur<br />
à laquelle un objet<br />
étranger, tel qu'une sonde<br />
parodonta1e , pénètre après<br />
le rebord gingival . A cause<br />
de degrés variés de rupture<br />
des tissus, les profondeurs<br />
du sulcus clinique excèdent<br />
généralement la profondeur du<br />
su1cus histologique.
- 75 -<br />
-Pour Magnusson et listgarten (184},deux encoches de référence sont<br />
préparées pour chaque dent au niveau de la gencive marginale: une mésio ou<br />
disto-vestibulaire et une mésio ou disto linguale.<br />
Utilisant un instrument pointu,une ligne est préparée sur le strip<br />
au niveau de la partie apicale de l 'encoche. la longueur du strip inséré<br />
est mesurée avec un compas à 0,1 mm près.<br />
Nous venons de le voir,les différents procédés de mesure dans leur<br />
ensemble sont les mêmes;ils varient de façon significative quand aux moyens<br />
utilisés (compas,jauge de Boley,microscope avec échelle micrométrique) ce<br />
qui signifie peut être que chaque auteur,utilisant des techniques différentes<br />
pour une approche la plus précise possible,n'en a pas une suffisamment rigoureuse<br />
à sa disposition;il faudra donc, pour atteindre des résultats scientifiquement<br />
valables,réduire au minimum les risques d'erreur en doublant les mensurations<br />
cliniques,en limitant le nombre des manipulations et en déchiffrant ces<br />
mesures avec une instrumentation permettant les données les plus exactes<br />
possibles.<br />
IV - 2.2 : Etude qualitative des mensurations<br />
l'hypothèse d'Armitage et coll. (10) est que la profondeur du<br />
sondage dépend :<br />
· du diamètre de la sonde<br />
· de la pression exercée sur la sonde<br />
· du degré d'inflarnmationdu tissu conjonctif.<br />
Elle dépend aussi de l'hygiène bucco-dentaire.<br />
IV - 2.2.1 : Influence du diamètre de la sonde<br />
Van der Velden et Jansen (297) pensent que,lorsqu 'on utilise une<br />
sonde de 0,63 mm de diamètre,la pression de sondage optimal doit être de<br />
240 N/Cm3.<br />
IV - 2.2.2 : Influence de la pression exercée lors du sondage<br />
• avec une sonde
- 77 -<br />
la moyenne des forces exercées lors du sondage délicat du su1cus<br />
gingival est comprise entre 9 kg et 14,8 kg;la morphologie des dents,la<br />
position dentaire,l 'expérimentateur,inf1uencent les forces exercées.<br />
-Hassel et coll. (127) ont mesuré,au moyen d'une sonde parodontale<br />
sensible à la pression,la profondeur des su1ci et des poches.<br />
Des différences significatives entre la force utilisée et la<br />
profondeur de sondage mesurée furent observées par les expérimentateurs.<br />
Seule une corrélation faib1e,pas statistiquement significative,<br />
existe entre force de sondage et profondeur.ta technique du sondage appara1t<br />
plus importante que la force.<br />
- Van der Velden et Devries (295) trouvent,par contre,une corrélation<br />
positive entre les deux.<br />
IV - 2.2.3 : Influence de la santé parodontale<br />
-Van der Ve1den et Jansen (297) pensent que le degré d'inflammation<br />
des tissus parodontaux peut influencer la profondeur à laquelle une sonde<br />
peut pénétrer dans la poche.<br />
-Robinson et Vitek (243),dans leur étude sur l'inflammation gingivale<br />
et la résistance à la pénétration de la sonde,ont démontré que:<br />
- le sondage parodontal n'est pas assez précis pour établir la<br />
position coronaire de 1'attache du tissu conjonctif.<br />
En effet<br />
- la pénétration de la sonde dans des tissus parodontaux enflammés<br />
dépend du degré d'inflammation (97)(141)(172).<br />
Pendant l'examen clinique de patients présentant des degrés variés<br />
de maladie parodontale,l'extrémité de la sonde pénètre régulièrement dans<br />
l'épithélium de jonction sur une distance moyenne de 0,3 mm (173).
• : dans le cas de bonne santé<br />
- 78 -<br />
La résistance du tissu conjonctif au sondage augmente, les fibres<br />
parodontales établissant ainsi un effet de hamac (243)(275).<br />
Chez des patients présentant une maladie parodontale non traitée,<br />
dans l'étude de Sivertson et Burgett (271),les résultats montrentqu'unefine<br />
sonde parodontale atteint l'attache du tissu conjonctif lors des sondages<br />
de routine.<br />
• : en présence d'inflammation gingivale marginale<br />
La pointe de la sonde traverse souvent l'épithélium dans le tissu<br />
conjonctif quand les forces de sondage légères sont appliquées (297).<br />
• : en présence de maladie parodontale<br />
Armitage et coll. (10) et Spray (274-275) suggèrent que la pointe<br />
de la sonde traverse seulement l'épithélium de la poche et pénètre dans<br />
le tissu conjonctif.<br />
• : après le traitement initial<br />
En 1980,Van der Velden (292) étudiant l'influence de la santé<br />
parodontale sur la profondeur du sondage et sur la tendance au saignement a<br />
établi :<br />
• qu'il y a une augmentation de la profondeur du sondage pour<br />
une force de sondage accrue,aussi bien avant qu'après le<br />
traitement initial.<br />
Dans les culs de sac de plus de 4 mm de profondeur,une différence<br />
significative a été trouvée entre le groupe de dents soumises A un traitement<br />
parodontal et celui de dents n'ayant reçu aucun traitement.Dans les dents<br />
non traitées,les bandelettes de métal utilisées pour le sondage pénétraient<br />
en moyenne à 0,9 mm dans le tissu conjonctif du cOté apical de l'épithélium<br />
de jonction.
- 79 -<br />
Les résultats indiquent qulil convient dlêtre prudent lors de<br />
l 'évaluation des modifications dans les mesures du sondage parodontal au<br />
cours des études longitudinales (184).<br />
Le traitement initial entraîne une diminution de la profondeur<br />
moyenne de sondage mais cette réduction dépend de la force appliquée;elle<br />
peut signifier un réattachement des fibres conjonctives (292).<br />
Pour Listgarten (172)tceci est dO,en partie,à la formation d'un<br />
épithélium de jonction lIallongéll.<br />
IV - 2.2.4 : Influence de l 'hygiène bucco-dentaire<br />
Van der Velden et Jansen (297),lors de l 'évaluation microscopique<br />
des mensurations de la profondeur des culs de sac pratiquées chez le chien)<br />
en employant six forces de sondage différentes,ont montré que, dans le groupe<br />
dont les dents avaient été brossées,llépithélium était toujours présent entre<br />
llextrémité de la sonde et le tissu conjonctif.<br />
Dans le groupe dont les dents n'avaient pas été brossées,la présence<br />
dlépithélium a été trouvé dans 21 des 23 spécimens.<br />
Dans les deux groupes,on a trouvé que, lorsque la force de sondage<br />
augmente,il se produit un changement dans la position de llextrêmité de<br />
la sonde.<br />
Lorsqulon utilisait des forces légères de sondage,on constatait<br />
que l lextrémité de la sonde dans le groupe sans brossage des dents était<br />
située au niveau le plus apical.<br />
Lorsqulon utilisait des forces de sondage plus élevées,on ne<br />
constatait pas de différence entre le groupe avec et celui sans brossage<br />
des dents.
IV - 2.3 : Situation de la sonde<br />
- 80 -<br />
La position de l'extrémité de la sonde est indépendante de la<br />
profondeur du su1cus ou de la poche (97).<br />
Le mouvement de la sonde se voit opposer une force contraire<br />
dûe à la densité du tissu conjonctif soutenu par un oedème tissulaire<br />
et l'os alvéo1aire;le tissu épithélial et l'attache ne para1ssent pas<br />
intervenir (97).<br />
-Jansen et coll. (143).après l'évaluation histologique de la<br />
pénétration de la sonde. ont abouti à la conclusion suivante:<br />
- le revêtement épithélial d'un cul de sac reste intact<br />
ce qui indique que,pendant les sondages c1iniques.1es tissus sont comprimés.<br />
déplacés mais pas perforés.<br />
-Po1son et coll. (234) ont montré que.pour une sonde soumise à<br />
une pression de 25 g.la pénétration de la sonde se fait.dans tous les cas.<br />
à un niveau coronaire par rapport à la limite apicale à l'épithélium de<br />
jonction (moyenne 0.25 mm) et à un niveau apical par rapport à la limite<br />
coronaire de l'épithélium de jonction (moyenne 0.27 mm).<br />
-Hancock et Wirth1in (121) concluent que la profondeur du sondage<br />
donne une estimation de la jonction dento-gingiva1e saine mais ne permet<br />
pas de faire la différence entre l'attache épithéliale et le tissu conjonctif.<br />
Il ressort de leurs observations que même un sondage léger peut<br />
être la cause de déchirures et de distortions extrêmes des tissus et que<br />
l'on ne peut assurer une mesure précise du niveau de la jonction dentogingivale<br />
saine.<br />
En moyenne.1'extrémité de la sonde parodonta1e tend à être située<br />
sur la ligne de démarcation entre l'épithélium jonctionne1 et l'attache du<br />
tissu conjonctif à la racine et peut être même dans le tissu conjonctif<br />
adjacent (l73).
•<br />
CHAPITRE Il<br />
•<br />
LES OBJECTIFS
1 - LES ANIMAUX<br />
1 - 1 : ETAT GENERAL<br />
1 - 2 : ETAT BUCCAL<br />
1 - 2.1 La formule dentaire<br />
1 - 2.2 Le choix des dents<br />
II - LE MATERIEL<br />
II - 1 : MATERIEL NECESSAIRE AU SONDAGE<br />
II - 2 : MATERIEL NECESSAIRE A LA PREPARATION DES DENTS<br />
II - 3 MATERIEL NECESSAIRE A LA REALISATION D'EMPREINTES<br />
II - 4 MATERIEL UTILISE POUR LA RETRACTION GINGIVALE<br />
II - 4.1 Pour la rétraction<br />
II - 4.2 Pour l'éviction<br />
II - 5 MATERIEL NECESSAIRE A LA REALISATION DES RESTAURATIONS TRANSITOIRES<br />
II - 6 MATERIEL DE MENSURATIONS MICROSCOPIQUES<br />
· Pour le sondage clinique<br />
· Pour l'interprétation histologique des coupes<br />
II - 7 : MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE<br />
III - PROTOCOLE EXPERIMENTAL<br />
III - 1 : STADE INITIAL DE L'EXPERIMENTATION<br />
III - 1.1 : Rétraction par fil<br />
III - 1.1.1 : Anesthésie<br />
III - 1.1.2 : Examen buccal<br />
· Examen général<br />
· Evaluation de l'état de santé parodontale<br />
III - 1.1.3 : Réalisation de l'encoche<br />
III - 1.1.4 : Empreintes pour restaurations transitoires
III - 1.1.5 La préparation coronaire<br />
III - 1.1.6 Empreintes globales sans rétraction<br />
III - 1.1.7 Mensuration de la profondeur du sulcus<br />
III - 1.1.8 Mise en place du fil rétracteur<br />
· Protocole général de mise en place du fil<br />
· Protocole pour chaque fil<br />
III - 1.1.9 : Empreintes après rétraction<br />
· Préparation<br />
• Empreinte<br />
III - 1.1.10 Les restaurations provisoires<br />
III - 1.1.11 Coulée des modèles<br />
III - 1.2 : Eviction chirurgicale<br />
III - 1.2.1 : Electrochirurgie<br />
III - 1.2.2 Technique mixte électrochirurgie + fil<br />
III - 1.2.4 Technique mixte curetage rotatif + fil<br />
III - 2 : STADE TERMINAL DE L'EXPERIMENTATION<br />
IV - FICHES OPERATOIRES<br />
V - LES MENSURATIONS<br />
V- 1 : MENSURATIONS CLINIQUES<br />
V - 1.1 Les mensurations<br />
V- 1.2 Leur but<br />
V- 1.3 Leur réalisation<br />
V - 2 : MENSURATIONS PROTHETIQUES<br />
V- 2.1 Préparation des modèles<br />
V - 2.2 Les mensurations<br />
V - 2.2.1 : Mesure sur le modèle sans préparation initiale
v - 2.2.2 : Mesure sur le modèle aprês Ilging;vectomie ll<br />
V - 2.3 Leur but<br />
V - 2.4 Leur réalisation<br />
V- 3 : MENSURATIONS HISTOLOGIQUES<br />
V - 3.1 : La préparation histologique<br />
Pour l'étude qualitative<br />
Pour l'étude stéréologique<br />
V - 3.2 Les mensurations<br />
V- 3.3 Leur but<br />
V - 3.4 Leur réalisation<br />
V- 4 : ANALYSE STEREOLOGIQUE DU TISSU CONJONCTIF GINGIVAL INFILTRE<br />
V- 4.1 Le but<br />
V - 4.2 Méthode<br />
. Grossissement x 280<br />
Grossissement x 500<br />
Grossissement x 760<br />
000
II - 2 MATERIEL NECESSAIRE A LA PREPARATION DES DENTS<br />
- pour le sillon sur la face vestibulaire des dents :<br />
· meulette RCB II - 16 0 (épaisseur de la tranche =lmm)<br />
- 88 -<br />
- pour la préparation des dents elles-mêmes:<br />
· fraises contenues dans le coffret RCB II K 0 du<br />
Dr L.P. Lustig (Boston)<br />
· un microtour portatif<br />
· une pièce à main,un contre-angle multiplicateur<br />
· un vernis de type Copalite 00<br />
· une seringue en plastique banale pour la pulvérisation d'eau<br />
· une aspiration chirurgicale.<br />
II - 3 MATERIEL NECESSAIRE A LA REALISATION D'EMPREINTES<br />
· porte-empreintes du commerce: cuillers d'inlay 000<br />
· élastomères : Zafo dur 0000 + Xantopren plus 00000<br />
• une seringue a injecter<br />
• une spatule métallique<br />
· un bloc à spatuler.<br />
II - 4 : MATERIEL UTILISE POUR LA RETRACTION GINGIVALE<br />
II - 4.1 : Pour la rétraction<br />
· un miroir de .bouche<br />
· une sonde<br />
• une précelle<br />
· une spatule de bouche aux bords arrondis<br />
· des rouleaux de coton<br />
• un flacon d'eau oxygénée.<br />
o Komet CMS-Dental<br />
00 Cooley and Cooley - Ltd Houston (Texas)<br />
000 Lab. Boehringer Ingelheim<br />
0000 Kettenbach<br />
00000 Bayer
· électrode 1 B-Bent 0<br />
fil Racestyptine<br />
fraises RCB II - 2<br />
RCB II - 3<br />
RCB II - 4<br />
RCB II - 5<br />
- 90 -<br />
II - 5 MATERIEL NECESSAIRE A LA REALISATION DES RESTAURATIONS TRANSITOIRES<br />
résine autopolymérisable Resinlay 00<br />
· disques à séparer<br />
· pointes montées carborandum<br />
cupules siliconées<br />
· godets plastiques<br />
· arrache· couronne<br />
· pince de Péan<br />
· ciment de scellement oxyphosphate de zinc ooo<br />
· fil de soie dentaire<br />
II - 6 : MATERIEL DE MENSURATIONS MICROSCOPIQUES<br />
• pour le sondage clinique: Comparateur de Huet<br />
• pour l'interprétation histologique des coupes<br />
- l'étude qualitative<br />
microscope Wild M20 avec les objectifs 3 x 10<br />
10 x 10<br />
20 x 10<br />
40 x 10<br />
- l'étude histométrique<br />
microscope Wild M20 avec l'objectif 3 x 10<br />
micromètre de Reichert de 2mm de long.partagé en 200 parties égales<br />
une division du micromètre = 10 microns.<br />
o Ellman Dental MFG<br />
00 Recomi - Division Uni dent<br />
000 De Trey
- l'étude stéréologique<br />
microscope Leitz Orthoplan<br />
écran Dynascope 4 A<br />
réticule à 117 points<br />
grossissements x 280<br />
x 500<br />
x 760<br />
II - 7 : MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE<br />
-'pour la partie clinique:<br />
• boitier Contax 139 quartz<br />
· doubleur de focale Tamron<br />
· télé-Macro Tamron 90 mm F 2,5<br />
· film Ektachrome 64<br />
200<br />
- pour la partie histologique:<br />
· appareil Orthomat de Leitz<br />
- 91 -<br />
1<br />
1<br />
l
- 96 -<br />
La fraise étant tenue perpendiculairement à la surface de la dent,<br />
cet enfoncement contrOlé et limité au demi-diamètre de la fraise peut se<br />
réaliser sur toute sa surface,y compris sur le bord libre,en créant des<br />
guides de profondeur,afin de ménager,sur toutes les faces,l 'épaisseur<br />
nécessaire à la restauration transitoire et définitive.<br />
Puis l 'opérateur,au moyen d1une fraise, cylindro-cOnique (ReS II K)<br />
relie ces guides de profondeur pour obtenir une décortication homogène.<br />
Les limites cervicales de ces préparations sont celles d1une<br />
coiffe coulée,à savoir une ligne de finition.Les préparations sont ensuite<br />
soigneusement polies à l'aide d'une cupule de caoutchouc siliconé.<br />
Nous avons choisi des préparations sous-gingivales moyennes;nous<br />
ne pensons pas utile de développer les critères qui ont guidé notre choix<br />
(147)(180)(192)(246)(250).<br />
III - 1.1.6 : Empreintes globales sans rétraction<br />
L'empreinte de chaque hémi-arcade est réalisée.Elle permettra<br />
de mesurer,sur les modèles en plâtre,la distance base apicale.sommet de<br />
la crête gingivale.<br />
La technique employée est la technique des élastomères injectés<br />
(32-33)(64) avec du Zafo dur et Xantopren plus:<br />
· dosage: cercle inférieur du godet (base) + 12 gouttes<br />
d'activateur<br />
· temps de mélange: 30 s<br />
· temps de manipulation: 2 mIT<br />
temps de prise en bouche: 4 mn 1/2.<br />
III - 1.1.7 Mensuration de la profondeur du sulcus<br />
La mensuration de la distance-base apicale de llencoche-fond du<br />
sulcus se fait au moyen d1une sonde équarissoire à extrémité mousse,sur<br />
laquelle vient s'insérer une rondelle de caoutchouc servant de butée<br />
d'arrêt.
- 99 -<br />
Procéder à la mise en place du deuxième fil t plus épais t pour<br />
compléter '1 'action du premier même si le sulcus est peu profond t étroit ou<br />
déjà rempli .<br />
Le deuxième fil peut déborder de la limite de la préparation mais son action<br />
chimique sera tout de même importante; il augmentera encore l'action du premier<br />
fil posé.<br />
• : Protocole pour chaque fil<br />
- Racestyptine : fil à 4 torons<br />
· tout d'abord 1 ou 2 torons torsadés sont insérés pour une même<br />
dent t<br />
· puis deux autres torons .<br />
- Alu-Pak :<br />
· mettre 2 torons du fil n02 t qui en comprend 4 t<br />
· puis 1 toron du N°l qui en comprend 2 .<br />
- Racecord 1 ou 2 brins sont tassés selon la profondeur du sulcus .<br />
- Healthco 1 toron du fil fin est d'abord introduit t<br />
puis 1 toron du fil épais pour chaque dent.<br />
III - 1.1.9 : Empreintes après rétraction<br />
• Préparation<br />
Les fils sont laissés en place pendant 3 à 10 minutes (5 en moyenne)<br />
jusqu'à ce que le matériau à empreinte léger soit dans la seringue et prêt à<br />
l'injection.<br />
Le fil est retiré sans endommager le sulcus: la zone créviculaire<br />
est t dans la plupart des cas t suffisamment hydratée par le fluide gingival ,<br />
sinon un léger spray suffira .
- 100 -<br />
Quand il Y a plusieurs préparations, ils seront enlevés au fur et<br />
à mesure .<br />
Le séchage nlest pas toujours nécessaire puisque les fils secs. imbibés<br />
de solution asséchante , agissent comme un buvard et absorbent l'humidite<br />
(48)(49).<br />
Toutes ces opérations devront être particulièrement soignées<br />
• Empreintes<br />
Les différentes empreintes sont prises dans les mêmes conditions afin<br />
de pouvoir établir un point de comparaison .<br />
Les produits utilisés sont le Zafo dur et le Xantopren .<br />
Commencer l'injection de l'élastomère léger au niveau de la limite<br />
cervicale en enrobant toute la préparation. L'embout de la seringue maintient<br />
le contact avec celle-ci sous la surface du matériau pour éviter d'emprisonner<br />
des bulles.<br />
Lorsque l'élastomère léger est injecté , le porte-empreinte , rempli<br />
d'élastomère lourd, est mis en place.<br />
L'ensemble est retiré après durcissement des matériaux.<br />
Les empreintes sont contrôlées, nettoyées de toute trace de salive<br />
et de sang puis séchées .<br />
III - 1.1.10 : Les restaurations provisoires<br />
Les restaurations transitoires sont réalisées selon la technique<br />
d'Ingraham et Basset (138) . A cet effet, une empreinte est prise lors des<br />
étapes précédentes .<br />
Après préparation des dents , les moignons sont protégés au moyen de<br />
plusieurs couches de vernis .
- 102 -<br />
Un polissage soigneux des restauratiohs transitoires et un nettoyage<br />
méticuleux du sulcus gingival , avant et après scellement, permettent d'éliminer<br />
, autant que faire se peut , les paramètres qui peuvent avoir une influence<br />
négative sur la durée et la qualité de la cicatrisation post-expérimentale .<br />
Donc, si tous ces critères sont respectés, l'incidence des restaurations<br />
provisoires sur la conduite de l'expérimentation , la cicatrisation gingivale<br />
et les résultats cliniques et histologiques, doit s'avérer nulle.<br />
•<br />
III - 1.1.11 : Coulée des modèles:<br />
Toutes les empreintes sont coulées de façon identique , en plâtre dur<br />
(Vel-Mix) dans l'heure qui suit la prise d'empreinte.<br />
Les 2 empreintes intéressant la même préparation sont coulées simultanément,dans<br />
les mêmes conditions et avec le même plâtre .<br />
Le mélange homogène de ce dernier s'effectue dans les rapports poudre/<br />
liquide mentionnés par le fabriquant.<br />
La coulée de l'empreinte se fait par des apports minimes de plâtre<br />
dans le haut de l'empreinte, lentement, en vérifiant qu'aucune bulle n'est<br />
emprisonnée dans une dent. L'utilisation d'un vibreur est indispensable.<br />
Le démoulage est pratiqué une heure minimum après la coulée .<br />
III - 1.2 EVICTION CHIRURGICALE<br />
La plupart des phases opératoires sont communes à celles décrites<br />
pour les techniques de rétr,action par fil hormis les étapes décrites dans les<br />
paragraphes 4,5,8 et 10 de ce chapitre .<br />
L'expérimentation est, dans tous les cas ,limitée à la face vestibulaire<br />
de chaque dent et la progression du travail se fait, pour chaque
- 103 -<br />
quadrant et aussi bien au maxillaire qu'à la mandibu1e,dans le<br />
sens antéro-postérieur.<br />
III - 1.2.1 : E1ectrochirurgie<br />
L'unitest1e Dento-Surg E11man FFP 90,rég1é sur la position 3.<br />
Le courant utilisé est un courant totalement filtré et redressé :un courant<br />
de coupe.<br />
La plaque neutre est glissée sous l'animal.<br />
L'électrode choisie est la 1 B-Bent {E11man):fine et longue,e11e<br />
est passée une fois autour de la dent,se1on la technique décrite par Gombeaud<br />
(110){schéma n° 2),le passage est limité à la face vestibulaire.<br />
L'électrode est tenue selon un angle de 35° par rapport au grand<br />
axe des dents.<br />
Le nettoyage des sillons gingivaux,après passage de l'électrode,<br />
se fait avec une simple sonde exploratrice.<br />
Dans le cas d'une légère hémorragie,un badigeonnage de la partie<br />
avec un coton imbibé d'eau oxygénée â 10 volumes est suffisant.<br />
III - 1.2.2 : Technique mixte: é1ectrochirurgie + fil<br />
Le procédé est le même que celui décrit dans le paragraphe précédent<br />
en ce qui concerne l'utilisation du bistouri électrique.<br />
Mais il Y a mise en p1ace,dans le néo-sil1on,après éviction<br />
é1ectrochirurgica1e,d'un toron double de fil Racestyptine.<br />
L'insertion du fil se fait de la même manière que celle dêcrite<br />
précêdemment.<br />
Le fil est laissé en place 5 mn.<br />
III - 1.2.3 : Curetage rotatif gingival<br />
Les fraises uti1isêes varient en fonction de la dent.
Préparation Polissage<br />
Prémolaire RCB II K-2 RCB II K-3<br />
Molaire RCB II K-4 RCB II K-S<br />
Tableau n° IV<br />
- 104 -<br />
L'extrémité de la fraise,pour chaque dent,est légèrement engagée<br />
dans le sulcus et orientée selon un axe parallèle au grand axe de la dent.<br />
Un ou deux passages nous ont suffi pour créer une éviction<br />
gingivale.<br />
Une pulvérisation a permis le nettoyage du sillon.<br />
Cette manoeuvre s'est rarement accompagnée d'hémorragie.Dans ce cas.<br />
un simple badigeonnage d'eau oxygénée s'avéra suffisant.<br />
III - 1.2.4 : Technique mixte: curetage rotatif + fil<br />
La technique du curetage rotatif est identique.<br />
Après éviction,un fil de Racestyptine (double toron) est inséré<br />
dans le sillon et laissé en place 5 mn.
III - 2 STADE TERMINAL DE L'EXPERIMENTATION<br />
- 105 -<br />
· Les animaux sont sacrifiés par overdose de Nembutal au 21 ème jour.<br />
· Mesure du SBI terminal<br />
· Dépose des provisoires<br />
· Nettoyage des dents: le ciment de scellement est oté avec une<br />
sonde en prenant soin de ne pas endommager<br />
ou faire saigner la gencive<br />
· Mensurations encoche - sulcus<br />
· Prise d'empreintes terminales.<br />
Ces différentes étapes sont réalisées exactement telles qu'elles<br />
ont été décrites dans le paragraphe 111.1 .
J<br />
J+2l<br />
HO RACESTYPTI NE FRAISE<br />
POS = 25 kg Male<br />
SBI = 0 SBI = 0<br />
La PM3 a saigné côté palatin<br />
lors de la taille.<br />
La PM2 a légèrement saigné<br />
face vestibulaire.<br />
Provisoires = PM2<br />
PM3<br />
Ml<br />
SBI = 0<br />
Le provisoire de la PM3<br />
manque .<br />
- 107 -<br />
fiW.. PD.S_=.2.2...5==-i k9===-_F.eme_l.l.. e__1<br />
=Chien décédé par arrêt cardiaque lors de l'anesthésie<br />
HG<br />
)1
J<br />
J+21<br />
J<br />
J+21<br />
HO<br />
BD<br />
PDS = 2lKg<br />
BISTOURI ELECTRIQUE FIL ADRENALINE 8 %<br />
Male<br />
SBI = 0 SBI = PM2 = 2<br />
Ml = l<br />
PM3 = Tartre vestibulomésial<br />
.Pas de gen-<br />
PM3 = un peu de tartre<br />
cive attachée<br />
Ml = Tartre abondant sur<br />
la face vestibulai<br />
re = non exploitable<br />
Provisoire = 0 Provisoires = PM2<br />
PM3<br />
Ml<br />
. SBI = 0 SBI = 0<br />
Aspect clinique normal aspect clinique normal<br />
BISTOURI ELECTRIQUE + FIL ALlIPAK<br />
Provisoires = PM2<br />
PM3<br />
SBI = 0 SBI = 0<br />
Ml = Absente Provisoires = PM3<br />
PM4<br />
Ml<br />
PM2 = Absente<br />
SBI = 0 SBI = 0<br />
- 108 -<br />
HG -<br />
BG
v - LES MENSURATIONS<br />
v - 1 : MENSURATIONS CLINIQUES<br />
v - 1.1 Les mensurations<br />
- 112 -<br />
Les mesures cliniques sont prises en duplicata au point médian de<br />
l'encoche située sur la face vestibulaire des dents expérimentales et des<br />
dents de contrô1e,avant l'intervention et avant le sacrifice (307),<br />
Le sondage, réalisé en bouche selon la technique décrite dans un<br />
châpitre précédent,permet de mesurer :<br />
• La distance base apicale de l'encoche-fond du su1cus gingival.<br />
• La sonde est placée au niveau de la partie médiane de l'encoche .<br />
• Deux mensurations de cette distance sont faites<br />
une avant tout procédé de rétraction A<br />
une avant le sacrifice AI<br />
Il est important de rappeler les réserves,vis à vis de ce type<br />
de mensurations,que nous avons énoncées précédemment<br />
la position de l'extrémité de la sonde est souvent bien contrcversée.<br />
'-<br />
-<br />
Schéma N°6 illustrant la technique<br />
de mensuration biométrique<br />
Crête marginale libre<br />
Limite1de génétration<br />
de a s nde<br />
Ligne muco-gingiva1e<br />
A = Jour J<br />
AI = J+21
v - 1.2 : Leur but<br />
- 113 -<br />
Leur but est de vérifier ou non si l 1attache épithéliale migre<br />
après rétraction gingivale quel que soit le procédé utilisé.<br />
Cette migration correspond à la différence A' - A<br />
v - 1.3 : Leur réalisation<br />
Après la mensuration clinique,la valeur de celle-ci est déterminée<br />
au moyen d'un comparateur de Huet.<br />
Cet appareil est muni d'un oeilleton présentant un trait vertical<br />
de référence.La sonde placée perpendiculairement à ce trait,l 'opérateur<br />
fait correspondre l'extrémité apicale de celle-ci avec le même trait.<br />
Une première lecture est effectuée au moyen du vernier optique<br />
de l'appareil.<br />
A l'aide d'une vis micrometrique.le support glisse horizontalement<br />
de manière à positionner le trait vertical de référence au niveau de la<br />
base apicale de la rondelle de caoutchouc.<br />
La mesure est lue;la différence entre les mesures nous permet de<br />
déterminer :<br />
La distance base apicale de l 1encoche. fond du sulcus.<br />
Ces mensurations ont été faites avec une précision de 1/100 mm.<br />
Une double mesure est réalisée,la moyenne de celle-ci est retenue<br />
pour nos données.(même chose pour nos mensurations prothétiques)<br />
v - 2 : MENSURATIONS PROTHETIQUES<br />
v - 2.1 : Préparation des modèles<br />
Pour chaque hémi-arcade,les dents intéressées sont séparées entreelles<br />
au moyen d'une scie à plâtre.
- 114 -<br />
La face linguale ou palatine des blocs obtenus est taillée parallèlement<br />
au grand axe de la dent,perpendicu1airement à l'axe de l'encoche.<br />
Le modèle est alors stable sur le plan de travai1,les flous dOs<br />
aux différences de niveau du plâtre atténués,le rayon lumineux perpendiculaire<br />
à la dent fait dispara1tre les zones d'ombre,ce qui permet une meilleure<br />
précision des mesures.<br />
v - 2.2 : Les mensurations<br />
v - 2.2.1 : Mesure sur le modèle sans préparation initiale<br />
Mesure de la distance base apicale de l'encoche-sommet de la crête<br />
gingivale,toujours prise au niveau de la partie médiane de l'encoche.<br />
avant rétraction mesure 1<br />
. pendant la rétraction : mesure 2<br />
Cette mesure détermine l'ouverture du sillon gingival et la déflexion<br />
de la gencive.P1us l'ouverture du sillon est importante,p1us les limites<br />
cervicales de la préparation seront mises à nu et plus grande sera la facilité<br />
d'écoulement du matériau à empreinte au niveau et légèrement au-delà de ces<br />
limites.<br />
. avant le sacrifice : mesure 3<br />
v - 2.2.2 : Mesure sur le modèle après "gingivectomie"<br />
C'est la mesure de la distance base apicale de l'encoche-fond du<br />
su1cus,prise au niveau de la partie médiane de l'encoche.<br />
Les ma1tres modè1es,en outre,doivent reproduire sur une faible<br />
hauteur les surfaces indemnes de la dent au-delà des limites des préparations<br />
de façon que la lecture de ces limites s'effectue avec facilité et sans<br />
ambiguïté.<br />
La décortication du modèle a pour but de visualiser intégralement<br />
les zones dissimulées par l'épaisseur de la gencive libre marginale.
Mesure sur le modèle sans préparation initiale.<br />
:15 -<br />
1 r<br />
______________________________. -1<br />
Mesure sur le modèle après Ilgin9ivectomie".<br />
1
- 116 -<br />
Une gorge est creusée à l'aide dlune fraise boule de gros diamètre,<br />
réalisant ainsi une "gingivectomie",un détourage sur plâtre et permettant<br />
une vision directe des limites les plus cervicales.<br />
v - 2.3 : Leur but<br />
avant rétraction : mesure 1 bis<br />
les limites cervicales sont floues pour cette mesure.<br />
après rétraction : mesure 2 bis<br />
Les surfaces du plâtre nloffrent pas suffisamment de<br />
contraste pour permettre une lecture facile;aussi avons nous<br />
souligné d'un trait de crayon dur,le plus fin possible,le<br />
bord interne des encoches et le bord coronaire de la gorge<br />
effectuée sur le plâtre.<br />
- la différence des mesures 1 et 3 permet de savoir slil y a eu<br />
changement ou non de position de la crête marginale de la gencive libre.<br />
- la mesure 2 nous donne la position plus apicale de la gencive marginale<br />
après rétraction<br />
_ la différence 2 - 1 correspond au changement de la gencive da a la<br />
déflexion latérale post rétraction<br />
_ la différence entre les mesures 2 bis et 1 bis correspond â la<br />
valeur de llefficacité "verticale" de la rétraction.<br />
v - 2.4 : Leur réalisation<br />
Le procédé' employé est identique a celui décrit dans les paragraphes<br />
relatifs aux mensurati ons clini ques.
v - 3 MENSURATIONS HISTOLOGIQUES<br />
v - 3.1 : La préparation histologique<br />
Les pièces sont :<br />
- conservées dans du formol à 10%<br />
- décalcifiées au formiate de sodium<br />
- rincées<br />
- déshydratées<br />
- englobées dans de la paraffine sous forme de bloc.<br />
- 117 -<br />
La dent est orientée,à l'intérieur du bloc,de telle sorte que chacune<br />
de ses faces soit parallèle à celle du bloc selon l'axe de la dent.<br />
Les colorations :<br />
- Le sens des coupes est vestibulo-lingual<br />
- 1es coupes ont une épai sseur de 5 mi crons .<br />
• pour l'étude qualitative<br />
· hématoxyline éosine<br />
• PAS<br />
· trichrome de Masson<br />
• pour l'étude stéréologique<br />
· tri chrome de Masson<br />
v - 3.2 : Les mensurations<br />
• La distance base de l'encoche - partie la plus apicale des cellules<br />
de l'attache épithéliale:<br />
- c'est la mesure Hl<br />
NB L'attache épithéliale est toujours ponctuelle sur la surface dentaire.
- 121 -<br />
Le rapport des deux nombres est converti en pourcentage.<br />
Le pourcentage moyen des diffêrentes lames choisies pour chaque<br />
dent est retenu.<br />
Nombre de points dans le TCI<br />
CI =-----------<br />
Nombre de points dans le TC<br />
• : grossissement x 500<br />
X 100<br />
Evaluation du pourcentage du volume tissulaire occupé par les<br />
vaisseaux au niveau du tissu conjonctif non infi1trê (V)(TCNI)<br />
On sé1ectionne,au hasard,dans la zone du tissu conjonctif non infi1trê<br />
une région sous jacente au TCI riche en vaisseaux.On compte un point quand<br />
il cofncide avec un vaisseau.<br />
Le pourcentage (V) correspondant est êga1 au rapport suivant<br />
Nombre de points situés dans les vaisseaux<br />
V= X 100<br />
Nombre total de points du TCNI de la grille<br />
• : grossissement x 760<br />
Evaluation du pourcentage tissulaire occupê par les diffêrents types<br />
cellulaires<br />
• lymphocytes<br />
• plasmocytes<br />
· monocytes<br />
• leucocytes po1ymorphonuclêaires<br />
et leur somme T au niveau du tissu conjonctif infi1trê.<br />
Dans le tissu conjonctif infi1trê,une zone riche en cellules<br />
inflammatoires est choisie au hasard.On dêterm1ne ainsi L,P,M,PMN et T<br />
Nombre de points p1acês sur les lymphocytes<br />
L = X 100<br />
Nombre total de points s1tuês dans le TCI de la grille
Nombre de points placés sur les plasmocytes<br />
P =------ _<br />
Nombre total de points situés dans le TC! de la grille<br />
Nombre de points placés sur les monocytes<br />
M =---------------- _<br />
Nombre total de points situés dans le TC! de la grille<br />
Nombre de points placés sur les leucocytes PMN<br />
PMN=---------------------<br />
Nombre total de points situés dans le TC! de la grille<br />
T = L + P + M+ PMN<br />
X 100<br />
X 100<br />
X 100<br />
T représente le pourcentage total de cellules inflammatoires<br />
(L" P , Met PMN).<br />
- 122 -<br />
A partir de ces données morphométriques obtenues par les formules<br />
stéréologiques de base (Weibel et Gomez 1962 - Weibel 1969),les résultats<br />
ont été exprimés en densités volumétriques pour chacune des zones étudiées.
•<br />
CHAPITRE IV<br />
•<br />
LES RESULTATS<br />
Leur interprétation
1 - TABLEAUX DES RESULTATS<br />
II - RESULTATS HISTOLOGIQUES QUALITATIFS<br />
III - STATISTIQUES : GENERALITES<br />
III - 1 INTRODUCTION<br />
III - 2 LES PARAMETRES<br />
· Facteur dent<br />
· Facteur chien<br />
· Les témoins<br />
IV - COMPARAISON ENTRE A , AI , AI - A , AI - Hl ' ET DISCUSSION SUR LE SONDAGE<br />
IV - 1 : Aet AI<br />
IV - 2 AI - A<br />
· Les résultats<br />
· Interprétation des résultats<br />
IV - 3 Comparaison entre AI et Hl<br />
V - COt+1ENTAIRES SUR LES MESURES PROTHETIQUES<br />
V - 1 : Comparaison entre 1 et 3<br />
• Les résul tats<br />
· Interprétation des résultats<br />
V - 2 Valeur 3 - 1<br />
V - 3 Llefficacité de la rétraction<br />
V - 4 Comparaison entre SP et SH<br />
V - 5 Comparaison entre 3 et H 2<br />
VI - ETUDE DES CORRELATIONS<br />
VI - 1 : Liaisons susceptibles dlexister entre les différentes variables<br />
et llefficacité<br />
VI - 1.1 : Efficacité et récession
VI - 1.2 ER et 2 - 1<br />
VI - 1.3 Efficacité et sulcus histologique<br />
VI - 2 : Corrélation comportant H<br />
3<br />
· H3<br />
et PH<br />
H<br />
3<br />
et A' - A<br />
H 3 et A' - Hl<br />
VI - 3 Les autres corrélations<br />
PH et AI - Hl<br />
· Hl - H 2 + H 3 et AI - A<br />
Hl - H 2 + H 3 et AI - Hl<br />
VII - EXPOSE DES RESULTATS DE L'ANALYSE STEREOLOGIQUE<br />
VII - 1 Résultats histologiques<br />
VII - 2 Résultats stéréologiques<br />
· Chez les témoins<br />
· Pour chaque technique<br />
· Densité volumétrique du TCI<br />
· Densité volumétrique des vaisseaux<br />
· Densité volumétrique des cell ules<br />
VII - 3 Discussion<br />
VII - 4 Bilan<br />
VIII - DISCUSSION GENERALE<br />
VIII - 1 Préparation et provisoire<br />
VIII - 2 Analogie entre le chien et l'homme<br />
000
RECAPITULATIF DES MENSURATIONS<br />
• : mensurations cliniques<br />
Base apicale de l'encoche - fond du sulcus<br />
- mesure A au jour J<br />
- mesure A' au jour J + 21<br />
- A' - A = migration théorique de l'attache épithéliale<br />
- mesure 1<br />
- mesure 2<br />
- mesure 3<br />
- mesure 1 bis<br />
- mesure 2 bis<br />
• : mensurations prothétiques<br />
- 2 bis - 1 bis<br />
- 2 - 1<br />
- 3 - 1<br />
- 2 bis - 1<br />
- 124 -<br />
Base apicale de l'encoche - sommet de la gencive marginale libre<br />
sur l'empreinte sans rétraction au jour J<br />
sur l'empreinte après rétraction au jour J<br />
empreinte sans rétraction au jour J + 21<br />
Base apicale de l'encoche - partie la plus apicale de la racine<br />
après "gingivectomie" sur les modèles en platre<br />
sur l'empreinte sans rétraction<br />
sur l'empreinte après rétraction<br />
efficacité de la rétraction ( verticale) ( ER )<br />
changement de position du sommet de la gencive marginale<br />
libre da a la déflexion latérale<br />
perte de hauteur de la gencive ( PH ) - récession gingivale<br />
sulcus prothétique ( SP )<br />
• mesures histologiques<br />
L'attache épithéliale est toujours ponctuelle<br />
- Hl base apicale de l'encoche - attache épithéliale<br />
- H<br />
2<br />
base apicale de l'encoche - sommet de la gencive marginale libre<br />
- H<br />
3<br />
distance jonction émail - cément -crête osseuse<br />
- H<br />
4<br />
distance attache épithêliale - jonction êmail-cêment<br />
- Hl - H<br />
2<br />
: profondeur du sulcus histologique ( SH )<br />
_ Hl - H + H<br />
2 3<br />
distance sommet de la gencive marginale - crête osseuse
- 127 -<br />
-3318 HO -<br />
-RT A PM2<br />
A PM3<br />
2.555<br />
3.095<br />
1. 710<br />
2.,205<br />
0.845<br />
0.890<br />
0.575<br />
0.655<br />
1. 710<br />
2.205<br />
2.285<br />
2.860<br />
2.565<br />
2.960<br />
0.855<br />
0.755<br />
0.845<br />
0.890<br />
A Ml 2.485 1.340 1.145 0.880 1.340 2.220 2.190 0.850 1.145<br />
HG<br />
- F B PM2 - B PM3<br />
1.845<br />
2.920<br />
1.690<br />
2.475<br />
0.155<br />
0.445<br />
0.120<br />
0.175<br />
1.245<br />
2.335<br />
1.365<br />
2.510<br />
1.730<br />
2.625<br />
0.485<br />
0.290<br />
0.600<br />
0.585<br />
B Ml 3.230 3.095 0.135 1.105 2.970 4.075 2.795 -0.175 0.260<br />
-3314 HG<br />
- A8%<br />
-<br />
B PM2<br />
B PM3<br />
1.645<br />
1.315<br />
0.895<br />
1.250<br />
0.750<br />
0.065<br />
0.525<br />
0.050<br />
0.895<br />
1.195<br />
1.420<br />
1.245<br />
1.785<br />
1.310<br />
0.890<br />
0.115<br />
0.750<br />
0.120<br />
B Ml 2.310 0.865 1. 445 -0.005 0.865 0.860 2.215 1.350 1.445<br />
BD - B+F<br />
- C PM2<br />
C PM3<br />
1.755<br />
1.135<br />
0.955<br />
0.883<br />
0.800<br />
0.252<br />
0.320<br />
0.032<br />
0.955<br />
0.883<br />
1.275<br />
0.915<br />
2.245<br />
2.060<br />
1.290<br />
1.177<br />
0.800<br />
0.252<br />
C PM4 1.780 1.065 0.715 0.720 1.065 1.785 2.123 1.058 0.715<br />
BG -<br />
AL E PM3 - E PM4<br />
1.580<br />
1. 715<br />
0.815<br />
1.040<br />
0.765<br />
0.675<br />
0.535<br />
0.305<br />
0.815<br />
1.040<br />
1.350<br />
1.345<br />
1.833<br />
2.145<br />
1.018<br />
1.105<br />
0.765<br />
0.675<br />
E Ml 2.535 2.295 0.240 0.015 2.295 2.310 3.105 0.810 0.240<br />
_.. -<br />
-3315 HO -<br />
A8% - A PM2<br />
A PM3<br />
1.620<br />
1.945<br />
0.690<br />
0.630<br />
0.930<br />
1.315<br />
0.130<br />
0.295<br />
0.855<br />
0.575<br />
0.985<br />
0.870<br />
1.275<br />
1.050<br />
0.420<br />
0.475<br />
0.765<br />
1.370<br />
HG<br />
A Ml 1.435 0.605 0.830 0.055 0.605 0.660 1.290 0.685 0.830<br />
AL<br />
-<br />
B PM2<br />
B PM3<br />
2.205<br />
2.135<br />
1.4-10<br />
0.935<br />
0.795<br />
1.200<br />
0.005<br />
0.060<br />
1.410<br />
0.935<br />
1.415<br />
0.995<br />
1.620<br />
1.360<br />
0.210<br />
0.425<br />
0.795<br />
1.200<br />
B Ml 2.240 1.213 1. 027 -0.060 1.213 1.153 1.555 0.342 1.027<br />
BD<br />
-<br />
F C PM2 2.045 0.665 1.380 0.050 0.770 0.820 1.190 0.420 1.275<br />
- C PM3 2.055 0.925 1. 130 -0.085 0.930 0.845 1. 735 0.805 1.125<br />
C PM4 2.015 1.280 0.735 0.160 1.310 1.470 1.670 0.360 0.705
Tableau nO VIII<br />
3318 HD<br />
-<br />
HG<br />
3314 HD<br />
-<br />
- 130 -<br />
1 Hl 1 H2 1 H3 IHl-H2 IHl-H2+f13 1<br />
RI A PMI 0.924 1. 965 2.889<br />
A PM2 3.582 2.446 1.038 1.136 2.174<br />
A PM3 3.224 2.208 0.990 1. 016 2.006<br />
A Ml 3.190 2.319 0.898 0.871 1. 769<br />
F B Ml 3.713 2.794 0.779 0.919 1. 698<br />
BE A PMI 1.012 0.950 1. 962<br />
A PM2 1 .71 1 1. 302 1. 417 0.409 1.826<br />
M A8% B PMI 0.735 1. 395 2.130<br />
- B PM2 1. 210 0.779 - 0.431 -<br />
B PM3 1. 958 1.008 0.740 0.950 1.690<br />
B Ml 2.491 1. 232 0.646 1.259 1. 905<br />
BD<br />
Ji±.f C PM2 1. 990 1. 320 0.665 0.670 1. 335<br />
C PM3 2.313 1.791 0.050 0.522 1. 157<br />
C PM4 2.508 2.165 1.162 0.343 1. 505<br />
BG<br />
-<br />
AL E PM4 0.620 0.977 1. 597<br />
-<br />
E Ml 3.202 2.481 0.499 0.721 1. 220
Tableau n° VIII<br />
(suite) 1<br />
- 131 -<br />
H21 .H31 Hl-H2! Hl-H2+H31<br />
-3312 HO - F+F<br />
-<br />
A PMI<br />
A PM2<br />
A PM3<br />
2.497<br />
-<br />
-<br />
1.474<br />
-<br />
-<br />
1.199<br />
1.307<br />
1.100<br />
1. 023<br />
1.634<br />
1. 232<br />
2.222<br />
2.941<br />
2.332<br />
A Ml 2.398 1. 672 1.437 1.726 2.163<br />
HG - Re - B PMI<br />
B PM2<br />
-<br />
2.015<br />
-<br />
1.122<br />
1.384<br />
1. 126<br />
1. 269<br />
0.893<br />
2.653<br />
2.019<br />
B PM3 1.764 1.126 0.606 0.638 1. 244<br />
B Ml - - 0.814 1. 562 2.376<br />
BD - F e PM2 2.446 0.818 1.443 1. 628 3.071<br />
- e PM3 2.018 1.397 0.863 0.621 1.484<br />
e PM4 1. 642 0.979 0.660 0.663 1. 323<br />
e Ml 2.361 1. 554 0.752 0.807 1. 559<br />
BG<br />
- RT E PM2 2.034 0.577 0.880 1. 457 2.337<br />
- E PM3 1. 650 0.924 1.100 0.726 1.826<br />
E PM4 2.042 1. 285 1.082 0.757 1. 839<br />
E Ml - - 0.572 0.421 0.993
Tabl eau n° VII 1<br />
(suite)<br />
- 132 -<br />
1 H1 1 H2 1 H3 1H1-H2lH 1- H2+H3 1<br />
-3308 jiQ.<br />
F+F - A PM2<br />
A PM3<br />
2.222<br />
2. 191<br />
1. 276<br />
1. 258<br />
0.997<br />
1.005<br />
0.946<br />
0.933<br />
1.943<br />
1.938<br />
A Ml 2.530 2.051 1.149 0.479 1. 628<br />
HG - A8% - B PMI<br />
B PM3<br />
1.165<br />
1. 837<br />
0.954<br />
1. 375<br />
-<br />
1.419<br />
0.211<br />
0.462<br />
-<br />
1.881<br />
8 Ml 2.693 1. 659 1.593 1. 034 2.627<br />
80 - 8E - e PM2<br />
e PM3<br />
1. 973<br />
1.813<br />
1. 211<br />
0.867<br />
1.056<br />
1.162<br />
0.762<br />
0.946<br />
1.818<br />
2.108<br />
e PM4 2.576 1.887 1.a17 0.689 1.706<br />
e Ml - - 0.826 1. 017 1.843<br />
8G - AL<br />
-<br />
E PM2<br />
E PM3<br />
1. 932<br />
1.829<br />
0.451<br />
0.874<br />
1.125<br />
1.169<br />
1.481<br />
0.955<br />
2.606<br />
2.124<br />
E PM4 1.980 0.946 1. 210 1. 034 2.244<br />
E Ml 2.358 1. 368 0.801 0.990 1. 791<br />
-3321 HG - Re - 8 PMI<br />
B PM2<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1.122<br />
1. 216<br />
1.478<br />
1.536<br />
2.600<br />
2.752<br />
B PM3<br />
8 Ml<br />
1. 829<br />
-<br />
1.113<br />
-<br />
1. 263<br />
1. 245<br />
0.716<br />
1. 239<br />
1. 979<br />
2.484<br />
BD<br />
B+F C PM2 1.447 0.856 0.880 0.592 1.472<br />
- e PM3 1. 628 1.089 0.737 0.539 1. 276<br />
e PM4 1. 760 1.408 1. 012 0.352 1. 364<br />
e Ml 2.068 1.439 0.691 0.629 1. 320
AI - H<br />
__1<br />
- 133 -<br />
Tableau n° IX<br />
1 3318 1 3314 1 3312 1 3308 1 3321 1<br />
RT BE F+F F+F<br />
HD A PMI 0.734<br />
A PM2 0.211 1.784 1.468<br />
A PM3 1.916 1.599<br />
A Ml 1.904 0.970 2.090<br />
,<br />
F A8% Re A8% Re<br />
HG B PMI<br />
B PM2 2.420 0.419<br />
B PM3 1.164 1.065 1.223 1.280<br />
B Ml 1.988 1.590 1.957<br />
B+F F BE B+F<br />
BD e PMI<br />
e PM2 1.525 0.342 0.707 1.400<br />
C PM3 1.337 0.639 1.067 1.287<br />
C PM4 2.857 0.854 0.594 1.508<br />
C Ml 0.642 2.007<br />
AL RT AL<br />
BG E PMI<br />
E PM2 0.879 0.708<br />
E PM3 0.688 1.291<br />
E PM4 1.108 0.930<br />
E Ml 1.396 1.072
II - RESULTATS HISTOLOGIQUES QUALITATIFS<br />
Norm al<br />
Versant<br />
1nterne--------1-1-<br />
dentine<br />
EPITHELIUM<br />
VU E D'E N5EM B LE<br />
Aca nt hose réactionnelle<br />
'. .<br />
.-- Leslon frequente<br />
Versant<br />
Externe
"! ) :J<br />
TECHNIQUE CHIRURGICALE = FRAISE + RACESTYPTINE (/1 F + F Il )<br />
Chien 3308 - A PM2<br />
A PM3<br />
Réparation presque achevée<br />
Epithélium =<br />
Chorion<br />
légère hyperplasie<br />
= hyperplasie fibroblastique modérée<br />
hypergénèse vasculaire modérée<br />
léger inflitrat leucocytaire<br />
Chien 3308 - A Ml Réparation presque achevée mais muqueuse fortement réac<br />
Chien 3312 - A PM2<br />
A M1(difficilementinterprétable<br />
)<br />
tionnelle .<br />
Epithélium<br />
Chori on·<br />
= hyperplasie avec forte acanthose<br />
= hyperplasie fibroblastique et vasculaire<br />
importante<br />
inflitrat leucocytaire assez importante<br />
= Idem mais infiltrat inflammatoire<br />
peu important )<br />
Chien 3312 - A PM3 = Idem (y compris infiltrat peu important)<br />
A signaler qu'une partie des lames montre peL<br />
ou pas de lésion .
TECHNIQUE CHIMICO-MECANIQUE = RACESTYPTINE (URT")<br />
Chien 3318 - A PM2<br />
A PM3<br />
A Ml<br />
Chien 3312 - E PM2<br />
E PM3<br />
E PM4<br />
E Ml<br />
- 140 -<br />
Fil imprégné de chlorure d'aluminium<br />
Epithélium hyperplasie modérée avec hyperacanthose<br />
Chorion = hyperplasie modérée fibroblastique<br />
et vasculaire<br />
Léger infiltrat inflammatoire<br />
Peu de réaction épithéliale et conjonctive mais in-<br />
filtrat inflammatoire relativement important
Technique<br />
D E GRÉ<br />
.<br />
D 1 H Y P ERP LAS 1 E<br />
- 144 -<br />
Epithélium Chorion Infi ltrat<br />
(gén. acanthose ) ( fibroblastes + Vx ) Inflalll11atoire<br />
B ++ ++ +<br />
B + F +++ ++ à +++ +<br />
F + à +++ + à +++ ++<br />
F + F ++ à +++ ++ à +++ +<br />
R T o à + o à + + à ++<br />
A L + à ++ ++ + à ++<br />
R C + à ++ + à ++ +<br />
A 8% o à + + + à ++<br />
Tableau nO X
III - STATISTIQUES GENERALITES<br />
III - 1 : INTRODUCTION<br />
- 145 -<br />
La statistique,méthode de raisonnement,permet d'interpréter le<br />
genre de données très particulières qu'on rencontre notamment dans les<br />
sciences de la vie et dont le caractère essentiel est la variabilité.<br />
Les tests statistiques choisis (analyse de variance et corrélation)<br />
ne sont valables que si la distribution des échantillons est normale.Donc,<br />
dans un premier temps,nous nous sommes préoccupés de savoir si toutes les<br />
variables obtenues lors de nos mensurations suivaient une distribution<br />
normale. Tel était le cas.<br />
Les résultats statistiques sont regroupés sous forme de tableau<br />
afin de faciliter leur compréhension.<br />
Des différences non significatives sont notées : NS<br />
Des différences significatives entre les 2 valeurs comparées le<br />
sont selon le code suivant :<br />
S<br />
S<br />
S<br />
++<br />
+<br />
test significatif a 1%0<br />
test significatif à 1%<br />
test significatif a 5%<br />
ce qui signifie que les seules fluctuations de l'échantillonage n'auraient<br />
qu'une chance sur 1000 ,une sur 100 ou 5 sur 100 de conduire a une différence<br />
égale ou supérieure à celle qu'on observe.<br />
III - 2 : LES PARAMETRES<br />
Il est important aussi de conna1tre les différents paramêtres<br />
pouvant influencer les résultats trouvés :
• : le facteur dent<br />
les dents traitées sont les suivantes<br />
- 146-<br />
- PM 2<br />
- PM 3<br />
- PM 4<br />
- M 1<br />
les PM 4 sont peu nombreuses puisqu'elles ne sont présentes qulà<br />
la mandibule.<br />
Afin d'établir des comparaisons entre les résultats obtenus sur<br />
ces chiens nous avons voulu savoir si les dents présentes sur les 2 arcades<br />
(PM 2 , PM 3 , M1) réagissaient de manière différente<br />
- à l'agression des instruments rotatifs<br />
- aux différents produits et méthodes de rétraction<br />
et guérissaient de la même façon.<br />
Aucune différence significative n'est relevée entre ces 3 dents<br />
pour tous les critères étudiés<br />
- clinique A' - A<br />
- prothétique ER PH<br />
- histologique H<br />
3<br />
Hl - H<br />
2<br />
' Hl - H<br />
2<br />
+ H<br />
3<br />
...<br />
En conséquence,nous nlavons plus pris en considération le facteur<br />
dent dans notre travail et avons considéré les 4 dents sur un même plan .<br />
• : le facteur chien ( tableau n° XI et n° XII )<br />
Au cours de cette enquête, nous avons constaté que les valeurs<br />
peuvent être très différentes dlun chien à l'autre et même être significatives<br />
(les divers temps opératoires de notre travail s'effectuent sur 7 chiens<br />
bâtards ne présentant aucune analogie si ce n'est leur age compris entre<br />
3 à 5 ans).<br />
l'interprétation des résultats en est d'autant plus difficile que<br />
le nombre d'animaux expérimentés est faible.
- 147-<br />
Nous ne reviendrons pas sur ce point dans la suite de notre êtude<br />
puisqu'il n'est pas possible d'effectuer de standardisation du fait que<br />
l'individu intervient à tout instant.<br />
• : les têmoins<br />
Les dents têmoins sont en nombre rêduit.Nous n'effectuerons pas<br />
d'analyse de variance entre ces dents et les dents traitêes car les valeurs<br />
correspondantes sont trop peu nombreuses.<br />
Nous nous contenterons de comparer les diffêrentes techniques entre<br />
elles.
- 148 -<br />
IV - COMPARAISON ENTRE As A' s A'- A s A'- Hl ET DISCUSSION SUR LE SONDAGE<br />
IV - 1 : Aet A'<br />
Notre idée était d'effectuer ces deux mesures A et A' afin de<br />
trouver une éventuelle migration de l'attache épithéliale à J + 21 par rapport<br />
à son niveau initial au jour J s d'une longueur égale à la différence A' - A .<br />
En effetsune récession ou non au niveau du bord libre ne signifierait<br />
rien si lion avait simultanément un approfondissement de la poche parodontale.<br />
Ce problème est résolu puisquessur toutes nos coupes histologiques s<br />
l'attache épithéliale correspond toujours à la limite émail-cément (ou plutôt<br />
dentine recouverte de cément - dentine sans cément sl'émail ayant disparu lors<br />
de la décalcification): situation normale de l'attache pour des chiens<br />
adultes âgés de 3 à 5 ans .<br />
• : les résultats<br />
Ces résultats sont regroupés dans le tableau nOVI<br />
Les valeurs Aet A' ne signifient riensprises individuellement,car<br />
elles varient en fonction de la position de l'encoche,situation qui n'est pas<br />
identique sur chaque unité dentaire.<br />
Pour chaque dentspar contreson peut comparer la valeur de A à celle<br />
de A' s la position de l'encoche étant stable.<br />
La différence A' - A varie énormément,selon la dent traitée,de O,02mm<br />
à 2,15 mm.
Tableau n° XI<br />
- Résultats des Analyses de Variance -<br />
2 Bis-1<br />
Comparaison Aet AI AI et Hl et 3 et H2 1 et 3<br />
entre =<br />
Hl - H2<br />
Global = + + + + NS NS NS<br />
Chien 3318 = NS + NS NS NS<br />
Chien 3314 = + + + + NS NS NS<br />
Chien 3308 = NS + + NS NS NS<br />
Chien 3312 =- + + + + NS + + NS<br />
Chien 3315 = +<br />
Chien 3317 = + + NS<br />
Chien 3321 = + + + + NS + +<br />
Légende + =<br />
+ + =-<br />
+ + + =<br />
N S =<br />
- 149 -<br />
S. a 5 % ( S =Significatif)<br />
S. a 1 %<br />
S. a 1 0/00<br />
Non Significatif
• interprétation des résultats : ( tableau n° XI )<br />
- l'analyse de variance globale entre A et AI , sans tenir compte<br />
- 151 ..<br />
· du chien<br />
· de la dent<br />
de la technique<br />
montre qu'il existe une différence hautement significative entre ces deux<br />
mesures (A 1> A)<br />
· la valeur moyenne pour A étant de 2,78mm<br />
· la valeur moyenne pour AI étant de 3,37nm<br />
et la valeur moyenne théorique de la migration de l'attache épithéliale<br />
égale à O,59mm.<br />
Or,il n'y a jamais de migration de l'attache épithéliale (H 4 = 0)<br />
sur les coupes histologiques.<br />
Nous pouvons déduire qu'il est vrai que le sulcus clinique et le<br />
sulcus histologique ne peuvent être comparés par un sondage.<br />
Ceci confirme les études effectuées sur les relations existant<br />
entre<br />
- la pénétration de la sonde<br />
.. le tissu gingival<br />
- le degré d'inflammation<br />
(décrits dans notre abord bibliographique)<br />
Nous avons décidé,suite à ces observations,dleffectuer des mesures<br />
histométriques pour vérifier ces affinlations.<br />
Iy - 2 : A' .. A<br />
Tableau nO YI et n° XII
- 152 -<br />
A I - A pour chaque technique AI. Apour les 2 grandes techniques<br />
Moyenne F + F = 0,40 nm Moyenne chirurgie = 0,67 l1l1I<br />
Il Rc = 0,40 Il<br />
Il Al = 0,46 Il Moyenne fi l = 0,51 nm<br />
Il B = 0,52 Il<br />
Il A 8% = 0,55 Il<br />
Il Rt =0,60 Il<br />
Il F = 0,68 Il<br />
Il B + F = 1,07 Il<br />
La plus grande variation slobserve<br />
pour la technique B+F , les autres<br />
sont voisines (0,4 et 0,68)<br />
Remarque :<br />
Moyenne F+F = 0,40 nm<br />
Il B = D,52 Il<br />
Il F = 0,68 Il<br />
Il B+F = 1,07 Il<br />
nous reviendrons plus loin sur<br />
l'explication de ces résultats.<br />
IV - 3 : Comparaison entre AI et Hl<br />
Test NS<br />
AI est une mesure clinique<br />
Hl représente la même mesure biologique ou histologique.<br />
(tableau nO IX et nO XI)<br />
Existe-t-il un lien entre ces deux mesures ?<br />
Nous obtenons les mêmes résultats qu'entre Aet AI (A') Hl) , résultats três<br />
significatifs.Nous rejoignons en cela de nombreux auteurs.<br />
Valeur moyenne<br />
- Hl<br />
- AI<br />
- A I<br />
- Hl<br />
=2,21 l1l1I<br />
= 3,50 mm<br />
= 1,29 l1l1I
- 153 -<br />
La sonde pénètrerait donc en moyenne de 1,29 mm apicalement par<br />
rapport à la portion coronaire de l'attache épithéliale.<br />
Néanmoins,certaines réserves peuvent être faites concernant notre<br />
protocole expérimental et le principe du sondage tel que nous l'avons décrit.<br />
Argumentation en notre faveur :<br />
Les dents de chien sont peu bombées sur la face vestibulaire et<br />
l'extrémité des sondes,bien que fine,est arrondie.<br />
La méthode utilisant une bande d'acier nous semblait plus fiable,<br />
a priori,mais après l'avoir essayée,nous en avons découvert les inconvénients<br />
majeurs: la perforation au niveau de l'encoche exigeait une très forte pression<br />
se faisait à"l'aveuglette"<br />
la position de la bande n'est pas stable,elle l'glisse".<br />
Valeurs extrêmes = 0,21 et 2,86 mm (tableau n° XII )<br />
A' - Hl pour chaque technique AI - Hl pour les 2 grandes techniques<br />
Moyenne F = 0,57 mm Moyenne fil = 1,22mm<br />
" Rc = 0,92 "<br />
" B = 1,04 Moyenne chirurgie = 1,33mm<br />
"<br />
Il Al = 1,08 Il<br />
Il Rt = 1,12<br />
"<br />
" F + F = 1,53 "<br />
" A 8% = 1,67 "<br />
" B + F = 1,70 "<br />
Test S+ Test NS<br />
Nous n'obtenons pas le même ordre<br />
que pour A'- A ce qui semble<br />
confirmer le fait que le sondage<br />
tel que nous l'avons décrit est<br />
un procédé trop imprécis et qu'il<br />
ne nous renseigne pas sur les<br />
réalités histologiques.
v - COMMENTAIRES SUR LES MESURES PROTHETIQUES<br />
valeur<br />
v - 1 : COMPARAISON ENTRE 1 et 3 (tableau n° XI)<br />
• : résultats<br />
- 154 -<br />
Les mesures sur l'empreinte au plâtre 1 et 3 quantifient la même<br />
une avant tout travail<br />
l'autre au J + 21<br />
= mesure 1<br />
= mesure 3<br />
Elles représentent toutes deux la distance entre la base apicale de<br />
l'encoche et le sommet de la gencive marginale libre.<br />
PH (3-1) indique donc la valeur de la récession gingivale .<br />
• : interprétation des résultats<br />
Nous n'avons pas de différence significative entre 1 et 3,ce qui<br />
montre que la récession est,dans la majorité des cas,infime .<br />
Les valeurs extrêmes sont 0 et 1,10mm<br />
- Moyenne 1 = 0,88 mm<br />
- Moyenne 3 = 1,06 mm<br />
La récession moyenne est 0,18 mm ce qui est faible,d'autant plus<br />
qu'il est probable qu'une certaine récession de la limite gingivale soit dOe<br />
à la disparition de l'oedème initial (132).<br />
Dans certains cas,on trouve,au contraire,une valeur négative, signe<br />
d'une inflammation de la gencive marginale.<br />
La valeur extrême est de 0,62 mm<br />
On peut dire alors que la cicatrisation n'est pas totale au bout<br />
de 21 jours.
v - 2 VALEUR 3 - 1 (tableau n° VII et n° XII)<br />
- 155 -<br />
PH pour chaque technique PH pour les 2 grandes techniques<br />
Moyenne B = - 0,05 nJ11<br />
Il Al = 0,11 Il<br />
Il A 8% = 0,13 Il<br />
Il Re = 0,15 Il<br />
Il F = 0,20 Il<br />
Il F + F = 0,23 Il<br />
Il Rt = 0,31 1\<br />
Il B + F = 0,32 Il<br />
Malgré les éca'rts apparents<br />
des moyennes il n'existe pas<br />
de DS .<br />
V - 3 : L'EFFICACITE DE LA RETRACTION<br />
Moyenne chirurgie<br />
Moyenne fil<br />
Pas de DS<br />
= 0,19R111<br />
= 0,19R111<br />
Elle se mesure à l'aide de 2 bis- 1 bis et 2 - 1<br />
Définition: 2 bis - 1 bis représente l'efficacité verticale<br />
2 - 1 représente le changement da à la déflexion latérale<br />
ER (2bis - 1bi s) 2 - 1<br />
Pour chaque Pour les 2 grandes Pour chaque Pour les 2 grandes<br />
technique techniques technique techniques<br />
M. Rc = 0,53 M. fil = 0,69 M. Rc = 0,17 M. fil = 0,4·6<br />
M. B + F = 0,59 M. chirurgie = 0,74 M. F = 0,39 M. chirurg= 0,64<br />
M. B = 0,61 M. Rt = 0,49<br />
M. F = 0,64 M. B = 0,55<br />
M. A 8% =0,66 M. A 8% = 0,59<br />
M. Al = 0,75 M. Al = 0,60<br />
M. Rt =.0,77 M. B + F = 0,74<br />
M. F + F = 1,07 M. F + F = 0,95<br />
D NS<br />
D NS<br />
la plus grande efficacité est notée<br />
que latéralement.<br />
S à 1% DS à 5%<br />
,<br />
M.chirg> M.fil<br />
pour F + F aussi bien verticalement
- 156 -<br />
v - 4 : COMPARAISON ENTRE SP (2bis - 1) ET SH (Hl - H 2 ) (tableau n° XI)<br />
2 bis - 1 représente le sulcus prothétique (SP)<br />
Hl - H 2 représente le sulcus histologique (SH)<br />
Existe - t-il un lien entre ces deux valeurs?<br />
Peut-on comparer les mesures prothétiques et les données histologiques?<br />
Il n'y a pas de différences significatives entre ces deux mesures<br />
si l'on ne tient compte:<br />
· ni du chien<br />
• ni de la dent<br />
· ni de la technique.<br />
Les deux types de mensurations sont donc superposables.<br />
- valeur moyenne SP = 0,83 mm<br />
- valeur moyenne SH = 0,90 mm<br />
- différence moyenne 0,07 mm<br />
Tout procédé de rétraction donne donc de bonnes appréciations quant<br />
à la profondeur du sulcus et le produit à empreinte pénêtre aisément dans<br />
l'espace ainsi élargi.<br />
v - 5 : COMPARAISON 3 ET H 2<br />
(tableau nO XI)<br />
Dans le même ordre d'idée qui précêde,nous avons effectué une analyse<br />
de statistique pour définir si le niveau gingival lu sur les moulages et sur<br />
les coupes histologiques était voisin.<br />
Si l'on ne tient pas compte<br />
· du chien<br />
· de la dent<br />
• de la technique<br />
il n'y a aucune différence significative entre 3 et H 2 •<br />
M 3 = 1,17 MH2 = 1,39
Densité volumétrique des divers composants structuraux - 161 <br />
Moyenne<br />
TtMOIN 6.83 5.58 3.89 0.00 3.78 0.00 7.67<br />
B 13.77 7.45 6.70 1.84 9.57 0.74 18.85<br />
B+F 19.90 10.94 1.98 0.25 12.59 0.51 15.33<br />
F 9.60 8.77 3.39 0.31 7.27 0.31 Il.29<br />
F+F 11.15 2.78 1.61 0.36 5.31 0.14 7.42<br />
CHIRURGI E 13.49 7.07 3.33 0.67 8.52 0.41 12.94<br />
RT 8.66 6.69 3.86 0.32 5.51 0.23 9.93<br />
AL 10.73 3.25 5.06 0.28 12.13 1.22 18.69<br />
RC 6.07 8.04 2.51 0.81 6.37 1.47 11.16<br />
A 8% 6.17 7.42 1. 73 0.52 3.74 0.26 6.25<br />
FIL 7.94 6.23 3.34 0.52 7.10 0.87 Il.82<br />
CUMULS 11.01 6.67 3.34 0.60 7.91 0.61 12.46<br />
Tableau n° XV
- 166 -<br />
1..__L_.... P_...__M_....I.__PM_N_l<br />
TEMOIN 50.71 0.00 49.28 0.00<br />
B 35.54 9.76 50.77 3.92<br />
B+F 12.91 1.63 82.13 3.33<br />
F 30.03 2.74 64.39 2.74<br />
F+F 21. 70 4.85 71.56 1.89<br />
CHIRURGIE 25.73 5.18 65.84 3.17<br />
RT 38.88 3.22 55.49 2.32<br />
AL 27.07 1.50 64.90 6.53<br />
RC 22.49 7.26 57.08 13.17<br />
A 8% 27.68 8.32 59.84 4.16<br />
FIL 28.26 4.40 60.06 7.36<br />
CUMULS 26.80 4.81 63.48 4.89<br />
Pourcentage de volume occupé par les diverses cellules<br />
Tableau n° XIX
- 168 -<br />
Si l'on étudie le pourcentage respectif du volume occupé par les<br />
diverses populations cellulaires ( tableau nOXIX),ces résultats sont confirmés.<br />
VII - 3 : DISCUSSION<br />
Pour tous les cas,il a été observé,en profondeur,sous l'épithélium<br />
créviculaire,une zone infiltrée par des cellules inflammatoires.<br />
La présence ou non d'une zone infiltrée au niveau d'un tissu<br />
gingival sain a fait l'objet de multiples discussions.<br />
Pour de nombreux auteurs,la gencive qui apparaft saine à l'examen<br />
clinique présente invariablement,à quelques exceptions près,une zone infiltrée<br />
par des cellules inflammatoires lorsqu'on l'observe au microscope,cette zone<br />
pouvant être considérée comme une entité anatomique chez l'homme (216), chez<br />
le singe (Aprile Schechtman) et chez le chien (Schroeder).<br />
Pour d'autres auteurs,ou parfois les mêmes,mais au cours d'autres<br />
travaux,cette zone infiltrée est considérée comme le premier signe histopathologique<br />
de la gingivite (261)(314) ; enfin d/autres,plus prudents,ont<br />
montré au niveau de biopsies prélevées chez des chiens présentant une gencive<br />
cliniquement saine des différences notables dans la composition tissulaire<br />
entre la zone non infiltrée et la zone située sous l'épithélium créviculaire<br />
qui représente le site de la Ilfuture" zone infiltrée,lors du développement<br />
éventuel d'une gingivite (13).<br />
Tous ces travaux montrent combien il est difficile,dans certains cas,<br />
de différencier un état sain d'un état pathologique.<br />
Cela peut expliquer la proportion légèrement plus importante du<br />
TCI observée dans cette étude (11,01% ) lorsqu'on la compare aux autres<br />
analyses du tissu gingival sain ( 8,2% chez le chien selon Schroeder<br />
7% chez l'homme selon Schroeder (261) ).<br />
Toutes ces études ont porté sur la gencive marginale vestibulaire.
- 169 -<br />
Daniel (53), quant à lui a trouvé 24,8 %de TCI par rapport au<br />
tissu conjonctif interdentaire total.<br />
Cette différence de site de prélèvement peut expliquer la proportion<br />
plus importante de TCI observée dans cette étude lorsqu'on la compare aux<br />
analyses stéréologiques précédemment citées.<br />
Les cellules inflammatoires occupent 8,5% de la zone de TCI chez<br />
le chien (13).<br />
· 12,46%<br />
· 21,6%<br />
· 25,8%<br />
dans notre étude<br />
chez l'homme (166)<br />
Daniel (53) chez l'homme.<br />
Les lymphocytes de la zone infiltrée occupent plus de 15% de cette<br />
même zone chez le chien (Schroeder),et 22,5% chez l'homme (261) contre 3,34%<br />
dans notre travail.<br />
Cette différence peut être expliquée par le fait que,dans les deux<br />
cas, les auteurs considèrent qu'il s'agit déjà d'un état de gingivite débutante,<br />
donc d'un état pathologique,rendant la comparaison plus difficile.Nous nous<br />
rapprochons davantage du pourcentage de 6,5 Z trouvé par Daniel (53) chez<br />
l'homme,pour une gencive cliniquement saine.Lindhe (166),chez l'homme,trouve<br />
15 %dans le cas de gencive saine.<br />
Il faut également souligner l'importance relative des cellules<br />
mononuclées (monocytes,macrophages) qui constituent 63,48 %des cellules<br />
situées au niveau de la zone infiltrée et qui occupent 7,91 %du volume<br />
tissulaire de cette zone.<br />
Ces chiffres sont plus élevés que ceux de Schroeder (261) chez<br />
l'homme 2,1% ,Schroeder (5,8% ± 3,1 pour la densité volumétrique),lindhe<br />
(166) 2% et Attstr6m (13) (1,5% du volume tissulaire chez l'homme) mais<br />
inférieurs â ceux de Daniel (53) 36% de cellules situées au niveau de la<br />
zone infiltrée qui occupe 12,2% du volume tissulaire de cette zone.
entre<br />
VII - 4 : BILAN<br />
- 172 -<br />
Statistiquement,nous ne relevons aucune différence significative<br />
TCI , V , L , P , M, PMN et T pour chaque technique.<br />
Cette analyse supplémentaire avait,nous le répétons,un but précis<br />
quantifier au moyen d'un seul chiffre l'inflammation du tissu conjonctif<br />
afin de la comparer à d'autres données et effectuer une analyse de variance<br />
entre les diverses techniques.<br />
Existe-t-il une formule reliant ces différents paramètres entre eux?<br />
Nous en avons déterminé une<br />
x = (T x TCI)+(V x TCNI)<br />
T = nombre de cellules dans le TCI<br />
TCNI = tissu conjonctif non infiltré = 100 - TCI<br />
V = nombre de vaisseaux dans le TCNI immédiatement situé sous la zone<br />
de TCI sous-jacente à l'épithélium sulculaire.<br />
X = (T x TCI)+ V (100 - TCI)<br />
Quand T x TCI augmente, l 'inflammation augmente et X augmente.<br />
Quand V (100 - TCI) augmente, l'inflammation augmente et X augmente.<br />
Plus X augmente, plus l'inflammation augmente.<br />
En raison du nombre limité de coupes étudiées stéréologiquement,<br />
il ne nous a pas été possible d'effectuer une analyse statistique.Néanmoins,<br />
les valeurs moyennes pour chaque technique nous renseignerons,de façon générale,<br />
sur la qualité du tissu conjonctif 21 jours après le début de l'expérimentation.
Technique X<br />
F + F 331<br />
Al 556<br />
A 8% 735<br />
Rt 800<br />
Rc 821<br />
B 884<br />
F 887<br />
B + F 1147<br />
- 173 -<br />
Tableau par ordre croissant des X (ordre décroissant de l'inflammation ).<br />
Résultat moyen pour les techniques par fil<br />
par chirurgie<br />
Remarques :<br />
Les techniques chirurgicales et mixtes donnent légèrement de moins<br />
bons résultats que celles par fil à une exception près: F + F dont la<br />
valeur X F + F est la plus faible (331).<br />
Il semblerait donc que l'action du fil diminue l'action irritative<br />
de la fraise ( X F = 887 ) et diminue l'inflammation ou accélère la réparation<br />
du tissu.<br />
La gencive dilacérée par la fraise facilite la pénétration des<br />
composants du fil ( Rt ).Le fil ,par ses propriétés antiseptiques,faciliterait<br />
alors la réparation de la gencive....<br />
Pour B+F,les résultats sont moins bon que pour B seul.Les substances<br />
antiseptiques contenues dans les fils ne peuvent agir sur des tissus coagulés.<br />
728<br />
812<br />
Nous n'avons pas trouvé d'explication valable â ce résultat.<br />
Nous avons déjâ remarqué cela en comparant V et T.<br />
On observe une certaine analogie entre le tableau des moyennes<br />
de AI - A pour chaque technique et le tableau des X (page 150 ) .
- 174 -<br />
La profondeur du sondage clinique serait liée à l'inflammation<br />
du sulcus.<br />
Cette zone inflammatoire très faible sur le plan clinique ( SBI = 0 )<br />
est néanmoins visible histologiquement.<br />
Notre but initial était de définir, dans la limite de nos possibilités,<br />
la méthode qui :<br />
- serait la plus efficace.Si l Ion veut objectiver la préparation dans sa<br />
totalité,il est nécessaire que l lempreinte aille un peu au·delà de ses<br />
limites.Nous ne considèrerons comme efficacité réelle que l'efficacité<br />
de rétraction verticale (ER)<br />
- entra;nerait le moins de récession<br />
présenterait le moins d'inflammation au jour 21.<br />
Pour cela,nous avons envisagé de regrouper ces chiffres en une<br />
seule valeur représentant la performance de la technique .<br />
ER doit être le plus grand possible<br />
PH doit être le plus petit possible<br />
X doit être le plus petit possible.<br />
Nous avons pris comme coefficient de performance le rapport suivant<br />
y = ER x 100<br />
IPHI x X<br />
Quand Y augmente,la qualité du produit est meilleure.
Classification par ordre décroissant<br />
Technique<br />
F + F<br />
B<br />
Al<br />
A 8%<br />
B + F<br />
Rc<br />
F<br />
Rt<br />
y<br />
14,03<br />
13,80<br />
12,26<br />
6,90<br />
4,33<br />
4,30<br />
3,61<br />
3,10<br />
Moyenne de Y pour les techniques par fil 4,99<br />
par chirurgie 4,79<br />
- 175 -<br />
Bien que nous ne relevions aucune différence significative entre<br />
les différentes valeurs pour toutes les techniques,il semblerait que le<br />
meilleur rapport efficacité / tolérance au jour 21 soit obtenu pour F + F .<br />
Nous pensons qu'il est difficile de conclure sur cette toute dernière<br />
partie de notre analyse,d'autant plus que :<br />
- le nombre des sujets formant les sous-groupes des techniques nlest sans<br />
doute pas assez élevé.<br />
- Une autre enquête,complémentaire à celle-ci,exécutée selon le même processus<br />
mais portant sur un nombre plus élevé de cas serait sans doute nécessaire<br />
pour éçlaircir ce point de notre analyse.<br />
Remarque<br />
Nous avons choisi IPHI car la moyenne pour le Bistouri est<br />
négative .En moyenne1il nly a pas de récession pour cette technique mais une<br />
très légère prolifération de tissu. Il se peut,qulau bout de 21 jours,la<br />
réparation ne soit pas complète pour les techniques chirurgicales et qu'un<br />
léger oedème persiste,d'autant que nos chiens ont une absence totale d'hygiène<br />
bucco-dentaire.
VIII - DISCUSSION GENERALE<br />
VIII - 1 : PREPARATION ET PROVISOIRES<br />
Notre plan initial comporte une phase de<br />
-préparation des dents<br />
-réalisation de prothèse transitoire.<br />
- 176 -<br />
Par la suite,notre protocole expérimental,par sa longueur,nous a<br />
imposé de réduire notre temps de travail en fonction des impératifs de<br />
l'anesthésie générale.<br />
Nous avons donc décidé de supprimer ces deux étapes dans les<br />
techniques chirurgicales: l'action des instruments rotatifs est évidente<br />
dans le cas de la technique F et F + F .<br />
Pour l'éviction au bistouri,la partie interne de l'épithélium<br />
sulculaire est enlevée.<br />
Par contre,il nous fallait effectuer les préparations en bouche<br />
dans le cas des techniques par fil pour opérer dans les mêmes conditions<br />
qu'avec nos patients.<br />
Quelle est l'influence des prothèses transitoires?<br />
Pour Alves (3), le temps de cicatrisation est altéré quand on utilise<br />
des coiffes temporaires en résine acrylique chimiquement active.<br />
Par contre Waerhaug (302),observant des coiffes acryliques placées<br />
dessous la limite gingivale chez les chiens,note que,dans des conditions<br />
favorables,l'épithélium s'adapte étroitement à la coiffe acryl ique comme autour<br />
d'une dent naturelle.<br />
Waerhaug (304),étudiant les effets des surfaces rugueuses sur le<br />
tissu gingival,suggère que les changements inflammatoires observé s sont dûs<br />
à une irritation chimique ou bactérienne plutOtqu'une irritation mécanique<br />
la plaque dentaire accumulée sur les aires radiculaires est la cause de<br />
l'inflammation ( Loe ).
- 177 -<br />
Pour L6e (177),la rugosité des restaurations plutôt que l'irritation<br />
chimique produit des lésions parodontales (84).<br />
Si les coiffes temporaires sont mal adaptées,elles vont créer ou<br />
entériner des lésions parodontales parfois difficiles â éliminer.<br />
Par contre,si elles sont bien conçues et réalisées,elles vont<br />
servir de support à la cicatrisation périphérique de chaque élément.<br />
La prothèse transitoire peut être considérée comme une proposition<br />
que le praticien fait au parodonte.Il est bien entendu qu'une prothèse provisoire<br />
doit répondre aux mêmes exigences que la prothèse définitive du point de vue<br />
de la qualité et de la précision des adaptations des formes de contour (246).<br />
Nous avons décidé,en accord avec cette dernière idée,de ne pas faire<br />
de différence entre les techniques chirurgicales et mécanico-chimiques<br />
et de ne pas tenir compte des provisoires dans notre interprétation des<br />
résultats,même si le protocole opératoire est différent.<br />
VIII - 2 : ANALOGIES ENTRE LE CHIEN ET L'HOMME<br />
La traditionnelle division de l'examen et de la discussion en deux<br />
parties ,1 'une clinique et l'autre histologique,entraine souvent un malentendu<br />
en ce qui concerne l'interrelation entre les techniques prothétiques et la<br />
réponse des éléments du parodonte.<br />
Il est nécessaire,selon Dragoo (65),que le praticien connaisse<br />
autant l'agent mécanique que l'aspect biologique des techniques utilisées<br />
en prothèse.<br />
A partir des résultats obtenus dans son étude (65),il ressort que<br />
la profondeur moyenne du sulcus chez le patient sain n'est seulement que de<br />
0,5 â 1 mm.Il évoque les relations normales existant entre le complexe<br />
gingival et l'odonte,chez l'homme,dans un environnement sain.<br />
La distance moyenne entre la limite apicale de l'attache épithéliale<br />
et la crête osseuse est de 1,07 mm.
Pour l'homme ( 65 ) Pour le chien<br />
- 178 -<br />
La distance gencive marginale - crête osseuse moyenne chez l'homme<br />
est plus forte que celle du chien ( Ot8mm ) et nous pensons donc que les<br />
résultats précédemment énoncés seraient peut être moins sévères chez l'homme.<br />
Or il n'y a pas de corrélation entre H 3 et PH.<br />
Harrison ( 123 )tà l 'inversetnote que la réaction tissulaire est<br />
généralement moins sévère que chez l'homme.<br />
000
•<br />
CON CLUSI ON
, ,<br />
RES UME
SUMMARY
•• •<br />
BIBLI OGRAPH lE
III - PROTOCOLE EXPERIMENTAL<br />
III - 1 : STADE INITIAL DE L'EXPERIMENTATION<br />
III - 1.1 : Rétraction par fil<br />
III - 1.1.1 Anesthésie<br />
Les chiens sont anesthésiés selon le protocole de la fiche<br />
dlanesthésie (voir fiche).<br />
III - 1.1.2 : Examen buccal<br />
• : examen général<br />
- 92 -<br />
Chez pratiquement tous les chienstil nous a révélé une bonne santé<br />
parodontaletpeu de gingivite et pratiquement pas de tartre (voir fiches<br />
opératoires) .<br />
• : évaluation de l'état de santé parodontale<br />
Les animaux nlont subi aucune préparation initialetà savoir ni<br />
détartragetni polissagetni brossage quotidien ou hebdomadairetni traitement<br />
général.
Mesure sur le modèle sans préparation initiale.<br />
Mesure sur le modèle après "gingivectomie".<br />
- 115 -
TECNIQUE CHIMICO - MECANIQUE = RACECORD ( "RC" )<br />
Fil imprégné d'adrénaline 4 %<br />
Chien 3321 - B PM2<br />
B PM3<br />
B Ml<br />
Chien 3312 - B PM2<br />
B PM3<br />
B Ml<br />
- 142 -<br />
Epithélium = hperplasie modérée ( avec acanthose )<br />
chorion = hyperplasie modérée ( surtout vasculai<br />
re )<br />
Léger infiltrat inflammatoire<br />
1 d e m
TECHNIQUE CHIMICO - MECANIQUE = ALUPACK ( "AL")<br />
Chien 3308 - E PM3<br />
E PM4<br />
E Ml<br />
Chien 3314 - A PM4<br />
A Ml<br />
Fil imprégné d'alun<br />
- 141 -<br />
Epithélium = hyperplasie modérée avec acanthose<br />
plus ou moins importante<br />
Chorion = fortement réactif (fibroblastes et<br />
vaisseaux)<br />
(Ml est plus réactif que PM3 et PM4 . Infiltrat<br />
inflammatoire presque absent dans PM3 et PM4 mais assez<br />
important dans Ml )<br />
difficile<br />
à<br />
interpréter<br />
( Aspect normal (?) ou légère hyperpla<br />
( sie épithéliale (avec acanthose modé<br />
(<br />
( rée)<br />
( Pas de réaction conjonctive?<br />
(<br />
( Pas d'infiltrat ?
TECHNIQUE CHIMICO-MECANIQUE = RACESTYPTINE ("RT")<br />
Chien 3318 - A PM2<br />
A PM3<br />
A Ml<br />
Chien 3312 - E PM2<br />
E PM3<br />
E PM4<br />
E Ml<br />
- 140 -<br />
Fil imprégné de chlorure d'aluminium<br />
Epithélium = hyperplasie modérée avec hyperacanthose<br />
= hyperplasie'modérée fibroblastique<br />
et vasculaire<br />
Léger infiltrat inflammatoire<br />
Peu de réaction épithéliale et conjonctive mais in-<br />
filtrat inflammatoire relativement important
1 TECHNIQUE<br />
CHIRURGICALE = FRAISE + RACESTYPTINE (II F + Fil)<br />
Chien 3308 - A PM2<br />
A PM3<br />
Chien 3308 - A Ml<br />
Chien 3312 - A PM2<br />
A M1(difficilementinterprétable<br />
)<br />
Réparation presque achevée-<br />
Epithélium<br />
Chorion<br />
= légère hyperplasie<br />
= hyperplasie fibroblastique modérée<br />
hypergénèse vasculaire modérée<br />
léger inflitrat leucocytaire<br />
Réparation presque achevée mais muqueuse fortement réactionnelle<br />
.<br />
Epithélium = hyperplasie avec forte acanthose<br />
Chorion = hyperplasie fibroblastique et vasculaire<br />
importante<br />
inflitrat leucocytaire assez important.<br />
= Idem (mais infiltrat inflammatoire<br />
peu important )<br />
Chien 3312 - A PM3 = Idem (y compris infiltrat peu important)<br />
A signaler qu'une partie des lames montre peu<br />
ou pas de lésion .
TECHNIQUE CHIRURGICALE = FRAISE ( "F" )<br />
- 138 -<br />
Chien 3318 - B Ml Epithélium = hyperplasie avec forte hyperacanthose<br />
Chien 3312 - C PM2<br />
C PM3<br />
C Ml<br />
Chorion = hyperplasie fibroblastique et vasculaire<br />
importante .<br />
Infiltrat inflammatoire important.<br />
Epithélium et chorion légèrement hyperplasiés<br />
( plus léger infiltrat) ou normaux.
- 137 -<br />
TECHNIQUE CHIRURGICALE = BISTOURI ELECTRIQUE + RACESTYPTINE ("B+F")<br />
Chien 3321 - C PM2<br />
C PM3<br />
C PM4<br />
C Ml<br />
Chien 3314 - C PM2<br />
C PM3<br />
C PM4<br />
- Epithélium = forte hyperplasie avec hyperacanthose<br />
- Chorion = forte hyperplasie fibroblastique et<br />
vasculaire mais léger infiltrat inflammatoire<br />
.<br />
- Epithélium = hyperplasie modérée avec assez forte<br />
acanthose cependant<br />
- chorion = hyperplasie fibroblastique et vasculaire<br />
modérée.<br />
Infiltrat inflammatoire modéré
Chien 3308 - C PM3<br />
C PM4<br />
C Ml<br />
Chien 3314 - A PM2<br />
T[GHNIQUE CHIRURGICALE = BISTOURI ELECTRIQUE ("B")<br />
Bonne cicatrisation<br />
- 136 -<br />
Epithélium hyperplasié avec hyperacanthose<br />
Chorion = hyperplasie fibroblastique et vasculaire<br />
modérée et localisée à une zone étroite.<br />
Réaction épithéliale et conjonctive importante<br />
Epithélium<br />
Chorion<br />
= hyperplasie avec hyperacanthose<br />
= hyperplasie importante , fibroblastique<br />
et vasculaire .<br />
Léger infiltrat inflammatoire par endroits.
.<br />
T E MOI N S<br />
- 135 -<br />
La muqueuse gingivale présente , sur le versant externe , un épithélium<br />
malpighien épais avec une couche 'Iparakératosique" nettement individualisée<br />
et des prolongements interpapillaires très prononcés et larges. Le<br />
chorion montre une zone relativement étroite sous l'épithélium avec un aspect<br />
de tissu conjonctif lâche et de nombreux vaisseaux, surtout dans les papilles.<br />
Le versant interne est relativement mince et toutes les couches cellulaires<br />
sont présentes mais réduites; les prolongements interpapillaires sont<br />
présents mais peu marqués . Le chorion sous-jacent montre une étroite bande de<br />
tissu conjonctif lâche riche en vaisseaux<br />
On observe , très fréquemment, une lésion de la muqueuse au niveau<br />
du rebord mais plus particulièrement sur le versant interne. Cette lésion<br />
consiste en une plage de cellules épithéliales en voie de lyse, un chorion<br />
présentant une hypertrophie de fibroblastes , un nombre de vaisseaux plus<br />
élevé que la normale et un infiltrat inflammatoire modéré (leucocytes)<br />
NB. : L'infiltrat inflammatoire, chez les témoins et surtout chez<br />
les chiens utilisés, paraît constitué de monocytes surtout, de lymphocytes,<br />
de plasmocytes et de quelques polynucléaires .