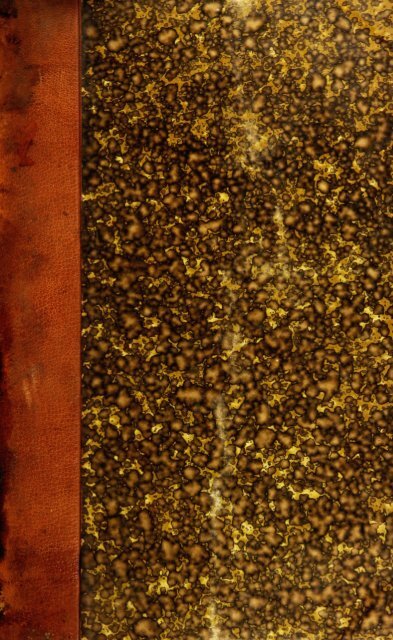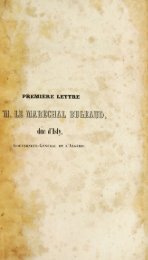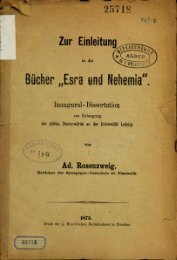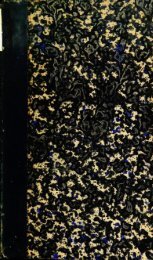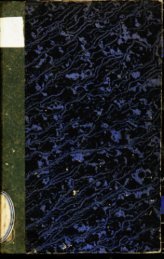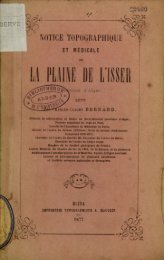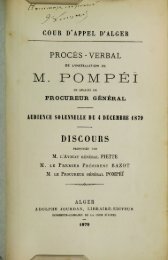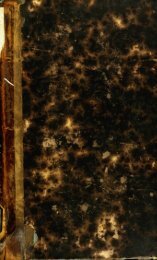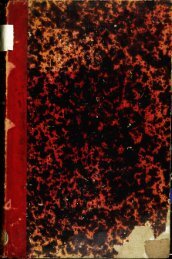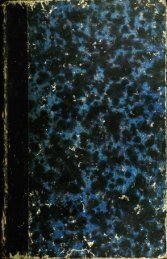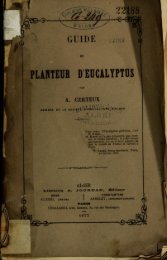You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
w-<br />
*Wh<br />
\ 1
BULLETIN JUDICIAIRE<br />
L'ALGERIE
ALGER. —<br />
TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN
REVUE BIMENSUELLE<br />
— Gui t''-<br />
BULLETIN JUDICIAIRE<br />
DE<br />
L'ALGERIE<br />
DOCTRINE. — JURISPRUDENCE. —<br />
• - L<br />
u «.- J.<br />
DEUXIÈME ANNEE<br />
1878<br />
ALGER<br />
LÉGISLATION<br />
TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN<br />
Imprimeur-libraire du Parquet général<br />
h, PLACE DU Q0UYERNEMENT, \<br />
1879
2e année. — Ier Janvier 1878. —<br />
N° 25<br />
BIMETIM JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
I. Domaine de l'État. — Ministre<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
11 niai 1877.<br />
de l'Intérieur.<br />
LÉGISLATION<br />
II. Chênes-liége. — Concession. — Cession définitive.<br />
III. ©hênes-llége. — Cession non consommée. — Action<br />
tice.<br />
en jus<br />
I. Le ministre de l'intérieur n'est plus recevable, depuis le décret du 7juil<br />
let 1876,<br />
domaniaux de l'Etat sur des terrains situés en Algérie.<br />
à intervenir devant le Conseil d'État pour faire valoir les droits<br />
II. Les concessionnaires de forêts de chênes-liège ont le droit d'obtenir la<br />
cession de ces forêts en toute propriété, s'ils en ont fait la demande avant le<br />
{^juillet 1870 (Décr. 2 févr. 1870, art. 1«) ;<br />
Mais la résolution du contrat de concession ne peut résulter que d'actes de<br />
vente et de cession passés par le Directeur des domaines et approuvés par le<br />
Directeur général (Décr. 2 févr. 1870, art. 10 et 18);<br />
III. Par suite, tant que ces actes ne sont pas intervenus, les concessionnaires<br />
ne sont pas recevables à agir en justice comme propriétaires des forêts (1).<br />
i« Espèce. —<br />
Jumel<br />
de Noireterbe c. Gomp. de Mokta-el-Hadid.<br />
— Le Conseil d'Etat; Sur l'intervention du ministre de l'intérieur;<br />
Considérant que le mémoire en intervention présenté par le ministre de l'in<br />
térieur est fondé sur ce que la forêt dont les époux Jumel de Noireterre se<br />
prétendent propriétaires, n'a jamais été aliénée par l'Étal, et que, dès lors,<br />
les dits requérants sont sans qualité pour se pourvoir conlre l'arrêté du<br />
Gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la Compagnie des mines de<br />
Mokla-el-Hadid à effectuer des recherches de mines au lieu dit Marouania,<br />
(1) Sur l'application de l'art. 4 du décr. du 2 février 1870, V. Cons. d'État, 12<br />
janvier 1877 (Bulletin Judiciaire, 1877, 273).<br />
—
— dans le périmètre de la forêt dont il s'agit ;<br />
Considérant qu'il résulte du<br />
décret du 7 juillet 1876, que les affaires concernant l'Algérie sont réparties<br />
entre les différents ministères suivant la même règle qu'en France ; qu'il suit<br />
de là qu'à la date du 10 nov. 1876, le ministre de l'intérieur n'était pas re-<br />
cevable à intervenir devant le Conseil,<br />
de l'État, sur le recours des époux Jumel de Noireterre ;<br />
dans leur recours,<br />
au nom et dans l'intérêt du domaine<br />
— Considérant<br />
que<br />
les époux Jumel de Noireterre prétendent agir non com<br />
me concessionaires des foré is de l'Oued-El-Aneb, du Metzel, etc., l'acte de<br />
concession passé le 7 juillet 1862 en faveur du sieur Duprat ayant expressé<br />
ment refusé aux concessionaires tous droits sur les mines, minières, carriè<br />
res, et autres produits de sous-sol, mais en se fondant sur ce qu'ils auraient<br />
acquis la propriété délinitive desdites forêts par l'effel du décret du 2 février<br />
— 1870 ; Considéranl que si l'art. 1« du décret précité dispose que les forêts<br />
de chênes-liège concédées par baux de 90 ans, doivent être cédées en toute<br />
propriété aux titulaires des concessions qui en auront fait la demande avant<br />
le 1«r juillet 1870, il résulte de l'art. 10 que les actes de vente et de cession<br />
doivent être passés par le directeur des Domaines ei approuvés par le Gou<br />
verneur général ; que ce sont seulement, aux termes du même article, les-<br />
dits actes qui emportent résolution du contrat de concession, sauf aux effets<br />
de la vente à rétroagir jusqn'au 1«juillet<br />
1870, conformément à l'art. 18 —<br />
;<br />
Considérant qu'il est reconnu que, jusqu'à ce moment, aucun acte de venle<br />
ni de cession n'a élé passé en faveur des époux Jumel de Noireterre, et que<br />
la Compagnie de Mokta-el-Hadid est fondée à prétendre que, tant que les<br />
actes dont il s'agit ne seront pas inlervenus, les requérants sont non receva-<br />
bles à agir comme propriétaires des forêts de l'Oued-el-Aneb, de Metzel, etc.,<br />
et à se pourvoir, en cette qualité, contre l'arrêté du Gouverneur général de<br />
l'Algérie ayant aulorisé la société défenderesse à effectuer des recherches de<br />
mines, au lieu dit Marouania, dans le périmètre desdites forêts :<br />
Art. 1er. L'intervention du ministre de l'intérieur n'est pas admise. —<br />
Art. 2. Le recours.<br />
. . est rejeté.<br />
MM. de Saint-Laumer, rap. , Bratjn, concl. ; M69 Nivard,<br />
Dareste, Aguillon et<br />
av.<br />
2e Espèce. -<br />
Du<br />
même jour, mêmes parties, mêmes mag. et av. — Pour<br />
voi dirigé contre un arrêté par lequel le préfet de Constantine a autorisé la<br />
Compagnie à occuper pour l'exploitation des gîtes de fer de toute nature, une<br />
rédac<br />
— parcelle de 90 hectares prise dans la forêt de l'Oued-el-Aneb. Même<br />
tion sauf la fin du dernier considérant ainsi conçue : « Et à- se prévaloir des<br />
droits qu'ils prétendent appartenir aux propriétaires de la surface, sur le mi<br />
nerai exploitable à ciel ouvert, dans l'étendue desdites forêts. »
TRIBUNAL DES CONFLITS<br />
12 mai 1877.<br />
Expropriation publique. — Occupation. — Restitution. — Com<br />
pétence administrative.<br />
En Algérie, lorsqu'il n'est pas contesté qu'un immeuble a étéaffecté à unser-<br />
vice public antérieurement au i« janvier 1845, l'autorité judiciaire n'est pas<br />
compétente pour statuer sur une demande tendant à la restitution de<br />
cet immeuble (1).<br />
Le conseil de préfecture est également incompétent à cet effet (2) ,<br />
Menouillard<br />
Le sieur Menouillard avait assigné, devant le tribunal de Mostaganem, le<br />
préfet du département d'Oran, comme représentant le Domaine de l'Étal, pour<br />
s'entendre condamner à lui restituer une parcelle de terrain indûment déte<br />
nue suivant lui par le Domaine, avec intérêts depuis le mois de juillet 1841,<br />
date de l'occupation, et dommages-intérêts.<br />
Le tribunal et, en appel, la cour d'Alger se sont successivement déclarés<br />
incompélenls ; le sieur Menouillard a porté alors sa réclamation devant le<br />
conseil de préfecture, —<br />
qui s'est également déclaré incompétent.<br />
Recours<br />
au tribunal des conflits, tendant à faire régler la compétence et renvoyer la<br />
contestation devant l'autorité judiciaire.<br />
— Letribunal des conflits; Vu les ordonnences des 31 juillet 1836, 1«<br />
—<br />
— octobre 1844 et 9 mars 1848 ; Vu le décret du 5 février 1851 ; Vu le<br />
décret du 30 juin 1876.<br />
Considérant, en ce qui touche le jugement du tribunal, qu'il n'est pas con<br />
testé que l'immeuble dont la restitution est demandée, occupé, dès l'année<br />
1841, par le service du génie militaire, a été compris par un arrêté du Gou-<br />
vernenr général de l'Algérie, en date du 6 mars 1845, dans l'état indicatif<br />
des immeubles domaniaux qui étaient, antérieurement au 1er janvier 1845,<br />
affectés aux services publics et portés audit état comme affecté au caserne<br />
ment militaire ;<br />
— Considérant<br />
que la décision par laquelle le Gouverneur<br />
général a affecté l'immeuble dont il s'agit au service du génie militaire est un<br />
acte administratif dont l'annulation, le cas échéant, n'aurait pu être pronon-<br />
(1) Si le fait de la possession de l'État avant 1845 avait été contesté, la demande<br />
aurait eu le caractère d'une véritable action en revendication et les tribunaux<br />
auraient pu en connaître (art. 13 de la loi du 16 juin 1851). Toutefois, le tribunal<br />
devrait surseoir s'il y avait lieu d'interpréter un acte administratif.<br />
(2)<br />
Le conseil de préfecture eût été compétent si le réclamant s'était borné à de<br />
mander une indemnité (ordonn. 1er oct. 1844, art. 79,<br />
décr, du 5 févr. 1851).<br />
et arrêté du 5 mai 1848 et
cée que par l'autorité administrative ; que le tribunal n'aurait pu statuer sur<br />
la demande en restitution de l'immeuble sans connaître de cet acte adminis<br />
tratif et sans violer les principes de la séparation des pouvoirs administratif<br />
— et judiciaire. Considérant, en ce qui touche l'arrêté du conseil de préfec<br />
ture, que la demande du sieur Meuouillard tendait à obtenir, non pas une<br />
indemnité pour cause de dépossession, mais la restitution de l'immeuble dont<br />
il a été dépossédé; qu'aucune disposition législative n'attribue aux conseils de<br />
préfecture la connaissance des demandes de cette nature ;<br />
— Que de ce qui<br />
précède il résulte qu'en se déclarant respectivement incompétenls pour con<br />
naître de la demande du sieur Menouillard, le tribunal de Mostagauem et le<br />
conseil de préfecture d'Oran n'ont pas méconnu leur compétence, et qu'il n'y<br />
a pas lieu â régler la juridiction ;<br />
Art. lr, s'il peut résulter d'une in<br />
dication spéciale contenue audit procès-verbal que la traduction n'aurait pas<br />
été faite dans chacun des cas où la loi l'ordonne .<br />
La Cour: Sur le pourvoi des nommés Mohamed ben Hamadouch EI-Bachir<br />
bou Tarem, Mohamed ould Embarek, en cassation d'un arrêt rendu le<br />
28 avril dernier, par la Cour d'assises d'Oran qui lésa condamnés chacun aux<br />
travaux forcés à perpétuilé. — Sur le moyen tiré de la violation des art. 319<br />
et — 332 du code d'instruction criminelle, Attendu que la loi en prescrivant<br />
par l'art. 332 du Code d'inst. crim. la nomination d'un interprèle pour le<br />
cas où l'accusé et les témoins ne parleraient pas la même langue, a voulu<br />
donnera l'accusé le moyen de discuter, contredire ou expliquer les déclara<br />
tions des témoins au moment même où ces déclarations sont émises ;<br />
— Que<br />
d'après l'art. 319 précité ce droit constitue une partie essentielle de la
— défense ; Attendu que la nullité prononcée par l'art. 332 pour le cas où<br />
aucun interprèle n'a été nommé,<br />
s'applique évidemment au cas où l'in<br />
terprète nommé n'aurait rempli sa mission que d'une manière incomplète ;<br />
— Attendu que dans l'espèce, le procès-verbal, dans la partie relative à l'au<br />
dition des témoins, constate qu'à l'exception de six témoins qui ont déposé en<br />
français, tous les témoins étant d'origine arabe et ne parlant pas le français<br />
ont été entendus par l'intermédiaire de l'inlerprète qui avait été nommé à rai<br />
— son de ce que les accusés ne parlaient que la langue arabe ; Qu'il résulte<br />
de cette rédaction quelesdépositions des témoins quisesont exprimées en fran<br />
çais n'ont point été traduite en arabe, de telle sorte que les accusés pussent<br />
— les comprendre et les discuter ; Attendu que si le procès-verbal mentionne<br />
dans sa partie finale que l'interprète a prêté son ministère toutes les fois qu'il<br />
a été utile, cette énoncialion conçue en termes généraux ne saurait prévaloir<br />
sur l'indication spéciale insérée dans le corps de l'acte, et de laquelle il ré<br />
sulte qu'aucune traduction n'a été faiie de la déposition des témoins parlant<br />
— la langue française ; Attendu, dès lors, que l'interprète nommé n'a pas<br />
rempli l'intégralité de sa mission, ce qui a constitué une violation de l'art.<br />
332 du code d'inst. crim. et rendu impossible aux accusés l'exercice libre et<br />
complet des droits à eux conféré par l'art. 319 dudit code.<br />
Par ces motifs, casse, etc.<br />
M. Gast, rap. ; M. Lacointa,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (ircCh.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
3 novembre 1877<br />
Mine. — Invention d'une mine. — Permis<br />
d'exploration. —<br />
Convention antérieure a l'acte de concession. — Interpré<br />
tation. —<br />
Société<br />
civile. — Compétence.<br />
La reconnaissance, les effets ou la déchéance du droit d'invention d'une<br />
mine ne peuvent être reconnus que par l'autorité administrative, seule compé<br />
tente pour permettre l'ouverture de la mine et régler les conditions de celte<br />
ouverture accordée, soit à l'inventeur lui-même, soit à un tiers qui devra à<br />
l'inventeur une indemnité déterminée par l'acte de concession.<br />
Le permis d'exploration est un acte administratif qui échappe à l'autorité<br />
judiciaire et ne peut être l'objet d'aucune mesure prononcée par elle.<br />
Il -appartient au contraire aux Tribunaux ordinaires de constater les con<br />
trats et quasi-contrats relatifs au droit d'invention d'une mine, constaté<br />
par le permis d'exploration, de les sanctionner, et au besoin, d'en prononcer la<br />
résolution.
Lorsque différentes personnes se présentent comme<br />
•<br />
6<br />
co'intéressés solidaires et<br />
coïnventeurs d'une même mine dont elles sollicitent ensemble l'exploitation in<br />
divise, elles se constituent par ce seul fait et dans ce but, en société : elles<br />
mettent en commun leur droit d'inventeur, lequel était né actuel et susceptible<br />
de produits, leur assurant en effet, aux termes de l'art. 16 de la loi du 21<br />
avril 1810, soit la concession ultérieure de l'exploitation de la mine, soit en<br />
tout cas, une indemnité.<br />
La preuve de cette société n'a pas besoin d'être constatée par un acte de<br />
société dressé régulièrement,<br />
elle résulte suffisamment des divers actes écrits<br />
dans lesquels les associés ont reconnu l'existence de cette société qui serait<br />
suffisamment établie par la demande collective d'autorisation qu'ils ont tous<br />
signée.<br />
Cette société a évidemment le caractère de société civile, d'autant plus que,<br />
précédant l'exploitation de la mine, elle n'avait pas pour objet la vente de ses<br />
produits, mais seulement les droits et les efforts qui,<br />
téressés,<br />
devaient conduire à l'exploitation de la mine.<br />
dans la pensée des in<br />
Dans une telle société, les droits des intéressés ne sont pas susceptibles d'être<br />
cédés, au regard de la société, et cette règle ne peut souffrir exception que lors<br />
que les associés ont, par une convention nouvelle et unanime, modifié l'état<br />
de choses primitif et admis un cessionnaire comme membre nouveau de la<br />
société.<br />
Gérard, Arrazat et consorts c. Hermandez, Perez et consorts.<br />
« La Cour,<br />
» Considérant que le 29 juin 1874, Gonzalvès Pascal, Gondolfo,<br />
Arrazal et<br />
Dameron, se qualifiant de cointéressés solidaires, adressèrent à M. le préfet<br />
d'Oran une demande unique tendant à constater,, à leur profit commun,<br />
le droit d'invention d'une mine de bitume et de charbon, sise dans la tribu<br />
des Béni Zerouat, et à être autorisés à commencer Içs travaux d'exploration ;<br />
» Considérant que le 14 octobre 1874, par acte reçu par Me Courserant,<br />
notaire à Mostaganem, Gonzalvès Pascal et Gondolfo donnaient mandat à la<br />
société Gérard et Seguela, représentée à l'acteur Gérard, l'un des associés,<br />
de faire les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations d'explora<br />
tion et d'exploitation, sollicitées et non encore accordées ; que la société Gé<br />
rard et Seguela se chargeait en outre de faire toutes les avances de fonds né<br />
cessaires à l'obtention de l'autorisation el aux travaux d'exploration, et qu'il<br />
était stipulé que cette cause trouverait sa place dans un acte authentique de<br />
société qui interviendrait dans la quinzaine de l'autorisation administrative<br />
à intervenir; que la société ainsi promise devait avoir pour effet d'attribuer<br />
à la société Gérard et Seguela les lieux cinquièmes des trois cinquièmes qui<br />
devaient appartenir plus tard à Conzalvès, Pascal et Gondolfo, dans l'exploi<br />
tation de la mine, comme faisant partie lous le trois des'cinq inventeurs de<br />
cette mine ;<br />
» Considérant qu'à la suite de ces stipulations de l'acte authentique du 14<br />
octobre, Gérard, en qualité de mandataire et directeur d'une société civile
qu'il disait exister entre Gonzalvès, Pascal, Gondolfo, ArrazaletDameron,pour<br />
obtenir la concession de la mine, sollicitait de nouveau, le 12 février 1875,<br />
l'autorisation d'exploration, s'engageant à payer personnellement les indem<br />
nités que les travaux à effectuer rendraient nécessaires;<br />
» Considérant que sur cette demande, par arrêté de M. le Gouverneur gé<br />
néral, en date du 18 avril 1875, le permis d'exploration fut accordé pour<br />
deux ans à la société civile des cinq inventeurs à charge par elle de consigner<br />
avant toute entreprise une somme de 500 fr. pour indemnités aux proprié<br />
taires des terrains sur lesquels se feraient les travaux projetés;<br />
» Considérant qu'après cet arrêté, Gérard et Seguela, Arrazat et Dameron,<br />
n'ayant plus rien fait relativement à la mine, Gonzalvès, Pascal et Gondolfo<br />
leur firent sommations régulières de se trouver réunis à jour et à heure fixes,<br />
en l'étude de Me Courserant, notaire, pour y passer ensemble un acte authen<br />
tique de société pour l'exploitation de la mine, conformément à leurs conven<br />
tions antérieures ;<br />
» Considérant qu'ainsi qu'il résulte d'un acte deM« Courserant, du 27 sep<br />
tembre 1875, Gérard ne déféra pas à la sommation à lui adressée, tandis que<br />
Seguela,<br />
Arrazat et Dameron déclaraient être prêts à passer l'acte de société<br />
qui ne fut point établi à raison de l'absence de Gérard ;<br />
» Considérant qu'Arrazat et Dameron s'étant ensuite refusés à contribuer<br />
à la consignation de la somme fixée par l'arrêté d'aulorisalion, Gonzalvès,<br />
Pascal et Gondolfo sommèrent Gérard, sans résultat, de faire les avances né<br />
cessaires, et que, le 3 novembre 1875, la somme de 500 francs fut déposée<br />
à la caisse des Consignations par Gonzalvès, tant de ses propres deniers que<br />
de ceux de Pascal et de Gondolfo ;<br />
» Considérant que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo ont fait,<br />
pour former la<br />
société projetée, de nouvelles sommations à Gérard, Seguela, Arrazat et Da<br />
meron, lesquelles sont restées infructueuses, ainsi qu'il résulte d'un acte de<br />
M
8<br />
Considérant que le Tribunal n'a pas prononcé de piano les résolutions<br />
de conventions et les déchéances que sollicitaient les demandeurs, mais qu'il<br />
les a édictées pour le cas où les défendeurs n'auraient pas passé acte de so<br />
ciété dans le délai qu'il leur a imparti ; que ce jugement a été frappé d'appel<br />
par les défendeurs, et qu'il p'a pas été attaqué par les demandeurs actuelle<br />
ment intimés ;<br />
» Considérant qu'il reste à tirer les conséquences juridiques des faits cons<br />
tatés ;<br />
» Considérant qu'il faut remarquer d'abord que les droits et obligations<br />
respectifs des parties peuvent résulter, soit du droit d'invention et du per<br />
mis d'exploration qu'elles ont obtenu, soit des conventions qui sont interve<br />
nues entre elles, ou des faits qui en tiennent lieu ; que la reconnaissance,<br />
les effets ou la déchéance du droit d'invention ne peuvent être reconnus que<br />
par l'autorité administrative, seule compétente pour permettre l'ouverture<br />
de la mine, et régler les conditions de cette ouverture accordée, soit à l'in<br />
venteur lui-même, soit à un tiers, qui devra à l'inventeur une indemnité<br />
déterminée par l'acte de concession ; que le permis d'exploration est un acte<br />
administratif qui échappe à l'autorité judiciaire et ne peut être l'objet d'au<br />
cune mesure prononcée par elle ; qu'il appartient, au contraire,<br />
aux Tribu<br />
naux ordinaires de constater les contrats et les quasi-contrats, de les sanc<br />
tionner et, au besoin, d'en prononcer la résolution ; que cette distinction,<br />
qui tient à la séparation des pouvoirs et à l'ordre public, doit être relevée<br />
d'office par la Cour ;<br />
» Considérant qu'à l'origine, Gonzalvès, Pascal, Gondolfo, Arrazat. et Da<br />
meron se présentant comme coïntéressés solidaires et coïnvenleurs d'une<br />
même mine, dont ils sollicitaient ensemble l'exploitation indivise, se consti<br />
tuaient, par ce seul fait et dans ce but, en société ; qu'ils mettaient en com<br />
mun leur droit d'inventeurs, lequel était né, actuel et susceptible de produits;<br />
qu'en effet, aux ternies de l'article 16 de la loi dn 21 avril 18'10, ce droit leur<br />
assurait soit la concession ultérieure de l'exploitation de la mine, soit, en<br />
tout cas, une indemnité ; qu'ainsi, leur société avait un objet déterminé et<br />
légitime ;<br />
» Que la preuve de cette société est régulièrement rapportée par les di<br />
vers actes écrits ci-dessus mentionnés, et dans lesquels tous les appelants ont<br />
reconnu l'existence de cette société primitive, qui serait suffisament établie<br />
par la demande collective d'autorisation qu'ils ont tous signée ; qu'en effet, il<br />
n'est pas nécessaire de constituer la société par un acte écrit,<br />
de fournir une preuve écrite de son existence ;<br />
mais seulement<br />
» Considérant qu'il s'agit dans la cause d'une société civile, d'autant plus<br />
que, précédant l'exploitation de la mine, elle n'avait pas pour objet la vente<br />
de ses produits, mais seulement les droils et les efforts qui, dans la pensée des<br />
intéressés, devaient conduire à l'exploitation de la mine;<br />
» Considérant que, dans une telle société, les droils des intéressés ne<br />
sont pas susceptibles d'être cédés, au regard de la société;<br />
» "Que si l'article 1861 du Code civil défend à l'associé d'introduire un tiers<br />
dans la société en l'associant à sa part, à plus forle raison lui défend-il de l'y<br />
introduire en lui cédant sa part tout entière; que de telles cessions peuvent<br />
avoir effet entre le cédant et le cessionnaire, mais à condition de n'en produire
9<br />
aucun envers les associés du cédant ; que la mort d|un associé dissout la so<br />
ciété, parce que l'héritier de l'associé ne peut s'introduire dans le fonction<br />
nement de la société; que par conséquent, im cession naire y peut encore<br />
moins pénétrer ;<br />
» Considérant que cette règle ne peut souffrir exception que lorsque les<br />
associés ont, par une convention nouvelle et unanime, modifié l'état de<br />
choses primitif et admis un cessionnaire comme membre nouveau de la société;<br />
» Considérant qu'il y a lieu d'apprécier, d'après ces principes, la situation<br />
particulière de chacune des parties en cause ;<br />
» En ce qui concerne Arrazat et Dameron :<br />
» Considérant qu'ils étaient membres de lo société primitive des cinq in<br />
venteurs qui demandaient à commencer immédiatement les travaux, aux<br />
frais des associés, et pour parvenir ultérieurement à une concession défini<br />
tive; que par conséquent, ces deux appelants ne peuvent être de bonne foi<br />
quand ils prétendent qu'ils ontpn attendre celte concession définitive, tandis<br />
qu'ils s'étaient précisément engagés à faire les choses qui devaient la précéder<br />
et la préparer,<br />
» Considérant que, si tout d'abord, Arrazat et Dameron ne s'étaient pas<br />
engagés envers leurs trois coïnventeurs à passer un acte authentique de so<br />
ciété, ils s'y sont engagés par la convention postérieure retenue à l'acte du 27<br />
septembre 1875; que sommés par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo de passer<br />
acte authentique de société, ils ont déclaré alors être prêls à le faire ; qu'il y a<br />
donc eu alors, quanta l'établissement d'un tel acte, sollicitation des uns et<br />
acceptation des autres, et qu'Arrazal et Dameron ont alors pleinement recon<br />
nu leur qualité actuelle d'associés ;<br />
» Que par conséquent, en refusaut leur concours aux travaux autorisés et<br />
aux dépenses qu'ils nécessitaient, Arrazat et Dameron ont méconnu leurs<br />
obligations ; qu'ils doivent être mis en demeure de les remplir, sous peine de<br />
la résolution des conventions dont elles dérivent ;<br />
Qu'<br />
» Arrazat et Dameron ne peuvent prétendre qu'on veut les contraindre<br />
à demeurer malgré eux en société, puisque le jugement attaqué leur donne<br />
précisément le choix entre l'exécution immédiate delà convention de soeiété<br />
et sa résolution ; qu'ils ne peuvent garder plus longtemps une situation in<br />
décise,<br />
ni se réserver les bénéfices éventuels d'une convention dont ils<br />
ont jusqu'ici répudié les charges ;<br />
«Considérant toutefois qu'en cas d'inexécution par Arrazat et Dameron du<br />
présent arrêt, il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de les<br />
déclarer déchus de tous droits sur la mine, ce qui comprendrait les droits<br />
qu'ils, peuvent tenir de l'invention de la mine et du permis d'exploration ;<br />
qu'il y aurait lieu seulement, dans ce cas, de déclarer résolues par leur faute<br />
les conventions intervenues entre eux et les trois autres inventeurs, sauf à<br />
ceux-ci à se pourvoir devant l'autorité administrative pour demander contre<br />
Arrazat et Dameron la déchéance de leurs- parts dans les droits d'inventeur ;<br />
- Considérant que c'est à tort que Dameron a demandé à être tiré des<br />
qualités en prétendant avoir cédé ses droits à Louis Lévy,<br />
aux termes d'un<br />
acte enregistré à Oran le 20 juillet 1875; que par cet acte, Dameron n'a<br />
cédé à Lévy qu'une part de ses droits, prétendant avoir cédé le reste à Gérard,<br />
ce qui n'est pas justifié ; qu'au surplus, ces cessions, faites par Dameron
10<br />
sans le consentement de se's associés, et même à leur insu, ne sauraient leur<br />
être opposées ; qu'en vain Dameron voudrait faire résulter l'approbation de<br />
ses associés de ce que ceux-ci ont donné mandat à Gérard pour cédera Lévy<br />
les 5 pour 100 de leurs propres parts; qu'il n'apparaît pas que la cession<br />
projetée des 5 pour 100 ait jamais été réalisée, et que Gonzalvès, Pascal et<br />
Gondolfo ont le droit de révoquer aujourd'hui le mandat qu'ils ont donné à<br />
cet effet; qu'il n'y aurait rien de commun entre la cession d'une fraction<br />
minime de leur propre part, faiteà Lévy par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo,<br />
et l'admission de Lévy dans la société primitive, au lieu et place de Dameron ;<br />
que Dameron a si bien senti qu'il ne pouvait opposer à ses associés la cession<br />
faite par lui à Lévy que, poslérieurement à celle cession,<br />
et dans l'acte au<br />
thentique du 27 septembre 1875, il s'est déclaré prêt à passer personnel<br />
lement acte de société ;<br />
» En ce concerne Gérard, considéré comme représentant de l'ancienne<br />
société Gérard et Seguela :<br />
» Considérant qu'il n'est pas l'un des inventeurs de la mine,<br />
et que le<br />
permis d'exploration ne le désigne que comme mandataire de ceux-ci ; que<br />
par conséquent, les droits qu'il peu! invoquer ne résulteraient que des con<br />
ventions intervenues ;<br />
» Qu'en effet, par l'acte du 14 octobre 1874, Gérard s'est fait céder les<br />
deux cinquièmes des parts de Gonzalvès, Pascal et Gondolfo ; qu'il a ainsi<br />
formellement reconnu l'existence de la légitimité de la société civile des in<br />
venteurs;<br />
qu'il l'a encore reconnue quand il a fait une demande à l'admi<br />
nistration en qualité de mandataire de cette sociélé ;<br />
» Considérant que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo, par le même acte, con<br />
fiaient à Gérard les intérêts et la direction de la société dans laquelle ils en<br />
tendaient l'introduire ; que celte volonté de leur part n'était pas opposable<br />
à Arrazat et à Dameron qui n'avaient pas concouru à l'acte ; mais que Ar<br />
razat et Dameron ont été sommés postérieurement de passer un acte de so<br />
ciété unique avec leurs coïnventeurs et Gérard ; qu'Arrazat, parlant tant<br />
pour lui-même que pour Dameron qui ne l'a pas désavoué, et a, au contraire,<br />
fait depuis cause commune avec lui, a déclaré, dans l'acte du 27 septembre<br />
1875, être prêt à passer cet acte de sociélé; qu'il résulte de ces faits que<br />
par consentement unanime des associés, Gérard a été introduit dans la so<br />
ciété primitive, où il devait prendre les deux cinquièmes des droils de Gon<br />
zalvès, Pascal et Gondalfo, aux termes de l'acte du 14 octobre 1874 ;<br />
Gérard avait<br />
» Que d'après ce même acte, et pour prix de son association,<br />
contracté l'obligation de passer avec ses associés acte authentique de société<br />
et de faire toutes les avances de fonds nécessaires aux travaux de la mine ;<br />
» Qu'il prétend aujourd'hui que l'exécution de celte obligation de sa part<br />
doit être ajournée jusqu'à la concession définitive de la mine; que cette in<br />
terprétation ne peut se soutenir en présence de la demande d'exploration<br />
adressée par Gérard à l'administration et dans laquelle il se déclarait respon<br />
sable des indemnités qui seraient dues pour travaux d'exploration, lesquels<br />
sont antérieurs à toute concession ;<br />
de<br />
» Qu'en effet, l'article 3 de l'acte du 14 octobre 1874 stipule qu'un acte<br />
société, interviendra pour constater que Gérard sera tenu de toutes les<br />
avances à faire pour les explorations; que par conséquent cet acte devait les
11<br />
précéder; qu'il est dès lors évident que le- mot d'exploitation contenu en<br />
l'article 6 du même acte, doit être entendu dans le sens d'exploration et non<br />
dans celui de concession définitive de la mine;<br />
• Considérant que malgré l'autorisation d'exploiter, événement accompli<br />
de la condition stipulée, Gérard s'est refusé à passer acte de société et à faire<br />
les avances promises ;<br />
» Qu'il objecte encore que l'arrêté d'exploration est frappé d'un pourvoi<br />
devant le Conseil d'Étal; que ce pourvoi n'étant pas suspensif, n'a pu para<br />
lyser les effets de l'arrêté ;<br />
» Que Gérard objecte enfin que la demande de ses adversaires est dénuée<br />
d'intérêt .parce<br />
que<br />
le permis d'exploration, accordé pour deux ans, est<br />
actuellement périmé ; qu'il ne faut pas apprécier la situation des choses à<br />
l'heure de l'arrêt, mais à celle de l'introduction de l'instance; qu'alors le<br />
permis était loin d'être périmé, et que quatre mois après la délivrance de<br />
cette autorisation, Gérard a été sommé sans succès de passer acte de société ;<br />
» Considérant que malgré la péremption actuelle du permis d'exploiter, la<br />
constitution de la sociélé par acte authentique, a encore son intérêt au point<br />
de vue de l'obtention de la concession de la mine ; qu'une sociélé établie<br />
sur des bases incontestables sera plus favorablement traitée par l'administra<br />
tion qu'une société qui pourrait paraître incertaine ou litigieuse ;<br />
» Qu'ainsi c'çst à bon droit que Gérard ès-noms a été placé entre l'accom<br />
plissement immédiat de ses obligations et la résolution des conventions avec<br />
perte de tous ses droits sur la mine ;<br />
» Considérant que la résolution des conventions emporterait la révocation<br />
du mandat reçu par Gérard, qui alors serait tenu d'en rendre compte sous les<br />
peines de droit ;<br />
» En ce qui touche Hernandez :<br />
» Considérant qu'il se présenle, aux termes de l'acte du 4 janvier 1876,<br />
comme introduit dans la société par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo; que cet<br />
acte intervenu sans la participation ni l'approbation d'Arrazal, Dameron et<br />
Gérard, ne leur est pas opposable ;<br />
» En ce qui concerne Perez, Novarro, Tortoza et Enton :<br />
■> Considérant qu'ils se présentent, aux termes de l'acte du 6 juillet 1876,<br />
comme cessionnaires de Seguela ; qu'aux termes de cet acte, Seguela ne leur<br />
a pas cédé les droits qu'il pouvait avoir dans la mine comme ancien membre<br />
de la société Gérard et Seguela ; qu'il leur a cédé seulement les droits nou<br />
veaux que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo lui auraient conférés en même<br />
temps qu'à Hernandez par acle précité du 4 janvier 1876, qui n'est pas oppo<br />
sable à Dameron, Arrazat et Gérard ;<br />
» Sur la demande de la nomination d'un gérant, formulée par les appe<br />
lants :<br />
» Considérant qu'elle devient sans objet en présence des solutions de l'arrêt<br />
qui doit assurer le fonctionnement normal et immédiat de la société inter<br />
venue entre les parties, ou la résolution de cette convention;<br />
» Sur les dépens ;<br />
» Considérant que l'adjonction dans le procès, à Gonzalvès, Pascal et Gon<br />
dolfo, de leurs cessionnaires, n'a occasionné aucuns frais particuliers, mais<br />
qu'elle a pu, dans une certaine mesure, déterminer les appelants à prolonger
12<br />
leur résistance ; mais qu'il faut bien remarquer que les cessions ont été dé<br />
terminées par la nécessité de se procurer les fonds que Gérard refusait injus<br />
tement d'avancer;<br />
» Considérant que la résistance de Gérard a été la cause principale du<br />
procès; que si Dameron et Arrazat ont, eux aussi, méconnu leurs obligations,<br />
ils ont cependant, à un moment donné, déclaré être prêts A passer acte de<br />
société;<br />
» Par ces motifs,<br />
• Reçoit en la forme Gérard, Arrazat et Dameron, opposants à l'arrêt par<br />
défaut du 7 mars 1877 et au fond :<br />
» Réformant partiellement le jugement dont appel,<br />
» Déclare Hernandez, Perez, Novarro, Torloza et Enton non recevables et<br />
mal fondés dans leurs demandes et les en déboute ;<br />
• Dit que dans les (rois jours de la signification de l'arrêt et de la réquisi-<br />
sition de Gonzalvès, Pascal et Gondolfo; Arrazal, Dameron et Gérard seront<br />
tenus de passer, avec les trois premiers, acte authentique de société pour les<br />
travaux d'exploration de la mine des Beni-Zarouat, et pour parvenir à<br />
l'exploitation de ladite mine ;<br />
» Dit que les droits actuels ou éventuels sur cette mine seront, par l'acte<br />
de société à intervenir, attribués cinq vingt-cinquièmes à Arrazat, cinq vingt-<br />
cinquièmes à Dameron, trois vingt-cinquièmes à GonzalvèSj^ trois vingt-<br />
cinquièmes à Pascal, trois vingt-cinquièmes à Gondolfo, et six vingt-cin<br />
quièmes à Gérard comme représentant l'ancienne société-Gérard et Seguela ;<br />
» Dit que les obligations de Gérard ès-noms envers la société seront éta<br />
blies dans l'acte à intervenir, conformément à l'acte du 14 octobre 1874,<br />
interprété au besoin par le présent arrêt;<br />
» Dit que, par le seul fait de l'expiralion du délai ci-dessus, sans que<br />
l'acte de société ait été établi conformément au présent arrêt, Gérard ès-noms<br />
sera déchu de tous droits quelconques sur les mines ; et, pour ce cas,<br />
confirme dès à présent toutes les condamnations prononcées contre lui par<br />
les premiers juges, sauf ce qui sera dit quant aux dépens ;<br />
» Dit que, par le, seul fait de l'expiration du délai ci-dessus, sans établis<br />
sement de l'acte de société, toutes conventions entre Gonzalvès, Pascal et<br />
Gondolfo, relativement à la mine, avec Arrazat et Dameron, seront de plein<br />
droit résiliées pour inexécution de la part de ces derniers ;<br />
■ Réserve, dans ce cas, à Gonzalvès, Pascal et Gondolfo de se pourvoir de<br />
vant l'autorité administrative, pour demander contre Arrazat et Dameron la<br />
déchéance des droits que ceux-ci pourraient avoir sur la mine, en dehors<br />
des conventions intervenues;<br />
» Réserve, en tout cas, à Gérard et à Seguela les droits qu'ils pourront<br />
avoir l'un contre l'autre, par suite du présent arrêt;<br />
» Réserve aux cessionnaires écartés par le présent arrêt, leurs droits contre<br />
leurs cédants ;<br />
» Déclare les parties non recevables et mal fondées dans leurs autres de<br />
mandes, fins et conclusions ;<br />
» Ordonne la restitution de l'amende ;<br />
» Condamne Gérard, Arrazat et Dameron, par tiers,<br />
par l'arrêt de défaut ;<br />
aux frais occasionnés
J13<br />
• Ordonne qu'il sera fait masse des autres dépens de première instance et<br />
d'appel. »<br />
M. Piette, av. gén.; Me8 Chéronnet et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. DUMALLE, conseiller.<br />
23 novembre 1877.<br />
Juridiction correctionnelle. — — Incompétence.<br />
de paix à compétence étendue.<br />
Justices<br />
Lorsqu'un délit rentre, en vertu des termes du décret du 22 novembre 1854,<br />
dans ceux dont ce décret attribue la connaissance auxjuges de paix à compé<br />
tence étendue,<br />
c'est à tort que le tribunal correctionnel en est directement<br />
saisi : il ne pouvait l'être que sur appel d'une décision du juge de paix.<br />
Toutefois, quand le prévenu, cité ainsi d'une manière irrégulière, n'a soulevé<br />
aucune exception tendant au renvoi et qu'il a été par lui défendu au fond, il<br />
n'est pas recevable à demander ensuite à la Cour, sur appel formé par lui,<br />
son renvoi devant lejuge de paix, seul compétent comme premier juge.<br />
Il y a lieu, pour la Cour, d'appliquer dans ce cas, par analogie, les dispo<br />
sitions de l'art. 192 du Code d'instruction criminelle et de décider que le<br />
tribunal correctionnel a statué en dernier ressort, comme s'il eût été juge<br />
d'appel, et de déclarer non recevables,<br />
celui du prévenu (\).<br />
Ministère public c. Fulgoux.<br />
tant l'appel du ministère public que<br />
Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par Fulgoux est basée<br />
sur les dispositions du décret du 22 novembre 1854, décret spécial à l'Algérie<br />
et qui attribue aux tribunaux de police des justices de paix à compétence<br />
étendue, la connaissance, au premier degré, de tous délits n'emportant pas<br />
une peine supérieure à six mois d'emprisonnement ou cinq cenls francs<br />
—<br />
d'amende; Que, dans l'espèce, s'agissant du délit prévu et puni par l'art.<br />
224 du Code pénal et la peine encourue étant inférieure au taux de la com<br />
pétence du juge de paix de Bordj-bou-Arrérklj, c'est à tort que le tribunal<br />
—<br />
— de Sétif a été directement saisi ; Qu'il ne pouvait l'être que sur appel ;<br />
(1) Cette décision,<br />
contraire à un précédent arrêt de la Cour d'Alger du 12<br />
juin 1873 (Robe, 1874, p. 140), nous paraît conforme aux raisons d'utilité pra<br />
tique sur lesquelles est basé le décret du 22 novembre 1854, et que nous avons<br />
exposées dans le Bulletin judieiaire, année 1877, p. 1 et 65. V. M.
14<br />
Considérant qu'il est constant en fait que Fulgoux n'a soulevé devant le<br />
tribunal correctionnel aucune exception tendant à renvoi, qu'il a été par<br />
— lui défendu au fond ; Considérant qu'aux termes de l'art, 192 du Code<br />
d'instruction criminelle, la juridiction correctionnelle est compétente pour<br />
connaître des contraventions qui ont été portées devant elle, par erreur de<br />
la citation, lorsque le renvoi n'est pas demandé par les parties; —<br />
le cas de faire à la cause l'application de ces principes;<br />
— Qu'on<br />
Que<br />
c'est<br />
exciperait<br />
en vaiu des termes mêmes de l'article 192 pour soutenir que cet article, ne<br />
— visant que des contraventions, ne saurait être applicable; Que l'article<br />
192, en effet, a pour objet d'attribuer, dans des cas déterminés, aux tribu<br />
naux correctionnels, la connaissance de tous faits susceptibles d'appel, de la<br />
compétence des tribunaux de police;<br />
— Que<br />
cette disposition étant générale,<br />
et les raisons qui ont fait édicter les principes de l'article 192 tenant à un<br />
intérêt de juridiction, il faudrait nécessairement, pour soustraire aux règles<br />
de compétence générale les faits nouveaux attribués aux tribunaux de police<br />
pour extension de leur compétence, une exception non écrite dans le décret<br />
du 22 novembre 1854, exception qui peut d'autant moins être suppléée<br />
— qu'elle irait contre le but même que l'article "192 s'est proposé; Que c'est<br />
donc à bon droit que le tribunal de Sétif a retenuMes faits qui lui étaient<br />
déférés,<br />
pas demandé;<br />
alors que le renvoi devant la juridiction du premier degré n'était<br />
— En<br />
ce qui touche l'appel à minima du Ministère public :<br />
Considérant que le tribunal correctionnel, saisi directement du délit de l'ar<br />
ticle 224 du Code pénal, n'a pas exercé une juridiction plus étendue que<br />
celle qu'il aurait exercée si la juridiction avait, aux termes du décret du 22<br />
novembre 1854, été portée au premier degré devant le tribunal de simple<br />
police, et, sur appel, devant le tribunal correctionnel —<br />
; Que c'est, en effet,<br />
en vertu de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, que le tribunal a<br />
connu des faits qui lui étaient déférés, et non comme tribunal correctionnel<br />
en présence d'un délit rentrant au premier degré dans la compétence géné<br />
rale;<br />
— Qu'il<br />
y a donc lieu, aux termes de l'article 192, de déclarer le ju<br />
gement rendu en dernier ressort ;<br />
Par ces motifs : Rejette l'exception d'incompétence; Dit n'y avoir lieu à<br />
renvoi; Déboute le Ministère public de son appel à minima; Condamne Ful<br />
goux en tous les dépens.<br />
M. Sauzède, Cons, rapp.; M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén.',<br />
Me Mallarmé, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décrets eu date du 20 décembre 1877, ont été nommés :<br />
Procureur de la République près le tribunal de première instance de Sétif,<br />
M. Gasquy, substitut du procureur de la République près le siège d'Alger<br />
en remplacement de M. Angéli, démissionnaire.<br />
Substitut du procureur de la République près le tribunal depremière ins-
15<br />
tance d'Alger, M. Parizot, substitut du procureur de la République près le<br />
siège de Constantine, en remplacement de M. Gasquy, qui est nommé procu<br />
reur de la République.<br />
Substitut du procureur de la République près le tribunal de première<br />
instance de Constantine, M, Fondi de Niort,<br />
substitut du procureur de la<br />
République près le siège de Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Parizot,<br />
qui est nommé substitut du procureur de la République à Alger.<br />
Substitut du procureur de la République près le tribunal de première ins<br />
tance de Tizi-Ouzou, M. Gauvenet, dit Dijon, juge de paix de Miliana, en<br />
remplacement de M. Fondi de Niort, qui est nommé substitut du procureur<br />
de la République près le siège de Constantine.<br />
Juge de paix de Miliana, M. Robert, juge de paix de Jemmapes, en rem<br />
placement de M. Gauvenet, dit Dijon, qui est nommé substitut dn procureur<br />
de la République près le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou.<br />
Juge de paix de Jemmapes, M. Régnier, juge de paix de Collo, en rem<br />
placement de M. Robert, qui est nommé juge de paix à Miliana.<br />
Juge de paix de Collo, M. Millarl,<br />
d'Akbou, en remplacement de M. Régnier,<br />
Jemmapes.<br />
suppléant rétribué du juge de paix<br />
qui est nommé juge de paix à<br />
Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou, M. Angeli (Anloine-François-<br />
Louis-<br />
Gustave), avocat, en remplacement de M. Millart, qui est nommé juge<br />
de paix.<br />
Juge de paix de Biskra, M. Madaune, suppléant rétribué du juge de paix de<br />
Guelma, en remplacement de M. Dubois, démissionaire.<br />
Juge de paix de Djelfa, M. Dudouit, suppléant rétribué du juge de paix de<br />
en remplacement de M. Depieds.<br />
Mascara,<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Mascara, M. Cochard, Louis, avocat,<br />
docteur en droit, en remplacement de M. Dudouit, qui est nommé juge de<br />
paix.<br />
Compétence. —<br />
Juge<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
de paix. — — Bornage.<br />
Les<br />
juges de paix, compé<br />
tents pour connaître des actions en bornage cessent de l'être, lorsque pendant<br />
le cours de l'instance, il s'élève une contestation sur le droit de propriété des<br />
terrains à délimiter ou sur les titres qui l'établissent (L. 25 mai 1838, art. 6,<br />
g 2 ; C. pr. civ. 7). —<br />
L'incompétence du juge de paix sur une question<br />
de cette nature est radicale, et ne peut être couverte par le consentement des<br />
—<br />
à ce que sa juridiction soit prorogée sur ce point. Civ. 20<br />
Cass.<br />
parties,<br />
juin 1877 (D. P. 77, 1,392).
Surenchère. —<br />
Délai. —<br />
16<br />
Le droit de surenchère n'est ouvert aux créan<br />
ciers inscrits sur un immeuble vendu que du jour ou le nouveau propriétai-^<br />
re a fait les notifications prescrites par l'art. 2183, C. civ. —<br />
1876 (D. P. 77, 2, 170). —<br />
Jour férié. —<br />
Prorogation.<br />
V.<br />
—<br />
Dijon,<br />
Cass. 17 août 1869 (D. P, 69, 1, 464).<br />
Saisie<br />
immobilière. —<br />
dernier paragraphe de l'art. 1033, C. pr. civ.,<br />
La<br />
16 mai<br />
disposition du<br />
aux termes de laquelle si le<br />
dernier jour du délai est un jour férié le délai doit être prolongé au lende<br />
main, est général, et s'applique à tous les actes de procédure faits à person<br />
— ne ou domicile ; En conséquence, si le dixième jour du délai accordé par<br />
l'art. 731, C. pr. civ., pour interjeter appel d'un jugement ayant statué sur<br />
un incident de saisie immobilière, est un jour férié, l'appel peut être vala<br />
blement formé le onzièmejour (C. pr. civ., 731, 1033). —Cass. Civ. 13 juin<br />
1877 (D. P. 77, 1,440).<br />
Assistance judiciaire .<br />
— — Compétence.<br />
Le tribunal saisi est incompé<br />
tent et doit renvoyer devant le bureau de l'assistance judiciaire, qui seul<br />
doit statuer sur les conclusions d'un défendeur tendantes à retirer le bénéfi<br />
ce de l'assistance judiciaire au demandeur, qui s'est fait à tort passer pour<br />
indigent pour obtenir cette faveur. —<br />
(Gaz. des trib. du 6 oct. 1877) .<br />
Trib.<br />
Diffamation.— Directeur de chemin de fer. —<br />
de la Seine,<br />
Preuve.<br />
—<br />
5eCh. 29 août 1877<br />
Le<br />
directeur<br />
d'une compagnie de chemins de fer doil être considéré, dans l'exercice de ses<br />
fonctions, comme agissant dans un caractère public. En conséquence, il y a<br />
lieu d'admettre la preuve des faits diffamatoires qui lui sont imputés. —<br />
Roche-sur- Yon, l^oct. 1877 (Gaz. des Trib. du 5 octobre).<br />
Timbre-quittance. —<br />
Interprétation<br />
de la loi du 23 août 1871 .<br />
— La<br />
quit<br />
tance même signée, portant décharge partielle au totale, tant qu'elle reste<br />
entre les mains du créancier, n'a pas besoin d'être revêtue du timbre de 10<br />
entimes. — Trib.<br />
octobre^! 877).<br />
de la Seine, 2« Ch., 22 juin 1877 (Gaz. des Trib. du 10<br />
L'Ordre des avocats a nommé, mardi, 8 janvier, M. BAUDRAND, avocat,<br />
membre du Conseil de l'Ordre, en remplacement de M. Vuillermoz, décédé.<br />
Alger. — Typ. A. Jo»hd*h.
2e année. — 16<br />
Janvier 1878. —<br />
N° 26<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE.<br />
-<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lreCh.)<br />
LEGISLATION<br />
Présidence de M. VOLLON, conseiller.<br />
25 juin 1877.<br />
Référé. — Exécution de jugement. —<br />
"Vente<br />
de l'industrie<br />
et de l'exploitation d'un journal. — Urgence.<br />
S'il est vrai qu'unjugement ne puisse être mis à exécution qu'un jour après<br />
la signification du commandement, on n'en doit pas moins considérer comme<br />
valable l'assignation en référé donnée te lendemain de ce commandement et<br />
ayant pour objet de faire déterminer par le juge de référé un moyen non<br />
prévu par la loi d'arriver à l'exécution de ce jugement : cette assignation en<br />
référé n'a, en effet, pour but que de.préparer cette exécution, mais elle ne cons<br />
titue pas par elle-même un moyen d'exécution.<br />
Le juge de référé n'est compétent en ce qui concerne une difficulté pour<br />
l'exécution d'un jugement, que lorsque cette difficulté se présente comme un<br />
obstacle opposé par le saisi ou un tiers à cette exécution, et sous la condition<br />
que la décision ne soit rendue qu'au provisoire .<br />
Il ne saurait donc être compétemment appelé à régler une difficulté d'une<br />
importance sérieuse, ne présentant nullement un caractère provisoire, décou -<br />
lanl de l'affaire elle-même, et ne constituant pas un obstacle opposé par le<br />
débiteur ou un tiers à l'exécution du jugement.<br />
nal,<br />
Il en est ainsi notamment lorsque le débiteur étant propriétaire d'un jour<br />
il s'agit de fixer le mode à employer pour opérer la vente de l'exploitation<br />
de ce journal.<br />
En présence du silence du Code sur cette question spéciale et du caractère<br />
de la difficulté à résoudre, c'est au tribunal d'exécution ayant plénitude de<br />
juridiction et non au juge de référé, qu'il appartient de statuer.<br />
Il en doit être surtout ainsi lorsque l'affaire, considérée sous son vraijour, ne comporte aucune urgence réelle.<br />
Pontus de Montlouis c. Aillaud et Cie.<br />
Attendu que Pontus de Montlonis a allégué à l'appui de son appel de l'or<br />
donnance de référé que, élant acceplé sans conteste que le jugement dont<br />
s'agit ne pouvait être mis à exécution qu'un jour après le commandement, et<br />
ce commandement ayant été fait à la date du 28 mai dernier, l'assignation en<br />
référé en date du 29, même mois, qui ne pouvait être acceptée que comme un<br />
acte d'exécution, se trouvait entachée, de nullité, ce qui entraînait la nullité
18-<br />
-- de l'instance ; Qu'il a prétendu en outre, que le juge de référé était incom<br />
pétent, soit parce qu'il ne s'agissait pas, dans le sens de fa loi, de difficultés<br />
relatives à l'exécution d'un jugement, soit parce qu'il n'y avait pas urgence<br />
à décider;<br />
Attendu que l'assignation en référé avait pour but uniquement de préparer<br />
l'exécution du jugement, en faisant déterminer par le juge les moyens qu'il<br />
y avait à employer dans un cas évidemment non prévu par la loi, pour y<br />
— parvenir ; Mais qu'il ne s'agissait nullement de procéder à l'exécution<br />
— elle-même ; Que sous ce rapport, l'exploit d'assignation ne peut être cri<br />
— tiqué ; Que le moyen proposé doit être rejeté ;<br />
Mais attendu que le juge de référé n'est compétent qu'au cas où la diffi<br />
culté se présente comme un obstacle opposé par le saisi ou un tiers à l'exécu<br />
tion du jugement et sous l'obligation que la décision ne soit rendue qu'au<br />
provisoire ;<br />
— Attendu qu'au cas dont il s'agit, aucun obstacle n'était opposé<br />
—<br />
par Pontus de Montlouis ou un tiers à l'exécution du jugement ; Qu'il y<br />
avait à régler en réalité le mode à employer pour opérer la vente de l'ex<br />
ploitation du journal ;<br />
— Qu'il<br />
n'est point douteux que le Code ne s'est pas<br />
expliqué sur la manière de vendre des droits incorporels et tout spécialement<br />
—<br />
pour la vente de l'industrie et de l'exploitation d'un journal ; Mais que<br />
dès lors qu'il y avait à s'adresser au juge pour régler cette difficulté, dont<br />
l'importance ne saurait être méconnue et qui ne présentait nullement un<br />
caractère de provisoire, c'était au tribunal d'exécution, ayant plénitude de<br />
juridiction, qu'il appartenait dé prononcer en pareille matière —<br />
; Attendu<br />
de plus que l'affaire considérée sous son vrai jour, ne comportait aucune<br />
urgence ;<br />
— Qu'il<br />
n'y avait aucun péril à suivre la voie ordinaire,<br />
et que se<br />
présentant le cas de célérité seulement, les délais pouvaient être abrégés<br />
suffisamment pour arriver à une prompte solution ;<br />
était incompétent.<br />
— Que<br />
le jugé de référé<br />
— Par ces motifs : Déclarant l'appel régulier, recevable en la forme ; Au<br />
fond, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué, mais admetlant le moyen<br />
— tiré de l'incompétence du juge ; Réforme<br />
l'ordonnance du juge de référé,<br />
— dit qu'elle a été rendue incompétemment ; L'annule et renvoie les parties<br />
à se pourvoir comme elles aviseront. Condamne Aillaud et compagnie aux<br />
dépens de l'instance d'appel, elc—<br />
M. Piette, av. gén. ; M«s Dazinière et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
24 décembre 1877.<br />
premier président.<br />
Algérie. — Expropriation pour cause d'utilité publique. —<br />
Appel. — Recevabilité. —<br />
cuter, à défaut en argent.<br />
Indemnité fixée en travaux à exé<br />
D'après l'art. 45 de l'ordonnance du 1« octobre 1844, spéciale à l'Algérie
19<br />
les jugements des tribunaux civils, rendus en matière d'expropriation pour<br />
cause d'utilité publique, sont souverains et sans appel en ce qui concerne la<br />
fixation du montant de l'indemnité .<br />
Cette règle ne cesse point de recevoir application lorsque le tribunal, dans la<br />
fixation d'une indemnité d'expropriation à payer par une Compagnie de che<br />
mins de fer, a compris une certaine somme pour le cas où la Compagnie au<br />
.profit de laquelle l'expropriation a eu lieu, n'établirait pas certains travaux,<br />
jugés indispensables pour éviter une dépréciation générale de la propriété.<br />
En effet, si le tribunal, dans ce cas, a pris en considération l'établissement<br />
de certains travaux pour atténuer le chiffre de l'indemnité, il n'est pas en cela<br />
sorti de cette sphère d'attributions où il apprécie souverainement et qui a trait<br />
à la fixation de l'indemnité .<br />
L'appel dirigé contre une telle décision doit donc être repoussé comme irre<br />
cevable .<br />
Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. c. Hubert de Ste-Croix.<br />
Attendu qu'à la suite d'un arrêt d'expropriation pour cause d'utilité pu<br />
blique, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée<br />
a fait notifier au sieur Hubert de Sle-Croix des offres pour indemnité ;<br />
Que ces offres ayant été refusées, la Compagnie a assigné l'intimé pour en<br />
— voir prononcer la validité ou fixer toute autre indemnité; Que par juge<br />
ment du 28 mars 1877, le tribunal de Philippeville a condamné la Compagnie<br />
de Paris-à Lyon et à la Méditerranée à payer à Hubert de Ste-Croix la somme<br />
de 2,474 fr. 18 c. pour valeur des parcelles expropriées et récoltes, et en<br />
outre une somme de 20,000 francs pour le cas où la Compagnie n'établirait<br />
pas certains travaux, jugés indispensables pour éviter une dépréciation gé<br />
— nérale de la propriété ; Que sur l'appel interjeté par la Compagnie, l'in<br />
timé oppose une fin de non-recevoir qu'il convient tout d'abord d'examiner;<br />
— Attendu<br />
que l'exproprialion pour cause d'nlililé publique est régie, en<br />
Algérie,<br />
octobre 1844 ;<br />
par une législation spéciale el notamment par l'ordonnance du 1er<br />
— Qu'aux<br />
termes de l'article 45 de cette ordonnance, les dé<br />
cisions des tribunaux de première instance, rendues en cette malière, sont<br />
souveraines et sans appel en ce qui concerne la fixation du montant de l'in<br />
demnité;<br />
— Attendu<br />
que, si celte disposition exceptionnelle, puisqu'elle<br />
supprime une voie de recours de droit commun, ne doit pas être étendue à<br />
des points étrangers à la fixation de l'indemnité, à la solution de difficultés<br />
de droit ou de questions de procédure, elle doit, du moins, conserver toute<br />
son efficacité en ne laissant pas subir l'épreuve d'un second degré de juri<br />
— diction à un litige qui ne porterait que sur l'indemnité ; Attendu que la<br />
procédure intentée, les termes de l'exploit introduclif d'instance, les mé<br />
moires des parties, les motifs et les dispositions du jugement, démontrent<br />
que la décision des premiers juges n'a vraiment trait qu'à la fixation de l'in-<br />
. »<br />
(1) Voir dans le Répert. de Narbonne, \» Expropriation pour cause d'utilité pu<br />
blique, nos 29 et suiv., la jurisprudence relative aux voies de recours contre les<br />
jugements rendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
—<br />
■
demnité ;<br />
— Qu'à<br />
20<br />
la vérité le tribunal a pris en considération l'établissement<br />
de certains travaux pour atténuer le chiffre de l'indemnité,<br />
mais qu'en cela<br />
même il n'est pas sorti de cette sphère d'attributions où il apprécie souve<br />
—<br />
rainement ; Qu'il importe, en effet, de constaler que les premiers juges<br />
cqn-<br />
ont maintenu à l'indemnité son caractère pécuniaire, qu'ils n'ont pas<br />
damné directement la Compagnie à l'exécution des travaux, mais qu'ils se<br />
sont bornés à réserver à la Compagnie une faculté pour se rédimer d'une<br />
partie de l'indemnité ;<br />
—<br />
Attendu, dès lors,<br />
que c'est le cas de faire appli<br />
cation à l'espèce de l'art. 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844;<br />
Par ces motifs : la Cour rejette l'appel comme irrecevable et condamne la<br />
Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à<br />
l'amende et aux dépens.<br />
Preuve testimoniale. —<br />
M. Piette, av. gén,; Mes Robe et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2">« Ch.)<br />
Présidence de M. JOUSSEUME, conseiller.<br />
Consentement<br />
26 octobre 1877.<br />
des parties en dehors<br />
des cas prévus par la loi.<br />
La preuve testimoniale peut être ordonnée en dehors des cas prévus par la<br />
loi, lorsque la partie contre laquelle elle est offerte, y consent .<br />
Ce -consentement rend la partie qui a offert la preuve non recevdble à atta<br />
quer le jugement qui l'a ordonnée et qui a ainsi prononcé implicitement l'ad<br />
mission de la preuve contraire (1).<br />
(1) L'art. 1343 du Code civil est ainsi conçu : « Celui qui, a formé une demande<br />
excédant 150 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en<br />
restreignant sa demande primitive. » Nettement et formellement exprimé, ce<br />
principe posé dans l'art. 1343, rigoureusement resserré, dans son application, par<br />
les art. 1341, 1342, 1344, 1345 et 1346, ne doit recevoir d'exceptions, dit le législa<br />
teur, que dans les cas déterminés par la loi ; et le Code prend soin de spécifier un<br />
à un ces cas exceptionnels, dans les art. 1347 et 1348.<br />
En présence de pareilles précautions restrictives, les plaideurs peuventils,<br />
bien<br />
qu'ils ne se trouvent dans aucune des conditions prévues, être admis à faire une<br />
preuve testimoniale ? En d'autres termes, la règle de l'art. 1343 est-elle absolue ?<br />
N'est-elle au contraire que facultative, et est-il permis de la négliger selon le gré<br />
ou même l'inadvertance des parties ?<br />
Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés dans des sens différents,<br />
Mais il faut reconnaître que la solution adoptée par la Cour dans l'arrêt ci- dessus<br />
rapporté,<br />
Cependant,<br />
paraît prévaloir.<br />
nous ne croyons pas que cette décision soit conforme aux véritables<br />
principes. A notre avis, la règle contenue dans l'art. 1343 est d'ordre public, in-
21<br />
Perron c. Perron.<br />
ARRÊT :<br />
Attendu, en ce qui concerne le cheval et la charrue numéros un et deux,<br />
dont la veuve Perron fils demande la reslitulion ou le prix, que celle der<br />
nière justifie qu'ils ont été achetés et payés par le sieur Perron fils, son<br />
mari;<br />
— Attendu<br />
que la veuve Perron fils justifie, en outre,<br />
que son dit<br />
mari a payé pour le comple de son père, le sieur Perron : premièrement,<br />
au sieur Cordier, la somme de douze cent trente francs; deuxièmement, au<br />
sieur Falgueretle, celle de cent francs;<br />
— Attendu<br />
que le sieur Perron père<br />
ne nie pas ces divers paiements', mais qu'il prétend que c'est avec ses -de<br />
—<br />
niers, à lui Perron père, que son fils les a faits; Attendu que le sieur<br />
—<br />
Perron père ne fait aucune justification à l'appui de celle allégation ;<br />
Qu'il n'existe, d'autre part, au procès, ni fait, ni document qui puisse faire<br />
présumer que celle allégation est vraie, tandis qu'il y a présomption légale<br />
que c'est de ses propres deniers que Perron fils a fait les paiements dont il<br />
s'agit;<br />
- En<br />
ce qui concerne : 1° les meubles (numéro 3), 2° la somme de<br />
deux mille francs, moitié de la récolte de 1876, réclamés par la veuve Perron<br />
flexible,<br />
et à laquelle il n'est nullement facultatif de se soustraire ou d'obéir. Et<br />
si, malgré leur précision formelle, les termes du Code civil pouvaient nous laisser<br />
quelques doutes, notre hésitation se dissiperait devant les origines do la disposi<br />
tion qui nous occupe. La prohibition de<br />
la'<br />
preuve testimoniale remonte à l'ordon<br />
nance de Moulins, de février 1566, qui porte que : « Pour obvier à multiplication<br />
» de faits que l'on a vu ci-devant estre mis en avant en jugement sujets à preuve<br />
» de témoins et repprocho d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et<br />
» involutions de procès, » aucune preuve par témoins ne sera reçue « de toutes<br />
» choses excédans la somme- ou valeur de cent livres pour une fois payer. ...»<br />
Les raisons d'ordre public qui ont déterminé le législateur de 1566 subsistaient à<br />
l'époque de. la rédaction du Code. Elles existent sans doute aujourd'hui. Qui mieux<br />
abreuve, mieux preuve. Cet adage rapporté par Loisel n'a-t-il pas l'air d'être fait<br />
pour nous ?<br />
Mais, pourrait-on objecter, il n'y a pas lieu de se préoccuper du motif de la cor<br />
ruption des témoins,<br />
puisque la partie adverse les accepte. Il n'en resterait pas<br />
moins le danger de la « multiplication des procès. »<br />
Ce second et puissant motif ne paraît pas suffisant à M. Edouard Bonnier, qui,<br />
dans son Traité des preuves, édition, I, 218, s'exprime de- la façon suivante:<br />
;. La doctrine de l'exclusion absolue permettrait au défendeur d'obtempérer en ap<br />
parence à une enquête frustatoire, en se réservant la faculté de l'attaquer, si elle<br />
lui était défavorable, et de tout remettre en question. Or, c'est là précisément<br />
retomber dans ces involutions de procédures que l'on cherchait par-dessus tout<br />
à éviter. »<br />
Nous nous trompons fort,<br />
ou cet argument se retourne directement contre le<br />
système soutenu par M Edouard Bonnier, en même temps qu'il renforce celui<br />
de l'exclusion absolue. Qu'est-ce qui empêche, en effet, d'attaquer une enquête,<br />
ne paraît-il pas que les involutions de procès<br />
—<br />
qu'on l'ait ou non acceptée ? Or<br />
que le législateur a voulu éviter,<br />
seraient diminuées d'autant, si, en rejetant les<br />
offres de preuve produites en dehors des cas prévus par la loi, les tribunaux sup<br />
primaient ainsi les occasions qu'ils donnent en accueillant ce moyen, d'augmenter<br />
le nombre et la durée des procès ? H . N.
fils;<br />
22<br />
— Attendu que la veuve Perron fils, ayant été admise par le jugement<br />
attaqué, confirmé sur ce chef par l'arrêt de défaut du 1« juin 1877, à la<br />
preuve de la demande relativement auxdils meubles et à l'existence d'Une<br />
association entre Perron père et Perron fils, son mari, Perron père prétend<br />
aujourd'hui que cette preuve, étant inadmissible, ne pouvait être ordonnée;<br />
— Attendu que la preuve testimoniale peut être ordonnée hors des cas permis<br />
par la loi, alors que la partie contre laquelle la preuve est offerte y consent;<br />
Que ce consentement rend celle partie non recevable à attaquer le jugement<br />
— qui a ordonné la preuve ; Attendu q-u'il constate des conclusions prises en<br />
première instance par la veuve Perron fils, qu'elle n'a point offert de preuve<br />
à l'appui des fins de sa demande ; Que, loin de là, elle a conclu à ce qu'elles<br />
lui fussent adjugées comme étant d'ores et déjà justifiées ; Que e'est Perron<br />
père qui a offert de prouver que la veuve Perron fils avait emporté ses meubles<br />
et, d'autre part, qu'il n'avait pas existé d'association entre son fils et lui;<br />
sur quoi, le tribunal a admis la veuve Perron fils à la preuve dont il s'agit,<br />
—<br />
en réservant la preuve contraire; Attendu que Perron père, en offrant la<br />
preuve qu'il a offerte, ne pouvait ignorer que l'admission de son offre en<br />
preuve entraînait de droit celle de la preuve contraire ; Qu'il a donc consenti<br />
implicitement à ce que cette preuve fût ordonnée; Qu'on doit même dire<br />
qu'il l'a demandée ; Qu'il est donc irrecevable à attaquer sur ce chef le juge<br />
ment entrepris et l'arrêt de défaut qui a confirmé ce jugement ;<br />
dès lors, qu'il y a lieu de rejeler, comme non fondée, l'opposition à l'arrêt<br />
— Atlendu,<br />
de défaut du 1er — juin 1877 et de confirmer ledit arrêt; Attendu que les<br />
— dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; Par ces<br />
motifs. . .<br />
M. Fau, Subsl. du Proc. gén.; M«=s F. Huré cIChéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.),<br />
Présidence de M. RASTIEN, président.<br />
18 mai 1877.<br />
Indigènes musulmans. — Détention de munitions de guerre.<br />
Circonstances de fait.<br />
Le délit particulier, spécial à l'Algérie et à ses indigènes, créé par le décret<br />
du 12 décembre 1851 , n'a pas été supprimé par le décret du 4 septembre 1870<br />
relatif au commerce des armes ; ce dernier s'adressait seulement aux habitants<br />
non indigènes de l'Algérie et suspendait à leur égard les dispositions de la loi<br />
du 24 mai 1834.<br />
Mais en tout cas, en admettant que le décret eût été paralysé un ms-<br />
tant par le décret de 1870, l'abrogation de ce dernier par la loi du 28
23<br />
septembre 1871 aurait eu pour effet de remettre en vigueur le décret de<br />
1851 (1)-<br />
Lorsqu'il résulte des faits de la cause, que l'indigène détenteur de munitions<br />
de guerre,<br />
ne les a eues en sa possession que parce qu'elles lui auraient été re<br />
mises par l'autorité française elle-même, à une époque antérieure, alors qu'il<br />
commandait un goum, cette circonstance peut être considérée comme équivalant<br />
à une autorisation dont lejuge a le droit d'apprécier librement les éléments, et<br />
peut amener conséquemment le relaxe du prévenu (2) .<br />
Le Procureur Général c. El Hadj Aliben Tabet<br />
Considérant que le décret du 12 décembre 1851 a créé un délit particu<br />
lier, spécial à l'Algérie et à ses indigènes ;<br />
que ses dispositions sont appli<br />
quées concurremment avec celles de la loi du 24 mai 1834, puisqu'elles<br />
régissent les uns et les autres des personnes et des cas différents; Considé<br />
rant que le décret du 4 septembre 1870,<br />
né sous l'empire d.es événements<br />
militaires qui affectaient la métropole, n'a eu ni ponr but ni pour effet de<br />
porter atteinte à la législation spéciale du décreldu 12 décembre 1851 ; qu'il<br />
s'adressait seulement aux habitants non indigènes de l'Algérie et suspendait<br />
à leur égard les dispositions de la loi du 24 mai 1834 ; Considérant en tout<br />
cas, que ce décret a été rapporté par la loi du 28 septembre 1871, qui_a eu<br />
pour but de rétablir la législation antérieure, telle qn'elle exisiait aupara<br />
vant ; Que par conséquent et en tout cas, celte loi aurait remis en vigueur le<br />
décret du 12 décembre 1851, en supposant, contrairement à la réalité, que<br />
ce décret eût pu être un instant paralysé par celui de 1870;<br />
Considérant qu'il résulte des documents de la cause que les cartouches<br />
saisies entre les mains du prévenu lui avaient été remises et laissées par l'au-<br />
lorité militaire quand, en 1871, il commandait un goum au service de la<br />
— France ; Que ce fait équivaut a une autorisation dont la Cour a le droit<br />
— d'apprécier librement les éléments ; Que par conséquent c'est à tort que<br />
déclaré le prévenu coupable de détention il<br />
les premiers juges ont, en fait,<br />
légale de munitions de guerre et qu'en droit, ils lui ont appliqué les disposi<br />
tions de la loi du 24 mai 1S34, au lieu de celles du décret du 12 décembre<br />
1851;<br />
Par ces motifs, statuant sur l'appel de Mr le Procureur Général et y fai<br />
sant droit tant dans l'inlérêl de la loi que dans celui du prévenu, réforme<br />
le jugement dont appel, renvoie le prévenu de la plainte sans dépens.<br />
(1)<br />
suivant.<br />
M. le prés. Bastien, rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. Gén. ;<br />
Me Sabatier (du barreau de Tlemcen), av.<br />
Voir plus bas la note sur l'arrêt rendu dans le même sens le 10 octobre<br />
(2) Nous ne pouvons que recommander à l'attention cette appréciation en fait<br />
qui nous parait très-rationnelle et très-équitable, de circonstances dans lesquelles<br />
un indigène peut se trouver détenteur d'armes ou de munitions de guerre sans<br />
qu'il y ait délit de sa part.
24<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.),<br />
Présidence de M. PINET de MENTEYER, conseiller.<br />
Indigènes musulmans.<br />
10 octobre 1877<br />
— Détention d'armes et de munitions<br />
de guerre.<br />
La loi du 24 mai 1834 est applicable en Algérie, aux indigènes qui sont<br />
trouvés détenteurs d'armes de guerre .<br />
La détention de munitions de guerre continue à être réprimée conformément<br />
aux dispositions du décret du 12 décembre 1851 (1).<br />
(1)<br />
Il nous semble regrettable que la Cour n'ait pas pris soin de mentionner<br />
dans cet arrêt les motifs sur lesquels elle s'est appuyée pour établir cette distinc<br />
tion entre la détention, par des indigènes, d'armes ou de munitions de guerre.<br />
En effet, un décret du 23 septembre 1872 a rendu les dispositions de la loi du<br />
24 mai 1834 exécutoires en Algérie. Or cette loi, dans ses différents articles, ne fait<br />
aucune différence entre la détention des armes et la détention des munitions de<br />
guerre : son titre même l'indique. 8a promulgation en Algérie a donc eu pour<br />
conséquence de substituer ses dispositions aux dispositions du décret de 1851, en<br />
ce qui concerne la détention des munitions de guerre. Aussi cherchons-nous<br />
vainement sur quelles considérations la Cour a pu s'appuyer pour juger que la pro<br />
mulgation sans réserves, en 1872, d'une loi de 1834 relative tout à la fois à la<br />
détention et des armes et des munitions de guerre, n'a pas eu pour effet d'abroger<br />
les dispositions du décret de 1851, applicable à l'un de ces deux délits.<br />
Le rédacteur du décret de 1851 avait pris soin lui-même d'indiquer, dans l'art. 2,<br />
qu'il n'édictait ces dispositions que par dérogation temporaire à la loi de 1834. La<br />
loi de 1834 est remise en vigueur en Algérie : ce sont ses dispositions seules qui<br />
nous semblent dorénavant devoir être appliquées dans toutes les matières qu'elle<br />
régit, fabrication, distribution et détention d'armes et de munitions de guerre, sans<br />
distinction.<br />
L'arrêt du 10 octobre mérite d'autant plus de fixer l'attention qu'il maintient<br />
l'application, dans l'espèce, d'un texte que la Cour elle-mê me a-plusieurs fois dé<br />
claré trop rigoureux. (Voir Narbonne, Rép. "V° Armes, n» 8).<br />
La loi de 1834 permet, en effet, l'admission des circonstances atténuantes ; le<br />
décret de 1851, au contraire, en refuse l'application et édicté une pénalité qui ne<br />
peut jamais être inférieure à un mois de prison et 200 francs d'amende.<br />
La Cour, dans différents arrêts, avait exprimé le regret que l'emploi de l'art. 463<br />
du Code pénal, ne pût atténuer la répression do tous les délits que prévoit et ré<br />
prime le décret de 1851. Si les dispositions de ce dernier texte peuvent encore,<br />
il est vrai, être appliquées au délit de vente aux indigènes ou, d'achat par eux de<br />
munitions de guerre, le décret de promulgation du 23 septembre 1872 a, selon<br />
nous et en ce qui concerne le délit de détention de munitions, donné indirectement<br />
satisfaction au désir général que la Cour exprimait, en remplaçant les prescriptions<br />
trop sévères des art. 4 et 2 du décret de 1851, par les dispositions plus indul<br />
gentes de la loi de 1834.<br />
Nous croyons donc pouvoir regretter que la Cour n'ait point indiqué les consi<br />
dérations qui, dans l'espèce, l'ont déterminée à s'écarter d'une doctrine qui réalise<br />
les vœux justement renouvelés par elle, A. H.
25<br />
Proc. Gén. c. Si Sliman Ould Mohamed<br />
Attendu que si c'est avec raison que les premiers juges ont fait au prévenu<br />
l'application des articles 2 et 3 de la loi du 24 mai "1834, en ce qui touche la<br />
détention d'un mousqueton d'artillerie, c'est à lort qu'ils ont visé les mêmes<br />
articles pour la détention de la poudre, des cartouches, des capsules, des<br />
pierres à fusil et des balles trouvées et saisies dans son domicile ;<br />
— Que<br />
cette détention de munitions de guerre est spécialement prévue et réprimée<br />
en Algérie par les articles 4, 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851 ;<br />
y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'appel du ministère public, d'in<br />
firmer la décision dont est appel et de faire au prévenu l'application des<br />
articles du décret sus-visé.<br />
— Qu'il<br />
Par ces motifs : LA COUR, infirme le jugement dont est appel. Et statuant<br />
à nouveau, déclare Si Sliman Ould Mohamed atteint et convaincu du délit de<br />
détention illicite d'une arme et des munitions de guerre ci-dessus spécifiées.<br />
Et lui faisant application des articles 4, 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851,<br />
le condamne à un mois de prison et 200 francs d'amende ; le condamne en<br />
oulre à tous las dépens de première instance et d'appel .<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; M. Lauth, cons. rapp. ;<br />
Me Doudart de La Grée, av.<br />
♦-<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
22 novembre 1877.<br />
— Jugement par défaut. Opposition. — — Irrégularité. Absence<br />
de citation primitive.<br />
Lorsqu'un prévenu a formé opposition à un jugement par défaut rendu con<br />
tre lui, et que sur cette opposition emportant citation à la plus prochaine au<br />
dience,<br />
il a comparu devant ses juges et accepté le débat au fond sans exciper<br />
d'aucune nullité de forme, il a ainsi couvert toute nullité de ce genre et il n'est<br />
plus recevable à la soulever encore en appel.<br />
Il en est ainsi notamment lorsque le jugement par défaut à été rendu sans<br />
qu'il y ait eu aucun exploit de citation préalable (1) .<br />
(1)<br />
La théorie posée par cette décision nous parait indiscutable en ce qui con<br />
cerne les nullités de forme proprement dites, comme par exemple une inobservation<br />
de délai, dont la procédure de défaut serait entachée: mais peut-on considérer<br />
Cette citation n'est-elle pas<br />
comme telle l'absence complète de citation première ? —<br />
indispensable pour préciser l'objet, le caractère, les limites de la prévention ?
26<br />
Procureur Général c. Mohamed ben Messaoud et Mohamed ben el Har.<br />
En ce qui concerne la demande en nullité de la procédure devant le tribu<br />
nal correctionnel de Sélif, basée sur l'absence de toute citation en justice. At<br />
tendu que si, à la vérité, ce tribunal a statué par défaut le huit octobre der<br />
nier contre Mohamed ben El Har alors qu'il n'existe au dossier aucun original<br />
de citation, il est certain que par acte du dix-huit du même mois ce prévenu<br />
a formé opposition à ce jugement, que sur cet acte emportant citation à la<br />
plus prochaine audience, il a comparu devant ses juges et a accepté d'être jugé<br />
par eux sans exciper d'aucune nullité de forme ; qu'il a ainsi couvert la nul<br />
lité qu'il invoque devant la Cour el qu'il n'est plus en conséquence recevable<br />
à la soulever en appel ;<br />
En ce qui concerne le supplément d'information subsidiairemenl réclamé<br />
par lui ; Attendu que l'information a été faile hors la présence du prévenu<br />
Mohamed ben El Har,<br />
qu'il n'a pu en conséquence faire valoir ses moyens<br />
de défense, ni établir l'alibi qu'il invoque ; qu'il n'a point été confronté avec<br />
les témoins qui prétendent l'avoir reconnu dans l'obscurité à la lueur d'un<br />
coup de feu;<br />
qu'à l'audience même où il a comparu à la suite de son acle<br />
d'opposition, aucun débat n'est intervenu, le tribunal s'élant contenlé de<br />
faire donner lecture de la déposition des témoins ; qu'il y a lieu en consé<br />
quence défaire droit à cette partie des conclusions dudit prévenu;<br />
Par ces motifs, La Cour déclare Mohamed ben El Har mal fondé et non<br />
recevable dans l'exception de nullité qu'il invoque ; dit que par les soins de<br />
M. le Conseiller Pinet de Menleyer, à ces fins commis, il sera procédé<br />
à un supplément d'informations en ce qui concerne Mohamed ben El Har, re<br />
lativement à la prévention de vol, et de coups et blessures relevés contre<br />
lui ; surseoit à statuer en l'état sur l'appel de ce prévenu ainsi q.ue sur celui<br />
de Mohamed ben Meçaoud ; sur lesquels il sera prononcé ultérieurement<br />
par un seul el même arrêt; Réserve les dépens, etc.<br />
M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. de Vaulx, subsl. du Proc. Gén. ;<br />
Me Mallarmé, av.<br />
La comparution volontaire sur avertissement de l'art 147 du Code d'instr. crim.<br />
n'existp pas en matière correctionnelle : d'autre part la comparution sur opposition<br />
a pour effet, suivant les termes de l'art. 187 du Code d'instr. crim . de faire consi<br />
dérer comme non avenu le jugement de défaut. Il en résulte que, si ce jugement<br />
disparaît et qu'il n'y ait pas eu de citation introductive d'instance, il n'existe rien<br />
dans la cause qui soit de nature à lier le débat. Toute la procédure doit donc être<br />
considérée, à notre avis, comme entachée d'une nullité absolue qui peut être op<br />
posée en tout état de cause, voire même en appel ou en cassation .<br />
V. M.
27<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
Compétence des cadis. — Loi<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
31 octobre 1877.<br />
du «6 juillet 1873. —<br />
vrance des titres de propriété.<br />
Déli<br />
S'il est vrai que d'après la loi du 26juillet 1873, l'établissement et la trans<br />
mission de la propriété en Algérie sont régis par la loi française , et reswrt-<br />
tissent conséquemment à la compétence des tribunaux français, cette règle ne<br />
s'applique, en ce qui concerne les immeubles soumis à la loi musulmane, que<br />
lorsque les opérations de la commission d'enquête ont été complètement termi<br />
nées et que des titres définitifs de propriété ont été délivrés conformément à<br />
l'art. 18 de cette loi.<br />
Jusqu'à ce moment, ces immeubles restent soumis aux règles du droit musul<br />
man etpar suite les cadis sont compétents pour statuer sur les contestations<br />
dont ces immeubles seraient l'objet entre indigènes (1).<br />
Amina et Fathma c. Cheickh J'ohamed ben El-Hadj Merouan.<br />
Attendu, il est vrai, que d'après la loi du 26 juillet 1873, l'établissement<br />
de la propriété en Algérie, la transmission contractuelle des immeubles et<br />
droits immobiliers sont régis par la loi française, mais que ce n'est qu'autant<br />
que les opérations de la commission d'enquête auront été complètement<br />
—<br />
terminées et que les litres définitifs auront été délivrés aux propriétaires ;<br />
Que ce n'est qu'à cette condition, que d'après l'article 18, les titres délivrés<br />
forment le point de départ unique de la propriété à l'exclusion de tous droits<br />
—<br />
antérieurs; Et que ce n'est qu'à partir de la transcription de ces litres<br />
— que la loi du 23 mars 1855 produira tous ses effets ; Que jusqu'à l'accom<br />
plissement de toutes ces formalités, les immeubles sont régis par les principes<br />
antérieurs qui attribuent à la justice musulmane le pouvoir de vider les<br />
contestations entre indigènes ;<br />
— Attendu<br />
qu'en l'état, la commission d'en<br />
—<br />
quête s'est bornée à procéder aux opérations préliminaires d'enquête ;<br />
Qu'aucun titre, ni provisoire ni définitif, n'a été délivré aux parties inté<br />
— ressées ; Que dans ces circonstances c'est à tort que le cadi s'est déclaré<br />
— —<br />
incompétent; Attendu qu'au fond la cause n'est pas en état; Que dès<br />
lors, il n'y a pas lieu d'évoquer et qu'il conyienl de renvoyer la cause devant<br />
le premier juge ;<br />
Par ces motifs : La Cour dit que c'est à tort que le premier juge s'est dé<br />
claré incompétent ; — En conséquence, réforme le jugement dont est appel<br />
(1) Jurisp. conf. Alger, 22 mars 1876 (Robe 1877, p. 172) et Alger, 15 mai 1877<br />
(Bull. Jud. 1877, p. 282 et la note)..— Voir dans Robe, 1877, p. 265, une disser<br />
tation en sens contraire sur cette question.
28<br />
et, pour être fait droit au fond, renvoie la cause et les parties devant le Cadi<br />
de la sixième circonscription de Tenez. Réserve les dépens.<br />
M. Lauth, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; Me Jouyne, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
10 décembre 1877.<br />
Indigènes musulmans. ; — Mariage. — I>rait de djebr.<br />
— Pouvoirs<br />
du juge.<br />
Si la loi musulmane donne au pèi e le droit de djebr,<br />
c'csl-à-dire l'entière<br />
disposition de sa fille- vierge el lui permet ainsi de la marier même sans la con<br />
sulter,<br />
ce droit exorbitant n'a été édicté que dans la présomption que le père<br />
veillerait aux intérêts de sa fille d'une manière plus clairvoyante que la fille<br />
elle-même .<br />
Aussi le rite hanefite est-il arrivé à admettre que, dans le cas où la fille rie<br />
ratifie pas le choix de son père,<br />
ou d'invalider le choix de celui-ci .<br />
c'était au juge qu'il appartenait de confirmer<br />
Le rite malekite, bien que moins disposé à respecter le droit des filles, n'en<br />
est pas moins arrivé, dans l'opinion d'un certain nombre de ses interprètes, à<br />
une doctrine identique.<br />
En conséquence, lorsqu'un père ayant accordé, contre le. gré de sa fille, la<br />
main de celle dernière, reconnaît qne le mariage convenu n'est pas conforme<br />
aux intérêts de celle-ci et retire sa parole, la justice a pour devoir de consacrer<br />
ce changement de- volonté qui peut tout au plus rendrj le père passible de<br />
dommages-intérêts,<br />
et cette décision n'a rien de contraire au respect du droit<br />
de djebr envisagé dans son véritable caractère (1).<br />
(1)<br />
On doit rendre hommage aux considérations morales très-élevées sur les<br />
quelles s'appuie cetaiTêt. — Mais<br />
si nous consultons l'ouvrage de MM. Sautayra<br />
et Cherbonneau (t. i, n°s 11 et suiv.), en ce qui concerne la portée et l'étendue du<br />
droit de djebr, nous sommes porté à penser que l'arrêt a exagéré les restrictions<br />
et les adoucissements dont ce droit exorbitant a été l'o'bjet de la part des doc<br />
teurs soit malekites, soit même hanefites. (Voir notamment nos 21 et suiv. )<br />
Nous y recherchons vainement entre autres la reconnaissance de ce droit (fort<br />
singulier du reste), qui appartiendrait au juge de décider entre le père et la fille,<br />
au cas où ils ne seraient pas d'accord pour le mariage de celle-ci.<br />
Au surplus, il nous semble que c'est moins la jurisprudence que le législateur<br />
qui devrait se préoccuper de cette question au moins aussi grave, par ses consé<br />
quences, que colle par exemple, de l'organisation de la propriété.<br />
Peu importent, à notre avis, les commentaires plus ou moins nuageux ou subtils
29<br />
Ahmed ben Ali ben Yklep c. Abd-el-Kader ben Mohamed.<br />
— Attendu que l'appel est régulier en la forme ; Au fond : Attendu que le<br />
cadi, pour valider le mariage, s'estappuyé sur le droit de djebr qui donne au<br />
père l'entière disposition de sa fille vierge^t lui permet de la marier même<br />
sans la consulter.<br />
Attendu, tout d'abord, que ce droit exorbitant a été édicté dans la pré<br />
somption que le père voit mieux que la fille elle-même ce qui lui convient<br />
pour son bonheur —Que ; parlant de cette idée, le rite banefile en est arrivé<br />
à admettre que dans le cas où la fille ne ratifie pas le choix de son père,<br />
c'était au juge qu'il appartenait de valider ou d'invalider le mariage consenti<br />
par le père ;— Que si le rite malekite s'est en général montré moins favorable<br />
pour les filles, cependant il est d'accord avec le rite hanefite sur les raisons qui<br />
ont fait édicler le droit de djebr en faveur du père et que même un certain<br />
nombre de docteurs malekites, guidés par la logique, en sont arrivés aux<br />
—<br />
mêmes conclusions que la généralité des docteurs hanefites; Attendu, dès<br />
que le droit de djebr n'est pas absolu même dans le rile malekite et<br />
lors,<br />
que l'on comprend 1res bien qu'un père, arrêté par les répugnances de son<br />
enfant, fasse lui-même ce que ferait le cadi el ne ratifie pas un mariage<br />
— convenu contre le gré de sa fille ; Que dans ce cas le père doit être seule<br />
ment passible de dommages-intérêts envers le gendre qu'il a choisi à la<br />
légère,<br />
et que dans aucun cas une juridiction ayant des<br />
idées'<br />
de morale et<br />
de justice, ne peut ordonner qu'une femme sera, contre son gré, livrée à un<br />
homme ; que ce serait ordonner un viol ;<br />
Attendu du reste, en l'espèce, que l'intimé ne se présente même pas devant<br />
la Cour pour soutenir les allégations qu'il a produites devant le cadi ;<br />
Qu'il est vraisemblable, comme l'affirme le père, qu'il n'y a eu que de simples<br />
— pourparlers ; Qu'il est certain, qu'aucune portion de la dot n'a été versée ;<br />
— Que dès lors, il n'y a pas eu convention de mariage dans le sens légal du<br />
mot, mais simples préliminaires de la convention en question —<br />
; Qu'il<br />
a donc pas lieu de condamner le père à des dommages-intérêts ;<br />
que la partie qui succombe doit supporter les dépens.<br />
—<br />
n'y<br />
— Attendu<br />
Par ces motifs : En la forme, reçoit l'appel d'Ahmed ben Ali ben Iklef —<br />
;<br />
Infirme el met à néant le-jugement indiqué. Condamne l'intimé en tous les<br />
dépens de première instance et d'appel.<br />
M. Lourdau. cons. rapp. ; M. Cammartw, av. gén.<br />
dont les docteurs musulmans auraient entouré l'exercice du droit de djebr : il est<br />
certain que ce droit révolte la conscience humaine et que, comme tel, il devrait<br />
disparaître des règles de la loi musulmane, pour faire place à ce principe évident<br />
du droit naturel : « Nul ne peut être marié sans son consentement libre et libre<br />
ment exprimé . » „<br />
.,
30<br />
TRIBUNAL DE 1re INSTANCE D'ALGER (Cil. correct.)<br />
Présidence de M. HUGUES, vice-président.<br />
14 novembre 1877.<br />
Renvoi pour suspicion légitime. — Délit de presse. — Prévenu.<br />
— Comparution personnelle. — Jugement<br />
par défaut.<br />
Le tribunal devant lequel le prévenu ou son avocat allègue avoir fait dili<br />
gences auprès de la Cour de cassation pour obtenir le renvoi de l'affaire devant<br />
un autre tribunal pour cause de suspicion légitime,<br />
à statuer en présence de cette allégation.<br />
n'est pas tenu de surseoir<br />
Cette obligation n'existe pour lui que sur la production d'un arrêt de soit<br />
communiqué rendu par la Cour de cassation,<br />
des art. 545 et suiv. du Code d'instr. crim. (1).<br />
conformément aux dispositions<br />
En dehors du cas où cette production a lieu, le tribunal doit d'autant moins<br />
s'arrêter à l'allégation d'une demande de renvoi pour suspicion légitime, que<br />
la loi du 29 décembre 1875 ordonne aux tribunaux de passer outre aux débats<br />
alors même que les prévenus déclineraient la compétence de la juridiction<br />
saisie .<br />
Si l'art. 10, g 2, de la loi du 11 mai 1868,<br />
porte que le prévenu de délit de<br />
presse qui a comparu devant le tribunal ne peut plus faire défaut, la cause<br />
ne saurait être cependant considérée comme liée contradictoirement, lorsque<br />
dans une poursuite de presse pouvant entraîner la peine de l'emprisonnement,<br />
(1) Cette doctrine, conforme à la jurisprudence (Cass , 23 juillet 1812,<br />
10 fév,<br />
1832, 3 août 1838; C d'ass. de la Corse, 14 juin 1839. V. Dalloz, V° Renvoi, n°<br />
176), a même été déclarée applicable en matière civile (Toulouse, 8 août 1827;<br />
Cass., 19 déc. 1831 ; Bastia, 23 déc. 18^7 ; Cass., 21 fév. 1838. Dalloz, v"<br />
Renvoi,<br />
n° 98). —<br />
La<br />
jurisprudence décide que la preuve même de la requête aux fins de<br />
renvoi, ne saurait contraindre le tribunal à surseoir. Il faut avouer que cette in<br />
terprétation semble bien rigoureuse. Aussi Dalloz (n° 159) présente-t-il à cet égard<br />
l'observation suivante : « Cependant, en matière de simple police et de police cor-<br />
» rectionnelle, les délais de la citation étant très-courts, il sera souvent matériel-<br />
n lement impossible de présenter requête à la Cour de cassation, et à plus forte<br />
» raison d'obtenir l'arrêt de sursis. Que fera le prévenu ? Il sollicitera une remise<br />
» et s'il ne l'obtient pas, il fera défaut; car il aurait compromis son droit de récu-<br />
» sation s'il avait cité des témoins. Cette alternative est pénible sans doute,<br />
et il<br />
» est fâcheux qu'une plus grande latitude n'ait pas été accordée à la défense, alors<br />
» que le législateur en a accordé une si grande au civil, où ne se débattent que<br />
» des intérêts minimes en comparaison de ceux qui s'agitent devant les tribunaux<br />
j> criminels. Mais telle est la loi. » II est regrettable que telle soit la loi, car elle<br />
anéantit ainsi d'une manière presque absolue l'ensemble des garanties essentielles<br />
qui devaient résulter du droit de récuser des juges pour cause de suspicion<br />
légitime. N'est-ce pas là une de ces réformes qui devraient attirer d'une manière<br />
toute particulière l'attention du législateur?
31<br />
un avocat s'est présenté à la barre pour demander le renvoi de l'affaire au<br />
nom de son client, mais sans être assisté par celui-ci el sans que le prévenu ait<br />
effectivement comparu.<br />
Bastien c. Chazot et Gojosso.<br />
Attendu que M
32<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Jugement correctionnel par défaut. — — Opposition. Est recevable à<br />
former l'opposition au jugement correctionnel qui l'a condamné par défaut,<br />
tout condamné qui se trouve dans les délais de l'opposition. On ne saurait<br />
trouver une fin de non-recevoir dans le fait par lui de s'êlre constitué pri<br />
sonnier pour subir la peine à laquelle ledit jugement par défaut l'a condamné.<br />
— Trib. de la Seine, 10* Ch., 21<br />
nov. 1877).<br />
novembre 1877. (Gaz. des Trib. du 22<br />
Capitaine. —<br />
garantie.<br />
— Le<br />
Navire.<br />
—<br />
Propriétaire,<br />
—<br />
Responsabilité.<br />
—<br />
Clause<br />
de non-<br />
propriétaire du navire peut valablement stipuler à l'égard<br />
du chargeur, par une clause de connaissement, qu'il ne répondra pas des<br />
fautes et négligences du capitaine. (C. comm. 216). Cass. civ., 14 mars 1877<br />
D. P. 77, 1, 449. —V. conf. Alger, 20 janvier 1877 (Bull. jud. 1877, 153).<br />
Timbre mobile. —<br />
Quittance.<br />
—<br />
Oblitération.<br />
—<br />
Amende.<br />
—<br />
L'amende<br />
due pour oblitération insuffisante d'un timbre mobile en usage pour l'acquit<br />
du droit de timbre de 10 centimes, est, non point celle de 50 francs, édictée<br />
pour les actes écrits sur papier non timbré, mais celle de 20 francs, établie<br />
pour toute infraction au règlement d'administration publique concernant les<br />
timbres mobiles à 10 centimes. (L. 2 juillet 1862, art. 22; 23 août 1871,<br />
Jugem. Rouen, 18 août 1875 (D. P. 77, 1, 441).<br />
art. 24). -<br />
Presse. —<br />
Vie<br />
privée. —<br />
Un<br />
fait ne cesse pas d'appartenir à la vie privée<br />
parce qu'il a été accompli en public el par un individu (un conseiller général,<br />
dans l'espèce) dont la personne est entourée d'une certaine notoriété, si,<br />
d'ailleurs,<br />
il ne se ratlache pas à une fonction ou profession publique exercée<br />
par celui— ri. Il en est ainsi, spécialement, de l'assistance à une représen<br />
tation théâtrale dans un but de distraction. Dès lors, il y a délit à publier<br />
ce fait dans un journal sans l'assenliment de son auteur,<br />
et le peu d'impor<br />
tance du fait n'est pas un obstacle à ce que l'intéressé en fasse réprimer la ,<br />
— divulgation. (L. 11 mai 1868, arl. 11). Cass. crim., 17 févr. 1877 (D. P.<br />
77, 1, 457) et Lyon, 25avr. 1877 (D. P. 77, 2, 205).<br />
Commissionnaire de transport. —<br />
Renonciation tacite. —<br />
Réception.<br />
—<br />
Fin<br />
de non-recevoir .<br />
Le voilurier (une Compagnie de chemin de fer), qui,<br />
sur une réclamation postérieure à la réception, a fait vérifier les colis avariés<br />
par un employé qui a reconnu la justice de la réclamation, est réputé avoir<br />
ainsi reconnu le droit à indemnité du réclamant et renoncé à opposer la fin<br />
de non-recevoir tirée de l'art. 105, C. corn. (C. civ. 222L 2248). —<br />
Req., 2 févr. 1876 (D. P. 77, 1,<br />
Alger. — Typ. A. Joobdan.<br />
—<br />
Cass.,
2e année.<br />
— 1er -Février 1878. —<br />
N° 27<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
Appel. —<br />
DOCTRINE.<br />
Codébiteurs<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
- -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lroCh.)<br />
LEGISLATION<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
19 mars 1877.<br />
solidaires. — Déchéance.<br />
—<br />
mariée. — Tutrice. — Mineurs.<br />
Femme<br />
L'appel relevé par une partie assignée comme débiteur solidaire, profite à<br />
son codébiteur solidaire, quoique celui-ci soit déchu dv di oit d'appel, à raison,<br />
par exemple,<br />
d'appel (I) .<br />
d'actes d'exécution volontaire ou de prescription du droit<br />
En conséquence, lorsqu'une veuve non commune en biens est assignée à la<br />
fois comme tutrice de ses enfants mineurs et en outre en son nom personnel<br />
comme solidairement tenue des engagements contractés par son mari, et qu'elle<br />
est condamnée comme telle, il importe peu qu'elle ait volontairement exécuté<br />
cette condamnation par le paiement des frais: -r si le jugement est valablement<br />
attaqué par la voie de au nom l'appel, des enfants, comme n'ayant pas été si<br />
gnifié au subroge-tuteur suivant le vœu de la loi, cet appel doit profiter d'une<br />
part aux mineurs dont la tutrice, par le paiement des frais, ne pouvait com<br />
promettre les droits, et d'autre part à la veuve elle-même en son nom person<br />
nel, à raison même du caractère solidaire de l'obligation qu'on prétendait<br />
poursuivre contre elle.<br />
Veuve Abraham ben Saïd el Mardochée ben Saïd c. Mohamed ben Hamada.<br />
Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que le jugement du 4 mars 1873<br />
(1) Il s'est élevé entre les auteurs de vives controverses sur la question de<br />
savoir quel était au regard des codébiteurs solidaires, l'effet d'un acte accompli<br />
par l'un notamment d'eux, d'un appel interjeté.<br />
La jurisprudence (voir notamment Cass. civ., 25 mars 1861 (D. 1861, I, 158<br />
1422), admet en conformément<br />
général,<br />
à<br />
et la note), et Dalloz, v Obtig., n°<br />
l'arrêt que nous rapportons, cette règle très-rationnelle qu'un débiteur solidaire<br />
a mandat pour améliorer la position de son codébiteur,<br />
pire.<br />
mais non pour la rendre
34<br />
n'ayant pas été signifié au subrogé-tuteur des enfants mineurs d'Abraham<br />
ben Saïd, l'appel relevé le 3 décembre 1873, l'a été, quant à eux, en temps<br />
— utile ; Attendu que la veuve Abraham ben ayant Saïd, été assignée comme<br />
solidairement tenue des engagements contractés par son mari et condamnée<br />
comme telle, l'appel valablement interjeté par un codébiteur solidaire doit<br />
— lui profiter; Attendu que le paiement des frais, effectué par la tutrice, ne<br />
pouvait, en emportant acquiescement, compromettre les droits des mineurs ;<br />
— Que dès lors, l'appel est recevable à l'égard de toutes parties.<br />
Au fond, Attendu que la veuve Abraham ben Saïd n'a pas été partie au<br />
-rcontrat<br />
de vente du 2 février 1870; Que n'étant pas commune en biens<br />
avec son mari, ne tenant de ce dernier aucun droit héréditaire, elle ne<br />
—<br />
pouvait à aucun titre être poursuivie pour l'exécution du contrat précité ;<br />
Que c'est donc à tort que le jugement dont est appel, a été prononcé contre<br />
— elle une condamnation personnelle ; Que les mineurs Abraham ben Saïd<br />
seuls étaient, comme héritiers de leur père, obligés par l'acte du. 2 février<br />
1870; —<br />
Attendu<br />
que la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble<br />
vendu du chef des frères Athon, est aujourd'hui rapportée, ainsi qu'il appert<br />
— de l'acte authentique du 24 février 1874 ; Qu'il n'apparaît pas qu'aucun<br />
—<br />
préjudice ait été souffert par Hamada et Chiche ; Qu'il suffit aujourd'hui,<br />
pour les désintéresser entièrement, de donner acte de celle mainlevée et<br />
d'ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires avec l'adjudication des<br />
dépens pour tous dommages-intérêts.<br />
Par ces motifs : LA COUR, en donnant défaut itératif contre Mohamed ben<br />
Hamada, régulièrement réassigné, sans s'arrêter aux exceptions soulevées par<br />
l'intimé, reçoit l'appel et infirmant le jugementt déféré, décharge la veuve<br />
Abraham ben Saïd des condamnations prononcées contre elle personnelle<br />
ment ;<br />
— Donne<br />
acte aux parties de la mainlevée des inscriptions du 12<br />
décembre 1870, volume 108, n°<br />
n° — 249 ^ Dit<br />
275 et du 5 octobre 1871, volume 111,<br />
que sur la production de l'acte du 24 février 1874 et du pré<br />
sent arrêt, M. le Conservateur des hypothèques sera tenu de radier<br />
— lesdiles inscriptions ; Condamne la veuve Abraham ben Saïd, ès-qualilés,<br />
aux dépens.<br />
M. Piette, av. gén. ; M" Chéronnet et Mallarmé, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1» Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
14 novembre 1877.<br />
Obligation de payer une somme d'argent. — Retard dans<br />
le paiement- Préjudice. Dommages-intérêts. — Intérêt légal.<br />
Aux termes de l'art. 1153 du Code civil, des dommages et intérêts résul<br />
tant du retard dans l'exécution d'une obligation ayant pour objet le paiement
35<br />
d'une certaine somme, ne consistent jamais que dans la condamnation aux<br />
intérêts fixés par la loi : c'est là une règle générale à laquelle le juge ne<br />
saurait déroger en s'appuyant sur le préjudice que l'inexécution de l'obligation<br />
aurait entraîné pour le créancier (1).<br />
Cette règle doit notamment recevoir application dans le cas où une traite<br />
tirée par une des parties étant restée impayée, a été, conformément aux usages<br />
du commerce, suivie d'une deuxième traite émise par l'autre partie sur le tireur<br />
primitif, et qui est également protestée à son échéance .<br />
BARBAROUX.et DE MARQUÉ C. CoUPUT.<br />
Attendu que le seul grief d'appel soumis à la Cour, est relatif à la condam<br />
nation de dommages-intérêts prononcée contre Barbaronx et de Marqué en<br />
— faveur de Coupul ; Qu'il est, dès à présent, reconnu par Couput luimême,<br />
que le molif donné par les premiers juges pour justifier la condam<br />
nation à des dommages-intérêts, repose sur une erreur de fait —<br />
; Qu'il y a<br />
lieu, quoiqu'il arrive, d'effacer cette grave imputation de détournement qui<br />
était de nature à porter atteinte à la considération de Barbaroux et de Marqué ;<br />
— Attendu<br />
qu'en dehors de cette cause de dommages-intérêts, aujourd'hui<br />
reconnue erronée, il n'en subsiste plus aucune ;<br />
— Qu'en<br />
effet, la première<br />
traite tirée par Couput étant restée impayée, a été suivie, conformément aux<br />
usages du commerce, suivant l'accord établi entre toutes parties et dans<br />
— l'intérêt même du tireur, d'une seconde traite tirée sur Couput; Que<br />
—<br />
cette seconde traite a été protestêe à son échéance ; Que dans cette situa<br />
tion, il n'y a el ne saurait y avoir d'autre préjudice que celui résultant du<br />
retard apporté à l'exécution d'une obligation consistant dans le paiement<br />
d'une somme d'argent ;<br />
— Que,<br />
par suite, c'est le cas d'appliquer le principe<br />
de l'article 1153 qui, pour ces sortes de dommages, a établi un forfait ne<br />
—<br />
pouvant jamais dépasser l'intérêt légal ; Que vainement Couput insiste sur<br />
le préjudice causé à son crédit par l'inexécution des engagements contractés<br />
—<br />
envers lui ; Que c'est là précisément une de ces réclamations auxquelles<br />
le législateur a voulu couper court en tarifant en quelque sorte les dommages-<br />
inlérêls causés par le retard du paiement d'une somme d'argent ;<br />
l'absence du molif assigné par les premiers juges, la condamnaiion à 5,000 fr.<br />
de dommages-intérêts demeure sans cause.<br />
— Qu'eu<br />
Par ces motifs: LA COUB faisant droit à l'appel de Barbaroux et de Marqué,<br />
maintient les dispositions du jugement déféré, quant à la demande principale<br />
—<br />
et la demande en garantie ; Émendant quant au chef des 5,000 francs de<br />
— dommages-intérêts alloués à Coupul ; Décharge Barbaroux et de Marqué<br />
— de la condamnation prononcée contre eux de ce chef ; Condamne Couput<br />
aux dépens d'appel envers Barbaroux et de Marqué et la Banque de l'Al<br />
gérie.<br />
M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet et Mallarmé, av.<br />
(1) Voir dans Dalloz, Codes annotés, sur l'art. H53 du Code civil, n°s 24 et suiv.<br />
les restrictions que la jurisprudence a apportées, dans différentes espèces, à ce<br />
principe absolu de l'art. 1153.
36<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
9 janvier 1878.<br />
premier président.<br />
— Appel. Désistement. — Forme du désistement.<br />
Si le désistement d'un,appel peut, aux termes de l'art. 402 du Code de<br />
procédure civile, être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou<br />
de leurs mandataires, il doit être, en tous cas,<br />
avoué, et à défaut de cette signification,<br />
désistement intervenu .<br />
signifié par acte d'avoué à<br />
il doit être donné acte par arrêt du<br />
Une partie qui s'est désistée est donc mal fondée à s'opposer à ce qu'il soit<br />
donné acte par arrêt de ce désistement, en alléguant que l'envoi de ce désiste<br />
ment par la poste doit emporter le même effet.<br />
Époux Amar et Abou c. Nathan Stora. ,<br />
Attendu qu'après avoir interjeté appel d'un jugement rendu par le tri<br />
bunal civil d'Alger, les époux Abou et Amar se sont désistés de cet appel<br />
—<br />
par acte sous signature privée du 4 septembre 1877, enregistré; Qu'ils se<br />
sont bornés à transmettre le désistement ainsi formalisé par la voie de la<br />
poste, et qu'aujourd'hui, tout en maintenant ce désistement, ils se refusent,<br />
soit à le signifier par acte d'avoué à avoué,<br />
— arrêt ; Attendu qu'aux termes de l'article 402 du Code de procédure, si le<br />
soit à en laisser donner acte par<br />
désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou<br />
—<br />
de leurs mandataires, du moins il doit être signifié d'avoué à 'avoué ;<br />
cette dernière forrdalité est destinée à clore la procédure en portant d'une<br />
.Que<br />
manière légale et officielle le désistement à la connaissance des parties et<br />
de leurs mandataires;<br />
— Que l'envoi par la poste de l'acte de désistement ne<br />
—<br />
saurait être considéré comme un équipollen.1 ; Attendu, dès lors, qu'en<br />
présence de la déclaration faite au nom des époux Abou et Amar qu'ils main<br />
tiennent leur désistement, de la déclaration faite au nom de Stora qu'il ac<br />
cepte ledit désistement, en l'absence d'une signification d'avoué à avoué, il<br />
est nécessaire de donner acte du désistement par arrêt ;<br />
Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'incident : Donne acte aux époux<br />
Abou et Amar de leur désislement, à Nathan Stora de son acceptation du dé<br />
— Condamne les époux Abou et Amar aux dépens.<br />
sistement;<br />
M. Piette, av. gén.; M«s Carrière et F. Hure, av.
37<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2»«Ch.)<br />
Présidence de M. JOUSSEUME, conseiller.<br />
3 novembre 1877<br />
I. — Degrés de juridiction . — Divisibilité. —<br />
/. —<br />
sous seing-privé. — Énoneiation<br />
II.<br />
— Acte<br />
du nombre des originaux.<br />
— Exécution moditicative des conventions. — Nullité.<br />
Est indivisible dans son objet la demande formée collectivement et en<br />
vertu du même titre par plusieurs créanciers contre un même débiteur (1) .<br />
Elle est encore indivisible à ce point de vue qu'il s'agit d'un seul et même<br />
jugement (2) .<br />
En conséquence, l'appel est recevable contre un jugement ayant prononcé<br />
sur une demande de cette nature, alors que tous les créanciers, sauf un seul,<br />
réclament une somme inférieure à 1 , 500 francs. —<br />
La doctrine contraire aurait<br />
pour résultat possible d'amener des décisions contradictoires, selon que les<br />
diverses demandes seraient ou non supérieures au taux du dernier ressort (3) .<br />
— //. Pour que le dernier \ de l'art. 1325, C. civ., soit applicable, il faut<br />
que les actes sous seing-privé, qui ne portent pas la mention qu'ils ont été<br />
faits en nombre d'originaux suffisant, aient été exécutés sans modification<br />
des conditions qu'ils contiennent (A) .<br />
Desvoisins c. Getten et consorts.<br />
ABRÊT:<br />
Attendu que l'opposition à l'arrêt de défaut du 1«r juin 1877 est rece-<br />
(1,2) Ces propositions ne nous paraissent pas exactes. L'indivisibilité d'une<br />
obligation ne résulte pas, d'après la loi, de circonstances telles que la réunion<br />
de plusieurs créanciers dans un même titre, dans une même assignation, ou dans<br />
un même jugement. Elle n'est pas un effet de la volonté ou du caprice des parties,<br />
mais seulement de la nature de « l'obligation, lorsque la chose ou le fait que la<br />
convention a pour objet n'est pas, dans sa livraison ou dans son exécution, sus<br />
ceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (art. 1217, C. civ.), ou<br />
lorsque le rapport sous lequel cette même chose est considérée dans l'obligation,<br />
ne la rend pas susceptible d'exécution partielle (art. 1218). »<br />
(3) Cette solution est contraire à la jurisprudence généralement adoptée, notam<br />
ment à celle de la Cour d'Alger, qui a toujours décidé qu'en matière personnelle<br />
et mobilière, l'objet de la demande se divise de plein droit entre tous les deman<br />
deurs, et que, par suite, l'appel n'est recevable qu'autant que la part afférente à<br />
chacun d'eux est supérieure au taux du dernier ressort — V. les arrêts cités dans<br />
la note de la page 21 du Bull. jud. de 1871, et le Réperl. de Narbonne, v° Degrés<br />
de juridiction, n05 15 et suiv.<br />
(4) Cette décision nous paraît absolument juridique. H. N.
38<br />
— vable en la forme ; En ce qui touche l'irrecevabilité de l'appel proposée<br />
contre tous les intimés, à l'exception de Getten, et prise de ce que la<br />
demande de chacun d'eux est inférieure à quinze cents francs; >- Atlendu<br />
que le litige actuel est indivisible dans son objet ; qu'il doit donc l'être aussi<br />
— dans sa procédure; Attendu que la matière est, en outre, indivisible, à<br />
ce point de vue qu'il s'agit d'un seul et même jugement, et que la doctrine<br />
contraire, si elle prévalait, amènerait ce résultat que, parmi des créanciers<br />
agissant en vertu du même titre, la demande des uns serait repoussée et celle<br />
des autres accueillie ;<br />
— Attendu,<br />
en outre, que le jugement attaqué<br />
ne prononce aucune condamnation et se borne à ordonner une expertise,<br />
— solution qui est indivisible ; Qu'il y a donc lieu de repousser l'exception<br />
—<br />
proposée et de déclarer l'appel recevable à rencontre de tous les intimés ;<br />
Au fond, en ce qui touche le chef du jugement attaqué, confirmé par l'arrêt<br />
de défaut du ler juiu 1877, par lequel les premiers juges ont déclaré nuls<br />
les actes sous seings-privés des 10 juillet 1875 et 23 septembre de la même<br />
année, par le motif qu'ils ne portent pas la mention qu'ils ont été faits en<br />
— double original ; Attendu que les époux Desvoisins font valoir conlre cette<br />
décision, que le sieur Génier a exécuté les conventions portées auxdits actes,<br />
et que, par suite, aux termes de l'art. 1325 du Code civil, les intimés, qui<br />
agissent comme étant aux droits du sieur Génier, ne sauraient leur opposer<br />
— le défaut de mention dont il s'agit ; Attendu que les conventions portées<br />
dans lesdits actes n'ont pas été exécutées, au sens de l'art. 1325 du Code<br />
résulte, en effet, des documents du procès, qu'à ces conven<br />
— civil ; Qu'il<br />
tions les époux Desvoisins et Génier en ont, dans le cours de l'exécution des<br />
— travaux, substitué d'autres; Que c'est ainsi, en ce qui concerne l'acte du<br />
10 juillet 1875, que les constructions el le prix convenus dans cet acte ont<br />
été changés, que la convention portée dans l'acte du 23 septembre 1875, a<br />
également subi, dans son exécution, par suite de conventions nouvelles, de<br />
dès lors,<br />
— notables •<br />
modifications; Attendu, que ce moyen de défense n'est<br />
— pas fondé ; Attendu qu'il y a lieu, par les motifs qui ont déterminé les<br />
premiers juges, de débouter les époux Desvoisins de leur opposition à l'arrêt<br />
de défaut du l^ juin 1877, et de confirmer ledit arrêt ;<br />
dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe.<br />
Par ces motifs<br />
— Attendu<br />
que les<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén.; Mes Chéronnet el Robe, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2»« Ch.)<br />
Présidence de M. BAST1EN, président.<br />
24 novembre 1877.<br />
Degrés de juridiction. — Divisibilité. —<br />
Appel<br />
irrecevable.<br />
Est en dernier ressort le jugement qui a statué sur une action personnelle
39<br />
intentée par plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs, alors le<br />
chiffre de la demande totale, d'ailleurs supérieur à 1,500 francs, se divise,<br />
pour les demandeurs et les défendeurs, en sommes inférieures au taux du dernier<br />
ressort (1).<br />
L'appel d'un pareil jugement est donc irrecevable et doit être rejeté d'office<br />
par les juges du second degré, ce qui tient aux juridictions étant d'ordre pu<br />
blic (2).<br />
Partouche c. Lascar.<br />
ARRÊT :<br />
Considérant que devant les premiers juges, les consorts Lascar, au nombre<br />
de trois, demandaient une somme de 2,200 francs avec intérêts, au 16 oc<br />
— tobre 1867 ; Que celte prétendue créance se divisait de plein droit entre<br />
les demandeurs et était pour chacun d'eux au-dessous du taux du dernier<br />
les défendeurs étaient eux-mêmes au nombre de quatre,<br />
—<br />
ressort; Que<br />
lesquels se sous-divisail encore<br />
entre, de plein droit la créance personnelle<br />
de chacun des demandeurs;— Considérant qu'au regard de chacune des<br />
—<br />
parties, le litige est inférieur au taux du dernier ressort ; Que le jugement<br />
étant par lui-même définitif, la Cour doit d'office lui maintenir ce caractère<br />
qui tient à l'ordre public et à l'organisation régulière des juridictions.<br />
Par ces molifs: Déclare l'appel non recevable, condamne les appelants à<br />
l'amende et aux dépens. .<br />
M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; Mes F. Huré et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
I, Appel correctionnel. — Prévenu.<br />
4 janvier 1878.<br />
vile. — Comparution personnelle.<br />
— Appel de la partie ci<br />
Iï. Soustraction frauduleuse. — Héritiers. — 'Valeurs de la<br />
succession. — Compétence correctionnelle.<br />
m. Algérie. —<br />
nels. — Notes<br />
Procédure<br />
devant les Tribunaux correction<br />
d'audience.<br />
/. La loi fait au prévenu en matière correctionnelle l'obligation de compa<br />
raître en personne dans les affaires relatives à des délits susceptibles d'entraîner<br />
la peine de l'emprisonnement.<br />
Celte règle est absolue et doit recevoir application même dans le cas où le<br />
(1-2) "V. l'arrêt qui préeède et la note.
40<br />
prévenu ayant été acquitté en première instance, il n'y a eu d'appel interjeté<br />
que par la partie civile et alors que le.Procureur général n'est plus dans les<br />
délais pour interjeter appel en vertu de l'art. 205 du Code d'instr. crim. En<br />
conséquence, dans l'hypothèse précitée,<br />
le prévenu ne peut se faire représenter<br />
devant la Cour, et faute par lui de comparaître personnellement, il doit être<br />
procédé contre lui par défaut (1) ,<br />
//. Le fait par un héritier de s'emparer frauduleusement des objets de la<br />
succession, au détriment de ses cohéritiers, constitue, s'il est établi, le délit<br />
prévu cl puni par l'art. 401 du Code pénal et ressortit conséquemmeut de la<br />
juridiction des tribunaux correctionnels (2) ;<br />
///. La disposition de l'art. 62 de l'ordonnance du 26 septembre 4 842, en<br />
vertu de laquelle les notes d'audience devaient être signées par les témoins en<br />
matière correctionnelle, a été abrogée par la mise en vigueur de la loi du<br />
13 juin 1 856, laquelle a été déclarée applicable à l'Algérie par l'art. 4 du décret<br />
du 15 décembre 1858.<br />
En conséquence,<br />
conformément à l'art. 189 du'<br />
Code d'instr. crim.., dont la<br />
rédaction a été fixée par ladite loi du 13 juin 1856, la seule formalité exigée<br />
pour la tenue régulière des notes M,'<br />
est qu'elles soient visées par le<br />
président (3).<br />
audience,<br />
(1) Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation,<br />
(Cass. 16 oct. 1847. R. de Vill., sur l'art. 185, n°<br />
17) à celle de la Cour d'Alger<br />
v°<br />
(Alger 24 oct. 1858, Narbonrïe, Rép. . jug crim. n05 1 et 2) et, à notre avis, à la<br />
véritable signification de l'art. 185 du Code d'inst. crim. qui ne saurait avoir<br />
évidemment pour but d'exiger la comparution personnelle du prévenu, lors<br />
qu'il n'y a plus en jeu dans l'instance que les intérêts pécuniaires de la partie ci<br />
vile.<br />
- Au surplus la Cour semble elle-même être revenue sur la manière de voir ex<br />
primée par elle dans l'arrêt rapporté, et, dans une affaire Meyhoffer c. Morio' qui<br />
paraissait à sa barre le 1er février 1878, dans des conditions identiques, elle a au<br />
torisé Me Ach. Huré, avocat du prévenu,<br />
à se présenter pour ce dernier.<br />
(2) Jurisp. conf. Cass. 14 mars 1818, 27 fév. 1836, 23 juin 1837. Montpellier,<br />
— 21 nov. 1853. Chauveau et Hélie, t. 5, p. 38. Blanche, Études sur le Code pénal,<br />
t. 5, g 482. Le jugement du Tribunal de Bône avait prononcé l'incompétence de<br />
la juridiction correctionnelle, en se fondant sur ce qu'aux ternies des art. 801 et<br />
792 du Code civil,<br />
qu'à une action civile.<br />
un détournement de cette espèce ne pouvait donner ouverture<br />
(3) Il suffit de rapprocher les textes pour être convaincu, comme l'a été. la Cour,<br />
de l'abrogation de la disposition de l'art. 62 de l'ordonn. de 1842, relative aux<br />
notes d'audience. Est- ce à dire que cette abrogation nous paraisse avoir été une<br />
chose heureuse ? — Assurément non ; la loi algérienne valait infiniment mieux<br />
que la loi française au point de vue de la garantie d'exactitude que doivent pré<br />
senter des notes d'audience, etJL est regrettable que cette disposition très-sage<br />
ait disparu alors qu'il subsiste dans notre législation algérienne tant d'autres<br />
anomalies inexplicables que rien ne justifie.
41<br />
Hasnaouï ben Ramdan c. Abed ben Belkassem et consorts.<br />
En ce qui concerne Abed ben Belkassem, intimé défaillant, pour lequel<br />
Me Jouyne déclare avoir reçu mandat de plaider :<br />
Attendu qu'il s'agit d'une action directe portée devant le tribunal correc<br />
tionnel de Bône par Hasnaouï ben Ramdan et Fathma bent Ramdan, parties<br />
civiles, contre Abed ben Belkassem et Khadidja bent Belkassem, pour délit<br />
— de soustraction frauduleuse ; Que l'action publique était mise en mouve<br />
— ment par le fait de l'introduction de l'action civile ; Attendu que la partie<br />
civile ayant seule interjeté appel de la décision qui rejetait son action par<br />
incompétence,<br />
se trouve devant le juge du second degré comme devant celui<br />
du premier, demandant justice en instance au criminel, et réparation pour<br />
— un fait par elle réputé délit ; Qu'en pareil cas, la juridiction d'appel élant<br />
régulièrement saisie, malgré l'absence d'appel.du ministère public, le juge<br />
du second degré a qualité pour prononcer sur l'action publique résultant<br />
de ce délit au cas même où le ministère public, en appel,<br />
s'en rapporte à<br />
— justice comme il l'avait fait devanl les premiers juges ; Attendu qu'en<br />
l'état, l'action publique restant entière et le délit poursuivi parl'aclion civile,<br />
s'il était constant, prévu par l'art. 401 du Code pénal et puni de la peine<br />
d'emprisonnement, Abed ben Belkassem ne peut, aux termes des art, 185 et<br />
211 du Code d'instruction criminelle, se faire représenter par un avocat —<br />
;<br />
Que l'arrêt à intervenir sera à soii égard, par défaut, faute de comparaître ;<br />
—<br />
Dit, en conséquence, que M" Jouyne ne sera pas entendu pour ledit<br />
Abed ben Belkassem, mais seulement pour la dame Kedidja ;<br />
— En ce qui<br />
—<br />
louche la validité des notes d'audience contestée par l'appelant Hasnaouï ;<br />
Attendu que ces notes sont certiliées conformes par le commis-greffier, qui<br />
a assisté à l'audience,<br />
et signées pour visa par le président qui a tenu l'au<br />
dience; Que celle forme est indiquée par l'art. 180 du Code d'instruction<br />
—<br />
criminelle, modifié par la loi du 17 juin 1856 ; Que si la loi dit qu'elles<br />
seront visées par le président dans les trois jours du prononcé du jugement,<br />
cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité ; —Attendu que vaine<br />
ment on objecte pour Hasnaouï que ces notes devaient être tenues dans la<br />
forme spéciale prescri le en Algérie, pour les l: liimaux correctionnels, par<br />
— l'art. 62 de L'ordonnance du 26 septembre 1842 ; Que cette forme, quoique<br />
compliquée et entraînant des relards, avait été suivie longtemps devant les<br />
juridictions correctionnelles de l'Algérie ; mais qu'elle dut être et a été<br />
constamment abandonnée pour être remplacée par celle que prescrit la loi<br />
précitée du 13 juin 1856, dès que, par décret du 15 décembre 1858, portant<br />
sur l'organisation de la Cour d'appel d'Alger, il fut prescrit (art. 4), que la<br />
—<br />
loi du 13 juin 1856 élait applicable à l'Algérie; Qu'ainsi, le moyen de<br />
nullité opposé par Me Robe n'est pas fondé ;<br />
— En ce qui touche la compé<br />
tence : Attendu que la juridiction correctionnelle était saisie par la partie<br />
civile, qui ne la décline pas en appel —Qu'il s'agissait ;<br />
d'un fait de sous<br />
traction frauduleuse de valeurs mobilières el en numéraire, dépendant d'une<br />
succession, soil du délit prévu par l'art. 401 du Code qu'ainsi<br />
pénal; la<br />
juridiction correctionnelle était compétente;— Attendu que celle compé<br />
tence n'a pas cessé devant les premiers juges après l'enquête d'audience, el<br />
parce que la partie civile n'aurait prouvé ni l'imporlance de la succession
42<br />
mobilière, ni les détournements qu'elle imputait aux prévenus;<br />
c'était le cas, non de déclarer l'incompélence, ainsi que l'a fait le tribunal<br />
de Bône, mais de rejeter la. —<br />
demande comme non justifiée; Attendu qu'il<br />
y a lieu, devant la Cour, en infirmant sur la question de compétence, d'évo<br />
quer le fond conformément à l'art. 215^du Code d'instruction criminelle,<br />
—<br />
ainsi interprété par une jurisprudence constante ; Sur ce : Attendu que<br />
les faits de détournements frauduleux à la charge des n'ont prévenus,<br />
été<br />
— Que<br />
— nullement prouvés; Que les documents du procès et les notes d'audience<br />
—<br />
suffisent pour former la conviction du juge à cet égard ; Qu'il n'y a lieu,<br />
de faire droit à la demande d'audition de témoins nouveaux, cette<br />
dès lors,<br />
audition étant facultative aux Cours d'appel comme aux tribunaux, par<br />
application des art. 190 et 191 du Code d'instruction criminelle.<br />
Par ces molifs : Jugeant par défaut à l'égard de Fatbma bent Ramdan,<br />
— donne acte de son désistement d'appel ; Jugeant aussi par défaut à l'égard<br />
d'Abed ben Belkassem et conlradictoirement à l'égard de Kadidja, infirme le<br />
jugement dont est appel en ce que constatant que la prévention de soustrac<br />
—<br />
tion frauduleuse n'était pas prouvée, il a déclaré son incompétence ; Dit au<br />
contraire, et admettant aussi le défaut de preuves quant au délit, qu'en l'état,<br />
les premiers juges étaient restés compétents à statuer tant sur l'aclion civile que<br />
—<br />
sur l'action publique ; Évoquant, renvoie les prévenus des fins de l'action<br />
—<br />
publique et de l'action civile ; Déboule Hasnaouï ben Ramdan, partie<br />
civile, de sa demande en dommages et intérêts, el le condamne aux dépens.<br />
M. Fau, av. gén. ; Mes Robe et Jouyne, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans).<br />
Indigènes musulmans. — Titre<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
14 novembre 1877.<br />
administratif. — Compétence.<br />
Lorsque dans un litige immobilier entre indigènes musulmans, une des<br />
parties produit un titre administratif établi en sa faveur, la production de ce<br />
titre français a pour effet, aux termes de la loi du 26 juillet 1873, de déférer<br />
la connaissance exclusive du procès aux juridictions civiles françaises de droit<br />
commun .<br />
En conséquence , le juge musulman ou même le tribunal statuant en vertu<br />
du décret du 29 août 1874 comme juge musulman, a pour devoir de se décla<br />
rer, même d'office, incompétent de ce chef, et s'il ne l'a fait,<br />
la Cour saisie<br />
comme juridiction d'appel, doit suppléer d'office à l'omission de ce moyen<br />
d'ordre publie (1).<br />
(1) Ces principes nous paraissent découler tout naturellement de l'art. 17 de la<br />
loi du 26 juillet 1873. Voir plus bas, un arrêt de la même Chambre du 18 décem<br />
bre 1877, statuant dans le même sens en ce qui concerne les actes notariés.
43<br />
Lakhdar ben Rahal c. M'hamed ben Kouïder.<br />
Attendu que l'appel est régulier en la forme; Au fond, Attendu que les<br />
questions de compétence intéressent l'ordre public, et qu'il appartient aux<br />
tribunaux de les relever d'office;— Attendu qu'en l'espèce, M'hamed ben<br />
Kouïder produit un litre signé de M. le Commissaire civil, administrateur<br />
de la commune mixte des Issers, établissant que ledit M'hamed ben Kouïder,<br />
après versement d'une soulte, a reçu de l'État la terre litigieuse, portant le<br />
numéro 3 bis, du territoire des Teurfa, en compensation d'autres terres<br />
— — prises pour la colonisation ; Que ce titre est un titre français ; Que dès<br />
lors, aux termes de la loi de juillet 1873, les juridictions civiles françaises de<br />
— droit commun sont seules compétentes ; Qu'il est même à observer que<br />
M'hamed ben Kouïder pourrait mettre l'État en cause pour se faire garantir<br />
— la terre à lui attribuée par le litre visé ci-dessus ; Que dès lors si c'est avec<br />
raison que le tribunal de Tizi-Ouzou, statuant comme juge musulman, a<br />
repoussé les conclusions d'incompélence de Lakhdar ben Rahal, basées sur des<br />
motifs erronés, il devait d'office se déclarer incompélenl à raison du titre<br />
français produit, que la juridiction musulmane ne pouvait examiner ;<br />
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.<br />
Par ces molifs : En la forme, reçoit l'appel de Lakhdar ben Rahal, infirme<br />
—<br />
le jugement critiqué comme rendu par une juridiction incompétente;<br />
Renvoie les parties à se pourvoir et condamne l'intimé aux dépens.<br />
M. Lourdaiï, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; Me Jouvnë, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
28 novembre 1877.<br />
Justice musulmane. — Kabyles. — Djemâas des Beui-Man-<br />
sour. — Appel. — Com;wtence.<br />
Les Djemâas de justice organisées aux Beni-Mansour conformément au dé<br />
cret du 29 août 1874 et à l'arrêté du 29 décembre de la même année, ont été,<br />
par le décret du 10 août 1875,<br />
dont elles relevaient pour l'appel .<br />
enlevées au ressort judiciaire de Tizi-Ouzou<br />
Mais ce dernier décret ne les a pas en même temps placées dans le ressort de<br />
la Cour d'Alger en matière musulmane; et à défaut d'une disposition for<br />
melle, la Cour d'Alger ne saurait, en présence des termes de l'art. 59 du dé<br />
cret du 31 décembre 1859, connaître de l'appel des litiges entre Kabyles.<br />
Les Djemâas des Beni-Mansour sont donc actuellement dénuées de juridic<br />
tion d'appel (1).<br />
(1)<br />
Nous appelons l'attention de qui de droit sur cette singulière lacune.<br />
—
44<br />
Ahmed ben Bou Daha c. Mohamed ben Bou âziz.<br />
Attendu que les Djemâas de justice organisées aux Beni-Mansour, confor<br />
mément au décret du vingt-neuf août 1 874, et arrêté du vingt-neuf décembre,<br />
même année, devaient ressortir pour les appels au tribunal de Tizi-Ouzou<br />
créé à cette lin; que le décret du dix août mil huit cent soixante-quinze<br />
les a bien enlevées ait ressort judiciaire de Tizi-Ouzou, mais ne les a pas<br />
placées dans celui delà Cour d'Alger en-malière musulmane ; Qu'en effet les<br />
Beni-Mansour sont Kabyles, soumis aux Kanouns,<br />
n'ont jamais été placés<br />
dans le ressort d'aucune mahakma,<br />
1859, modifié par celui du Ireize décembre 1866, sur la justice musulmane<br />
en Algérie, excepte formellement en son article cinquante-neuf les décisions<br />
des Djemâas Kabyles de celles sur lesquelles s'exerce le droit de réformation<br />
en appel de la Cour.<br />
et que le décret du trenle-et-un décembre<br />
Par ces motifs : Déclare inadmissible l'appel des Ahmed ben bou Daha et<br />
de son frère Massaoud ben Ahmed ou Himmi, comme porté devant une<br />
juridiction qui ne saurait l'examiner à aucun titre.<br />
M. Zeys, cons. rapp.; M. Cammariin,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Cli. des appels musulmans.)<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
18 décembre 1877.<br />
Indigènes musulmans. — Acte notarié. — Compétence,<br />
Lorsque dans un litige immobilier entre indigènes musulmans, la solution<br />
du procès implique nécessairement l'appréciation et l'application d'un titre<br />
notarié français produit par l'une des parties, cette circonstance a pour effet<br />
d'entraîner l'incompétence absolue du juge musulman el cette exception réelle<br />
et d'ordre public peut être proposée en tout état de cause, et même être soulevée<br />
a"<br />
office par le juge (1).<br />
En effet, la loi de 1873,<br />
en dispensant les Commissions d'enquête et le Service<br />
des Domaines d'étendre leurs opérations aux propriétés déjà constatées par<br />
acte administratif ou notarié, n'a eu évidemment d'autre pensée que de consi<br />
dérer ces propriétés comme soumises de plein droit aux principes et à la juri<br />
diction de droit commun.<br />
Les enfants de Ben Souna c. El-Hadj Mamar ben Ujelloul.<br />
Attendu que l'article 17 de la loi du 26 juillet 1873 dispose que « pour<br />
« tout ce qui se rapporte à la conslatation, à la reconnaissance et à la confir-<br />
(1) Voir l'arrêt du 14 novembre 1877 rapporté plus haut, page 42.
45<br />
« mation de la propriété possédée à titré privatif et non constatée par acte<br />
« notarié ou administratif, le Service des Domaines, sur le vu des conclu-<br />
« sions du commissaire enquêteur, procédera à l'établissement des titres<br />
« provisoires. »<br />
Qu'il suit évidemment de là que la loi de 1873, dont le but principal et<br />
même unique consistait à reconnaître et à constater la propriété prévue, ne<br />
pouvait avoir d'autre pensée, en dispensant les commissaires-enquêteurs et le<br />
Service des Domaines d'étendre leurs opérations sur les propriétés déjà cons<br />
tatées par acte notarié ou administratif, que de considérer ces propriétés<br />
comme soumises de plein droit aux principes du droit commun et à la juri<br />
diction ordinaire, les opérations de la commission d'enquête et du Domaine<br />
n'en'<br />
— devenant"complètement superflues ; Que s'il étail pas ainsi, ces pro<br />
priétés seraient par la force des choses soustraites au principe du droit<br />
—<br />
français ; Que la loi irait en contre-sens du but qu'elle s'élait proposé ;<br />
Qu'on ne comprendrait pas non plus que la loi ait voulu soumettre à l'ap<br />
préciation ou à l'application d'un tribunal musulman un acte émané d'une<br />
autorité ou d'un fonctionnaire français ;<br />
— Qu'en<br />
décidant autrement, on<br />
arriverait à cette autre conséquence qu'il suffirait qu'un acte notarié ou<br />
administratif fût suivi d'une transaction intervenue en la forme indigène,<br />
pour qu'immédiatement la propriété retombât sous la juridiction musulmane<br />
et qu'ainsi, la loi de 1873 serait constamment éludée ou ne recevrait<br />
jamais'<br />
— d'application ; que cela ne saurait être; Attendu qu'au cas particu<br />
lier, la terre faisant l'objet du litige, a été, à la date du 27 décembre 1874,<br />
l'objet d'un partage 'devant Me Hunout, notaire -à Miliana ;<br />
— Que pour<br />
apprécier l'empiétement dont se plaignent les appelants, il faut nécessaire<br />
— ment recourir à cet acte et en faire l'application sur le tenainj Que l'em<br />
piétement étant nié, il ne s'agit pas seulement dans l'espèce d'une demande<br />
d'indemnité pour non-jouissance, mais que la contestation porte sur une<br />
véritable question réelle immobilière;<br />
— Attendu<br />
cielle proposée, est réelle et d'ordre public ;<br />
proposée en tout état de cause et même soulevée d'office ;<br />
que l'exception préjudi<br />
— Que<br />
dès lors elle peut être<br />
Par ces motifs : LA COUR, infirme le jugement dont appel, en ce qu'il a<br />
retenu la cause, émendant, se déclare incompétente et renvoie les parties<br />
devant les juges qui doivent connaître de la contestation ;<br />
intimés aux dépens.<br />
— Condamne<br />
les<br />
M. Lauth, cons. rapp.;. M, Cammartin, av. gén.; MesRoBE et Mallarmé, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décrets en date du 5 décembre 1877, ont été nommés :<br />
Défenseur près le tribunal de 1 instance de Mostaganem (Algérie),<br />
M. Santelli, défenseur près le siège de Tizi-Ouzou, en remplacement de<br />
M. Bossu-Picat, décédé.<br />
Défenseur près le tribunal de lro instance de Tizi-Ouzou, M. Legrand<br />
en remplacement de M Santelli.<br />
(Charles-Jean-Baptiste), ancien magistrat, .
46<br />
Par décret en date du 5 décembre 1877, M. Boveron (Sylvain-Emilienj,<br />
a été nommé greffier de la justice de paix de Milah (arrondissement de Cons<br />
tantine),<br />
en remplacement de M. Morlane démissionnaire.<br />
M. Boveron, a été autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attribu<br />
tions restreintes (section 2 du décret du 18 janvier 1875,<br />
du 5 décembre 1877).<br />
Par arrêté du 7 janvier 1878, M. L'Orza,<br />
arrêté ministériel<br />
greffier de la justice de paix de<br />
Biskra, a été -autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attributions<br />
restreintes (section 2 du décret du 18 janvier 1875).<br />
Par arrêté du 15 janvier 1878, M. Pawloski, a été autorisé à remplir les<br />
fonctions de notaire avec attributions restreintes (section 2 du décret du 18<br />
janvier 1875).<br />
Par décret en date du 18 janvier 1878, M. Marty (Prosper), a été nommé<br />
greffier de la justice de paix de Djelfa (place créée).<br />
Par décret en date du 5 décembre 1877, M. Janaud (Louis-Adrien), a été<br />
nommé huissier à Perrégaux (arrondissement de Moslaganem), en remplace<br />
ment de M. Michel, décédé.<br />
Par décrets en date du 15 janvier 1878, ont été nommés :<br />
Huissier à Aumale (Algérie), M. Oudaille, huissier à Dellys, en remplace<br />
ment de M. Balagayrie.<br />
Huissier à Dellys (arrondissement de Tizi-Ouzou), M. Balagayrie, huissier<br />
à Aumale, en remplacement de M. Oudaille.<br />
Par décret en date du 18 janvier 1878, M. Berthier (Jacques), a été nommé<br />
huissier à Djelfa (arrondissement de Blida), place créée.<br />
Par décrets en date du 26 janvier 1878, ont été nommés :<br />
Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Hugues, vice-président du tribu<br />
nal de 1r« instance de la même ville, en remplacement de M. Soulé, admis<br />
sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite (loi du 9 juin 1853), et<br />
nommé conseiller honoraire.<br />
Vice-président au tribunal de 1« instance d'Alger, M. Dannery, président<br />
du siège de Bougie, en remplacement de M. Hugues, nommé conseiller.<br />
Président du tribunal de i« instance de Bougie, M. Carayol, juge d'ins<br />
truction au siège de Blida, en remplacement de M. Dannery, nommé vice-<br />
présidenl à Alger.<br />
Juge au tribunal de 1« instance de Blida, M. Commandré, juge au siège<br />
de Sétif, en remplacement de M. Carayol, nommé président.<br />
M. Commandré, nommé par le présent décret juge au tribunal de ïre ins<br />
tance de Blida, a été chargé du service de l'instruction.<br />
Juge au tribunal de Ire instance de Sétif, M. Armanet, juge de paix à<br />
Bougie,<br />
en remplacement de M. Commandré.
47<br />
Juge de paix à Bougie, M. Raffali, avocat, en remplacement de M. Armanet.<br />
Juge au tribunal de 1" instance de Bougie, M. Le Brethon, juge de paix<br />
de Sétif, en remplacement de M. Rousse, nommé juge à Orthez.<br />
Juge de paix à Sétif, M. Pécoul, juge de paix à Perrégaux, en remplace<br />
ment de M . Le<br />
Brethon .<br />
Juge de paix à Perrégaux, M. Blanchier, suppléant rétribué du juge de<br />
paix de Bel-Abbés.<br />
a<br />
Par décrets en date du 26 janvier, ont été nommés :<br />
Assesseur musulman près la Cour d'appel d'Alger, Si Kaddour ben Chérif,<br />
en remplacement de Si Saïd, décédé.<br />
Greffier de la justice de paix de Fprt-National, M. Benedetti,<br />
justice de paix de Cassaigne, en remplacement de M. Ceccaldi, décédé.<br />
Greffier de la justice de paix de Cassaigne, M. Balète.<br />
Travaux publics. —<br />
Extraction<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
de matériaux. — — Indemnité.<br />
greffier de la<br />
Responsa<br />
— bilité de l'État, Le propriélaire de terrains, dans lesquels des extractions<br />
de matériaux ont eu lieu en vertu de l'autorisation de l'Administration,<br />
peut, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, demander que l'État soit<br />
condamné conjointement avec ce dernier, à lui payer le montant de l'indem<br />
—<br />
nité à laquelle il a droit. Cons. d'État, 27 avril 1877 (D. P. 77, 3, 65).<br />
TbIbunaux de commerce. —<br />
Président.<br />
—<br />
— Élections. Les fonctions de<br />
président d'un tribunal de commerce ne peuvent être dévolues qu'à un né<br />
gociant ayant la capacité légale de remplir ces fonctions pendant deux an<br />
nées (C. . corn., 623) — Par suite, celui qui, étant juge titulaire depuis trois<br />
ans, ne doit plus être maintenu en fonctions que pendant une année, ne<br />
peut être élu président. — Cass. civ., 9 mai 1877 (D. P. 77, 1, 446).<br />
Valeurs étrangères soustraites. — — Opposition.<br />
ne permettant pas d'opposition .<br />
titution: —<br />
Le banquier français,<br />
— — Paiement.<br />
Législation étrangère<br />
Rejet de la demande en res<br />
chargé par un gouvernement étranger de<br />
payer en France les coupons d'arrérages afférents aux fonds de l'État, et<br />
d'opérer le renouvellement des titres dans les conditions où s'effectueraient<br />
ces opérations, si elles avaient lieu sur le territoire même de ce pays, n'est<br />
pas tenu de s'arrêter aux oppositions formées aux paiements des coupons et
48<br />
au renouvellement des titres par un propriétaire auquel ces valeurs auraient<br />
été détournées,<br />
si la législation étrangère interdit toute opposition au paie<br />
ment et à la circulation de ces litres. —<br />
cembre 1877 (Gaz. des Trib. du 13 janvier 1878).<br />
Cour d'assises .<br />
— — Serment.<br />
Formule<br />
Cour de Paris, 2« Chambre, 31 dé<br />
incomplète. —<br />
La constatation du<br />
proces-verbal des débats que les témoins ont prêté le serment « de parler<br />
sans haine et sans crainte, et de dire toute la vérité, » est insuffisante,<br />
mule de ce serment étant incomplète. —<br />
(Gaz. des Trib. du 12 janvier 1878).<br />
Chemin de fer. —<br />
prescription. — Il<br />
Perte<br />
"de marchandises. — Action.<br />
la for<br />
Cass., Ch. crim., 20 déc. 1877<br />
—<br />
Exemption<br />
de<br />
y a violation de l'art. 108 du Code de- commerce et de<br />
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, de la part du jugement qui admet une ac<br />
tion intentée contre une Compagnie, à raison de la perle de marchandises,<br />
plus de six mois après le jour où le transport aurait dû être effectué, en se<br />
fondant sur ce que la Compagnie aurait été appelée en garantie dans une<br />
précédente instance engagée contre un tiers par l'expéditeur, sans même<br />
—<br />
mentionner la date de cette assignation en garanlie. Cass., Ch. des réq.,<br />
d'un jug. du Trib. de Constantine, 31 déc. (Gaz. des Trib. du 4 janv. 1878).<br />
Chemin de fer. — Lettre<br />
— Délai réglementaire .<br />
d'avis. —<br />
— Les<br />
Mise à la disposition du destinataire.<br />
Compagnies de chemins de fer ne sont pas<br />
obligées d'aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises en gare; il<br />
suffit qu'elles soient prêles à les lui délivrer lorsqu'il se présente pour les<br />
retirer dans le délai réglementaire total fixé par le tarif général ou p«r le<br />
tarif spécial réclamé. —<br />
4 janv. 1878).<br />
Faillite. —<br />
faillite. —<br />
Arrivée<br />
Paiement<br />
Cass., Ch. des req., 31 déc. 1877 (Gaz. des Trib. du<br />
à un Créancier. —<br />
Envoi<br />
de -la lettre le jour de la faillite. —<br />
par la poste la veille de la<br />
Nullité.<br />
—<br />
Le<br />
paie<br />
ment envoyé à un créancier par lettre mise à la poste la veille de la faillite,<br />
et arrivé seulement le jour de la faillite, doit êlre déclaré nul. — Trib.<br />
commerce de la Seine, 5 mai 1877 (France judic . du !«•<br />
Alger. —<br />
Typ. A. Jourdan.<br />
déc. 1877).<br />
de
2e année. — 16<br />
Février 1878. —<br />
N° 28<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
-<br />
LEGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. des Req.)<br />
Présidence de M. de RAYNAL, président.<br />
14 novembre 1876.<br />
Vente. — Résolution. — Inexécution réciproque du contrat. —<br />
Faute première du -vendeur. — Dommages-Intérêts. — tKr»îs<br />
d'enregistrement.<br />
Lorsque le vendeur et l'acheteur demandent l'un et l'autre la résolution d'un<br />
contrat de vente d'immeuble pour inexécution des conditions, cette résolution<br />
peut être prononcée contre le vendeur seul, bien qu'aucune des deux parties<br />
n'ait satisfait aux clauses qui lui étaient imposées, si l'obligation de l'acqué<br />
reur de payer le prix convenu dans un terme fixé, était subordonnée à celle<br />
imposée au vendeur de rapporter dans un délai déterminé, la mainlevée de<br />
saisies et d'inscriptions frappant l'immeuble vendu .<br />
Dans ce cas, les dommages-intérêts mis à la charge du vendeur à raison de<br />
son inexécution, peuvent comprendre les droils d'enregistrement que l'acqué<br />
reur avait versés et cette condamnation ne constitue pas une violation de l'art.<br />
31 de la loi du 22 frimaire an VII qui porte que les droits d'enregistrement<br />
d'un acte de vente doivent être acquittés par le nouveau possesseur .<br />
Marais c. Bizot<br />
Dans un procès engagé entre le sieur Marais et le sieur Bizot au sujet de<br />
la vente d'une maison sise à Bône, le Tribunal de Bône avait déclaré que les<br />
deux parties ayant à se reprocher des torts réciproques et égaux par l'inexé<br />
cution des charges qui leur étaient imposées par le contrat, avait déclaré la<br />
venle résiliée au profit de chacune d'elles. Sur l'appel de Marais, il est inter<br />
venu, le 18 juillet 1875, l'arrêt suivant de la Cour d'Alger, rejetant cet appel,<br />
et faisant droit au contraire à l'appel incident de Bizot sur l'appel principal :<br />
ARRÊT :<br />
Attendu que l'acte du 10 novembre par lequel 1873, Marais a vendu à<br />
Bizot une maison sise à Bône, rué Valicon, renferme des obligations, l'une à
50<br />
la charge de Marais et — l'autre à la charge de Bizol; Que Marais s'oblige par<br />
cet acte à justifier, dans le courant du mois de novembre, de la mainlevée des<br />
— inscriptions el saisies frappant la maison vendue ; Que Bizot s'oblige en<br />
vers Marais à lui payer comptant ou a ses ayants droit, le 30 décembre pro<br />
chain, la somme de 70,000 fr., pour prix principal auquel la vente dont<br />
—<br />
s'agit est consentie; Qu'il est évident que de ces deux obligations, il en<br />
est une, celle de Bizot, dont l'exécution devait être nécessairement suspendue<br />
— jusqu'à l'exécution de l'autre; Que c'est ce qui résulte de la nature même<br />
de l'obligatioh de Marais et des détails stipulés par l'une et l'autre de ces<br />
—<br />
obligations ; Qu'en effet, en exigeant de Marais qu'il justifiât, dans le cours<br />
du mois de novembre 1873, de la mainlevée des inscriptions et saisies gre<br />
vant la maison vendue, Bizot s'était proposé deux buts: que, d'une part, il<br />
avait voulu s'éviter l'ennui d'avoir à s'immiscer dans une procédure à la<br />
quelle par sa profession il était tout à fait étranger; que, d'autre part, en<br />
acquéreur prudent, il avait tenu à ne payer son prix d'acquisition que tout<br />
autant que l'immeuble lui étant livré, libre et quitte de toutes charges, il<br />
— pourrait entrer en sa possession en pleine sécurité; Attendu qu'on ne<br />
—<br />
saurait reprocher à Bizol aucun lort; Que, s'il n'a payé son prix, ça été<br />
par la faute de Marais qui ne remplissait pas bien ses obligations. Qu'on ne<br />
saurait imputer à faute à Bizot de n'avoir pas mis Marais en demeure de<br />
—<br />
remplir ses obligations au terme stipulé dans l'acte du 10 novembre 1873;<br />
Que ce terme avait été stipulé en faveur de Bizot ; que si ce dernier n'a pas<br />
agi, comme il l'aurait pu, rigoureusement envers Marais dans les délais con<br />
venus, Marais serait mal venu à s'en plaindre —<br />
; Qu'il résulte de la conduite<br />
de Bizot qu'il a été de bonne foi et que par la raison, sans doute, qu'il pensait<br />
avoir fait une acquisition avantageuse, il a voulu sincèrement l'exécution de<br />
—<br />
son contrat; Attendu qu'il appert, au contraire, des faits et circonstances<br />
de la cause, qu'à aucun moment Marais n'a été en mesure de remplir son<br />
— obligation ; Que s'il eût pu la remplir dans le délai qui lui avait été im<br />
parti, il n'eût pas manqué de le faire, désireux qu'il devait être de toucher le<br />
prix de la vente, el il eût fait sommation à Bizot de payer son prix;<br />
Marais n'a pas été en mesure dans le délai qui a suivi jusqu'au 15 janvier<br />
— Que<br />
1874, jour où les parties se sont présentées devant M> —<br />
Lagorce, notaire;<br />
Que ce jour-là même, il ne l'était pas davantage ; que ce qui le prouve, c'est<br />
ce fait reconnu par toutes les parties à savoir que le conservateur s'est refusé<br />
à toute radiation, ne trouvant pas que Marais fûl en règle et que les formalités<br />
voulues eussent été remplies ;<br />
— Attendu<br />
que la condition résolutoire est<br />
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où<br />
l'une des — parties ne satisfait pas à son engagement ; Que c'est donc à bon<br />
droit que les premiers juges ont résilié la vente consentie le 10 janvier 1873;<br />
— Qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement dont est appel,<br />
en l'émendant toutefois en ce qu'il prononce la résiliation aux loris des deux<br />
parties, tandis qu'elle ne doit être prononcée qu'aux torts de Marais ;<br />
Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte en appel par Marais,<br />
en ses<br />
conclusions additionnelles, qu'il y a lieu de la rejeter comme n'étant pas<br />
concluante;<br />
— Attendu<br />
que par les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu de<br />
débouter Marais des fins el conclusions de son appel et de sa demande en dom<br />
mages-intérêts contre Bizot ;
51<br />
Sur l'appel incident: — En ce qui touche la somme de 1,900 fr. déboursée<br />
par Bizot pour droit d'enregistrement de la convention du 10 novembre<br />
1873;<br />
— Attendu<br />
que si Bizot a payé cette, somme, ça été par le fait de<br />
Marais qui l'a contraint à le mettre en demeure et, par suite, à faire enre<br />
— gistrer ladite convention ; Qu'il est même à remarquer que Bizol a retardé<br />
cet enregistrement jusqu'à la veille du jour où un double droit eût été exi<br />
gible;<br />
— Qu'il<br />
y a donc lieu, sur ce chef, d'infirmer le jugement attaqué<br />
et de condamner Marais à rembourser à Bizot ladite somme ;<br />
Attendu en ce qui touche les dommages-intérêls reclamés par Bizot, qu'il<br />
y a lieu de confirmer le jugement dont est appel et de débouter le sieur Bizot<br />
de sa demande, par le motif qu'elle n'est pas justifiée ;<br />
Par ces motifs, sur l'appel principal : — Rejette la preuve offerte par<br />
— Marais ; Confirme le jugement dont est appel en ce qui touche la résilia<br />
— tion de la vente du 10 novembre 1873 ; Dit que cette résiliation est pro<br />
— noncée aux torts de Marais seulement; Dit que le jugement attaqué, en ce<br />
— qui concerne la résiliation, sortira son plein el entier effet ; Sur l'appel<br />
— incident: En ce qui touche la demande de Bizot, que Marais soit condamné<br />
à lui payer la somme de 1,900 fr.. qu'il a déboursée pour droit d'enregistre<br />
— ment de la convention du 10 novembre 1873 ; Infirme le jugement dont<br />
— est appel ; Condamne Marais à payer à Bizot ladite somme 1,900 fr.<br />
Mes F. Huré et Mallarmé, av.<br />
Pourvoi du sieur Marais rejeté le 14 novembre 1876,<br />
de la Ch. des requêtes ainsi conçu :<br />
par un arrêt<br />
—<br />
La Cour; sur le premier moyen, pris delà violation des art. 1134, 1184<br />
el 1383, c. civ. —<br />
; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que si l'acte de vente<br />
du 10 novembre 1873 contient deux obligations, -l'une par laquelle Marais<br />
s'engage à justifier, dans le courant du mois de novembre 1873, des mainle<br />
vées des hypothèques et saisies qui pourraient grever la maison vendue, l'au<br />
tre par laquelle Bizot s'engage a payer le prix de l'immeuble le 30 décembre<br />
suivant, il ressort, d'une part, de l'économie de l'acte et de l'intention des<br />
parties, que la première de ces obligations devait être exécutée avant la<br />
deuxième, et qu'il est établi, d'autre part, parles faits de la cause, que, tan<br />
dis que Bizot n'a eu aucun tort à s'imputer, Marais n'a jamais élé en mesure<br />
— de remplir son engagement ; Qu'en rejetant, clans ces circonstances, la<br />
demande en résolution de la vente formée par Marais contre Bizot, et par<br />
voie de conséquence celle en 50,000 fr.'de dommages-intérêts pour préju<br />
dice résultant de celte résolution, et en accueillant, au contraire, la demande<br />
en résolution formée par Bizol conlré Marais, ledit arrêt n'a violé aucun des<br />
articles susvisés.<br />
Sur le 2e moyen, tiré de la violation de l'art. 31 de la loi du 22 frimaire<br />
— an 7 ; Attendu que si aux termes de l'art 31 de la loi du 22 frimaire an 7,<br />
les droils d'enregistrement d'un acte de vente doivent être acquittés par<br />
l'acquéreur, cesdroits peuvent, au cas de la résolution de la vente prononcée<br />
contre le vendeur, être mis à la charge de ce dernier à titre de dommages-<br />
intérêts ;<br />
— Attendu<br />
qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt dénoncé<br />
que c'est à titre de dommages-hitérêts que Marais a été condamné à sup-
52<br />
porter les frais de l'enregistrement de l'acte de vente du 10 novembre 1873 ;<br />
que, dès lors, l'art, précilé n'a pas été violé ;<br />
Sur le 3e<br />
1810 :<br />
— Attendu<br />
moyen, fondé sur 1* violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril<br />
que, pour démontrer qu'il avait exécuté son engagement,<br />
c'est-à-dire qu'il avait justifié de la mainlevée des hypothèques et saisies pou<br />
vant grever la maison vendue, Marais a, par des conclusions additionnelles,<br />
posé en fait et offert de prouver « que le 20 mars 1874, sa femme, qui était<br />
sa mandataire, se trouvait en l'étude Lagorce, porteur de toutes les mainle<br />
vées, savoir celle : l° de Babon 2°<br />
; de Jaïs 3"<br />
; de Cordian 4"<br />
; de Chambron ;<br />
5° de Maméli, el que ces créanciers se trouvaient également dans l'étude pour<br />
y constater personnellement mainlevée ou ratification de celle donnée par<br />
second contre le dépôt, par Bizot, de son prix d'acquisition, lequel n'aurait<br />
— été délivré qu'après radiation ; Que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt<br />
attaqué ne se base pas seulement sur ce que l'offre de preuve n'est pas con<br />
cluante; qu'il déclare, en outre,<br />
qu'il appert des faits et circonstances de la<br />
cause, qu'à aucun moment Marais n'a été en mesure de remplir son engage<br />
ment;<br />
» d'où il suit qu'il a été pleinement satisfait aux prescriptions de<br />
l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ;<br />
— Rejette.<br />
M. Petit, cons. rapp.; M. Godelle, av. gén. c. conf.; Me Duboy, av.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. des Req.)<br />
Présidence de M. de RAYNAL, président.<br />
■<br />
20 février 1877.<br />
Compétence administrative. — Cours d'eau. — Acte admi<br />
nistratif. — Propriété. —<br />
Dommage.<br />
En Algérie, les Tribunaux civils sont, en vertu de la loi du 16 juin 1851,<br />
compétents pour décider si des mesures administratives portent ou non atteinte<br />
aux droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage.<br />
Mais il ne leur appartient pas d'apprécier le préjudice qui, sans toucher aux<br />
droits de cette nature, pourrait avoir été causé aux intérêts des particuliers par<br />
les mesures dont il s'agit (L. 16-24 août 1790, lit. 2, art. 13).<br />
Ricci c. Préfet d'Alger.<br />
Le sieur Eicci possédait quatre anciens moulins arabes et leurs<br />
chutes sur l'Oued-el-Kebir. En 1868, il a adressé à l'administration<br />
une demande à la suite de laquelle celle-ci a pris divers arrêtés opé<br />
rant règlement d'une usine que le sieur Ricci avait substituée aux an<br />
ciens moulins. Le sieur Eicci a prétendu que les dispositions de ces<br />
arrêtés portaient atteinte à ses droits antérieurs de propriété ou
d'usage,<br />
Blidah,<br />
53<br />
et il a assigné le Préfet d'Alger devant le Tribunal civil de<br />
pour voir dire qu'il lui sera fait défense de le troubler dans sa<br />
possession et jouissance, et s'entendre condamner en 20,000 fr. de<br />
— dommages-intérêts. Le 15 juin 1875, jugement de ce Tribunal, qui<br />
—<br />
se déclare incompétent. Appel par le sieur Eicci.<br />
Le 9 mai 1876, arrêt de la (Jour d'Alger,<br />
ainsi conçu :<br />
Attendu que, sans avoir à examiner si l'action était recevable, il s'agit en<br />
la cause d'actes administratifs el d'arrêtés pris par le Préfet, dans la plénitude<br />
—<br />
de ses attributions, et qui ne touchenl en rien au droit de propriélé;<br />
— Que, dès lors, la justice ordinaire est incompétente pour en connaître ; Par<br />
ces motifs, confirme.<br />
Pourvoi du sieur Eicci, pour violation de l'art. 2, § 3, de la loi du<br />
16 juin 1851, et fausse application de la loi des 16-24 août 1790,<br />
titre 2, art. 13, en ce que la Cour d'Alger a refusé de connaître de<br />
l'action intentée par lui contre l'Etat, à un de faire déclarer qu'il avait<br />
sur un cours d'eau d'Algérie un droit de propriété non soumis à la<br />
réglementation administrative.<br />
ARRÊT :<br />
La Cour : Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 2 de la loi<br />
du 16-24 août 1790, lit. 2, art. —<br />
13; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt<br />
attaqué que les mesures dont se plaint Ricci ne touchent en rien à ses droits<br />
de propriélé ;<br />
— Que,<br />
par cette déclaration, la Cour d'Alger, bien loin de<br />
méconnaître la compétence attribuée aux tribunaux civils par l'art. 2 de la<br />
loi du 16 juin 1851, a précisément fait usage de cette —<br />
compétence; Qu'àla<br />
vérité, elle a ajoulé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le préjudice<br />
qui, sans porter atteinte aux droils de propriété de Ricci, pourrait avoir été<br />
causé aux intérêts de celui-ci par les faits de l'administration, mais qu'en<br />
statuant ainsi, ladite Cour a fait une exacte application des règles qui ré<br />
gissent la compétence respective de l'autorité administrative et de l'autorité<br />
judiciaire ;<br />
— Rejette.<br />
MM. Reverchon, rapp ; Godelle, av. gén., c. coiaf.; Me Perriquet, av.<br />
Succession. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
Procès-verbal<br />
28 janvier 1877.<br />
de carence. —<br />
Procès-verbal<br />
descriptif d'objets ne pouvant être mis sous scellés. —<br />
Droits de greffe .<br />
Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal descriptif des objets néces'
54 ,<br />
saires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le<br />
scellé ne puisse être mis, dressés aux termes de l'art. 924 du Code de proc<br />
civ. par le juge de paix lors de l'ouverture d'une succession, ne sont point,as<br />
similés, en ce qui concerne les droits de greffe, aux procès-verbaux descriptifs<br />
dressés après apposition et levée de scellés, suivant les dispositions des art. 10<br />
et M de l'ordonnance du 26 décembre 1842 portant règlement général sur les<br />
successions vacantes.<br />
Ces derniers sont, aux termes du % 1er de l'art. 1 1 , exonérés de tous frais<br />
lorsqu'au moment de la levée des scellés, les valeurs mobilières de la succession<br />
seront présumées être inférieures à 1,000 francs;<br />
aucune disposition de loi<br />
identique n'existe en ce qui concerne les procès-verbaux dressés en verlu de<br />
l'art. 924 du Code depr. civ.<br />
En conséquence, c'est à bon droit qu'un curateur aux successions vacantes a<br />
acquitté les frais de greffe afférents à ces actes, sur le visa et la taxe régulière<br />
ment établis par le juge de paix, conformément aux dispositions de la loi.<br />
— Attendu<br />
Joly,<br />
curateur aux successions vacantes.<br />
ARRÊT :<br />
En ce qui concerne les 17 successions ci-après désignées : 1° Abadie, etc..<br />
que les frais de greffe, dont le paiement est certifié par le juge<br />
ment dont est appel, ont été régulièrement acquittés par le curateur sur le<br />
ainsi que le prescrivent l'art. 21 de l'ordon<br />
visa et la taxe du juge de paix,<br />
nance royale du 26 décembre 1842,1a décision ministérielle du 7 juillet<br />
1854 et l'art. 1er — de l'ordonnance royale du 17 juillet 1825; Attendu<br />
d'ailleurs que le curateur ne pouvait qu'accepler la taxe qui avait été faite<br />
Que,<br />
—<br />
par le juge de paix et qui était conforme aux dispositions de la loi ;<br />
en effet, il ne s'agissait point, dans l'espèce, comme l'apprécie le jugement<br />
dont est appel, de procès-verbaux descriptifs dressés après apposition et<br />
levée de scellés, suivant les dispositions des art. 10 et 11 de l'ordonnance<br />
du 26 décembre 1842, et qui, aux termes du paragraphe 1er de ce dernier<br />
article, sont exonérés de tous frais, mais de procès-verbaux descriptifs établis<br />
dans les cas où il n'y a aucun effet mobilier, où les effets mobiliers sont né<br />
cessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels<br />
les scellés ne peuvent être mis, ainsi qu'il est prévu en l'art. 924 du Code de<br />
procédure civile ;<br />
— Qu'aucune disposition de la loi n'exonère ces procès-<br />
—<br />
verbaux des frais ordinaires; Attendu, par suite, que c'est à bon droit<br />
que le curateur a acquitté les frais des notes de greffe dont s'agit et qu'il y a<br />
lieu d'homologuer ses comptes de gestion pour ces dix-sept successions<br />
comme pour les premières.<br />
Par ces molifs : Infirme le jugement dont est appel. Homologue purement<br />
et simplement les comptes de gestion du curateur Joly pour l'année 1875.<br />
M. Fau, subst.du proc. gén.; M. Blanckaert, cons. rapp.
Faillite. —<br />
L'art . 580<br />
Jugement<br />
55<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lrc Ch,)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
3 décembre 1877<br />
fixant l'époque de la cessation des<br />
paiements. — Opposition. —<br />
Délai.<br />
du Code de commerce qui a fixé à un mois, à partir du jour où les<br />
formalités de publication énoncées en l'art. 442 du mê:i
56<br />
la veille, le jugement dont il s'agit a été légalement publié ; Qu'ayant laissé<br />
—<br />
passer ce délai ils sont devenus non recevables à l'attaquer ; Attendu que<br />
les frères Carrus soutiennent en appel que le délai qui leur est opposable n'est<br />
pas le délai prévu par l'art. 580, mais bien le délai fixé par l'art. 581 , lequel au<br />
surplus, disent- ils, n'a pu courir contre eux —<br />
; Qu'à l'appui de cette préten<br />
tion, ils disent qu'au moment de la déclaration de faillite ils n'étaient pas les<br />
—<br />
— créanciers de Valensi ; Qu'ils.étaienl dès lors sans droit ni action ; Que<br />
leur droit à opposition ne s'est ouvert que du jour où ils ont été condamnés à<br />
faire rapport à lajnasse, parce que les conséquences de cette condamnation les<br />
a constitués créanciers de la faillite,<br />
et que le délai de l'art. 581 n'a pu courir<br />
—<br />
contre eux que du jour où leur droit s'est ouvert ; Attendu que l'art. 581<br />
qu'ils invoquent, porte qu'aucune demande des créanciers tendant à faire<br />
fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui<br />
résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne<br />
sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation<br />
des créances;<br />
— Attendu<br />
qu'il résulte des constatations du jugement attaqué,<br />
que les frères Carrus se sont présentés comme créanciers dans les opéralions<br />
de la failli! te el ont reçu du greffe, en celle qualité, les convocations d'usage;<br />
— Qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être admis à soutenir qu'ils n'étaient pas.<br />
créanciers antérieurement à la vérification et à l'affirmation des créances et<br />
que faute par eux d'avoir formé leur opposition avant le 2 juin 1876, date de<br />
la clôture de ces opérations, ils sont, à ce nouveau point de vue, également<br />
que l'opposition des frères<br />
— non recevables dans leur opposition; Attendu<br />
Carrus, élanl déclarée-non recevable, il est inutile de rechercher, comme l'a<br />
fait le premier juge, si elle était bien fondée ;<br />
Par ces motifs,<br />
et ceux du jugement attaqué qui sont adoptés en ce qu'ils<br />
onl trait à la non-recevabilité de l'opposition, rejette l'appel. Confirme le<br />
jugement attaqué, dans la disposition qui déclare les frères Carrus irrece<br />
vables dans leur opposition au jugement du 5 avril 1876 ;<br />
— Ordonne<br />
qu'il<br />
sortira son plein et entier effet, et condamne les appelants en l'amende et<br />
aux dépens.<br />
I. Algérie. —<br />
M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet el F. Huré, av.<br />
Délais.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
3 décembre 1877.<br />
— Requête civile. — Délai<br />
II. Conclusions. —<br />
Motifs.<br />
—<br />
de distance.<br />
Dispositif.<br />
/. L'art 16 de l'ordonnance du 16 avril 1843 qui accorde à ceux qui sont<br />
domiciliés hors de l'Algérie ou dans un lieu autre que cetyi où le jugement a<br />
été rendu, outre le délai légal pour l'appel ou la requête civile, les délais de
57<br />
distance fixés par la même ordonnance pour les ajournements, est encore ac<br />
tuellement en vigueur.<br />
Il n'y a point été dérogé par la loi du 3 mai 1 862 qui n'a eu pour effet que<br />
de régler les délais pour les personnes habitant l'Algérie et ayant des procès à<br />
soutenir en France, mais qui n'a point touché aux délais fixés pour les procès<br />
soutenus en Algérie. En conséquence, les parties résidant en Algérie ont pour<br />
former une requête civile contre un jugement rendu en Algérie, outre le délai<br />
de deux mois actuellement fixé par la loi de 1862 pour la requête civile, le<br />
délai d'un jour par myriamètre pour la distance existant entre le lieu de la<br />
résidence de la partie et celui où le jugement a été rendu ; conséquemment entre<br />
Constantine et klger un délai de distance de quarante-trois jours (l) .<br />
II. Le dispositif seul des conclusions détermine la portée du litige, et il n'y<br />
a liiu conséquemment de tenir compte de la discussion contenue dans les<br />
motifs desdites conclusions, notamment pour apprécier au point de vue du<br />
bien fondé d'une requête civile, si le jugement frappé de cette requête avait ou<br />
non omis de statuer sur l'un des chefs de demande.<br />
Bouroon c. Rochefort.<br />
Attendu que Rochefort soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardi-<br />
— velé de l'assignation ; Qu'il soulienl qu'une requête civile doit être signi<br />
fiée dans le délai de deux mois, à partir du jour de la signification du juge<br />
ment attaqué, que fixe l'art. 483 du Code de procédure civile, sans qu'il y<br />
— ail lieu à l'augmentalion du délai de distance ; Attendu qu'il convient<br />
— tout d'abord d'examiner le mérite de celle exceplion ; Attendu qu'aux<br />
termes de l'art. 16 de l'ordonnance du 16 avril 1843, modiflcalive du Code<br />
de procédure civile en Algérie, ceux qui demeurent hors de l'Algérie ou dans<br />
un lieu autre que celui où le jugement a élé rendu, ont, outre le délai de<br />
quatre-vingt-dix jours pour la requête civile, les délais à raison de la dis-<br />
(1) Dans le Vol. de 1877 du Bull, jud., page no-s 49, avons publié une disser<br />
tation sur le Délai d'appel en France et en Algérie : les réflexions critiques que nous<br />
avons formulées dans ce travail, au sujet de la situation singulière faite à l'Algérie<br />
pour les délais de procédure, s'appliquent avec autant de force à la requête civile.<br />
l'n plaideur domicilié en France a un délai de deux mois pour former requête<br />
civile contre un jugement rendu en France (art. 485 pr. civ.), quelle que soit la<br />
distance entre son domicile el le lieu où lejugement a été rendu.<br />
Un plaideur domicilié en Algérie, pour a, former requête civile contre un juge<br />
ment rendu en France, deux mois de délai fixe, plus un mois de délai de distance<br />
(art. 486 et 73 du Code de pr. civ.)<br />
Mais le plaideur domicilié à Constantine, a pour signifier une requête civile contre<br />
un jugement rendu à Alger, outre le délai de deux mois, celui de quarante-trois<br />
jours pour la distance légale entre Alger et Constantine (art. 16 de l'ord. du 16<br />
avril 1843).<br />
Y a-t-il rien de plus illogique que de pareilles anomalies ?<br />
Quand donc songera-t-on à les effacer pour y substituer dans la mesure la plus<br />
large possible, la pure et simple application de la loi française en Algérie ?<br />
V. M.
tance fixés par les mêmes ordonnances pour les ajournements ;<br />
58<br />
— Attendu<br />
que si la loi des 3 mai-3 juin 1862 a substitué le délai de deux mois à celui<br />
de quatre-vingt-dix jours, elle n'a point fait disparaître la situation excep<br />
tionnelle de l'Algérie, au point de vue du délai des distances, qui, en cette<br />
matière, n'existe pas dans la législation du territoire européen de la France ;<br />
— Attendu qu'on soutient en vain, pour faire décider le contraire, qu'il<br />
n'est accordé de délai de distance qu'en faveur -du demandeur absent du<br />
territoire européen de France ou du territoire de l'Algérie pour cause de<br />
service public ou en favenr des gens de mer absents pour cause de naviga<br />
— tion ; Attendu en effet, que l'introduction en 1862 des mots : ou du terri<br />
toire de l'Algérie dans le texte de l'art. 485 du Code de procédure civile,<br />
n'a pas eu pour objet de modifier la législation spéciale de l'Algérie, mais<br />
seulement de retirer de l'exception les habitants de l'Algérie pour les faire<br />
rentrer dans le droit commun, au point de vue des procès qu'ils peuvent<br />
avoir à soutenir en France ; que ceci ne saurait être douteux en présence de<br />
l'exposé des motifs de la loi des 3 mai-3 juin 1862, et que si cette modifi<br />
cation n'eût pas été apportée à l'art. 485, les personnes résidant en Algérie<br />
pour cause de service public, auraient, outre le délai de deux mois,, le<br />
délai de huit mois fixé par ledit art. 485, délai qui eût été excessif en pré<br />
sence des améliorations apportées dans les moyens de communication, tandis<br />
qu'elles ont aujourd'hui, aux termes de l'art. 486, comme demeurant hors<br />
de la France continentale, le délai ordinaire et suffisant des ajournements ;<br />
— Attendu<br />
que c'est donc avec raison que Bourdon soutient qu'il avait, pour<br />
signifier sa requête, outre le délai de deux mois, le délai des dislances enlre<br />
Alger et Constantine, lequel est de quarante-trois —<br />
jours; Attendu que<br />
l'arrêt du 27 février 1877 n'ayant été signifié que le 21 avril, la signiticalion<br />
— de la requête civile a été utilement faite le 2 aoûl ; Qu'il<br />
déclarer la requête civile recevable en la forme ;<br />
— Au fond : Attendu que Bourdon demande la rétractation de l'arrêt ren<br />
y a donc lieu de<br />
du par celte chambre le vingt-sept février 1877 en soutenant que cet arrêt a<br />
omis de statuer sur l'un de chefs de demande ;<br />
Que d'après lui la Cour était saisie tout à la fois de l'appel d'un jugement<br />
du Tribunal de commerce de Constantine du vingt-cinq août 1876 par lui<br />
interjeté le seize septembre suivant et d'un appel formalisé le quatorze dé<br />
cembre tant de ce même jugement que d'un second jugement portant la date<br />
du dix novembre,<br />
et que cependant l'arrêt dont il demande la rétractation<br />
n'aurait statué quesur ce dernier appel ;<br />
— Attendu<br />
en fait qu'aprèsavoir suc<br />
combé dans une exception par lui proposée devant le Tribunal de commerce<br />
de Constantine, le mandataire de Bourdon se retira et laissa condamner celui-<br />
ci par défaut le vingt-cinq août 1876 ; Que le jugement du vingt-cinq août<br />
fut signifié le quinze septembre à Bourdon, qui, le lendemain seize septembre,<br />
interjeta appel de la disposition contradictoire rendue sur l'exception ;<br />
— At<br />
tendu qne Rochefort ayant poursuivi l'exécution du jugement du vingl-cinq<br />
août qui prononçait des condamnations à son profil, Bourdon forma opposi<br />
tion à ce jugement à la daie du dix-neuf octobre et que celte opposition fut<br />
rejetée par un jugement du dix novembre qui fut signifié le vingt-quatre du<br />
— même mois ; Attendu que le qualorze décembre suivant Bourdon qui<br />
jusqu'alors n'avait pas suivi sur l'appel du seize septembre dirigé contre les
59<br />
parties contradictoires du jugement du ving-cinq août, frappa d'appel par un<br />
même acte : 1° la partie du jugement du vingt-cinq août qui était restée en<br />
dehors de l'appel du seize septembre « autant qu'il a été prononcé par dé<br />
faut, est-il dit dans l'exploit, dans la partie contenant défaut de conclure ; »<br />
2° — le jugement du dix novembre 1876 ; Attendu que le vingt-trois décem<br />
bre, Me Huré se constitua pour Rochefort sur l'appel du quatorze décembre<br />
et mit l'affaire au rôle : que le huit février il signifiait des conclusions ten<br />
dant à la non-recevabilité de l'appel, auquel il donnait par erreur, au lieu<br />
de la date du quatorza décembre, la fausse dale du vingt-quatre novembre,<br />
confondant la date de l'appel avec celle de la signification du jugement du<br />
dix novembre; Attendu que cette date erronée, qui s'est maintenue jusque<br />
dans l'arrêt du \ingl-sept février 1877, ne peut cependant faire naître aucun<br />
doule sur celui des deux appels auquel s'appliquaient les conclusions<br />
de M
60<br />
trois cents francs d'amende et à cent cinquante francs de dommages-intérêts<br />
envers la partie ;<br />
Par ces motifs, déclare la requête civile recevable en la forme ; Au fond la<br />
rejette; Dit que l'arrêt du vingt-sept février sera exécuté selon sa forme el<br />
teneur; —Condamne Bourdon à l'amende de trois cents francs;<br />
— Le<br />
con<br />
damne en cent cinquante francs de dommages-intérêts envers Rochefort, le<br />
quel est autorisé à loucher sur le vu de la grosse ou d'un extrait du présent<br />
arrêt, de la caisse du bureau de l'enregistrement, des domaines et du timbre<br />
d'Alger, la somme de cent cinquante francs qui a été consignée pour lesdits<br />
dommages- intérêts sous le numéro quatre cent trente-hail.<br />
Condamne enfin Bourdon aux dépens.<br />
M. Piette, av. Mes<br />
gén.;<br />
Chabert-Moreau et F. Huré av.<br />
Indigènes musulmans. — Justice<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2 Ch.)<br />
Présidence de M. BAST1EN, président.<br />
24 novembre 1877.<br />
française.<br />
Ordre public. — Frais frustratoires.<br />
— Compétence. —<br />
Les musulmans ne peuvent saisir la justice française de leurs différends<br />
qu'en se conformant à l'art. 2 du décret du 31 décembre 1866,<br />
s'<br />
adressant au juge de paix.<br />
c'est-à-dire en<br />
L'incompétence des tribunaux ordinaires est d'ordre public et doit être re<br />
levée d'office,<br />
même par le juge d'appel (1).<br />
En conséquence, les frais de l'instance engagée devant le tribunal de lre ins<br />
tance, doivent être mis à la charge du défenseur (art. 1031, C. pr. civ.).<br />
— Que<br />
Halima bent Osman Bey c. consorts Osman Bey.<br />
ARRÊT :<br />
Considérant qu'il s'agit dans la cause d'une réclamation entre musulmans;<br />
si une opposition a été formulée entre les mains de M. le Trésorier-<br />
payeur d'Oran, c'était à litre purement conservatoire;<br />
— Que ce fonctionnaire<br />
n'a été mis en cause personnellement ni en première instance ni en appel,<br />
— même comme tiers saisi ; Considérant que si les musulmans sont libres<br />
de saisir d'un commun accord la justice française de leurs différends, c'est<br />
à la condition de se conformer à l'article 2 du décret du 31 décembre 1866<br />
— et que le tribunal civil n'en resterait pas moins incompétent; Que celte<br />
incompétence, à raison de la matière, tient à l'ordre des juridictions el<br />
doit être suppléée par la Cour;<br />
— Que l'instance en mainlevée d'opposi<br />
tion, introduite le 30 octobre 1875, dans ces conditions, devant le tribunal<br />
(1) V. Conf. 6 janvier 1877, Bull, jud., 1877, 90 et la note.
61<br />
civil d'Oran, sous la constitution de M* Mathieu 'St-Laurent, défenseur, et<br />
accueillie par jugement du 27 novembre 1876, a donc été dès l'origine el<br />
— jusqu'à ce jour inutile et fruslratoire ; Qu'en présence de la faute lourde<br />
du défenseur quia introduit l'instance, il doit être personnellement con<br />
damné aux dépens aux termes de l'article 1031 du Code de procédure civile ;<br />
Par ces motifs, la Cour : Infirme el met à néant, comme incompétemment<br />
rendu, le jugement prononcé entre les parties par le'tribunal civil d'Oran, le<br />
27 novembre 1876; Met également à néant la procédure engagée au nom des<br />
intimés par exploit du 30 octobre 1875 ; Renvoie les parties à se pourvoir ;<br />
Ordonne la restitution de l'amende; Condamne les ayants cause de Me Ma<br />
thieu St-Laurent, décédé, à tous les dépens de première instance et d'appel,<br />
sans recours contre les parties en cause.<br />
M. du Moiron, Subst. du Proc. gén.; M« Robe et Chéronnet, av.<br />
I. Dommages-intérêts. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2»«Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
29 novembre 1877.<br />
— dommages-intérêts à payer parjour. Appel.<br />
firmatif. —<br />
Point<br />
Obligation<br />
de faire sous peine de<br />
—<br />
Arrêt<br />
eon-<br />
de départ. — II. Interprétation d'arrêt. —<br />
Droit de la Cour d'appel.<br />
/. Lorsqu'un tribunal a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts<br />
à payer par chaque jour de retard pour lepréjudice qui sera causé par l'inexé<br />
cution d'un acte dont il a ordonné l'accomplissement dans un délai déterminé<br />
et que cette décision a été purement et simplement confirmée en appel, l'appel<br />
n'a nullement eu pour effet de suspendre l'existence des créances successivement<br />
acquises par la partie en faveur de laquelle les dommages-intérêts ont été<br />
prononcés (1).<br />
En effet, l'appel ne suspend que l'exécution du jugement entrepris (art. 457,<br />
c. pr. civ.), lequel produit son effet sous la condition résolutoire d'une infir-<br />
mation possible, mais qui n'est pas survenue. — En<br />
outre l'appel ayant été mis<br />
—<br />
à néant, est censé n'avoir jamais et existé; une interprétation contraire con<br />
duirait à ce résultat qu'un appel mal fondé procurerait un bénéfice à l'appe<br />
lant qui aurait eu le tort de le formuler.<br />
II. Enfin, en interprétant ainsi l'arrêt confirmatif,<br />
la Cour constate qu'elle<br />
n'a fait qu'exercer le droit, que lui donne l'art. 404 du Code de proc. civ.,<br />
(t) V. Conf. Paris, 28 août 1840 (J. P. V° Dommages-intérêts, n°s<br />
193, 194) ;<br />
cass. civ. 24 janvier 1865 (D. P. 65,1,226); Dalloz, Table des 22 années, n°s 145 à<br />
151;<br />
Voy. aussi cass. ci/. 12 décembre 1876 (D. P. 77,1,306).<br />
Nous avons cru devoir développer plus que de coutume la notice de l'arrêt ci-<br />
dessus rapporté, parce que cette décision de la Cour d'Alger nous a paru rédigée<br />
dans des termes plus complets et plus concluants que les diverses solutions ren<br />
dues dans le même sens par la jurisprudence.
62<br />
d'allouer des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement.<br />
Mais, sur l'instance en interprétation, la Cour ne peut plus liquider les dom<br />
mages-intérêts dus, et dont le chiffre doit être soumis au premier degré de<br />
juridiction .<br />
De Tocqueville c. Le Roy<br />
ARRÊT :<br />
Considérant que par jugement du tribunal civil d'Alger du 29 décembre<br />
1875, le sieur Le Roy<br />
cinq cents francs dédommages-intérêts, et, en outre, à lui remettre un bil<br />
let ou à lui payer cinq francs par jour de retard depuis la signification du<br />
jugement jusqu'à la remise dub'illet; Que ce jugement a été confirmé par<br />
arrêt de la Cour du 23 décembre 1 876 (1) ; Que la demoiselle de Tocqueville se<br />
pourvoit actuellement devant la Cour en interprétation dudil arrêt, pour<br />
a été condamné à payer à la demoiselle de Tocqueville<br />
voir dire que Le Roy est devenu passible des dommages-intérêts moratoires<br />
même au cours de l'appel, et pour le faire condamner par la Cour, en consé<br />
quence, à lui payer une somme de treize cent soixante francs ; que Le Roy con<br />
teste cette double prétenlion de la demoiselle de Tocqueville ;<br />
— Considérant<br />
qu'il y a lieu de distinguer, dans la demande de la demoiselle de Tocqueville, ce<br />
qui touche à l'interprélation de l'arrêt, laquelle peut être demandée à la Cour,<br />
et ce qui est relatif à l'exécution de l'arrêt confirmatif, laquelle appartient<br />
—<br />
au tribunal ; Considérant que la lecture du jugement confirmé prouve que<br />
les magistrats ont entendu édicter la réparation d'un préjudice déjà consom<br />
mé au moment du jugement el qu'ils ont évalué à cinq cents francs, —et<br />
celle d'un préjudice ultérieur à prévoir qu'ils évaluaient à cinq francs par<br />
jour;<br />
que la force de chose jugée acquise par cette décision ne peut permet<br />
tre à la Cour d'y introduire aucune modification ; qu'on prétend, en vain,<br />
que les dommages-intérêts moratoires n'ont pu courir pendant l'inslance<br />
d'appel ; que cette inslance n'empêchait pas le préjudice que les premiers<br />
juges avaient voulu prévoir et dont ils avaient à l'avance édicté la réparation ;<br />
que l'appel suspend seulement les voies d'exécution, mais qu'il ne saurait<br />
empêcher ni suspendre l'existence des créances, ni les conséquences que<br />
peut produire cette existence; que la demoiselle de Tocqueville devenait<br />
chaque jour créancière d'une nouvelle somme de cinq francs, à la condition<br />
que le billet ne lui aurait pas été remis ; que sans doute le jugement, n'étant<br />
pas alors définitif, ne pouvait produire cet effet que sous la condition réso<br />
lutoire d'une infirmalion possible; mais qu'au contraire, le jugement a été<br />
confirmé; que l'appel, mis à néant, est censé n'avoir jamais existé, et que le<br />
— jugement doit produire les mêmes effets sauf les voies d'exécution qui<br />
n'ont pas été tentées,<br />
rendu.;<br />
— que<br />
s'il avait été définitif au moment où il a été<br />
qu'une in lerprétalion contraire conduirait à ce résultai qu'un appel<br />
déclaré mal fondé conlinuerait cependant à produire des effets el procurerait<br />
— un bénéfice à l'appelant qui a eu le tort de le formuler ; Considérant que la<br />
demoiselle de Tocqueville aurait pu, en comparaissanl pour la première fois<br />
devant la Cour, obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé<br />
pendant l'appel, même si les premiers juges ne lui en avaient point à<br />
l'avance alloué ; qu'en confirmant les dispositions prises à cet égard par les<br />
(1) Cet arrêt est rapporté au Bull, jud,, 1877, 42.
63<br />
premiers juges, la Cour n'a fait qu'exercer sous une autre forme le droit<br />
qu'elle tenait elle-même de l'article 464 du Code de procédure ;<br />
dérant que si la Cour est compétente pour affirmer le droit de la demoiselle<br />
— Consi<br />
de Tocqueville, tel qu'il doit résulter d'un précédent arrêt, elle ne peut ac<br />
tuellement prononcer aucune condamnation contre Le Roy; que la demande<br />
formulée à cet égard par la demoiselle de Tocqueville échapperait au premier<br />
degré de juridiction ; qu'à la vérité lorsqu'on a comparu devant la Cour sur<br />
l'appel du jugement, on pouvait alors liquider les dommages- intérêts courus<br />
pendant l'instance d'appel; mais que la Cour ne tenait cette faculté que de la<br />
compétence qu'elle avait pour juger te litige, et des dispositions exception<br />
nelles de l'article 464 du Code de procédure*<br />
qu'elle n'a plus aujourd'hui le<br />
même pouvoir, puisqu'elle a été dessaisie par le premier arrêt qu'elle a rendu<br />
et qu'elle ne peut plus statuer que dans les limites étroites de l'interprélation<br />
de ce précédent arrêt; que les conditions de la créance de la demoiselle de<br />
Tocqueville étant bien déterminées par les deux arrêts, il lui appartiendra<br />
de faire valoir ses titres devant les juges compétents qui auront à apprécier<br />
aussi les motifs de libération allégués par Le Roy; que ces questions réser<br />
vées seront l'exécution de l'arrêt ; qu'il n'y aura plus lieu à l'interpréter<br />
puisque les faits sur lesquels on pourra discuter désormais sont en dehors de<br />
l'arrêt lui-même.<br />
Par ces motifs : Interprétant au besoin son arrêt du 23 décembre 1876 : Dit<br />
que la demoiselle de Tocqueville sera créancière de Le Roy de la somme de<br />
cinq francs par jour depuis le 16 février 1876, date de la signification du<br />
jugement, jusqu'au jour que Le Roy prouvera, selon les règles du droit et<br />
devant les juges compélents, avoir été celui de la remise dutiireàla de<br />
moiselle de Tocqueville ; Dit n'y avoir lieu pour la Cour à statuer sur le sur<br />
plus des conclusions de la demoiselle de Tocqueville el à cet égard la renvoie<br />
à se pourvoir; Condamne Le Roy aux dépens de l'incident.<br />
M. du Moiron, subst. du proc. gén. concl. conf.; Mes NARRONNEel F. Huré, av.<br />
Succession. —<br />
Héritier<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2°<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
1er décembre 1877.<br />
bénéficiaire. —<br />
Délais<br />
pour faire<br />
inventaire et pour délibérer. — Délai judiciaire. — Frais<br />
de poursuites.<br />
Lhéritier bénéficiaire qui n'est plus dans les délais de l'art. 797, C. civ.,<br />
mais qui conserve la faculté accordée par l'art. 800, est passible des frais<br />
de poursuites faits contre lui, en sa qualité de comptable de la succession,<br />
s'il n'a pas sollicité de délai judiciaire, conformément à l'art. et 798, s'il ne<br />
se trouve pas dans un des cas prévus par l'art. 799.<br />
Mais il ne saurait être condamné à payer le principal, puisqu'il peut, aux<br />
termes de l'art. 802, renoncera la succession et se décharger ainsi du passif<br />
qui la grève.
Rossi c. Schiltz et Velay.<br />
ARRÊT :<br />
Considérant que les femmes Schiltz et Velay sont héritières bénéficiaires<br />
de leur père, Couriol, décédé en 1870, et de leur mère, décédée en 1876 ;<br />
— Qu'il<br />
n'est point allégué qu'elles aient pris la qualité d'héritières pures<br />
et simples ou fait des actes qui imposeraient cette qualité;<br />
sont poursuivies par Rossi pour réparations faites par lui en 1874 et 1875,<br />
d'ordre de la veuve Couriol, tutrice des dames intimées, alors mineures, à<br />
— Qu'elles<br />
des immeubles indivis entre ladite veuve Couriol et la succession de son<br />
mari;<br />
— Considérant<br />
qu'on se prévaut vainement, pour obtenir une con<br />
damnation contre les intimées, de la qualité qu'on leur attribue de copro<br />
priétaires des immeubles entretenus et de l'action de in rem verso, et des<br />
obligations dont elles seraient tenues du chef de la veuve Couriol ;<br />
— Qu'elles<br />
peuvent encore, aux termes de l'art. 802 du Code civil, abandonner la pro<br />
priété de ces biens el se décharger de tout le passif des successions de<br />
— leurs auteurs ; Que si elles prenaient ce parti, il en résulterait que les<br />
opérations ordonnées par leur mère et lulrice n'auraient pas été faites pour<br />
leur compte, et qu'elles seraient en outre affranchies des obligations person<br />
— nelles de celle-ci ; Considérant que les créanciers de la succession peuvent<br />
valablement intenter des poursuites contre les héritiers bénéficiaires, en cette<br />
qualité seulement, puisqu'ils sont les représentants légaux de la succession<br />
du débiteur;<br />
—Que l'article 797 du Code civil édicté seulement un délai<br />
pendant lequel l'héritier bénéficiaire ne peut être atteint par une condamna-<br />
lion —<br />
personnelle, qui enlraînerait la qualité d'héritier pur et simple;<br />
Qu'aux termes de l'art. 800, la faculté du bénéfice d'inventaire et ses effets<br />
subsistent après l'expiration des délais de l'art. 797, ce qui est précisément<br />
— le cas dans lequel se trouvent les intimées; Mais que lesdiles intimées<br />
n'ont pas sollicité de délai judiciaire, conformément à l'art. 798 ;<br />
— Qu'elles<br />
ne se trouvent pas dans les cas prévus par l'art. 799, et que par conséquent,<br />
aux termes de cet article, elles sont en demeure, et du moins en faute de<br />
négligence dans la liquidation des successions dont elles sont comptables, et<br />
à ce titre, personnellement passibles des frais de poursuites.<br />
Par ces molifs : LA COUR, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'ap<br />
pelant non recevable quant à présent à obtenir contre les intimées des con<br />
damnations personnelles ;<br />
— Et<br />
le réformant pour le surplus, condamne les<br />
intimées, mais seulement en leur qualité d'héritières bénéficiaires de la veuve<br />
Couriol, à payer à l'appelant 1,967 francs 60 centimes avec intérêtsà 10 p. °/o<br />
— du jour de la demande ; Les en leur qualité d'héri<br />
condamne également,<br />
tières bénéficiaires du sieur Couriol, à payer à l'appelant la part de la somme<br />
ci-dessus qui correspondrait aux droits qui seront attribués à Couriol sur les<br />
immeubles réparés, mais sans qu'il puisse résuller double emploi de ces<br />
deux chefs de condamnation. Ordonne la restitution de l'amende. Condamne<br />
les intimées personnellement aux dépens de première instance et d'appel.<br />
M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; M?» Chéronnet et Garau, av.<br />
Alger. —<br />
Typ. A. Jodbdmi.
2e année. —<br />
ier Mars 1878. —<br />
N° 29<br />
BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE.<br />
- LEGISLATION<br />
DU RENVOI DEVANT UNE NOUVELLE COUR OASSISES<br />
APRÈS CASSATION<br />
On trouvera plus loin, page 71, un arrêt: rendu le 8 janvier 1878<br />
par la Cour de Cassation dans une affaire Mohamed ben Hamadouch<br />
et consorts : c'est la deuxième décision de Cassation reproduite par<br />
notre Recueil relativement à la même affaire (Voir Bull, jud., 1878,<br />
p. 4).<br />
Il s'agit d'un crime commis dans le département d'Oran, aux envi<br />
rons de Mascara. L'arrêt de condamnation intervenu devant la Cour<br />
d'assises d'Oran avait été cassé par la Cour suprême qui avait<br />
renvoyé devant la Cour d'assises d'Alger, et la décision de cette<br />
dernière a été également l'objet d'une cassation dont l'effet est de<br />
faire renvoyer actuellement l'affaire devant la Cour d'assises de<br />
Constantine .<br />
Cette affaire criminelle aura donc passé successivement d'Oran à<br />
Alger, d'Alger à Constantine; et si par une fatalité quelconque, les .<br />
accusés étaient encore une fois déclarés coupables et qu'un vice de<br />
forme se fût de nouveau glissé dans la procédure, c'est devant les<br />
jurés de Bône ou ceux des Bouches- du-Rhône que le procès aurait à<br />
revenir .<br />
C'est à propos de ces renvois devant une autre (Jour d'assises, et<br />
des inconvénients sérieux qui en sont la conséquence, qu'il nous pa<br />
raît utile d'émettre quelques considérations.<br />
Ces renvois sont prononcés aux termes de l'art. 429 du Code<br />
d'instr. crim., qui s'exprime ainsi :<br />
«"<br />
La Cour de Cassation prononcera le renvoi du procès, savoir :<br />
» Devant une Cour d'appel autre que celle qui "aura réglé la compé-<br />
» tence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour<br />
» l'une des causes exprimées en l'art. 229.— Devant une Cour d'assises
66<br />
» autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont<br />
» annulés pour cause de nullités commises à la Cour d'assises. »<br />
On s'explique facilement les raisons d'une telle<br />
disposition : le lé<br />
gislateur a pensé que les conditions d'impartialité seraient plus com<br />
plètes devant une juridiction qui n'aurait,<br />
à aucun point de vue et<br />
sous aucune forme, connu précédemment de l'affaire portéedevant elle.<br />
Les inconvénients, d'autre part, en sont assez insignifiants en<br />
France. 11 n'y a pas, entre deux sièges voisins quelconques de Cour<br />
d'assises en France, un éloignement assez considérable pour que les<br />
intérêts de la justice et en particulier ceux de la non défense, plus<br />
que les intérêts pécuniaires du puissent Trésor, être lésés par un tel<br />
déplacement de l'affaire.<br />
En est-il de même en Algérie ? —<br />
l'admettre.<br />
Il<br />
nous parait impossible de<br />
La distance extrême qui sépare ici les sièges d'assises les uns des<br />
autres,<br />
a au contraire pour effet d'entraîner des résultats extrême<br />
toutes les fois qu'un renvoi de ce genre est prononcé.<br />
ment fâcheux,<br />
Il s'agit par exemple dans l'espèce,<br />
la province d'Oran, et qui à Oran même,<br />
d'une affaire venant du sud de<br />
était déjà jugée assez loin<br />
de son lieu d'origine ; que sera-ce si par suite de renvois prononcés<br />
par la Cour suprême, cette affaire doit paraître à Alger,<br />
tine, à — peut-être Bône,<br />
devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône ?<br />
C'est de deux cents,<br />
sera obligé d'appeler les témoins ! —<br />
pour ceux-ci,<br />
accessoire,<br />
semaines durant 1<br />
à Constan<br />
même, au cas de nouvelle cassation,<br />
de trois cents lieues que -le ministère public<br />
Quels<br />
dérangements onéreux<br />
obligés d'abandonner pour une déposition peut-être<br />
leur domicile et leurs affaires pendant une ou deux<br />
— Que<br />
de chances de manquement de la part de ces<br />
témoins aux citations qu'ils auront reçues ? —<br />
quelles dépenses considérables pour le Trésor ! (1)<br />
Et<br />
par dessus tout,<br />
A un autre point de vue bien important encore, on peut comprendre<br />
combien cet éloignement si grand entre le lieu où doit se juger l'affaire<br />
et l'endroit où- les faits à juger ont été commis, peut nuire aux<br />
intérêts de la défense. Si l'accusé n'est pas dans un réel état d'indi-<br />
(1) On peut compter que dans l'affaire Hamadouch dans laquelle il a. quinze y<br />
témoins à charge, les taxes de ces témoins peuvent faire monter les frais de la<br />
procédure d'Alger, de S à 3,000 francs, et ceux de la procédure de Constantine,<br />
On voit l'importance de la question pour le budget des<br />
de 3 à 4,000 au moins ! —<br />
frais de justice criminelle !
67<br />
gence, c'est à ses frais qu'il doit faire venir ses témoins à décharge,<br />
et quel que soit le résultat de l'affaire, ces frais rendus si lourds par<br />
la distance, resteront à son compte en tous les cas dans l'état actuel<br />
de notre législation. —<br />
L'accusé<br />
est éloigné des siens, de tous ceux<br />
qui peuvent l'appuyer de leurs attestations ; il est éloigné de ses<br />
moyens de justification que son conseil, désigné parfois quelques<br />
jours à peine avant l'audience, n'a plus lé temps de rechercher si<br />
— loin ; de telles distances sont donc susceptibles, comme on le voit,<br />
de compromettre gravement la libre défense des accusés.<br />
N'y<br />
aurait-il pas lieu de porter remède à une situation aussi re<br />
—<br />
grettable ? Nous n'hésitons pas à penser que c'est chose nécessaire,<br />
et en le déclarant, en préconisant l'adoption d'une mesure spéciale à<br />
l'Algérie pour ce cas particulier, nous ne croyons pas être en contra<br />
diction avec cette thèse tant de fois défendue par nous, qu'il faut<br />
assimiler, dans la plus large mesure possible,<br />
de l'Algérie à celle de la France .<br />
l'organisation judiciaire<br />
Cette thèse doit avoir précisément à notre avis un tempérament<br />
indispensable quant aux distances qui séparent ici les différents cen<br />
tres judiciaires ; c'est pour ce motif que nous avons approuvé en<br />
principe l'institution des jugés de paix à compétence étendue ; c'est<br />
aussi par cette unique raison qu'une modification à l'art. 429 du<br />
Code d'instr. crim. nous paraît absolument désirable.<br />
La modification est, au surplus, d'autant plus facile à opérer,<br />
qu'elle existe déjà depuis quinze ans en ce qui concerne les renvois<br />
par suite de cassation, devant la Chambre des mises en accusation .<br />
Voici, en effet,<br />
(Mén. n, p. 121) :<br />
ce que porte la loi des 9 mai-21 septembre 1863<br />
« La Cour de Cassation, lorsqu'elle annule un arrêt de la Chambre<br />
» des mises en accusation de la Cour d'Alger, prononce le renvoi du<br />
» procès devant une autre chambre de ladite Cour. Cette chambre<br />
» procède, au nombre de cinq juges, comme chambre d'accusation.<br />
» Aucun des magistrats qui ont participé à l'arrêt annulé ne peut en<br />
» faire partie.<br />
— Néanmoins,<br />
la Cour de Cassation peut,<br />
suivant les<br />
» circonstances, renvoyer l'affaire devant la Chambre des mises en<br />
» accusation d'une autre Cour d'appel. »<br />
Les raisons qui ont dicté cette modification au 1er paragraphe de<br />
l'art. 429 du Code d'instr. crim., ne sont pas comparables, suivant<br />
nous, comme gravité,<br />
à celles qui appellent pour l'Algérie une modi-
68<br />
fication au 2e paragraphe de ce même article, et nous n'entrevoyons<br />
pas d'inconvénients que puisse présenter cette dernière innovation,<br />
s'il est bien déterminé que l'accusé ne retrouvera en aucun cas de<br />
vant lui, ni les mêmes jurés, ni les mêmes magistrats,<br />
on reproduit pour parer à toute éventualité,<br />
mée dans la loi de 1863.<br />
et si en outre<br />
la réserve finale expri<br />
Nous émettons, en conséquence, le vœu qu'une proposition de loi,<br />
motivée sur les considérations que nous venons de formuler, soit sou<br />
mise aux Chambres dans le sens que voici :<br />
« La Cour de cassation, lorsqu'elle cassera un arrêt d'une des Cours<br />
» d'assises de l'Algérie,<br />
prononcera le renvoi du procès devant la<br />
» même Cour d'assises autrement composée. Aucun des magistrats<br />
» qui auront participé à l'arrêt annulé,<br />
ne pourra en faire partie. La<br />
» liste sur laquelle le tirage des jurés de jugement devra s'opérer,<br />
» ne pourra contenir aucun des noms compris sur la liste du jury<br />
» qui aura servi au précédent tirage. —<br />
Néanmoins<br />
la Cour de cas-<br />
» sation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'affaire devant<br />
» une autre Cour d'assises,<br />
» crim. »<br />
I. Vente, —<br />
conformément à l'art. 429 du Code d'inst.<br />
V. Mallarmé.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
Présidence de M. MERCIER,<br />
20 novembre 1877.<br />
premier président.<br />
Mandataire, personne interposée. —<br />
Prescription, jour (â quo). — II.<br />
ance.<br />
Chefaâ. —<br />
Nullité.<br />
—<br />
Délai, déché<br />
I. La prescription décennale de l'action en milité ouverte au mandant con<br />
tre l'actepar lequel le mandataire s'est porté acquéreur, par l'intermédiaire d'une<br />
personne interposée, d'un bien qu'il était chargé de vendre, ne court qu'à dater<br />
du jour où le •<br />
égard (G. civ. 1304, 1596).<br />
mandant a découvert la simulation frauduleuse commise à son<br />
//. En Algérie, le propriétaire d'une part indivise dans un immeuble qui a<br />
été autorisé par jugement à exercer sur la part de son copropriétaire, vendue<br />
par ce dernier, le chefaâ, ou droit de préemption admis par la législation mu-
69<br />
sulmane, peut être déclaré déchu de ce droit s'il a laissé passer le délai d'un an<br />
fixé par ladite législation pour l'exercice du chefaâ, sans payer à l'aequéreur<br />
l'indemnité qu'il lui doit (L. 16 juin 1851, art. 17) (1) .<br />
Consorts Merzouga c. Bernard et autres.<br />
Par acte en dale du 15 mars 1859, le sieur Ersham, agissant comme man<br />
dataire des trois frères Daly-Ahmed, Muslapha et Mohamed, a vendu au sieur<br />
Hardemayer, son beau-frère, les parts indivises de ses mandants dans le do<br />
maine de Blad-Ben-Ismaël, situé sur le territoire de Milianah, et qui représen<br />
— taient un neuvième de la propriété entière. Le 7 novembre 1862, après<br />
le décès d'Ersham, le sieur Hardemayer a vendu au sieur Claude Bernard,<br />
moyennant une rente perpétuelle de 700 fr., tous les droits qu'il avait acquis<br />
dans le domaine de Blad-Ben-Ismaël. En 1864, un jugement rendu entre les<br />
sieurs Guérin et Hardemayer, héritiers du sieur Ersham, a reconnu que, dans<br />
la vente passée en 1859 par ce dernier, comme mandalaire de Daly-Amed et<br />
de ses frères, Hardemayer n'avait joué qu'en apparence le rôle d'acquéreur,<br />
et qu'il n'avait été que le piête-nom d'Ersham lui-même.<br />
Par exploit du 9 juin 1866, les consorls Merzouga, copropriétaires du do<br />
maine de Blad-ben-Ismaël, ont introduit, tant contre la succession Ersham<br />
que contre Claude Bernard, l'aclion de chefaâ ou de préemption à l'effet de<br />
racheier à leur profit la part aliénée par Daly-Amed el ses frères. Sur cette<br />
assignation, le tribunal de Blidah a rendu, le 10 juin 1868, un jugement dont<br />
le^dispositif est ainsi conçu:<br />
« Dit et déclare que les consorts Merzouga sont admis à exercer le droit de<br />
chefaâ contre Claude Bernard, et substitués au bénéfice de la vente du 7 novembre<br />
1862, dont acte aux consorts Merzouga, moyennant l'offre qu'ils font de rem<br />
bourser à Claude Bernard le capital de la rente de 700 francs évaluée au taux de<br />
10 p. 100, leur donne acte également de ce qu'ils sont prêts à payer à Claude Ber<br />
nard la somme de 1 fr. pour frais et loyaux coûts, sauf à. parfaire, et sous le bé<br />
néfice de cette offre, dit et ordonne que Claude Bernard sera tenu de remettre au<br />
retrayant tous titres établissant ses droits et ceux de son vendeur; réserve toute<br />
fois les droits des tiers valablement conservés, etc.<br />
Ce jugement, signifié le 3 juin 1869,<br />
a acquis l'autorité de la chose<br />
jugée. Cependant, les consorts Merzouga, ainsi autorisés à exercer<br />
le retrait, n'ont pas manifesté l'intention d'exécuter la décision ren-.<br />
due à leur profit, et malgré la sommation qui leur a été adressée par<br />
la succession Ersham, ils ont persisté dans leur inaction. La succes<br />
sion Ersham les a cités devant le tribunal de Blidah pour les faire<br />
déclarer déchus du droit de chefaâ, faute de l'avoir exercé en temps<br />
utile ; en même temps elle a actionné Claude Bernard en résolution<br />
de la vente qui lui avait été consentie en 1862,<br />
ment du prix.<br />
pour défaut du paye<br />
Dans le cours de l'instance, la veuve et le fils de Daly-Ahmed, en<br />
leur qualité d'héritiers de celui-ci, sont intervenus au procès,<br />
(1) V. la note de la page 223 du vol. 1877,<br />
et ont
70<br />
demandé que la vente du 15 mars 1859 fût déclarée nulle, peur 4a<br />
part appartenant à leur auteur dans le bien comme vendu, ayant été<br />
faite au mandataire lui-même, et que cette nullité fût étendue, par<br />
voie de conséquence, à la revente consentie en 1862. Le 24 avril 1872<br />
jugement qui déclare les héritiers de Daly-Ahmed non recevables dans<br />
leur intervention, et prononce la déchéance du chefaâ contre les con<br />
la succession<br />
sorts Merzouga, au cas où, dans le délai de six mois,<br />
Ersham n'aurait pas été payée de tout ce qu'il lui était dû comme in<br />
demnité de retrait . Les consorts Merzouga se sont conformés à cette<br />
décision, et ont, dans le délai fixé par le tribunal, versé l'indemnité<br />
par eux due à la Caisse des dépôts et consignations.<br />
Le jugement du 24 avril 1872 a été frappé d'appel par le sieur Claude Ber<br />
nard et par les héritiers Daly-Ahmed . Le 1 1 décembre 1 873, arrêt delà Cour<br />
d'Alger, dont le dispositif est ainsi conçu :<br />
« Joint les appels et situant sur le tout par un seul et môme arrêt;<br />
droit sur l'appel de Hanifa-ben-Mohamed-ben-Yani-Youldah et Mustapha-ben-<br />
— Disant<br />
Ahmed-ben-SIiman, dit Daly-Ahmed, son reçoit fils, lesdits Hanifa et Mustapha<br />
— intervenants au procès et tiers opposants au jugement du 10 juin 1868; Au<br />
— Infirme<br />
fond,<br />
le jugement dont est appel et rétracte le jugement du 1 0 juin 1868,<br />
en ce qu'ils ont maintenu,<br />
aussi bien pour les parts de Daly-Ahmed que pour<br />
celles de ses deux frères Mohamed et Mustapha, la vente du 15 mars 1859, faite<br />
par Ersham à Hardemayer, et celle du 7 novembre 1862, par le mandataire de<br />
— Déclare lesdites ventes nulles et de nul effet,<br />
Hardemayer à Claude Bernard ;<br />
mais seulement en ce qui concerne les parts afférentes à l'auteur de Hanifa et<br />
Mustapha, parts qtii consistent dans 391/5.40 du 1/9 de Blad-Ismaèl, lesdites ventes<br />
étant maintenues en ce qui concerne le surplus; — Dit et déclare, moyennant ce,<br />
lesdits Hanifa et Mustapha seuls propriétaires des parts dont s'agit, et déboute,<br />
en conséquence, quant à ce, les consorts Merzouga de leur action en exercice<br />
sur l'appel de Claude Bernard.,.., déclare les consorts<br />
■— de chefaâ; Statuant<br />
Merzouga déetrus de l'exercice du droit du chefaâ, etc. »<br />
Pourvoi par les consorts Merzouga pour violation, par fausse ap<br />
plication des art. 1596, 1304 et 1358, C. civ., ainsi que du principe<br />
de la chose jugée et de la loi musulmane, en ce que l'arrêt attaqué,<br />
poursuivi par les demandeurs en cassation, a prononcé là nullité de<br />
parfaitement régulières, et en tout cas ratifiées, et méconnu<br />
l'autorité d'un jugement de 1868,<br />
jugée,<br />
ayant acquis l'autorité de la chose<br />
et qui les avait admis à exercer cette même action.<br />
LA COUR, —<br />
Sur<br />
ARRÊT :<br />
le premier moyen ;<br />
lité ouverle par l'art. 1596, C. civ.,<br />
— Attendu<br />
que si l'action en nul<br />
se prescrit par dix ans à compter du jour<br />
même de la passation de l'acte contre lequel elle est dirigée, quand le man<br />
dataire s'est directement et ouvertement rendu acquéreur des biens<br />
était chargé de vendre, il n'en saurait être ainsi, lorsque, dans le but de se<br />
soustraire à la prohibition établie par ledit article, il a eu recours à l'inter<br />
— médiaire d'une personne interposée ; Que, par application des considéra<br />
tions qui ont dicté les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1304, on doit<br />
décider que, dans ce cas, la prescription de dix. ans ne commence à courir
71<br />
que du jour où le mandant a découvert la simulation frauduleuse dont le<br />
— mandataire s'est rendu coupable à son égard ; Attendu que l'arrêt attaqué<br />
constate en fait, que la veuve et les fils du Daly-Ahmed, qui lui-même,<br />
n'avait point eu connaissance de la simulation, ont intenté leur action en<br />
nullité avant l'expiration de dix années à partir du jour eu ils ont appris<br />
que dans la vente passée le 15 mars 1859, par Ersham, mandataire de leur<br />
mari el père à Hardemayer, ce dernier n'était que le prête-nom dudit man<br />
dataire;<br />
— D'où<br />
il suit, qu'en déclarant cette action non prescrite, l'arrêt<br />
attaqué n'a ni violé l'art. 1304 ni faussement appliqué l'art. 1596 C. civ. ;<br />
— Sur .le deuxième moyen ; Attendu que l'art. 17, al. 2, de la loi du 16 juin<br />
1851, qui maintient, en Algérie, l'action en retrait connue sous le nom de<br />
droit de chefaâ, en donnant toutefois aux tribunaux le pouvoir d'autoriser<br />
ou de refuser le retrait, n'a modifié, sous aucun rapport, l'exercice de cette<br />
action qui continue à être régie par la loi musulmane;— Attendu que,<br />
d'après les principes de cette loi, tels qu'ils sonl.alteslés par les auteurs les<br />
plus accrédités, le chefaâ doit, à peine de déchéance, Sre exercé dans l'année<br />
— à dater du jour où le retrayant obtenu connaissance de la venle ; Que,<br />
d'un autre côté, le retrait exercé dans ce délai est frappé de nullité si dans<br />
les trois jours au plus tard, à partir de son exercice, le retrayant n'a pas<br />
— réalisé ses offres et payé au relrayé l'indemnité du retrait ; Attendu que<br />
l'arrêt attaqué, faisant courir le premier de ces délais du 10 juin 1868, jour<br />
auquel le tribunal de Blidah avait admis les consorts Merzouga à l'exercice du<br />
chefaâ, a déclaré ces derniers déchus de ce droil pour avoir laissé passer plus<br />
— Attendu qu'en admettant avec le pourvoi, que<br />
de deux ans sans l'exercer ;<br />
celte cause de déchéance ne fût pas applicable à un retrait déjà opéré<br />
par l'effet du jugement du 10 juin 1868, qui avait déclaré les consorts Mer<br />
zouga substitués au bénéfice de la venle du 7 novembre 1862, la condition<br />
de ces derniers ne s'en trouverait pas améliorée, puisque la non -réalisation<br />
de leurs offres dans les trois jours dudit jugement, ou tout au moins dans les<br />
trois jours de la sommation qui leur avait adressée été, à cet effet, le 28<br />
août 1870, aurait entraîné la nullité du retrait qu'ils prétendent avoir exercé;<br />
— D'où il suit, qu'en déclarant les demandeurs déchus du droit d'exercer<br />
un retrait qui, eût-il été exercé en temps utile, ne l'aurait pas été d'une<br />
manière régulière et efficace, l'arrêt attaqué n'a ni porté atteinte à la chose<br />
jugée,<br />
ni violé aucune loi.<br />
Par ces motifs : Rejette.<br />
M. Aubry, rap. ; M. Charrins, 1er av. gén., c. conf. ; M
72<br />
Lorsque l'acte de notification à un accusé de la liste des jurés de la session<br />
contient des erreurs multipliées sur le nom patronymique et le domicile de plu<br />
sieurs jurés, il y a lieu à cassation de l'arrêt, l'accusé ayant été placé par suite<br />
de ces erreurs, dans l'impossibilité d'exercer son droit de récusation en pleine<br />
connaissance de cause (1) .<br />
Lorsqu'il y a dans une affaire plusieurs accusés, l'erreur commise au préju<br />
dice de l'un d'eux dans la notification à lui faite de la liste des jurés, doit-elle<br />
profiter aux autres condamnés,<br />
lument régulière et exacte? (Non résolu) (2).<br />
vis'-à-vis de laquelle la notification a été abso<br />
Les erreurs contenues dans la notification de la liste du jury peuvent cons<br />
tituer de la part de l'officier ministériel qui a procédé à cette notification, une<br />
faute lourde susceptible d'entraîner contre'lui, aux termes de l'art. 415 du Code<br />
d'Instruction criminelle, la mise à sa charge de tous les frais de la procédure<br />
à recommencer (3) .<br />
(1)<br />
Cette solution est conforme à une jurisprudence constante; la Cour de Cas<br />
sation a rendu un grand nombre d'arrêts fixant les distinctions suivant lesquelles<br />
les erreurs commises dans la notification de la liste des jurés, sont ou non suscep<br />
tibles d'-entraîner la cassation de l'arrêt.<br />
(2) C'est par erreur que l'arrêt parle d'inexactitudes commises dans fa notifica<br />
tion faite aux accusés: en réalité il ne s'en trouvait que dans la copie signifiée à<br />
Mohamed ould Erabareck; et cette copie transmise à la Cour suprême avec une<br />
note du défenseur de cet accusé, a amené l'examen du moyen qui n'a donc pas été<br />
soulevé d'office. Quant aux copies signifiées aux deux, autres accusés, elles ne<br />
contenaient aucune matière à critique, et elles n'ont même pas été jointes au<br />
dossier pour être soumises àla_Cour de Cassation.<br />
L'erreur dans laquelle la Cour suprême est tombée sur ce point,<br />
a eu pour con<br />
séquence de laisser inaperçue la question délicate que nous posons dans notre<br />
sommaire.<br />
A notre avis, les inexactitudes graves commises dans la copie signifiée à un des<br />
accusés devaient entraîner la cassation non-seulement en ce qui le concernait, mais<br />
encore pour tous les autres : — en effet, le droit de récusation n'est-il pas exercé<br />
concurremment par tous les accusés, et l'erreur dans laquelle un d'eux serait<br />
tombé n'aurait-elle pas eu pour effet de vicier la composition du jury pour les autres?<br />
Nous n'avons trouvé aucun documentde jurisprudence particulier à cette ques<br />
tion;<br />
mais on pourra consulter par analogie les arrêts rendus en sens divers sur<br />
la question de savoir si la notification de la liste des jurés à plusieurs accusés, sans<br />
que tous aient reçu copie, ne profite qu'à ceux vis-à-vis desquels cette formalité<br />
essentielle a été omise. (Voir Roland de Villargues, sur l'art. 395, g 122 et'suiv.)<br />
(3) On pourra trouver peut-être que la négligence commise par quelque clerc<br />
de l'huissier, a été réprimée bien sévèrement contre ce. dernier, par la Cour de cas<br />
sation qui, elle aussi, est parfois sujette à erreur (la note qui précède le prouve<br />
bien). Mais il est certain que cette pénalité rigoureuse est conforme à l'interpré<br />
tation donnée par la jurisprudence à l'art. 415 du Code d'instruction criminelle.<br />
(V. Roland de "Villargues sur l'art. 415, § 1 et suiv. notamment ji 6).<br />
On trouvera plus haut, page 65, les réflexions qui nous ont paru ressortir du<br />
double renvoi si onéreux prononcé successivement dans cette affaire, d'Oran à<br />
Alger et d'Alger à Constantine,<br />
V. M.
73<br />
Mohamed ben Hamadouch el consorts.<br />
Sur le moyen relevé -d'office et tiré d'une violation de l'art. 395 du Code<br />
d'instruction criminelle, en ce que la notification faite aux accusés le 23<br />
novembre dernier de la liste des jurés de la session présenterait de notables<br />
et nombreuses erreurs sur les noms et les domiciles de plusieurs des jurés<br />
compris dans cette liste ; Que notamment le juré Bouron, propriélaire à Mé-<br />
déah, a été désigné dans la copie notifiée sous le nom de Bourau propriélaire<br />
place d'Isly à Alger ; que le juré Guigon a élé dénommé Guigau ; que pour<br />
neuf autres des jurés, les domiciles ont élé indiqués dans les villes autres que<br />
— celles où ils résident ; Attendu que la désignation exacte du nom patrony<br />
mique du juré et de son domicile, est indispensable pour l'exercice complet<br />
du droit de récusation qui appartient aux accusés; qu'en l'absence de ces<br />
dispositions et des nombreuses, erreurs commises dans la notification du 23<br />
novembre dernier, il est demeuré impossible pour les demandeurs au pour<br />
voi, d'exercer leur droit de récusation en pleine connaissance de cause ; que<br />
par suite les droits de la défense el les disposilions.de l'art. 395 du Code<br />
d'instruction criminelle, ont été manifestement violés;<br />
— Attendu<br />
que les<br />
irrégularités dont il s'agit ont été commises par la négligence du sieur B. . .<br />
,<br />
huissier près la Cour d'Alger, qui a procédé à la notification dont il s'agit;<br />
qu'elles constituent parleur gravité exceptionnelle, une faute prévue par<br />
l'art. 415 du Code d'instruction criminelle ;<br />
Casse el annulle l'arrêt rendu le 24 novembre dernier par la Cour d'assises<br />
d'Alger, c. les nommés Mohamed ben Hamadouch etc. et pour être statué<br />
— sur la prévention, Renvoie la cause et les parties, en l'état où elles se<br />
devant la Cour d'assises de Constantine à ce déterminée par une dé<br />
trouvent,<br />
libération spéciale prise en la chambre du Conseil ;<br />
Déclare que les frais de la procédure à recommencer seront mis à la charge<br />
de l'huissier B. . . à la négligence duquel les nullités commises sont impu<br />
tables.<br />
M. Roussel, cons. rapp.; M. Benoist, av. gén-<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
12 décembre 1877.<br />
I, Autorisation de femme mariée. — Femme «assignée par<br />
son mari. — II. Puissance paternelle. — Droit<br />
Intervention des tribunaux.<br />
du "père. —<br />
/. Lorsqu'une femme mariée est appelée en justice par son mari, elle se<br />
trouve par cela même suffisamment autorisée à se défendre contre lui (1) .<br />
(1)<br />
Jurisprudence constante et absolument rationnelle.<br />
. — . ^— —-- — "«
74<br />
//. Durant le mariage, le père exerce seul la puissance paternelle. La loi<br />
n'a porté d'autre exception à cette règle que dans le prévu par l'art. 335<br />
du Code pénal .<br />
Les tribunaux ne peuvent intervenir pour modifier le droit du père relative<br />
ment à l'administration provisoire des enfants que lorsqu'il existe une demande<br />
en séparation de corps ( 1 ) .<br />
Michel c. dame Michel.<br />
ARRÊT :<br />
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation maritale;<br />
Attendu que la disposition de la loi qui ne permet pas à la femme d'esler en<br />
jugement sans l'autorisation de son mari,<br />
est une conséquence de la puis<br />
sance maritale, du droit qu'a le mari et du devoir qui lui incombe de veiller<br />
à ce que la femme ne compromette pas en justice les intérêts communs de<br />
— l'association conjugale ; Que dès lors, celle disposition ne peut avoir effet<br />
que dans les cas où la femme voudrait agir en justice de son propre mouve<br />
—<br />
ment ou y serait appelée par d'autres que son mari ; Mais qu'elle ne peut<br />
être invoquée par le mari qui, lui-même, a appelé sa femme en justice,<br />
puisqu'en dirigeant une action contre elle, eh manifestant expressément son<br />
intention d'obtenir un jugement contre elle, il l'a par cela même suffisamment<br />
autorisée à se défendre contre lui ;<br />
— Attendu<br />
que c'est donc<br />
—<br />
avec'<br />
raison<br />
—<br />
que le.tribunal<br />
ne s'est pas arrêté à l'exception soulevée par Michel ;<br />
Au fond: Attendu qu'il résulte des articles 371, 372, 373 et 374 du Code<br />
civil, que durant le mariage, le père exerce seul la puissance paternelle,<br />
que l'enfant mineur non émancipé est sous son autorité et ne peut quitter<br />
la maison paternelle sans l'autorisation de son père ;<br />
— Attendu que la<br />
loi n'a porté d'autre exception aux règles posées par ces articles que celle<br />
qui est écrite dans l'article 335 du Code pénal, lequel prévoit un cas<br />
— qui ne se présente pas dans la cause ; Qu'elle n'a autorisé l'intervention<br />
des tribunaux pour modifier le droit du père, relativement à l'administration<br />
provisoire des enfants, que lorsqu'il existe une demande en séparation de<br />
—<br />
corps, ce qui n'est pas ; Attendu que s'il était vrai, ainsi que le soutient<br />
la dame Michel, que l'autorité paternelle n'est ni absolueni sans contrôle et<br />
que les tribunaux sont investis du droit d'apprécier s'il y a, de la part du<br />
père, usage légitime ou abus de lapuissance paternelle, il faudrait recon<br />
naître que, dans l'espèce, on ne rencontre aucune circonstance de nature à<br />
— motiver une telle intervention de la justice ; Attendu, en conséquence,<br />
que c'est à tort que le jugement déféré, faisant droit aux prétentions de la<br />
(1) Les considérants de l'arr.êt portent que c'est la loi qui autorise lés tribunaux<br />
à intervenir. Nous ne croyons pas que cette autorisation se trouve écrite dans la<br />
loi ; mais il est certain que les juges la tiennent d'une jurisprudence aussi sage<br />
que constante. Toutefois,<br />
il faut reconnaître que cette dérogation aux droits for<br />
mels du père ne doit être prononcée que pour les motifs les plus graves, et, ainsi<br />
que le porte un arrêt de la Cour d'Alger, du 27 juin 1864 (Robe, vi, 118 ; Narbonne,<br />
Rép., v° Puissance paternelle, n°<br />
l'enfant.<br />
5), seulement lorsqu'il y<br />
a abus ou danger pour
dame Michel,<br />
lance de celle-ci .<br />
75<br />
a laissé la jeune Marie-Jeanne en la garde et sous la surveil<br />
Par ces motifs: LA COUR, en ce qui concerne l'exception soulevée par<br />
Michel, confirme le jugement dont est appel —<br />
; Au fond, infirme ledit juge<br />
ment, et, statuant par décision nouvelle, dit : que Marie-Jeanne Michel ren<br />
trera sous la garde de son père ;<br />
— Condamne la dame Michel en tous les<br />
dépens de première instance et d'appel;'— Ordonne<br />
l'amende consignée.<br />
la restitution de<br />
M. Piette, av. gén. concl. conf. ; Mes Narbonne et Doudart de la Grée. av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
24 décembre 1877<br />
Mandat. — Commis-Voyageur. — Vente.<br />
Un commis-voyageur est le représentant, le mandataire de la maison pour<br />
laquelle il voyage, et possède par suite le pouvoir exprès ou tacite de conclure<br />
des marchés, lorsque sa mission n'est pas restreinte aux seules attributions de<br />
faire des offres et de recevoir des propositions qu'il transmet ensuite à son<br />
préposant.<br />
Celui-ci ne saurait donc se refuser à exécuter le marché contracté par son<br />
voyageur,<br />
ché (1) .<br />
alors qu'aucune réserve de ratification n'a accompagné ce mar<br />
Housset c. Ferraky.<br />
Attendu que le 31 mars 1877, à Bône, Ferrary a, par l'intermédiaire du<br />
sieur Servant, son commis-voyageur, vendu à Housset divers articles de son<br />
commerce et notamment trois kilogrammes de quinine, dix kilogrammes<br />
d'iodure de potassium, deux kilogrammes de bromure de potassium et deux<br />
—<br />
kilogrammes de sous-nitrate de bismuth, le tout livrable en avril ;<br />
Attendu que le 13 avril, Ferrary annonçait à Housset qu'il ne pouvait lui<br />
expédier ces dernières marchandises que s'il consenlait à les payer à des<br />
prix qu'il fixait et qui étaient supérieurs aux prix convenus, parce que,<br />
(1) Voir dans Dalloz, Code civil annoté, sur l'art. 1989, § 35 et suiv., l'indication<br />
des différents systèmes admis par la jurisprudence sur le mandat des commis-<br />
voyageurs. — La<br />
(D. 1873, 5, 315)<br />
— question est controversée, Un arrêt d'Aix du 12 avril 1872<br />
la résout dans un sens opposé à l'arrêt rapporté. La jurispru<br />
dence de la Cour d'Alger semble au contraire fixée dans le sens de ce dernier<br />
(voir Alger, 5 février 1877. Bull. jud. 1877, p. 145.)
76<br />
Housset, loin<br />
—<br />
disait-il, il y avait eu erreur de la part de Servant; Que<br />
d'acquiescer à cette prétention, ayant déclaré qu'il exigeait l'exécution du<br />
marché, Ferrary soutint alors que n'ayant pas ratifié la venle consentie par<br />
Servant, il n'était pas ténu de s'exécuter, parce qu'un voyageur qui n'a pas<br />
la procuration d'une maison ne peut vendre ferme et que toutes ses ventes<br />
— doivent être approuvées par la maison expéditrice ; Attendu qu'un com<br />
mis-voyageur est le représentant, le mandataire de la maison de commerce<br />
pour laquelle il voyage el qu'il a, par suite, le pouvoir exprès ou tacite de<br />
conclure des marchés, lorsque sa mission n'est pas restreinte aux seules at<br />
tributions de faire des offres et de recevoir des propositions qu'il transmet à<br />
son préposant ;<br />
— Attendu<br />
que Housset méconnaît, el que Ferrary n'allègue<br />
même pas que Servant ait jamais vendu à Housset sous réserve de ratifica<br />
tion ;<br />
— Attendu<br />
qu'aucun mandat écrit n'étant représenté et la qualité de<br />
commis-voyageur étant reconnue à Servant par Ferrary, il convient, pour<br />
déterminer l'étendue du mandat de Servant, d'examiner la manière dont les<br />
conventions qu'il a conclues au nom de Ferrary, avec d'autres personnes, ont<br />
— été faitespar lui et exécutées par Ferrary ; Attendu qu'il résulte des do<br />
cuments de la cause, qu'à la même date du 31 mars, ou à une dale Irès-rapprochée,<br />
Servant a, en Ja même qualité de commis-voyageur de Ferrary,<br />
reçu, sans parler de ratification nécessaire, des commandes de plusieurs<br />
autres négociants de Bône et que ces commandes ont été exécutées en entier<br />
par Ferrary, sans ratification préalable —<br />
; Attendu qu'il suit de là que<br />
Servant n'avait pas la mission restreinte de recueillir pour les transmettre à<br />
Ferrary, des propositions que celui-ci était libre d'accueillir ou de rejeter ;<br />
mais au contraire qu'il était investi des pouvoirs suffisants pour conclure des<br />
marchés que Ferrary ne pouvait se dispenser d'exécuter;— Attendu qu'il<br />
résulte également des documents de la cause, qu'à l'époque de la vente dont<br />
il s'agit, les prix fixés étaient en rapport avec le cours de la marchandise, que<br />
c'est donc uniquement pour se soustraire à la perle résullant pour lui de la<br />
variation dans ce prix survenu entre le jour de la vente et celui où il en a eu<br />
connaissance, que Ferrary, après avoir tenté de se faire payer par Housset<br />
des prix supérieurs aux prix convenus, a parlé de ratification nécessaire et<br />
— refusé l'exécution du marché ; Que c'est donc à bon droit que Housset<br />
demande la résiliation de ce marché à raison de sa non-exécution et conclut<br />
à ce que Ferrary soit condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé par<br />
— son refus de livraison à l'époque convenue ; Attendu que la Cour possède<br />
les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le chiffre de ce préjudice.<br />
— Par ces motifs : admet l'appel de Housset ; Infirme le jugement déféré ;<br />
— Déclare la convention verbale du 31 mars 1877 résiliée aux torts de Fer<br />
rary ; —Condamne celui-ci à payer à Housset, à litre de dommages-intérêts,<br />
la somme de douze cents francs. Le condamne en lous les dépens tant de<br />
première instance que d'appel.<br />
M. Piette, av. gén. ; Mes Chéronnet et Dazinière, av.
•77<br />
TRIBUNAL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />
Présidence de M. DELACROIX, président.<br />
5 février 1878.<br />
Louage. — Industries similaires. — Étendue<br />
obligations du bailleur.<br />
des droits et<br />
L'article 1719 du Code civil n'apour but que de garantir au preneur la pai<br />
sible jouissance de la chose louée, et non de lui assurer l'exercice exclusif de<br />
son commerce, en imposant au bailleur l'obligation de le garantir contre toute<br />
concurrence. Le droit du propriétaire ne peut être restreint que par la volonté<br />
commune des parties, manifestée d'une façon quelconque .<br />
En conséquence, en l'absence de toute convention de nature à restreindre<br />
son droit, le propriétaire qui a loué une partie de sa maison pour une indus<br />
trie déterminée, a le droit d'en louer une autre partie pour une industrie simi<br />
laire (1).<br />
Chantoub Akiba c. Narboni et Borge.<br />
Attendu que le droit de propriété confère la faculté d'user et de disposer<br />
— de sa chose en toute liberté, dans les limites qu'a posées la loi ; Que ce<br />
droit, consacré par l'article 544 du Code civil, est absolu et qu'aucune loi n'y<br />
apporte de restriction pour le cas où le propriétaire a loué une partie de son<br />
— immeuble à un commerçant ; Que dans ce cas le propriétaire conserve la<br />
faculté d'admettre dans le surplus de l'immeuble un second preneur exerçant<br />
une industrie similaire ou même identique à celle exercée par le premier<br />
preneur;<br />
— Attendu<br />
que l'article 1719 qui oblige le bailleur à faire jouir<br />
paisiblement le preneur pendant la durée de son bail, est dominé parles<br />
—<br />
principes généraux qui fondent et garantissent la propriété ; Que cet arti<br />
cle n'a eu en vue que la jouissance matérielle des lieux el leur libre posses<br />
sion, mais'ne peut s'étendre aux circonslances extérieures qui pourraient<br />
entraver ou gêner l'exercice et le développement de la profession du loca<br />
—<br />
taire; Attendu que le droit du propriélaire, à défaut d'une restriction<br />
posée par une disposition législative, ne peut être limité que par la volonté<br />
commune des parties, volonté dont la preuve peut ressortir soit des termes<br />
explicites du contrat, soit des faits contemporains dudit contrat cl manifes<br />
— tant celte commune inlenlion ; Qu'en dehors de ces circonstances, il n'est<br />
pas permis de suppléer au silence des conventions sans s'exposer à fixer d'une<br />
manière arbitraire les limites dans lesquelles devrait s'exercer le droit du<br />
(1)<br />
La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans ce sens après de longues con<br />
troverses. (Voir notamment Cass. civ., 6 nov. 1867 (D. 1868, 1, 129). Cass. Req.<br />
29 janv. 1868 (D. 1868, 1, 213). Metz, 26 nov. 1868 (D. 1869, 2, 44). Paris 16<br />
janv. 1874 (D. 1877, 2, 229).<br />
Le Code civil annoté de Dalloz, sur l'art. 1719, § 87 et suivants, indique avec le<br />
plus grand détail toutes les distinctions que la jurisprudence a présentées succes<br />
sivement sur cette question,
78<br />
propriélaire; —Attendu que par actes sous seings-privés,<br />
en date du 30 juin<br />
1870, enregistrés, Chantoub Akiba a loué^i Narboni et consorts une boutique<br />
faisant partie d'une maison; sise à Constantine, rue Caraman, pour y exercer<br />
que le bail ne contient aucune inter<br />
—<br />
la profession de mercier; Attendu<br />
diction pour le propriétaire de louer d'autres parties de sa propriélé à des<br />
— industries similaires à celle de Chantoub Akiba; Que, à défaut d'une<br />
clauseexpresse,<br />
cette interdiction, que Chantoub Akiba était libre de stipuler<br />
au contrat, ne peut s'induire des faits ni d'aucune circonstance de la cause.<br />
—<br />
D'où il suit que la demande de Chantoub Akiba rt'est nullement justifiée ;<br />
Attendu qu'en la rejetant, le tribunal n'a plus à statuer sur la double demande<br />
en garantie formée par Narboni et consorts contre la dame Borge el par la<br />
— dame Borge contre Siméon Isaac ; Que les demandeurs en garantie n'ont<br />
éprouvé aucun préjudice el qu'il n'y a pas lieu de leur accorder des dom<br />
mages-intérêts.<br />
Par ces motifs : Jugeant contradictoirement et en premier ressort, sans<br />
s'arrêter aux faits articulés par Chantoub Akiba ni à sa demande subsidiaire,<br />
à fins de preuve testimoniale, le déclare mal fondé dans sa demande, l'en dé<br />
boute. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes en garantie ni d'accor<br />
der des dommages-intérêts à leurs auleurs. —<br />
aux dépens envers toutes parties.<br />
Condamne<br />
Chantoub Akiba<br />
M.deCastelbajac, subst.duPr. deto.Rep.;M«HAFFNER, GivoDANetGiLLOTTE,ai>.<br />
TRIBUNAL CORR- DE MOSTAGANEM<br />
Présidence de M. Constant FENET, juge<br />
11 janvier 1878.<br />
Maison de prêt sur nantissement. — Gages<br />
tres de pension et brevets de légionnaires. —<br />
l'article 411 1 du Code pénal.<br />
Incorporels. —•<br />
Ti<br />
Application de<br />
Les avances faites habituellement sur mise en dépôt à titre de gage de titres<br />
de pension et brevets de légionnaires, bien que portant sur des gages incor<br />
porels, tombent sous l'application de l'art. 411 du Code pénal. (1)<br />
(1) Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette<br />
dernière, statuant sur le pourvoi d'un sieur Mesquida coutre un arrêt de la Cour<br />
d'Alger, a jugé le 15 avril 1876 (D. 1876, I, 404) que les avances faites sur gages<br />
incorporels, comme par exemple sur dépôt de titres de pension ou de brevets de<br />
ne légionnaires, tombaient point sous l'application de la loi. L'arrêt de la Cour<br />
d'Aix intervenu sur renvoi dans la même affaire le 29 juin 1876 (8. 1876. 2. 237)<br />
s'est rangé à la doctrine de la Cour de cassation.<br />
Nous avons critiqué au Bull. jud. de 1877, p. 189, la distinction que la Cour de<br />
Cassation établit dans sa jurisprudence entre la mise en gage de brevets de légion<br />
naires ou de titres de pension — qu'elle déclare parfaitement licite, et la mise en<br />
gage de reconnaissances du mont-de-piété qu'elle déclare au contraire punissable.<br />
Le jugement que nous rapportons repousse avec raison, à notre cette avis,<br />
distinction,<br />
mais c'est pour se montrer plusjigoureux que la Cour suprême eteom-<br />
prendre à la fois sous l'application de la loi pénale, lesprêts sur gage atteints par cette<br />
dernière et les avances faites habituellement sur titres ou autres gages incorporels.
79<br />
Le Ministère public c. Judas. .<br />
Attendu qu'en principe, le prêt sur gage ou nantissement est libre ; mais<br />
que cette espèce de prêt devient répréhensible, lorsqu'elle dégénère en un<br />
véritable trafic à l'aide duquel le créancier gagiste exploite habituellement<br />
les classes pauvres (Chauveau Adolphe et Faustin Hélie. Théorie du Code<br />
pénal, te — 5, maison de prêt sur gages); Attendu que de l'information et des<br />
débats il résulte la preuve que depuis moins de trois ans, à Mostaganem, au<br />
su du public, avec le concours d'agents salariés, et la stipulation d'intérêts<br />
variant entre 150 et 300 p. % par an, le nommé Judas. . . prêtait habituel<br />
—<br />
— lement de l'argent aux militaires retraités, sur dépôt à titre de gage de<br />
— leurs titres de pension et de leurs brevets de légionnaires; Attendu que<br />
ce fait, reconnu constant par le tribunal,<br />
par l'art. 411 du Code pénal ainsi conçu:<br />
.<br />
constitue le délit prévu et réprimé<br />
• Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantis<br />
sement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas<br />
tenu un registre conforme aux règlements contenant de suite, sans aucun<br />
blanc ni interligne, les sommes ou objets prêles, les noms, domicile et profes<br />
sion des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nan<br />
tissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de<br />
trois mois au plus el d'une amende de cent à deux mille francs. »<br />
Attendu que pour se soustraire à une condamnation correctionnelle, Judas<br />
... soutient que l'arL 411 sus-transcrit n'est applicable qu'aux personnes<br />
prêtant habituellement sur des effets mobiliers, et non aux avances sur titres<br />
ou autres gages incorporels; qu'à l'appui de sa thèse le prévenu présente<br />
d'abord l'argumentation suivante:<br />
« L'article 411 a pour unique but de protéger le monopole des monts-de-<br />
pièté et de punir les gans ayant créé ou lenu des établissements similaires,<br />
sans autorisation ; or, les prêts incriminés dans l'espèce actuelle n'ont rien<br />
de commun avec les opérations des monts-depiété;<br />
il résulte, en effet, tant<br />
du décret du 24 messidor an XII que de la loi du 24 juin 1851, et de tous les<br />
règlements relatifs au monts-de-pièté, que ces maisons ne reçoivent point des<br />
gages incorporels. Un amendement à fin de permettre aux monts-de-piété<br />
de faire des avances sur brevets de pensions ou inscriptions de rente, a été<br />
précisément repoussé au moment de la discussion de ladite loi du 24 juin<br />
1851 ; ce rapprochement démontre donc, d'une façon péremptoire, que l'art.<br />
411 est inapplicable au prévenu, les opérations de ce dernier ne faisant au<br />
cunement partie de celles réservées au monopole des monts-de-piété. »<br />
A ce compte, tous les établissements de banque qui pratiquent sur une si vaste<br />
échelle les avances sur dépôt de titres de rente ou de valeurs de bourse, tombe<br />
raient sous le coup de l'art. 411 du Code pénal.<br />
En réalité les raisons ingénieuses par lesquelles le jugement prétend expliquer<br />
— la portée morale de l'art. 411 nous semblent assez spécieuses ; le seul fait répré<br />
hensible aux yeux de la morale, qui y soit relevé, consiste en non effet, dans la<br />
mise en gage en elle-même, ni dans l'avance faite 'd'une somme d'argent, mais<br />
uniquement dans la perception d'intérêts usuraires, et dans ee cas, ainsi que nous<br />
— l'avons dit déjà, ou bien la législation fournit comme en France, un moyen<br />
direct de frapper l'usure,<br />
— ou bien le taux de l'intérêt est libre comme en Algérie,<br />
et alors il semblera toujours singulier de frapper par une voie détournée, un fait<br />
que la loi économique du pays considère comme absolument licite. V, M,
Mais attendu que l'historique, l'esprit et les termes généraux de l'article<br />
411, ne permettent point d'avoir égard à ce raisonnement spécieux; qu'il<br />
n'est pas vrai de dire que la disposition pénale dont il s'agit, a pour unique<br />
but d'assurer le monopole des monts-de-piélé ; que lors de la confection du<br />
Code pénal, l'article 411 fut introduit pour tenir lieu notamment de la loi du<br />
16 pluviôse au XII sur les maisons de prêts. (Carnot, Commentaire du Code<br />
pénal, T. 2, p. 404) ;<br />
que le but de cette loi était non pas de protéger le mo<br />
nopole des monls-de-piélé, puisque ce monopole n'existait pas encore ! mais<br />
« de garantir la faiblesse de l'oppression, l'ignorance de l'erreur, soustraire<br />
« le besoin à la cupidité, la misère à la spoliation. » (Extrait de l'exposé des<br />
motifs) ; que le décret du 24 messidor an XII n'a fait que régler la matière con<br />
cernant les monts-de-piété, et les maisons de prêl sur nantissement;<br />
loin de militer en faveur du prévenu, tous les règlements relatifs aux monts-<br />
— Que<br />
de-piété, y compris la loi du 24 juin 1851 sus-invoquée, corroborent par à<br />
fortiori l'application de l'article 4 1 1 au cas présent ; Qu'en effet, si le légis<br />
lateur —<br />
des pauvres —<br />
après s'être constamment etavant tout montré soucieux du besoin<br />
a<br />
refusé aux monls-de-piété le droit de faire des avances d'ar<br />
gent sur gages incorporels, c'est qu'il « n'a pas voulu étendre outre mesure<br />
« l'action de ces établissements. L'expérience prouve que ce ne serait pas un<br />
« grand service à rendre aux détenteurs de pareils effets, de leur prêter ne<br />
» l'argent à 9 1/2 p. % quand ils en trouveraient partout ailleurs, à des<br />
p conditions plus favorables. « (Paroles du rapporteur de la loi précitée, du<br />
24 juin 1851);<br />
Que le fait de prêter habituellement au taux de 300 p. % ! comme ici, à<br />
d'anciens militaires nécessiteux, sur dépôt de titres de pensions ou de brevets<br />
de légionnaires formant leur seul moyen d'existence, constitue donc à plus<br />
forte raison, « la cupidité - et « la spoliation » que le législateur a voulu pré<br />
venir el réprimer en édiclant l'art. 41 1, dont les termes embrassent —<br />
(on<br />
ne saurait trop le faire —<br />
observer) toute espèce de nantissement, sans<br />
distinction entre les gages corporels et les gages incorporels;<br />
Attendu qu'en désespoir de cause Judas prétend subsidiairement,. que les<br />
brevets de pensionnaires et de légionnaires n'étant pas dans le commerce, ne<br />
sauraient être l'objet d'un contrat de nantissement; mais attendu que les bre<br />
vets en question ont élé remis au prévenu et acceptés par lui à titre de gage,<br />
et, bien que la chose déposée dans ces conditions ne soit pas susceptible de<br />
vente, il y a, pour le prêteur un droit efficace, celui de rétention, et, pour le<br />
débiteur, l'impossibilité de toucher des arrérages, fautede pouvoir représen<br />
ter le brevet; que cette pression que le créancier gagiste peut exercer sur le<br />
débiteur, en cas de non-remboursement, justifie surabondamment l'applica<br />
tion, dans l'espèce actuelle, de l'article 411 du Code pénal, la disposition in<br />
fine dudit article visant justement les abus et les fraudes qui accompagnent<br />
toujours la constitulibn de gages irréguliers ;<br />
Par ces motifs, repousse comme mal fondés, les moyens de défense présen<br />
tés par le prévenu"; déclare le nommé Judas. . . coupable du délit ci-dessus<br />
spécifié, el lui faisant application des dispositions de l'article 411 prérappelé,<br />
le condamne, etc.<br />
Alger. — Typ. A.Ioobdan.
2e aimée. —<br />
16<br />
Mais 1878. —<br />
N° 30<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
- LÉGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />
2 mai 1877.<br />
S. Propriété, Titres, Preuve, Vente. — II. "Vente, Condition,<br />
Cassation, Appréciation.<br />
/. Le seul fait de la détention des titres de propriété relatifs à un immeuble<br />
ne constitue pas une présomption légale suffisante pour établir la transmission<br />
de l'immeuble en vertu d'un contrat de vente, au profit du détenteur.<br />
II. Il appartient auxjuges du fait d'apprécier souverainement si une promes<br />
se de vente est subordonné-j à une condition et si cette condition s'est réalisée.<br />
Hamidou ben Mohamed c. Ahmed ben Mohamed ben El-Zouaodi.<br />
Hamidou ben Mohamed,<br />
prétendait qu'un immeuble d'une contenance<br />
d'environ 12 hectares, situé à Mustapha-Supérieur, lui avait été vendu<br />
moyennant 13,500 fr. par Ahmed ben Mohamed ben El-Zouaoui. Celui-ci a<br />
déclaré qu'il n'avait consenli à la vente que conditionnellement, sous la ré<br />
serve de l'agrément de ses enfants, qui d'ailleurs l'avaient formellement<br />
refusé. Hamidou ben Mohamed ayanl remis à Kaddour ben Hamen, gendre<br />
d'Ahmed,<br />
par l'intermédiaire duquel il s'était déjà fait communiquer les litres<br />
de propriélé, une somme de 500 fr. à litre d'arrhes, Ahmed n'a pas voulu<br />
l'accepter et sur le refus de Hamidou de la reprendre, il l'a cité devant le<br />
cadi pour le faire contraindre à recevoir cette somme. Le Cadi par une sen<br />
tence infirmée pour cause d'incompétence par la Cour d'Alger, a déclaré que<br />
la venle élait valable, el que les arrhes devaient être reçues. Hamidou a<br />
ensuite assigné Ahmed devant le tribunal d'Alger pour le faire condamner à<br />
réaliser la vente. Le Iribunal a fait droit à cette demande par jugement du<br />
27 juillet 1874.<br />
Sur l'appel est intervenu un arrêt infirmatif de la Cour d'Alger,<br />
du 24 juillet 1875, ainsi conçu :<br />
Attendu que la vente dont se prévaut Hamidou ben Mohamed, pour en<br />
deman-
82<br />
derla réalisation par acte authentique, n'est établie par aucun titre ni commence<br />
ment de preuve par écrit;— Qu'aux affirmations de Hamidou, El-Zouaoui en<br />
—<br />
oppose de contraires tout aussi vraisemblables ; Que la simple détention des<br />
titres de propriété, ne peut suffire pour prouver la vente et le fait d'exécution par<br />
la délivrance de l'immeuble, lorsqu'il n'est point établi que cette détention provient<br />
de la remise volontaire qui en a été sciemment faite et consentie par le vendeur ;<br />
— Qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que cette remise soit le fait personnel du<br />
vendeur, que celui-ci le nie formellement, et qu'elle pourrait dès lors être le<br />
—<br />
résultat d'une erreur ou d'une surprise qui ne créerait aucun lien de droit;<br />
Attendu qu'il en est de même du payement de 500 fr. à-compte par l'acquéreur ;<br />
— Qu'il n'est point justifié que cette somme ait été versée à El-Zouaoui person<br />
nellement, et qu'il n'est point contesté que, loin de l'accepter, il a voulu la resti<br />
tuer dès qu'elle est parvenue en ses mains ; — Attendu,<br />
d'ailleurs,<br />
que la contes<br />
tation étant aux termes des art. 1 et 2 de la loi de juillet 1873, régie par la loi<br />
française,<br />
aucune preuve testimoniale ne peut être admise ;<br />
— Attendu,<br />
dès lors,<br />
que "les protestations de Hamidou ben Mohamed ne reposent que sur l'aveu consi<br />
gné dans un jugement du cadi, du 18 février 1874, mais que cet aveu, qui subor<br />
donnait la vente à une condition qui ne se serait pas réalisée, est indivisible —<br />
;<br />
Par ces motifs : déclare Hamidou ben Mohamed mal fondé en sa demande, l'en<br />
déboute.<br />
Pourvoi du sieur Hamidou ben Mohamed pour :<br />
1° Violation de l'art. 1315 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a mis<br />
à la charge du possesseur des titres de propriété la preuve que la<br />
remise en avait été faite volontairement, et qu'elle n'était le résultat<br />
ni de l'erreur, ni du dol ;<br />
2° Violation de l'art. 1356 C. civ. et méconnaissance par le juge<br />
de ses propres pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à l'aveu<br />
extra-judiciaire écrit, le principe de l'indivisibilité spécial à l'aveu<br />
judiciaire.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Sur les deux moyens du pourvoi :<br />
— Attendu<br />
qu'après avoir<br />
constaté que le demandeur n'avail aucune preuve de la vente par lui allé<br />
guée, l'arrêt attaqué considère, d'une part, que le seul fait de la possession<br />
par le demandeur des titres de-propriété, ne saurait constituer une présomp<br />
tion légale suffisante à justifier la transmission de l'immeuble à son profit;<br />
— Et<br />
que, d'autre part, l'arrêt attaqué, se livrant à une appréciation sou<br />
veraine, ainsi qu'il en avait le droit, des déclarations faites par. le défendeur<br />
devant le cadi el rappelées dans le jugement du 26 février 1874 annulé pour<br />
cause d'incompétence, a constaté que la promesse de vente faite par le défen<br />
deur au demandeur se trouvait subordonnée à une condition qui ne s'est pas<br />
réalisée ;<br />
— Attendu<br />
qu'en déboutant, en cet élal des faits, le demandeur<br />
des conclusions par lui prises, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de<br />
loi invoqués par le pourvoi ;<br />
— Rejette.<br />
M. Greffier, rapp.; M. Bédarbides, av. gén. c. conf. ; M« Lesage<br />
etMlMEREL, av.
83<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2°>«Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
26 janvier 1678.<br />
Bail de colonisation. — Décret du 18 juillet 18Ï4, —<br />
Hypothèque, privilège. — Nullité.<br />
Le droit au bail de colonisation, consenti par l'État conformément au décret<br />
du 15 juillet 1874, bien que constituant un droit immobilier sui generis, ne<br />
saurait cependant suffire à l'assiette de ^hypothèque (1).<br />
// ne comporte pas non plus de privilège (2).<br />
Raynard,<br />
syndic Leclerc c. Chiche et autres.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR: Considérant que par acte du 4 août 1875, reçu M8 Favereau,<br />
notaire à Alger, le sieur Leclerc, actuellement en failitc, a vendu à Chiche<br />
une maison sise à Bordj-Menaïel, pour dix mille francs, et le droit au bail<br />
d'un lot rural, pour sept mille francs; qu'un ordre a été ouvert devant le<br />
tribunal de Tizi-Ouzou sur l'ensemble de ces deux prix ; que le règlement<br />
provisoire a élé l'objet de plusieurs contredits sur lesquels il y a lieu de sta<br />
tuer ;<br />
— Considérant<br />
qu'un premier contredit du syndic Leclerc, tendant au<br />
(1-2) Pour pouvoir discuter avec fruit cette décision déjà fameuse, il importe que<br />
nous établissions d'abord les conditions dans- lesquelles intervient, entre l'fitat et le<br />
colon, le contrat appelé bail de colonisation.<br />
Aux termes du décret du 15 juillet « 1874, le Gouverneur général est autorisé à<br />
consentir, sous promesse de propriété, définitive, des locations de terres domaniales<br />
d'une durée de cinq années, en faveur de tous Français d'origine européenne<br />
ou naturalisés, qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour<br />
vivre pendant une année (art. 2, g 1er) .<br />
>; La location est faite à condition de résidence personnelle pendant toute la<br />
durée du bail (art. 3).<br />
» Le prix est fixé à 1 franc par an (art. 4).<br />
» A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif<br />
de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre, pendant une nouvelle<br />
période de cinq années, à tous indigènes non naturalisés (art. 6, § 1er).<br />
» Le défaut d'installation du colon dans les six mois, le défaut de résidence pen<br />
dant les cinq premières années, ou la contravention à la défense qui précède, em<br />
portent résolution de plein droit de la concession au profit de l'État (art. 8, 6, § 2,<br />
12,8 2).<br />
» A l'expiration de la troisième année, le locataire peut céder son droit au<br />
bail (art. 7).<br />
» A l'expiration de la deuxième année, il peut consentir le transfert de ce droit,
84<br />
sursis à l'ordre, a été écarté par arrêt du 19 janvier, présent mois ; qu'il y a<br />
—<br />
lieu de statuer d'abord sur la somme à distribuer ;<br />
Considérant que l'acte<br />
d'acquisition de Chiche a élé notifié aux créanciers qu'il n'a inscrits, élé<br />
— l'objet d'aucune surenchère; qu'ainsi accepté, il doit faire la loi du ven<br />
deur et de ses créanciers hypothécaires, en se combinant avec les droits que<br />
à titre de garantie des prêts qui lui auraient été consentis, soit pour édifier ses<br />
bâtiments d'habitation ou d'exploitation, soit pour se procurer le cheptel et les<br />
sera<br />
semences. — Le transfert sera accepté par le préfet ou le général. — 11<br />
transcrit, (art. 13).<br />
» L'acquéreur de fermes isolées ne pourra pas vendre son immeuble à des indi<br />
gènes non naturalisés avant l'expiration de dix années (art. 12).<br />
» Dans le cas de déchéance prononcée pour défaut de résidence, si le locataire<br />
a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et permanentes,<br />
l'adjudication en<br />
sera effectuée et le prix en provenant sera attribué au locataire ou à ses ayants<br />
cause (art. 8).<br />
» Dans le cas de non-paiement des sommes dues au créancier bénéficiaire du<br />
transfert organisé par l'art. 13, celui-ci pourra requérir l'adjudication de la con<br />
cession, et la pire chance qu'il ait à courir est celle de requérir l'attribution défi<br />
nitive des constructions et bâtiments d'exploitation, ainsi que du sol sur lequel<br />
ils seront établis, le surplus faisant retour au domaine de l'État (art. 14). »<br />
Telles sont, en substance, les dispositions du décret du 15 juillet 1874.<br />
Le contrat particulier qui intervient en vertu de ce décret entre l'Etat et les<br />
colons, est, ainsi qu'on l'a vu, appelé tantôt bail, tantôt concession. Le rédacteur<br />
de cet acte du pouvoir exécutif a certainement éprouvé quelque embarras à lui<br />
donner une dénomination précise. L'arrêt ci-dessus rapporté emploie, pour le<br />
désigner,<br />
l'expression de bail de colonisation. Cependant la Cour reconnaît que<br />
le locataire possède un droit immobilier, mais un droit immobilier sui generis.<br />
Qu'est-ce donc que cette convention ? Ce n'est pas un bail, puisqu'elle donne<br />
ouverture à un droit immobilier. Ne serait-ce pas une promesse de vente?<br />
Nous allons le rechercher, car il nous parait que la première préoccupation du<br />
jurisconsulte doit être de déterminer la nature du contrat dont il a à discuter<br />
les effets. Ce point étant acquis, il ne reste plus qu'à appliquer les principes et les<br />
règles propres à la convention spéciale, tels qu'ils sont prévus par la loi.<br />
Or, nous n'hésitons pas à reconnaître dans le bail de colonisation une véritable<br />
promesse de vente, à laquelle ne manque aucun des éléments qui rendent cet acte<br />
parfait,<br />
c'est-à-dire l'accord entre les parties contractantes sur la chose et sur le<br />
prix (C. civ. 1583, 1589).<br />
Cette proposition nous parait indiscutable. En ce qui concerne la chose, aucune<br />
difficulté. Quant au prix, on pourrait arguer de sa vilité pour demander la résolu<br />
tion du contrat. Ce moyen ne sera jamais soulevé par l'Etat. Il n'empêche pas, du<br />
reste, la vente d'exister, puisqu'il n'est accordé par la loi qu'en vue seulement<br />
d'une demande en rescision du contrat de vente et que, passé le délai de deux<br />
ans, le vendeur est déchu du droit de s'en prévaloir.<br />
Ainsi le colon-locataire est, il n'en faut pas douter, non un locataire,<br />
mais un<br />
acheteur de l'État, puisque promesse de vente vaut vente.<br />
Mais s'il est vrai que le contrat de vente est parfait entre l'État et le colon, il<br />
est certain aussi que le droit de propriété de ce dernier est modifié par des condi -<br />
tions suspensives et résolutoires, celles de l'installation, de la résidence, et par la<br />
prohibition de vendre avant l'expiration de divers délais.<br />
Ces diminutions du droit de propriété sont-ils des empêchements à la consti<br />
tution de l'hypothèque ? Contrairement à la décision de la Cour, nous ne croyons
85<br />
— chaque créancier lient de son contrat et de la loi ; Considérant que la<br />
dame Ravan, créancière première inscrite, a fait porter son inscription sur la<br />
maison et sur le droit au bail, pour sûreté d'une somme de 11,600 francs,<br />
avec intérêts et accessoires ; Que c'est en présence de cette inscription et de<br />
ses termes, que l'acquéreur s'est engagé à payer la dame Ravan au lieu et<br />
pas qu'il soit possible de rejeter l'application de l'art. 2125 du Code civil, dont il<br />
importe de rappeler les termes : « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit sus-<br />
» pendu par une condition, ou résolutoire dans certains cas, ou sujet à rescision,<br />
» ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à<br />
» la même rescision. »<br />
Les dispositions de cet article ne s'appliquent, selon la Cour, que « dans le cas où<br />
» le droit de propriété privée existe déjà, quant à l'immeuble engagé, au profit de<br />
» celui qui consent l'hypothèque, mais appartient, sous condition résolutoire, à une<br />
» autre personne. . Nous avouons ne pas nous rendre bien compte de cette distinc<br />
tion. Nous ne comprenons pas qu'un droit de propriété existe sur un immeuble en<br />
faveur d'une personne autre que celle à qui cet immeuble appartient, même sous<br />
une condition résolutoire. Que l'on soit propriétaire sans conditions ou sous une<br />
condition résolutoire, on n'en est pas moins investi du droit complet de la pro<br />
priété. Et on ne voit pas, en -dehors de la société ou de l'indivision, qu'une même<br />
chose puisse appartenir à deux personnes à la fois. Il peut se faire que Pierre ait<br />
des droits éventuels à la propriété d'un objet, et que ces droits puissent se réaliser<br />
si la condition résolutoire sous laquelle Paul possède cet objet vient à se pro<br />
duire. 'Mais cela ne fait pas que Pierre soit propriétaire en même temps que Paul.<br />
11 arrivera même souvent qu'il ne le deviendra jamais. Comment pourra-t-il<br />
consentir une hypothèque sur ce qui ne lui appartient pas encore, sur un immeuble<br />
qui ne sera peut-être jamais sa propriété? Prenons garde : en hypothéquant le<br />
bien de Paul, Pierre ne se rendrait-il pas stellionataire (art. 2059) ?<br />
L'interprétation donnée par l'arrêt à l'art. 2125 est donc erronée. Examinons<br />
maintenant si notre opinion, qui consiste à dire que l'art. 2125 est exactement<br />
applicable au droit qui s'ouvre, sur l'immeuble loué, en faveur du colon-locataire,<br />
se justifie suffisamment.<br />
Nous l'avons démontré, le colon a acheté de l'État un droit de propriété sur<br />
l'immeuble concédé. Il en est propriétaire. Toutefois son droit de propriété est<br />
soumis à diverses modifications. Ce droit qui, pour être complet, doit comporter<br />
celui d'aliéner, est « suspendu » par la condition de venir s'installer dans les six<br />
mois de la notification de l'acte de concession, et de résider pendant trois années.<br />
Ce droit est « résolutoire dans certains n cas, et pour partie, tels que le défaut de<br />
résidence pendant cinq années, l'aliénation à des indigènes, le défaut de paiement<br />
des sommes dues aux créanciers bénéficiaires du transfert. Les dispositions de<br />
l'art. 2125 s'adaptent à la situation du colon-locataire.<br />
Mais il ne faudrait pas non pïus que le droit de ce dernier fût modifié par<br />
d'autres circonstances que la loi n'aurait pas prévues ou qu'elle aurait repoussées.<br />
Le colon se trouverait-il dans le cas de la condition potestative indiquée par<br />
l'art. 1174? Est-il exact de prétendre que la prohibition de vendre un droit à<br />
d'autres qu'à une certaine catégorie de personnes, a pour effet de retirer ce droit<br />
du commerce ; que la loi s'oppose à la constitution de l'hypothèque sur le droit<br />
au bail? La solution donnée à ces questions par l'arrêt du 26 janvier doit-elle être<br />
maintenue ?<br />
Le colon -locataire peut, dit cet arrêt, par le défaut de résidence, empêcher la<br />
constitution de la propriété.<br />
pure-<br />
Cela est vrai. Et la déchéance étant prononcée, l'immeuble concédé fait
86<br />
— place du vendeur ; Que l'acquéreur n'entendait contracter enversJa dame<br />
Ravan aucune obligation personnelle, qui eût été sans cause, mais seulement<br />
se conformer à la situation hypothécaire de l'immeuble ; qu'il ne pouvait<br />
dépendre, ni du vendeur, ni de l'acquéreur, de donner de l'extension à<br />
—<br />
l'hypothèque d'un créancier, au détriment de la masse chirographaire;<br />
ment et simplement retour à l'État. Les hypothèques qu'a pu consentir le colon<br />
restent inefficaces.<br />
Mais cette faculté dont pourrait user le colon, pour empêcher la constitution de<br />
la propriété, ne saurait être considérée comme une condition potestative,<br />
dans le<br />
sens^de l'art. 1174 du Code civil. Il est de principe, en effet, que cet article ne<br />
déclare nulles que les obligations contractées sous une condition potestative de la<br />
part du débiteur; que si la condition n'entraîne pas défaut de lien, l'obligation<br />
contractée est valable ; que l'art. 1174 ne s'applique pas aux conditions potesta-<br />
tives dans lesquelles les circonstances sont telles que le débiteur ne puisse faire<br />
accomplir ou défaillir le fait qu'en s'imposant un préjudice, une perte, qui forme<br />
pour le créancier une garantie contre le caprice de ce débiteur (Marcadtb, sur l'art.<br />
1174). C'est bien le cas des colons-locataires qui, en s'exposant à la déchéance,<br />
se priveraient de l'acquisition facile de propriétés souvent importantes par leur<br />
valeur actuelle ou par celle que leur réserve un avenir sans doute rapproché.<br />
Enfin, est-il exact de dire que, par le défaut de résidence, le colon empêche<br />
sûrement la constitution de la propriété? Est-il au pouvoir du colon d'assurer la<br />
résolution de son contrat avec l'État? S'il est vrai que l'administration ait le droit<br />
de prononcer la déchéance du colon, dans des cas déterminés, il est nom,moins<br />
certain qu'elle n'y est pas obligée, et qu'elle est souveraine dans l'exercice ou<br />
l'abandon de ce droit rigoureux.'<br />
Ainsi la condition potestative manque en droit et en fait.<br />
Il ne nous reste plus qu'à rechercher si le droit au bail de colonisation est ou<br />
n'est pas dans le commerce.<br />
Aux termes des articles 7 et 13 du décret de 1874, le colon peut, dans divers cas,<br />
céder son droit au bail, mais seulement aux personnes remplissant les conditions<br />
exigées par l'art. 2, § 1er. D'où, d'après le système de la Couk. le droit au bail<br />
ne peut être cédé qu'à une certaine catégorie de personnes; d'où if n'est plus<br />
dans le commerce. Donc il ne peut être hypothéqué (art. 2118, C civ.).<br />
Remarquons d'abord que cette
87<br />
Considérant que les privilèges et hypothèques pouvant exister sur les im<br />
meubles de Leclerc se restreignent à la somme de 10,000 francs, déclarée en<br />
— l'acle d'acquisition êlre le prix de la maison ; Que la cession du droit au<br />
bail n'est pas susceptible d'hypothèque; qU'à la vérité, -le bail de colonisa<br />
tion constitue un droit immobilier t-ui generis ; mais que cela ne saurait suf-<br />
11 faut conclure de cette mesure prohibitive, que l'hypothèque ne sera valable que<br />
si elle a été consentie dans les conditions imposées par le décret pour la validité<br />
de la cession du droit au bail, et aussi pour la validité de la vente,<br />
vrance du titre définitif de propriété.<br />
Quant à soutenir que le gage n'est pas réalisable, .ainsique<br />
après la déli<br />
la Cour l'exprime<br />
dans l'arrêt rapporté, nous ne voyons pas ce qui pourrait justifier cette proposi<br />
tion. Ainsi que nous le ferons remarquer tout à l'heure, l'État, dans ce décret,<br />
n'a pris que des mesures conservatoires de ses droits, et propres, selon notre<br />
législateur, à développer la colonisation en Algérie. Or, tout bien étant le gage du<br />
créancier, la saisie en est possible tant que la loi no l'a pas formellement excepté<br />
du droit commun . Ijt l'expropriation qui en est effectuée no saurait nuire aux droits<br />
du précédent vendeur. En quoi donc l'État aurait-il intérêt à s'opposer à la réalisa<br />
tion par un créancier hypothécaire d'une concession engagée ? Qu'a-t-il à craindre ?<br />
Le nouvel acquéreur devra présenter les conditions exigées. S'il ne se produit pas<br />
d'adjudicataire, l'immeuble fera retour au Domaine. Pourquoi,'<br />
nous le répétons, se<br />
serait-il préoccupé d'empêcher la constitution de l'hypothèque et la réalisation de<br />
—<br />
l'immeuble affecté? Mais, loin de là, il a certainement prévu ces événements,<br />
lorsqu'il a dit, dans l'art. 7 du décret, que la cession du droit au bail pourrait<br />
avoir lieu » aux clauses et conditions intervenues entre le cédant et le cession-<br />
naire. » Quel autre moyen que l'expropriation pourrait avoir le cédant pour<br />
obtenir l'accomplissement de ces clauses et conditions ? Aucun, si ce n'est la saisie<br />
mobilière ? Une telle réponse ne serait pas sérieuse. D'un autre côté l'art. 14 ne<br />
dispose qu'en faveur du créancier bénéficiaire du transfert et n'est pas applicable au<br />
vendeur de ce droit. Il faut donc reconnaître que ce dernier, à qui on apefmis de<br />
vendre, peut aussi se faire payer, c'est-à-dire réaliser les biens de son débiteur.<br />
Les deux autres arguments de l'arrêt du 26 janvier, tirés d'une prétendue ana<br />
logie entre le droit au bail et le droit d'usage, et de l'organisation par le décret du<br />
transfert du droit au bail, ne nous paraissent pas de nature à modifier notre ma<br />
nière de voir.<br />
Le droit au bail de colonisation ne saurait, en effet, être assimilé au droit d'usage,<br />
qui est essentiellement mobilier, tandis que le droit au bail est, ainsi que la Cour<br />
le reconnaît elle-même, évidemment imnfobilier.<br />
Touchant le transfert organisé par les art. 13 et 14 du décret, nous n'y voyons<br />
pas « la déclaration expressément formulée par le législateur algérien, que le bail<br />
■< de colonisation n'est pas susceptible d'hypothèque. » Qu'il ait été inutile d'arrêter<br />
les dispositions qui le régissent, c'est possible, au moins pour tout ce qui regarde<br />
le privilège (et non l'hypothèque) que la loi accorde sur les constructions, sur le<br />
cheptel ou sur les récoltes, aux créanciers qui ont fourni les fonds pour bâtir, pour<br />
acheter des bestiaux ou pour se procurer des semences. Car de même qu'il ne<br />
nous paraît pas qu'un décret émané du pouvoir exécutif eût pu supprimer des<br />
droits formellement établis par la loi, de même aussi le décret pouvait-:! se dis<br />
penser de déclarer qu'il en admettait l'exercice. (Voir un arrêt de la lre Ch. de la<br />
Cour, du 27 déc. 1876, au Bull, jud., 1877, p. 84).<br />
Mais dans l'organisation du transfert du droit au bail, le décret nous semble<br />
s'être préoccupé d'autre chose que de la diminution des droits des tiers, et il a<br />
porté ses soins à la conservation des droits de l'État. Où aboutit, en effet, ce
88<br />
fire à l'assiette de l'hypothèque ; qu'en effet, un droit d'usage n'est pas non<br />
plus susceptible d'hypothèque ; que seuls, la propriété d'un immeuble ou<br />
son usufruit sont susceptibles d'une telle affectation: qu'en vain dirail-on<br />
que le bail de colonisation confère une propriété sous condition suspensive ;<br />
qu'il dépend toujours du colon, en manquant à la résidence à lui imposée,<br />
transfert? D'une part, au remplacement du locataire par un autre locataire soumis<br />
aux mêmes conditions ; d'autre part, au retour à l'État de toute la concession,<br />
sauf le sol sur lequel ont été établis, avec les fonds du créancier bénéficiaire du<br />
transfert, les constructions et les bâtiments d'exploitation. Ainsi, dans le premier<br />
cas, rien de changé dans les droits du Domaine. Dans le second, le décret con<br />
sacre le privilège que la loi accorde à celui qui a prêté les deniers pour l'édifica<br />
tion de bâtiments. Il supprime même certaines conditions imposées, en pareille<br />
matière, par le Code civil pour la conservation de ce privilège (art. 2103, 4° et 5°).<br />
Et il le peut, puisqu'il ne fait en cela que renoncer à un moyen dont l'Etat seul<br />
aurait intérêt à exciper, et dont l'abandon no saurait nuire à personne. Il a ajouté<br />
l'attribution au créancier du sol formant l'emplacement des^ constructions, pour<br />
rendre un nouvel hommage à la loi,<br />
et afin de se soustraire à l'obligation qui lui<br />
serait imposée par l'art. 555 in fine du Code civil, s'il voulait conserver la propriété<br />
de cet emplacement.<br />
Selon notre appréciation, le décret n'a voulu que se réserver les moyens<br />
d'assurer la colonisation par l'élément français. Voilà pourquoi il stipule qu'il in<br />
terviendra, pendant un certain nombre d'années, dans les mutations du droit au<br />
bail. Il ne veut pas que le 'but qu'il se propose puisse être éludé. Et pour par y<br />
venir, il n'a pas eu à se préoccuper des droits d'hypothèque ou autres, que le lo<br />
cataire pouvait avoir consentis en faveur de tiers. 11 savait que le locataire nu<br />
pouvait pas donner plus qu'il ne possédait lui-même. Il a seulement édicté une<br />
disposition dérogatoire au droit cpmmun, mais qui se trouve dans les attributions<br />
du pouvoir exécutif, c'est celle en vertu de laquelle le droit au bail de colonisation<br />
est retiré du commerce durant diverses'périodes de temps et à l'égard de per<br />
sonnes déterminées.<br />
Nous dirons en conséquence, en «vertu des considérations qui précèdent :<br />
Pendant tout le temps que le concessionnaire ne pourra pas céder son droit au<br />
bail, c'est-à-dire pendant trois ans, il ne pourra pas consentir d'hypothèques.<br />
Pendant les deux années suivantes, il ne pourra en consentir qu'au profit des<br />
personnes désignées dans l'art 2, g 1er.<br />
Après qu'il aura reçu son titre définitif de propriété, il ne pourra pas hypothé<br />
quer sa concession en faveur d'indigènes"<br />
naturalisés, pendant cinq années.<br />
'<br />
Cette période sera de dix années pour les acquéreurs de fermes isolées.<br />
Voilà, selon nous, les conclusions qu'il faut tirer de la discussion du décret du 15<br />
juillet 1874. Bien que plus favorables que l'arrêt du 26 janvier au développement<br />
de la colonisation, elles sont loin de satisfaire tios vœux ; mais ce n'est pas le lieu<br />
d'exprimer nos désirs sur un sujet étranger au but de notre publication.<br />
Quant à la très-grave proposition qui fait l'objet du second alinéa de notre som<br />
maire, elle est écrite dans l'arrêt, bien qu'aucune considération ne la prépare ni<br />
ne l'explique. Elle nous paraît d'ailleurs inadmissible. Ce que nous venons de dire<br />
suffit, pensons-nous, pour justifier notre opinion. Ajoutons seulement qu'on ne voit<br />
pas à quoi servirait la transcription ordonnée par l'ait. 13 du décret, si ce n'était à<br />
conserver le privilège du créancier ? Bien loin de supprimer le privilège, ce qu'il<br />
n'aurait pas pu faire sans commettre un excès de pouvoir, le législateur algé<br />
rien l'a non-seulement admis, mais il en a simplifié l'exercice, ainsi que nous l'a<br />
•<br />
vons démontré.<br />
H NARBONNE.
89<br />
d'empêcher la constitution de la propriété; que, par conséquent, la préten<br />
due condition suspensive serait en même temps potestative de la part du<br />
débiteur ; que l'article 1174 du Code civil proclame l'impossibilité d'une telle<br />
situation ;<br />
— Considérant<br />
que la prétendue propriété évenluelle du colon ne<br />
serait encore pas susceptible d'hypothèque à un aulre point de vue; qu'elle<br />
ne remplirait pas la condition imposée par l'article 2118 du Code civil, d'être<br />
dans le commerce ; qu'en effet, aux termes des articles b'<br />
et 7 du décret du<br />
15 juillet 1874, le colon ne peut céder qu'à certaines catégories de personnes<br />
son droit au bail et même le droit de propriété sui generis, auquel le bail doit<br />
conduire; qu'il ne peut être constitué d'hypothèque tout le temps qu'il serait<br />
juridiquement impossible de réaliser l'immeuble hypothéqué ; que si l'art.<br />
2125 du Code civil permet de constituer hypothèque à celui qui n'a, sur<br />
l'immeuble, qu'un droit soumis à une condition suspensive, c'est dans l'hy<br />
pothèse où le droit de propriété privée existe déjà quant à l'immeuble engagé,<br />
mais appartient, sous condition résolutoire, à une personne autre que celle<br />
qui constitue l'hypothèque; qu'au contraire, pendant le cours du bail de<br />
colonisation, le droil de propriété n'est encore né au profit de personne ; que<br />
le législateur algérien a expressément déclaré que le bail de colonisalion<br />
n'était pas susceptible d'hypothèque, quand dans l'art. 13 du décret du 1 Fî juil<br />
let 1874, il a organisé le transfert du droil de cession du bail comme garantie<br />
des prêts que le colon pourrait contracter, ce qui eût été parfaitement inulile<br />
— s'il avait eu la faculté d'hypothéquer ; Considérant que c'est donc à tort que<br />
le juge-commissaire et le tribunal de Tizi-Ouzou ont considéré le prix de<br />
7,000 fr., promis par Chiche, pour acquisition du droit de bail, comme un<br />
second lot susceptible de collocations ; qu'il y a lieu de se borner aux colloca-<br />
tions sur le premier lot, la maison, et à la somme de 10,000 fr., qui en fait le<br />
prix, avec les intérêts mis à la charge ide Chiche par son contrat d'acquisition ;<br />
Que cette somme appartient entièrement aux créanciers hypothécaires ; que<br />
si, dans son acte d'acquisition, Chiche a stipulé certaines compensations et<br />
défalcations, elles ne portent, aux termes du même acte, que sur la portion<br />
du prix qui excède les 10,000 fr. dus pour la maison ; qu'il en devait être<br />
ainsi pour respecter les droits des hypothèques régulièrement inscrites sur la<br />
— maison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les créanciers<br />
hypothécaires n'ayant aucun droit sur ce qui pourra être dû par les cession<br />
naires du bail de colonisation du failli Leclerc, la créance du prix de cette<br />
cession appartient à la masse de la faillite, doit être laissée aux diligences du<br />
syndic el en dehors des opérations de l'ordre qui seules font l'objet du présent<br />
arrêt ; que s'il esl permis de distribuer, dans un ordre, à des créanciers chi-<br />
rographaires une portion du prix resiée libre, c'est quand il s'agit d'un prix<br />
d'immeuble affecté d'abord à des créances hypothécaires ; que le prix d'une<br />
cession de bail de colonisalion ne rentre pas dans ces conditions.<br />
Sur les collocations faites sur le premier lot : Considérant qu'il résulte de<br />
ce qui précède que la dame Ravan, n'ayant ni créance personnelle contre<br />
Chiche, ni privilège sur le droit au bail, qui ne comporte pas de gage de celle<br />
nature, doit obtenir unecollocation formelle au rang de son hypothèque —<br />
;<br />
Adoptant,<br />
pour l'admission des autres collocations, les motifs des premiers<br />
juges et maintenant ces collocations à leur ordre d'inscription que leur a as<br />
signé le règlement provisoire ; — Considérant que la plus grande partie des
90<br />
dépens litigieux a été occasionnée par les prétentions mal fondées de Faraud,<br />
el les autres, par les autres parties.<br />
Donne défaut contre les sieurs Faraud, Élie frères et non Sénés, com<br />
—<br />
parants quoique dûment cités, intimés; Et statuant définitivement à l'é<br />
gard de toutes les parties, réforme le règlement provisoire el le jugement dont<br />
est appel ; met à néant les collocations sur le second lot. Dit que la somme à<br />
distribuer dans l'ordre sera uniquement celle des 10,000 francs, prix de la<br />
maison avec les intérêts qu'elle a produits. Et sur celle somme maintient les<br />
collocalions du règlement provisoire du premier lot ;<br />
— Dit<br />
néanmoins que<br />
la dame Ravan sera colloquée sur cette somme pour le montant de sa créance<br />
en première ligne après les frais privilégiés d'ordre. Ordonne la restitution<br />
de l'amende. Réserve au syndic el à la masse chirographaire de la faillite les<br />
droits qu'ils pourront avoir contre les cessionnaires du bail de colonisation<br />
— du failli ; Condamne Faraud à la moitié des dépens faits depuis le premier<br />
contreditjusqueset y compris le présent arrêt, à l'exception, toutefois, de ceux<br />
faits sur la demande du syndic tendant à sursis, lesquels resteront à la charge<br />
de la masse, ainsi qu'il a élé réglé par un précédent arrêt —<br />
; Condamne la<br />
veuve Ravan el le syndic, chacun à un quart des dépens litigieux, dont le<br />
surplus est mis à la charge de Faraud ; autorise le syndic à employer en frais<br />
de syndicat la portion des dépens mis à sa charge<br />
M. du Moiron, Subst. du Proc. gén.; Me8 Chéronnet el F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans).<br />
Présidence de M. CARRÈRE, président.<br />
4 février 1878.<br />
Application de la loi du S© juillet 18Î3 —<br />
Opérations du commissaire-enquêteur ,<br />
Compétence,<br />
—<br />
— Sursis.<br />
La juridiction musulmane est compétente pour statuer sur les litiges en ma<br />
tière immobilière durant les opérations du commissaire-enquêteur .<br />
Cette compétence n'est pas suspendue alors même que les parties ont comparu<br />
devant le commissaire-enquêteur el que celui-ci, n'ayant pas terminé ses opéra<br />
tions,<br />
demeure encore chargé par la loi de la mission de les concilier (1).<br />
(1) Nous avons rapporté au Bull.jud., 1877, p. 282, et 1878, p. 27,<br />
les arrêts<br />
par lesquels la Cour d'Alger a décidé que le juge musulman restait compétent<br />
pour statuer sur les questions de propriété immobilière entre indigènes,<br />
jusqu'à la<br />
publication des titres provisoires de propriété délivrés aux termes des art. 17 et<br />
18 de la loi du 26 juillet 1873.<br />
Faut-il,<br />
martin,<br />
/<br />
ainsi que le demandaient les conclusions de M. l'avocat général<br />
Cam-<br />
que dans le cas où les opérations du commissaire-enquét«ur portent spé-
91<br />
Ben Youssef ben Ikhlef et autres, c. consorts Ezzeghouani.<br />
Nous croyons intéressant de reproduire les conclusions approfon<br />
dies que M. l'avocat général Cammartin a présentées dans cette<br />
affaire pour soutenir l'incompétence du premier juge, et que la Cour<br />
a repoussées par son arrêt.<br />
Ces conclusions étaient ainsi conçues :<br />
En fait: Attendu que les parties reconnaissent avoir accompli les obliga<br />
tions imposées par la loi du 26 juillet 1873 pour la constalation de la pro<br />
— priété immobilière ; Qu'elles ont comparu comme elles le devaient devant<br />
le commissaire-enquêteur chargé d'examiner leurs revendications, de les<br />
concilier et de donner ses conclusions sur leurs prétentions respectives;<br />
Que ces opérations terminées, le commissaire-enquêteur a déposé son procès-<br />
verbal el que l'administration des Domaines a établi un litre provisoire de<br />
propriété qui n'a élé l'objet d'aucune contestation dans les formes prescrites<br />
par la loi ;<br />
— Que<br />
c'est au cours des opérations du commissaire-enquêteur<br />
et alors qu'elles n'étaient pas terminées, que le litige a été porté devant le<br />
cadi;<br />
En droit : Attendu qu'il s'agil de rechercher si, dans ces circonstances, le<br />
cadi était compétent pour statuer ou s'il devait surseoir jusqu'à la lin des<br />
cialement sur l'immeuble en litige, le juge musulman, bien que compétemment<br />
saisi, soit tenu de surseoir à statuer jusqu'au moment où l'œuvre conciliatrice du<br />
commissaire-enquêteur aura été complètement terminée? —<br />
—<br />
On lira, plus haut,<br />
les raisons très-sérieuses qui ont été invoquées de part et d'autre pour la solution<br />
de cette importante question.<br />
A notre avis, il n'est jamais entré dans la pensée du législateur de 1873 que<br />
l'œuvre des commissions d'enquête qu'il instituait, put être entravée par les procès<br />
plus ou moins sérieux que les indigènes introduiraient à plaisir devant les cadis.<br />
Se figure-t-on, en effet, cette singularité d'une concurrence entre le magistrat et<br />
l'agent administratif,<br />
ayant tous deux le droit de demander aux parties leurs<br />
pièces et pouvant aboutir à ce résultat bizarre que le cadi aura en mains les titres<br />
d'une partie,<br />
enquêteur ?<br />
pendant que l'autre partie aura remis les siens au commissaire-<br />
Mais si ce conflit est manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1873, il est<br />
bien regrettable qu'elle ne l'ait pas réglé nettement en décidant: I" quelle serait<br />
dans un territoire soumis aux opérations d'enquête par arrêté du Gouverneur gé<br />
néral, la juridiction compétente pour juger les procès immobiliers introduits pos<br />
térieurement à cet arrêté ; 2° si cette juridiction serait ou non tenue de surseoir à<br />
statuer jusqu'à l'entier achèvement des opérations de la commission d'enquête.<br />
La loi actuelle contient évidemment sur ces deux points une lacune, et devant<br />
cette lacune, nous devons avouer qu'à nos yeux la CSur, aussi bien dans l'arrêt<br />
rapporté plus haut que dans les arrêts relatifs à la compétence de la justice mu<br />
sulmane, n'aurait pu se prononcer autrement qu'elle n'a sans empiéter sur<br />
fait,<br />
l'œuvre du législateur.<br />
En présence de la jurisprudence adoptée par la Cour sur plusieurs questions re<br />
latives à la loi de 1873 (nous rappellerons notamment la grave question du partage<br />
des successions immobilières), la révision de cette loi apparaît comme une incon<br />
testable nécessité.<br />
V. M.
92<br />
opérations du commissaire enquêteur ;<br />
— Attendu<br />
que la loi du 26 juillet<br />
1873 a prescrit des règles obligatoires pour la constatation de la propriété<br />
immobilière, qu'elle en a confié l'application à l'administration, pour rendre<br />
celte œuvre considérable plus prompte et moins onéreuse, qu'elle a chargé,<br />
dans ce but, le commissaire-enquêteur de la mission d'enlendre les parties,<br />
les témoins, de compulser les registres publics et d'examiner les titres privés,<br />
qu'elle a voulu assurer l'exactitude de ses appréciations par une nouvelle<br />
—<br />
vérification après les publications et les réclamations des intéressés;<br />
Qu'elle lui a prescrit de tendre jusqu'au dernier moment à la conciliation<br />
des parties ;<br />
— Attendu,<br />
il est vrai, que la loi n'a pas accordé au commis<br />
saire-enquêteur le pouvoir de décider même en premier ressort sur les con<br />
testations qui s'agitent devant lui ; Que le principe de la séparation des pou<br />
voirs ne permellail pas d'attribuer à un agent administratif la mission de<br />
juger les litiges touchants la propriété immobilière; Que la loi de 1873 a<br />
donc réservé au pouvoir judiciaire le dernier mol sur ces questions ;<br />
— At<br />
tendu, dès lors, que la Cour, dans divers arrêts, a décidé, à bon droit, que la<br />
mission du commissaire-enquêteur n'était pas interruptive du cours de la<br />
justice et que les cadis conservaient la compétence qu'ils tiennent de la loi,<br />
jusqu'au moment où s'ouvre la compétence des tribunaux français, en vertu<br />
Mais attendu qu'en respectant la compétence des cadis, il<br />
de l'article 18; —<br />
y a lieu d'en faire concorder l'exercice avec l'application de la loi de 1873 ;<br />
— Attendu qu'il est incontestable que les cadis peuvent connaître des con<br />
testations portant sur la propriélé immobilière, alors même que le commis-<br />
saire-enquêleur exercerait dans leur ressort, tant que ses opérations ne por<br />
tent pas spécialement sur l'immeuble objet du litige; qu'ils peuvent égale<br />
ment connaître des litiges dont ils sont saisis, après le dépôt des conclusions<br />
du commissaire-enquêteur et avant l'ouverture de la compétence des tribu<br />
— naux français ; Que la jurisprudence de la Cour, sur ce point, esl justement<br />
assise; qu'en effet il ne peut y avoir conflit, dans ce cas, entre l'application<br />
de la loi de 1873 el les atlributions des cadis, puisque dans un cas les opéra-<br />
lions du commissaire-enquêteur n'ont pas commencé sur l'immeuble objet<br />
— du litige et que dans l'autre cas elles.sonl terminées ; Mais attendu que la<br />
décision doit être différente, lorsqu'il s'agit d'un immeuble spécialement et<br />
actuellement soumis à l'enquête du commissaire administratif;<br />
en effet, que la voie conlen lieuse n'est ouverte aux parties que lorsqu'elles<br />
— Attendu,<br />
—<br />
ont parcouru jusqu'au bout celle que la loi a tracée pour la conciliation ;<br />
Que le commissaire-enquêteur esl chargé de concilier les parties, qu'elles ne<br />
peuvent donc se dérober à son action conciliatrice tant qu'il n'a pas achevé<br />
les — opérations qui seules y mettent fin ; Que d'ailleurs, en comparaissant<br />
devant lui, elles se soumettent à l'obligation, imposée par la loi, de suivre en<br />
son entier la procédure_adminislrative el qu'elles ne peuvent s'y soustraire,<br />
en —<br />
vertu de la maxime: Und via electd, non datur regressus ad alteram;<br />
Attendu, dès lors, que lant qu'elles sont en instance d'enquête et de con<br />
ciliation devant le commissaire-enquêteur, il ne leur est pas loisible de<br />
porter leur débat devant le juge du contentieux ; Que celui-ci doit, pour<br />
laisser à la loi de 1873 son application, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration<br />
— des pouvoirs du commissaire-conciliateur; Attendu que toute autre inter<br />
prétation, évidemment contraire aux principes du droit et à la loi de 1873,
93<br />
aurait des conséquences qui n'en permettraient pas l'adoption ;<br />
effet, s'il était permis au commissaire-enquêteur et au cadi d'exercer simul<br />
tanément leur action sur la même propriété immobilière, outre le conflit el<br />
— Qu'en<br />
les inconvéuienls qui naîtraient du droit de chacun d'eux de se faire remet<br />
tre les titres et d'entendre les témoins, on arriverait à ce résultat inadmis<br />
sible que ces deux actions indépendantes pourraient attribuer différemment<br />
— et souverainement la propriélé ; Qu'en effet, les conclusions du commis<br />
saire-enquêteur donneraient, dans certains cas, naissance à un litre définitif<br />
de propriélé, alors qu'il résulterait du jugement du cadi une décision opposée ;<br />
— Que les parties se trouveraient ainsi en présence d'un litre administratif,<br />
seul point de départ de la propriélé, el d'un jugement contraire passé en forme<br />
de chose jugée, que nulle autorité ne pourrait concilier el qui, en laissant<br />
la propriété en suspens,<br />
ajouterait à la confusion que la loi de 1873 a voulu<br />
— dissiper et détruirait notre prestige aux yeux des indigènes; Attendu<br />
qu'il y a donc lieu de reconnaître que les opérations du commissaire-enquê<br />
teur étant commencées et non terminées sur l'immeuble objet du litige,<br />
lorsque le cadi a été saisi de la contestation, ce magistrat devait surseoir à<br />
— Qu'il y avait<br />
statuer jusque après l'expiration de la période de conciliation ;<br />
lilispendance et que le cadi, en jugeant au fond, a incompétemment jugé —<br />
;<br />
Atlendu, toutefois, que la cause esl en état, que les conclusions du commis<br />
saire-enquêteur ont été déposées, qu'un litre provisoire a élé établi, que les<br />
publications en ont élé faites, mais que la juridiction musulmane élail saisie<br />
avant ces publications rt qu'elle reste compétente, aux termes des articles 17<br />
et 18 de la loi de 1873 et de la jurisprudence de la Cour ;<br />
— Qu'il<br />
y a donc<br />
lieu d'évoquer le fond et de statuer sur les conclusions du commissaire-<br />
enquêteur qui deviennent pièces du procès, comme elles le seraient devant<br />
la juridiction des tribunaux français, si l'instance avait pris naissance après<br />
— les publications prescrites par l'art. 17 ; Qu'il convient également d'attri<br />
buer aux parties en cause les noms patronymiques dont elles ont fait choix ;<br />
Par ces motifs : Plaise à la Cour annuler, comme incompétemment rendu,<br />
le jugement dont est appel. Évoquer le fond : Ordonner le dépôt des conclu<br />
sions du commissaire-enquêteur et du plan y annexé ; nous réserver de con<br />
clure sur les prétentions des parties après communication de ces pièces.<br />
Contrairement à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt suivant :<br />
ARRÊT :<br />
—<br />
Attendu que l'appel esl régulier en la forme;<br />
Atlendu,<br />
en ce qui louche<br />
les conclusions à fin d'incompétence prises par le ministère public, qu'à la<br />
date du 14 mai 1877, qui est celle à laquelle a été rendu le jugement frappé<br />
d'appel, le commissaire-enquêteur, qui s'élail rendu dans l'ancienne tribu<br />
des Ferouka pour en constater la propriété indigène, conformément à la loi<br />
du 26 juillet 1873, y avait, il. est vrai, commencé ses opérations pour la<br />
reconnaissance des biens objets du litige actuel, mais qu'aucun texte de ladite<br />
loi n'a édicté que les conséquences des opérations ainsi commencées seraient<br />
— de suspendre le cours de la justice ordinaire; Qu'une disposition aussi<br />
exorbitante ne peut se comprendre que formellement écrite et ne saurait<br />
s'induire des termes de l'article 16 de la loi,<br />
qui ne donne d'autres altfibu-
94<br />
tions, ayant une apparence de caractère judiciaire,<br />
enquêteurs, que celles de concilier les parties, si faire se peut;<br />
aux commissaires-<br />
— Que<br />
si<br />
concilier, c'est-à-dire essayer d'amener les parties à un accord de volonté,<br />
est un droit qui peut pour ainsi dire appartenir à tout le monde, il en est<br />
autrement du droit de juger, c'est-à-dire de trancher les différends, droit<br />
qui n'appartient qu'aux tribunaux légalement institués pour rendre la justice<br />
—<br />
au nom du Peuple français ; Attendu, dès lors, que si les opérations des<br />
commissaires-enquêteurs avaient pour effet de suspendre la compétence des<br />
juridictions légales des musulmans, on en arriverait à ce résultat impossible<br />
de laisser pendant un temps absolument indéterminé, qui souvent dure des<br />
années entières, les propriétaires indigènes, en faveur de qui la loi a été<br />
faite, sans aucune justice, dans une complète anarchie, exposés à toutes les<br />
usurpations et à tous les empiétements, puisque le possessoire n'est pas<br />
dis- •<br />
— linct du pétitoire en droit musulman ; Attendu que vainement on préten<br />
drait que la conciliation est une instance indéfiniment ouverte devant le<br />
commissaire-enquêteur et prohibant toute autre instance sur le même objet;<br />
que la loi ne le dit pas ; que d'accord avec tous les principes de noire légis<br />
lation, qui cherche à faciliter la conciliation, elle donne seulement aux parties<br />
le droit de se concilier devant le commissaire-enquêteur, mais que la con<br />
ciliation, loin d'être une instance, esl, au contraire, tout l'opposé d'une instance<br />
et un acte de pur accord des parties ; que celles-ci ne remettent en aucune<br />
façon au conciliateur le droit de décider entre elles, qu'autrement ce ne<br />
serait plus une conciliation, mais un compromis; qu'il suit de là que dès que<br />
cet accord, presque toujours l'œuvre d'un instant, et qui dans tous les cas<br />
n'exige ni preuves ni débats sur le droit, n'est pas librement réalisé, le pou<br />
voir du concilialeur cesse ipso facto pour faire place au droit des parties de<br />
faire trancher leurs prétentions par les juridiclions normales, lesquelles ne<br />
sauraient se refuser à le faire sans déni de justice ;<br />
— Attendu<br />
surabondam<br />
ment qu'il suffit de lire le texte de l'article 17 de la loi précitée, pour se<br />
convaincre que le Service des Domaines ne peut établir de certificats provi<br />
soires de propriété qu'au nom des individus dont les droits ne sont pas<br />
conlestés ; que c'est dire nettement que ce service doit toujours surseoir, en<br />
cas de contestations, jusque ce que ces contestations aient été tranchées, et<br />
que, comme les juridictions françaises de droit commun ne deviennent, aux<br />
termes de l'article 18, compétentes qu'après l'établissement des litres provi<br />
soires, ces contestations doivent être résolues par les juridiclions musulmanes<br />
ordinaires; que sinon on en arriverait, dans le système contraire, à ce résul<br />
tat qu'en cas de contestations et de non-conciliation, les parties demeureraient<br />
sans justice el sans litres de propriété possibles;<br />
— Atlendu<br />
que c'est en<br />
vain que l'on craindrait de voir dans l'application de la loi de 1873 une<br />
cause possible de conflit entre les juridictions des indigènes et le Service des<br />
Domaines ; qu'il ne saurait en exister que si ce service, dont le rôle, d'après<br />
l'article 17 sus-visé, se borne à « constater, reconnaître et confirmer la pro<br />
priété possédée à titre privatif », se refusait à tenir compte des litres des<br />
parties que la loi lui ordonne d'appliquer au sol melk, les plus incontestables<br />
et les plus puissants de tous ces litres étant toujours les décisions judiciaires ;<br />
—<br />
Attendu, dès lors,<br />
1877 dont l'appel est aujourd'hui soumis à la Cour;<br />
que le cadi était compétent bars du jugement du 14 mai<br />
—Au fond : Atlendu
95<br />
que c'est avec raison que le cadi a estimé que, d'après l'acte de Moharem 1 186<br />
de l'hégire, postérieur à la convention entre Bou-Ydir et Ben Ikhlef, la<br />
famille Ezzeghouani avait droit au tiers de deux parcelles de terre, dites<br />
Tamardine, sises au Ferouka, entre la rive orientale du Bou-Chemla el la<br />
rive gauche des ravins de Bou-Zadfroun el El-Ramda, d'une contenance<br />
ensemble de un hectare quarante ares environ, lesdites parcelles bornées à<br />
l'ouest par le chemin de Soumah aux Béni Kinâa, lequel chemin les sépare<br />
des terrains de la Compagnie des mines et de ceux de Mohamed ben Seghir,<br />
dit Mokhtari, délimitées d'autres parts par la Compagnie des Mines et le<br />
Domaine de l'État,<br />
telles,*<br />
du reste, qu'elles se trouvent périmétrées en rose<br />
sur le plan dressé le 25 novembre 1877 par M. Grand, géomètre à Bouffarick,<br />
lequel plan, visé par M. le juge de paix dudit canton de Bouffarick, sera an<br />
nexé au présent arrêt;— Attendu que Abdelkader ben Larbi ben Ydir est<br />
intervenu en son nom et en celui de ses frères devant M. le juge de paix de<br />
Bouffarick et à l'audience, et que le jugement doit être déclaré commun<br />
—<br />
entre lui et les autres parties; Atlendu que les parties qui succombent<br />
doivent être condamnées aux dépens ;<br />
Par ces motifs : En la forme, reçoit l'appel de Ben Youssef ben Mohamed<br />
— ben Abderrahman ben Ikhlef;. Reçoit Abdelkader ben Larbi ben Ydir in<br />
— tervenant en son nom el en celui de ses frères ; Confirme le jugement<br />
critiqué, compétemment rendu par le premier juge. Ordonne qu'il sortira son<br />
—<br />
plein el entier effet ; Condamne les appelants el intervenants aux dépens<br />
de première instance et d'appel.<br />
M. Lourdau, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; conc contr.<br />
Me Batjdband, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en date du 16 février 1878, ont été nommés:<br />
Juge au tribunal d'Alger, M. Ronnpt, juge au siège de Constantine, en<br />
remplacement de M. Marchi, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droils<br />
à la retraite et nommé juge honoraire.<br />
Juge au tribunal de Constantine, M. Viet, juge d'instruction au siège de<br />
Bône.<br />
Juge d'instruction au tribunal de Bônê, M. Verner, juge au même siège.<br />
Juge au tribunal de Bône, M. Kolb, juge au siège de Sétif.<br />
Juge au tribunal de Sétif, M. Berger, juge de paix de Mascara.<br />
Juge au tribunal de Mostaganem, M. Vénal, ancien magistrat.<br />
Juge de paix de Mascara, M. Girieud, juge de paix de Bordj-Méuaïel .<br />
Juge de paix de Bordj-Ménaïel, M. Quastana, juge de paix de Bouffarick.<br />
Juge de paix de Bouffarick, M. Ciavaldini, juge de paix de Tenez.<br />
Juge de paix de Tenez, M. Cassaigneau, juge de paix de Cassaigne.<br />
Juge de paix de Cassaigne, M. Patrimonio, suppléant rétribué du juge de<br />
paix de Bouffarick.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Bouffarick, M. Genty, avocat.<br />
Juge de paix de Marengo, M. Bordes, juge de paix de Djidjelly, en rem<br />
placement de M. Cardot.
96<br />
Juge'<br />
de paix de Djidjelly, M. Cardot, juge de paix de Marengo en rempla<br />
cement de M. Bordes.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou, M. Charlan, avocat.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Morellet, avocat.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, M. Bach, avocal.<br />
Par décret en dale du 23 février 1878, ont été nommés :<br />
Huissier près la Cour et les tribunaux d'Alger, M. Clar (Emile-Martin),<br />
secrélaire en chef du parquet de la Cour, en remplacement de M. Bastard,<br />
démissionnaire.<br />
Huissier près la justice de paix de Relizane, M. Durand, huissier près la<br />
justice de paix d'Orléansville, en remplacement de M. Tourisse, décédé.<br />
Huissier près la justice de paix d'Orléansville, M. Lelouch, huissier près la<br />
justice de paix de Boghari, en remplacement de M Durand.<br />
Huissier près la justice de paix de Boghari, M. Kœnig, huissier près la<br />
justice de paix d'inkermann, en remplacement de M. Lelouch.<br />
Huissier près la justice de paix d'inkermann, M. Defarge (Lacroix-Pierre-<br />
Gustave), ancien huissier, en remplacement de M. Kœnig.<br />
Par décret en dale du 26 février 1878, M. Marty, greffier de la justice de<br />
paix de Djelfa, esl autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attributions<br />
restreintes. (Section 2 du décret du 18 janvier 1875.)<br />
Par décret en date du 28 février 1878, a été nommé :<br />
Juge de paix de Constantine, M. Vandier, 1« substitut du procureur de la<br />
République à Cayenne, en remplacement de M. Cuny Ravet.<br />
Par décret en date du 28 février, M. Vidal (Louis), garde-colonial, à Aïn-<br />
Mokra, est nommé huissier près la justice de paix de Mondovi, en remplace<br />
ment de M. Prévost, décédé.<br />
Par décret en date du 5 mars 1 878, a été nommé :<br />
Huissier près de la justice de paix de l'Oued-Zenati, M. Roses (Laurent),<br />
ancien maréchal-des-logis de gendarmerie, en remplacement de M Henriet,<br />
révoqué.<br />
Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger,<br />
4 mars 1878, ont été nommés :<br />
en dale du<br />
Secrétaire en chef du parquet de ladite Cour, M. Léon Costedoat, soussecrétaire,<br />
en remplacement de M. Clar, nommé huissier.<br />
Sous-secrélaire du parquet de ladite Cour, M. Louis-Réné-Robert de<br />
Sambœuf, avocat, en remplacement 'de M. Costedoat, nommé secrélaire en<br />
chef.<br />
Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, on date du<br />
8 mars 1878, ont été nommés :<br />
Garde colonial à Aïn-Mokra, M. Rosenfeld, garde colonial à Lamoricière,<br />
en remplacement de M. Vidal, nommé huissier.<br />
Garde colonial à Lamoricière, M, Morelti, secrélaire du parquet de Tlemcen,<br />
en remplacement de M. Rosenfeld, nommé à Aïn-Mokra.<br />
Alger. — Typ. A. Jourdan.
2e année. — 1er Avril 1878. —<br />
N° 3!<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
27 avril 1877.<br />
Chemins vicinaux. — — Prestations.<br />
— Termes échus. —<br />
LEGISLATION<br />
Réclamations.<br />
Quittance.<br />
La disposition de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1832, aux termes de laquelle<br />
le contribuable qui présente une demande en décharge ou en réduction de con<br />
tributions directes,<br />
doit joindre à sa demande la quittance des termes échus<br />
de
Eaux, —<br />
Usine.<br />
—<br />
Droits<br />
98<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
13 juillet 1877.<br />
acquis. — — Ouvrages. Autorisation<br />
administrative. — Contravention de grande voirie.<br />
En Algérie, un particulier , alors même qu'il aurait acquis, avant la loi du<br />
16 juin 1851, des droits sur un cours d'eau,<br />
ne peut exécuter des travaux<br />
susceptibles de modifier le régime des eaux sans une autorisation de l'adminis<br />
tration,<br />
qui peut lui imposer les mesures propres à empêcher qu'il en résulté un<br />
préjudice pour l'intérêt général .<br />
Par suite, ce particulier commet une contravention de grande voirie, s'il ne<br />
se conforme pas aux conditions qui lui ont été ainsi imposées (I).<br />
Ricci .<br />
Le Conseil d'État : Vu la requête présentée par le sieur Ricci, tendant à<br />
ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté par lequel le Conseil de préfec<br />
ture d'Alger l'a condamné à 50 fr. d'amende pour ne s'être pas conformé,<br />
dans l'établissement des vannes de décharge du canal qui amène à son usine<br />
les eaux dérivées de l'Oued-el-Kebir, aux prescriptions moyennant lesquelles<br />
il a obtenu l'autorisalion de réunir en une seule les quatre chutes qu'il pos<br />
sédait, et a prescrit l'enlèvement des vannes dont il s'agit ; ce faisant, attendu<br />
que le requérant esl propriétaire des droils qu'il exerce sur les eaux déri<br />
vées de l'Oued-el-Kebir, en vertu de titres antérieurs à la loi du 16<br />
juin 1851,<br />
el qu'ainsi il n'avait pas besoin d'autorisation pour établir sur sa<br />
propriélé, et dans les canaux construits par lui, des vannes destinées à régler<br />
l'écoulement des eaux dont il a l'usage ; qu'en tout cas, le Conseil de préfec<br />
ture eût dû surseoir à statuer jusqu'à la solution d'une instance introduite<br />
par<br />
lé"<br />
requérant devant le tribunal civil de Biida, et tendant à faire interdire<br />
à l'État de le troubler dans la jouissance de ses droits, décharger le sieur<br />
Ricci des condamnations prononcées contre lui, dire, en tout cas, qu'il sera<br />
sursis à statuer jusqu'à solution de procès pendant devant le tribunal de<br />
Blida.....;<br />
Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, l'inslruction législative des 12-20<br />
août 1790, l'arrêté du Gouvernement du 19 vent., an vi, et la loi du 16<br />
juin 1851 ;<br />
— Vu la loi du 29 flor., an x ;<br />
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur-Bicci a demandé et<br />
obtenu, par arrêté du général commandant la division d'Alger, l'autorisation<br />
de réunir quatre chutes, qu'il possédait sur l'Oued-el-Kebir, en une chute<br />
n<br />
unique comportant l'établissement d'un canal de dérivation de 1,032 mètres<br />
de longueur, destiné à l'alimentation d'une usine nouvelle à turbine hydrau-<br />
" ~~ ~<br />
(1) V. ci-dessus, p. 52, de ce vol., un arrêt de la Chambre des requêtes du 20<br />
février 1877, statuant sur une question de compétence au sujet de* mesures admi<br />
nistratives prises à l'égard de l'usine du sieur Ricci.
lique ;<br />
— Que<br />
l'Oued-el-Kebir,<br />
99<br />
ces travaux, susceptibles de modifier le régime des eaux de<br />
ne pouvaient être exécutés sans une autorisation de l'admi<br />
nistration, à qui il appartenait de prescrire les mesures propres à empêcher<br />
qu'il en résultât aucun préjudice pour l'intérêt général ; qu'en ne se confor<br />
mant pas, dans l'exécution des travaux dont il s'agit, aux prescriptions con<br />
tenues, soil dans l'arrêt précité, soit dans les arrêtés préfectoraux du 15<br />
février et du 15 juillet 1872, le sieur Ricci a commis une contravention de<br />
grande voirie, et que c'est avec raison que le Conseil de préfecture d'Alger<br />
l'a condamné à l'amende et a ordonné l'enlèvement des vannes établies con<br />
trairement aux dispositions de ces arrêiés ;<br />
— Art. 1«. La requête est rejelée.<br />
MM. Mavniel, rap., Bbaun, comrn. du gouv., concl. conf.<br />
Cour d'assises. —<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
Présidence de M. de CARNtÈRES, président<br />
27 juillet 1.876.<br />
Interrogatoire. — Arrêt de renvoi.<br />
Pourvoi. —<br />
Délai.<br />
Un accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats de la Cour d'as<br />
sises avant l'expiration du délai de cinq jours qui lui est ouvert, à partir du<br />
jour de l'interrogatoire par le président,<br />
l'arrêt de renvoi (C. instr. crim. 293, 296, 301 et 408) (i).<br />
pour se pourvoir en nullité contre<br />
A moins qu'il ne consente expressément à ce que ce délai soit abrégé (2).<br />
Ce consentement peut être donné soit dans l'interrogatoire prescrit par l'art.<br />
293. C. instr. crim., soit au cours des débats (3) .<br />
El Habib ben Zergoug .<br />
ARRÊT :<br />
— LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et résultant de ce que les ac<br />
cusés auraient été soumis aux débats de la Cour avant l'expiration du délai<br />
de cinq jours qui leur était ouvert par l'art. 296, C. instr. crim., pour se<br />
pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi: —<br />
408, C. instr. crim ;<br />
— Atlendu<br />
Vu<br />
les arl. 293, 296, 301 et<br />
que de la combinaison de ces articles, il ré<br />
sulte qu'un accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats de la Cour<br />
d'assises avant l'expiralion du délai légal de cinq jours qui lui esl ouvert pour<br />
se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi, à partir du jour de l'interro-<br />
(1) Jurisp. constante. V. Dalloz, Table des 22 années, v° Instr. crim., n° 396.<br />
(2) Conf. cass. crim., 23 sept. 1858 (D. P., 58, 5, 212).<br />
(3) V., en ce sens, Cass. crim., 11 août 1864 (D. P.. 66, 5, 252).
100<br />
gatoire prescrit par l'art. 293, C. instr. crim. ; —<br />
Que ce délai est substantiel<br />
et que son inobservation constitue une violation du droit de la défense, et<br />
qu'il ne peut, sous peine de nullité, être abrégé sans le consentement formel<br />
et exprès de l'accusé, donné soit dans l'interrogatoire prescrit par l'art. 293,<br />
—<br />
soit au moins au cours des débats ; Attendu, en fait, que les trois accusés<br />
ont été interrogés le 26 avril 1876, qu'ils ont élé soumis aux débals le 1« mai<br />
suivant, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prescrit par l'arl. sus- 296<br />
visé ; qu'il n'appert, ni de leurs interrogatoires, ni du procès-verbal des dé<br />
qu'ils aient formellement renoncé au bénéfice du délai qui leur était<br />
bats,<br />
accordé par la loi, en quoi il y a eu violation des articles susvisés.<br />
Par ces motifs : casse.<br />
MM. Ddpré-Lasale, rap. ; M. Godelle, av. gén.,<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
13 novembre 1877.<br />
c. conf.<br />
Responsabilité civile. — Faute. — Compagnie de chemins<br />
de fer.<br />
Une Compagnie de chemins de fer est responsable des conséquences de l'acci<br />
dent arrivé par suite de la faute de ses employés qui ont chargé un homme<br />
d'équipe de porter sur ses épaules un colis d'un poids trop considérable, surtout<br />
quand le chemin à parcourir se trouve en pente et rendu particulièrement<br />
glissant par suite de la pluie.<br />
Elle ne saurait être admise à invoquer, pour se dégager absolument de cette<br />
responsabilité, la faute commise par la victime elle-même qui, bien que pesam<br />
ment chargée, serait descendue directement du trottoir du quai se trouvant à<br />
une hauteur assez élevée, sur la voie chargée de ballast fraîchement remué, au<br />
lieu-de suivre le pont en bois spécialement destiné au passage de cette voie.<br />
Cette faute de la victime ne fait pas disparaître, en effet, la faute initiale de<br />
la elle ne peut avoir Compagnie, pour résultat que d'en atténuer la responsabi<br />
lité,<br />
et de réduire l'indemnité à fixer par les juges .<br />
Héritiers Costesèque c Compagnie des chemins de fer P.-L.-M.<br />
Attendu qu'il résulte des documents de la cause el notamment des enquêtes<br />
et contre-enquêtes auxquelles il a été procédé, que le 1« janvier 1875, au<br />
moment de l'arrivée, dans la gare de Relizane, du train d'Oran à Alger, le<br />
nommé Costesèque, homme d'équipe, reçut l'ordre du facteur Loret de trans<br />
porter du dépôt dans le wagon, les bagages qui devaient être transportés par<br />
le train ;<br />
— Que<br />
parmi les bagages se trouvait une caisse de savon pesant<br />
130 kilogrammes ; que celfe caisse fut chargée sur ses épaules et que Coste-
101<br />
sôque, au lieu de prendre, pour traverser la voie, le passage à cabrouet, suivit<br />
le trottoir, le quitta dès qu'il fut arrivé en face du wagon, et descendit<br />
directement du trottoir, élevé d'environ 35 centimètres, sur la voie elle-même<br />
dont le ballast avait élé récemment remué ; que là, il s'affaissa et tomba sous<br />
la caisse qu'il porlail ; que dans sa chute il se fil une grave lésion à la colonne<br />
vertébrale, lésion qui a entraîné une assez longue maladie.<br />
Attendu que le 15 oclobre, même année, Costesèque a assigné la Com<br />
pagnie Paris-Lyon-Méditerranée en paiement d'une somme de 25,000 fr.<br />
à litre de dommages-intérêts ; qu'étant décédé en juillet 1876, ses héritiers,<br />
c'est-à-dire son père, sa mère el ses deux —<br />
frères, ont repris l'instance ;<br />
Attendu que la Compagnie, arguant du défaut de qualité des parties deman<br />
deresses, soulève une fin de non-recevoir contre leur action,<br />
mais que celte<br />
exception est sans fondement ;<br />
Attendu que la Cour a à examiner, en l'état de la cause, si la réclamation<br />
des héritiers Costesèque est fondée, c'est-à-dire si la Compagnie défenderesse<br />
peut être déclarée responsable de l'accident dont cet homme a été victime;<br />
Attendu qu'il est incontestable que cet accident a élé principalement le<br />
résultat de l'imprudence commise par Costesèque lui-même, qui au lieu de<br />
se diriger vers le train en passant par le pont en bois, n'a pas craint, quoique<br />
porteur d'un lourd fardeau, de descendre directement du quai sur la voie<br />
— chargée de ballast ; Attendu néanmoins que cet accident n'aurait pas eu<br />
lieu, ou du moins n'aurait pas eu de conséquences graves si la caisse que<br />
Costesèque était chargé de transporter n'avait pas eu un poids aussi consi<br />
— dérable ; Qu'il faut donc reconnaître que l'accident a eu une double cause,<br />
d'abord et principalement la faute de la victime, et ensuite le poids delà<br />
— caisse ; Que tout en tenant un large compte de l'imprudence de Coste<br />
sèque et en reconnaissant que c'est elle qui a surtout occasionné l'accident,<br />
il y a lieu de rechercher si la responsabilité de la Compagnie n'est pas enga<br />
gée en partie par ce fait, que cet individu a été chargé de porter sur son dos<br />
— un colis d'un poids aussi élevé ; Attendu, en fait, qu'il est établi que Cos<br />
tesèque a été commandé par le facteur Loret pour transporter cette caisse ; que<br />
ce sont les employés de la gare qui l'ont placée sur ses épaules et que dans la<br />
situation où il se trouvait, il ne pouvait qu'obéir —<br />
; Attendu que si le poids<br />
de la caisse, soit 130 kilos, n'est pas par lui-même excessif, il y a lieu néan<br />
moins à reconnaître que ce colis était fort lourd eu égard à ce fait que Coste<br />
sèque avait à traverser la voie sur un pont dont la pente était très-prononcée<br />
et rendu si glissant ce jour-là par la pluie, que les hommes d'équipe déclarent<br />
qu'ils ont évité d'y passer, et qu'il devait, en outre, pour arriver au wagon,<br />
longer la voie du côté opposé à la gare ; qu'au reste, il résulte de l'enquête<br />
que ce poids dépassait le poids des colis que les hommes doivept porter sur<br />
— le dos et qui esl de 100 kilos; Qu'en effet, aussitôt après l'accident, des<br />
mesures ont été prises à la gare de Relizane pour que ce poids maximum<br />
— ne fût plus dépassé ; Qu'il est donc certain, qu'à ce point de vue.il existait<br />
dans cette avant gare, l'événement, une certaine négligence chez les employés<br />
—<br />
chargés de la surveillance ; Attendu que la Compagnie est responsable des<br />
agissements de ceux de ses employés qui ont commandé ou même simplement<br />
laissé opérer par Costesèque le transport sur le dos de la caisse en question ;<br />
— Que dans ces circonstances il y a lieu d'infirmer la décision des premiers
102<br />
juges et de décider que la Compagnie Paris-Lyon-Médilerranée est en partie<br />
responsable de l'accident arrivé à Costesèque, el doit participer par une in<br />
—<br />
demnité proportionnelle à la réparation du préjudice ; Attendu que la<br />
Cour trouve dans la cause des éléments qui lui permettent de fixer cette in<br />
demnité.<br />
Par ces molifs : LA COUR, rejette comme mal fondée la fin de non-rece<br />
voir soulevée par la Compagnie. Infirme le jugement du tribunal civil d'Oran,<br />
du 14 février dernier. Et slaluant à nouveau: Condamne la Compagnie<br />
Paris-Lyon-Méditerranée à payer, à titre d'indemnité, à Julien Costesèque;<br />
Rose Jollon, épouse Costesèque; Paul el Jean Coslesèque, en leur qualité<br />
de représentants de l'hoirie de Pierre Costesèque, la somme de 2,000 fr. avec<br />
intérêts à partir de la demande. La condamne en outre en tous les dépens de<br />
première instance et d'appel.<br />
Algérie. Domaine<br />
M . Piette,<br />
av . gén . ; Mes Chabert-Moreas el Robe, av .<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (i»Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
14 novembre 1877.<br />
— Régime des eaux.. —<br />
— Concessions. —<br />
premier président.<br />
public Inaliénable.<br />
Prescription.<br />
Les eaux, sous l'empire du droit musulman, dépendaient, il est vrai, du Do<br />
maine public, mais il résulte de la saine interprétation de la loi musulmane, de<br />
l'opinion de ses docteurs les plus autorisés, d'une série de faits de propriété<br />
reconnus et consacrés par les siècles au profit des tribus ou de simples particu -<br />
tiers, de travaux d'établissement nombreux,<br />
enfin des termes et des travaux<br />
préparatoires de la loi du 16 juin 1851 , ainsi que de la jurisprudence, que les<br />
eaux étaient parfaitement susceptibles d'appropriation privée ,<br />
Cette appropriation pouvait résulter soit d'une concession ou aliénation pro<br />
venant du Sultan ou de ses représentants, soit d'une jouissance suffisante pour<br />
acquérir la prescription (1) .<br />
(I)<br />
Cet important arrêt de principe est conforme à la jurisprudence antérieure de<br />
la Cour (Voir Narbonne, Répertoire, v'Eaux, n°" 1 à 5). La seule décision (visée au<br />
surplus dans l'arrêt lui-même, qui semble en contradiction avec les principes<br />
énoncés, est l'arrêt du 22 juin 1874 (Robe, 1874, p. 232), rendu dans une affaire<br />
Dessoliers et l'État c. de Fleurieu, de St-Victor, sous la présidence de M. Cuniac.<br />
Toutefois, les termes de cette dernière décision sont en opposition plutôt appa<br />
rente que réelle avec l'arrêt rapporté : car la doctrine qu'elle adopte apparaît entou<br />
rée de bien des réserves et des restrictions. Voici en. effet comme elle s'exprime :<br />
« Attendu au surplus qu'en consacrant le maintien des droits légalement acquis,
103<br />
Préfet d'Alger c, Fayolles et Caillol.<br />
ARRÊT:<br />
Attendu que Fayolles revendique contre l'État le droit à la jouissance,<br />
dans<br />
des'<br />
conditions déterminées, d'une prise d'eau dérivée de l'Oued-el-<br />
Kebir par le canal de Mebdouah ;<br />
— Que l'État, avant même de discuter les<br />
titres invoqués par son adversaire, leur oppose un droit supérieur et préémi<br />
— nent ; Qu'il soutient qu'en Algérie les eaux, de quelque nature qu'elles<br />
soient, font partie du domaine public inaliéanable, et que ce principe, for<br />
mellement édicté pour l'avenir par la loi du 16 juin 1851, était déjà l'ex<br />
pression de la législation antérieure ; qu'en effet, le droit musulman, obéis<br />
sant lui-même à des nécessités impérieuses, fondées sur la nature des choses,<br />
avait placé les eaux dans la catégorie des biens non susceptibles de propriété<br />
privée, parce que, constituant une richesse utile à tous, elles devaient être<br />
réservées à l'usage général sous le contrôle de l'autorité publique ; que, tout<br />
au plus et rarement ce principe avait pu recevoir quelques dérogations par<br />
des concessions émanant de l'autorité souveraine et presque divine du Sultan<br />
—<br />
ou de ses représentants ; Attendu qu'il importe d'autant plus d'examiner<br />
le mérite d'un pareil moyen que le Domaine annonce ouvertement qu'il<br />
poursuit surtout daus ce procès l'occasion de faire consacrer une doctrine<br />
générale ;<br />
— Attendu<br />
que le texte et l'esprit de la loi du 16 juin 1851 four<br />
nissent tout d'abord, contre la thèse du Domaine, une objection considéra<br />
—<br />
ble; Que si sous l'empire du droit musulman, les eaux eussent fait partie<br />
du domaine public inaliénable, le législateur de 1851, qui voulait consacrer<br />
ce principe pour l'avenir, n'eût pas manqué de recueillir cette doctrine<br />
traditionnelle et qu'il se fût gardé d'insérer dans le g 4 de l'article 2 de la<br />
» la loi de 1851 admet, il est vrai,<br />
—<br />
» priété privée, selon le droit musulman ; Mais<br />
que les cours d'eau ont pu tomber dans la pro-<br />
qu'en principe, dans les pays<br />
» musulmans, l'eau, à raison de sa nécessité et de l'intérêt général qui, plus que<br />
» dans d'autres contrées, doit en dominer la distribution, fait partie du domaine<br />
—<br />
» public et est inaliénable; Que, sans doute, le Sultan ou le Dey, exerçant l'aulo-<br />
» rite souveraine et presque l'autorité divine, n'ont pas toujours respecté, en fait, les<br />
» droils de la communauté musulmane ; —<br />
» pour eux-mêmes, ou les ont concédées à des particuliers ;<br />
Qu'ils<br />
se sont parfois emparés des eaux<br />
— Mais qu'en admet-<br />
» tant la validité des concessions de ce genre, les intimés n'en produisent aucun<br />
« titre ;<br />
— Qu'il<br />
n'est point justifié que Hassan Pacha se soit attribué les eaux de<br />
» l'Oued Zouine et de l'Oued Kerma ;<br />
» équivaloir à un titre,<br />
» n'est fournie et ne saurait l'être »<br />
— Attendu<br />
que la longue possession, pût-elle<br />
aucune preuve de cette possession antérieure à la conquête<br />
Ainsi qu'on le voit, tout se trouve énoncé d'une manière dubitative dans cette<br />
décision,<br />
et l'on ne peut la considérer comme constituant une contradiction réelle à<br />
la doctrine qui avait été soutenue par M. Robe dans la dissertation publiée par lui<br />
dans son Journal de jurisprudence, année 1867, p. 257, et qui, revêtue déjà de<br />
l'autorité de plusieurs arrêts, a été consacrée, une fois de par plus,<br />
l'arrêt rapporté,<br />
dans les termes les plus explicites.<br />
Voir également sur cette question la brochure publiée il y a quelques années<br />
par M. sur Barny la Question des eaux en Algérie.
104<br />
loi du 16 juin, une réserve aussi expresse que celle-ci : « Néanmoins son^<br />
« reconnus et maintenus, tels qu'ils existent, les droits de propriété, d'usu-<br />
« fruit ou d'usage légalement acquis antérieurement à la présente loi... »<br />
Que ce préjugé ressort avecplus d'évidence encore des travaux préparatoires<br />
—<br />
de la loi de 1851 ; Attendu, au surplus, que la réfutation directe de la<br />
proposition sur laquelle s'appuie le Domaine, résulte de la saine interpréta<br />
tion de la loi musulmane, de l'opinion de ses docteurs les plus autorisés,<br />
d'une série de faits de propriélé reconnus et consacrés par les siècles au pro<br />
fil des tribus ou de simples particuliers, de travaux d'établissement nom<br />
breux qui révèlent des appropriations, fruit d'un long usage ;<br />
enfin d'une<br />
jurisprudence imposante dont la fermeté n'a pu être ébranlée par la contra<br />
—<br />
diction d'un arrêt unique; Attendu, dès lors, qu'il n'y<br />
s'arrêter à l'exception principale invoquée au nom de l'État et tirée du ca<br />
a pas lieu de<br />
ractère inaliénable des eaux, dépendance du Domaine public;<br />
que Fayolles est devenu propriétaire du Haouch-el-Bey-Hassen en vertu des<br />
— Attendu<br />
actes du 21 septembre 1831 et 30 septembre 1836, et que ces titres lui don<br />
— Que d'ailleurs, il repose en outre<br />
naient droit à la prise d'eau contestée ;<br />
sur une jouissance immémoriale, pratiquée par les auteurs de Fayolles, at<br />
testée par des ouvrages apparents, établie par des enquêtes qui, bien qu'or<br />
données dans d'autres litiges, n'en sont pas moins applicables à la cause<br />
— actuelle ; Que le droit de propriété de la dérivation des eaux de l'Ouedel-Kebir<br />
par le canal de Mebdouah a été formellement reconnu par l'État<br />
dans les instances San Angabio, Pages et Legoff ;<br />
— Que<br />
celle reconnaissance,<br />
si elle ne peut être opposée aujourd'hui sous la forme d'exception de la chose<br />
jugée, n'en constitue pas moins une présomption de fait décisive ;<br />
dans cette situation si bien connue de l'État, il ne saurait même y avoir<br />
— Que,<br />
prétexte à la déchéance consacrée par l'arrêté du 18 août 1842, en admettant<br />
qu'un simple arrêt puisse édicter de pareilles sanctions; Que c'est donc à<br />
bon droit que les premiers juges ont consacré le droit de propriété de<br />
Fayolles,<br />
ordonné en conséquence qu'il serait rétabli dans la libre jouissance<br />
— de son droit et condamné l'État à des dommages-intérêts; En ce qui<br />
concerne le chiffre des dommages-intérêts et leur point de dépari; Adoptant<br />
— les motifs des premiers juges; En ce qui touche les conclusions en ga<br />
— ranties prises par le Domaine contre le syndicat ; Atlendu que le syndicat<br />
n'était qu'usufruitier el que, conformément à la loi, après avoir dénoncé la<br />
revendication au Domaipe, il s'est toujours désintéressé du débat sans élever<br />
— aucune prétenlion personnelle; Que le Domaine, en 'se conslituant en 1«<br />
instance et en appel l'adversaire de Fayolles, a seul assumé la responsabilite.de<br />
— la contestation ; Que c'est donc justement que leTribunal de Blidah a ordon<br />
— né la mise hors de cause du syndicat; Par ces motifs : La cour rejette l'ap<br />
pel, met hors de cour et de procès le sieur Caillol —<br />
ès-qualilé; Confirme le<br />
jugement déféré, lequel sortira son plein el en entier effet; Condamne le<br />
Préfet d'Alger représentant le Domaine de l'État en tous les dépens.<br />
M. Piette, av. gén. concl. conf. ; M" Genella, Bouriaud<br />
et Chabert-Moreau, av.
105<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT; premier président.<br />
24 décembre 1877<br />
Partage. — — Effet — déclaratif. Valeurs mobilières. Créan<br />
ces. — Rétroactivité. — Ordre.<br />
L'effet déclaratif du partage, édicté par l'art. 883 du Code civil, s'applique<br />
à tous les effets héréditaires, de quelque nature qu'ils soient, tant mobiliers<br />
qu'immobiliers (1).<br />
Notamment, lorsqu'une liquidation de communauté attribue à l'un des co-<br />
partageanls le prix d'immeubles vendus par expropriation à la requête d'un<br />
créancier personnel de l'autre copartageant, cette attribution a pour effet de<br />
faire considérer t'<br />
attributaire comme ayant été ab initio seul propriétaire des<br />
immeubles à l'exclusion de toute copropriété.<br />
En conséquence le prix de ces immeubles pour la distribution duquel un<br />
ordre a été ouvert, doit être attribué intégralement et sans frais d'ordre, à<br />
titre de propriétaire, au copartageant dans le lot duquel il a élé placé.<br />
Consorts Dodin c. consorts W^ehrel.<br />
Attendu en fait, que la dame Clarisse Dodin, mariée au sieur Soipteur sous<br />
le régime de la communauté réduite aux acquêts, décédait à Boghar, le 6<br />
— septemhre 1867 ; Que le mari survivant restant en possession de tous les<br />
biens dépendant, soit de la communauté, soit de la succession —<br />
; Que dès<br />
—<br />
l'année suivante, il convolait à de secondes noces avec la dame Washrel;<br />
Qu'après avoir introduit une demande en liquidation de la communauté<br />
Soipteur-Dodin, les héritiers de la dame Dodin discontinuèrent leurs pour<br />
— suites ; Que pendant l'intervalle, Soipteur agissant toujours en maître sur<br />
les biens de la première communauté, contracta divers —<br />
engagements;<br />
Que sur l'aclion hypothécaire d'un créancier personnel de Soipteur, dont la<br />
créance était née postérieurement à la dissolution de la communauté, des<br />
immeubles dépendant de cette communauté furent frappés de saisie immobi<br />
— lière ; Que les consorts Dodin, qui avaient requis tardivement l'inscription<br />
de l'hypothèque légale appartenant à la ^ame Dodin, furent sommés, au<br />
—<br />
domicile élu, d'avoir à prendre communication du cahier des charges ;<br />
Que la procédure d'expropriation poursuivit son cours et aboutit, sans inci<br />
dent, à l'adjudication des immeubles au profit d'un —<br />
tiers; Qu'à la suite<br />
de celte adjudication qu'ils n'avaient pas essayé d'entraver, les héritiers<br />
Dodin, reprenant l'instance en liquidation interrompue, firent dresser le<br />
(1 ) Voir sur l'effet déclaratif du partage, relativement aux créances, Dalloz, Code<br />
civil annoté, sur l'art. 883, g 59 et. suiv.; Demolombe, Successions, t. 5, n°s 292 et<br />
suiv.
106<br />
procès-verbal de partage et liquidation par le notaire Ganter et en deman<br />
dèrent l'homologation devant le tribunal de Blida; que le jugement du 3<br />
janvier 1877, prononçant celte homologation, a élé régulièrement signifié et<br />
qu'il est aujourd'hui définitif;<br />
Attendu que le partage, ainsi homologué, attribuait aux héritiers Dodin le<br />
prix des quatre premiers lois vendus par expropriation ; que c'est dans cette<br />
situation et après le décès de la dame Wsehrel et de Soipteur, qu'un ordre a<br />
— été ouvert pour la distribution du prix de l'adjudication; Que le jugecommissaire,<br />
et après lui le tribunal de Blida, sans tenir aucun compte de<br />
l'avènement du partage, considérant les immeubles expropriés comme dépen<br />
dant de la communauté, ont colloque, d'après le rang de leurs créances, les.<br />
créanciers du sieur Soipteur à concurrence de la moitié du prix de l'adjudi<br />
cation ;<br />
Attendu que la contestation actuelle pouvait soulever le conflit des intérêts<br />
suivants : ceux de l'adjudicataire, ceux des créanciers Soipteur, ceux des co-<br />
—<br />
partageauls; Que les héritiers Dodin qui eussent pu, peut-être, mettre en<br />
question la régularité de l'adjudication, se sont néanmoins inclinés devant<br />
— ce fait accompli ; Que renonçant à demander le partage en nature, ils se<br />
sont bornés à réclamer l'attribution du prix et que cette attribution leur a élé<br />
faite, pour les quatre premiers lots, par l'acte de liquidation Ganter —<br />
; At<br />
tendu que le principe de l'article 883 du Code civil est général et qu'il s'ap<br />
plique aux effets héréditaires de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou<br />
immobiliers ;<br />
— Que<br />
le législateur moderne accueillant à cet égard une doc-<br />
trinetraditionnelle, l'accommodant sagement aux besoinsde la société actuelle,<br />
a proclamé d'une manière absolue, dans les rapports des copartageants entre<br />
eux et dans les rapports de ceux-ci avec les ayants cause de leurs cohéritiers,<br />
— l'effet déclaratif du partage ; Que la rétroactivité, conséquence nécessaire<br />
de ce principe, a pour but el pour résultat, en effaçant les actes accomplis<br />
pendant l'indivision par quelques-uns des cohéritiers, d'assurer la stabilité<br />
des partages, de tarir la source des procès entre copartageants et de conso<br />
lider la propriété issue du partage ;<br />
— Que c'est là une règle fondamentale<br />
— qui doit prévaloir sur toutes les autres ; Que le texte de l'article 883, son<br />
esprit surtout, répugnent à des distinctions qui seraient fondées sur la nature<br />
— mobilière ou immobilière des biens objet du partage; Qu'il serait difficile<br />
de comprendre pourquoi les copropriétaires d'immeubles indivis ne pour<br />
raient consentir que des droits résolubles soumis à l'éventualité du partage<br />
tandis que les copropriétaires de créances pourraient consentir, au con<br />
traire, des droits incommutables ; Qu'une pareille distinction ne troublerait<br />
pas seulement l'harmonie d'un système juridique, mais qu'elle produirait dans<br />
les rapports de famille basés sur —<br />
les partages une complète perturbation ;<br />
Qu'il suit de là qu'en attribuant aux héritiers Dodin le prix de l'adjudication<br />
des quatre premiers lots, le partage du 3 janvier 1877 a eu un effet déclara<br />
tif et que la propriété de ce prix, ainsi reconnue par le partage aux héritiers<br />
Dodin, exclut pour le passé la copropriété de Soipteur et par voie de consé<br />
quence les droils des ayants cause de ce dernier; que ce résultat est aussi<br />
équitable que juridique —'Qu'en ; effel, si l'immeuble demeuré indivis avait<br />
été attribué par le partage aux héritiers Dodin, toutes les hypothèques consen<br />
ties par Soipteur sur cet immeuble, se seraient évanouies devant le principe
1Q7<br />
de la rétroactivité ; que la situation des créanciers personnels de Soipteur ne<br />
saurait être modifiée par cela qu'une expropriation est survenue et que le<br />
partage, au lieu de mettre dans le lot des héritiers Dodin l'immeuble même,<br />
y place le prix qui en est la représentation —<br />
; Al tendu, dès lors, que le rè<br />
glement provisoire a été établi en violation de l'article 883 du Code civil ;<br />
Qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit fait attribution aux consorts Dodin, sans<br />
frais d'ordre, à titre de propriétaires, non à titre de créanciers, du prix des<br />
quatre premiers lots avec les intérêts courus :<br />
Faisant droit à l'appel, infirme le jugement déféré ; ordonne qu'il sera fait<br />
attribution pleine et entière, sans frais d'ordre, à tilre de propriétaires, non<br />
à titre de créanciers, aux héritiers Dodin, du prix d'adjudication des qualre<br />
premiers lots. Dit que le règlement provisoire sera modifié en ce sens.<br />
M. Piette, av. gén. ; Mes Doudart de la Grée et Dazinière, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
31 décembre 1877.<br />
I. Privilège du vendeur de l'art. S102 C. civ. — Identité de<br />
l'objet. —<br />
dises.<br />
Fonds<br />
de commerce. — Matériel.<br />
— Marchan<br />
II. Privilège du bailleur. — — Inexécution du bail. Dommages-<br />
intérêts.<br />
/. Le privilège de vendeur de l'art. 2102 du Code civil ne peut être exercé<br />
qu'à la condition d'une identité absolue entre la chose vendue et celle sur laquelle<br />
l'exercice du privilège doit avoir lieu.<br />
En conséquence,<br />
si le vendeur d'un fonds de commerce a le droil évident<br />
d'exercer son privilège, pour le solde de sonprix de vente, au cas où le fonds de<br />
commerce serait l'objet d'une revente, il ne peut en être de même si la deuxième<br />
vente porte non sur le fonds lui-même, mais bien sur le matériel ou les marchan<br />
dises garnissant le magasin ; dans ce cas le privilège ne peut être exercé que<br />
relativement aux objets mobiliers dont l'identité avec ceux compris dans la<br />
vente primitive serait reconnue (1).<br />
//. Le privilège du bailleur de l'art. 2102 du Code civil a pour objet de<br />
garantir l'exécution du bail ; il s'applique conséquemment aux dommages-inté<br />
rêts accordés au bailleur contre le preneur pour inexécution du bail.<br />
Coste et C'» c. époux Benoît.<br />
Attendu qu'à la suite de la vente aux enchères publiques du matériel et<br />
(1) Cpr. Dalloz. Code civil annoté sur l'art. 2102, § 274 et suiv. Jurisp. conf.,<br />
"V"<br />
7 août 1841 (D. Privilèges, n" 356 et 357.)<br />
Paris, 26 nov. 1833. Rouen,
108<br />
des marchandises dépendant du fonds de commerce appartenant au sieur<br />
—<br />
Jaitte, le prix a été mis en distribution ; Que dans la contribution ouverte,<br />
Benoîl a obtenu une collocation privilégiée pour le solde du prix de la vente<br />
du fonds de commerce qu'il avait consentie à Jaitte, par acle sous seing-privé,<br />
—<br />
enregistré, du 29 novembre 1875 ; Attendu que si, en principe, le privi<br />
lège de l'art. 2102 du Code civil s'applique à un fonds de commerce, le droit<br />
de préférence du vendeur ne saurait s'exercer que sur le prix de revente<br />
de ce même fonds de commerce ;<br />
— Que<br />
dans l'espèce, le fonds de commerce<br />
n'a pas été revendu et que la somme mise en distribution provenait exclu<br />
sivement de la vente du matériel et des marchandises garnissant le magasin ;<br />
— Qu'il<br />
résulte des documents du procès que les marchandises vendues aux<br />
enchères étaient autres que celles qui avaient élé vendues par Benoît avec le<br />
— fonds de commerce ; Que dès lors la condition essentielle à l'exercice du<br />
privilège de l'art. 2102 manquait dans la cause, et que c'est à tort que les<br />
'<br />
premiers juges ont colloque de ce chef, par privilège, la créance du sieur<br />
Benoîl pour solde du prix de vente',<br />
— Mais<br />
attendu que l'identité du maté<br />
riel qui se trouvait en la possession de Jaitte au moment de la vente étant au<br />
contraire suffisamment établie, il y a lieu de maintenir, quant à ce, la collo<br />
cation privilégiée pour la somme de 332 fr. 65 c, montant de la revente de<br />
ce matériel ;<br />
En ce qui touche la collocation privilégiée pour les 300 francs de domma<br />
— ges-intérêts alloués aux époux Benoît ; Attendu que les dommages-inté<br />
rêts accordés pour l'inexécution du bail constituent, d'après les termes et<br />
l'esprit de l'art. 2102 du Code civil, une créance privilégiée;<br />
— Que<br />
c'est<br />
donc le cas de maintenir sur ce point le règlement provisoire.<br />
Par ces motifs : LA COUB, reçoit l'appel des consorts Cosle et infirmant le<br />
— jugement déféré ; Dit que les époux Benoît ont été à tort colloques par<br />
privilège pour l'entier solde du prix de la vente du fonds de commerce; que<br />
le bénéfice de cette collocation privilégiée doit être restreint à la somme de<br />
— 332 fr. 65 c, représentant la valeur du matériel ; Maintient, au contraire,<br />
la collocation privilégiée pour la somme de 300 francs de dommages-inté<br />
rêts;— Ordonne que le règlement provisoire sera rectifié conformément<br />
aux dispositions du présent arrêt. El quant aux dépens, dit que ceux de<br />
première instance et d'appel seront mis en masse pour être supportés par<br />
moitié, par chacune des parties.<br />
M. Piette, av. gén. ; M" Bouriaud et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Les expressions m<br />
Présidence de M. DUMALLE, conseiller.<br />
27 octobre 1877.<br />
Diffamation. — Outrage.<br />
, souteneur de filles, constituent l'outrage prévu
109<br />
et réprimé par l'art. 224 du C. p. et non la diffamation définie par l'art. 13<br />
de la loi du 17 mai 1819.<br />
Proc gén. c. Mohamed ou Ramdan Saïd Naît Saïd.<br />
Sur le premier et le troisième chef de prévention : Adoptant les motifs<br />
— des premiers juges ; Sur Te deuxième chef de prévention : Attendu que la<br />
diffamation implique, aux termes de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819,<br />
l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de<br />
la personne ; que cette imputation ne se rencontre pas dans les mots :<br />
m<br />
, souteneur de filles ;<br />
mais qu'ils constituent l'outrage prévu et puni<br />
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de modi<br />
—<br />
par l'article 224 du Code pénal ;<br />
fier la qualification des premiers juges et de substituer l'outrage à la diffa<br />
mation, le délil d'outrage étant d'ailleurs constant et devant être retenu à<br />
— rencontre des appelants; Sur l'application de la peine : Attendu que les<br />
circonstances de la cause permetlenl d'atténuer la condamnation prononcée<br />
par le tribunal.<br />
Par ces motifs : Réduit l'emprisonnement à quatre mois et ordonne que les<br />
autres dispositions du jugement déféré sortiront leur plein et entier effet ;<br />
Condamne les appelants solidairement aux dépens de première instance et<br />
d'appel.<br />
M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />
Me Baudband, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />
Présidence de M. TRUADT, président.<br />
25 janvier 1878.<br />
I. Appel correctionnel. — Déclaration d'appel. —<br />
—<br />
Mandat<br />
spécial. — Avocat. — II. Algérie. — Nullité facultative.<br />
/. Aux termes des art. 203 et 204 du Code d'inst. crim., la déclaration<br />
d'appel ne peut, à peine de nullité, être formée que par la partie, son avoué,<br />
ou son mandataire spécial.<br />
Par suite, est nul l'appel interjeté au nom du prévenu par un avocat, agis<br />
sant sans procuration spéciale; car il ne peut être considéré comme un manda<br />
taire légal ad litem.<br />
77. La nullité dont est entaché l'appel interjeté par un avocat, ne peut être<br />
rejetée par application de l'art. 69 de l'ord. du 26 Septembre 1842, qui rend<br />
facultatives pour lejuge les nullités des actes d'exploits et de procédure (1).<br />
(1) Cet arrêt a été rendu conformément aux principes établis . La Cour d'Alger,<br />
par une jurisprudence constante, a décidé que la faculté accordée par l'art. 69
no<br />
Contributions diverses c. Cerdan el Gomez.<br />
En la forme : Attendu que Cerdan Antonio, bien que régulièrement cité<br />
ne comparait pas ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;<br />
Au fond : Attendu en droit qu'aux termes des articles 203 et 204 du Code<br />
d'instruction criminelle, la déclaration d'appel ne peut, à peine de déchéance,<br />
être formée que par la partie elle-même, son avoué ou un mandataire spé<br />
— cial ; Attendu que l'avocat n'est pas, comme l'avoué, le mandataire légal<br />
ad litem de la partie pour laquelle il plaide; Qu'à défaut d'un mandat spécial,<br />
il est dès lors sans qualité pour interjeter appel au nom de son client et que<br />
l'appel par lui relevé dans de telles conditions est entaché de nullité ;<br />
Atlendu que cette nullité étant constante, il ne saurait appartenir aux tribu<br />
naux de relever des conséquences qu'elle entraîne, la partie qui l'a encou<br />
rue ;<br />
1842,<br />
que les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre<br />
qui rend facultatives pour le juge les nullités d'exploits ou de procé<br />
dure, ne peuvent, en effet, recevoir application lorsqu'il s'agit ;d'actes ou<br />
de procédures qui devaient, à peine de déchéance, être faits, soil dans un<br />
délai fixe, soit dans une forme déterminée par la loi —<br />
; Attendu en fait,<br />
que suivant acte reçu au greffe le 30 octobre 1877, M"<br />
—<br />
Rouire, avocat à Oran,<br />
a déclaré relever appel au nom de l'administration des Contributions diverses<br />
du jugement en dale du 20 octobre 1877, par lequel le tribunal correction<br />
nel d'Oran a renvoyé des poursuites dirigées contre eux les nommés Cerdan<br />
Antonio el Gomez Ramon ; qu'il n'est pas justifié que Me Rouire ait été in<br />
—<br />
vesti d'un mandat spécial à l'effet de faire cette déclaration ; Attendu que<br />
conformément aux principes ci-dessus rappelés, l'appel dont il s'agit doit être<br />
déclaré nul ;<br />
Par ces motifs : Donne défaut contre Cerdan Antonio,<br />
non comparant.<br />
pouvait s'appliquer aux nullités de rédaction et d'énonciation, mais n'autorisait pas<br />
les tribunaux à relever les parties de déchéances ou forclusions encourues faute<br />
d'accomplissement de formalités prescrites dans les délais déterminés (Ménerville,<br />
I, p. —<br />
395, note 2). Jurisp. conf. Voir notamment 11. nov. 1858, Maingot c.<br />
Verdin; 7 déc. 1868, Préfet de Constantine c. Lacombe (Narbonne, Rêpèrt., v°<br />
Nullités facultatives, n°s 2 et 3.) Voir Bull, jud., 1877, p. 97.<br />
Il y a lieu toutefois de remarquer que dans cette affaire, en raison de la<br />
qualité de la partie appelante et de l'état de la procédure, l'appel, repoussé unique<br />
ment comme non recevable en la forme, pouvait peut-être être relevé à nouveau. En<br />
effet, l'art. 13 du décret du 1" germinal an XIII, réglant la forme de procéder sur<br />
les contraventions aux lois concernant les impôts indirects, qui stipule « que l'appel<br />
devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, et qu'après ce<br />
délai il ne sera plus recevable », réglemente spécialement la matière. La Cour de<br />
cassation a décidé que cette procédure spéciale n'avait pas été abrogée par la pro<br />
mulgation de l'art. 203 du Code d'instr. crim. , les lois générales ne dérogeant pas<br />
aux lois spéciales, à moins de dispositions expresses (Cass. 13 février 1840). Dans<br />
l'espèce, si le jugement rendu par le tribunal d'Oran n'avait pas été signifié à l'Ad<br />
ministration, la voie de l'appel était toujours ouverte, et la nullité prononcée de<br />
l'appel irrégulier n'emportant point déchéance, l'appel pouvait être régulièrement<br />
renouvelé. (Cass. 11 mai 1808. — Cass.<br />
Dalloz, v» Impôts indirects, n°s 520 et 531).<br />
10 fév. 1814. —<br />
Cass.<br />
16 avril 1819. —<br />
H. J.
111<br />
Statuant au foûd : Rejette comme nul et non recevable l'appel interjeté par<br />
Me<br />
Rouire, avocat, au nom de l'administration des Contributions diverses.<br />
Ordonne en conséquence que le jugement dont est appel sortira son plein et<br />
entier effet. Condamne l'administration des Contributions diverses aux frais<br />
envers l'État.<br />
M. Fau, av. gén. ; M« Chéronnet et Doudart de la Grée, av.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (lre Ch.)<br />
Présidence de M. DELACROIX, président.<br />
8 janvier 1878.<br />
Responsabilité. — Échelle abandonnée sur la vole publique. —<br />
Vol.<br />
Les dommages-intérêts qui sont dus à raison d'un délit, doivent comprendre,<br />
à l'égard de la perte éprouvée par la partie lésée, tout ce qui est une suite im<br />
médiate et directe de ce délit , mais non les dommages qui ne se rattachent au<br />
fait incriminé que d'une manière éloignée et peuvent avoir d'autres causes .<br />
Ainsi, lorsque des malfaiteurs s'emparent d'une échelle abandonnée pour<br />
commettre un vol en franchissant une clôture, on ne peut faire remonter la<br />
bien que l'abandon de<br />
responsabilité du vol jusqu'au propriétaire de l'échelle,<br />
l'échelle constitue une contravention punissable aux termes de la loi.<br />
Jouve c. Debabd.<br />
Attendu que si aux termes de l'article 1382 du code civil, lout fait quel<br />
conque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute<br />
duquel il est arrivé, à le réparer, il est reconnu par la doctrine et la juris<br />
prudence que cet article doit être interprété dans ce sens que pour donner<br />
ouverture à l'action en dommages-intérêts, il faut que le préjudice dont se<br />
plaint la partie lésée soit la conséquence directe et immédiate de la contra<br />
vention ou du délit dont il poursuit la réparation civile ; que la raison et<br />
l'équité,<br />
conformes au texte et à l'esprit de la loi (art. 1151 du code civil),<br />
démontrent jque nul ne peut être tenu de réparer le dommage qui ne découle<br />
pas positivement de son fait, qui ne prend qu'indirectement- sa source dans<br />
le fait incriminé, sans quoi il n'y aurait plus de limites à l'étendue de la<br />
—<br />
responsabilité; Attendu que la cause directe du préjudice éprouvé par<br />
Jouve est la perpétration du vol auquel on ne peut dire que les défendeurs<br />
aient coopéré,, et non l'abandon des échelles sur la voie publique, contraven<br />
tion pour laquelle ils ont été condamnés à cinq francs d'amende ; — Qu'il<br />
n'existe pas entre cette contravention et le vol qui l'a suivie, relation suffi<br />
sante pour assimiler les contrevenants aux auteurs de la soustraction fraudu<br />
leuse ou à leurs complices, quant à la réparation —<br />
civile; Que dès lors,
112<br />
en admettant pour constants les faits articulés par Jouve, les défendeurs ne<br />
sauraient être tenus de réparer le dommage qu'il a éprouvé ;<br />
Par ces motifs, jugeant contradictoirement el en premier ressort : — Déclare<br />
Jouve non recevable et mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le con<br />
damne en tous les dépens.<br />
M, de Castelbajac, subst. du Proc. de la Rêp.; Mcs Gillotte et Gjvodan, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par arrêté du Procureur général près la Cour<br />
16 mars 1878 :<br />
M . Benedetli,<br />
Ange-Marie,<br />
d'appel'<br />
d'Alger,<br />
en date du<br />
est npmmé curateur aux successions vacantes<br />
dans le canton de Fort-National, en remplacement de M. Ceccaldi, décédé.<br />
Par décret en dale du 18 mars 1878 :<br />
M. Benedetti, greffier de la Justice de paix de Fort-National, a élé autorisé<br />
à remplir les fonctions de notaire au titre II .<br />
Par arrêté en date du 1er avril 1878 :<br />
M. Lartigue, Léonce, secrélaire du Parquet de sous-<br />
Blidah, a été nommé<br />
secrétaire au Parquet de première instance d'Alger, en remplacement de<br />
M. Pauc, Henri,<br />
mis en disponibilité sur sa demande.<br />
M. Blin, Adolphe-Pierre, a été nommé secrélaire du Parquet de Blidah,<br />
en remplacement de M. Lartigue,<br />
mière instance d'Alger.<br />
Dette. —<br />
cier. — Une<br />
nommé sous-secrétaire du Parquet de pre<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Libération entre les mains d'un notaire. — Mandat d'un créan<br />
personne n'est pas libérée vis-à-vis de son créancier en payant<br />
sa dette entre les mains d'un notaire; si ce notaire n'a pas reçu du créancier<br />
mandat de recevoir (Cass. Req., 18 déc. 1877). — France judic, p. II, 257.<br />
Chemins de fer. —<br />
Action<br />
choisi par le destinataire. —<br />
en responsabilité. —<br />
Extinction<br />
Livraison<br />
de toute action. — L'art.<br />
au camionneur<br />
105 du<br />
Code de commerce, aux termes duquel « la réception des objets transportés<br />
» et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voi-<br />
» turier, » s'applique même lorsque la livraison a été faite, non au destina<br />
taire lui-même, mais au camionneur choisi par ce dernier (Cass. civ., 16<br />
juillet 1877). — France judic, II, p. 246.<br />
Alger. —<br />
Typ. A. Joubdan.
2e année. — 16<br />
Avril 1878. —<br />
N° 32<br />
BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
I. Algérie. —<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
LÉGISLATION<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président<br />
Condamnation<br />
26 juillet 1877.<br />
correctionnelle. — Pourvoi<br />
cassation. — Mise en état. —<br />
II. Dénonciation calomnieuse. — Fausseté<br />
cision de l'autorité compétente,<br />
— IIï. Algérie. Commune<br />
IV. Cour d'appel. —<br />
gravation.<br />
/. La loi du 26 juin 1877,<br />
en<br />
Promulgation de» lois .<br />
des faits. —<br />
mixte. — Adjoint indigène. —<br />
Aggravation de peine. —<br />
Dé<br />
Caïd.<br />
Rioîifs de l'ag<br />
qui a modifié les art. 420 et suiv. du Code<br />
d'instr. crim., relatifs à la mise en état des condamnés correctionnels qui se<br />
sont pourvus en cassation, est exécutoire de plein droit pour la Cour de cas.<br />
sation en ce qui concerne les condamnés algériens, sans qu'il y ail à rechercher<br />
si cette loi a été l'objet d'une promulgation spéciale en Algérie.<br />
H. La fausseté des faits dénoncés résultant d'une ordonnance de non-lieu<br />
et en outre d'une enquête administrative, il n'y a pas violation de l'art. 373<br />
du Code pénal dans ce fait que l'arrêt de condamnation, après avoir constaté<br />
ces décisions,<br />
aurait apprécié les faits eux-mêmes pour en déduire la preuve<br />
de la mauvaise foi et de l'intention malveillante du dénonciateur .<br />
III. Le titre de caïd ne peut être considéré comme un titre militaire, que<br />
lorsque le chef qui en est revêtu exerce ces fonctions en territoire militaire.<br />
Mais lorsque la commune mixte administrée par le caïd, a été détachée du<br />
commandement militaire pour passer sous l'autorité et préfectorale, que l'an<br />
cien caïd, qualifié de président de Djemda, est devenu fonctionnaire civil de<br />
celte commune mixte, peu importe que la "qualification de caïd lui soit encore<br />
parfois attribuée à titre honorifique : dans ce c'est cas, à la juridiction ordi<br />
naire et non à l'autorité militaire qu'il appartient d'apprécier la vérité ou la<br />
fausseté des incriminations dirigées contre l'ancien caïd.
114<br />
IV. Les juges d'appel ont le droit d'aggraver la peine prononcée par les<br />
premiers juges, en appréciant souverainement les circonstances de la prévention,<br />
et sans avoir à faire ressortir les circonstances qui motivent cette aggravation.<br />
Hadj Ahmed ben Kaddobr.<br />
Attendu que, par acte déposé au Greffe le 25 juillet courant et signé Chambareaud,<br />
avocat en la Cour, El Hadj Ahmed ben Kaddour a déclaré se désister<br />
de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Alger, chambre des appels correc<br />
tionnels, qui lui a refusé, le 27 avril 1877, la mise en liberté provisoire sous<br />
que ce désistement est régulier en la forme, la Cour en<br />
— caution ; Atlendu<br />
donne acle au demandeur, dit en conséquence qu'il n'échei de statuer sur<br />
le pourvoi qui en sera considéré comme non avenu, ordonne la restitution<br />
— de l'amende consignée ; Et staluanl sur la recevabilité du pourvoi contre<br />
l'arrêt de condamnation formé par le demandeur sans qu'il ait, au préalable,<br />
— justifié de sa mise en étal ; Attendu qu'aux termes de la loi du 26 juin<br />
1877, modificative des articles 420 et 421 du Code d'instruction criminelle,<br />
les condamnés à une peine emportant privation de la liberté, ne sont tenus<br />
de se mettre en état pour la recevabilité de leur pourvoi en cassation, qu'au<br />
tant que cette peine excède une durée de six mois, durée que n'excède point<br />
— la peine prononcée contre le demandeur ; Attendu que les dispositions de<br />
cette loi, promulguée dans le Journal officiel du 30 juin, sont dès à présent<br />
exécutoires pour la Cour de cassation, sans qu'il y ail à rechercher si elle a<br />
élé l'objet d'une promulgation spéciale en Algérie, d'où il suit que le pourvoi<br />
du demandeur est recevable indépendamment de sa mise en état ;<br />
Au fond : Sur la première branche du premier moyen, prise de la viola<br />
tion prétendue de l'article 373 du Code pénal en ce que, s'agissant d'un délit<br />
de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, au lieu de se borner à constater<br />
la mauvaise foi du dénonciateur, aurait statué sur la fausseté des faits im<br />
putés,<br />
qui ne pouvait être déclarée que par une décision préalable de l'auto<br />
— rité compétente; Attendu que le demandeur, dans une dénonciation<br />
par écrit adressée au Sous-Préfet de Mostaganem, imputait au caïd El-Hadj<br />
Morsly un allendatà la pudeur avec violence,<br />
sur la personne de Mohamed ben Kaddour, son fils;<br />
que ce dernier aurait commis<br />
— Que<br />
cette dénonciation<br />
a été jugée sans fondement par l'autorité judiciaire, et qu'à la suite d'une infor<br />
mation régulière, le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem a,<br />
sur les réquisitions conformes du ministère public,<br />
rendu une ordonnance<br />
portant « qu'à défaut de charges suffisantes contre l'inculpé, il n'y avait pas<br />
lieu à poursuivre » ;<br />
— Attendu<br />
que, sur la plainte en dénonciation calom<br />
nieuse portée par Morsly contre Ben Kaddour, le tribunal correctionnel, dont<br />
la Cour d'Alger a, sur ce point, adopté les motifs, s'est exclusivement référé,<br />
quant à la fausseté des faits imputés, d'une part à l'ordonnance de non-lieu<br />
rendue par le juge d'instruction, d'autre part, et par voie surérogatoire, à<br />
l'enquête administrative dont les résultats avaient été également favorables<br />
— au caïd inculpé; Que c'est à la suite de ces constatations émanées de l'au<br />
torité compétenle, que l'arrêt attaqué, appréciant à un autre point de vue les<br />
faits de la cause, en a déduit la preuve que le dénonciateur avait agi dans un<br />
tombe la première<br />
esprit — de vengeance et de mauvaise foi ; Qu'ainsi<br />
— branche du moyen ; Sur la deuxième branche, prise de la violation des
115<br />
règles de la compétence et des articles 55 et 56 du Code de justice de l'armée<br />
de terre et de mer, en ce que Morsli, en sa qualité de caïd, étant un chef mi<br />
litaire,<br />
c'était à la juridiction militaire seule qu'il appartenait de se prononcer<br />
sur la fausseté des faits imputés ;<br />
— Attendu<br />
que si le titre de caïd a pu être<br />
considéré comme un litre militaire, c'était lorsque le chef qui en était revêtu<br />
— en exerçait les attributions en territoire militaire; Attendu, dans l'espèce,<br />
que la commune mixte de Cassaigne, dont dépend l'agglomération de Ma-<br />
zouna, résidence Morsli,. d'El-Hadj a été détachée du commandement mili<br />
taire pour passer, à partir du 1er janvier 1876, sous l'autorité préfectorale, et<br />
qu'elle est régie par un agent de l'ordre administratif;<br />
— Que<br />
par arrêté du<br />
Préfet d'Oran, du 15 mai de la même année, Morsli, qualifié de président de<br />
la Djemâa de Mazouna, a été nommé adjoint indigène de la commune de<br />
Cassaigne et appelé, en celte qualité,<br />
mission municipale de ladite commune ;<br />
à faire partie des membres de la Com<br />
— Qu'il est donc investi de fonctions<br />
purement civiles, et que si la qualification de caïd lui est encore, parfois,<br />
c'est à titre exclusivement honoiifique et comme expression d'un<br />
attribuée,<br />
état de chose qui n'est plus, qu'il suil de là que c'était à la juridiction ordi<br />
naire, et non à l'autorité militaire, qu'il appartenait d'apprécier la vérité ou<br />
— la fausseté des incriminations dirigées contre l'ancien caïd ; Que, sous ce<br />
rapport, la deuxième branche du premier moyen doit également être rejetée;<br />
— Sur ie deuxième moyen pris de la violation des articles 7 de la loi du 20<br />
avril 1810 et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que la Cour d'ap<br />
pel aurait aggravé les condamnations prononcées en première instance sans<br />
donner les motifs de celte aggravation ;<br />
— Attendu que les juges d'appel ont,<br />
pour déterminer la quotité des peines applicables aux prévenus reconnus<br />
coupables,<br />
—<br />
Cour de cassation ; Attendu, d'ailleurs, dans la cause, que l'arrêt attaqué,<br />
en se fondant, pour élever la peine appliquée par les premiers juges, « sur<br />
un droil souverain d'appréciation qui échappe au contrôle de la<br />
ce que cette peine n'était point en rapport avec la gravité du délit, et qu'il y<br />
avait lieu de tenir compte des manœuvres de toute espèce employées par le<br />
prévenu pour donner créance à la calomnie par lui » imaginée; a suffisam<br />
ment motivé l'aggravation de peine qu'il a prononcée ;<br />
Par ces motifs, rejette le pourvoi.<br />
M. B. de Chenevières, cons. rapp.; M. Bobinet de Clery, av. gén.;<br />
Mes Chambareaud et Aguillon, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
24 octobre 1877<br />
Servitude de prise d'eau. — Mode de jouissance. —<br />
tion. — Fermier.<br />
— Jouissance précaire.<br />
Prescrip<br />
Lorsque dans la vente d'un immeuble, le vendeur a stipulé un droit de prise
116<br />
d'eau au profit d'un fonds contigu qui lui appartient et qu'il a indiqué en<br />
outre, au profit du fonds dominant, le droit de faire certains ouvrages pour<br />
utiliser en jets d'eau et fontaine une partie de cette eau, il importe peu que la<br />
stipulation relative à ce mode d'exercice de la servitude n'ait pas été suivie<br />
d'exécution ; si l'on a pris du reste l'eau pour les irrigations ou d'autres usages,<br />
la servitude subsiste dans l'ensemble des stipulations qui l'ont constituée .<br />
Tout au plus pourrait-on prétendre que la portion de la servitude relative<br />
aux jets d'eau et à la fontaine se serait éteinte par le non-usage;<br />
— dans<br />
ce<br />
cas il faut rechercher si la prescription doit être considérée comme accomplie.<br />
La prescription de la servitude d'usage ne court point pendant que le pro<br />
priétaire du fonds servant est fermier du fonds auquel appartient cette servi<br />
tude . Pendant<br />
cette période en effet, la réunion des deux fonds dans la même<br />
main, opère une confusion temporaire de leurs droits et servitudes, et au surplus<br />
le fermier a seulement une jouissance précaire qui ne lui pjrmet pas plus de<br />
prescrire contre son bailleur une servitude existant au profit de celui-ci, qu'il<br />
n'aurait pu acquérir par prescription le fonds lui-même.<br />
Il en doit être particulièrement ainsi si le fermier du fondsdominant l'a, à<br />
un moment donné; sous-loué avec l'usage de la servitude ; il reconnaît en<br />
effet formellement par là cette servitude, et en tous cas, le fait de. cette sous-<br />
location doit toujours être considéré comme interruptif<br />
Veuve Charbonnaud c". Martres.<br />
de la prescription .<br />
Considérant qu'en vendant un moulin le 29 juillet 1846 par acte authen<br />
Me<br />
reçu Triboulel, les auteurs de l'intimé ont réservé sur la pro<br />
tique,<br />
priété vendue un droit de prise d'eau en faveur de la propriélé contiguë<br />
que conservaient les vendeurs; Qu'il n'importe que les vendeurs aient in<br />
diqué au profil de leur fonds le droit de faire certains ouvrages pour utiliser<br />
en quatre jets d'eau et une fontaine une partie de l'eau qui leur était ré<br />
servée; que ce n'était là qu'un mode d'emploi de la servitude de prise<br />
d'eau laquelle doit être considérée dans son unité et dans l'ensemble des<br />
stipulations qui l'ont constituée ; Que si les auteurs de l'intimé n'ont pas fail<br />
les ouvrages nécessaires à l'établissement des jets d'eau et de la fontaine, il<br />
est cependant reconnu qu'ils n'ont cessé d'user de la servitude de prise d'eau<br />
qui leur a servi à des irrigations et autres usages ; —Considérant qu'en sup<br />
posant que la portion de la servitude relative aux jets d'eau et à la fontaine<br />
ait été susceptible d'exlinction par non-usage, celte prescription ne serait<br />
pas actuellement accomplie;— Qu'il résulte des documents de la cause,<br />
que Charbonnaud, mandataire de sa femme, a été pendant plusieurs années<br />
fermier en celte qualité du fonds auquel — est attaché la servitude ; Que pen<br />
dant cette période, la réunion dans la même main du fonds dominant et du<br />
fondsservant opérait une confusion temporaire des droits et des servitudes des<br />
deux fonds et par conséquent empêchait la présomption de libération qui<br />
peut résulter du non-usage d'une servitude de la part d'un propriétaire sur<br />
un fonds — possédé par un autre que lui ; Que les époux Charbonnaud ne<br />
pouvaient au cours du bail se préparer un élément de prescription contre
117<br />
leur bailleur et qu'aux termes de l'article 2236 du Code civil, ils ne pou<br />
vaient pas plus éteindre alors par la prescription une servitude qui est un<br />
démembrement de la propriété et en priver à leur propre profit le fonds loué,<br />
qu'ils n'auraient pu acquérir par prescription ce fonds lui-même ;<br />
dérant, en tous cas, qu'en 1870, Charbonnaud fermier du fonds dominant,<br />
l'a sous-loué avec l'usage de la servitude dont s'agit, qu'il a ainsi formelle<br />
— ment reconnue ; Que ce faisant, il aurait, en tous cas, interrompu la<br />
— Consi<br />
prétendue prescription alors en cours par le non-usage el qu'il n'aurait pu<br />
dès lors compter que les années à courir pour établir une prescription nou<br />
velle. Adoptant en outre les motifs des premiers juges ;<br />
El considérant que depuis l'appel, la privation de l'eau contestée, a causé<br />
à l'intimé un préjudice dont la Cour peut apprécier l'étendue ;<br />
solutions qui précédent rendent sans objet toute mesure préparatoire.<br />
— Que<br />
les<br />
Par ces motifs: Confirme le jugement, condamne l'appelant à l'amende,<br />
aux dépens el en 200 francs de dommages-intérêts.<br />
M. Piette, av. gén.; Me» Chéronnet et F. Hure, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
14 janvier 1878.<br />
premier président.<br />
I. Testament par acte public. — Formalités substantielles. —<br />
Accomplissement. — Mentions.<br />
II. Appel. —<br />
Inflrmation partielled'unjugement ordonnant une<br />
mesure d'instruction.<br />
— Renvoi devant les premiers juges.<br />
/. Si les formalités tracées par l'art. 972 du Code civil quant à la forme des<br />
testaments authentiques, sont substantielles el prescrites àpcine de nullité, et<br />
s'il faut considérer notamment comme telle , l'obligation de mentionner<br />
expressément l'accomplissement desdiles formalités, elles ne comportent néan<br />
moins ni formule sacramentelle ni ordre nécessaire. Il suffit qu'on trouve dans<br />
le corps du testament en termes explicites la preuve que chacune des formalités<br />
a été accomplie (l).<br />
En conséquence, la preuve de la présence des deux notaires et des deux té<br />
moins résulte suffisamment de la mention de celte présence dans le préambule et<br />
à la fin de l'acte,<br />
lorsqu'elle est accompagnée de ces mots qui excluent toute<br />
interruption; le tout fait et passé à en présence de<br />
(1)<br />
Cette doctrine est généralement adoptée par les auteurs et la jurisprudence.<br />
Demolombe (Bonat. et Test, tome 4 § 281 et suiv.) étudie dans le-plus grand détail<br />
la valeur juridique des mentions diverses que peut renfermer un testament par<br />
acte public, pour attester l'exécution régulière des formalités exigées par la loi .
118<br />
De même la dictée du testament par la testatrice,<br />
et son écriture par l'un<br />
des notaires en présence du second notaire et des témoins résulte suffisamment<br />
de ce passage : laquelle étant saine d'esprit ainsi qu'elle a paru l'être à nous<br />
notaires et témoins, a fait son testament comme suit.<br />
. .<br />
, Telles sont les dis<br />
positions de dernière volonté de la testatrice que j'ai écrites telles qu'elle me<br />
les a dictées et dont je lui ai donné lecture entière, le tout fait et passé, etc.<br />
La lecture du testament à la testatrice en présence des notaires et des té<br />
moins est aussi clairement mentionnée dans ce même passage .<br />
II. Lorsqu'un jugement a ordonné une mesure d'instruction (dans l'espèce<br />
une enquêté) et que la Cour saisie de l'appel de ce jugement, juge convenable<br />
d'ordonner une voie d'instruction différente plus conforme à l'intérêt des parties<br />
(dans l'espèce une commission de notaire),<br />
cette infirmation n'étant que par<br />
tielle n'oblige pas la Cour à dessaisir les premiers juges et l'affaire peut consé<br />
quemment leur être renvoyée pour la continuation de l'instance .<br />
Carcagno c. Dames Trinitaires<br />
Attendu que l'appelant, bien qu'il élève encore contre le testament authen<br />
tique du 3 juin 1873, le reproche de captation et de suggestion, se borne à<br />
invoquer un ensemble de présomptions et qu'il déclare être dans l'impuis<br />
—<br />
sance d'articuler aucun fait précis; Attendu que cette argumentation dé<br />
guise à peine l'abandon du moyen soulevé en première instance et que d'ail<br />
leurs il résulte de tous les documents de la cause que la demoiselle Carcagno,<br />
en religion sœur Sainte Pauline, a testé dans toute la plénitude de sa liberté;<br />
En ce qui louche les vices de forme : — Attendu que dans un intérêt d'or<br />
dre public, pour assurer le repos des familles et prévenir les contestations trop<br />
fréquentes auxquelles donnent lieu les'<br />
testaments, le législateur a prescrit<br />
pour la confection des testaments authentiques, non-seulement l'accomplis<br />
sement de formalités minutieuses mais encore la mention expresse de leur<br />
—<br />
accomplissement; Que si les formalités, prescrites par l'article 972 et notam<br />
contenir"<br />
ment celle qui se rattache à la mention que doit le testament, sont<br />
substantielles et ordonnées à peine de nullité, elles ne comportent néanmoins<br />
ni formule sacramentelle, ni ordre nécessaire —<br />
; Qu'il suffit qu'on trouve<br />
dans le corps du testament, en termes explicites, la preuve que chacune des<br />
formalités a été accomplie;<br />
Attendu, en fait, que la rédaction du testament du 3 juin 1873, n'est pas<br />
sans doute un modèle de précision et de clarté, mais qu'elle remplit cependant<br />
le vœu de la loi, puisqu'on y trouve énoncées, sinon dans les meilleurs ter<br />
mes, du moins d'une manière trèsintelligible,<br />
les formalités constitutives du<br />
— Qu'en effet la présence des deux notaires et des<br />
testament authentique;<br />
deux témoins se trouve mentionnée une première fois dans le préambule du<br />
testament et une deuxième fois à la fin de l'acte, avec ces mots significatifs<br />
qui excluent toute interruption : « Le tout fait et passé à Valence. . . En pré<br />
— Que la dictée du testament par la testatrice, et son<br />
sence de etc ;<br />
écriture par l'un des notaires en présence du second notaire et des témoins<br />
résultent de ces passages : « Laquelle (la testatrice) étant saine d'esprit ainsi<br />
qu'elle a paru l'être à nous notaires et témoins, a fait son testament comme
119<br />
suit Telles sont les dispositions de dernière volonté de la testatrice<br />
que j'ai écrites telles qu'elle me les a dictées et dont je lui ai donné lecture<br />
—<br />
entière, le tout fait et passé à Valence en présence, etc. » Que la lecture du<br />
testament à la testatrice en présence des notaires et des témoins, se trouve<br />
également mentionnée dans les passages qui précèdent ;<br />
— Attendu<br />
dès lors<br />
qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux prétendus vices de forme signalés par<br />
l'appelant. Que c'est à bon droit que les premiers juges ont proclamé à la<br />
fois et la régularité et la spontanéité du testament du 3 juin 1873 ;<br />
— Atlendu que toutes les parties sont d'accord pour<br />
Sur l'appel incident,<br />
demander la modificalion des mesures d'instruction ordonnées par le Tribu<br />
nal.— Qu'au lieu de recourir à une enquête longue el dispendieuse, il est plus<br />
pratique et plus simple de charger un notaire d'établir la consistance de la<br />
succession ;<br />
Par ces motifs : La Cour, sans s'arrêter aux conclusionsde l'appelant, rejet<br />
te l'appel principal ; dit que le testament du 3 juin 1873 est régulier dans la<br />
forme ; qu'il est la manifestation de la libre volonté de la testatrice ; donne<br />
acte à la congrégation des Dames Trinitaires de la renonciation de l'appe<br />
— —<br />
lant à son legs de trois mille francs; Faisant droit à l'appel incident ;<br />
Infirme le jugement déféré du chef qui ordonne l'enquêle; dit que par les<br />
soins de maître Montader, notaire à Oran, que la Cour désigne à cet effet, la<br />
consistance de la succession de la demoiselle Geronima Carcagno sera établie ;<br />
Autorise ledit notaire à puiser dans tous les dépôts publics et études d'offi<br />
ciers ministériels, les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mis<br />
sion, à s'entourer de tous renseignements utiles, même à entendre les témoins<br />
— indiqués par les parties el appelés d'office ; Ordonne que le notaire recher<br />
chera s'il y a eu inventaire dressé à la mort des père et mère de la testatrice ;<br />
qu'il dressera dans tous les cas inventaire des biens dépendant de la succes<br />
sion de la testatrice en déterminant l'actif et le passif, pour être ultérieure<br />
ment, sur le procès-verbal du notaire commis, par les parties conclu et par<br />
le Tribunal statué ce que de droit ;<br />
Et attendu qu'il y a seulement infirmation partielle du jugement el que la<br />
décision des derniers juge's est maintenue sur les points les plus essentiels;<br />
Benvoie la cause et les parties devant le Tribunal d'Oran pour la continuation<br />
de l'instance. Condamne l'appelant es qualités, à l'amende et en tous les dépens.<br />
M. Piette, av. gén. concl. conf. ; Mes Doudart de la Grée et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2fe<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
13 décembre 1877.<br />
Appel.— Production d'une expédition du jugement attaqué.<br />
— Irrecevabilité<br />
— Droits réservés.<br />
Est irrecevable dans son appel celui qui ne produit pas une expédition du<br />
jugement attaqué.
120<br />
Mais si les délais d'appel ne sont pas expirés et qu'aucun acquiescement n'ait<br />
été donné au jugement, l'appelant conserve néanmoins tous ses droits, et doit<br />
seulement être débouté de sa procédure incomplète.<br />
De Marqué c. Lallemand.<br />
ARRÊT :<br />
Considérant que les appelants ne remplissent pas l'obligation qui leur<br />
incombe de produire devant la Cour l'expédition du jugement qu'ils atta<br />
quent;<br />
Que celle situation rend leur procédure incomplète el non rece<br />
vable, sans pouvoir préjudicier aux droits sur le fond ;<br />
Que les appelants<br />
auraient le droil de se désister de<br />
n'étant pas nantis d'une pièce nécessaire,<br />
leur procédure d'appel, sans que ce désistement emportai la déchéance de<br />
l'action, c'est-à-dire du droit d'appel lui-même ; Que leur situation actuelle<br />
—<br />
devant la Cour produit les mêmes effets qu'un désistement de leur part ;<br />
Considérant que la déchéance d'une procédure incomplète, non recevable ou<br />
prématurée, laisse subsister l'action, c'est-à-dire, au second degré, le droit<br />
d'interjeter appel efi temps utile ; Que la déchéance du droit d'appel ne peut<br />
résulter que d'un acquiescement formel ou tacite au jugement rendu ; Que<br />
l'acquiescement tacite supposé par la loi ne peut résulter que du délai<br />
écoulé depuis la signification du jugement; Que la connaissance toujours<br />
incertaine que la partie aurait acquise du jugement par toute autre voie, ne<br />
saurait lui être opposée dans le sens d'un acquiescement supposé ; Qu'il en<br />
est ainsi surtout lorsque, comme dans l'espèce, la partie condamnée en pre<br />
mière instance s'est empressée de protester par un appel,<br />
les délais d'appel aient commencé à courir.<br />
même avant que<br />
Par ces motifs : LA COUR déclare, en l'état, les appelants non recevables<br />
en leur appel ; les déboute de leur procédure intentée devant la Cour, les<br />
condamne aux dépens de cette procédure, tous droits au fond réservés.<br />
M. de Vaulx, subst. du Proc. gén.; Mes Chéronnet, F. Huré, elDAZiwÈRE, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
20 décembre 1877.<br />
Chemin de fer d'intérêt local. — Police des chemins d© fer.<br />
Contravention.<br />
La loi du 15 juillet lèibsur la police des chemins de fer constitue, avec l'or<br />
donnance réglementaire du 15 novembre 1846 sur le même objet, une dispo<br />
sition d'ensemble et connexe qui ne saurait être divisée dans l'application.<br />
Il importe donc peu que la loi du 12juillet 1805 sur les chemins de fer d'in<br />
térêt local, n'ait, dans son art. 4, soumis formellement ces chemins de fer
t<br />
121<br />
qu'aux dispositions de la loi del 1845 ; ils sont en effet, par conséquence<br />
nécessaire du principe énoncé plus haut, et sauf les facultés de dispense indiquées<br />
par ledit art. 4, soumis à l'ordonnance de 1846, comme annexe de la loi de<br />
1845, indispensable à son exécution (1).<br />
En conséquence, une Compagnie de chemin de fer d'intérêt local commet<br />
une contravention passible des peines de l'art. 21 de la loi de 1845, lorsqu'au<br />
mépris de l'art. 6 de l'ordonnance de 1846, elle n'éclaire pas les stations et<br />
leurs abords aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'au passage du der<br />
nier train, et elle ne saurait être fondée à exciper, pour s'affranchir de<br />
cette contravention, du silence, soit du cahier des charges, soit de l'arrêté<br />
préfectoral relatif à l'exploitation de la ligne (lle espèce).<br />
De même en ce qui concerné l'obligation d'éclairer les voitures des trains,<br />
prévue par l'art. 24 de l'ordonnance de 1846 (2me espèce).<br />
De même en ce qui concerne l'obligation d'afficher en permanence, aux<br />
abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente, des exem<br />
plaires de l'ordonnance de 1846,<br />
ordonnance (3me espèce).<br />
obligation prévue par l'art. 78 de cette<br />
De même en ce qui concerne l'obligation de pourvoir d'un uniforme ou d'un<br />
signe distinclif extérieur les agents employés sur les chemins de fer, obligation<br />
prescrite par l'art. 73 de Vordonnance de 1846,<br />
et la Compagnie ne serait<br />
pas admissible à prétendre que le Préfet, en ne prescrivant aucun signe distinctif<br />
pour les agents dans son règlement général sur l'exploitation, aurait dis<br />
pensé la Compagnie de l'exécution de cette disposition réglementaire, cette fa<br />
culté de dispense n'ayant été accordée au Préfet que pour les cas formellement<br />
prévus par l'art. 4 de la loi de 1865 (4nie espèce).<br />
Mais il n'y a pas contravention de la part de la Compagnie de n'avoir pas<br />
pourvu de lanternes, au passage des trains du soir,<br />
certains passages à niveau<br />
de sa voie, s'il n'est pointjustifié d'une décision administrative prescrivant d'éclairer<br />
lesdits passages ; en effet, c'est là une condition formelle indiquée dans l'art. 6<br />
de l'ordonnance de 1846, seule disposition de cette ordonnance qui soit relative<br />
à l'éclairage des passages à niveau (5m0 espèce) .<br />
Compagnie des Chemins de fer de Bône a Guelma c. le Proc. Gén.<br />
1« espèce : — Attendu<br />
qu'il résulte du procès-verbal du 24 août 1877 du<br />
Commissaire de surveillance administrative, que la façade de la gare de<br />
Guelma, du côté-de l'avenue, et le point de jonction de cette avenue avec la<br />
route départementale où passe la partie d'un aqueduc non voûtée, ne sont<br />
(1)<br />
L'art. 4 de la loi du 12 juillet 1865 est ainsi conçu :<br />
« Les chemins de fer d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du<br />
» 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après :<br />
» Le Préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie du chemin.<br />
» Il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins<br />
» peu fréquentés. »
122<br />
pas éclairés depuis le coucher du soleil et jusqu'après le départ des voya<br />
que ce fait est poursuivi comme conslituanl la contraven<br />
—<br />
geurs ; Attendu<br />
tion correctionnelle prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 15 novembre<br />
1846,<br />
21, Titre III, de la loi du 15 juillet 1845 ;<br />
portant règlement d'administration publique en exécution de l'article<br />
- Attendu<br />
que la Compagnie dé<br />
clare que la loi du 15 juillet 1845, qui ne punit pas le fait constaté, est<br />
seule applicable, el nullement l'ordonnance réglementaire du 15 novembre<br />
1846, le chemin de fer de Bône à Guelma éianl d'intérêt local à la date du<br />
procès- verbal ;<br />
Attendu que celte loi et celle ordonnance ne font qu'une disposition d'en<br />
semble et connexe, principalement au point de vue de la police des chemins<br />
— de fer ; Qu'elles ont été promulguées pour recevoir leur application en<br />
Algérie par décrets, la première du 24 juillet 1862, la deuxième du 27 juillet<br />
— suivant ; Attendu que le chemin de fer de-<br />
Bône à Guelma est institué<br />
d'intérêt local par décret du 7 mai 1874 ; Qu'un décret du même jour a dé<br />
claré promulguée en Algérie la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer<br />
— d'intérêt local ; Que l'article 4 de cette loi dispose que les chemins de fer<br />
d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur<br />
la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après : « Faculté pour<br />
-» le Préfet de dispenser des clôtures sur la voie, de dispenser des barrières<br />
— » au croisement des chemins peu » fréquentés; Atlendu que si les che<br />
mins de fer d'intérêt local sont.soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet<br />
1845, ils le sont, par conséquence nécessaire,<br />
précitées, à l'ordonnance du 15 novembre 1846, rendue dans la forme des<br />
règlements d'administration publique, comme annexe à la loi de police du<br />
15 juillet 1845, et étant indispensable pour son exécution;<br />
sauf les facultés de dispense<br />
Qu'ainsi toute<br />
contravention à l'ordonnance est une contravention à la loi ; C'est pourquoi<br />
la loi du 12 juillet 1865 n'a cru devoir viser, pour l'application aux chemins<br />
de fer d'intérêt local, que la loi du 15 juillet —<br />
1845; Atlendu que la Com<br />
pagnie excipe, en outre, de ce que l'article 9 du cahier des charges, relatif<br />
aux stations et gares, ne prescrit pas leur éclairage ; Mais que cette prescrip<br />
tion formelle, toute de droit et de nécessité élémentaire, résulte de l'article<br />
6 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846, qui esl ainsi conçu :<br />
o Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier<br />
» train, les stations et leurs abords devront être éclairés ; » — Attendu<br />
que<br />
vainement la Compagnie excipe de ce que cette prescription ne résulte pour<br />
elle ni du cahier des charges, ni d'un arrêté du Préfet du 5 septembre 1876;<br />
Que nulle disposition, autre qu'un règlement d'administration publique, ne<br />
pourrait déroger à l'article 6 précité ;<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges: —<br />
Confirme<br />
le jugement at<br />
taqué pour être exécuté selon sa forme et teneur. Condamne Lepage, es qua<br />
lités, en tous les dépens.<br />
2me espèce: —<br />
Attendu<br />
qu'il résulte d'un procès-verbal du 11 septembre<br />
1877 du commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma,<br />
qu'à l'arrivée du train numéro 4, à la gare de Bône, ledit jour, à 8 h. 45 du<br />
soir, quatre comparlimenls de voilures de voyageurs n'étaient pas éclairés.<br />
Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant la contravention cor<br />
rectionnelle prévue par l'art. 24 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 ;
123<br />
Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent<br />
les considérants relatés dans l'arrêt précédent.)<br />
Attendu que la Compagnie déclare : premièrement,<br />
que le cahier des<br />
charges, article 31, pas plus que le règlement approuvé par le Préfet, ne<br />
prescrivent l'éclairage des voilures des voyageurs; 2° que d'ailleurs à<br />
l'arrivée du train aux jour et heure dits au procèsverbal,<br />
le train esl arrivé<br />
à Bône avec4 lampes éteintes, deux dans les fourgons, une dans les troisièmes,<br />
une dans les secondes ;<br />
Sur le premier moyen : Attendu que- si le cahier des charges el le règle<br />
ment approuvé par le Préfet sont muets sur l'obligation d'éclairer les voi<br />
tures des voyageurs, c'est parce que l'article 24 de l'ordonnance précitée de<br />
1846 en fait une obligation permanente pour la nuil, et pour le jour durant<br />
le passage des souterrains qui sont désignés par arrêté du ministre.<br />
Sur le deuxième moyen: Atlendu que la déposition des témoins produits<br />
par la Compagnie aux débats devant les premiers juges, n'a pas délruit la<br />
force du procès-verbal précité; Qu'il est demeuré constant que dans les<br />
compartiments des secondes et des premières il y avait des wagons où les<br />
lampes étaient éteintes, de sorle que les voyageurs se trouvaient dans une<br />
profonde obscurité.<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges : Confirme.... Condamne.<br />
o"" espèce: — Attendu<br />
qu'il résulte du procès-verbal du 27 août 1877 du<br />
commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma, qu'il ne<br />
s'est pas encore conformé à l'article 78 de l'ordonnance réglementaire du<br />
quinze novembre 1846 sur la police des chemins de fer, qui prescrit que<br />
des exemplaires de ladite ordonnance seront affichés dans les salles d'attente<br />
— des stations; Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant la<br />
contravention correctionnelle, prévue par l'article 78 de l'ordonnance pré<br />
citée.<br />
Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent les<br />
considérants relatés précédemment)<br />
Attendu que la Compagnie déclare que les stations ou gares ont élé pour<br />
vues des affiches de l'ordonnance du 15 novembre 1846, mais que par l'effet<br />
du temps ou des intempéries, ces affiches ont été détruiles;<br />
Attendu que le procès-verbal constatant qu'il n'a pas encore élé pourvu à<br />
l'affichage doit être cru jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée ;<br />
Mais qu'en admettant le fait d'apposition première il est constant qu'à la<br />
date du procès-verbal les affiches n'existaient pas ; Que la permanence de<br />
l'affichage est dans l'application de la loi sainement entendue.<br />
Par ces motifs, et ceux des premiers juges. Confirme.<br />
4c — espèce : Attendu<br />
qu'il résulle du procès-verbal du 24 août 1877 du<br />
commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma,<br />
que la<br />
Compagnie concessionnaire du chemin de fer ne s'est pas encore conformée<br />
à l'article 73 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846, sur la<br />
police des chemins de fer, qui prescrit que les agents employés sur le chemin<br />
de fer soient revêtus d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ;<br />
Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant une contravention<br />
correctionnelle à l'article 73 de l'ordonnance précitée ;
124<br />
Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent<br />
les considérants relatés précédemment)<br />
Attendu que vainement la Compagnie excipe de ce que le règlement gé<br />
néral sur l'exploitation arrêté par le Préfet,<br />
ne prescrit aucun signe distinc-<br />
lif pour les agents, puisque l'uniforme ou le signe distinclif sont prescrits<br />
par l'ordonnance réglementaire el que pour les chemins d'intérêt local, le<br />
Préfet ne peut dispenser de certaines dispositions réglementaires que dans<br />
les cas prévus par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1865, dans lesquels ne se<br />
trouve pas le fait relevé au procès-verbal et confirmé aux débats.<br />
Par ces motifs el ceux des premiers juges. Confirme.<br />
5m
■<br />
125<br />
/. En matière correctionnelle, l'exception d'incompétence basée sur une faus<br />
se qualification des faits incriminés est d'ordre public et peut être conséquem<br />
ment proposée en tout état de cause et même relevée d'office.<br />
II. En droit musulman, est parfaitement valable la disposition testamentaire<br />
faite verbalement devant deux témoins mâles, chargés d'en déposer après le décèt<br />
soit devant la justice, soit devant une personne ayant qualité pour recevoir leur<br />
déclaration.<br />
Une fausse déclaration faite dans ce sens devant le cadi par des témoins,<br />
constitue de leur part, non le délit de faux mais témoignage, bien le crime de<br />
faux en écriture authentique. En effet ce n'est pas comme juge que le cadi a<br />
reçu cette déclaration sur le mérite de laquelle il n'a pas le pouvoir de statuer<br />
au moment où il la reçoit, mais bien comme officier public, en vertu des fonctions<br />
qui lui ont été expressément conférées par l'art. 51 du décret du 1er oct. 1854.<br />
Conséquemment lajuridiction correctionnelle serait incompétente pour statuer<br />
sur une prévention ayant pour objet une fausse déclaration de cette nature, la<br />
quelle aurait été à tort qualifiée de faux témoignage ( 1 ) .<br />
Min. pub. c. Mohammed ben Happaf et consorts.<br />
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au nom des prévenus à<br />
l'exception d'incompétence soulevée par le Ministère public;-— Attendu que<br />
l'exception d'incorapétence basée sur une fausse qualification des faits incri<br />
minés est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause et même<br />
rélevée par les Tribunaux ;<br />
En ce qui concerne l'exception elle-même : Attendu que les sept premiers<br />
prévenus sont inculpés d'avoir le 9 décembre 1875, fait devant le cadi de la<br />
5e<br />
circonscription judiciaire d'Alger, une déclaration mensongère en affir<br />
mant que quelque temps avant sa mort Khadoudja bent HamadHes avait<br />
pris à témoin qu'elle léguait le tiers- de ses biens à -Ali et à Mohamed ben Djel-<br />
loul et lès trois derniers d'avoir suborné lesdits faux témoins ; — Atten<br />
du qu'on ne peut rencontrer dans ces faits les éléments du faux lémoignage :<br />
Qu'en effet ce n'est point en laqualité déjuge chargé de connaîlreun litige et<br />
de statuer sur lui, que le cadi a reçu les déclarations des prévenus amenés<br />
devant lui par le caïd Djelloul, mais simplement en sa qualité d'officier<br />
— public ; Que dès lors les prévenu* ne peuvent être considérés comme des<br />
témoins appelés dans un débat judiciaire, interpellés en justice par un magis<br />
— Que leurs déclarations sont simplement extrajudiciaires, et ne<br />
trat;<br />
peuvent être appréciées que comme des déclarations intervenues devant un<br />
officier public uniquement chargé de les constater, de leur conférer l'authen.<br />
licite et la publicité, mais ne possédant aucun pouvoir, ni aucun mandat de<br />
justice pour les juger et statuer sur elles : — Attendu au contraire, que dans<br />
les faits retenus par l'ordonnance du juge d'instruction du 27 juillet 1877,<br />
on retrouve tous les caractères du faux en écriture authentique et publique,<br />
(\) Jurisp. Conf. Alger, Ch. des mises en accusation, 18 août 1874, aff. Martino<br />
et autres. Faux actes de notoriété.
126<br />
c'est-à-dire l'altération volontaire et consciente de la vérité, dans des décla<br />
rations faites devant un officier public ayant qualité pour les recevoir et les<br />
consigner dans un acte authentique et public, lesquelles déclarations avaient<br />
pour but et pour effet de dépouiller une héritière directe et légitime, du<br />
tiers de la succession qui lui était dévolue, pour l'attribuer à deux légataires;<br />
— Qu'en effet les cadis, en dehors de leurs fonctions de magistrats de l'or<br />
dre judiciaire, ont été de tous temps investis de la qualité d'officiers chargés<br />
de recevoir entre musulmans les actes publics, et que ces dernières attribu<br />
tions leur ont été expressément conservées par l'article 51 du décret du l«r<br />
oclqbre 1854 ;<br />
Que d'un autre côté, la loi musulmane admet comme valable la disposi<br />
tion testamentaire faite verbalement devant deux témoins mâles, chargés,<br />
après le décès, d'en déposer soit devant la justice, soit devant une personne<br />
ayant qualité pour recevoir leurs déclarations iSautayra, page 358, Sabatery<br />
— pages 173 et 174, Tournauw, page 188) ; Qu'il y a donc lieu de recon<br />
naître que l'acte du 9 décembre 1875, par lequel le cadi de la cinquième<br />
circonscription d'Alger a régulièrement consigné les déclarations par les<br />
quelles les sept premiers prévenus ont affirmé que quelque temps avant sa<br />
mort Khadoudja bent Hamadi les a pris à témoin qu'elle léguait le tiers de ses<br />
biens à Ali et à Mohamed ben Djelloul, est un véritable testament revêtu de<br />
la forme publique et authentique et possédant toute l'autorité el la force de<br />
dès lors,<br />
—<br />
ces sortes d'act.es ; Attendu que si la fausseté des déclarations de<br />
ces témoins était établie, ces déclarations constitueraient, un faux en écri<br />
ture authentique et publique par fabrication de conventions, dispositions ou<br />
obligations, crime prévu et puni de peines infamantes par l'article 147 du<br />
Code pénal ;<br />
— Que s'il était également établi que le caïd Djelloul et ses<br />
fils Ali el Mohamed, ont par un des moyens prévus par l'article 60 du.Code<br />
pénal coopéré à la fabrication de cet acte, ils doivent être considérés comme<br />
les complices des sept premiers prévenus;<br />
— Attendu<br />
en conséquence que<br />
c'est à tort que les faits résullant de l'information ont été appréciés comme<br />
constituant le délit de faux témoignage en matière civile, ressortissant de la<br />
juridiction correctionnelle ;<br />
— Qu'ils<br />
constituent réellement le crime de faux<br />
—<br />
en écriture authentique et publique de la compétence de la Cour d'Assises ;<br />
Qu'il y a donc lieu d'admettre l'exception d'incompétence proposée par le<br />
Ministère public et de statuer conformément aux dispositions de l'article 214<br />
du Code d'instruclion criminelle ;<br />
En ce qui concerne la délivrance du mandat de dépôt: Attendu qu'en<br />
l'état de la procédure et en présence de ce fait que les prévenus ont, jusqu'à<br />
ce jour, obéi à toutes les réquisitions de la justice, il n'y<br />
mettre en état d'arrestation préventive.<br />
a pas lieu de les<br />
Par ces motifs : la Cour rejetle la fin de non-recevoir soulevée contre l'ex<br />
ception d'incompétence. Et statuant sur cette exception et y faisant droil, se<br />
déclare incompétente. Annule le jugement rendu par le Tribunal correction<br />
nel d'Alger, le 20 novembre 1877. Renvoie le Ministère public à se pourvoir<br />
ainsi qu'il appartiendra.<br />
M. Pinet de Menteyeh, cons. rapp.; M. Fau. av. gén.;<br />
Mes Honel el Jouyne, av.<br />
*
127<br />
TRIBUNAL CIVIL DE TIZI-OUZOU<br />
Présidence de M. PARIZOT, président.<br />
14 février 1878.<br />
•Juges de paix, a compétence étendue. — Kabylie. — Loyers.<br />
Les juges de paix de Kabylie, à compétence étendue, sont incompétents pour<br />
connaître des actions en paiement de loyers ou de parts de récoltes, lorsque la<br />
location annuelle dépasse 400 francs (1) .<br />
Saïd ou Aomar c. Dellinger.<br />
JUGEMENT.<br />
— LE TRIBUNAL : Attendu que l'appel est régulier en la forme ; Au fond :<br />
Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mai 1838 et de celles du<br />
20 mai 1854 et 2 mai 1855, promulguées en Algérie, les juges de paix sont<br />
incompétents ratione materiœ pour connaître des demandes en paiement de<br />
loyers et fermages, lorsque les locations verbales ou par écrit excèdent an<br />
nuellement quatre cents francs ;<br />
— Attendu<br />
que l'article 4 du décret du 29<br />
(1) Cette décision, qui nous paraît absolument juridique,<br />
preuve de l'incohérence de la législation algérienne,<br />
maintes fois signalée.<br />
est une nouvelle<br />
que le Bulletin judiciaire a<br />
Au premier abord et si l'on consulte la jurisprudence de la Cour d'appel<br />
d'Alger,<br />
on croit voir une opposition manifeste entre le système du Tribunal de<br />
Tizi-Ouzou et celui de la Cour. Un arrêt du"22 mai 1861 (Robe, 1861, 127, et<br />
Narbbnne, v°<br />
Compétence,<br />
n°<br />
114) a décidé, en effet, que lesjuges.de paix à com<br />
pétence étendue, institués en vertu du décret du 19 août 1854, doivent connaître<br />
de toutes les demandes personnelles et mobilières, dans les limites du premier et<br />
du dernier ressorts, sans que les restrictions de la loi du 25 mai 1838 leur soient<br />
applicables. Ainsiune action en paiement de loyers pour une somme inférieure<br />
à 1,000 francs, bien que la location annuelle dépasse 400 francs, doit être portée<br />
devant le juge de paix à compétence étendue.<br />
Cette solution, conforme au texte et sans doute à l'esprit du décret du 29 août<br />
1854,<br />
a définitivement fixé la jurisprudence delà Cour et des Tribunaux. Com<br />
ment se fait-il que le Tribunal de Tizi-Ouzou se soit prononcé dans un sens<br />
complètement opposé ?<br />
Il faut remarquer le silence gardé par le jugement sur le décret du 19 août<br />
1854, silence justifié par les termes du décret du 29 août 1874, relatif à l'organi<br />
sation judiciaire dans la Kabylie.<br />
Les juges de paix de Kabylie ne sont nullement institués en conformité des<br />
dispesitions du décret de 1854,<br />
sur lequel celui de 1874 reste muet. Ces magis<br />
trats ne tiennent leurs pouvoirs que du décret du 29 août 1874. Or, il n'est pas<br />
douteux que l'article 4, 1° de ce décret restreint leur compétence dans les limites<br />
tracées par les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855,<br />
fait le décret de 1854.<br />
ce que n'a pas<br />
ïl en faut conclure que le Tribunal de Tizi-Ouzou a fait une exacte application<br />
de la législation en vigueur, mais qu'il serait bon que d'aussi étranges contra<br />
dictions ne pussent pas se révéler dans cette législation. H, N.
128<br />
aoûl 1874 n'a apporlé aucune modification aux attributions des juges de<br />
paix de Kabylie en cette matière, et qu'il s'est borné à élever à cinq cenls<br />
francs le taux de leur compétence en dernier ressort ;<br />
— Attendu, par suite,<br />
que ces magistrats, de même que les juges de paix de la métropole, sont in<br />
compétents pour connaître de semblables demandes ;<br />
— Et atlendu qu'il est<br />
constant en fait que la location consentie par Dellinger à Saïd ou Aomar a<br />
été faite moyennant, outre une somme d'argent et certaines prestations,<br />
l'obligation par le preneur de.remeitre au bailleur le quart des récoltes ac<br />
crues sur la propriélé louée, c'est-à-dire moyennant un prix annuel indéter<br />
miné ; Qu'il échet donc d'accueillir le déclinatoire proposé, en conséquence<br />
— d'infirmer le jugement dont est appel; Sur les conclusions subsidiaires<br />
de Dellinger tendant à l'évocation de l'affaire : Attendu que la cause n'est<br />
pas en état de recevoir une solution définitive ;<br />
Par ces motifs : Reçoit l'appel en la forme ; Au fond, faisant droit, infirme<br />
le jugement donl est appel ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Ordonne la res<br />
titution de l'amende consignée et condamne l'intimé aux dépens de première<br />
instance et d'appel.<br />
M" Martin el Gaillard, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par arrêté du Procureur général en date du 9 avril 1878:<br />
M. Hanig, huissier, a élé nommé curateur aux successions vacantes*<br />
canton de Boghari, en remplacement de M. Lelouch,<br />
léansville. v<br />
Par décret en date du 4 avril 1878, ont été nommés :<br />
Juge de paix de Koléa, M. Mayen, juge de paix de Boghari,<br />
du<br />
nommé huissier à Or-<br />
en remplace<br />
ment de M . Zimmer, décédé .<br />
Juge de paix de Tiaret, M. Kraft, juge de paix des Ouled-Rahmoun, en<br />
remplacement de M. Dupont, qui est nommé juge de paix à Laghouat.<br />
Juge de paix des Ouled-Rahmoun, M. Bailly, juge de paix de Laghouat,<br />
en remplacement de M. Kraft qui est nommé juge de paixii Tiaret.<br />
Juge de paix d'Orléansville, M. de Bercegol du Moulin, juge de paix de<br />
St-Denis-du-Sig,<br />
Castellane.<br />
en remplacement de M. Doreau qui a élé nommé juge à<br />
Juge de paix de St-Denis-du-Sig, M. Poirey, juge de paix à Si-Arnaud, en<br />
remplacement de M. Bercegol du Moulin, qui est nommé juge de paix à Orléansville.<br />
Juge de paix à St-Arnaud, M. Patrimonio, juge de paix de Takitount, en<br />
remplacement de M. Poirey, qui est nommé juge de paix à St-Denis-du-Sig.<br />
Juge de paix à Boghari, M. Niel, juge de paix de Bou-Saâda, en remplace<br />
ment de M. Mayen, qui est nommé juge de paix à Koléa.<br />
Alger. — Typ. A. Jouiidas.
2» année. — 4" Mai 1878. —<br />
N° 33<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
- LÉGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />
Présidence de M. MERCIER,<br />
7 août 1877.<br />
premier président.<br />
Désistement. — Copie. — Signature,<br />
Le désistement donné, soit par un simple acte d'avouéà avoué,<br />
soit par un<br />
acte sous seing-privé signé de la partie et dont copie est signifiée par son<br />
avoué, est nul si la signature de la partie n'a pas été apposée sur la copie si<br />
gnifiée à la partie adverse dont elle constitue le seul titre (C. pr. civ., 402).<br />
Ismael ben Cheriff, c. la ville de Constantine.<br />
ARRÊT :,<br />
LA COUR: Sur le moyen tiré de la violation des art. 402 el 403, C. pr.<br />
civ.;— Attendu qu'aux termes de l'art . 403, C pr. civ., le désistement<br />
peut êlre fait par un simple acte d'avoué à avoué, mais que lorsqu'il est<br />
donné dans cette forme, il doit être signé par la partie ou par son manda<br />
taire,<br />
et que la signature doit nécessairement être apposée sur la copie si<br />
gnifiée à la partie adverse à laquelle elle tient lieu d'original et dont elle<br />
constitue le seul litre ;<br />
égard,<br />
— Attendu<br />
qu'il n'y a pas lieu de distinguer, à cet<br />
entre le cas où le désistement est fait par un simple acte d'avoué et<br />
celui où il est donné par un acte sous seing-privé signé de la partie et dont<br />
la mention faite par l'avoué de la<br />
—<br />
copie est signifiée par son avoué ; Que<br />
signature apposée au bas du désistement ne saurait, en effet, remplacer la<br />
signature de la partie, cet officier ministériel n'ayant pas qualité pour en<br />
certifier la vérité ;<br />
— Que<br />
dans l'une comme dans l'autre hypothèse, l'ori<br />
ginal du désistement restant en la possession de la partie qui le consent, son<br />
adversaire serait dans l'impossibililé absolue de s'assurer personnellement et<br />
de justifier devant les tribunaux de sa régularité si la copie ne portait pas la<br />
signature de la partie;— Atlendu qu'en le décidant ainsi, et en déclarant,<br />
parsuile, nul le désistement signifié à la requête du demandeur à la com<br />
mune défenderesse, l'arrêi attaqué, loin de violer les articles du Code visés<br />
ces motifs :<br />
au pourvoi, en a fait, au contraire, une saine application —<br />
; Par<br />
Rejette.<br />
MM. Goujet, rap. ; Chabbins, 1« av. gén. (c. conf.) M" Sauvel et Doboy, av.
130<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />
Algérie. — Lois. — Décrets.<br />
22 mars 1878.<br />
— Infractions spéciales a l'indi-<br />
génat, — Xrlbunal de simple police. — Dernier ressort.<br />
Les lois françaises en vigueur en Algérie ne peuvent être abrogées ou mo<br />
difiées que par une loi nouvelle, votée par les deux Chambres et régulièrement<br />
promulguée.<br />
Mais relativement aux matières non traitées et non réglementées par ces lois,<br />
en exécution de l'art. 4 de l'ordonnance du<br />
le Président de la République peut,<br />
22 juillet 1834, prendre, sous forme de décrets, des ayant un carac<br />
mesures,<br />
tère législatif, destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la<br />
tranquillité en Algérie.<br />
Tels sont les décrets des 29 août et 11 septembre 1874, relatifs aux infrac<br />
tions spéciales à l'indjgénat et les arrêtés préfectoraux pris en vertu des dispo<br />
sitions qu'ils contiennent.<br />
En conséquence,, les, tribunaux de simple police statuent en dernier ressort<br />
sur les contraventions dont il s'agit., et l'appel de leurs jugements est irrece<br />
vable (1).<br />
(1) C'est une question importante que celle de savoir si un décret peut, en Al<br />
gérie, modifier les règles établies par la loi.<br />
Il est certain qu'en ce qui concerne le droit du pouvoir exécutif de prendre « les<br />
mesures destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la tran<br />
quillité », aucune difficulté ne saurait être soulevée. La loi française n'a pas pu<br />
prévoit de pareils besoins. Nous ne pensons pas qu'elle s'en soit même préoc<br />
cupée .<br />
Mais ce que la loi a formellement prévu, c'est la compétence des tribunaux. La<br />
Cour suprême reconnaît que les lois françaises « en vigueur en Algérie » ne<br />
vent être modifiées que par des lois nouvelles. Le Code d'instruction criminelle<br />
est en vigueur dans la Colonie . Un décret peut-il en modifier les dispositions ?<br />
L'affirmation nous semble en contradiction avec le principe posé par l'arrêt lui-<br />
même .<br />
Le droit d'appel est trop essentiel, il intéresse trop<br />
puisse être supprimé autrement que par une loi.<br />
l'ordre public pour qu'il<br />
S'il s'agissait du droit de se pourvoir contre un arrêt de Cour d'assises, recon<br />
naîtrait-on à un décret le pouvoir de l'abolir 1<br />
Un arrêt de la Cour d'Alger du 27 décembre 1876 (B. J. 1877, 84) a refusé aux<br />
décrets le droit de modifier leâ règles dé compétence Civile ou administrative dé<br />
terminées par les lois .<br />
En matière criminelle, où les garanties accordées par la loi Sont encore plus sa<br />
crées,"<br />
il nous paraît difficile d'admettre qu'un décret puisse anéantir la garantie de<br />
l'appel et supprimer une j uridictioij., _,_ , ... H. N.
131<br />
Tahab ben Aïech.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR: Sur le moyen unique, pris de la fausse application de l'ar<br />
ticle 172 du Code d'instruction criminelle et de la violation de l'artiele 17<br />
du décret du 29 août 1874, rendu applicable dans tous les territoires civils<br />
de l'Algérie, parle décret du 11 septembre de la même année;— Vu ces<br />
— dispositions locales; Attendu que Tahar ben Aïech, indigène, domicilié<br />
dans la commune de Constantine, avait élé traduit devant le Tribunal de<br />
simple police du canton de ce nom, pour négligence habituelle dans Je paie<br />
ment des impôts dont il était redevable au cours de l'année 1877, infraction<br />
spéciale à l'indigénat prévue par l'article 1", n°<br />
13, de l'arrêté du Préfet de<br />
Constantine, du 10 février 1875, pris en exécution de l'article 17 du décret<br />
—<br />
Que, par jugement du 20 décembre 1877, indiqué<br />
du 29 août 1874;<br />
comme ayant été rendu en dernier ressort, selon les prescriptions formelles<br />
de l'article 17 du décret précité, l'inculpé avait été reconnu coupable de la<br />
contravention reprochée, et avait été condamné à un jour d'emprisonnement,<br />
conformément aux dispositions de cet article et de l'article 465 du Code pé<br />
nal, applicable au fait poursuivi, d'après les prescriptions de ce —<br />
décret;<br />
Que, sur l'appel interjeté par Tahar ben Aïech, le Tribunal de Constantine a<br />
rejeté la fin de non-recevoir relevée par le Ministère public, par le motif que<br />
l'article 17 du décret du 29 août 1874 n'avait pu abroger ou modifier l'ar<br />
Que,<br />
—<br />
ticle 172 du Code d'instruction criminelle; prononçant sur ledit<br />
appel, ce Tribunal a renvoyé le prévenu des poursuites, en déclarant que la<br />
— contravention imputée n'était pas suffisamment établie; Attendu qu'en<br />
statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu le caractère légal des deux<br />
décrets précitésdes 29 août et 1 1 septembre 1874 et la nature disciplinaire des<br />
infractions spéciales à l'indigénat, définies dans l'arrêté préfectoral sus-<br />
—<br />
relaté; Atlendu, en effet, que, sans doute, les lois françaises en vigueur<br />
en Algérie ne peuvent être abrogées ou modifiées que par une loi nouvelle,<br />
• l'auteur<br />
votée par les deux Chambres et régulièrement promulguée; mais que rela<br />
tivement aux matières non traitées et non régies par ces lois, le Président de<br />
la République.peut, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 22 juil<br />
let 1834, prendre, sous formes de décrets, des mesures ayant un caractère<br />
législatif destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la tran<br />
— quillité en Algérie ; Attendu que lès mesures autorisées à l'égard des in<br />
digènes, par les décrets de 1874, el formulées dans l'arrêté précité, ont es<br />
sentiellement le caractère de mesures urgentes de sûreté publique et de dis<br />
cipline locale algérienne; qu'elles se réfèrent à des obligations el infractions<br />
spéciales non prévues par le Code pénal et les autres lois françaises, et<br />
qu'elles ont pour objet d'assurer, en Algérie, l'exécution immédiate des lois et<br />
règlements concernant les indigènes ; qu'elles rentraient dans les prévisions<br />
de l'ordonnance de 1834,<br />
dont les dispositions n'ont pas été restreintes et<br />
limitées par un partage d'attributions entre le pouvoir législatif et le pouvoir<br />
—<br />
exécutif ; Atlendu que, dans ces circonstances et dans les limites que<br />
des décrets avait posées elqui n'ont pas été dépassées, ces décrets ont<br />
la plénitude de l'autorité législative,'<br />
el que le pouvoir exécutif a pu, sans<br />
trouver un obstable dans l'article 172 du Code d'instruction criminelle, ré-
132<br />
gler la matière à laquelle ils s'appliquent en déterminant la sanction pénale<br />
des arrêtés à intervenir, la juridiction appelée à juger les infractions à ces<br />
arrêtés,<br />
et déclarer que les tribunaux de simple police statueraient en der<br />
— nier ressort; D'où il suit qu'en décidant le contraire le jugement attaqué<br />
a faussement appliqué l'article 172 du Code d'instruction criminelle et a<br />
violé les dispositions légales des décrets précités ;<br />
Par ces motifs, et attendu que le jugement du Tribunal de simple police<br />
de Constantine a été rendu en dernier ressort, et que l'appel devant être<br />
considéré comme non avenu, il ne reste rien à juger : Casse et annulle sans<br />
renvoi lie jugement rendu le 11 février 1878, par le_ Tribunal correctionnel<br />
de Constantine, jugeant comme Tribunal d'appel en matière de simple police,<br />
en faveur de Tahar ben Aïech .<br />
MM. Saint-Luc Courborieu, rap, ; M. Bbnoist,<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
11 décembre 1877.<br />
premier président.<br />
av. gén..<br />
Voirie urbaine. — Obligation de construire suivant un plan<br />
d'architecture déterminé, imposée dans une vente par l'État.<br />
— Commune substituée aux droits de l'État. — Servitude de<br />
circulation .<br />
L'État a le droit, en vendant un terrain,<br />
de se conformer à un plan uniforme d'architecture,, dans le double intérêt<br />
d'imposer à l'acquéreur l'obligation<br />
public de la circulation et de l'harmonie des édifices, notamment, comme dans<br />
l'espèce,<br />
de construire son immeuble avec arcades ouvertes à l'accès du public.<br />
Cette restriction au droit de propriété transféré, constitue manifestement une<br />
servitude réelle imposée à l'immeuble par le père de famille dans l'intérêt de la<br />
voie publique et afin de pourvoir aux nécessités de la circulation.<br />
Quand postérieurement à une convention de ce genre, il y a eu érection en<br />
commune de la localité où se trouve situé l'immeuble,<br />
cette commune se trouve<br />
substituée au droit qu'avait l'État de poursuivre l'exécution de celte clause; en<br />
effet,<br />
le droit réservé par l'État au profit de la circulation publique se trouve<br />
compris parmi les choses dont l'État a fait remise à ladite commune lors de<br />
cette érection et qui constituent le domaine public communal.<br />
La commune a donc le droit de poursuivre la démolition des ouvrages que le<br />
propriétaire aurait construits en vue de faire obstacle à la servitude existant<br />
d'après la stipulation de l'acte d'acquisition primitif, et consacrée au surplus<br />
par l'exécution sans cesse donnée depuis cette époque à cette convention .
133<br />
On ne saurait trouver une objection sérieuse à ce droit de la commune, dans<br />
la tolérance dont elle aurait fait preuve précédemment,<br />
en autorisant le pro<br />
priétaire à établir sous /es arcades des ouvrages d'un caractère lout provisoire.<br />
Lambert c. Commune de Blidah.<br />
M. Lambert, propriétaire à Blidah,<br />
possède dans cette localité un<br />
immeuble sis sur la place d'Armes et présentant en façade sur cette<br />
place des arcades ouvertes à la circulation : il crut avoir le droit de<br />
fermer les arcades de son immeuble,<br />
briques;<br />
au moyen d'une construction de<br />
mais la Commune de Blidah se pourvut devant le Tribunal<br />
civil pour demander la démolition de cette construction, qui formait<br />
un empêchement à la libre circulation du public .<br />
Le 6 juin 1877, jugement qui accueille la demande de la Commune :<br />
Attendu que le fait par l'administration d'avoir toléré l'édification de clô—<br />
, tures provisoires pour représentations théâtrales ou bals publics ne saurait<br />
à aucun titre constituer un droit, celte tolérance se justifiant parles circons<br />
tances dans lesquelles ces travaux ont été faits, et par la nature essentielle<br />
ment provisoire de ces ouvrages, qui consistaient uniquement en quelques<br />
planches mobiles pouvant être enlevées à première réquisition; —Qu'il est<br />
impossible de voir dans ces actes de complaisance et de tolérance de l'admi<br />
nistration locale, l'abandon ou la restriction d'un droit qui résulte d'un titre;<br />
— Que c'est précisément lorsque Lambert a voulu affirmer ses prétentions en<br />
élevant sous les arcades une véritable construction en maçonnerie de briques,<br />
que la Commune a fait dresser procès-verbal de celte usurpation, sur le<br />
caractère de laquelle elle ne pouvait plus conserver aucun doule ;<br />
En ce qui touche la déclaration faite par la Commune de ce qu'elle recon<br />
— naît que le sol des arcades ne lui appartient pas ; Attendu que la Com<br />
mune ne peut en effet se prétendre propriétaire à aucun titre, du sol des<br />
arcades dans le sens légal de ce mot, tel qu'il esl déterminé par l'article 544<br />
du Code civil, el qu'elle n'a pas entendu déclarer autre chose; mais qu'il<br />
n'en esl pas moins incontestable que le sol des arcades a élé spécialement<br />
affecté à la voie publique en vertu de l'obligation imposée à l'auteur de Lam<br />
— bert par l'acte de vente du 9 février 1849 ; Attendu que, dès la conquête,<br />
les exigences du climat de l'Algérie avaient imposé à l'administration l'obli<br />
gation d'adopter pour la construction des places publiques un plan particulier<br />
d'architecture;<br />
— Que<br />
l'administration,<br />
en imposant l'obligation d'élever<br />
des arcades a eu pour non-seulement but, l'ornementation et l'uniformité<br />
des places, mais s'est préoccupée surtout d'assurer aux habitants une circu<br />
lation commode, à l'abri des ardeurs du soleil et de sauvegarder ainsi la santé<br />
—<br />
publique; Que ce mode de construction a été exécuté dans plusieurs villes<br />
de l'Algérie et notamment à Blidah, dès 1843, c'est-à-dire quatre ans avanl<br />
la date de l'aliénation consentie en faveur du sieur Allien, el que depuis<br />
Cette époque, c'est-à-dire depuis 34 ans, jusqu'au jour de l'entreprise à la<br />
quelle Lambert s'est livré, le public a toujours circulé librement sous les<br />
arcades; — Qu'ainsi donc l'article 4 de l'acte du 7 février 1847, obligeant
134<br />
Allien à se conformer au plan spécial, n'a fait que rappeler une obligation<br />
générale acceptée el exécutée sans protestations ni réserves par les autres<br />
— propriétaires de la place qui avaient bâti avant lui ; Qu'il est impossible<br />
trouvant en 1847 la place d'Armes construite depuis<br />
d'admeltre'qu'Allien,<br />
plusieurs années dans les conditions où elle se trouve encore aujourd'hui,<br />
c'est-à-dire d'après un plan admis et accepté, ail pu construire autrement<br />
que les autres, alors que la clause spéciale de l'acte d'aliénation lui imposait<br />
l'obligation de construire suivant le plan ; —Attendu que l'État, propriétaire<br />
originaire, avait le droit d'imposer à ses acquéreurs l'obligation de se confor<br />
mer à un plan uniforme d'architecture, dans le double intérêt public de la<br />
—<br />
circulation el de l'harmonie des édifices ; Que c'est là une servitude éta<br />
— blie par le père de famille; Qu'il est même peu important qu'au moment<br />
où cette obligation a été imposée, ce plan uniforme fût définitivement arrêté<br />
—<br />
ou fût seulement en projet ; Que l'acte du 7 février, en obligeant Allien<br />
à se conformer au plan d'architecture adopté pour la place d'Armes, a<br />
consacré l'adoption définitive de ce plan, qui avait déjà reçu la consécration<br />
de l'exécution et du fait accompli ;<br />
En ce qui touche l'objection proposée par Lambert, et suivant laquelle la^<br />
— Commune ne serait pas aux droits de l'État; Attendu que cette<br />
remise résulte du fait seul de l'érection de Blidah en commune ;<br />
parmi les choses qui constituent le domaine public communal, se trouvent<br />
celles qui sont affectées à un service public, comme les églises, les fontaines,<br />
les rues, les places publiques,<br />
de toute nature constitués ou acquis au profit de la circulation ;<br />
— Que<br />
et par suite les droits de servitude et d'usage<br />
— Que le<br />
droit réservé par l'État au profit de la circulation lors de l'aliénation du 7<br />
février 1847,<br />
se trouve donc compris parmi les choses dont il a fait remise à<br />
la Commune de Blidah et qui constituent aujourd'hui le domaine public<br />
— communal ; Attendu qu'il résulte de toul ce qui précède que c'est sans<br />
droit que le sieur Lambert a édifié une construction interceptant la circula<br />
— tion ; Que la demande en démolition des ouvrages et en rétablissement des<br />
lieux dans leur état primitif est juste et fondée et qu'il y a lieu de l'accueillir;<br />
— — Attendu que le dommage causé n'esl pas établi ; Que dans tous les cas<br />
les dépens tiendront lieu de dommages-intérêts;<br />
Par ces motifs, etc.<br />
Le sieur Lambert ayant interjeté appel, la Cour a rendu le 1 1 dé<br />
cembre 1877, l'arrêt confirmatif suivant :<br />
Attendu que les droits de propriélé du sieur Lambert sur l'immeuble sis<br />
à Blidah, place d'Armes, prennent leur origine dans l'acte de vente du 9 fé<br />
vrier 1847, intervenu entre le Domaine de l'État et l'un des auteurs du sieur<br />
Lambert, acte de vente approuvé par ordonnance royale du même jour ;<br />
Qu'au nombre des clauses eUcondilions de cette aliénation, se trouvait for<br />
mellement énoncée celle-ci (Art. 4) : « Il (l'acquéreur) sera tenu en outre :<br />
» 1° d'élever sur le terrain qui lui est vendu des constructions conformes à<br />
» l'alignement et au plan d'architecture adoptés pour la place d'Armes ; » —<br />
Qu'il importe de constater que déjà, avant la construction de la maison appar<br />
tenant aujourd'hui au sieur Lambert, existaient d'autres édifices bàlis sur un<br />
plan uniforme, reliés entre eux par des arcades symétriques, formant ainsi,<br />
—
135<br />
autour de la place, Une voie ouverte livrée à la circulation publique, des<br />
tinée, suivant les usages du pays, à offrir contre les ardeurs du climat un<br />
— abri nécessaire; Que cet état de choses explique et caractérise en même<br />
temps la stipulation insérée dans l'acte de vente du 9 février 1847 ;<br />
— Que<br />
cette restriction apportée au droit de propriété constituait manifestement une<br />
servitude réelle imposée à l'immeuble dans l'intérêt de la voie publique, afin<br />
— de pourvoir aux nécessités de la circulation ; Que cette interprétation, qui<br />
découle si logiquement des termes du contrat et de la nature même des<br />
choses,<br />
vention;<br />
est au surplus confirmée par l'exécution qui a été donnée à la con<br />
— Qu'en effet, pendant près de trente années, le public a libre<br />
ment circulé sous les arcades de la maison Lambert comme sous celles des<br />
— autres maisons bordant la place; Atlendu qu'en décidant, dans ces cir<br />
constances, que l'entreprise du sieur Lambert, barrant le passage ouvert<br />
sous les arcades de sa maison, faisait obstacle à l'exercice d'une servitude<br />
établie, le Tribunal de Blidah a sainement apprécié les faits de la cause et le<br />
droit des ■.<br />
parties;<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui sont adoptés pour le sur<br />
Cour : Rejette l'appel, confirme le jugement déféré dans son<br />
—<br />
plus; La<br />
entier dispositif et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.<br />
M. Piette, av. gén. (concl. conf.) ; M« Chéronnet et Boukiadd, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
5 janvier 1878.<br />
Marchandise. — Dommage, — DéBcit. — Fin de non-recevoir.<br />
Un chargement consistant en une seule nature de marchandises, effectué par<br />
les mêmes chargeurs, constaté par la même charte-partie et par le même<br />
connaissement, constitue un ensemble unique au point de vue des droits et des<br />
obligations qu'il peut faire naître.<br />
Le déficit partiel dans un chargement de cette nature, constitue un « dom<br />
mage arrivé à la marchandise,<br />
commerce (1).<br />
» dans le sens des art. 435 et 436 du Code de<br />
La fin de non-recevoir établie par ces articles est considérée comme d'ordre<br />
public et peut être produite pour la première fois en appel.<br />
Scely c. Warot.<br />
ARRÊT:<br />
LA COUR : Considérant qu'un chargement consistant en une seule nature<br />
de marchandises,<br />
effectué par les mêmes chargeurs, constaté par la même<br />
charte-partie et par le même connaissement,<br />
constitue un ensemble unique<br />
(t) Voir Conf. Cass. civ., 2 juillet 1877 (D. P. 78,1, 57, et la note)
136<br />
au point de vue des droits et des obligations qu'il peut faire naître;<br />
Considérant qu'en fait, le destinataire a reçu, sur le vu de la charte-partie<br />
et du connaissement, toute la marchandise que portait le navire, sans pro<br />
tester contre le manquant, dès lors connu de lui, de la marchandise, dans<br />
les délais et dans les formes prévus par les articles 435 et 436 du Code de<br />
— commerce ; Considérant que le déficit partiel, dans un chargement unique<br />
et identique, constitue évidemment un dommage causé au destinataire de ce<br />
chargement, fait prévu par les articles —<br />
précités; Qu'à ce dommage absolu<br />
doivent, à plus forte raison, s'appliquer les motifs qui ont déterminé le<br />
législateur en vue d'un dommage partiel, qui pourrait résulter de la dété<br />
—<br />
rioration de la marchandise ; Que dans les deux cas, on a voulu hâter la<br />
solution des difficultés maritimes pour ne pas immobiliser, avec préjudice<br />
général, les forces de la navigation —<br />
; Que la prescription dont s'agit a pour<br />
point de départ la connaissance obtenue par le destinataire du dommage<br />
dont il est menacé;<br />
— Que<br />
cette connaissance a été évidemment acquise<br />
par Warot quand il a recule chargement dgnt il a constaté l'insuffisance par<br />
rapport à l'expédition ;<br />
— Considérant<br />
que la fin de non-recevoir dont s'agit,<br />
exclusivement basée sur des motifs d'intérêt général et international, est<br />
considérée comme d'ordre public et peut être produite pour la première fois<br />
en appel ;<br />
— Considérant<br />
qu'il y a lieu de faire droit à la demande recon<br />
ventionnelle de l'appelant quant au paiement du fret et aux dommages-<br />
intérêts;<br />
— — Que les jours de staries expiraient le 24 novembre ; Que le<br />
capitaine a dû, par le fait de la demande de Warot,<br />
— d'Alger l'expertise qui a eu lieu le 10 décembre ; Qu'il est dû, selon les<br />
usages du port d'Alger, dix jours de surslaries, el que la charte-partie a fixé<br />
les surslaries à deux cents francs par jour, soit pour dix jours deux mille<br />
- Qu'en outre, il est dû pour les cinq autres jours de séjour, des<br />
francs;<br />
—<br />
attendre'<br />
dans le port<br />
dommages-intérêts qui, d'après les éléments de la cause, doivent être fixés à<br />
cinq cents francs ;<br />
— Qu'à<br />
partir du 10 décembre, il n'est plus dû de dom<br />
mages-intérêts au capitaine, qui alors pouvait reprendre la mer ;<br />
— Considé<br />
rant que la Compagnie Lyonnaise d'assurances reconnaît qu'elle doit garantir<br />
Warot dans les termes du contrat intervenu entre eux et qu'elle a déclaré<br />
— dans ses conclusions prendre son fait et cause ; Considérant que les frais<br />
de la demande tardivement intentée doivent rester à la charge de Warot,<br />
mais que la Compagnie Lyonnaise n'a pas pris de conclusions contre lui;<br />
Par ces motifs : Infirme el met à néant le jugement dont est appel ; Dé<br />
clare Warol non recevable en sa demande, dirigée contre le capitaine Scely<br />
pour déficit dans les madriers expédiés à Warol ; Condamne la Compagnie<br />
Lyonnaise à indemniser, dans les termes de son contrat, Warot du préjudice<br />
qu'il éprouvera, par suite de ce déficit ; Déclare nulle et sans effet l'exper<br />
tise à laquelle il a été procédé à la suite du jugement donl est appel;<br />
Condamne Warot à payera Scely le solde de son fret et en outre deux mille<br />
cinq cents francs tant pour surslaries que pour dommages-intérêts; Ordonne<br />
la restitution de l'amende; Condamne Warol envers Scely aux dépens de<br />
première instance et d'appel ; Dit que la Compagnie Lyonnaise supportera<br />
les dépens par elle exposés.<br />
M'8<br />
M. deVaulx, subst. du Proc. gén.; Chéronnet, Dazinière et F. Huré. av.
137<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
18 décembre 1877.<br />
Justice musulmane. — Appel. — Organisation de la justice<br />
en Kabylie. —<br />
de demande. —<br />
Omission<br />
Jugement<br />
de statuer sur un ou plusieurs chefs<br />
en dernier ressort.<br />
La Cour d'appel (Chambre musulmane) ne saurait en aucun cas être saisie<br />
de l'appel d'un jugement rendu en matière mobilière et conséquemment en<br />
dernier ressort, par le Tribunal de Tizi-Ouzou, aux termes des dispositions du<br />
décret du 29 août 1874.<br />
77 en est ainsi, même s'il résulte de l'examen du jugement que celui-ci a<br />
omis de statuer sur un ou plusieurs chefs de demande ou négligé de motiver<br />
le dispositif qu'il contient .<br />
La Cour ne peut dans ce cas que repousser l'appel qui est incompétemment<br />
porté devant elle, en renvoyant l'appelant à se pourvoir devant le Tribunal<br />
compétent pour interpréter, expliquer ou compléter lejugement irrégulier dont<br />
il était appelé devant elle ( 1 ) .<br />
Tassadit bent Bouzazous c. El Hadj Ahmed ben Zerrouk.<br />
Attendu que devant M. le juge de paix de Dra-el-Mizan, Tassadit bent<br />
Bouzazous réclamait à El Hadj Ahmed ben Zerrouk, son ex-gendre : lu 550<br />
(1) La décision de la Cour nous paraît absolumentjuridique. Évidemment, tout<br />
en constatant avec regret, en faisant mêma ressortir les irrégularités du jugement<br />
qui lui était déféré, la Cour ne pouvait aller au-delà; l'arrêt semble indiquer à la<br />
partie lésée la voie qu'elle pourrait suivre pour corriger l'erreur dont elle est vic<br />
time; mais la Cour n'aurait pu, sans usurper les pouvoirs d'une Cour suprême de<br />
cassation dont aucune législation ne l'a investie, statuer par voie d'infirmation à<br />
rencontre de ce jugement, quels qu'en fussent les vices.<br />
Cet arrêt indique manifestement une des lacunes qui se rencontrent entre autres<br />
dans l'organisation de la justice musulmane en Algérie : c'est l'absence d'une ju<br />
ridiction régulatrice, chargée de briser toutes les décisions entachées de vices de<br />
et également de fixer d'une manière précise les principes de jurisprudence<br />
forme,<br />
applicables en matière musulmane.<br />
La nécessité d'une Cour de cassation se fait sentir plus particulièrement alors<br />
qu'on est en présence d'une procédure en quelque sorte rudimentaire dans la<br />
quelle les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition, et alors que<br />
les décrets de 1866 et de 1874 ont attribuéà<br />
de simples tribunaux d'arrondisse<br />
ment le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les matières les plus importantes,<br />
notamment sur toutes les actions personnelles ou mobilières, quel que soit le<br />
chiffre de la demande, et sur les contestations relatives aux matières religieuses ou<br />
d'état-civil.<br />
V. M.
138<br />
francs auxquels elle prétendait comme héritière de sa fille Fathma, décédée<br />
sans postérité ; 2° des bijoux d'une valeur de 300 francs confiés par elle à<br />
sadite fille ; 3° un troupeau de quatre brebis et sept chèvres confiées en<br />
cherika ;<br />
4° enfin 10 francs prêles en argent au même ;<br />
— Que par une dé<br />
cision, dont on devrait mais dont on ne peut trouver la date dans le juge<br />
ment infirmalif du Tribunal de Tizi-Ouzou, M. le juge de paix de Dra-el-<br />
Mizan, écartant le dernier chef de demande comme non-justifié, avait admis<br />
!• les droits de Tassadit : sur une somme de 735 francs dont il lui attri<br />
buait le sixième comme héritière de Fathma; 2° sur une somme de 125 fr.<br />
dont il lui attribuait également le sixième pour répondre au deuxième chef<br />
de sa demande ; enfin 3° sur le troupeau confié à titre de chérika à El Hadj<br />
Ahmed ben Zerrouk, troupeau évalué par le premier juge à la somme de<br />
110 francs qu'il condamnait le défendeur à payer à Tassadil ;<br />
Attendu que sur l'appel d'El Hadj Ahmed ben Zarrouk, le Tribunal de<br />
Tizi-Ouzou,<br />
après un préparatoire ordonnant une enquête portant unique<br />
ment sur le fait de savoir si Fathma fille de Tassadil était ou non décédée<br />
sans postérité, a, à la date du 26 octobre 1877, infirmé la décision du pre<br />
mier juge ;<br />
Attendu que c'est de ce second jugement que Tassadit a fait appel à son<br />
tour ; qu'elle invoque à l'appui dudit appel que dans sa décision le Tribu<br />
nal de Tizi-Ouzou n'a examiné ni son appel incident sur le deuxième chef<br />
de sa demande relatif aux bijoux par elle confiés à sa fille, ni, ce qui saute<br />
aux yeux les moins clairvoyants, le chef du troupeau confié en cherika au<br />
défendeur originaire, chef que M. le juge de paix de Dra-el-Mizan avait ce<br />
pendant pleinement admis après une enquête justificative<br />
Attendu que si, en effet, l'infirmation du premier jugement par le Tri<br />
bunal de Tizi-Ouzou sans examen des divers chefs du procès,<br />
;■<br />
est incom<br />
préhensible pour la Cour, celle-ci, aux termes dit décret du 29 août 1874, ne<br />
saurait statuer sur une question purement mobilière née dans l'arrondisse<br />
ment de Tizi-Ouzou ; Que c'est au Tribunal de Tizi-Ouzou lui-même que<br />
Tassadit doit s'adresser pour lui demander d'expliquer par voie d'interpré<br />
tation son infirmation non mûlivée qui semble frapper pourtant tous les chefs<br />
de demande sans exception qu'avait admis le premier juge ;<br />
la partie qui a appelé à tort doit supporter les dépens de son appel.<br />
— Attendu<br />
que<br />
Par ces motifs : Déclare l'appel de Tassadit bent Bouzazous irrecevable<br />
comme porté devant une juridiction incompétente, la renvoie à se pourvoir<br />
devant le Tribunal pouvant expliquer le jugement du 26 octobre 1877 et la<br />
condamne aux dépens de son appel .<br />
M. Lourdau, cons. rapp. ; M. DU Moiron. subst. du Proc, gén.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE (1" Ch.)<br />
Présidence de M. AUTRAN, président.<br />
12 décembre 1877.<br />
Algérie. — Douanes. — Droit de quai. — IVavIre<br />
venant des
139<br />
ports d'Algérie dans les ports de France. — Double per<br />
ception.<br />
biennale.<br />
— Restitution des droits perçus. — Prescription<br />
-<br />
Aux termes des lois des 11 janvier 1851, 19 mai 1 866 e^ 17 juillet 1867,<br />
toutes les barrières de Douane entre la France et l'Algérie ont été supprimées, et<br />
la même législation est uniformément applicable à l'une comme à l'autre : les<br />
rares différences qui se rencontrent encore entre. lesckux territoires, sont en fa<br />
veur de l'Algérie, et consistent généralement en affranchissement ou dégrèvement<br />
de droits ayant pour but de favoriser développement commercial.<br />
Par suite de ce principe, l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1 872 a été appliqué<br />
en Algérie comme en France, au point de vue de la perception du droit de quai,<br />
aux navires y arrivant de l'étranger ou des colonies et possessions françaises.<br />
Mais par le même principe aussi, l'administration ne saurait être fondée à<br />
percevoir ce même droit de quai dans les ports de la métropole, sur les navires<br />
venant desports de l'Algérie : l'article 6 de la loi du 30 janvier 1872 est évidem<br />
ment inapplicable à une perception de département français à département<br />
français,<br />
et l'Algérie ne peut être soumise à cette situation anormale d'être<br />
assimilée à la métropole pour la perception du droit sur les navires qui y ar<br />
rivent,<br />
et d'être en même temps classée comme colonie pour la perception du<br />
droit sur les navires qui en sortent et viennent en France.<br />
On ne saurait admettre que la loi du 30 janvier 1872 a fait revivre, relati<br />
vement aux navires arrivant en Algérie, le droit de tonnage supprimé par la loi<br />
du 18 mai 1866 : il n'y a, en effet, à côté de différences essentielles, d'autre<br />
ressemblance entre ce droit et le droit de quai qu'en ce qui concerne le prin<br />
cipe de l'assiette de l'impôt,<br />
explicitement ni implicitement de la loi de 1872.<br />
et en outre son rétablissement ne résulte ni<br />
En conséquence, l'administration qui a perçu le droit de quai dans les ports<br />
de la métropole sur les navires venant d'Algérie, doit être condamnée à le res<br />
tituer avec les intérêts à partir du jour de la perception.<br />
Toutefois, aux termes de l'art. 25, litre xm, de la loi du 22 août 1791, les<br />
sommes perçues plus de deux ans avant la demande en restitution, sont cou<br />
vertes par la prescription .<br />
Les tribunaux qui ordonnent cette restitution ne peuvent néanmoins en même<br />
temps faire défense à l'administration de renouveler cette perception à l'avenir,<br />
car ce serait violer l'art. 5 du Code civil; qui interdit au juge de prononcer,<br />
par voie de disposition générale ou réglementaire, ainsi que l'art. 1 3, titre m,<br />
de la loi des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III, qui font<br />
défense aux tribunaux de s'immiscer dans les fonctions de l'administration.<br />
Administration des Douanes c. Cie Valéry.<br />
La Compagnie de navigation Valéry frères et fils,<br />
la Compagnie de<br />
navigation mixte, les Messageries maritimes et les Transports mari-
140<br />
times avaient assigné M. le Receveur principal des Douanes de<br />
France à Marseille,<br />
de cette ville,<br />
devant M. le Juge de paix du deuxième canton<br />
en restitution des sommes perçues pour droits de quai<br />
sur les navires venant d'Algérie à Marseille. (Art. 6 delà loi du 30<br />
janvier 1872).<br />
M. le Juge de paix du deuxième canton a rendu, le 12 janvier<br />
1877, un jugement qui ordonne la restitution par la Douane,<br />
à la<br />
Compagnie Valéry, de 71,450 fr. 24 c. pour la ligne d'Alger, de<br />
34,952 fr . 20<br />
c . pour la ligne de Stora,<br />
et des perceptions faites de<br />
puis le 18 août 1875 jusqu'au jour du jugement, le tout avec intérêts<br />
et fait défense à la Douane de percevoir à.<br />
du jour de la demande,<br />
l'avenir le droit de quai de 50 c. par tonneau sur les navires venant<br />
des ports d'Alger et de Stora dans les ports de Marseille.<br />
Sur l'appel de l'administration des Douanes,<br />
Marseille (lre<br />
suivant :<br />
le Tribunal civil de<br />
Ch.) a rendu, le 12 décembre 1877, le jugement<br />
Vu l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872, ainsi conçu : « Les navires de<br />
venant de l'étranger ou des colonies et possessions fran-<br />
» lout pavillon,<br />
» çaises, chargés en totalité ou en partie, acquitteront, pour frais de quai,<br />
» une taxe fixée par tonneau de jauge, savoir : pour les provenances des<br />
» pays d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, 50 centimes; pour les arri-<br />
» vages de tous autres pays, 1 — franc;» Attendu que, dans la cause<br />
actuelle, la question à résoudre ne porte pas sur une simple dénomination,<br />
ni sur le point de savoir si, dans le langage usuel et dans des circonstances<br />
diverses, l'Algérie peut être appelée une colonie ou une possession française;<br />
— Que ce dernier terme n'a rien de plus caractéristique que le premier el<br />
— n'a pas une signification qui l'attache spécialement à l'Algérie; Que le<br />
Sénégal, Mayotle, Pondichéry sont des possessions françaises et que, dans le<br />
rapport de la commission sur le projet converti en.loi le 30 janvier 1872, on<br />
ne lit rien qui détermine l'applicalion de cette expression à l'Algérie ;<br />
Attendu qu'il s'agit de reconnaître si, au point de vue des lois de douane, et<br />
nolammenl de celle du 30 janvier 1872, l'Algérie doitêtre considérée comme<br />
une colonie, point de départ qui donne lieu à l'application du droit de quai<br />
aux navires, même français, à leur arrivée daniun port de la France métro<br />
politaine, ou si les ports du département de l'Algérie doivent être regardés<br />
comme égaux aux porls de la France continentale, en sorte que de ces porls<br />
français à ports français la navigation soil affranchie de ce droil; —Attendu<br />
que le législateur lui-même, dans la loi du 30 janvier 1872 (art. 4) place<br />
l'Algérie, quant aux surtaxes de pavillon et d'entrepôt, hors de la catégorie<br />
générale des colonies et l'assimile aux ports français proprement dits;<br />
Qu'il se tait, il esl vrai,<br />
quant au droit de quai qui n'esl édiclé que dans un<br />
article subséquent; mais l'assimilation une fois prononcée, il a Irès-bien pu<br />
juger qu'il n'était pas nécessaire de réitérer cette disposition, d'autant mieux<br />
que la règle générale est, quanta l'Algérie, l'assimilation aux porls français;<br />
—<br />
—
141<br />
— Attendu qu'en effet, en vertu des lois des 11 janvier 1851, 19 mai 1866 et<br />
17 juillet 1867, toutes barrières de douane entre la France et l'Algérie ont<br />
été supprimées, l'union douanière entre les deux territoires est devenue en<br />
—<br />
tière et la législation uniformément applicable à l'un comme à l'autre ;<br />
Que si l'on y remarque quelques rares différences, elles sonl en faveur de<br />
l'Algérie,<br />
c'est-à-dire qu'elles consistent généralement en affranchissement ou<br />
en réduction de droits ayant pour but de favoriser son développement com<br />
mercial ; — Attendu<br />
que c'est en vertu de celte application uniforme des<br />
loisdouanières sur le territoire de la métropole et sur celui de l'Algérie, que<br />
l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 a été immédiatement appliqué, en Al<br />
gérie comme en France, aux navires y arrivant de l'étranger ou des colonies<br />
— et possessions françaises ; Attendu que le législateur lui-même a reconnu<br />
le motif de celte application et sa régularité lorsque, en 1875, il s'est occupé<br />
de quelques modifications à apporter en faveur de l'Algérie aux dispositions<br />
— de l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 ; Que l'exposé des motifs de la loi<br />
du 30 janvier 1872, s'exprime ainsi : «<br />
gé-<br />
Conformément aux dispositions<br />
l'article 6 de la loi<br />
» nérales des lois des 1er janvier 1851 et 17 juillet 1867,<br />
» du 30 janvier 1872, portant l'établissement du droit de simulquai,<br />
a élé<br />
— » tanément appliqué en France el en Algérie;» Attendu que c'est uni<br />
quement en verlu de cette assimilation des ports de l'Algérie aux porls de la<br />
métropole, que le droit de quai a été ainsi perçu en Algérie, car l'article 6<br />
—<br />
ne contient rien qui soit particulièrement relatif aux ports algériens;<br />
Attendu que si le droit de quai a régulièrement atteint, à l'entrée dans les<br />
ports de l'Algérie, les navires désignés dans l'art. 6 précité, c'est irrégulière<br />
ment que la taxe a été imposée aux navires venant des ports de l'Algérie dans<br />
les ports de la métropole, car de département français à département français<br />
l'art. 6 est inapplicable, el dans les débats qui ont précédé le vote de la loi<br />
du 30 janvier 1872, le Rapporteur et M. le Ministre des finances proclament<br />
à l'envi qu'on entend faire à l'Algérie exactement la même situation qu'à un<br />
département français;<br />
— Que si cette intention a été ainsi exprimée dans la<br />
discussion de l'art. 4, elle n'a rien de spécial par rapport à cet article, et l'on<br />
ne peut voir dans cette formule qu'un principe général qui domine égale<br />
— ment l'art. 6; Attendu que procéder comme l'entend la Douane, c'est créer<br />
—<br />
au détriment de l'Algérie une position singulière et anormale ; Qu'en effet,<br />
relativement aux colonies, le droit de quai ne frappe pas les navires qui y<br />
entrent; il atteint seulement ceux qui en sortent et viennent en France;<br />
quant à l'Algérie, au contraire,<br />
on veut soumettre au droit de quai les na<br />
vires qui y arrivent soit de l'élranger, soit' des colonies, parce qu'on l'assi<br />
et en même temps on enlend frapper de ce<br />
même droit ceux qui en sortent et viennent en France, parce qu'on la<br />
classe comme colonie; en sorte que pour la perception de ce drpit, on la<br />
considère comme territoire assimilé à la métropole et comme territoire colo<br />
mile aux départements français,<br />
—<br />
nial, ce qui esl contradictoire; Attendu que l'administration soutient que<br />
si les navires venant de l'Algérie sont soumis à la taxe en verlu de l'art. 6<br />
comme partis d'une colonie, ceux qui arrivent en Algérie sont soumis au<br />
droit de quai, parce que cette taxe n'est autre que l'ancien droit de tonnage<br />
—<br />
qui se trouve rétabli par l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 ; Attendu<br />
que cette prétention est tout à fait erronée ; que cel article n'a nullement
142<br />
fait revivre les dispositions constitutives du droit de tonnage supprimé par<br />
la loi du 19 mai 1866; qu'il faut, pour qu'une loi nouvelle remette en<br />
vigueur une loi abrogée, que cette rénovation soit ordonnée formellement<br />
ou que les dispositions abrogées soient reprod«ites; que la loi du 30 janvier<br />
1872 n'exprime rien de pareil;<br />
que l'ancien droit de tonnage en Algérie ne<br />
s'appliquait qu'aux navires étrangers, tandis que le droit de quai, créé par<br />
la loi de 1872, atteint les navires sous tous pavillons en s'attachanl seule<br />
— ment à leur provenance ; Que le droit de tonnage était tarifé à 4 fr. par<br />
tonneau, tandis que le droit de quai n'est que de 50 c. ou de 1 fr.; qu'il y<br />
a seulement une ressemblance dans le principe de l'assiette de l'impôt, mais<br />
les différences ne sont pas moins essentielles et profondes et rien ne permet<br />
de considérer les anciennes dispositions abrogées comme rétablies ; qu'au<br />
surplus, ce n'est pas en verlu de la loi de 1851 que la perception est pour<br />
suivie, mais d'après la loi de 1872;<br />
— Allendu que l'administration fait<br />
encore valoir que dans le rapport de la loi de 1872, on cile le chiffre officiel<br />
du tonnage des navires entrés en France en 1869 comme une indication sur<br />
le produit du nouvel impôt, et que la décomposition de ce chiffre démontre<br />
que le tonnage des navires venant d'Algérie y esl compris, mais il est à ob<br />
—<br />
server que cet aperçu est présenté sous un point de vue loul différent ;<br />
Qu'il s'agil en bloc : 1° de la navigation venant des mers d'Europe et de la<br />
Méditerranée 2° —<br />
; des autres navigations ; Que rien ne prouve que l'at<br />
— tention se soit portée d'une manière particulière sur l'Algérie ; Que même<br />
ce calcul, en le rattachant au système de la Douane, ne se raccorderait pas<br />
avec lui et serait fautif, puisque l'Algérie n'y serait comprise que pour les<br />
navires venant de ses ports et qu'on ne tient pas compte de ceux qui y<br />
entrent;<br />
— Attendu<br />
que vainement encore l'administraiion prétend-elle<br />
qu'on n'a pas à se préoccuper de ce qui se passera en Algérie, parce que c'est<br />
la légalité de la perception faite à Marseille qui est seule en question, et<br />
— qu'il s'agit donc de deux bureaux de douane différente ; Que cette consi<br />
dération ne saurait prévaloir, car si le bureau de l'Algérie et celui de Mar<br />
seille sont distincts, l'administration est une, et surtout l'application de la loi<br />
que le législateur lui-même en dé<br />
ne peut être qu'uniforme ;<br />
— Attendu<br />
clarant, dans les lois des 20 mars 1875 et 12 mars 1877, modifier la per<br />
ception en Algérie du droit de quai établi par la loi du 30 janvier 1872 a,<br />
par là.même, reconnu que ce droit y était légitimement perçu;<br />
— Qu'il<br />
s'ensuit que celte même disposition ne peul, par un double effet, atteindre<br />
encore les navires venant d'Algérie dans la France continentale ;<br />
que le juge de première instance a donc sainement entendu et appliqué l'art.<br />
6 de la loi du 30 janvier 1872 ;<br />
— Que<br />
— Attendu<br />
c'est encore à bon droil que, par<br />
application de l'art. 25, titre xm, de la loi du 22 août 1791, il a déclaré<br />
couverlcspar la prescription les sommes perçues plus de deux ans avant la<br />
demande en —<br />
restitution, c'est-à-dire antérieurement au 18 août 1 873 ;<br />
Mais attendu que le jugement dont est appel fait défense à la Douane. d'ap<br />
pliquer à l'avenir la taxe des droits de quai aux navires de là Compagnie<br />
Valéry frères et fils venant des ports de l'Algérie dans celui de Marseille —<br />
;<br />
Qu'il a ainsi violé l'art. 5 du Code civil qui interdit au juge de prononcer par<br />
voie de disposition générale ou réglementaire, ainsi que l'art. 1 3, tilre ni de la<br />
loi des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III, qui font défense aux
143<br />
— tribunaux de s'immiscer dans les fonctions de l'administration ; Qu'il y a<br />
— donc lieu d'infirmer sur ce chef le jugement ; Atlendu que c'est à tort<br />
encore que le jugement dont est appel prononce contre la Douane la con<br />
damnation aux intérêts à compter du jour de la demande, ou soit du 18 août<br />
même pour les sommes qui ont été perçues seulement à partir dudit<br />
1875,<br />
jour jusqu'au jour dudit jugement ; que les intérêts ne pouvaient courir<br />
pour les sommes qui n'étaient point encore déboursées ; qu'ils n'ont pu<br />
prendre cours que du jour de leur perception ;<br />
— Atlendu, quant aux dé<br />
pens, que la Douanasuccombe sur la partie principale du litige —<br />
; Que les<br />
frais doivent être réglés entre les parties en proportion de l'importance des<br />
points sur lesquels elles triomphent ou succombent.<br />
Par ces motifs :<br />
Reçoit l'administration des Douanes (bureau de Marseille) en son appel en<br />
vers le jugement rendu le 12 janvier 1877, par le juge de paix du deuxième<br />
canton de Marseille, et, y ayant tel égard que de raison ; Infirme ledit jugement<br />
quant au chef faisant à l'administration des Douanes inhibition et défenses<br />
d'appliquer à l'avenir certaines taxes aux navires de la Compagnie de navi<br />
gation Valéry frères et fils ; dit el ordonne que lesdites inhibitions el dé<br />
fenses seront tenues comme non avenues; Ordonne, quant aux intérêts des<br />
sommes dont la restitution est prononcée, que les intérêts tels que de droit<br />
seront payés à dater du jour de la demande, ou soit du 18 août 1875, pour<br />
les sommes indûment perçues à celte date ; mais que, pour les intérêts des<br />
sommes indûment perçues à dater dudit jour 18 août 1875 jusqu'au jour du<br />
jugement, ils devront être payés comme prenant cours à complet des per<br />
ceptions ; Confirme tous les autres chefs du jugement dont est appel; Or<br />
donne qu'ils sortiront leur plein et entier effet pour être exécutés selon leur<br />
forme et teneur ; Ordonne la restitution de l'amende ; Ordonne qu'il sera<br />
fait masse des dépens de première instance et d'appel et qu'ils seront sup<br />
portés pour les trois quarts par les Douanes et pour un quart par la Compa-<br />
pagnie Valéry frères et fils, avec distraction au profit des avoués.<br />
M. Berr, subst. du Proc. de la Rêp.; Mes Blanchard et Aicard, av.<br />
Même jugement sur l'appel émis parles douanes des jugements en<br />
premier ressort par : 1° la Compagnie mixte ; 2° les Transports ma<br />
ritimes, et 3° les Messageries maritimes.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en dale du 21 mars 1878 :<br />
M. Goguyer a été nommé interprète judiciaire près la justice de paix de<br />
Krenchela,<br />
en remplacement de Si Younès ben Mohamed, révoqué.
144<br />
Par décret en date du 2 avril 1878, ont été nommés :<br />
Huissier près la justice de paix de Guelma M. Arnould, huissier près la<br />
justice de paix de l'Oued-Alhménia, en remplacement de M. Boullon.<br />
Huissier près la justice de paix de l'Oued-Athmenia, M. Youda ben Simon,<br />
huissier près la justice de paix de Collo, en remplacement de M. Arnould.<br />
Huissier du tribunal de lre instance d'Oran, M. Boullon, huissier prés la<br />
justice de paix de Guelma, en remplacement de M. Danerou, décédé.<br />
Huissier près la justice de paix de Collo, M. Maggiore (Gaétan Ange), en<br />
remplacement de M. Youda ben Simon.<br />
Par décrets en date du 13 avril 1878, ont élé nommés:<br />
Vice-président au Tribunal de première instance de Constantine, M. Ron-<br />
not, juge au siège d'Alger, en remplacement de M. Lefébure qui esl nommé,<br />
sur sa demande, juge à Alger.<br />
Juge au Tribunal de première instance d'Alger, M. Lefébure, vice-prési<br />
dent au siège de Constantine, en remplacement de M. Ronnot, qui est nom<br />
mé vice-président.<br />
Suppléant du juge de paix de l'Oued-Athménia, M. Abadie (Joseph-Gus<br />
tave),<br />
en remplacement de M. Henglais démissionnaire.<br />
M. Moreau a été nommé greffier de la justice de paix de Takitount, en<br />
remplacement de M. Chardon, décédé.<br />
Par arrêté du Procureur général en date du 15 avril 1878 :<br />
M. Rochet (Félix-Antoine)<br />
a été nommé curateur aux successions vacantes<br />
pour les deux cantons d'Alger, en remplacement de M. Joly, démissionnaire.<br />
Par arrêté en date du 19 mars 1878:<br />
M. Tailleuse a été nommé secrétaire du Parquet de Tlemcen, en rempla<br />
cement de M. Moretti, nommé garde colonial à Lamoricière.<br />
Par arrêté du Procureur général en dale du 29 avril 1878 :<br />
M. Claire, commis-greffier près la justice de paix de Bordj-bou-Arréridj,<br />
a élé nommé curateur aux successions vacantes dans lecanlon de cette justice<br />
de paix, en remplacement de M. Jais, démissionnaire.<br />
Alger. — Typ. A. Jourdan.
2e année.<br />
— 16<br />
Mai 1878. —<br />
N° 3-<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
LÉGISLATION<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />
23 novembre 1877.<br />
Dénonciation calomnieuse. — Crime. — Magistrat. — Premier<br />
— président de la Cour d'appel. Compétence,<br />
— Décision.<br />
Aux termes des dispositions combinées de l'art. 484 et de l'art. 128 du Code<br />
d'instr. crim., c'est le premier président de la Cour d'appel qui remplit les<br />
fondions de juge d'instruction toutes les fois qu'une dénonciation, à raison<br />
d'un crime, est portée contre un des magistrats dénommés en l'art. 483 du<br />
même Code, dans l'espèc.i un suppléant de justice de paix (1) .<br />
En conséquence, l'ordonnance de non lieu que le premier président a<br />
sur une dénonciation de ce genre, et qui n'a été l'objet d'aucun recours du<br />
procureur général, constitue une décision sur la vérité ou la fausseté des faits<br />
dénoncés et est susceptible de servir de base à une action en dénonciation calom -<br />
nieuse .<br />
Vitalis c. le Ministère public<br />
LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles<br />
128 et 484 du Code d'instruction criminelle en ce que la fausseté du fait<br />
—<br />
dénoncé n'aurait pas été vérifiée el déclarée par l'autorité compétente ;<br />
Attendu que, d'après les constatations de l'arrêt, Vital is avait adressé, le 4<br />
février 1877, au procureur général près la Cour d'Alger, une plainte revê<br />
tue de sa signature, dans laquelle il dénonçait le sieur Fleury, président du<br />
syndical administratif de TIemcen, auquel il imputait spécialement d'avoir<br />
touché, en celle qualité, et détourné à son profil une somme de 1,500 fr.,<br />
au moyen de faux mandais délivrés au nommé Georges Forster qui n'aurait<br />
(1)<br />
Les art. 483 et 484 du Code d'instr. crim. règlent la compétence correction<br />
nelle et les formes d'instruction en ce qui concerne lès juges de paix ou de police,<br />
les membres des tribunaux de commerce, les officiers de police judiciaire, les<br />
membres des tribunaux correctionnels ou de première instance, et les officiers du<br />
ministère public chargés près de l'un de ces juges ou tribunaux.
146<br />
— été qu'un créancier fictif; Attendu que, en 1874, la gestion de Fleury,<br />
alors comme aujourd'hui suppléant du juge de paix, avail été dénoncée par<br />
un sieur Dablau au procureur général d'Alger ; que le fait concernant<br />
Georges Forsler avait été, d'après les affirmations de l'arrêt* vérifié et<br />
reconnu faux, au cours de l'information à laquelle avait procédé le juge<br />
d'instruction au siège de Tlemcen, par délégation de M. le premier prési<br />
dent, conformément aux dispositions de l'art. 484 du Code d'instruction<br />
— Que, à la suite de celte information, M. le premier président<br />
criminelle;<br />
de la Cour d'Alger avait reconnu la fausseté des faits dénoncés, déclaré que<br />
Fleury n'avait détourné de sa destination aucune somme quelconque et avait<br />
rendu, le 24 septembre 1874, une ordonnance de non-lieu contre laquelle<br />
aucun recours n'a élé formé par le procureur général, dont les réquisitions<br />
avaient été conformes ;<br />
— Attendu<br />
nouvelles, a acquis l'autorité de la chose jugée ;<br />
que celle ordonnance, à défaut de charges<br />
— Qu'elle<br />
avait élé rendue<br />
par l'autorité compétente d'après les dispositions combinées de l'art. 484 et<br />
de l'art. 128 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 17<br />
— juillet 1856; Qu'en effet, l'art. 484 confère au cas prévu, au premier<br />
président, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction, et<br />
rend applicables à la procédure, dans l'hypothèse indiquée, les dispositions<br />
Que,<br />
générales du Code d'instruction criminelle ;<br />
— d'après le texte el<br />
l'esprit de ces deux articles rapprochés, le premier président d'Alger était<br />
compétent pour vérifier el déclarer la fausseté des faits dénoncés et pour<br />
rendre une ordonnance de non lieu ;<br />
—<br />
Attendu, d'ailleurs,<br />
que l'arrêt a<br />
affirmé la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu el qu'il est<br />
régulier dans sa forme ;<br />
Rejette, etc.<br />
M. Lacointa, av. gén. (concl. conf.) ; M. Saint-Luc Courborieu, cons. rapp.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
Présidence de M. DE CARNIÈRES, président.<br />
21 mars 1878.<br />
Juridiction correctionnelle. — Incompétence. — Condamnation<br />
aux dépens. — Cassation.<br />
En matière correctionnelle, la condamnation aux dépens ne peut être que la<br />
conséquence de la condamnation prononcée contre un prévenu déclaré coupable<br />
d'un fait punissable (1).<br />
*<br />
(t) Voir au Bull, jud., 1877, p. 118, un arrêt de la Cour d'Alger (Ch. des ap<br />
pels correct.), en date du 27 décembre 1876, qui avait, contrairement à la doctrine<br />
de la Cour de Cassation, condamné aux frais un prévenu acquitté : cette décision<br />
a été l'objet de nos critiques.
147<br />
En conséquence, une Cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître<br />
de la poursuite dirigée contre un prévenu, ne saurait, sans violer la loi, con<br />
damner Ce prévenu aux dépens.<br />
Par suite, si une semblable condamnation a été prononcée, la Cour de<br />
Cassation,<br />
saisie par lettre du Garde des sceaux aux termes de l'article 441 du<br />
Code d'instr. crim. , doit casser et annuler dans cette partie qui lui est déférée,<br />
tant dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt du condamne, l'arrêt qui pro<br />
nonce à tort cette condamnation (\).<br />
Ettodmi ben Mohamed et autres.<br />
Par arrêt en date du 13 décembre 1877,<br />
la Cour d'Alger (Ch. des<br />
appels correct.), ayant à statuer sur une prévention de vol dirigée<br />
contre différents indigènes,<br />
avait relevé l'existence de plusieurs<br />
circonstances aggravantes de nature à donner aux faits un caractère<br />
criminel, et s'était déclarée incompétente;<br />
avait condamné les prévenus aux dépens.<br />
mais en même temps elle<br />
M. le Garde des sceaux crut devoir déférer cet arrêt à la Cour de<br />
Cassation par la lettre suivante :<br />
« Monsieur le Procureur général, par votre dépêche du 4 février dernier,<br />
vous avez appelé mon attention sur un arrêt de la Cour d'appel d'Alger, en<br />
date du 13 décembre 1877, confirmant d'un jugement d'incompétence du<br />
Tribunal correctionnel de la même ville, dont la contradiction avec une ordon<br />
nance motivait un règlement de juges (affaire Mohamed ben Ahmed et autres,).<br />
» Cet arrêt, par excès de pouvoir et en violation des principes consacrés<br />
par les articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle, a condamné<br />
les prévenus qui échappaient à la juridiction correctionnelle aux dépens de<br />
première instance et d'appel, liquidés à la somme de 120 fr. 55, en fixant à<br />
quarante jours la durée de la contrainte par corps.<br />
» Vous vous êtes abstenu néanmoins de dénoncer ces irrégularités à la<br />
Cour, en verlu de l'art. 442 du Code d'instruction criminelle,<br />
parce que<br />
votre intervention aurait élé sans profit direct pour les condamnés et aurait<br />
seulement fait ressortir la violation de la loi ; vous avez, en conséquence,<br />
provoqué l'intervention du Garde des sceaux, qui lient de l'art. 441 du même<br />
Code,<br />
des pouvoirs plus étendus. »<br />
M. Pavocat-général Benoîst a présenté le réquisitoire suivant :<br />
La question qui vous est soumise par M. le Garde des sceaux et sur laquelle<br />
vous êtes appelé à statuer est tellement simple, qu'il suffit de l'exposer pour<br />
la résoudre.<br />
(1) En raison de l'application assez rare de l'art. 441 du Code d'instr. crim. qui<br />
confère au Garde des Sceaux le droit de provoquer l'annulation des actes judi<br />
ciaires, jugements ou arrêts contraires à la nous avons loi, pensé qu'il serait<br />
intéressant de reproduire dans leur intégrité la lettre du Garde des Sceaux et le<br />
réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation.
148<br />
Un Tribunal qui se déclare incompétent peut-il prononcer une.conda<br />
nation aux frais el à la contrainte par corps?<br />
Sous l'ancienne législation, les accusés n'étaient poinl condamnés aux<br />
frais; ce principe fut maintenu par la loi du 27 septembre 1790,<br />
qui mit à la<br />
charge du Trésor public les frais de poursuites criminelles faites à la re<br />
quête du Procureur du Roi ou d'office.<br />
La loi du 18 germinal an VII, introduisit dans la législation une règle<br />
nouvelle qui subsiste toujours ; elle déclara que lout jugement portant con<br />
damnation à une peine quelconque, prononcerait en même temps contre le<br />
condamné, au profil de l'État, le remboursement des frais de la pro<br />
cédure.<br />
Celte règle a élé consacrée par les arl. 52 et 55 du Code pénal et par les<br />
art. 162 et 176, 194, 211 et 368 du Code d'instruction criminelle. En effet,<br />
aux termes des art. 162, 194 et 368 de ce Code, tout jugement de condamna<br />
tion doit assujettir le condamné au remboursement des frais. Mais il en<br />
résulte, comme une conséquence naturelle,<br />
que les frais cessent d'être à<br />
la charge des prévenus ou des accusés lorsqu'ils n'ont pas succombé dans<br />
la poursuite dirigée contre eux.<br />
Il faut donc, pour que l'accusé ou le prévenu puisse être condamné aux<br />
frais, qu'une peine quelconque soit venue l'atteindre.<br />
Ce principe, proclamé par la doctrine et par la jurisprudence, a élé consa<br />
cré par de nombreux arrêts de votre Chambre criminelle, notamment le 13<br />
février 1845, Bulletin 47 ; le 13 juin 1863, Bulletin 164 ; et dernièrement<br />
encore, le 21 août 1873, Bulletin 238 ; dans une espèce analogue à celle qui<br />
nous, occupe.<br />
« Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes de l'art. 194, du Code d'instruc<br />
tion criminelle, la condamnation aux frais ne doit être que la conséquence<br />
— de la condamnation prononcée contre un prévenu déclaré coupable ; At<br />
tendu que Delsal, n'ayant élé et ne pouvant être condamné à aucune peine<br />
par un 'simple jugement d'incompétence, ne devait pas encourir une con<br />
damnation aux dépens ;<br />
i D'où il suit qu'en prononçant une pareille condamnation, le juge de<br />
policé a commis un excès de pouvoir el formellement violé l'article 194<br />
précité. »<br />
Comme le juge de paix de Solesmes, la Cour d'appel d'Alger, en condam<br />
nant les prévenus aux dépens et à la contrainte par corps, après s'être<br />
déclarée incompétente, a commis un excès de pouvoir et violé l'article 194 du<br />
-d'instruction criminelle.<br />
Dans ces circonstances el par ces considérations,<br />
Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du<br />
9 mars 1878 ;<br />
Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, les articles 162, 194 et<br />
368 du même Code ;<br />
Et les pièces du dossier ;<br />
Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour,, Chambre criminelle,<br />
casser et annuler, parte in quà, tant dans l'intérêt de la loi que des condam<br />
nés, l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger, ci-dessus, etc<br />
»
149<br />
La Cour de cassation, faisant droit aux réquisitions qui précèdent,<br />
a rendu l'arrêt suivant :<br />
La Cour :<br />
Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du<br />
9 mars 1878;<br />
Vu la réquisition du procureur général en la Cour, ci-dessus transcrit ;<br />
et 55 du<br />
Vu les articles 441, 194, 211 du Code d'instruction criminelle,<br />
Code pénal ;<br />
Attendu qu'aux termes des articles de la loi sus-visés, la condamnation aux<br />
frais ne peut être que la conséquence de la condamnation prononcée contre<br />
un prévenu déclaré coupable d'un fait punissable ;<br />
— Attendu<br />
que les nom<br />
més Elloumi ben Mohamed ben Bachara et consorts, prévenus de vol, ne<br />
pouvant être et n'ayant été condamnés à aucune peine par un simple arrêt de<br />
compétence, ne pouvaient encourir une condamnation aux dépens; que<br />
néanmoins la Gour d'appel d'Alger (Chambre correctionnelle), après s'être<br />
déclarée incompétente pour connaître de la poursuite dirigée contre les sus<br />
nommés, les a condamnés aux frais, solidairement el avec contrainte par<br />
corps ; d'où il suit qu'en prononçant une pareille condamnation, ladite Cour<br />
a commis un excès de pouvoir et violé expressément les dispositions des<br />
articles de lois sus-visés ; que son arrêt tombe sous la censure de la Cour de<br />
cassation ;<br />
Par ces motifs : Casse et annule dans la partie qui lui est déférée, tant<br />
dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt des'<br />
condamnés, l'arrêt de la Cour<br />
d'appel d'Alger, du 13 décembre 1877, rendu contre les nommés Ettoumi<br />
ben Mohamed ben Bachara et autres; Dit qu'il n'y a lieu de prononcer<br />
aucun renvoi.<br />
M. EsTiohARD de Lafaulotte, const rapp.; M. Benoist,<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l«Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
4 mars 1878.<br />
premier président.<br />
av. gén.<br />
Saisie-exécution. — Vente. — Saisie-arrêt sur le prix de la vente.<br />
attribution de ce prix au saisissant.<br />
Lorsqu'une saisie-exécution a été suivie de la vente des objets saisis,<br />
et que<br />
selon les prescriptions de l'art. 622 du Code de procédure civile, la vente, en<br />
l'absence d'une opposition quelconque, a été arrêtée dès qu'elle a produit somme<br />
suffisante pour désintéresser le saisissant en principal, intérêts et frais, il en ré<br />
sulte une véritable attribution de cette somme au profit de ce saisissant.<br />
En conséquence,<br />
les oppositions qui seraient pratiquées postérieurement aux
mains de l'huissier- sur ce prix,<br />
150<br />
ne sauraient préjudiciel'<br />
aux droils du saisis<br />
sant, ni avoir pour effet, par suite, une distribution par contribution à opérer<br />
entre lui et les opposants (1).<br />
Pardiès c. Campillo.<br />
Attendu que le sieur Pardiès, créancier de Fernandez en verlu d'un juge<br />
ment du 9 novembre 1876, a fait pratiquer, contre ce dernier,<br />
une saisie-<br />
exécution ;— Qu'à la date du 24 décembre 1876, l'huissier a procédé à la<br />
vente des meubles saisis et qu'aucune opposition n'étant survenue à cette<br />
époque,<br />
la vente a été arrêtée dès qu'elle eut produit somme suffisanle pour<br />
désintéresser le saisissant en principal, intérêlset frais; —Que, deux jours<br />
après, une saisie-arrêt étail interposée à la requête de Campillo, entre les<br />
mains de l'huissier, et que celui-ci déposait alors les fonds à la Caisse des<br />
— dépôts et consignations; Que le 20 mars 1877, une nouvelle opposition<br />
des'<br />
— était signifiée au préposé à la Caisse consignations; Qu'en cet élat<br />
s'élevait la question de savoir si la somme provenant de la venle devait être<br />
attribuée à Pardiès ou si elle devait, au contraire, faire l'-objet d'une distri<br />
— bution par conlribulion ; Attendu que l'article 2093 du Code civil dispose<br />
que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le<br />
prix s'en distribue enlre eux par contribution, à moins qu'il n'y<br />
légitime de préférence;<br />
— Que<br />
ait cause<br />
ce texte suppose un gage réalisé, le prix non<br />
attribué et des créanciers également vigilants, faisant valoir simultanément<br />
leurs droits sur ce prix ;<br />
— Que telle n'esl pas la situation créée par les faits<br />
de la cause ;<br />
— Que l'article 622 du Code de procédure civile, en prescrivant<br />
d'arrêler la vente dès qu'elle a produit somme suffisante pour désintéresser<br />
le saisissant el les opposants qui se sont fait connaître avant la clôture de la<br />
vente, contient implicitement et nécessairement un principe d'attribution en<br />
(l) Ce principe n'est pas admis d'une manière générale par la jurisprudence et<br />
les auteurs : au contraire, un arrêt de Liège, 14 avril 1823 (D. V° Saisie-exécution,<br />
n»<br />
342)<br />
et un arrêt<br />
d'Orléans"<br />
11 juillet 1860 (/. du Pal. 1860, page 1095), décident<br />
n°<br />
292, Bioche,<br />
avec Chauveau sur Carré, quest. 2096, note 2, Rauter, Proc. civ.,<br />
V° n"<br />
Saisie-exécution, p. 123, n°<br />
4, et Dalloz, V°<br />
237, Pigeau, Proc. civ., II,'<br />
Saisie-exécution, nos 342 et 343,<br />
que toutes les fois que le saisissant ne touche pas<br />
immédiatement le prix de vente, ce prix reste la propriété du saisi et est soumis<br />
par suite à l'action des autres créanciers, la loi n'accordant aucune préférence au<br />
saisissant.<br />
L'opinion admise par l'arrêt d'Alger, nous semble infiniment plus conforme à<br />
l'esprit de l'art. 622 ; elle a été du reste soutenue d'une manière énergique dans<br />
une dissertation remarquable que M. Boucher d'Argis, conseiller honoraire à la<br />
Cour d'Orléans, a insérée au Journal du Palais en note de l'arrêt de cette Cour<br />
indiqué plus haut. (Voir aussi Thomine-Desmazures, Comment, du Code de pr. civ.<br />
sur l'art. 622, t. 2, n° 689). L'argument d'analogie tiré de la saisie-arrêt est parti<br />
culièrement frappant : en effet s'il est vrai, comme la Cour de cassation l'a jugé le<br />
5 août 1856 (/. du Pal. 1857, p. 65) et le 20 mai 1858 (J . du Pal. 1858, p. 854) que<br />
le jugement validant une saisie-arrêt approprie le saisissant des sommes que cette<br />
saisie tendait à lui faire attribuer, n'est-il pas tout naturel qu'une vente qui inter<br />
vient après une saisie-exécution produise absolument le même effet ?<br />
'<br />
V. M.
faveur de ceux-ci ;<br />
—<br />
Qu'autrement,<br />
151<br />
celle disposition serait inexplicable et<br />
qu'elle deviendrait un véritable piège pour les créanciers diligents ;<br />
effet, s'il fallait admettre à contribution les créanciers qui pourraient former<br />
des oppositions ultérieures, comment saurait-on jamais que la valeur des<br />
— Qu'en<br />
objets saisis excède le montant des causes de la saisie et des oppositions et<br />
qu'il y a lieu d'arrêter la vente? — Que si néanmoins,<br />
malgré celte éventua<br />
lité toujours menaçante, on arrêtait la vente, on arriverait à cette consé<br />
quence vraiment inique de forcer un créancier à se dessaisir de son gage, sur<br />
la promesse qu'il sera intégralement payé et de la réduire plus tard à un<br />
—<br />
simple marc le franc ; Que le lexte el l'esprit de l'article 622, sainement<br />
entendus, doivent conduire à cette interprétation que le législateur a voulu<br />
consacrer dans ce cas une attribution en faveur du saisissant et des oppo<br />
sants connus;<br />
— Qu'après<br />
l'interruption delà vente imposée au saisissant,<br />
s'il n'y a pas d'opposant, comme dans l'espèce, les fonds doivent être versés<br />
entre les mains du saisissant;<br />
—<br />
Que, de ce moment, il y<br />
a attribution et<br />
qu'on ne saurait faire dépendre ce résultat du paiement effectif, subordonné<br />
souvent à des retards indépendants de la volonté du saisissant, pour laisser le<br />
temps à des oppositions nouvelles de se produire ; — Qu'il<br />
n'y a pas à s'éton<br />
ner du principe posé par l'article 622, car il n'est qu'une application légitime<br />
— de celte règle de droit et d'équilé : jura vigilantibus succurrunt ; Qu'on<br />
— trouve déjà, dans la saisie-arrêt, un effet analogue ; Que si un créancier,<br />
après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, esl assez<br />
heureux pour devancer les autres créanciers de son débiteur et obtenir,<br />
avanl qu'ils aient formé opposition, un jugement de validité, devenu défi<br />
nitif, il y a attribution à son profit des deniers arrêtés, bien qu'ils soient<br />
—<br />
encore entre les mains du tiers-saisi ; Que celte attribution, conséquence<br />
de la saisie-arrêt, se comprend mieux encore à l'égard de la saisie-exéculion,<br />
—<br />
pratiquée en vertu d'un titre exécutoire el sur le débileur directement;<br />
Attendu enfin, par une dernière considération de fait, que les fonds prove<br />
nant de la venle avaient élé déposés à Ja Caisse des consignations, au nom<br />
de Pardiès et comme lui appartenant, et que ce dépôt nécessité par la saisie-<br />
arrêt, eut au moins emporté attribution —<br />
; Attendu que la contestation sou<br />
—<br />
levée par Campillo a causé à Pardiès un préjudice qui doit êlre réparé ;<br />
Que la Cour possède les éléments nécessaires pour arbitrer ce préjudice ;<br />
Par ces motifs : la Cour reçoit l'appel et infirmant le jugement déféré ;<br />
Annule l'opposition formée, le 20 mars 1877, à la requête de Campillo,<br />
maintient, en lant que de besoin, la nullité, déjà prononcée parles premiers<br />
juges, de la saisie-arrêt du 26 décembre 1877; Dit que les fonds provenant<br />
de la vente des objets saisis et déposés à la Caisse des consignations appar<br />
tiennent à Pardiès; Ordonne, en conséquence, que le préposé de la Caisse<br />
des dépôts et consignations sera tenu de les verser à Pardiès, sur le vu de la<br />
signification du présent arrêt, quoi faisant sera valablement déchargé, etc.<br />
M. Piette, av. gén.; M°» Garau et Chabert-Moreau, av.
152<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (I Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
Péremption d'instance. —<br />
18 mars 1878.<br />
premier président.<br />
Actes interruptifs.<br />
de la cause du rôle.<br />
— Radiation<br />
L'expiration du délai fixé par l'art. 397 du Code de procédure civile suffit<br />
pour consacrer la péremption d'instance, à moins qu'on ne puisse opposer à ta<br />
demande en péremption l'existence d'un acte interruptif.<br />
La radiation de la cause du rôle ne peut être considérée comme ayant le<br />
caractère d'un acte interruptif<br />
: ce n'est qu'une mesure d'ordreprise par la Cour<br />
el ne pouvant en conséquence avoir aucun effet au point de vue de la péremption<br />
d'instance (1).<br />
Attendu que le législateur,<br />
Carruana c. Bonici.<br />
consacrant en cela une tradition ancienne en<br />
même temps qu'une maxime de raison, a établi la péremption pour mettre<br />
— un terme nécessaire au procès; Atlendu, en fait, que dans l'inslance d'ap<br />
pel pendante entre Carruana et Bonici, le dernier acte de la procédure paraît<br />
avoir été le renvoi des parties prononcé, sans arrêt, à la date du 15 mars<br />
1873, devant- M. — le conseiller d'André de Renouard ; Que, depuis celte<br />
époque, aucun acte de procédure n'a été fait ;<br />
— Que seulement la cause a<br />
été rayée du rôle à la date du 19 décembre 1873 ;<br />
— Atlendu que la demande<br />
en péremption a été formée le 8 octobre 1877, par acte d'avoué à avoué ;<br />
Qu'ainsi, du simple rapprochement des dates, il résulte que la péremption<br />
— était acquise, à moins qu'il ne fût justifié d'acte interruptif; Qu'à ce poinl<br />
de vue Bonici se prévaut des deux circonstances suivantes: 1° la radiation<br />
du rôle, 2° — l'existence de pourparlers de transaction ; Atlendu que la ra<br />
sans que rien fasse supposer l'intervention des défenseurs<br />
diation de l'affaire,<br />
ou des parties,<br />
ne saurait être considérée comme un acle interruptif de la<br />
péremption, mais seulement comme une mesure d'ordre, prise d^office par la<br />
— Cour ; Que les pourparlers de transaction sont allégués, sans qu'il y ait au<br />
procès ni preuve à cet égard, ni offre de preuve ;<br />
Par ces motifs : la Cour déclare périmée l'inslance d'appel inlroduite par le<br />
sieur Bonici; Dit en conséquence que le jugement frappé d'appel sortira son<br />
plein et entier effet; Condamne Bonici en tous les dépens.<br />
(1)<br />
M. Piette, av. gén.; M« Chéronnet et Bouriaud, av.<br />
Évidemment la radiation de l'affaire ne peut avoir lieu sans que celle-ci<br />
soit appelée au rôle : et l'appel de la cause à l'audience a été déclaré<br />
acte interr.uptif (Grenoble 24 janvier 1822. D. V° Péremption, n° 195). Mais<br />
—<br />
constit<br />
un<br />
lorsque cet appel a lieu d'office et par mesure d'ordre, lors de l'appel général du<br />
rôle de la Chambre, on ne saurait lui attribuer un semblable effet (Orléans 26<br />
mai 1841. D. V» Péremption 196, et Cass. de""<br />
Belgique, tO février 1842. D. "V0<br />
n"<br />
Péremption 115).
153<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
Jugement par défaut. —<br />
8 février 1878.<br />
Profit-Joint.<br />
—<br />
au principal et en garantie..<br />
Défendeurs<br />
Lorsqu'un demandeur a assigné deux défendeurs, l'un en revendication im<br />
mobilière, l'autre en garantie, si l'un de ces derniers fait défaut, il n'y a pas<br />
lieu de rendre un jugement de défaut profit-joint, les deux actions dirigées<br />
contre les défendeurs étant distinctes l'une de l'autre, et pouvant même être<br />
disjointes (C. pr. civ., 184). —<br />
//<br />
doit, au contraire, être statué contradictoi-<br />
rement contre la partie qui se présente, et par défaut contre celle qui ne com<br />
paraît pas (1).<br />
Agius c. Ben Cheikh.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Considérant qu'il s'agissait devant les premiers juges de statuer<br />
sur l'opposition formulée par les époux Agius au jugement par défa'ut qui a<br />
admis la demande en garantie intentée contre eux par les consorts Ben<br />
Cheikh; '— Que ceux-ci excipent devant la Cour de l'irrecevabililé de celle<br />
opposition, parce qu'elle n'aurait pas élé formalisée par requête signifiée<br />
— d'avoué à avoué ; Considérant qu'il s'agit là d'un moyen de forme qui n'a<br />
pas élé proposé devant les premiers juges et qui n'est plus recevable après<br />
— les défenses au fond ; Considérant que Ben Cheikh avait formé devant les<br />
premiers juges une demande contre l'État, pour voir dire que ledit Ben<br />
Cheikh serait déclaré propriétaire du terrain qu'il<br />
acquis d'Agius;<br />
— Qu'en même temps il avait assigné Agius devant les<br />
détenait'<br />
comme l'ayant<br />
mêmes juges pourvoir dire que ce dernier Serait tenu d'assurer le succès<br />
de la demande de Ben Cheikh contre l'État, sinon de garantir son acquéreur;<br />
— Que si les deux demandes de Ben Cheiklrétaient connexes, elles étaient<br />
aussi.parfaitement<br />
distinctes, l'une immobilière et en revendication, l'autre<br />
mobilière en —<br />
garantie, el résullanl des obligations d'un contrat de venle;<br />
Qu'ainsi les défendeurs ne défendaient pas à la même action mais à deux<br />
actions différentes; —Que l'un des défendeurs, Agius, ayant fait défaut,<br />
faute de comparaître, il n'y avait clone pas lieu à rendre un jugement de<br />
défaut profit-joint, qui n'a d'autre profit que de prévenir l'événement de<br />
(I) L'art. 153) C. pr. civ est applicable<br />
, lorsque, entre la partie défaillante el la<br />
partie comparante, qui peuvent d'ailleurs avoir des intérêts distincts, existe un<br />
lien commun d'où pourrait résulte)', en cas d'opposition au jugement par défaut,<br />
une contrariété de décisions. "V. Alger, 25 juin 1860 (Robe, 1860, 209; Narbonne,<br />
n'<br />
— 8). Ce ne peut être le cas de deux défendeurs aussi<br />
v» Jugement par défaut,<br />
indépendants l'un de l'autre que ceux dont s'occupe l'arrêt rapporté.— V. Jugeni .<br />
Alger, 28 nov. 1876 (B. J. 1877, 77).
154<br />
décisions contraires rendues successivement vis-à-vis de deux défendeurs à<br />
la même action ;<br />
y<br />
— Qu'au<br />
contraire, quand il y a deux actions distinctes, il<br />
a lieu de statuer conlradictoiremenl sur celle dans laquelle les parties ont<br />
constitué, et par défaut sur celle qui n'a pas été défendue ;<br />
— Que<br />
l'article<br />
184 du Code de procédure permet même de prononcer la disjonction complète<br />
entre la demande principale et la demandé en garantie, et de statuer sépa<br />
— rément sur l'une et sur l'autre; Que si cet article a eu en vue le cas le<br />
plus ordinaire, où la demande en garantie est formée par le défendeur ori<br />
ginaire, il n'a fait qu'appliquer les règles générales de l'indépendance des<br />
— Que dans la cause, il était d'autant plus nécessaire de sta<br />
deux actions ;<br />
tuer conlradictoiremenl entre l'État et Ben Cheikh, en l'absence d'Agius, qui<br />
n'avail pas constitué avoué, qu'en cet état de faits il n'existait aucun lien de<br />
droft ni de procédure entre l'État et Agius, qui ne concluaient pas l'un<br />
— contre l'autre; Que pour faire naître entre les deux actions un lien qu'il<br />
pût invoquer, Agius aurait dû commencer par constituer et par conclure<br />
contre l'État, en intervenant, comme il était requis de le faire, dans l'ins<br />
— tance pendante entre l'État et Ben Cheikh ; Qu'il n'a pu, en ne le faisant<br />
pas, paralyser le droit qu'avaient dès lors l'État el Ben Cheikh de faire juger<br />
— contradicloirement le différend qui les divisait; Qu'une décision contra<br />
dictoire ayant été rendue à bon droit entre l'État el Ben Cheikh, Agius n'a<br />
pu former opposition contre l'État à cette décision, lors de laquelle l'État<br />
n'avait pas conclu contre lui;<br />
— Qu'en<br />
effet, lors de celte revendication,<br />
l'État n'avait eu d'autre adversaire que le propriétaire acluel, Ben Cheikh ;<br />
— Qu'Agius<br />
n'a pu former opposition qu'à la demande en garantie formulée<br />
— contre lui par Ben Cheikh et seule jugée par défaut ; Considérant que Ben<br />
Cheikh a élé évincé par une décision passée en force de chose jugée, de la<br />
terre qu'il avait acquise d'Agius ;<br />
— Que<br />
Ben Cheikh a proposé contre le<br />
revendiquant tous les moyens utiles; Qu'il a dénoncé la revendication à son<br />
vendeur, qui a fait —<br />
défaut; Adoptant en outre les motifs des premiers<br />
Considérant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice autre que celui<br />
juges; —<br />
réparé par la décision dont est appel : Confirme le jugement attaqué;<br />
Condamne l'appelant à l'amende el aux dépens d'appel.<br />
M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén.; M« Chéronnet et F. Huré, av.<br />
COUR'<br />
Indigènes musulmans. —<br />
D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
20 décembre<br />
Preuve<br />
1877."<br />
testimoniale. — Abus<br />
de confiance. — Dépôt,<br />
S'il est de principe en droit français que le dépôt volontaire, alors qu'il<br />
porte sur une somme de plus de cent cinquante francs, doit être prouvé par
écrit,<br />
•<br />
155<br />
il n'en est pas de même en Algérie en ce qui concerne les contrats inter<br />
venus entre indigènes musulmans ; en effet, le droit musulman autorise en<br />
pareille matière la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la<br />
somme déposée. En conséquence, la violation d'un dépôt dont l'existence aurait<br />
été prouvée ainsi par témoins, constitue, à l encontre du dépositaire infidèle, le<br />
délit prévu par l'art. 408 du Code pénal (1).<br />
Proc. gén. c. Bel Hassen.<br />
Attendu qu'il résulte de l'information et des débats, que le prévenu avait<br />
reçu eu dépôt depuis moins de trois ans, dans l'arrondissemenl d'Oran, une<br />
somme de quatre cent vingt-cinq francs, dont il a détourné deux cent<br />
soixante cinq francs au préjudice du déposant ; que s'il est de principe en<br />
droit français que le dépôt volontaire alors qu'il s'élève à une somme supé<br />
rieure à cent cinquante francs doit être prouvé par écrit, il en esl autrement<br />
en Algérie, quand le contrat, comme dans le cas particulier, a eu lieu<br />
d'indigène à indigène, le droit musulman autorisant en pareille matière la<br />
preuve testimoniale ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer de ce 'chef le juge<br />
ment, déféré; —<br />
Attendu<br />
que le fait ci-dessus visé, constitue le délit prévu<br />
et puni par les articles 408 el 406 du Code pénal.<br />
Par ces motifs : —<br />
Donne<br />
défaut contre le prévenu non comparant.<br />
Infirme le jugement dans la disposition relative à l'abus de confiance et<br />
condamne El-Hadj Ahmed bel Hassen à six mois vingt-<br />
d'emprisonnement et<br />
cinq francs d'amende, le condamne en outre aux dépens de première instance<br />
el d'appel.<br />
Algérie. —<br />
M. Fau, av. gén. ; M. Dumalle,<br />
cons. rapp.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
9 février 1878.<br />
.Cours d'eau réglementés. — Dégradation des ca<br />
naux et ouvrages assurant la dérivation et la répartition<br />
des eaux. — Compétence. — Contravention de grande voirie.<br />
En Algérie, bien qu'aucun cours d'eau ne soit classé adminislralivement<br />
comme navigable ou flottable, tous les cours d'eau rentrent sans distinction, aux<br />
termes de la loi de 1851 , dans le domaine public.<br />
En conséquence, lorsqu'un cours d'eau est réglementé par arrêté préfectoral<br />
(1) Ce principe incontestable, lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre indigènes<br />
musulmans, a déjà été consacré par la jurisprudence de la Cour d'Alger (23 dé<br />
cembre 1865. Robe, 1866, p. 46. V. Narbonne, Rép, V° Abus de confiance, 1 et<br />
Preuve testimoniale, 6).
156<br />
constituant les propriétaires et colons riverains en association de syndical, soit<br />
pour l'irrigation des terres, soil pour la mise<br />
le syndicat n'est chargé que comme usufruitier pour la société des irrigants,<br />
en'<br />
activité d'usines hydrauliques,<br />
des ouvrages servant à la dérivation, conduite et distribution des eaux, ouvrages<br />
dont l'Etat est le propriétaire .<br />
Il en résulte que les délits et contraventions consistant dans la dégradation<br />
desdils ouvrages, constituent des délits et contraventions de grande voirie de la<br />
compétence des Conseils de Préfecture, aux termes des art .<br />
4 de la loi du 28<br />
pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du 29 floréal an X, et punissable en verlu de<br />
l'ordonnance d'août 1669, modifiée par la loi du 23 mars 1842.<br />
En effet, cette compétence spéciale est fondée non sur le caractère de cours<br />
d'eau navigable ou flottable qui serait propre, au cours d'eau sur lequel l'en-<br />
'treprise aurait été commise, mais sur la nécessité qui existe pour l'Etat de<br />
conserver le domaine public libre de toute atteinte provenant de l'intérêt ou de<br />
la malignité privée.<br />
Il importe peu, du reste, que les dégradations des canaux ou des ouvrages<br />
qui assurent la dérivation et reparution des eaux réglementées, soient faites<br />
dans un but de détournement d'eau ou tout autre.<br />
Les contraventions, au contraire, qui ont trait à un simple détournement<br />
d'eau au détriment d'un ou plusieurs mais sans qu'il usagers, y ait eu dégrada-<br />
lion ou destruction des ouvrages, sont du ressort de la simple police.<br />
L'art. 6 de la loi du 10 juin 1854,<br />
se référant à la pénalité édictée dans les<br />
art. 456 et 457 du Code pénal pour réprimer la destruction totale ou partielle<br />
des conduits d'eau ou l'obstacle apporté volontairement au libre écoulement. des<br />
eaux, est spécial aux eaux provenant de drainage, et son application ne saurait<br />
s'étendre conséquemment à des canaux d'irrigation ou d'amenée d'eau aux<br />
usines réglementées .<br />
Proc. gén. c. Mohamed ben Diban.<br />
Attendu qu'il résulte des documents de la cause, notamment de deux<br />
procès-verbaux, l'un du garde des eaux du syndicat de Tlemcen en date du<br />
27 juillet 1877, l'aulre de la. gendarmerie du 3 août suivant, qu'une prise<br />
d'eau délictueuse a élé opérée le 27 juillet dernier dans un canal principal<br />
servant aux irrigations et aux usines du .syndicat de Tlemcen ; Qu'elle a eu<br />
lieu au moyen d'un trou de dix centimètres carrés pratiqué en amont du<br />
partileur à l'aide d'une barre de fer, dans une roche de tuf surmontée d'un<br />
mur et formant le canal précité ; Que ce trou versait l'eau à quelques mètres<br />
de là dans un canal d'irrigation où sont situés les jardins arrosables des fa<br />
milles Baba Ahmed el Bou Sultan, el divers moulins, nolammenl celui de<br />
Ahmed ben Amar, prenant ainsi leur force motrice dans les eaux d'un canal<br />
d'amenée faisant partie du syndicat ; Qu'enfin le prévenu Mohamed ben<br />
Diban,'<br />
gendre de Baba Ahmed, avait été vu, ce jour-là,<br />
cherchant à boucher<br />
le trou en apercevant Ahmed ben Amar, qui conslatail ce détournement<br />
—<br />
d'eau, la voie de fait et le chômage forcé de son usine ; Attendu que pour<br />
ce fait, Ahmed ben Diban fut cilé, à la requête du Procureur de la Répu<br />
blique, devant le Tribunal correctionnel de Tlemcen, par exploit du 6 août<br />
1877, pour avoir à répondre sur la prévention d'avoir, dans le- courant de<br />
juillet 1877, à El-Kala, canlon et de Tlemcen, détruit par-
157<br />
tiellemenl une conduite d'eau et apporté volontairement obstacle au libre<br />
écoulement des eaux, délit prévu par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1854<br />
— et réprimé par les articles '456 et 457 du Code pénal ; Que par jugement<br />
contradictoire du 24 août suivant, le Ministère public ayant requis comme en<br />
la citation, le Tribunal visant un arrêté du Préfet d'Oran sur le syndical des<br />
eaux d'arrosage de la commune de Tlemcen et ses additions en dale des 8<br />
décembre 1862, 7 mars 1865 et 29 .juin 1867, faisant application de l'article<br />
29 et considérant que le fait recherché constituait une contravention ou un<br />
délit pour dégradation des canaux ou ouvrages qui assurent la dérivation et<br />
la réparlition des eaux, contravention ou délit justiciable du Conseil de Pré<br />
fecture, comme en matière de grande voirie, se déclara —<br />
incompétent; Que<br />
par acte du 28 août ce jugement fut frappé d'appel par le Ministère public ;<br />
— Attendu que Mohamed ben Dihan, régulièrement cité sur cet appel par<br />
exploit du 28 septembre 1877 et pour l'audience du 8 novembre, n'ayant pas<br />
comparu, là Cour a prononcé défaut el renvoyé en délibéré pour le profit du<br />
défaut;<br />
Attendu que par les arrêtés organiques et réglementaires du Préfet d'Oran<br />
des 8 décembre 1862, 7 mars 1865 et 29 juin 18fj7, certains propriétaires el<br />
colons usagers des eaux dérivées de la Seffef du territoire de Tlemcen, soit<br />
pour l'irrigation des terres, soit pour, la mise en activité d'usines hydrau<br />
ont été constitués en association de syndicat sous la tutelle de l'auto<br />
liques,<br />
rité préfectorale ; Que par l'article 10, le syndicat est tenu d'enlreienir en<br />
bon état les canaux, bassins, aqueducs, vannes, panneaux, elc, en un mot<br />
tous les ouvrages servant à la dérivation,<br />
conduite et distribution des eaux<br />
dont il est chargé comme usufruitier pour la Sociélé des irrigants envers<br />
l'État, propriétaire desdits —<br />
ouvrages; Que d'après l'article 29, le détour<br />
nement d'eau au détriment d'un ou plusieurs usagers, donne lieu à des<br />
poursuites en simple police, indépendamment de l'action civile en dom-<br />
—Que mages-inlérêls; les délits et contraventions sont déférés aux tribunaux<br />
compétents, en conformité des lois du 26 floréal an X et 16 décembre 1807;<br />
— Que<br />
les contraventions ou délits qui auront pour résultat la dégradation<br />
des canaux ou des ouvrages qui assurent les dérivations et la répartition des<br />
eaux, doivent être jugés par le Conseil de Préfecture comme en matière<br />
— de grande voirie ; Attendu que les arrêtés émanant de l'autorité préfec<br />
torale compétente, pour la police elle règlement des cours d'eau (chapitre 6,<br />
loi du 20 août 1790; art. 16, titre u, loi du 6 octobre 1791), ne peuvent êlre<br />
attributifs, mais seulement indicatifs de juridiction, d'après les lois exis<br />
—<br />
tantes; Atlendu que pour ce qui concerne la distribution des eaux de la<br />
Seffef entre les irriganls et usiniers divers, les arrêtés précités du Préfet<br />
d'Oran constituent dès règlements dont l'infraction et la pénalité sont régies<br />
devant la juridiction de simple police par l'art. 471, n°<br />
— Mais<br />
15, du Code pénal;<br />
que pour les dégradations des canaux ou des ouvrages qui assurent<br />
la dérivation et répartition des eaux réglementées,<br />
que ces dégradations<br />
soient faites dans un but de détournement d'eau ou tout autre, il y a à re<br />
chercher si, comme sans .pouvoir l'énoncent, l'édicler en droit, les arrêlés<br />
précités, ces fails constituent des délits ou contraventions de grande voirie,<br />
et par suite entraînent la compétence des Conseils de Préfecture aux termes<br />
des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du 29 floréal
158<br />
—<br />
an X ; Attendu que ces lois qualifient délits ou contraventions de grande<br />
voirie, toutes espèces de détériorations commises sur les canaux, fleuves et<br />
rivières navigables, tous chemins de halage, francs oords, fossés et ouvrages<br />
d'art;<br />
— Que<br />
la pénalité pour ces contraventions se trouve édictée par l'art.<br />
42 de l'ordonnance d'août 1669, sur les eaux et forêts, portant : « Nul, soit<br />
» propriélaire ou engagisle, ne pourra faire moulins ou balardeaux, écluses,<br />
» gards, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fas-<br />
» cines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours d'eau dans<br />
>» les fleuves et rivières navigables et flottables,<br />
» traire; » — Attendu<br />
à peine d'amende arbi-<br />
que cette ordonnance est encore en vigueur aux<br />
termes d'une jurisprudence constante, par l'effet des lois des 19-22 juillet<br />
1791, article 29, litre Ier, sauf la modification pour la pénalité qui résulte de<br />
la loi du 23 mars convertissant 1842, l'amende arbitraire en un chiffre de<br />
16 fr. au minimum et 300 fr. au maximum;<br />
Attendu, ces faits étant posés,<br />
terminé et imputé au prévenu Mohamed ben Diban, constitue un délit ou<br />
une contravention passible des peines édictées par l'ordonnance de 1669,<br />
modifié par la loi de. 1842 précitée el relève de la juridiction du Conseil de<br />
Préfecture;<br />
— Attendu<br />
qu'il échet d'examiner si l'acte ci-dessus dé<br />
que s'il fallait ne considérer que la question de navi<br />
gabilité ou de flottabililé du cours d'eau la Seffef, d'où est dérivé le canal<br />
sur lequel porte le fait de détérioration impulé à Ben Diban, il est évident<br />
que la juridiction du Conseil de Préfecture serait incompétente, puisque la<br />
Seffef, pas plus que les autres cours d'eau ou fleuves en Algérie,<br />
ne sont<br />
adminislralivement classés comme navigables et flottables ; Mais qu'il y a lieu<br />
de replacer plus haut le principe de la compélenee exceptionnelle dont.<br />
—<br />
s'agit; Qu'en effet, si dans les délits ou entreprises sur les cours d'eau<br />
navigables ou flottables, il en esl qui ont pour résultat de nuire à la libre<br />
navigation, il en est d'autres dont le vrai caractère est l'atteinte à la pro<br />
priélé, à la conservaiion, à l'enlrelien d'une chose et de ses accessoires que<br />
la loi classe dans les dépendances du domaine public (art. 538 du Code<br />
civil), c'esl-à-dire servant à l'utilité de tous, sous le patronage et la régle<br />
— mentation de l'autorité administrative ; Attendu que la compétence spé<br />
ciale, en pareil cas, de la juridiction administrative, s'explique par la nécessité<br />
pour l'Élat de conserver ce domaine libre de toutes atteintes de l'intérêt ou<br />
de la malignité privée qui le rendraient impropre à l'utilité publique, la<br />
quelle se manifeste tant par l'irrigation et le fonctionnement des usines<br />
hydrauliques, que par la navigation proprement —<br />
dite; Que la navigabilité<br />
ou la floitabililé n'est pas à proprement parler le caractère déterminant de<br />
cette compétence, mais plutôt la classification du cours d'eau el de ses acces<br />
soires comme dépendant du domaine public;<br />
— Qu'en effet, bien qu'un<br />
cours d'eau soit navigable et flottable, il est admis en jurisprudence que ce<br />
sont les tribunaux ordinaires qui doivent connaître de toutes contraventions<br />
par lesquelles les intérêts particuliers et non publics sont compromis (Conseil<br />
d'Étal, 25 avril 1812, 12 avril 1812, 28 juillet 1819 et autres) ;<br />
— Que<br />
les<br />
tribunaux de simple police jugent les infractions aux intérêts qui n'ont<br />
pour objet que des mesures de salubrité publiques, quoiqu'applicables aux<br />
cours d'eau navigables et flottables (Cassation, 14 aoûl 1857); Mais, par<br />
contre, il est admis par la même autorité doctrinale, que si des entreprises
159<br />
sont commises sur des bras ou canaux de communication non navigables,<br />
mais délachés des rivières navigables ou flottables, la répression a lieu, non<br />
devant les tribunaux ordinaires, mais devant le Conseil de Préfecture (arrêts<br />
Conseil d'État, 27 avril 1825 et autres) ;<br />
Attendu que si le principe de la juridiction répressive administrative ré<br />
side, tant sur le fait de la propriété publique des cours d'eau dits navigables<br />
el flottables et des ouvrages y adhérents qui sonl l'œuvre de l'Éiat, que sur<br />
la nécessité de proléger plus efficacement ce domaine par l'appréciation mieux<br />
entendue des dommages résultanl des entreprises délictueuses sur ces cours<br />
d'eau, il est hors de doule qu'il doit régir en Algérie la répression des délits<br />
ou contraventions affectant l'intérêt public, et commis sur tous les cours<br />
d'eau, dont aucun n'est classé administrativement comme navigable ou flot<br />
—<br />
table; Qu'en effet, aux termes de la loi du 16 mai 1851, art. 2, sur la<br />
propriélé en Algérie, le domaine public se compose : 1° des canaux d'irriga<br />
tion et de dessèchement exécutés par l'État ou pour son compte dans un but<br />
d'utilité publique et des dépendances de ces canaux ; 2° des cours d'eau de<br />
toutes sortes et des sources, sauf les droits privés de propriété, usufruit ou<br />
— usage existant antérieurement; Que, de plus, divers arrêtés préfectoraux,<br />
constituant des syndicats en Algérie pour l'irrigation et la marche d'usines<br />
comprises dans certaines circonscriptions, concèdent aux syndicats,<br />
non la<br />
propriélé, mais seulement la jouissance de tous les ouvrages et canaux qui, à<br />
la date de l'arrêté, servent à divers intéressés, soi i irrigants, soit usiniers<br />
(arrêté du 13 décembre 1866, pour l'organisation du syndicat des eaux de<br />
l'oued Kebir à Blidah; arrêté du 24 août 1876, pour l'organisation du syn<br />
dicat de Berbessa, commurfe de Coléah) ;<br />
— Que<br />
particulièrement dans l'es<br />
pèce les arrêts du Préfet d'Oran précités des 8 décembre 1862,<br />
et 29 juin 1867 édictent (art. 10) que la mission du syndical,<br />
7 mais 1865<br />
composé d'usi<br />
niers el d'irriganls, est d'entretenir en bon état les canaux, bassins, aqueducs,<br />
vannes, ponceaux, etc., en un mot tous les ouvrages servant à la dérivation,<br />
conduite et distribution des eaux, « dont il est chargé comme usufruitier<br />
» pour la Sociélé des irrigants envers l'État,<br />
» vrages; »<br />
propriélaire desdits ou-<br />
Attendu que si toule entreprise délictueuse sur les cours d'eau de l'Algérie<br />
étant du domaine public sonl justiciables des Conseils de Préfecture, par<br />
application des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du<br />
29 floréal an X,<br />
ces mêmes entreprises sur les canaux d'irrigation ou d'ame<br />
née des eaux aux usines réglementées, lorsque ces travaux sont propriétés<br />
—<br />
de l'État, doivent être soumises à la même juridiction administrative ;<br />
Attendu que c'est sans fondement que devant les premiers juges, l'organe du<br />
Ministère public, retenant la compétence des tribunaux correc|jonnels, a<br />
invoqué l'appui de l'article 6 de la loi du 10 juin 1854, se référant à la péna<br />
— lité édictée dans les articles 456 et 457 du Code pénal ; Que la loi de 1854<br />
s'applique à des canaux de dérivation ou d'expulsion d'eau provenant du<br />
drainage,<br />
et nullement à des canaux d'irrigalion ou d'amenée d'eau aux<br />
usines réglementées, et qu'en matière pénale, il n'est pas permis de procéder<br />
par analogie ou assimilation ;<br />
Par tous ces motifs : Rejette comme non fondé l'appel du Procureur de la
160<br />
République de Tlemcen ; En conséquence, confirme le jugement attaqué<br />
pour être exécuté selon sa forme et teneur.<br />
M. Fau, av. gén. (concl. contr.) ; M. Sauzèue, cons. rapp.<br />
= .^ _—<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en dale du 30 avril 1878, ont été nommés :<br />
Procureur de la République près .<br />
le Tribunal de lre instance de Tizi-Ouzou<br />
(Algérie), M. Rack, Substitut du Procureur de la République près le siège<br />
d'Alger, en remplacement de M. Barbe, qui a été nommé Procureur de la<br />
République à Muret.<br />
Substitut du Procureur delà République près le Tribunal de lr« instance<br />
d'Alger, M. Létevez, Substitut du Procureur de la République près le siège<br />
d'Oran, en remplacement de M. Rack, qui est nommé Procureur de la<br />
République.<br />
Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de lr
Appel. —<br />
2e année. — Ier Juin 1878. —<br />
N° 35<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
Procédure<br />
. Présidence<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1« Ch.)<br />
de M. PERINNE, conseiller.<br />
d'ordre. —<br />
24 décembre 1877.<br />
Nullité.<br />
facultatives.<br />
LÉGISLATION<br />
— Algérie, — Nullité»<br />
Dans une procédure d'ordre, la notification d'appel faite à l'avoué du der<br />
nier créancier colloque, suffit à remplacer celle que l'appelant aurait dû faire<br />
au créancier qui a élevé une contestation personnelle contre lui sur la priorité<br />
de collocation.<br />
En effet, l'avoué du dernier créancier colloque représente la masse des créan<br />
ciers postérieurs en ordre à celui dont la créance esl contestée, et conséquem<br />
ment il a qualité pour défendre en leur nom à Vencontre de cet appel (l).<br />
Il doit être jugé ainsi, notamment si les créanciers contestants ont élé, bien<br />
qu'en dehors des délais d'appel, personnellement mis en cause et conséquemment<br />
utilement appelés à se défendre.<br />
En admettant, au surplus, que l'appel ainsi interjeté soit nul, cette nullité<br />
est de pure forme et conséquemment il appartient aux juges algériens de n'en<br />
point faire état aux termes de l'art . 46<br />
de l'ord . du 1 6 avril 1 843 (2) .<br />
Époux Rivière c. Mahieu et autres.<br />
Attendu que Doreau, pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers<br />
a imaginé de mettre son domaine de Medjebar sous le nom de la<br />
légitimes,<br />
dame Rivière au moyen d'une vente fictive ;<br />
— Que<br />
la dame Rivière s'est<br />
(1) Les circonstances particulières de la cause, et notamment la confusion dans<br />
laquelle semble, aux termes de l'arrêt, être tombé l'officier ministériel qui a engagé<br />
la procédure d'appel, ont évidemment exercé une certaine influence sur l'esprit de<br />
la Cour dans cette décision qui ne paraît pas en harmonie parfaite avec les termes<br />
des art. 762 et 763 du Code de proc. civ. et qui est on contradiction absolue avec<br />
un arrêt de Cass. du 7 mai 1823*(Dalloz, V» Ordre, n»<br />
954, 1°).<br />
(2) Voir, relativement aux Nullités facultatives, le Rép. de Narbonne, et le Bull.<br />
jud. p. 1877, 97.
162<br />
associée à cetle fraude, et qu'il en est résulté pour elle- la perte de la presque<br />
— totalité de sa fortune ; Attendu qu'à la suite d'actes innombrables el de<br />
machinations Doreau a fait<br />
frais énormes entraînés par .ces<br />
frauduleuses,<br />
assigner la dame Rivière pour voir dire qu'il avait toujours été le proprié<br />
taire réel de Medjebar et que ladite dame Rivière n'avait jamais été que son<br />
— prête-nom ; Attendu qu'un arrêt du 23 mars 1873 a souverainement réglé<br />
— la position respective des deux parties ; Qu'aux termes de cet arrêt, d'une<br />
part, le sieur Doreau a été reconnu le propriétaire de Medjebar et, d'autre<br />
part, qu'il a été accordé à la dame Rivière un droit de rétention pour le<br />
cet arrêt est esssentiellement indivi<br />
— recouvrement de ses avances ; Que<br />
sible, qu'il n'appartient pas aux créanciers de Doreau de se servir de la pre<br />
mière partie dudit arrêl et de rejeter la seconde ; et que s'ils ont eu le droil<br />
de faire vendre le domaine de Medjebar comme étant la propriété de Doreau,<br />
leur débiteur, ils ne peuvent en toucher le prix qu'après le paiement à<br />
—<br />
la dame Rivière des sommes à elle assurées par son droit de rétention ;<br />
Attendu que le domaine de Medjebar a été vendu sur leur saisie pour la<br />
somme de deux cent cinquante mille francs, mais que celte somme doit reve<br />
nir d'abord aux créanciers de la dame Rivière, et ensuite à la dame Rivière<br />
elle-même, jusqu'à concurrence du montant des avances par elle faites pour<br />
l'acquisition fictive de ce domaine, soil au moyen de deniers d'emprunt,<br />
soit au moyen de ses denjers personnels ;<br />
Attendu que dans l'ordre ouvert pour la distribution de ce prix, et par<br />
suite du jugement sur contredit, les créanciers privilégiés et les créanciers<br />
de la dame Rivière, savoir : 1° Holmes ; 2° Alcay ; 3° Almaric, en sa qualité<br />
de créancier de ladite dame, mais non en sa qualité de créancier de Doreau ;<br />
4° Mascioni ; 5° Mahieu et 6° Didier onl été colloques en première ligne ;<br />
Que la dame Rivière n'a jamais contesté et ne conteste pas leur collocation ;<br />
:— Qu'elle<br />
a même consenti à un règlement définitif à leur profit, et que<br />
plusieurs d'entre eux sont déjà payés ;<br />
— Mais<br />
que ces collocations ont ab<br />
sorbé la presque totalité du prix et que la partie du prix restant libre s'élève<br />
— à moins de trente mille francs ; Attendu que la collocation sur ce reste de<br />
prix est le seul objet du procès entre la dame Rivière et les créanciers de<br />
Doreau ;<br />
— Atlendu<br />
que dans ces circonstances, la dame Rivière ne réclame<br />
point la totalité de ses créances; qu'elle n'a aucun intérêt à en faire liqui<br />
der le montant total et qu'elle se borne à invoquer un titre de créance<br />
authentique de cinquante mille francs ;<br />
— Attendu<br />
—<br />
que foi est due à l'acte<br />
authentique jusqu'à preuve légale du contraire ; que rien n'établit que cette<br />
créance soit fictive ; et qu'il esl au contraire constant en fait que la créance<br />
totale de la^dame Rivière dépasse de beaucoup ladite somme de cinquante<br />
mille francs;— Attendu que ladite créance de cinquante mille francs est<br />
formellement garantie à la dame Rivière sur le solde du prix du domaine de<br />
Medjebar par le droit de rétention reconnu à son profit par l'arrêt du 23<br />
mars 1873;<br />
— Attendu que le jugement sur contredit ayant rejeté la<br />
demande en collocation de la dame Rivière sur le solde du prix de Medjebar,<br />
la dame Rivière a, à bon droit, interjeté appel dudit jugement ;<br />
Attendu que les créanciers de Doreau arguent de nullité l'acte d'appel de<br />
la dame Rivière, et que telle est en réalité la seule difficulté du procès —<br />
;<br />
Attendu que le jugement sur contredit a été —<br />
signifié le 3 mars 1877 ;
163<br />
Attendu que la dame- Rivière en a interjeté un double appel, l'un en date du<br />
— Attendu que<br />
12 mars 1877 et l'autre en date du 17 novembre suivant;<br />
par l'exploit d'appel du 12 mars, l'officier ministériel qui a rédigé cet acte et<br />
qui en a l'entière responsabilité, a intimé devant la Cour : 1" Holmes ;<br />
2" 3°<br />
Alcay; Almaric; 4" Mascioni; 5° Mahieu 6°<br />
; Didier 7° M«<br />
; Jacquel,<br />
pris comme défenseur du créancier dernier colloque, et 8° le sieur Doreau,<br />
—<br />
partie saisie ; Attendu que si l'on comprend jusqu'à un certain point<br />
l'inlimalion d'<br />
Almaric parce qu'il est non-seulement créancier de la dame<br />
Rivière, mais encore créancier de Doreau, rien ne justifie l'appel contre<br />
Holmes, Alcay, Mascioni, Mahieu et Didier, puisque la dame Rivière ne<br />
conteste pas et n'a jamais contesté leur collocation ; Que ceux-ci ne contes<br />
tent pas la sienne el qu'ils —<br />
sont absolument désintéressés dans le débat ;<br />
Attendu qu'au lieu de faire les frais de cette intimation inutile, on aurait dû<br />
intimer : 1° les consorts Peyron et 2° les consorts Fagard qui avaient con<br />
testé en première instance la collocation de la dame Rivière;<br />
Attendu, toutefois, que Fagard et les consorts Peyron sont créanciers de<br />
Doreau et compris dans la masse des créanciers postérieurs en ordre à la<br />
— Que la masse de ces créanciers était légalement repré<br />
dame Rivière ;<br />
sentée par Me Jacquel. défenseur du créancier dernier colloque;<br />
l'appel a été relevé contre M" — Jacquel en sadite qualité ; Que ledit appel<br />
— Que<br />
a élé régulièrement dénoncé au greffier du tribunal par exploit du 14 mars<br />
— 1877 ; Que le sieur Fagard et les consorts Peyron ont, en outre, été person<br />
nellement mis en cause et utilement appelés à se défendre par l'acte d'appel<br />
du 17 novembre dernier;— Qu'il s'agit d'ailleurs d'une nullité de pure<br />
forme et que dans les circonstances de la cause il conviendrait de faire en<br />
tant que de besoin application de l'art. 46 de l'ordonnanee du f6 avril 1843.<br />
Par ces motifs : Réformant le jugement dont appel, donne défaut contre<br />
Me Jacquel, ès-noms qu'il agit et contre le sieur Doreau ; Met hors de Cour<br />
les sieurs Holmes, Alcay, Almaric, en leur qualité de créanciers, Rivière,<br />
Mascioni, Mahieu et Didier ; Déclare la dame Rivière recevable en son appel<br />
contre toutes les autres parties; Ordonne que le règlement provisoire sera<br />
réformé en ce sens que le prix restant libre, après le paiement des créan<br />
ciers Rivière, sera attribué à la dame Rivière par imputation sur la créance<br />
de cinquante mille francs et par préférence aux créanciers Doreau. Et con<br />
damne Me Jacquel, ès-'noms qu'il agit, en tous les dépens qu'il est autorisé à<br />
prélever par préférence à la dame Rivière sur ce qui reste des deniers à dis<br />
tribuer.<br />
M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet, Dazinièbe et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lCh.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
■<br />
12 février 1878.<br />
premier président.<br />
Indigène» musulmans, — Litige déféré à la juridiction Iran-
çaise. — Incompétence<br />
164<br />
du tribunal de lre instance. —<br />
Difficulté sur exécution d'arrêt.<br />
bunal.<br />
— Incompétence du tri<br />
/. Lorsqu'une contestation s'élève entre relativement musulmans, à un con<br />
trat,<br />
dont une clause porte que les parties déclarent se soumettre pour son<br />
exécution à la juridiction française, c'est le juge de paix, jugeant en matière<br />
civile et musulmane qui peut seul connaître du litige,<br />
décret du 31 décembre 1866 (1).<br />
en vertu de l'art .<br />
2 du<br />
C'est donc à tort que contrairement au dêclinatoire opposé, le tribunal civil<br />
s'est déclaré compétent.<br />
II. La contestation née entre parties, en suite d'un arrêt préparatoire ordon<br />
nant une expertise, du refus de l'une d'elles de communiquer, dans des formes<br />
exigées par la partie adverse, les pièces nécessaires pour suivre les opérations<br />
de l'expertise, constitue une difficulté d'exécution de l'arrêt.<br />
C'est donc à tort qu'en cet état, considérant l'action engagée comme princi<br />
pale et directe, le tribunal civil s'est déclaré compétent ;<br />
il n'aurait pu que<br />
statuer provisoirement en cas d'urgence, à l'état de référé, si les parties<br />
l'avaient requis (art . 554)<br />
, la Cour étant seule compétente au fond .<br />
Hamouoa ben Cheik El-Islam c. Bou Reker ben El-Lifgoun.<br />
Attendu que Bou Beker a assigné Si Hamouda devant le tribunal civil de<br />
Constantine à l'effet d'obtenir communication de litres de propriélé relatifs<br />
aux biens, objet du partage ;<br />
— Que<br />
le demandeur avait introduit son action<br />
aux termes de laquelle les<br />
en se fondant sur une clause de l'acte de partage,<br />
parties avaient déclaré se soumettre, pour l'exécution, à la juridiction fran<br />
que les premiers juges, qualifiant l'aclion de Bou Beker de<br />
— çaise ; Atlendu<br />
directe et de principale, visant spécialement la clause précitée de l'acte de<br />
partage, ont, malgré le dêclinatoire proposé par si Hamouda, déclaré leur<br />
—<br />
compétence et statué au fond. Attendu qu'en envisageant l'action à ce<br />
point de vue, la décision du tribunal de Constantine devrail être réformée<br />
parce qu'elle est contraire aux dispositions précises d3s articles 1 et 2 du<br />
décret organique du 13 décembre 1866 sur la justice musulmane ;<br />
effet,<br />
— Qu'en<br />
pour le cas où des musulmans contraclenl sous l'empire de la loi<br />
française, la justice française est, il est vrai, compétente, mais que pour des<br />
raisons de célérité et d'économie, la juridiction du juge de paix esl alors<br />
substituée au premier degré à celle du cadi ;<br />
— Que, sous ce rapport donc,<br />
le tribunal civil de Constantine était incompétent ;<br />
— Attendu que dans<br />
l'espèce, l'action de Bou Beker peut êlre considérée sous un autre aspect ;<br />
—<br />
Qu'intentée après l'arrêt interlocutoire du 4 avril 1877, qui avait ordonné<br />
une expertise, motivée par cette experlise même, destinée à renseigner furie<br />
(1) V. Jurisp. conf. Alger, 6 janv. 1877 (3= Ch.). Bull. jud. 1877, p. 90 et 24<br />
nov. 1877 (2°<br />
p. 60.<br />
Ch.). Bull. jud. 1878,<br />
Dans ces différents arrêts, la Cour avait d'office relevé l'exception d'incompé<br />
tence qui n'avait été indiquée ni dans les conclusions ni dans les plaidoiries.
165<br />
des parties sur la valeur et la consistance des biens à expertiser, cette action<br />
se rattachait par un lien d'étroite connexité à l'instance pendante devant la<br />
Cour;<br />
— Qu'elle constiluait en réalité une difficulté d'exéculion de l'arrêt<br />
— lui-même ; Qu'à ce nouveau poinfde vue le tribunal de Constantine élait<br />
encore incompétent, et qu'il eût pu seulement, en cas d'urgence, statuer<br />
provisoirement, à-l'état de référé, si les parties l'avaient spécialement requis ;<br />
— Mais qu'il ne lui appartenail pas, dans cet ordre d'idées, de se saisir<br />
— principalement en empiélant sur la juridiction de la Cour ; Que par suite,<br />
de quelque manière qu'on envisage la question, le tribunal de Constantine<br />
étail incompétent et que son jugement doit être infirmé du chef de la com<br />
— pétence ; Mais attendu que la cause est prête à recevoir une décision<br />
définitive et que les parties ont conclu au fond ; que c'esl le cas pour la Cour<br />
d'évoquer;<br />
— Attendu<br />
que la difficulté qui divise les parties conslitue vrai<br />
—<br />
ment une difficulté d'exéculion née à l'occasion de l'arrêt du 4 avril 1877 ;<br />
Que la réclamation de Bou Beker, juste et fondée en soi, est, en outre, jus<br />
— tifiée par une clause formelle de l'acte de partage ; Que la communication<br />
demandée doit être ordonnée dans les formes de droit, c'est-à-dire par la<br />
voie du greffe.<br />
Par ces motifs : LA COUR, reçoit l'appel et y slatuant. Infirme le jugement<br />
déféré ; Dit que le Iribunal de lie instance de Constanline élait incompétent ;<br />
l'annule de ce chef. Évoquant et statuant au fond : Déclare Bou Beker, fondé<br />
dans sa demande. Ordonne, en conséquence, que dans la quinzaine qui<br />
suivra la prononciation du présent arrêt, Si Hamouda sera tenu, sous une<br />
contrainte de 25 francs par chaque jour de retard, de déposer au greffe du<br />
tribunal de Constantine lous les titres de propriété relatifs aux immeubles,<br />
objet du partage, pour être pris communication desdits titres par Bou Beker.<br />
Dit qu'un mois après la signification de l'arrêt et faute par Si Hamouda<br />
d'avoir opéré ce dépôt, il sera fait droit à la demande de Bou Beker. Con<br />
damne Si Hamouda eo tous les dépens de première instance et d'appel.<br />
M. Piette, av. gén. ; Mes Jouyne et Dazinièbe, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
Serment lïtis-décîsoîre. —<br />
25 février 1878.<br />
Acte<br />
authentique,<br />
Capacité pour déférer le serment. — Ordre.<br />
— Nullité. — Motifs nouveaux.<br />
— Syndic.<br />
—<br />
— Contredit.<br />
Si un acte authentique fait pleine foi, jusqu'à inscription de faux,<br />
réalité extérieure des faits constatés par le notaire comme<br />
s'<br />
de la<br />
étant passés en sa<br />
présence, la même force probante ne saurait s'attacher à la sincérité des faits<br />
juridiques que le notaire n'a pu certifier par son attestation personnelle.
166<br />
En conséquence, la preuve contraire, et par suite,<br />
la délation du serment<br />
Utis-décisoire sont toujours admissibles dans cette mesure pour établir une<br />
simulation frauduleuse (1).<br />
Le serment Utis-décisoire a le caractère d'une véritable transaction mettant<br />
fin au litige ; pour pouvoir déférer ce sermeut il faut donc avoir la capacité,<br />
de transiger ; il en résulte que le syndic d'une faillite ne peut être admis à<br />
faire une semblable délation qu'à la condition de suivre au préalable la procé<br />
dure indiquée par l'art . 487<br />
du Code de comm . pour les transactions inté<br />
ressant la masse, et faute par le syndic de s'être pourvu des autorisations<br />
nécessaires, la délation du serment n'est pas recevable . (2)<br />
L'obligation de motiver les contredits, en matière d'ordre, n'est pas imposée<br />
par l'art. 758 du Code de proc. civ., à peine de nullité (3).<br />
A plus forte raison ne saurait-on rencontrer de déchéance dans ce fait que<br />
des conclusions subsidiaires auraient apporté, à l'appui d'un contredit, des<br />
motifs plus spéciaux qui n'auraient pas été mentionnés dans ce contredit : et il<br />
en doit être particulièrement ainsi lorsque ces motifs plus spéciaux auront<br />
été appelés par la réduction de la demande originaire,<br />
d'une manière plus précise à tels ou tels immeubles déterminés.<br />
Syndics Bussidan c. Coll.<br />
en vue de l'appliquer<br />
Attendu que les syndics de la faillite Bussidan défèrent au sieur Coll, le<br />
— serment litis-décisoire; Que vainement le sieur Coll, pour repousser la<br />
délation du serment, se prévaut de la foi due à l'acte authentique consta<br />
— tant sa créance; Qu'en effet, si l'acte authentique fait pleine foi, jusqu'à<br />
inscription de faux, de la réalité extérieure des faits constatés par le notaire,<br />
comme s'étant passés en sa présence, la même force probante ne saurait s'at<br />
tacher à la réalité intrinsèque, à la sincérité des faits juridiques que le no<br />
— taire n'a pu certifier par son attestation personnelle ; Que dans cette<br />
mesure, la preuve contraire et, par suite, la délation du serment litis-déci<br />
soire, sont toujours admissibles pour établir une simulation frauduleuse ;<br />
Mais attendu que le sieur Coll élève contre la délation du serment une<br />
autre objection qui mérite un examen plus attentif ; Qu'il fait remarquer que<br />
les syndics", pourvus de l'autorisation du juge-commissaire, ne sont pas suffi<br />
samment habilités à déférer le serment,<br />
qu'ils eussent dû préalablement<br />
remplir les formalités prescrites par l'article 487 du Code de commerce ;<br />
Attendu que le serment litis-décisoire, analysé dans sa nature et dans ses<br />
effets, est une véritable transaction, destinée à mettre fin au litige, d'aulant<br />
(1) Jurisp. conf. Cass. 9 août 1852 (D. 1853, 1, 155), Cass. 22 nov. 1869 (D. 1870,<br />
1, 273).<br />
(2) Jurisp conf. Paris, 17 fév. 1844 (D. V» Faillite, 524). Rennes, 9 mai 1858-<br />
(J. du Pal. 1859, p. 146). Dallo7, V- Obligations n 5228 et 5229.<br />
(3) Jurisp. conf. Grenoble, 10 mars 1848 (D. 1849, 2, 34). Besancon,<br />
—<br />
7 févr.<br />
1863 (D. 1863, 2, 130). Aix, 20 déc. 1871 (D. 1873, 2, 96). Cass. 27 mai 1872<br />
(D. 1873, 1, 160), Paris, 7 juillet 1874 (D. 1876, 2, 65).
167<br />
plus grave qu'elle est en quelque sorte forcée, puisqu'elle ne laisse, à la<br />
partie à qui elle esl offerte, d'autre alternative que de prêter le serment où<br />
de le référer, sous — peine de perdre son procès; Que déjà, sous l'empire de<br />
la législation romaine, le jurisconsulte Paul avait proclamé ce principe en<br />
— Que les rédacteurs<br />
ces termes : jusjurandum speciem transactions continet ;<br />
du Code civil, s'inspirant à la même source, suivant en cela Pothier, leur<br />
guide habituel, ont consacré la même règle, qui esl aujourd'hui enseignée<br />
— presque unanimement par tous les auteurs ; Que c'esl donc une question<br />
de capacité, et que si la délation du serment constitue une transaction, il est<br />
conséquent de dire que, pour déférer le serment, il faut avoir la capacité de<br />
— transiger ; Qu'en ce qui concerne le mineur, par exemple, la doctrine<br />
s'accorde à reconnaître que le tuteur ne pourra déférer le serment qu'après<br />
avoir rempli à la lettre les formalités prescrites par l'article 467 du Code<br />
civil ;<br />
— Qu'à<br />
l'égard des syndics, la solulion doit êlre la même et que, pour<br />
transiger sous la forme du serment litis-décisoire, ils doivent, au préalable,<br />
suivre la procédure indiquée par l'article 487 du Code de commerce pour<br />
— les transactions inléressant la masse ; Qu'il n'y a pas place pour un sys<br />
tème intermédiaire, qui se contenterait de la seule autorisation du juge-<br />
commissaire, puisque cette opinion,<br />
n'observerait pas, ne reposerait alors sur aucun texte ; — Qu'il<br />
en s'écarlant de l'article 487 qu'elle<br />
faut, en celte<br />
matière, appliquer rigoureusement les principes, car, à défaut de capacité<br />
chez les syndics, le serment ne lierait personne, n'aurait aucune force déci-<br />
soire et les créanciers conservant le droit de former tierce opposition, la<br />
—<br />
contestation qu'on voulait éteindre pourrait renaître ; Atlendu, dès lors,<br />
que, faute par les syndics de s'être pourvus des autorisations nécessaires, la<br />
délation du serment n'est pas. recevable ;<br />
Atlendu que, par leurs conclusions subsidiaires, les syndics demandent<br />
que la collocation du sieur Coll soil restreinte à la distribution du prix des<br />
trois immeubles compris dans l'inscription du 6 juin 1872 ;<br />
— Que le sieur<br />
Coll, oppose que c'esl là une demande nouvelle, tout au moins un moyen<br />
nouveau qui n'a pas été indiqué dans le contredit; Que l'une et l'autre sont<br />
non recevables aux termes des dispositions précises de l'article 758 du Code<br />
de procédure civile ;<br />
— Attendu qu'il importe de constater que, dans leur<br />
contredit du 12 juin 1877, les syndics avaient contesté en bloc la collocation<br />
de 76,000 fr. attribués à Coll sur les prix en distribution des cinq immeubles<br />
adjugés et que leur contredit était uniquement fondé sur l'article 446 du<br />
Code de commerce ;<br />
—<br />
Qu'aujourd'hui, les syndics s'attaquent encore à la<br />
même collocation qu'ils contestent pour partie après l'avoir contestée pour<br />
— le lout; Que c'est donc là, non une demande nouvelle, mais la même<br />
— demande réduite ; Qu'à la vérilé, les conclusions subsidiaires sont aujour<br />
d'hui justifiées par un motif plus spécial qui n'a pas été consigné dans le<br />
—<br />
contredit du 13 juin 1877; Qu'il échet, dès lors, de rechercher si cette<br />
*-<br />
omission doit entraîner déchéance ; Attendu que les déchéances et fins de<br />
non-recevoir sont de droil étroit et ne peuvent résulter que d'une disposition<br />
— formelle de la loi ; Que, sans doute, la loi du 21 mai 1858 a prescrit de<br />
motiver les contredits, afin que le procès-verbal du juge-commissaire fût<br />
—<br />
comme le résumé entier et fidèle des contestations ; Que la loi cependant<br />
—<br />
n'a pas interdit de réparer une erreur ou de compléter une défense ; Que
168<br />
l'article 758 ne contient pas cette exclusion et que, loin de là, il présente<br />
le premier,<br />
— dans sa rédaction un contraste frappant avec l'article 762 ; Que<br />
en effet, ordonne de motiver les dires et, pour le cas d'infraction, garde le<br />
silence; que le second prescrit que l'acte d'appel énonce les griefs et, à<br />
défaut de celte énoncialion, en déclare formellement la nullité -<br />
; Que cette<br />
interprétalion, déjà fondée sur les texles, est officiellement indiquée par un<br />
passage topique du rapport où il est dit que l'obligation de motiver les<br />
— contredits n'est pas imposée à peine de nullité ; Qu'il n'est.pas inutile de<br />
constater d'ailleurs que, dans l'espèce, le contredit était motivé, complète<br />
ment motivé, et que c'est la réduction de la demande originaire qui a appelé<br />
— un motif particulier et plus spécial ; Atlendu que les conclusions subsi<br />
diaires des syndics, recevables en la forme, sont justifiées au fond —<br />
; Qu'en<br />
effet l'inscription du 6 juin 1872 n'a frappé que trois des immeubles dont<br />
les prix sont mis en distribution ;<br />
Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel et y statuant, dit que les syndics,<br />
faute de s'être pourvus des autorisations nécessaires, sont non recevables à<br />
déférer le serment litis-décisoire ; confirme en conséquence le jugement,<br />
— Infirme au contraire,<br />
quant au chef qui a repoussé la délation du serment ;<br />
— quant aux conclusions subsidiaires ; Dit que l'inscription du 6 juin 1872<br />
n'ayant frappé que la maison sise rue Française, la maison sise rue de l'Ar<br />
tillerie, la propriété rurale, le sieur Coll ne devra être colloque au rang de<br />
son hypothèque que sur les prix de vente de ces trois immeubles ;<br />
Ordonne que le règlement provisoire sera rectifié conformément au* pres<br />
criptions du présent arrêt : — Et<br />
tivement sur plusieurs chefs, etc.<br />
attendu que les parties succombent respec<br />
M. Piette, av. gén. (concl. conf.) ; Mes Bouriaud et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, président.<br />
22, décembre 1877.<br />
Faillite. — Droit du créancier. — Action<br />
honoraires des syndics. —■ Concordat<br />
—<br />
en réduction des<br />
par abandon d'actif.<br />
— Ses effets. — Pouvoirs des syndics, — Fixation de leurs<br />
honoraires.<br />
Tout créancier a intérêt et qualité, pour, sous sa responsabilité et à ses frais,<br />
provoquer les mesures et intenter les actions qui lui paraissent utiles aux inté<br />
rêts de la masse, chaque fois que la loi ne les a pas prohibées par une disposi<br />
tion spéciale.<br />
Le créancier qui soulève, devant le tribunal de commerce, une action en
169<br />
réduction des honoraires d'un syndic, formule ainsi une action contradictoire,<br />
et non une opposition à une décision par défaut.<br />
Il résulte de la combinaison des art. 541, 532 et 534 du Code de comm. ,<br />
qu'au cas de concordat par abandon d'actif, les syndics sont chargés de la<br />
liquidation de l'actif, en tant que syndics, sous la surveillance du juge-commis<br />
saire, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes limites qu'au cas d'union .<br />
La disposition de l'art 541 qui dit que le concordai par abandon produit les<br />
mêmes effets que les autres concordats, ne vise que la personne et la capacité du<br />
failli, et ne peut évidemment pas s'appliquer à l'actif de la faillite.<br />
Il importe que la rémunération du syndic soit fixée, après la reddition de<br />
son compte devant le juge-commissaire, et bien que ce compte soit ultérieure<br />
ment contesté, puisque celte rémunération forme un article important de l'avoir<br />
du syndic et par conséquent un des éléments mêmes du compte dont il s'agit,<br />
lequel doit être soumis entier à lajustice pour être définitivement arrêté.<br />
Famin c. veuve Rémy.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Sur la recevabilité de l'opposition de la veuve Rémy au juge<br />
Considérant,<br />
—<br />
ment du 2 mai 1877 ; adoptant les motifs des premiers juges ;<br />
en outre, qu'en supposant contradicloire ce jugement du 2 mai, frappé d'op<br />
position devant les premiers juges, les questions qu'il soulève seraient actuel<br />
lement déférées valablement à la Cour, puisque la veuve Rémy en a interjeté<br />
— appel ; Sur la recevabilité de Famin à agir en réduction des honoraires du<br />
— Considérant que tout créancier a intérêt et qualité pour provo<br />
syndic;<br />
quer, sous sa responsabilité personnelle el à ses frais, les mesures qui lui<br />
paraissent utiles aux intérêts de la masse; Qu'il en est surtout ainsi,<br />
lorsque, comme dans l'espèce, les intérêts du syndic sont en opposition avec<br />
ceux des créanciers ; Que ces actions paniculières d'un créancier peuvent<br />
être intentées chaque fois que la loi ne les a pas piohibêes par une disposition<br />
spéciale ; Qu'elles n'ont pas pour effet, au cours de la faillite, de rompre la<br />
centralisation des forces de la faillite enlre les mains du syndic, puisque leur<br />
succès aurail seulement pour effet d'augmenter les valeurs disponibles dont<br />
le syndic reste toujours détenteur tant qu'il est en fonctions ; Que si l'action<br />
particulière d'un créancier est recevable, c'esl surtout lorsque, comme dans<br />
l'espèce, il s'agit de critiquer les honoraires d'un syndic dont la mission est<br />
— terminée ; Considérant que le créancier ayant qualité est recevable à for<br />
muler devant le tribunal de commerce une action contradictoire ; Qu'en vain<br />
il donne à celle action le nom d'opposition ; Qu'elle n'a évidemment rien de<br />
commun avec l'opposition formée à une décision par défaut; Qu'une telle<br />
action n'est au fond qu'un mode spécial de tierce opposition au jugement<br />
intervenu sur requête et en dehors du créancier qui vient à contredire<br />
ultérieurement ; Qu'il résulte de nombreux textes du Code de commerce que<br />
la loi n'a pas entendu assujettir, en matière de faillite, le recours des créan<br />
—<br />
ciers aux formalités spéciales édictées au chapitre de la tierce opposition ;<br />
Considérant que l'article 462 du Code de commerce esl applicable aux con-
170<br />
cordais par abandon d'actif; Qu'il résulte de la combinaison des articles 541,<br />
532 et 534, qu'au cas de concordat par abandon, les syndics.sont chargés de<br />
la liquidation de l'actif, en tant que syndics, sous la surveillance du juge-<br />
commissaire, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites qu'au cas d'union ;<br />
— Que si l'article 541 du Code de commerce dit que le concordat par aban<br />
don produit les mêmes effets que les autres concordats, cette disposition ne<br />
vise que la personne du failli et la capacité qui lui est restituée; Qu'elle ne<br />
peut évidemment s'appliquer à l'actif qui n'est pas remis au failli après un<br />
concordat par abandon, comme après un concordat ordinaire;<br />
—<br />
Qu'ainsi,<br />
c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action de Famin non rece<br />
vable.<br />
Au fond : Considérant que si, en droit,<br />
est applicable, ses dispositions ont, en fait, été respectées; Que la rémunéra<br />
l'article 462 du Code de commerce<br />
tion du syndic n'a été fixée qu'après qu'il avait rendu son compte devant le<br />
juge-commissaire ; Que la loi n'exige pas davantage et qu'il importe peu que<br />
ce compte ait été ultérieurement contesté par Famin ; Que s'il en était autre<br />
ment, les syndics seraient absolument à la discrétion d'un contestant de<br />
mauvaise foi ; Qu'il était même nécessaire que la rémunération du syndic<br />
fût fixée avant que le compte contesté du syndic ne fût définitivement arrêté<br />
en justice, puisque la rémunération accordée forme un article important de<br />
l'avoir du syndic et par conséquent un des élémenls même du compte dont<br />
— s'agit ; Sur les conséquences particulières produites par la mort du syndic ;<br />
— Adoptant les molifs des premiers juges.<br />
Par ces motifs : Émende le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré<br />
l'action de Famin non recevable. Le confirme en ce qu'il l'a déclarée mal<br />
—<br />
fondée. Le confirme également dans ses dispositions et condamnations;<br />
Déclare les parties non recevables et mal fondées dans le surplus de leurs<br />
conclusions. Condamne Famin à l'amende et aux dépens.<br />
M. de Yaulx, subst. du Proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
23 novembre 1877.<br />
Faux serment. — Serment supplétoire. — Chose<br />
duction de pièce nouvelle.<br />
jugée. — Pro<br />
Lorsque dans une instance commerciale, à la suite d'une enquête, le'<br />
serment<br />
supplétoire a été déféré à l'une des parties, et prêtépar elle, elle peut être pour.<br />
suivie pour faux serment, s'il résulte d'un document resté ignoré des premiers<br />
juges,<br />
certains éléments de conviction de nature à faire croire à la fausseté de<br />
'
171<br />
ce serment, encore bien que le fait constaté par le document produit, ait été,<br />
lors de l'enquête, attesté formellement, sbus la foi du serment, par la personne<br />
dont il émane.<br />
On ne saurait prétendre, en effet, que les premiers juges saisis de la contes<br />
tation commerciale, aient souverainement apprécié la portée de ce fait : car un<br />
témoignage ne pouvant avoir l'autorité d'un écrit au point de vue de l'im<br />
pression produite sur la conviction du juge .<br />
Le prévenu est donc mal fondé, dans ces conditions, à invoquer l'autorité de<br />
la chose jugée à Vencontre de la poursuite dont il est l'objet.<br />
Procureur général c. Grange.<br />
Attendu en fait, que par exploit du 31 octobre 1873, Tixier a assigné<br />
Grange devant le Tribunal de commerce de Constantine, en paiement de<br />
11,959 francs, comprenant diverses sommes, mais principalement celle de<br />
11,509 francs, montant des bénéfices réalisés dans l'exploitation des coupes<br />
de bois dépendant des anciennes coupes de feu Prudhomme, vendues à la<br />
criée par M» Champroux, notaire, exploitation pour laquelle une association<br />
en participation aurait été formée entre Grange et lui ;—<br />
Attendu,<br />
que par<br />
jugement du 5 décembre de la même année, le Tribunal a admis Tixier à faire<br />
— la preuve de cette association ; Qu'après enquête et contre-enquête, le<br />
Tribunal a constaté son existence et a renvoyé les parties devant un expert<br />
— liquidateur ; Attendu que sur l'appel de Grange, la Cour dans son arrêt<br />
du 25 juin 1875, tout en reconnaissant que l'enquête était favorable à Tixin-,<br />
a admis que la position de celui-ci, dénué de toute ressources, un règlement<br />
de compte intervenu dans le courant de la prétendue association et l'absence<br />
de tout écrit établissant les bases de cette association, étaient àulanl de molifs<br />
sérieux de douler de son existence et en conséquence elle a infirmé le juge<br />
ment et débouté Tixier, à la charge par Grange d'affirmer par serment devant<br />
le juge de Batna, qu'il n'a pas existé d'association entre lui el Tixier pour la<br />
coupe des bois dont il s'agit;<br />
— Attendu<br />
que le 16 décembre de la même<br />
année les parties ont comparu devant ce magistrat et que là Grange a prêté<br />
le serment en ces termes : « Je jure que je n'ai jamais été l'associé de Tixier,<br />
» pour la coupe des bois en grumes, les perches et croûtes des anciennes<br />
» coupes de feu Prudhomme. »<br />
Attendu que par acte du 7 décembre 1876, Tixier a de nouveau assigné<br />
Grange devant le Tribunal de commerce de Constantine en paiement d'une<br />
somme de 7,050 francs, chiffre des bénéfices réalisés sur la d'une<br />
coupe acquise de Vitel par lui Tixier dont les bois avaient élé cependant ven<br />
dus par Grange el le prix retenu par lui ; Que par jugement du 6 avril 1877,<br />
le Tribunal a décidé, après avoir entendu les explications des parties, que<br />
cette nouvelle demande était comprise dans la revendication de la somme de<br />
11,959 francs, sur laquelle il avait été définilivement statué par arrêt de la<br />
Cour du 25 juin 1875, que l'inslance actuelle n'avait pour but que d'em<br />
pêcher l'effet dudit arrêt et de faire revivre sous une autre forme la pre<br />
mière instance ; qu'il y avail en un mot chose jugée ;<br />
— Attendu<br />
que dans<br />
cette deuxième instance et pour établir que Tixier n'avait point, ainsi qu'il<br />
le'<br />
prétendait, acquis de ses seuls deniers le lot Vitel,<br />
Grange a produit un
172<br />
reçu ainsi conçu : « Reçu de Monsieur Grange et de Monsieur Tixier, la<br />
» somme de trois cent quatorze francs, pour un lot de perches que j'ai acheté<br />
» à Bourgenne, concession Prudhomme,<br />
ainsi que d'un lot de planches que<br />
» j'ai acheté à la Marouïna, sur lesquels je leur cède tous mes droils. Batna,<br />
» le vingt -quatre mars 1872. Signé: Vitel Eugène. » Que le 26 avril dernier,<br />
Tixier, soutenant que ce reçu a été retenu par Grange et qu'il contient la<br />
preuve qu'une association a existé enlre Grange et lui pour l'exploitation des<br />
coupes Prudhomme, a déposé une plainte en faux serment contre Grange;<br />
Qu'une information judiciaire a eu lieu et que le 27 juillet le Tribunal cor<br />
rectionnel de Constantine a, par application des articles 366 et 463 du Code<br />
pénal, condamné Grange à six mois de prison et 500 francs d'amende ; Que<br />
Grange ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Que<br />
ces appels sont recevables en la forme, qu'il y a lieu de statuer sur le fond ;<br />
Attendu que tout en respectant la chose jugée, la Cour a à rechercher si le<br />
nouveau document produit, c'est-à-dire le reçu Vitel, joint aux faits révé<br />
lés par les enquêtes et aux autres pièces déjà appréciées par la justice, n'ap<br />
porte pas la preuve qu'en affirmant sous serment qu'il n'a jamais existé<br />
d'association entre Tixier et lui, pour l'exploitation des coupes Prudhomme,<br />
— Grange n'a pas fait un faux serment ; Qu'il ressort de toutes les circons<br />
tances de la cause, que ce document n'a point été produit aux premiers dé<br />
bats; qu'il n'en est fait état dans aucune des décisions ni intervenues, dans<br />
les conclusions jointes au placet; Qu'il faut donc reconnaître que la quit<br />
tance Vitel est un document nouveau, non encore apprécié par la justice, do<br />
cument qui est resté enlre les mains de Grange ; Qu'on ne saurait admettre<br />
que la Cour a indirectement apprécié ce reçu en soutenant que Vitel, dans<br />
l'enquête, avait déposé du fait constaté par ladite quittance ; Qu'en effet, un<br />
témoignage ne saurait jamais avoir l'autorité d'un écrit ; Que tandis que la<br />
justice peut douter et hésiter devant un témoignage, elle doit s'incliner de<br />
— en ce qui concerne la<br />
vant un écrit régulier et non contesté ;<br />
Attendu,<br />
force probante du reçu Vitel, qu'il ressort incontestablement de son texte<br />
que la coupe Vile! a été acquise des deniers communs de Grange et de Tixier<br />
el que jusqu'à preuve contraire cet achal suppose l'existence d'une association<br />
en participation enlre les acquéreurs ;<br />
— Que<br />
cela esl si vrai, que dans son<br />
inlerrogatoire devant le juge d'instruction, Grange lui-même,<br />
après beau<br />
coup d'hésitations et de réticences, avoua que réellement un projet d'asso<br />
ciation a existé enlre lui et Tixier quant à celte coupe, qu'il en avait fait<br />
part à Vitel, que c'est dans cet état de choses que le reçu a élé rédigé, mais<br />
que postérieurement ce projet a élé abandonné ;<br />
— Attendu<br />
qu'il n'est pas<br />
admissible que Grange et Tixier aient été associés pour la coupe Vitel sans<br />
l'avoir été également pour les autres;— Qu'en effet la coupe Vitel faisait<br />
— partie des coupes delà succession Prudhomme; Qu'elle étail siluée au<br />
même lieu ;<br />
— Qu'elle élait comprise dans la même exploitation ;<br />
— Qu'elle<br />
ne formait en un mot qu'un tout avec les autres coupes et constituait avec<br />
elles une seule et même opération ;<br />
— Attendu<br />
au reste que le serinent<br />
prêté par Grange a porlé sur la coupe Vitel aussi bien que sur les autres<br />
coupes ;<br />
— Que<br />
Tixier a toujours déclaré que la somme de 7,050 francs, chif<br />
fre des bénéfices de celte coupe, élait comprise- dans le chiffre de 11,959 fr.,<br />
objet de la première demande ;<br />
— Qu'il<br />
ne saurait en être autrement, puisque
173<br />
dans sa première assignation il réclame sa part des bénéfices réalisés dans<br />
— l'exploitation des coupes provenant de la succession Prudhomme ; Qu'on<br />
ne saurait donner une portée qu'il n'a pas à ce passage de l'assignation :<br />
« Vendues à la criée par Me Ghamproux, notaire »,<br />
et lui donner un sens<br />
restrictif ;<br />
— Qu'il est certain que la coupe Vilel provenant de la succession<br />
Prudhomme, faisait partie de la même exploitation;<br />
— Qu'il n'a jamais<br />
élé fait dans la première instance aucune distinction entre les coupes<br />
achetées directement devant le notaire et celle acquise de Vilel qui avait la<br />
même origine; Qu'au reste lalormule du serment prêté par Grange le 16 dé<br />
cembre 1875, est générale, puisqu'il affirme sous serment qu'il n'avait jamais<br />
été l'associé de Tixier pour la coupe des bois des anciennes coupes Prudhom<br />
me;<br />
Qu'au surplus Grange lui-même l'a judiciairement reconnu puisque<br />
sur sa demande le Tribunal de commerce a décidé par son jugement du<br />
6 avril 1877, qu'il y avait chose jugée, que l'arrêt de la Cour du 25 juin 1875<br />
qui a déféré le serment, avait statué sur la coupe Vitel comme sur les autres;<br />
que la seconde instance n'avait pour but que d'empêcher les effets de cet<br />
arrêt et de faire revivre sous une autre forme la première instance ;<br />
tendu, en résumé, qu'il y a lieu de reconnaître que le reçu Vitel est un do<br />
cument nouveau, non encore apprécié par la justice; Que ce document<br />
prouve que la coupe Vitel a été acquise en commun par les parties et que,<br />
— At<br />
combiné avec les autres documents de la cause, il établit qu'il y a eu associa<br />
tion entre Grange et Tixier non-seulement pour le loi Vitel, mais pour toutes<br />
les coupes provenant de la succession Prudhomme ; Qu'il s'ensuit que Grange,'<br />
en prêtant le 16 décembre 1875 devant le juge de paix de Batna le serment<br />
ci-dessus transcrit, s'est rendu coupable du délit prévu et puni par l'art. 366<br />
— du Code pénal ; Attendu que la peine prononcée par les premiers juges<br />
est suffisante ; Qu'il n'y a pas lieu de l'élever.<br />
Par ces motifs : LA COUR, statuant sur les appels tant du prévenu que du<br />
ministère public, confirme, pour sortir son plein et entier effet, le jugement<br />
dont est appel ; condamne Grange en tous les dépens de première instance et<br />
d'appel.<br />
M. le prés. Truaut, rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; Me Ché<br />
ronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, présidenl.<br />
20 mars 1878.<br />
Terres cédées par l'État à des indigènes.<br />
— Compétence.<br />
— Titres français.<br />
Lorsque des terres ont été remises par l'État à des indigènes, les titres déli<br />
vrés étant des titres français, les cadis, aux termes de la loi du 26 juillet 1873,<br />
n'ont pas qualité pour procéder à la vente de ces immeubles.
174<br />
En conséquence les tribunaux français, jugeant en matière musulmane, sont<br />
eux-mêmes incompétent'} pour connaître des litiges relatifs à ces immeubles .<br />
Mohammed Sadoun c. Amar ou Kl-Hadj Haddouch.<br />
Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou a, par le jugement dont est appel,<br />
déclaré Mohammed Sadoun non recevable en sa demande en revendication<br />
en s'appuyant sur un acte de vente dressé par le cadi de Bordj-Menaïel, le<br />
— 19 février 1K76 ; Atlendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle a procédé le<br />
juge de paix de Bordj-Menaïel, en exécution d'un arrêt de la Cour du 23 oc<br />
tobre 1877, que les frères Sadoun onl reçu de l'État, il y a plusieurs années,<br />
en compensation de terrains abandonnés par eux, les deux immeubles en<br />
litige ; —-<br />
Que<br />
les titres délivrés sont des litres français et, par suite, que les<br />
immeubles qu'ils concernent sont, aux termes de la loi du 26 juillet 1873,<br />
— régis par la loi française; Que dans cet état des faits, le cadi n'avait point<br />
qualité pour passer l'acte de vente du 19 février 1876 el que le tribunal de<br />
Tizi-Ouzou, jugeant en matière indigène, n'était point compétent pour<br />
—<br />
connaître de la contestation enlre les parties; Attendu, elc ;<br />
— Mais attendu que la Cour, constituée en Chambre musulmane, n'est pas<br />
plus compétente pour statuer en appel que ne l'était le tribunal de Tizi-<br />
Ouzou pour juger en premier ressort ; qu'il n'y a lieu par suite que d'infir<br />
mer le jugement attaqué, sauf aux parties à saisir la juridiction qui doit en<br />
connaître.<br />
Par ces motifs : Reçoit Mohammed Sadoun appelant du jugement rendu le<br />
7 juillet 1877. Infirme ledit jugement. Dit que le tribunal 'de Tizi-Ouzou,<br />
jugeant en matière indigène, élait incompétent pour connaître de la contes- .<br />
lalion entre les parties. Se déclare incompétent pour statuer sur l'appel.<br />
Renvoie les parties devant les juges qui doivent connaître de leur différend.<br />
Condamne Amar ou El-Hadj aux dépens.<br />
M. Sautayra, cons. rapp. ; M- Cammartin, av. gén.; M« Ballesteros<br />
et Achille Huré, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en date du 9 mai 1878, ont été nommés :<br />
Juge de paix de Souk-Ahras (Algérie), M. de Sèauve, Juge de paix de Kren-<br />
chela, en remplacement de M. Godart, qui est nommé Juge de paix de Joinville<br />
(Haute-Marne).<br />
Juge de paix d'Aïn-Mokra (Algérie), M. Terrier, ancien magistrat, en<br />
remplacement de M. Pougat, qui a élé nommé Substitut du Procureur de la<br />
République.<br />
Par décret en date du 10 mai l878,<br />
a été nommé :<br />
Huissier près la Justice de paix de Guelma (Algérie), M. Jouda ben Simon,<br />
huissier nommé près la Justice de paix de l'Oued-Alhménia, en remplace-
175<br />
ment de M. Arnould, qui conserve, sur sa demande, ses fonctions d'huissier<br />
à l'Oued-Athménia.<br />
Par décret en date du 18 mai 1878, ont été nommés :<br />
Juge au Tribunal de 1re instance de Mostaganem, M. Cherpitel, Juge au<br />
siège de Bar-le-Duc, en remplacement de M. Leclerc, qui est nommé Juge à<br />
Saint-Mihiel.<br />
M. Cherpitel, nommé Juge au Tribunal de 1« instance de Mostaganem,<br />
remplira les fonctions de Juge d'instruction, en remplacement de M. Leclerc.<br />
M. Mounier, Juge au Tribunal de lre instance de Constantine, y est spé<br />
cialement chargé du règlement des ordres pendant l'année judiciaire 1877-<br />
1878.<br />
Par décret en date 'du 18 mai 1878, ont été nommés :<br />
Greffier de la Justice de paix des Ouled-Rahmoun, M. Houlez, Greffier de<br />
la Justice de paix d'El-Arrouch, en ïemplacement de M. Loviconi.<br />
Greffier de la Justice de paix d'inkermann, M Matteï (Émilien), en rem<br />
placement de M. Lambert-Gimey.<br />
Greffier de la Justice de paix d'Aïn-Témouchent, M. Lambert-Gimey, Gref<br />
fier de la Justice de paix d'inkermann, en remplacement de M. Ferry.<br />
Greffier de la Justice de paix de Saint-Cloud, M. Ferry. Greffier de la<br />
Justice de paix d'Aïn-Témouchent, en remplacement de. M. Fossier, démis<br />
sionnaire.<br />
Huissier près la Justice de paix de l'Arba, M. Marolot, Huissier près la<br />
Justice de paix de Dra-el-Mizan, en remplacement de M. Gaucher.<br />
Huissier près la Justice de paix de Dra-el-Mizan, M. Gaucher, Huissier<br />
près la Justice de paix de l'Arba, en remplacement de M. Marolot.<br />
'<br />
Par décret en date du 18 mai 1878, ont élé nommés :<br />
Interprète judiciaire près la Justice de paix d'El-Arrouch, M. Jaïs, inter<br />
prète à Bordj-bou-Arréridj, en remplacement de M. Tracqui.<br />
Interprète judiciaire près de la Justice de paix de Bordj-bou-Arréridj,<br />
M. Tracqui, interprète à El-Arrouch, en remplacement de M. Jaïs.<br />
Par décret en date du 28 mai 1878, ont été nommés :<br />
Huissier près la Justice de paix de Perrégaux, M. Robaglia (Charles), en<br />
remplacement de M. Janaud, décédé.<br />
Interprète judiciaire à Djelfa, M. Sidoun, en remplacement de M. Torre,<br />
nommé à Perrégaux.<br />
Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger,<br />
30 avril 1878 :<br />
en date du<br />
M. Henri Teufel,<br />
Curateur aux successions vacantes dans le canton de Mascara, en remplace<br />
ment de M. Marty, nommé Greffier de la Justice de paix de Djelfa.<br />
commis au bureau de l'Enregistrement, a élé nommé
176<br />
Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, en date du<br />
4 mai 1878 :<br />
M. Balèle, Greffier de la Justice de paix de Cassaigne,<br />
esl nommé Cura<br />
teur aux successions vacantes dans le canton de celte Justice de paix.<br />
Par arrêtédu Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, ont été<br />
nommés :<br />
Curateur aux successions, vacantes à Aïn-Témoueheril, M. Lambert-Gimey,<br />
en remplacement de M. Ferry, nommé Greffier à Saint-Cloud.<br />
Curateur aux successions vacantes à Saint-Cloud, M. Ferry,<br />
ment de M. Fossier, démissionnaire.<br />
Mariage. —<br />
Intermédiaire.<br />
—<br />
matrimonial. — — Nullité.<br />
DECISIONS DIVERSES<br />
Convention.<br />
—<br />
Salaire<br />
en remplace<br />
stipulé. — Courtage<br />
La convention par laquelle une indemnité a été<br />
promise à un intermédiaire à tilre d'obligation conditionnelle et à forfait,<br />
pour le rémunérer de ses soins et efforts en vue d'arriver à négocier un<br />
mariage avec une personne .déterminée, est illicite et ne saurait être consacrée<br />
par la justice. L'intermédiaire n'a droit qu'à la restitution de ses déboursés.<br />
— Trib. civ. de la Seine, T Ch., 10 janvier 1878 (Francejudic, II,<br />
Compétence. —<br />
Cotisations.<br />
— Comice agricole. — Les<br />
p. 261).<br />
président, vice-pré<br />
sident et trésorier d'un Comice agricole ont qualité pour poursuivre, au<br />
nom de ce Comité, en tant que mandataires de ses membres, le recouvrement<br />
des cotisations que ceux-ci se sont engagés à verser annuellement en sous<br />
crivant aux statuts. (Cass. civ., 30 août 1859, D. t. 59,"<br />
. p 365)<br />
judiciaire a compétence pour juger une réclamation de cette nature,<br />
L'autorité<br />
et ce<br />
n'est pas à l'autorité administrative qu'il appartient, soit de dresser les rôles<br />
des cotisations à recouvrer, soit d'assurer l'exécution de ces rôles. —<br />
Ch. civ., 29 janvier 1878 (Gaz. des Trib. du 2 fév. 1878).<br />
Corruption électorale. —<br />
Élection<br />
de maire. — Loi applicable. — Le<br />
Cass.,<br />
dé<br />
cret du 2 février 1852 (art. 48) et les lois subséquentes relatives aux élections<br />
du Corps législatif, des Conseils généraux et municipaux, produits du suf<br />
frage universel, n'a pu prévoir l'élection des maires et adjoints, établie par la<br />
loi de 1876, qui n'est que le produit du suffrage restreint des conseillers<br />
municipaux enséance secrète. Ce ne sont donc pas les peines édictées par la loi<br />
de 1872 qui doivent être appliquées dans le cas de la vente et de l'achat du<br />
vote d'un conseiller municipal ; mais, en l'absence de la répression édictée<br />
par le décret de 1852, la pénalité de la loi générale, c'est-à-dire de l'art. 113<br />
du Code pénal, doit être prononcée. —<br />
Gass., Ch. crim., 8 fév. 1878 (Gaz.<br />
des Trib. des 10 et 15 février 1878).<br />
Alger. — Tjifi. A. Jourdan.
2e année. — 16<br />
Juin «878. —<br />
N° 36<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
Algérie. —<br />
DOCTRINE. -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
-<br />
LÉGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. desReq.)<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />
— Habous.<br />
Inaliénabilité<br />
18 décembre 1877.<br />
des biens habousés,<br />
— Décret du 30 octobre 18S8.<br />
Les ventes immobilières de biens habous passées de musulman à musulman<br />
étaient nulles antérieurement au décret du 30 octobre 1858; mais ce décret a<br />
eu pour effet de valider ces aliénations aussi bien pour le passé que pour<br />
l'avenir.<br />
Il les a purgées du vice dont elles étaient entachées, en leur accordant le<br />
bénéfice que l'ordonnance du 1" octobre 1844 et la loi du 16juin 1851 avaient<br />
concédé aux aliénations consenties par un musulman au profit d'un non mu<br />
sulman, et qui auraient eu pour objet un immeuble inaliénable aux termes de<br />
la loi musulmane.<br />
Skbaoun ben Amour c. Amar ben Aïssa.<br />
LA COUR : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2267 du<br />
Code civil et de la fausse application tant de l'article 2265 du même Code,<br />
que de l'article \" — du décret du 30 octobre 1858 ; Allendu que, par adju<br />
dication publique du 12 décembre 1864, Ali ben Beder s'est rendu acquéreur<br />
d'une maison située à Conslanline, et dont une part indivise, après lui avoir<br />
été vendue en 1855 par Hamaden ben Aïssa el Abraham Scebrat, qui l'avaient<br />
achetée en 1853 de Mérien, fille de Radia, avait été revendue en 1859, par<br />
Garmina, fille de Mérien, à Sebaoun bèn Amour —<br />
; Attendu que celte part<br />
d'immeuble avait été frappée de habous en 1822, par Radia, au profit de ses<br />
deux enfants, Mustapha ben Achim el Mérien, mais que Mérien la possédait<br />
seule, lors de la vente de 1853, par suite du décès de Radia et de Mustapha<br />
— ben Achim ; Attendu que si les cessions de 1853 et de 5855 étaient nulles<br />
originairement, comme contraires au principe qui défendait encore, de mu<br />
sulman à musulman, les aliénations de habous, le décret du 30 octobre 1858<br />
a validé ces aliénations, aussi bien pour le passé que pour l'avenir, en leur<br />
accordant le bénéfice de l'ordonnance du t« octobre 1844 et de la loi du 16
178<br />
juin 1851, qui avaient déjà disposé qu'aucun acte translatif de propriété<br />
d'immeuble consenti par un musulman au profit d'une autre personne qu'un<br />
musulman ne pouvait être allaqué à raison de ce que l'immeuble était inalié<br />
— nable aux termes de la loi musulmane ; Attendu que le décret de 1858 a<br />
donc purgé les cessions de 1853 et de 1855 du vice dont elles étaient primi<br />
tivement entachées ; el que, par conséquent, la vente consentie par Garmina<br />
à ben Amour, en 1859, était nulle comme vente de la chose d'au trui, puisque<br />
la propriété qui en était l'objet reposait, depuis l'année précédente, entre les<br />
mains d'Ali ben Beder, en verlu d'un titre légalement inattaquable : — D'où<br />
il suit que le demandeur n'avait aucun droit dans le prix de l'adjudication de<br />
1844 et qu'en le jugeant ainsi, par application du décret de 1858, après avoir<br />
bien loin de violer<br />
inutilement invoqué la prescription, l'arrêt dénoncé,<br />
aucune loi, s'est exactement conformé à la règle. de la malière ;<br />
Rejette.<br />
M. Guillemard, cons. rapp. ; M. R. de Cléry, av. gén. (cl. conf). ;<br />
Instance domaniale. —<br />
M" Lehmann, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
Mémoire<br />
25 février 1878.<br />
préalable, — Délais. —<br />
malités substantielles.<br />
For<br />
Les dispositions du décret du 28 décembre 1855 relatives à la procédure des<br />
instances domaniales en Algérie, el édictant l'obligation d'un mémoire préala<br />
ble avec production de pièces devant être signifié quarante jours au moins avant<br />
l'assignation introductive d'instance, ont une importance substantielle et leur<br />
violation emporte nullité de l'assignation et de l'instance qui en a élé la suite ,<br />
Cette nullité doit être prononcée même dans le cas où l'assignation aurait été<br />
précédée du mémoire exigé par la loi mais sans que le délai de quarante jours<br />
attribué au Préfet pour sa réponse, ait été observé (1).<br />
(1) La jurisprudence de la Cour d'Alger n'a pas toujours été la même sur cette<br />
question. Voir un arrêt du 29 juillet 1872 (Robe 1872, p. 158) qui décide que<br />
l'omission de la signification de mémoire, constitue, non pas une nullité d'ordre<br />
public, mais une nullité de procédure qui est couverte, si elle n'a été proposée<br />
avant toute défense au fond.<br />
L'arrêt rapporté présente une importance considérable en ce qu'il marque nette<br />
ment une distinction essentielle entre la portée des articles 1 à 3 du décret du 28<br />
décembre 1855, spécial à l'Algérie, et celle de l'article 15 de la loi des 28 octo<br />
bre 5 novembre 1790 applicable à la métropole.
179<br />
Préfet d'Alger c. Djelloul ben Moussa el consorts<br />
ARRÊT :<br />
Attendu que les intimés ne comparaissant pas, bien que régulièrement<br />
assignés, il y a lieu de donner défaut contre eux;<br />
— Au<br />
fond : Attendu que<br />
par exploit du ministère de Misse, huissier à Alger, en date du 25 avril 1877,<br />
Djelloul ben Moussa el Ahmed ben Youssef ben Moussa ont signifié à l'ad<br />
ministration un mémoire par lequel ils se prétendent propriétaires de par<br />
celles détenues par le Domaine et donné copie du titre sur lequel ils fondent<br />
—<br />
leur revendication ; Que, par le même acte, ils ont assigné l'État devant<br />
— le tribunal de Blidah pour voir slaluer sur leur action ; Attendu que le<br />
décret du 28 décembre 1855, réglant la procédure des instantes domaniales<br />
en Algérie, contient les dispositions suivantes : « Article premier. — Préa<br />
lablement à toule action contre le Domaine de l'Etat ou le Domaine départe<br />
mental de l'Algérie, les demandeurs seront tenus de se pourvoir devant le<br />
préfet du département par simple mémoire avec production de pièces à l'ap<br />
pui. Ce mémoire devra contenir élection de domicile au siège du tribunal<br />
compétent. Il en sera délivré un récépissé qui interrompra la prescription de<br />
l'action, lorsqu'il aura été dans les trois mois de sa date, suivi d'une action<br />
—<br />
en justice. Dans les quarante jours, à partir de la date du récépissé, le<br />
préfet notifiera aux parties, dans la forme administrative et au domicile élu,<br />
— — les réponses de l'administration ; Article tcoisième. Toute audience sera<br />
refusée au demandeur, s'il n'est justifié de l'accomplissement des formalités<br />
— prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus ; L'assignation donnée avant que<br />
ces formalités aient été remplies et que les délais soient expirés, sera considérée<br />
comme nulle et nonavenue. » Attendu que le texte de ces dispositions, l'esprit<br />
dans lequel elles ont été édictées, le caractère conciliatoire qui les distingue,<br />
les raisons d'ordre public qui les ont déterminées, suffiraient à marquer leur<br />
importance substantielle el à justifier la nullité, conséquence nécessaire de<br />
— leur violation ; Qu'au surplus, le 2e paragraphe de l'article 3, plus expli<br />
cite que la loi de 1790, voulant sans doute effacer en cette matière les tolé<br />
rances d'une jurisprudence trop indulgente, a prononcé expressément la<br />
nullité de l'assignation donnée prématurément ;<br />
—<br />
que cette sanction ex<br />
presse ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire des tribunaux ;<br />
— Que par suite, le tribunal de Blidah, en accordant audience aux deman<br />
deurs et en validant l'assignation donnée à leur requête avant l'accomplisse<br />
ment des formalités prescrites par le décret du 28 décembre 1855, a formel<br />
lement violé les disposilions de ce décret.<br />
Par ces motifs : la Cour :<br />
Donnant défaut contre les intimés non comparants bien que régulièrement<br />
assignés, reçoit l'appel, infirme le jugement déféré, annule l'assignation du<br />
— 25 avril 1877 el tout ce qui s'en est suivi ; Condamne Djelloul ben Moussa<br />
et Ahmed ben Youssef ben Moussa à tous les dépens.<br />
M . Piette,<br />
av. gén. (concl . conf.) ; Me Garau, av.
lao<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
N<br />
22 mars 1878.<br />
Corruption de fonctionnaires.<br />
l'indigénat. —<br />
Contravention.<br />
—<br />
— Infraction aux règles de<br />
Crime.<br />
—<br />
Connexité.<br />
Lorsqu'on impute à un fonctionnaire indigène de s'être, par offres agréées,<br />
abstenu de faite un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, et qu'il est in<br />
culpé en même temps d'infraction aux règles de l'indigénat pour avoir négligé<br />
défaire à l'autorité judiciaire la déclaration immédiate d'un crime ou délit<br />
commis dans la circonscription, ces deux inculpations constituant ,<br />
la première<br />
un crime, la deuxième une contravention, ont un caractère manifeste de càn-<br />
nexité et doivent conséquemment, aux termes de l'art. 226 du Code d'instr.<br />
crim,,<br />
être déférés à la mêmejuridiction.<br />
En conséquence lajuridiction correctionnelle saisie de cette double prévention,<br />
et se trouvant incompétente pour statuer sur la première qui a pour objet un<br />
çrimepuni depeines à la fois infamante cl correctionnelle, ne saurait davantage<br />
statuer sur la contravention et doit renvoyer la cause tout entière devant te<br />
juge qui doit en connaître.<br />
Le Procureur général c. Lakdar Ould M'hamed.<br />
Attendu que par décret du 29 août 1874, primitivement restreint à la Ka<br />
bylie,<br />
mais rendu applicable dans les territoires civils de toute l'Algérie par<br />
celui du 11 septembre 1874, l'article 17 dispose: « En territoire civil, les<br />
» indigènes non naturalisés pourront être poursuivis et condamnés aux<br />
» peines de simple police fixées par les articles 464, 465 et 466 du Code<br />
» pénal, pour infractions spéciales à l'indigénat, non prévues par la loi fran-<br />
» çaise, mais déterminées par des arrêtés préfectoraux rendus sur les propo-<br />
» sitions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale, ou<br />
» des maires, la peine de l'amende et celle de la prison pourront être cumu-<br />
» léeset s'élever au double,<br />
en cas de récidive prév,ue par l'article 483 "du<br />
» Code pénal ; les juges de simple police statueront en cette matière sans<br />
» frais et sans appel. » — Attendu qu'à fin avril 1877, dans le. douar du<br />
territoire civil des Oulad M'alâa, canton de Tlemcen, dont, Lakdar Ould M'ha<br />
med est chef partiel, ou Kebir Caria, pourvu d'une commission du maire de<br />
Tlemcen, un meurtre fut commis sur la personne dit nommé.Mohamed. ben<br />
— Qu'aux termes d'un arrêté du préfet d'Oran, du 30 mars 1875, pris<br />
Aïssa ;<br />
en exécution des décrets des 29 août et 1 1 septembre, précités, il a commis une<br />
contravention aux règles de l'indigénat, parle fait (n° 29 de l'article 1er) de la<br />
part des adjoints indigènes, présidents de Djemâas, chefs de Douarspartiels, de<br />
négliger ou d'avoir, négligé de faire la déclaration immédiate au juge de<br />
paix de leur canton ou au procureur de la République, lorsque le siège du<br />
181<br />
tribunal sera au chef-lieu de canton, des crimes ou délits commis dans la<br />
— circonscription de ces agents indigènes ; Attendu qu'en vertu d'une<br />
ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Tlemcen, du 14 juin 1877,<br />
et par exploit du 19 juin suivant, Lakdar Ould M'hamed a été cité, en sa<br />
qualité de chef du douar des Oulad M'alâa (Oulad Aala), devant le tribunal<br />
correctionnel de Tlemcen, sous la double prévention : 1° de s'être, depuis<br />
moins de trois ans, aux Oulad M'alâa, canton et arrondissement de Tlemcen,<br />
en suite d'offres agréées, abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de<br />
ses pouvoirs, c'est-à-dire de dénoncer à la justice l'assassinat du nommé<br />
Mohamed Ould Aïssa 2°<br />
; d'avoir, dans les mêmes circonstances de lemps et de<br />
négligé de faire la déclaration immédiate au procureur de la République<br />
lieu,<br />
dudit crime commis dans sa circonscription; — Attendu que par jugement<br />
contradictoire du- 16 janvier 1878, le tribunal de Tlemcen a renvoyé Lakdar<br />
sur le chef de corruption, qu'il déclare n'avoir pas élé suffisamment justifié<br />
à sa charge ; l'a déclaré suffisamment convaincu sur le chef de contravention<br />
à l'arrêté préfectoral du 30 mars 1875, et faisant application du paragraphe<br />
31, article Ier de cet arrêté, et de l'article 192 du Code d'instruction crimi<br />
nelle, a condamné Lakdar en quinze francs d'amende —<br />
; Attendu que ce<br />
jugement a été frappé d'appel, le 19 janvier suivant, à la requête du procu<br />
reur de la République de Tlemcen ; qu'à l'audience le ministère public<br />
conclut à la confirmation du jugement sur le chef de la contravention et à<br />
l'incompétence de la juridiction correctionnelle sur le chef de la corruplion ;<br />
— Altendu que par l'ordonnance du juge d'instruction, comme par la cita<br />
tion donnée au prévenu devant les premiers juges, celui-ci élait renvoyé<br />
devant la juridiction correctionnelle sous l'inculpation: 1° d'avoir agréé des<br />
offres d'argent pour s'abstenir de déclarer à l'autorité, ce qui élait son devoir,<br />
l'assassiuat de Mohamed ben Aïssa perpétré dans sa circonscription ; 2° d'avoir<br />
négligé de faire la déclaration immédiate de ce crime à l'autorité judiciaire ;<br />
— Attendu que ces faits, s'ils étaient établis à la charge du prévenu, dans les<br />
formes de juridiction régulière, constitueraient : le premier, le crime de<br />
corruption par un fonctionnaire ou agent d'une administration, prévu par<br />
l'article 177, § 2, du Code pénal ; le deuxième,<br />
la contravention passible de<br />
peine de simple police, prévue par l'article 1", §§ 29 et 30 de l'arrêté préfec<br />
toral précité du 30 mars 1875 ; — Atlendu que ni devant les premiers juges<br />
ni devant la Cour, aucune partie n'a demandé le renvoi devant le tribunal<br />
— de simple police pour le chef de contravention ; Mais altendu d'ailleurs<br />
que le fait conslitutif de cette contravention est le même qui constitue le<br />
crime ci-dessus spécifié, sauf que pour ce dernier, l'agent incriminé se serait<br />
—<br />
en plus laissé corrompre en agréant ou acceptant des dons en numéraire;<br />
—<br />
Qu'il y a connexité et surtout indivisibilité enlre les deux inculpations ;<br />
Attendu que la juridiction correctionnelle étant incompétente à connaître du<br />
chef de corruption, qui constitue un crime réprimé de peines à la fois infa<br />
mante et correctionnelle, articles 177, 8 el 9 du Code pénal, il y a lieu, par<br />
le principe de connexité et d'invisibilité enlre le chef de contravention et le<br />
chef de crime, de déclarer l'incompétence sur le tout, la juridiction la plus<br />
élevée attirant à elle les faits connexes et indivisibles relevant d'une juridic<br />
tion inférieure (article 226 du Code d'instruction criminelle) ;<br />
Par ces molifs : Infirme le jugement attaqué pour cause d'incompétence de
182<br />
la juridiction correctionnelle, tant sur le chef de crime que sur le chef de<br />
—<br />
contravention sus-spécifiés ; Relève en l'état Lakdar Ould M'hamed des<br />
condamnations prononcées contre lui ;<br />
devant les juges qui doivent en connaître :<br />
M. Truaut, prés. rapp. ; M. Fau, av. gén.<br />
— Renvoie<br />
la cause et les parties<br />
TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />
Présidence de M. DELACROIX, président.<br />
21 mai 1878.<br />
Privilège du bailleur. — Vente d'un fonds de commerce et<br />
cession du bail. — Loyers dus par le locataire principal,<br />
Les termes de l'art. 2102 du Code civil sonl généraux et absolus en ce qui<br />
concerne le privilège de bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués.<br />
En conséquence, au cas où le locataire aurait même,<br />
propriétaire,<br />
avec le consentement du<br />
cédé son bail à un tiers auquel il aurait en même temps vendu<br />
son fonds de commerce, le privilège du bailleur subsisterait sur les meubles<br />
compris dans la vente de l'établissement,<br />
premier locataire.<br />
pour les loyers restant dus par le<br />
En effet, la propriété de ces meubles n'a pu être transmise qu'avec la charge<br />
du privilège dont ils étaient précédemment grevés, et d'autre part, on ne sau-<br />
faire résulter du consentement donné par le propriétaire, un abandon implicite<br />
et éventuel de son privilège du bailleur, alors surtout que le bail impose for<br />
mellement au locataire l'obligation de tenir constamment les lieux garnis d'un<br />
mobilier suffisant pour garantir le paiement des loyers.<br />
Seyman frères c. Pizzorno et dame Millière.<br />
Attendu que par bail sous seing-privé, en date du 6 octobre 1874, enre<br />
gistré, les frères Seyman ont loué à Pizzorno un immeuble situé à Constan<br />
tine, rue Damrémonl, pour 3, 6 ou 9 années, à partir du 1« août 1874, et<br />
moyennant un prix de 8,000 francs, payable par trimestre et d'avance, prix<br />
réduit, par acte du 26 janvier 1877, enregistré, à 7,000 francs à partir du<br />
l«r —<br />
avril 1877 ; Attendu que le 1« avril 1877, Pizzorno a vendu son<br />
fonds de commerce et cédé son droit au bail à la dame Millière ;<br />
— Que par<br />
exploit du 18 janvier 1878, Seyman et consorts ont fait commandement à<br />
— Pizzorno de payer 4,650 francs pour loyers dus ; Que ce commandement<br />
étant resté sans effet, ils ont, par exploit de Salmon, huissier à Constantine,<br />
en date du 6 février 1878, fait saisir les meubles garnissant les lieux occupés<br />
— Qu'ils demandent aujourd'hui à Pizzorno : 1° le<br />
par la dame Millière ;
183<br />
payement des loyers dus ; 2° la résiliation du bail faute de payement du prix ;<br />
3° la conversion de la saisie-gagerie en saisie-exécution 4°<br />
; une indemnité<br />
— de relocation de 3,000 francs; Attendu que Pizzorno a actionné la dame<br />
Millière en garantie ; que celle-ci, de son côté, a formé une demande recon<br />
ventionnelle de 25,000 francs de dommages-intérêls pour le cas où la résilia<br />
— tion du bail serait prononcée ; Attendu que Pizzorno, pour repousser la<br />
demande des propriétaires, allègue que ceux-ci l'ont autorisé à céder son bail<br />
à la dame Millière el que ce consentement le dégage de tout lien, de toute<br />
—<br />
obligation à leur égard ; Mais altendu que Pizzorno ne rapporte pas la<br />
—<br />
preuve de ce consentement; Qu'il résulte au contraire des documents de<br />
la cause, du libellé d'une quittance, en date du 14 novembre 1877, laquelle<br />
sera enregistrée avec le présent jugement, et des exploits signifiés tant à Piz<br />
zorno qu'à la dame Millière, que les bailleurs, loin de consentir à une<br />
novation, de vouloir changer de débiteur, ont toujours considéré Pizzorno<br />
comme leur locataire, obligé directement envers eux —<br />
; Altendu que les<br />
demandeurs réclanaent à Pizzorno le paiement d'une somme de 6,400 francs<br />
pour loyers dus du 1er aoûl 1877 au l
184<br />
que la dame Millière ne saurait opposer en compensation à cette dette liquide,<br />
exigible et certaine, des dommages-intérêts éventuels, qui sont l'objet d'un<br />
litige pendant enlre les parties devant le tribunal de commerce;<br />
— Altendu<br />
que sa demande «conventionnelle basée sur le préjudice qui doit résulter<br />
pour elle de la saisie de ses meubles et de la résiliation du bail, n'est pas<br />
— mieux fondée ; Qu'à l'époque de la saisie, le 6 février, étant déjà débitrice<br />
du terme de novembre échu, et du terme payable d'avance le 1er février, elle<br />
a contribué, par sa faute, autant que Pizzorno,<br />
aux poursuites exercées par<br />
les propriétaires pour sauvegarder leurs droits, et que si la résiliation du<br />
bail doit en être la conséquence, on ne saurait en faire peser sur Pizzorno<br />
seul toute la responsabilité ;<br />
Par ces motifs: Jugeant contradictoirement el en premier ressort, con<br />
damne Pizzorno à payer aux demandeurs la somme de 6,400 francs pour<br />
loyers échus et exigibles 'jusqu'au 30 avril 1878, avec intérêts de droit —<br />
;<br />
Valide la saisie-gagerie du 6 février 1878, et ordonne la vente des saisis-<br />
objets<br />
gages pour le produit être touché à valoir ou jusqu'à due concurrence, pro<br />
nonce la résiliation du bail et autorise les demandeurs à faire expulser tant<br />
Pizzorno que tous occupants de son chef qu'il aurait pu se substituer, el<br />
pour réparation d u préjudice que cette résiliation entraine, condamne Pizzorno<br />
en 3,000 francs de dommages-intérêts; Condamne rele-<br />
la dame Millière à le<br />
veret garantir des condamnations prononcées contre lui jusqu'à concurrence<br />
de 3,500 francs ; Déboute les parties du surplus de leur demandes, fins et<br />
conclusions; Condamne Pizzorno aux dépens; Condamne la dame Millière à<br />
le relever et garantir jusqu'à concurrence du quarl desdits frais ; Dit que la<br />
quittance du 14 novembre 1877, sus-ènoncée, sera enregistrée avec le présent<br />
jugement; Dil qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.<br />
M. de Castelbajac, subst. du Proc. de la Rép. ; Mes Gillotte<br />
et Fontaneau, av.<br />
TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2">e Ch).<br />
Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />
26 juin 1876.<br />
I. Acquisition simultanée de deux chevaux. — Effet du contrat<br />
en cas de vice rédhibitoire chez l'un des deux animaux.<br />
II. Vente opérée par l'entremise d'un commissaire-priseur.<br />
— Responsabilité de cet officier ministériel.<br />
I. Dans le cas où deux chevaux sont vendus simultanément, mais moyennant<br />
un prix distinct pour chacun, cette opération ne peut être considérée comme<br />
vente d'un attelage, de sorte que si le contrat vient à être annulé par suite de<br />
vices rédhibitoires existant chez l'un des animaux, la vente de l'autre n'en est<br />
pas moins valable.
185<br />
IL Le commissaire-priseur qui procède à une vente publique n'est qu'un inter<br />
médiaire légal entre le vendeur et l'acheteur et ne. peut, en conséquence, être<br />
rendu responsable des contestations auxquelles les vices de la chose vendue<br />
pourraient donner naissance, en tant toutefois qu'il ne lui est reproché aucun<br />
fait de dol ou de fraude, ni aucune faute.<br />
Messin c. Mantout, Demolins et Roussel.<br />
Attendu que le sieur Paul-Albert Messin a, par exploit du 22 janvier 1876,<br />
enregistré, assigné le sieur Mantout devant ce tribunal, en nullité de venle<br />
de deux chevaux, remboursement de trois cent cinquante francs payés à<br />
titre d'à-compte sur le prix de six cents francs de dommages-intérêts, exécu<br />
— tion provisoire et dépens ; Attendu que le sieur Mantout avait, par exploit<br />
du 11 novembre 1875, enregistré, en prévision de celte action, assigné le<br />
sieur Demolins, devant ce même tribunal, en résiliation de vente, rembour<br />
sement du prix, deux cents francs de dommages-intérêls, garantie des<br />
damnations pouvant être prononcées contre ledit sieur Mantout au profit<br />
— d'un sieur Messin avec dépens; Atlendu que le même a, par autre exploit<br />
du 26 janvier 1876, enregistré, assigné le sieur Demolins devant cette juri<br />
diction, pour prendre fait et cause, le relever, et garantir du sièur Messin<br />
— avec mille francs de dommages-intérêts et dépens ; Sur la demande<br />
principale: Attendu que le sieur Messin a acheté du sieur Mantout deux<br />
chevaux, moyennant la somme de huit cent cinquanle francs ;<br />
Que ces che<br />
vaux ayant été conduits à Miliana, il s'est aperçu que l'un d'eux paraissait<br />
atteint d'une maladie contagieuse ; qu'il provoque alors la nomination d'un<br />
expert, lequel dresse un rapport constatant que l'un de ces chevaux était<br />
— atteint de farcin chronique ; Atlendu que le sieur Messin se base sur ce<br />
rapport pour demander, après observation des formes et délais prescrits par<br />
la loi en matière de vices rédhibitoires, la nullité de la vente des deux che<br />
— vaux à lui vendus par le sieur Mantout ; Atlendu que si cette prétention<br />
est évidemment fondée aux termes des art. 1641 du Code civil et 1 à 6 de la<br />
loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires en ce qui concerne le cheval<br />
farcineux, qui d'ailleurs est mort de celle maladie, elle ne saurait être ac<br />
cueillie en ce qui concerne le cheval trouvé sain par l'expert et qui jusqu'à<br />
—<br />
ce jour n'a cessé d'être en parfaite santé ; Attendu, en effet, que le sieur<br />
Messin n'établit pas qu'il ait acheté au sieur Mantout un attelage indivisible<br />
de deux chevaux ;<br />
— Qu'il<br />
résulte au contraire des faits ou circonstances<br />
ainsi que des pièces ou documents du procès qu'il a acheté purement el sim-<br />
plementdeux chevaux au sieur Mantout ;— Attendu que l'acheteur ne saurait<br />
par suite, dans ces conditions, réclamer, à raison du vice rédhibitoire de l'un<br />
des deux chevaux, la nullité de la vente de l'un et de l'autre ;<br />
— Altendu<br />
que le cheval farcineux était de quatre cent cinquante francs, que le sieur<br />
Messin n'a encore payé sur le prix des deux chevaux, qui esl de huit cent<br />
cinquante francs, que trois cent cinquante francs, qu'il reste donc devoir,<br />
déduction faite de la valeur du cheval farcineux, au sieur Mantout pour solde<br />
—<br />
de compte, la somme de cinquante francs ;<br />
Attendu que dans ces limites<br />
et sous ces restrictions, les conclusions principales du sieur Messin se trou-
vent justes et vérifiées;<br />
— Sur<br />
186<br />
la demande additionnelle en dommages-<br />
intérêts : Attendu qu'elle n'est pas justifiée ;<br />
Sur la demande en garantie : Altendu que le sieur Mantout a acheté, le<br />
2 novembre 1875, aux enchères publiques, à Alger, du commissaire-priseur<br />
Demolins, vendant pour le compte du sieur Roussel, un cheval appartenant<br />
— à ce dernier ; Attendu que le sieur Mantout base sa demande sur ce que le<br />
sieur Demolins lui aurait vendu ce cheval avec toute garantie ;<br />
qu'il convient, en tenant provisoirement pour constantes la formule de toute<br />
garantie et l'identité du cheval farcineux avec le cheval vendu par le "sieur<br />
Demolins au sieur Mantout, formule et identité qui sont contestées par l'ap<br />
pelé en garantie, de rechercher si, ces faits étant certains, le sieur Demolins<br />
est réellement garant à l'égard du sieur Mantout de la nullité de la vente du<br />
— Attendu<br />
— Attendu que le commissaire-priseur, officier ministériel,<br />
cheval farcineux ;<br />
n'est qu'un intermédiaire légal entre le vendeur et l'acheteur Manlout dans<br />
l'engagement particulier et personnel sus-indiqué ;<br />
— Qu'il<br />
n'est d'ailleurs<br />
articulé à la charge de cet officier public aucun fait de fraude ou de dol ni<br />
aucune faute ; que par .suite il ne saurait être garant à l'égard du sieur Man<br />
tout de la nullité de"<br />
la vente du cheval farcineux dont s'agit ;<br />
que celte solution est, dans l'espèce,<br />
— Atlendu<br />
d'autant plus certaine qu'il s'agit d'un<br />
vice caché que les connaissances professionnelles*du commissaire-priseur ne<br />
pouvaient lui faire connaître, puisqu'il avait échappé aux connaissances<br />
professionnelles supérieures en celte matière de l'acheteur qui exerce la pro<br />
fession de marchand de chevaux, et que d'ailleurs il n'est nullement néces<br />
saire de stipuler de garantie pour ce vice rédhibitoire, celle-ci existant de<br />
— plein droit, en ce cas, de par la loi; Atlendu qu'il résulte des considéra<br />
tions qui précèdent, que les conclusions du sieur Manlout à l'égard du sieur<br />
Demolins doivent être rejelées ;<br />
En ce qui concerne les dépens : Attendu qu'ils doivent être mis à la charge<br />
de la partie qui succombe ;<br />
Par ces motifs : Statuant en dernier ressort,sans s'arrêter comme inutile<br />
à l'offre du sieur Mantout d'établir par témoins la formule de toute garantie<br />
et 1'idenlilé du cheval farcineux avec celui qui lui a été vendu par le com<br />
missaire-priseur Demolins, déclare résiliée la vente du cheval farcineux faite<br />
par le sieur Manlout, condamne Messin à payer à Mantout, pour solde du<br />
prix d'achat du cheval non farcineux la somme de cinquante francs ; Or<br />
donne, atlendu l'existence d'une promesse reconnue, l'exécution provisoire<br />
—<br />
du présent jugement, nonobstant opposition ou appel el sans caution ;<br />
Condamne Mantout aux dépens delà présente instance envers le sieur Mes<br />
sin, y compris les frais de fourrière afférents au cheval farcineux ; Rejelle<br />
comme mal fondées ou non justifiées toutes autres fins ou conclusions du<br />
sieur Messin à l'égard du sieur Manlout. Déclare mal fondée la demande en<br />
garantie du sieur Manlout contre lesieurDemolins. Condamne le sieur Man<br />
tout aux dépens envers le sieur Demolins.<br />
Mes Bordet, Chatel et Letellier, av.
187<br />
TRIBUNAL DE PAIX DE BLIDA<br />
M. LISBONNE, juge de paix,<br />
7 juin 1878.<br />
I. Action possessoire, — Chose jugée.<br />
II. Cours d'eau. — Fossé. — Jouissance commune des eaux. —<br />
Mode d'exercice de cette jouissance.<br />
III. Trouble de possession. — Menace<br />
de trouble.<br />
I. La sentence rendue aupossessoire, en vue de la possession annale reconnue<br />
alors exister au profit d'une partie, ne préjuge rien sur l'état de la possession<br />
à une époque postérieure de plusieurs années, c'est-à-dire à un moment où la<br />
possession annale peut avoir changé de main ou de caractère ; et par suite cette<br />
sentence ne saurait être invoquée comme ayant l'autorité de la chose jugée sur<br />
une autre action possessoire intentée ultérieurement par la même partie (art. 23<br />
du C. de proc. civ., 1851 du C. civ.) (1).<br />
II . Est en possession d'un fossé séparant deux héritages,<br />
celle des parties<br />
qui l'a seul entretenu et en a périodiquement opéré le curage ; cette possession<br />
emporte avec elle la possession des eaux qui y coulent ; en conséquence, le<br />
propriétaire riverain ne peut détourner les eaux de ce fossé par la raison qu'il a<br />
la jouissance et la possession commune des eaux de la source dont dépendent<br />
celles coulant dans ledit fossé, alors que pour l'exercice de cette jouissance, il<br />
en a usé autrement pendant les dernières années qui ont précédé l'action pos<br />
sessoire .<br />
III. La menace d'un trouble peut donner ouverture à l'action possessoire, si<br />
cette menace est imminente et peut se réaliser sans entreprise nouvelle ; il en est<br />
surtout ainsi si, pendant l'instance et avant décision, le trouble s'est réalisé.<br />
Veuve L***c. A. D""<br />
Atlendu qne l'action intentée par la dame veuve L*"*<br />
contre le sieur A. D*'*<br />
rejève plusieurs faits de trouble que ce dernier aurait commis contre sa pos<br />
session, soit du barrage construit sur le cours d'eau Aïn-Beïda, soit de la<br />
rigole ou conduite d'eau servant à l'irrigation de ses terres, soit enfin du fossé<br />
— limitrophe qui sépare leurs propriétés respectives ; Altendu que les divers<br />
faits de trouble, distincts et indépendants les uns des autres, présentent des<br />
caractères différents, et doivent, pour leur solution, être examinés et appré<br />
ciés séparément, au point de vue qui leur est propre —<br />
; Qu'il y a donc lieu<br />
de les diviser en deux catégories : la première se rapportant au barrage el à<br />
—<br />
la rigole ; la deuxième aux tranchées ouvertes sur le fossé limitrophe ;<br />
d'après les déclarations<br />
Sur la première : Atlendu qu'il n'est point douteux,<br />
(1) Jurisp. conf. cass., 26 janvier 1869 (D. 1871. I, 207 et la note).
188<br />
des parties elles-mêmes, et d'après les dépositions de plusieurs des témoins<br />
de l'enquête et de la conlre-enquêfe, que depuis plus d'an et jour ce barrage<br />
et cette rigole sont dans l'état qu'ils se trouvent actuellement; qu'aucun<br />
changement n'y a été apporté; que dès lors, le trouble dont se plaint la dame<br />
L***, si trouble il y a, n'a point été commis dans l'année qu'a précédé son<br />
— action en justice; Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de sa<br />
demande les dispositions d'un jugement rendu au sur possessoire, le, même<br />
lequel l'a maintenue dans la possession dû barrage<br />
objet, le. 21 mai 1871,<br />
dont il s'agit, et que M. A. D***<br />
avait détruit, ainsi que de la rigole ou 'con<br />
duite d'eau que celui-ci avait comblée ; Que dès lors il y a sur ce point<br />
chose jugée; Que la possession lui a été adjugée et lui est définitivement<br />
acquise et ne peut plus être l'objet d'un trouble quelconque ; Qu'enfin<br />
les dispositions de l'art. 23 du Code de proc. civ. ne peuvent<br />
plus recevoir<br />
leur application, le défendeur ne pouvant plus exciperque d'une possession<br />
— entachée de précarilé ; Attendu que cet argument tiré de la chose jugée a<br />
longtemps divisé les auteurs et a même donné lieu à diverses décisions con<br />
tradictoires ; que néanmoins le dernier état de la jurisprudence, conforme à<br />
l'opinion de Dalloz, esl : que si depuis le jugement rendu au possessoire,<br />
le défendeur a repris la possession; s'il a lui-même acquis une possession<br />
annale et nouvelle, réunissant tous les caraclères exigés par l'art. 23 du Code<br />
de proc. civ., l'autorité de la chose jugée ne peut plus être utilement invo<br />
quée ;<br />
— C'est<br />
ainsi que cela a élé jugé par un arrêt de la Cour de cassation<br />
en date du 26 janvier qui a 1869, décidé que la sentence rendue au posses<br />
soire, en vue de la possession annale et reconnue alor,s exister,, ne préjuge rien<br />
surl'élat de la possession à une époque postérieure de plusieurs années, c'est-à-<br />
dire à un moment où la possession annale avait changé de main et de carac<br />
— tère ; Attendu donc que la'dame L **<br />
ne rélevant, quant à ce barrage et à<br />
la conduite d'eau ou rigole, aucun fait nouveau de possession et de trouble<br />
à cette possession, dans l'année qui a précédé sa demande en justice, et se<br />
fondant uniquement sur l'exception de la chose jugée en 1871, n'est point<br />
recevable dans son action, quant à ce premier —<br />
chef; Sur la deuxième :<br />
Attendu qu'il existe entre les propriétés L***<br />
el A. D***<br />
un grand fossé qui<br />
—<br />
sépare leurs héritages et qui reçoit les eaux de la source Aïn-Beïda;<br />
Atlendu qu'il résulte des dispositions de divers témoins de l'enquête que<br />
c'est toujours M. L***, seul, qui a fait opérer les travaux d'entretien et de<br />
—<br />
recurage de ce fossé ; Que ce point de fait n'a point été formellement dé<br />
nié par le sieur A. D***<br />
-- lui-même ; Altendu que les actes, ces seuls que<br />
puisse exiger la nalure de l'objet litigieux, ayanl toujours été exécutés par<br />
L***, à l'exclusion de tous autres, lui attribuent d'une manière indubitable<br />
— la possession exclusive de ce fossé ; Altendu qu'en pareil cas le juge du<br />
possessoire n'a point à examiner si le fossé est ou non mitoyen, la seule<br />
question qu'il ait à résoudre étant celle de la possession acquise par des acles<br />
caractéristiques ;<br />
D***<br />
— Atlendu qu'en cet état, le sieur A. a fait sur son<br />
terrain propre diverses tranchées qui viennent aboutir au bord du fossé dont<br />
il s'agit ;-— Attendu que la dame L***<br />
prétend que celle entreprise constitue<br />
un trouble à sa possession, ces Iranchées pouvant, à un momënl donné, être<br />
destinées par le sieur A. D***<br />
à détourner l'eau du fossé et à la répandre sur<br />
ges terres pour lés irriguer ; — Altendu que le défendeur repousse cette pré-
189<br />
tention : 1° parce que les tranchées existent depuis plus d'an et jour ; 2» qu'el<br />
les ont été ouvertes sur son propre terrain 3°<br />
; que quelques-unes de ces tran<br />
chées, sinon toutes, sont plutôt destinées au dessèchement de ses terres qu'à<br />
les irriguer, que ce qui le prouve suffisamment, c'est la différence de niveau<br />
existant entre son terrain et le lit du fossé ; 4*<br />
que d'ailleurs il n'y avait<br />
dans ce fait qu'une menace de trouble ne pouvant donner ouverture à une<br />
action possessoire 5°<br />
; que dans tous les cas il a, comme la dame L*"*, la<br />
jouissance commune des eaux d'Aïn-Beïda, et que partout il a le droil d'en<br />
user, comme bon lui semble, sans que la dame L***<br />
puisse prétendre qu'elle<br />
— est troublée dans sa possession ; Attendu que ces moyens de défense ne<br />
— sont point fondés ; Attendu tout d'abord, que s'il résulte de certaines dé<br />
positions des témoins de la contre-enquête, que les tranchées dont il s'agit<br />
ont élé ouvertes depuis plus d'une année, aucun de ces témoins n'indique<br />
que le sieur A. D***<br />
— les ait employées à irriguer ses terres; Il résulte<br />
également de l'inspection des lieux, que ces tranchées ne pourraient recevoir<br />
les eaux du fossé à moins d'établir des vannes pour les faire refluer et les<br />
répandre sur les terres du défendeur ;<br />
— Attendu<br />
qu'il ne ressort nullement<br />
tant de l'enquête que de la contre-enquête, que le sieur A. D***<br />
Ou ses au<br />
teurs aient irrigué leurs terres en délpurtiant les eaux du fossé, et que rien<br />
n'indique que ce mode d'arrosage ail été pratiqué au moyen de ces tranchées;<br />
— Attendu que si les faits de la cause se bornaient à cette situation, l'action<br />
de la dame L***<br />
serait non recevable ; et que quoique la menace de trouble<br />
puisse, suivant les circonstances, donner ouverture à une action possessoire,<br />
faut-il encore que l'entreprise présente un caractère de menace imminente<br />
— de trouble sans le concours d'entreprise nouvelle ; Mais, attendu que pen<br />
dant l'instance el avant sa solution, le sieur A. D***<br />
a récemment, et à la<br />
date des 7, 8, et 11 mai dernier, au moyen de barrages volants placés dans le<br />
lit du fossé, détourné les eaux qui y déroulent et les a conduites sur son ter<br />
—<br />
rain, au moyen des tranchées ou canaux ci-dessus mentionnés ; Que ces<br />
faits résultent de trois procès-verbaux dressés par le garde-champêtre de la<br />
commune d'Oued-el-Alleug, et ont donné lieu à la nouvelle citation intro<br />
— duite par la dame L*'*, à la date du 21 mai dernier; Atlendu que celte<br />
instance et celle primitivement introduite, par exploit du 27 décembre der<br />
nier, sont liées entre les mêmes parties; qu'elles sont relatives au même<br />
objet, et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction —<br />
; Attendu que par son<br />
entreprise nouvelle, le sieur A. D***<br />
a réellement troublé la dame L*** dans<br />
la possession du fossé limitrophe et que ce qui n'était qu'une menace de<br />
— trouble est devenu un trouble certain el réalisé ; Atlendu que sur ce point<br />
le sieur A.<br />
I)***<br />
prétend qu'ayant, concurremment avec la dame L***, la pos<br />
session el la jouissance commune des eaux d'Aïn Beïda ; que ces eaux élant<br />
les mimes que celles coulant dans le fossé limitrophe,<br />
et ayant la même<br />
il a le droit d'en user çoncuremment avec la demanderesse ;%—<br />
origine,<br />
Attendu que c'est là une erreur ; qu'en effèl il ne s'agit pas au procès du<br />
point de savoir si les eaux d'Aïn-Beïda sont communes aux deux parties;<br />
mais bien de rechercher si pour exercer l'usage de ce cours d'eau,. le sieur<br />
A. D***<br />
est fondé à ouvrir sur ce fossé, dont la possession est reconnue ap<br />
partenir à la défenderesse, des tranchées destinées à détourner les eaux de ce<br />
fossé, au détriment de celte —<br />
dernière; Attendu que le droil à l'usage des
190<br />
eaux d'Aïn-Beïda et le mode d'exercice dé ce droit, sont deux questions bien<br />
distinctes qui, d'après les faits et circonstances de la cause, sont sujettes à une<br />
—<br />
solution différente; Attendu qu'il n'a point été démontré que le sieur<br />
A. D***<br />
ni ses aient fait jamais usage des eaux d'Aïn-Beïda par le<br />
auteurs,<br />
fossé limitrophe; que les témoins, qui ont déposé sur les faits d'irrigation<br />
des propriétés du sieur A. D***, n'ont point déclaré et n'ont point reconnu<br />
que celui-ci ait exercé son droit à l'usage desdiles eaux par des coupures et<br />
tranchées faites au fossé séparatif ;<br />
— Que<br />
d'ailleurs ces tranchées n'existent<br />
que depuis quelques années seulement ; et aucun témoin n'a déclaré qu'elles<br />
aient été destinées à l'irrigation des terres dudit sieur A. D***<br />
;<br />
— Atlendu<br />
que celui-ci a si bien compris que les faits relevés par les enquéles et contre-<br />
enquêtes semblaient indiquer le contraire, que par des conclusions subsi<br />
diaires, il demande à prouver qu'à maintes reprises (en 1877, 1876 et 1875)<br />
les tranchées dont il s'agit ont élé employées à l'exercice du droit d'arrosage ;<br />
— Attendu que celte demande en supplément d'enquête est tardivement<br />
soulevée, et qu'il n'est point possible d'y faire droit alors que l'instruction<br />
est complète et parachevée, et qu'il y a eu déjà une première fois prorogation<br />
—<br />
d'enquête; Attendu donc, en résumé, qu'il y a lieu de maintenir la dame<br />
L***<br />
en possession du fossé qui sépare son héritage de celui du défendeur,<br />
D***<br />
ainsi que des eaux qui y sont contenues, sauf au sieur A. à exercer son<br />
droit d'arrosage de toute autre manière qu'en détournant, au moyen de<br />
— tranchées ou canaux, les eaux de ce fossé ; Attendu que les parties suc<br />
combant dans leurs prétentions respectives, il y a lieu de faire masse des<br />
dépens pour être répartis dans les proportions qui vont être indiquées ;<br />
Par ces motifs : Nous juge de paix, slatuant en premier ressort et contra-<br />
dictoirement, vidant notre interlocutoire du 2 janvier dernier, prenant<br />
droit des enquêtes et contre- enquêtes des 16 février, 2 et 9 mars derniers,<br />
ordonnons la jonction des deux instances introduites par exploits des 21<br />
décembre 1877 et 21 mai 1878. Et statuant au fond, déclarons la dame L*** non<br />
recevable et mal fondée dans sa demande relative au barrage et à la conduite<br />
— d'eau faisant l'objet du premier chef; Mais la maintenons dans la pareille<br />
possession du fossé. limitrophe ainsi que des eaux qui y sont contenues;<br />
faisons, en conséquence inhibitions et défenses au sieur A. D*** de la trou<br />
bler à l'avenir dans cette possession en détournant les eaux dudit|fpssé d'une<br />
manière quelconque, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. Le con<br />
damnons, pour le préjudice déjà occasionné, à payer à la dame L***<br />
de cent francs ù titre de dommages-intérêts ;<br />
seront supportés : 3/5e" par le sieur A. D*'*<br />
Par décret en date du 6 juin 1878 :<br />
— Faisons<br />
Nominations et mutations<br />
la somme<br />
masse des dépens qui<br />
et 2/5" par la dame L***.<br />
M. Hun, ancien juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, est nommé juge<br />
honoraire à ce siège.
Par décret du 6 juin 1878,<br />
191<br />
ont été nommés :<br />
Juge au Tribunal de 1« instance de Tizi-Ouzou, M. Treich-Laplène, juge<br />
de paix de Neuvic, licencié en droit, en remplacement de M. Arrighi qui a<br />
été nommé substitut du Procureur de la République .<br />
Notaire à Milianah, M. Lions, notaire à Dellys,<br />
Hunout.<br />
en remplacement de M.<br />
Notaire à Dellys, M. Lefèvre (Louis- Auguste-Edmond) , principal clerc de<br />
en remplacement de M. Lions.<br />
notaire,<br />
Par décret en dale du 8 juin 1878, ont été nommés :<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès (Algérie), M. Baffrey<br />
(Victor-MarieMeinrad), licencié en droit, en remplacement de M. Morellet<br />
qui est nommé juge de paix.<br />
Juge de paix de Laghouat (Algérie), M. Morellet, suppléant rétribué du<br />
juge de paix de Sidi-bel-Abbès. en remplacement de M. Dupont, démission<br />
naire.<br />
Juge de paix de Takilount (Algérie), M. de Laxagne,<br />
suppléant rétribué<br />
du juge de paix de Bordj-Menaïel, en remplacement de M. Patrimonio, qui<br />
a été nommé juge de paix à Tiaret.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Bordj-Menaïel (Algérie), M. Cauvy<br />
(Armand-Barthélémy), licencié en droit, en remplacement de M. de Laxagne,<br />
qui est nommé juge de paix.<br />
Par arrêté du Garde des Sceaux,<br />
en date du 31 mai 1878 :<br />
L'audience foraine établie à Ighil-Ali, canton d'Akbou,<br />
lazemalt, même canton.<br />
L'audience foraine établie à Bou-Hamza est supprimée.<br />
Par arrêté du Garde des Sceaux, en dale du 31 mai 1878 :<br />
est transférée à<br />
M. Balette, greffier de la justice de paix de Cassaigne est autorisé à remplir<br />
les fonctions de notaire aux attributions restreintes (section 2 du décret du<br />
18 janvier 1875).<br />
Par arrêté du procureur général en date du 13 juin 1878 :<br />
M. Mouty,<br />
successions vacantes<br />
missionnaire.<br />
Théâtres. —<br />
greffier de la Justice de paix de Djelfa est nommé curateur aux<br />
Droit<br />
dans'<br />
ce canton, en remplacement du sieur Louis, dé<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
des pauvres. — La<br />
loge dont le propriétaire d'une<br />
salle s'est réservé, par une clause du bail, la jouissance exclusive pour toutes
192<br />
les représentations, ne peut être considérée comme lui ayant été concédée à<br />
titre gratuit ; en conséquence, ce,tte loge est passible du.droit des pauvres. —<br />
Cons. de préf. de la Sejne, 24 janvier 1878 (Gag. des Mb. du 8 février 1878).<br />
Engagement militaike. --<br />
Incompétence.<br />
— Les tribunaux civils sont in<br />
compétents pour connaître de la validité des engagements militaires contrac<br />
tés en contravention aux dispositions de la loi militaire (par exemple, par<br />
un individu condamné pour vol à une peine d'emprisonnement), quand il<br />
ne s'agit dans la contestalion ni de l'Etat, ni des droits civils de l'engagé. Il<br />
appartient en pareil cas au Ministre de la guerre de statuer, sauf recours au<br />
Conseil d'État, par la voie contentieuse. —<br />
trib. du 15 février 1878).<br />
Règlement de juges .<br />
arrêt. — La<br />
Dijon,<br />
— — Arrêt d'incompétence . Disposition<br />
8 février 1878 (Gaz, des<br />
erronée de cet<br />
Cour de cassation, saisie d'une demande en règlement de juges<br />
afin de faire cesser un conflit négatif de juridictions, n'a pas à se prononcer<br />
sur la nullité de certaines dispositions et spécialement de la disposition de<br />
l'arrêt qui, bien que déclarant l'incompétence, condamne le prévenu aux<br />
frais de la procédure. Ce n'est pas le cas prévu par l'art. 536 du Code d'inst.<br />
crim., qui n'a entendu parler que des actes pouvant faire obstacle à ce que<br />
Arrêt de règle<br />
la Cour de cassation slatue sur le conflit de juridictions. —<br />
ment de juges dans l'aff. Étoumi ben Mohamed. —<br />
janvier 1878 (Gaz. des trib. du 8 février 1878).<br />
Dernier ressort. — Cie d'assurances. —<br />
Primes.<br />
Cass.<br />
Ch. crim., du 31<br />
— En matière d'assu<br />
rances, le taux du dernier ressort doit être fixé non par le chiffre des indem<br />
nités assurées, mais par le total de toutes les primes stipulées et dues en<br />
vertu de la police dont l'exécution est poursuivie, — Paris, 2e Ch., 8 janvier<br />
1878 (Gaz. des trib. du 8 février 1878).<br />
Cour d'assises. — — Liste dujury.<br />
Interprète.<br />
—<br />
I.<br />
Les irrégularités sans<br />
importance, portant sur l'orthographe des noms de trois jurés, ne sauraient<br />
induire l'accusé en erreur sur l'identité de ces jurés, ni nuire à son droit de<br />
récusation. — IL<br />
Un nouveau serment de l'interprète ayant assisté régulière<br />
ment l'accusé, lors du tirage du jury de jugement, n'est pas nécessaire pour<br />
l'assister aux débats, — Cass» Ch. crim., 31 janvier 1878 {Gaz, dès trib. du<br />
8 février 1678).<br />
Cour d'assises. — Interprète.<br />
—<br />
Il y a nullité lorsque le procès-verbal<br />
des débats exclut, par ses énonciations, la traduction de certaines dépositions<br />
de témoins. La mention finale et générale que l'interprète a prêté son mi<br />
nistère, chaque fois qu'il a été utile, ne saurait prévaloir sur les énonciations<br />
spéciales et exclusives. — Cass. Ch. crim. . 31 janvier 1878 (Gaz. des trib. du<br />
8 février 1878).<br />
Alger, i— Typ. A. Joubdun.
2e année. — Ier Juillet «878. —<br />
N° 37<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
Algérie. —<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
-<br />
LEGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. desReq.)<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />
I»rêt<br />
14 janvier 1878.<br />
à Intérêt. — Usure. — Commission.<br />
Banquier.<br />
La loi du 3 septembre 1807 n'étant pas applicable à l'Algérie, on ne saurait<br />
en aucun cas considérer comme entachée d'usure une convention relative à un<br />
prêt à intérêt, passée en Algérie,<br />
quel qu'en soit le taux ; peu importe du reste<br />
que les intérêts prétendus usuraires soient ou non déguisés sous la forme de<br />
droits de commission de banque stipulés entre les parties (1).<br />
Bijrgay c. Moutte et Girard.<br />
Sur le moyen pris de la violation et fausse application des art. 1152, 1153,<br />
—<br />
1154 et 1907 Code civil, 1 et 2 de l'ordonnance des 7-18 décembre 1835;<br />
Attendu que le pourvoi soutient que les intérêts accordés par l'arrêt au<br />
défendeur éventuel se sont élevés à un taux usuraire, par l'effet des droits de<br />
commission, qui n'étaient eux-mêmes que des intérêts déguisés ;<br />
que l'arrêt attaqué accorde, d'une part, au créancier Moutte, sur la somme<br />
de 27,637 fr. 90 c, un intérêt conventionnel de 12 p. % ou un intérêt légal<br />
de 10 selon les périodes de temps qu'il précise ; que, d'autre pari, il lui<br />
— Attendu<br />
(1) Un arrêt de la Cour d'Alger du 5 nov. 1861 (Robe, 1861, p. 247) a décidé,<br />
contrairement à l'arrêt rapporté, que bien que le taux de l'intérêt de l'argent ne<br />
soit pas limité en Algérie, néanmoins, lorsqu'il est excessif, il doit être considéré<br />
comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, comme offrant les carac<br />
tères du dol et de la violence chez celui qui le pratique, de l'erreur et de l'op<br />
pression chez celui qui le subit et par conséquent peut être réduit dans une cer<br />
taine mesure pas les tribunaux.<br />
Nous comprenons que cette décision importante et très-étudiée de la Cour<br />
d'Alger n'ait point fait jurisprudence ; en effet, bien qu'elle soit basée sur des<br />
principes d'une rectitude morale elle nous parait assurément con<br />
irréprochable,<br />
traire à la règle de la liberté des qu'il appartient aux tribunaux d'assu<br />
conventions,<br />
rer, mais qu'ils ne sauraient avoir le droit cte restreindre.<br />
V. M.
194<br />
accorde une commission de 12 p. %>, également à tilre de convention, sur la<br />
somme de 180,000 fr. montant des négociations d'effets entre les parties par<br />
—<br />
suite de leurs opérations de banque ; Altendu que l'intérêt accordé n'a pu<br />
la loi du 3 septembre 1807 n'étant pas<br />
avoir en lui-même rien d'usuraire,<br />
applicable à l'Algérie ; que les droits de commission n'ont pas eu davantage<br />
ce caractère ; qu'ils ont été fixés par les règlements intervenus entre les par<br />
ties et les comptes-courants fournis par Moutte et acceptés par Burgay, con<br />
formément à leurs conventions ;<br />
— Rejette.<br />
M. Bécot, rapp. ; M. Robinet de Cléry, av. gén. (c. conf). ; Me<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
25 mars 1878.<br />
Périer, av.<br />
Travaux publics. — Marché pour l'exécution des terrasse<br />
ments de chemina de fer. — Prix unique. — Défaut de<br />
sondages. — -— Forfait. Erreur. — Imprévision.<br />
Le marché par lequel un entrepreneur s'engage, envers une Compagnie de<br />
chemins de fer, à exécuter des travaux de terrassements « moyennant un prix<br />
unique s'appliquant au mètre cube de déblais de toute nature, exécutés suivant<br />
les profils prescrits et se rapportant aux divers terrassements de l'entreprise :<br />
terre ordinaire et gravier à la pelle ou à la bêche ; terrains marneux et pier<br />
reux, à la pioche ou au pic, roches disséminées ou en bancs compacts, exi<br />
geant l'emploi de coins, de la tranche, de la masse, de la pince, de la poudre,<br />
et cetera, quelles que soient d'ailleurs les largeurs et les profondeurs des<br />
tranchées à ouvrir et emprunts à effectuer el les inclinaisons données aux<br />
talus des terrassements », est un traité à forfait qui forme la loi des parties et<br />
gui doit être exécuté avec toutes les chances aléatoires auxquelles l'entrepreneur<br />
s'est sciemment exposé.<br />
Si donc l'entrepreneur rencontre des terrains non prévus au marché, il ne<br />
saurait être admis, pour justifier une demande en supplément de prix, à arguer<br />
de l'erreur,<br />
puisque la convention ne reposait ni sur des données certaines ni<br />
sur des prévisions arrêtées à l'avance.<br />
Il doit en être surtout ainsi lorsque la Compagnie n'ayant d'ailleurs pas<br />
procédé à des sondages préalables, l'entrepreneur a souscrit la stipulation<br />
suivante: « Je reconnais formellement par les présentes que la série des prix<br />
ci-annexée (<br />
sera la seule base admise pour le règlement de tous les travaux<br />
que j'aurai à exécuter jusqu'à la mise en exploitation du chemin de fer. Je<br />
reconnais, en outre, que tous les documents dont il m'a été donné connais-
195<br />
sance,- tels que plans, profils, métrés et dessins d'ouvrages,<br />
ainsi que les son<br />
dages effectués sur le terrain ne m'ont été fournis qu'à titre de simples<br />
renseignements, et ne saurait engager en rien la Compagnie, soit comme tracé<br />
de la ligne, soit comme importance des ouvrages dont l'exécution m'esl<br />
confiée. »<br />
Quant à Vimprévision, c'est là une théorie nouvelle, qui n'a pas pris place<br />
dans nos Codes, et qui est contraire à la loi (1) .<br />
(1)<br />
Voir l'arrêt suivant.<br />
Les principes sur lesquels roulent les procès de travaux publics sont nom<br />
breux et quelquefois contradictoires. Aussi ne croyons-nous pas qu'il soit possible<br />
d'en tirer une règle présentant des conditions suffisantes de certitude. C'est encore<br />
ce qui explique la variété des décisions rendues par les tribunaux en pareille ma<br />
tière. Les articles du Code civil le plus souvent invoqués sont les art. 1134, 1109,<br />
1110, 1108, 1126, 1156, 1163, 1104, 1964, 1793, 1794. Or la lecture de ces textes<br />
fait ressortir, par la comparaison de l'art. 1109 avec l'art. 1134, que si, dans un<br />
cas, le juge peut réformer le contrat pour cause d'erreur viciant le consentement,<br />
dans un autre, il maintiendra le contrat en rappelant les parties au respect dû aux<br />
conventions. Il se décidera donc toujours par des considérations de fait, et les<br />
recueils de jurisprudence ne contiendront guère que des solutions d'espèces.<br />
Nous essaierons cependant de résumer les discussions théoriques auxquelles la<br />
matière a donné lieu.<br />
Le marché de travaux publics, avec un prix moyen pour terrassements dans toute<br />
nature de terrains, est-il un marché à forfait, ou bien a-t-il le caractère d'un louage<br />
d'ouvrage ou d'un contrat aléatoire ? De graves autorités, telles que celle d'Aucoc<br />
(Conf. sur le droil administratif, t. 2, p. 147 et suiv.) se prononcent pour le louage<br />
d'ouvrage, après avoir écarté tant le marché à forfait que le contrat aléatoire, dont<br />
les conditions ne se rencontrent pas dans celui qui nous occupe. D'un côté, en<br />
effet, manquent le prix total invariable et un plan arrêté et convenu (art. 1793) ; de<br />
il n'est pas possible de considérer l'erreur ou l'imprévision comme un évé<br />
l'autre,<br />
nement incertain au sens de l'art. 1964, dans le cas duquel l'événement incertain<br />
est très-certainement prévu ; nous admettrons donc l'opinion de ceux qui pensent<br />
qu'il ne faut pas voir dans le marché pour terrassements dans toute nature de terrains,<br />
avec un prix moyen convenu, autre chose qu'un louage d'ouvrage, auquel sont<br />
applicables les principes généraux du droit, à l'exclusion des règles particulières à<br />
tel ou tel autre contrat.<br />
Et il sera juste de dire qu'il devra être tenu compte de l'erreur (art. 1109), et<br />
aussi que,<br />
toute convention devant être limitée à son objet propre (art. 1108 et<br />
1126), les travaux exécutés en dehors des prévisions constatées dans le contrat,<br />
devront faire l'objet d'un prix particulier.<br />
Nous ne saurions, en conséquence, partager l'avis si énergiquement exprimé par<br />
la lre Chambre delà Cour, au sujet de la théorie de l'imprévision.<br />
Quant à l'appréciation des conditions dans lesquelles doit être admise l'erreur ou<br />
l'imprévision, elle appartient souverainement au juge du fait, qui décide quels sont<br />
les travaux prévus par le devis, et-détermine les caractères de l'imprévision, soit<br />
que les ouvrages aient été réellement imprévus, soit que la quantité des ouvrages<br />
dépasse les limites soit enfin qu'il s'agisse d'ouvrages s'exécutant<br />
prévues, prévus,<br />
dans des conditions imprévues. Remarquons seulement que la théorie de l'erreur<br />
paraît être plus spécialement adoptée par les Cours d'appel, tandis que les tribu<br />
naux administratifs admettent plus généralement celle de l'imprévision.<br />
On consultera avec fruit, sur les questions relatives aux marchés de terrasse-
196<br />
Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien c. Robert.<br />
ARRÊT:<br />
Attendu, en fait, que la Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien avait<br />
mis en adjudication, sur la ligne de Constantine à Sétif, un lot de terrasse<br />
ments d'ouvrages d'art désigné sous le nom de deuxième lot, s'étendant<br />
entre le piquet 340. et le piquet 968, sur une longueur de 13 kilomètres<br />
— environ ; Que pour bien déterminer le caractère du marché à intervenir<br />
et préciser les charges de l'entreprise, la Compagnie avait publié un imprimé<br />
contenant la série des prix, avec les clauses et conditions de la soumission ;<br />
— Que<br />
dans l'article premier, on indiquait que les terrassements à opérer et<br />
le prix afférent par chaque mètre cube, s'appliquaient aux déblais de toute<br />
— nalure ; Que pour prévenir toute incertitude sur la partie de cette clause,<br />
une note mise au bas de l'art. 1", prenait soin d'expliquer: « Que le prix<br />
» s'appliquait au mètre cube de déblais de toute nalure, exécutés suivant les<br />
» profils prescrits et se rapportant aux divers terrassements de l'entreprise ;<br />
» terre ordinaire el gravier à la pelle ou à la bêche ; terrains marneux et<br />
» pierreux à la pioctre ou au pic ; roches disséminées ou en bancs compacts,<br />
» exigeant l'emploi de coins, de la traillhe, de la masse, de la pince, de la<br />
» poudre, etc., quelles que soient d'ailleurs les largeurs et les profondeurs<br />
» des tranchées à ouvrir et emprunts à effectuer et les inclinaisons données<br />
» aux talus des terrassements. » — Que<br />
la Compagnie qui témoignait ainsi,<br />
par des stipulations explicites l'intention de laisser les entrepreneurs exécu<br />
ter les travaux à leurs périls et risques, marquait encore davantage le carac<br />
tère aléatoire de l'entreprise en s'abstenanl de faire aucun sondage préalable;<br />
— Qu'elle ne fournissait elle-même aucune donnée pouvant éclairer les<br />
entrepreneurs sur les difficultés plus ou moins grandes qu'ils pouvaient<br />
rencontrer dans l'exécution des travaux ;<br />
—<br />
. Que vainement les frères Robert<br />
prétendent avoir reçu verbalement de l'ingénieur de la Compagnie des ren<br />
seignements propres à les fixer sur la nature des terrassements ;<br />
allégation formellement déniée n'est appuyée d'aucune preuve ;<br />
— Que<br />
— Que<br />
cette<br />
c'est<br />
sans plus de fondement qu'ils invoquent la communication qui leur aurait<br />
été faite, après le dépôt de leur soumission, d'une note du même ingénieur<br />
le sens de cette<br />
— donnant des indications sur les terrains à fouiller ; Que<br />
note est contesté et qu'il se peut, en effet, ainsi que le déclare l'auteur,<br />
qu'elle ait eu exclusivement pour but de déterminer, aux termes de l'art. 4<br />
de la série des prix, la plus-value pour la mise en dépôt des matériaux utili<br />
d'ailleurs,<br />
—<br />
sables ; Que ces circonstances antérieures au marché deviennent<br />
indifférentes en présence des clauses formelles de ce marché qui précisent<br />
effet, dans la<br />
— définitivement les engagements respectifs des parties ; Qu'en<br />
convention enregistrée des 1« et 3 mars 1877, les frères Robert déclarent<br />
formellement s'obliger à exécuter les travaux dans les conditions fixées par<br />
ments, les Clauses et conditions générales de 1833, le Commentaire qu'en a publié<br />
et l'Étude sur la jurisprudence en matière de terrassements de M. Wil<br />
M. Barry,<br />
liam Nordling.<br />
H. N.
197<br />
la série des prix qu'ils ont signée ; acceptant ainsi la clause caractéristique de<br />
l'art. 1« —<br />
précité; Que de plus, et par surcroit de précaution, la Compa<br />
gnie faisait insérer dans le traité la stipulation suivante souscrite par les<br />
entrepreneurs : « Je reconnais formellement, par la présente, que la série<br />
sera la seule base admise<br />
» des prix ci-Nannexée, visée par les deux parties,<br />
» pour lé règlement de tous les travaux que j'aurai à exécuter jusqu'à la<br />
» mise en exploitation du chemin de fer; je reconnais, en outre, que tous<br />
» les documents dont il m'a été donné connaissance, tels que plans, profils,<br />
» métrés et dessins d'ouvrages, ainsi que les sondages effectués sur le terrain,<br />
o ne m'ont été fournis qu'à titre de simples renseignements, et ne sauraient<br />
» engager en rien la Compagnie soit comme tracé de la ligne, soil comme im-<br />
» portancedes ouvrages dont l'exécution m'est confiée. » — Atlendu qu'il ré<br />
sulte des termes si nets de cette convention, de l'esprit qui y-a présidé, des faits<br />
qui ont précédé, accompagné et suivi le truite intervenu entre les parties, qu'il<br />
s'agit, dans l'espèce, d'un marché à forfait conclu sur prix unique, en ce qui<br />
— concerne les terrassements ; Que la conséquence qui découle d'une con<br />
vention de ce genre, c'esl que les avantages ou désavantages de l'entreprise<br />
—<br />
prévus ou imprévus sont pour le compte des entrepreneurs ; Que ceux-ci<br />
ne sauraient arguer de l'erreur puisqu'ils se sont sciemment exposés à des<br />
chances aléatoires, et que la convention, au moment où elle est intervenue,<br />
ne reposait ni sur des données certaines, ni sur des prévisions arrêtées à<br />
l'avance ;<br />
— Qu'en<br />
pareil cas, les entrepreneurs traitant à forfait ne sont pas<br />
plus fondés à se plaindre d'une exploitation onéreuse que la Compagnie ne le<br />
serait elle-même à réclamer contre des résultats trop favorables aux entre<br />
preneurs ;<br />
— Qu'autrement<br />
ce serait, sous prétexte d'équité, mais contraire<br />
ment à là loi, à la faveur d'une théorie nouvelle, celle de l'imprévision, qui<br />
n'a pas pris place dans nos Codes, refaire le marché el substituer au contrat<br />
— librement consenti par les parties, un aulre contrat; Attendu que les<br />
frères Robert ont, d'ailleurs, notablement exagéré le préjudice auquel ils<br />
— prélentent être exposés; Qu'en effet, après qu'ils ont eu abandonné les<br />
travaux, la Compagnie a pu traiter avec d'autres entrepreneurs pour le prix<br />
de deux francs cinquante centimes, et qu'il est expliqué dans ce nouveau<br />
traité que l'élévation du prix est motivée par cette circonstance que les<br />
entrepreneurs sortants avaient opéré tous les déblais faciles et les transports à<br />
—<br />
courte distance ; Attendu, dès lors, que les premiers juges, en accueillant<br />
l'action des frères Robert, ont violé -la convention qui était la loi des parties ;<br />
— — Qu'il y a lieu d'infirmer sur l'appel principal ; Et quant à l'appel inci<br />
dent : Attendu que la Compagnie reconnaît que le tribunal a statué ultra<br />
petita, en lui allouant des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas actuel<br />
— lement ; Qu'elle se borne, quant à présent, à demander qu'il lui soit<br />
donné acte de ses réserves à cet égard.<br />
Par ces motifs : LA COUR, statuant tant sur l'appel principal que sur<br />
l'appel incident, infirme le jugement déféré. Déclare les frères Robert mal<br />
fondés dans leur deman.de et les en déboule. Les décharge de la condamna-<br />
nation à dix mille francs de dommages-intérêts à laquelle il n'avait pas été<br />
conclu. Les condamne néanmoins aux dépens de première instance et d'appel.<br />
Donne acte à la Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien de ses réserves<br />
à l'égard de l'action en dommages-intérêts qui peut lui appartenir pour
198<br />
inexécution du traité par les frères Robert ainsi que de tous autres droits et<br />
actions. Ordonne la restitution des amendes consignées.<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén. (concl. conf.) ; Mes F. Huré<br />
Travaux publics. — Terrassements,<br />
et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. #ASTIEN, président.<br />
24 janvier 1878.<br />
—<br />
prévue et imprévue, — — Quantité imprévue. Marché<br />
nant un prix unique.<br />
Mature<br />
des terrains<br />
moyen<br />
— Constatation des travaux imprévus.<br />
—<br />
— — Métré et réception. Situations provisoires. Situation<br />
définitive.<br />
Lorsque des entrepreneurs se sont engagés envers une Compagnie de chemins<br />
de fer, àexécuter des terrassements dans toute nature de terrains,<br />
moyen unique par mètre cube ;<br />
pour unprix<br />
— si des études et des sondages ont été préala<br />
blement effectués par la Compagnie et communiqués auxdits entrepreneurs,<br />
avant la signature du marché,<br />
— lesdits<br />
éludes et sondages révélant!plusieurs<br />
natures de terrains déterminées, et indiquant les quantités à mettre en mouve<br />
le traité intervenu entre les entrepreneurs et la<br />
ment pour chacune d'elles, —<br />
Compagnie ne constitue pas un traité à forfait général s'appliquant à tous les<br />
terrains quelconques qui pourront se rencontrer, mais seulement aux catégories<br />
annoncées par les études.<br />
Si donc une de ces catégories dépasse les prévisions indiquées par la Compa<br />
gnie,<br />
les entrepreneurs n'ont rien à réclamer pour le préjudice qui pourrait en<br />
résulter pour eux .<br />
Mais s'il arrive qu'ils aient à exécutefdes travaux non prévus, ils pourront<br />
en demander le paiement aux prix en usage.<br />
Il importerait peu que le marché stipulât que les documents fournis par la<br />
Compagnie n'engagent en rien l'administration et ne déterminent nullement<br />
l'importance des travaux, cette clause n'ayant pour effet de dégager la Com<br />
pagnie qu'en ce qui concerne les erreurs commises dans les indications données<br />
pour chaque nature de terrain prévue (I).<br />
Toutefois les travaux imprévus doivent être constatés à mesure qu'ils s'ac<br />
complissent, et les réclamations qui surviendraient alors que les vérifications<br />
11) Voir la note sous l'arrêt précédent.
199<br />
seraient devenues difficiles, devraient être considérées comme tardives et non<br />
avenues .<br />
L'état de situation définitive qui n'a pas été précédé du métré et de la ré<br />
ception contradictoires des travaux n'a de caractère définitif qu'en ce qui con<br />
cerne la récapitulation des à-compte versés aux entrepreneurs selon les situa<br />
tions provisoires,<br />
— et ne saurait être considéré comme arrêtant définitive<br />
ment le compte des parties . — Les principes généraux du droit et les instruc<br />
tions de l'administration des Ponts-et-Chaussées,<br />
qui servent de règle en<br />
matière de travaux publics, veulent, en effet, que la déchéance opposable aux<br />
entrepreneurs ne puisse résulter que du métré et de la réception définitifs, qui<br />
doivent toujours avoir lieu .<br />
RlCHEMONT C. DÉFASQUES et MÉREL<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Considérant que par un marché du 3 mai 1875 qui sera enre<br />
gistré avec le présent arrêt, Défasques et compagnie se sont engagés à faire,<br />
pour le compte de la Compagnie du chemin de fer du Tlélat à Sidi-bel-<br />
Abbès, des terrassements et ouvrages d'art formant un premier lot de travaux<br />
enlre le 8e — kil. 226 et le dixième kilomètre; Que ces travaux ont été<br />
terminés le 30 septembre 1876, aux termes d'un état des sommes à payer à<br />
cette date, état approuvé par les parties, qui sera enregistré avec le présent<br />
arrêt et qui est intervenu sur une situation qualifiée de définitive ;<br />
sidérant que, le 6 octobre 1875, a été conclu enlre les mêmes parties un<br />
second marché, lequel sera enregistré avec le présent ayant arrêt, pour objet<br />
— Con<br />
un second lot de travaux de même nature que les premiers et s'étendant du<br />
10e kil. au 16e kil. 800, de la même voie ferrée ; Qu'il résulte des docu<br />
ments de la cause que les travaux de ce second lot ont été terminés à la fin<br />
d'avril 1877 ; Que les deux marchés sont conçus en des termes identiques,<br />
en ce qui concerne les terrassements ; Que les entrepreneurs se chargent<br />
des terrassements dans toute nature de terrain, avec emploi aux remblais,<br />
dressement des plates-formes et des talus, pour le prix moyen unique de<br />
1 fr. 35 c. le mètre cube, pour le premier lot et de 1 fr. 45 c. pour le se<br />
cond ; Que les entrepreneurs demandent aujourd'hui un prix nouveau et<br />
supplémentaire à fixer pour des ouvrages d'après eux imprévus, à recon<br />
naître préalablement par une expertise et qui consisteraient en déblais et<br />
remblais de puddings, rochers, blocs erratiques, grès et tufs, à la poudre;<br />
Que devant la Cour, Richemont déclare, par l'organe de son défenseur, con<br />
clure, au nom, pour le compte et aux risques de la Compagnie du chemin de<br />
fer, qu'il a déjà représentée dans les contrats intervenus avec les entrepre<br />
neurs ; Que la Compagnie objecte, en ce qui concerne le premier lot, qu'il<br />
ne saurait être l'objet d'aucune réclamation, que la quantité des travaux,<br />
leur nature et leur prix ont été définitivement réglés par la situation dite<br />
définitive du 30 septembre 1876;— Considérant qu'il résulte des docu<br />
ments de la cause que cet état de situation n'a pas été précédé de la réception<br />
des travaux ; Que ce n'est qu'assez longtemps après, et en mai 1877, que<br />
a Compagnie a envoyé aux entrepreneurs son état des travaux du premier
200<br />
lot qui devait servir de base au métré et à la réception contradictoires ; Que<br />
par conséquent le compte des parties n'avait pu être définitivement arrêté en<br />
septembre 1876, soit qu'on se place au point de vue des principes généraux<br />
soit que l'on considère plus spécialement les instructions de l'ad<br />
du droit,<br />
ministration des Ponts-et-Chaussées sous l'empire desquels les parties avaient<br />
entendu contracter; Que la situation du 30 septembre 1876 ne pouvait avoir<br />
de caractère définitif que pour la récapitulation qu'elle présente des à-comples<br />
alors versés aux entrepreneurs selon les situations provisoires.<br />
Au fond : — Considérant qu'il est reconnu par les parties que les marchés<br />
intervenus ont été précédés d'études et de sondages opérés par la Compagnie<br />
sans le concours des entrepreneurs ; Qu'avant lout traité, la Compagnie a<br />
publié dans les journaux que les personnes désireuses d'entreprendre ses tra<br />
vaux trouveraient dans les bureaux les renseignements nécessaires pour<br />
asseoir leurs offres ; Que le résultat des travaux d'études a été communiqué<br />
aux entrepreneurs avant la signature des marchés ;<br />
— Considérant que les<br />
études de la Compagnie et ses classifications de terrains pour le premier lot<br />
ont même été remises aux entrepreneurs ; Que si ceux-ci ne sont pas por<br />
teurs du même document pour le second lot,<br />
ce fait n'indique pas moins<br />
l'importance considérable que les contractants ont attachée aux études pré<br />
liminaires faites par la Compagnie ; Qu'il résulte des documents de la cause<br />
que les entrepreneurs n'ont fait aucun travail personnel pour contrôler l'exac<br />
titude de ces documents ; Que les parties n'ont pas eu l'intention d'établir<br />
un forfait général ; Qu'on n'a pas à l'avance déterminé un prix total unique<br />
pour les travaux à effectuer ; Que le prix unique déterminé à tant la mesure<br />
n'en resle pas moins un prix de louage de services el la rémunération de<br />
travaux tels qu'ils ont élé prévus par les conlractants ; Que si les entrepre<br />
neurs ont pris à leur charge les risques et les difficultés des déblais et rem<br />
blais dans toule nature de terrain, il faut éclairer cette stipulation par les<br />
constatations de fait qui précèdent; Que les traités sont intervenus sans que<br />
les parties eussent d'autre élément que lesétudesdela Compagnie, lesquelles<br />
révélaient plusieurs natures de terrain déterminées, et indiquaient les quan<br />
tités à mettre en mouvement pour chacune d'elles; Que c'est à ces catégories<br />
dénommées que les parties appliquaient ces mots : toute nature de terrain,<br />
qui ne pouvaient se référer qu'à ce qui avait fait l'objet de leurs prévisions ;<br />
Que c'est dans le cercle de ces prévisions établies et sur leur ensemble seu<br />
lement, qu'ont élé fixés les prix moyens uniques, de telle sorte que les entre<br />
preneurs n'auraient pu réclamer si, à leur préjudice, une des catégories de<br />
terrain annoncées avait dépassé les prévisions des éludes de la Compagnie ;<br />
Que c'est aussi dans ce sens que doit êlre entendue cette clause des marchés,<br />
que les documents fournis par la Compagnie n'engagent en rien l'adminis<br />
tration et ne déterminent nullement l'importance des travaux; Qu'avec celle<br />
clause la Compagnie n'est pas responsable des quantités de chaque nalure<br />
par elle prévues ; Mais que si les études préliminaires ne fixent pas absolu<br />
ment les difficultés des travaux à faire, elles en ont, du moins, dans l'état<br />
des faits constatés, déterminé la nature et la limite ; Que Si on faisait abs<br />
traction de ces éludes, les intentions des parties au moment du contrat n'au<br />
raient eu aucune base qui pût les fixer; et que cependant elles n'ont pas<br />
déclarer traiter à forfait ;<br />
— Mais<br />
considérant que, d'après leurs contrats,
201<br />
les entrepreneurs n'ignoraient pas qu'ils travaillaient sous l'empire d'une<br />
stipulation qui fixait deux prix uniques pour les terrassements prévus; Que<br />
dans toutes les situations provisoires du premier lot, et dans celles du second<br />
lot jusqu'en septembre 1876, ils ont fait l'application des prix uniques sans<br />
aucune réclamation ; Qu'ils ont ainsi reconnu que le prix unique s'appli<br />
quait légitimement alors à tous les travaux effectués el qu'il n'apparaissait<br />
en ce moment aucun travail imprévu donnant lieu à l'application d'un prix<br />
différent;<br />
Que c'est seulement au moment de l'achèvement du premier lot<br />
que, par la lettre du 20 septembre 1876, qui sera enregistrée avec le présent<br />
arrêt, les entrepreneurs ont produit pour la première fois leurs prétentions<br />
actuelles; Que par conséquent on ne peut ajouter aujourd'hui aucune créance<br />
à celles de leurs réclamations qui ont pour objet des travaux antérieurs;<br />
Que ce serait ouvrir la porte à toutes les incertitudes el à tous les abus, que<br />
de permettre aux entrepreneurs de ne pas faire constater, à mesure qu'ils se<br />
produisent, les faits dans lesquels ils croient trouver l'origine d'un droit nou<br />
veau el extrinsèque aux stipulations de leur contrat ; Qu'ils ne peuvent<br />
ajourner leurs réclamations à la fin des travaux, quand les vérifications se<br />
ront devenues difficiles; Que dans l'espèce la Compagnie a voulu se sous<br />
traire à ce danger en stipulant, dans l'article 3 des traités, que les entrepre<br />
neurs seraient tenus, sous peine de renonciation à toute réclamation, de<br />
faire constater, à mesure qu'ils se produiraient, les travaux dont la vérifica<br />
tion ultérieure présenterait des difficultés; Que telle est la nature des tra<br />
vaux qui font l'objet du procès; Que cette prescription doit surtout s'appli<br />
quer rigoureusement aux travaux non prévus aux traités ou aux devis; Que<br />
tandis que ces actes peuvent toujours et ultérieurement servir d'élément de<br />
constatation pour les travaux eflectués qu'ils avaient prévus, on ne peut cons<br />
tater sûrement la nature et l'importance des travaux imprévus, qu'en les<br />
examinant au moment même où il s'accomplissent ; Qu'en ce qui les concerne,<br />
tant autre élément fait défaut ; Que par conséquent les intimés doivent être<br />
déclarés non recevables en toule réclamation dont l'objet serait antérieur à<br />
la situation provisoire mensuelle de septembre 1876 ; Qu'il résulte de leurs<br />
propres agissements, des faits de la cause et des conventions intervenues,<br />
que les entrepreneurs sont censés avoir renoncé à toute réclamation de cette<br />
nature ;<br />
— Considérant<br />
qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne pourra y<br />
avoir lieu à un prix spécial pour travaux de déblais ou remblais non prévus<br />
aux marchés que pour les travaux du second lot, postérieurs au 1er sep<br />
tembre 1876; Que pour les rechercher, l'expert aura à rapprocher de ses<br />
constatations sur le terrain, les catégories qui ont été indiquées par les<br />
études préliminaires de la Compagnie quant au second lot; Que s'il constaie<br />
des travaux de terrassements non prévus à ces catégories, il leur appliquera<br />
les prix indiqués à l'article 5 du deuxième marché qui a prévu celte situa<br />
tion.<br />
Par ces motifs : Donne acte aux intimés de ce que la Compagnie du che<br />
min de fer du Tlélat à Sidi-bel-Abbès a déclaré conclure par M* Chéronnet ;<br />
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il y avait lieu à expertise à<br />
—<br />
l'effet d'examiner tous les travaux faits à l'entreprise parles intimés. Ré-<br />
formanl pour le surplus: Dit que l'expert sera désigné parmi les fonction<br />
naires des Ponts-et-Chaussées d'Oran, par le juge de paix d'Oran, délégué par
.202<br />
la Cour, et qu'il prêtera serment entre les mains de ce magistrat, aulorisé à<br />
remplacer l'expert premier nommé en cas de refus ou d'empêchement. Dit<br />
que pour les travaux du premier lot, l'expert appliquera exclusivement les<br />
prix du marché de mai 1875, notamment, à tous les travaux de déblai et de<br />
remblai sans en distinguer la nature, le prix unique de 1 fr. 35 c. le mètre<br />
cube. Qu'il opérera de la même façon pour tous les travaux du second lot<br />
effectués jusqu'au 1" septembre 1876, leur appliquant les prix du marché<br />
du 6 octobre 1875, et, notamment, à tous les travaux de déblai et de remblai,<br />
le prix unique de 1 fr. 45 c. le mètre cube. Dit que pour tous les travaux<br />
du second lot postérieurs au 1er septembre 1876, l'expert appliquera le prix<br />
de 1 fr. 45 c. le mètre cube à tous les travaux de déblai ou remblai prévus<br />
Qu'il fera en dehors le décompte<br />
aux études^préliminaires du deuxième lot;<br />
des déblais et remblais non prévus à ces études et qu'il leur appliquera les<br />
prix en usage dans l'arrondissement, ou, à leur défaut,<br />
ceux adoptés pour les<br />
travaux d'entretien de la route de Sainle-Rarbe à Rel-Abbès. Dit qu'après<br />
l'expertise, l'affaire reviendra au fond devant le Tribunal de Commerce d'O<br />
ran, composé d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement réformé.<br />
— Ordonne la restitution de l'amende d'appel; Condamne la Compagnie ap<br />
pelante au tiers et les intimés aux deux tiers des dépens d'appel. Réserve les<br />
dépens de 1 instance sur lesquels il sera statué pap le jugement qui inter<br />
viendra après l'expertise. Dit que les frais des enregistrements ordonnés par<br />
le présent arrêt seront réservés et suivront le sort des dépens de lre instance<br />
réservés.<br />
M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ; Mes Chéronnet et Robe, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />
19 novembre 1877.<br />
Droit musulman . — Partage de succession ,<br />
intenter l'action en rescision. — Donation.<br />
—<br />
— Délai<br />
pour<br />
Formes.<br />
En droit musulman, le cohéritier qui a laissé passer un an sans réclamer<br />
contre le partage d'une succession, n'est plus recevable à diriger contre ce par<br />
tage une action en rescision (1).<br />
Une donation qui ne repose que sur de simples déclarations de témoins, peut<br />
cependant être considérée comme sincère , lorsqu'elle est rendue vraisemblable<br />
par les circonstances de la cause et que lors d'un partage, sa réalité a été admise<br />
par tous les héritiers copartageants (2).<br />
(1) D'après l'ouvrage de MM. Sautayra et Cherbonneau ( II, p. 277 ), le délai<br />
pour intenter l'action en rescision, n'est pas fixé avec autant de précision. Cette<br />
action doit seulement être intentée dans un court espace de temps, comme disent les<br />
jurisconsultes musulmans .<br />
(2) Jurisp, conf. — Voir<br />
Sautayra et Cherbonneau, II, p. 368,
203<br />
Hahda bent Omara c. Ohm Hani bent Zerrouk .<br />
Attendu que l'intimée a déclaré elle-même devant la Cour qu'elle n'en-<br />
lendait pas revenir sur le partage consommé en ce qu'il portait sur l'une<br />
des moitiés de la succession, mais qu'elle réclamait seulement sa part dans<br />
—<br />
l'autre .Attendu moitié;<br />
que la demande circonscrite dans ces termes<br />
tend à faire naître la question de savoir si la donation dont se prévaut l'ap<br />
— pelante est sincère et valable ; Attendu que quelque insolite que soit la<br />
forme dans laquelle cet acte est conçu et quelle que soit la défaveur avec<br />
laquelle la justice accueille d'ordinaire les donations qui ne reposent que sur<br />
de simples déclarations de témoins, il ne faut pas oublier qu'au cas particu<br />
lier, cette donation, d'après les déclarations de l'appelante, n'aurait élé faite<br />
qu'en compensation de ses prétentions antérieures et pour la remplir de ses<br />
droits de créance vis-à-vis de son défunt mari, soit à raison de sa dot, soit à<br />
—<br />
raison des biens qu'elle aurait recueillis dans la succession de ses parents ;<br />
Attendu que telle paraît avoir été la portée que tous les héritiers ont don<br />
née à la donation dont s'agit, lors du partage du 1er juin, puisqu'à ce mo<br />
ment aucune protestation ne s'est produite et qu'au moment actuel encore,<br />
—<br />
aucun des autres héritiers n'a réclamé ; Attendu qu'en droit musulman<br />
on n'est pas admis à revenir contre un partage, quand on a laissé passer le<br />
— délai d'un an sans réclamer; Attendu qu'il y a «J'aulanl plus lieu d'ap<br />
pliquer ce principe que d'après les considérations précédemment exposées, le<br />
partage du 1er juin, malgré quelques erreurs de chiffres, parait avoir tenu<br />
compte des droits respectifs de chacune des parties en cause ;<br />
Par ces motifs : infirme, émendant et statuant sur les fins de 1a demande<br />
originaire déclare la demanderesse non recevable et mal fondée en icelle, la<br />
déboute et la condamne en tous les dépens.<br />
M. Lauth, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén,; M«s Mallarmé et Honel, av.<br />
Algérie. Juge<br />
TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (1" Ch).<br />
Présidence de M. DEDREUIL-PAULET, président.<br />
24 janvier 1878.<br />
— Indigènes musulmans. —<br />
matière musulmane. — Appel.<br />
de paix siégeant en<br />
Toutes les fois que des indigènes musulmans portent d'un commun accord<br />
leur différend devant lejuge de paix, sans que cette contestation ait le carac<br />
tère d'une action immobilière tombant sous l'application de la loi du 26 juillet<br />
1873, le juge de paix juge conformément aux dispositions du décret du<br />
31 décembre 1866, et l'appel de ses décisions est porté devant le tribunal d'appel<br />
musulman, et non devant le tribunal civil.
204<br />
En conséquence te tribunal civil, saisi d'un appel semblable, doit, même<br />
d'office,<br />
se déclarer incompétent pour en connaître (1).<br />
Mohamed ben Aouda c. Larbi ben Kouach.<br />
Attendu que suivant exploit de Delpech, huissier à Coléah, du 24 novem<br />
bre 1875, le sieur Larbi ben Kouach a fait assigner le sieur Mohamed ben<br />
Aouda devant M. le juge de paix de Coléah à l'effet de s'enlendre, le dit<br />
défendeur,<br />
condamner à lui payer la somme de 600 fr. pour réparation d'un<br />
préjudice étant résulté pour lui de l'indue occupation par ledit Mohamed<br />
ben Aouda d'une lerre de la contenance d'environ deux hectares, sise au<br />
quartier de Fohsghen, canton de Coléah, figurée au plan de lotissement sous<br />
—<br />
len°80; Altendu que devant le premier juge, le sieur Mohamed ben<br />
Aouda a, sur celle demande, offert au sieur Larbi ben Kouach de le laisser<br />
jouir, à titre de dédommagement du préjudice allégué, d'une parcelle de<br />
— terre d'égale contenance voisine de la terre indûment occupée ; Altendu<br />
que statuant sur les prétentions respectives des parties, M. le juge de paix a,<br />
suivant jugement du 27 novembre 1875, condamné le sieur Mohamed ben<br />
Aouda à délaisser, dans l'état où il se trouvait, le terrain du sieur Larbi ben<br />
Kouach, et à défaut de cet abandon dans un délai de 10 jours, à payer un<br />
—<br />
prix de location de 100 fr. pour l'année à échoir au 15 octobre 1876;<br />
Atlendu que par exploit du même huissier Delpech, du 31 décembre 1875,<br />
ledit sieur Mohamed ben Aouda a interjeté appel de celle instance devant le<br />
— tribunal civil d'Alger; Attendu que, de son côté, le sieur Larbi ben<br />
Kouach a émis appel incident de la même décision ;<br />
Attendu que le tribunal n'a pas compétence pour connaître de ces appels ;<br />
—<br />
Attendu, en effet, que lorsque des indigènes musulmans veulent, d'un<br />
commun accord, saisir la justice française de leurs conteslations, c'est, sans<br />
doute,<br />
d'abord,<br />
à la juridiction des juges de paix qu'ils ont le devoir de s'adresser<br />
en observant devant ces magistrats les formes de la procédure fran<br />
—<br />
çaise; Mais attendu que, dans ce cas, la juridiction du juge de paix esl<br />
substituée à celle du cadi et lui est assimilée pour le taux du premier et du<br />
— dernier ressort; Atlendu que l'appel des décisions qui émanent alors de<br />
cette juridiction transformée doit se porter devant la Cour d'appel d'Alger,<br />
— pour l'arrondissement d'Alger; Attendu que ces règles sont certaines,<br />
qu'elles se trouvent tracées dans les articles 21, 23 et 24 du décret du 13-31<br />
"(1) Cette décision est l'application de la jurisprudence de la Cour, qui interprète<br />
dans un sens absolument restrictif, à ce point de vue, les dispositions du décret<br />
de 1866. Alger, 6 janvier 1877 (Bull, jud., 1877, p. 90), Alger, 24 novembre 1877<br />
(Bull, jud., 1878, p. 60) et Alger, 12 février 1878 (Bull, jud., 1878. p. 163).<br />
Nous avons déjà exprimé (Bull, jud., 1877, p. 8t) le vœu qu'une modification<br />
soit apportée sur ce point à la législation existante, e,t que lorsqu'il y a commun<br />
accord des parties, les indigènes musulmans puissent être admis, comme les<br />
justiciables de toute autre nationalité, à demander à la juridiction de droit commun<br />
là solution de leurs différends.<br />
Il est assurément singulier de voir la loi française imposer aux Musulmans la<br />
justice musulmane contre leur gré et malgré leur volonté formellement exprimée.<br />
V. M.
205<br />
décembre 1866, que leur application est d'ordre public —<br />
; Qu'il n'appartient<br />
—<br />
ni aux parties ni au tribunal de les méconnaître ; Attendu, à la vérité,<br />
que la loi du 26 juillet 1873 a implicitement porté aux dispositions des<br />
— articles sus-visés des atteintes qu'il faut remarquer ; Que d'après cette loi<br />
le sol indigène esl devenu sol français, dans un rayon déterminé ; que toutes<br />
les actions immobilières se rattachant à ce sol ont été, pour l'avenir, soumises<br />
à la loi française, qu'à cet égard les justiciables indigènes ont acquis les<br />
mêmes droits et les mêmes avantages de juridiction que les justiciables eu<br />
Mais,<br />
— ropéens ; attendu que la loi du 26 juillet 1873 est inapplicable dans<br />
— la cause; Que la contestation n'y revêt, en effet, aucun caractère immo<br />
— bilier possessoire ; Qu'elle n'y a pour objet principal et direct que la<br />
— réparation pécuniaire d'un acte de jouissance dommageable ; Qu'elle y<br />
reste purement personnelle el mobilière, que dès lors M. le juge de paix n'a<br />
pu la juger que dans les termes et en conformité des dispositions de l'article 2<br />
— du décret précité ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte donc<br />
que le tribunal a l'obligation étroite de se dessaisir d'office de la connais<br />
sance d'appels qui ont été incompétemment soumis à sa juridiction ;<br />
Par ces motifs : Se déclare incompétent pour statuer sur les appels indiqués<br />
contre la décision de M. le juge de paix de Coléah, du 27 novembre 1875.<br />
Renvoie les parties devant la juridiction qui doit connaître de ces appels.<br />
M. Wurtz, Subst. du Pr. de la Rép. ; MMes Letellier et Bordet, av.<br />
TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />
Présidence de M. DANNERY, président.<br />
13 avril 1878.<br />
Diffamation. — Injure. — Outrage. —<br />
Conseiller général. —<br />
Citoyen chargé d'un ministère de service public.<br />
Les propos outrageants adressés à un conseiller général dans l'exercice ou<br />
à l'occasion dé l'exercice de ses fonctions, ne tombent pas sous le coup de<br />
l'art. 224 du Code pénal.<br />
En effet, les conseillers généraux ne sauraient être assimilés aux personnes<br />
qui sont protégées par cet article, non plus à des fonctionnaires publics qu'à<br />
des citoyens chargés d'un ministère de service public .<br />
En conséquence, les propos outrageants dont ils sont l'objet, s'ils ne réunis<br />
sent les caractères légaux de la diffamation ou de l'injure publique, ne cons<br />
tituent que la contravention d'injure simple prévue par l'art. 471, § 11 du<br />
Code pénal et pouvant être effacée par l'excuse de la provocation (1).<br />
(1) Cette décision est conforme à la jurisprudence (Voir Dalloz, Table des vingt-<br />
V' deux n»<br />
années, Fonctionnaire public, 123, et par rapport aux conseillers munici<br />
paux, notamment Nancy, 21 mars 1876 (D. 1878, 2, 30).
206<br />
A la suite de propos dirigés dans une séance du Conseil général d'Alger par M. de<br />
Malglaive, membre de cette assemblée, contre M. Boutemaille, son collègue, ce der<br />
nier avait assigné M. de Malglaive devant le tribunal prétendant que<br />
correctionnel,<br />
ces propos constituaient notamment un outrage contre un citoyen chargé d'un mi<br />
nistère de service public, et demandant pour. réparation une condamnation en cinq<br />
francs de dommages-intérêts et l'insertion flans les journaux de Blidah et d'Alger.<br />
Le Tribunal a rendu la décision suivante :<br />
Boutemaille c. de Malglaive.<br />
Attendu qu'il résulte des débats d'audience, et des explications mêmes du<br />
prévenu, que le 26 octobre dernier, pendant une séance publique du Conseil<br />
général du département d'Alger, et dans le cours de sa discussion, de Mal<br />
glaive s'est écrié en s'adressant à Boutemaille, son collègue : « Je vous ai<br />
connu, au Mexique. » — Altendu<br />
que mis en demeure d'expliquer et de pré<br />
ciser sa pensée, de Malglaive, au moment de la reprise de la séance publique,<br />
s'est exprimé dans les termes suivants : « Je suis allé au Mexique où j'ai été<br />
» blessé, M. Boutemaille y faisait le commerce des bestiaux ; c'est un métier<br />
» honnête. Je pourrais peut-être en dire davantage ; mais je ne veux pas<br />
» m'exposer à tomber sous le coup de la loi de 1819 et aller en prison. » —<br />
Atlendu, les faits étant ainsi établis, qu'il convient de rechercher si les<br />
propos incriminés renferment les éléments d'un délit caractérisé ;<br />
En ce qui touche l'application de la loi du 17 mai 1819, laquelle est invo<br />
quée aux termes de sa citation : Attendu que les propos ci-dessus rapportés<br />
ne renferment l'allégation d'aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur ou<br />
à la considération du plaignant, el que, dès lors, ils ne peuvent constituer<br />
—<br />
une diffamation ; Attendu qu'ils ne constituent pas non plus une injure,<br />
dans le sens de la loi du 17 mai 1819, puisque, bien qu'ils aient été proférés<br />
publiquement, ils ne constituent, dans les termes vagues où ils sont conçus,<br />
l'imputation d'aucun vice déterminé ; ^<br />
En ce qui concerne l'application de l'art. 224 du Code pénal, laquelle a élé<br />
proposée à l'audience : Attendu que cet article n'est pas applicable dans la<br />
cause, par le molif qu'en sa qualité de conseiller général, le plaignant n'est<br />
dépositaire d'aucune portion de l'autorité publique, et que, dès lors, il ne<br />
peut être assimilé aux personnes que protège l'article invoqué ;<br />
Mais, attendu que, pris dans leur ensemble, les propos qui font l'objet de<br />
la prévention contiennent, à l'adresse du plaignant, des expressions outra<br />
geantes et des termes de mépris, lesquels ont été proférés par de Malglaive,<br />
sans qu'il ail été provoqué ;<br />
prévue et punie par l'art. 471, % 11 du Code pénal;<br />
— Attendu que ce fait constitue la contravention<br />
Nous ne saurions toutefois penser qu'elle soit conforme au sens et à l'esprit<br />
de l'art. 224 du Code pénal. Les mots « citoyens chargés d'un ministère de service<br />
public<br />
» ont un caractère de généralité qui semble bien devoir embrasser les<br />
fonctions électives telles que celles de conseiller général ou de conseiller munici<br />
pal. Il semblerait étrange que dans l'état actuel de notre législation, la loi pénale<br />
qui couvre avec sollicitude la personne des fonctionnaires et des agents même les<br />
plus subalternes du pouvoir exécutif, ne contînt aucune disposition ayant pour<br />
objet de protéger également en dehors des députés, les citoyens qui sont investis<br />
de mandats conférés par le suffrage des électeurs. V. M.
207<br />
Statuant sur les conclusions de la partie civile, et sans qu'il soit nécessaire<br />
— de statuer sur les conclusions déposées sur le bureau du tribunal ; Attendu<br />
que le tribunal possède les éléments nécessaires pour apprécier l'importance<br />
du préjudice causé à Boutemaille, el la réparation de ce préjudice;<br />
Par ces motifs : Déclare de Malglaive coupable d'avoir, à Alger, le 26 oc<br />
tobre 1877, sans avoir élé provoqué, proféré des injures contre Boutemaille.<br />
Le condamne à cinq francs d'amende. Le condamne à payer à Boutemaille la<br />
somme de cinq francs, à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-<br />
énoncées ; ordonne que les motifs el le dispositif du présent jugement seront,<br />
dans la huitaine du jour où il sera devenu définitif, insérés en entier dans<br />
deux journaux d'Alger, et dans un journal de Blidah, au choix de la partie<br />
civile et aux frais de Malglaive. Condamne de Malglaive aux dépens.<br />
M. Rack, subst. du proc. de la Rép. (concl. 'conf.) ; MM«» Mallarmé<br />
et Bordet, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en dale du 15 juin 1878, ont été nommés :<br />
Suppléant du juge de paix de Djelfa (Algérie), M. Vincenti (Vincent),<br />
(exécution du décret du 10 août 1875).<br />
Suppléant du juge de paix de Saïda (Algérie), M. Jaillant (Jean-Marie) , en<br />
remplacement de M . Hugues,<br />
démissionnaire.<br />
Par décret en date du 22 juin 1878, ont été nommés :<br />
Juge de paix d'El-Arrouch (Algérie), M. deSeauve, juge de paix de Souk-<br />
Ahras,<br />
en remplacement de M. Waton.<br />
Juge de paix de Souk-Ahras (Algérie), M. Waton, juge de paix d'El-Ar<br />
rouch, en remplacement de M. de Seauve.<br />
Par décret en dale du 22 juin 1878, a été nommé :<br />
Huissier près la justice de paix de Takitount (Algérie), M. Hocquart (Fran<br />
çois), (exécution du décret du 23 avril 1874).<br />
Par décret en dale du 25 juin 1878, a été nommé :<br />
Juge de paix de Tébessa (Algérie), M. Charlan, suppléant rétribué du juge<br />
de paix d'Akbou, en remplacement de M. Martin, décédé.
208<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Contravention postale. — Facture commerciale. — Taxe réduite. — Note<br />
de correspondance. — Commet<br />
une contravention aux dispositions des<br />
art. 4, 5 et 9 de la loi du 25 juin 1856, le commerçant expéditeur par la<br />
poste d'une facture commerciale bénéficiant de la taxe réduite, dans lesquelles<br />
il insère des mentions, ayant pour effet de faire connaître à l'acheteur des<br />
tinataire le mode de paiement de ia marchandise vendue, le délai accordé<br />
pour se libérer et la date à laquelle le mandat sera présenté. — Cour d'Or<br />
léans, 4 février 1878 (Gaz. des trib. du 10 mai 1878).<br />
Lettre de change. —<br />
Femme<br />
non commerçante. — L'acceptation<br />
donnée<br />
par une femme non commerçante, en bas d'une lettre de change tirée sur<br />
elle par un tiers, est nulle si elle n'est pas revêtue du « bon » ou de Y « ap<br />
prouvé » prescrit par l'art. 1326 du Code civil. — Cass. Ch. civile. 20 février<br />
1878.<br />
— Conversion de valeurs nominatives en valeurs au porteur. Acte d'admi<br />
nistration. — Femme<br />
séparée de biens. —<br />
d'obligations nominatives a droit,<br />
Tout<br />
propriétaire d'actions ou<br />
aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 juin<br />
1857, de les convertir en actions ou obligations au porteur. Cette conversion<br />
ne constituant pas une aliénation mais un simple acte d'administration, la<br />
femme séparée de biens n'a besoin d'aucune autorisation pour l'effectuer,<br />
conformément à l'art. 1449 du Code civil. —<br />
Paris, 1 Ch. 10 mai 1878<br />
(Gaz. des trib. du 13 mai 1878).<br />
Hypothèque légale de la femme. -<br />
tion du mariage. —<br />
Date<br />
de cette hypothèque. —<br />
Célébra<br />
L'hypothèque légale de la femme sur les biens immobi<br />
liers du mari date, non pas de la convention matrimoniale passée par les<br />
futurs époux devant le notaire,<br />
mais seulement de la célébration du mariage<br />
devant l'officier de l'état civil. — Cass. Req. 22 janvier 1878 (France judic .<br />
II,<br />
p. 419).<br />
Paiements de loyers. — Saisie-gagerie.<br />
—<br />
Référé.<br />
—<br />
Une<br />
saisie-gagerie<br />
étant pratiquée des meubles d'un locataire débiteur de loyers, et les meubles<br />
saisis gagés étant insuffisants pour répondre de la valeur de ces loyers, le<br />
juge du référé a compétence pour ordonner qu'il sera passé outre à la vente<br />
des objets saisis et à l'expulsion du locataire. —<br />
1878 (Gaz. des trib. du 10 mars 1878).<br />
Alger.<br />
— Typ. A. Jourdain,<br />
Paris, \l* Ch., 22 février
2e — — année. 16 Juillet 4878.<br />
N° 38<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
Algérie .<br />
DOCTRINE. -<br />
JURISPRUDENCE.<br />
— Séquestre. —<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
-<br />
TRIBUNAL DES CONFLITS<br />
24 novembre 1877.<br />
Régularité.<br />
levée. —<br />
—<br />
LEGISLATION<br />
Demande<br />
Compétence,<br />
en main<br />
En Algérie les tribunaux judiciaires et les conseils de préfecture sont éga<br />
lement incompétents pour rechercher si un séquestre, dont l'existence est<br />
constante, a été régulièrement établi el pour prononcer sur une demande en<br />
main-levée formée par un revendiquant ;<br />
Le Gouverneur Général,<br />
actuellement investi des pouvoirs conférés au Mi<br />
nistre de la guerre par l'art. 5 de l'ord. du 31 octobre 1845,<br />
de statuer définitivement sur ces sortes de demandes ;<br />
DARNOSP1L C. l'ÉTAT.<br />
a seul le droit<br />
Le Tribunal des conflits ;<br />
Vu la loi du 24 mai 1872 el le règlement d'administration publique du<br />
— 26 octobre 1849; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et celle du 12 mars<br />
1831, les lois des 16-24 août 1790, til. 2, art. 13, et du 16 fruct. an 3; Vu<br />
l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie du 14 fév. 1842, le règl. du<br />
l
210<br />
tachant à l'exécution dél'arrêté du 14 fév. 1842 pris par le Gouverneur Général<br />
— de l'Algérie, au moment de la conquêle de Tlemcen ; Considérant que, le<br />
fait du séquestre étant ainsi établi, il ne saurait appartenir aux Tribunaux<br />
judicaires ni aux Conseils de préfecture de décider si cette mesure de<br />
haute administration a été prise régulièrement ; que la main-levée du sé<br />
questre, mesure nécessaire et préalable à l'instance en revendication, ne<br />
peut être obtenue qu'en se conformant aux dispositions de l'art 5 de l'ordon<br />
nance du 31 ocl. 1845, auxquelles la loi du 16 juin 1851 n'a point dérogé;<br />
— Considérant que ledit article investit le Ministre de la Guerre, dont les<br />
pouvoirs ont été transmis successivement au Ministre de l'Algérie et des Colo- ,<br />
nies el au Gouverneur Général de l'Algérie, du droit de statuer définitive<br />
— ment sur ces sortes de demandes ; Considérant que, dans celle situation,<br />
la Cour d'appel d'Alger et le Conseil de préfecture d'Oran étaient également<br />
incompétents pour statuer sur l'action en revendication portée devant eux;<br />
qu'ainsi le conflit n'exisle pas :<br />
Art. 1«. _<br />
La<br />
requête de la dame Darnospil est rejetée.<br />
MM. Almeras Latour, rap. ; Laferkière, concl. ; M« Valabregue<br />
I, Jugement par défaut. —<br />
el Nivart, av.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
22 juin 1878?<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />
Citation<br />
ment à une contre-date. —<br />
tribunaux. —<br />
IV.<br />
à jour Bxe. —<br />
III.<br />
II.<br />
Juge<br />
Règlement intérieur des<br />
Violation des droits de la défense.<br />
I- Le juge correctionnel, saisi par une citation donnée à jour fixe au pré<br />
venu, est tenu de juger aujour indiqué ;<br />
II. Il peut cependant, si les nécessités du service l'exigent, remettre à une<br />
autre audience les affaires qui n'ont pu être jugées au jour indiqué par la<br />
citation, mais en prononçant le renvoi en présence des pour parties, les mettre<br />
en demeure de comparaître au jour indiqué, et en faisant constater le renvoi<br />
au plumitif;<br />
III. Les règlements intérieurs des tribunaux ne peuvent lier les justiciables ;<br />
dès lors il ne saurait être adm
211<br />
Chazot et Gojosso c. Bastien<br />
Sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'arlicle 188 du Code<br />
d'instruction criminelle et de la violation des droits de la défense, en ce que<br />
les prévenus auraient été jugés et condamnés par défaut à une audience pour<br />
laquelle ils n'avaient pas été cités ;<br />
— Atlendu<br />
que, sur l'appel formé par les<br />
prévenus d'un jugement du tribunal correctionnel d'Alger, qui les avait<br />
condamnés à l'emprisonnement, à l'amende et à des réparations pécuniaires<br />
envers la partie mile, pour délit d'outrage public à un magistrat à raison<br />
de sa qualité (délit et condamnations pénales effacés aujourd'hui par la loi<br />
d'amnistie du 3 avril dernier), le Procureur Général leur avait l'ait donner<br />
citation à a comparaître le jeudi, 20 décembre 1877, à une heure de relevée,<br />
devant la Cour d'appel d'Alger, qui lient ses audiences au palais de justice,<br />
pour voir statuer sur ledit » appel; — Attendu qu'à celle date du 20, l'af<br />
faire concernant les prévenus n'a élé ni jugée, ni appelée;<br />
que c'est seule<br />
ment le lendemain 21, -qu'il a élé statué en leur absence sur la citation à eux<br />
donnée pour le 20, et qu'un arrêt confirmalif de la sentence des premiers<br />
— juges a été rendu contre eux par défaut; Attendu que rien ne prouve<br />
que les prévenus, dont le droil était d'ailleurs de faire défaut, aient élé pré<br />
sents à l'audience du 20, et qu'en supposant un renvoi de leur cause au len<br />
demain, renvoi dont le plumitif n'a gardé aucune trace, rien n'établit non<br />
— plus qu'ils aient été légalement informés ; Attendu qu'on objecterait vai<br />
nement qu'aux termes du règlement de la Cour d'appel d'Alger, la chambre<br />
des appels correctionnels étant tenue de juger correctionnellement pendant<br />
les trois derniers jours de la semaine, tant que son rôle n'est pas épuisé, les<br />
prévenus étaient parla même avertis, qu'à défaut d'appel de leur cause à-<br />
l'audiencedu jeudi, elle se trouvait légalement reportée au jour suivant; que<br />
ce règlement d'ordre intérieur e*t sans force obligatoire pour les parties aux<br />
quelles aucune communication régulière n'en a été el n'en pouvait être faite ;<br />
— Qu'il reste donc acquis dans la cause, que les prévenus app lés à jour fixe<br />
devant la Cour d'appel, ont élé jugés à un jour autre que celui pour lequel ils<br />
avaient été cités el sans avoir élé mis en demeure de comparaître à cet autre<br />
jour, qu'ainsi le droit de défense a élé violé à leur égard ;<br />
Par ces motifs : Casse. Renvoie devanl la Cour d'appel d'Aix.<br />
I. Habous. —<br />
tiers. — II.<br />
sulmanes ,<br />
M. Chennevièkes, rapp. ; Me Duboy, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1» Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
Inaliénabilité<br />
.<br />
2 avril 1878.<br />
— Transactions.<br />
premier président.<br />
—<br />
Droits<br />
des<br />
Recours des cohéritiers. — III. Successions mu<br />
\I. Les créanciers munis d'hypothèques judiciaires peuvent poursuivre la<br />
saisie d'immeubles grevés de habous ;
212<br />
Le décret du 30 octobre 1858, qui déclare applicable aux transactions, les<br />
dispositions de la loi de 1851,<br />
vente,<br />
relatives aux immeubles acquis par contrat de<br />
a eu pour but de faire disparaître l'inaliénabilité et l'insaisissabililé<br />
que le droit musulman attachait aux biens habousés, en permettant aux tiers<br />
l'exercice de tous les droits quelconques par eux acquis ;<br />
On ne saurait assimiler les immeubles habousés à des biens se trouvant pla<br />
cés sous le régime dotal de la loi française, et le législateur tout en respectant<br />
les principes des indigènes en ce qui concerne la constitution des habous, telle<br />
qu'elle a été réglée, par la loi musulmane, a voulu en concilier l'application<br />
avec les droits des tiers ;<br />
II Les dispositions de l'art, 875, % 1er du C. civ. qui règlent les rapports<br />
de cohéritiers entre eux ne peuvent être opposés à celui qui n'est ni héritier,<br />
ni successeur à titre universel ;<br />
III .<br />
Ces dispositions ne sauraient d'ailleurs être invoquées à l'encontre de<br />
musulmans, puisque en droit musulman toutes les successions sont bénificiaires .<br />
D'ie Devacx c. Ali ben Bahamed.<br />
Attendu que les appelants élèvent en premier lieu un contredit dirigé<br />
contre l'ensemble des collocations et fondé sur l'inaliénabililé de l'immeuble,<br />
— dont le prix est en distribution ; Qu'ils soutiennent que le jardin Karoubet,<br />
frappé de habous en 1751 par leur auteur Hassein bey, est, en verlu des<br />
principes de la législation musulmane, passé successivement entre les mains<br />
des divers dévolutaires libre de toutes charges ; Que si le législateur français<br />
a cru devoir apporter quelques restrictions au système des habous, tel qu'il<br />
était pratiqué sous l'empire du droit musulman, il n'a pas décrété l'aboli<br />
tion de cette institution profondément enracinée dans les mœurs indigènes<br />
et qu'il s'est borné à sauvegarder les droils des acquéreurs ; Qu'on ne sau<br />
rait donc sans forcer le sens des textes, sans violer leur esprit et sans porter<br />
atteinte à des droits qu'on avait solennellement promis de respecter, aller au<br />
delà et notamment permettre à des créanciers munis d'hypothèques judi<br />
ciaires de saisies des biens frappés d'inéliabiliié; Qu'une pareille interpré<br />
tation en effet équivaudrait à la suppression des habous alors que par des scru<br />
pules officiellement manifestés, on a reculé devant une mesure aussi radicale ;<br />
— Attendu<br />
que, s'il<br />
ne"<br />
faut pas étendre tes lois, il convient aussi de ne pas<br />
— les restreindre ; Que le législateur français renconlranl, sur la terre al<br />
gérienne, cetle institution originale des habous, la trouvant comme tant<br />
d'autres, marquée du caractère religieux, frappé, d'autre"<br />
part, des dangers<br />
que celte subslilulion clandestine créait pour les intérêts européens a fait à<br />
ce système une première brèche par l'article 3 de l'ordonnance du 1« oc<br />
tobre 1844 ;<br />
— Qu'il<br />
se bornait à maintenir les actes translatifs des pro<br />
1851,<br />
— priétés consentis par un indigène au profit d'un européen ; Qu'en<br />
faisant un pas de plus dans cette voie, il consolidait (article 17 de la loi du<br />
16 juin 1851), l'aliénation du bien habousé consentie par un musulman au<br />
— profit de toule autre personne qu'un musulman; Qu'en 1858, à une<br />
époque où le progrès de la colonisalion avait multiplié les contrats passés
213<br />
avec les indigènes, le législateur forcément amené à protéger les intérêts<br />
divers menacés par les constitutions de habous déclarait, par le décret du<br />
30 octobre 1858, les dispositions de l'ordonnance de 1844 et de la loi de<br />
1851,<br />
applicables aux Iransaclions passées ou à venir de musulman à musul<br />
man et de musulman à israélite ;<br />
— Qu'après<br />
avoir songé tout d'abord à ga<br />
rantir les ventes consenties à des européens, puis à toutes autres personnes,<br />
la loi a dû accorder la mémo protection aux engagements et qu'elle l'a dit<br />
— clairement en parlant des transactions; Que la généralité de cette expres<br />
sion transaction, choisie à dessein par le législateur, la progression si mani<br />
feste établie dans les acles législatifs, les motifs qui les ont inspirés, la pro<br />
tection dont on a voulu entourer les intérêts des liers, l'efficacité qu'il faut<br />
assurer à ces dispositions tulélaires, lout concourt à démontrer que le légis<br />
lateur français a eu pour but d'effacer l'inaliénabilité et l'insaisissabilité qui<br />
s'attachait au droit musulman, aux biens frappés de habous —<br />
; Qu il n'y a<br />
aucune comparaison à établir enlre l'inslilulion des habous el le régime do<br />
tal;<br />
— Que<br />
l'un s'abrite sous la loi française, fait partie intégrante de nos<br />
Codes, tandis que l'autre fondé sur la loi musulmane n'est toléré par la<br />
notre que dans la mesure ou il ne prêjudicie pas aux intérêts des tiers;<br />
Qu'ensuite on peut toujours se mettre en garde par de simples précautions<br />
contre les inconvénients du régime dotal, tandis que la clandestinité des<br />
— habous constitue un danger incessant et inévitable ; Attendu enfin que<br />
cette interprétation n'a pas ainsi qu'on l'objecte, pour résultat d'abolir l'ins<br />
titution des habous et de dépasser ainsi l'intention du législateur;— Qu'en<br />
l'absence de conflit avec les droits des tiers, lorsque le dévolutaire d'un bien<br />
habousé n'a consenti aucun acte d'aliénation directe ou indirecte, la consti<br />
—<br />
tution du habous suit son cours tel qu'il a élé réglé par la loi musulmane;<br />
Que c'est finalement à cette conciliation que doivent aboutir et la protection<br />
due aux inlérêls des liers et le respect des mœurs indigènes ;<br />
— Que<br />
—<br />
loin<br />
d'ébranler une jurisprudence si sage déjà attestée par de nombreux arrêts,<br />
—<br />
il faut l'affermir et y persévérer comme l'ont fait les premiers juges;<br />
Attendu qu'en dehers de cette critique générale les appelants opposent à<br />
l'intervenante que, dévolutaire du bien habousé, en payant les créanciers<br />
colloques, elle a acquitté une dette dont elle était tenue, et que si elle a payé<br />
au-delà de sa pari, elle ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation que<br />
dans les limites restreintes indiquées par l'article 875 du Code civil ;<br />
— Al<br />
tendu que c'est là peut-êlre une demande nouvelle, non recevable par suite,<br />
Qu'en effet l'article 8f5 règle les rapports<br />
dans lous les cas mal fondée; —<br />
de cohéritier à cohéritier et que la dame Daïka bent Haffiz n'étant ni héri<br />
tière, ni successeur à titre universel de la dame Aïcha, ne peut se voir op<br />
— poser les dispositions de l'article 875 ; Qu'à un dernier point de vue ce<br />
texte serait inapplicable à la cause puisqu'en droil musulman les successions<br />
sont bénéficiaires et que l'héritier n'est jamais tenu des dettes qu'inlra vires ;<br />
—<br />
— En ce qui concerne la collocalion de Kalfa Allouch ; Attendu qu'on<br />
objecte vainement que le jugement du 8 août 1848 n'a pu servir de fonde<br />
constate l'existence d'une obli<br />
—<br />
ment à une hypothèque judiciaire ; Qu'il<br />
gation certaine à la charge du débiteur et qu'à ce litre il doit produire hypo<br />
thèque ;— Que les autres objections tirées de la péremption du défaut d'indi<br />
cation de l'exigibilité, de l'absence de signification du transport sont sans
214<br />
valeur et qu'elles tombent devant la production des inscriptions et de leurs<br />
renouvellements. — Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont<br />
adoptés pour le surplus, la Cour, donne défaut contre le Kalifa ben Ali ben<br />
Bahamed et son défenseur, M« Chabert Moreau, faute de conclure;<br />
- Déclare<br />
régulière l'intervention de la dame Daïka bent Haffiz;'— Rejelle l'appel,<br />
—<br />
confirme le jugement déféré pour être exéculé dans sa forme et teneur ;<br />
Et condamne les appelants, parties de M" F, Huré, à l'amende et en tous les<br />
dépens.<br />
M. Cuniac, subst. du Proc. gén.; M« F. Huré, Dazinière, Chabert et<br />
Carrière, av.<br />
Saisie-arrêt.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
7 mai lo78.<br />
— Demande en validité, — Dernier ressort.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une demande en validité de saisie-arrêt, le taux du der<br />
nier ressort se détermine par le montant des causes de la saisie dont ta validité<br />
est poursuivie.<br />
Meihoffer c. Ventre.<br />
Attendu que le Tribunal de Bône était saisi d'une demande en validité<br />
d'une saisie-arrêt formée le 27 juin 1877, à la requête de Meihoffer pour<br />
avoir paiement d'une somme de cinq cents francs en principal, d'intérêts et<br />
des frais, le lout évalué à six cents francs, dont il se prétendait créancier<br />
pour une cause commerciale; que le Tribunal jugeant commercialement,<br />
avait par décision du 3 septembre 1877, joignant l'inslance en paiement de<br />
la somme sus-dite de cinq cents francs à une autre instance en dissolution<br />
des sociétés et en paiement de dix-neuf mille cenls cinq francs introduite<br />
par Venlre contre Meihoffer, reconnu qu'il existait enlre les parties une<br />
société commerciale, et que la somme de cinq cents francs réclamée par<br />
Meihoffer constituait un apport social, prononcé la dissolution de ladite<br />
—<br />
sociélé el ordonné sa liquidation ; Attendu qu'en cet élat de choses, le<br />
Tribunal de Bône était compétent pour examiner si, avant la liquidation<br />
d'une sociélé, l'un des associés peut former une saisie-arrêt contre l'autre ;<br />
— Atlendu<br />
que lorsqu'il s'agit d'une demande en validité d'une saisie-arrêt,<br />
le taux du dernier ressort se détermine par le montant des causes de la saisie;<br />
— Attendu que la saisie-arrêt a élé pratiquée pour obtenir le paiement d'une<br />
—<br />
somme de six cents francs ; Que, même en ajoutant à celle somme ainsi,<br />
que l'appelant prétend qu'on doit le faire, le montant des dommages-intérêts<br />
qui font l'objet de la demande reconvenlionnelle de rentes, la réunion de<br />
ces deux sommes ne formerait que celle totale de onze cents francs ;<br />
— Que
215<br />
par conséquent, c'est avec raison que le Tribunal a déclaré qu'il statuait en<br />
dernier ressort ; que l'appel n'est donc pas recevable.<br />
Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable, condamne l'appelant à<br />
l'amende et aux dépens.<br />
M. de Vaulx, av. gén ; M« Chéronnet et Jouyne, av.<br />
^<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
20 juin 1878.<br />
Jugement correctionnel par défaut. — Appel. —<br />
Peine.<br />
Opposition.<br />
Lorsqu'un tribunal correctionnel a condamné un prévenu par défaut, le<br />
ministère public ne peut interjeter appel de cette décision que dans les délais<br />
fixés par l'art. 205 du Code d'Inst. crim. ; en effet, le jugement a le caractère<br />
d'un jugement contradictoire au regard du ministère public, et l'appel interjeté<br />
par le Procureur Général plus de deux mois après la prononciation du juge<br />
ment est conséquemment tardif;<br />
L'opposition formée par un prévenu contre un jugement correctionnel qui l'a<br />
condamné par défaut, ne saurait avoir pour effet d'aggraver la position qu'il<br />
aurait eue en acquiesçant à cette décision : en conséquence, leAribunal appelé<br />
à statuer sur cette opposition ne peut prononcer une peine plus grave que celle<br />
résultant du jugement par défaut.<br />
Procureur général c. Tahar ben Abderrahman.<br />
Attendu que le prévenu condamné par défaut, par le tribunal correction<br />
nel de Bône, à trois ans de prison et seize francs d'amende, le 24 mai 1877,<br />
a formé opposition à cette décision le 3 mai 1878, à la suite de la signification<br />
— qui lui en avait été faite par le même exploit ; Que le tribunal, statuant<br />
sur 'celte opposition, a, par jugement contradictoire du 16 mai 1 878, élevé<br />
la peine à cinq ans de prison et cinquante francs d'amende ;<br />
— Altendu<br />
que<br />
par déclaration au greffe, en dale du 25 mai 1878, le condamné a relevé appel<br />
— de ce dernier jugement; Que, d'autre part, à l'audience du 13 courant, le<br />
"Procureur Général a, à son tour, fait appel du jugement de défaut du 24 mai<br />
—<br />
1877; Attendu, dans cette situation, qu'il échet pour la Cour d'examiner :<br />
1° si l'appel du Procureur général est recevable ; 2° si le Tribunal de Bône,<br />
saisi à nouveau par l'opposition du condamné, pouvait élever là peine pré<br />
cédemment prononcée contre lui ;<br />
que le jugement de défaut du 24 mai<br />
Sur le premier point : — Atlendu<br />
1877 n'était tel qu'à l'égard du prévenu ; Que pour le ministère public il a<br />
été contradictoire; Qu'on ne saurait donc admettre que le délai de deux<br />
mois accordé au Procureur Général pour relever appel puisse ne courir que<br />
du jour de la signification du jugement par défaut ; Que dans ces conditions<br />
le jugement dont s'agit ayant été prononcé à la date du 24 mai 1877, l'appel
2J6<br />
Atlendu, d'ailleurs,<br />
—<br />
n'est plus possible aujourd'hui queles<br />
;<br />
termes mêmes<br />
de l'article 205 du Code d'instruction criminelle s'opposent à une interpréta<br />
tion contraire;<br />
— Qu'en<br />
effet, cet article ne distingue pas entre les juge<br />
ments par défaut et les jugements conlradicioires ; qu'il n'établit qu'une<br />
seule distinction enlre les jugements qui ontétésignifiésau Procureur Géné<br />
— ral et ceux qui ne lui oui pas é.é signifiés; Atlendu, par ces divers motifs,<br />
qu'il éihel de déclarer non recevable comme tardif l'appel du Procureur<br />
Général;<br />
Sur le deuxième point : —<br />
Attendu que le Tribunal de Bône n'a été<br />
saisi à nouveau de l'examen de l'affaire, à la suite du jugement par défaut<br />
du 24 mai 1877, que par l'opposition seule du prévenu ; Qu'en pareil cas le<br />
prévenu ne saurait rendre sa position pire et risquer une aggravation de<br />
peine, à l'abri de laquelle il se serait trouvé, s'il avait aquiescé à la première<br />
— décision rendue contre lui ; Altendu que ce principe lutélajre d'équité<br />
est incontestable en matière d'appel, et que les raisons de décider de même<br />
— en matière d'opposition sont évidentes; Que c'esl donc à lort que les pre<br />
miers juges n'ayant, par le jugement de défaut, prononcé qu'une peine de<br />
trois ans d'emprisonnement el seize francs d'amende contre le prévenu, onf,<br />
lors des débats conlradicioires, élevé cette peine à cinq ans d'emprisonne<br />
ment et cinquante francs d'amende.<br />
Sur le troisième point : — Attendu que l'appel du prévenu esl régulier en la<br />
forme;<br />
— Au fond : — Attendu queles premiers juges ayant à tort élevé à cinq<br />
ans d'emprisonnement età cinquante francs d'amende la peine précédemment<br />
prononcée par eux contre le prévenu, il échel d'infirmer le jugement dont<br />
est appel, et de maintenir la peine originairement prononcée;<br />
—<br />
Attendu,<br />
sur ces données; que l'appel du prévenu n'est pas justifié ;<br />
Par ces motifs : La Cour déclare irrecevable l'appel relevé par M. le Pro<br />
cureur général contre le jugement de défaut du 24 mai 1877 ;<br />
pel de Tahar ben Abderrahman en la forme ;<br />
— Au<br />
— Reçoit<br />
l'ap<br />
fond, infirme le juge<br />
ment dont es"t appel en ce qu'il a élevé à cinq ans de prison el cinquante<br />
francs d'amende la peine originairement encourue; maintienl la condamna<br />
tion à trois ans de prison et seize francs d'amende prononcée par le juge<br />
ment de défaut précité; condamne Tahar ben Aderrahman en tous les dépens.<br />
M. Zeys, cons. rap. ; M. Ctjniac, subst. du Proc. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />
.<br />
Présidence de M. CARRÈRE, président.<br />
1«* juillet 1878.<br />
Succession musulmane. — Droit malekite, — Degré succès-<br />
sible. — Acebs,<br />
—<br />
Droits du JBeït-el-Mal.<br />
D'après les règles du droit malekite l'héritier aceb n'est habile à succéder<br />
que jusqu'au 6° degré ;
217<br />
A défaut d'héritiers acebs, habiles à succéder, le Béit-el-Mal a seul qualité<br />
pour demander l'envoi en possession de la succession du de cujus (1),<br />
Mohamed ben Ahmed ben Moramrd Zenagui el aulres, c. El Hadj Ahmed<br />
ben Djafar El Mugr&bi et son frère Mostefa.<br />
— Atlendu que tous les appels sont réguliers en la forme ; Au fond.: Adop<br />
tant les motifs du premier juge en ce qui concerne lous les prétendanls à la<br />
succession d'Ahmed ben Youcef, sauf El Hadj Ahmed ben Djafar et son frère<br />
— Moslefa ; Atlendu en ce qui louche ces derniers, el sans même relever ce<br />
qu'ont de suspect les témoignages d'étrangers, produits en leur faveur, qu'ils<br />
seraient, d'après la propre généalogie qu'ils présentent, parents du de cujus<br />
au-delà du 6° — degré ; Atlendu que selon une jurisprudence conslanle suivie<br />
par la Cour et les autres tribunaux de l'Algérie, les acebs, en droit malekite,<br />
ne sauraient hériter au delà du 6e — degré ; Attendu que cette jurisprudence<br />
esl basée sur les textes même de Sidi Khalil, qui esl considéré par les Malékites<br />
d'Algérie comme leur législateur principal et aussi le plus orthodoxe-, Qu'elle<br />
s'appuie d'ailleurs sur la pratique non moins conslanle du Beït-el Mal du temps<br />
des Turcs comme depuis l'occupation française ; Qu'au-delà du 6e degré le Beïl-<br />
el-Mal prend la place des acebs, et que l'Élat, conformément aux règles sui<br />
vies dans lous les pays non sauvages, remplace la parenté qui n'a plus de titre<br />
— légal à l'hérédité ; Altendu que cela est du reste une conséquence forcée<br />
de l'étal dans lequel vivent les musulmans; Qu'ils n'ont en effet aucun étal-<br />
civil ; Que peu d'entre eux pourraient indiquer le nom du grand père et des<br />
oncles de leur père, et que chez un peuple où lout se règle sur le témoignage<br />
oral, aucune preuve de filiation certaine n'était possible au-delà de quelques<br />
générations ; Que si on admettait la suceessibilité sans limite, tout individu<br />
pourrait, à un titre quelconque, se prétendre aceb, avec des témoins de complai<br />
sance ou même par Adam ou par Noé, d'un de cujus; décédé sans pareilts connus,<br />
et s'emparer ainsi de sa succession jusqu'à ce qu'un autre fit preuve d'une pa<br />
renté plus prochaine ; Qu'il n'existerait plus alors ni successions en déshé<br />
rence, ni Beït-el-Mal, ni droil des patrons,<br />
ni ainine des règles admises<br />
comme essentielles par la législation malekite pour le cas où il n'existe pas<br />
—<br />
i'aceb au degré successible ; Atlendu, dès lors, qu'il y a lieu de réformer<br />
— de ce chef la décision attaquée; Atltendu que les parties qui succombent<br />
doivent supporter les dépens ; qu'en l'espèce elles succombent toutes sur des<br />
chefs diflérenis ;<br />
Par ces motifs : La Cour, etc.<br />
M. Lourdau, rapp. ; M. Cammartin, av. gén. (conf.); MM" Mallarmé,<br />
Jouyne et Durand, av.<br />
(I) Cet arrêt conforme à la jurisprudence de la Cour, est aussi conforme aux<br />
doctrines du rite malekite, résumées dans l'ouvrage de MM. Sautayra et Cher<br />
bonneau, sur les Successions (voir vol. II, page 146, le tableau des héritiers acebs<br />
dressé par les auteurs).
I. Saisie-revendication. —<br />
II. Nullité. —<br />
III.<br />
du revendiquant. —<br />
du saisi.<br />
218<br />
TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM<br />
Présidence de M. DROULIN<br />
27 février 1878.<br />
Règles de la saisie-exécution, —<br />
Preuves de propriété. — IV.<br />
"V* Délai. —<br />
VI.<br />
Obligations<br />
Mise bors de cause<br />
/. Les règles de la saisie-revendication doivent être assimilées à celles de la<br />
saisie-exécution ;<br />
Par suite lorsque sur une saisie-revendication, intervient une opposition de<br />
celui qui se prétend propriétaire des objets saisis, t'opporilion doit être faite<br />
selon les prescriptions de l'art. 608 du C. de proc. civ. au titre de la saisie-<br />
exécution, et il doit être statué, par le tribunal du lieu de la saisie, comme en<br />
matière sommaire et conformément à l'art. 405 du C. de proc. civ. ;<br />
//. Le défaut d'enrôlement à la première audience utile, bien que regrettable<br />
eu égard à la nature et à l'urgence de l'affaire, ne constitue pas une cause de<br />
nullité ;<br />
Mais la procédure, suivie par l'opposant, doit être déclarée nulle en exécu<br />
aujour où l'affaire<br />
tion des prescriptions de l'art. 153 du C, de proc. civ. si,<br />
enrôlée par le saisissant est appelée à l'audience,<br />
il n'est pas requis défaut<br />
profit-joint par l'opposant contre le saisi qui n'a pas constitué défenseur ;<br />
///. // est suffisamment satisfait à l'obligation de renonciation des preuves<br />
de propriété, exigée à peine de nullité par l'art. 608 du C. de pr. civ., lors<br />
que l'exploit d'opposition porte que la saisie a été faite sur des animaux<br />
trouvés en la possession et au domicile de l'opposant ;<br />
IV. La nullité prononcée de la procédure suivie par l'opposant, ensuite<br />
d'une saisie-revendication, ne saurait affranchir le revendiquant bailleur en<br />
,<br />
l'espèce, de l'obligation légale qui lui incombe de rapporter la double preuve<br />
que les animaux par lui revendiqués sont la propriété de son fermier et qu'ils<br />
ont été distraits de la ferme louée dans les 40 jours qui ont précédé la saisie-<br />
revendication ;<br />
V. Dans ces conditions, le saisissant conserve le droit de suivre utilement sur<br />
la demande en validité de la saisie par lui formée, l'art. 831 du C. de proc.<br />
civ. n'impartissant pas de délai fatal ;<br />
VI. Si le saisi, dont la présence au procès était nécessitée par les règles de<br />
la procédure, n'a soulevé aucune contestation, sa mis» hors de cause pure et<br />
simple doit être prononcée.
219<br />
Campillo c. Sarda et Cano<br />
Attendu qu'il y a lieu, avant d'entrer dans la discussion des prétention des<br />
Sarda et des sieurs Campillo, de remarquer et de constater : 1° que c'est Sarda<br />
qui a fait pratiquer une saisie-revendicalion au domicile des sieurs Campillo ;<br />
2° que ces derniers, sans attendre la demande de Sarda en validité de la re<br />
vendication, ont introduit leur action en distraction des animaux saisis;<br />
3° que ces animaux ont été saisis en leur possession, el que dès lors, jusqu'à<br />
preuve du contraire, ils doivent être réputés légitimes propriélaires des ani<br />
maux saisis à la requête de Sarda ; 4° que les règles de la saisie-revendicalion<br />
ne peuvent être assimilées qu'à celles de la saisie-exécution; 5° que ni au<br />
titre de la saisie-revendication, ni au titre de la saisie-exécution, il n'est im<br />
parti de délai pour la demande en validité ;<br />
— Ceci posé: Attendu qu'il y a lieu d'examiner successivement les pré<br />
tentions des parties el de décider : 1° Si la jonction des instances doit être<br />
prononcée ; 2° Si la demande en distraction des frères Campillo esl nulle, et<br />
si, par voie de conséquence, la revendication de Sarda doit deplano être<br />
validée ; 3° Si l'exception des ftères Campillo tirée de la lardivité de la de<br />
mande en validité doit être accueillie ; 4 Si Cano doit être mis hors de cause;<br />
5° Si des dommages-intérêts sont dus à l'une ou l'autre des parties;<br />
Sur la première question. — Attendu que les frères Campillo avaient à se<br />
conformer aux prescriptions des articles 608 et 405 du Code de procédure<br />
civile ; qu'il esl consîant qu'ils ont légalemenl formé, entre les mains du<br />
gardien, opposition à la venle des animaux saisis et ont ensuite dénoncé<br />
ce'te opposition au saisissant et au saisi, avec assignation à comparaître à<br />
huitaine franche, outre les délais de distance, pardevant le tribunal de céans,<br />
— pourvoir statuer sur leur> prétentions ; Attendu que les frères Campillo de<br />
vaient donc faire enrôler pour<br />
la"<br />
première audience utile; qu'ils ont un<br />
reproche sérieux à encourir pour n'avoir pas rempli celte obligation ; que<br />
toutefois le législateur n'ayant point édicté de nullité pour cette omission, le<br />
— tribunal ne peul el ne doit en prononcer ; Attendu qu'il n'en esl pas de<br />
même pour la faule commise par les frères Campillo de n'avoir point pris dé<br />
faut joint contre Cano à l'audience du 30 janvier dernier, alors que ce der<br />
nier n'avait pas encore constitué défenseur; que cette négligence est une<br />
— cause de nullité ; Altendu que Sarda excipe encore d'une cause de nullité<br />
tirée de l'inobservation par les frères Campillo de là prescription de l'article<br />
608 du Code de procédure civile, qui veut que le revendiquant fasse renon<br />
—<br />
ciation de ces preuves de propriélé ; Attendu que celle nullité esrplus que<br />
discutable si l'on considère que la saisie a été pratiquée au domicile des frères<br />
Campillo sur des animaux en leur possession ; qu'en fait de meubles, posses<br />
sion vaut titre, el que la mauvaise foi ne se présume pas ; que le fait seul de<br />
leur possession suffisait à constituer en leur faveur et jusqu'à preuve du con<br />
traire, une forle présomption de propriélé au regard de Sarda; —Altendu,<br />
dès lors, que la nullité de là procédure des frères Campillo doit être pronon<br />
cée, mais seulement à cause de leur omission d'avoir requis l'accomplissement<br />
—<br />
de la formalité prescrite par l'article 153 du Code de Procédure civile;<br />
Altendu que cette nullité ne saurait cependant avoir la conséquence que<br />
veut lui attribuer Sarda ; qu'il ne faut pas perdre de vue, en effet, que dans
220<br />
l'espèce le véritable revendiquant est Sarda, et que la procédure insolite et<br />
intempestive des frères Campillo ne saurait, changeant la vraie situation du<br />
procès, l'affranchir de l'obligation qui lui incombe de rapporter la double<br />
preuve que les animaux par lui saisis-revendiqués sonl la propriété de son<br />
fermier et ont élé déplacés de la propriété louée dans les quarante jours qui<br />
ont précédé la saisie; que déclarer de piano le sieur Cano propriétaire des<br />
animaux saisis, par suite du fait seul de la nullité de la procédure des frères<br />
Campillo, serait violer et les règles de l'équité et les règles de droit;<br />
— Que<br />
pour bien juger la situation, il faut se placer à ce point de vue que si Sarda<br />
avait assigné en validité de la saisie-revendication, pratiquée à sa requête,<br />
c'était à lui incontestablement qu'incombait l'obligation de rapporter la dou<br />
ble preuve dont il est ci-dessus parlé, devant la déclaration que les frères<br />
Campillo n'auraient pas manqué de lui faire, qu'en fait de meubles possession<br />
vaut titre ;<br />
Sur la troisième question : — Atlendu que l'article 831 du Code de procé<br />
dure civile n'impartit pas de délai pour la demande en validité ; que l'on ne<br />
peut, 'à bon droit,<br />
reprocher à Sarda de ne point avoir encore fait celte<br />
demande, alors que jusqu'à ce jour elle était inutile en présence de l'altitude<br />
prise par les frères Campillo et de la procédure par eux commencée cinq<br />
jours seulement après la revendication ; que de ce chef il n'y a lieu de s'arrêter<br />
à l'exception soulevée par les frères Campillo;<br />
— Sur ta quatrième question. Attendu que Canot ne formulant aucune<br />
prétention à la propriété des animaux saisis et se tenant complètement en<br />
dehors du débat, sa présence au procès, nécessitée par les règles de la procé<br />
dure, n'est plus et ne peut plus être d'aucune utilité ; que prononcer sa mise<br />
hors de cause, c'est éviter des frais ultérieurs ; qu'en ce qui concerne sa de<br />
mande en dommages-intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice appréciable<br />
autre que les dépens, el que dès lors elle doil être repoussée, sa mise hors de<br />
cause étant prononcée avec condamnation des frères Campillo aux dépens;<br />
Sur la demande en dommages-inlérêls de Sarda el des frères Campillo :<br />
Attendu que la solution de cette question est subordonnée à l'issue définitive<br />
du procès ;<br />
Par ces motifs : Le Tribunal jugeant conlradictoiremenl et en premier<br />
ressort, joint les instances dont il s'agit, et statuant sur le tout par un seul<br />
et même jugement, prononce la nullité de la procédure faite par les frères<br />
Campillo, faute par eux d'avoir requis l'accomplissement de la formalité<br />
édictée par l'article 153 du Code de procédure civile ; les condamne aux dé<br />
pens de leur instance, tant à l'égard de Cano qu'à l'égard de Sarda; met le<br />
sieur Cano hors de cause sans dépens, le déboute de sa demande en dom<br />
mages-inlérêls;<br />
repoussé l'exception des frères Campillo tirée de la lardivité<br />
de la demande en validité de la revendication, et. remellant les parties dans<br />
le même étal où elles se trouvaient avant la procédure annulée des frères<br />
Campillo; admet le sieur Sarda à faire statuer sur la saisie-<br />
validité de sa<br />
revendication, et disant droitàses conclusions subsidiaires, l'autorise à prou<br />
ver devant M. le Juge de Paix de Saïda, à ces fins commis, tant par titres que<br />
par témoins: 1° que les porcs dont s'agit appartenaient à son fermier Cano;<br />
2° Qu'ils étaient fixés à demeure dans la propriété par lui louée à ce dernier ;<br />
3° et qu'ils ont été déplacés depuis moins de quarante jours avant la saisie-<br />
—
221<br />
revendication ; la preuve contraire réservée ; réserve aussi les dépens de<br />
ce chef ainsi que la question de dommages intérêts jusqu'à l'issue définitive<br />
du procès.<br />
M . Pichard,<br />
subst. de M. le Proc. de la Rép. ; M69 Ravoux, Santelli et<br />
Saurin, av.<br />
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'ALGER<br />
M. BORDENAVE, Juge de paix.<br />
21 mars 1878.<br />
I. Algérie. — Arrêté du S Juillet 18îO sur le pesage et le<br />
mesurage publics — II. Pesage dan» le port. — Intervention<br />
nécessaire du peseur public. — ni. Pouvoir d'appréciation<br />
du juge de simple police.<br />
/. L'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, concernant le pesage et me-<br />
surage publics,<br />
pris régulièrement el dans les limites des attributions de ce<br />
fonctionnaire, régit encore la matière (1);<br />
II. L'article 3 dudit arrêté disposant « que les préposés auxpesage et mesurage<br />
« interviendront nécessairement dans les ventes faites au poids ou à la me-<br />
« sure, dans les places, marchés, chantiers, ports et autres lieux publics, sou-<br />
« mis à la surveillance de police » , la vente au poids d'une certaine quantité de<br />
charbon opérée à bord d'un navire, stationnant dans le port,<br />
l'intervention nécessaire des préposés ;<br />
est assujettie à<br />
En conséquence, le refus de laisser constater par les préposés aux poids pu<br />
blics une vente effectuée à bord d'un navire mouillé dans le port, constitue une<br />
contravention à l'art . 3<br />
de l'arrêté du 8 juillet 1 840, sans qu'il y ail à établir de<br />
distinction entre un navire, ou toute autre embarcation amarrée au quai, en<br />
prétendant que c'est sur les embarcations amarrées au quai, que l'intervention<br />
des préposés aux poids publics pourrait seule s'imposer ;<br />
III. Une semblable interprétation serait contraire à la défense faite aux<br />
tribunaux de police de modifier les arrêtés municipaux et administratifs, de<br />
les rectifier, et même de les interpréter en les détournant de leur sens naturel (2).<br />
Beyle c. Destremp, Curci, Durand et Axiak.<br />
Attendu que le service des poids publics en Algérie établi et organisé par<br />
(1) Voir sur la légalité, de l'arrêté du 8 juillet 1840, Bulletin judiciaire 1877,<br />
p. 264.<br />
(2) Jurisp. conf. Cass. 12 avril 1854, V. Dalloz, V° Commune.
222<br />
arrêté du Gouverneur général du 8 juillet 1840, se trouve encore aujourd'hui<br />
régi par les dispositions de cet arrêté dont l'art. 3 est ainsi conçu :<br />
o Les préposés aux pesage, jaugeage et mesurage, interviendront, nécessai-<br />
« rement, sans pouvoir être suppléés, dans les ventes faites au poids, à la<br />
o jauge ou à la mesure dans les places, les marchés, chantiers,<br />
ports et<br />
« autres lieux publics soumis à la surveillance de la police; » — Attendu<br />
qu'il n'est pas contesté que la venle du charbon, objet delà poursuite,<br />
ait été faite au poids dans le port d'Alger ; qu'elle ait été opérée sur un na<br />
vire ou tout autre embarcation amarrée au quai, cetle vente ainsi faite dans le<br />
port n'était pas moins par ledit article 3 de l'arrêté précité assujettie à l'in<br />
tervention nécessaire des préposés assermentés des poids publics ;<br />
que malgré lesmolifs invoqués par la défense en faveur d'une exception à la<br />
— Attendu<br />
généralité dudit art. 3 pour les ventes faites à bord des navires, le tribunal<br />
ne pourrait aujourd'hui admettre celle exception en faveur des contrevenants<br />
qu'en modifiant l'arrêté du 8 juillet 1840, ce qui serait un excès de pouvoir<br />
étant formellement interdit aux juges de simple police, non-seule<br />
flagrant,<br />
ment de modifier ou rectifier les arrêté.* municipaux et administratifs léga<br />
lement rendus el publiés, mais même de les interpréter dans le sens de l'ex-<br />
— tenlion ou de la restriction ; Attendu que cet unique moyen de défense<br />
des contrevenants n'étant point accueilli ceux-ci restent sous le coup de la<br />
prévention;— Altendu qu'en refusant et en empêchant l'inlervemion des<br />
peseurs assermentés pour le pesage, à bord du navire Nedelek, du charbon<br />
vendu au sieur Axiak par Prosper Durand, lesdits inculpés pour ne s'être pas<br />
conformés à un arrêté légalement publié et obligatoire en Algérie, ont com<br />
mis la contravention prévue el punie par l'art. 471, nu —<br />
15 du Code Pénal;<br />
Attendu en outre que les agissements des défendeurs ont eu pour résultat de<br />
frustrer le fermier des poids publics du droit de pesage à lui dû sur le<br />
charbon vendu à Louis Axiak par Prospert Durand, pourquoi ledil fermier<br />
est en droit de demander réparation ;<br />
— Altendu<br />
que d'après les documents<br />
communiqués el reconnus exacts par Me Jouyne, avocat de la partie civile,<br />
la quantité de charbon ou briqiieltes soustraites au pesage de ce dernier ou<br />
de ses préposés ne dépasse pas le poids de 203 tonnes, qui, à raison de Ofr.<br />
75 c. la tonne prix maximum du pesage d'après le tarif de l'adjudication<br />
donnent une somme de 152 fr. 25 c. qu'il est juste d'allouer au sieur Bayleà<br />
titre de réparai ion civile;<br />
Par ces molifs: Le Tribunal jugeant conlradictoirement et en premier res<br />
sort ; Par application de l'art. 471, n° 15 du Code Pénal, dont lecture a été<br />
donnée, Condamne, etc.<br />
MMe» Jouyne et Berlemdïer, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en date du 6 juillet 1878, ont été nommés :<br />
Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Eyssautier, président du Tribunal
223<br />
de ir* instance d'Embrun, en remplacement de M. Vacheresse, qui est nommé<br />
président à Embrun.<br />
Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de ire instance<br />
de Bône (Algériel, M. Tomasi,<br />
substitut du Procureur de laRépublique nommé<br />
près le siège de Tlemcen, en remplacement de M. Cuniac, qui conserve, sur<br />
sa demande,<br />
Tlemcen.<br />
ses fonctions de substilul du Procureur de la République à<br />
Par décret en date du 13 juillet 1878, ont été nommés:<br />
Suppléant du juge de paix de Laghouat (Algérie). M. Pierre de Puygreffler<br />
(Marie-Eugène), en remplacement de M. Naudin, démissionnaire.<br />
Suppléant du juge de paix de Boghari (Algérie), M. Blanc (Louis-Auguste),<br />
en remplacement de M. Perriolat, décédé.<br />
Greffier de la justice de paix d'El-Arrouch (Algérie), M. Tarlarôli, greffier<br />
de la justice de paix d'Aïn-Mohra, en remplacement de M. Houlez, qui a été<br />
nommé greffier près la justice de paix des Ouled-Rahmoun.<br />
Greffier de la justice de paix d'Aïn-Mokra (Algérie), M. Hébrard (François),<br />
en remplacement de M. Tarlarôli.<br />
Par décret en dale du 22 juillet 1878, a été nommé:<br />
Suppléani du juge de paix de Perrégaux (Algérie), M. Duforest (Jules-<br />
Joseph), en remplacement de M. Game, démissionnaire.<br />
Par décret en date du 22 juillet 1878, ont été nommés :<br />
Greffier de la justice de paix de Tébessa (Aigrie), M. Benazet, greffier de<br />
la justice de paix de l'Oued-Athménia, en remplacement de M Susini.<br />
Greffier de la justice de paix de l'Oued-Athménia (Algérie), M. Susini,<br />
greffier de la justice de paix de Tébessa, en remplacement de M. Benazet.<br />
DECISIONS DIVERSES<br />
Élections municipales. — Non inscription sur les listes électorales. — Con<br />
— ditions d'éligibitilé. Pour<br />
être éligible au Conseil municipal, il n'est pas<br />
nécessaire d'être inscrit sur la liste électorale; il suffit qu'on ait la capacité<br />
électorale conforme aux dispositions de la loi du 7 juillet 1874 ; il n'est pas<br />
nécessaire qu'on en possède en oulre l'exercice. —<br />
Seine, 29 janv. 1878 (Francejudic. 1878, p. 505).<br />
Cons.<br />
de préf. de la<br />
— Vol. Chose soumise à un usufruit. — Nu-propriétaire. — Le nu-pro-
224<br />
priétaire qui s'empare frauduleusement au préjudice de l'usufruitier de la<br />
chose qui est l'objet de l'usufruit, commet le délit de soustraclio» fraudu<br />
leuse prévu el puni par la loi. -<br />
p. 506).<br />
Saisie- arrêt .<br />
Nîmes, 8 fév. .1878<br />
(France judic, 1878,<br />
— Salaires d'un ouvrier,—- Caractère alimentaire. —Les<br />
salaires d'un ouvrier, s'ils sont à peine suffisants pour son entretien et celui<br />
des siens, ont un caractère alimentaire qui les rend insaisissables. En consé<br />
quence, le patron peut valablement les payer,<br />
pratiquée entre ses mains. — Trib.<br />
1878, p. 502).<br />
nonobstant une saisie-arrêt<br />
de la Seine, 23 janv. 1878 (France judic.<br />
Faux serment. — — Adjudicataire. Rélrocessionnaire , — Chose jugée. — Il<br />
y a faux serment en matière civile par celui qui, rélrocessionnaire direct d'un<br />
adjudicataire d'une coupe debois en association avec un tiers, affirme quecette<br />
association n'existe pas.Tenanl directement de l'adjudicataire la rétrocession de<br />
celte association, rétrocession faite à son profit,<br />
sans serment un fait qu'il sait ne pas être vrai. — Le<br />
ce rélrocessionnaire affirme<br />
jugement au civil, rendu<br />
d'après un faux serment reçu par le juge civil, ne saurait constituer la chose<br />
jugée de nature à arrêter l'aclion du ministère public en répression de ce<br />
faux serment. — Rejet<br />
du pourvoi du sieur Grange contre un arrêt de la Cour<br />
d'Appel d'Alger du 23 nov. 1877, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement et<br />
500 fr. d'amende pour faux serment en matière civile. — Cass.<br />
16 mai 1878 [Gaz,. des trib. du 5 juin 1878).<br />
Ch. crim.,<br />
Cour d'assises. — Interrogatoire avant les débats. — La loi ne prescrit<br />
qu'un interrogatoire avant l'ouverture des débats. Si cet interrogatoire a été<br />
subi, le président de la Cour d'assises, saisi par le renvoi à une autre session<br />
prononcé dans la session précédente, n'esl pas tenu de le renouveler. C'est à<br />
l'accusé à provoquer une nouvelle information s'il est parvenu des faits<br />
nouveaux à sa connaissance ou s'il a lui-même des révélations à faire —<br />
Rejet du pourvoi du sieur Domecq, condamné aux travaux forcés à perpétuité<br />
par arrêt de la Cour d'assises d'Oran du 14 avril 1878. —<br />
des trib. du 6 juin 1878).<br />
Faillite. —<br />
Syndic.<br />
—<br />
Obligation<br />
de justifier sa qualité. — Si<br />
Cass. 31 mai (Gaz.<br />
le syndic<br />
d'une faillite, malgré la publicité légale qui accompagne sa nomination, peut<br />
être tenu de justifier de sa qualité au regard d'un débiteur de la faillite au<br />
quel il réclame un paiement, il nVst pas obligé de faire cette justification<br />
par la remise aux mains de ce débiteur d'un extrait de jugement qui contient<br />
sa nomination.<br />
Alger. — Tyi>. A. JoimnAN.
2e année. —<br />
Jer Août 1878. —<br />
N° 39<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
LÉGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />
8 janvier 1878.<br />
I. Effets de commerce. — Protêt. —■ Dispense. —<br />
ciation .<br />
II,<br />
Appré<br />
/. Il peut être dérogé par conventions particulières aux dispositions qui<br />
prescrivent la constatation par protêt du refus de paiement d'un effet de com<br />
merce à son échéance, ces dispositions n'intéressant pas l'ordre public (1) ;<br />
//. C'est au juge du fond qu'il appartient de constater souverainement l'ac<br />
cord intervenu à cet égard entre les parties intéressées.<br />
'<br />
Bourut c. Abadie et Mesrine.<br />
LA COUR : Sur le moyen pris des articles 162, 163, 168, 175 et 187 du C.<br />
que les dispositions de la loi commerciale qui prescrivent<br />
— Gomm. ; Attendu<br />
de constater, par un protêt,<br />
le refus de paiement à l'échéance d'une lettre de<br />
change ou d'un billet à ordre n'intéressent pas l'ordre public, et qu'on peut,<br />
dès lors, y déroger par des conventions particulières —<br />
; Attendu que l'arrêt<br />
attaqué déclare qu'un accord de toutes les parties excluait les formalités du<br />
protêl, relativement à des valeurs souscrites par Gilly pour une somme de<br />
33,000 francs au profit de Bourut, et remises par ce dernier à Abadie et Mes<br />
—<br />
rine ; Que celte constatation souveraine rendait sans application à la cause<br />
les articles 162, 163, 168, 175 et 187 du C. comm., et qu'ainsi la Cour d'Alger<br />
n'a ni violé, Rejette,<br />
(1)<br />
— ni pu violer lesdits articles. etc. ,<br />
M. Connelly, rap. ; M. Godelle, av. gén. ; Me Sauvel, av.<br />
Jurisp. conf. : Cass. 6 fév. 1872 et Cass. 10 avril 1876.
I. Chose jugée. —<br />
226<br />
COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />
Moyen<br />
II. Responsabilité civile. —<br />
personnel.<br />
/. L'exception de chose jugée,<br />
26 juin 1878<br />
irrecevable comme nouveau. —<br />
Exercice<br />
des fonctions. —<br />
Fait<br />
soulevée pour la première fois devant la Cour<br />
de cassation, est tardive, et ce moyen doit par suite être déclaré irrecevable<br />
comme nouveau ;<br />
II, Lorsqu'il a été constaté que l'accident,<br />
qui a causé le dommage dont la<br />
réparation est poursuivie, a été amené par l'imprudence personnelle du mé<br />
decin d'une Compagnie de transports maritimes, qui se trouvant à bord, au<br />
rait dérangé l'échelle de débarquement à l'arrivée du navire, c'est à bon droit<br />
qu'il a été décidé que la Compagnie n'était pas responsable de l'accident ;<br />
En effet la responsabilité des maîtres et commettants, à raison du dommage<br />
causé par leurs domestiques ou préposés, ne peut être engagée que par les actes<br />
que ces derniers commettent dans les fonctions auxquelles ils les ont employés,<br />
et non par le fait particulier et personnel étranger à ces fonctions .<br />
Le 20 novembre 1877,<br />
Puccini c. C'8 Valéry.<br />
le Tribunal de Bône rendait le jugement suivant :<br />
Attendu que sur une demande introduite par Puccini contre la C« Valéry,<br />
en paiement d'une somme de 1,500 fr. à titre de dommages-intérêts pour ré<br />
paration de préjudice causé par un de ses employés, le Tribunal, par juge<br />
ment avant faire droit du 27 mars 1877, a admis le demandeur à faire la<br />
— preuve de ses allégations, preuve contraire réservée ; Mais atlendu, en ce<br />
qui concerne le fond, que l'enquête a établi que l'accident élait arrivé par le<br />
fait du docteur du bord qui avait démaré l'échelle au moment de la descente<br />
de Puccini ; Que dès lors, la Compagnie ne saurait être déclarée responsable<br />
de l'imprudence de son agent, imprudence toute personnelle à cet égard ;<br />
Attendu que l'article 1384 du Code civil, énumérant les personnes dont on<br />
doit répondre, ne parle que des dommages causés par ces personnes dans<br />
— l'exercice de leurs fonctions; Atlendu que, dans l'espèce, la Cie<br />
Valéry ne<br />
péul évidemment êlre déclarée responsable d'une imprudence commise par<br />
le médecin et tout à fait étrangère aux fondions qu'il remplit à bord du ba<br />
teau, que dans la circonstance, le docteur a agi comme un simple particulier,<br />
et que, dès lors, Puccini ne peut avoir d'action que contre lui personnel<br />
lement.<br />
Sur le pourvoi formé par Puccini contre ce jugement est intervenu l'arrêt sui<br />
vant :<br />
—
227<br />
LA COUR : Sur le moyen tiré du principe de la chose jugée ;<br />
que ce moyen n'a pas été proposé devant les juges de la cause, qu'il est sou<br />
— Attendu<br />
levé pour la première fois devant la Cour de cassation, et qu'il est consé<br />
quemment irrecevable ;<br />
— Sur le moyen tiré de la violation, par fausse ap<br />
— plication, de l'article 1384 du Code civil ; Attendu. qu'il esl déclaré souve<br />
rainement parla décision dénoncée, que le docteur They, médecin delà<br />
Compagnie défenderesse, n'était pas dans ses fonctions, lorsqu'il a dérangé<br />
l'échelle qui a causé l'accident ;<br />
— D'où<br />
il suit que la Compagnie n'était pas<br />
responsable- du fait générateur de la demande en dommages-intérêts,<br />
c'est à bon droit, dès lors, que cette demande a été repoussée.<br />
• Par<br />
ces motifs, rejette le pourvoi du sieur Puccini.<br />
et que<br />
M. Guillemard, cons. rapp, ; M. R. de Cléry, av. gén. ; Me Laneyrie, av.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.<br />
Présidence de M. GUYHO<br />
18 avril 1878.<br />
I. Testament en matière musulmane. — Témoin». —<br />
déclaration. — II. Faux en écriture publique. — III.<br />
ment de juges.<br />
Fausse<br />
Règle<br />
/. La fausse déclaration des dispositions d'un testament faite devant un<br />
cadhi, instrumentant comme officier public, en vertu des fonctions qui lui ont<br />
été conférées par l'art. 51 du décret du 1er octobre 1854, par des témoins in<br />
digènes, auxquels le testateur a fait connaître ses dernières dispositions, ne<br />
constitue pas le délit de faux témoignage en matière civile, qui ne peut se pro<br />
duire qu'au cours d'une instance liée devant un juge ;<br />
II. La fausse déclaration se produisant dans ces conditions, constitue le<br />
crime de faux en écriture publique par fabrication de dispositions ;<br />
C'est à tort qu'on a soutenu que selon la règle musulmane le testameut étant<br />
parfait par la seule déclaration des volontés du produites en présence<br />
testateur,<br />
de témoins, l'insertion de cette déclaration dans un acte public,<br />
n'est qu'une<br />
simple formalité qui n'ajoute rien à la validité du testament, et qu'en supposant<br />
cette déclaration mensongère elle ne pourrait tomber sous le coup de la loi ré<br />
pressive ;<br />
Les témoins appelés par le testateur étant destinés à assurer par leur té<br />
moignage la réalisation des volontés de celui-ci, leurs dépositions consignées<br />
par écrit constituent le titre du légataire, et l'acte dressé, dans les conditions<br />
ci-dessus indiquées, a le caractère d'un véritable testament sous forme authen<br />
tique et publique ;<br />
III. En présence du conflit négatif de juridictions que fait naître une ordon<br />
nance de renvoi de police correctionnelle prise par un juge d'instruction et l'ar<br />
rêt d'une Cour qui se déclare incompétente, la Cour de cassation peut d'office
228<br />
convertir le pourvoi formé devant elle par les prévenus en demande en règle<br />
ment déjuges (1).<br />
Mohammed ben Haffaf et consorts c. Min. Pub.<br />
Sur le moyen pris d'une violation des art. 363 et 365 du Code pénal, d'une<br />
fausse application de l'art. 147 du même code et d'une interprétation erronée<br />
de la loi musulmane sur la forme des testaments, en ce que là Chambre des<br />
appels correctionnels de la Cour d'Alger, se serait, à lort, déclarée incompétente<br />
pour connaître de la prévention dirigée contre les demandeurs, par le motif<br />
qu'en tenant pour constant les faits imputés à ces derniers, ils constitueraient,<br />
non les délits de faux témoignage et de subornation de témoins relevés à leur<br />
charge par l'ordonnance de renvoi, mais bien les crimes de faux et de com<br />
plicité de faux en écriture authentique et publique, prévus et punis par les<br />
— art. 147, 59 et 60 du C. pén. ; Attendu que les sept premiers demandeurs<br />
étaient inculpés d'avoir, le 9 décembre 1876, auFondouk, devant le cadi de<br />
l'Arbah, fait une déclaration mensongère en afirmant que peu de lemps avant<br />
sa mort, Kadoudja bent Hamadi, femme indigène, les avait pris à témoins<br />
qu'elle léguait le liers de ses biens à ses neveux Ali et Mohamed ben Djelloul,<br />
et ces deux derniers ainsi que Djelloul ben Saïd, leur père, d'avoir suborné<br />
lesdits faux témoins ;<br />
— Attendu<br />
qu'à bon droit, l'arrêt atlaqué a refusé de<br />
voir, dans les faits ainsi constatés, le délit de faux témoignage en matière<br />
civile prévu et réprimé par l'art. 363 sus-visé du C. p. ; Qu'aux termes de<br />
cet article interprêté suivant la porlée qu'à entendu lui donner le législateur,<br />
on ne peut considérer comme faux témoins en matière civile que les indivi<br />
dus appelés judiciairement par la partie,<br />
pour déclarer et attester sous la foi<br />
du sermentjes faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les fins de sa<br />
demande ; Que le faux témoignage suppose une instance liée devant un ma<br />
— gistrat agissant dans l'ordre de ses attributions judiciaires ; Attendu que<br />
si les cadis sont revêtus d'attributions de ce genre et chargés dans les limites<br />
fixées parla loi de leur institution de statuer sur les différents qui divisent<br />
les parties, ils ont, à un autre point de vue, le caractère d'officiers publics ap<br />
pelés en celle qualité à rédiger les actes, à recevoir les déclarations, à cons<br />
tater les conventions qui interviennent entre musulmans, et qu'ils sont, à<br />
cet égard, assimilés aux notaires, ainsi qu'il résulte des art. 44 à 48 du décret<br />
du 31 décembre 1859;<br />
— Attendu<br />
que c'esl en cette dernière qualité et en<br />
vue de lui imprimer un caractère authentique et public, que le cadi de l'Ar<br />
bah a reçu la déclaration supposée mensongère des sept premiers prévenus<br />
touchant les prétendues dispositions testamentaires que Kadoudja bent Hamadi<br />
aurait faites au profil de ses neveux Ali et Mohamed Djelloul, et au détri<br />
ment de sa seule et directe héritière, Mimi bent Kelil ben Assef ; Qu'une pa<br />
reille déclaration, préjudiciable aux intérêts d'un tiers, faite dans une inten<br />
tion frauduleuse, et insérée dans un acte authentique par un officier public,<br />
ayant qualité pour la recevoir, constituerait, si la fausseté en était démontré,<br />
le faux par fabrication de disposition ou obligations, tel qu'il est défini par<br />
(1) Nous avons donné au Bulletin judiciaire, page 124, 1878, l'arrêt de la Cour<br />
d'Alger,<br />
qui a donné lieu au pourvoi sur lequel a statué la Cour de Cassation par<br />
l'arrêt que nous publions aujourd'hui.
229<br />
l'art. 147 pré-rappelé du C. pên.;— Atlendu que vainement les deman<br />
deurs soutiennent qu'aux termes de la loi musulmane, le testament étant<br />
parfait par la seule déclaration des volontés du testateur faite devant deux<br />
ou plusieurs .témoins, l'insertion de cette déclaration clans un acte public,,<br />
n'ajoute rien à sa validité; qu'elle est une formalité purement surérogaloire<br />
et qu'en la supposant mensongère, elle no pourrait, à défaut d'un intérêt<br />
appréciable, tomber sous le coup de la loi répressive;<br />
le testateur, 'en appelant près de lui des témoins,<br />
— Mais<br />
attendu que<br />
sur la véracité desquels il<br />
croit pouvoir compter, et en leur faisant connaître ses intentions, en ce qui<br />
touche la dévolution de son hérédité n'a pas seulement pour but de leur<br />
communiquer ses dernières volontés, mais d'en assurer la réalisation, par le<br />
témoignage qu'ils en rendront plus tard, soit en justice, soit devant un of<br />
ficier public, chargé de leur imprimer le sceau de l'authenticité; que la mis<br />
sion de ces témoins esl donc, après le décès du testateur, de faire connaître<br />
les dispositions par lui arrêtées ; qu'à cet effet, leurs dépositions sont consi<br />
— gnées par écrit « et constituent. 1.? titre des légataires » ; Atlendu<br />
que l'arrêt attaqué, en assignant à l'acte du 9 décembre 1875,<br />
dès lors<br />
par lequel le<br />
cadi de l'Arbah a régulièrement reçu les déclarations de sept des prévenus<br />
relatives au legs prétendu fait par Kadoudja aux frères Ali et Mohamed Djel<br />
loul, le caractère d'un véritable testament sous forme authentique et publique,<br />
et en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente pour juger les<br />
auteurs et complices des fausses énonciations insérées dans cel acte, sauf au<br />
ministère public l'usage de son droit, loin d'avoir violé les dispositions de loi<br />
précitées en a fait au contraire une juste el saine interprétation ;<br />
— Altendu<br />
d'ailleursque l'arrêt est régulier en la. forme et qu'il n'échet d'en prononcer<br />
— l'annulation ; Mais altendu que sous un autre rapport le dispolif dudit<br />
arrêt est en contradiction avec l'ordonnance du juge d'instruction d'Alger du<br />
27 juillet 1877 qui renvoie les prévenus devant le Tribnnal correctionnel;<br />
Que de ces deux décisions contraires, passées aujourd'hui en force de chose<br />
jugée, et ne pouvant plus être réformées par les voies ordinaires, résulte un<br />
conflit négatif de juridiction qui interromp le cours de la justice ; qu'il y a'<br />
lieu dès lors pour le rétablir, de convertir le pourvoi en cassation en de<br />
— mande en règlement de juges ; Vu les ail. 526 et suivants du Coded'inst.<br />
—<br />
criminelle; Réglant de juger el sans s'arrêter à l'ordonnance du juge<br />
d'instruction laquelle sera considérée comme nulle et non avenue, renvoie:<br />
1° — El Hadj Lakdar ben Mohamed ben 2°<br />
Larbi; Ahmed ben Mohamed<br />
— ben Yahya ben 3° —<br />
Haffaf; Mohamed ben Djelloul 4°<br />
; Saad ben Saïdou ;<br />
6°<br />
5° —<br />
— Abdallah ben Saïdan ; Omar ben Mahdi 7°<br />
; Kouïder ben Sliman<br />
— Derad 8" —<br />
; Djelloul ben Saïd ben Akhlel 9° —<br />
; Ali ben Caïd Djelloul ;<br />
10°<br />
Mohamed ben Caïd Djelloul, en l'état où ils se trouvent, el les pièces de<br />
la procédure, devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel<br />
d'Alger, pour, au vu de l'instruction déjà faite et d'après tout complément<br />
qui sera jugé nécessaire, être statué conformément à la loi, tant sur la pré<br />
— vention que sur la compétence ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur<br />
général, le présent arrêt sera notifié à qui de droit.<br />
M. Rorert de Chenevière, rapp.; M. Petiton, av. gén.; Mc Lehman, av.
230<br />
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER<br />
23 février 1878.<br />
Acte d'appel , — Défaut de signification à personne ou à<br />
domicile. — Nullité.<br />
Est nul l'appel signifié au domicile élu dans un commandement alors que<br />
les causes de ce commandement ont été éteintes ; la règle que tout acte doit être<br />
signifié à personne ou à domicile reprend dès lors toute sa vigueur .<br />
Mestre, c. Dreyfus, Mayer et Cle, de Cette.<br />
La Cour : Attendu qu'aux termes de l'article 456 du Code de procédure civile,<br />
l'acted'appel doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou à domicile;<br />
Attendu en fait que l'acte d'appel relevé par Mestre, à Alger, a élé notifié au do<br />
—<br />
micile élu dans un commandement du 29 novembre 1877; Attendu que l'ar<br />
ticle 584 du Code de procédure civile, autorise, il est vrai, le débiteur, pour<br />
suivi à faire au domicile élu dans le commandement toutes significations,<br />
même d'offres réelles et d'appel, mais seulement jusqu'à la fin de la pour<br />
—<br />
suite; Attendu qu'il résulte des documents versés au débat, que la pro<br />
cédure à laquelle avait donné lieu le commandement du 29 novembre-élait<br />
terminée dès le 3 décembre suivant par la libération intégrale du débiteur<br />
poursuivi;<br />
— Attendu<br />
que l'appel n'a été relevé que le 5 décembre 1877,<br />
qu'à ce moment l'exécution élait complète el que le débiteur ne pouvait plus<br />
— bénéficier des immunités de l'article 584 ; Altendu au surplus que la fa<br />
culté accordée par l'article 584 a pour but évident de permettre au débiteur<br />
d'arrêter les poursuiles qui pourraient être la conséquence immédiate du<br />
commandement, mais que cette faculté n'a plus d'objet, lorsque, comme dans<br />
l'espèce, le paiement amis fin à toutes les poursuites —<br />
; Atlendu que l'ap<br />
pel de Mestre devait donc être notifié conformément aux dispositions pres<br />
crites à peine de nullité par l'article 456, d'où il suit que cet appel est ir<br />
Par ces motifs : Rejette comme nul et irrecevable l'appel relevé<br />
recevable;<br />
par Mestre, et condamne ce dernier à l'amende et aux dépens.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lr«Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
7 mai 1878.<br />
I, Cession de créance. — II. Cautionnement.<br />
/. Le transport d'une créance comprend, ipso facto, le transport du cautionne-
231<br />
ment qui la garantissait ; la caution est donc obligée vis-à-vis du cessionnaire ,<br />
comme elle l'était avant le transport, vis-à-vis du cédant ;<br />
II. Le fait par le cédant d'avoir consenti à une prorogation<br />
, d'échéance, sans le<br />
consentement de la caution, ne peut dégager celle-ci, si elle n'a point fait elle-<br />
même, à l'époque du terme primitif,<br />
dette ou se fare décharger du cautionnement .<br />
les diligences nécessaires pour éteindre la<br />
Crouzat c. Sinègre.<br />
Altendu qu'aux termes de l'art. 1692 du Code civil la cession d'une<br />
créance comprend la caution ; Que, lorsque le 6 avril 1863, Masson a trans<br />
porté à Sinègre les créances que lui avait cédés Crouzat le 19 juin 1859, il<br />
lui a transporté en môme temps,<br />
parla seule force de la loi, le cautionne<br />
ment, personnel de Crouzal résultant de l'acte sons seing- privé enregistré,<br />
du 10 juin 1858; Que Crouzat est donc tenu envers Sinègre comme il fê<br />
— lait envers Masson ; Attendu en conséquence que Crouzat n'est pas fondé<br />
à soutenir que n'élanl pas la caution de la créance, mais simplement garant<br />
envers Masson, que celui-ci serait payé, les dispositions de l'art. 2039 du<br />
Code civil ne sont pas applicables à la cause; Qu'il ne peut soutenir da<br />
vantage que le cautionnement a pris fin par l'échéance du lerme el qu'en<br />
accordant une prorogation de 7 années sans demander le consentement de<br />
la caution, l'intimé a commis une faute lourde qui dégage la caution ; Que<br />
Crouzat ne peut en effet s'en prendre qu'à lui-même, si, peu vigilant et peu<br />
soucieux de ses intérêts, il a négligé, à l'échéance du lerme, de poursuivre les<br />
débiteurs pour les forcer au paiement pu lui procurer la décharge de son<br />
cautionnement;<br />
— Altendu que la condamnation prononcée par le jugement<br />
dont est appel devra naturellement être diminuée des sommes que Sinègre<br />
a ou aura touchées sur les créances dont Crouzal s'est porté caution ;<br />
— At<br />
tendu qu'à partir du jour de la demande les intérêts doivent être fixés au<br />
taux légal en Algérie ;<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés : Confirme le ju<br />
gement dont est appel, et condamne l'appelant à l'amende consignée et aux<br />
dépens.<br />
M. de Vaulx, subs. du proc. gén. ; MMes Chéronnet et Bouuiaud, av.<br />
I. Compétence. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />
Présidence de M. BAST1EN, Président.<br />
II.<br />
22 décembre 1877.<br />
Litige, entre musulmans, au sujet d'un<br />
immeuble non soumis à la loi française, —<br />
III. Xitre Français.<br />
Ordre<br />
public. —<br />
/. Entre musulmans la compétence ries tribunaux musulmans est le droit
232<br />
commun et originaire, qui doit être suivi jusqu'à<br />
ce1<br />
que la preuve d'une déro<br />
gation, autorisée par une législation postérieure, ait élé démontrée ;<br />
II. Lors donc qu'il s'agit, entre musulmans, d'une contestation relative à un<br />
immeuble que l'on n'établit pas avoir été soumis à la loi française, les tribunaux<br />
français doivent se déclarer incompétents d'office, ce qui touche à l'organisa<br />
tion des juridictions étant d'ordre public ;<br />
Il importerait peu que la terre, objet du eût litige; été possédée précédemment<br />
par un français, si la preuve de l'établissement de la propriété par un titre<br />
français,<br />
n'est pas fournie (1).<br />
Mohamed bel Kassem c. Srir ben Hassen.<br />
ARRÊT.<br />
LA COUR: Considérant qu'il s'agit au procès d'une contestation relative à<br />
vertu de la loi du 26 juillet 1873<br />
— l'existence d'un bail d'une terre; Qu'en<br />
cette contestation serait du ressort des tribunaux français,<br />
s'il élait prouvé<br />
que la terre qu'elle a pour objet est elle-même soumise à la loi française ;<br />
Mais que cette preuve n'esl point rapportée et ne peut résulter de ce que<br />
l'immeuble aurait élé précédemment en la possession d'un français;<br />
cette possession a pu être le résultat, soit d'un bail, soit d'une voie de fait et<br />
non celui de l'établissement de la propriélé par un litre français, qui n'est<br />
—<br />
pas rapporté ; Que rien n'indique que la loi de 1873 ail été jusqu'à pré<br />
—<br />
sent appliquée aux terrains dont s'agit ; Qu'entre musulmans, la compé<br />
tence musulmane est le droil commun et originaire qui doit être suivi jus<br />
—<br />
— Que<br />
qu'il a été abrogé par l'application d'une<br />
qu'à ce qu'il soit démontré, en fait,<br />
législation postérieure ;<br />
— Considérant qu'il s'agit d'une incompétence d'or<br />
-<br />
dre public tenant à l'organisation des juridictions ; Considérant que les in<br />
timés, en faisant commandement à fin de saisie-gagerie suivant la loi fran<br />
çaise, ne pouvaient formuler cet acte qu'à charge de voir porter devant les<br />
tribunaux français, seuls compétents pour apprécier une semblable procé<br />
l'oppositian dont elle pourrait être l'objet de la part de ceux qui en<br />
dure,<br />
— étaient touchés ; Qu'ainsi c'est par le fait des intimés que les tribunaux<br />
français ont été saisis à lorl ;<br />
Réforme comme incompétamment rendu le jugement don l est appel ; Le<br />
meta néant ; Décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées ;<br />
Déclare, en l'état, les parties non recevables en toutes leurs conclusions; Or<br />
donne la restitution de l'amende ; Condamne les intimés aux. dépens de pre<br />
mière instance et d'appel.<br />
M. de Yaulx, subst. du proc. gén.; MMes Chéronnet et F. Huré, av.<br />
*o<br />
(1) La Cour accentue de plus en plus sa dernière jurisprudence,<br />
en vertu de<br />
laquelle l'accès des tribunafix français se -trouve fermé aux indigènes, sauf dans<br />
— les cas formellement prévus par la loi. V. Bull. jud. 1878, p. 27 et la note.;<br />
1877, p. 90. — Mais dans le cas où l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un titre<br />
français,<br />
le juge musulman doit aussi soulever d'office l'exception d'incompétence.<br />
C'est ce qui résulte de deux arrêts publiés dans le Bull. jud. de 1878, p. 42 et 44<br />
et de l'arrêt suivant.
Compétence, —<br />
233<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2' Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
4 janvier 1878.<br />
Contestation entre musulmans, — Titre ad<br />
ministratif.<br />
Est de la compétence exclusive des tribunaux français la contestation sou<br />
levée, entre musulmans, au sujet d'immeubles qui ont fait l'objet d'un titre ad<br />
ministratif (1) .<br />
Veuve Mohamed bent Merbach c. Mohamed ben Achour.<br />
ARRÊT.<br />
LA COUR: Considérant qu'en Ihèse générale, ce serait à bon droit que<br />
les prejniers juges se seraient déclarés incompétents pour connaître d'une<br />
revendication territoriale entre musulmans ; Mais que l'appelante demande<br />
resse en première instance fonde sa revendication sur son acte d'échange<br />
passé en la forme administrative le 21 mars 1858 entre elle et l'État, devant<br />
le général de division, ledit acle enregistré à Alger, le 16 mai 1859;<br />
— Qu'il<br />
est de principe que les tribunaux français sont seuls compétents pour appré<br />
cier les questions de propriélé fondées sur des actes émanés de l'autorité<br />
française ;<br />
— Que<br />
cette compétence est la conséquence de la souveraineté<br />
territoriale et de la séparation des juridiclions française et musulmane ;<br />
Que les tribunaux musulmans ne peuvent apprécier des droits constatés par<br />
des fonctionnaires ou offloiers publics sur lesquels ils ne peuvent avoir au<br />
cune action et qui agissent dans une sphère étrangère à la leur ;<br />
— Que ces<br />
principes ont été appliqués par l'ordonnance du 21 juillet 1846 et l'article 2<br />
de la loi du 26 juillet 1873;<br />
—<br />
Par ces motifs : Donne défaut contre l'intimé non comparant ;<br />
— Dit<br />
—<br />
Réforme;<br />
que la juridiction française est compétente, et le fond n'étant pas en<br />
état, renvoie les parties devant, le Tribunal de Blida composé d'autres juges ;<br />
Ordonne la restitution de l'amende; Condamne l'intimé aux dépens d'appel,<br />
réserve les dépens d'instance pour être joints au fond.<br />
M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén. ; Me Dazinière, av.<br />
I. Désistement. — Réserves.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2« Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
25 juillet 1878.<br />
—<br />
(1) Voir la note sous l'arrêt qui précède.<br />
Refus<br />
d'acquiescement.
II. Appel<br />
234<br />
irrecevable.— Préjudice résultant de l'appel.—<br />
Dommages et intérêts, — III. Droit de statuer<br />
/. La partie à laquelle est signifié un acte de désistement d'appel, est fondée<br />
à refuser d'y acquiescer, lorsque cet acte contient une clause de réserve, d'un<br />
caractère incertain ou litigieux qui peut compromettre ses droits ;<br />
//. L'appel irrecevable,<br />
reconnu purement vexâtoire et ayant entraîné un<br />
préjudice pour l'intimé, peut servir de base à une demande en dommages et in<br />
térêts formulée par celui-ci en exécution des termes de l'art. 464 du C. de<br />
pr. civ. ;<br />
///. Rien que déclarant l'appel irrecevable, la Cour, qui a seule qualité pour<br />
reconnaître l'irrecevabilité, peut valablement être saisie d'une demande en<br />
dommages et intérêts forméepar l'intimé, et statuer sur cette demande justifiée<br />
par l'appel considéré comme fait non juridique mais dommageable.<br />
Haziza frères c. Jacob Bou-Aziz et Coeffier, syndic de la faillite Bou-Aziz.<br />
LA COUR : Considérant que pour justifier le refus d'acceptation du désis-<br />
■ tement d'appel offert par Haziza, il n'est pas nécessaire d'établir que la ré<br />
serve contenue en ce désistement élait mal fondée ; Qu'il suffit de remarquer,<br />
ce qui esl incontestable, que cette réserve était d'un caractère incertain ou<br />
litigieux, pour que l'intimé ne pût, sans compromettre ses droits, acquiescer<br />
— à l'acte qui la conlenait; Considérant qu'il résulte des pièces de la pro<br />
cédure et qu'il, esl reconnu par les parties que l'appel a été interjeté après<br />
— l'expiration du délai légal ; Que cet appel a causé à l'intimé un préjudice<br />
q-ue la Cour peut évaluer, qui résulte de la difficulté qu'éprouvait l'intimé à<br />
vendre la maison sur laquelle continuait à peser l'inscription sans valeur<br />
prise par l'appelant ; Que l'intimé ne pouvait ainsi réaliser les ressources qui<br />
lui étaient nécessaires pour satisfaire aux obligations de son concordat ; Que<br />
cependant l'inscription devait être radiée, ainsi que l'a reconnu l'appelant en<br />
offrant de se désister de son appel contre le jugement qui avait ordonné<br />
cette radiation ; Que l'appel a donc été un acte vexatoire et de méchanceté ;<br />
— Considérant<br />
que si l'intimé ne peut demander des dommages-intérêts par<br />
appel incident, puisque l'appel principal et non-recevable n'a pu saisir vala<br />
blement la Cour, ni ouvrir la faculté d'appel incident,<br />
il peut former celte<br />
demande aux termes de l'art. 464 du Code de procédure, pour préjudice subi<br />
depuis le jugement et par l'appel considéré comme fait non juridique; mais<br />
dommageable; Qu'il n'appartenait qu'à la Cour de reconnaître la non rece<br />
vabilité de l'appel, lequel produisait ses effets suspensifs, jusqu'à ce qu'il eût<br />
été rejeté; Que la juridiction compétente pour y slatuer peut seule l'être<br />
aussi pour apprécier les réparations qu'il peut comporter;<br />
Par ces motifs : Dit qu'il n'y a lieu de sanctionner le désistement offert<br />
par l'appelant ; Déclare l'appel non recevable ; Condamne l'appelant en<br />
300 francs de dommages-intérêts à l'amende et aux dépens d'appel distraits.<br />
M. Cammartin, av, gén. ; MM" Robe el Jouyne, av.
235<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels_ musulmans) .<br />
I, Loi musulmane. — Mariage.<br />
tion du mariage. — Condition.<br />
— — III. Divorce.<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
IV.<br />
29 janvier 1878.<br />
— Puberté, — II. Consomma<br />
—<br />
Violation<br />
Appréciation, —<br />
de la condition.<br />
Droits réservés.<br />
I. Le droit musulman autorise la célébration du mariage entre parties con<br />
tractantes n'ayant pas encore atteint l'âge de puberté, mais sous condition de<br />
consommation ultérieure du mariage, suspendue jusqu'après l'événement de la<br />
puberté ;<br />
II. C'est au magistrat qui dresse l'acte de mariage qu'il appartient de pren<br />
dre les mesures nécessaires, pour assurer effectivement le respect de la condition<br />
imposée;<br />
III. La violation par le mari de cette condition est de nature à légitimer<br />
une demande en divorce formulée par la femme ;<br />
IV. Lorsqu'une femme musulmane non encore nubile,<br />
mariée sous une sem<br />
blable condition, a été l'objet de la part de son mari de violences, qui autori<br />
seraient une demande de divorce, sajeunesse ne. luipermettant pas encore d'ap<br />
précier s'il est de son intérêt de rompre l'union contractée, il a y lieu pour le<br />
juge, après constatation de la violation de la condition imposée, de mettre effi<br />
cacement la femme à l'abri des brutalités du mari, en lui réservant tous ses<br />
droits pour provoquer le divorce ultérieurement à l'événement de sa puberté.<br />
Kueiba bent Mohamed c. Ahmed ben Mohamed.<br />
Considérant que par acte en date du 13 décembre 1876, le cadi de la cin<br />
quième circonscription d'Aumale, Sid Mohamed Es-Saïd ben El-Laoubi, a<br />
dressé l'acte de mariage de Ahmed ben Mohamed, âgé de 16 ans et de Kheïra<br />
bent Mohamed ben Khaoua, désignée comme ayant l'âge de 13 ans;<br />
— Consi<br />
dérant qu'il est stipulé dans cet acte que la consommation du mariage n'aura<br />
lieu que lorsque l'épouse sera nubile, mais que le cadi n'a prescrit aucune<br />
—<br />
mesure pour assurer l'exécution de cet engagement; Que Kheïra a élé<br />
remise aux parents de son mari et à son mari lui-même ;<br />
qu'il résulte d'un certificat de médecin, qu'à la date du 25 janvier 1878,<br />
Kheïra est âgée de 12 à 13 ans et que le mariage a été consommé ;<br />
— Considérant<br />
— Que<br />
dès lors, au moment du mariage celte enfant était âgée de 11 à 12 ans, et<br />
que la condition insérée dans le contrat de mariage n'a pas été accomplie ;<br />
Considérant que si le droit musulman autorise les mariages sous la condition<br />
d'une consommation ultérieure, il faut admettre aussi que le magistrat qui<br />
procède à ces unions doit, sous sa responsabilité, prendre les mesures néces<br />
saires ponr garantir la jeune fille de tout attentat commis contre sa pudeur<br />
—<br />
pendant l'existence de la condition ; Considérant que nonobstant celte<br />
obligation de stricte morale, les cadis d'Algérie ayant, dans la plupart des<br />
cas, négligé de protéger efficacement les enfants dont ils célébraient le ma-<br />
—
236<br />
riage contre la brutalité des maris, el les actes. les plus odieux, les plus<br />
scandaleux, des crimes mêmes, ayant été la conséquence de celte coupable<br />
négligence, M. le Gouverneur général, usant de son droit disciplinaire sur la<br />
justice musulmane, a, par de nombreuses circulaires et notamment dans celle<br />
du 19 décembre 1872, défendu aux cadis de procéder à des mariages avant le<br />
jour ou ils peuvent être légalement consommés ;<br />
— Qu'il<br />
est dit :<br />
« Le ma-<br />
» riage esl subordonné à la puberté ou à la nubilité des contractants; dans<br />
» le cas de doules,<br />
c'est sous leur responsabilité personnelle que les cadis<br />
» passeront outre au mariage et je me suis décidé à prononcer la révocation<br />
» de tout magistrat, qui dans un cas de l'espèce commettrait une erreur ou<br />
» se rendrait coupable d'une complaisance préjudiciable à l'un ou à l'autre<br />
» des » conjoints; — Considérant que le cadi d'Aumale ayant méconnu ces<br />
devoirs si nettement tracés et dont au besoin il aurait dû trouver la règle dans<br />
sa conscience demagistrat, ilestarrivé, comme cela était inévitable, que lajeune<br />
Kheïra, cohabitant avec son mari, a été l'objet de l'odieuse lubricité de ce jeune<br />
homme et que pour se soustraire à ses mauvais traitements elle s'est enfuiedu<br />
— domicile conjugal ; Considérant que par le jugement dont est appel le cadi<br />
persistant dans son aveuglement inexcusable n'a trouvé rien de mieux à<br />
faire que de placer les deux époux sous la surveillance du chaouch du juge<br />
de paix d'Aumale, tout en maintenant leur cohabitation antérieure;<br />
— Con<br />
sidérant que les faits de la cause sont de nature à légitimer le divorce, mais<br />
que le mariage ayant été consommé el Kheïra se trouvant encore trop jeune<br />
pour apprécier s'il convient mieux pour elle de rompre son union ou de la<br />
maintenir, il y a lieu dans son intérêt de se borner à la mettre efficacement<br />
à l'abri de la brutalité de son mari jusqu'à sa nubililé constatée en lui réser<br />
vant toutefois tous ses droils pour provoquer à celle époque le divorce à rai<br />
son des faits qui motivent lé présent arrêt ;<br />
Par ces motifs : Confirme au fond le jugement entrepris;<br />
— Dit<br />
toutefois<br />
que la femme Kheïra sera remise à sa mère chez laquelle elle séjournera<br />
pendant l'espace de deux ans ; fait défense au père de Kheïra de recevoir pen<br />
dant ce temps son gendre dans sa maison;<br />
— Condamne-<br />
l'intimé à payer<br />
pendant ce temps une pension de vingt francs par mois pour sa nourriture<br />
et ses vêtements, et ce à partir du jour du jugement ; le condamne également<br />
à tous les dépens de première instance el d'appel.<br />
M. Cammartin, av. gén. ; Baudrand, av.<br />
TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2« Ch).<br />
Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />
29 octobre 1877.<br />
I. Droit de réponse aux. articles publiés dans les journaux. —<br />
Excédant de longueur. — Détermination du prix .<br />
réelles. — Validité.<br />
— II.<br />
Offres<br />
/. Il n'appartientpas au rédacteur d'unjournal mis en demeure d'insérer la
237<br />
réponse d'une personne dont il a parlé, de déterminer à son gré le prix des<br />
lignes excédant le nombre accordé par la loi.<br />
Quand bien même il n'aurait inséré la réponse qu'après avoir indiqué le prix<br />
qu'il entendait réclamer, il n'y a là aucun contrat.<br />
II. Il appartient aux Tribunaux d'apprécier la valeur de ce supplément<br />
d'insertion et de valider les offres faites par celui qui l'a requise.<br />
Bourlier c. Leroux. .<br />
Attendu que le sieur Emile Leroux,<br />
rédacteur et gérant du journal le<br />
Réveil, a par exploit du 2 janvier 1877 enregistré, assigné le sieur Charles<br />
Bourlier devant le tribunal civil d'Alger, en paiement de la somme de<br />
810 fr., avec intérêt de —<br />
droit, dépens et exécution provisoire; Attendu<br />
que le sieur Leroux conclut à l'adjudication des fins de son exploit intro-<br />
— ductif d'instance; Attendu que le sieur Bourlier conclut sans l'offre<br />
d'une somme de 162 fr. au déboulé des prétentions du sieur Leroux ;<br />
— At<br />
tendu que le journal le Réveil, du 24 décembre 1876, contenait un article en<br />
165 lignes dans lequel la personne du sieur Bourlier, conseiller général,<br />
était désignée; Que celui-ci a par exploit du 29 décembre 1876, enregistré,<br />
sommé le sieur Leroux d'insérer dans le plus prochain numéro du journal<br />
devant paraître le 31 décembré'lors courant, à la place et avec les caractères<br />
de l'article du 24 décembre 1876, sa réponse, offrant la somme qui serait<br />
réclamée par le sieur Leroux pour le prix d'insertion des lignes pouvant ex<br />
céder son droit de réponse soit 330 lignes; Que le sieur Leroux a répondu à<br />
l'huissier instrumentant qu'il étail prêt à obtempérer à cette sommation en<br />
prenant acte toutefois de l'offre faite par le sieur Bourlier, de payer le prix<br />
d'insertion de l'excédant, prix que ledit sieur Leroux déclarait être de 5 fr.<br />
par ligne ; Que le sieur Leroux ès-qualilés a effectivement inséré dans le<br />
Réveil du 31 décembre 1876, la réponse du sieur Bourlier, en 492 lignes;<br />
Qu'ainsi le nombre de lignes excédant le droil de réponse du sieur Bourlier<br />
—<br />
s'est trouvé être de 162 lignes ; Attendu que les faits qui précèdent sont<br />
constants entre les parties; Que le litige porte uniquement sur le point de<br />
savoir quel doit être le prix de l'excédant; Que le sieur Leroux le fixe à<br />
5 francs la ligne, soit 810 francs, et le sieur Bourlier à 1 franc la ligne, soit<br />
à 162 francs; Que le sieur Leroux se base sur ce que, d'une part le sieur<br />
Bourlier, en offrant le prix d'insertion de l'excédant, et ne répondant pas à<br />
sa déclaration, que ce prix était de 5 francs la ligne consenti, dès lors à<br />
payer cet excédant au prix de 5 francs la ligne ; Que le second se base sur ce<br />
que la loi ne l'obligeant à payer l'excédant, que d'après le tarif des annonces<br />
du Réveil, et le prix le plus élevé des annonces du journal étant de 1 franc<br />
la ligne, il ne pouvait être tenu de payer les 162 lignes dont s'agit plus de<br />
1 franc la ligne; Qu'il convient d'apprécier actuellement, ceci posé, le mé<br />
— rite de ces prétentions contraires; Attendu que l'offre du sieur Bour<br />
lier au sieur Leroux de payer la somme qui serait réclamée, pour le prix<br />
d'insertion des lignes pouvant excéder le droit de réponse, doit être raison<br />
nablement considérée non comme un engagement de payer la somme qui<br />
pourrait être légalement réclamée par le sieur Leroux ; Qu'ainsi cette offre<br />
ne touche pas le point arlétigieux,<br />
c'est-à-dire la question de savoir, si c'est
238<br />
bitrairement ou légalement dans l'espoir que le sieur Leroux réclame 5 fr.<br />
par ligne au sieur Bourlier ; Qu'à la vérité le sieur Bourlier n'a pas répondu<br />
à la déclaration du sieur Leroux prenant acte de son offre, et affirmant que le<br />
prix de la ligne d'excédant à raison de la place et des caractères de l'insertion,<br />
étaient de 5 francs la ligne, mais que ce silence est à lort, considéré parle<br />
sieur Leroux, comme une acceptation certaine du chiffre de 5 francs ; Que<br />
les conventions se forment par l'échange des consentements formels des con<br />
tractants;<br />
Qu'elles ne sauraient légalement résulter par induction du con<br />
sentement exprès de l'une rapprochée du silence de l'autre; Que le sieur<br />
Leroux devait rapporter une acceptation formelle par le sieur Bourlier, du<br />
chiffre de 5 francs par lui réclamée ; Qu'alors seulement il établissait la con<br />
vention qu'il invoque;<br />
— Attendu<br />
qu'il importe peu qu'une insertion vo<br />
lontaire dans le Réveil à la demande officieuse d'un particulier, coûte à<br />
celui-ci à la place el avec les caractères employés dans la réponse du sieur<br />
Bourlier, 5 francs la ligne ; Qu'il existe alors entre les intéressés une con<br />
vention, qu'il en est autrement d'une insertion forcée, sur la sommation<br />
d'un particulier désigné dans un journal, agissant pour l'exercice de son<br />
droit de réponse en vertu de dispositions spéciales de la loi ; Que si dans le<br />
premier cas, le particulier est libre de choisir la place et les caractères qui<br />
lui conviennent, dans le second cas il est moralement obligé de répondre à<br />
la place et avec les caractères employés ; Qu'autrement l'équilibre serait<br />
rompu dans une certaine mesure, entre l'attaque et la défense; Que c'est<br />
l'auteur du premier article el non de la réponse qui impose par suite, la place<br />
et les caraclères de la réponse; Qu'il ne peut dépendre de lui, de détermi<br />
ner en cas d'excédant, la somme que devra payer l'auteur de la réponse pour<br />
cet excédant que le premier article aura rendu nécessaire; Que d'ailleurs<br />
les deux cas dont s'agit sont tellement différents, que si, dans le premier,<br />
toutes les lignes doivent être intégralement payées, d'après la place et les ca<br />
ractères de l'insertion, dans le second, l'insertion delà réponse a lieu gratis<br />
fut-elle double de l'article qui l'a motivée ; Qu'ainsi l'excédant de lignes de-<br />
la réponse à la place et avec les caractères employés dans le Réveil ne doit<br />
pas nécessairement être payé par le sieur Bourlier sur le prix de 5 francs la<br />
ligne comme une insertion volontaire ; Qu'il s'agit d'hypothèses distinctes ;<br />
Que c'est à la loi qui a réglé l'exercice du droit de réponse qu'il faut recou<br />
vrir dans l'espèce qui est celle d'une insertion forcée pour résoudre le point<br />
— du litige; Attendu qu'il résulte des articles 11 de la loi du 25 mars 1825,<br />
17 de la loi du 9 septembre 1835, du décret du 6 mars 1648, de l'article 13<br />
de la loi du 17 juillet 1849, combinées complétés, par la doctrine que l'excé<br />
dant du droil de réponse doit être payé d'après le tarif des annonces du jour<br />
—<br />
nal ; Atlendu que ce tarif est pour le Réveil de 15, 35 centimes, 1 franc<br />
la ligne, suivant le cas, que le sieur Bourlier offre le prix le plus élevé, soit<br />
— 1 franc la ligne; Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent,<br />
que les prétentions du sieur Leroux sont mal fondées ;<br />
— Altendu que le<br />
sieur Bourlier a par exploit du 5 janvier 1877 enregistré, offert au sieur Le<br />
roux la somme de 1 1 1 francs ; Qu'il offre actuellement au sieur Leroux, celle<br />
de 162 francs; Que le procès est né,<br />
non de la différence entre ces deux<br />
sommes-, différence qui est le résultai d'un erreur matérielle de, calcul du<br />
sieur Bourlier mais de la prétention du sieur Leroux de se faire payer 5 fr.
239<br />
la ligne, l'excédant du droit de réponse alors que le sieur Bourlier, n'enten<br />
dait le payer qu'un franc la ligne ; Qu'ainsi les dépens doivent être mis à.la<br />
charge de Leroux : —<br />
Atlendu<br />
qu'il n'y a lieu à exécution provisoire.<br />
Par ces motifs: Statuant en premier ressort, dit n'y avoir lieu de valider<br />
les offres du sieur Bourlier, comme n'ayant point été faites en temps utile<br />
pour la somme de 162 francs ; Donne acte toutefois au sieur Bourlier de ce<br />
qu'il a toujours offerfet offre encore au sieur Leroux de lui payer l'excédant<br />
1 franc la ligne. Condamne en tout que de besoin le sieur Bourlier, à payer<br />
pour ces causes, la somme de 162 francs avec intérêts de droit au sieur Le<br />
roux, débouter ce dernier du surplus des fins de sa demande et le condamne<br />
aux dépens.<br />
M. Rack, subst. du pr. de la Rép. ; MMes Bordet et Letellier, av.<br />
— I, Presse. Outrage.<br />
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MOSTAGANEM<br />
plainte. — II.<br />
Présidence de M.-<br />
—<br />
5 juillet 1878.<br />
MESSIER, juge.<br />
Ministre d'un culte. — Absence de<br />
Irrecevabilité de l'action publique.<br />
/. Lorsque le ministre.d'un culte reconnu par l'État a été outragé, non pas<br />
dans l'exercice de ses fonctions,<br />
mais seulement à raison de ses fonctions ou de<br />
sa qualité, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par une<br />
plainte de la partie intéressée ;<br />
II. Parlant est irrecevable comme irrégulièrement intentée la poursuite<br />
exerce'e d'office par le ministère public dans de semblables conditions .<br />
Min. pub. c. Aguillon..<br />
LE TRIBUNAL : Altendu que le nommé Aguillon a été assigné à cpmpa-<br />
raîlre comme prévenu d'avoir, à Mostaganem, le 20 juin 1878, outragé pu<br />
bliquement, à raison de ses fondions ou de sa qualilé, le curé de la ville,<br />
—<br />
ministre d'un culte légalement reconnu el salarié par TÉlal ; Attendu que<br />
la poursuite est basée sur ce fait qu'Aguillon aurait, au milieu d'un rassem<br />
blement populaire, proféré contre le minisire du culte précité les cris : « A<br />
bas les calottins ! Ce sont tous des canailles ! » — Endroit<br />
: Attendu qu'au<br />
termes de la législation (loi du 26 mai 1819, art. 5 ; du 25 mars 1822,<br />
arl. 6<br />
et 7; du 8 octobre 1830, art. 5 ; combinés) et de la jurisprudence (arrêts de<br />
la Cour de cassation du 10 janvier 1833 et du 25 juin 1846), l'action pu<br />
blique ne pouvait en l'espèce être mise en mouvement que'par une plainte<br />
— delà personne outragée; En fait: Atlendu qu'aucune plainte préalable<br />
—<br />
n'a été formulée ; qu'aucune déclaration du curé de Mostaganem ne figure<br />
même au procès-verbal ; que bien plus cet ecclésiastique a demandé que des<br />
poursuites n'eussent pas lieu ;<br />
—<br />
Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas des<br />
à raison même des circonstances toul-à-fait exceptionnelles dans les-<br />
débals,
240<br />
quelles le fail s'est produit, que les paroles incriminées aient été prononcées<br />
à l'adresse directe dudit curé de Mostaganem; Que du reste ces paroles n'ont<br />
eu aucun écho dans la foule, et que ni l'ordre public ni la tranquillité des<br />
— citoyens n'en ont été troublés ; Attendu que dans ces conditions la. pré<br />
vention, telle qu'elle est formulée par le ministère public ne peut-être ac<br />
cueillie ;<br />
Par ces motifs : Déclare Aguillon acquitté de la prévention portée contre<br />
lui,<br />
et le renvoie des fins des poursuites, sans dépens.<br />
Fonds de commerce. — Vente.<br />
Validité du paiement.<br />
M. Charrier, Proc. de la Rép. ; M
2e année. —<br />
16<br />
Août 1878. —<br />
IV0 40<br />
BULLETIN JUDICIAIRE M L'ALGÉRIE<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />
Algérie. — Ville d'Alger, —<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
19 mai 1876.<br />
LÉGISLATION<br />
Taxe pour frais de premier éta<br />
blissement ou de reconstruction à grande section des égoûts<br />
publics. —<br />
tre égoût .<br />
Maison riveraine déversant ses eaux dans uu au<<br />
Aux termes du décret du 28 août et 4 octobre 1859, les frais depremier éta<br />
blissement ou de reconstruction à grande section des égoûts publics dans la<br />
ville d'Alger, doivent être répartis par moitié entre la ville et les propriétaires<br />
riverains au prorata du développement des façades de leurs propriétés .<br />
Une maison ayant sa façade principale sur une rue et déversant ses eaux<br />
dans l'égoût de cette rue, mais qui est en même temps riveraine d'une autre<br />
rue, doit contribuer au prorata du développement de sa façade sur cette der<br />
nière rue à l'établissement de l'égoût de celle-ci.<br />
Dame veuve Durand, c. la Ville d'Alger.<br />
La dame veuve Durand, propriétaire à Alger d'une maison faisant angle sur<br />
les rues Desaix et de la avait Kasbah, demandé la charge d'une somme qui lui<br />
avait été imposée à titre de part contributive dans les frais de reconstruction de<br />
l'égoût de cette dernière rue ; elle soutenait qu'elle n'avait aucun intérêt à cette<br />
construction, la façade principale de son immeuble étant située rue Desaix, et<br />
les tuyaux d'écoulement des eaux pluviales et ménagères déversant leurs ea«x<br />
dans l'égoût de cette dernière rue, La commune d'Alger répondait en invoquant<br />
les termes de l'art. 5 du décret du 26 août 1859. Le conseil de préfecture d'Al<br />
ger et sur pourvoi de la dame Durand, le conseil d'état, ont repoussés par les<br />
motifs suivants, les prétentions de cette dame.<br />
Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du décret du 26 août 1859, les frais<br />
de premier établissement ou de reconstruction à grande section des égoûts<br />
publics, doivent être répartis par moitié entre la ville d'Alger et les pro<br />
priétaires riverains au prorata du développement des façades de leurs pro<br />
priétés ; — Considérant qu'il résulle de l'instruction que,<br />
si la maison appar<br />
tenant à la dame Durand, a sa façade principale rue Desaix et déverse ses<br />
eaux pluviales et ménagères dans l'égoût de cette rue, ladite maison n'en a<br />
pas moins sur la rue de la Kasbah, une façade dont le développement est de 15
242<br />
m. 80 cent. ; que dans ces -circonstances, la dame Durand n'est pas fondée à<br />
demander décharge de la somme de72fr. 67,<br />
montant de sa part contri<br />
butive dans les frais de reconstruction de l'égoût de la rue de la Kasbah ;<br />
Rejette, etc.<br />
M. de la Martinière, rapp. M. Laferrière, comm. du gouv.<br />
Algérie. — Tase des loyers. —<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
13 juillet 1877.<br />
Officier<br />
sans troupes. —<br />
—<br />
Offi<br />
cier détaché comme stagiaire dans un bureau arabe. —<br />
Prestations .<br />
Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 novembre 1848, les officiers sans<br />
troupes sont imposables à la taxe des loyers dans des conditions identiques à<br />
celles qui régissent tous les contribuables, et comme aux termes du décret du<br />
25 décembre 1875, les officiers employés dans les affaires indigènes de l'Al<br />
gérie sont classés comme officiers sans troupes, ils ne sont pas fondés à de<br />
mander leur décharge, en soutenant que leur mission était toute temporaire.<br />
Carles c. commune de Constantine.<br />
Le sieur Caries, lieutenant au 34° régiment de ligne, employé au bureau arabe<br />
de Constantine, en qualité de lieutenant stagiaire, demandait sa décharge des<br />
taxes municipales en se fondant sur ce que sa fonction au bureau arabe avait un<br />
caractère absolument temporaire, et qu'il pouvait être à tout instant appelé à ren<br />
trer dans son régiment. Le conseil de préfecture rejeta cette demande par arrêté<br />
en date du 30 décembre 1876, et sur son pourvoi, le conseil d'état a confirmé<br />
cette décision par l'arrêté suivant :<br />
Vu les observations du minisire de l'intérieur, tendant au rejet;<br />
— Vu<br />
l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 21 novembre 1848, le décret du 5<br />
juillet 1854 et celui du 25 décembre 1875 ;<br />
— En ce qui concerne la taxe des loyers; Considérant qu'aux termes de<br />
l'art. 16 de l'arrêté ci-dessus visé du 4 novembre 1848, les officiers sans trou<br />
pes sont imposables à la taxe des loyers, d'après le même mode et dans les<br />
mêmes proportions que les autres contribuables, el qu'aux termes de l'art. 24<br />
du décret ci-dessus visé du 25 décembre 1875, sonl classés parmi les officiers<br />
sans troupes, les officiers employés dans les affaires indigènes de l'Algérie ;<br />
— Considérant qu'au 1« janvier 1876, le sieur Caries était employé au bu<br />
reau arabe de Constantine, en qualité de lieutenant stagiaire, que, dès lors,<br />
il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le conseil de préfecture de<br />
Constantine a rejeté sa demande en décharge de la taxe des loyers à laquelle<br />
il a été imposé pour l'année 1876, sur le rôle de la ville de Constantine.<br />
— En ce qui concerne la taxe des prestations ; Considérant qu'aux termes<br />
de l'art. 4 du décret ci-dessus visé du 5 juillet 1854, lout habitant de l'Algé-
243<br />
rie, européen ou indigène, peut être appelé à fournir chaque année une<br />
prestation de trois jours pour sa personne, à moins qu'il ne se trouve dans<br />
un des cas d'exemption prévus par ledit article ;<br />
— Considérant qu'il résulte<br />
de l'instruction qu'au 1er janvier 1876, le sieur Caries habitait la commune<br />
de Constantine, dans laquelle il avait été imposé à la taxe des loyers, qu'il<br />
ne se trouve dans aucun des cas d'exemption prévus par l'art, précité; que<br />
dès lors, c'est avec raison qu'il a été imposé el maintenu au rôle des pres<br />
—<br />
tations de la ville de Constantine pour l'année 1876 ; Rejette, etc.<br />
M. Babdenet, rapp. M. David, comm. du gouv.<br />
Taxe sur les loyers —<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
Réclamation.<br />
8 juin 1877.<br />
—<br />
recevabilité .<br />
Timbre.<br />
— Mon<br />
La loi du 21 avril 1832 dans son art. 28 n'a dispensé du timbre les récla<br />
mations en matière de contributions directes que lorsqu'elles ont pour objet une<br />
cote moindre de 30 francs.<br />
En conséquence, lorsqu'une décharge est demandée pour une cote supérieure<br />
si la requête devant le Conseil d'Etat n'a pas été présentée sur papier timbré,<br />
elle doit être rejetée comme non recevable.<br />
Sartor.<br />
Considérant que l'art. 28 de la loi du 21 avril 1832 n'a dispensé de timbre<br />
que les réclamations en matière de contributions directes que lorsqu'elles<br />
— ont pour objet une cote moindre de 30 francs ; Considérani que la taxe<br />
sur les loyers dont le sieur Sartor demande la décharge, s'élève à 90 francs<br />
pour l'année 1875, que sa requête devant le Conseil d'Ëlat n'a pas élé pré<br />
sentée sur papier timbré ; que dès lors,<br />
Rejette.<br />
ladite requête n'est pas recevable.—<br />
M. Baudenet, rapp. ; M. Laferrière, comm. du gouv.<br />
Fonds de commerce. — Vente.<br />
-^<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1« Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
24 avril 1878.<br />
établissement similaire.<br />
— Interdiction de fonder un<br />
— Faillite. — Syndics.<br />
La vente d'un fonds de commerce avec la clientèle et l'achalandage a pour
244<br />
conséquence virtuelle, même en l'absence d'aucune stipulation formelle insérée<br />
dans l'acte à cet éqard, l'interdiction pour le vendeur d'élever dans la même<br />
localité et dans un rayon rapproché, un établissement de commerce similaire.<br />
— En<br />
effet, les contrats contiennent à là fois des stipulations expresses et des<br />
stipulations implicites, celles-ci résultant évidemment de la commune intention<br />
des parties, et les dernières ne sont pas moins obligatoires que les autres. On<br />
doit attribuer ce caractère à l'interdiction spécifiée ci-dessus, et dont la viola<br />
tion constitue un trouble pour lequel il est dû garantie, en vertu des règles<br />
ordinaires de la vente (I).<br />
Lorsque la vente d'un fonds de commerce a été opérée par les syndics d'une<br />
faillite, au surplus avec l'adhésion du failli, celui-ci ne saurait être fondé à<br />
prétendre que cette vente n'étant point son fait, il ne peut être contraint per<br />
sonnellement à se soumettre aux obligations du vendeur, notamment quant à<br />
l'interdiction d'ouvrir, au mépris des droits de l'acheteur, un établissement de<br />
commerce similaire .<br />
En effet, les syndics étaient ses représentants [légaux, et, conséquemment, ils<br />
l'ont valablement engagé.<br />
Il doit en être tout particulièrement ainsi quand les fonds provenant de la<br />
vente du fonds de commerce lui ont procuré un concordat et lui ont, par suite,<br />
restitué la liberté de se livrer de nouveau à l'exploitation d'un commerce .<br />
Legey c. Benêt.<br />
Attendu, en fait, que Marius Benel qui exploitait depuis de longues années<br />
l'hôtel d'Orient, à Bône, fut déclaré en état de faillite par jugement du<br />
— 28 mars 1877 ; Que les syndics dûment autorisés à cet effet par les jugescommissaires,<br />
avec l'adhésion du failli qui avait apposé sa signature au bas<br />
de la requête,<br />
vendirent le fonds de commerce aux frères Legey, suivant acte<br />
sous seing-privé, enregistré, du 13 juillet 1877, pour le prix de quarante<br />
mille francs;<br />
— Que<br />
celle vente comprenait expressément le matériel de<br />
l'hôtel, les marchandises, l'achalandage, la clientèle el la cession du droit au<br />
— bail ; Que cette cession du fonds de commerce permettait à Marius Benêt<br />
d'oblejiir de ses créanciers un concordat par abandon d'actif, le prix de la<br />
— vente précitée composant le principal élément de cet actif; Que quelques<br />
jours après l'obtention de ce concordat, Benêt prenait ses dispositions et<br />
ouvrait à Bône même, dans un rayon de cent mètres à peine de l'hôtel<br />
d'Orient, un établissement rival,<br />
sa concurrence, il faisait, par une large publicité,<br />
et que pour caractériser encore davantage<br />
appel à son ancienne et<br />
(1) Cette question, longtemps indécise dans la jurisprudence, semble aujour<br />
d'hui tranchée dans le sens de l'espèce rapportée ,<br />
Juritsp. conf.: Alger, 5janv. 1865<br />
(Robe, 1865, p, 208), Alger, 14 juin 1866 (Robe, 1866, p. 162). Amiens, 30 av. 1875<br />
(/. dû Pal,, 1875, p. 931). Riom, 20 mars 1876 (J. du Pal.,. 1875, p. 931, —<br />
Contra : Cass., 6 fév. 1855 (J. du Pal,, 1856, 2, p -438). Cass., 2 mai 1860 (/. du<br />
Pal., 1860, p, 1016). Angers, 7 mai 1869 (J. du Pal., 1870, p. 89).— Cass.,<br />
21 juillet 1873 (J. du Pal. , 1874, p. 503) et la note.
245<br />
— nombreuse clientèle ; Que c'est dans ces conditions que les frères Legey<br />
ont inlenlé leur action devant le tribunal de Bône ;<br />
— Qu'ils soutiennent<br />
que, dans les circonstances de la cause, il y avait interdiction pour le sieur<br />
— Benêt d'exercer à Bône une industrie similaire; Que dans l'intérêt de<br />
l'intimé,<br />
on prétend que celui-ci n'a fait qu'user d'une faculté qu'il<br />
n'avait jamais aliénée et que sou droit s'abrite sous le principe général de la<br />
— liberté de commerce ; Atlendu qu'il est un principe non moins certain :<br />
— celui du respect des conventions ; Qu'il n'est point douteux que le ven<br />
deur d'un fonds de commerce ne puisse, par une clause expresse qui n'a rien<br />
deconliaire à l'ordre public, s'interdire d'une façon plus ou moins absolue<br />
— la faculté de créer un établissement rival ; Qu'à la vérité, cette stipulation<br />
—<br />
ne se trouve pas écrite dans l'acte de vente du 13 juillet 1877 ; Mais que,<br />
dans tous les contrats se rencontrent des stipulations expresses et des stipu<br />
— lations implicites ; Que les unes ne sont pas moins obligatoires que les<br />
autres à la condition qu'elles soient certaines et aient été dans la commune<br />
intention des parties ;<br />
— Atlendu<br />
que des divers documents de la cause, des<br />
circonslances qui ont précédé, accompagné et suivi l'acte du 13 juillet 1877,<br />
de la cession formelle de la clientèle et de l'achalandage, il résulte pour la<br />
Cour la preuve que le contrat de vente intervenu entre les parties, contenait<br />
implicitement la prohibition, pour l'ancien propriétaire de l'hôtel d'Orient,<br />
d'élever à Bône, dans un rayon aussi rapproché, un hôtel rival —<br />
; Que telle<br />
a été la commune intention des parties, et que, dès lors, rétablissement de<br />
l'hôtel Marius constituait un trouble pour lequel il était dû des garanties,<br />
en vertu des règles ordinaires de la vente ;<br />
Attendu que Marius Benêt cherche à éluder les conséquences naturelles<br />
qui découlent de la convention du 13 juillet 1877, en prétendant qu'il y est<br />
demeuré —Altendu étranger; queles syndics qui ont comparu à l'acte de<br />
venle étaient les représentants légaux du failli, et que procédant dans les<br />
formes indiquées par le Code de commerce, ils ont valablement engagé<br />
le failli est d'autanl moins fondé à se dégager des obliga<br />
—<br />
celui-ci ; Que<br />
tions de vendeur, que le prix de la vente versé à ses créanciers, lui a procuré<br />
le concordat, et, par suite, cette liberté dont il voudrait aujourd'hui abuser<br />
que le trouble apporté au droit de l'ache-<br />
—<br />
contre ses acquéreurs ; Altendu<br />
leur étanl le fait personnel du failli, ne saurait obliger que lui el que -la mise<br />
eh cause du syndic, élait sans objet ;'— Que néanmoins, les frais occasionnés<br />
par sa présence dans l'instance, seront mis à la charge de Benêt, à titre de<br />
dommages-inlérêts ;<br />
— Attendu<br />
que la Cour possède des éléments suffisants<br />
pour arbitrer les dommages dûs pour l'exploilation abusive dans le passé, et<br />
qu'elle les fixe à la somme de deux mille francs ;<br />
Par ces moiifs, LA COUR: Reçoit l'appel et y statuant infirmant;<br />
— Met<br />
hors de cause et de procès le syndic Carboué ;— Déclare, quant à lui,<br />
l'action des frères Legey non recevable —<br />
; La déclare, au coniraire, receva<br />
ble et bien fondée'<br />
contre Marius Benêt ;<br />
— Dit que celui-ci élait sans droit<br />
pour faire concurrence à l'hôtel d'Orient, d'élever l'hôtel Marius ;<br />
— Le con<br />
damne à payer aux frères Legey la somme de deux mille francs à titre de<br />
dommages-intérêts pour le passé;<br />
— Ordonne que dans les vingt-quatre<br />
heures de la signification de l'arrêt, Benêt sera tenu de fermer l'hôtel<br />
exploité par lui à Bône, sous peine de cent francs de dommages-intérêls par
chaque jour de retard ;<br />
mois, il sera fait droit.<br />
- Dit<br />
246<br />
qu'en cas d'inexécution et après le délai d'un<br />
M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; MM« Chéronnet, F. Huré el Garou, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, l1* président<br />
22 mai 1878.<br />
Corme, — Acte rédigé en français et en arabe.<br />
nement. — Acte rédigé en un seul original .<br />
6on j»owr.<br />
— Caution<br />
— Formalité du<br />
Un acte rédigé à la fois en langue française et en langue arabe présente<br />
d'après sa forme extérieure, les garanties spéciales exigées par l'arrêté du<br />
9 juin 1831, et ces apparences ne sauraient tomber devant la simple allégation<br />
que les formalités exigées par l'ordonnance n'auraient pas été régulièrement<br />
accomplies (1) .<br />
La formalité du double écrit n'est exigée par la loi que pour les actes sous<br />
seings-privés contenant des conventions synallagmatiques : conséquemment,<br />
cette formalité ne saurait être exigée en ce qui concerne le cautionnement, qui,<br />
de sa nature, constitue essentiellement un contrat unilatéral (2).<br />
Il peut se rencontrer, à la vérité, dans un cautionnement, des stipulations<br />
qui ont un véritable caractère synallagmatique, et dans ce cas,<br />
l'art. 1325 du Code civil pourra êlre exigée pour la validité de l'acte;<br />
la formalité de<br />
mais on<br />
ne saurait considérer comme des engagements semblables stipulés du créancier,<br />
de simples conditions mises par la caution, dans son propre intérêt,<br />
au cau<br />
tionnement par elle souscrit, telles que, par exemple, une condition de délai ;<br />
dans ce cas, la caution esl suffisamment protégée par l'existence d'un seul ori<br />
ginal, dont la production nécessaire pour l'exercice de l'action du créancier,<br />
fait apparaître en même temps et le cautionnement et les restrictions dont il a<br />
été l'objet.<br />
Les dispositions de l'art. 1326, sur la nécessité du bon pour, sont générales<br />
et absolues, el s'appliquent au contrat de cautionnement, qu'il porte ou non sur<br />
(1) Voir dans le Rép. de Narbonne, V" acte sous seing-privé, les différentes appli<br />
cations que la jurisprudence a faites de l'arrêté du Gouverneur de l'Algérie, du<br />
9 juin 1831 , qui ordonne la rédaction des actes sous seing-privé dans la langue de<br />
chacun des contractants.<br />
(2) Jurisp. conf. : Cass, 3 avril 1850 (J. du Pal., 1850, t. p. 671) ; Cass.<br />
5 avril 1870 (J. du Pal., 1870, p. 641), J. du Pal, Rép. V° Double Écrit, n°* 35 et 53,<br />
et Cautionnement, n° 158.
247<br />
une somme déterminée ; en conséquence, faute d'avoir été revêtu de cette for<br />
malité substantielle, l'acte de cautionnement doit être annulé,<br />
si son auteur ne<br />
rentre pas par sa profession dans une des catégories formellement exceptées de<br />
cette règle générale par la loi (1).<br />
Consorts ren Zagoutha c , consorts de Buros<br />
Attendu que les consorts ben Zagoutha demandent la nullité de l'acte du<br />
27 avril 1876, qui sert de fondement aux poursuites dirigées contre eux par<br />
les consorts de Buros ;<br />
Attendu que, pour l'appréciation même des moyens de nullité invoqués<br />
par les appelants, il convient de constater, en fait, que, dans l'acte précité,<br />
les fils Ben Zagoutha déclaraient cautionner la dette de leur père vis-à-vis des<br />
consorts de Buros, et qu'en qualité de cautions pour le cas où le débiteur<br />
principal ne paierait pas, ils stipulaient pour eux-mêmes un délai, en frac<br />
— tionnant le cautionnement en deux termes ; Que cet acte, écrit en langue<br />
française et en langue arabe, était fait en un seul original signé des cautions,<br />
mais non revêtu du bon pour ou d'une approbation de la somme cautionnée ;<br />
Attendu que les appelants opposent, en premier lieu, que le contrat du<br />
27 avril 1876est intervenu sans que les formalités prescrites par l'ordonnance<br />
du 9 juin 1831 aient élé exactemenl remplies;<br />
— Mais attendu que l'acte<br />
précité contient le texte du cautionnement en langue française et en langue<br />
arabe ;<br />
—<br />
Qu'ainsi, d'après sa forme extérieure, il présente les garanties spé<br />
ciales exigées par l'ordonnance, et que ces apparences ne sauraient tomber<br />
devant de simples allégations ;<br />
Attendu que les appelants excipent, en deuxième lieu, de ce que l'acte du<br />
27 avril 1876 a été fait en un seul original, contrairement aux prescriptions<br />
— de l'article 1325 du Code civil ; Atlendu que la formalité des doubles a<br />
été exigée seulement pour les actes sous seings-privés contenant des conven<br />
tions synallagmatiques, soit que le législateur ait voulu attacher à cette forme<br />
le signe d'un contrat définitif, soit qu'il ait voulu armer chacun des contrac<br />
tants d'un litre lui permettant d'agir,<br />
— Que celte exigence ne saurait s'étendre, à moins de circons<br />
malgré l'inaction ou la renonciation de<br />
l'autre ;<br />
tances exceptionnelles, aux contrais unilatéraux et notamment au caution<br />
nement qui, de sa nature, est essentiellement un contrat unilatéral ; —Qu'à<br />
la vérile, il peut se rencontrer, même dans un contrat! unilatéral une con<br />
vention synallagma tique et qu'alors l'art. 1325 devient applicable ;<br />
— Qu'il<br />
en est ainsi en matière de cautionnement, lorsque, par exemple, la caution<br />
stipule du créancier qu'il renoncera aux poursuites intentées contre le débi<br />
teur principal ou qu'il accordera à ce dernier un lerme pour une dette<br />
exigible ;<br />
— Mais qu'il ne faut pas confondre avec ces engagements stipulés<br />
du créancier, de simples conditions mises par la caution dans son propre<br />
— intérêt au cautionnement souscrit par elle ; Que ces restrictions, qui n'al<br />
tèrent en rien la nature et l'essence du cautionnement, laissent à l'acte son<br />
(s) Jurisp. conf. : Douai, 28 novembre 1860 (J. du l'ai., 1861, p, 16. —<br />
Orléans,<br />
24 déc. 1864 (J. du Pal., 1865, p. 919). —Poitiers, 17 juin 1867 (J. du Pal., 1868,<br />
p. 90, Rép. duJ. du Pal., table complémentaire. V Caution. n»e 27 et suiv.
248<br />
caractère unilatéral et ne sauraient, par suite, l'assujétir à la formalité de<br />
—<br />
l'art. 1325 ; Qu'alors, la caution est suffisamment protégée par l'existence<br />
d'un seul original, dont la production nécessaire pour l'exercice de l'action<br />
du créancier fera apparaître en même temps que le cautionnement les condi<br />
—<br />
tions qui y ont élé apportées; Altendu, dans l'espèce, que l'acte du<br />
27 avril 1876 ne contenait aucun engagement stipulé par.les cautions, imposé<br />
au créancier, mais seulement une condition de délai indiquée dans l'intérêt<br />
exclusif des cautions, sans que la position respective du créancier et du débi<br />
teur principal fut en rien modifiée; —Que, dès lors, il n'y<br />
a pas lieu.de<br />
s'arrêter au second grief élevé par les appelants ;<br />
Mais attendu que les consorts BenZagoulha font remarquer, en dernier lieu,<br />
que l'acte du cautionnement, signé par eux, ne contenait ni bon pour ni<br />
— approbation ; Altendu que les dispositions de l'art. 1326 du Code civil sont<br />
générales et absolues ;<br />
— Qu'elles s'appliquent au contrat de cautionnement,<br />
même indéterminé, mais, à plus forte raison, à un cautionnement qui,<br />
comme dans l'espèce, était d'une somme déterminée ;<br />
— Que, par suite,<br />
l'acte du 27 avril 1876 est nul pour n'avoir pas été revêtu d'une formalité<br />
substantielle ;<br />
- Que<br />
vainement on cherche à placer les consorts Ben Za<br />
goutha dans la catégorie des personnes dispensées de la formalité de l'ar<br />
ticle 1326 du Code civil ;<br />
— Qu'en<br />
elfet les consorts Ben Zagoutha ne sau<br />
raient être considérés comme des marchands, artisans, laboureurs, vignerons,<br />
gens de journée et de service ;<br />
Par ces motifs, LA COUR : Reçoit l'appel et y faisant droil ; Infirme le<br />
jugement déféré ;<br />
— Déclare<br />
nul et de nul effet l'acte du 27 avril 1876, en<br />
violation des dispositions de Fart. 1326 du Code civil ;<br />
— Déboute,<br />
en con<br />
séquence, les consorts de Buros de leurs demandes, fins et conclusions ;<br />
Les condamne à l'amende et en tous les dépens de première inslance et<br />
d'appel .<br />
M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; MM^ F. Huré et Chéronnet, av.<br />
I. Degrés de juridiction, —<br />
alternative .<br />
COUR D'APPEL D'ALGER &' Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
19 janvier 1878.<br />
— Demande indéterminée .<br />
à tort en dernier ressort. — Exécution .<br />
non recevoir.<br />
—<br />
Héritier ressort, — Demande<br />
— Jugement<br />
— Appel,<br />
qualifié<br />
—<br />
— II. "Vente d'une chose mobilière. —<br />
—<br />
propriété , "Vendeur .<br />
— Faute .<br />
Fin<br />
de<br />
Droit de<br />
/. Lorsque dans leur dernier état, les conclusions d'une demande présen<br />
tent une alternative dont l'une des branches est indéterminée, le jugement
249<br />
rendu sur ces conclusions est susceptible d'appel, et c'est mal à propos qu'il est<br />
qualifié dejugement en dernier ressort (1 ) .<br />
Lorsqu'un jugement a été mal à propos qualifié de jugement en dernier<br />
ressort, et que, sommée d'assister à l'exécution de ce jugement,<br />
la partie suc<br />
combante a obtempéré à cette sommation, mais sans aucune adhésion de sa<br />
part, on ne saurait se prévaloir de ce fait pour faire déclarer non recevable<br />
l'appel interjeté par cette partie .<br />
II. En cas de venle d'une chose mobilière par une personne autre que le<br />
propriétaire , sans que le droit personnel de celui-ci soit révélé, l'acheteur ne<br />
saurait payer son prix au mépris d'oppositions pratiquées enlre ses mains<br />
contre le vendeur apparent ; en offrant de payer le prix aux mains de qui il<br />
appartient, en consignant ensuite ce prix, il se dégage absolument de toute<br />
responsabilité : le propriétaire ne peut s'en prendre qu'à lui-même des incon<br />
vénients d'une situation qui est le résultat, non de la faute mais d'autrui, de<br />
sa propre imprudence .<br />
Castillon c. Lenoir.<br />
— Sur les fins de non-recevoir contre l'appel ; Considérant que, dans<br />
leur dernier état, les conclusions de la demande de Castillon offrant une<br />
— demande alternative, dont l'une des branches est indéterminée; Que le<br />
— jugement a donc été mal à propos qualifié en dernier ressort ; Que, si<br />
Castillon, sommé, a assisté à l'exécution qu'il ne pouvait empêcher, d'un<br />
jugement ainsi qualifié, il n'a pas adhéré à cette exécution, et qu'il avait<br />
auparavant interjeté un appel dont il ne s'est pas désisté ;<br />
— Au fond ; Considérant que Castillon ne justifie pas qu'il soit proprié<br />
taire du blé qu'il revendique, et qu'il n'a pas fait la preuve mise à sa charge<br />
— par les premiers juges pour l'établir ; Que si Lenoir a, dans des conclu<br />
sions de première instance, admis hypothétiquemenl que Castillon serait<br />
effectivement propriétaire de ce blé, c'est en ajoutant qu'il l'avait fait vendre<br />
— par Menjon sans révêler sa propriété personnelle ; Que si elle est l'expres<br />
sion de la vérité, Menjon, au moment de la vente, ne se présentait pas<br />
moins à Lenoir comme propriétaire et vendeur du blé, etque,<br />
dès lors,<br />
Lenoir ne pouvait payer son prix au mépris des oppositions faites entre ses<br />
mains contre Menjon ;<br />
— Que Castillon aurait eu seulement un recours à<br />
exercer contre Menjon, à qui il aurait remis le filé ;<br />
- Que Lenoir ayant<br />
toujours offert son prix à qui il appartiendrait, et l'ayant, en définitive,<br />
—<br />
consigné, n'a aucun reproche à se faire ; Qu'il déclare ne pas s'opposer à<br />
— ce que Castillon louche le prix consigné ; Que si Castillon, après celte<br />
déclaration,<br />
éprouvait encore quelques difficultés à toucher le prix consigné,<br />
ce ne serait pas par le fait de Lenoir, simple liers saisi, mais par celui de<br />
Menjon, de créanciers de celui-ci, et surtout par sa propre imprudence —<br />
;<br />
Considérant que Castillon a laissé écouler le délai de l'enquête ordonnée, et<br />
qu'en l'état des faits, il n'y a plus lieu à mesure d'instruction ;<br />
(1) Jurisp. conf.: Cass. 14 juill. 1857 (J. du Pal. 1858,<br />
26 mars 1867 (J. du Pal, 1867, p. 507),<br />
p. 1229,} ;,Cass.
250<br />
Confirme le ju<br />
Par ces motifs: Déclare l'appel non recevable et mal fondé;<br />
— gement ; Donne acte à Castillon que Lenoir ne s'oppose pas, en ce qui le<br />
concerne personnellement, mais sous les réserves des droils des opposants,<br />
en ce que Castillon touche le prix consigné par Lenoir ;<br />
tillon envers toutes les parties aux dépens d'appel.<br />
M. du ÎHowon , subst .<br />
— Condamne<br />
Cas<br />
du Proc. gén. ; MMes Chéronnet et Bouriaud, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
I. Banqueroute simple. — Tenue<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
17 février 1877.<br />
— Irrégularités de comptabilité. — II.<br />
d'effets. —<br />
Opérations<br />
isolées. —<br />
Fonds remis en compte courants.<br />
des livres en partie double ,<br />
III.<br />
Circulation fictive<br />
Abus de confiance. —<br />
/. Lorsque le livre-journal d'un commerçant est régulièrement tenu, on ne<br />
saurait s'arrêter, au point de vue d'une poursuite en banqueroute simple diri<br />
gée contre ce commerçant en état de faillite, à cette circonstance que les totaux<br />
et les balances du grand-livre et des comptes courants, n'auraient pas été faits<br />
régulièrement au moment de la faillite, le commerçant avait en effet le droit<br />
légal de tenir ses livres en partie simple, et il ne saurait être exposé à une res<br />
ponsabilité pénale plus étroite pour avoir employé la tenue en partie double.<br />
II. Le délit de circulation fictive et ruineuse d'effets ne saurait résulter de<br />
deux opérations isolées : il ne peut être constitué que par des faits complexes<br />
et multipliés concourant à créer une situation d'ensemble.<br />
III. Le fait par un banquier de s'approprier des valeurs à lui remises en<br />
comptes courant, ne constitue pas le délit d'abus de confiance : en effet, ce<br />
compte a pour effet immédiat de transférer au banquier la propriété des va<br />
leurs qui lui ont été endossées, en le rendant débiteur d'une valeur autre, mais<br />
d'un chiffre égal à celui de la valeur reçue.<br />
Si des valeurs peuvent être exclues du compte courant pour être remises au<br />
banquier avec une affectation spéciale, à titre par exemple de mandat ou de<br />
nantissement, cette exclusion qui aurait pour effet de modifier le caractère<br />
légal de la remise et conséquemment de l'appropriation,<br />
ne peut être établie<br />
que par une convention indiscutable et il ne saurait suffire pour en faire ad<br />
mettre l'existence de l'affirmation intéressée de créanciers de la faillite, cher<br />
chant à se créer un privilège vis-à-vis de la masse .
251<br />
Battandier c. le Min. pub ,<br />
Sur l'état général de la comptabilité : — Considérant<br />
qu'il ne faut pas s'ar<br />
rêter à la circonstance que les totaux et les balances du grand-livre el des<br />
comptes courants, n'ont pas été faits avant la faillite ; Que si cet état de cho<br />
ses empêchait de se rendre un compte immédiat de la situation du failli, on<br />
pouvait cependant y arriver en relevant les opérations inscrites au livre-<br />
— journal ; Qu'il est reconnu que ce livre était régulièrement tenu ; et qu'il<br />
suffit, pour la comptabilité courante, aux exigences de la loi, que la tenue<br />
des livres en partie double, telle que la pratiquait Battandier, ne peut pas<br />
l'exposer à une responsabilité pénale plus étroite, que s'il avait suivi la tenue<br />
— des livres en partie simple, comme il en avait le droit ; Que l'état matériel<br />
de la comptabilité ne doit donc pas être retenu contre Battandier ;<br />
considérant que Battandier a inscrit à son actif des créances qui, depuis long<br />
— Mais<br />
temps, n'avaient plus de valeur ; Que s'il a passé au compte profits et pertes,<br />
certaines créances de peu d'importance, il n'a pas procédé de même pour des<br />
—<br />
créances élevées, dont le maintien présentait un actif imaginaire ; Que<br />
c'est ainsi qu'il a maintenu intégralement, lui faisant même porter des inté<br />
rêts, la créance Mouran, devenue litigieuse dès 1873 ;<br />
— Qu'il<br />
a procédé de<br />
même pour son solde créditeur, sur la femme Veilley, tandis que cette<br />
créance, augmentant d'année en année, ne pouvait laisser au prévenu au<br />
cune illusion sur la solvabilité de la débitrice. Que Battandier a encore con<br />
servé à son actif la créance "Viar après la déconfiture du débiteur ;<br />
dérant qu'il suffit de rapprocher la situation de la faillite des énonciations<br />
— Consi<br />
des livres de Battandier pour constater que l'actif indiqué aux livres n'exis<br />
— tait pas ; Que les inventaires de Battandier ont toujours affirmé un actif<br />
—<br />
net de plus de 200,000 francs; Qu'aujourd'hui l'excédant du passif sur<br />
l'actif dépasse 1,500,000 francs, d'où un écart de 1,700,000 francs avec le<br />
— dernier inventaire; Considérant que si on retranche de ce chiffre le mon<br />
tant des traites Siguaret 428,000 francs, la perle à prévoir sur les immeubles<br />
et les autres 'pertes indiquées par le prévenu, comme survenues au moment<br />
de la faillite ou peu auparavant, on atteint à pjinc 1,100,000 fr. ;<br />
reste donc en chiffre rond un déficit de 600,000 francs, qui ne peut s'expli<br />
quer que par un passif ancien, non accusé aux livres —<br />
; Considérant que<br />
la manière d'agir du prévenu a été d'autant plus regrettable qu'elle a pu lui<br />
— Qu'il<br />
dissimuler que depuis plusieurs années il était au-dessous de ses affaires ;<br />
el qu'il a ainsi continué des opérations dont le résultat s'est aggravé de jour<br />
en jour. Adoptant en outre les motifs des premiers juges ;<br />
Sur la circulation d'effets : — Considérant<br />
que Battandier a fait créer à son<br />
profit, du papier fictif sur François Battandier et Laugier ; Qu'il l'a endossé<br />
en 1875 et a encaissé le produit delà négociation ; Mais considérant que cette<br />
négociation a élé opérée par Ballandier lui-même comme banquier, et que<br />
—<br />
rien n'indique qu'elle lui ait occasionné des frais onéreux ;<br />
Considérant du<br />
reste que ces deux opérations fictives sont demeurées isolées, et qu'elle ne<br />
sauraient suffire à constituer une circulation, qui ne peut résulter que de faits<br />
complexes et mullipliés, concourant à créer une situation d'ensemble;<br />
Sur l'abus de confiance Bonifay. Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />
— Sur les abus de confiance Forret, Martin et Arnaud ; Considérant que
252<br />
ces trois personnes étaient en compte courant avec Battandier ; Que ce compte<br />
avait pour effet immédiat de transférer à Battandier la propriété des valeurs<br />
qui lui étaient transférées par endossement en rendant débiteur d'une valeur<br />
autre, mais d'un chiffre égal à celui de la valeur reçue —<br />
; Considérant qu'il<br />
résulte de la complabilité que les effets envoyés à Battandier par ces trois<br />
correspondants, même pour encaissement, entraient dans le compte courant<br />
général et en formaient même un des principaux éléments, que dans le mou<br />
vement des affaires, on a toujours réclamée Battandier, non des valeurs con<br />
sidérées comme corps certains, mais des couvertures, considérées comme<br />
une délie ordinaire el résultant du découvert d'un compte courant, que ce<br />
découvert était lui-même causé par l'envoi el la cession des valeurs transfé<br />
— rées à Battandier précédemment ; Considérant que si les valeurs peuvent<br />
être exclues du compte courant par une stipulation formelle, cette exclusion<br />
n'a pas un lien dans la cause ; Que pour prouver que cette convention excep<br />
tionnelle esl intervenue oralement on ne saurait admettre l'allégation inté<br />
ressée des créanciers de la faillite cherchant à se créer un privilège vis-à-vis<br />
de la masse ;-- Que Jarret reconnaît qu'il a été en compte courant avec<br />
Battandier jusqu'au 30 avril 1875;<br />
parties et de leurs opérations que le compte courant a continué avec Jarret<br />
qu'il résulte de la correspondance des<br />
au-delà de cette dale et jusqu'à la cessation de paiement arrivée quinze jours<br />
après;<br />
— Considérant<br />
que si Martin et Arnaud ont assigné une affectation<br />
spéciale aux valeurs dont Battandier a conservé le produit, du moins en par<br />
tie au moment de la faillite, il faut remarquer qu'ils n'avaient jamais opéré<br />
autrement précédemment et dans le mouvement du compte courant. Que<br />
l'assignation d'emploi s'appliquait moins dans l'intention des parties à la va<br />
— leur envoyée qu'à la couverture qui devait résulter de l'envoi ; Qu'il n'y a<br />
pas eu convention exceptionnelle du compte courant et abus de confiance,<br />
mais continuation d'opérations antérieures; Qu'il y a lieu de remarquer qu'à<br />
plusieurs reprises et même en 1875, Arnaud dans son compte avec Battan<br />
— dier était débiteur; Que s'il esl arrivé à Arnaud et à Martin de réclamer<br />
des couvertures immédiates quand ils étaient créanciers, leur qualité de<br />
créanciers suffisait pour expliquer cette réclamation, sans que leur créance<br />
résultât d'un mandat qu'Arnaud, apprenant que Battandier avait disposé d'une<br />
partie des valeurs qui font l'objet de la prévention, n'éleva alors aucune<br />
— réclamation conlre ce mode de procéder ; Considérant que si Battandier<br />
a eu le tort grave de recevoir des valeurs à lui envoyées par ses correspondants,<br />
quand il se savait exposé à une cessation de paiements immédiate, le délit<br />
d'abus de confiance ne saurait cependant exister en comple courant ; Qu'il<br />
suffirait même pour écarter le délit que Battandier ce fut cru, même par<br />
erreur, au comple courant, puisque croyance de sa part serait incom<br />
patible avec l'intention frauduleuse nécessaire pour constituer l'abus de<br />
confiance ;<br />
Par ces motifs : Réformant partiellement le jugement dont est appel<br />
émandant, déclare Baltandier non coupable de banqueroute simple ;<br />
— pour<br />
le retard dans le dépôt de bilan;<br />
— pour irrégularité dans la tenue des<br />
— —<br />
pour circulation ruineuse d'effets ; pour dépenses excessives.<br />
livres;<br />
Déclare Batlandier coupable de banqueroute simple;<br />
inventaire;<br />
— pour<br />
— pour n'avoir pas fail<br />
avoir tenu des livres qui ne présentaient pas sa véri-
2.53<br />
table situation. Déclare Battandier non coupable d'abus de confiance au pré<br />
judice de Bonifay, Jorret, Martin et Arnaud.<br />
— Sur l'application de la peine ; Considérant que la Cour a écarté les<br />
délits d'abus de confiance et deux des éléments de banqueroute simple, ad<br />
— mis par les premiers juges ; Qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte au<br />
prévenu de l'honorabilité commerciale qu'il a longtemps conservée, du dé<br />
vouement dont il a fait preuve dans l'exercice des fonctions publiques et de<br />
la détention préventive qui a élé nécessaire. — Réduit<br />
mois d'emprisonnement.<br />
la peine à quatre<br />
M. le prés. Bastien, rapp; M. Valette, av. gén. M. Gilotte, du barreau<br />
Droit musulman. — Habous.<br />
de Constantine, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
19 février 1878.<br />
— Annulation. — Créanciers du<br />
dévolutaire. — Droit d'hérédité en matière musulmane.<br />
Si d'après les principes de droit musulman, les biens déclarés habous sont<br />
déclarés inaliénables et imprescriptibles,<br />
cette immobilisation ne peut avoir<br />
lieu en fraude des droits de créanciers ; en conséquence, les créanciers du cons<br />
tituant ont le droit évident de faire annuler le habous en vue de poursuivre<br />
le paiement de leur créance sur les biens immobiliers .<br />
Mais ce droit cesse, du moment que les biens habous ont passé aux mains<br />
d'un dévolutaire; en effet, d'une part , les créanciers du constituant ne sau<br />
raient exercer un droit de suite sur des biens acquis à des tiers ; d'autre part,<br />
l'héritier, en droit musulman, n'est pas tenu des dettes du défunt au delà des<br />
forces de la et succession, au surplus, le dévolutaire d'un bien constitué ha<br />
bous, tient ses droits non de sa qualité d'héritier du défunt,<br />
propre qui ressort de l'acte de constitution lui-même .<br />
mais d'un droit<br />
Il résulte, il est vrai, des dispositions législatives actuellement en vigueur,<br />
qu'un bien habouspeut être aliéné par un dévolutaire et que conséquemment,<br />
les créanciers de celui-ci ont la faculté de poursuivre l'exercice de leur droit<br />
contre ce dévolutaire, leur débiteur personnel, mais par les principes énoncés<br />
plus haut, cette règle cesse de recevoir application lorsque, par suite de l'accom<br />
plissement des règles fixées par l'acte de habous, les biens ont passé aux mains<br />
d'un dévolutaire subséquent .<br />
Zohra bent Youssef c. Youssef et autres.<br />
Attendu que si d'après les principes du droit musulman, les biens consti^
254<br />
tués habous sont déclarés inaliénables et imprescriptibles, il était naturel<br />
d'un autre côlé, que cette immobilisation ne put avoir lieu en fraude des<br />
droits des créanciers que ; par suite, rien n'empêchait les créanciers person<br />
nels du constituant de faire annuler le habous pour se faire payer sur les<br />
biens immobilisés; qu'il aurait été inique en effet qu'un débiteur de mau<br />
vaise foi put écarter ses créanciers en frappant ses biens du caractère d'ina-<br />
liénabilité ;<br />
— Attendu<br />
toutefois que le droit des créanciers cesse du moment<br />
où les biens habous ont passé entre les mains d'un dévolutaire;<br />
d'une part, que les créanciers du constituant ne peuvent exercer un droit<br />
de suite sur des biens acquis à des tiers ;<br />
— Atlendu,<br />
— Altendu<br />
d'autre part, qu'en<br />
droit musulman, un héritier n'est pas tenu des dettes du défunt au delà des<br />
forces de la succession et que, les créanciers n'ont d'autre gage de leur<br />
créance que les biens mêmes de leur débiteur ;<br />
— Attendu enfin que le<br />
dévolutaire d'un bien constitué habous, tient ses droits non pas de sa qualité<br />
d'héritier du défunt, mais d'un droit propre qui lui est dévolu en vertu<br />
que les biens habous une<br />
du titre même de la constitution ; —Qu'il suit de là,<br />
fois sortis de la main du constituant échappent à l'aciion de ses créanciers ;<br />
Atlendu, il est vrai, que d'après la législation actuelle, un bien habous<br />
peut être aliéné par le dévolu taire et que par suite, la jurisprudence a décidé<br />
que ces biens servaient de gage même aux créanciers du dévolutaire, mais<br />
que ce principe ne doit être appliqué qu'aulant que les créanciers font valoir<br />
leurs droits contre le dévolutaire leur débiteur personnel, et que leur action<br />
cesse du moment que les biens ont passé entre les mains d'un dévolutaire<br />
subséquent ;<br />
Et attendu que le jardin sur lequel l'appelante entend faire valoir ses droits<br />
a été conslitué habous par Yamina, mère d'El Hadj Ismaïl Khodja ;<br />
sa créance est une detle personnelle à El Hadj Ismaïl ; que ce dernier étant<br />
— Que<br />
décédé, le jardin a été transmis à ses enfants, non pas en<br />
tiers de leur père, mais comme un droit propre en verlu du titre même de<br />
leur'<br />
qualité d'héri<br />
constitution ; que dans ces circonstances, l'appelante ne saurait être admise<br />
à exercer ses droits sur le jardin dont il s'agit ;<br />
Attendu au contraire, que rien n'empêche l'appelante de venir exercer ses<br />
droils, le cas échéant sur le petit jardin grevé de rahniaet qui est à l'état de<br />
melk, après prélèvement toutefois de la dette qui repose sur lui ;<br />
Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel. — Dit qu'il sera<br />
exécuté selon sa forme et teneur ; Condamne l'appelante aux dépens.<br />
M. Lauth, cons. rapp., M. Cammartin, av. gén., M. Mallarmé, av.<br />
JUSTICE DE PAIX DE SIDI-BEL-ABBÊS<br />
M. FEYT1T, juge de paix.<br />
18 février 1878.<br />
Élections municipales ( — Algérie, — Étranger,<br />
—<br />
Inscription
255<br />
personnelle sur les rôles des contributions,<br />
commerciale .<br />
Un étranger domicilié en Algérie,<br />
— Association<br />
ne réunit pas les conditions exigées<br />
pour l'éleclorat municipal par l'art. 10 du décret du Ï6 décembre 1866, s'il<br />
n'est pas inscrit nominativement sur le rôle des patentes. Peu importerait au<br />
surplus qu'il fît partie d'une association commerciale dont la raison sociale<br />
figurerait à ce rôle . En pareille matière, l'inscription doit être essentiellement<br />
personnelle (1).<br />
Judas Aboab.<br />
Attendu que c'est à tort qu'Aboab prétend qu'il remplit les conditions<br />
exigées par l'art. 10, paragraphe 3 du décret du 10 décembre 1867 et que<br />
participant aux bénéfices de la société Tubiana Safar et Cie qui paie patente,<br />
il doit être inscrit lui-même aux rôles des patentés ; que la loi du 7 juillet<br />
1874, dont le texte est clair el précis, n'autorise point celui qui réclame son<br />
inscription sur les listes électorales d'une commune, à se prévaloir de l'ins<br />
cription sur les rôles d'une société dont il prétend faire partie, qu'il n'y a<br />
pas lieu d'examiner ici si Aboab est ou non fondé à se dire l'associé innomé<br />
de cette société ; qu'il y a lieu seulement d'examiner s'il est personnellement<br />
el nommément inscrit sur les rôles ; qu'Aboab reconnaît lui-même qu'il<br />
n'est pas inscrit personnellement ; que c'est donc avec raison que la com<br />
mission municipale de Sidi-bel-Abbès a, dans sa délibération du 8 février<br />
dernier, déclaré qu'Aboab n'avait pas satisfait aux prescriptions du para<br />
graphe 3 de l'article 10 du décret du 27 décembre 1866 et prononcé de ce<br />
ohef sa radiation de la liste électorale municipale de Sidi-bel-Abbès ;<br />
Par ces motifs : Déclare Aboab mal fondé dans son exception, la rejette,<br />
et jugeant au fond maintien comme bien rendue la décision dont est appel ;<br />
en conséquence, ordonne que la dite décision sera exécutée selon sa forme<br />
et teneur.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret du 10 août 1878, ont été nommés :<br />
Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou (Algérie), M. Bourdeau (Jean-<br />
Bapliste-Marie-Alpinien), avocat, en remplacement de M. Charlan, nommé<br />
juge de paix.<br />
Suppléant du juge de paix de Teniet-el-Hâad, M. Huck (Adolphe-Charles),<br />
en remplacement de M. Sérié, démissionnaire.<br />
Par décret en date du 10 août 1878, ont été nommés:<br />
Juge suppléant rétribué au Tribunal de 1« instance d'Alger, Bonamy,<br />
juge au siège de Blida, en remplacement de M. Martel, qui est nommé juge.<br />
(1) Jurisp. conf. cassation 26 mars 1877 (Sirey. 1877, 1,223)
256<br />
Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de lre instance<br />
de Tlemcen (Algérie), M. Babinel (Jérémie-Léon- Louis), avocat, atlaché pro<br />
visoire au Tribunal de 1 instance de la Seine, en remplacement de M. Cuniac,<br />
qui est nommé substitut du Procureur de la République à Chaumont.<br />
Juge au Tribunal de 1" instance de Tizi-Ouzou (Algérie), M. Guilhonjuge<br />
de paix de la même ville, en remplacement de M. Lepezel, démissionnaire.<br />
Juge au Tribunal de lre instance de Tlemcen (Algérie), M. Bouchet (Au<br />
guste-Gabriel), avocat, en remplacement de M. de Cabissole, qui a été nommé<br />
juge à Marvejols.<br />
Par décret en date du 10 août 1878, ont été nommés :<br />
Huissier près la justice de paix de Nemours (Algérie), M. Coursager, huis<br />
sier près la justice de paix de Lalla-Marghnia, en remplacement de M. Ga-<br />
labren.<br />
Huissier près la justice de paix de Lalla-Marghnia, M. Donsimoni, en rem<br />
placement de M. Coursager.<br />
Titres au porteur. Vol. —<br />
Lorsqu'un titre au porteur,<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Négociations<br />
successives .<br />
— —<br />
Revendication.<br />
objet de plusieurs négociations dont l'une esl<br />
aniérieure et les autres postérieures à la publication d'une opposition à la<br />
le propriétaire dé<br />
négociation de ce litre, a été soustraite frauduleusement,<br />
possédé a le droil, nonobstant les diverses négociations qui se sont accomr<br />
plies, de le revendiquer entre les mains du liers porteur, en vertu de l'ar<br />
— ticle 2279 du Code civil. Cass. Ch. des req., 3 juin 1878 (Francejudic,<br />
1878,<br />
p. 550).<br />
Envoi en possession. — Ordonnance.<br />
—<br />
Non<br />
recevabilité de l'appel. —<br />
L'ordonnance d'envoi en possession rendu par leprésident du Tribunal, dans<br />
les termes de l'art. 1018 du Code civil, ne constitue pas une décision judi<br />
— ciaire susceptible d'être attaquée par la voie d'appel. Cour de Paris, 4e Ch.,<br />
27 juin 1878 (France judic, 1878, p. 551).<br />
ERRATA<br />
Lire au jugement du 29 octobre 1877 : A consenti au lieu de consenti, page 237,<br />
35me ligne. Toute somme quelconque qui serait arbitrairement réclamée par le sieur Le- ■<br />
roux mais comme un engagement de payer ; après un engagement de payer, page<br />
237, 44m0 ligne. L'espèce au lieu de l'espoir, page 238, lre ligne. Devrait au lieu de<br />
devait, page 238, 10me ligne. Établirait au lieu de établissait, page 238, llme ligne.<br />
Déboute au lieu de débouter, page 239, 10mc ligne.<br />
Alger. — Typ. A. Jourdan.
2e année. — Ier Septembre 1878. —<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE LALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
19 janvier 1878.<br />
-<br />
LÉGISLATION<br />
I. Contrat de louage. — Obligations du propriétaire. — Danger<br />
imminent résultant de l'état de l'immeuble, —<br />
tence,<br />
— Commune propriété.<br />
II,<br />
Compé<br />
/. La première obligation du propriétaire esl de veiller à ce que l'état des<br />
lieux loués ne compromette pas la sûreté du locataire. Il ne remplit pas com<br />
plètement celte obligation quand il se borne à prévenir son locataire et à l'in<br />
viter lui-même à quitter les lieux. Son devoir est d'adresser à son locataire<br />
une sommation régulière et même de l'assigner en justice pour obtenir son dé-<br />
guerpissement et à défaut de ces mesures de précaution, il peut être considéré<br />
comme s'étanl mis en faute, faute qui peut être au surplus atténuée considéra<br />
blement par l'inertie du locataire ;<br />
II. Lorsqu'une commune est actionnée à raison de fautes que le demandeur<br />
prétendait faire découler contre elle d'un droit de co-propriété dont elle serait<br />
investie sur un immeuble ordinaire, les tribunaux ordinaires sont compétents<br />
pour connaître de cette action.<br />
Cardona c. Hunout et Commune d'Alger.<br />
Considérant que la première obligalion du propriétaire est de veiller à ce<br />
—<br />
que l'état des lieux loués ne compromette pas la sûreté du locataire; Que<br />
le propriétaire ne remplit pas complètement cette obligation quand il se<br />
borne à prévenir son locataire d'un danger imminent elà l'inviter lui-même<br />
— à quitter les lieux ; Qu'en présence de l'inertie du locataire, le proprié<br />
laire doit, pour se dégager, lui faire une sommation régulière et même s'a<br />
dresser à la justice pour prescrire le déguerpissemenl si la sommation a été<br />
— insuffisante ; Que néanmoins la connaissance du fait acquise par le loca<br />
taire Cardona du danger qui le menaçait et sa persistance à demeurer dans<br />
les lieux atténuent largement la faute qui résulte de l'insuffisance des dili<br />
gences du propriétaire et la responsabilité qui en peut résulter, qui est dé<br />
terminée par les documents de la cause ;
258<br />
— Sur la demande en garantie de Hunout; Considérant qu'elle est -for<br />
mulée à raison du mauvais état des voûtes dont la commune d'Alger serait<br />
co-propriélaire d'après Hunoul dans leur partie supérieure. Que Hunout re<br />
proche à la commune de n'avoir pas fait à sa chose les travaux nécessaires<br />
—<br />
pour ne pas nuire à autrui ; Qu'ainsi c'est à raison de sa qualité de pro<br />
priétaire d'un immeuble ordinaire que la commune est assignée par Hunout<br />
et non à propos des travaux de vicinalité faits ou à faire à la voie publique<br />
supportée par les voûtes dont s'agit. Que dans cette situation, les tribunaux<br />
—<br />
ordinaires sont compétents ; Considérant qu'il résulte d'actes administra<br />
tifs de concession parfaitement clairs et dès lors non-susceptibles d'interpré<br />
tation : Que Hunout et ses auteurs ne sont devenus propriétaires des voûtes<br />
et du sol qui les supportent qu'à charge de faire eux-mêmes et sans recours<br />
contre qui que ce soit, les travaux qui seraient nécessaires ;<br />
LA COUR : Donne défaul contre Cardona el contre Me Carrière son défen<br />
Réformant le jugement dont . est<br />
seur faute de conclure et pour le profil. —<br />
appel,<br />
— Condamne<br />
intérêts. —<br />
Hunoul à payer à Cardona cent francs de dommages-<br />
Dit<br />
qu'en ouireà titre de supplément de dommages-intérêts<br />
Cardona est déchargé des loyers par lui dûs à Hunout ;<br />
— Se<br />
déclare com<br />
pétente pour statuer sur la demande en garantie de Hunout contre la com<br />
—<br />
mune d'Alger; Déclare celte demande mal fondée.<br />
— Ordonne la restitution de l'amende; Condamne Hunout envers toutes<br />
les parties aux dépens de première instance el d'appel.<br />
M . Du<br />
Moiron, Subst . du Proc. gén . ; M
259<br />
leur égard par le cahier des charges, doivent être considérés comme compris<br />
dans l'adjudication .<br />
En conséquence, si ces frais ont élé exposés par les fermiers de l'immeuble,<br />
ceux-ci ont le droit d'en réclamer le remboursement en vertu de l'action de<br />
in rem verso, non point à l'adjudicataire, mais bien au concessionnaire évincé<br />
qui profite du prix d'adjudication et par suite, de la plus-value entraînée par<br />
les améliorations et les travaux dont le fonds a été l'objet (1).<br />
//. Lorsqu'un acte synallagmatique est nul, cette nullité étant le fait<br />
commun des deux parties, interdit à cet acte de devenir le fondement d'un<br />
droit quelconque ; en conséquence, on ne saurait faire supporter à l'une des<br />
parties les frais de cet acte, en<br />
s'<br />
appuyant sur une clause même formelle con<br />
çue dans ce sens ; car cette clause suppose manifestement la validité et le<br />
maintien de l'acte lui-même, et ne saurait recevoir d'exécution en présence de<br />
sa nullité .<br />
Jeantelc Ahmed ren Brahim, Mounicq et Dournon.<br />
Considérant que le 5 février 1875 les époux Dournon sont devenus con<br />
— cessionnaires au titre 2 du lot rural qui fait l'objet du litige; Que n'ayant<br />
pas rempli leur obligation de résidence, ils ont encouru la déchéance et<br />
l'éviction de leur droit au bail ; Que la décision de l'autorité administrative<br />
—<br />
qui édifiait ces mesures rigoureuses leur a élé signifié le 3 janvier 1876 ;<br />
Que néanmoins par acte authentique du 7 mars 1876, ils ont cédé à Mounicq<br />
leur droil au bail sans lui révéler la déchéance dont il élait frappé ; —<br />
Qu'à<br />
la vérité cet acte n'a pas obtenu l'agrément de i'autorilé administrative au<br />
quel il était subordonné par ses propres stipulations et par la législation<br />
—<br />
spéciale sur la malière; Qu'ainsi il n'a pas reçu son accomplissement ni<br />
—<br />
sa conclusion juridique ; Que les frais de cet acte 205 francs 45 centimes<br />
—<br />
ont été payés par Mounicq ; Qu'après ces faits, Mounicq a acquis par de<br />
nouvelles communicaiions administrai ives, la connaissance de la déchéance<br />
— dont avait été frappé son cédant ; Que néanmoins après l'avoir apprise,<br />
il a loué à Ahmed ben Brahim et à Hamoud ben Gueltach les terres sur les<br />
—<br />
quelles il n'avait aucun droit ; Que par suite de ce bail, dont ils igno<br />
raient le vice originel, ces deux arabes onl cullivé el ensemencé les terres à<br />
—<br />
eux louées; Que le 23 janvier 1877 par suile de l'éviction piononcée<br />
contre les époux Dournon, ces terres ont élé adjugées administralivement à<br />
Jeanlel qui s'en est mis en possession ;<br />
— Qu'elles portaient alors des cé-<br />
(1) Voir au Bull. jud. 1877, p. 297 avec une note critique de M. Poivre, le<br />
jugement du Tribunal de Constantine relatif à cette affaire. Cette décision ad<br />
mettait qu'à défaut de clause formelle contraire du cahier des charges, l'applica<br />
tion absolue des art. 548 et 1381 du Code civil, devait contraindre l'acquéreur<br />
du droit au bail, à rembourser les frais de semences et de labours ayant produit<br />
les récoltes se trouvant sur la propriété. — Comme<br />
on peut le voir plus haut, la<br />
Cour s'est prononcée dans un sens contraire, et nous croyons que sa décision<br />
présente une rectitude juridique plus complète que le jugement de première<br />
instance.
260<br />
réaies pendant par racines, c'esl-à-dire immeubles par destination que le<br />
cahier des charges n'a pas distingué du fonds lui-même ; Qu'il-a dit au con<br />
traire, que l'adjudicataire prenait l'immeuble dans son élal actuel ;<br />
— Sur la demande de Brahim et de Guettach contre Jeantel ; Considérant<br />
que ces fermiers ont réclamé le prix de leurs travaux et débours à l'adjudi<br />
cataire qui les évinçait ; — Considérant<br />
que s'il est inconteslable que ces<br />
indigènes doivent être indemnisés, il n'en résulte pas que ce soit l'adjudi<br />
cataire qui soit tenu envers eux ;<br />
— Que<br />
pour devenir débiteur des labours<br />
et semences envers un tiers qui les a fails, il ne suffit pas d'être propriélaire<br />
— —<br />
du terrain ; Qu'il faut, en outre, avoir élé enrichi par ces travaux ;<br />
Que l'obligation du propriélaire repose uniquement sur le principe que nul<br />
—<br />
ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; Considérant que si l'adjudica<br />
taire a dans l'espèce trouvé les labours et les semences il les avait payés par<br />
une portion de son prix d'adjudication, lequel avait été établi en contempla<br />
— tion de l'état actuel de l'immeuble ; Qu'il les payerait une seconde fois,<br />
s'il était condamné à en rembourser la valeur à leurs auteurs ;<br />
— Qu'en<br />
réalité, celui qui s'est enrichi par ces travaux n'est pas l'adjudicataire, mais<br />
bien les époux Dournon concessionnaires évincés, à qui doit revenir le prix<br />
de l'adjudication ;<br />
Sur la demande en garantie de Jeantel contre Mounicq ;<br />
— Considérant<br />
qu'il n'y a plus lieu de s'en occuper, la demande principale de Brahim et<br />
de Guetlaeh étant écarlée ;<br />
— Que<br />
celte demande en garantie étant occasion<br />
née par la demande principale mal fondée de Brahim et de Guettach contre<br />
Jeantel, ces demandeurs au principal doivent en supporter les dépens ;<br />
Sur la demande de Brahim et de Guetlaeh contre Mounicq leur bailleur,<br />
reposant sur leur contrai de bail et sur l'éviction qu'ils ont éprouvée des<br />
terres par eux louées et ensemencées ;<br />
— Considérant<br />
que le bail dont<br />
s'agit était en lui-même parfailement valable et qu'il n'est infirmé que par<br />
le vice de la cession antérieure du 7 mars 1876 à laquelle Brahim el Guet<br />
— tach n'avaient pas parlicipés ; Que cette cession étant le titre de Mounicq<br />
il est responsable de ses vices à l'égard des tiers avec lesquels il a ultérieure<br />
ment contracté ;<br />
— Que c'est à bon droit que les premiers juges ont pro<br />
noncé conlre Mounicq la résiliation d'un bail désormais sens exécution<br />
possible, la condamnation en restitution de 275 francs touchés sur le prix<br />
du bail, et ordonné une expertise pour évaluer les dommages-intérêts dus<br />
-<br />
aux fermiers évincés ; Adoptant, en outre, les motifs qui les ont déter<br />
minés sur ces divers points ;<br />
— Sur les demandes de Mounicq contre les époux Dournon ; Sur la nullité<br />
de la cession du 7 mars 1876 annulée par le Tribunal faute d'avoir reçu l'au<br />
— torisation administrative ; Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />
Sur la demande de dommages-intérêts de Mounicq à raison du bénéfice<br />
dont il pourra être privé par — la nullité de celle cession ; Considérant que<br />
la nullité d'un acte synallagmatique est —<br />
le fait commun des deux parties;<br />
Que l'acte dont il s'agit n'ayant jamais reçu sa perfection juridique n'a pu<br />
devenir le fondement d'aucun droit et adoptant les motifs des premiers<br />
juges ;<br />
Sur la demande en garantie des dommages-intérêts à prononcer contre<br />
Mounicq à raison de l'éviction de ses fermiers —<br />
; Considérant que la loca-
261<br />
tion faite par Mounicq à une époque où il connaissait le vice de la cession qui<br />
lui avait été faite est une faute<br />
qui'<br />
ne peut dès lors fonder un recours en garantie ;<br />
lui est exclusivement personnelle et qui<br />
— Adoptant,<br />
en outre, les<br />
motifs des premiers juges à cet égard ;<br />
Sur la demande en garantie des dommages-intérêts à prononcer contre<br />
Mounicq pour les frais de labours et semences faites par ses fermiers —<br />
;<br />
Considérant qu'il a été ci-dessus établi quo ces frais ont profité aux époux<br />
Dournon puisque leur valeur a augmenté le prix d'adjudication ;<br />
— Que<br />
cette valeur va être remboursée aux indigènes fermiers évincés par Mounicq<br />
— leur bailleur; Que les époux Dournon ne pouvant s'enrichir aux dépens<br />
de Mounicq, il en résulte, à cet égard, en faveur de ce dernier, une action<br />
récursaire;<br />
— Que<br />
celle-ci ne prend par sa source dans le contrat annulé,<br />
mais dans un quasi contrat de droil commun et l'action de in rem verso ;<br />
Sur la restilulion du coût de la cession du 7 mars 1876 payé 205 francs<br />
par Mounicq ;<br />
— Considérant que cet acte étant nul, on ne peut argumenter<br />
contre Mounicq de la clause qui l'obligeait à payer les frais d'acles, laquelle<br />
supposait évidemment la validité et le maintien de l'acte ;<br />
— Que cet acle<br />
même incomplet et ce paiement des frais qui ont élé la conséquence n'ont<br />
pu intervenir que parce que les époux Dournon laissaient alors ignorer à<br />
—<br />
Mounicq la déchéance dont ils étaient frappés ; Que celte réticence, rap<br />
prochée des autres circonstances de fait, constitue une faule de la part des<br />
époux Dournon qui sont obligés, dès lors, de réparer le préjudice qu'elle a<br />
directement occasionné en faisant payer 205 francs à Mounicq ;<br />
Sur la saisie arrêt interposée par Mounicq entre les mains du Domaine<br />
contre les époux Dournon ;<br />
— Considérant qu'elle doit être validée dans<br />
les limites où ce présent arrêt reconnaît Mounicq créancier des<br />
Dournon ;<br />
époux<br />
Par ces motifs ;<br />
— Attendu la connexité, maintient la jonction prononcée<br />
des causes, el émendant le jugement dont appel ;<br />
— Déclare Brahim et<br />
Guettach mal fondés en leur action contre Jeantel ;<br />
-<br />
Met, dès à présent,<br />
Jeantel hors de cause ;<br />
— Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en<br />
garantie de Jeantel contre Mounicq ;<br />
— Confirme le jugement en ce qu'il a<br />
déclaré nulle la cession de droit au bail du 7 mars 1876;<br />
- Confirme le<br />
jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Mounicq<br />
et condame ce dernier à restituer 275 francs à Brahim et à Guettach ;<br />
Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise destinée à déter<br />
miner ce qui esl dû à Brahim et à Guettach pour labours et semences et<br />
— inexécution du bail ; Dit néanmoins que celle expertise ne concernera pas<br />
— Jeantel ; Dit que les époux Dournon seront responsables envers Mounicq<br />
— de ce que celui-ci devra payer pour labours et semences seulement; Con<br />
damne les époux Dournon à payera Mounicq 205 francs 45 cenlimes pour<br />
— remboursement de frais d'acte ; Valide pour ces deux chefs de créance<br />
seulement la saisie arrêt interposée par Mounicq contre les époux Dournon<br />
—<br />
entre les mains du Receveur des Domaines ; Déclare Mounicq mal fondé,<br />
—<br />
dans le surplus de ses demandes contre les époux Dournon; Déclare<br />
les parties non recevables et mal fondées dans le surplus de leurs demandes<br />
et conclusions;<br />
— Ordonne<br />
Jeantel et de Mounicq ; — Et<br />
la restitution des amendes sur les appels do<br />
statuant ensemble sur les dépens de première<br />
—
262<br />
— instance faits jusqu'à ce jour et sur les dépens d'appel ; Condamne Bra<br />
him et Guetlaeh aux dépens particulièrement occasionnés par leur demande<br />
contre Jeaniel et par la demande en garantie de Jeantel contre Mounicq,<br />
notamment à tous les dépens exposés par Jeantel, ceux d'appel distraits à<br />
Mounicq<br />
Me Dazinière aux offres de droit et liquidés à ;<br />
— Condamne<br />
à supporter le surplus des dépens exposés par Brahim et Guettach, ceux<br />
d'appel distraits à Me Garau aux offres de droit et liquidés à ;<br />
— Con<br />
damne Mounicq à supporter la moitié de ses propres, dépens ; — Condamne<br />
les époux Dournon à supporter 1'aulre moitié des dépens de Mounicq, ceux<br />
d'appel distraits à Me Chéronnet aux offres de droit et liquidés à.... ;<br />
Condamne les époux Dournon à supporter la totalité de leurs propres<br />
dépens.<br />
M.duMoiron, subst. du Proc. gén.; Mes Dazinière, Chéronnet et Garau, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr..)<br />
Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />
9 mars 1878.<br />
Appel correctionnel. — Appel du ministère public. — Forme».<br />
— Appel<br />
du prévenu .<br />
raître devant la Cour.<br />
— Désistement<br />
.<br />
— Citation<br />
—<br />
à compa<br />
L'appel correctionnel interjeté par le ministère public de première instance,<br />
par une déclaration faite au greffe, aux termes de l'art. 203 du Code d'instr.<br />
crim., est parfaitement régulier par lui-même,<br />
sans qu'il soit besoin de porter<br />
cet appel à la connaissance du prévenu, au moyen d'une notification spéciale,<br />
ainsi que cela est exigé pour l'appel du Procureur général.<br />
En conséquence, si le prévenu a lui-même interjeté appel,<br />
el si la citation<br />
qui lui est donnée à comparaître devant la Cour ne mentionne que son propre<br />
appel, sans indiquer l'appel du ministère public, la Cour n'en est pas moins<br />
saisie de ce dernier appel et a le devoir d'y statuer .<br />
Il importe peu même que, postérieurement à cette situation, le prévenu se soit<br />
désisté de son propre appel, ce désistement ne pouvant avoir pour effet de<br />
faire disparaître l'appel régulier du ministère public, et ne devenant définitif,<br />
au surplus, que lorsque la Cour l'ayant examiné, en a apprécié la régularité<br />
et en a donné acte.<br />
La Cour conserve donc, nonobstant ce désistement, l'obligation de statuer sur<br />
l'appel du ministère public et le pouvoir d'y faire droit en élevant la peine pro<br />
noncée par . les premiers juges .
263<br />
Le Min. pur. c. Benjamin Attal.<br />
Considérant que Benjamin Altaï, condamné le 13 décembre 1877 parle<br />
tribunal correctionnel de Bône, à un mois de prison et seize francs d'amende<br />
pour coups et blessures, a relevé appel le 15 décembre de la décision qui l'a<br />
— frappé ; Que le 19 du même mois le Procureur de la République de Bône<br />
a relevé, à son tour, appel de cette décision ;<br />
—<br />
Que,<br />
par exploit du 22 dé<br />
cembre signifié à la requête du Procureur général, Benjamin Attal a élé cité<br />
à comparaître le 21 février devant la Cour pour voir statuer sur le mérile de<br />
—<br />
son appel ; Considérant que, postérieurement à cette assignation à une<br />
—<br />
date qui ne peut être précisée, Benjamin Attal s'est désisté de son appel ;<br />
Que la question se pose, dès lors, de savoir si la Cour se «trouve valablement<br />
saisie de l'appel du Procureur de la République de Bône, Attal n'étant pas<br />
—<br />
ajourné spécialement pour y répondre ; Considérant sur ce point que le<br />
Procureur déjà République, contrairement à ce qui a lieu pour le Procureur<br />
général, n'est astreint à aucune notification de son recours; Qu'aux termes<br />
de l'art. 203 du Code d'instr. crim., le Procureur de la République n'est<br />
tenu qu'à déclarer son appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ;<br />
— Que si le Procureur de la République relève seul l'appel, l'assignation<br />
par lui donnée au prévenu, nécessaire dans ce cas,<br />
n'a d'autre but que de<br />
dénoncer à la parlie condamnée le jour où la Cour statuera à nouveau ; —<br />
Que si, au contraire, il y a appel du prévenu et du ministère public, l'assi<br />
gnation donnée au premier pour voir statuer à jour fixe sur son appel<br />
personnel, est suffisante pour que la Cour soit valablement saisie des deux<br />
appels, le Procureur de la République ayant rempli ses'obligalions en décla<br />
— rant son appel au greffe; Considérant que le désistement du prévenu ne<br />
saurait en rien modifier cette situalion, le désistement n'ayant évidemment<br />
pas pour effet d'ôler à celui-ci la connaissance qu'il doit avoir de l'appel du<br />
ministère public, alors surtout qu'il est incontestable que le désistement<br />
n'est définitif que lorsque la Cour après l'avoir examiné le juge régulier et<br />
en a donné acte en présence du prévenu ou lui dûment appelé par l'assigna<br />
tion qu'il a reçue;<br />
—<br />
Considérant, dès lors, qu'il échet de déclarer la Cour<br />
valablement saisie de l'appel du ministère public près le tribunal de Bône ;<br />
Considérant que Benjamin Attal ne se présente pas et qu'il y a lieu de<br />
statuer par défaut contre lui ;<br />
— Considérant,<br />
en ce qui touche le désis<br />
tement de Benjamin Attal qu'il est régulier et qu'il convient de lui en<br />
— donner acte ; Considérant, en ce qui touche l'appel du ministère public,<br />
que la blessure faite a entraîné pour la plaignante une incapacité de travail<br />
de plus de vingt jours, et aura pour conséquence inévitable une difformité<br />
— de la région claviculaire; Que, dans ces conditions, le fait reproché au<br />
prévenu tombe sous l'application de l'art. 309 du Code pénal el que la peine<br />
prononcée par le tribunal de Bône. n'est pas en rapport avec la gravité des<br />
lésions constatées sur le corps de la plaignante, et qu'il y a lieu d'élever la<br />
—<br />
peine énoncée en faisant droit à l'appel du Procureur de la République ;<br />
qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du<br />
Attendu, toutefois,<br />
prévenu ;<br />
Par ces motifs : Adjugeant défaut prononcé contre Attal à l'audience du<br />
21 février; Donne acte à Attal de son désistement comme régulier en la<br />
forme, et le déclare, en —<br />
conséquence, déchu du bénéfice de son appel ;
264<br />
Statuant sur l'appel du Procureur de la République de Bône, se déclare<br />
valablement saisie dudit appel; Faisant droit a icelui, Infirme le jugement<br />
dont est appel en ce qu'il n'a condamné Allai qu'à un mois de prison el seize<br />
francs d'amende ; Et statuant à nouveau, vu les arl. 309 et 463 du Code<br />
pénal, visés au jugement dont est appel ; Condamne Benjamin Attal en trois<br />
mois de prison ; le condamne en tous les dépens.<br />
M. Zeys, cons. rapp. ; M. av. Fau, gén.<br />
COUR ""D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M. TRUAUT, président.<br />
16 mars 1878.<br />
Publication, exposition ou mise en vente,<br />
autorisation. — Photographies.<br />
de dessins sans<br />
Bien que les termes de Vart. 22 du décret du\l février 1852 ne spécifient<br />
comme devant êlre munis d'autorisation pour leur publication,<br />
mise en vente, que les dessins, gravures, lithographies, médailles,<br />
exposition ou<br />
estampes ou<br />
emblèmes, il faut considérer les reproductions photographiques comme rentrant<br />
dans les prescriptions de cet article, et celui qui les aura publiées, exposées ou<br />
mises en vente, tombe conséquemment sous le coup des dispositions pénales qui<br />
s'y<br />
trouvent édictées .<br />
Témime c. le Procureur général.<br />
Attendu que la Cour est saisie de l'appel de Témime, par acte au greffe du<br />
14 février dernier, de celui du Procureur général vis-à-vis de Témime, sui<br />
— vant déclaration faite à l'audience du 7 mars ; Altendu qu'il résulte des<br />
documents de la cause, notammenl d'un procès-verbal du commissaire de<br />
police, du 16 janvier 1878, que Témime a élé trouvé mettant en vente sur<br />
une des places d'Alger, des dessins photographiques de femmes nues, dans<br />
des positions diverses obcènes, lesquels dessins ont élé saisis et figurent dans<br />
— les pièces de conviction ; Attendu que ce fait constitue un double délit :<br />
1° l'outrage à fa morale publique et aux bonnes mœurs, prévu el réprimé<br />
par les art. 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, el retenu par les premiers juges ;<br />
2° le délit de mise en vente de dessins sans autorisation préfectorale, prévu<br />
et réprimé par l'article 22 du décret du 17 février 1852, promulgué en<br />
Algérie par décret du 14 mars 1855 ;<br />
,<br />
Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont relaxé le prévenu<br />
sur ce dernier chef par le motif que le décret énonçant le cas de dessins par<br />
la gravure ou la lithographie, n'indique pas le procédé de la photographie ;<br />
— Que le principe de la loi c'esl la réglementation de l'exposition où de la
265<br />
mise en vente publiquement de dessins en général, que si spécifiquement le<br />
législateur énonce comme manifestation du dessin la gravure et la lithogra<br />
phie, il est évident qu'il ne peut exclure la photographie, qui est un mode<br />
d'émission et de publication des dessins plus facile à multiplier que les deux<br />
autres;<br />
—Qu'ainsi lout dessin photographique enlre dans les prescriptions<br />
réglementaires édictées par le décret précité ;<br />
Par cps motifs : Statuant sur les deux appels, Confirme le jugement attaqué<br />
sur la déclaration de culpabilité, quant au délit d'oulrage à la morale et aux<br />
sur le chef de mise en vente de dessins, photo<br />
— bonnes mœurs ; L'infirme<br />
graphiques sans autorisation préfectorale ;<br />
—<br />
Et, vu les articles l8* et 8 de<br />
la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852, Condamne<br />
Témime en un mois d'emprisonnement et cent francs d'amende.<br />
M. le prés. Truaut, rapp. ; M. av. gén.<br />
Fau,<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Jugement correctionnel .<br />
Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />
3 mai 1878.<br />
— Arrêt par défaut .<br />
Formes, — Nullité.<br />
— Opposition<br />
.<br />
L'opposition aux arrêts par défaut rendus en matière correctionnelle doit<br />
être, à peine de nullité, par application des art. 187 el 208 du Code d'instr.<br />
crim .<br />
, notifiée par exploit d'huissier au Procureur général .<br />
L'opposition que le prévenu aurait formée par simple déclaration au greffe,<br />
doit conséquemment être rejetée comme nulle et sans effet (1).<br />
Le Procureur général c. Lécuyer.<br />
Attendu que le quatorze mars dernier, Lécuyer s'est présenté au greffe du<br />
tribunal d'Oran et a déclaré former opposition à l'arrêt rendu par défaut<br />
contre lui, le 1er février 1878, par la Cour d'appel d'Alger, qui a confirmé le<br />
jugement rendu par le tribunal d'Oran, le 24 novembre 1877, lequel pro<br />
nonce contre lui la peine à un an et un jour de prison pour délit d'abus de<br />
(1) De même, à l'inverse, l'appel correctionnel interjeté non par déclaration au<br />
greffe, comme le veut l'art. 203 du Code d'instr. crim., mais par exploit d'huissier<br />
signifié au ministère public et à la partie civile, est absolument nul et sans valeur.<br />
Cass 27 sept. 1825, 22 mai 1835 ; Aix, 22 mai 1862 (J. du p. Pal, 1862, 1088). Il<br />
est incontestable que la loi a prescrit deux modes distincts en ce qui concerne ces<br />
deux voies de recours dans la même matière ; quant à la raison de cette distinction,<br />
nous avouons qu'elle nous échappe absolument, et il nous semblerait bien plus<br />
rationnel que l'appel et l'opposition fussent pratiqués sous une forme identique.
266<br />
—<br />
confiance ; Que Lécuyer n'a pas, en conformité des articles .208 et 187 du<br />
Code d'instruction criminelle, fait notifier à M. le Procureur général son<br />
—<br />
opposition ainsi formulée ; Que cet acte est, en conséquence, nul et sans<br />
effet ;<br />
Par ces motifs, LA COUR : Déclare nulle et sans effet l'opposition formée<br />
par le prévenu au greffe du tribunal d'Oran, le 14 mars 1878, à rencontre<br />
de l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger, du 1er Dit,'<br />
février 1878; en consé<br />
quence, que cet arrêt sortira son plein et entier effet ;— Condamne Lécuyer<br />
aux nouveaux dépens.<br />
M. Zeys, cons. rap. ; M. Fau,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />
Justice musulmane .<br />
Présidence de M. LAUTH, Conseiller.<br />
12 novembre 1877.<br />
— Région saharienne — Appels ,<br />
Forme, —<br />
Nullité.<br />
Les appels des jugements rendus en matière musulmane hors Tell ne peuvent,<br />
aux termes des art. 8 et suivants du décret des 8-15 janvier 1870, êlre soumis<br />
qu'autant que l'une ou l'autre partie aura dans les<br />
directement à la Cour,<br />
termes de cet art .<br />
Midjtlès consultatif.<br />
déclaré renoncer à soumettre le différend à l'avis d'un<br />
A défaut d'une semblable déclaration,<br />
Cour,<br />
doit être déclaré non recevable (1 ).<br />
—<br />
l'appel ponté directement devant la<br />
Mohamed ben Abd-el-Keriji c. Ahmed ben Charral.<br />
Attendu que d'après les articles 8 et suivants du décret des 8-15 janvier<br />
1870 les appels des jugements hors Tell, ne peuvent être soumis directement<br />
à la Cour qu'autant que l'une ou l'autre des parties aura déclaré renoncer- à<br />
—<br />
soumettre leur différend à l'avis d'un Midjelès consultatif; Que faute par<br />
l'une ou l'autre des parties d'avoir fait cette déclaration, le Midjelès doit<br />
nécessairement être consulté préalablement; Attendu, au cas particulier,<br />
qu'aucune des parties n'a fail la déclaration dont il s'agit ;<br />
(1) D'après l'art. 8 du décret de 1870, c'est en interjetant appel, que l'appelant<br />
doit faire la déclaration qu'il renonce à soumettre l'affaire à l'examen du Midjelès<br />
consultatif. Ne peut-on considérer comme équivalent à une telle renonciation de<br />
sa part, le fait qu'il aura formellement déclaré son intention de porter son appel<br />
directement devant la Cour ?
Par ces motifs ;<br />
— Déclare<br />
267<br />
l'appel non recevable, quant à présent, et ren<br />
voie les parties à se pourvoir comme elles l'entendront. Dépens réservés.<br />
M. Lauth, cons. rapp., M. Cammartin,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
30 avril 1878.<br />
I, Justice musulmane, — Administration du Beit-el-Mal. —<br />
Compétence. —<br />
II.<br />
Habous. — Biens engagés, — Hypothèque.<br />
/. Bien que l'administration du Beit-el-Mal soit une administration fran<br />
çaise, elle ne récuse pa$ pour le jugement des affaires dans lesquelles elle se<br />
trouve engagée, la juridiction des juges musulmans : en effet toutes les ins<br />
tances impliquent des questions de successions, de la compétence de cette juri<br />
diction,<br />
et d'autre part les agents de cette administration sont eux-mêmes des<br />
musulmans incapables de plaider devant une juridiction dont la procédure<br />
serait plus compliquée ;<br />
Aussi la tradition de la Cour d'Alger fondée sur sa jurisprudence a-t-elle<br />
toujours retenu la compétence de la juridiction musulmane pour les affaires du<br />
Beit-el-Mal ;<br />
II . Un<br />
habous ne peut être constitué que sur des biens absolument libres ;<br />
En conséquence, n'est point susceptible de habous, un immeuble qui a été<br />
antérieurement frappé d'hypothèque : l'hypothèque doit être sous ce rapport,<br />
absolumeut assimilé à la raknia.<br />
Khelil hen Furki c. le Beit-el-Mal.<br />
Atlendu que l'appel est régulier en la forme ;<br />
— Attendu<br />
qu'il n'y a pas<br />
lieu d'examiner si l'Oukil ancien du Beit-el-Mal avait reçu une nolilication -<br />
de son remplacement à la date du jugement dont est appel ; Que ce sérail<br />
seulement au cas où le Beit-el-Mal aurait perdu son procès que la question<br />
présenterait quelque intérêt ; mais attendu qu'il y a lieu pour la Cour d'exa<br />
miner sa propre compétence ;<br />
Attendu à cet égard, que se basant sur ce que les instances qui les concer<br />
nent sont toutes des questions de successions, le Beit-el-Mal a toujours adopté<br />
la juridiction musulmane pour le jugement de ses affaires ; Que ses agents<br />
sont eux-mêmes des musulmans incapables de plaider devant une juridiction<br />
à procédure moins primitive; Que la jurisprudence constante de la Cour a<br />
toujours admis cette compétence, bien que le Beil-el-Mal soit aujourd'hui<br />
devenu une administration française;— Qu'il y a donc lieu dans ces cir-
268<br />
constances, pour la Cour de se conformer à des traditions auxquelles il n'a<br />
jamais élé dérogé jusqu'à ce jour el auxquelles a si amplement participé le<br />
Beit-el-Mal lui-même ;<br />
— Que<br />
la Cour doit en conséquence retenir sa com<br />
pétence el celles des juridictions musulmanes du premier degré;<br />
Atlendu au fond que le habous constitué par Mériem est nul comme portant<br />
sur des biens non libres ; Qu'il résulte en effet d'un état d'inscription hypo<br />
thécaire délivré le 27 octobre 1877 et portant sur tous les biens sis dans<br />
l'arrondissement d'Alger,<br />
qu'Ahmed ben Mohamed ben Rebrah de qui Mé<br />
riem tenait des droils, qu'à la dale du 31 mai 1873, les biens dudit Ahmed<br />
avaient élé frappés d'hypolhèqne ; Que l'hypothèque doit être assimilée à la<br />
— raknia qui empêche l'habousation ; Que<br />
dès lors c'est à bon droit que<br />
Khelil ben Brahim ben Turki demande à être envoyé en possession des<br />
biens tous sis dans l'arrondissement d'Alger, mal à propos frappés de habous<br />
et non dégrevés des hypothèques inscrites du vivant d'Ahmed ben Mohamed<br />
ben Rcbrab ;<br />
— Altendu<br />
que la partie qui succombe doit êlre condamnée<br />
aux dépens ;<br />
Par ces motifs : en la forme,<br />
Turki ;<br />
— Au fond dit qu'il a été bien appelé, mal jugé ;<br />
séquence les jugements entrepris;<br />
reçoit l'appel de Khelil ben Brahim ben<br />
— Fait<br />
— Infirme<br />
en con<br />
droit à la demande primitive de<br />
— Khelil ; Déclare nul et de nul effet comme portant sur des biens non libres,<br />
le habous du 22 mai 1875 et envoie Khelil en possession des biens désignés<br />
audit habous;<br />
Condamne le Beit-el-Mal, en tous les dépens tant de première instance que<br />
d'appel.<br />
M. Lourdau, cons. rap. ; Cammartin, av. gén. ; Me Jouyne, av.<br />
TRIBUNAL DE PAIX DE BLIDA<br />
M. LISBONNE,<br />
23 août 1878.<br />
Juge de paix.<br />
Péremption d'Instance en matière de Justice de paix. — Se»<br />
caractères. — Jugement interlocutoire. — Jugement pré<br />
paratoire, — Fin de non-recevoir, — Conclusions prises. —<br />
Péremption d'instance en matière civile.<br />
La péremption d'instance édictée par l'art. 15 du Code de proc. civ., rela<br />
tivement aux procédures soumises à la juridiction des juges de paix, ne s'ap<br />
plique que dans le cas où il a été rendu dans la cause un jugement interlocu<br />
toire, et non dans celui où le jugement rendu n'aurait qu'un caractère simple<br />
ment préparatoire ( I ) .<br />
(1) Jurisp. conf. Cass., 12 fév. 1822.
269<br />
Le jugement interlocutoire se distingue du jugement préparatoire, en ce sens<br />
que le premier ordonnant ou rejetant une mesure d'instruction proposée par<br />
l'une des parties, mais repoussée par l'autre, fait d'ores et déjà grief à l'une<br />
d'elles, tandis que le deuxième a pour seul effet d'ordonner sans débats une<br />
mesure d'instruction qu'aucune des parties n'a combattue : aussi le premier<br />
est-il susceptible d'appel, tandis que le second est rendu définitivement et en<br />
dernier ressort.<br />
La péremption d'instance édictée par l'art. 15 du Code de proc. civ. en ma<br />
tière de justice de paix est couverte si après le délai de quatre mois fixé.par<br />
cette disposition, les parties ont pris des conclusions au fond ou fait un acte<br />
quelconque de procédure de<br />
poser ce moyen (1).<br />
nature'<br />
d faire supposer qu'elles ont renonce à op<br />
Il en est ainsi spécialement quand la mesure ordonnée par le jugement in<br />
terlocutoire ayant été une enquête, les deux parties ont après le délai de quatre<br />
mois, spontanément et sans réserve,<br />
assisté et coopéré à cette enquête.<br />
La péremption d'instance édictée par le Code de proc. civ. (art. 297) pour<br />
les instances introduites devant les tribunaux civils, ne saurait être étendue<br />
par voie d'analogie aux instances de justice de paix : ces dernières ne sont<br />
soumises à d'autres péremptions que celle qui leur est attribuée formellement<br />
par la loi et qui au surplus, leur est absolument spéciale (2).<br />
Canac c. Bonnemain.<br />
Atlendu en fait, que le 29 septembre 1874 le sieur Bonnemain a introduit<br />
devant ce Tribunal, contre le sieur Canac, une instance en dommages-inté<br />
un jugement<br />
rêts, sur laquelle a été rendu à la date du 2 octobre suivant,<br />
qui, avant dire droit au fond, a ordonné plusieurs mesures d'instruction ;<br />
Attendu que les 15, 22 et 26 mars 1875, il fut procédé à la visite des lieux<br />
litigieux et aux enquête et contr'enquête ordonnées par ce jugement, et que<br />
depuis lors celte instance n'a reçu aucune solution définitive ;<br />
Attendu que c'est en cet état que le sieur Canac a, par exploit du 31 juil<br />
let dernier, demandé la péremption de l'instance introduite contre lui par le<br />
sieur Bonnemain, le 29 septembre 1874, el ce par application des dispositions<br />
des art. 15 et 397 du Code de procédure civile.<br />
Endroit. —<br />
Sur<br />
le 1er moyen. — Atlendu<br />
que l'art. 15 du Code de p.<br />
c. porte : « Dans les cas où un interloculoire a élé ordonné la cause doit êlre<br />
« jugée définitivement dans le délai de quatre mois au plus tard, à parlir du<br />
« jugement interlocutoire,<br />
à peine de nullité du jugement qui serait rendu<br />
(1) La péremption d'une instance de justice de paix peut-elle être suspendue<br />
ou couverte par un simple acte de procédure, ou faut-il la renonciation formelle<br />
et expresse de la partie ? — Voir sur cette question coutreverfée Cass. 17 déc.<br />
1860 (/. du Pal. 1861, p. 216) avec la note, ainsi qu'au Rép. du J. du Pal Table<br />
comptém. V° Péremption, n° 52.<br />
(2; Jurisp. conf. Orléans, 14 avril 1809. Cass. 13 sep. 1809 (Rép. du J. du Pal.<br />
~V°jug. par défaut, n° 564.
« après ce délai ; >. — Attendu<br />
270<br />
qu'il est reconnu par tous les auteurs et ad<br />
mis par la jurisprudence que cette disposition ne s'applique point au cas<br />
—<br />
où la cause a reçu seulement un jugement préparatoire ; Qu'il y a donc<br />
lieu de rechercher quel est le véritable caractère du jugement rendu entre<br />
—<br />
parties le 2 octobre 1874 ; Altendu que pour résoudre cette première dif<br />
il convient de bien définir quelles sont les conditions qui font attri<br />
ficulté,<br />
buer à un jugement d'avant dire droîl le caractère de interlocutoire ou prépa<br />
ratoire;— Atlendu que l'art. 452 du Code de proc. civ. s'exprime ainsi:<br />
« Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la<br />
« cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement défi-<br />
— « nitif; Sont<br />
réputés interlocutoires les jugements qui ordonnent une<br />
« preuve, une virificalion ou une instruction qui préjuge le fond ;<br />
tendu qu'il faul encore compléter ces dispositions par celles de l'art. 451 du<br />
même Code, portant: « L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être<br />
« interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce<br />
- >■ At<br />
« jugement ; tandis que l'appel d'un jugement interlocutoire peut être in-<br />
« lerjelé avant le jugement du fond ;<br />
•> — Attendu que c'est parla combi<br />
naison de ces deux textes que s'explique d'une manière claire et précise<br />
la qualification que le législateur a donnée aux jugements d'avant dire droit;<br />
— Qu'ainsi il en résulte que tout jugement qui ordonne ou rejette une me<br />
sure d'instruction proposée par l'une des parties, mais contestée par l'autre,<br />
et dont dépend la solution définitive du litige, fait d'ores et déjà grief à l'une<br />
— ou à l'autre des parties ; Ce jugement pouvant être frappé d'appel par la<br />
partie dont les conclusions ont été rejelées, doit êlre qualifié de jugement<br />
interlocutoire;— Que si, au contraire,<br />
le Tribunal admet sans débats une<br />
mesure d'inslruclion demandée par les deux parties en cause, et dont cha<br />
cune d'elle croit tirer avantage pour le jugement du fond, le jugement qui<br />
l'ordonne, loin de faire grief à l'une ou à l'autre des parties, fait droit à<br />
leurs conclusions respectives, et l'appel d'un jugement de cette nalure ne<br />
serait point recevable, puisqu'il ne préjuge en aucune façon la situation dé<br />
finitive;<br />
Atlendu que les principes incontestables ainsi posés, il ne reste plus qu'à<br />
en faire l'application à la cause actuelle, c'est-à-dire à rechercher quel est le<br />
—<br />
caractère du jugement rendu par ce Tribunal, le 2 octobre 1874 ; Que ce<br />
jugement porte: « qu'avant dire droit au fond, le juge de paix se transpor-<br />
« lera sur les lieux litigieux pour en examiner les dispositions, se rendre<br />
« compte de la nalure el de l'importance des griefs que Bonnemain impute<br />
« à Canac; faire enquête sUr icenx ; entendre en conséquence tous témoins<br />
« qu'il plaira tant au demandeur qu'au défendeur de faire entendre sur les<br />
réserve les dépens. •> — que ces<br />
diverses mesures d'instruction ont élé demandées et acceptées par les deux<br />
« faits qui font l'objet du litige, Attendu<br />
parties et le Tribunal, en les ordonnant,<br />
n'a fait que leur donner acle de<br />
— leurs conclusions respectives et de leur consentement réciproque; Qu'il<br />
est impossible de considérer ce jugement comme un interlocutoire, préju<br />
geant la soluiion définitive du procès, el pouvant être frappé d'appel par<br />
— l'une ou par l'autre des parties; Que ce jugement présente au contraire<br />
tous les caraclères d'un jugement préparatoire el portant non sujet à la pé<br />
remption prescrite par l'art. 15 du Code de proc. civ. ;
27 1<br />
Altendu enfin que lors même qu'il pût être considéré comme interlocu<br />
toire, la demande en péremption n'en devrait pas moins êlre déclarée mal<br />
fondée ;<br />
Attendu en effet que cette péremption de quatre mois peut être couverte<br />
si, après ce délai, les parties ont pris des conclusions au fond ou fait tel acte<br />
de procédure qui fasse supposer qu'elles renoncent au bénéfice de celte pé<br />
—<br />
remption; Que tel est l'opinion unanime des auteurs, consacrée par plu<br />
sieurs arrêts de la Cour de cassation ;<br />
Atlendu que le jugement dont il s'agita été rendu le 2 octobre 1874;<br />
qu'il n'a été procédé aux enquête et contr'enquête ordonnées par icelui que<br />
les 15, 22 et 26 mars 1875, c'est-à-dire plus de quatre mois après la date du<br />
— jugement ; Atlendu que le sieur Canac a assisté aux mesures d'inslruciion<br />
— ordonnées et a fait entendre de nombreux témoins; Qu'il a donc ainsi<br />
renoncé à la péremption alors acquise, péremption qui, une fois couverte par<br />
le consentement exprès ou tacite des parties, ne peut, plus lard, être utilement<br />
invoquée. (Arrêts delà Cour de cassation des 22 mars 1837 et 13 février<br />
1848 J— Altendu qu'à tous les points de vue ce premier moyen doit êlre<br />
rejeté ;<br />
Sur le 2« — moyen : Altendu<br />
que le Code de procédure civile édicté deux<br />
cas de péremption d'instance, distincts l'un de l'autre; l'un applicable aux<br />
instances portées devant les Tribunaux de paix (art. 15), l'aulre se rapportant<br />
— aux instances introduites devant les Tribunaux civils (art. 397); Attendu<br />
— que ces deux règles ne peuvent être confondues ; Que s'il n'est point ad<br />
missible d'appliquer aux Tribunaux civils la péremption prescrite par l'art.<br />
15, il est non moins admissible d'attribuer aux justices de paix celle prescrite<br />
— par l'art. 397 ; Que là où la loi trace d'une manière formelle des règles par<br />
ticulières el spéciales à telle ou telle juridiction, il n'est point permis au<br />
juge de les enfreindre, ni de raisonner par analogie, et d'établir enfin une<br />
confusion que repoussent d'une manière formelle les textes précis de la loi ;<br />
— Atlendu<br />
que si quelques auteurs onl émis l'avis que la péremption pré<br />
vue par l'art. 397 pouvait être appliquée aux Tribunaux de commerce, cette<br />
opinion peut trouver sa raison d'être dans la lacune que laisse le Code de<br />
procédure civile à l'égard des instances portées devant les tribunaux consu<br />
— laires ; Mais ces motifs et ces considérations disparaissent en présence<br />
des règles établies par le titre 2 du Code de procédure civile, traitant spécia<br />
lement des causes portées devant les Tribunaux de paix ;<br />
Altendu donc que la demandeenpéremption de l'instance du 29 septembre<br />
1874 n'étant point fondée, celte instance est encore debout et peut être conti<br />
nuée et poursuivie par celle des parties qui le juge convenable, sur ses der<br />
niers errements, si mieux elles n'aiment l'une et l'autre l'abandonner;<br />
Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;<br />
Par ces motifs : Nous juge de paix,<br />
statuant contradictoirement et en pre<br />
mier ressort, déclarons le sieur Canac mal fondé dans sa demande en péremp<br />
tion d'instance, l'en déboutons et le condamnons aux dépens.<br />
—
272<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en date du 24 août 1878, a été nommé :<br />
Suppléant du juge de paix de Fort-National (Algérie), M. Herbelin (Jeau-<br />
Marie-Antoine). —<br />
Exécution<br />
du décret du 23 avril 1874.<br />
M, Fermé, juge au tribunal de lre instance de Tlemcen (Algérie), rem<br />
plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, en remplacement de<br />
M. de Cabissole,<br />
qui a été nommé juge à Marvejols.<br />
Par arrêté en date du 24 août 1878 :<br />
M. Tarlarôli, greffier de la justice de paix d'El-Arrouch (Algérie), est auto<br />
risé à remplir les fonctions de notaire avec attributions restreintes. (Section<br />
2 du décret du 18 janvier 1875).<br />
M. Moreau, greffier de la justice de paix deTakitount (Algérie), est autorisé<br />
à remplir les fondions de notaire avec attributions restreintes. (Section 2 du<br />
décret du 18 janvier 1875).<br />
Par arrêté de M. le Procureur général, en date du 30 août 1878",. a été<br />
nommé :<br />
Curateur aux successions vacantes dans le canton de Nemours, M. Auguste<br />
Longchamp, en remplacement de M. Bernouin, démissionnaire.<br />
Par arrêté de M. le Procureur général, en date du 7 septembre 1878 :<br />
M. Valat, greffier de la justice de paix de Lamoricière, a élé nommé cura<br />
teur aux successions vacantes dans le canton de ladite justice de paix.<br />
Alger. — Typ. A. Jocudan.
2e année.<br />
— 16<br />
Septembre 1878. —<br />
fl° 42<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
LÉGISLATION<br />
Étude sur les articles 67, 69 et 463 actuels, combinés<br />
du Code Pénal.<br />
La rédaction de ces articles dans le Code Pénal n'est point tellement claire que<br />
leur interprétation et la part d'application à faire, soit aux mineurs de i6 ans ayant<br />
agi avec discernement inculpés de crimes, soit aux mêmes mineurs inculpés de simples<br />
délits, des articles 67 et 69 d'une part, 463 de l'autre, depuis les lois des 28 avril<br />
1832 et 13 mai 1863, n'offrent de sérieuses difficultés et n'aient soulevé des diver<br />
gences profondes dans la jurisprudence. Ces textes sont pourtant d'une applica<br />
tion sinon courante, au moins assez fréquente ; les juges correetionnels sont<br />
appelés par l'article 68 du Code Pénal à s'en occuper de temps à autre.<br />
Premier point.<br />
— Quelle<br />
portée faut-il donner à ces expressions de l'ar<br />
ticle 67, § 3, du Code Pénal : S'il a encouru la peine des travaux forcés à<br />
temps, de la détention, de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans<br />
une maison de correction pour un temps égal au 1/3 au moins, et à la 1/2 au<br />
plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines ?<br />
L'interprétation la meilleure, la plus accréditée n'est pas, comme on l'a<br />
enseigné, de prétendre, par exemple, que le mineur de 16 ans déclaré avoir<br />
commis avec discernement un crime entraînant la peine des travaux forcés à<br />
temps pourra être puni au maximum d'une détention dans une maison de<br />
correction, de 20 mois (1/3 de 5 ans ou 60 mois), au maximum d'une pareille<br />
détention mais d'une durée de 10 ares (1/2 de 20 ans); non la meilleure<br />
interprétation de cet article 67, % 3, consiste à dire que, pour ce mineur, ce<br />
sera l'application du tiers (1/3) de 5 , 7 , 10 , 13 ,<br />
15 20 soit<br />
, , 20 mois<br />
, 28 mois 40 mois , etc. , qui<br />
constituera le minimum applicable de la détention dans une maison de cor<br />
rection, et l'application de la moitié (1/2) de 5 , 7 , 10 ,<br />
13 , 15 , 20 ans, soit 30 mois ,42 mois , h ans , etc.,<br />
qui constituera le maximun applicable. (Blanche, vol. 2 sur le Code Pénal,<br />
passim, sur l'article 67 du Code Pénal ; Dalloz, v° peine n° 447 (arrêts de<br />
Cassation du 15 janvier et du 11 février 1825 ; arrêt de Cassation du 2 avril<br />
1864, cité dans les tables de Dalloz de 1845 à 1867, v° Excuse, n° 48).<br />
Deuxième point. — Les<br />
dispositions de l'article 67 du Code Pénal s'appli<br />
quent-elles, même dans les matières spéciales non régies par le Code Pénal ?
274<br />
Ici, quoique la jurisprudence et la doclrine soutiennent le pour el le<br />
contre, il y a prépondérance d'autorité dans le sens de l'affirmative. (Voir les<br />
nombreux arrêts de la Cour de Cassalion et des Cours d'Appel, relatés dans<br />
les labiés de Dalloz v°<br />
périodiquer excuse : de 1841 à 1856, n05 24 à 19,<br />
de 1845 à 1867, n°*43el44).<br />
Troisième point.<br />
— L'article<br />
463 du Code Pénal peut-il se combiner,<br />
au profit du mineur de 16 ans reconnu avoir commis un délit ou crime avec<br />
discernement avec l'article 67 et l'article 69 du Code Pénal ?<br />
La jurisprudence, d'abord contraire à cette combinaison parce qu'elle<br />
envisageait ces articles 67 et 69 comme tenant lieu de l'article 463 pour le<br />
mineur qui nous occupe, esl revenu sur l'arrêt de Cassation du 1 1 janvier<br />
1856 (signalé dans les tables de Dalloz de 1845 à 1867, v°<br />
excuse, n°<br />
51), par<br />
deux arrêls de la Cour de Cassation des 2 avril 1864 (cité page 454 de la<br />
1« partie du Dalloz périodique, année 1865), 10 août 1866 (cité dans les<br />
tables de Dalloz de 1845 à 1867, v°<br />
excuse, n° 52). Au surplus avant ces<br />
deux derniers arrêts, la Cour de Cassation avait, antérieurement au 1 1 janvier<br />
admis la combinaison des articles 67 et 69 du Code Pénal avec l'article<br />
1856,<br />
463, par des arrêts des 19 septembre 1839, 6 juin 1840,<br />
448).<br />
26 février 1841<br />
(cités dans Dalloz v°<br />
alphabétique, peine, n°<br />
Quatrième point. — Quel<br />
est le mode de combinaison, au profit du mineur<br />
de 16 ans reconnu coupable d'avoir commis avec discernement un délit ou<br />
crime, des articles 67, 69, 463 du Code Pénal ?<br />
Le Juge doit: 1° Envisager le mineur comme un majeur et lui faire,<br />
à ce point de vue, l'application de la réduction de peine édictée par l'article<br />
463 du Code Pénal ; 2° cette première réduction opérée envisager le mineur<br />
comme mineur et renchérir en vertu et par application de l'article 67 ou de<br />
l'article 69 suivant les cas, sur celle première atténuation de peine faite en<br />
vertu de l'article.<br />
C'est le procédé indiqué et autorisé par M. Faustin Hélie, tome 1, pages<br />
468 et 480 du Code Pénal, les arrêls de Cassation précités dés 19 septembre<br />
1839, 6 juin 1840, 26 février 1841, 2 avril 1864, 10 août 1866.<br />
Quatrième point. — Si<br />
le procédé de double atténuation de la peine, in<br />
diqué dans le troisième point et dérivant des articles 67 et 69 du Code<br />
Pénal combinés avec l'article 463 du même Code, conduit à appliquer au<br />
mineur précité une peine d'emprisonnement ou d'amende inférieure au mi<br />
nimum correctionnel de ces peines (lequel est : 16 francs pour l'amende, 6<br />
jours pour la prison), le Juge devra-t-il, pourra-t-il descendre au-dessous<br />
de ce minimum ?•<br />
La négative est enseignée dans : Rolland de Villargues sur l'article 69 du<br />
Code Pénal, page 555, et il cite un arrêt de Colmar, du 5 mai 1857, de<br />
Cassation du 11 janvier 1856 (déjà relaté) : Blanche, t. 2, p. 434 et 435<br />
(qui cite le susdit arrêt du 11 janvier 1856 et un arrêt de Cassation du 3<br />
février 1849) : le Code Pénal annoté par Sirey, article 69, commentaire 3
275<br />
(Bordeaux, 26 août 1830) : Chauveau et Hélie, t. 1, p. 480, § 2 : Dalloz<br />
alphabétique, v°<br />
peine, n°447.<br />
Il faut convenir que cette doctrine paraît spécieuse lorsqu'elle soutient<br />
que,<br />
s'agissant de prison ou d'amende de nature correctionnelle à appliquer<br />
en vertu des articles 67 et 69 du Code Pénal el par des Juges qui comme<br />
ceux de ces articles et de l'article 68 sont au moins des Juges correctionnels,<br />
il ne peut être question de prison ou d'amende au-dessous du minimum<br />
correctionnel, et par conséquent de simple police.<br />
Toutefois il a prévalu en jurisprudence et, selon nous avec raison (les<br />
Juges correctionnels ne sont-ils pas autorisés par l'article 463, § dernier, à<br />
appliquer des peines de simple police soit prison, soit amende, même à des<br />
majeurs) que, soit en vertu de l'article 69, pris en dehors de toute combi<br />
naison avec l'article 463 du Code Pénal (par exemple au cas de l'article 1 1<br />
de la loi du 3 mai 1844, où le minimum était de 16 francs d'amende pour<br />
un majeur l'article 69 conduit à un minimum de 8 francs pour le mineur),<br />
— soit en vertu de la combinaison des articles 67 el 69 avec l'article 463<br />
— du Code Pénal, le Juge peut, par application des articles 67, 68, 69 et 463<br />
du Code Pénal descendre au-dessous du minimum correctionnel, soit pour la<br />
prison, soit pour l'amende. (Arrêts de Cassation, des : 3 février 1849, cité<br />
dans l'année 1850 de Dalloz périodique, 5« partie, page 59 : 18 juin 1846, cité<br />
dans l'année 1846 de Dalloz périodique, lre partie, page 234: 9 avril 1875,<br />
cité dans l'année 1877 de Dalloz périodique, v°<br />
peine, n" 8 ; arrêt d'Orléans,<br />
du 19 octobre 1864, cité dans les tables de Dalloz, de 1845 à 1867, v°<br />
excuse,<br />
n»<br />
. 49)<br />
Cinquième point. — L'article 69 du Code Pénal, malgré le silence du texte,<br />
n'est-il applicable qu'au mineur reconnu coupable d'un simple délit, qui est<br />
mineur de 16 ans et qui a agi avec discernement ?<br />
L'affirmative est certaine ; il faut déclarer que le mineur a agi avec discer<br />
nement pour lui appliquer l'article 69 du Code Pénal. (Arrêls de Cassation<br />
des : 21 juin 1811, 17 juillet 1812, 8 octobre 1813, 17 avril 1824, cilés dans<br />
Rolland de Villargues, sur l'article 69, annoté du Code Pénal) .<br />
Sixième point. — L'article 69 du Code Pénal est-il applicable, même dans<br />
les matières spéciales non régies par le Code Pénal ?<br />
L'affirmative enseignée par des arrêts de Cassation des 3 janvier 1845,<br />
21 mars 1846, 18 jwm-1846, 3 février 1849, 11 janvier 1856, par un arrêt<br />
de Colmar du 5 mai 1857 (tous cités dans Rolland de Villargues sur l'article<br />
69 annoté), a prévalu sur la négative soutenue par des arrêts de : Grenoble,<br />
28 novembre 1833, 12 janvier 1825 : Cour de Cassation Belge, 31 mars 1836.<br />
CONCLUSION<br />
Pour résumer tout ce qui précède, prenons quelques exemples :<br />
I. // s'agit d'un mineur de 16 ans déclaré avoir agi avec discernement et<br />
ayant encouru la peine de la détention.
276<br />
Le Juge lui applique l'article 67, g 3 du Code Pénal,<br />
l'article 463.<br />
sans lui accorder<br />
Le minimum de détention dans une maison de correction qui pourra être<br />
infligé à ce mineur sera le 1/3 de 5 ,7 , 10 , 13 , etc.,<br />
20 ans (c'est-à-dire 20 ,26 mois 3 ans et 4 , mois, etc.); le maximum<br />
de détention dans une maison de correction qui pourra lui êlre infligé sera<br />
la 1/2 de 5 , 7 , 10 , 13 , etc., 20 ans (c'est-à-dire<br />
30 , 42 mois . . . 5 ans .<br />
.,<br />
. . 6 ans 1/2 .<br />
.,<br />
. .<br />
., etc., 10 . ans)<br />
Le Juge .lui<br />
Pénal.<br />
applique<br />
l'article 67, § 3, et l'article 463, g 7 du Code<br />
Le minimum de détention dans une maison de correction qui pourra être<br />
infligé à ce mineur sera le 1/3 de l'emprisonnement correctionnel de l'article<br />
401 du Code Pénal, c'est-à-dire le 1/3 de 1...... 2 , 3 , 4 ,<br />
5 ans (donc 4 8 mois 1 an ,16 mois , 20 mois) ;<br />
le maximum de détention, etc , sera la moitié (1/2) de l'empri<br />
sonnement correctionnel de l'article 401, c'est-à-dire la 1/2 de 1 ,<br />
2 , 3 , 4 , 5 ans (donc 6 mois — , 1 an — , 1 an 1[2 ....,<br />
2 ans 2 ans 1/2).<br />
S'il s'agit (et c'est facultatif) d'appliquer, en vertu des articles 67, g<br />
3 et<br />
463, g 7 du Code Pénal, l'amende de l'article 401 audit mineur, le minimum<br />
de l'amende applicable au mineur sera le 1/3 de 16 , 50<br />
100 , 140 , etc., 500 francs (c'est-à-dire 5 16 ,<br />
33 , 46 , etc., 166 francs) ; le maximum de l'amende appli<br />
cable au mineur sera la 1/2 de 16 ,50<br />
, 100 , 140 ,<br />
etc., 500_ francs (c'est-à-dire 8 , 25 , 50 , 70 etc.,<br />
250 francs).<br />
Il est en effet de jurisprudence que l'amende ne peut jamais descendre à<br />
des fractions de franc .<br />
II. Il s'agitd'un mineur de 16 ans déclaré avoir, avec discernement commis<br />
un outrage public à la pudeur ou une infraction à ^'article 11 (1°) de la loi du<br />
3 mai 1844 ou une infraction punie de travaux forcés à temps.<br />
Dans ces trois cas, l'article 68 le fait juger par le Tribunal correctionnel.<br />
Dans les deux premiers en vertu des articles 68 et 69, le minimum de<br />
l'amende correctionnelle qu'on peut lui infliger sera de 8 francs, soit une<br />
amende de simple police.<br />
Dansée 3e cas, si on lui refuse l'article 463 le minimum de détention dans<br />
une maison de correction sera en vertu de l'article 67, § 3 du Code Pénal<br />
le 1/3 de 5 .<br />
. . .<br />
, 7 ,9 12 , etc., 20 ans (soit 20 mois<br />
....,<br />
28 mois , eic.j 6 ans, 8 mois) le maximum de détention, etc., sera<br />
la 1/2 de 5 , 7 , etc., 20 ans (soit 30 mois 42 mois<br />
,<br />
etc., 10 ans).<br />
L. ARMANET,<br />
Juge à Sétif.
I. Algérie. — Mines. —<br />
Intervention.<br />
277<br />
CONSEIL D'ÉTAT<br />
Il janvier 1878.<br />
Autorisation de recherches. — Incompétence<br />
neur général.<br />
— II. Recevabilité. — III.<br />
du Gouver<br />
I . Il n'appartientpas au Gouverneur général de l'Algérie d'intervenir devant<br />
le Conseil d'Etat pour défendre au recours formé contre un de ses arrêtés (1).<br />
//. Les propriétaires du sol d'une mine sont recevables à attaquer pour excès<br />
depouvoir, l'arrêté accordant à des tiers, autorisation de recherches sur le même<br />
terrain.<br />
III. Lesrecherches pour découvrir les mines, à défaut de consentement des pro<br />
priétaires du sol, ne peuvent être autorisées que par le gouvernement ; aux<br />
termes de la loi du 21 avril 1810, déclarée applicable à VAlgérie par la loi<br />
du 16juin 1851,<br />
sur les demandes de recherches.<br />
il doit être statué par décret du Président de la République<br />
Aucune disposition particulière n'a délégué à cet effet au Gouverneur général<br />
de l'Algérie les pouvoirs du chef de l'Etat ; conséquemment l'arrêté par le<br />
quel le Gouverneur général de l'Algérie a autorisé des recherches de mines,<br />
excède les pouvoirs de ce fonctionnaire et doit être annulé.<br />
Badaroux el autres c. le Gouverneur général de l'Algérie.<br />
En ce qui touche le mémoire en intervention présenté au nom du Gou<br />
verneur général de l'Algérie ; — Considérant<br />
qu'il n'appartient pas au Gou<br />
verneur général de l'Algérie d'intervenir devant le Conseil d'État pour dé<br />
fendre au recours formé contre son arrêté du 18 août 1875 ;<br />
— Sur le défaut de qualité opposé aux sieurs Badaroux et consorts"; Consi<br />
dérant que les sieurs Badaroux et consorts produisent un acte notarié en dale<br />
du 7 juillet 1874, par lequel divers indigènes leur ont vendu des terrains sur<br />
lesquels les sieurs Conzalvès et consorts ont été autorisés à effectuer des<br />
recherches de mines ; qu'ils produisent, en outre, plusieurs jugements par<br />
lesquels le cadi de la 17* circonscription et le tribunal civil d'Oran ont rejeté<br />
des actions en revendication dirigées contre eux et leurs auteurs où ont donné<br />
acte du désistement des demandeurs; qu'enfin lesdits sieurs Badaroux et con<br />
sorts agissant comme propriétaires du sol , ont effectué eux-mêmes des recher<br />
ches de mines et ont demandé, à la suite du 23 septembre 1874, la concession<br />
du gisement souterrain ; que, dans ces circonstances et alors même que d'au-<br />
(1) Voir au Bull. jud. 1878, p. 1,,<br />
l'arrêté rendu par le Conseil d'État le 11<br />
mai 1877, dans une espèce identique (aff. Jumel de Noireterre c. Comp. de Mokta-<br />
el-Haddid) .
278<br />
très contestations seraient encore pendantes,<br />
au sujet de la propriété des<br />
terrains dont il s'agit, les sieurs Badaroux et consorts sont recevables à atta<br />
quer, pour excès de pouvoir, l'arrêté du Gouverneur général accordant<br />
autorisation de recherches aux sieurs Gonzalvès et consorts ;<br />
Au fond: —<br />
Considérant<br />
qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 21 avril<br />
1810, que les recherches pour découvrir des mines, à défaut de consentement<br />
des propriélaires du sol, ne peuvent être autorisées que par la gouvernement ;<br />
qu'ainsi il doit être statué par décret du Président de la République ; que la<br />
loi du 21 avril 1810,<br />
juin 1851 et qu'aucune disposition particulière n'a délégué pour l'Algérie, au<br />
.Gouverneur général,<br />
a élé déclarée applicable à l'Algérie par la loi du 16<br />
les attributions qui, en France, appartiennent au chef<br />
de l'État, en vertu de l'article précité de la loi du 21 avril 1810 ; qu'il suit de<br />
là que, par l'arrêté attaqué, en autorisant les sieurs Domingo Gonzalvès et<br />
consorts à exécuter des recherches de mines à Ain-Zeft, le Gouverneur géné<br />
ral de l'Algérie a excédé ses pouvoirs ;<br />
Arrête : L'arrêté du Gouverneur général, en date du 18 août 1875,<br />
demeure annulé .<br />
M. de Saint-Laumer, rapp.; M. Laferrière, comm. du Gouv.;<br />
MM« Dareste et Nivard, av.<br />
Séparation de biens, —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, 1" Président.<br />
Exécution<br />
26 mars 1878.<br />
du jugement, —<br />
Action des créancière.<br />
est et<br />
Fraude. —<br />
Lorsqu'à la suite d'un jugement prononçant une séparation de biens, la<br />
femme a poursuivi, il est vrai, dans la quinzaine, devant un notaire la liqui<br />
dation de ses reprises, mais que la manière même dont il a été procédé à cette<br />
liquidation, l'absence de contradiction sérieuse, l'inaction inexplicable que la<br />
femme aurait gardée dans la mise à exécution du jugement par elle obtenu,<br />
sont de nature à faire présumer un concert établi entre les deux époux, en<br />
fraude des droits des créanciers, ceux-ci sont fondés à demander la nullité<br />
de la séparation de biens prononcée, et au cas de décès d'un des époux, de<br />
provoquer une liquidation nouvelle des reprises de la femme (1).<br />
(1) Voir,<br />
quant à l'application de l'art, 1444 du Code civil relatif à la non-<br />
exécution du jugement prononçant une séparation de biens, Alger, 31 mars 1858<br />
(Robe, 1859, p. 193). Cass., 28 déc. 1858 (J. du Pal, 1859, p. 938). Cass., 14 mars<br />
1859 (J. du Pal, 1859, p. 559). Rouen, 31 janv. 1863 (/. du Pal., 1863, p. 900).<br />
Alger, 19 fév. 1867, (Robe, 1868, p. 32). Paris, 2 mars 1877 (J. du Pal., 1877,<br />
p. 1,006). Angers, 5janv. 1877 (J. du Pal., 1877, p. 1,278) et Bordeaux, 7 nov.<br />
1877 (/. du Pal.,-<br />
p. 1878, 337).
279<br />
Veuve Bruat c. consorts Fabre.<br />
Attendu que les consorts Fabre ont demandé et obtenu la nullité do la<br />
séparation de biens prononcée par le jugement du 19 avril 1861 ;<br />
la veuve Bruat a interjeté appel pour faire maintenir, à son profil, le béné<br />
— Que<br />
fice de cette séparation de biens ;<br />
Attendu que le législateur s'armant en cette matière, de défiances légi<br />
times a soumis l'exécution du jugement de séparation de biens à des régies<br />
rigoureuses qui sont à la fois la preuve de la sincérité des griefs invoqués<br />
par la femme et une garantie pour les droils des tiers ;<br />
><br />
Attendu, en fait, que la dame Bruat a poursuivi dans la quinzaine, la<br />
liquidation de ses reprises mais que la manière même dont il a été procédé<br />
à cette liquidation, l'absence de loute contradiction sérieuse autorisent les<br />
suspicions dirigées par les consorts Fabre contre l'œuvre du notaire liquida<br />
ce procès-verbal de liquidation la dame Bruat est demeurée<br />
—<br />
teur; Qu'après<br />
dans une inaction absolue, ne manifestant par aucun acte de poursuite<br />
l'intention de ramener à exécution le jugement qu'elle avait obtenu ;<br />
Que loin de trouver sa justification dans les circonstances de la cause,<br />
cet arrêt des poursuites ne parait s'expliquer que par un concert établi entre<br />
la dame Bruat et son mari; Qu'en effel, il résulte des documents du procès,<br />
que si Bruat n'était pas précisément revenu à une meilleure fortune, cepen<br />
dant il avait fait certaines acquisitions sur lesquelles la dame Bruat avait<br />
prise el qu'elle a sciemment laissé échapper à son action ;<br />
—<br />
— Attendu<br />
qu'en prononçant dans ces la nullité de la séparation de biens et<br />
en ordonnant qu'il serait procédé à une liquidation nouvelle, nécessitée par<br />
le décès du sieur Bruat, les premiers juges ont fait une exacte apprécialion<br />
— des droits des parties; Adoptant, en conséquence, les motifs du Tri<br />
bunal ;<br />
— Rejette l'appel de la dame Bruat ; Confirme le jugement déféré pour<br />
— êlre exécuté dans sa forme et teneur ; Condamne la dame Bruat à l'a<br />
mende et en tous les dépens.<br />
M. de Vaulx, subst. du Proc. gén.;M" Chéronnet, RoBEetCHABERT-MoREAU, av.<br />
KniphJ'tèoee .<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />
— Caractères<br />
8 avril 1878.<br />
spéciaux. — Bail<br />
avec le domaine,<br />
L'emphytéose a pour caractère essentiel,<br />
à long ternie<br />
qui lui sert de type et qui le dis<br />
tingue du bail ordinaire, qu'elle transmet au preneur un droit réel, un quasi-
280<br />
domaine qui lui permet de disposer d'une manière absolue sinon de l'immeuble<br />
emphytéosé,<br />
du moins du droit conféré par l'emphyléose .<br />
Peu importe donc qu'un bail renferme les autres conditions que présente<br />
habituellement l'emphytéose, le terme de longue durée, la modicité de la re<br />
devance, la condition d'améliorer le fonds,<br />
si ce bail n'opère pas par la<br />
translation de ce quasi-domaine, un véritable démembrement de la propriété ,<br />
il ne saurait être considéré comme un bail emphytéotique .<br />
Il en est ainsi lout spécialement lorsque le bail contient interdiction de sous-<br />
louer ou de céder sans le consentement du bailleur (1).<br />
Préfet d'Alger c, Cervera.<br />
Attendu que la solution du litige dépend exclusivement de la question de<br />
savoir si le sieur Tordieu avait contracté avec l'Élat un bail emphytéotique<br />
et s'il était par suite investi d'un droit réel, jus in re, susceptible d'hypo<br />
thèque et d'expropriation ;<br />
Attendu que sans qu'il soit besoin de remonter à l'origine de l'emphy<br />
téose, ni de rechercher ses diverses transformations, sans qu'il faille non<br />
plus examiner si elle est encore au nombre des dénombrements de la pro<br />
priété autorisés par noire législation, il suffit pour la Cour de constater un<br />
état général de la doctrine et delà jurisprudence auquel elle donne sa pleine<br />
—<br />
adhésion; Attendu que le caractère essentiel de l'emphytéose, celui qui<br />
lui sert vraiment de type et qui la distingue du bail ordinaire, c'est qu'elle<br />
transmet au preneur un droit réel et pour employer l'expression de la Cour<br />
suprême, un quasi-domaine qui lui permet de disposer d'une manière ab<br />
solue sinon de l'immeuble emphytéosé, du moins du droil conféré par l'em<br />
—<br />
phytéose ; Que le long terme i assigné au bail, la modicité de la redevance,<br />
la condition d'améliorer ce fonds sont des conditions habituelles de l'em<br />
la loi Belge,<br />
phytéose, mais non pas des traits caractéristiques —<br />
; Qu'ansi<br />
s'inspirant de notre jurisprudence, qu'elle a heureusement résumée dans<br />
un texte,<br />
définit l'emphytéose : « Un droit réel qui consiste à avoir la pleine<br />
« jouissance d'un immeuble, appartenant à autrui, sous la condition de lui<br />
« payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature,<br />
« naissance de son droit de propriété, » — Attendu<br />
en recon-<br />
que c'est, à la lumière<br />
de ces principes, qu'il convient d'apprécier les conventions arrêtées entre<br />
les parties ;<br />
Attendu qu'il est intervenu successivement entre l'État et le sieur Tordieu,<br />
deux conventions relatives an même immeuble, la première à la date du<br />
31 août 1862, la seconde à la date des 2 octobre el 17 novembre 1868 ;<br />
Qu'il est à remarquer d'abord, que dans ces deux contrats préparés par<br />
l'administration des Domaines, le mot d'emphytéose n'est jamais prononcé el<br />
que lout au contraire, les expressions employées sont celles de bail et de<br />
location;— Qu'en analysant les clauses de la condition du 31 août 1862,<br />
on constate l'existence d'un contrat qualifié de bail, fait pour 18 années,<br />
avec interdiction au preneur de sous-louer ou de céder, avec réserve ex-<br />
(1) Conf. Grenoble, 4 janv. 1860 (J. du Pal,, 1860,<br />
p. 901 et la note).<br />
—
281<br />
— presse des règles ordinaires applicables aux baux ; Qu'il est ainsi mani<br />
feste que cette première convention, dans laquelle ne se rencontrent ni le<br />
caractère essentiel de l'emphytéose, ni même les conditions habituelles de ce<br />
— contrat ne constitue qu'un bail ordinaire ; Que la convention des 2<br />
octobre et 17 novembre 1868 qui a succédé à celle de 1862 n'est que la pro<br />
rogation de celle-ci, ainsi que cela résulte formellement de l'intitulé el du<br />
préambule de l'acte; —<br />
Que<br />
si la durée du bail est prorogée de 18 années<br />
à 99 ans, la nature du conlral n'est pas modifiée, puisqu'on prend soin d'y<br />
rappeler les clauses de la convention précédente et notammenl l'interdiction<br />
de sous-louer et de céder, ainsi que l'application des règles ordinaires des<br />
— baux ; Qu'il suit de là, que pas plus dans la seconde convention que dans<br />
la première le preneur n'est investi de ce quasi-domaine qui lui permettrait<br />
— de disposer du droit à lui confié ; Qu'ainsi le preneur n'a de par la con<br />
vention, qu'un droit personnel insusceplible d'hypolhèque et d'expropria<br />
;'<br />
tion et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme une emphytéole<br />
Que les premiers juges, en repoussant l'action du Domaine, ont donc<br />
inexactement interprété les conventions et mal apprécié les droils des<br />
parties ;<br />
Par ces motifs : LA COUR en donnant défaut contre Tordieu non compa<br />
rant bien que régulièrement assigné ;<br />
— Reçoit l'appel interjeté au nom de<br />
l'Étal et y faisant droit ;<br />
— Infirme le jugement déféré ;<br />
— Déclare nulle<br />
et irrégulière la saisie immobilière pratiquée par le sieur Fourrier ;<br />
—<br />
— Dé<br />
— Ordonne,<br />
clare recevable et bien fondée l'aclion en distraction de l'État ;<br />
en conséquence, que les droits aux baux sus-visés, compris à tort dans la<br />
saisie immobilière du 23 novembre 1874 seront distraits de la dite saisie et<br />
— de la vente pour saisie. à la requête de Fourrier; Ordonne quant à ce,<br />
la radiation de la dite saisie avec mention en marge de tous actes et procès-<br />
verbaux, enregistrés et transcrits au présent arrêt ;<br />
- Condamne aux dépens<br />
de première instance et d'appel les parties de M«s Carrière et Chéronnet.<br />
M. Cuniac, subst. du Proc. gén.; Mes Gahau, Robe et Chéronnet, av.<br />
Servitudes. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lreCh.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
15 mai 1878.<br />
Vues. — Ouvertures. —<br />
Construction»<br />
indi<br />
gènes. — Destination du père de famille. — Fait du prince.<br />
— — Prescription,<br />
Reconstruction de l'immeuble.<br />
On ne saurait considérer comme un simple jour de souffrance, une ouverture<br />
pratiquée dans une maison mauresque, et présentant une largeur de quarante-<br />
cinq centimètres sur soixante centimètres de haut ;
282<br />
En effet, dans le système des constructions indigènes, une ouverture d'une<br />
telle dimension a le caractère d'une véritable fenêtre d'aspect, et on ne saurait<br />
lui enlever ce caractère en se fondant : 1° Sur ce qu'elle serait percée dans un<br />
mur d'une forte épaisseur, et 2° sur ce que dans le milieu de l'épaisseur de ce<br />
mur, seraient placés des barreaux de fer ou de bois, alors surtout que ces bar<br />
reaux auraient pour objet de parer aux dangers résultant du peu d'élévation du<br />
sol contigu (1);<br />
En conséquence, cette ouverture constitue une servitude continue et appa<br />
rente,<br />
susceptible de s'établir par la destination du père de famille et de s'ac<br />
quérir par la prescription ;<br />
Le principe posé dans l'article 694 du Code civil, aux termes duquel, si le<br />
propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de<br />
servitude,<br />
dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune.<br />
convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passi<br />
vement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, doit recevoir applica<br />
tion au cas où c'est un créancier du propriétaire qui fait, dans les mêmes condi<br />
tions,<br />
vendre l'immeuble sur poursuites de saisie immobilière : en effet en pour<br />
suivant cette vente, le créancier exerce en réalité les droits de son débiteur ;<br />
On doit appliquer le même principe lorsque les immeubles qui étaient la pro<br />
priété d'un seul individu, ont été séparés par le fait du prince (2) ;<br />
Une servitude de vue s'acquiert par la prescription trentenaire,<br />
encore lien<br />
que dans le cours des trente années servant à fonder cette prescription, il y ait<br />
eu reconstruction du mur dans lequel l'ouverture est pratiquée : seulement la<br />
partie contre laquelle la prescription est acquise, a le droit de demander que<br />
l'ouverture soit replacée dans les mêmes conditions de grandeur et de disposi<br />
tion, où elle se trouvait avant cette reconstruction (3) .<br />
Sakar Guedj c. Mustapha ben Ahmed.<br />
Altendu qu'il s'agit au procès de deux ouvertures existant dans le mur de<br />
la maison de la demoiselle Khadoudja bent Mohamed, l'une au rez-de-chaus<br />
— sée ou à l'entresol, l'autre au premier étage; Quête jugement dont est appel<br />
reconnail et constate que cette derrière constitue non un jour de souffrance,<br />
mais une fenêtre d'aspect el, par suite, une servitude continue et apparente,<br />
susceptible d'être établie par la destination du père de famille et acquise par<br />
(1)<br />
Au sujet de la distinction à établir entre les simples jours de souffrance et<br />
les vues constituant de véritables servitudes, et spécialement quant aux construc<br />
tions indigènes de l'Algérie, v. Alger, 29 juin 1872. '(Robe, 1872,<br />
p. 210 et la<br />
note). Cass. juillet 1874. Robe, 1875, p. 282) et Narbonne, Rép. v. Servitudes, nos 16<br />
et suiv. ,<br />
(2) Jurisp. Conf. Cass. 19 juin 1861 (J. du Pal, 1863, —<br />
3 juin 1858. (/. du Pal, 1859,<br />
p. 529).<br />
p. 531).<br />
Contra, Metz,<br />
(3) Conf. Cass,, 21 mai 1851 (J. du Pal, 1853, 1. p. 666), Bordeaux,<br />
1855 (/. du Pal., 1857, p. 204); Cass,, 25 juin 1866 (J, du Pal,, 1866,<br />
14 août<br />
p. 967).
283<br />
— la prescription ; Qu'il refuse ce caractère à l'ouverture inférieure et la<br />
considère comme un simple jour de souffrance ;<br />
Mais attendu qu'il résulte des contestations dudit jugement que cette ou<br />
verture a 45 centimètres de largeur sur une hauteur de 60 centimètres;<br />
— Que dans le système des conslruclions indigènes, une ouverture d'une<br />
— telle dimension a le caractère d'une véritable fenêtre d'aspect; Que vai<br />
nement, pour lui enlever ce caractère, on se fonde : 1° sur ce qu'elle est<br />
percée dans un mur de soixante centimètres d'épaisseur, circonstance indif<br />
férente; 2° Sur ce que dans le milieu de l'épaisseur du mur sont placés des<br />
— barreaux de fer et de bois : Que c'est là en effet, un système de protection<br />
imposé à l'habitant de la pièce éclairée par celle ouverture, par le peu d'élé<br />
vation de ladite ouverture au-dessus du sol du terrain contigu ;<br />
qu'il suit de là que les deux ouvertures, dont la suppression est demandée,<br />
— Attendu<br />
sont de même nalure et conslituent l'une et l'autre, des vues droites el par<br />
conséquent des servitudes continues et apparentes ;<br />
Attendu que l'appelant, tout en reconnaissant que les deux immeubles<br />
ont appartenu primitivement au même propriélaire Salah Bey, soutient<br />
néanmoins qu'il n'y a pas destination du père de famille, à l'égard des vues<br />
contestées, parce que la deuxième condition de l'article 693 fait défaut, du mo<br />
ment qu'il n'est pas prouvé que c'est Salah Bey qui a mis les lieux dans<br />
— l'étal dont on veut fait résulter les servitudes ; Qu'il repousse aussi la<br />
prescription trentenaire comme n'étant pas prouvée ;<br />
Attendu qu'il est vrai que l'article 693 du Code civil dispose qu'il n'y a<br />
destination du père de famille, que lorsqu'il est prouvé que c'est par le pro<br />
priétaire des deux fonds actuellement divisés, que les choses ont été mises<br />
dans l'état duquel résulte la servitude el que la preuve manque sur ce point ;<br />
mais que, au* termes de l'article 694, si le propriétaire de deux héritages<br />
entre lesquels il existe un signe apparent de servitudes, dispose de l'un des<br />
héritages sans que le conlrat contienne aucune convention relative à la ser<br />
vitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds<br />
—<br />
aliéné ou sur le fonds aliéné; Qu'il est de jurisprudence que le principe<br />
posé dans cet article, doit recevoir son application, au cas où c'esl un créan<br />
cier du propriétaire qui fait vendre sur poursuites de saisie immobilière et<br />
ce par le motif qu'en poursuivant la vente, le créancier exerce les droits de<br />
—<br />
son débiteur ; Qu'il en est de même, ainsi que cela a élé jugé par la<br />
Chambre des Requêtes, le dix-neuf juin 1861, lorsque les immeubles qui<br />
—<br />
étaient la propriété d'un individu ont été séparés par le fait du prince ;<br />
Que celte circonstance se rencontre dans la cause; qu'il est certain en effet,<br />
el n'est pas méconnu d'ailleurs, que l'État, après la prise de Constantine, en<br />
1837, dépossédant Salah Bey de l'un des deux immeubles conligus dont il<br />
s'agit au procès, et se substituant aux droils de celui-ci, a opéré la séparation<br />
des deux fonds sans apporter aucune modification aux règnes apparents de<br />
—<br />
servitudes qui existaient en faveur de l'un d'eux; Atlendu que c'est dans<br />
l'état où les choses étaient au moment de la séparation, qu'en 1876, l'im<br />
meuble qui est aujourd'hui la propriélé de l'appelant, lui a été adjugé;<br />
Qu'il importe donc peu qu'il ne soit pas prouvé que ce soit Salah Bey qui<br />
ait mis les choses dans l'état duquel résultent les servitudes ;<br />
Altendu au surplus, qu'il résulte de l'enquête que les ouvertures dont la<br />
—
284<br />
suppression est demandée existent depuis plus de trente ans, antérieurement à<br />
— l'action de l'appelant; Que les servitudes qu'elles constituent sont donc,<br />
en tous casr acquises par la possession trenlenaire, aux termes de l'article<br />
— 690 du Code civil ; Attendu qu'il importe peu, relativement à la fenêtre<br />
du premier étage, qu'il y ail eu reconstruction depuis moins de trente ans,<br />
ainsi que cela parait résulter de l'enquêle, de la partie supérieure du mur<br />
— dans lequel se trouve cette fenêtre ; Qu'il est juste toutefois de réserver à<br />
l'appelant, comme l'a fait le jugement dont est appel, le droit de demander<br />
la remise de cette ouverture dans les conditions et proportions où elle se<br />
trouvait avant sa transforma'tion ;<br />
Altendu que la solution à laquelle s'arrête la Cour, repousse d'une ma<br />
nière absolue la demande en dommages-intérêts formée par l'appelant;<br />
Attendu que succombant dans toutes ses prétentions, Lakar Guedj<br />
condamné en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.<br />
—<br />
doit êlre<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qu'ils<br />
— n'ont pas de contraire au présent; Rejetant l'appel principal et faisant<br />
— —<br />
droit au contraire à l'appel incident; Confirme le jugement déféré :<br />
mal fondé dans sa demande en suppres<br />
1° En ce qu'il a déclaré Lakar Guedj<br />
sion de la fenêtre française existant dans le mur séparatif de son immeuble<br />
d'avec la maison de Khadoudja bent Mohamed, et a ordonné le maintien de<br />
celte fenêtre en réservant à Lakar Guedj le droit d'en demander la réduction<br />
dans les conditions et proportions où elle se trouvait avant sa transformation;<br />
— 2°<br />
En ce qu'il dit qu'il n'y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts ;<br />
Infirme au contraire ledit jugement : —<br />
—<br />
1° Dans la disposition qui a ordonné<br />
la suppression de l'ouverture de quarante-cinq centimètres de largeur sur<br />
soixante de hauteur, existant dans la partie inférieure du mur ;<br />
— 2°<br />
En ce<br />
—<br />
qu'il a mis un tiers des dépens à la charge de Khadoudja bent Mohamed ;<br />
Émendant quant à ce, ordonne le maintien de l'ouverture inférieure dans<br />
— les conditions où elle se trouve; Condamne l'appelant en tous les dépens<br />
de première instance et d'appel.<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; Mes F. Huré el Bouriaud, av.<br />
I. Créancier. —<br />
immeuble, —<br />
Notaire. —<br />
Responsabilité.<br />
Intervention.<br />
Succession.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
—<br />
—<br />
—<br />
29 novembre 1877.<br />
Partage.<br />
II.<br />
—<br />
Amélioration<br />
Aliéné. —<br />
Réserves.<br />
Curateur.<br />
d'un<br />
—<br />
III.<br />
/. Un créancier a droit d'intervenir dans tout acte où son débiteur figure à<br />
litre personnel, en vue d'exercer, le cas échéant, les droits et actions de ce débi<br />
teur;
285<br />
Lorsque postérieurement au décès du de cujus, un immeuble de la succession<br />
a été l'objet d'améliorations, si des sommes provenant d'un tiers ont été em<br />
ployées au paiement de ces améliorations, ce tiers a le droit d'intenter l'action<br />
de in rem verso et il doit la diriger, nonpoint contre l'adjudicataire du fonds,<br />
mais contre les co-licitants qui profitent tous de ces améliorations, par plus- la<br />
value qui en est résulté sur la quotité du prix d'adjudication ;<br />
Il est le créancier de tous les co-héritiers, proportionnellement à la part hé<br />
réditaire de chacun, et à ce titre, à l'encontre des créanciers de la succession qui<br />
sont investi d'un droit réel sur tous les objets ayant fait partie de cette succes<br />
sion, il est recevable à intervenir au partage, pour prévenir une collusion qui<br />
augmenterait en apparence la part des héritiers insolvables, au détriment de<br />
celle des héritiers solvables ;<br />
II. Une personne placée dans un asile d'aliénés ne saurait valablement<br />
donnerprocuration pour être représentée à des opérations de partage ; elle ne<br />
peut y être représentée que par un administrateur provisoire nommé conformé<br />
ment à l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838,<br />
ou par un notaire désigné suivant<br />
l'art. 36 de la même loi ;<br />
Il appartient aux Tribunaux, en vertu du pouvoir tutélaire dont ils sont in<br />
vestis à cet effet, de constater el de régulariser la situation dans laquelle un<br />
incapable doit figurer à des opérations de partage où il est intéressé, notam<br />
ment au point de vue d'un mandat plus ou moins explicite que l'administra<br />
teur provisoire chargé de représenter cet incapable aurait conféré à un liers ;<br />
III .<br />
Si les notaires ne figurent pas parmi les officiers ministériels qui peu<br />
vent, d'après l'art. 1031 du Code de pr. civ., être condamnés d'office aux dé<br />
pens, leurs actes, notamment au point de vue de la rétribution qu'ils peuvent<br />
ou non comporter , peuvent faire l'objet de réserves établies d'office en faveur<br />
des parties, surtout quand il s'agit d'actes dans lesquels le notaire n'a été que<br />
le délégué de la juridiction saisie.<br />
Veuve Gadot et Lapeyre c. Daniel et autres.<br />
— Sur l'intervention de Daniel ; Considérant que Daniel se présente à la<br />
liquidation comme exerçant les droits de son débiteur Lapeyre, en verlu de<br />
— l'article 1666 du Code civil ; Qu'il suffit donc que Lapeyre soit personnel<br />
lement partie à l'acte, pour que l'intervention de Daniel se trouve justifiée ;<br />
— Considérant<br />
que Lapeyre n'esl point intervenu à la liquidation unique<br />
ment pour autoriser sa femme co-partageante ; qu'à l'acte de partage, il a<br />
entendu faire des déclarations personnelles et contracter des obligations,<br />
notamment en reconnaissant que ces immeubles acquis en son nom étaient<br />
réellement la propriété de la famille Gadot ;<br />
Considérant que Daniel prétend que des sommes à lui soustraites par<br />
Lapeyre auraient été employées à améliorer les immeubles de l'hoirie Gadot<br />
—<br />
et qu'il pourrait ainsi intenter l'action de in rem verso ; Qu'en vain les<br />
appelants soutiennent que cette action ne pourrait être intentée que contre<br />
la veuve Gadot seule, comme adjudicataire sur licitation des immeubles
286<br />
— améliorés ; Que tous les co-licitants étant vendeurs des immeubles indivis,<br />
ils ont personnellement profité, par le prix obtenu, de la plus-value.qu'a<br />
— vaient pu valoir les immeubles licites ; Que si les créanciers d'une suc<br />
cession ne sont pas recevables à intervenir au partage, en vertu de l'art. 882<br />
du Code civil, parce qu'ils ont un droit réel sur tous les objets ayant fait<br />
partie de l'actif de la succession, le droit d'intervention. est consacré au profit<br />
des créanciers des héritiers ;<br />
Qu'il en est ainsi, notamment pour celui qui se prétend créancier à titre<br />
— égal de tous les héritiers ; Qu'il a, en effet, intérêt à prévenir une collu<br />
sion qui pourrait augmenter, eu apparence, la part des héritiers insolvables<br />
au détriment de celle des héritiers solvables ;<br />
— Que<br />
la plus-value immobi<br />
lière dont se prévaut Daniel, aurait été, selon lui, réalisée après la mort de<br />
— Gadol ; Qu'ainsi Daniel n'ayant jamais été créancier de Gadot, ne prétend<br />
pas être créancier de la succession, qui n'est que la continuation de la per<br />
—<br />
sonne du défunt ; Que sa créance n'a pu naître que contre chacun des<br />
héritiers personnellement, mais proportionnellement à leur part héréditaire ;<br />
— En ce qui concerne Anaïs Gadot : Considérant que, placée dans une<br />
maison d'aliénés, elle ne pouvait valablement donner procuration pour être<br />
—<br />
représentée à des opérations de partage ; Qu'elle ne pouvait y être repré<br />
sentée que par une administrateur provisoire , nommée conformément à<br />
l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838, ou par un notaire désigné, suivant<br />
l'art. 36 de la même loi, ce qui n'a pas eu lieu —<br />
; Considérant que lors du<br />
jugement du 21 juillet 1875, dont esl appel, la demoiselle Gadot n'était pas<br />
pourvue d'un administrateur provisoire, et qu'alors ce fut à bon droit que<br />
les premiers juges ont désigné un notaire, Me Chambige, pour représenter la<br />
demoiselle Gadot aux opérations de comple, partage et liquidation ;<br />
— Mais<br />
que, par jugement du tribunal de Constantine, rendu le 6 octobre 1876, sur<br />
requête de M. le Procureur de la République, le sieur Salmon a été nommé<br />
à Mlle —<br />
Gadol en qualité d'administrateur provisoire ; Que, dès lors, aux<br />
termes des articles 32 et 36 de la loi du 30 juin 1838. ce serait à l'adminis<br />
trateur provisoire qu'il appartiendrait actuellement de représenter la demoi<br />
—<br />
selle Gadot dans la liquidation à intervenir ; Mais que, devant la Cour,<br />
l'administrateur provisoire demande la confirmation pure et simple du juge<br />
ment, et, par conséquent, le maintien de Me Chambige pour représenter<br />
— la demoiselle Gadot aux opérations ; Que cette déclaration équivaut à un<br />
mandat donné à Me Chambige par l'administrateur, lequel a capacité suffi<br />
sante ;<br />
— Que,<br />
même en l'absence de conclusions spéciales des parties, il<br />
appartient à laCour de constater et de régulariser la situation, en vertu du<br />
pouvoir tutélaire des tribunaux et quand il s'agit d'arriver au règlement des<br />
droits d'un incapable ;<br />
Adoptant, en outre, sur tous les points, les motifs des premiers juges ;<br />
En ce qui concerne Me — C. . . : Considérant qu'il résulte des motifs adop<br />
tés par la Cour du jugement dont est appel, qu'ils commis des fautes lourdes<br />
dans l'accomplissement du mandat que la justice lui avait confié et qu'elle<br />
— Que dans l'établissement des comptes des<br />
s'est vue obligée de lui retirer ;<br />
parties, il a négligé les justifications nécessaires, et qu'il a préparé un projet<br />
— de liquidation préjudiciable aux droils de la co-parlageante aliénée ; Que<br />
si les notaires ne figurent pas parmi les officiers ministériels qui peuvent être
287<br />
condamnés d'office aux dépens, d'après l'article 1031 du Code de procédure,<br />
leurs actes, notamment au point de vue de la rétribution qu'ils peuvent ou<br />
comporter, doivent faire l'objet de réserves établies d'office en faveur des<br />
parties, surtout quand il s'agit d'actes dans lesquels le notaire n'a été que le<br />
délégué de la juridiction saisie ;<br />
Par ces motifs: Confirme; Dit que M« Chambige représentera, comme<br />
mandataire de l'administrateur provisoire, la demoiselle Gadot aux opérations<br />
— à intervenir; Dit que si le sieur Salmon venait à révoquer ce mandat, il<br />
serait tenu de représenter lui-même et sur sa responsibilité la demoiselle<br />
— Gadot auxdiles opérations ; Réserve aux parties les droits qu'elles peuvent<br />
avoir contre Me — C. .<br />
., au sujet de ses frais et honoraires ; Condamne les<br />
appelants à l'amende et aux dépens d'appel.<br />
M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ; MMes Chabert-Moreau, Mallarmé<br />
I. Compétence . — Tribunaux<br />
el Lépiney, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2«Ch.)<br />
Présidence de M. FAVRE, conseiller.<br />
personnel. — — Étrangers,<br />
13 avril 1878.<br />
de commerce . — II . Statut<br />
Communauté.<br />
—<br />
Tutelle.<br />
/. Les Tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des questions<br />
de statut personnel qui peuvent être soulevées devant eux ;<br />
II. En conséquence, lorsqu'un tribunal de commerce est saisi d'une demande<br />
dirigée contre une veuve, tant en son nom personnel, comme ayant été commune<br />
en biens, que comme tutrice de ses enfants mineurs, si la défenderesse soutient<br />
*<br />
qu'en qualité d'étrangère, les règles de ta loi française sur la communauté<br />
légale et la tutelle ne sauraient lui être applicables, le Tribunal a le droit de<br />
renvoyer d'office les parties devant les tribunaux ordinaires pour y faire juger<br />
toutes questions préjudicielles, et en l'état, il doit surseoir à l'examen du<br />
fond (1).<br />
Calcutyc veuve Ramond.<br />
Atlendu que Joseph Ramond, ancien épicier à Koléa, y est décédé le cinq<br />
mars 1866 ;<br />
— Atlendu<br />
que Calcuty el Mikalef, demeurés créanciers de celui-<br />
(1) Cass. 13 juin 1808. Nîmes, 9 mai 1809. Rennes, 24 mai 1820. Conf. cass.,<br />
!«■<br />
juin 1842 (/. du Pal, 1842, 2, p. 351 et la note). Rép. du J. du Pal. V.<br />
Compétence commerciale, n°s 645 et suiv.
288<br />
ci pour fournitures faites à son magasin ont, le huit juin 1877, assigné de<br />
vant le Tribunal de commerce d'Alger, en paiement de la somme de 2,417<br />
fr. 70 c. la veuve Ramond tant en son nom personnel, comme ayant élé com<br />
mune en bien, que comme tutrice de ses enfants —<br />
mineurs; Attendu que<br />
la demande de Calcuty et Mikalef ainsi formulée, onze ans après le décès de<br />
Ramond, implique nettement leur intention d'actionner les héritiers Ramond<br />
en paiement d'une dette de la succession ;<br />
Atlendu qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure, de sembla<br />
bles actions ne peuvent être portées devant les Tribunaux de commerce,<br />
qu'autant que les qualités d'héritiers ne sont pas contestées;<br />
Attendu que la veuve Ramond a soutenu devant les juges consulaires<br />
qu'elteétait espagnole, veuve d'espagnol, et comme telle soumise à son statut<br />
personnel ; que mariée sans contrat de mariage, les règles de la communauté<br />
légale telles qu'elles existent en France ne pouvaient lui être appliquées ;<br />
Attendu en ce qui concerne ses enfants mineurs, qu'elle a soutenu égale<br />
ment, qu'aux termes du traité international Franco-Espagnol, les tutelles en<br />
Algérie appartiennent aux agents consulaires d'Espagne et qu'elle ne peut<br />
être actionnée devant les Tribunaux français comme tutrice de ses enfants ;<br />
— Que du resle Ramond père n'ayant rien laissé à son décès, il n'avait pas<br />
été utile de recourir à la tutelle du consul ;<br />
Atlendu qu'en présence de pareilles conclusions qui nécessitent au préala<br />
ble la solution de questions de droits matrimoniaux et successoraux, le Tri<br />
bunal de commerce avait le devoir de renvoyer d'office les parties devant les<br />
Tribunaux ordinaires, pour y faire juger toutes questions préjudicielles et<br />
de surseoir à — l'examen du fond ; Attendu qu'à tort le Tribunal de<br />
statuant sur les constestations qui s'élevaient au sujet de laqualilé<br />
commerce,<br />
des héritiers,<br />
a débouté les demandeurs de leur action contre la veuve<br />
Ramond, ex-qualilé;<br />
Par ces motifs : Infirme le jugement dont est appel ;<br />
— Dit qu'il n'y a lieu<br />
à évocation, l'affaire n'étant pas en l'état ;<br />
— Renvoie les parties à se pouvoir<br />
ainsi qu'elles le jugeront convenable;<br />
tous les dépens.<br />
— Condamne<br />
Calcuty<br />
et Mikalef en<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén ; M" Jouyne et Dazinière, av.<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Prescriptions et péremptions. Guerre. —<br />
thécaire. —<br />
Renouvellement.<br />
—<br />
tions pendant le cours de la guerre,<br />
La<br />
Suspension.<br />
—<br />
Inscription hypo<br />
suspension des prescriptions et péremp<br />
qu'ont édicté les décrets des 9 septem<br />
bre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871, profite même aux<br />
inscrip-~<br />
tions hypothécaires dont le délai de renouvellement n'est expiré que depuis<br />
la fin de la guerre. (Aix, 14 déc. 1876. /. des avoués, 1877, p. 62).<br />
■ — Alger.<br />
Typ. A. Jourdan.
2e année. — 1er Octobre 1878. —<br />
N° 43<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />
LÉGISLATION<br />
LES LOIS, DECRETS ET ARRETES<br />
RELATIFS<br />
A LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE<br />
d'Octobre 1877 à Octobre 1878 (1)<br />
Ce travail est rédigé conformément au plan que nous avions déjà<br />
adopté l'an dernier . Nous<br />
pensons qu'il répond à la partie de notre<br />
programme, comprise dans le mot : Législation, et que les lecteurs du<br />
Bulletin judiciaire peuvent trouver un avantage réel à posséder ainsi<br />
classés par ordre chronologique, dans une ou deux livraisons au plus,<br />
tous les documents législatifs utiles d'une année, relatifs à l'Algérie,<br />
avec un renvoi précis au n°<br />
du Bulletin officiel qui les contient. Grâce<br />
à ce renvoi, on pourra retrouver facilement le texte intégral des<br />
actes que nous relatons seulement en substance .<br />
— 16 octobre 1877. Arrêté homologuant les opérations de la Commission<br />
d'enquête, relatives à l'application de la loi de 1873 dans le douar de Sefafa<br />
(arrondissement de Mostaganem) (1877, n° 163}.<br />
— 26 octobre 1877. Arrêté réunissant le douar-commune de Cherfa,<br />
distrait de la commune indigène de Sétif, à la commune mixte d'Aïn-Abessa<br />
(département de Constantine) (1877, n° 166).<br />
27 octobre 1877. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans les territoires indigènes de la commune d'Hennaya (arrondissement de<br />
(t) LeS chiffres qui suivent l'intitulé de chaque document, représentent, le pre<br />
mier l'année du Bulletin officiel, l'autre le numéro de la série générale comprise<br />
dans chacun des volumes de ce BuUetin.
290<br />
Tlemcen), et, dans la tribu des Oulad-Alâa (commune mixte de Tlemcen)<br />
(1877, n° 164).<br />
22 novembre 1877. —<br />
Arrêté<br />
instituant une Commission permanente<br />
chargée : 1° d'examiner, au point de vue de leur valeur littéraire, scienti<br />
fique et de leur utilité pour le pays, les ouvrages publiés sur l'Algérie ou<br />
pouvant l'intéresser à un litre quelconque ; 2° de soumettre des propositions<br />
sur la suite à donneraux demandes de subventions ou de souscriptions qui<br />
seront formulées par les auteurs desdils ouvrages (1877,<br />
30 novembre 1877. —<br />
Arrêlé<br />
n°<br />
1 97;.<br />
relatif aux boursiers indigènes près de<br />
l'École de médecine et de pharmacie d'Alger (1877,-n0 185).<br />
Vu le décret du 4 août 1857, instituant une École de médecine et de pharmacie<br />
— à Alger ; Considérant qu'il importe de développer chez les indigènes le, goût<br />
des études médicales en vue d'assurer les services médicaux à cette partie de la<br />
population; qu'il est nécessaire de leur donner, dans ce but, toutes les facilités<br />
de suivre les cours de l'Ecole de médecine, en augmentant le nombre des bourses<br />
— Sur la proposition de M. le Conseiller<br />
déjà concédées aux étudiants indigènes ;<br />
d'Etat. Directeur général des affaires civiles et financières,<br />
« Art. 1er. —<br />
Un<br />
ouvert chaque année, à Alger,<br />
concours pour l'obtention des bourses de l'État sera<br />
nos Établissements d'instruction publique.<br />
« Art. 2. —<br />
trois.<br />
« Art. 3. —<br />
Le<br />
Une<br />
entre les élèves indigènes qui fréquentent<br />
nombre des bourses à accorder chaque année est fixé à<br />
commission d'examen, composée : de l'Inspecteur de<br />
l'Académie d'Alger, d'un professeur de l'École de médecine, d'un professeur<br />
du Lycée, se réunira tous les ans, dans la première quinzaine du mois de<br />
juillet, pour procéder aux opérations du concours,<br />
ultérieurement déterminées.<br />
« Art. 4. —<br />
dont les épreuves seront<br />
Les candidats reconnus admissibles seront nommés boursiers<br />
de l'Étal et recevront, à ce litre, —<br />
une indemnité mensuelle de 100 fr.<br />
Les<br />
frais d'études seront directement payés par l'Administralion à l'Agent comp<br />
table de l'École de médecine.<br />
Arl. 5. —<br />
La dépense résultant de cette organisation sera supportée par<br />
le budget de l'Algérie. —<br />
Chapitre<br />
l'assistance hospitalière. »<br />
3 décembre 1877. —<br />
Décret<br />
1«, ressources spéciales,— Budget de<br />
déclarant authentiques pour cinq ans, à<br />
partir du Ie' janvier 1878, les tableaux de la population des départements,<br />
n°<br />
des arrondissements et des communes de l'Algérie (1877, 189).
3 décembre 1877. —<br />
Décret<br />
291<br />
créant la commune de Gueltar-el-Aïch,<br />
distraite de la commune du Kroub (département de Constantine) (1877,<br />
n°193).<br />
— 14 décembre 1877. Arrêté rattachant à la commune mixte de l'Oued-<br />
Fodda, six douars-communes distraits de la commune indigène de Milianah<br />
(1877, n» 195).<br />
14 décembre 1877. —<br />
Arrêté rattachant six douars-commnnes, distraits<br />
de la commune indigène de Médéa, à la commune mixte de Berrouaghia, qui<br />
portera le nom de Ben-Chicao (1877, n° 196).<br />
20 décembre 1877. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans l'ensemble des territoires indigènes de la commune de Boghar (1877,<br />
n°201).<br />
20 décembre 1877. -<br />
Décret<br />
déclarant d'utilité publique l'établissement<br />
d'un chemin de fer d'intérêt local de la station de la Maison-Carrée au vil<br />
lage de l'Aima (déparlement d'Alger) (1878, n° 131).<br />
Sur le rapport du Ministre des travaux publics, d'après les propositions du<br />
— Vu l'avant-projet présenté pour l'établis<br />
Gouverneur général civil de l'Algérie ;<br />
sement, dans le département d'Alger, d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de<br />
la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Aima ;<br />
— Vu les délibérations en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 4 mai et 10 juil<br />
let 1876, du Conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession<br />
du chemin de fer sus-mentionné ; — Vu les pièces de l'enquête ouverte en vue<br />
de la déclaration d'utilité publique de ce chemin ; ensemble l'avis de la commission<br />
spéciale d'enquête du 15 juillet 1875 et celui du Préfet, du 8 novembre —<br />
suivant;<br />
Vu les avis du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 7 et 14 septem<br />
Vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le Préfet d'Alger,<br />
bre 1876 ; —<br />
agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur -constructeur,<br />
demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que<br />
— le cahier des charges annexé y ; Vu les avis du Conseil général des ponts et<br />
chaussées, des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877 —<br />
; Vu l'adhésion du<br />
— Ministre de la guerre, du 17 août 1876 ; Vu la lettre du Ministre de l'intérieur,<br />
— du 24 mars 1877 ; Vu le titre IV de l'ordonnance du 1er octobre 1844, le titre IV<br />
delà loi du 16 juin 1851, et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859,<br />
la<br />
concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie ; — Vu<br />
loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du<br />
7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie —<br />
; Vu le décret du<br />
23 septembre 1875, sur l'organisation des Conseils généraux de —<br />
l'Algérie; Vu<br />
le décret du 30 juin 1876, qui attribue au Ministre des travaux publics la présen<br />
tation des projets de décret concernant les chemins de fer à établir en Algérie ; —<br />
Le Conseil d'Etat entendu,
.. Art.<br />
1«. —<br />
Est<br />
292<br />
déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin<br />
de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée,<br />
d'Alger à Oran, au village de l'Aima.<br />
sur la ligne<br />
« La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non<br />
avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de<br />
fer ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du<br />
présent décret.<br />
« Art. 2. —<br />
Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution<br />
de ce chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du<br />
12 juillet 1865 et et du décret du 7 mai 1874, qui rend celle loi exécutoire en<br />
Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la cenvention passée,<br />
le 31 août 1877, avec le sieur Joret,<br />
à celte convention.<br />
ainsi que du cahier des charges annexé<br />
« Les copies certifiées, de ces convention et cahier des charges, resteront<br />
annexées au présent décret.<br />
— « Arl. 3. Dans<br />
le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le che<br />
min sus-menlionné comme ligne d'intérêt général, l'État pourra se subroger<br />
aux droits et obligations qui résultent, pour le*<br />
département, des convention<br />
et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département<br />
les sommes qu'il aurait versées à litre de garanties d'intérêt,<br />
de ladite convention.<br />
« Art. 4. —<br />
Aucune<br />
en exécution<br />
émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en<br />
vertu d'une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, de<br />
concert avec le Gouverneur général de l'Algérie,<br />
des finances.<br />
et après avis du Ministre<br />
« En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme<br />
supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la<br />
dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploi<br />
tation du chemin de fer, et ce capital-aclions devra être effectivement versé,<br />
sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement<br />
qu'en argent.<br />
« Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant<br />
que les quatre cinquièmes du capital-actions aient élé versés et employés en<br />
achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de<br />
cautionnement.<br />
« Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obliga<br />
tions lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment<br />
justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les<br />
termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions<br />
anticipées devront êlre déposés, soit à la Banque de France, soit à la Banque<br />
de l'Algérie ou à la Caisse des dépôts el consignations, et ne pourront être
m<br />
mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du<br />
Gouverneur général de l'Algérie.<br />
« Art. 5. —<br />
Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation, com<br />
prenant les dépenses de premier établissement el d'exploitation et les receltes<br />
brutes sera remis, tous les trois mois, au Gouverneur général de l'Algérie,<br />
qui l'enverra au Ministre des travaux publics pour êlre inséré au Journal<br />
officiel. »<br />
CONVENTION<br />
« L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trente-un aoûl,<br />
« Enlre :<br />
« Le Préfet du département d'Alger, agissant au nom du département, en<br />
vertu des délibérations du Conseil général, en date des 26 octobre 1875,<br />
2 mai, 10 juillet 1876, et sous réserve de l'application des présentes par qui<br />
de droit,<br />
« D'une part,<br />
« Et M. Pierre-François-Henri Joret, ingénieur-constructeur, demeurant<br />
à Paris, 80, rue Taibout,<br />
« D'autre pari,<br />
« II ai élé convenu ce qui suit :<br />
« Art. Ier —<br />
Le<br />
Préfet du département d'Alger,<br />
en vertu des pouvoirs<br />
résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret qui<br />
accepte, le chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima .<br />
« Art. 2. —<br />
La<br />
durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans<br />
l'article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans qui commenceront à<br />
courir à l'expiration du dix-huitième mois qui suivra le décret de ratification<br />
de la présente convention.<br />
— « Art. 3. M. Joret s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls el aux<br />
clauses el conditions du cahier des charges ci-annexé (n 1 et 1 bis) le che<br />
min de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, dans le délai de dix-huit mois, à<br />
partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.<br />
« Le chemin sera exécuté successivement par sections, en conformité des<br />
projets approuvés par le Préfet el pour chacune des sections. Toulefois, il<br />
pourra être introduit en cours d'exéculion des modifications de détail, soit<br />
sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du Préfet, et après appro<br />
bation de la Commission départementale.<br />
« Les projets de tous les travaux à exécuter devront, d'ailleurs, êlre dressés<br />
et présentés à l'approbation du Préfet,<br />
en conformité des dispositions du<br />
cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant êlre entrepris pour<br />
l'élablisse-<br />
ment du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisaiion préfec<br />
torale.
« Art. 4. ■-<br />
294<br />
Le concessionnaire s'engage à construire el à exploiter chaque<br />
section dans un délai de 18 mois, à partir du jour où,<br />
les projets, le Préfet donnera l'ordre de commencer, les travaux.<br />
après avoir approuvé<br />
« Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les<br />
plans et profils dos projets définitifs approuvés par le Préfet.<br />
« Art. 5. —<br />
Le<br />
Préfet du département d'Alger s'engage,<br />
au nom du<br />
même département, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la<br />
présente concession, un minimum d'intérêt de six francs pour cent francs<br />
par an, amortissement compris, sur le capital employé parle concessionnaire<br />
à l'exécution des travaux du chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, et<br />
dont le coût esl fixé à forfait à la somme de trois millions huit cent mille<br />
francs (3,800,000 fr.), sans toutefois que l'intérêt garanti puisse en aucun<br />
cas excéder la somme de deux cent vingt-huit mille francs (228,000 fr.).<br />
■ La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du<br />
premier trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation totale ou<br />
partielle de la ligne,<br />
ploités.<br />
proportionnellement au nombre de kilomètres ex<br />
« A cet effet, dans les deux premiers mois de chaque semestre, le conces<br />
sionnaire devra fournir au Préfet un compte détaillé des recettes etdes<br />
dépenses de l'exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent.<br />
Le comple sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du<br />
contrôle.<br />
« Pour l'évaluation du revenu net garanti, les frais d'exploitation seront<br />
établis à fortait ainsi qu'il suit, par rapport aux receltes brutes constatées:<br />
« Au-dessous de 1 1 ,000 fr. de recettes brutes 7,000 fr. somme fixe ;<br />
De 11,000 à 12,000 fr. 64 0/0 sans excéder 7,440 fr.<br />
De 12.000 à 13,000 fr. 62 0/0 sans excéder 7,800 fr.<br />
De 13,000 à 14,000 fr. 60 0/0 sans excéder 8,120 fr.<br />
De 14,000 à 15,000 fr. 58 0/0 sans excéder 8,400 fr.<br />
De 15,000 à 16,000 fr. 56 0/0 sans excéder 8,640 fr.<br />
De 16,000 à 20,000 fr. 55 0/0 sans excéder 10,400 fr.<br />
Au-delà de 20,000 fr. 52 0/0.<br />
« En conséquence, après avoir établi le monlant des recettes brutes, on<br />
en déduira les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et l'on obtiendra<br />
ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la<br />
différence sera payée par le département au concessionnaire; si au contraire<br />
le revenu net atteint ou dépasse ce minimum, il ne sera rien dû au conces<br />
sionnaire par le département. Après quatre années d'exploitation de la ligne<br />
entière, les frais d'exploitation seront fixés définitivement par le Conseil<br />
général, le concessionnaire entendu.<br />
■ Il est entendu que, dans lès dépenses, seront compris les intérêts et les
295<br />
avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux<br />
frais de l'exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis, en<br />
attendant le payement par le déparlement. Cel intérêt ne pourra dépasser<br />
le six pour cent.<br />
« Toutefois, ne sont pas compris dans les frais annuels, l'intérêt el l'amor<br />
tissement des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour<br />
l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par le<br />
déparlement.<br />
« Le Préfet pourra faire contrôler les éléments du comple sur lous les<br />
registres el pièces de l'exploitation, qui devront êlre communiqués, sans<br />
déplacement,<br />
aux personnes qu'il désignera.<br />
« Le règlement définitif de chaque compte semeslriel de la garantie sera<br />
arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes el<br />
des dépenses du même semestre.<br />
« Dans le cas où celte garantie deviendrait effective, les sommes versées à<br />
ce tilre par le département au concessionnaire seronl remises, à lilre<br />
d'avances remboursables parle concessionnaire,<br />
aussitôt que le revenu net<br />
excédera huit pour cent. La moitié de cet excédant, dans quelque année que<br />
cel excédant se produise, sera affectée à l'exlinction du compte avancé,<br />
l'autre moitié restant au concessionnaire.<br />
Pour rendre effective la garantie dont il esl parlé ci-dessus,<br />
le gouvernement autorise l'inscription sur les litres qui pourront être émis,<br />
de la garantie du département pour le payement des intérêts. Les intérêts<br />
« Art. 6. —<br />
garantis ne pourront, dans aucun cas dépasser le chiffre d'estimation à forfait<br />
fixé par la présente convention, el ne seront dus que proportionnellement à<br />
l'avancement des travaux après la réception provisoire et la mise en exploi<br />
tation de chaque section.<br />
— o Art. 7. Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la<br />
base de 1/20 du forfait des dépenses de la ligne concédée, lequel sera versé<br />
aussitôt après le décret d'utilité publique. Ce cautionnement sera ultérieu<br />
rement remboursé au concessionnaire dans les termes de l'article 67 du<br />
cahier des charges.<br />
« Art. 8. —<br />
droit,<br />
Dans le cas de la non approbation des présentes par qui de<br />
les parties contractantes n'auront -à exercer aucun droil à indemnité<br />
respectivement l'une contre l'autre.<br />
« Art. 9. —<br />
Les frais d'enregistrement de la présente convention et du<br />
cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe de trois<br />
francs,<br />
et ils seront à la charge du concessionnaire.<br />
« Fait double à Alger, le trente-un août mil huit cent soixante-dix-sept.<br />
« Lu et approuvé :<br />
» Lu et approuvé : « Le Préfet,<br />
• Signé : H. Joret. « « Signé : Brunel.
296<br />
Suit le texte du cahier des charges annexé à la convention.<br />
27 décembre 1877. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans les douars Arb-Filfila et Mellila (arrondissement de Philippeville)<br />
(1877, n« 202).<br />
29 décembre 1877. —<br />
brement de 1876,<br />
munes de l'Algérie (1877, n° 191).<br />
31 décembre 1877. —<br />
Arrêté modifiant, d'après les résultats du dénom<br />
la composition des conseils municipaux de diverses com<br />
nistration départementale en Algérie (1877, n»<br />
Arrêté<br />
Vu la loi de finances du 20 décembre 1872,<br />
fixant les cadres du personnel de l'Admi<br />
208) (1).<br />
qui a déterminé le taux du traitement<br />
la décision impériale du<br />
attribué à chacun des trois Préfets de l'Algérie ;<br />
— Vu<br />
13 novembre 1858, fixant les traitements des Sous-Préfets algériens ; ensemble le<br />
décret du 27 juillet 1875 qui a créé, dans la colonie, une quatrième classe de Sous-<br />
Préfets ; — Vu la décision impériale du 19 décembre 1868,<br />
divisant en deux classes<br />
— les Secrétaires généraux de préfecture en Algérie ; Vu l'arrêté du Gouverneur<br />
général du 9 février 1863, portant fixation du cadre normal et classification des<br />
Conseillers de préfecture en Algérie ; ensemble le décret du 25 mars 1865, qui a<br />
— élevé de 10 à 13 le nombre de ces fonctionnaires; Vu l'arrêté du Gouverneur<br />
général du 30 décembre 1876, déterminant les classes et le traitement dans chaque<br />
classe des Administrateurs de communes mixtes et de leurs adjoints ; — Vu le<br />
décret du 21 décembre 1861, le règlement du 16 avril 1862, et les arrêtés des<br />
12 janvier 1874, 18 août 1875 et 12 décembre 1876, sur le personnel des employés<br />
de l'administration départementale de l'Algérie; ensemble les arrêtés des 11 juin<br />
1870, 10 mars 1876, et la décision du 15 octobre 1877, concernant les bureaux civils<br />
des divisions et subdivisions ;<br />
— Vu l'arrêté du 17 avril 1863, la décision du<br />
24 mai 1869, l'arrêté du 22 février 1874 et la circulaire du 1er décembre 1875,<br />
— relatifs à l'examen d'admissibilité au grade de commis principal ; Considérant<br />
qu'il est indispensable, dans l'intérêt du service, de constituer les cadres du per<br />
sonnel des fonctionnaires et des employés de l'administration départementale de<br />
l'Algérie ;<br />
— Sur<br />
affaires civiles et financières ;<br />
« Art. 1er. —<br />
les propositions du Conseiller d'Etat, Directeur général des<br />
— Le<br />
Conseil du Gouvernement entendu,<br />
Les cadres du personnel des fonctionnaires de l'Administra<br />
tion départementale de l'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :<br />
— (Loi<br />
« 3 Préfets : 1 (Alger) à 25,000 fr.,— 2 (Oran et Constantine) à 20,000 fr.<br />
de finances du 20 décembre 1872)<br />
■ 12 Sous- Préfets : 3 de 1 classe ; 3 de 2 classe ; 3 de 3m« classe<br />
et 3 de 4me classe 12<br />
« 3 Secrétaires généraux de Préfecture : 1 de l*e classe ; 2 de<br />
2m* classe 3<br />
(1) Cet arrêté porte, par suite d'une inadvertance évidente, dans le volume du<br />
Bull. off. de 1877, le n" 1 au lieu du n» 208 qui lui appartient.<br />
3
297<br />
« 13 Conseillers de Préfecture : 4 de 1« classe; 4 de 2ra« classe et<br />
5 de 3">« classe , 13<br />
• 30 Administrateurs de communes mixtes : 6 de lre classe;<br />
10 de<br />
2mc classe et 14 de 3rae classe 30<br />
« 30 Adjoiuls aux Administrateurs de communes mixtes : 6 de<br />
1" classe ; 10 de 20>e classe et 14 de 3me classe 30<br />
« Total 91<br />
« Sauf en ce qui concerne les Préfets, la classe est inhérente à la personne<br />
et non à la résidence.<br />
« Art. 2. —<br />
Sont fixés comme il suit les cadres du personnel appartenant<br />
aux préfectures, aux sous-préfectures et aux bureaux civils des divisions el<br />
des subdivisions :<br />
I. PRÉFECTURES<br />
« Chefs de bureau 15<br />
« Sous-Chefs de bureau 15<br />
« Commis principaux 21<br />
« Commis rédacteurs ou vérificateurs 47<br />
« Commis expéditionnaires 42<br />
« Surnuméraires appointés ou commis auxiliaires . 7<br />
« Surnuméraires non appointés 8<br />
II . SOUS-PRÉFECTURES<br />
« Secrétaires de sous-préfectures 12<br />
« Commis rédacteurs ou vérificateurs 12<br />
« Commis expédiliounaires 6<br />
« Khodjas (secrétaires indigènes) 12<br />
III. BUREAUX CIVILS DES DIVISIONS<br />
« Chefs de bureau. 3<br />
« Commis principaux , 3<br />
« Commis rédacteurs 3<br />
o Commis expéditionnaires 5<br />
« Sous-Chefs de bureau,<br />
IV. CIVILS DES SUBDIVISIONS<br />
dirigeant le bureau 9<br />
« Commis rédacteurs 9<br />
« Art. 3. —<br />
Ce<br />
Total 229<br />
personnel est réparti entre les services administratifs ci-<br />
dessus désignés, suivant le tableau A joint au présent.<br />
« Art. 4. —<br />
Les membres de ce personnel, dont l'art. 8 du règlement sus-<br />
visé du 16 avril 1862, réserve la nomination au Gouverneur général ou au
298<br />
Directeur général délégué, concourent à l'avancement sur l'ensemble des<br />
vacances d'emploi dans les trois départements.<br />
« Les Préfets des départements et les Généraux commandant les divisions<br />
continuent, chacun en ce qui le concerne, et en se renfermant dans la limite<br />
des cadres, à user du droit de nomination qui leur a été conféré par le<br />
règlement précité (Art. 8 g 3).<br />
« Provisoirement, les employés attachés aux bureaux civils des subdivi<br />
sions sont à la désignation du Gouverneur général.<br />
« Art. 5. —<br />
Le nombre des employés,<br />
dans les diverses classes de chaque<br />
grade, ne peut, en auÇun .cas, excéder celui fixée par le tableau B, ci-<br />
annexé.<br />
« Art. 6. —<br />
En<br />
cas de vacances dans les emplois de chefs, de sous-chefs<br />
de bureau el de secrétaires de sous-préfectures,<br />
el à défaut de candidats<br />
réunissant les conditions réglementaires, des employés du grade immédiate<br />
ment inférieur, pourront êlre appelés à ces postes,<br />
fonctions. —<br />
Une<br />
en qualité de faisant<br />
indemnité pour services exceptionnels leur sera accordée,<br />
et, dès qu'ils rempliront les conditions d'ancienneté voulues pour justifier<br />
une promotion, ils prendront rang dans le grade (ou la classe) pour lequel<br />
ils auront acquis des titres,<br />
16 avril 1862.<br />
« Art. 7. —<br />
Chaque<br />
en conformité de l'art. 10 du règlement du<br />
année, dans le courant du mois de janvier, des exa<br />
mens d'admissibilité au grade de commis principal auront lieu à Alger pour<br />
les candidats des trois départements. Il sera accordé des frais de route aux<br />
candidats qui auront à se déplacer.<br />
« Art. 8. —<br />
Les commis principaux seront répartis entre les trois préfec<br />
tures suivant les besoins du service, sans que leur nombre puisse excéder<br />
celui de 21, fixé par le tableau A, ci-annexé.<br />
« Dans le cas où le personnel d'une préfecture compterait plus ou moins<br />
de 7 commis principaux, le nombre des commis rédacteurs de celle préfec<br />
ture devrait être diminué ou augmenté dans la même proportion.<br />
« Art. 9. —<br />
A<br />
défaut de commis rédacteurs de lre classe, ayant satisfait<br />
aux examens, le grade de commis principal pourra être conféré aux commis<br />
rédacteurs de 2me classe reconnus admissibles et comptant au moins trois ans<br />
d'exercice dans leur classe.<br />
« Art. 10. —<br />
Sont<br />
el demeurent rapportées toutes dispositions antérieures,<br />
contraires à celles du présent arrêté.<br />
« Jusqu'à ce que l'effectif actuel des fonctionnaires et des employés de<br />
l'administration départementale ait élé ramené aux chiffres fixés par les<br />
articles 1 et 2 qui précèdent, il ne sera fait qu'une nomination ou qu'une<br />
promotion sur deux vacances dans chaque emploi, grade ou classe, en sur<br />
nombre.
18 janvier 1878. —<br />
Décret<br />
forges de Châtillon et Commentry<br />
n» 24).<br />
299<br />
concédant à la Compagnie anonyme des<br />
les mines de fer-d'Aïn-Sadouna (1878,<br />
« Art. 1«\ — Il est fait concession à la Compagnie anonyme des forges de<br />
Châtillon et Commentry, déjà propriétaire des concessions de mines de fer<br />
de Thosles et Beauregard (Côle-d'Or), de Beauregard et Creux-de-Fée (Haute-<br />
Marne et Côte-d'Or), d'Etrochy (Côte-d'Or), de Bézenet (Allier)<br />
et locataire<br />
de la concession des mines de fer et de cuivre de Gouraya (déparlement<br />
d'Alger), des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, com<br />
mune mixte de Gouraya (département d'Alger).<br />
• Art. 2. —<br />
Celte concession,<br />
qui prendra le nom d'Aïn-Sadouna, est<br />
limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit,<br />
savoir :<br />
« Au Nord, par une ligne droile A F partant du point A, embouchure<br />
d'un ravin se jetant dans l'Oued Kallela, à 500 mètres environ en aval<br />
de l'Oued Bourberan, et allant au point F, confluent de l'Oued Rha et de<br />
l'Oued Amelen, ledit point F appartenant à la borne Sud-Ouest de la con<br />
cession de Gouraya.<br />
« A l'Est, par l'Oued Rha ou Khaff, depuis le poinl F jusqu'au point M où<br />
il est rencontré par la limite Sud ci-après définie.<br />
« Au Sud, par deux lignes droites partant chacune du point B,<br />
sommet du<br />
mamelon dit Lahari-bou-Agfeur ; la première allant au point C, sommet<br />
d'une butte blanche, sur la rive gauche de l'Oued Rha, à environ 60 mètres<br />
en amont du confluent de l'Oued Jérid et prolongée jusqu'à son intersection<br />
M avec l'Oued Rha ; la seconde allant du point N,<br />
Azzen-Berkouk dans l'Oued Kalléla.<br />
embouchure de l'Oued<br />
« A l'Ouest, par l'Oued Kallela, depuis le point N jusqu'au point de<br />
départ'A.<br />
o Lesdites limites comprennant une superficie de 5 kilomètres carrés<br />
soixante hectares (5 kil. carrés 60 hect.).<br />
« Art. 3. —<br />
La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer<br />
exploitables par travaux souterrains réguliers ; à l'égard des minerais de fer<br />
dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient<br />
situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils de<br />
meureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploi<br />
tation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir,<br />
l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur.<br />
« Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les<br />
propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du<br />
21 avril 1810.<br />
« Art. 4. —<br />
Il<br />
n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîles de tout mine-
ai étranger au fer,<br />
d'Aïn-Sadouna.<br />
300<br />
qui peuvent exister dans l'étendue de la concession<br />
« La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après<br />
une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines d'Aïn-<br />
Sadouna,<br />
soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux con<br />
cessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concession<br />
naires entre eux pour la conservation de leurs droils mutuels et pour la<br />
bonne exploitation des deux substances.<br />
« Art. 5. —<br />
Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les<br />
articles 6 el42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concé<br />
dées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par<br />
hectare de terrain compris dans la concession.<br />
Les concessionnaires paieront, en outre,<br />
la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du<br />
« Art. 6. —<br />
21 avril 1810,<br />
l'exploitation des mines.<br />
« Art. 7. —<br />
En<br />
aux propriétaires de<br />
pour les dégâts et non jouissance de terrain occasionnés par<br />
exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810,<br />
toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires à raison de<br />
recherches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le<br />
Conseil de préfecture.<br />
— « Art. 8. Les concessionnaires paieront à l'État, entre les mains du<br />
receveur de Cherchell, les redevances fixe et proportionnelle établies par la<br />
loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret<br />
du 6 mai 1811.<br />
« Art. 9. —<br />
Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispo<br />
sitions du cahier des charges annexé au présent décret et qui est considéré<br />
comme en faisant partie essentielle.<br />
— « Art. 10. En<br />
exécution de l'ordonnance du 18 avril 1842, ils devront<br />
élire un domicile administratif, qu'ils feront connaître par une déclaration<br />
adressée au préfet du déparlement.<br />
« Art. 11. —<br />
Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7<br />
de la loi du 27 avril 1838, de désigner, par une déclaration authentique,<br />
faite au secrétariat de la préfecture,<br />
celui d'enlre eux ou toule aulre per<br />
sonne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en<br />
leur"nom avec l'autorité administrative, el, en général, pour les représenter,<br />
vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.<br />
« Art. 12. —<br />
Conformément<br />
au décret du 23 octobre 1852, les concession<br />
naires ne pourront, sans l'autorisation du Gouvernement,<br />
réunir leur con<br />
cession à d'autres concessions de même nalure, par association, acquisition<br />
ou de toute aulre manière,<br />
sous peine de reirait des concessions réunies cl<br />
sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en verlu des<br />
articles 414 et 419 du Code pénal.
« Art. 13. —<br />
301<br />
Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance<br />
de l'administration des Mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la<br />
loi du 21 avril 1810 et du titre II du décret du3 janvier 1813, si la propriété<br />
de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une<br />
seule personne ou à une autre société. Ce cas arrivant, le nouveau ou les<br />
nouveaux propriétaires de la concession seront tenus de se conformer exac<br />
tement aux conditions prescrites par le présent décret el par le cahier des<br />
charges y annexé.<br />
i Art. 14. —<br />
Dans<br />
le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810<br />
où l'exploilalion serait restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la<br />
sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Préfet assignera aux<br />
concessionnaires un délai de rigueur. Faute par les concessionnaires de jus<br />
tifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens<br />
de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au<br />
Gouverneur général civil de l'Algérie, qui prononcera, s'il y a lieu, le reirait<br />
de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et<br />
suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.<br />
« Art. 15. —<br />
Si<br />
les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à<br />
une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition au Préfet,<br />
six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'aban<br />
donner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition :<br />
« 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ;<br />
« 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe<br />
point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire,<br />
un état de celles qui pourraient avoir été prises.<br />
23 janvier 1878. —<br />
Décret<br />
302<br />
prorogeant jusqu'au 31 décembre 1878, le<br />
délai de 6 mois accordé par le décret du 15 mai 18"7 pour le visa et l'enre<br />
gistrement d'actes sous-seing privé entre indigènes musulmans et d'actes et<br />
jugements passés devant les Cadis (1878, n° 27).<br />
Vu les articles 55 et 56 du décret du 31 décembre 1859, sur la justice musul<br />
— mane en Algérie;<br />
— l'établissement et la constitution de la propriété en Algérie ; Vu<br />
Vu les articles 11 et 19 de la loi du 26 juillet 1873, sur<br />
le décret du<br />
16 mai 1877, article 1er, qui accorde un délai de six mois pour faire viser pour<br />
timbre et enregistrer, sans droits en sus ou amendes, les actes sous-seing privé<br />
entre indigènes musulmans, les actes ou jugements passés devant les Cadis, qui<br />
emportent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou de<br />
droits réels susceptibles d'hypothèques, les baux à ferme, à loyer ou. à rente, les<br />
sous beaux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de<br />
même nature ; — Considérant que ce délai a été reconnu insuffisant ;<br />
— Qu'il<br />
importe dans l'intérêt du Trésor, comme dans celui des particuliers, de faciliter,<br />
par tous les moyens possibles, l'accomplissement des formalités du timbre et de<br />
l'enregistrement des actes et jugements qui y sont soumis, en vue de la constitu<br />
tion et de l'assiette de la propriété foncière en Algérie.<br />
— « Art. 1«. Est prorogé jusqu'au 31 décembre 1878, le délai de six mois<br />
accordé par- le décret sus-visé du 16 mai 1877.<br />
« Art. 2. —<br />
Le bénéfice de cette prorogation ne s'applique qu'aux actes<br />
et jugements d'une dale antérieure au dit décret du 16 mai 1877.<br />
« Les droils en sus ou amendes qui ont été perçus sur les actes et juge<br />
ments enregistrés antérieurement au présent décret,<br />
tuables. «<br />
25 janvier 1878. —<br />
ne sont pas resti<br />
Arrêté fixant les conditions de l'examen d'admissibi<br />
lité au grade de commis principal dans l'administration départementale en<br />
Algérie (1878, n° 9).<br />
« Art. 1«. —Est instituée à Alger,<br />
une commission unique chargée de<br />
procéder, chaque année, à l'examen des candidats au grade de commis prin<br />
cipal dans l'administration départementale.<br />
« Celte commission est composée ainsi qu'il suit :<br />
« Président : Un conseiller rapporteur au Conseil du gouvernement ;<br />
« Membre : Trois chefs de bureau de l'Administration centrale ;<br />
sous-chef de bureau de l'Administration centrale ;<br />
» Secrétaire : Un commis-rédacteur de l'Administration centrafe.<br />
— Un<br />
« Art. 2. —Les épreuves à subir par les candidats consisteront en deux<br />
compositions écrites et en un examen oral.<br />
« Les compositions écrites porteront sur des matières d'administration<br />
algérienne,<br />
„ g ier# _<br />
« § 2. — Colonisation,<br />
Organisation<br />
se rapportant à l'un des six paragraphes suivants:<br />
politique, administrative et judiciaire ;<br />
régime commercial et industriel ;
« § 3. —<br />
Travaux<br />
« § 4. — Régime<br />
303<br />
public ; régime des eaux ;<br />
financier ;<br />
— comptabilité publique ;<br />
—<br />
comptabilité<br />
départementale et communale ;<br />
« — § 5. Administration des indigènes (territoire civil et territoire de<br />
commandement).<br />
« g 6. —<br />
Loi sur la propriété;<br />
—<br />
séquestre.<br />
« La première composition aura pour sujet une question de droit adminis<br />
tratif théorique ;<br />
« La deuxième, une question de pratique administrative.<br />
« L'examen oral portera sur les matières indiquées dans les six<br />
phes ci-dessus.<br />
paragra"<br />
« Lescandidats pourront être interrogés également sur les principes gêné»<br />
raux de la législation administrative de la Métropole.<br />
«.Art. 3. — Sont<br />
et demeurent rapportées toutes les dispositions anté<br />
rieures contraires aux présentes. »<br />
25 janvier 1878. — Arrêté<br />
ordonnant la suppression du cercle de Cons<br />
tantine (territoire de commandement) (1878, n° 16).<br />
« — Art. 1«. Le cercle de Constantine (territoire militaire) est supprimé.<br />
— « Art. 2. Les tribus qui en faisaient partie sont réparties de la manière<br />
suivante :<br />
o Les caïdats du Ferdjioua, du Zouagha, des Ouled Kebbeb et de l'Oued<br />
Bousselah sont constitués en une annexe, relevant directement de M. le<br />
Général commandant la subdivision de Constantine,<br />
d'annexé de Fedj-Mzala,<br />
(Ferdjioua).<br />
« Le caïdat des Segnia,<br />
qui prendra le nom<br />
el dont le chef-lieu sera au dit lieu de Fedj-Mzala<br />
comprenant les quatre douars-communes des<br />
Ouled Sbâ, Ouled Si-Ounis, Ouled Messaad, Oulëd Achour, destinés à être<br />
rattachés au territoire civil du département, de Constanline, sera, par dispo<br />
sition transitoire et jusqu'à ce que celte remise ait été effectuée, administré<br />
directement par M. le Général commandant la subdivision de Constanline.<br />
« Art. 3. —<br />
Il<br />
n'est rien changé, jusqu'à nouvel ordre, à l'organisation<br />
financière et judiciaire de ces tribus, qui continuera à fonctionner dans les<br />
mêmes conditions qu'à l'époque où elles étaient comprises dans le cercle de<br />
Constantine. >■<br />
29 janvier 1878. —<br />
Décret<br />
érigeant en commune de plein exercice la<br />
commune de Saint-Cyprien des Attafs (arrondissement de Milianah) (1878,<br />
n» 14).
31 janvier 1878. —<br />
304<br />
Arrêté distrayant de la commune mixle de Milianah<br />
les douars communes de Sidi Simiane et d'El-Gourine pour les rattacher à<br />
la commune mixte de Gourayas (1878, nJ 17).<br />
6 février 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
le douar Guettara (Oued-el-Hammam) commune mixte de Milah (arrondisse<br />
ment de Constantine) (1878, n° 19).<br />
12 février 1878. —<br />
Décret<br />
établissant une septième commission régio<br />
nale des voies de communication (Chemins de fer de l'Algérie) (1878, n°29).<br />
RAPPORT AU PRÉSIDENT BE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE<br />
« Monsieur le Président,<br />
Paris, le 12 février 1878.<br />
« Le développement de la colonisation, en Algérie, appelle un dévelop<br />
pement correspondant des chemins de fer. Déjà,<br />
un millier de kilomètres<br />
environ ont été construits ou concédés par l'Etat (1). A ce premier réseau<br />
d'intérêt général s'adjoignent un peu plus de 400 kilomètres d'intérêt local<br />
ou industriel. Mais, outre que ces dernières lignes n'ont pas élé disposées<br />
pour satisfaire aux besoins de l'intérêl général, un développement tolal de<br />
1,400 à 1,500 kilomètres est loin de sulïir aux progrès de notre colonie.<br />
« Les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées de l'Algérie estiment qu'un se<br />
cond réseau, à peu près de même étendue,<br />
serait dès maintenant nécessaire.<br />
Ce réseau se formerait de 1,240 kilomètres de lignes nouvelles et de 167<br />
kilomètres de lignes d'intérêt local qu'il s'agirait d'incorporer au réseau<br />
d'intérêt général. Le résultat serait de créer une ligne de fer continue enlre<br />
la frontière de Tunis et celle du Maroc, d'environ 1,300 kilomètres,<br />
et de<br />
rattacher celte ligne aux ports et aux centres principaux par une série d'em<br />
branchements.<br />
a Sans me prononcer, quant à présent, sur le mérite de cette concep<br />
tion, qui a rallié le suffrage du Conseil supérieur de l'Algérie, je trouve les<br />
études assez sérieusement faites et appuyées sur des motifs assez réels pour<br />
qu'il y ait lieu d'envisager la possibilité de les mettre à exécution. Avant de<br />
(1)<br />
Ce sont les lignes :<br />
D'Alger à Oran , 426 kil.<br />
De Philippeville à Constantine 87 »<br />
De Bône à Duvivier<br />
'<br />
54 »<br />
De la frontière de la Tunisie au Kroubs 274 »<br />
De Constantine à Sétif 155 »<br />
D'El-Guerrak à Batna 80 »<br />
Total 1.076 kil.
305<br />
pousser plus loin, il conviendrait, selon moi, de leur faire subir la même<br />
épreuve que nous avons appliquée aux études analogues pour la Métropole,<br />
c'est-à-dire de les soumettre au jugement d'une Commission technique et<br />
administrative, formée sur les mêmes bases que les six Commissions ré<br />
gionales, créées par le décret du 2 janvier.<br />
« Je viens donc, après m'êlre concerté avec M. le Gouverneur général<br />
civil de l'Algérie, vous proposer d'instituer une 7e Commission régionale,<br />
spéciale à l'Algérie. Cette Commission aurait à se prononcer sur le tracé de<br />
toutes les lignes destinées à former provisoirement le réseau d'intérêt géné<br />
ral. Je dis provisoirement, car il est impossible, dans l'état actuel de l'Al<br />
gérie, d'assigner, dès aujourd'hui, le lerme final du réseau ferré. Les pro<br />
grès de la colonisation sont trop rapides, les transformations trop incessantes<br />
pour qu'on puisse fixer avec certitude tous les points à desservir. Il est pro<br />
bable, au contraire, que de nouvelles lignes, se détachant de la grande artère<br />
centrale, se dirigeront plus tard vers le Sud, pour pénétrer dans l'intérieur<br />
des terres. Mais, tout en réservant à cet égard l'avenir on peut, du moins,<br />
poser les bases essentielles du réseau, avec l'assurance que ces bases ne ces<br />
seront pas d'être en harmonie avec les développements les plus lointains de<br />
la colonie.<br />
« Si vous voulez bien, monsieur le Président, revêtir de votre signature<br />
le présent rapport et le décret qui l'accompagne, je réunirai immédiatement<br />
la Commission. J'ai à peine besoin d'ajouter que, d'accord avec M. le Gou<br />
verneur général civil de l'Algérie, j'ai désigné, pour en faire partie, des hom<br />
mes connaissant bien le territoire el les besoins de noire possession africaine.<br />
Celle Commission se mettra en rapport avec les Sénateurs et les Députés de<br />
l'Algérie et recevra les communications de toutes les personnes en l'état de<br />
l'éclairer. J'estime que,<br />
eu égard au degré d'avancement des études déjà<br />
faites et dont les résultats vont lui être livrés, elle pourra terminer ces tra-<br />
vaux'à la même date que les six Commissions de la Métropole, c'est-à-dire<br />
au 31 mars prochain. »<br />
Vu le décret du 30 juin 1876,<br />
l'Algérie ;<br />
— Sur<br />
sur les actes de haute administration concernant<br />
le rapport du Ministre des Travaux publics, d'après les pro<br />
positions du Gouverneur général civil de l'Algérie,<br />
« Art. 1«. —<br />
Il<br />
TITRE PREMIER<br />
est établi une Commission technique et administrative<br />
chargée, en ce qui concerne l'Algérie :<br />
« 1° De dresser la liste des voies ferrées à établir pour compléter le réseau<br />
actuel d'intérêt général de la colonie,- en dehors de celles qui ont élé déjà<br />
concédées, déclarées d'ulilité publique ou prévues par la loi ;<br />
« 2° De rechercher les lignes qui font aujourd'hui partie du réseau d'in-<br />
(Supplèment.)
lérêt local, régulièrement concédé,<br />
réseau d'intérêt général ;<br />
306<br />
et qu'il conviendrait d'incorporer au<br />
« 3u De classer, en une liste unique, par ordre de priorité d'exécution,<br />
toutes les lignes du réseau complémentaire, tant celles dont la construction<br />
a déjà élé projetée que celles qui seraient proposées par la Commission, en<br />
vertu des paragraphes 1 el 2 du présent article.<br />
« A l'appui de cette liste, la Commission devra dresser une ou plusieurs<br />
caries et présenter un rapport justificatif.<br />
« Art. 2.— Cette Commission sera composée de trois Inspecteurs généraux<br />
des Ponts-et Chaussées, y compris l'Inspecteur général chargé de l'inspection<br />
des Travaux publics en Algérie, d'un Maître des requêtes au Conseil d'État,<br />
d'un Inspecteur principal de l'exploitation commerciale, de deux Ingénieurs<br />
en chef des Ponts-et-Chaussées ayant pris une part imporlante à la conslruc-<br />
tion ou à l'exploitation des chemins de fer,<br />
attaché au service de l'Algérie.<br />
« Arl. 3. —<br />
Le<br />
et d'un Ingénieur des Mines<br />
Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, le<br />
Directeur général des Affaires civiles de l'Algérie et le Direcleur des Chemins-<br />
de ferfonl partie de droit de la Commission.<br />
« Art. 4. —<br />
Les<br />
rapports et documents à l'appui, produits par la Com<br />
mission, seront soumis au Conseil général des Ponts-el-Chaùssées,<br />
donner son avis sur ces propositions.<br />
« Art. 5. —<br />
appelé à<br />
Le Ministre des Travaux publics prendra l'avis du Ministre de<br />
la Guerre, en ce qui concerne l'intérêt stratégique,<br />
sur le classement pro<br />
posé par le Conseil général des Ponls-et-Chaussées ; puis, après avoir arrêté<br />
ce classement, il le convertira en un projet de loi et le portera devant les<br />
Chambres, sans préjudice des décisions ultérieures que les pouvoirs compé<br />
tents auraient à prendre sur la déclaration d'utilité publique, sur les voies<br />
el moyens, sur le mode d'établissement et d'exploitation,<br />
cession, s'il y a lieu.<br />
« Art. 6. —<br />
La<br />
TITRE n<br />
enfin sur la con<br />
Commission technique et administrative des Chemins de<br />
fer algériens est composée de la manière suivante :<br />
« MM. Le Gros, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, président ;<br />
Hardy, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, chargé de l'inspection des<br />
Travaux publics en Algérie; Collet-Meygret, Inspecteur général des Ponls-<br />
et-Chaussées ; Chauchat, Maître des requêtes au Conseil d'État ; De Savigny,<br />
Inspecteur de l'exploitaliou commerciale des Chemins de fer ; Lebiez, Ingé<br />
nieur en chef des Ponts-et-Chaussées, attaché au service de l'Algérie ;<br />
Godin de Lépinay, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées ; Pouyanne,
307<br />
Ingénieur des Mines faisant fonctions d'Ingénieur en chef, attaché au service<br />
de l'Algérie.<br />
« Art. 7. —<br />
La Commission désignera celui de ses membres qui sera<br />
chargé des fonctions de secrétaire. Sur sa proposition, des secrétaires auxi<br />
liaires,<br />
choisis parmi 'les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ou des Mines ou<br />
parmi les auditeurs au Conseil d'Élat, pourront lui être adjoint avec voix<br />
consultative.<br />
« Art. 8. —<br />
La<br />
Commission pourra entendre, sur la convocation de son<br />
Président toutes les personnes dont elle croira les dépositions nécessaires à<br />
son élude.<br />
« Art. 9. —<br />
Elle devra avoir remis au Ministre, avant le 31 mars prochain,<br />
les listes, cartes et rapports définis à l'article 1" du présent décret. »<br />
19 février 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans les douars-communes de Ghoufirat Oulad-Dani et Ghoufirat-Sficila<br />
(commune mixte el arrondissement de Mostaganem) (1878, n° 35).<br />
6 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
les douars Bou-Taïeb et Ghezala, commune mixte de Jemmapes (arrondisse.<br />
ment de Philippeville) 1878, n» 53).<br />
11 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
dislrayanl de la commune indigène de Cons<br />
tantine les douars-communes de Ouled-Messaad, Ouled-Achour, Ouled-Sebah<br />
et Ouled-si-Ounis, et les réunissant à la commune mixte d'Aïn-Mlila (1878,<br />
no 50).<br />
11 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
homologuant les opérations delà commission<br />
d'enquête accomplies dans le douar-commune des Oulad-Riab, tribu des<br />
Hazedj (arrondissement de Sidi-bel-Abbès) (1878, n° 55).<br />
11 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
rattachant le canton judiciaire de Khenchela<br />
(département de Constantine) au bureau de l'Enregistrement, des Domaines<br />
et du Timbre d'Aïn-Beïda (1878, n» 52).<br />
12 mars 1878. —-<br />
Arrêté<br />
distrayant de la commune indigène d'El-Milia<br />
le douar-commune des Beni-Tlilen el le réunissant à la commune mixte de<br />
Milah (département de Constantine) (1878, n« 51).
•<br />
13 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
308<br />
créant un bureau de l'Enregistrement, des<br />
Domaines et du Timbre à Akbou (département de Constanline) (1878, n° 43).<br />
, 14 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans les douars-communes de Gueraïria et de Guerbouça (commune mixte<br />
deRelizane) (1878, n" 54).<br />
19 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
les territoires indigènes de la commune de plein exercice de Saint-Cyprien-<br />
des-Attafs (arrondissement de Milianah) (1878, n°8l).<br />
20 mars 1878. —<br />
Arrêté<br />
le douar des Ouled-Farès,<br />
d'Orléansville) (1878, n° 82).<br />
31 mars 1878. —<br />
Décret<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
commune mixte de Malakoff (arrondissement<br />
portant que le village projeté à l'Oued-Melah,<br />
commune mixte de Gouraya (département d'Alger),<br />
Villebourg (1878, n° 69).<br />
le' avril 1878. —<br />
Arrêté<br />
prendra le nom de<br />
supprimant le cercle de Collo et créant le cer<br />
cle d'El-Milia (département de Constanline) (1878, n° 101).<br />
n Art. 1er. —<br />
Le<br />
cercle de Collo est supprimé.<br />
— « Art. 2. L'annexe d'El-Milia est érigée en un cercle qui comprendra les<br />
mêmes divisions territoriales que l'annexe actuelle.<br />
— « Art. 3. il<br />
esl créée une annexe dont le chef-lieu sera à Collo et qui<br />
relèvera du cercle d'El-Milia. Cette annexe comprendra les douars-communes<br />
de : Elli-Zeggar, Beni-Zid, El-Ouldja, Ziabra, Oulad-Djama, El-Djezia,<br />
Denaïra, Beni-Ouelban, Oulad-Arksib,-Aïn-Tabia, Ouled-Hamidech, Ouled-<br />
Mrabot, Afensou, Arb-El-Goufi, c'esl-à-dire la même division territoriale que<br />
l'ancien cercle du même nom, moins les douars-communes de Tokla, Ker-<br />
kera, Demuia, El-Alba el Taabna, destinés à être rattachés au territoire<br />
civil.<br />
« Art. 4. —<br />
Le<br />
cercle d'El-Milia et l'annexe de Collo réunis formeront<br />
une seule commune indigène administrée par le Commandant supérieur du<br />
cercle d'El-Milia.<br />
« Art. 5. —<br />
Jusqu'au<br />
jour où les douars de Tokla, Kerkera, Demnia, El-<br />
Atbaet Taabna de l'ancien cercle de Collo qui doivent passer en territoire
309<br />
civil, seront remis effectivement à l'autorité préfectorale, ils continueront<br />
à relever de la nouvelle annexe de Collo.<br />
3 avril 1878. —<br />
Loi<br />
sur l'état de siège (Journal off. du 4 avril 1878).<br />
— « Art. 4. Dans le cas où les communications seraient interrompues avec<br />
l'Algérie,<br />
de siège dans les conditions de la présente loi.<br />
3 avril 1878. —<br />
le Gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état<br />
Arrêté portant que la commune mixte de Sainle-Barbe-<br />
du-Tlélat portera désormais le nom de Saint-Lucien et que le village de ce<br />
nom devient le chef-lieu de la commune mixte (1878, n" 98).<br />
4 avril 1878. —<br />
Arrêté<br />
réduisant à 40 jours le délai d'exécution des<br />
transactions en matière de délits forestiers commis par les indigènes des ter<br />
ritoires de commandement (1878, n° 104).<br />
« Art. 1er. —<br />
Le<br />
l'arrêté du 3 janvier 1876,<br />
« Art. 2. —<br />
Dans<br />
délai d'exécution des transactions fixé par l'article 5 de<br />
est réduit de soixante à quarante jours.<br />
le cas prévu par l'art. 7, de l'arrêté précité, c'est-à-dire<br />
à défaut de paiement du montant de la transaction dans les délais fixés en<br />
l'article précédent, l'Inspecteur des forêls adressera au Général commandant<br />
la Division, à qui appartient l'exercice des poursuites, le procès-verbal de<br />
délit et le certificat du Receveur, au plus tard, le 50« jour qui suit la déci<br />
sion de transaction.<br />
Arl. 3 .<br />
— Dès la réception de ces actes, le Général commandant le Division<br />
donnera l'ordre d'informer contre les délinquants. »<br />
5 avril 1878. —<br />
(1878,<br />
n°<br />
89).<br />
5 avril 1878. —<br />
Arrêté<br />
Arrêté<br />
réorganisant le service médical de colonisation<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873, dans<br />
le douar Bagdoura, commune mixte deTénès (arrondissement d'Orléansville)<br />
(1878, n» 108).<br />
16 avril 1878. —<br />
Arrêté<br />
les douars Ouled-Hamza et Ouled-Habeba,<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
(arrondissement de Philippeville) (1878, n° 128).<br />
commune mixte d'El-Arrouch
18 avril 1878. —<br />
310<br />
Décret promulguant en Algérie le décret du 11 dé<br />
cembre 1864, et le règlement général du 30 juin 1865, sur les Monts-de-Piété<br />
(1878, n» 130).<br />
20 avril 1878. — Décret homologuant des plans de délimitation et des<br />
procès-verbaux de bornage, de zones et de servitude (1878, n° 198).<br />
24 avril 1878. —<br />
Arrêté<br />
réunissant à la commune mixte de Collo les<br />
douars-commnnes de Tokla, d'Arb-Guerguera, de Demnia, d'El-Atlba, et de<br />
Taabna, distraits de la commune indigèuedu même nom (1878, n° 120).<br />
30 avril 1878. -<br />
Décision<br />
du Ministre des finances portant révision .du<br />
tableau des franchises postales en Algérie (1878, n°<br />
. 154)<br />
6 mai 1878. —<br />
Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les<br />
douars Ouled-Trif et Ouled-Ferghen, commune mixle de Ben-Chicao (arron<br />
dissement d'Alger) (1878, n° 147).<br />
— 7 mai 1878. Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le<br />
douai-commune d'El-Messabehia (Hassassena) ,<br />
(1878, n
311<br />
« Il résulte de ces dispositions : 1° Que le taux étant actuellement de<br />
10 p. o/° d'après<br />
l'ordonnance du 7 décembre 1835, tout débi-renlier doit,<br />
pour se racheter, verser un capital formé de 10 fois le montant de la rente;<br />
2o Que dans le cas où de nouvelles dispositions viendraient à modifier le<br />
taux légal, ces dispositions seraient applicables aux rentes encore dues.<br />
« L'administration, préoccupée des charges, relativement lourdes, que les<br />
rentes font peser sur la propriété foncière, dont elles déprécient la yaleur,<br />
a eu recours, depuis longtemps, à diverses mesures destinées à en faciliter<br />
l'amortissement. C'est dans ce but qu'ont été rendus les décrets des 21, 22<br />
février 1850, 25 juin et 19 décembre 1851.<br />
« Ces mesures n'ont pas produit tous les résultats que l'on en attendait.<br />
« Le nombre des titres constitutifs de renies non rachetées élait, récem<br />
ment encore, de 16,000 environ, représentant un revenu annuel de<br />
400,000 fr., soit un capital, au denier 10, de 4,000,000 fr.<br />
« Des considérations nonvelles ont fail penser qu'il y avait un intérêt ma<br />
jeur, tant pour l'État que pour les débi-rentiers à provoquer, dans le plus<br />
bref délai, l'amortissement de toutes les rentes dont la propriélé est grevée<br />
au profit du Trésor. —<br />
D'un côté, en effet, un certain nombre de litres cons<br />
titutifs remontent à près de 30 ans, et vont être atteints par la prescription,<br />
d'où la nécessilé de faire souscrire aux. débi-rentiers un litre nouvel par<br />
— application de l'art. 2263 du Code civil. D'ud<br />
autre côté, la réduction<br />
probable et prochaine du laux de l'intérêt légal aura fatalement pour consé<br />
quence d'augmenter le capital à rembourser, dans les conditions déter<br />
minées à l'art. 12 de l'ordonnance du 1er octobre 1844.<br />
« Afin d'éviter les difficultés que créerait à l'administration l'obligation de<br />
"faire souscrire des titres nouvel, les frais qui en résulteraient pour les débi-<br />
rentiers et l'augmentation de capilal qui serait la conséquence de la réduc<br />
tion du taux de l'intérêt légal, j'ai provoqué et M. le Président de la Répu<br />
blique a signé, le 8 mai courant, un décret destiné à faciliter aux débi-<br />
rentiers les moyens de se libérer entièrement vis-à-vis du Trésor.<br />
« Aux termes de l'article 1er : Un escompte de 25 fj/0 est accordé à tout<br />
débiteur qui remboursera le capital de sa rente avant le 1er juillet 1879,<br />
sauf à ceux qui auraient déjà souscrit l'engagement de se libérer par an<br />
nuités, encore dues en lout ou en partie, à opter enlre l'exécution des clauses<br />
et conditions de leur engagement ou la faculté qui leur esl donnée par le<br />
nouveau décret.<br />
« Aux termes de l'article 2 : Les tiers intéressés pourront, à défaut du<br />
débiteur, bénéficier des dispositions de fart. 1« dans les trois mois qui<br />
suivront l'expiration du délai, c'esi-à-dire du 1er juillet au 30 septembre<br />
1879,<br />
auquel cas ils seront subrogés aux droils de l'État.<br />
« En résumé, tout débiteur d'une renie annuelle et perpétuelle de 20 fr.,<br />
par exemple, qui aurait eu à payer pour amortir celle renie un capital de
312<br />
200 fr. n'aura plus à verser, s'il se libère avant le 1er juillet 1879, que 150 fr.<br />
— Il évitera, en outre, les frais d'un litre nouvel qu'il serait dans l'obliga<br />
tion de souscrire devant notaire, plus l'éventualité de l'augmentation du<br />
capital par suite de la réduction du taux de l'intérêt légal. —<br />
Dans<br />
ces con<br />
ditions, il est à présumer qu'aucun débiteur n'hésitera à profiter des béné<br />
fices que lui accorde le décret du 8 mai.<br />
« J'ai l'honneur de vous adresser, pour notification, un certain nombre<br />
Vous voudrez bien, je<br />
d'exemplaires d'une affiche reproduisant ce décret. —<br />
vous prie, en faire déclarer dans tous les centres relevant de voire adminis<br />
tration,<br />
et prendre tous autres mesures que vous jugerez nécessaires pour<br />
assurer la plus grande publicité aux dispositions du dit décret.<br />
•■ Art. l«r. —<br />
du Domaine,<br />
Tout<br />
débiteur d'une rente constituée, en Algérie, au profit<br />
pour prix de vente ou de concession d'immeubles ou pour ces<br />
sion de droits immobiliers, qui se libérera de sa dette,<br />
par le remboursement<br />
du capital, calculé conformément à l'ordonnance du l«r octobre 1844, avant<br />
le \"juillet 1879, sera admis à bénéficier d'un escompte de vingt-cinq francs<br />
par cent francs (25 p. rj/0),<br />
sur le montant dudit capital .<br />
« Tout débi-rentier qui aurait déjà souscrit l'engagement de se libérer du<br />
capital par annuités encore dues, en tout ou parlie aura l'option,<br />
soit de ne<br />
payer les annuités qu'aux échéances convenues dans son engagement, soit de<br />
se libérer en un seul ou plusieurs termes, dans le délai ci-dessus fixé, en<br />
bénéficianl de l'escomple de 25 p. rj/0.<br />
« Dans le cas où le remboursement sérail effectué par à-comptes, le mon<br />
tant de l'escompte ne serait prélevé que sur le dernier paiement pour solde.<br />
« Art. 2. —<br />
A<br />
défaut du débiteur de la rente, l'acquéreur primitif, le<br />
détenteur, les acquéreurs intermédiaires, les créanciers hypothécaires et<br />
autres tiers intéressés seront admis à jouir des bénéfices de l'article précédent<br />
dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai, c'est-à-dire jusqu'au<br />
30 septembre 1879 inclusivement. Les tiers qui auront effectué le paiement<br />
seront subrogés dans la quittance aux droits de l'État.<br />
« Art. 3. —<br />
Toutes<br />
les dispositions antérieures relatives au rachat de<br />
rentes domaniales sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent<br />
décret.<br />
13 mai 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application delà loi de 1873 dans<br />
le douar des Heumis, commune mixte de Ténès (1878, n° 149).<br />
22 mai 1878. —<br />
Arrêté<br />
commune de plein exercice (1878, n" 164).<br />
constituant la commune mixte de Biskra en
22 mai 1878. —<br />
Arrêté<br />
313<br />
homologuant les opérations d'enquête accomplies<br />
en exécution de la loi de 1873 dans le douar des Beni-Hameïdan (arrondis<br />
sement de Constantine) (1878, n° 177).<br />
23 mai 1878. —<br />
Arrêté<br />
réglant la liquidation des anciens budgets des<br />
localités non érigées en communes (1878, n» 227).<br />
Vu le décret du 27 octobre 1858, portant création, à l'art. 54, des budgets des<br />
Vu l'arrêté du 20 mai 1868, donnant une<br />
Vu le décret du 5 no<br />
localités non érigées en communes ; —<br />
nouvelle organisation aux territoires de commandement ; —<br />
vembre 1868, portant suppression définitive des budgets des localités non érigées<br />
— en communes ; Considérant que les liquidations partielles de ces comptes, telles<br />
qu'elles ont été opérées par les différentes autorités départementales et divi<br />
sionnaires n'ont pas permis de rembourser au Trésor des avances dont il se<br />
trouve encore à découvert, au titre de certains budgets, tandis qu'elles ont laissé<br />
— à d'autres des excédants de recettes sans emploi ; Vu les comptes généraux du<br />
Ministère des finances, pour les années 1872, 1873, 1874, faisant ressortir ces<br />
— résultats ; Vu la dépêche à ce sujet, de M. le Ministre des Finances, en date<br />
— du 23 mars 1877 ; Considérant que, pour régulariser définitivement la situation,<br />
il est indispensable, aujourd'hui, de fondre en une masse commune l'actif d'une<br />
part, et le passif de l'autre, de tous les anciens budgets des localités non érigées<br />
en communes, et de charger un ordonnateur unique du règlement à faire ; —<br />
Considérant enfin qu'à la suite des changements survenus, depuis 1869, dans<br />
l'organisation des territoires en Algérie, il n'est pas possible maintenant de déter<br />
miner à quelles unités communales appartiennent plus spécialement les ressources<br />
qui resteront disponibles, une fois le Trésor désintéressé, et qu'il convient, par<br />
conséquent, d'en faire profiter la collectivité, en attribuant ces sommes à des éta<br />
— blissements d'utilité pour toutes ; Sur la proposition de M. le Conseiller d'État,<br />
Directeur général des affaires civiles et financières,<br />
-« Art. 1
314<br />
Compte de liquidation définitive des anciens budgets des localités non<br />
ékigées en commune (Art. 54 du décret du 27 octobre 1858)<br />
Situation actuelle d'après les comptes généraux du Ministère des Finances,<br />
« Province d'Alger ....<br />
— d'Oran<br />
— de<br />
pour les années 1872, 1873, 1874.<br />
reliquats de recettes<br />
18.877 55<br />
28.650 47<br />
Constantine 63.070 17<br />
Total des reliquats de recettes 110.59819<br />
avances du trésor restant a régulariser<br />
« M. le Trésorier-payeur de la division d'Alger 20.303 44<br />
« M. le Trésorier-payeur de la division d'Oran 38.599 43<br />
« M. le Trésorier- payeur de la division de Constantine 489 35<br />
Total des avances à régulariser 57.392 22<br />
récapitulation<br />
« Total des reliquats de recettes 110.598 19<br />
— des<br />
25 mai 1878. —<br />
avances à régulariser 59.392 22<br />
Décret<br />
décret du 22 février 1876,<br />
maritime (1878, n° 153).<br />
Excédant de receltes<br />
51-205 97<br />
appliquant à l'Algérie, sous certaines réserves, le<br />
portant règlement général de police sanitaire<br />
— « Art. ler. Le décret du 22 février 1876, sus-visé,<br />
général de la police sanitaire maritime pour la France, est déclaré applica<br />
ble à l'Algérie, sous la réserve des modifications suivantes :<br />
« Art. 8. —<br />
portant règlement<br />
La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée, dans un<br />
port de l'Algérie, est obligatoire, en lout temps, pour les navires provenant<br />
des côtes orientales de la Turquie d'Europe, du littoral de la mer Noire et de<br />
tous les pays situés hors d'Europe.<br />
« Art. 9. —<br />
A.<br />
—<br />
En tous temps sont dispensés de se munir d'une patente<br />
de santé, à moins de prescription exceptionnelle, les navires faisant le cabo<br />
tage de France en Algérie el de port d'Algérie à porl d'Algérie.<br />
« B. —<br />
En<br />
temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune maladie pestilen<br />
tielle n'est signalée dans aucun pays du Nord de sont l'Europe, dispensés de
315<br />
présenter une patente de santé, à leur arrivée dans un port d'Algérie, les<br />
navires provenant de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de<br />
l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège, delà Suède et de la Russie.<br />
— « Art. 2. Le<br />
Gouverneur général de l'Algérie exerce celles des attribu<br />
tions conférées au Ministre de l'agriculture et du commerce par le décret du<br />
22 février 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins dn service,<br />
des circonscriptions sanitaires maritimes .<br />
27 mai 1878. —<br />
Décret<br />
»<br />
fixant les traitements minima des instituteurs et<br />
institutrices dans les écoles publiques françaises et les écoles arabes-fran<br />
çaises du territoire civil (1878, n°<br />
205).<br />
« Les traitements minima des instituteurs et institutrices dans les écoles<br />
publiques françaises et les écoles arabes-françaises du territoire civil, sont<br />
fixés de la manière suivante :<br />
« 1° Instituteurs titulaires, divisés en quatre classes : 4« classe, 1.500 fr.,<br />
3* classe, 1 .700 fr. ,<br />
2« classe, 1 .900 fr.,<br />
1" classe, 2. 100 fr.<br />
« 2o Institutrices titulaires, divisées en trois classes : 3e classe, 1 .200 fr.,<br />
2e<br />
classe, 1 .300 fr., U°<br />
classe, 1 .500 fr.<br />
« 3» lnlituteurs adjoints français, divises en trois classes : 3"<br />
1 .200 fr., 2e classe, 1 .300 fr.,<br />
1'"<br />
classe, 1 .500 fr.<br />
classe,<br />
« 4° Instituteurs adjoints indigènes attachés aux écoles arabes-françaises,<br />
divisés en trois classes: 3e classe, 1.000 fr., 2e classe, 1.200,<br />
1.400 fr.<br />
lrC<br />
classe,<br />
« 5° Institutrices adjointes, divisées en deux classes : 2e classe, 1 .000 fr.,<br />
1« classe, 1.100 fr.<br />
■< Art. 2. —<br />
Les<br />
articles 2, 4, 5, 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1875 sont<br />
applicables aux instituteurs el institutrices titulaires ou adjoints attachés aux<br />
écoles françaises et aux écoles arabes-françaises du territoire civil. Les insti<br />
tuteurs et institutrices publics de tout ordre, pourvus d'un diplôme de lan<br />
gue arabe, auront droit, en outre à une prime spéciale, qui sera déterminée<br />
par le Minisire de l'instruelion publique.<br />
« Art. 3. —L'enseignement primaire est gratuit dans les écoles arabes-<br />
françaises publiques.<br />
Disposition transitoire. « Art. 4, —<br />
Les<br />
instituteurs et institutrices de<br />
loul ordre parviendront aux traitements ci-dessus fixés, par augmentations<br />
successives, dans un délai qui n'excédera pas quatre années, à dater du<br />
Ie' janvier 1878. »<br />
28 mai 1878. —<br />
Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les
316<br />
douars-communes de Sidi-Saâda et El-Ghomri,<br />
(1878, no 178).<br />
29 mai 1878. —<br />
commune mixte de Relizane<br />
Arrêté ordonnant l'application de la toi de 1873 dans les<br />
douars-communes de Ghoualize et de Tahamda,<br />
(1878, n» 179).<br />
4 juin 1878. —<br />
Arrêté<br />
commune mixte de Relizane<br />
ordonnant l'application delà loi de 1873 dans le<br />
douar des Sellaouas, commune mixte de l'Oued Zenati (1878, n» 180).<br />
5 juin 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant L'application de la loi de 1873 dans les<br />
territoires des Douairs Flittas, Oulad-bou-Ali et Kalaâ,<br />
Relizane (1878, n° 181).<br />
8 juin 1878. —<br />
commune mixte de<br />
Décret approuvant un échange entre l'État et la Sociélé<br />
générale algérienne (1878, n° 204).<br />
8 juin 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
le douar-commune de l'Oued -Sebbah, commune mixte d'A'ïn-Temouchent<br />
(1878, n" 203;.<br />
18 juin 1878. —<br />
Arrêté<br />
homologuant les opérations d'enquête accom<br />
plies en exécution de la loi de 1873 dans le douar-commune de l'Oued-Dar-<br />
dara, commune mixte de Bône (1878, no 220).<br />
20 juin 1878. —<br />
Décret<br />
érigeant en commune de plein exercice la sec<br />
tion du Pont-du-Chéliff distraite de la commune d'Aïn-Tedelès (arrondisse-<br />
mentde Mostaganem), en y rattachant le douar de&Oulad-Bou-Kamel, distrait<br />
de la commune mixte de Mostaganem (1878, n3<br />
22 juin 1878. —<br />
Arrêté<br />
211) .<br />
ordonnant L'application de la loi de 1873 dans<br />
le territoire de la vallée de l'Oued-Drader enclavé entre les limites de la<br />
commune de Stora et du douar M'salla (arrondissement de Philippeville)<br />
(1878, n» 236).<br />
1« juillet 1878. —<br />
Décret créant à Tizi-Ouzou, une place de pasteur du<br />
culte réformé, au traitement de 3,500 francs (1878, n° 231).
317<br />
1" juillet 1878. — Décret ajournant jusqu'au 31 décembre 1878, l'ap<br />
plication des dispositions du décret du 19 décembre 1876 relatif à la pêche du<br />
corail sur les côtes de l'Algérie (1878 n»<br />
. 235)<br />
8 juillet 1878. —<br />
Arrêté<br />
dans le douar-commune de l'Oued-Berkech,<br />
chenl (1878, n°221).<br />
20 juillet 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
commune mixte d'Aïn-Temou-<br />
autorisant la franchise télégraphique enlre<br />
les Juges de paix de l'Algérie et le Procureur général près la Cour d'appel<br />
d'Alger (1878, n°<br />
20 juillet 1878. —<br />
233).<br />
Arrêté<br />
homologuant les opérations d'enquête exé<br />
cutées par application de la loi de 1873 dans le douar Medjabria, com<br />
mune de Condé-Smendou (arrondissement de Constantine) (1878,<br />
23 juillet 1878. —<br />
n*<br />
237).<br />
Décret érigeant en commune de plein exercice le<br />
centre de Bois-Sacré distrait de la commune mixte des lssers (arrondissement<br />
de Tizi-Ouzou) (1878,<br />
28 juillet 1878. —<br />
Décret<br />
n"<br />
242).<br />
érigeant en commune de plein exercice le<br />
centre de l'Oued-Amizour, distrait de la commune mixte de Bougie (1878,<br />
n° 244).<br />
23 juillet 1878. —<br />
Décret<br />
rattachant le douar d'El-Bethem à la com<br />
mune de Bir-Rabalou (département d'Alger) (1878, n° 246).<br />
27 juillet 1878. -<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans le douar commune de Sidi-Ali-ben-Chaïb (commune mixte de Tlemcen)<br />
(1878, n» 239).<br />
— 27 juillet 1878. Décret rattachant au canton judiciaire de Guelma,<br />
la commune d'Enchir-Saïd, distraite du canton judiciaire de Jemmapes<br />
(1878, n» 258).<br />
31 juillet 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873<br />
dans le douar d'Aïn-Melouk, commune mixte de l'Oued-Zenati (arrondisse<br />
ment de Constantine) (1878, n° 238).
7 août 1878. —<br />
Décret<br />
318<br />
appliquant aux produits de l'Espagne les dispo<br />
sitions préventives des décrets en date des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874<br />
et 14 août 1875 (1878, n°262).<br />
Attendu que le phylloxéra a fait son apparition en Espagne, où il exerce ses ra<br />
vages entre Torre et Malaga, et qu'il y a lieu de prendre des mesures préventives<br />
Vu les décrets des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874 et 14<br />
pour l'Algérie ; —<br />
août 1875 ;<br />
— Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce,<br />
d'après les propositions du Gouverneur général civil de l'Algérie.<br />
« Art. 1er. —<br />
Les<br />
dispositions prohibitives des décrets en date des 8 jan<br />
vier 1873, 30 novembre 1874 et 14 août 1875, sont déclarées applicables aux<br />
produits de toutes les provinces d'Espagne. »<br />
10 août 1878. —<br />
Décret<br />
étendant aux agents des Contributions directes<br />
et des Postes, le bénéfice des primes pour la connaissance de la langue arabe<br />
telles qu'elles sont réglées par le décret du 14 mai 1875 (1878, no 261).<br />
19 août 1878. —<br />
Arrêté<br />
ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />
les douars des M'chaïa, Herenfa, Sobah, Oulad -Ziad, Medinet-Merdjaja.<br />
Guerboussa, Tsighaout et Harchoun,<br />
(1878, n- 255).<br />
19 août 1878. —<br />
Décret<br />
commune indigène d'Orléansville<br />
interdisant en Algérie, l'introduction des fruits<br />
et légumes frais el secs, et pommes de terre de provenance d'Espagne (1878,<br />
n» 279).<br />
19 août 1878. —<br />
Décret distrayant différents terrains de la commune<br />
de Marengo (déparlement d'Alger, (1878, n° 269).<br />
22 août 1878. —<br />
Arrêté du Ministre de l'intérieur autorisant la Compa<br />
gnie de l'Est algérien à émettre des obligations (1878, n° 282).<br />
« Art. 1er. —<br />
La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien est au<br />
torisée à émettre des obligations jusqu'à concurrence de la somme de 10 mil<br />
lions,<br />
applicables à la construction de la ligne de Constanline à Sétif<br />
« Art. 2. —<br />
La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien sera tenue<br />
de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de deux mil<br />
lions deux cent vingt-cinq mille francs (2,225,000 fr.), égale à la partie non<br />
encore versée de son capital-actions. Cette somme ne pourra être retirée<br />
qu'au fur et à mesure des versements opérés sur le capital-actions et sur une<br />
autorisation donnée à la Compagnie. »
22 août 1878. —<br />
319<br />
Décret homologuant des plans de délimitations et des<br />
procès-verbaux de bornage de zones de servitude (1878, n° 265).<br />
28 août 1878. —<br />
Arrêté<br />
homologuant les opérations d'enquête accomplies<br />
par exécution de la loi de 1873 dans les fractions de la tribu des Ghomra et<br />
du douar-commune de Sidi-Bokhti,<br />
dOran (1878, n»276),<br />
5 septembre 1878. —<br />
time de l'Algérie (1878, no 273).<br />
Vu le décret du 22 février 1876,<br />
taire en France; —<br />
commune de Bou-Sfer (arrondissement<br />
Arrêté créant la circonscription sanitaire mari<br />
portant règlement général sur la police sani<br />
Vu le décret du 25 mai 1878, qui déclare ce règlement ap<br />
plicable à l'Algérie, sous réserve de certaines modifications et dont l'article 2 est<br />
ainsi conçu : « Le Gouverneur général de l'Algérie exerce celles « des attributions<br />
« conférées au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, par le décret du 22 fécir-<br />
des<br />
« vrier 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins du .<br />
service,<br />
• conscriptions sanitaires maritimes. » — Sur la proposition de M le Conseiller<br />
d'État, Directeur général des affaires civiles et financières,<br />
« Art. 1er. —<br />
Le<br />
littoral algérien forme une circonscription appelée<br />
« Circonscription sanitaire maritime de l'Algérie » dont le siège est fixé<br />
à Alger.<br />
a Art. 2. —<br />
Le Directeur de cette circonscription exercera toutes les at<br />
tributions qui sont énumérées au litre XI du décret sus-visé du 22 février<br />
1876. —<br />
Il<br />
est placé sous l'autorité immédiate du Gouverneur général. •<br />
— 7 septembre 1878. Arrêté rattachant à la commune mixte de Meurad,<br />
les terrains distraits delà commune de Marengo par le décret du 19 août 1878<br />
(1878,no270).<br />
Arrêté accordant au Directeur de la circonscrip<br />
tion sanitaire maritime de l'Algérie, la franchise télégraphique avec les<br />
11 septembre 1878. —<br />
Préfets et Sous-Préfet de l'Algérie ainsi qu'avec les Maires et les agents char<br />
gés du service sanitaire dans les divers ports du littoral algérien (1878,<br />
n» 275) .<br />
30 septembre 1878. —<br />
(1878,<br />
n°<br />
293).<br />
i Art. l»r. —<br />
Les<br />
Décret<br />
sur les concessions de terres en Algérie<br />
terres domaniales comprises dans le périmètre d'un<br />
centre de population et affectées au service de la colonisation sont divisés en<br />
lots de villages et en lots de fermes. Le lotissement varie selon les conditions
320<br />
du sol, sans toutefois que la contenance totale d'un lot de village puisse<br />
excéder quarante hectares et celle d'un lot de ferme cent hectares.<br />
« Les terres impropres à la culture, qui ne sauraient être utilement com<br />
prises dans le périmètre d'un groupe de population, peuvent être alloties en<br />
lots d'une étendue plus considérable, en égard aux industries spéciales qui<br />
pourraient y être installées.<br />
Titre 1e»-. —<br />
« Art. 2. —<br />
Le<br />
De<br />
la concession de terres sous condition suspensive.<br />
Gouverneur général est autorisé à concéder les terres<br />
alloties dans les conditions prescrites par le paragraphe 1er de l'article 1er<br />
aux Français d'origine européenne et aux Européens naturalisés ou en ins<br />
tance de naturalisation qui justifient, pour les lots de villages, de ressources<br />
jugées par lui suffisantes, et pour les lots de fermes, d'un capital disponible<br />
— représentant 150 francs par hectare. Le Gouverneur général peut déléguer<br />
au Préfet ou au Général commandant la division, suivant le territoire, les<br />
droits qui lui sont attribués par le paragraphe précédent. — La<br />
est gratuite. — Elle<br />
concession<br />
attribue au concessionnaire la propriété de l'immeuble<br />
sous la condition suspensive de l'accomplissement des clauses ci-après déter<br />
minées. Le concessionnaire jouira immédiatement de l'immeuble et de ses<br />
fruits sans répétition au cas de déchéance.<br />
« Art. 3. —<br />
Les<br />
demandeurs s'engagent à transporter leur domicile et à<br />
résider sur la terre concédée avec leur famille d'une manière effective et<br />
permanente, pendant les cinq —<br />
années qui suivront la concession.<br />
vent, en outre, déclarer qu'ils ne sonl et n'ont été ni locataires,<br />
sionnaires,<br />
Ils<br />
doi<br />
ni conces<br />
ni adjudicataires de terres domaniales à aucun des litres prévus<br />
parles décrets des 16 octobre 1871,<br />
le présent décret.<br />
« Art. 4. —<br />
Peuvent<br />
10 octobre 1872 et 15 juillet 1874 ou par<br />
être dispensés pour la résidence, mais seulement<br />
pour les lots de fermes, les demandeurs qui s'obligent : 1° à installer et à<br />
maintenir, pendant les cinq années qui suivront la concession, une ou plu<br />
sieurs familles de Français d'origine européenne ou d'Européens naturalisés<br />
0u en instance de naturalisation, à raison d'un adulte au moins, par vingt<br />
hectares ; 2° à employer en améliorations utiles et permanantes, une<br />
somme représentant une dépense moyenne de 150 fr. par hectare, dont le<br />
tiers au moins affeclé à construire des bâtiments d'habitation et d'exploita<br />
tion.<br />
« Art. 5. —<br />
Un<br />
procès-verbal contradictoire constate la'mise en posses<br />
sion du concessionnaire? condition de résidence. —<br />
Dans<br />
le cas prévu par<br />
l'article 4, il est procédé dans la même forme à la constatation : 1° de l'élat<br />
exact de la terre au moment de la mise de possession du concessionnaire ;<br />
2o de l'installation des familles.
16 OCTOBRE 1878 321 N» 44<br />
» Art. 6. —<br />
A titre de récompense pour des services exceptionnels et dû<br />
ment constatés, les indigènes naturalisés ou non peuvent être admis comme<br />
concessionnaires sous condition de résidence, sans que le lot qui leur serait<br />
attribué puisse excéder trente hectares, qu'elle qu'en soit la destination.<br />
— Ces concessions sont consenties par le Gouverneur général, le Conseil<br />
de gouvernement entendu, sous les conditions déterminées aux articles 2, 3<br />
et 5 ci-dessus.<br />
« Art. 7. —<br />
Des<br />
terres domaniales peuvent être mises à la disposition<br />
temporaire des sociétés ou des particuliers qui prendraient l'engagement :<br />
1° de peupler un ou plusieurs villages en assurant l'installation particulière<br />
des familles destinées à former le peuplement ; 2° de transmettre gratuite<br />
ment lesdites terres à ces familles dans le délai de deux ans, aux conditions<br />
prescrites par les articles 3 et 5, et par lots limités comme il a été dit à l'ar<br />
ticle 1er, sans que ces sociétés ou particuliers puissent jamais devenir pro<br />
priétaires des terres qui leur ont été remises à charge de transmission. —<br />
Les conventions à intervenir entre l'État et les sociétés ou particuliers<br />
sont approuvées par le Gouverneur général, le Conseil de gouvernement<br />
entendu .<br />
« Le peuplement doit être composé pour les deux tiers de Français immi<br />
grants, et pour un tiers, soit de Français, soit d'Européens naturalisés ou en<br />
instance de naturalisation déjà établis en Algérie. —<br />
le but<br />
Par<br />
exception, et dans<br />
de'<br />
favoriser l'établissement d'industries spécialement utiles, le<br />
Gouverneur général peut, le Conseil de gouvernement entendu, autoriser la<br />
substitution d'immigrants étrangers européens aux immigrants français, la<br />
composition du dernier tiers restant la même que ci-dessus.<br />
« Art. 8. —<br />
Les<br />
actes de transmission réalisés par les entreprises de<br />
peuplement en exécution des conventions passées enlre elles el l'Étal sont<br />
notifiés, suivant le territoire,<br />
au Préfet ou au Général commandant la divi<br />
sion qui les vise après s'être assuré de l'accomplissement des clauses imposées<br />
par lesdites conventions. — Ces<br />
actes tiennent lieu pour les bénéficiaires<br />
des titres de concession directement délivrés par l'État, sous condition de<br />
résidence. — Ils<br />
droit fixe de 1 fr. 50.<br />
« Art. 9. —<br />
sonl soumis au timbre de dimension et enregistrés au<br />
Si la transmission des terres n'est pas effectuée dans le délai<br />
de deux ans, à partir du jour où la remise leur en a élé faite, l'État reprend<br />
possession des lots non Iransmis.<br />
Titre u. — De<br />
• Art. 10. —<br />
la cession des concessions avant la délivrance<br />
des titres définitifs de propriété.<br />
Les concessionnaires sous condition de résidence, établis en<br />
vertu des articles 3, 6 el 7, qui ont résidé pendant un an au moins peuvent,
322<br />
aux conditions qui leur étaient imposées à eux-mêmes, céder -la concession à<br />
tout Français d'origine européenne ou à tout Européen naturalisé ou en<br />
inslance de naturalisation.<br />
— L'acte<br />
de cession est soumis, suivant le ter<br />
ritoire, à l'approbation du Préfet ou du Général commarrdanl la division,<br />
qui slatue dans le délai de deux mois. —<br />
Si<br />
la décision du Préfet ou du<br />
Générai commandant la division n'est pas intervenue dans le délai ci-dessus<br />
fixé,<br />
la cession est définitive.<br />
« Art. 11. —<br />
Le<br />
cessionnaire peut, à son tour,<br />
céder la concession dans<br />
les mêmes formes et les mêmes conditions que l'attributaire primitif, sans<br />
êlre toutefois astreint à ne rétrocéder ses droils qu'après un an de résidence.<br />
Titre m .<br />
• Art. 12. —<br />
— Des<br />
emprunts avant la délivrance des titres définitifs<br />
de propriété.<br />
Pendant la période. de concession provisoire, les attributaires<br />
ne peuvent consentir d'hypothèque. sur l'immeuble dont ils ont été mis en<br />
possession qu'au bénéfice des prêteurs qui leur fournissent des sommes des<br />
tinées : 1° aux travaux de construction ou de reconstruction, de réparation<br />
ou d'agrandissement des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; 2° à des<br />
travaux agricoles constituant des améliorations utiles et permanenlés ; 3° à<br />
l'acquisition d'un cheptel.<br />
— « Art. 13. L'acte d'emprunt, dressé dans'la forme authentique, conslale<br />
la destination des fonds empruntés. L'emploi devra eu être ultérieurement<br />
établi par quittances el autres documents justificatifs. —<br />
Ledit<br />
acte d'em<br />
prunt est enregistré au droit fixe de 1 fr. 50 et transcrit sans autres frais<br />
que le salaire du conservateur et les droils de timbre. —<br />
vant le territoire,<br />
Il<br />
est notifié, sui<br />
au préfet ou au général commandant la division.<br />
— « Art. 14. En cas de vente à la requête du créancier hypothécaire qui se<br />
trouve dans les conditions exigées par les articles 12 et 13 ci-dessus, tous les<br />
enchérisseurs d'origine européenne sont admis à l'adjudication sous l'obliga<br />
tion de remplir les conditions imposées au concessionnaire primitif.<br />
« Art. 15.— Si le prix de vente n'est pas absorbé par les créanciers, le<br />
concessionnaire est admis à réclamer, sur le reliquat du prix, une indemnité<br />
égale à la valeur estimative des améliorations utiles et frenrianenles réalisées<br />
par lui sur la terre concédée au moyen de ses ressources personnelles. L'in<br />
demnité esl fixée par un arrêté du Préfel ou du Général commandant la Divi<br />
sion, —<br />
suivant le territoire.<br />
Le recours, s'il y a lieu, doit être porté devant<br />
le Conseil de Préfecture, dans le délai de trois mois, à partir de la notifica<br />
tion du dit arrêté.<br />
« Le surplus du prix de vente est versé au Trésor public.<br />
« Art. 16. —<br />
Les<br />
concessionnaires qui tiennent leurs droits des actes de<br />
transmission autorisés par les articles 7 et £ peuvent consentir hypothèque,
323<br />
dans les conditions du présent titre, au profit des entrepreneurs de peuple<br />
ment pour le remboursement des avances qu'ils ont reçues d'eux, soil en<br />
deniers, soit en valeurs de constructions élevées même avant la prise de pos<br />
session par les dils concessionnaires.<br />
Titre iv. —<br />
Déchéances.<br />
« Art. 17. —Sont déchus de leurs droits :<br />
« 1° Le concessionnaire direct sous condition de résidence dans les termes<br />
de l'article 3, qui ne s'est pas fait mettre en possession dans un délai de six<br />
mois, ou qui n'a pas installé sa famille dans un délai d'un an à partir du<br />
— terme qui lui a été assigné par son acte de concession<br />
2°<br />
; Le concession<br />
naire admis par application des articles 7 et 8, qui ne s'est pas installé avec sa<br />
famille dans un délai de six mois à partir du terme fixé dans l'acle de trans<br />
mission notifié à l'administration par l'entreprise de peuplement;<br />
— 3°<br />
Le<br />
concessionnaire indigène, admis à titre de récompense exceptionnelle, qui<br />
ne s'est pas installé avec sa famille dans un délai de six mois à partir du<br />
jour où son admission lui a été notifiée ;<br />
judicataire d'une concession, à charge de résidence,<br />
— 4° Le concessionnaire ou l'ad<br />
qui ne s'est pas ins<br />
tallé dans un délai de trois mois à partir du jour où lut est notifiée l'autori<br />
sation de cession, ou trois mois après la dale de l'adjudication — 5o<br />
; Le<br />
concessionnaire, cessionnaire ou adjudicataire qui, après s'être installé sur la<br />
concession, va habiter ailleurs, ou qui,<br />
au cours de la période quinquen<br />
nale de concession provisoire, s'est absenté pendant plus de six mois sans y<br />
— avoir été autorisé 6°<br />
; Le concessionnaire admis en vertu et dans les<br />
termes de l'article 4 qui, dans un délai de six mois à dater du jour où son<br />
admission lui a été notifiée, n'a pas installé les familles composant l'effectif<br />
prescrit ou qui, dans les deux ans à partir du même jour,<br />
les constructions exigées ;<br />
— 7° Le même concessionnaire qui,<br />
n'a pas achevé<br />
pendant six<br />
mois, laisserait incomplet l'effectif de familles prescrit par son titre --<br />
;<br />
8° L'adjudicataire d'une terre concédée avec dispense de résidence, qui se<br />
placerait dans l'un des cas prévus aux n°s 6 et 7 ;<br />
— 9° Le concessionnaire,<br />
cessionnaire ou adjudicataire admis comme étant en instance de naturalisa<br />
tion et dont la demande aurait été rejetée ou qui s'en serait désisté ; —<br />
10° Le concessionnaire,<br />
cessionnaire ou adjudicataire admis sur sa décla<br />
ration qu'il n'est el n'a pas été détenteur de terres domaniales dans les con<br />
ditions énoncées à l'article 2, § 3,<br />
songère.<br />
et dont la déclaration serait reconnue men<br />
— « Art. 18. La déchéance est prononcée par le Préfet ou le Général com<br />
mandant la Division, —<br />
suivant le territoire. L'arrêté de déchéance est notifié<br />
administrativement à l'atlributaire en son domicile, ou, si ce domicile n'est<br />
—<br />
pas connu, à la mairie de la situation des biens. Il est transcrit.gratis.<br />
« Art. 19. — Si les conditions imposées par l'acle de concession n'onl reçu
'<br />
"<br />
324<br />
aucun commencement d'exécution, l'attributaire peut, dans un délai de trente<br />
jours, à partir de la notification, former opposition à l'arrêté de déchéance<br />
devant le Conseil de préfecture,<br />
« Art. 20. —S'il y a eu commencement d'exécution, l'arrêté de déchéance<br />
est précédé d'une mise en demeure adressée à l'attributaire, par acte admi<br />
nistratif, notifié comme il est dit à l'article précédent, d'avoir à se conformer<br />
aux clauses du contrat dans un délai de trois mois. —<br />
Ce<br />
délai expiré, et<br />
faute par l'attributaire d'avoir produit les justifications nécessaires, le préfet<br />
ou le général commandant la division, suivant le territoire,<br />
déchéance,<br />
qui est notifiée comme ci-dessus.<br />
— L'attributaire<br />
prononce la<br />
et tous inté<br />
ressés peuvent, dans un délai de trente jours, à partir de ladite notification,<br />
former opposition à l'arrêté de déchéance devant le Conseil de préfecture.<br />
« Si l'arrêté est confirmé, et que néanmoins des améliorations utiles et per<br />
manentes aient été réalisées par l'attributaire, le Conseil de préfecture en fixe<br />
le montant el prescrit la vente aux enchères publiques, à la date par lui fixée<br />
aux clauses el conditions imposées au concessionnaire primitif. — L'attri<br />
butaire déchu reste en possession jusqu'au jour de la vente. —<br />
L'adjudica<br />
tion a lieu par voie administrative. Sont admis à y concourir tous enché<br />
risseurs d'origine européenne, à l'exclusion» de l'attributaire déchu et des<br />
individus déjà attributaires de lerres domaniales. —<br />
Le<br />
prix de l'adjudica<br />
tion, sous déduction des frais et compensation faite des charges, s'il y a<br />
lieu,<br />
est dévolu à l'attributaire déchu ou à ses ayants cause jusqu'à con<br />
currence du montant des améliorations réalisées par lui. En cas d'insuffisance,<br />
le concessionnaire déchu ne peut — réclamer aucune indemnité. Le<br />
surplus, s'il y en a, est versé au Trésor public.<br />
« Art. 21. —<br />
Si le concessionnaire contre lequel la déchéance est pro<br />
noncée a hypothéqué dans les conditions énoncées au titre III l'immeuble à<br />
lui concédé, l'arrêté de déchéance est notifié au prêteur, qui a un délai de<br />
trois mois à partir du jour de ladite notification pour réquérir la venle dudit<br />
immeuble. —<br />
L'adjudication<br />
crites à l'article précédent. —<br />
a lieu dans les formes et conditions pres<br />
Le<br />
prêteur exerce sur le prix les droits de<br />
préférence résultant de l'hypothèque consentie à son profit, sans que l'État<br />
puisse se prévaloir de la cause de résolution qui résulterait aux termes de<br />
l'article .2125du<br />
teur.<br />
« Art. 22. —<br />
Code<br />
Titre v. — De.<br />
civil, de la déchéance prononcée contre l'emprun-<br />
la délivrance du titre définitif de propriété.<br />
A l'expiration de la période quinquennale qui suit la conces<br />
sion provisoire, le concessionnaire à charge de résidence ou son ayant cause<br />
régulièrement investi adresse, suivant le territoire, au Préfet ou au Général<br />
commandant la Division,<br />
propriété. — Le<br />
une demande en délivrance du titre définitif de<br />
concessionnaire dispensé de la résidence en vertu de l'ar-
325<br />
ticle 4, joint à l'appui de sa demande, l'état descriptif de la situation actuelle,<br />
de la terre concédée et le compte des travaux exécutés. — Un<br />
récépissé de la<br />
demande et des pièces y sonl jointes, s'il y a lieu, est délivré au demandeur<br />
par le Secrétariat général de la Préfecture ou par le Bureau civil de la Di<br />
vision .<br />
« Art. 23. —<br />
Dans<br />
les deux mois delà date du récépissé, le Préfet ou le<br />
Général commandant la division remet au demandeur le titre définitif de<br />
propriété ou lui notifie un arrêté du Préfet ou du Général commandant la<br />
division, suivant le territoire, prononçant le rejet de sa demande pour cause<br />
d'inexécution des conditions imposées.<br />
« Dans ce dernier cas, le demandeur peut, dans le délai de trente jours, à<br />
partir delà notification qui lui esl faite, former opposition devant le Conseil<br />
de Préfecture. -<br />
Si<br />
l'arrêté est confirmé, et si, néanmoins, le Conseil de<br />
Préfecture reconnaît une plus-value donnée à la terre par le concession<br />
naire, le Conseil de Préfecture détermine la portion de terre qui esl attri<br />
buée au concessionnaire en représentation de la plus-value constatée, le<br />
surplus faisant retour à l'État, franc et libre de toute charge, ou il fixe<br />
l'indemnité due au concessionnaire et il ordonne la mise en vente du lot<br />
dans les formes prescrites par le paragraphe 6 de l'article 20- Le concession<br />
naire peut toujours requérir la vente aux enchères de l'entière propriélé ;<br />
il reste en possession jusqu'au jour de l'adjudication. —<br />
Si<br />
le concession<br />
naire a hypothéqué l'immeuble dans les conditions du titre III, il est pro<br />
cédé comme il a élé dit à l'article 21.<br />
« Art. 24. —<br />
A<br />
défaut de notification de l'arrêté de rejet, dans le délai<br />
de deux mois fixé par le paragraphe 1er de l'article précédent, la propriété<br />
définitive des terres concédées appartient audemandeur.<br />
Titre vi, —<br />
« Art. 25. —<br />
De la faculté d'obtenir le titre définitif de propriété avant<br />
l'expiration du délai de cinq ans .<br />
Après trois ans de résidence, le concessionnaire astreint à<br />
la résidence a la faculté de réclamer le tilre définitif de propriété en jus<br />
tifiant d'une dépense moyenne de 100 fr. par hectare réalisée en améliora<br />
tions utiles et permanentes, dont un tiers au moins en bâtiments d'habita<br />
tion ou d'exploitation agricole. Le concessionnaire qui tient ses droils d'une<br />
entreprise de peuplement doit, en oulre, justifier qu'il est complètement<br />
libéré envers ladite entreprise.<br />
— La<br />
même faculté appartient au bout de<br />
trois ans, au concessionnaire dispensé de la résidence qui justifie de l'ac<br />
complissement de toutes les obligations qui lui étaient imposées. —<br />
Dans<br />
les deux cas, il est procédé et statué conformément aux dispositions des<br />
deux premiers paragraphes de l'article 23.<br />
Titre vu. —<br />
« Art. 26. —<br />
De l'aliénation des terres domaniales par la voie de la vente.<br />
Le Gouverneur général est autorisé à prescrire,<br />
par arrêtés
326<br />
rendus en Conseil de gouvernement, la vante aux enchères publiques :<br />
1°. De lots de fermes situés dans les lieux qui ne peuvent se prêter à la for<br />
mation d'un village ;<br />
— 2°<br />
élre utilisées qu'au pacage.<br />
Des terres qui, dans leur état actuel ne peuvent<br />
« Les arrêtés déterminent les conditions de la vente et la contenance<br />
des lots. —<br />
Toutefois,<br />
prescrit par l'article 1er;<br />
l'élendue des lots de fermes est limitée aux maxima<br />
celle des lots des terres impropres à la culture<br />
peut être fixée sans maximum en raison de l'usage auquel elles peuvent<br />
être affectées. — Tous<br />
à l'adjudication.<br />
« Art. 27. —<br />
Le<br />
les enchérisseurs d'origine européenne sonl admis<br />
Gouverneur général peut également, le Conseil de gou<br />
vernement entendu, ordonner la vente, soit aux enchères, soit de gré à gré,<br />
aux conditions qu'il détermine,<br />
et sans conditions d'origine pour les acqué<br />
reurs, des lots dits industriels à former dans les centres de population.<br />
Titre vin .<br />
« Art. 28. —<br />
— De<br />
l'interdiction temporaire de vendre aux indigènes<br />
non naturalisés les terres d'origine domaniale .<br />
Il est interdit à tout individu devenu propriétaire d'une<br />
terre d'origine domaniale, par l'un des moyens énoncés au présent décret,<br />
à l'exception du cas prévu par l'article 27, de la vendre ou céder, sous<br />
quelque forme que ce soit, aux indigènes non naturalisés,<br />
riode de vingt ans si elle provient des lots de fermes,<br />
provient de lots de village. —<br />
sion définitive indiqué sur le titre de propriété.<br />
« Art. 29. —<br />
Les<br />
Ces<br />
pendant une pé<br />
et de dix ans si elle<br />
délais partent du jour de la conces<br />
ventes faites, dans les délais fixés par l'article précédent,<br />
aux indigènes non naturalisés, sont nulles et de nul effet. Les terres<br />
qui en auraient fait l'objet sont reprises entre les mains des acquéreurs, à la<br />
diligence de l'administration du Domaine et font retour à l'État, sauf pour<br />
les créanciers hypothécaires le droit de requérir la vente de la terre dans les<br />
formes et les — conditions énoncées à l'article 21. L'action du Domaine ne<br />
peut s'exercer qu'après l'expiration des délais de dix ans et de vingt ans ci-<br />
dessus fixés.<br />
Titre ix. —<br />
Dispositions générales.<br />
— « Art. 30. Pendant dix ans, à partir du jour de la concession, les terres<br />
qui en ont fait l'objet sont exemptes de tous impôts qui pourraient être éta<br />
blis sur la propriélé immobilière.<br />
» Art. 31. —<br />
Lorsque le concessionnaire décède avant l'expiration de la<br />
période de concession provisoire, ladite concession est transmise à ses héri<br />
tiers, si ceux-ci le requièrent et remplissent, d'ailleurs les conditions im<br />
posées à. leur auteur. — Les<br />
héritiers ont le droit de renoncer à la conces<br />
sion. En, ce cas, si des améliorations utiles et permanentes ont été réalisées
327<br />
sur le lot,, ils sont admis à requérir la venle aux enchères publiques de<br />
la concession dans les conditions de l'article 20. —<br />
Faute<br />
par eux d'avoir<br />
usé, dans le délai d'un an, à partir du décès de leur auteur, de l'un ou de<br />
l'autre des droits qui leur sont attribués par le présent article, le lot fait<br />
retour au Domaine. —<br />
Si, dans le cas prévu par le paragraphe 3 du présent<br />
article le concessionnaire a hypothéqué l'immeuble dans les conditions du<br />
titre III, le prêteur sera informé administrativement que les héritiers ont<br />
laissé écouler le délai d'un an, à partir du décès de leurs droits; à partir de<br />
cette notification, il aura un délai de trois mois pour requérir la venle de<br />
l'immeuble dans les conditions et les formes indiquées à l'article 21 .<br />
— Si<br />
le défunt tenait ses droils d'une entreprise de peuplement, les héritiers ne<br />
peuvent requérir la vente aux enchères qu'après avoir justifié du rembour-<br />
semenl à l'entreprise de toutes avances fai les par celle-ci à leur auteur.<br />
\ Art. 32. —<br />
Les attributaires de terres domaniales dans les conditions<br />
déterminées par le décret du 16 octobre 1871,<br />
ou par les décret; postérieurs<br />
sont admis, s'ils le requièrent, au bénéfice du présent décret et obtiennent<br />
la substitution à leur titre de bail d'un litre de concession provisoire ; le<br />
temps de résidence qu'ils onl accomplis comme locataires sous promesse de<br />
vente est déduit du délai qui leur serait imposé comme concessionnaire à<br />
titre provisoire ponr obtenir le litre définitif de propriété. Dans le cas où ils<br />
auraient usé de la faculté de transfert de leur bail à tilre de garantie, leur<br />
demande doil êlre accompagnée de la quittance régulière des emprunts con-<br />
tractés.ou du consentement des prêteurs bénéficiaires du transfert.<br />
« Art. 33. —<br />
Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables<br />
aux conventions antérieurement passées avec les sociétés et entreprises de<br />
peuplement ou de construction. Celles de ces conventions qui sont en cours<br />
d'exécution continuent à recevoir effet suivant leur teneur.<br />
« Art. 34. —<br />
Les titres tant provisoires que définitifs de concessions con<br />
senties en verlu des titres 1er, V et VI du présent décret, ainsi que les actes<br />
de cession et d'adjudication dans les cas prévus aux titres II, III et IV, sont<br />
visés pour timbre el enregistrés gratis. —<br />
Ils sont transcrits sans autres frais<br />
que le salaire du conservateur et les droits de timbre, le tout à la diligence<br />
de l'administration de l'enregistrement et des domaines, mais aux frais du<br />
titulaire,<br />
les mains du receveur de l'enregistrement de la situation des biens.<br />
qui doit déposer préalablement la somme présumée nécessaire entre<br />
—
328<br />
Toute hypothèque qui aurait été consentie par le concessionnaire en dehors<br />
des conditions et des formes énoncées auxdits articles est radiée à la requête<br />
de l'administration des domaines, sur le vu, dans le premier cas, de l'arrêté<br />
de déchéance et d'une déclaration du préfet, ou, suivant le territoire, du<br />
général commandant la division, constatant que ledit arrêté est devenu défi<br />
nitif, et, dans le second cas, sur le vu d'une déclaration des mêmes autorités<br />
constatant le rejet définitif de la demande en délivrance du titre de propriété.<br />
Si les hypothèques ont été consenties par application des art. 12 et 13, la<br />
radiation ne sera opérée qu'après l'expiration du délai fixé par l'art. 21.<br />
» Art. 36. —<br />
Le<br />
Journal officiel del'<br />
Algérie publie chaque trimestre l'état<br />
nominatif des personnes admises comme attributaires de terres domaniales<br />
dans les diverses conditions du présent décret, ainsi que la désignation des<br />
lots affectés à chacune d'elles.<br />
— « Art. 37. Est abrogé le décret du 15 juillet 1874,<br />
traire au présent décret.<br />
2 octobre 1878. —<br />
étendue,<br />
Arrêté<br />
en ce qu'il a de con<br />
accordant aux Juges de paix à compétence<br />
la franchise télégraphique avec les commandants des brigades de<br />
gendarmerie de leur ressort (1878, n°<br />
298.)<br />
— 4 octobre 1878. Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873,<br />
dans les douars des Oulad-Messaoud, commune mixte d'El-Arrouch (arron<br />
dissement de Philippeville) (1878, n»<br />
16 octobre 1878. —<br />
Décret<br />
295.)<br />
relatif à l'enregistrement des jugements et<br />
actes émanant des Cadis (Journal officiel du 24 octobre 1878.)<br />
'Vu l'article 56 du décret du 31 décembre 1859 sur la justice musulmane en<br />
Algérie, qui, en territoire civil, assujettit à l'enregistrement sur expédition, dans<br />
les trois mois de leur date, les jugements et actes emportant transmission de<br />
propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme, à loyer ou à rente,<br />
les sous-baux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de<br />
l'article 14 de la loi du 23 août 1871 qui fixe le minimum<br />
même nature ;<br />
— Vu<br />
du droit en sus encouru à défaut d'enregistrement desdits actes dans les délais<br />
déterminés ; —<br />
Considérant que la formalité de l'enregistrement est actuellement<br />
requise à la diligence des parties, que la négligence des indigènes ou leur igno<br />
rance des lois fiscales les exposent journellement à des pénalités souvent hors de<br />
proportion avec le droit simple de mutation ; qn'il importe,<br />
vue de remédier à cette situation ;<br />
23 mai 1878 ; —<br />
— Vu<br />
à tous les points de<br />
l'avis du Conseil de gouvernement du<br />
Sur le rapport du Ministre des finances et d'après les propositions<br />
du Gouverneur général civil de l'Algérie.<br />
- « Art. I". —<br />
Le délaide trois mois fixé par l'article 56 sus-visé du
329<br />
décret du 31 décembre 1859 pour l'enregistrement sur expédition des ju<br />
gements et actes dénommés audit article est porté à six mois, à partir de la<br />
date du jugement du de l'acte.<br />
« Art. 2. —<br />
Les<br />
cadis sont tenus d'établir une expédition de chacun des<br />
actes ou jugements de leur ministère, assujettis à l'enregistrement dans les<br />
conditions de l'article qui précède. Chaque expédition devra êlre déposée par<br />
le cadi rédacteur au bureau de l'enregistrement de sa circonscription, dans<br />
les trois mois de la date de l'acte ou du jugement, sous peine d'une amende<br />
de 10 francs par chaque acte ou jugement.<br />
« Art. 3. —<br />
Au<br />
moment de la réception de l'acte ou du prononcé du<br />
jugement, le cadi avertit les parties intéressées qu'elles auront à se présenter,<br />
dans un délai de six mois, à partir de la date de l'acte ou du jugement, au<br />
bureau du Receveur de l'enregistrement pour retirer l'expédition etacquitter<br />
les droits de mutations exigibles. —<br />
sera faite dans l'acte ou dans le jugement,<br />
10 francs.<br />
Mention<br />
expresse de cet avertissement,<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.).<br />
sous peine d'une amende de<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />
17 mai 1878.<br />
Fau serment, — Serment supplétoire. — Chose jugée, —<br />
Action du ministère public, — Compétence.<br />
Dans une poursuite pour faux serment prêté dans une instance commer<br />
ciale, les juges de répression sont autorisés à admettre comme preuve de ce faux<br />
serment, une pièceproduite au cours d'une deuxième instance, alors surtout que<br />
les éléments de leur conviction sont puisés, en outre, dans tout ce qui résultait<br />
des débats et de l'enquête à laquelle il avait été procédé (l).<br />
Les Tribunaux correctionnels ont évidemment compétence pour déclarer<br />
l'existence d'un faux serment prêté devant les juges civils ou commerciaux, et<br />
on ne saurait leur opposer l'autorité de la chose jugée résultant de la décision<br />
même qui a été basée sur ce faux serment. De même, l'action du ministère<br />
public ne saurait être arrêtée par une semblable objection que l'art. 366 du<br />
Code pénal suffit à écarter.<br />
■<br />
(1) Voir Bull, Jud. 1878, p. 170, l'arrêt de la Cour l'espèce.<br />
d'Alger,<br />
confirmé dans
330<br />
Grange c. le Ministère public<br />
Sur le premier moyen tiré d'une prétendue violation des art. 154, 155,<br />
158 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué qui<br />
a déclaré le demandeur coupable de faux serment en matière civile, aurait<br />
formé sa conviction uniquement sur une quittance émanée du nommé<br />
Vitlel,<br />
quittance des termes de laquelle l'arrêl attaqué aurait tiré cette con<br />
séquence qu'il avait existé entre le demandeur Grange et le nommé Tixier,<br />
une association pour l'exploilalion de coupes de bois provenant de la suc<br />
cession de feu Prud'homme, et par suite que ledit demandeur avait fait un<br />
faux serment en affirmant, sous serment, le 16 décembre 187 5 devant le<br />
que jamais il n'avait été l'associé de Tixier pour les<br />
Juge de Paix de Batna,<br />
coupes de bois en question, el ce, pour donner exécution à l'arrêt rerîdu le<br />
25 juin 1875, par la Cour d'appel d'Alger, qui, jugeant au [commercial,<br />
avait déféré audit Grange le serment supplétoire ;<br />
Attendu que l'arrêt attaqué s'est, il est vrai, fondé sur les termes de la<br />
quittance qui avait élé produite par Grange lui-même, au cours d'une se<br />
conde instance introduite par Tixier postérieurement à l'instance qu'avait<br />
terminée l'arrêt du 25 juin 1875, mais que, des termes de cette quittance,<br />
l'arrêt attaqué a conclu, avec raison, que la preuve était faite de -l'existence<br />
— de l'association déniée par Grange ; Que d'ailleurs, ledit arrêt ne s'est<br />
— pas contenté de s'appuyer sur les termes de celle quittance; Qu'il a tiré,<br />
en outre, les éléments de sa conviction de tout ce qui résultait des débats et<br />
— de lVnquêle à laquelle il avail été procédé ; Que dans ces circonstances,<br />
il échel de reconnaître que l'arrêl attaqué en statuant comme il l'a fait, n'a<br />
violé aucune des dispositions de loi invoquées par le demandeur';<br />
—Que le<br />
premier moyen n'est donc pas fondé ;<br />
Sur le second moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait violé les règles<br />
de la compétence et méconnu l'autorité de la chose jugée;<br />
Attendu que, ce moyen est fondé sur cette circonstance que Grange ayant<br />
prêté le serment supplétoire au moyen duquel a été rejelée la demande de<br />
Tixier,<br />
a obtenu un arrêt définitif qui ne peut êlre attaqué devant la juri<br />
diction correctionnelle;<br />
Attendu que l'article 366 du Code pénal, en déclarant que le faux serment<br />
prêté devant les juges civils ou commerciaux pouvait donner matière à des<br />
poursuites correctionnelles, a établi que la juridiction correctionnelle saisie<br />
de poursuites de celle nalure, ne peut êlre arrêtée dans l'exercice de ses<br />
attributions ni par une question de compétence,<br />
ni par une question de<br />
chose jugée ;<br />
Qu'admettre le contraire serait poser un obstacle infranchissable à l'exer<br />
cice du pouvoir des Tribunaux de répression appelés à statuer conformément<br />
à la loi sur un délit puni par les lois el déféré à un Tribunal par le minis<br />
tère public;<br />
Que si, dans l'espèce, il était établi, comme il l'a élé, que le nommé<br />
Grange avait prêté un faux serment devant la justice civile, il est évident que<br />
le Tribunal correctionnel avait, de par la loi, compétence pour connaître<br />
du délit qui lui était soumis ;<br />
Que c'est donc, à tort, que le demandeur dénie la compétence de la juri-
331<br />
diction correctionnelle et invoque l'autorité de la chose jugée ; — Que le<br />
deuxième moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier ;<br />
Sur le troisième moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1366<br />
du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué aurait donné une extension illégitime<br />
à la formule du serment prêté par Grange;<br />
Attendu que, s'il est vrai, que parmi les coupes de bois que Tixier disait<br />
avoir exploitées avec Grange, et qui dépendaient de la succession de feu<br />
Prud'homme,<br />
il en existait une qui ne provenait pas directement de l'adju<br />
dication prononcée par le notaire Champeroux au profil de Grange, il est<br />
constant que cette coupe définitivement adjugée au nommé Viltel, a élé par<br />
— ce dernier rétrocédée à Grange et Tixier ; Que dans ces circonstances, le<br />
Tribunal de répression élait fondé à admettre que Grange appelé à prêter<br />
serment sur la question de savoir s'il avait existé entre lui et Tixier une<br />
association pour l'exploitation des coupes provenant de la succession<br />
Prud'homme, avait compris dans son serment, dont les termes sont des plus<br />
—<br />
absolus et des plus généraux, toutes les coupes qui avaient été adjugées;<br />
Que l'interprétation du serment prêté par Grange a donc été faite légalement<br />
par l'arrêt attaqué ;<br />
Que de tout ce que dessus, résulte que son pourvoi ne peut être admis ;<br />
Par ces motifs ;<br />
— Rejetie<br />
le pourvoi formé par Antoine Grange contre<br />
l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger (Chambre correctionnelle) du 23 novembre<br />
1877, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq cenls francs<br />
d'amende pour faux serment en matière civile.<br />
M. Berthelipî, cons. rapp.; M. Benoist, av.-gén. (concl. conf.);<br />
M. Chambareaud, av.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />
22 juin 1878.<br />
Action publique. — Ministère public» — Tribunal<br />
sion. — Compétence.<br />
de répres<br />
L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires<br />
auxquels elle est confiée par la loi.<br />
Les officiers du Ministère public ont seuls (à défaut de la partie civile) le<br />
droil de saisir les Tribunaux de répression conformément à la loi.<br />
Il n'appartient donc pas à un Tribunal de répression, notamment à un<br />
Tribunal de simple police (excepté le cas de délit d'audience), de se saisir lui-<br />
même, et s'il prononce unjugement dans de telles conditions, celle décision<br />
doit être annulée pour excès de pouvoirs et violation de la loi (1).<br />
(1) Jurisp. Conf. Cass. 10 sept. "1836 (J. du Pal, 1837., 1. p. 543). Cass. 20,<br />
déc. 1845 (J. duPal., 1846., 2. p. 48). Montpellier, 24 mars 1851 (7. du i>aJ.,1852.<br />
1. p. 38).
332<br />
Abdelkader bou Hanoun.<br />
Statuant sur le pourvoi de l'administrateur remplissant les fonctions de<br />
Ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Cassaigne<br />
(Algérie) ;<br />
Sur le premier moyen pris de la .violation des articles 1, 11, 15, 21, 145,<br />
147 du Code d'instruction criminelle,<br />
en ce que le Tribunal de simple po<br />
lice a prononcé une condamnation alors que aucune poursuite n'avait été<br />
■ intentée par le Ministère public ;<br />
— Vu ces articles ;<br />
— Atlendu que, aux<br />
termes de l'art l«r du Code d'instruction criminelle, l'action pour l'appli<br />
cation des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée<br />
— par la loi; Que d'après les dispositions de l'art. 15 du même Code, les<br />
procès-verbaux dressés par les fonctionnaires désignés dans l'art. Il, doi<br />
vent être remis, avec tous renseignemenls et pièces, à l'officier qui remplit<br />
les fonctions du Ministère public, près le Tribunal de simple police;<br />
Qu'il appartient à cet officier et à lui seul (à défaut de partie civile), de saisir<br />
le Tribunal de simple police, conformément aux art. 21, 145, 147 du même<br />
— Gode ; Qu'il résulte des dispositions légales précitées, qu'un Tribunal de<br />
répression, excepté le cas de délit d'audience, ne peut se saisir lui-même,<br />
en matière<br />
qu'il doit êlre saisi par Impartie publique ou par la partie civile,<br />
de police correctionnelle ou de simple police ;<br />
Altendu, en fait, que le Juge de paix de Cassaigne, après avoir dressé<br />
procès-verbal contre Abdelkader bou Hanoun, pour avoir contrevenu à l'ar<br />
en s'abstenant de se<br />
rêté du Préfet d'Oran du 30 mars 1875, art. 1«, g 30,<br />
rendre sur simple invitation devant ce Magistral procédant à une informa<br />
tion criminelle, « l'avait invité à comparaître à son audience publique du<br />
« 23 mars 1878, pour être statué à l'égard de ce procèsverbal,<br />
conformé-<br />
« ment à l'art. 2 de ce même arrêfé. » — Que<br />
le 23 mars le Ministère pu<br />
blic, loin de s'approprier la poursuite irrégulièrement intentée par un<br />
Magistrat dépourvu de tout pouvoir légal pour la prescrire, avait déclaré à<br />
l'audience « faire ses réserves, en ce qui concernait les poursuites ordonnées<br />
« non par le Ministère, —<br />
mais par le Juge de paix seul.»<br />
Atlendu<br />
—<br />
que le<br />
Tribunal de police, en se considérant comme valablement saisi et en pro<br />
nonçant une condamnation à l'amende contre le sus-nommé qui n'avait pas<br />
été poursuivi par le Ministère public a commis un excès de pouvoir et a<br />
violé les dispositions des articles précités ;<br />
Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens<br />
proposés,<br />
— Casse et annule sans renvoi le jugement rendu le 23 mars<br />
1878, par le Tribunal de simple police du canton de Cassaigne, contre<br />
— Abdelkader bou Hanoun ; Ordonne que le présent arrêt sera imprimé,<br />
qu'il sera transmis sur les registres du Tribunal de simple police du canlon<br />
de Cassaigne et que mention en sera faite en marge de la décision annulée,<br />
à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation .<br />
M. Saint-Luc Courborieu, cons. rapp. ; M. Petiton, av.-gén.
i 333<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
25 juin 1878.<br />
premier président.<br />
Saisie-gagerie. — Bail à colonage partiaire. — Avances faites<br />
au colon partiaire. — Remboursement, —<br />
bilité.<br />
Date<br />
d'exigi<br />
Le privilégedu propriétaire établi par l'art. 2102 du Code civil s'étend<br />
indistinctement à toutes les obligations dérivant du bail (1).<br />
La voie de la saisie-gagerie qui a pour objet de mettre à la disposition du<br />
propriétaire une procédure prompte et facile pour arriver à la réalisation<br />
de son gage, s'applique, non-seulement aux loyers et fermages échus, comme<br />
semblerait l'indiquer le texte de l'article 819 du Code de pr. civ., mais à<br />
toutes les créances se rattachant à l'exécution du bail, ainsi qu'il doit résulter<br />
de l'étroite corrélation existant entre cet article et la disposition de l'art. 1202<br />
du Code civil (2).<br />
Ces principes applicables au bail à ferme,<br />
le sont également au bail à colo<br />
riage partiaire, notamment pour les avances faites par le propriétaire au<br />
colon ; en effet, bien que le coloriage partiaire ait quelques affinités avec la<br />
société, le caractère dominant de ce contrat n'en est pas moins le bail (3).<br />
Toutefois, la saisie-gagerie ne peut être pratiquée par le propriélaire que<br />
pour les avances exigibles, et sauf stipulation contraire, les avances ne sont<br />
exigibles qu'après que le métayer, par la vente de sa part de fruits, s'est<br />
procuré les ressources nécessaires au remboursement ; en conséquence, il faudrait<br />
considérer comme faite prématurément et sans droit,<br />
une saisie-gagerie inter<br />
posée par le propriélaire avant que la récolte des fruits ait été recueillie et<br />
partagée. —<br />
Une<br />
telle saisie-gagerie doit, en conséquence,<br />
être annulée et<br />
peut même entraîner des dommages-intérêts à rencontre du propriétaire (4) .<br />
(1) Voir Dalloz, Code civ. annoté, sur l'art 2102, nos 78 et suiv.<br />
(2) Jurisp. conf. Besançon, 3 juin 1824 (D. Rép,<br />
9 juillet 1860 iD. 1860, 5. p. 340). —<br />
n°<br />
v°<br />
saisie-gagerie,<br />
1876 (D. 1876,1. 269).<br />
26). Caen, —<br />
v°<br />
saisie-gagerie, n"<br />
9). Lyon,<br />
Contra, Orléans, 10 déc. 1812 CD. Rép.<br />
4 fév. 1839 (cod. loco). Voir aussi Cass., 4 avril<br />
. (3) Jurisp conf, Aix, 6 février 1822 (D . Rép. v°<br />
saisie-gagerie,<br />
(4) L'arrêt nous paraît aller un peu loin en disant que les avances ne sont exigi<br />
bles que lorsque le métayer aura pu se procurer des ressources par la vente de<br />
sa part de fruits : il nous semble que, dès que la perception et le partage ont eu<br />
lieu ayant pour corollaire naturel le droit pour le colon de disposer des produits<br />
du fonds, le propriétaire a le droit d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts. (D.<br />
Rép. v° Louage à coton, part,, n° 18).<br />
n"<br />
8).
334<br />
Dibos c. consorts Devisât.<br />
Attendu que Dibos tenait à bail, par colonage partiaire, un immeuble<br />
— appartenant aux héritiers Deynat ; Qu'à la dale du 8 septembre 1877, les<br />
bailleurs ont fait pratiquer sur le colon, une saisie-gagerie pour avoir rem<br />
— boursement deJeurs avances; Attendu que Dibos demande la nullité de<br />
celle saisie-gagerie, comme faite en violation de l'article 819 du Code de<br />
procédure civile ;<br />
— En droit; Attendu que le législateur, prenant en considération la fa<br />
veur due au propriélaire locateur, voulant, d'autre part, faciliter ce contrat<br />
de louage qui a dans noire organisation sociale une si grande importance, a<br />
institué un privilège pour les créances résultant de l'exécution du bail, (ar<br />
— ticle 2102 du Code civil) ; Que ce prjvilége a élé établi à la fois dans<br />
l'intérêt du bailleur à qui il assure l'exécution des conditions du bail, dans<br />
l'intérêt du preneur à qui il assure ainsi un crédit nécessaire ;<br />
s'étend à toutes les obligations dérivant du bail sans distinction ;<br />
— Qu'il<br />
— Altendu<br />
que le Code de procédure civile a eu pour bul de sanctionner les principes<br />
du Code civil et qu'en matière de bail spécialement, le législateur, fidèle à la<br />
même pensée, a complété le système de l'article 2102 en organisant une<br />
procédure prompte el facile pour la réalisation du gage du propriélaire ;<br />
Que tel esl l'objet de la saisie-gagerie déjà pratiquée sous noire ancienne ju<br />
risprudence, présentant alors ce caractère marqué de faveur pour le pro<br />
priétaire, introduite dans notre législation moderne dans le même but el<br />
— presque dans les mêmes termes ; Que l'esprit de la loi est clairement<br />
attesté par M. Berlier dans l'exposé des motifs et surtout par le Tribun Tar-<br />
rible ;<br />
— Que<br />
tous les deux expriment l'étroite corrélation qui existe enlre<br />
l'article 2102 du Code civil et l'article 81 9 du Code de procédure, el qu'ils<br />
déclarent que cette dernière disposition est partie pour assurer l'efficacité<br />
—<br />
du privilège concédé au propriétaire ; attendu que ces précédents et ces<br />
commentaires officiels permettent, sans témérité, de ne pas s'arrêter à une<br />
— interprétation judaïque de l'article 819; Que, en se renfermant étroi<br />
tement dans la formule de l'article 819, on se tiendrait à la surface d'un<br />
— texte sans en pénétrer le véritable sens ; Qu'on romprait l'harmonie qui<br />
doit régner enlre le Code civil et le Code de procédure et qu'on fonderait,<br />
entre les créances résultant du bail, une distinction contraire aux intentions<br />
— Qu'alors que<br />
du législateur aussi bien qu'à la raison même de la loi ;<br />
toutes les créances dérivant du bail ont élé déclarées dignes de la même<br />
faveur,<br />
on arriverait à décider que les unes néanmoins seraient plus favo<br />
rables que les autres,<br />
poursuivies par voie de saisie-gagerie ;<br />
puisqu'elles ne seraient pas toutes susceptibles d'être<br />
— Que<br />
—<br />
cette solution, désastreuse<br />
pour le bailleur qui verrait souvent lui échapper un gage qui lui a été assuré<br />
par l'article 2102, serait également préjudiciable au preneur, dont le crédit<br />
serait amoindri, ou qui, pour éviter une saisie-gagerie, se trouverait exposé<br />
aux doubles frais d'une saisie gagerie restreinte et d'une saisie exécution ;<br />
Attendu, dès lors, que la voie de la saisie-gagerie est ouverte au pro<br />
priélaire pour toutes les — créances résultant de l'exécution du bail; Que<br />
ces principes, applicables ati bail à ferme, le sont également au bail à colo<br />
riage partiaire, notamment pour les avances faites par le propriétaire au
colon ;<br />
— Que<br />
335<br />
telle était laloitsuivie sousnotre ancienne jurisprudence et<br />
que telle doit encore êire la solution sous l'empire du Code civil, car, si le<br />
colonage partiaire ,a<br />
quelques affini|és avec la société, le caraclère prédo<br />
minant de ce contrat est celui du bail ;<br />
— Qu'il<br />
n'y a donc pas lieu, pour<br />
ce motif au moins, d'annuler la saisie-gagerie au 28 septembre 1877 ;<br />
— En fait ; Atlendu qu'en l'absence de toute stipulation, les avances faites<br />
par un propriétaire au métayer ne sont exigibles qu'après que le métayer<br />
par la vente de sa part de fruits, s'est procuré les ressources nécessaires au<br />
—<br />
remboursement; Qu'au moment où la saisie-gagerie a été interposée, la<br />
récolte des blés seule était recueillie et non partagée, celles plus importantes<br />
Qu'ainsi,<br />
des tabacs et des vins n'étaient pas même faites ;<br />
—<br />
celle saisie<br />
était cerlainemenl prématurée, par suite, faite sans droit, el que sous ce<br />
rapport, Dibos a éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation el pour<br />
— l'appréciation duquel la Cour possède les éléments suffisants ; Atlendu<br />
qu'il appert des documents versés au procès, que le sieur Dibos est actuel<br />
lement débiteur envers les héritiers Deynat, de la somme de 1610 fr. 65 c.<br />
pour avances, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont, derechef,<br />
prononcé contre lui condamnation pour celte somme ;<br />
En ce qui concerne la demande d'avances à faire, pour l'année 18~7-1878 ;<br />
— Adoplant les motifs des premiers juges ;<br />
Atlendu, enfin, que Dibos lui-même pour liquider sa situation a conclu à<br />
la nomination d'un séquestre avec pouvoir d'opérer le partage et la vente<br />
des récolles ;<br />
Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel et y faisant droit ;<br />
— Dit que la<br />
saisie-gagerie du 28 septembre 1877 était prématurée, puisque les avances<br />
—<br />
n'étaient pas alors exigibles; L'annule, en conséquence, par celte consi<br />
— dération de fait; Dit que celle saisie-gagerie prématurée a occasionné<br />
préjudice au sieur Dibos, et condamne les héritiers Deynat solidairement à<br />
cinq cents francs de —<br />
dommages-intérêts; Confirme la condamnation pro<br />
noncée par le Tribunal contre Dibos, en faveur des héritiers Deynat, de la<br />
somme de 1610 fr. 65 c, pour avances —<br />
; Maintient la disposition du ju<br />
gement qui rejette la demande de Dibos en 1500 fr. d'avances à faire pour<br />
l'année 1877-1878 ;<br />
— Ordonne<br />
le séquestre des meubles, fruits et récoltes<br />
saisis gagés entre les mains du sieur Nicolaus, huissier, à Bouffarick ;<br />
— Dit<br />
que cet officier ministériel procédera, suivant les convenlions du bail, au<br />
partage des récolles; qu'il sera autorisé à vendre amiablement ou aux en<br />
chères, la part revenant à Dibos, pour sur le prix en provenant, altribuer<br />
aux héritiers Deynat, la somme de 1610 fr. 65 c, déduction faite de 500 fr.<br />
de dommages-intérêts à Dibos,<br />
sauf le droit pour ce dernier d'éviter la vente<br />
en remboursant ; —Maintiennes dispositions du jugement non contraires<br />
au présent;<br />
— Moyennant<br />
conclusions des parties;<br />
ce, dit n'y avoir lieu de statuer sur plus amples<br />
— Ordonne<br />
enfin, que les dépens de première<br />
instance et d'appel seront mis en masse, pour être supportés un tiers par<br />
deux tiers par Dibos.<br />
les héritiers Deynat,<br />
M. de Yaulx, subst. du Proc. gén.; M« F. ffùRÉ el Dazinièke, av.
336<br />
Nominations et mutations<br />
Par arrêté de M. le Procureur général près la Cour d'appel d'Alger en date<br />
du 10 septembre 1878:<br />
M. Matteï, greffier de la Justice de Paix à Inkermann est nommé Curateur<br />
aux successions vacantes dans le canton de ladite justice de paix, en rempla<br />
appelé à d'autres fonctions.<br />
cement de M. Lambert Gimey,<br />
Par décret en date du 8 octobre 1878, ont été nommés :<br />
Juge de paix de Relizane (Algérie), M. Brulfer, juge de paix à Gien, en<br />
remplacement de M. Bachan qui a été nommé juge de paix, à Vélines.<br />
Suppléant du juge de paix de Bougie (Algérie), M . Parés<br />
(Marius-Benjamin-<br />
Sébaslien-Laurent), en remplacement de M. Crance, démissionnaire.<br />
Par décret en date du 8 octobre 1878, ont été nommés :<br />
Interprèle judiciaire près le Tribunal de Tlemcen, Mohamed ben Mohamed<br />
ben el hadj Mohamed, en remplacement de M. Belaïch, décédé.<br />
Assesseur arabe près le Tribunal de lr« instance de Tizi-Ouzou, Si Salah<br />
ben Abdellif, en remplacement de Si Ahmed ben Djadoun, appelé à d'autres<br />
fonctions.<br />
Huissier près le Tribunal de 1« instance de Constantine, M. Courtois<br />
(Edouard), en remplacement de M. Scias, décédé.<br />
Par arrêté du Procureur général, près la Cour d'appel d'Alger,<br />
du 14 octobre 1878 :<br />
en date<br />
Le sieur Charles Perney, commis-greffier à la Justice de Paix de Relizane a<br />
élé nommé Curateur aux successions vacantes, dans le canton de cette<br />
justice de paix, en remplacement de M. Cariol, démissionnaire.<br />
L'ordre des Avocats près la Cour d'appel d'Alger a procédé, le 12 octobre,<br />
à l'élection du Bâtonnier et des Membres du Conseil de l'Ordre, pour l'année<br />
judiciaire 1878-1879. Ont élé élus :<br />
Membres du Conseil : MMes Honel .<br />
Me Mallarmé, Bâtonnier.<br />
Doudart de la Grée (Secrétaire) .<br />
Huré (Achille) .<br />
Baudrand.<br />
La Chambre des Avocats-défenseurs près le Tribunal civil de première<br />
instance d'Alger esl composée, pour l'année judiciaire 1878-1879, de :<br />
MM. Chatel. . . . Président.<br />
Blasselle. . . Rapporteur.<br />
Looover. . . . Membre.<br />
Letellieb. . , Secrétaire,<br />
Alger. — Typ. A. Joubdar.
2e année. —<br />
Ier Novembre 1878. —<br />
IN0 45<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGERIE<br />
Dépens. —<br />
DOCTRINE. -<br />
Instance<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />
- LEGISLATION<br />
Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />
21 mai 1878.<br />
dirigée contre une femme mnrlée. —<br />
Séparation de biens. —<br />
Conclusions.<br />
Mari.<br />
Lorsqu'il résulte des conclusions reproduites dans les qualités, qu'un mari<br />
séparé de biens d'avec son époute,<br />
ne s'est pas contenté d'autoriser celle-ci à<br />
ester en justice, mais que, sans exciper de sa qualité d'éf-oux séparé de biens,<br />
ni de son prétendu défaut d'intérêt personnel, il a procédé d conclu avec elle,<br />
en s'associant à ses moyens d'attaque et de défense, c'est à bon droit que la<br />
condamnation aux dépens prononcée contre sa femme est prononcée conjointe<br />
ment contre lui.<br />
Époux Ben Chimol c. Sidi Laribi.<br />
Attendu que des conclusions reproduites dans les qualités de l'arrêt atla-<br />
qué, il résulte que Ben Chimol, époux en secondes rinces de la veuve Cohen-<br />
Scali, ne s'est pas borné à autoriser celle-ci à ester en justice ; que, sans<br />
exciper ni. Je sa qualité d'époux séparé quant aux biens, ni de son prétendu<br />
défaut d'intérêt personnel clans la cause, il a procédé el conclu avec sa femme,<br />
en s'associant à ses moyens d'attaque el de défense, tant en appel qu'en<br />
—<br />
première instance ; Qu'ayant ainsi pris une part directe et personnelle au<br />
fond du litige, il a assumé le risque d'en supporter les dépens en cas d'in<br />
succès ;— D'où il suit qu'en le condamnant à payer ces dépens conjointe<br />
ment avec sa femme, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'ait. 130 C. pr civ.,<br />
l'a sainement appliqué.<br />
Par ces motifs : Rejette.<br />
M. Aucher, cons. rapp. ; M Dssjardins, av. gén. (concl. conf.) ;<br />
Me Lehmann, av.
Vente à réméré. — Relocation<br />
de prix. — Contrat<br />
338<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (i'e Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
14 mai 1878.<br />
faite aux vendeurs.<br />
pignoratif. — Transcription<br />
Validité. — Faillite. — Créancier,<br />
— Vilité<br />
antichrèse.<br />
— Production.<br />
On doit considérer comme un contrat pignoratif, c'est-à-dire comme consti<br />
tuant en réalité un prêt à intérêt avec garantie immobilière, le contrat de venle<br />
à réméré avec la faculté de rachat à une époque fixe, portant relocation im<br />
médiate au vendeur el passé moyennant un prix qui est notablement inférieur<br />
à la valeur de l'immeuble (1).<br />
Il importe peu que le prix de relocation ne représente que l'intérêt au taux<br />
légal de la somme stipulée comme prix .<br />
Le juge doit restituer à ce contrat le véritable caractère qu'il y découvre,<br />
surtout si ces circonstances se rattachant au contrat lui-même sont corroborées<br />
par le fait que le prétendu acheteur a produit à la faillite de son vendeur, en<br />
prenant la qualité de prêteur clans cette production.<br />
Le caractère réel du contrat formé dans ces conditions, est celui d'un contrat<br />
de prêt à intérêt avec remise en antichrèse au créancier, d'un immeuble appar<br />
tenant à l'emprunteur.<br />
La transcription qui a été faite du contrat avec son apparence primitive de<br />
vente à réméré, répond suffisamment aux prescriptions de la loi du 23<br />
mars 1855 relativement à la transcription des actes constitutifs d' antichrèse.<br />
D'autre part, la deuxième condition exigée pour la régularité de l'anti-<br />
chrèse, consistant dans la remise de l'immeuble en la possession du créancier,<br />
se trouve également remplie par suite de la stipulation d'un loyer à payer par le<br />
débiteur ;<br />
créancier.<br />
— celte<br />
location constitue évidemment ce dernier détenteur pour le<br />
En conséquence, dans le cas où la faillite du débiteur aurait été déclarée, le<br />
créancier a le droit de se présenter comme ayant les droits d'un antichrèsiste<br />
sur les biens qui lui avaient été vendus en apparence.<br />
(1) Voir dans Dalloz, Rép. v°<br />
Nantissement, n05 293 et suiv. les caractères du<br />
contrat pignoratif et spécialement les distinctions suivant lesquelles il faut recon<br />
naître dans une vente à réméré, une vente sérieuse ou un prêt avec nantissement<br />
d'immeubles. Cpr. Cass. 31 janv. 1837 (D. Rép. v° Contrat de mariage, n° 3571).<br />
Cass. 23 déc. 1845 (D. 1854, t. 422) avec la note;<br />
—<br />
14 déc. 1843 (D.<br />
Orléans,<br />
cod. loco). Caen, 31 janv, 1851 (D. 1858, 2. 102). Trib. de (D. 1867,<br />
Lyon, 30 1863<br />
5.286).
339<br />
On serait mal fondé à soutenir que la production qui aurait été faite en<br />
termes purs et simples par le créancier, doit le faire considérer comme déchu du<br />
bénéfice de son antichrèse.<br />
En effet, en produisant à la vérification des créances d'une faillite, un créan<br />
cier n'est pas astreint par la loi à déclarer et faire constater à ce moment la<br />
qualité qui lui permettrait de réclamer un traitement plus favorable que celui<br />
des autres créanciers de la masse. Il ne pourrait être déchu des droits particu<br />
liers qui lui appartiennent, qu'au cas où il prendrait part au vote dans tes opé<br />
rations relatives au concordat.<br />
Robert c. Vinot, syndic Toullier.<br />
Atlendu que Vinot, liquidateur de l'atif de la faillite de Claude-Marie Toui<br />
ller, soutient que l'actedu 18 novembre 1871 est un contrat pignoratif;<br />
— Que<br />
Robert, à celte époque, prêtait 20,000 francs -à Claude-Marie Toullier qui<br />
était le véritable propriétaire des immeubles énoncés au contrai et dont<br />
Pierre-Marie Toullier, Léon Landy el les époux Henri Landy n'étaient que le<br />
— prête-nom ; Que Robert prétend, au contraire, que l'acle du 18 novembre<br />
1871 est sincère et en demande l'exécution ;<br />
— Attendu que la question<br />
principale du procès est donc celle de savoir qu'elle est la nature de cet acte,<br />
ce qu'il faut rechercher tout d'abord ;<br />
Atlendu que l'acte du 18 novembre 1871, envisagé dans ses termes, esl un<br />
contrat de venle d'immeubles avec faculté de rachat consenti à Robert par :<br />
1» Pierre-Marie Toullier; 2° Léon Landy; 3° les époux Henry Landy, ces<br />
derniers comparant en personne et les deux premiers représentés par Claude-<br />
— Marie Toullier, leur mandataire ; Attendu que : 1° Pierre-Marie Toullier ;<br />
2° le syndic de la faillite de Léon Landy ; 3° Jean Landy, dont la femme est<br />
décédée et qui esl le tuteur de ses enfants mineurs, c'est-à-dire ceux qui ont<br />
comparu comme vendeurs dans l'acte du 18 novembre 1871, où leurs repré<br />
sentants déclarent, dans leurs conclusions, qu'ils n'entendent pas s'immiscer<br />
dans le débal qui s'agile enlre Vinot et Robert, reconnaissant qu'ils ne<br />
peuvent contester les prétentions de Vinot et demandent acte de ce qu'ils<br />
—<br />
s'en rapportent à justice ; Attendu que leurs déclarations viennent à l'appui<br />
des dires de Vinot sur le caractère du contrat dont il s'agit et que les clauses<br />
— de ce contrai ne laissent aucun doute à cet égard ; Qu'en effet il contient<br />
relocation immédiate aux vendeurs moyennant l'intérêt à 10 p. % du prix de<br />
la vente, sans déterminer même la durée pour laquelle esl faite celle reloca<br />
— tion ; Que la faculté de rachat ne peut s'exercer qu'à l'échéance fixe de<br />
cinq années, ni avant ni après, ainsi que cela résulte d'une clause ainsi con<br />
« çue: Mais à défaut par eux d'user de ce droil dans le délai assigné sans<br />
» qu'il puisse êlre exercé avant, l'acquéreur demeurera dès lors l'acquéreUr<br />
» incommulable. Qu'il<br />
» —<br />
y a vililé de prix, ce prix étant de 20,000 francs<br />
seulement, alors que les immeubles vendus consistent dans une étendue de<br />
2,024 hectares environ, dont 289 c'est-à-dire hectares, la septième partie<br />
seulement, onl été depuis vendus 13,506 soit plus flancs, des deux liers du<br />
prix de 20,000 francs;<br />
Atlendu que la faculté de rachat accordée aux prétendus vendeurs, pour<br />
une époque fixe, la relocation faite moyennant l'intérêt légal en Algérie du
3i40<br />
prix de vente sans du,réfii>déJtelrminée,?la,vvililê du prixv lout dans l'acte du<br />
18 noyènjbre 1871, concourt^ démontrer que les parties , n'ont pas voulu<br />
transférer réellement la propriété des immeubles értumèrés audit'çontrat ;<br />
— Qu'elles ont vouju seulement que ces immeubles servissent de garantie<br />
— pour la sûreté d'un prêt de 20,000 francs que faisait Robert ; Que si la<br />
forme d'Une vente à réméré a été employée, il semble que ce soit parce que<br />
les procurations données à Claude-Marie Toullier par les vendeurs apparents<br />
ne contenaient pas le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ;<br />
— Attendu,<br />
d'ailleurs, que Robert lui-même a reconnu qu'il n'était que prêteur, en<br />
produisant, pour le capital de vingt mille francs et 3,500 francs d'intérêts<br />
échus et ne faisant admettre pour ces sommes au passif de la faillite de<br />
Claude-Marie Toullier, le 18 mars 1875; après vérification contradictoire<br />
enlre son mandataire et le syndic;<br />
Que si dans un acte de Durand, huissier,<br />
en dale du 14 avril suivant et<br />
enregistré à Rlida le même jour, Robert a déclaré à Vinot que c'était par<br />
erreur qu'il avait été admis à la faillite pour la somme de 20,000 francs.; si<br />
cette prolestalion pouvait avoir pour effet de détruire la qualité du-prêleur<br />
qui résultait pour lui de sa production, il n'en résulterait pas moins qu'en<br />
donnant dans cet acte la qualification de vendeur à Claude-Marie Toullier,<br />
Robert a reconnu que l'acte du 18 novembre 1871 n'était pas sincère, au<br />
moins en ce qui concerne les qualités prises dans cet acte par les personnes<br />
— qui contractaient avec lui ; Qu'on lit, en effet, dans l'exploit du 14 avril,<br />
que faute par le liquidateur de payer les loyers dans les vingt-quatre heures,<br />
il y serait contraint avec les autres vendeurs ;<br />
Attendu qu'il suit de ce qui vient d'être dil, touchant le contrat du 18 no<br />
vembre 1871, que ce contrat, s'il élait maintenu tel qu'il, apparaît, violerait<br />
les dispositions de l'article 2088 du Code civil, portant que le créancier auquel<br />
son immeuble a été remis en nantissement ne devient point propriélaire de<br />
cel immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu, et que toute<br />
clause contraire est nulle ;<br />
— Mais<br />
que ce contrat qui devrait recevoir exé-<br />
culion's'il ne contenait pas implicitement le pacle compromissoire, puisque<br />
les parties ont pu faire d'une manière indirecte ce qu'elles avaient le droit de<br />
faire directement, doit être simplemenl modifié ;<br />
— Attendu<br />
que si l'on en<br />
supprime la clause prohibée, et si on lui restitue son véritable caractère,<br />
l'acte du 18 novembre 1871 est un contrat de prêta intérêt dans lequel les<br />
immeubles prétendus vendus ont élé remis par Claude-Marie Toullier. qui en<br />
était propriélaire, en antichrèse à Robert pour sûreté de la dette, laquelle<br />
étail de 20,000 francs, avec la stipulation prévue par l'article 2089 du Code<br />
civil que les fruits se compenseraient totalement avec les intérêts de la somme<br />
prêtée, intérêts fixés à 10 p %; ,'Q<br />
Altendu que rien ne s'oppose à ce que ledit contrat soit sanctionné avec le<br />
— caractère de contrat d'an lichrôse; Que l'on y trouve, en effet, les formes<br />
et les garanties exigées pour la constitution de l'anlichrèse qui ne s'établit<br />
que par écrit, exige la transcription de l'acte et la remise de l'immeuble en<br />
la possession du créancier;<br />
Atlendu, en effet, que ces conditions se rencontrent dans l'acte du 18 no<br />
— vembre 1871 ; Que cet acte, régulier en la forme adoptée, a été transcrit le<br />
27 novembre 1871 au bureau des hypothèques de Mostaganem; que la trans-<br />
.<br />
..
341<br />
cription ainsi opérée d'un acte emportant en apparence translation des im<br />
meubles y désignés, répond suffisamment aux prescriptions de l'article 2 de la<br />
loi des 23-26 mars 1855, portant que lout acte constitutif d'anlichrèse doit<br />
être transcrit, puisque cette transcription est plus ample que celle qu'exige<br />
ledit article et qu'elle a eu pour effet d'avertir suffisamment les tiers qu'au<br />
cun droit ne pouvait être utilement exercé, contre les anciens propriétaires,<br />
sur les fruits desdits immeubles ;<br />
Attendu, au point de vue de la possession, que le liquidateur soutient à<br />
tort que la remise des immeubles, objel du contrat, n'a pas élé faite à Robert ;<br />
que le contraire résulte de la clause portant que pour tenir lieu de la jouis<br />
sance conservée par ceux avec lesquels- il contractait, Robert recevrait<br />
— 20,000 francs par an ; Que celte location constitue le débiteur détenteur<br />
— pour le créancier et qu'il est ainsi satisfait au vœu de la loi ; Qu'on objec<br />
terait en vain qu'un tel mode de jouissance par le créancier, est de nalure à<br />
tromper les tiers, puisqu'aujourd'hui que l'anlichrèse n'a, si elle n'est trans<br />
crite, aucun effet contre les tiers, ceux-ci ne peuvent être induiis en erreur ;<br />
—<br />
Attendu, qu'aux termes de l'article 2087 du Code civil, le débiteur ne peut,<br />
avant l'enlier acquittement de la délie, réclamer la jouissance de l'immeuble<br />
— qu'il a remis en antichrèse ; Que l'événement de la faillite de Claude-<br />
Marie Toullier ne change rien à celte situation, puisque le titre de Robert a<br />
été régulièrement transcrit ; qu'en conséquence, et nonobstant l'inscription<br />
prise au nom de la masse des créanciers sur les immeubles du failli, les im<br />
meubles aujourd'hui détenus par Robert ne peuvent rentrer dans l'actif de<br />
la faillite, que grevés de, l'anlichrèse ; que Roberl est donc fondé à conserver<br />
la jouissance-desdits immeubles jusqu'au jour où il sera complètement rem<br />
boursé en capital, intérêts et frais de la somme de 20,000 francs qui a fait<br />
l'objet du contrat de prêt du 18 novembre 18^1 ;<br />
— Atlendu<br />
que pour<br />
repousser les conséquences de cet acle ainsi compris, le liquidateur soutient<br />
que Roberl, en.produisanl et se faisant admettre au passif de la faillite de<br />
Claude-Marie Toullier pour une somme de 23,500 francs, avait pris irrévoca<br />
blement la qualité de simple-créancier ;<br />
Mais attendu que la production à la faillite ne peut avoir une telle consé<br />
— quence ; Altendu, en effet, que tous ceux qui se prétendent créanciers<br />
d'un failli sont obligés de produire à la vérification ; mais que la loi ne les<br />
astreint pas à déclarer el faire constater, au moment où ils réclament leur<br />
admission au.passif, la. qualité spéciale qui leur permettrait de se faire traiter<br />
plus favorablement que d'autres ; — Que celui qui produit, n'a en vue que<br />
de faire reconnaître son titre de créancier et le droil qu'il a de participer à<br />
l'actif; que le silence qu'il garde sur la garantie de quelque nature qu'elle<br />
soit, qui peut êlre attachée à sa créance, ne porte aucun préjudice à la masse<br />
el qu'en définitive celle garantie, si elle existe, ne peut être perdue par lui<br />
qu'au cas où il. prendrait part au vote dans les opérations relatives au con<br />
—<br />
. cordat; Attendu» dès lors, que la production et l'admission, après affir<br />
mation delà sincérité de sa créance, au passif de la faillite pour 23,500 francs,<br />
sans que des réserves aient été faites au sujet de garanties atlachéesà la sûreté<br />
de ladite, créance et de nature, à- lui en assurer le paiement intégral, ne<br />
peuvent être invoquées contre Robert pour établir qu'il est simple créancier<br />
chirographaire et doit suivre le sort de la, masse ;
342<br />
Altendu, quant à l'importance des immeubles soumis à l'antichrèse, qu'au<br />
nombre des biens qui ont fait l'objet du 18 novembre 1871, se trouvaient<br />
1156 hectares dont Claude-Marie Toullier n'avait la propriété sous le nom de<br />
Léon Landy que jusqu'à concurrence d'un quart; que ces 1156 hectares ont<br />
élé vendus par licilation à la barre du Tribunal de Mostaganem ; qu'à cette<br />
licitation ont figuré Léon Landy et —<br />
Roberl; Qu'il ne s'agit donc plus<br />
aujourd'hui de la part indivise que possédait Claude-Marie Toullier dans ces<br />
1156 hectares, mais seulement du surplus des immeubles compris à l'acte de<br />
1871, lesquels sonl désignés dans le dispositif du jugement dont est appel ;<br />
—<br />
Attendu, en ce qui concerne le bordereau de collocation s'élevant à<br />
14,924 francs 41 centimes, représentant le quart du prix des immeubles ven<br />
dus sur la licitation dont il vient d'être parlé et dont Vinot demande la<br />
restitution contre Landy et Roberl, que Claude-Marie Toullier a figuré à la<br />
licitation et à ce qui s'en esl suivi par Landy son prête-nom ; que le liquida<br />
teur de sa faillite, représentant des créanciers qui n'ont pas plus de droils<br />
que n'en avait Claude-Marie Toullier, n'est pas fondé à réclamer le bordereau<br />
dont Robert e&t détenteur ; que s'il a reçu ce bordereau en qualité de pro<br />
priétaire apparent, Robert y aurait eu droil, d'après ce qui vient d'être<br />
décidé, comme créancier anlichrésiste, et que, d'ailleurs, en quelque<br />
apparente qu'il louche le montant de ce bordereau, la somme de 14,924 fr.<br />
41 centimes sera déduile de sa créance sur la faillite, ce qui ôte lout intérêt<br />
à la réclamation de Vinot;<br />
Attendu que, pour le cas où le liquidateur ne pourrait, sans recourir à la<br />
venle de la totalité ou d'une partie des immeubles soumis à l'anlichrèse,<br />
payer à Robert le complément de sa créance en principal, intérêts et frais, il<br />
est juste de décider,<br />
comme conséquence des droils de Robert et pour les<br />
sauvegarder, que le liquidateur serait tenu d'imposer à l'adjudicataire de<br />
payer en sus de son prix, dans les trois mois du jour de la venle, le solde en<br />
capital, intérêts el frais, de la créance de Robert et d'insérer au cahier des<br />
charges une clause portant que l'adjudicataire n'entrerait en jouissance que<br />
le jour où Roberl serait complètement désintéressé ;<br />
Attendu que, d'après le caractère reconnu à l'acte du 18 novembre 1871,<br />
Claude-Marie Toullier est le fermier des immeubles remis en nantissement à<br />
— Robert ; Qu'il convient donc de donner acte à celui-ci de ses réserves de<br />
faire valoir son privilège de locateur sur le prix des objets ayant garni la<br />
ferme, la somme qu'il pourrait toucher de cette manière devant, dans tous<br />
les cas, venir en déduction de sa créance;<br />
Altendu que Robert el Vinot succombant dans leurs prétentions respectives,<br />
il y a lieu d'ordonner qu'il soit fait masse des dépens exposés en appel par<br />
toutes les parties et de les mettre à la charge de Robert et Vinot dans des pro<br />
portions qui vont êlre déterminées;<br />
Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qui n'est<br />
pas contraire au présent : Statuant tant sur l'appel principal de Robert que<br />
sur l'appel incident de Vinot ;<br />
Reçoit lesdits appels et y ayant — tel égard que de raison ; Dit<br />
que l'acte<br />
du 18 novembre 1871 est un contrat de prêt à intérêt, avec constitution<br />
d'anlichrèse, au profit de —<br />
Robert; Dit que Claude-Marie Toullier n'a<br />
jamais cessé d'être propriélaire des immeubles soumis à l'antichrèse et énu-
343<br />
— mérés dans le dispositif du jugement dont est appel; Dit que Robert est<br />
créancier de la somme de 20,000 francs par lui versée à Claude-Marie Toul<br />
lier, le 18 novembre 1871, et portant intérêts au taux stipulé au contrat<br />
— dudit jour ; Dit que Roberl est fondé à retenir la jouissance des immeu<br />
bles précités, jusqu'au jour où il sera payé complètement en principal, inté<br />
rêts el frais, de ladite somme de 20,000 francs ;— Dit que le liquidateur n'est<br />
pas fondé à demander la remise du bordereau de 14,924 francs 41 centimes ;<br />
— Dit que dans le cas où Vinot, aujourd'hui seul liquidateur, mettrait en<br />
vente, avant d'avoir complètement désintéressé Roberl, la totalité ou une<br />
partie des immeubles soumis à l'antichrèse, il serait tenu d'imposer à l'adju<br />
dicataire de payer en sus de son prix, dans les trois mois du jour de la venle,<br />
le solde en capital, intérêts et frais de la créance de Robert, el d'insérer au<br />
cahier des charges une clause portant que l'adjudicataire n'enlrerait en<br />
— jouissance que le jour où Robert serait complètement désintéressé; En<br />
conséquence, infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé quelles liqui<br />
dateurs prendraient la libre disposition des immeubles vendus à Robert, el<br />
qu'ils seraient lenus d'imposer à l'adjudicataire de payer à Robert le solde de<br />
sa créance, en déduction de son prix el non pas en sus de son prix ;<br />
— Con<br />
firme le jugement dans le surplus de ses dispositions et ordonne qu'ainsi<br />
modifié et complété il recevra son entière exécution;<br />
— Dit<br />
qu'il sera fait<br />
mention du présent arrêt en marge de la transcription de l'acle du 18 no<br />
vembre 1871 el que les frais occasionnés par celle mention suivront le sort<br />
— des dépens ; Donne acte à Huvey, à Pierre-Marie Toullier, à Jean Landy, de<br />
— ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice; Donne acte à Robert des<br />
réserves qu'il fait de répéter la somme de 3,500 francs, solde de loyers, par<br />
privilège sur le prix de venle des effets mobiliers garnissant la ferme et<br />
— vendus par les soins du syndic ; Ordonne qu'il soit fait masse de tous les<br />
dépens d'appel, lesquels seront supportés, savoir : un quart par boberl et<br />
— trois quarts par Vinot; Condamne, en conséquence, Vinot à payer à<br />
Robert, à Huvey, à Pierre-Marie Toullier et à Jean Landy les trois quarts des<br />
dépens par eux exposés.<br />
M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />
Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />
24 juin 1878.<br />
Action. — Immeuble saisi. — Revendication. —<br />
saisi.<br />
— Demande<br />
Droits<br />
du<br />
en résolution d'une vente pour défaut<br />
de paiement du prix.<br />
L'action est inséparable du droil d'où elle dérive : en conséquence il n'ap<br />
partient qu'à celui-là même qui se prétend propriétaire d'un immeuble, de
344<br />
poursuivre par la revendication ou par une demande en distraction, son<br />
main/ien dans la propriété de cet immeuble saisi comme appartenant à<br />
autrui : et la partie saisie est sans qualité pour soulever une semblable de<br />
mande en se fondant sur ce que l'immeuble ne lui appartient pas, et de<br />
mander ainsi la nullité de la saisie.<br />
Le même principe doit êlre appliqué en ce qui concerne la demande en ré<br />
solution appartenant au vendeur pour défaut de paiement du prix d'une<br />
ancienne aliénation : la partie saisie serait de même irrecevable à soulever une<br />
semblable contestation .<br />
Tholançe c. de Junnemann.<br />
Attendu que l'action est inséparable du droit d'où elle dérive ;<br />
— Qu'il<br />
n'appai lient donc qu'au propriélaire d'uu immeuble de poursuivre en<br />
justice par la voie de la revendication ou d'une demande en distraction,<br />
son maintien dans la propriélé de cel immeuble saisi comme appartenant à<br />
—<br />
une autre personne; Qu'il en est de même pour la demande en résolu<br />
tion fondée sur le défaut de paiement du prix d'une ancienne aliénation;<br />
— Qu'en<br />
conséquence, à quelque point de vue qu'on se place, la partie saisie<br />
est sans qualité pour demander la nullité de la saisie en se fondant sur ce<br />
que l'immeuble ne lui appartient pas;<br />
Attendu dès lors, que sans qu'il soit besoin de rechercher si au moment<br />
de la saisie dont la nullité esl demandée, l'appelant élait ou n'était<br />
pas1<br />
pro<br />
priétaire de l'immeuble saisi ou s'il l'est devenu depuis, il faut décider<br />
comme l'ont fait les premiers juges, que la demande en nullité de laditesaisie<br />
n'est pas recevable;<br />
Par ces motifs ;<br />
— Confirme le jugement déféré;<br />
— Ordonne qu'il sera<br />
exécuté selon sa forme et teneur ;<br />
— Condamne l'appelant en l'amende et<br />
aux dépens.<br />
M de Vaulx, subst, du proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Présidence de M.<br />
PINET'<br />
DE MENTEYER, Conseiller.<br />
5 octobre 1877.<br />
Attentat à la pudeur. — Caractères constitutifs. — Outrage<br />
public a là pudeur. — Publicité,<br />
Il ne peut y avoir crime d'attentat àla pudeur que lorsque les circonstances<br />
de fait relevées sont par leur nature absolument exclusives du consentement de<br />
la victime : notamment des cris poussés par cette dernière, ne sauraient par
345<br />
eux-mêmes suffire à écarter l'idée d'une participation volontaire à l'acte hon<br />
teux qui a été commis (1).<br />
La publicité exigée par la loi pour caractériser le délit d'outrage public<br />
à la pudeur résulte suffisamment de ce fait que l'acte a élé commis dans une<br />
excavation sans clôture et où toute personne eût pu pénétrer sans obstacle pour<br />
voir ce qui se passait à l'intérieur (2 ) .<br />
Le Proc. Gén. c. Mohamed ben Mohamed.<br />
Attendu que Mohamed ben Mohamed quoique régulièrement assigné ne<br />
comparaît pas ;<br />
En ce qui concerne la compétence ;<br />
— Attendu que c'esl à tort que- les<br />
premiers juges ont cru voir dans les faits établis à la charge du prévenu les<br />
éléments constitutifs — du crime d'attentat à la pudeur ; Que rien ne<br />
prouve que Abd cl KaJer Ouled Soufi, âgé d'environ quinze ans, n'ait pas<br />
consenti à l'acte de sodomie reproché au prévenu elquecelui-ci ait usé de vio<br />
lence poui l'y contraindre; —Qu'il résulte, au contraire, des renseignements<br />
recueillis, que ce jeune homme se livre volontairement el habituellement à<br />
de pareils actes ;<br />
— Qu'il n'est point certain que les légères éraillures cons<br />
tatées sur sa personne soient le résultat d'aclesdc violence exercés sur. lui par<br />
le prévenu ;<br />
— Que<br />
les cris et les plaintes entendus par les témoins peuvent<br />
s'expliquer par la douleur qu'il ressenlail au moment même, sans que cette<br />
(i) Le principe admis par l'arrêt s'applique d'une manière spéciale à l'attentat à<br />
la pudeur consomméjni tenté avec violence. —_QuantJ]'attentat à la pudeur sans<br />
violence, qui n'est punissable que lorsqu'il a eu pour victime un enfant de moins<br />
de treize ans, ou qu'il a été commis sur la personne d'un mineur non émancipé par<br />
mariage, par un des ascendants de celui-ci, évidemment la loi a admis une sorte<br />
de présomption légale par suite de laquelle elle suppose qu'un consentement libre<br />
n'a pu être donné à l'acte répréhensible, soit à raison do l'âge de la victime, soit<br />
dans la deuxième hypothèse, à raison de l'abus d'autorité qui a dû s'exercer sur<br />
elle.<br />
(2) Lajurisprudence de la Cour de Cassation s'est fixée comme il suit sur la<br />
question de savoir quand se rencontrait la publicité nécessaire pour constituer le<br />
délit de l'art. 330 du Code pénal : Elle a décidé par arrêt du 2 janv. 1846 (D 1846,<br />
I. 46) que des rapports intimes liés avec une fille en rase campagne, à une heure<br />
avancée de la soirée, à distance d'un chemin et hors la présence de témoins, ne<br />
— constituaient pas un outrage public à la pudeur. De même, un arrêt de la<br />
même Cour en date du 16 janv. 1862 (D. 1862, I. 197) statue dans le même sens<br />
pour l'aote immoral commis en plein champ, s'il n'a été aperçu par personne et<br />
si personne n'a pu l'apercevoir. — D'autre part, la Cour de Cassation décidait<br />
dans le mémo arrêt qu'il y avait publicité lorsque l'acte avait eu lieu sur un sen<br />
tier même privé, mais reliant un lieu public à un autre lieu public, encore bien<br />
que l'action eût été commise la nuit et qu'elle n'eût étevue de personne. — La Cour<br />
d'Alger 'semble être allée un peu au-delà dans l'arrêt que nous rapportons : cet<br />
arrêt ne constate on effet d'aucune manière, que le délit ait été commis à proximité<br />
d'un chemin public ou même privé, et d'autre part, les personnes qui sont déve<br />
nues témoins de la scène, semblent l'avoir été non à raison de la proximité de<br />
leur passage, mais par suite des cris poussés par la victime, qui les avaient<br />
attirées ,
346<br />
circonstance soit exclusive de son consentement aux propositions du préve<br />
nu ;<br />
— Qu'il<br />
y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement, de dé<br />
clarer la compétence de la juridiction correctionnelle et de retenir la cause;<br />
— Statuant au fond sur la poursuite ; Attendu que c'est encore à tort que<br />
dans, leurs motifs les premiers juges déclarent que les faits de la- cause ne<br />
—<br />
sauraient constiluer un outrage public à la pudeur ; Qu'il est certain que<br />
l'excavation où l'acte de pédérastie a élé commis, ne possédait ni clôture, ni<br />
fermelure;<br />
— Qu'en<br />
conséquence, tout individu, passant devant elle, pou<br />
vait, sans qu'aucun obstacle ne s'y opposât voir tout ce qui faisait à l'inté<br />
— rieur ; Qu'au surplus trois personnes accourues aux cris, ont été témoins<br />
de l'acte contraire à la pudeur commis par le prévenu sans qu'elles aient<br />
eu besoin pour cela, d'user d'aucune escalade, d'aucune effraction, d'aucun<br />
—<br />
acle pouvant constituer une violation de domicile ; Que celle circonstance<br />
à elle seule suffirait pour constituer l'élément de publicité exigé par l'article<br />
330 du Code pénal ;<br />
— Qu'il y a lieu d'infirmer encore à ce point de vue,<br />
la décision des premiers juges;<br />
Par ces motifs;<br />
— Donne défaut contre Mohamed ben Mohamed;<br />
—<br />
— Se déclare<br />
Infirme le jugement du Tribunal d'Oran, du 30 juin dernier ;<br />
compétent, retient la cause,<br />
prévenu ;<br />
— Déclare<br />
et statuant sur la poursuite dirigée contre le<br />
Mohamed ben Mohamed coupable d'avoir, à Aïn-Té-<br />
mouchent, le 27 mai dernier, commis un outrage public à la pudeur ;<br />
en réparation, le condamne à 2 ans de prison el 16 francs d'amende ;<br />
condamne, en outre, en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />
M. Pinet de Menteyer, cons. rapp . ; M. Valette,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />
Danqueroute simple. — Circulation<br />
Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />
16 mars 1878.<br />
— Et<br />
— Le<br />
ruineuse d'effets. — Enga<br />
gements contractés pour le compte d'autrui.<br />
Doit être déclaré coupable de banqueroute simple comme<br />
s'<br />
étant livré, dans<br />
l'intention de retarder sa faillite, à des circulations d'effets et autres moyens<br />
ruineux de se procurer des fonds, le commerçant qui, se trouvant dans une<br />
situation embarrassée sans pouvoir se faire illusion à cet égard, s'est jeté tété<br />
baissée dans de nouvelles opérations commerciales, sans avoir liquidé son passé<br />
et en employant une circulation très-considérable d'effets en vue de se procurer<br />
des fonds.<br />
Le délit de banqueroute simple résultant de ce que le failli aurait contracté,<br />
pour le compte d'autrui, sans recevoir de valeurs en échange, des engagements<br />
trop considérables eu égard à sa position, ne doit pas être accueilli par les<br />
juges lorsqu'il est constant qu'au jour de la faillite le failli était presqu'abso-
347<br />
lument dégagé de ces engagements par lui contractés, sans qu'il en soit résulté<br />
un préjudice sérieux pour la masse des créanciers.<br />
Mesrine c. le Pboc. gén.<br />
En ce qui concerne les chefs de prévention, écartés par le Tribunal :<br />
Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />
En ce qui touche la prévention de s'être livré, depuis moins de trois ans, à<br />
Constantine, dans l'intention de retarder sa faillite, à des circulations d'effets<br />
des*<br />
— et autres moyens ruineux de se procurer fonds ; Atlendu qu'il résulte<br />
des vérificalions du syndic Huvey, corroborées par celle de l'expert Gaudin,<br />
que la faillite Mesrine présentait, au 25 octobre 1875, un déficit de<br />
2,005,560 francs 37 centimes, déficit qui, au 2 mai 1877, a atteint le<br />
— chiffre de 2,008,819 francs 70 centimes; Que Mesrine n'indique aucune<br />
cause sérieuse expliquant cet énorme déficit, aucun sinistre financier dans<br />
lequel il aurait été compromis, aucune opération, en dehors de celle relati<br />
vement peu importante des prêts indigènes, qui aurait entraîné pour lui des<br />
— pertes considérables et inattendues ; Qu'il faut donc admettre, comme<br />
uniquement vraies et comme expliquant seules ce désastre, les causes men<br />
tionnées dans les rapports du syndic el de l'expert, qui sonl: 1° Les dépenses<br />
— considérables faites par Mesrine sur ses immeubles 2°<br />
; Des perles subies<br />
dans des entreprises commerciales mal conçues, mal dirigées, mal surveillées ;<br />
— 3° L'énorme circulation de valeurs, la plupart fictives, créées par lui,<br />
sans cesse renouvelées, n'ayant pour but que de se procurer des fonds pour<br />
faire face à des échéances écrasantes, d'empêcher tout prolêt et de retarder<br />
— ainsi sa déclaration de faillite 4°<br />
; Enfin le désordre de sa comptabilité ;<br />
— Atlendu que Mesrine invoque en vain l'ignorance dans laquelle il sérail<br />
Atlendu,<br />
—<br />
toujours resté de la véritable situation de ses affaires ;<br />
lout d'a<br />
bord, qu'un pareil système de défense, serait-il fondé en fait, ne saurait êlre<br />
— accueilli ; Que le premier devoir d'un commerçant, surtout quand il opère<br />
avec l'argent d'autrui, est de se rendre, à chaque instant de sa vie commer<br />
ciale,<br />
un comple rigoureux et exact de sa position el de chacune des opéra<br />
— tions qu'il entreprend ; Mais attendu, dans l'espèce, qu'il est certain que,<br />
dans les derniers mois de l'année 1873, époque à laquelle Mesrine a fondé en<br />
son nom personnel une maison de commerce à Constantine, sa position pé<br />
cuniaire élait mauvaise, embarrassée, et qu'il ne pouvait se faire illusion sur<br />
— elle ; Qu'il est constant qu'à celle époque Mesrine était engagé dans des<br />
associations et opérations diverses avec Abbadie, Léon Lavie et Chautard ;<br />
qu'aucune de ces associations ou opérations n'était liquidée ; que son devoir<br />
le plus impérieux était alors et avant d'entreprendre un nouveau commerce,<br />
de régler ses comptes, de mettre à jour sa situation et de dégager sa respon<br />
—<br />
sabilité pour tout son passé commercial ; Que loin de là, Mesrine, sans se<br />
préoccuper de sa position dans ces diverses entreprises, s'est jeté têle-baissée<br />
dans toutes sortes de nouvelles opérations commerciales, n'apporlant dans<br />
leur direction aucune surveillance sérieuse ; ne songeant qu'à se procurer<br />
des fonds par tous moyens possibles, n'appliquant l'argent qu'il obtenait par<br />
l'escompte des effets qu'il créait sur Chantard, Billaud, Berlagna, Bérard et<br />
Rouyer, Mangiawacchi, Barbaroux et De Marqué, Bou-Nar, Ahmed Bey et<br />
autres indigènes, qu'à l'extinction des dettes qui pesaient déjà sur lui, renou-
348<br />
vêlant sans cesse ces effets à leur échéance et augmentant ainsi sans profit<br />
aucun, par des frais énormes d'agio, son passif chaque jour grossissant, jus<br />
qu'au moment où son wédil cessant, il a dû cesser lui-même ces désastreuses<br />
opérations, laissant après lui un déficit de plus de deux millions et de nom<br />
breux çt malheureux commerçants absolument ruinés;<br />
Attendu qu'il résulte des lettres versées aux débats, qu'en 1873 Mesrine<br />
connaissait sa situation el ne pouvait se méprendre sur le résultat fatal au-<br />
— devant duquel il courait, quelqu'efforl qu'il fît pour s'aveugler; Qu'en<br />
effet, Cornet, dans trois lettres adressées par lui à Mesrine les 28 février,<br />
21 août el 3 septembre 1873, el Rerlagna dans deux autres lettres des 8 mars<br />
1873 et 7 février 1874, insislenl auprès de lui et s'efforcent de lui démontrer<br />
— tout le côté périlleux de sa situation et de sa manière d'opérer; Que Cor<br />
net lui fait toucher du doigt combien sont ruineuses ses émissions de papier<br />
qu'il ne cesse de lancer à droite et à gauche, et l'engage à chercher un<br />
moyen sérieux de sortir d'un élat de choses qui se complique par des<br />
échéances sans cesse renouvelées;<br />
— Que<br />
le 3 novembre 1873,<br />
Cornel lui<br />
écrit : « J'apprends que la traite tirée sur Rouyer est en souffrance. Je re-<br />
» grelte de ne pouvoir rien faire. Dieu veuille que cela vous ouvre enfin les<br />
o yeux I » — Que Rertagna, dans sa lettre du 8 mars 1873, se plaint d'une<br />
façon très-vive du papier sans cesse créé par lui, renouvelé périodiquement<br />
à chaque échéance avec la régularité d'un chronomètre, portant les mêmes<br />
sommes, les mêmes signatures, les mêmes échéances; s'étonne de l'in<br />
croyable bonne volonlé des banquiers qui l'acceptent ; fait ressortir les dan<br />
gers d'un pareil mode de se procurer des fonds et engage le prévenu à chan<br />
— ger sa manière d'opérer; Que dans sa lettre du 7 mars 1874, Rerlagna<br />
écrit à Mesrine qu'il ne comprend plus rien à sa manière de traiter les affaires<br />
et lui repreche de laisser en souffrance les traites de Barthélémy ;<br />
que Mesrine ignorait, si peu le mauvais élat de ses affaires en 1873, que dans<br />
cinq lettres qu'il écrit les 14 septembre el 22 octobre 1873 à Cornet, Rouyer<br />
— Atlendu<br />
et Chantard, il avoue « que Guelâa a élé pour lui, un gouffre qu'il désespère<br />
« d'expliquer ; que tout est si embrouillé, qu'il lui semble impossible de s'y<br />
»<br />
reconnaître; qu'il est nécessaire d'apporter la lumière ; qu'il ne comprend<br />
» plus rien à bien des choses ; que les contrariétés, jointes aux graves préocr<br />
» cupations que lui donne le soin, de débrouiller ses affaires si enchevêtrées,<br />
» le rendent malade. Il se plaint qu'on lui a lout caché jusqu'à ce jour, où<br />
» enfin il voit ou plutôt entrevoit sa situation. » Il reproche à Chantard de<br />
n'avoir pas surveillé sa comptabilité avec la Société algérienne el d'avoir<br />
» —<br />
que c'est<br />
« laissé dérailler l'importante affaire LéonLavie; Attendu<br />
cependant dans une pareille situation dont il reconnaissait lui-même toule<br />
la gravité, que Mesrine n'a pas craint d'ouvrir à Constanline, en son nom<br />
personnel, une nouvelle maison de commerce, d'user de son crédit pour se<br />
procurer des sommes considérables à l'aide, desquelles il s'est lancé dans des<br />
opérations peu sûres, spécialement dans des ventes à livrer et qu'il est ainsi<br />
fatalement arrivé, après vingt mois seulement de celle existence commerciale,<br />
à la faillite si désasireuse qui en 1875 a jeté la pertubation dans le commerce<br />
de la province de Conslaniine ;<br />
— Attendu,<br />
en outre, que peu de jours avant<br />
l'époque fixée comme étant celle de sa cessation de paiement en avril et mai<br />
1875, Mesrine, pour se procurer les fonds nécessaires à une de ses dernières
349<br />
échéances, n'a pas hésité à consentir à Truc, Piélra et Aouizerat, des ventes<br />
de grains à livrer et s'est fait remettre par eux un acomple de 345,000 fr.<br />
qu'il a appliqué à ses besoins personnels, alors que sa position ne lui per<br />
mettait pas d'espérer sérieusement qu'il pourrait satisfaire aux obligations<br />
qu'il contractait;<br />
En ce qui touche la prévention d'avoir contracté pour le compte d'autrui<br />
(Barbaroux et de Marqué), sans recevoir des valeurs en échange, des engage<br />
ments trop considérables eu égard à sa position lorsqu'il les a contractés:<br />
Altendu que s'il est établi que Mesrine, pour la simple garantie hypothécaire<br />
d'une somme de cent mille francs, a consenti à être le préseniateur à la<br />
banque du papier de la maison Barbaroux et de Marqué, papier sur lequel il<br />
apposait sa signature el qu'il a ainsi pris des engagements pour des sommes<br />
bien supérieures à la garantie fournie puisque, à un moment donné, ces<br />
sommes se sont élevées à un million trois cent vingt-cinq mille francs ; il est<br />
constaté qu'au jour de la faillite, sa responsabilité n'élait plus engagée que<br />
pour 142,000 francs ; qu'il résulte même d'une lettre éciite le 20 février der<br />
nier parle directeur de la Banque au défenseur de Mesrine, que cette res<br />
ponsabilité serait entièrement dégagée à la suite d'un arrangement intervenu<br />
—<br />
entre cet établissement financier et la maison Barbaroux et de Marqué;<br />
Que ce résultat définitif démontre que Mesrine n'a pas commis une trop<br />
grande imprudence en comptant aussi complètement qu'il l'a fait sur la sol<br />
vabilité de celle maison, puisqu'il.n'est résulté des engagements qu'il a con<br />
tractés pour elle aucun préjudice pour la masse de ses créanciers ;<br />
— Qu'il<br />
y<br />
a lieu, eft conséquence, de réformer le jugement dont est appel en ce qu'il<br />
a retenu ce chef de prévention et de déclarer qu'il n'est point suffisamment<br />
établi ;<br />
En ce qui touche les préventions : 1° de n'avoir pas fait, dans les Irois jours<br />
de la cessation de ses paiements, la déclaration exigée par les articles 438 et<br />
439 du Code de commerce ; et 2° d'avoir tenu des livres incomplets et irrégu<br />
liers, n'offrant pas sa véritable situation active el passive, el de n'avoir dressé<br />
—<br />
aucun inventaire; Attendu que ces délits sont constants ; qu'ils ne sont<br />
points contestés; que Mesrine a seulement essayé d'en atténuer la gravilé;<br />
— Mais altendu que ces infractions sont d'aulant plus coupables que Mesrine<br />
o'pérail avec son crédit et l'argent qu'il se procurait à l'aide des moyens ci-<br />
— dessus indiqués ; Que les entreprises auxquelles il se livrait étaient nom<br />
breuses et comportaient un roulement de fonds considérable dont le chiffre<br />
total a élé approximativement évalué par l'expert à douze millions ;<br />
ne tenant pas une comptabilité sérieuse et surtout en ne dressant aucun in<br />
— Qu'en<br />
ventaire, Mesrine s'est volontairement mis dans l'impossibiliié de se rendre<br />
un comple exact de sa situation et que le désordre qui a constamment régné<br />
dans sa comptabilité, surtout jusqu'en 1874, a eu des conséquences si<br />
fâcheuses,, que l'expert Gaudin n'hésite pas à le considérer comme une des<br />
—<br />
causes qui ont amené son désastre commercial; Atlendu, néanmoins,<br />
qu'il y a lieu de reconnaître^ en sa faveur, qu'une des principales causes qui<br />
l'ont placé en 1873 dans une situation embarrassée, situation qui a constam<br />
ment pesé sur son existence commerciale, ne saurait lui êlre exclusivement<br />
— imputée ; Qu'en effet les prêls auxquels indigènes, il a pris une très-large<br />
part, constituaient une opération commencée sous d'heureux auspices, que
350<br />
les événements malheureux de 1870 et 1871 ont rendue désastreuse ;<br />
d'un aulre côté le syndic et l'expert, tout en précisant la situation de la fail<br />
— Que<br />
lite, déclarent qu'il faut en partie attribuer les pertes éprouvées à l'ignorance<br />
commerciale du prévenu, ainsi qu'au grand nombre d'affaires qu'il a voulu<br />
embrasser, et affirment qu'il n'existe contre lui aucune trace de fraude, de<br />
—<br />
mauvaise foi ni d'un détournement quelconque ; Attendu, enfin, qu'on ne<br />
peut reprocher à Mesrine des dépenses personnelles ou d'intérieur excessives ;<br />
qu'il esl constant qne son genre de vie et celui Tfe sa famille étaient plus que<br />
modestes eu égard à leur position sociale ;<br />
tances, il y<br />
— Que<br />
dans de pareilles circons<br />
a simplement lieu de maintenir la peine prononcée par les pre<br />
miers juges ;<br />
Par ces motifs : LA COUR, statuant tant sur l'appel du prévenu que sur<br />
—<br />
celui du Procureur général ; Infirme le jugement du tribunal correction<br />
nel de Constanline du 21 décembre 1877, en tant qu'il a déclaré le prévenu<br />
coupable d'avoir contracté, pour le compte d'autrui (Barbaroux et de Marqué),<br />
— des engagements trop considérables ; Dit que celle prévention n'est point<br />
—<br />
—<br />
suffisamment établie ; Relaxe Mesrine de ce chef d'inculpation ; Confir<br />
me, pour sortir sor plein et entier effet, ledit jugement dans toutes ses autres<br />
dispositions; —Maintient, en.conséquence, la peine de trois mois d'emprison<br />
— Condamne Mesrine aux frais.<br />
nement prononcée par les premiers juges ;<br />
M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. Fau, av. gén. ; M" Jouyne, av.<br />
TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />
Présidence de M. DELACROIX, président.<br />
15 octobre 1878.<br />
Algérie. — Concession déterre. —<br />
Résidence.<br />
—<br />
Déchéance ad<br />
ministrative. — — Mise en adjudication du droit au bail . Sous<br />
location antérieure. — Impenses. —<br />
culture. —<br />
Restitution.<br />
Frais de semences et de<br />
Lorsqu'une concession accordée par l'État, conformément aux règles du<br />
titre 2 du décret du 15 juillet 1874, a été retirée au concessionnaire par suite<br />
du défaut de résidence, et que le droit au bail dont il a élé évincé a élé mis<br />
en adjudication, le sous-locataire de ces terres qui connaissait la situation pré<br />
a-<br />
caire du bailleur et le danger d'éviction dont celui-ci élait menacé, consenti<br />
à ses risques et périls un contrat aléatoire qui ne peut donner ouverture à une<br />
action en dommages-intérêts contre l'attributaire évincé.<br />
L'adjudicataire,<br />
en vertu des droits de propriété et d'accession que lui con<br />
fère l'adjudication, est fondé à expulser le sous- locataire et à profiter des fruits<br />
pendant par racines qui se trouvent sur le fonds sans être tenu d'indemniser<br />
le fermier dépossédé ; celui-ci a seulement le droit d'en réclamer le rembourse<br />
ment au concessionnaire évincé.<br />
La résiliation du bail avant le terme fixé par suite de la déchéance prévue<br />
par les parties, donne lieu à la restitution proportionnelle des fermages payés<br />
par anticipation et des avances faites pour travaux de construction.
351<br />
Carrèbe c. Denot.<br />
Atlendu que suivant conventions verbales du l" octobre 1875, Denot, lot'<br />
concessionnaire au Pont de l'Oued-Kerm, a loué à Carrère son d'une su<br />
Que ce bail<br />
perficie de 25 hectares conligu à la concession de ce dernier; —<br />
a été consenti pour 3 années à compter du 28 octobre 1875 pour finir à la<br />
-<br />
même époque en 1878, moyennant un fermage annuel de 325 francs;<br />
Attendu que Carrère prenait en outre l'engagement de terminer la maison<br />
— d'habitation construite par Denot; Atlendu qu'il a joui paisiblement pen<br />
— dant l'année agricole 1875-1876 ; Que pour l'année 1876-1877 il a cultivé<br />
et ensemencé les terres à lui louées; que le 23 janvier 1877, par suite de<br />
l'éviction prononcée contre Denot, ces terres ont été adjugées adminislralivement<br />
à Roy qui s'en est mis aussitôt en possession, en vertu du droit<br />
d'accession que lui conférait son adjudication ;<br />
— Attendu que Carrère a<br />
pratiqué une saisie-arrêt sur la somme de 4,000 francs, prix de l'adjudication<br />
— faite au profit de Roy ; Qu'après avoir fait toutes ces réserves à l'égard de<br />
Roy, il réclame à Denot : 1° 2,480 francs de dommages-inlérêts, savoir :<br />
480 francs pour perte éprouvée sur la vente forcée d'une partie de son béiail<br />
et 2,000 francs pour indemnité de déplacement et de relocalion -,<br />
2° pour le<br />
montant de la récolte, 2,740 francs; 3° pour la valeur d'un gourbi, 200 francs ;<br />
4° pour l'achèvement de la maison d'habitation, 120 francs ;<br />
Sur le 1er chef. — Altendu<br />
qu'il résulte des enquête et contre enquête<br />
qu'au moment où il a consenti le bail dont s'agit, Carrère savait que Denot<br />
définitif de la chose<br />
était concessionnaire au litre 2 et non propriétaire-<br />
louée; que concessionnaire lui'même au même titre et voisin de Denot, il<br />
n'ignorait pas la condition de résidence imposée à celui-ci, le danger d'évic<br />
tion qu'il encourait et par conséquence, le vice qui enlachait la chose louée;<br />
— Que sa bonne foi n'a donc pu être surprise, ainsi qu'il a élé forcé de le<br />
reconnaître dans ses dernières conclusions; qu'il a voulu courir une sorte<br />
que le contrat de louage<br />
d'aléa, calculant en conséquence le prix de location;<br />
qu'il a consenti avec connaissance de cause, était subordonné tacitement à la<br />
—<br />
condition résolutoire de l'éviction qui menaçait Denot ; Altendu que si la<br />
déchéance a été prononcée et a eu pour conséquence la résolution du bail<br />
avant le terme convenu pour sa durée, cet événement prévu par Carrère el<br />
accepté par lui d'avance avec toutes ses conséquences juridiques, ne saurait<br />
-<br />
engendrer pour Denot l'obligation à des dommages-intérêts ; Attendu que<br />
les faits intermédiaires qui se sont produits, comme la résidence temporaire<br />
de Denot sur sa concession pour donner le change à l'administration, ne<br />
sauraient changer, au regard de Carrère, la nalure aléatoire du contrat ni<br />
modifier les effets que cette convention doit légalement produire;<br />
— Qu'il<br />
n'y a donc pas lieu d'allouer des dommages-inlérêls à'Carrère ;<br />
Sur le deuxième chef. — Altendu si que Carrère ne peut prétendre à des<br />
dommages-intérêts, il a droit lout au moins au remboursement des fermages<br />
payés d'avance el des frais de semence et de labour supporlés par lui, en<br />
vertu de ce principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;<br />
ces impenses ayant augmenté le prix d'adjudication dont Denot a profité, il<br />
— Que<br />
—<br />
esl juste qu'il en tienne comple à Carrère ; Altendu que le Tribunal n'a pas<br />
les éléments suffisants pour en fixer le montant, dès à présent, qu'il y aura
352<br />
lieu de les établir par élat, pour éviter les lenteurs et les frais d'une<br />
expertise;<br />
Sur le troisième chef. — Attendu que Carrère ne justifie pas d'une dé<br />
pense de 200 francs pour construction d'un gourbi; qu'au surplus il n'était<br />
pas autorisé à faire*<br />
celle construction et qu'il pouvait eu enlever les maté<br />
riaux quand il a quitté la propriété ;<br />
Sur le quatrième chef. — Altendu que Roy était autorisé à déposséder<br />
Carrère, mais que le bail ayant élé résolu avant le lerme fixé, il y a lieu à<br />
restitution delà part de Denot d'une partie des dépenses faites par Carrère<br />
proportionnée à la durée de la<br />
pour l'achèvement de la maison d'habitation,<br />
jouissance qui ne s'esl pas réalisée au profit du preneur ;<br />
— Attendu que<br />
Carrère n'ayant joui qu'une année sur 3 de la chose louée, les 2/3 de la dé<br />
pense, soil 80 francs, doivent être mis à là charge de Denot ;<br />
- Altendu que<br />
Roy, en vertu de son adjudication, était en droil d'expulser et de profiter de<br />
lu récolte ;<br />
— Qu'en effet, les fruits pendants par racines qui se trouvent sur<br />
le fonds en faisaient partie comme immeubles par destination el appartenaient<br />
à l'adjudicataire en verlu du droit d'accession ; que la valeur de cette récolte<br />
a d'ailleurs élé comprise dans le prix d'adjucalion, que Roy ne peut être con<br />
damné à le payer deux fois : qu'il n'y a pas lieu dès lors de donner acte à<br />
Carrère de ses réserves contre Roy ;<br />
Allendu, en ce qui concerne ja saisie-arrêt pratiquée par Carrère, qu'il<br />
est équitable de ne la maintenir quejusqu'à concurrence des sommes qui peu<br />
—<br />
vent être dues par Denot au saisissant; Allendu<br />
frais de labour el de semence avancés par Carrère,<br />
en ce qui concerne les<br />
que le Tribunal a les<br />
éléments suffisants pour les évaluer provisoirement à 1,200 francs au point<br />
de vue du maintien de la saisie-arrêl;<br />
Par ces motifs : Jugeant conlradictoiremenl et en premier ressort, déclare<br />
—<br />
Carrère mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute;<br />
— Dit qu'il n'y a lieu de lui donner acte de ses réserves contre Roy; Donue<br />
acle à Denot de ce qu'il déclare êlre prêt à restituer à Carrère, 200 francs<br />
— qu'il a reçus de lui par anticipation sur les fermages de 1877; Lui donne<br />
acle de ce qu'il est prêt à payer à Carrère, les 2/3 des dépenses par lui faites<br />
pour l'acbèvemenl de la maison d'habitation, soil 80 —<br />
francs; Valide la<br />
saisie arrêl pratiquée par Carrère contre les époux Denot jusqu'à concur<br />
— rence de 1,480; Et slaluant avanl faire droit, dit que dans le délai d'un<br />
mois, à partir de la signification du présent jugement, Carrère devra fournir<br />
élat et présenter son compte des frais de semence et de labour avancés par<br />
lui pour être ensuite par les parties conclues el par le Tribunal statué ce qu'il<br />
appartiendra. —<br />
Dépens<br />
réservés.<br />
M. Fondi de Niort, subst. du Proc. de la Rép. ; MES Gillotte et Haffneb, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décrel en date du 29 octobre 1878 :<br />
M. Champroux, notaire à Raina, a élé nommé notaire à Guelma, en rem<br />
placement de M. Caubet, décédé.<br />
Alger. —<br />
Typ. A. Jounnin.
2e année. —<br />
16<br />
Novembre 1878. —<br />
N°<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />
LÉGISLATION<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />
7 août 1878.<br />
Justice musulmane. — Pourvoi eu cassation. —<br />
lité. —<br />
Composition<br />
musulmans .<br />
Irrecevabi<br />
irrégulîère du Tribunal des appels<br />
Aux termes des dispositions des décrets du 31 décembre 1859 et 15 dé<br />
cembre 1866, réglementant la justice musulmane en Algérie, les décisions ren<br />
dues en dernier ressort par les cadis, ou sur appel, par la Cour ou les Tribunaux<br />
d'appel mixtes, ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation ;<br />
Il n'y a pas à distinguer si le pourvoi repose, sur la violation de la loi mu<br />
sulmane ou sur la violation d'une loi française, le principe qui interdil aux<br />
parties le recours en cassation contre les décisions des Tribunaux statuant entre<br />
musulmans et d'après la loi musulmane, étant général el absolu ;<br />
Partant est non-recevable le pourvoi dirigé contre un jugement rendu<br />
par un Tribunal mixte d'appel irrégulièremeut composé, bien qu'il soit motivé<br />
sur cette irrégularité, et vainement prétendrait-on que celte irrégularité cons<br />
tituant une violation de la loi française, autoriserait le pourvoi en cassation ;<br />
L'art. 37 du décret de 1 866 n'autorise les pourvois en cassation contre les<br />
décisions entre musulmans, que lorsque les parties ont déclaré vouloir con<br />
tracter sous l'empire de la loi française, et que cette loi leur a été appliquée, en<br />
exécution de l'art. \,$2du décret précité (1).<br />
(1) La solution donnée par la Cour de cassation à cette importante question, ne<br />
est certain que les auteurs des dé<br />
saurait être juridiquement contestable. — Il<br />
crets de 1859 et 1866 ont tenu à soustraire à l'appréciation de la Cour suprême<br />
tout litige porté devant les juridictions spéciales qu'ils organisaient pour les indi<br />
gènes musulmans ; ils n'ont admis d'autre exception à cette règle que pour le<br />
cas où les musulmans auraient formellement déclaré dans l'acte au sujet duquel<br />
s'élève la contestation, qu'ils entendaient contracter sous l'empire delà loi française.<br />
— Mais tout en reconnaissant que l'interprétation de ces dispositions ne saurait<br />
donner lieu à aucune divergence, ne nous sera-t-il pas permis de nous étonner
354<br />
Sin el Habib ould Cadi c. X.<br />
Attendu qu'aux termes de l'art. 37 du décret du 31 décembre 1859, sur la<br />
justice musulmane en Algérie, les jugements en dernier ressort des cadis et<br />
les jugements et arrêls sur appel n'étaient pas susceptibles de recours en cas<br />
sation ;<br />
Que, par la nouvelle disposition de son article 37, le décret du 13 dé<br />
cembre 1866 qui a retouché et modifié celui de 1859, après avoir reproduit le<br />
même principe, sans y apporter de dérogation, n'admet le recours en cassa<br />
tion que dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'art. 1, et où les parties<br />
ayant déclaré contracté sous l'empire de la loi française, ont pour juge au<br />
premier degré, le juge de paix substitué au cadi et appliquant la loi fran<br />
çaise ;<br />
Qu'ainsi, pour que le pourvoi soit recevable contre une sentence, un juge<br />
ment ou un arrêt enlre musulmans algériens, il faut deux conditions liées<br />
l'une à l'autre:<br />
1° L'oplion des parties ayant eu pour effet d'entraîner la compétence du<br />
juge de paix ;<br />
2° L'application de la loi française en verlu de cette option ;<br />
Que, par conséquent, soil qu'il s'agisse d'une décision de cadi ou de juge<br />
de paix, appliquant le droit musulman, ou d'une décision d'appel rendue à la<br />
suite, il ne saurait jamais y<br />
avoir ouverture à pourvoi malgré la gravité des<br />
vices dont ces décisions peuvent être entachées ;<br />
Que vainement on oppose que l'irrégularité dans la composition du tribu<br />
nal d'appel constitue une violation, non de la loi musulmane, mais de la loi<br />
française,<br />
et que c'est uniquement l'application de la loi musulmane qu'on a<br />
voulu attribuer au domaine exclusif el souverain du juge local ;<br />
Qu'en effet, le principe qui interdit aux parties le recours en cassalion<br />
contre les décisions des Tribunaux statuant entre musulmans el d'après la<br />
loi musulmane, est général et absolu —<br />
; Qu'il ne comporte aucune exception,<br />
que le système actuel ne fail pas plus de place que le précédent, à la Cour de<br />
cassalion dans l'organisation de la justice indigène, en dehors du cas où la<br />
contestation est régie par la loi française d'après l'oplion des parties, et que,<br />
quelles que soient les vues qui aient dicté ce principe, il doit être stricte<br />
ment obéi et maintenu ;<br />
D'où il suit que le Tribunal civil d'Oran, dont la décision est attaquée,<br />
qu'un législateur ait pu les consacrer et qu'elles se maintiennent en vigueur ?<br />
L'existence d'une juridiction suprême recherchant tout-à-fait en dehors de l'exa<br />
men et de l'appréciation des faits de la cause, les irrégularités juridiques de fond<br />
et de forme dont peut être entaché un jugement rendu, semble une chose indis<br />
pensable, et il est certes étrange qu'une partie croyant avoir à relever comme dans<br />
l'espèce, la composition irrégulière du Tribunal qui a rendu celte décision,<br />
destituée du droit de soulever<br />
soit, par suite de la volonté formelle du législateur,<br />
une critique aussi essentielle. — Nous nous proposons d'examiner plus longue<br />
ment, dans un de nos prochains numéros, les inconvénients et les dangers même<br />
que présente sous ce rapport la situation actuelle, en recherchant quels seraient<br />
à notre avis les meilleurs moyens pratiques pour y remédier .<br />
V. M.
355<br />
ayant statué en matière de droit musulman et comme tribunal mixte, sur<br />
l'appel d'une sentence du cadi d'Aïn-Témouchenl, celte décision n'est pas<br />
susceptible de recours en cassation, même pour irrégularité dans la compo<br />
sition du Tribunal;<br />
Par ces motifs: Déclare le pourvoi non recevable, etc.<br />
M. Guillemard, cons. rapp. ; M. Robinst de Clérv,<br />
COUR D'APPEL D'AIX (1" Ch.)<br />
Présidence de M. RIGAUD, premier Président.<br />
24 janvier 1878.<br />
av. gén. (concl. conf.).<br />
I. Usufruit légal de» père et mère. — Statut personnel.<br />
II. Algérie. — Israélites algériens. — — Naturalisation. Tutelle<br />
légale. — Option. — Renonciation au statut personnel.<br />
I. La disposition de l'art. 384 du*<br />
Code civil qui accorde au père ou à la<br />
mère la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, est une disposition qui<br />
appartient essentiellement au statut personnel et qui ne peut être invoquée que<br />
par le Français jouissant de tous les droits civils accordés par les lois fran<br />
çaises.<br />
II. L'art. 2 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, qui porte que les Israé<br />
lites indigènes en Algérie sont Français, porte aussi qu'ils continueront à être<br />
régis par leur statut personnel.<br />
En conséquence, même après ce sénatus-consulte, un Israélite indigène qui<br />
aurait, par sa volonté expresse ou présumée, placé tel ou tel contrat sous l'em<br />
pire des lois françaises, ne doit pas, malgré cette option relative à un contrat<br />
déterminé,<br />
être considéré comme ayant fait une renonciation générale à son<br />
statut personnel et acquis ainsi une sorte de naturalisation tacite (1).<br />
L'Israélite indigène ne saurait donc avoir droit à la jouissance légale accor<br />
dée au père et à la mère par l'art. 384 du Code civil, qu'à partir du moment où<br />
il a acquis, par la naturalisation, le droit d'invoquer cette disposition du statut<br />
personnel français.<br />
Peu importe, au surplus, qu'il ait, par application soit de la loi rabbinique,<br />
soit même de la loi française, la tutelle légale de ses enfants mineurs, cette<br />
(1)<br />
Sur la question fort importante de savoir dans quelles circonstances les Is<br />
raélites indigènes devaient être considérés comme ayant renoncé à leur statut<br />
personnel, et sur les divergences que cette question a rencontrées dans la juris<br />
prudence, voir Narbonne, Rép. V* Israélite n" 1 à 10.
356<br />
jouissance légale étant non une conséquence de la tutelle mais bien un attribut<br />
de la puissance paternelle.<br />
Veuve Cohen Scali c. consorts Cohen et autres.<br />
Par suite du renvoi que la Cour de cassation a prononcé dans cette affaire, à la<br />
date du 14 mars 1877 (Voir Bull. jud. 1877, p 360), la Cour d'Aix a rendu l'arrêt<br />
suivant :<br />
Sur l'appel principal: Allendu que la disposition de l'article 384, qui ac<br />
corde au père ou à la mère la jouissance des biens de leurs enfants mineurs,<br />
est une disposition qui appartient essentiellement au slalut personnel, el qui<br />
ne peut êlre invoquée que par les Français jouissant dé tous les droits civils<br />
accordés par les lois françaises ;<br />
Altendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 a été à<br />
bon droit interprété en ce sens que les Israélites indigènes pouvaient, par<br />
leur volonté expresse ou présumée, placer lel ou tel contrat sous l'empire des<br />
il ne s'en suit pas que cette option, appliquée à un contrat<br />
lois françaises,<br />
déterminé,<br />
entraîne une renonciation générale au slatut personnel et puisse<br />
opérer une sorle de naturalisation tacite ;<br />
Altendu, dans l'espèce,<br />
qu'il n'est pas même établi que la veuve Cohen<br />
Scali ail eu la tutelle légale de ses enfants mineurs par application de la loi<br />
française,<br />
maintient,<br />
puisque l'arrêt de la Cour d'Alger du 21 novembre 1866 qui la lui<br />
déclare qu'elle ne lui appartient que par application de la loi rab-<br />
binique;<br />
Atlendu qu'alors même il en serait autrement, il ne s'ensuivrait pas que<br />
la veuve Cohen Scali eût droit à l'usufruil légal des biens de ses enfants<br />
mineurs, cet usufruit n'étanl nullement, en droit français, une conséquence<br />
de la tutelle, mais bien un attribut de la puissance paternelle ;<br />
Attendu, dès lors, que cel usufruit n'a pu lui appartenir que du jour où,<br />
renonçant à son statut personnel Israélite qui le lui refusait, elle a acquis,<br />
par sa naturalisation, le droil d'invoquer la disposition du slatut personnel<br />
français qui le lui accorde ;<br />
Allendu que la veuve Cohen Scali l'a ainsi compris elle-même, puisque,<br />
devant toutes les juridiclions devant lesquelles elle a plaidé, elle n'a jamais<br />
basé sa demande d'usufruit légal que sur le décret de naturalisation du 16<br />
juin 1869 auquel seulement elle voulait faire produire un effet rétroactif;<br />
Par ces motifs : LA COUR, staluanl par suite du renvoi ordonné par la Cour<br />
de cassation, ayant tel égard que de raison aux conclusions des appelants, dit<br />
que la veuve Cohen Scali a droit à l'usufruit légal sur les biens de ses en<br />
fants mineurs depuis le 16 juin 1869, jour auquel elle a été naturalisée<br />
française, jusqu'au jour où chacun de ses enfants a atteint sa dix-huitième<br />
année, etc.<br />
M. Gobrdez, subst. du Proc. gén. ; Me» Lëven et P. Rigaud, av.
357<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (lr0Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT, premier Président.<br />
8 avril 1878.<br />
I. Intervention . — Droits de l'intervenant. —<br />
cier. — M-<br />
Forclusion,<br />
Ordre. —<br />
Règlement<br />
définitif. —<br />
Appel.— Créan<br />
Contredit. —<br />
Une partie qui est intervenue dans une instance, a le droit d'interjeter appel<br />
du jugement rendu et cet appel est valable, bien que la partie succombante ait<br />
accepté la décision rendue contre elle (1) .<br />
Cette règle s'applique plus particulièrement à l'intervenant qui interjette<br />
appel d'un jugement rendu contre son débiteur ; car, dans ce cas, outre le<br />
droit résultant de sa situation personnelle comme intervenant au procès, il doit<br />
encore être considéré comme exerçant les droils et actions de son débiteur aux<br />
termes de l'art. 1166 du Code civil (2).<br />
Lorsqu'une procédure d'ordre a abouti au règlement définitif suivi d'une or<br />
donnance de clôture et de la délivrance des bordereaux de collocation, les<br />
créanciers qui ont figuré à l'ordre, ne sauraient plus,<br />
même en donnant à leur<br />
contestation l'apparence d'une action en répétition ûe l'indu, élever à Vencontre<br />
de l'ordre définitivement clos, des griefs qu'ils auraient omis de formuler<br />
jusque-là .<br />
En effet le règlement définitif fixe le sort des créanciers produisants et par<br />
ticipe de la nature de l'autorité et de l'irrévocabilité des décisions judiciaires<br />
ordinaires,<br />
et un recours n'est possible contre lui que lorsque par erreur ou<br />
excès de pouvoir, l'ordonnance de clôture n'est pas conforme au règlement<br />
provisoire non contesté ou a mal appliqué ou interprêté les décisions qui ont<br />
statué sur les contredits {3) .<br />
Hors ce cas spécial, le règlement définitif, comme toutes les décisions judi<br />
ciaires, ne peut être attaqué même pour cause de fraude, que dans des cas<br />
exceptionnels et par la voie extraordinaire de la requête civile.<br />
Housset c. consorts Mestre.<br />
-<br />
Atlendu que les intimés apposent à l'appelant une fin de non-recevoir ;<br />
Qu'ils soutiennent que Housset, simple ayant cause des époux Darcourt, a as<br />
sisté aux débats de première instance sans y être partie, et que dès lors il n'a<br />
(i) Cpr. D. Rép. V» Appel civil, n" 439 ; Cass. 13 nov. 1833.<br />
(2) Cpr. D. Rép. V" Intervention, h°s 138 et 139.<br />
(3) Cpr. D. Rép. V Ordre, n°s 710 et suiv. Bordeaux,<br />
V» n»<br />
Ordre, 712). Bourges, 17 déc. 1852 (D. 1854, 2. p. 65).<br />
24 janv. 1837 (D. Rép.
358<br />
pas qualité pour relever appel d'un jugement qui a été accepté par les époux<br />
Darcourt ;<br />
Attendu que Housset est régulièrement intervenant en première instance<br />
et qu'à ce litre d'intervenant, il était vraiment partie intéressée au procès<br />
et puisait dans celte situation, prise par lui, le droit personnel d'interjeter<br />
appel ;<br />
— Qu'autrement<br />
ce serait en effet réduire le rôle d'un intervenant à<br />
celui d'un simple assistanl, et faire perdre à. l'intervention son efficacité ;<br />
Attendu, d'ailleurs, que Housset est créancier des époux Darcourt et qu'en<br />
celte dernière qualité, en présence de l'inaction de ses débiteurs, il aurait<br />
encore le droil, aux termes de l'article 1 166, d'interjeter appel, en mettant<br />
en cause, ainsi qu'il l'a fait, les époux Darcourt ;<br />
Qu'il n'y a donc pas lieu, et par un double motif, de s'arrêter à l'exception<br />
soulevée par les appelants ;<br />
Au fond : Allendu, en fait, qu'à la suite d'une adjudication sur saisie<br />
immobilière poursuivie sur un sieur Cherif ben Cbeik, un ordre a été ouvert<br />
— pour la distribution du prix; Qu'après divers débats, un règlement dé<br />
finitif est intervenu, une ordonnance de clôture a élé rendue et un borde<br />
reau da collocation délivré aux époux Darcourt pour la somme de 4,127 fr.<br />
— 60 c. ; Qu'aujourd'hui les consorts Mestre, faisant état de certaines dé<br />
clarations qu'ils versent au procès, cherchent à établir que les époux Dar<br />
court ont été indûment colloques, parce qu'au moment où la collocation a<br />
été arrêtée à leur profit, ils n'étaient pas ou n'étaient plus créanciers de<br />
Cherif ben Cheik;<br />
— Que<br />
vainement, par une habile rédaction de leurs<br />
conclusions, ils s'efforcent de se placer en dehors de l'ordre et de donner à<br />
leur — action la couleur d'une action en répétilion de l'indu ; Que les faits<br />
et circonstances de la cause ne sauraient se prêter à une pareille interpré<br />
tation ;<br />
Attendu, en effet, que la déclaration, dont l'écriture esl d'ailleurs déniée<br />
par les époux Darcourt, porte la date du 20 septembre 1871 -<br />
; Que son<br />
sens est obscur et qu'il se peut qu'elle n'ait eu d'autre but qne d'empêcher,<br />
par une attestation de complaisance, la déclaration de faillite du sieur Cherif<br />
ben Cheik, alors en butte aux poursuites de ses créanciers;— Que dans<br />
tous les cas, cet écrit, ainsi que cela résulte des pièces du procès, était<br />
entre — les mains des consorts Mestre ; Que cependant ni Cherif ben<br />
Cheik, ni Mestre, qui ont figuré à l'ordre, qui ont élé mêlés aux contredits<br />
qu'il a soulevés, n'ont élevé aucune critique contre, la demande en collo<br />
cation des époux Darcourt;— Que Mestre, partie à l'ordre,<br />
créancier ins<br />
crit postérieur en rang aux époux Darcourt, empêché par la collocation de<br />
ceux-ci de venir en ordre utile, a gardé le silence, bien qu'il fût armé déjà<br />
d'une -r- pièce qu'il présente actuellement comme décisive ; Que dès lors<br />
c'est sciemment qu'il a laissé l'ordre suivre son cours et la collocation des<br />
époux — Darcourt acquérir l'autorité de la chose jugée; Qu'on ne saurait au<br />
jourd'hui et dans de pareilles conditions, rouvrir une contestation qui n'irait<br />
rien moins qu'à -renverser l'économie d'un ordre définitivement clos;<br />
Attendu que le règlement définitif fixe le sort des créanciers produisants el<br />
qu'il participe de la nalure, de l'aulorilé et de l'irrévocabilité des décisions<br />
judiciaires ordinaires;<br />
Que si la doctrine et la jurisprudence admettent la possibilité d'un recours<br />
—<br />
—
359<br />
contre le règlement définitif, c'est seulement lorsque par erreur ou exeès de<br />
pouvoir, l'ordonnance de clôture n'est pas conforme au règlement provi<br />
soire non contesté, ou a mal appliqué ou interprété les décisions qui ont<br />
— statue sur ces contredits; Mais qu'il ne saurait appartenir en dehors de<br />
ces cas, à des créanciers, surtout à ceux qui ont figuré dans l'ordre, de re<br />
mettre en question les bases du règlement définitif, ses solutions sur la<br />
somme à distribuer, l'existence, la quotité el le rang des créances ;<br />
trement la loi sur les ordres, avec ses formalités minutieuses, avec ses délais<br />
— et ses déchéances, ne serait plus qu'un vain mot; Que les consorts Mestre<br />
ne peuvent se réfugier dans l'allégation du dol et de la fraude, en soutenant<br />
que la dol el la fraude font exception à toutes les règles, même à celle de la<br />
— Qu'au<br />
— chose jugée ; Que le législateur établissant une différence nécessaire<br />
entre les conventions et les décisions de la justice, n'a permis de faire tom<br />
ber, pour cause de fraude, les jugements et arrêts que dans des cas excep<br />
tionnels et par la voie extraordinaire de la requête civile;— Altendu dès<br />
lors que les premiers juges en ne repoussant pas immédiatement la demande<br />
des consorts Mestre, ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'altachait<br />
à l'ordre judiciaire en exécution duquel le bordereau de collocation aurait<br />
été délivré aux époux Darcourt ;<br />
Par ces molifs : LA COUR, en donnant acte au sieur Hermitle et aux<br />
—<br />
époux Darcourt de ce qu'ils se joignent aux conclusions de l'appelant ;<br />
— Reçoit l'appel de Housset et y faisant droit ; Infirme le jugement déféré ;<br />
— Déclare<br />
les époux Mestre mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et<br />
conclusions, les en déboule et les condamne en tous les dépens de première<br />
instance et d'appel.<br />
M. Cuniac, Subst. du Proc. gén. ; Me» Dazinière et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN', Président.<br />
Degrés de juridiction. —<br />
4 janvier 1878.<br />
Ana.<br />
—<br />
annuelle.<br />
Taux de la prestation<br />
Quels que soient, en droit musulman, les caractères spéciaux du contrat<br />
d'ans, il se traduit par le paiement d'une somme annuelle, qui ne peut être<br />
qu'une rente ou un loyer, et dont le montant doit servir de base à la fixation<br />
du premier ou du dernier ressort (L. 11 avril 1838, art. I«).<br />
Hamoud ou Ali c. Saïd ben Amara.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Considérant que la terre dont s'sgit est comprise dans la ban<br />
lieue d'Alger, zone pour laquelle la juridiction française esl compétente, en
360<br />
—<br />
vertu des ordonnances antérieures à la loi del873 ; Que, par conséquent,<br />
il n'y a pas lieu pour la Cour de se déclarer incompéten te, soit d'office, soil sur<br />
— la demande des parties ; Considérant que, quels que soient, en droit mu<br />
sulman, les caractères spéciaux du contrat d'ana, qu'il ait pour objet un<br />
droit rachetable ou non, il se traduit par le paiement d'une somme annuelle<br />
—<br />
qui ne peut être qu'une rente ou un loyer; Qu'en employant ces deux<br />
termes, la loi de 1838 a voulu, d'une manière générale, régler le taux du<br />
dernier ressort sur le taux de la prestation annuelle qui prendrait le nom de<br />
rente, quand elle serait le prix d'une transmission de propriété, el celui de<br />
loyer, quand elle sérail le prix d'une simple jouissance —<br />
; Considérant qu'il<br />
s'agit dans la cause d'une terre dont la. valeur se traduit, entre les parties,<br />
par le paiement annuel d'une somme de 700 francs 50 centimes;<br />
'<br />
Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable. Condamne l'appelant à<br />
l'amende et aux dépens d'appel.<br />
M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; M8B Carrière el F. Huré, av.<br />
I. Appel. —<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. RASTIEN, Président.<br />
Domicile<br />
22 février 1878.<br />
élu. — Défenseur, huissier.<br />
II. Nullités facultatives.<br />
I. Est nul l'appel signifié à domicile de l'huissier chez lequel domicile avait<br />
été élu, purement et simplement,<br />
dans l'exploit de signification du jugement.<br />
Cette élection de domicile ne peut valoir que pour les actes d'exécution du<br />
jugement, l'huissier n'étant pas, par la nature de sa fonction, chargé d'une<br />
mission plus étendue (1).<br />
// en serait autrement du domicile élu -niiez un défenseur (2) .<br />
II. L'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 n'est pas applicable aux<br />
nullités édictées par l'ordonnance du 16 avril-12 mai 1843 (art. 46 de cette<br />
ordonn . )<br />
Mohammed El Arbi c. Amar Mabrouk.<br />
ARRÊT :<br />
Sur la fin de non recevoir contre l'appel :<br />
(1-2) 11 est dé jurisprudence constante que l'appel est valablement signifié en<br />
l'étude du défenseur chez, lequel domicile a été élu dans l'acte de signification. —<br />
V. Bull, jud., 1877, p. 57, note. Mais la question résolue par l'arrêt ci-dessus<br />
rapporté ne s'était pas encore présentée. La Cour établit, entre le domicile élu<br />
chez le défenseur et le domicile élu chez l'huissier,'<br />
une distinction que les précé<br />
dentes décisions des tribunaux algériens ne paraissent pas avoir prévue. D'après<br />
les termes de certaines de ces décisions, il est même permis de douter que cette<br />
distinction eût été admise. — Voir notamment l'arrêt du 29 décembre 1876, au Bull<br />
p. 56.<br />
jud., 1877,
361<br />
Considérant que, si aux termes de l'article 69 de l'ordonnance royale du<br />
26 septembre 1842, les nullités d'exploits et de procédure sont, en Algérie,<br />
facultatives pour le juge, cette faculté cesse aux termes de l'article 46 de<br />
l'ordonnance du 12 mai 1843, quant aux nullités édictées par cette dernière<br />
ordonnance;—<br />
Considérant, en fait, que le jugement dont est appel avait<br />
élé signifié, avec élection de domicile, chez l'huissier et que l'appel a été<br />
— Considérant qu'aux termes de l'ar<br />
signifié au domicile de cet huissier ;<br />
ticle 3 de l'ordonnance du 12 mai 1843, aucune assignation ne peut être va<br />
lablement faite qu'à la résidence ou au domicile réel ou d'élection; —<br />
Que<br />
par les mots domicile d'élection, on ne peut entendre qu'un domicile élu<br />
d'une manière générale, à l'origine d'une affaire, pour tous les acles auxquels<br />
elle donnera lieu, ou une élection de domicile spéciale faite en vue d'une<br />
signification à recevoir; —Que l'élection de domicile faite dans l'espèce chez<br />
— l'huissier ne rentre pas dans ces prévisions ; Qu'on ne saurait l'assimiler<br />
à l'élection de domicile faite chez le défenseur, laquelle s'élend à tous les<br />
actes de procédure, à raison de la nature du mandat judiciaire du défenseur<br />
— et de la direction de l'affaire qui en est le résultat ; Que toute aulre est<br />
—<br />
la situation de l'huissier qui n'est que l'agent judiciaire d'exécution ;<br />
Qu'à moins d'une déclaration formelle, accompagnant l'élection de domicile<br />
faite chez l'hussier, la portée de celte élection de domicile se détermine par<br />
— la fonction même de l'officier ministériel qui en esl l'objet ; Qu'elle se<br />
restreint à ce qui est directement relatif aux actes d'exécution ; que dans<br />
l'espèce, l'appel a été interjeté avant tout acte d'exécution el même avant tout<br />
commandement ; Qu'en vain prétendrail-on que l'élection de domicile faite<br />
chez l'huissier avant tout commandement était nécessairement faile en vue<br />
— d'un appel possible; Que celte élection pourrait être soit faile, en vue<br />
d'offres extra-judiciaires à recevoir, soit en vue d'actes d'exécution ultérieurs ;<br />
— Que la signification de l'exploit d'appel au domicile élu chez l'huissier,<br />
n'aurait pu êlre valable qu'autant qu'elle aurait coïncidé avec des actes<br />
d'exéculion ou qu'elle aurait été à l'avance autorisée par une déclaration for<br />
melle dans l'acte qui élisait le domicile ;<br />
ne se rencontre dans la cause.<br />
— Qu'aucune<br />
de ces circonstances<br />
Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable et nul. Condamne l'appelant<br />
au principal, à l'amende et aux dépens d'appel. Condamne les intimés à<br />
l'amende d'appel incident.<br />
M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; M Huré et Chéronnet, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
5 février 1878.<br />
— Compétence . Propriété. — —<br />
Loi du «6 juillet 1 873.<br />
cisïon judiciaire. —<br />
Litige<br />
entre indigènes musulmans.<br />
Dé-<br />
Est de ba compétence exclusive des tribunaux français, la conteétation judi-
362<br />
ciaire soulevée enlre indigènes musulmans, et portant sur des immeubles ayant<br />
fait l'objet d'une décision judiciaire émanant d'unejuridiction française (1).<br />
Amina bent Abdallah c. Mohamed ben Aouda.<br />
Attendu que la loi du 26 juillet 1873 a eu pour but de constituer et de<br />
constater la propriélé immobilière en Algérie ;<br />
l'article 17 de ladite loi dispose que<br />
— Atlendu<br />
à cet effet que<br />
« pour tout ce qui se rapporte à la<br />
« constatation, à la reconnaissance el à la confirmation de la propriété pos-<br />
a sédée à titre privatif et non constatée par acle notarié ou administratif, le<br />
. service des Domaines, sur le vu des conclusions du commissaire-enquêteur,<br />
» procédera à l'établissement des litres provisoires des propriétés ; » At<br />
tendu qu'il résulte de l'article 18 qu'à partir de ce moment les conteslations<br />
qui pourraient surgir seraient soumises aux tribunaux français;<br />
qu'il n'apparait pas que l'immeuble qui fail l'objet du procès ait élé soumis à<br />
— Attendu<br />
l'application des formalités prescrites par l'ordonnance du 21 juillet 1846, et<br />
qu'à cette époque des titres nouveaux aient été délivrés aux ayants droits;<br />
— Mais que s'il suffit d'après l'article 17 sus-visé qu'une propriété ait été<br />
l'objet d'un acte notarié ou administratif, pour rendre inutile les formalités<br />
prescrites par la loi de 1873 et soumettre de plein droit l'immeuble à la loi<br />
française,<br />
à plus forte raison cet effet doit-il être produit par cela seul que<br />
l'immeuble a été l'objet d'une décision judiciaire quelconque ;<br />
qu'il résulte des documents versés au procès que déjà, à la dale du 23 juillet<br />
— Attendu<br />
1853, le haouch Hadj situé aux Adoules, a élé l'objet d'une décision judi<br />
ciaire en ce qu'un sieur Hachette a été reconnu propriétaire d'une part in<br />
— divise de l'immeuble ; Que postérieurement à ce jugement, diverses ten<br />
tatives ont élé faites devant le Tribunal de Rlidah pour arriver au partage de<br />
cette propriété revendiquée par un grand nombre deco-propriélaire ;<br />
— At<br />
tendu qu'en dernier lieu un jugement du Tribunal de Blidah du 14 mars<br />
1877, a ordonné la licitation du haouch Hadj, vu le grand nombre des<br />
ayants-droit et l'impossibilité d'arriver à un partage en nalure ;<br />
—<br />
que l'adjudication a eu lieu en huit lots suivant jugement du 8 mai 1877;<br />
Allendu dans ces circonstances el la question relative à la'validité de la vente<br />
du 24 février 1871, n'ayant été soulevée que postérieurement à toutes les<br />
— Attendu<br />
procédures ci-dessus mentionnées, la juridiction musulmane ne pourrait en<br />
connaître, sans contrevenir aux principes relatifs à la lilispendance, le Tri<br />
bunal de Blidah élanl saisi de la question de savoir dans quelles propor<br />
tions et entre qui les divers prix d'adjudication devront êlre répartis;<br />
Qu'il y a lieu dès lors de confirmer la sentence du premier juge.<br />
Par ces motifs : Confirme le jugement dont esl appel. — Renvoie les par<br />
ties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront el condamne l'appelante aux dépens.<br />
M. Cammartin, av, gén. ; Me» Amar et Chabert-Moreau, av.<br />
(1) Cette interprétation de la loi du 26 juillet 1873 ne nous paraît pas pouvoir<br />
être l'objet d'une contestation. Elle ne fait que confirmer au surplus la jurispru<br />
dence antérieure de la Cour. (Cpr. les arrêts des 14 nov. 1877, 18 déc. 1877, 22<br />
déc. 1877 et 4 janv. 1878. (Bull, jud., 1878, p. 42, 44, 231 et 233).<br />
—
363<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />
Droit musulman. — Successions.<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
tiers réservatolres. — Acebs.<br />
pauvres.<br />
26 mars 1878.<br />
— Rite malekite. — Héri<br />
— Beit el mal. — Parents<br />
Suivant les principes du rite malekite, l'hérédité musulmane se partage :<br />
1° entre les héritiers légitimes qui ont des parts fixes ne pouvant être augmen<br />
tées par voie de dévolution, contrairement à ce qui se pratique dans les rites<br />
hanefite et chafeïte ; 2° entre les héritiers acebs ou, à leur défaut, le Beit el Mal<br />
à qui revient l'excédant de la succession, c'est-à-dire ce qui reste après le prélè<br />
vement des parts dues aux légitimaires .<br />
En l'absence d'héritiers acebs et en cas de renonciation ou de non revendi<br />
cation du Beit el Mal, cet excédant est partagé entre les pauvres et de préfé<br />
rence entre les parents pauvres non successibles, se rattachant par les femmes<br />
au de cujus (1).<br />
Mimi bent Ali c. Nefissa.<br />
Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />
— Attendu que les parties<br />
— en cause et le de cujus appartiennent au rite malekite; Attendu que sui<br />
vant les principes de ce rite, une hérédité se partage : 1° entre les héritiers<br />
légitimes qui ont des parts fixes, qui ne peuvent être augmentées par voie de<br />
dévolution, contrairement à ce qui se pratique dans les rites hanefite et<br />
chafeïte ;<br />
2°<br />
enlre les héritiers acebs ou, à leur défaut, le Beit el Mal à qui<br />
revenait l'excédant de la succession, c'est-à-dire tout ce qui reste après le<br />
prélèvement des parts dues aux légitimaires ; 3° entre les pauvres el préfé-<br />
rablemenl à ceux-ci enlre les parents pauvres par les femmes, en l'absence<br />
des héritiers acebs au cas de renonciation ou de non revendication du Beit<br />
el Mal.<br />
Attendu que dans l'espèce, le de cujus a laissé comme héritiers légitimaires<br />
— sa sœur consanguine Nefissa et sa veuve Goussem ; Que dès lors, Nefissa a<br />
— droit à la moitié et Goussem au quart ; Attendu qu'aucun héritier aceb<br />
n'étant connu et le Beit el Mal, débouté par le jugement déféré, s'étanl désislé<br />
de son appel, le quart restant de la succession devrait appartenir aux pauvres;<br />
— Mais altendu que Mimi bent Ali ben Abderrhaman ben Sidi ben Essadi,<br />
fille d'une sœur consanguine, décédée, du de cujus, a établi son état d'indi<br />
—<br />
gence; Que dès lors elle doit être préférée aux pauvres et qu'il y a lieu de<br />
lui attribuer le quatrième quart de la succession de son oncle maternel Sid<br />
(1) Cpr. Sautayra et Cherbonneau, Du statut personnel et des successions, II,<br />
2 619 et suiv.
Ahmed ben Sidi Saïd Guédoura ;<br />
les dépens.<br />
— Dit<br />
— Atlendu<br />
364<br />
que la partie qui succombe doit<br />
Par ces molifs : Recevant en la forme l'appel interjeté et statuant au fond ;<br />
— qu'il a été mal jugé, bien appelé ; Infirme, en conséquence, le<br />
— Émendanl, ordonne que le quart restant de la succession<br />
jugement déféré ;<br />
de Sid Ahmed ben Sidi Saïd Guédoura, après prélèvement des parts légales<br />
de Hefina et de Goussem, sera attribué à Mimi bent Ali ben Abderrhaman<br />
ben Sidi ben Essaâdi, et condamne ladite Nefissa en tous les dépens de<br />
première instance et d'appel.<br />
M. le prés. Carrère, rapp. ; M. Cammartin,<br />
Ajournement, —<br />
TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2« Ch).<br />
Me<br />
av gén. ; Ballesteros, av.<br />
Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />
Absence<br />
15 juillet 1878<br />
des noms et immatricule de<br />
l'huissier. — Signature illisible. — Nullité.<br />
Est nulle la copie d'un exploit d'ajournement qui, contrairement aux<br />
prescriptions de l'art. 61 g 2° du Code de proc. civ., ne contient ni les noms,<br />
demeure et immatricule de l'huissier instrumentant, ni les noms de la partie<br />
citée;<br />
La signature illisible de l'huissier,<br />
ment,<br />
apposée au bas de l'exploit d'ajourne<br />
ne peut tenir lieu du nom de cet officier ministériel pour les tiers qui ne<br />
sonl pas familiarisés avec cette signature ;<br />
Par suite, la partie à laquelle on a signifié un exploit d'ajournement dans<br />
ces conditions irrégulières et contre laquelle un jugement de défaut aurait élé<br />
surpris est fondée à demander la nullité ■<br />
de cel acte et celle de la procé<br />
dure qui l'a suivi, le coût de l'exploit devant rester à la charge de l'huissier,<br />
par application de l'art. 1031 du Code de proc. civ. (1).<br />
(1) Cette décision est conforme à la jurisprudence relative aux nullités des ex<br />
ploits de procédure en ce qui concerne spécialement les mentions exigées par<br />
Tart. 61, n° 2 du Code de proc. civ. (V. Dalloz, Code de proc. civ. annoté, sur<br />
l'art. 61, n°s 222 et suiv. et 250).<br />
La question intéressante qui pouvait s'élever dans l'espèce, était celle de savoir<br />
si la nullité résultant de l'absence de ces mentions était une de celles qui peuvent,<br />
en Algérie, aux termes de l'art. 6 de l'ord. du 26 sept. 1842, être, selon les cir<br />
constances, accueillies ou rejetées. Le Tribunal ne paraît pas avoir été saisi de la<br />
question. En nous reportant au résumé de la jurisprudence algérieune que<br />
la'<br />
M. Narbonne a publié dans le Bull. jud. (1877, p. 96j sur question des nul<br />
lités facultatives, nous sommes amené à penser que les irrégularités relevées
365<br />
Moïse ben Addi c. Gally Lelouch.<br />
Attendu que le sieur Gally Lelouch a verbalement loué au sieur Moïse ben<br />
Addi, le 3 novembre 1875, un appartement au deuxième étage d'une maison<br />
sise rue Randou, n°<br />
23, pour deux années, du 1« décembre 1875 au 1" dé<br />
cembre 1877, moyennant un loyer annuel de 600 francs par an payable par<br />
trimestre et - d'avance ; Atlendu que le sieur Gally Lelouch a, par exploit<br />
du 18 octobre 1877, enregistré, assigné le sieur Moïse ben Addi devant le<br />
Tribunal civil d'Alger en paiement avec intérêts de droit el dépens, de 600 fr.<br />
pour loyers de l'appartement sus-indiqué, de 85 francs pour loyers d'une<br />
petile chambre, de 25 francs qui auraient été i»dûment retenus par le sieur<br />
Moïse ben Addi, et, à défaut de paiement, en résiliation de location, déguer-<br />
pissement, expulsion, avec — exécution provisoire ; Attendu que le sieur<br />
Gally Lelouch a obtenu, sur celte assignation du Tribunal civil d'Alger,<br />
le 6 novembre 1877, un jugement de défaut, enregistré, lui adjugeant le<br />
bénéfice des fins de son exploit du - 18 octobre 1877 sus-indiqué; Allendu<br />
que le sieur Moïse ben Addi a, par requête de défenseur à défenseur du<br />
21 décembre 1877, enregistré, formé opposition à ce jugement et conclu<br />
principalement à la nullité de l'assignation du 18 octobre 1877 et de la<br />
procédure, qui en a été la suite, subsidiairement au fond à la validité de<br />
ses offres, au rapport du jugement précité, au rejet de la demande du sieur<br />
— Gally Lelouch, avec dépens ; Atlendu que le sieur Gally Lelouch conclut<br />
au maintien du jugement donl est opposition, à la nullité des offres du sieur<br />
Moïse Addi et s'oppose à l'adjudication des fins de sa requête du 21 dé<br />
cembre 1877, précité;<br />
En la forme : Attendu que l'opposition est régulière ;<br />
Sur la nullité de l'assignation du 18 octobre 1877: Atlendu que le sieur<br />
Moïse ben Addi se base, pour la demander, sur ce que la copie de cet acte, à<br />
lui notifiée, ne contient ni l'immatricule de l'huissier ni le nom de la partie<br />
— cilée ; Attendu que la copie dont s'agit ne contient ni les noms, demeure,<br />
immatricule de l'huissier, la signature illisible de l'huissier ne pouvant tenir<br />
lieu dunomdecet officier public pour les tiers qui nesont pas familiarisés avec<br />
cette signalure, ni le nom de la partie citée;— Allendu que ces mentions sont<br />
cependant exigibles à peine de nullité, dans toute assignalion, par l'article 61<br />
du — Code de procédure civile; Allendu que la demande en nullité du sieur<br />
Moïse ben Addi esl dès lors fondée et doit par conséquent être accueillie,<br />
l'assignation dont s'agit demeurant à la charge de l'huissier A***, par appli<br />
cation de l'article 1031 du Code de procédure civile, sous réserve de recours<br />
du sieur Gally Lelouch contre ledit huissier, ainsi que de droit;<br />
Sur le surplus des conclusions des parties : Altendu qu'il devient inutile<br />
d'en examiner le mérite;<br />
Par ces motifs : Reçoit en la forme comme régulière et au fond comme jus<br />
au point de vue de la nullité de l'assignation notifiée au sieur Moïse<br />
tifiée,<br />
ben Addi, l'opposition de ce dernier au jugement de défaul du 6 novembre<br />
étaient de nature à pouvoir être écartées par les juges, d'autant plus que le défen<br />
deur se trouvant en réalité nanti, de la copie incomplète, ne pouvait sérieusement<br />
arguer d'aucun préjudice dont il fût victime. V, M.
1877 ;<br />
— Déclare<br />
366<br />
nulle ladite assignation et ce qui s'en esl suivi ;<br />
— Ordonne<br />
que le jugement dont est opposition soit considéré, par suite, comme non<br />
— avenu dans toutes ses dispositions ; Remel les parties au même état où<br />
— elles étaient avant l'assignation annulée ; Condamne le sieur Gally Youssef<br />
de Nessim Lelouch à lous les dépens faits jusqu'à ce jour envers le sieur<br />
Moïse Addi, le coût de l'assignation annulée'demeurantà la charge de l'huis<br />
sier A***<br />
sous réserve, ainsi que de droit, du recours du sieur Gally Lelouch<br />
contre ledit huissier, à raison du préjudice que lui cause l'annulation de<br />
celte assignation el de la procédure qui s'en est suivie.<br />
M. Parisot, subst. du Proc-, de la Rép. ; M« Jouyne el A. Blasselle, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en dale du 14 novembre 1878, a été nommé :<br />
Notaire à Batna, M. Massonnié (Thomas-Henri),<br />
taire, en remplacement de M. Champroux,<br />
qualité à Guelma.<br />
Par décret en dale du 14 novembre 1878,<br />
principal clerc de no<br />
qui a élé nommé en la même<br />
ont été nommés :<br />
Conseillera la Cour d'appel d'Alger, M. Pellereau, président du Tribunal<br />
de lre instance d'Oran, en remplacement de M. Duplessis, admis,<br />
sur sa de<br />
mande, à faire valoir ses droits à la retraite et nommé conseiller honoraire.<br />
Président du Tribunal d'Oran, M. Besse de la Romiguière, président du<br />
siège de Blida, en remplacement de M. Pellereau.<br />
Président du Tribunal de Blida, M. Parizot, président du siège de Tizi-<br />
Ouzou,<br />
en remplacement de M. Besse de la Romiguière.<br />
Juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, M. Rey, juge d'instruction à<br />
Constantine, en remplacement de M. Maynard de la Lavalelte, admis, sur sa<br />
demande, à faire valoir ses droits à la retraite et nommé vice-président ho<br />
noraire.<br />
Juge au Tribunal de 1 instance de Constantine, M. Lejeune, juge d'ins<br />
truction à Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Rey.<br />
Juge au Tribunal de Blida, M. Lisbonne, juge de paix de Blida, en rem<br />
placement de M. Schwab, décédé.<br />
Juge au Tribunal de Blida, M. Terrasson, juge au siège de Bougie, en<br />
remplacement de M. Bonamy, nommé juge suppléant rétribué à Alger.<br />
Juge au Tribunal de Bougie, M. Cotlen, juge de paix d'Aïn-Temouchent,<br />
en remplacement de M. Terrasson.<br />
Substitut du Procureur de la République de Blida, M. Pichard, substitut<br />
du Procureur de la République à Mostaganem, en remplacement de M .<br />
Breuilhac, nommé substitut à Millan (Aveyron).
367<br />
Juge au Tribunal de Tizi-Ouzou, M. Tellier, juge de paix de Dra-el-Mizan,<br />
en remplacement de M. Lejeune.<br />
Juge au Tribunal de Bône, M. Bercegol du Moulin, juge de paix d'Or<br />
léansville, eu remplacement de M. Kolb, décédé.<br />
Sont, par le même décret, spécialement chargés du règlement des ordres,<br />
pour l'année judiciaire 1878-1879, près le Tribunal de Bône, M.Bourges,<br />
juge du siège ; près le Tribunal de Mostaganem, M. Pandrigue de Mai-<br />
sonseul, juge du siège ; près le Tribunal de Constanline, M. Mounier, juge<br />
du siège ; près le Tribunal d'Alger, M. Bourouillou, juge du siège.<br />
Par le même décret, M. Lejeune, juge près le siège de Constantine, rem<br />
plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, M . Tellier<br />
au siège de Tizi-Ouzou les fonctions de juge d'instruction.<br />
Par décret en date du 14 novembre 1878, ont été nommés :<br />
remplira<br />
Juge de paix d'Aïu-Temouchent, M. Gravereau, juge de paix de Bordj-bou-<br />
Arréridj, en remplacement de M. Cotten, nommé juge.<br />
Juge de paix de Bordj-bou-Arréridj, M. Dudouit, juge de paix de Djelfa,<br />
en remplacement de M. Gravereau, qui est nommé juge de paix d'Aïn-Te-<br />
mouchent.<br />
Juge de paix de Djelfa, M. Broche, ancien magistrat, en remplacement de<br />
M. Dudouit, qui esl nommé juge de paix à Bordj-bou-Arréridj.<br />
Juge de paix d'Orléansville, M. Virgilti, juge de paix d'Akbou, en rempla<br />
cement de M. de Bercegol du Moulin,<br />
nommé juge.<br />
Juge de paix d'Akbou, M. Barrion, juge de paix de Saïda, en remplace<br />
ment de M. Virgilti, qui est nommé juge de paix à Orléansville.<br />
Juge de paix de Saïda, M. Favre, juge de paix de Teniet-el-Hâad, en rem<br />
placement de M. Barrion, nommé juge de paix à Alibou.<br />
Juge de paix de Teniet-el-Hâad, M. Geoffroy, suppléant rétribué du juge<br />
de paix de Miliana, en remplacement de M. Favre,<br />
Saïda .<br />
nommé juge de paix à<br />
Suppléant rélribué du juge de paix de Miliana, M. Thiébault (Charles-<br />
Paul), licencié en droit, en remplacement de M. Geoffroy, nommé juge de<br />
paix à Teniet-el-Hâad.<br />
Juge de paix de Blida, M. Genly, suppléant rétribué du juge de paix de<br />
Boufarik, en remplacement de M. Lisbonne, nommé juge.<br />
Suppléant rétribué du juge de paix de Boufarik, M. Forget, avocat, en<br />
remplacement de M. Genty, nommé juge de paix à Blida.
Obligation a ordre. Endossement. —<br />
368<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Transport.<br />
—<br />
On<br />
peut valablement<br />
stipuler qu'une obligation contractée par acte notarié, el ayant même une<br />
cause civile, sera payable à l'ordre du créancier ; par suite l'endossement<br />
d'une telle obligation suffit pour en opérer la cession vis-à-vis des tiers.<br />
(Cass. civ., 8 mai 1878. /. du Pal., 1878, p. 743)<br />
Louage. Incendie. —<br />
Indemnité<br />
—<br />
-Répartition. — La répartition de l'in<br />
demnité due au propriétaire par les divers locataires d'une maison incendiée,<br />
alors qu'il est impossible de savoir chez lequel d'enlr'eux l'incendie a pris<br />
naissance, doit se faire par portions égales et non proportionnellement à l'im<br />
portance de leurs loyers respectifs. (Trib. de Nancy, 13 juillet 1876. Recueil<br />
des arrêts de Nancy, 1878, p. 102).<br />
Notaire. Paiement. —<br />
Preuve<br />
par écrit. —<br />
Livres.<br />
—<br />
Grosse.<br />
—<br />
Le no<br />
taire qui réclame à son client une somme de plus de 150 francs qu'il prétend<br />
avoir payée en l'acquit de ce dernier, n'est pas recevable, en l'absence d'un<br />
commencemenl de preuve par écrit, à fonder sa demande sur de simples<br />
présomptions, tirées soit de la détention de la grosse de l'acle d'obligation,<br />
soit des énonciations contenues dans ses livres. (Cass. civ., 6 février 1878.<br />
J. du Pal., 1878, p. 749).<br />
Dette de jeu. Effet de commerce.<br />
— Endossement.<br />
—<br />
Le<br />
perdant au jeu<br />
qui, pour acquitter sa detle, a endossé régulièrement au profil du gagnant<br />
un billet souscrite son ordre par un liers,<br />
ne peut pas exiger la restitution<br />
de ce billet ni se faire remettre par le gagnant la somme que celui-ci aurait<br />
reçue du souscripteur : mais, de son côté, le gagnant ne peut exercer contre<br />
le perdant aucune action récursoSre pour l'obliger à payer le montant du bil<br />
let, dans le cas où le souscripteur ne l'acquilteraitpas ; ce qui serait, en effet,<br />
un moyen détourné de poursuivre le paiement d'une detle de jeu. (Cass. civ.,<br />
6 août 1878. Fr.jud., Il, p. 681).<br />
Société. Actes additionnels. -—<br />
Publication.<br />
—<br />
L'art.<br />
61 de la loi du<br />
24 juillet 1867 sur les Sociétés n'exige pas la publication des actes addition<br />
nels qui ont pour unique objet de régler les rapports des associés entre eux,<br />
sans affecter en rien les intérêts des tiers. (Cass. req , 15 juillet 1878. Fr.<br />
jud., II, p. 619).<br />
Étranger divorcé. Mariage en France. —<br />
Un<br />
étranger (dans l'espèce un<br />
sujet belge), régulièrement divorcé dans son pays, peut contracler un nou<br />
veau mariage en France, bien que le premier mariage ail été contracté avec<br />
une Française. (Cass. civ., 15 juillet 1878. Fr.jud., II, p. 620).<br />
Alger. — Typ, A. Jobudan.
2e année. — Ier Décembre 1878. —<br />
N° 47<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
Appel. —<br />
DOCTRINE. -<br />
Conclusions<br />
JURISPRUDENCE.<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
-<br />
COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />
LÉGISLATION<br />
Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />
W juillet 1878<br />
nouvelles. — — Omission. Adoption<br />
de motifs.<br />
Lorsque devant les juges d'appel, il est présenté pour la première fois une<br />
exception nouvelle, l'arrêt qui sans s'expliquer à cet se contente égard, de<br />
confirmer par adoption de motifs, le jugement dans lequel cette exception<br />
n'avait pu être appréciée, doit être cassé comme ayant violé l'art. 7 de la loi du<br />
20 avril 1810 (1).<br />
Ferveur c. Gallo.<br />
—<br />
LA COUR : Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que Gallo<br />
agissant comme créancier hypothécaire de la dame Duffaut, avait obtenu<br />
du tribunal de Mostaganem un jugement qui ordonnait la licitation de cer<br />
tains immeubles provenant de la succession de Jean-Louis Ferveur, père de<br />
sa débitrice, ou de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme<br />
—<br />
survivante ; Que Joseph Ferveur, frère et cohéritier de la dame Duffaut,<br />
ayant appelé de ce jugement, avait produit, pour justifier son appel, un acte<br />
sous seingprivé,<br />
daté du 9 juillet 1872 et enregistré le 28 avril 1876, portant<br />
de lous les biens composant la<br />
partage, entre la veuve Ferveur et ses enfants,<br />
communauté el la succession paternelle; qu'il avait conclu, en conséquence,<br />
à ce que la Cour d'Alger déclarât que les immeubles en litige ayant été par<br />
tagés en nature, il n'y avait pas lieu à licitation —<br />
;<br />
Attendu que, sans s'ex<br />
pliquer sur cet acle de partage, dont la valeur et les objets n'avaient pu être<br />
appréciés par le tribunal de première instante, la Cour d'appel a confirmé le<br />
jugement qui ordonnait la licitation, en adoptant les motifs des premiers<br />
— Qu'en rejetant ainsi implicitement, et sans en donner aucun<br />
juges ;<br />
61). Cass. 3 mai 1869 (D.<br />
(1) Jurisp. constante. Cass., 18 févr. 1867 (D. 1867, 1,<br />
1869, l, 256). Cass., 2 déc. 1872 (D 1872, 1, 462). Cass., 24 mars 1873 (D-. 1873,<br />
1 280). — Cpr. D. Code de proc, civ. annoté sous l'art. 141, n°» 782 et suiv.
370<br />
motif, l'exception proposée pour la première fois en appel par Joseph Fer<br />
veur, l'arrêt attaqué a violé la disposition légale ci-dessus visée ;<br />
— Par ces<br />
motifs : Casse.<br />
M. Requier, cons. rap. ; M. Charrins, 1er av. gén, (conc. conf.) ;<br />
Me Lehman, av.<br />
COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />
Présidence de M. BARBIER, conseiller.<br />
29 août 1878.<br />
Cour d'assises. — Interrogatoire par le président des assises.<br />
— Formes. —<br />
compétents .<br />
Contumax.<br />
— Interrogatoires. —<br />
Magistrats<br />
L'interrogatoire prescrit par l'art. 293 du Code d'instr. crim. constitue une<br />
formalité substantielle, non seulement au point de vue
»1<br />
président des assises portant simplement que l'accusé a répondu affirmativement<br />
sur le point de savoir s'il persiste dans ses réponses antérieures, est entaché<br />
d'une nullité substantielle qui doit entraîner l'annulation de toute la procédure<br />
qui a suivi (1).<br />
Mohamed ben Ahmed.<br />
LA COUR : Sur le moyen pris de la violation des art. 266, 293, 303 du Code<br />
d'instruction criminelle :<br />
Attendu, en droit, que l'interrogatoire prescrit par l'art. 293 du Code<br />
d'instruction criminelle constitue une formalité substantielle, dont l'accom<br />
plissement est indispensable à la manifestation de la vérité, tant dans l'inté<br />
rêt de l'accusé que dans l'intérêt de l'accusalion ;<br />
Altendu que cet interrogatoire n'a pas uniquement pour but le choix ou la<br />
désignation du défenseur qui devra assister l'accusé pendant les débats et<br />
l'avertissement à donner à l'accusé au sujet de son droil de se pourvoir en<br />
cassation contre l'arrêt de renvoi, mais qu'il a en oulre pour objet de mettre<br />
l'accusé en mesure de fournir sur les éléments de, l'information telles expli<br />
cations qu'il jugerait utiles à sa défense ;<br />
Attendu que si, en ce qui concerne celte dernière partie de l'interrogatoire,<br />
il est suffisamment satisfait au vœu de la loi par la mention insérée au procès-<br />
verbal, d'une réponse affirmative de l'accusé à la question de savoir s'il per<br />
siste dans les réponses consignées dans ses précédents interrogatoires, il n'en<br />
saurait être ainsi lorsque les interrogatoires antérieurs sont dénués de loute<br />
valeur légale, comme actes d'instruction, à raison de l'incompétence des<br />
magistrats qui y ont procédé, que dans ce cas, la nullité de ces interroga<br />
toires entraîne la nullité de l'inlerrogaloire qui s'y réfère et dont ils sont le<br />
complément indispensable;<br />
Altendu qu'aux termes de l'art. 303 du Code d'instruction criminelle il ne<br />
peut êlre procédé à des actes d'instruction postérieurement à l'arrêt de renvoi-<br />
que par le président de la Cour d'assises ou en verlu de sa délégation;<br />
qui s'était soustrait<br />
Attendu, en fait, que l'accusé Mohamed ben Si Ahmed,<br />
par la fuite à l'exécution des mandats décernés contre lui, n'avait point élé<br />
interrogé dans le cours de l'information ; qu'arrêté postérieurement à l'arrêt<br />
de renvoi, il a été interrogé, sans aucune délégation du président des assises,<br />
par le juge de paix du canton de Bordj, et ensuite par M. le substitut de<br />
M. le procureur de la République de Sétif;<br />
Que l'interrogatoire auquel il a élé procédé, en exécution de l'art. 293 du<br />
Code d'instruction criminelle, se borne à mentionner que l'accusé interpellé<br />
sur le point de savoir s'il persiste dans ses réponses consignées dans ses<br />
interrogatoires antérieurs, a répondu affirmativement ;<br />
Attendu que, dans ces conditions, cet interrogatoire se trouve entaché<br />
d'une nullité substantielle qui doit entraîner l'annulation de la procédure<br />
qui l'a. suivi;<br />
Par ces molifs : Casse l'arrêt rendu le 18 juillet 1878 par la Cour d'assises<br />
(1) Nous n'avons pas trouvé de décision antérieure de la Cour de Cassation<br />
ayant statué sur l'intéressante question résolue dans l'espèce.
de Constantine,<br />
372<br />
qui a condamné le nommé Mohamed ben Si Ahmed à la peine<br />
de mort ; renvoie la procédure devant la Cour d'assises de Rône.<br />
M. Gast, cons. rapp. ; M. Petiton, av. gén. ; Mes Codlombel<br />
et Massenat-Deroche, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
Substitution prohibée.<br />
11 février 1878.<br />
premier Président.<br />
— Donation sous condition.<br />
— Fidéicommis «fe resMwo.<br />
Une disposition ne tombe sous le coup de la loi, comme contenant une subs<br />
titution prohibée, que lorsqu'on y trouve deux institutions, distinctes faites en<br />
faveur de deux personnes différentes, non alternatives, mais successives,<br />
séparées par un trait de temps, la seconde subordonnée au décès du premier<br />
institué, et que cette disposition opère ainsi une transmission à deux degrés,<br />
établissant un véritable ordre de succession, avec obligation implicite pour le<br />
premier institué de conserver et de rendre au deuxième.<br />
On ne saurait trouver de semblables caractères dans une donation qui, lais<br />
sant au donataire, à partir du jour du décès du donateur, la libre disposition<br />
des biens donnés, stipule seulement que la succession du, donataire aura à<br />
remettre aux héritiers du donateur ces mêmes biens dans le cas où ils existe<br />
raient en nature, ou leur valeur estimative s'ils n'existaient plus ainsi.<br />
En effet, le donataire ayant dans ce cas la libre disposition des objets<br />
donnés, n'est plus tenu de les conserver, et le signe le plus caractéristique de la<br />
substitution fait ainsi défaut.<br />
Cette disposition constitue ce qu'on appelait jadis le fidéicommis de residuo ;<br />
il n'a aucunement pour effet de modifier l'ordre des successions qui, suspendu<br />
seulement pendant la vie du donataire, reprend son cours à la mort de ce der<br />
nier pour les biens qui resteront.<br />
Cette forme de disposer, conçue en général dans un sage esprit de famille,<br />
n'offre aucun des inconvénients inhérents aux substitutions et doit donc être<br />
sanctionnée sans difficulté (1).<br />
(1) Jurisp. conf., Colmar,<br />
29 mai 1861 (D. 1862, 2, 5).<br />
v°<br />
6 fév. 1824 (D. Rép. Substitution, n° 65), Rennes,<br />
La jurisprudence, longtemps indécise sur cette question, s'est fixée actuellement<br />
v°<br />
dans le sens de l'arrêt rapporté (Cpr. Dalloz, Rép, Substitution, g 66 et suiv.,<br />
Aubry et Ru, VI, p. 19, et JD. Code civil annoté, sous l'art. 896, n°» 98 et t.<br />
suiv.)
373<br />
Héritiers Rolland c. veuve Rolland.<br />
Attendu que les héritiers Rolland demandent la nullité, pour cause de<br />
substitution prohibée, de la donation consentie par Claude Rolland en faveur<br />
de sa femme, suivant acte reçu par M
Capitaine de navire.<br />
374<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />
Ch.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
4 janvier 1878.<br />
de la nécessité de cet emprunt. Privilège<br />
prêteur.<br />
— Emprunt à la grosse. — Constatation<br />
— Preuve. —<br />
du<br />
Le capitaine étant le mandataire tant des armateurs que des chargeurs, pour<br />
tout ce qui a trait au transport et à la conservation de la marchandise placée<br />
à bord, il peut, pour le salut du navire, qui se confond avec celui de la mar<br />
chandise, emprunter avec privilège sur la marchandise (C. com., 234, 236).<br />
// n'est pas indispensable,<br />
pour la validité de l'emprunt et du gage qui en<br />
résulte, que la nécessité de l'emprunt ait été constatée par les mesures prélimi<br />
naires édictées par l'art. 234. Il suffit que l'existence de cette nécessité soit<br />
reconnue par le juge. Mais, dans ce cas, le capitaine aura la preuve à sa<br />
charge.<br />
Le tiers qui a prêté sur marchandises à bord, peut invoquer, d'une manière<br />
générale, le privilège des frais par lui faits pour la conservation de la chose.<br />
Il résulte des art. 315, 320 et 324 du Code de commerce, que le préteur à la<br />
grosse a privilège sur la marchandise .<br />
Marquant et Cie c. Salgé et Giron.<br />
ARRÊT :<br />
LA COUR : Considérant que les capitaines de navires sont les mandataires<br />
non seulement des armateurs, mais aussi ceux des chargeurs pour tout ce qui<br />
a trait au transport et à la conservation de la marchandise placée à bord ;<br />
— Que les capitaines peuvent, dans la limite de leur mandai, obliger leurs<br />
— mandants vis-à-vis des tiers ; Qu'il résulte des articles 234 et 236 du Code<br />
de commerce, que le capitaine peut, pour le salut du navire, qui se confond<br />
avec celui de. la marchandise, emprunter avec privilège sur la marchandise ;<br />
— Qu'il<br />
n'est pas nécessaire pour la validité de l'emprunt et du gage qui en<br />
résulte, que la nécessité de l'emprunt ait élé constatée par les mesures préli<br />
minaires édictées par l'article 234 du Code de commerce ;<br />
l'existence de cette nécessité soit reconnue par le juge ;<br />
— Que<br />
— Qu'il<br />
suffit que<br />
le capitaine,<br />
qui n'aura pas pris les mesures édictées par l'article 234 du Code de com<br />
merce, destinées à l'affranchir de toute responsabilité, aura la preuve à sa<br />
—<br />
charge; Que le liers, qui aura prêté sur marchandises à bord, peut invo<br />
quer d'une manière générale le privilège des frais par lui faits pour la con<br />
servation de la chose ; qu'il suffit que le prêt ait profité aux marchandises, ou<br />
—<br />
qu'il ait élé destiné à cet objet, selon toutes les règles de la prudence ;<br />
Qu'il résulte des articles 315, 320 et 324 du Code de commerce que le prêt à
h375<br />
la grosse, beaucoup moins favorable que celui qui a pour objet les réparations<br />
— du navire, a également privilège sur la marchandise ; Considérant que<br />
Marquand- et Cie ont, à bon droit, fait des avances pour la réparation du<br />
navire l'Esther, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de<br />
Mais,<br />
commerce d'Oran ;<br />
—<br />
qu'à partir du jour où ils onl reçu une opposi<br />
tion à la requête des chargeurs, ils n'ont pu continuer ces avances qu'à leurs<br />
— risques et périls personnels; Qu'en effet l'ordonnance, étant un acte de<br />
juridiction gracieuse, n'a pu couvrir les prêteurs à partir du jour où une<br />
contestation soulevée a fait entrer les choses dans une période contentieuse;<br />
— Que la prudence prescrivait à Marquant, soit de s'abstenir désormais, soit,<br />
du moins, d'appeler les opposants en référé devanl le magistrat qui avait<br />
rendu l'ordonnance contre laquelle on protestait;<br />
— Que<br />
Marquand ne<br />
pouvait plus considérer le capitaine comme le mandataire légal et unique<br />
des chargeurs, dès que ceux-ci avaient envoyé sur place un mandataire spé<br />
— cial qui se révélait par un acte judiciaire ; Considérant que si Marquant a<br />
reconnu qu'au jour de l'opposition, il n'avait avancé que 1,600 francs, il<br />
entendait par là les sommes remises directement au capitaine el qu'il récla<br />
mait, en dehors, les déboursés par lui faits en payant des dépenses qui ont<br />
— profité au navire et à la cargaison ; Que la Cour a les éléments nécessaires<br />
pour fixer l'ensemble des avances à 3,043 francs 15 centimes au jour de<br />
— l'opposition ; Considérant que les premiers juges ont bien apprécié ce qui<br />
était dû à Marquand pour frais et salaires de magasinage, intérêts el commis<br />
sion de banque, commission sur le cautionnement donné à la douane —<br />
;<br />
Mais qu'ils ont alloué une commission exagérée pour soins donnés à la tierce<br />
consignation des marchandises ;<br />
— Que<br />
le larif de l'établissement des docks<br />
de Marquand n'a pu êlre pris en aucune considération;— Que, dans les<br />
circonstances do la cause, Marquand était mandataire, non des parties, mais<br />
— de justice; Qu'il<br />
étaient assurées aux frais de leurs propriétaires ;<br />
n'avait aucun risque à courir puisque les marchandises<br />
— Qu'il n'avait à peu près<br />
aucun soin à donner à la marchandise, ni à l'exposer aux amateurs, ni à en<br />
faciliter la venle, comme cela se pratique dans les docks —<br />
; Que cette mar<br />
—<br />
chandise était renfermée dans un magasin dont la douane gardait la clef ;<br />
Que Marquand avait été payé, d'autre part, des frais de transbordement et de<br />
— la surveillance qu'il avait apportée à cette opération ; Que, dans ces cir<br />
constances, une commission de un demi pour cent sur une marchandise d'un<br />
prix élevé est suffisante et qu'il y a lieu de réduire l'allocation de ce chef à<br />
— 894 francs ; Adoptant, en outre, en tant que non contraires à ceux cidessus,<br />
les motifs des premiers —<br />
juges; Considérant que par suite de l'exé<br />
cution provisoire du jugement dont appel, Giron, ès-noms, a payé 6,110 fr.<br />
89 centimes, le 11 octobre 1877, tandis que, d'après le présent arrêt, il n'est<br />
débileur que de 3,503 francs 5 centimes;<br />
Par ces motifs : Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident :<br />
Confirme le jugement au principal ;<br />
— Et<br />
émendant sur l'appel incident :<br />
Arrête le solde de compte d'entre parties à 4,503 francs 5 centimes. — Con<br />
damne Marquand et C« à payer à Giron, ès-qualilés, et comme représentant<br />
les Compagnies d'assurances aux risques desquelles voyageaient les marchan<br />
dises chargées sur l'Esther, la somme de 1 ,607 francs<br />
75 centimes avec inté<br />
rêts à 10 pour o/o, du il octobre 1877. - Ordonne la restitution d'amende
d'appel incident. —<br />
Confirme<br />
376<br />
les dispositions du jugement qui ont donné<br />
acte aux parties de leurs déclarations et réserves. — Déclare les parties non<br />
recevables et mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclu<br />
sions. —<br />
d'appel .<br />
Condamne Marquand et C*
377<br />
il n'est pas lui-même acheteur de la chose, la détenant seulement à titre de<br />
gage, et celui dont il tient cette possession, n'en avait pas davantage acquis à<br />
la propriété.<br />
Il ne saurait donc se refuser à restituer à la partie, dont le droit de propriété<br />
est demeuré intact, le troupeau appartenant à celle-ci.<br />
Alberge et Jauffret c, Castillon et Mainvielle.<br />
Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges<br />
que Mainvielle a remis en gage à Castillon un troupeau de soixante-trois<br />
— porcs ; Que ce troupeau était réduit à cinquante-huit têtes au moment de<br />
l'expertise et que quarante-cinq lêtes portaient la marque d'Alberge et<br />
Jauffret ;<br />
Considérant qu'Alberge et Jauffret avaient confié à Mainvielle un troupeau<br />
de porcs, suivant convenlion sous seing-privé, enregistré à Bel-Abbès, le<br />
— 13 février 1874 ; Que celle convention n'est point une vente puisqu'aucun<br />
— prix n'y est stipulé ; Qu'elle n'est point un échange puisque, si le trou<br />
peau d'Alberge et Jauffret constitue un corps certain, on n'indique aucun<br />
— autre objet qui serait contre-échange avec ce troupeau ; Que si la con<br />
vention ne constitue pas un cheptel ordinaire, elle établit un contrat innomé<br />
—<br />
qui conserve actuellement la propriété du troupeau à Alberge et Jauffret ;<br />
— Que ce troupeau porte leur marque ; Qu'il est stipulé que Mainvielle<br />
devra faire des livraisons successives d'animaux jusqu'à concurrence d'un<br />
poids déterminé, et que ces livraisons faites, l'excédant du troupeau appar<br />
— tiendra à Mainvielle ; Qu'il résulte donc de ce contrat que la propriété du<br />
troupeau demeurera à Alberge et Jauffret et ne sera transférée à Mainvielle<br />
— qu'après les livraisons prévues ; Qu'ainsi la transmission de la propriété a<br />
été soumise par les parties à une condition suspensive qui ne s'est pas réali<br />
sée et que Mainvielle n'a pas cessé de posséder à titre provisoire et pour<br />
autrui ;<br />
Que par conséquent, en essayant de donner en gage à Castillon la chose<br />
d'autrui, il n'a pu lui transférer des droils qu'il ne possédait pas lui-même ;<br />
— Que l'acte de gage invoqué par Castillon est nul en la forme puisqu'il n'a<br />
pas été enregistré avant d'être attaqué en justice ; — Qu'il<br />
est nul au fond<br />
puisqu'il a pour objet la chose d'autrui ;<br />
Que Castillon ne peut invoquer sa possession personnelle et l'article 2279<br />
du Code civil puisqu'il ne possédait que du chef de Mainvielle et, par consé<br />
avec le vice de précarité qui empêche la prescription instantanée édic<br />
quent,<br />
tée par l'article 2279 ;<br />
— Que<br />
cet article ne peut être invoqué que par celui<br />
qui se prétend propriélaire et non par le détenteur qui se prétend seulement<br />
— créancier gagiste ; Que Castillon ne saurait invoquer davantage l'article<br />
2102 du Code civil qui protège seulement celui qui a acheté une chose non<br />
payée par un premier acheteur ;<br />
— Que<br />
d'abord Mainvielle n'est pas un pre<br />
mier acheteur puisqu'il n'y a pas eu vente enlre Alberge et Jauffret et<br />
lui ;<br />
— Qu'ensuite<br />
Castillon n'est pas un second acheteur puisqu'il ne se<br />
présentait que comme ayant acquis sur le troupeau un simple droil de gage ;<br />
Que Castillon est donc responsable, envers Alberge et Jauffret, de la valeur<br />
qu'avaient les animaux appartenant à ceux-ci quand il les a reçus ;<br />
— Que
,378<br />
dans leur exploit introduclif d'instance, les demandeurs ont fixé cette valeur<br />
à 25 fr. 50 c. par tête, chiffre très-inférieur à, leurs prétentions actuelles;<br />
— Qu'ils ont conclu alternativement à la restitution des animaux ou au paie<br />
est préférable de condamner seulement Castil<br />
— ment dé leur valeur; Qu'il<br />
— lon à rembourser la valeur au jour de réception ; Que Castillon ne saurait<br />
être tenu de la valeur actuelle obtenue par la nourriture qu'il a lui-même<br />
fournie ;<br />
quarante-<br />
Considérant, dès lors, que Castillon est tenu de la valeur des<br />
cinq têtes pour lesquelles il n'est pas justifié d'une autre marque que celle<br />
d'Alberge et Jauffret, soit d'une somme de 1,147 fr. 50 c. ;<br />
— Considérant<br />
que la mauvaise foi de Castillon n'étant pas justifiée, il n'est pas possible<br />
d'autres dommages-intérêts que des intérêts judiciaires ;<br />
En ce qui touche la demande d'Alberge et Jauffret contre Mainvielle, la<br />
demande de Castillon contre Mainvielle, les demandesreconvenlionnelles de<br />
Mainvielle;<br />
adoptant les motifs des premiers juges;:<br />
Con<br />
— Infirme et met à néant le jugement dont esl appel ;<br />
Réformant':<br />
damne Castillon à payer à Alberge et Jauffret 1,147 fr. 50 c, avec intérêt^ à<br />
10 pour °/o du jour de la demande ;<br />
— Dit<br />
que cette condamnation viendra<br />
en déduction des créances d'Alberge et Jauffret contre Mainvielle -^.Con<br />
damne Mainvielle à 1,000 fr. de dommages-intérêts envers Alberge et Jauf<br />
— fret sans déduction à opérer de ce chef; Condamne Mainvielle à payera<br />
— Réserve à Castillon ses droits contre Mainvielle pour<br />
Castillon 3,688 fr. ;<br />
se faire garantir des suites du présent arrêt en faveur d'Alberge el Jauffret ;<br />
— Déboute les parties de tout le surplus de leurs demandes, Sds et conclu<br />
— —<br />
sions ; Ordonne la restitution de l'amende ; Condamne Castillon envers<br />
— Alberge et Jauffret aux dépens de première instance el d'appel ; Condamne<br />
Mainvielle aux dépens de première instance et d'appel envers toutes les<br />
autres parties;<br />
— Le<br />
parant quoique dûment réassigné.<br />
tout avec itératif défaut contre Mainvielle, non com<br />
M . de Vaulx, subst. du proc. gén. ; Mes Bouriaud et Chabert Moreau, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
1er avril et 24 juin 1878.<br />
Droitmusulman. — Mariage. — Impuissance dumari. —Divorce.<br />
En droit musulman, l'état d'impuissance du mari, surtout si son état in<br />
tellectuel se trouve en outre voisin de l'idiotisme, peut être considéré par les<br />
juges comme une cause suffisante pour faire prononcer le divorce entre les<br />
époux (1).<br />
(1) Voir dans l'ouvrage de MM. Sautayra et Cherbonneau, I, g 150 et suiv., les<br />
règles du dioit musulman relatives aux « vices rédhibitoires<br />
l'un ou l'autre époux.<br />
» dont serait atteint
379<br />
Daouïa c. Ahmed ben Saïd.<br />
Cette affaire se présentait devant la Cour avec un caractère tout particulier de<br />
saveur locale.<br />
La femme, qui demandait son divorce,<br />
prétendait qu'en présence de l'impuis<br />
sance de son mari, elle se serait laisser déterminer par la mère de ce dernier,<br />
à avoir des relations avec lui, ayant la tête voilée pour conjurer les effets de l'in<br />
firmité dont il semblait atteint, et qu'au cours de l'épreuve, elle aurait remarqué, en<br />
écartant un coin du voile, qu'un tiers avait été substitué au mari pour cette expé<br />
rience.<br />
Ces affirmations de la femme se produisaient avec un tel caractère de vraisem<br />
blance que la Cour crut devoir, par un premier arrêt, en ordonner la vérification.<br />
Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />
Attendu que pour justifier son refus de réintégrer le domicile conjugal,<br />
Daouïa prétend, en premier lieu, que son mari Ahmed ben Saïd est impuis<br />
sant, et, en second lieu, que la mère de celui-ci, abusant de l'inexpérience<br />
de l'appelante, à l'aide du plus odieux subterfuge, l'aurait livrée au nommé<br />
Saïd ben Abderrhaman, demeuranl aux Ouled-ben-Salah,<br />
croire que ledit Saïd ben Abderrhaman n'était autre que son mari ;<br />
Attendu qu'à la suite de cet altenlal Daouïa a déposé une plainte entre les<br />
en lui laissant<br />
mains de M. Choisnet, administrateur civil de Dra-el-Mizan, et qu'un<br />
homme de l'art commis à cet effet a déclaré, après examen, que suivant<br />
toutes probabilités, Ahmed ben Saïd, qui lui paraissait êlre dans un état<br />
voisin de l'idiotisme, était impuissant, et que Daouïa n'était pas vierge ;<br />
Attendu qu'avant de statuer au fond sur le mérite de l'appel interjeté, il<br />
convient de vérifier la sincérité des allégations de Daouïa relatives à l'entre<br />
prise dont elle aurait été la victime, et que, dans ce but, c'est le cas de char<br />
ger le juge de paix de Ménerville de procéder à une enquête ;<br />
— Attendu<br />
que les dépens doivent être réservés ;<br />
— Par ces motifs : Recevant l'appel en la forme et avant dire droit ; Com<br />
met M. le juge de paix de Ménerville à l'effet de provoquer et de recevoir<br />
les explications détaillées de Daouïa bent Mohamed ben El Khouas ; d'entendre<br />
tous les témoins qui lui seront désignés par les parties en cause et tous ceux<br />
qu'il jugera utiles; de s'entourer de tous renseignements et de procédera<br />
— toute mesure d'instruction susceptible d'éclairer le débat; Dit, toutefois,<br />
que le magistrat commis ne devra pas prescrire la visite corporelle par un<br />
homme de l'art, desdits Ahmed ben Saïd ben Mohamed et Daouïa bent Moha<br />
— med ben El Kouas; Réserve les dépens. .<br />
L'information ne produisit pas des résultats suffisants pour établir absolument la<br />
réalité de l'odieux outrage dont la femme Daouïa aurait été victime.<br />
Néanmoins, vu l'état physique et intellectuel du mari , la Cour a prononcé le<br />
divorce par l'arrêt suivant :<br />
Attendu que si l'information à laquelle il a été procédé n'a pas eu pour<br />
résultat d'établir dans toute leur étendue et leur gravité la vérité des alléga<br />
tions de Daouïa, celte information n'a pas du moins affaibli les présomptions<br />
—<br />
que justifie le rapport de l'homme de l'art ; Altendu que ce rapport cons<br />
tate qu'il y a quelques probabilités qu'Ahmed ben Saïd ben Mohamed esl
:380<br />
atteint d'anaphrodisie, c'est-à-dire d'impuissance, et que, de plus, son état<br />
intellectuel est si peu développé que l'on peut, à bon droit, le considérer<br />
comme voisin de l'idiotisme;<br />
Attendu que dans l'intérêt des deux parties, aussi bien qu'au point de vue<br />
du droit strict, il y a là cause suffisante pour légitimer la demande de divorce<br />
de Daouïa et de rejeter dès lors les conclusions d'Ahmed relatives à la réinté<br />
gration du domicile conjugal ; .<br />
Attendu,<br />
en ce qui touche la restitution de la dot et les dommages et inté<br />
rêts réclamés par Daouïa, que d'une part il n'est pas prouvé qu'une dot ait<br />
été stipulée et que, d'autre part, le préjudice causé à Daouïa provient non<br />
de son mari Ahmed, mais d'une faute commune à ses parents et à ceux dudit<br />
Ahmed ; que vis-à-vis des auteurs du préjudice il n'y a pas d'instance et que<br />
— dès lors il n'y a lieu de faire droit à ce chef de conclusions ; Atlendu que<br />
la partie qui succombe doit les dépens.<br />
Par ces motifs : LA COUR, vidant son préparatoire, dit qu'il a été mal jugé<br />
bien appelé ;<br />
Réforme*<br />
—<br />
—<br />
en conséquence, le jugement déféré ; Émendant,<br />
prononce le divorce entre Ahmed ben Saïd ben Mohamed et Daouïa bent<br />
Mohamed ben El Khouas;<br />
autres fins et conclusions ;<br />
première instance et d'appel.<br />
— Déboute<br />
— Condamne<br />
les parties en cause de toutes leurs<br />
ledit Ahmed en tous les dépens de<br />
M. le prés. Carrère, rapp. ; M. Cammartin,<br />
av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels mus.)<br />
Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />
3 juin 1878.<br />
Droit musulman, — Mariage. — Relations sexuelles de la<br />
femme antérieurement au mariage. — Annulation de l'acte<br />
de mariage.<br />
En droit musulman, le mari a la faculté de demander l'annulation du ma<br />
riage s'il résulte de l'aveu de la femme que celle-ci, antérieurement au mariage,<br />
a eu des relations sexuelles avec un tiers.<br />
Dans ce cas la juridiction musulmane a pour devoir de prendre acte de la<br />
déclaration que fait à cet égard le mari, et même au cas où elle aurait été<br />
rétractée plus tard par une déclaration contraire du mari, de la consacrer par<br />
une décision formelle (1).<br />
(1) Cpr. Sautayra et Cherbonneau,<br />
I p. 152. L'arrêt rapporté nous semble avoir<br />
exagéré dans une certaine mesure les droits du juge, en refusant de tenir compte<br />
de la déclaration finale du mari demandant.
381<br />
Fathma bent Mustapha c. Cherif ben Mohamed.<br />
— Attendu que l'appel est recevable en la forme ; Attendu au fond que<br />
sans doute l'acte de mariage, en date du 22 octobre 1877, est valable et que<br />
El-Chérif avait le droit d'en réclamer le bénéfice ; mais qu'à la suite de<br />
l'aveu de Fathma qu'elle avait eu des relations avec son cousin, El-Chérif,<br />
à l'audience du 6 mai, a déclaré ne plus la vouloir pour femme et demander<br />
— des dommages et intérêts ; Altendu qu'en présence de cette déclaration<br />
formelle, et qui s'accorde si bien avec un juste sentiment d'honneur, il n'y a<br />
pas lieu d'accueillir la nouvelle déclaration d'El-Chérif qui, à l'audience<br />
de ce jour, réclame Fathma pour femme, malgré la flétrissure publique<br />
devant laquelle elle n'a pas reculé et que dès lors l'acte de mariage<br />
doit être annulé ;<br />
— Attendu<br />
par suite que Fathma doit être condamnée à<br />
rendre la somme de soixante-quinze francs payés par El-Chérif à titre de<br />
— dot ; Attendu quant aux dommages et intérêts, que c'est le cas d'en accor<br />
der et de les fixer à la somme de cent francs pour réparation des dépenses<br />
occasionnées à El-Chérif, par l'entretien de Fathma, chez son beau-frère, et<br />
par les cadeaux qui lui ont été faits ;<br />
doit les dépens ;<br />
— Altendu que la partie qui succombe<br />
Par ces motifs : Recevant l'appel en la forme et prenant droit des déclara<br />
— tions d'El-Chérif à l'audience du 6 mai dernier ; Annule l'acte de mariage<br />
du 22 octobre 1877, el condamne Fathma au remboursement de la somme<br />
de soixante-quinze francs payée à titre de dol et en cent francs de dommagesintérêts,<br />
avec contrainte par corps, dont la durée est fixée à six mois ; La<br />
condamne en outre aux dépens.<br />
M. le prés, Carrère, rapp., M. Cammartin, av, gén., M
382<br />
II. La saisie immobilière suivie contre une personne pourvue d'un conseil<br />
judiciaire, sans l'assistance et la participation de ce conseil, est nulle et de<br />
nul. effet.<br />
Toutefois, dans cette nullité, ne doit pas être compris le commandement aux<br />
fins de saisie immobilière, dont cette saisie doit être précédée aux termes de<br />
l'art. 673 du Code de proc, civ. ; en effet, ce commandement ne constitue qu'un<br />
acte préparatoire de la saisie, et non un acte d'exécution (1) .<br />
Petitjean c. Rlain et Herriot.<br />
Attendu que l'intervention de Petitjean en qualité de conseil judiciaire de<br />
Herriot est recevable en la forme ;<br />
Au fond : Altendu que Petitjean demande l'annulation de l'obligation<br />
souscrite par Herriot, le 15 septembre 1876, au profit de Rlain et celle de la<br />
saisie immobilière pratiquée par Rlain au préjudice dudit Herriot, en exécu<br />
tion d'un jugement du tribunal de céans, en dale du 6 novembre 1877;<br />
En ce qui touche la nullité de l'obligation : Atlendu que le jugement du 6<br />
novembre 1877, en vertu duquel a été pratiquée la saisie immobilière, ayant<br />
reconnu valable et consacré l'obligation dont s'agit, le titre el le jugement<br />
ne peuvent plus êlre séparés et la question se réduit à savoir si le tribunal a<br />
le pouvoir de réformer le jugement sus-énoncé ;<br />
trine et de jurisprudence qu'une partie ne<br />
— Altendu<br />
qu'il est de doc<br />
peut,'<br />
par action principale et<br />
sans employer l'un des modes de rétractation ou de réformalion indiqués par<br />
la loi, demander devant un tribunal la nullité d'un jugement précédemment<br />
rendu par le même tribunal, sous prétexle qu'elle n'a pas élé valablement<br />
— Que lout jugement doit subsister, quels que<br />
représentée dans l'instance ;<br />
soient les vices dont il estfinlaché, tant qu'il n'a pas été attaqué par les voies<br />
de droit ; que le législateur a établi et déterminé lés moyens par lesquels il a<br />
permis d'attaquer les jugements et qu'il a fixé les délais pendant lesquels<br />
lesdits moyens peuvent êlre employés; qu'au nombre de ces moyens n'est<br />
point la demande principale en nullité des jugements lorsque ceux-ci ont<br />
— été rendus par des juges autres que des arbitres ; D'où il suit que le vice<br />
dont peut se trouver atteint le jugement dont s'agit, quelles qu'en soient la<br />
source et la nalure, peut bien otfrir un moyen, un argument à faire valoir à<br />
l'appui d'un des modes de rétractation ou réfonnation indiqués par la loi,<br />
mais ne saurait constituer une voie spéciale de recours;<br />
Attendu que la demande en nullité de titre n'élant pas recevable, il devient<br />
superflu de rechercher en fait si le prêt consenti par Rlain a tourné au profit<br />
d'Herriot ;<br />
En ce qui touche la nullité de la procédure : Attendu qu'une saisie immo<br />
bilière suivie contre une personne pourvue d'un conseil judiciaire, sans<br />
l'assistance et la participation de ce conseil, est nulle et de nul —<br />
effet;<br />
Qu'il s'agit seulement d'examiner si tous les actes de la procédure, y compris<br />
(1) Jurisp. conf., Douai, 17 février 1859. (D. 1859, 2, 63). Cpr. D. Rép. v° Vente<br />
publ, d'imm,, n°»142 et suiv.
383<br />
le commandement, doivent être annulés; en conséquence, si la subrogation<br />
demandée par le poursuivant esl légale et par qui doivent être supportés les<br />
— frais ; Atlendu que le commandement n'est pas un acle d'exéculion ;<br />
qu'en effet, ainsi que l'a déclaré un arrêt de Cassation du 5 février 1811,<br />
l'article 673 disant que la saisie immobilière sera précédée d'un commande<br />
ment, il en résulte que ce commandement ne fait pas partie de la poursuite<br />
en expropriation forcée dont il n'est au contraire qu'un acle préparatoire ;<br />
— Attendu<br />
qu'en admettant même,<br />
ainsi que le soutiennent un cerlain<br />
nombre d'auteurs, que le commandement est un acte d'exéculion, il n'est pas<br />
censé nécessairement faire partie de la saisie immobilière ; que si c'est en<br />
réalité le premier acte de poursuite, ce n'est aussi qu'un avertissement qu'on<br />
— va saisir ; Qu'il y a lieu, dès lors, de ne prononcer la nullité de la saisie<br />
immobilière qu'à partir de la saisie réelle et de sa dénonciation au sieur<br />
Herriot ;<br />
— Atlendu<br />
qu'aux termes de l'art. 728 du Code de procédure, la<br />
poursuite, en cas de nullité, peut être reprise à partir du dernier acle valable ;<br />
que Blain peut être autorisé à reprendre la poursuite contre toutes parlies<br />
en cause, à partir du procès- —<br />
verbal de la saisie réelle ; Attendu qu'il n'est<br />
pas établi que l'incapacilé d'Herriot fût ignorée de Blain ; qu'en tous cas,<br />
il appartenait à ce dernier de s'enlourer de tous les renseignements néces<br />
saires ; que tous les frais de la procédure annulée doivent êlre laissés à sa<br />
charge et que succombant sur certains chefs de sa demande, il doit suppor<br />
ter une partie des dépens de la présente instance ;<br />
Par ces motifs : Reçoit le sieur Petitjean partie intervenante dans l'action<br />
—<br />
en saisie immobilière enlre le sieur Blain et le sieur Herriot ; Et, faisant<br />
droit sur ladite intervention, dit et ordonne que la saisie immobilière dont<br />
s'agit est nulle et de nul effet à partir de la saisie réelle el de sa dénoncia<br />
— tion au sieur Herriot ; Dit que le conservateur des hypothèques sera, sur<br />
la présentation de la grosse du présent, tenu d'opérer la radiation de<br />
— ladite saisie immobilière ; Autorise Blain à reprendre la poursuite à partir<br />
du procès-verbal de la saisie-réelle; déclare les parties non-recevables autant<br />
que mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; les<br />
en déboute;— Condamne Blain aux dépens de la procédure annulée; et<br />
atlendu que les parties succombent respectivement sur certains chefs de leurs<br />
demandes, fait masse des dépens de l'inslance liquidés à 100 francs, sauf<br />
taxe ; dit qu'ils seront supportés moitié par Blain el moitié par les interve<br />
nants.<br />
M. Ballero, juge suppl. ffons de min. pub. ;M«» Givodan et Poivre, av.<br />
Nominations et mutations<br />
Par décret en date du 19 novembre 1878, ont été nommés :<br />
Substitut du Procureur de la République à Mostaganem, M. Dubreuil, avo<br />
cat, attaché provisoire au Parquet de 1 instance de la Seine, en remplace<br />
ment de M. Pichard.
Président du Tribunal de 1 instance de Tizi-Ouzou, M. Rourouillou, juge<br />
à Alger, en remplacement de M. Parizot.<br />
Juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, M. Simon, juge à Oran,<br />
placement de M. Rourouillou.<br />
en rem<br />
Juge au Tribunal de 1« instance d'Oran, M. Bourges, juge au siège de<br />
Bône,<br />
en remplacement de M. Simon.<br />
Juge au Tribunal de lr« instance de Bône, M. Arnaud,<br />
Philippeville,<br />
en remplacement de M. Bourges.<br />
juge au siège de<br />
Juge au Tribunal de 1» instance de Philippeville, M. Robert, juge de paix<br />
de Miliana,<br />
en remplacement de M. Arnaud.<br />
Par arrêté du 30 novembre 1 878 :<br />
Le sieur Combarieu (Jean-Baptiste), greffier de la justice de paix de St-Arnaud,<br />
est nommé curateur aux successions vacantes dans le canton de ladite<br />
justice de paix.<br />
Le sieur Groslière (Nicolas-Auguste), commis greffier au Tribunal de Bône,<br />
est nommé curateur aux successions vacantes dans le canton d'Aïn-Mokra.<br />
Amnistie. Délits multiples. — Peine.<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
—<br />
La<br />
condamnation prononcée<br />
contre un prévenu poursuivi pour mendicité, cris, séditieux et injures pu<br />
bliques envers les agents de l'autorité publique, doit disparaître<br />
ment en présence d'une amnistie qui a éteint postérieurement les deux<br />
derniers délits,<br />
si la peine prononcée pour tous les délits se trouvent être<br />
supérieure au maximum de celle prévue pour le délit non amnistié. (Cass.<br />
crim., il avril 1878. D. 1878. 1. 398.)<br />
Effets de commerce. Lettre de change. — Femme<br />
Acceptation. —<br />
Bon<br />
pour. — L'acceptation<br />
non commerçante.<br />
donnée par une femme non<br />
commerçante sur une lettre de change est sans valeur légale si elle n'est<br />
précédée du bon pour ou approuvé, prescrit par l'art. 1326 du Code civil.<br />
(Cass. civ. 6 mai 1878. D. 1878. 1. 367.)<br />
Alger. — Typ. A. Joordan,<br />
comp<br />
—
2° année. — J6<br />
Décembre 1878. —<br />
N° 48<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
I. Algérie. —<br />
nes. — Beïtel<br />
II. Habous. —<br />
DOCTRINE. -<br />
REVUE BIMENSUELLE<br />
JURISPRUDENCE. -<br />
LÉGISLATION<br />
COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />
Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />
Actions<br />
9 juillet 1878.<br />
domaniales. — Successions musulma<br />
Mal. — Cadi. — Compétence.<br />
Dévolutaire<br />
définitif. — Fondation pieuse.<br />
I. En Algérie comme en France, il n'appartient qu'au Préfet dans chaque<br />
département, d'intenter et de soutenir, au nom de l'État, les actions domania<br />
les.<br />
En conséquence, l'Oukil Beit el Mal n'a aucune qualité pour exercer ces sor<br />
tes d'actions ni pour y défendre, et d'autre part le cadi qui n'a mission d'ad<br />
ministrer lajustice qu'entre musulmans, est sans pouvoir pour connaître des<br />
contestations qui intéressent le Domaine .<br />
L'Etat n'a donc pas été légalement représenté dans la demande formée par<br />
l'Oukil Beit el Mal devant le Cadi et on ne saurait ^attribuer sur ce point l'auto<br />
rité de la chose jugée à la sentence qui serait intervenue sur une semblable de<br />
mande (1).<br />
II .<br />
Les biens des corporations religieuses, en Algérie, ont été réunis au do<br />
maine soit par les arrêtés du Gouverneur général des % sept, et 7 déc. 1830, soit<br />
par la loi du 16 juin 1851 ; l'État par suite a été investi, non-seulement de la<br />
propriété des habous que ces corporations possédaient déjà,<br />
recueillir ceux dont elles étaient éventuellement dévolutaires ,<br />
mais du droit de<br />
dispositions législatives qui ont autorisé en l'élargissant peu à peu l'alié-<br />
nabilité des biens habous, n'ont pas supprimé pour cela les constitutions de<br />
habous : les biens grevés ont conservé pour leur transmission non contractuelle,<br />
l'ordre de successibilité fixépar le fondateur,<br />
et il en résulte qu'après l'épuise-<br />
(1) Voir dans Robe, 1875, p. 248, l'arrêtde la Cour d'Alger en date du24 nov. 1875,<br />
contre lequel le pourvoi était dirigé. Nos lecteurs trouveront plus loin, page 396<br />
en note sous l'arrêt du 11 nov. 1878, nos observations sur l'importante question<br />
résolue par la Cour de cassation',
386<br />
ment des dévolutions intermédiaires, lorsque le wakf<br />
a été établi en faveur<br />
d'une œuvre pie, c'est à l'État, s'ils n'ont pas été qu'ils aliénés, reviennent à<br />
titre de dévolution définitive (1).<br />
Consorts Ben Zekri c. le Domaine de l'État<br />
Altendu que, sur l'action intentée par Si Hamama devant le Cadi de Cons<br />
tantine et tendant à la revendication du habous constitué en 1785, par Abdal<br />
lah ben Zekri, l'Oukil Beïl el Mal étant intervenu, a réclamé les biens liti<br />
gieux pour les villes de la Mecque et Médine, aujourd'hui représentées par<br />
l'État, et que le cadi, statuant sur celle intervention par jugement du 1« mars<br />
1869, a décidé que le habous, objet de la contestation, ne pourra être dévolu<br />
aux villes saintes qu'autant qu'il n'existera plus d'enfants de la parenté mas<br />
culine du fondateur ;<br />
Attendu qu'en Algérie comme en France, il n'appartient qu'au préfet, dans<br />
chaque déparlement, d'inlenter et de soutenir, au nom de l'État, les actions<br />
— domaniales ; Que l'Oukil Beït el Mal n'a nulle qualité, ni pour les exercer,<br />
ni pour y défendre, et que le cadi qui n'a mission d'administrer la justice<br />
qu'entre musulmans, est sans pouvoir pour connaître des contestations qui<br />
intéressent le Domaine ;<br />
D'où il suit que l'État n'a pas été légalement représenté dans la demande<br />
formée par l'Oukil Beït el Mal devant le cadi, et que, dès lors, en déniant à<br />
la sentence du 1
387<br />
D'où il suit que l'arrêt attaqué, en jugeant de la sorte el en consacrant ces<br />
principes,<br />
n'a violé ou faussement appliqué aucune des dispositions invoquées<br />
à l'appui du second moyen ;<br />
». Désistement. —<br />
— Par<br />
M. Guillemard, cons. rap, ;<br />
ces motifs : Rejette le pourvoi, etc.<br />
— M.<br />
Robinet de Cléby, av. gén.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />
Présidence de M. BAZOT,<br />
Acceptation.<br />
18 mars 1878.<br />
—<br />
Demande reconventionnelle .<br />
diction saisie. — Douar.<br />
Refus<br />
— Appréciation<br />
premier Président.<br />
du défendeur. —<br />
de la juri<br />
— Représentants légaux. —<br />
Ml ainguli. — Rejet du désistement. —<br />
II. Algérie. —<br />
Évocation.<br />
Action<br />
Terres dites Hlail el BamwM (terres a pou<br />
dre). — Bien vacant et sans maître. — Prise<br />
par l'État. —<br />
Sénatus-consulte<br />
de 1863, —<br />
de possession<br />
Caractère défi<br />
nitif des distractions antérieures. — Dien domanial. —<br />
Revendication. —<br />
— Possession.<br />
—<br />
III. Transaction. —<br />
Action<br />
Irrecevabilité<br />
Droits<br />
— — en justice. Délai. Forclusion.<br />
de la preuve.<br />
de l'État. —<br />
— — ÏV. Évocation. Décision définitive.<br />
Cession<br />
à des tiers.<br />
Nomination d'experts.<br />
I. Tout demandeur a le droil de se désister en la forme d'une instance lors<br />
qu'il a pour le faire un motif légitime, que son désistement ne cause aucun<br />
préjudice au défendeur et que les conditions de ce désistement sont les consé<br />
quences naturelles de la renonciation qu'il implique.<br />
En effet, l'opposition que le défendeur y apporterait, ayant pour effet de<br />
forcer le demandeur à continuer une procédure irrégulière el de provoquer à<br />
grands frais et sans profit, une décision inutile, ne saurait êlre accueillie par<br />
la justice qui doit en conséquence imposer le désistement au défendeur dont le<br />
refus ne se baserait sur aucune raison plausible.<br />
Mais d'un aulre côté, lorsqu'un désistement n'est de la part du défendeur<br />
qu'une retraite habile ayant pour but de le soustraire à une condamnation<br />
imminente, résultant d'une demande reconventionnelle dirigée contre lui, les<br />
tribunauxpesant dans leur appréciation discrétionnaire les causes sur lesquelles<br />
se base en réalité cette retraite, doivent rejeter le désistement et mettre ainsi<br />
le défendeur à l'abri des combinaisons artificieuses de son adversaire.<br />
Par exemple, il y aurait lieu à appliquer cette manière de voir lorsque les<br />
demandeurs, se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassalion, prétendent qu'ils<br />
ont mal intenté leur procès en ayant agi comme représentant lés droits de<br />
Djemâas de tribus ou de fraction» de tribus indigènes dont ils ne seraient
388<br />
cependant point les représentants légaux,<br />
alors qu'en fait ils ont agi dans la<br />
cause individuellement en leurs noms personnels, comme étant indivisément<br />
propriétaires avec les membres d'une agrégation qui n'est ni une commune<br />
indigène,<br />
ni un douar,<br />
Il doit en être lout particulièrement ainsi quand tous les individus, qui sem<br />
blent être les membres intéressés de cette agrégation,<br />
sont intervenus dans<br />
l'instance, et qu'après cette intervention, demandeurs et intervenants ont for<br />
mellement déclaré, sans être contredits dans leur déclaration, être les seuls<br />
propriétaires de l'immeuble revendiqué.<br />
Au surplus l'action serait toujours engagée régulièrement tout au moins à<br />
l'égard des indigènes qui figurent en nom dans l'inslance.<br />
En outre cette irrégularité, en admettant qu'elle existe, n'a pas un carac<br />
tère d'ordre public et conséquemment ne peut êlre relevée d'office, et dans le cas<br />
où le défendeur, loin de l'invoquer, a déclaré au contraire formellement qu'il<br />
renonçait à s'en prévaloir, le désistement n'a plus d'objet et c'est à bon droit<br />
qu'il a élé refusé .<br />
En conséquence, au cas où la cause a été l'objet de conclusions au fond, lé<br />
défendeur esl fondé à demander qu'il y soit donné une solution, même par<br />
évocation de la part des juges si d'appel, le procès est en état de comporter une<br />
décision définitive (1).<br />
II. En Algérie,<br />
une terre désignée par les Arabes du nom de Blad el Baroud<br />
(terre à poudre, qu'on se dispute les armes à la main), peut être prise par l'Etat<br />
comme un bien véritablement vacant et sans maître, et cette prise de possession<br />
n'est ni un acte de violence ou de spoliation, mais une réelle et légitime appro<br />
priation,<br />
lorsqu'elle consiste dans une opération régulière accomplie dans les<br />
formes administratives après des vérifications minutieuses, faites en présence<br />
des indigènes et dont le résultat a été officiellement constaté par un procès-<br />
verbal de reconnaissance, suivi de l'inscription de l'immeuble sur les sommiers<br />
de consistance du Domaine (2) .<br />
(1) Jurisp. conf. Douai, 26 févr. 1825 (J. désavoués, t. 32, p. 318). Bordeaux,<br />
9 juin 1837 (D. Rép. v°<br />
n"<br />
Désistement, 114). Cpr. Pigeau, t. 1, p'. 692. Chauveau<br />
sur Carré, quest. 1459 bis, et Bioche, n° 57.<br />
(2-3)<br />
Nous ne savons en vertu de quelle disposition légale (car nous ne saurions<br />
reconnaître comme ayant un tel caractère, les instructions générales du 11 juin 1863<br />
pour l'exécution du Sénatus-consulte) l'Administration aurait le droit de s'emparer<br />
d'une terre tout simplement parce qu'elle serait une terre dite Blad Baroud, qu'on<br />
se dispute les armes à la main.<br />
Il semble difficile d'admettre qu'une terre, parce qu'elle est disputée d'une ma<br />
nière trop violente par ceux qui la possèdent en commun, puisse être considérée<br />
comme une terre vacante et sans maître qui le Domaine ait le droit de s'approprier<br />
en vertu de l'art. 539 du Code civil : or, dans l'espèce, la jouissance immémoriale<br />
d'un grand nombre de familles établies sur le Blad-Boudjemah, ne saurait être mise<br />
en doute : elle est attestée au surplus dans les termes les plus explicites par le<br />
rapport qui a précédé le décret' du 2 octobre 1869i
389<br />
Lorsque cette prise de possession de la part de l'État a été consacrée en outre<br />
par des actes de possession à titre de propriétaire sans susciter les réclamations<br />
de personne, elle doit être considérée, cinq ans après, comme constituant au<br />
profit de l'Etat un droil né dans des conditions régulières et ayant, en outre, la<br />
consécration du temps.<br />
En conséquence, il faut la ranger dans les actes, partages et distractions de<br />
territoires intervenus entre l'État et les indigènes, confirmés d'une manière<br />
absolue par Vart . 1,<br />
g 2 du Sénatus-consulte de 1863,<br />
surtout lorsqu'il estinter- -<br />
venu à la suite des opérations d'application du Sénatus-consulte, un décret de<br />
répartition classant définitivement l'immeuble comme bien domanial (3).<br />
D'autre part, les motifs de sécurité publique qui ont servi de prétexte à ces<br />
mains-mises, paraissent bien secondaires à une époque où la tranquilité générale est<br />
assise en Algérie, où la justice musulmane y est organisée, où, en un mot, il y a<br />
des moyens réguliers eblégaux de vider les différends pouvant exister entre les<br />
co-possesseurs.<br />
• Nous ne voyons pas en conséquence comment le Domaine a pu légitimement<br />
puiser dans une semblable prise de possession la prétention à un véritable droit de<br />
propriété, prétention qui aurait été ensuite définitivement consacrée par le § 2 de<br />
l'art. 1 du Sénatus-consulte de 1863 comme une distraction de territoire intervenue<br />
mire l'État et les indigènes. Et cette théorie paraît d'autant plus singulière dans<br />
l'espèce, qu'elle arriverait en fin de compte à profiter uniquement à l'une des frac<br />
tions établies sur le'Blad-Boudjemah laquelle s'en servirait aujourd'hui pour<br />
expulser du terrain ses anciens co-possesseurs.<br />
Cette application du g 2 de l'art. 1 du Sénatus-consulte nous paraît au surplus<br />
avoir été repoussée d'une manière formelle dans une espèce presque identique par<br />
un arrêt de la Cour d'Alger rendu sous la présidence de M. Cuniac, le 31 juillet 1873<br />
(l'État c, les Dehaknas, Robe, 1873, p. 205), où nous lisons notamment le passage<br />
suivant :<br />
a Attendu que le moyen tiré, en droit, du paragraphe 2 de l'art. 1er du Sénatus-<br />
« consulte du 22 avril 1863 et basé, en fait, sur deux procès-verbaux, en date des<br />
« 5 septembre 1855 et 28 mai 1858, par lesquels des agents du Domaine, assistés<br />
« d'officiers du bureau arabe,<br />
après avoir recueilli de quelques indigènes convo-<br />
« q.ués des renseignements divers, déclarent prendre possession, au nom de l'Etat,<br />
o des terres dont il s'agit, comme succédant aux droits tant du beylik que de lext<br />
émir Abd-el-Kader, n'est fondé que sur une fausse interprétation de la disposi-<br />
« tion invoquée ;<br />
i Qu'il ressort des travaux préparatoires du Sénatus-consulte, comme des docu-<br />
« ments rédigés pour son application, que le paragraphe 2 de l'art. 1" du Sénatus-<br />
« consulte, qui était l'art. 6 du projet du gouvernement, n'a eu pour but que de<br />
«t consacrer le principe de non « rétroactivité, il aura pour effet, dit l'exposé des<br />
« motifs, de régulariser les transactions intervenues jusqu'à ce jour entre l'Etat et<br />
« les indigènes,<br />
« vegarder ; » — Que<br />
sur la foi desquelles se sont établis des droits qu'il importe de sau-<br />
le Sénatus-consulte n'a donc eu en vue que les actes, par-<br />
« tages ou distractions de territoire consentis par les indigènes et passés ainsi<br />
« dans le Domaine de l'État ou des colons européens, soit par suite de transactions<br />
«<br />
privées, soit par suite des opérations de cantonnement, ou encoue en vertu des<br />
« règles du séquestre, ou de l'expropriation légalement consommée ou réputée<br />
« telle, pour la période antérieure au i
390<br />
Au surplus, même en faisant abstraction de ce droit de l'État basé sur l'art, 1 ,<br />
g 2 du sénatus-consulte de 1863, les droits de l'État se fonderaient avec raison<br />
sur les dispositions du décret du 23 mai 1863,<br />
dans le cas où les indigènes<br />
n'auraient opposé à la revendication de l'État qu'une contre- revendication par<br />
tielle et auraient ainsi encouru pour le surplus la forclusion édictée par les<br />
art. 1 1, 12 et 13 de ce décret, et si même leur contre-revendication avait poxfé<br />
sur l'ensemble de la terre, dans le cas où elle n'aurait pas été suivie d'une action<br />
en justice introduite par eux dans le délai prescrit par l'art. 13 de ce décret du<br />
22 mai 1863 à peine de nullité (1).<br />
111. Lorsque l'État, par une transaction intervenue au cours d'une instance,<br />
a cédé à des particuliers, tous les droits et actions qui peuvent lui appartenir<br />
quant à une terre litigieuse,<br />
les cessionnaires investis de ces droits et actions<br />
en vertu de cet acle, ont le droit, bien qu'ayant été les adversaires du Domaine,<br />
d'invoquer contre des tiers les moyens sur lesquels le Domaine s'était appuyé<br />
contre eux-mêmes, bien que ces moyens fussent en contradiction absolue avec<br />
leurs propres prétentions, et qu'ils fussent en outre tirés de l'exercice même de<br />
la puissance publique (2).<br />
« simples agents du Domaine,<br />
à la suite de renseignements nécessairement vagues-<br />
« et incomplets, dont la légalité, pour le temps postérieur aw. 1er octobre 1844, ne<br />
« repose sur aucun fondement, el dans laquelle il ne faut voir,<br />
même lorsqu'elle a été<br />
« subie par les tribus, que des mesures provisoires et de protection, une sorte de séquestre<br />
« dans le sens des art. 1961 el suivants du Code civil, dans l'intérêt de ceux qui seront<br />
« reconnus être les véritables propriétaires du sol. »<br />
Quant à la portée du décret du 2 août 1869, en admettant qu'elle soit bien réel<br />
lement celle que l'arrêt lui assigne, elle ne saurait être manifestement de créer<br />
un droit quelconque au profit de l'Etat : il ne peut que consacrer un droit antérieur,<br />
et c'est sur l'existence ou la non existence de ce droit antérieur que l'attention doit<br />
exclusivement se porter.<br />
(1) Il est incontestable que la revendication de l'État, si elle n'a été suivie d'op<br />
positions ou contre-revendications régulières complètes de la part des indigènes,<br />
entraîne"<br />
la forclusion de ceux-ci, aux termes des art. 11 et suivants du décret du<br />
23 mai 1863 : mais si les oppositions se sont produites régulièrement, cette même<br />
forclusion serait-elle encourue parce qu'on ne les aurait pas fait suivre d'une.action<br />
en justice dans le délai imparti à peine de nullité, par l'art 13 ?<br />
Nous n'hésitons pas à croire qu'il y a là une confusion : — C'est<br />
en effet, aux<br />
termes de l'art. 13, le revendiquant qui devra, en cas d'opposition, former sa<br />
demande en justice dans le mois, et ici il semble bien, d'après les termes mêmes<br />
de l'arrêt, que le véritable revendiquant soit, non les indigènes, mais le Domaine ;<br />
tout en admettant donc, conformément à un arrêt de la Cour d'Alger du 20 avril<br />
1868 (Robe, 1868, p. 140), que l'État qui est en possession d'une terre, ne doit<br />
point être considéré facilement comme ayant renoncé à son droit par suite de<br />
l'inobservation des formalités fixées par la loi, il ne paraît pas non plus admissible<br />
que cette inobservation de la part du Domaine, puisse entraîner contre ses adver<br />
saires une déchéance quelconque.<br />
Nous serions tenté de souligner de quelques réflexions l'étrange transaction<br />
(î)<br />
intervenue dans cette affaire, par laquelle le Domaine de l'État a abandonné à des
391<br />
IV . Il n'y a pas violation de la disposition de l'art. 473 du Code de proc.<br />
civ. portant qu'il ne peut y avoir évocation que .si la<br />
matière est disposée<br />
à recevoir une décision définitive, lorsque toutes les questions pendantes au<br />
procès se trouvant résolues, les juges d'appel nomment des experts aux seules<br />
fins de procéder à l'abornement des parcelles réservées à l'une des parties, ainsi<br />
qu'à la fixation des fruits à restituer (1).<br />
Les Oulad-Amranes c. les Oulad-Ziad et l'État.<br />
Attendu que l'appel, interjeté par les Ouled-Amranes, tend à la réforma<br />
tion du jugement du Tribunal de Blida qui a donné acte d'un désistement,<br />
offert par les demandeurs et refusé par les défendeurs ;<br />
— Attendu que, pour<br />
l'appréciation de celte question, il est nécessaire de préciser exactement la<br />
demande, sa nature, les qualités dans lesquelles ont procédé les parties en<br />
cause, les divers errements suivis par la procédure ;<br />
Attendu que l'instance, aujourd'hui soumise à la Cour,<br />
a été ouverte par<br />
un exploit, du 12 juin 1872, donné à la requêle de Abd el-Kader ben Aïssa,<br />
ben Youssef ben Khalifa, Si bel Hacem ben Hadj Mohamed, Mohamed ben<br />
Aïssa, et encore à la requête des Djemads des Ouled-Ziads, Ouled-Djelloul,<br />
Ouled-Melaab, Belaadis et Anaguadis dont ils sont les représentants, agissant<br />
—<br />
tous dans un intérêt commun ; Que, par nouvel exploit du 6 août 1872,<br />
les quatre indigènes, dénommés dans l'exploit précédent, donnaient assigna<br />
tion aux mêmes fins et déclaraient agir, tant en leurs noms personnels que<br />
comme représentant les Ouled-Ziads, Ouled-Djelloul, Ouled-Melaab, Belaadis,<br />
— Anaguadis ; Que, par une requêle, signifiée le 25 avril 1874, 156 indigè<br />
les seuls<br />
nes dénommés, déclarant qu'ils étaient, avec les quatre demandeurs,<br />
propriétaires des terres en litige, intervenaient au procès, tant pour régula<br />
— riser la procédure que pour surveiller leurs droits ; Que, par conclusions<br />
signifiées le 8 janvier 1877, Si Mohamed ben Rabah, Bel Kacem ben Saad,<br />
El-Hadj Lakdar, El-Hadj Kouïder ben Déni, Taïeb M'hamed ben Sidi Ahmed,<br />
-Mohamed ben Marouf, Maamar ben Djelloul, défendeurs à l'action principale,<br />
ont formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;<br />
Qu'en cet<br />
l'instance étant ainsUiée, toutes parties ont conclu au fond : —<br />
— Que<br />
état, et par acte du 30 mars 1877, reçu par le greffier de la justice de paix<br />
deTéniet-el-Haâd, remplissant les fonctions notariales, les demandeurs ont<br />
déclaré se désister, mais en la forme seulement, de l'instance introduite par<br />
eux, faisant réserves expresses de leurs droits au fond ;<br />
— Que<br />
par acte du<br />
palais du 4 juin 1877, signifié d'avoué à avoué, les demandeurs ont renou-<br />
indigènes, à l'exclusion des co-possesseurs de ceux-ci, et sans aucun motif appa<br />
rent de préférence, ses droits (incontestables suivant l'arrêt) sur une terre de<br />
17,800 hectares, en consentant en outre à conserver à sa charge tous les frais<br />
d'instance qu'il avait exposés.<br />
Mais la nature spéciale de ce recueil nous oblige à nous abstenir complètement<br />
à cel égard.<br />
(i) Jurisp. conf. Cass., 30 mars 1842 (D. Rép. V" Degrés dejurid., n°<br />
Cass. 9 mars 1863 (D. 1863, 1, 176).<br />
V. M.<br />
578, 5°).
392<br />
vêlé leur désistement limité à la procédure, contenant les mêmes réserves<br />
— quant à l'action ; Que les défendeurs ont refusé d'accepter ce désistement<br />
et que c'est sur cet incidenl'que le tribunal a été appelé à statuer ;<br />
que tout demandeur a le droit de se désister d'une<br />
Atlendu, d'nne part,<br />
instance lorsqu'il y a, pour le faire, un molif légilimefque son désistement<br />
ne cause aucun préjudice au défendeur et que les conditions qu'il conlient<br />
—<br />
sont les conséquences naturelles de sa renonciation ; Que l'opposition du<br />
défendeur ne saurait avoir pour effet de forcer le demandeur à continuer une<br />
procédure irrégulière el de provoquer ainsi, à grands frais et sans profit, une<br />
décision inutile, puisqu'elle pourrait, plus tard, tomber sous les attaques de<br />
son adversaire ;<br />
— Qu'en<br />
ce cas l'acceptation doit êlre imposée par jugement<br />
au défendeur qui n'a aucune raison plausible de refuser le désistement ;<br />
Mais atlendu, d'autre part, que les tribunaux, dans celle appréciation discré<br />
tionnaire, doivent peser équilablement les intérêts de chacune des parties et<br />
ne pas laisser non plus le défendeur à la merci des combinaisons plus ou<br />
moins artificieuses du demandeur ;<br />
— Que<br />
—<br />
si, après que le défendeur a<br />
réuni les éléments de sa défense, formulé une demande reconvenlionnelle,<br />
et se voit près de triompher, le demandeur cherche à se soustraire à une con<br />
damnation imminente par une habile retraite, ce calcul doit êlre déjoué<br />
par le re'jet du désistement ;<br />
Attendu qu'il échet de faire l'application de ces principes à la cause en<br />
recherchant si les demandeurs ont "un molif sérieux de se désister ou si,<br />
en l'absence de toute raison légitime de leur part, les défendeurs ont le droit<br />
— de les retenir au procès ; Altendu que le seul motif, mis en avanl par les<br />
inlimés, est tiré d'un arrêt de la Cour de cassalion, aux termes duquel les<br />
actions qui appartiennent aux communes ou douars indigènes ne peuvent<br />
être intentées ou soutenues en justice que<br />
— Que<br />
par1<br />
leurs représentants légaux ;<br />
les demandeurs prétendent qu'ayant agi comme représentant les<br />
droits des Djemaâs de tribus ou de fractions de tribus indigènes, ils ont<br />
désormais juste sujet de craindre que leur procédure soit entachée d'un vice<br />
irrémédiable;<br />
— Attendu<br />
que celte préoccupation, puisée dans une affaire<br />
antérieure, où la nature de l'action el les qualités des parties étaient absolu<br />
ment différentes, repose sur un principe de droil certain, mais inapplicable à<br />
— la cause actuelle ; Qu'il importe, en effet, de placer ici une constatation de<br />
— fait essentielle ; Que l'action intentée par les demandeurs, à laquelle se<br />
sont joints les intervenants, non plus que la demande reconvenlionnelle,<br />
n'intéressent pas une commune indigène, ni un douar officiellement consti<br />
— tué ; Qu'il résulte, d'un décret du 2 octobre 1869, inséré au Bulletin offi<br />
ciel de l'Algérie, que la tribu des Ouled-Ayed, à laquelle apparliennenl les<br />
parties, a été délimitée sous ce nom en vertu du Sénatus-consulte et que son<br />
territoire a été réparti en trois douars qui ont reçu les noms d'El-Medad, Ben-<br />
—<br />
Naouri el d'Ighoud ; Que, dans aucune des pièces du procès, le nom de la<br />
tribu des Ouled-Ayed ou des trois douars qui la composent n'est mentionné et<br />
que nul n'a enlendu plaider au nom de cette tribu et de ses douars consti<br />
— Que, dans leur revendication de Bled-bou-Djemaà, les demandeurs<br />
tués;<br />
ont agi individuellement, en leurs noms personnels, comme étant indivisé<br />
ment propriétaires avec les membres d'une agrégation, qui n'est ni une com<br />
mune indigène, ni un douar, et qui a été désignée sous les dénominations
usitées en pays arabe ;<br />
— Que<br />
393<br />
les conclusions prises dans les exploits intro-<br />
ductifs d'instance, d'accord avec les qualités des parties, tendent à la déclara<br />
tion de propriélé en faveur des requérants, non de la commune ou du douarj<br />
— Qu'il n'y avait pas lieu, pour ces collectivités n'ayant qu'une existence de<br />
fait sans constitution officielle, à la représentation organisée par les arrêtés du<br />
—<br />
20 mai 1868 et 24 novembre 1871 ; Que, dès lors, le molif invoqué à l'ap<br />
pui du désistement manque el en fait et en droit ;<br />
Attendu que l'accession des 156 intervenants à la demande principale<br />
parait avoir introduit dans l'inslance tous les membres intéressés de l'agréga<br />
tion, puisque demandeurs et intervenants ont formellement déclaré, après<br />
l'intervention, qu'ils étaient les seuls propriétaires de l'immeuble revendiqué;<br />
— Que ces déclarations, consignées dans les conclusions, n'ont pas été con<br />
tredites et qu'aucun document du procès niesl venu les infirmer ;<br />
-- Qu'on<br />
ne saurait donc, à ce point de vue, invoquer le maxime que nul en France ne<br />
plaide par procureur, puisque l'interveniion personnelle des 156 intervenants,<br />
qu'on dit former avec les demandeurs principaux les agrégations indiquées<br />
dans les exploits inlroduclifs, a eu ce résultat de mettre tous les intéressés en<br />
— nom dans l'instance ; Qu'au surplus, cette irrégularité, en supposant<br />
qu'elle subsistât encore, n'a pas un caractère d'ordre public, qu'elle ne peut<br />
être suppléée d'office et que simplement énoncée dans les plaidoiries, elle n'a<br />
— pas été relevée dans les conclusions ; Que, d'ailleurs, par conclusions du<br />
19 mai 1877, les Ouled-Amranes, qui, seuls auraient pu se prévaloir de l'irré<br />
gularité, ont déclaré expressément accepter la procédure engagée ainsi que<br />
— les qualités prises par toutes les parties ; Altendu enfin que l'action inten<br />
tée, en admettant qu'elle eut impliqué le droit d'autres personnes qui ne<br />
figurent pas au procès, procède régulièrement, tout au moins à l'égard des<br />
167 indigènes qui sont en nom dans l'instance ;<br />
Qu'il faut conclure des considérations qui précèdent que les demandeurs<br />
n'ont eu aucune raison plausible de se désister et que c'est à bon droit que<br />
— les défendeurs ont refusé un désistement qui leur préjudiciail ; Qu'on ne<br />
peut manquer d'être frappé de la date et des circonstances dans lesquelles le<br />
— désistement s'est produit ; Que les scrupules des demandeurs ne sont pas<br />
nés de l'arrêt de la Cour de cassalion, puisque cet arrêt esl du 5 août 1874 et<br />
—<br />
que le désistement n'a eu lieu que le 30 mars 1877; Qu'il esta remarquer<br />
que c'est après la cession consentie par l'Étal aux Ouled-Amranes, alors que<br />
ceux-ci se trouvaient forts de leurs droils et des droits de l'État, que les<br />
Ouled-Ziads, désespérant de gagner leurs procès, ont songé à déserter l'ins<br />
—<br />
tance; Que c'est là, en fait, le vrai molif du désistement et qu'après en<br />
avoir ainsi montré le caractère, il n'est plus besoin d'insister pour justifier<br />
l'infirmation du jugement ;<br />
Altendu que toutes les parties ont conclu au fond et qu'en présence des<br />
pièces nombreuses versées^u procès, des titres respectivement produits, la<br />
cause est en élat de recevoir une décision définitive ;<br />
— Qu'il<br />
y a lieu d'évo<br />
quer;<br />
Altendu qu'il ressort de documents, qui ont presque une valeur historl<br />
que que le Bled-bou-Djemaâ élait une de ces terres que les Arabes désiguent<br />
d'un nom expressif, Blad-el-Baroud, terres à poudre, qu'on se dispute les<br />
ou-<br />
—<br />
Que, depuis longtemps, une lutte de ce genre était<br />
.armes à la main ;
394<br />
verte sur Bled-bou-Djemaâ, Iorsqu'en 1858, l'État en prit possession;<br />
Que ce ne fut alors ni un acte de violence, ni un acle de spoliation, mais une<br />
opération régulière accomplie dans les formis administratives, après des véri<br />
fications minutieuses, faites en présence des Indigènes et dont le résultat fut<br />
officiellement constaté par un procès-verbal de reconnaissance dressé à la<br />
dale du 1er — juin 1858; Que l'État occupa le Bled-bou-Djemaâ comme un<br />
— bien véritablement vacant sans maître ; Qu'il porta cette terre sur ses<br />
sommiers de consistance, fit des concessions partielles, vendit quelques<br />
—<br />
parcelles, afferma les autres ; Que cette situation se continua jusqu'au<br />
Sénatus-consulte, sans avoir suscité les réclamations de personne, et qu'en<br />
1863,<br />
elle apparaissait comme un droil né dans des conditions régulières et<br />
ayant, en outre, la consécration du temps ;<br />
Altendu que le Sénatus-consulte de 1863, destiné à marquer un progrès<br />
dans cette œuvre si laborieuse de la constitution de la propriété, en Algérie,<br />
devait, en traçant des délimitations nouvelles, confirmer d'abord les ancien<br />
—<br />
nes attributions ; Que cette idée principale se dégage du texte de ses dispo<br />
sitions, de leur esprit attesté par des travaux préparatoires du commentaire<br />
—<br />
officiel dont elles ont élé l'objet ; Que le rapporteur de la Commission du<br />
Sénat fait connaître que, dans ce but, on a reporté à l'article 1er l'article 6<br />
qui confirme tous les actes, partages et distractions de territoires intervenus<br />
—<br />
enlre l'État et les Indigènes; Que, dans les instructions publiées en 1865,<br />
pour l'exécution du Sénatus-consulte, le Gouverneur général prenait soin de<br />
déclarer que ces instructions ne s'appliqueraient en aucune manière aux<br />
prises de possession que le Domaine de l'Étal avait effectuées antérieurement<br />
au Sénatus-consulte, ces prises de possession étant rendues définitives par les<br />
dispositions du g 2 de l'article 1er du Sénatus-consulte ;<br />
— devant le<br />
Conseil du Gouvernement,<br />
Que,<br />
à l'occasion des réclamations auxquelles avait<br />
donné îieu le Bled-bou-Djemaâ, le Conseiller rapporteur faisait remarquer<br />
qu'en présence du procès-verbal du 1er juin 1858, la question était souverai<br />
nement tranchée en faveur de l'État par l'article 1er § 2 du Sénalus-consulle;<br />
—<br />
sur le rapport de la Commission et l'avis conforme du Conseil de<br />
Que,<br />
gouvernemenl,<br />
le décret de répartition du 2 octobre 1869 classait définitive<br />
ment le Bled-bou-Djemaâ comme bien domanial ;<br />
Allendu que, si le droit de l'État ne paraissait pas suffisamment appuyé<br />
sur l'article 1er g 2 du Sénatus-consulle, il se fonderait, tout au moins, sur<br />
— les dispositions du décret du 23 mai 1863 ; Qu'en effet, il semble résulter<br />
des documents versés au procès que, lors des opérations du Sénatus-consulte<br />
dans la tribu des Ouled-Ayed, les demandeurs actuels n'onl opposé une con<br />
tre revendication à la revendication de l'État que pour quatre parcelles, dé<br />
pendant du contes*<br />
Bled-bou-Djemaâ, parcelles qui sonl aujourd'hui hors de<br />
talion ;<br />
— Qu'à<br />
ce point de vue, les Ouled-Ziads auraient encouru, pour les<br />
autres parties du Bled-bou-Djemaâ attribué à l'Étal, la forclusion édictée par<br />
— les articles 11, 12 et 13 du décret dû 23 mai 1863 ; Qu'en admettant même<br />
que la contre revendication eut porté sur l'ensemble du Bled-bou-Djemaâ,<br />
les Ouled-Ziads seraient encore déchus, aux termes des dispositions précitées,<br />
pour n'avoir pas formé leur action en justice, dans les délais prescrits par le<br />
— décret du 23 mai 1863 à peine de nullité ; Qu'ainsi le droit de propriété<br />
de l'État sur le Bled-bou-Djemaâ, fondé ou sur l'article 1« § 2 duSénatus-<br />
—
395<br />
consulte ou, sur les articles 11 , 12 et 13 du décret du 23 mai 1863, a été ré<br />
—<br />
gulièrement et définitivement proclamé dans le décret du 2 octobre 1869;<br />
Que, si les tribunaux, accueillant des actions tardives, infirmant les opéra<br />
tions failes en vertu du Sénatus-consulte homologuées par des décrets,<br />
laissaient la porte ouverte à des contestations, il s'ensuivrait un trouble pro<br />
fond dans la constitution de la propriété en Algérie ;<br />
Allendu que le droil de propriété de l'État sur le Bled-bou-Djemaâ, étant<br />
établi, il suffit de constater que les Ouled-Amranes sont cessionnaires des<br />
droits de l'État en vertu de l'acte authentique du 14 juillet 1876 et qu'ils sont<br />
ainsi devenus eux-mêmes propriélaires du Bled-bou-Djemaâ;<br />
Attendu que dans ces conditions, l'offre. de preuve faile subsidiairemenl<br />
par les Ouled-Ziads n'est ni admissible, ni pertinenle —<br />
; Qu'il y a lieu dès<br />
iors de rejeter l'action en revendication, intentée par les Ouled-Ziads et les<br />
intervenants relativement au Bled-bou-Djemaâ et de faire droil au contraire<br />
à la demande reconventionnelle des Ouled-Amranes tendant aux mêmes, fins;<br />
— Qu'il<br />
convient néanmoins de mettre hors de litige et de contestation qua<br />
tre parcelles dépendant du Bled-bou-Djemaâ et comprise dans un acte de<br />
donation de 1701 ;<br />
— Que<br />
les Ouled-Amranes reconnaissent qn'il y a sur ce<br />
point chose jugée, entre les Ouled-Ziads et eux, par une décision du Midjelès<br />
du 8 septembre 1856 qui a attribué aux Ouled-Ziads les quatre parcelles,<br />
telles qu'elles sont dénommées et délimitées dans l'acie de donation précité ;<br />
— En ce qui touche la restitution des fruits ; Altendu que l'État les ayant<br />
perçus comme légitime propriétaire, ne saurait être tenu, vis-à-vis d'une des<br />
parties, à des restitutions ;<br />
Atlendu que les Ouled-Amranes ne les récla<br />
ment, conlre les Ouled-Ziads, que du jour de la demande en justice et qu'ainsi<br />
limitée celle demande accessoire est légitime ;<br />
Attendu que toutes les questions pendantes se trouvant résolues en prin<br />
cipe, il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 473 du Code de pro<br />
—<br />
cédure civile; Qu'en l'état, il appartient à la Cour d'ordonner l'expertise<br />
demandée par les Ouled-Amranes, celte mesure n'étant qu'une voie d'exécu<br />
lion d'un arrêt définitif sur la question de propriété ;<br />
Par ces motifs : la Cour reçoit l'appel et, infirmant le jugement déféré, dit<br />
les Ouled-Amranes bien fondés à refuser le désistement offert par les deman<br />
— deurs ; Évoquant et statuant au fond, sans s'arrêter à l'offre de preuve des<br />
rejette comme mal fondée l'action en revendication du Bled-<br />
Ouled-Ziads,<br />
— bou-Djemaâ intentée par les demandeurs et les intervenants; Faisant droit<br />
au contraire à la demande reconvenlionnelle des Ouled-Amranes;— Les<br />
déclare propriélaires ut singuli, comme cessionnaires de l'Étal aux termes de<br />
l'acte de transaction du 14 juillet 1876, de la terre dite le Bled-bou-Djemaâ ;<br />
Dit néanmoins que les Ouled-Ziads sont propriétaires des quatre parcelles<br />
dénommées dans la décision du Medjelèsdu 8 septembre 1856;<br />
— Donne acte<br />
—<br />
aux parties des déclarations failes à cel égard par les Ouled-Amranes; Con<br />
damne, en conséquence, les Ouled-Ziads, demandeurs el intervenants à dé<br />
laisser les parcelles du Bled-bou-Djemaâ qu'ils détiennent, à l'exception des<br />
quatre faisant l'objet de la donation de 1701 et à eux attribuées par la décision<br />
— du Medjelès précitée ; Condamne les Ouled-Ziads à restituer, à partir de la<br />
— demande en justice, les fruits qu'ils ont perçu ; Dit que l'Étal n'est tenu<br />
fruits;'<br />
—<br />
vis-à-vis de personne à aucune restitution de<br />
Ordonne que, par
396<br />
trois experts qui seront désignés par les parties dans la quinzaine de la pro<br />
nonciation de l'arrêt, à moins qu'elles ne conviennent d'un seul,<br />
par MM.<br />
à défaut<br />
que la Cour nomme d'office, il sera procédé sur les bases de l'arrêt à l'abor-<br />
nement des quatre parcelles attribuées aux Ziads sur le Bled-bou-Djemaâ,<br />
—<br />
ainsi qu'à la fixation des fruits à restituer ; Dit n'y avoir lieu à slatuersur<br />
l'appel incident de l'État qui se trouve, par suite du dispositif de l'arrêt, dé<br />
M8<br />
sormais sans objet; Condamne les demandeurs et inlervenanls, parties de<br />
Huré, en tous les dépens de 1« instance el d'appel vis-à-vis de l'État et des<br />
Ouled-Amranes, sauf les frais d'expertise qui seront supportés par moitié —<br />
;<br />
Donne acte aux Ouled-Amranes de ce qu'ils déclarent prendre à leur charge<br />
les dépens de l'État sauf recours contre les parties deM*<br />
Robe, Huré et Garau, av.<br />
COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />
Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />
11 novembre 1878.<br />
I. Justice musulmane. — Chambre des appels musulmans. —<br />
Nullités de forme.<br />
■II. Algérie. — Successions musulmanes. — Beït<br />
pétence.<br />
el Mal. — Com<br />
III. Droit musulman. — — Ordre héréditaire. Nièce du «fe CMJt#».<br />
I. // est de principe à la Chambre des appels musulmans de la Cour d'Alger,<br />
de ne jamais s'arrêter aux nullités de pure forme (\).<br />
II. Le décret du 31 décembre 1859, sur la justice musulmane, dans ses art.<br />
40 et 41 non modifiés sur ce point par le décret du 13 décembre 1866, a attri<br />
bué d'une manière formelle aux juridiclions musulmanes réglées par ce décret,<br />
la connaissance des procès dans lesquels se trouve engagé le Beït el Mal, et<br />
c'est en vain que le préfet, au nom du Domaine de l'État, essayerait de s'élever<br />
contre cette attribution de compétence, en se fondant sur l'art. 4 de la loi du<br />
16juin 1851 (2).<br />
(\) La nullité qui était relevée dans l'espèce et dont la Cour a refusé de faire<br />
acception, était relative à la tierce opposition par laquelle le Préfet du départe<br />
intervenait par exploit d'huissier pour<br />
ment d'Alger, comme représentant l'État,<br />
demander la rétractation d'un arrêt rendu précédemment par la même Chambre.<br />
(2) Comme on le voit, la Chambre musulmane de la Cour d'Alger résout la ques<br />
tion en sens absolument contraire de la Cour de Cassation dont nous avons rap<br />
porté plus haut, page 385',: l'arrêt en date du 9 juillet 1878.
397<br />
III. Dans les successions musulmanes, la fille de la sœur du défunt doit être<br />
préférée au Btït el Mal et sa présence est une cause absolue d'exclusion pour<br />
ce dernier (1).<br />
Cette dernière décision a incontestablement pour elle une jurisprudence qui s'est<br />
maintenue invariable de*puis 1868 (voir notamment Alger, 10 fév. 1868. — Robe,<br />
1869, p. 39). Alger, ?5 mai et 7 octobre 1873 (Sautayra et Cherbonneau,^!!, § 683,<br />
av. observ. conf. des auteurs) ; Alger, 24 nov. 1875 (Robe, 1875, p. 248) .<br />
Si la Chambre musulmane avait, à la date du 30 avril 1878 (Bull. jud. 1878, p.<br />
267) admis un principe contraire, cette décision se fondait plutôt,» il faut le dire,<br />
sur un assentiment de fait de l'administration du Beït el Mal et sur les traditions,<br />
que sur un principe de droit rigoureux.<br />
L'arrêt rapporté invoque au contraire à l'appui de sa thèse, un argument de texte<br />
tiré de l'ait. 41 du décret de 1859 sur la justice musulmane et qui imposerait, sans<br />
discussion possible, cette juridiction spéciale, aux contestations dans lesquelles le<br />
Domaine, comme étant aux droits du Beït el Mal,<br />
Mais la portée de cet article est-elle bien aussi péremptoire ? —<br />
se trouverait engagé.<br />
Il est conçu<br />
dans les termes suivants : « En cas de contestations, il est statué par les cadis et<br />
« les tribunaux, conformément aux règles de compétence et de procédure fixées par<br />
« le présent décret. »<br />
Quel est le véritable sens de ces termes : « aux règles de compétence ?» — Si<br />
elles ont trait à la distinction entre le premier et le dernier ressort telle qu'elle est<br />
tracée par les art. 18 et suiv. du décret, il faut nécessairement approuver la doc<br />
trine de l'arrêt qui ne fait qu'appliquer un texte législatif formel.<br />
Peut-être pourraît-on interpréter autrement ce texte,<br />
et considérer ces ex<br />
pressions comme se référant à la règle générale de compétence posée dans l'article<br />
17,<br />
qui limite la juridiction des cadis aux seules affaires civiles et commerciales<br />
entre musulmans. Dans ce cas, suivant que le Domaine se trouverait engagé ou<br />
non dans le débat, le procès serait déféré soit aux tribunaux ordinaires, soit aux<br />
conformément aux règles de compétence fixées par te décret de 1859.<br />
cadis,<br />
La formule même de la disposition ne nous semble pas absolument décisive<br />
dans l'un ou l'autre sens, et nous ne trouvons d'autre part aucun éclaircissement à<br />
cet égard dans les rapports qui accompagnent les décrets de 1859 et de 1866.<br />
Si cet argument de texte peut être écarté, nous n'hésitons pas à accorder la pré<br />
férence à !a jurisprudence de la Cour de Cassation qui nous paraît la plus conforme<br />
aux vrais principes juridiques,<br />
Tant que l'administration du Beït el Mal a eu une personnalité distincte, repré<br />
sentée par des agents spéciaux, elle a pu être considérée, par une sorte de fiction,<br />
-<br />
comme un véritable musulman car elle ne tirait son origine et sa raison d'être<br />
;<br />
elle-même que de l'application de la loi musulmane.<br />
Mais aujourd'hui que le Beït el Mal a cessé d'exister comme institution distincte,<br />
que l'administration des Domaines lui a été substituée d'une manière absolue, et<br />
que les biens provenant de l'application du droit musulman en ce qui concerne les<br />
droits du Beït el Mal dans les successions, viennent se confondre dans le domaine<br />
il semble difficile que celui-ci puisse plaider ces sortes de procès dans<br />
de l'État,<br />
des conditions différentes des autres instances qu'il soutient ; et notamment qu'il<br />
soit astreint à plaider par oukil et à se conformer à toutes les règles particulières<br />
de procédure établies évidemment par les décrets de 1859 et de 1866 à l'usage des<br />
seuls musulmans,<br />
(1) Cette solution est tout à fait contraire à la jurisprudence antérieure. (Cpr.<br />
Sautayra et Cherbonneau, II, n»<br />
631, p. 133). Medjelès, 4 mai 1860. Alger, 28 mai
398<br />
Le Préfet d'Alger cles<br />
dames Goussem, Nefissa et Mimi.<br />
En ce qui touche les nullités : — Attendu<br />
qu'il esl de principe à la Cham<br />
bre musulmane de ne jamais s'arrêter aux nullités de pure forme ;<br />
En ce qui concerne la compétence :<br />
Attendu que pour décliner la compétence de la Chambre musulmane,<br />
M. le Préfet s'appuie : 1° sur trois arrêls de la Cour, en date du 10 janvier<br />
1868, 25 mai 1873 et 7 octobre 1873, et 2» sur l'art. 4 de la loi du 16 juin<br />
— 1851 ; Atlendu que des trois arrêts produits, et même du procès actuel, il<br />
résulte que le service du Beït et Mal saisit constamment les cadis de ses pro<br />
cès comme seuls juges compétents,<br />
el décline constamment la compétence de<br />
la juridiction supérieure, chargée d'infirmer ou de confirmer les jugements<br />
qu'un semblable système est absolument inadmissible ;<br />
— des cadis; Attendu<br />
— Que précisément, à raison de ce système inauguré par le service du Beït<br />
el Mal, la Cour est revenue à la jurisprudence qu'elle avait toujours suivie<br />
jusqu'à Tarrêt du 10 février 1868 ;<br />
— Que<br />
par arrêt du 30 avril 1878 elle a<br />
de nouveau affirmé sa compétence et que celte dernière jurisprudence doit<br />
seule être suivie ;<br />
Attendu en effet qu'il ne s'agit point ici de la loi de 1851 et de la compé<br />
tence générale des tribunaux de droit commun pour les procès du domaine<br />
de l'État,<br />
mais qu'il s'agit exclusivement du décret du 31 décembre 1859 et<br />
de la compétence spéciale attribuée par ce décret, aux cadis el aux Chambres<br />
musulmanes des tribunaux d'appel et de la Cour dans ses procès particuliers<br />
—<br />
au Beït el Mal ; Attendu que ce décret modifié par le décret du 13 novem<br />
bre 1866, est le décret même qui a organisé la justice musulmane en Algé<br />
—<br />
rie; Que sa légalité n'a jamais élé contestée par personne et que M. le Pré<br />
fet ne la conteste pas ;<br />
Attendu que ce décret dispose en termes formels,<br />
« cèdent<br />
art. 40: • Les cadis pro-<br />
2° sous la surveillance de l'administration des Domaines,<br />
« à la liquidation et au partage des successions musulmanes, auxquelles sont<br />
« intéressés le Beït el Mal et les absents ;<br />
— Art. 41 : En cas de contestations,<br />
« il est statué par les cadis et les tribunaux, conformément aux règles de<br />
«. compétence et de procédure fixées par teprésent décret » ; ,<br />
Attendu que l'art. 40, g 2, a élé textuellement reproduit par le décret du<br />
13 décembre 1866, et que la question se réduit à savoirsi l'art 41 a été abrogé<br />
— Altendu que le rapport annexé au décret de 1866, expli- .<br />
par ledit décret ;<br />
1862 (Robe, 1862, p. 11 6). Ces décisions avaient statué formellement que « la loi<br />
« musulmane, conforme en cela au livre sacré, n'assigne à la nièce ou à la petite-<br />
« nièce, aucune quote-part d'hérédité. » Comme on le voit, la contradiction est<br />
aussi absolue que possible .<br />
Nous nous garderons bien, et pour cause, d'oser émettre une préférence per<br />
sonnelle pour l'un ou l'autre des deux systèmes.<br />
Mais ne semble-t-il pas étrange qu'au bout de 48 ans d'occupation française en<br />
Algérie,<br />
on n'ait pas jusqu'ici cru devoir fixer d'une manière officielle et immuable<br />
les règles applicables à l'ordre des successions musulmanes et qu'il puisse encore<br />
se rencontrer, dans la jurisprudence, une semblable divergence sur une question<br />
aussi importante ? V. M.
399<br />
que comment ce décret laisse subsister dans la plupart de ses dispositions le<br />
décret du 31 décembre 1859 et se borne à modifier un certain nombre d'articles ;<br />
Altendu que spécialement l'art. 1 de ce décret est ainsi conçu: — >• les art.<br />
« 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,<br />
« 34, 35, 37, 38, 39 et 40 du décret de 1859, sont abrogés et remplacés par<br />
« les dispositions suivantes : » —<br />
Attendu, dès lors, que le décret de 1866, en<br />
abrogeant les articles ci-dessus énumérés, a maintenu au contraire les art.<br />
3, 6, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 36 et toute la série du n°41 au n° — 61 ; Atlendu<br />
que la traduction arabe du décret ne laisse aucuu doute à cet égard, et que<br />
les — magistrats indigènes ne s'y sont jamais trompés; Allendu d'abord qu'il<br />
n'est d'ailleurs ni justifié ni même allégué que les dits art. 40 et 41 des décrets<br />
de 1859 et de 1866, aient jamais été abrogés par aucune loi postérieure;<br />
Atlendu dès lors que la Cfiambre musulmane s'est à bon droit déclarée<br />
compétente par son arrêt du 30 avril 1878, et que M. le Préfet demande en<br />
■vain à la Cour de revenir sur cetle jurisprudence :<br />
En ce qui louche le fond : — Attendu<br />
que devant la Chambre musulmane<br />
il ne saurait être permis à personne d'invoquer le droit musulman sans en<br />
— citer et en rapporter les textes; Attendu que pour enlèvera la nièce du dé<br />
funt sa part d'héritage, et attribuer cette part à l'Étal, le Domaine se borne<br />
— à invoquer vaguement l'autorité de Malek ; Attendu que vérification faile<br />
sur ce point de la traduction officielle de Sidi Khelil, parle docteur Perron,<br />
il se trouve que l'Iman Malek est mort en l'an 795 el que depuis le IXe siècle<br />
les jurisconsultes malekites ont universellement admis le droit d'héritage du<br />
don el ahram (ce qui comprend la nièce de Si Ahmed) et à défaut, le droit<br />
d'accroissement au profit des légitimaires (Perron, vol. 6, p. 357 et 358 in<br />
fine) ; ^- Attendu que suivant le Code ottoman (1), le Code Égyptien (2) et<br />
M. de Tornauw (3), il se trouve qu'en Turquie, en Egypte et dans les pays<br />
musulmans soumis aux Russes, la fille delà sœur du défunt est tpujours pré<br />
— férée au Beïl el Mal ; Atlendu qu'au nom de la nièce de Si Ahmed on a<br />
produit un nombre considérable d'exlrails d'auteurs musulmans, établissant<br />
qu'il en était ainsi en Afrique sous la domination turque ; —Altendu que le<br />
Domaine n'a rapporté aucune justification contraire ;<br />
Attendu dès lors que l'arrêt ,du 26 mars 1878 a justement attribué à la<br />
nièce du défunt sa part légitime d'héritage dans la succession de sou oncle ;<br />
En ce qui concerne les dommages et inlérêls : — Altendu qu'en faisant<br />
défense au cadi d'exéculer l'arrêt de la Cour, et en empêchant tous, les héri<br />
tiers du défunt, même sa sœur et sa veuve dont il ne contestait pas les droits,<br />
de toucher leurs parts d'héritage, et en leur faisant en outre un procès néces<br />
sairement coûleux, le service du Beït el Mal a causé aux dits héritiers un<br />
préjudice évident ;<br />
Par ces motifs : Déclare M. le Préfet d'Alger recevable mais mal fondé dans<br />
—<br />
sa tierce opposilion à l'arrêl du 26 mars 1878 ; Ordonne que ledit arrêt<br />
recevra sa pleine et entière exécution ; —Condamne M. le Préfet és-nom<br />
(1) V. d'Ohsson, vol. 5,<br />
(2) V. de Tornauw, p. 253.<br />
tableau final.<br />
(3) V. Code égyptien, statut personnel,<br />
art. 631 et s .
400<br />
qu'il agit, à payer : 1° à Goussem, 100 fr.; 2° à Nefissa, 200 fr. et 3° à Mimi<br />
— 200 fr. de dommages et intérêts ; Le condamne en outre aux dépens du<br />
présent arrêt el de ses suites.<br />
M. Boullay, cons. rapp. —<br />
; M. Cumac, subs. duproc. gén. (concl. conf.) ;<br />
— M"<br />
Garau, Ballesteros et Jouyne, av.<br />
Par décret du 3 décembre 1878,<br />
à la résidence de Sidi-bel-Abbès.<br />
Nominations et mutations<br />
Ont élé nommés notaires à Sidi-bel-Abbès :<br />
un deuxième office de notaire a été créé<br />
U (place créée) M. Friess, notaire à St-Cloud ;<br />
2° M. Goillot, notaire à Mascara, en remplacement de M. Lemarchand,<br />
décédé.<br />
Par décret du 7 décembre 1878, M. Bénézet, juge de paix de St-Mamert<br />
(Gard), a été nommé greffier du tribunal de lre instance de Bougie (Algérie),<br />
en remplacement de M. Seveslre, décédé.<br />
Par décret du 12 décembre 1878,<br />
ont été nommés :<br />
Greffier près la justice de paix deTakitount (Algérie), M. Benedetti, greffier<br />
près la justice de paix de Fort-National, en remplacement de M. Moreau.<br />
Greffier près la justice de paix de Fort-National (Algérie), M. Moreau,<br />
greffier près la justice de paix de Takitount, en remplacement de M. Bene<br />
detti.<br />
Notaire. —<br />
Responsabilité.<br />
—<br />
DÉCISIONS DIVERSES<br />
Imprudence.<br />
—<br />
Preuve<br />
d'un décès. —<br />
La<br />
responsabilité spéciale que la loi du 25 venlôse, an XI, édictée contre les<br />
notaires, ne les affranchit pas de la responsabilité de droit commun qu'ils<br />
peuvent encourir, dans les termes des art. 1382 et 1383 du Code civil, en<br />
compromettant, par une imprudence, les intérêls de leurs clients ; on doit<br />
considérer comme une imprudence de nalure à entraîner ia responsabilité<br />
du notaire, le fait par lui d'avoir accepté comme preuve de la date d'un décès<br />
un acle informe et une simple lettre, au lieu d'un acte régulier de l'état civil<br />
(Cass. req., 2 juillet 1878. Fr.jud. III, p. 161).<br />
Élections. —<br />
Crimes<br />
et délits électoraux. —<br />
Partie<br />
civile. — — Électeur.<br />
En l'état de la législation actuelle, lout électeur a le droit de poursuivre, par<br />
voie de plainte, les crimes et délits électoraux commis dans la circonscription<br />
électorale à laquelle il appartient et de se porter partie civile devanl le tri<br />
bunal correctionnel (Nîmes, 9 mai 1878. Fr.jud. 111, p. 167).<br />
Alger. — Typ. A. Jovrdan.
TABLES<br />
DU<br />
BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />
Tome II. —<br />
Année<br />
1878<br />
TABLE DBS MATIÈRES<br />
A<br />
Abus de confiance. Fonds remis en compte-courant 250<br />
Acte sous seing-privé. Acte rédigé en français et en arabe. Acte rédigé en<br />
un seul original. Formalité du bon pour.<br />
Acte sous seing-privé. Énonciation du nombre des originaux. Exécution modificative<br />
des conventions. Nullité 37<br />
Acte notarié (Voyez Indigènes musulmans)<br />
Action. Immeuble saisi. Revendication. Droits du saisi. Demande en réso<br />
lution d'une vente pour défaut de paiement du prix 343<br />
Actions domaniales. ( Voyez Algérie)<br />
385<br />
Action possessoire. Chose jugée 187<br />
Action publique. Ministère public. Tribunal de répression. Compétence. . . 331<br />
Ajournement. Absence des noms et immatricule de l'huissier. Signature il<br />
lisible. Nullité . 364<br />
Algérie. Actions domaniales. Successions musulmanes. Beït-el-Mal. Cadi.<br />
Compétence<br />
Algérie. Arrêté du 8 juillet 1840 sur le pesage et le mesurage publics. Pe<br />
sage dans le port. Intervention nécessaire du peseur public . Pouvoir d'ap<br />
préciation du juge de simple police .<br />
Algérie. Commune mixte. Adjoint indigène. Caïd<br />
Algérie. Concession de terre. Résidence. Déchéance administrative. Mise en<br />
adjudication du droit au bail. Sous-location antérieure. Impenses. Frais<br />
de semences et de culture. Restitution<br />
*<br />
246<br />
44<br />
385<br />
221<br />
113<br />
350
— 2 —<br />
Pages.<br />
Algérie. Condamnation correctionnelle. Pourvoi en cassation. Mise en état.<br />
Promulgation des lois 113<br />
Algérie: Cours d'eau réglementés. Dégradation des canaux et ouvrages as<br />
surant la dérivation et la répartition des eaux. Compétence. Contravention<br />
de grande voirie<br />
Algérie. Délais. Requête civile. Délai de distance . 56<br />
Algérie. Douane. Droit de quai. Navire venant des ports d'Algérie dans les<br />
ports de France. Double perception. Restitution des droits perçus. Pres<br />
cription biennale<br />
Algérie. Expropriation pour cause d'utilité publique. Appel. Recevabilité.<br />
Indemnité fixée en travaux à exécuter, à défaut émargent 18<br />
Algérie. Habous. Inaliénabilité des biens habousés. Décret du 30 octobre<br />
1858<br />
Algérie. Indigènes musulmans. Juge de paix siégeant en matière musulmane.<br />
Appel ^<br />
Algérie. Israélites algériens. Naturalisation. Tutelle légale. Option. Renon<br />
ciation au statut personnel<br />
Algérie. Lois. Décrets. Infractions spéciales à l'indigénat.- Tribunal de<br />
simple police. Dernier ressort. 130<br />
Algérie. Mines. Intervention. Recevabilité. Autorisation de recherches. In<br />
compétence du Gouverneur général 277<br />
Algérie. Nullités facultatives 109<br />
Algérie. Prêt à intérêt. Usure. Commission. Banquier 193<br />
Algérie. Procédure devant les tribunaux correctionnels. Notes d'audience. 39<br />
Algérie. Régime des eaux. Domaine public inaliénable. Concessions. Pres<br />
cription 102<br />
Algérie. Séquestre. Régularité. Demande en main-levée. Compétence. . . 209<br />
Algérie. Succession musulmane. Beït-el-Mal. Compétence 396<br />
Algérie. Taxe des loyers. Officier sans troupes. Officier détaché comme sta<br />
giaire dans un bureau arabe. Prestation 242<br />
Algérie, Taxe des loyers. Réclamation. Timbre. Non recevabilité 243<br />
Algérie. Terres dites Blad el Baroud (Terres à poudre). Bien vacant et sans<br />
maître. Prise de possession par l'Etat. Sénatus-consulte de 1863. Caractère<br />
définitif des distractions antérieures. Bien domanial. Revendication. Ac<br />
tion en justice. Délai. Forclusion. Possession. Irrecevabilité de la preuve. 387<br />
Algérie. Ville d'Alger. Taxe pour frais de premier établissement ou de re<br />
construction à grande section des égoûts publics. Maison riveraine déver<br />
sant ses eaux dans un autre égoût 241<br />
Aliéné. Curateur 284<br />
Appel, Codébiteurs, solidaires. Déchéance. Femme mariée. Tutrice. Mi<br />
neurs 33<br />
Appel. Conclusions nouvelles. Omission. Adoption de motifs 369<br />
Appel., Défaut de signification de l'acte d'appel à personne ou à domicile.<br />
■<br />
Nullité<br />
Appel.. Désistement. Forme du désistement 36<br />
Appel. Domicile élu. Défenseur. Huissier 360<br />
Appel. Infirmation partielle d'un jugement ordonnant une mesure d'instruc<br />
tion; Renvoi devant les premiers juges 117<br />
Appel. Procédure d'ordre. Nullité. Algérie. NuHités facultatives 161<br />
Appel. Production d'une expédition du jugement attaqué. Irrecevabilité.<br />
Droits réservés 119<br />
155<br />
138<br />
177<br />
203<br />
355<br />
230
— - 3<br />
Pages.<br />
A ,<br />
Appel correctionnel. Aggravation de peine. Motifs de l'aggravation. ... 113<br />
Appel correctionnel. Appel du ministère public. Formes. Appel du pré<br />
venu. Désistement. Citation à comparaître devant la Cour 262<br />
Appel correctionnel. (Voyez Citation à jour fixe.)<br />
210<br />
Appel correctionnel. Déclaration d'appel. Mandat spécial. Avocat 109<br />
Appel correctionnel. Prévenu. Appel de la partie civile. Comparution per<br />
sonnelle<br />
..... 39<br />
application de la loi du 26 juillet 1873. Compétence. Opérations du commis<br />
saire-enquêteur. Sursis 90<br />
Attentat à la pudeur. Caractères constitutifs. Outrage public à la pudeur. Pu<br />
blicité 344<br />
Autorisation de femme mariée. Femme assignée par son mari 73<br />
B<br />
Bail de colonisation. Décret du 15 juillet 1874. Hypothèque. Privilège. Nullité. 83<br />
Banqueroute simple. Circulation ruineuse d'effets. Engagements contractés<br />
pour le compte d'autrui 346<br />
Banqueroute simple. Tenue des livres en partie double. Irrégularités de<br />
comptabilité 250<br />
Beït-el-Mal. (Voyez Justice musulmane)<br />
Beït-el-Mal. (Voyez Algérie)<br />
G<br />
267<br />
385 et 396<br />
Capitaine de navire. Emprunta la grosse. Constatation de la nécessité de cet<br />
emprunt. Preuve. Privilège du prêteur 374<br />
Cession de créance. Cautionnement 260<br />
Chefâa. Délai. Déchéance 68<br />
Chemin de fer d'intérêt local. Police des chemins de fer. Contravention.-. 120<br />
Chemins vicinaux. Prestation. Réclamations. Termes échus. Quittance.. .<br />
Chênes- lièges. Concession. Cession définitive. Cession non consommée. Ac<br />
tion en j ustice<br />
Chose jugée. Moyen irrecevable comme nouveau<br />
Circulation fictive d'effets. Opérations isolées 250<br />
Circulation ruineuse d'effets. (Voyez Banqueroute simple) 346<br />
Citation à jour fixe. Jugement correctionnel par défaut rendu à contre-date.<br />
Règlement intérieur des tribunaux. Violation des droits de la défense. .<br />
Compétence. (Voy ez Algérie. Cours d'eau réglementés)<br />
Compétence. (Voyez Algérie. Séquestre)<br />
Compétence. (Voyez Algérie. Successions musulmanes). 396<br />
Compétence. (Voyez Application de la loi du 26 juillet 1873) 90<br />
Compétence. (Voyez Dénonciation calomnieuse)<br />
Compétence administrative. (Voyez Expropriation)<br />
Compétence, (Voyez Faux serment)<br />
Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Acte notarié)<br />
Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Justice française) .<br />
Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Litige déféré à la juridiction<br />
française)<br />
97<br />
1<br />
225<br />
210<br />
155<br />
209<br />
145<br />
3<br />
329<br />
44<br />
60<br />
163
— 4 —<br />
Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Titre administratif)<br />
Comp^ence. (Voyez Juridiction correctionnelle)<br />
Compétence. (Voyez Justice musulmane. Beït-el-Mal)<br />
Compétence. (Voyez Justice musulmane. Kabyles)<br />
Compétence. ( Voyez Louage. Obligations du bailleur)<br />
Compétence. (Voyez Mine)<br />
Compétence. (Voyez Soustraction frauduleuse)<br />
Pages.<br />
42<br />
13-146<br />
Compétence. (Voyez Terres cédées par l'État à des indigènes)<br />
173<br />
Compétence. Contestation entre musulmans. Titre administratif 233<br />
Compétence. Contestation entre musulmans au sujet d'un immeuble non<br />
soumis à la loi française. Ordre public. Titre français 231<br />
Compétence. Tribunaux de commerce. Statut personnel. Étrangers. .<br />
Compétence. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Décision judiciaire. Litige<br />
entre indigènes musulmans<br />
267<br />
43<br />
257<br />
5<br />
39<br />
. . 287<br />
Compétence administrative. Cours d'eau. Acte administratif. Propriété. Dom<br />
mage . 52<br />
Compétence correctionnelle. Fausse qualification des faits incriminés. In<br />
compétence d'ordre public 124<br />
Compétence des cadis. Loi du 26 juillet 1873. Délivrance des titres de pro<br />
priété 27<br />
Concession de terres (Voyez Algérie)<br />
Concession de terres. Déchéance administrative. Mise en adjudication du<br />
350<br />
droit au bail. Frais de semences et culture. Restitution 258<br />
Conclusions. Motifs. Dispositif 56<br />
Contrat. Vente. Échange. Contrat innomé. Mise en gage. Chose d'autrui.<br />
Possession 376<br />
Contrat synallagmatique. Nullité. Faute réciproque<br />
Cours d'eau réglementé. (Voyez Algérie;<br />
Corruption de fonctionnaires. Infraction aux règles de l'indigénat. Contra<br />
155<br />
vention. Crime. Connexité 180<br />
Cour d'assises. Interrogatoire. Arrêt de renvoi. Pourvoi. Délai 99<br />
Cour d'assises. Interrogatoire par le président des assises. Formes. Con<br />
tumax. Interrogatoires. Magistrats compétents 370<br />
Cour d'assises. (Voyez Liste des jurés)<br />
Cours d'eau. Fossé. Jouissance commune des eaux. Mode d'exercice de<br />
cette jouissance<br />
Créancier. Succession. Partage. Améliorations d'un immeuble. Intervention. 284<br />
D<br />
Degrés de juridiction. Ana. Taux de la prestation annuelle 359<br />
Degrés de juridiction. Divisibilité 37<br />
Degrés de juridiction . Divisibilité. Appel irrecevable 38<br />
Degrés de juridiction. Dernier ressort. Demande alternative. Demande in<br />
déterminée. Jugement qualifié à tort en dernier ressort. Exécution. Appel.<br />
Fin de non recevoir. . ; 248<br />
Délais. (Voyez Algérie)<br />
Délit de presse. Outrage à un ministre d'un culte. Absence de plainte. Irre<br />
56<br />
cevabilité de l'action publique 239<br />
■<br />
361<br />
258<br />
71<br />
187'
- 5<br />
-<br />
Délit de presse. (Voyez Renvoi pour suspicion légitime)<br />
Demande en nullité de jugement par action principale. Voies de recours. .<br />
Vages.<br />
30<br />
Dénonciation calomnieuse. Crime. Magistrat. Premier président de la Cour<br />
d'appel. Compétence. Magistrat 145<br />
Dénonciation calomnieuse. Fausseté des faits. Décision de l'autorité com<br />
pétente 113<br />
Dépens. Instance dirigée contre une femme mariée. Mari. Séparation de<br />
biens. Conclusions 337<br />
Désistement. Acceptation. Refus du défendeur. Demande reconventionnelle.<br />
Appréciation de la juridiction saisie. Douar. Représentants légaux. Action<br />
ut singuli. Rejet du désistement. Evocation 387<br />
Désistement. Copie. Signature 129<br />
Désistement. Réserves. Refus d'acquiescement. Appel irrecevable. Préju<br />
dice résultant de l'appel. Dommages-intérêts. Droit de statuer. ..... 233<br />
Détention d'armes et de munitions de guerre. (Voyez Indigènes musulmans). 22-24<br />
Diffamation. Injure. Outrage. Conseiller général. Citoyen chargé d'un minis<br />
tère de service public 205<br />
Diffamation. Outrage.<br />
Djemâas. (Voyez Justice musulmane)<br />
Domaine de l'État. Ministre de l'intérieur<br />
Dommages-intérêts. Obligation de faire, sous peine de dommages-intérêts,<br />
à payer par jour. Appel. Arrêt confirmant'. Point de départ 61<br />
Droit musulman. Habous. Annulation. Créancier dévolutaire. Droit d'héré<br />
dité en matière musulmane ". 253<br />
Droit musulman. Mariage. Impuissance du mari. Divorce<br />
Droit musulman. Mariage. Droit de djebr<br />
Droit musulman. Mariage. Puberté. Consommation du mariage. Condition.<br />
Violation de la condition. Divorce. Appréciation. Droits réservés 235<br />
Droit musulman. Mariage. Relations sexuelles de la femme antérieurement<br />
au mariage. Annulation de l'acte de mariage<br />
Droit musulman. Ordre héréditaire. Nièce du de cujus<br />
Droit musulman. Partage de succession. Délai pour intenter l'action en res<br />
cision. Donation. Forme<br />
Droit musulman. Succession. Rite malekite. Héritiers réservataires. Acebs.<br />
Beït-el-Mal. Parents pauvres<br />
Droit musulman. Testament fait verbalement par le de cujus devant témoins<br />
chargés d'en déposer après le décès devant le Cadi. Fausse déclaration .<br />
Caractère du délit. Faux en écriture authentique. Faux témoignage. 124-227<br />
Droit de réponse aux articles publiés dans les journaux. Excédant de lon<br />
gueur. Détermination du prix<br />
Eaux. Usine Droits acquis. Ouvrages. Autorisation administrative. Contra<br />
vention de grande voirie<br />
Eaux (régime des) .( Voyez Algérie)<br />
Effets de commerce. Protêt. Dispense. Appréciation..<br />
Élections municipales. Algérie. Étrangers. Inscription personnelle sur les<br />
rôles des contributions. Association commerciale<br />
E<br />
Emphytéosé, Caractères spéciaux. Bail à long terme avec le Domaine. ... 279<br />
381<br />
108<br />
43<br />
1<br />
378<br />
28<br />
380<br />
396<br />
202<br />
363<br />
2i}b<br />
9°<br />
1°2<br />
225<br />
254
- 6 -<br />
Pages.<br />
Évocation. Décision définitive. Nomination d'experts 387<br />
Expropriation pour cause d'utilité publique (Voyez Algérie)<br />
18<br />
Expropriation publique. Occupation. Restitution. Compétence administrative. 3<br />
F<br />
Faillite, Droit du créancier. Action en réduction des honoraires des syndics.<br />
Concordat par abandon d'actif. Ses effets. Pouvoirs des syndics. Fixation<br />
de leurs honoraires 168<br />
Faillite. Jugement fixant l'époque de la cessation des paiements. Opposition.<br />
Délai<br />
Faux serment. Serment supplétoire. Chose jugée. Production de pièce nou<br />
velle,<br />
55<br />
.170<br />
Faux serment. Serment supplétoire. Chose jugée. Action du ministère pu<br />
blic . Compétence 329<br />
Fonds de commerce. Vente, Interdiction de fonder un établissement simi<br />
laire. Faillite. Syndics 243<br />
H<br />
Habous (Voyez Algérie) , 177<br />
Habous. Biens engagés. Hypothèque 267<br />
Habous, Dévolutaire définitif. Fondation pieuse 385<br />
Habous ( Voyez Droit musulman)<br />
Habous. Inaliénabilité . Transaction.<br />
Droit des tiers. Recours des cohéri<br />
tiers. Successions musulmanes 211<br />
Indigènes musulmans . Acte<br />
I<br />
253<br />
notarié. Compétence 44<br />
Indigènes musulmans. Détention d'armes et de munitions de guerre. . . 24<br />
Circonstances"<br />
Indigènes musulmans. Détention de munitions de guerre.<br />
de<br />
fait 22<br />
Indigènes musulmans. Justice française. Compétence. Ordre public. Frais<br />
-<br />
frustratoires<br />
Indigènes musulmans. Litige déféré à la juridiction française. Incompétence<br />
du tribunal de lre instance. Difficulté sur exécution d'arrêt. Incompétence<br />
du tribunal 163<br />
Indigènes musulmans. Preuve testimoniale. Abus de confiance . Dépôt.<br />
60<br />
. . 153<br />
Indigènes musulmans. Titre administratif. Compétence 42<br />
Infraction aux règles de l'indigénat (Voyez Corruption de fonctionnaires). . . 180<br />
Instance domaniale. Mémoire préalable. Délai. Formalités substantielles . . 178<br />
Interprétation d'arrêt. Droit de la Cour d'appel 61<br />
Interprète. Nullité. Procès- verbal . Témoins<br />
4<br />
Intervention. Droits de l'intervenant. Appel. Créanciers 357<br />
Israélites algériens (Voyez Algérie)<br />
J<br />
Jugement correctionnel. Arrêt par défaut. Opposition. Formes. Nullité, . . 265<br />
Jugement correctionnel par défaut, AppeL Opposition. Peine 215<br />
355
Jugement correctionnel par défaut (Voyez Citation à jour fixe)<br />
Pages.<br />
210<br />
Jugement correctionnel par défaut. Opposition. Irrégularité. Absence de cita<br />
tion primitive 25<br />
Jugement par défaut. Profit-joint. Demandeurs au principal et en garantie .<br />
Juges de paix à compétence étendue. Kabylie. Loyers 127<br />
Juridiction correctionnelle. Incompétence. Condamnation aux dépens. Cas-<br />
'<br />
sation<br />
Juridiction correctionnelle. Incompétence. Justices de paix à compétence<br />
étendue 13<br />
Justice musulmane. Administration du Beit el Mal. Compétence 267<br />
.<br />
Justice musulmane. Appel. Organisation de la justice en Kabylie. Omission de<br />
statuer sur un ou plusieurs chefs de demande Jugement en dernier ressort. 137<br />
Justice musulmane. Chambre des appels musulmans. Nullités de forme. . . 396<br />
Justice musulmane. Kabyles. Djemâas des Beni-Mansour. Appel. Compé<br />
tence 43<br />
Justice musulmane. Pourvoi en cassation. Irrecevabilité. Composition irré<br />
gulière du tribunal des appels musulmans 353<br />
Justice musulmane . Région saharienne. Appels. Forme. Nullité 266<br />
Liste des jurés. Notification. Erreurs. Faute grave de l'huissier. Cassation.<br />
Frais de la nouvelle procédure<br />
L<br />
Louage. Industries similaires. Étendue des droits et obligations du bailleur. 77<br />
Louage. Obligation du propriétaire. Danger imminent résultant de l'état de<br />
l'immeuble. Compétence. Commune. Propriétaire..<br />
M<br />
Maison de prêt sur nantissement. Gages incorporels. Titres de pension et<br />
brevets de légionnaires. Application de l'art. 411 du Code pénal 78<br />
Mandat. Commis- voyageur. Vente 75<br />
Marchandise. Dommage. Déficit. Fin de non recevoir !35<br />
Mariage (Voyez Droit musulman)<br />
28-235-378-380<br />
Mines (Voyez Algérie)<br />
267<br />
Mine. Invention d'une mine. Permis d'exploration. Convention antérieure à<br />
l'acte de concession. Interprétation. Société civile. Compétence 5<br />
Nullité facultative ( Voyez Algérie)<br />
N<br />
o<br />
Obligation de payer une somme d'argent. Retard dans le paiement. Préju<br />
légal 34<br />
dice. Dommages-intérêts . Intérêt<br />
Offres réelles. Validité!<br />
Ordre. Règlement définitif. Contredit. Forclusion<br />
P<br />
~<br />
.<br />
153<br />
14g<br />
71<br />
257<br />
109<br />
' 236<br />
Partage. Effet déclaratif. Valeurs mobilières. Créances. Rétroactivité. Ordre. 105<br />
357
— 8 —<br />
Partage de succession (Voyez Droit musulman)<br />
Pages.<br />
202<br />
Péremption d'instance. Actes interruptifs. Radiation de la cause du rôle.. . 152<br />
Péremption d'instance en matière de justice de paix. Ses caractères. Juge<br />
ment interlocutoire. Jugement préparatoire. Fin de non recevoir. Conclu<br />
sions prises. Péremption d'instance en matière civile<br />
Pesage et mesurage publics (Voyez Algérie)<br />
Pourvoi en cassation (Voyez Justice musulmane)<br />
Prêt à intérêt ( Voyez Algérie)<br />
Preuve testimoniale. Consentement des parties en dehors des cas prévus par<br />
la loi<br />
Privilège de vendeur tie l'art. 2102 du Code civil. Identité de l'objet. Fonds<br />
de commerce. Matériel. Marchandises<br />
Privilège du bailleur. Inexécution du bail. Dommages-intérêts 107<br />
Privilège du bailleur. Vente d'un fonds de commerce et cession du bail.<br />
-Loyers dus par le locataire principal > 182<br />
Procédure devant les, tribunaux correctionnels (Voyez Algérie)<br />
Propriété. Titres. Preuve. Vente<br />
Publication, exposition ou mise en vente de dessins sans autorisation. Photo<br />
graphies<br />
Puissance paternelle. Droit du père. Intervention des tribunaux. .".... 73<br />
Référé. Exécution de jugement. Vente de l'industrie et de l'exploitation d'un<br />
journal. Urgence<br />
Renvoi pour suspicion légitime. Délit de presse. Prévenu. Comparution per<br />
sonnelle. Jugement par défaut. :<br />
R<br />
Responsabilité civile. Exercice des fonctions. Fait personnnel 226<br />
Responsabilité civile. Échelle abandonnée sur la voie publique. Vol 111<br />
Responsabilité civile. Faute. Compagnie de chemins de fer 100<br />
Saisie-arrêt. Demandé en validité. Dernier ressort. .<br />
Saisie-exécution. Vente. Saisie-arrêt sur le prix de la vente. Attribution de ce<br />
prix au saisissant<br />
S<br />
Saisie-gagerie. Bail à colonage partiaire. Avances faites au colon partiaire.<br />
Remboursement. Date d'exigibilité 333<br />
Saisie -immobilière . Conseil judiciaire. Commandement. Annulation de la<br />
procédure 381<br />
Saisie-revendication. Règles de la saisie-exécution. Nullités. Preuves de pro<br />
priété. Obligations du revendiquant. Délai. Mise hors de cause du saisi.. .<br />
Séparation de biens. Exécution du jugement. Fraude. Action des créanciers. 278<br />
Séquestre (Voyez Algérie)<br />
Serment litis-décisoire. Acte authentique. Syndic. Capacité pour déférer le<br />
209<br />
serment. Ordre. Contredit. Nullité. Moyens nouveaux 165<br />
Servitudes. Vues. Ouvertures. Constructions indigènes. Destination du père<br />
■<br />
de famille. Fait du prince. Prescription. Reconstruction de l'immeuble. .<br />
Servitude de prise d'eau. Mode de jouissance. Prescription. Fermier. Jouis<br />
sance précaire 115<br />
(<br />
•. .<br />
268<br />
221<br />
353<br />
193<br />
20<br />
107<br />
39<br />
81<br />
264<br />
17<br />
30<br />
214<br />
149<br />
218<br />
281
- 9 —<br />
Soustraction frauduleuse. Héritiers. Valeurs de la succession. Compétence<br />
correctionnelle 39<br />
Statut personnel. Étrangers. Communauté. Tutelle 287<br />
Substitution prohibée. Donation sous condition. Fideicommis.de residuo. . . 372<br />
Succession. Héritier bénéficiaire. Délais pour faire inventaire et délibérer.<br />
Délai judiciaire. Frais de poursuite 63<br />
Succession musulmane. Droit malekite. Degré successible. Acebs. Droits du<br />
Beït el Mal 216<br />
Succession. Procès- verbal de carence. P.ocès- verbal descriptif d'objets ne<br />
pouvant être mis sous scellés. Droits de greffa '. 53<br />
T<br />
Taxe des loyers (Voyez Algérie) 242-243<br />
Terres cédées par l'État à des indigènes. Titres français. Compétence.... 173<br />
Testament en matière musulmane. Témoins. Fausse déclaration. Faux en<br />
écriture publique. Règlement de juges 227<br />
Testament par acte public. Formalités substantielles. Accomplissement.<br />
Mentions 117<br />
Titre administratif (Voyez Indigènes musulmans)<br />
Transaction. Droit de l'État. Cession à des tiers 337<br />
Travaux publics. Marché pour l'exécution dos terrassements de chemins de<br />
fer. Prix unique. Défaut de sondages. Forfait. Erreur. Imprévision. ... 194<br />
Travaux publics. Terrassements. Nature des terrains, pré /ue et imprévue.<br />
Quantité imprévue. Marché moyennant un prix unique. Constatation des<br />
travaux imprévus. Métré et réception. Situations provisoires. Situation<br />
définitive 198<br />
Trouble de possession. Menace de trouble 187<br />
u<br />
Usufruit légal des père et mère . Statut personnel 355<br />
V<br />
Vente. Condition. Cassation. Appréciation 81<br />
Vente. Mandataire. Personne interposée. Nullité. Prescription. Jour a quo. . 68<br />
Vente. Résolution. Inexécution réciproque du contrat. Faute première du<br />
vendeur. Dommages-intérêts. Frais d'enregistrement 49<br />
Vente à réméré. Relocation faite aux vendeurs. Vilité de prix. Contrat<br />
pignoratif. Transcription. Antichrèse. Validité. Faillite. Créancier. Pro<br />
duction 338<br />
Vente d'une chose mobilière. Droit de propriété. Vendeur. Faute 248<br />
Vente opérée par l'entremise d'un commissaire-priseur. Responsabilité de<br />
cet officier ministériel 184<br />
Vices rédhibitoires. Vente simultanée de deux chevaux. Vice rédhibitoire<br />
relevé chez l'un des deux seulement 184<br />
Voirie urbaine. Obligation de construire suivant un plan d'architecture déter<br />
miné, imposé dans une vente par l'État. Commune substituée aux droits de<br />
'<br />
l'État. Servitude de circulation 132<br />
42
— 10<br />
TABLE CHRONOLOGIQUE<br />
(Les mots lre Chambre, Sœe Chambre, etc.,<br />
18 lr« Chambre<br />
24 lre Chambre<br />
de la juridiction, s'appliquent à la Cour d'Alger.)<br />
Juillet 1875<br />
Mai 1876<br />
Pages.<br />
49<br />
81<br />
19 Conseil d'État 241<br />
Juin 1876<br />
26 Trib. civil d'Alger (2 Ch.) .<br />
Juillet 1876<br />
184<br />
27 Cass. (Crim.) 99<br />
Novembre 1876<br />
14 Cass. (Req.) 49<br />
Janvier 1877<br />
28 1" Chambre 53<br />
17 Appels corr.<br />
20 Cass. (Req.)<br />
Février 1877<br />
Mars 1877<br />
19 lro Chambre....<br />
27 Conseil d'État<br />
Avril 1877<br />
Mai 1877<br />
2 Cass. (Civ.)<br />
11 Conseil d'Etat. ......<br />
12 Tribunal des conflits. . . ,<br />
18 Appels corr<br />
Juin 1877<br />
250<br />
52<br />
33<br />
97<br />
81<br />
1<br />
3<br />
22<br />
6 Trib. de Blidah 132<br />
8 Cass. (Crim.) 4<br />
8 Conseil d'Etat 243<br />
'25 lre Chambre 17<br />
Juillet 1877,<br />
13 Conseil d'Etat 98<br />
13 Conseil d'Etat 242<br />
■26 Cass. (Crim.) 114<br />
7 Cass, (Civ.)<br />
Août 1877<br />
129<br />
sans désignation spéciale<br />
Octobre 1877<br />
Pages.<br />
5 Appels corr 344-<br />
10 Appels corr . 24<br />
24 lre Chambre 115<br />
26 2me Chambre 20<br />
27 Appels corr 108<br />
29 Trib. civil d'Alger (2meCh.). 236<br />
31 Appels musulmans 27<br />
Novembre 1877<br />
3 1» Chambre 5, 37<br />
12 Appels musulmans 266<br />
13 1 Chambre 100<br />
14' Trib. corr. d'Alger 30<br />
14 1» Chambre 34, 102<br />
14 Appels musulmans 42<br />
19 Appels musulmans 202<br />
20 Cass. (Civ.) 68<br />
22 Appels corr 25, 170<br />
23 Cass. (Crim.) 145<br />
23 Appels corr 13<br />
24 2 Chambre 38, 60<br />
24 Trib. des conflits ,209<br />
28 Appels musulmans 43<br />
29 2m" Chambre 61, 284<br />
Décembre 1877<br />
.<br />
1 2me Chambre 63<br />
3 1« Chambre ... . 55, 56<br />
10 ApJ^ls musulmans 28<br />
11 i« Chambre 132<br />
12 1» Chambre 73<br />
12 Trib. civil de Marseille ... 138<br />
13 2 Chambre 119<br />
18 Appels musulmans ... 44,<br />
137<br />
18 Cass. (Req.) 177<br />
20 Appels corr 120, 154<br />
22 2 Chambre 168, 231<br />
24 i« Chambre . . 18,<br />
75, 105, 161<br />
31 l^ Chambre 107<br />
4<br />
4<br />
2me Chambre<br />
Appels corr<br />
Janvier 1878<br />
233, 359, 374<br />
5 2 Chambre 135, 376<br />
8 Cass. (Req.) 225<br />
8 Trib. civil de Constantine . . 111<br />
9 1 Chambre 36<br />
10 Cass. (Crim.) 71
.<br />
11 Conseil d'Etat<br />
Pages.<br />
277<br />
Trib."<br />
11 corr. de Mostaganem 78<br />
14 Cass. (Req.) 193<br />
14 lra Chambre 117<br />
19 2 Chambre 248, 257<br />
24 Cour d'appel d'Aix 355<br />
24 2""= Chambre 198<br />
24 Trib. civil d'Alger (1 Ch.). 203<br />
25 Appels corr 109<br />
26 2me Chambre 83<br />
26 Appels corr 124<br />
29 Appels musulmans .... 235<br />
Février 1878<br />
.<br />
.<br />
4 Appels musulmans 90<br />
5 Appels musulmans 361<br />
5 Trib. civil de Constantine . 77<br />
8 2 Chambre 153<br />
9 Appels corr 155<br />
11 {■"> Chambre 372<br />
12 lre Chambre 163<br />
14 Trib. civil de Tizi-Ouzou. . . 127<br />
18 Tr. de paix de Sidi-bel-Abbès 254<br />
19 Appels musulmans 253<br />
22 2"'° Chambre 360<br />
23 Cour d'appel de Montpellier 230<br />
25 l Chambre 165, 178<br />
27 Trib. civil de Mostaganem. . 218<br />
Mars 1878<br />
.<br />
1<br />
4 lre Chambre 149<br />
9 Appels corr 262<br />
16 Appels corr 264, 346<br />
18 1'» Chambre 152, 387<br />
20<br />
21<br />
Appels musulmans,<br />
Cass. (Crim.)<br />
173<br />
146<br />
21 Tr. de simple police d'Alger 22 1<br />
2«* Chambre 258<br />
22 Cass. (Crim.) 130<br />
22 Appels corr 180<br />
25 1«> Chambre 194<br />
26 1 Chambre 278<br />
26 Appels musulmans ; . . . . 363<br />
Avril 1878<br />
1 Appels musulmans 378<br />
2 1" Chambre 211<br />
— — 11<br />
8 1» Chambre 279, 357<br />
13 2 Chambre 287<br />
13 Trib. corr. d'Alger 205<br />
18 Cass. (Crim.) 227<br />
24 1''» Chambre 243<br />
30 Appels musulmans 267<br />
Mai 1878<br />
3 Appels corr 265<br />
7 1« Chambre 214, 230<br />
14 1" .<br />
.<br />
Chambre 338<br />
15 1 Chambre 281<br />
17 Cass. (Crim.) 329<br />
21 Cass. (Civ.) 337<br />
21 Trib. civil de Constantine. 132<br />
22 1 Chambre 246<br />
Juin 1878<br />
3 Appels musulmans 380<br />
7 Trib. de paix de Blidah. . . 187<br />
20 Appels corr 215<br />
22 Cass. (Crim.) 210, 331<br />
24 lr° Chambre 343<br />
24 Appels musulmans 378<br />
25 1 Chambre 333<br />
26 Cass. (Req.) 226<br />
Juillet 1878<br />
1 Cass. (Civ.) 369<br />
1 Appels musulmans.... 216<br />
5 Trib. corr. de Mostaganem. . 239<br />
9 Cass. (Req.) 385<br />
15 Trib. civil d'Alger (2m°Ch.). 364<br />
25 2»° Chambre 233<br />
Août 1878<br />
7 Cass. (Civ.) 353<br />
23 Trib. de paix de Blidah. . . 268<br />
29 Cass. (Crim.) 370<br />
Octobre 1878<br />
15 Trib. civil de Constantine. .<br />
Novembre 1878<br />
350<br />
5 Trib. civil de Constantine . . 381<br />
11 Appels musulmans 396
- 12 -<br />
TABLE DES NOMS DES PARTIES<br />
A<br />
Pages<br />
Abdelkader bou Hanoun 331<br />
Abraham ben Saïd (veuve)<br />
Administration des Douanes c. Cio Valéry<br />
138<br />
Agius c. Ben Cheickh 153<br />
et Mardochée ben Saïd c. Mohamed ben Hamada. 33<br />
Ahmed ben Ali ben Yklefc. Abdelkader ben Mohamed 28<br />
Ahmed ben Bou Daho c. Mohamed ben Bou Aziz 43<br />
Alberge et Jauffret c. Castillon et Mainvielle 376<br />
Amar (époux)<br />
et Abou c. Nathan Stora<br />
•<br />
. . . . 36<br />
Amina et Fathma c. Cheickh Mohamed ben el Hadj Merouan 27<br />
Amina bent Abdallah c. Mohamed ben Aouda 361<br />
B<br />
Badaroux et autres c. Gouverneur général de l'Algérie 277<br />
Barbaroux et de Marqué c. Couput 34<br />
Bastien c. Chazot et Gojosso 30<br />
Ben Chimol c. Sidi Laribi 337<br />
Ben Souna (les enfants) c. El Hadj Mamar ben Djelloul 44<br />
Ben Youssef ben Ikhlef c. Ezzeghouani 90<br />
Ben Zagoutha c. de Buros 246<br />
Beylec. Destremp, Curci, Durand et Axiak. , 221<br />
Bonnemain 97<br />
Bourdon c. Rochefort •<br />
56<br />
Bourlier c. Leroux 236<br />
Bourut c. Abadie et Mesrine 225<br />
Boutemaille c. de Malglaive 205<br />
Bruat (veuve)<br />
Burgay<br />
c. consorts Fabre 278<br />
c. Moutte et Girard 193<br />
Bussidan (syndic)<br />
Calcuty<br />
c. Coll 165<br />
C<br />
c. veuve Ramond 287<br />
Campillo c. Sarda et Cano 218<br />
Canac c. Bonnemain ; 268<br />
Carcagno c. Dames Trinitaires 117<br />
Cardona c. Hunout et commune d'Alger 257<br />
Caries c Commune de Constantine 242<br />
Carrère c. Denot<br />
'<br />
Carruana c. Bonici 152<br />
Carrus frères c. Tillier, syndic Valensi 55<br />
350
- 13<br />
—<br />
Pages.<br />
Castillon. c- Lenoir 248<br />
Chantoub Akiba c. Narboni et Borge 77<br />
Charbonneau (veuve)<br />
c. Martres 115<br />
Chazot et Gojosso c. Bastien 210<br />
Compagnie de l'Est Algérien c. Robert 194<br />
Compagnie des chemins de fer P. -L. -M. c. Hubert de Sainte Croix. ... 18<br />
Cohen Scali c. consorts Cohen et autres 355<br />
Contributions diverses c. Cerdan et Gomez 109<br />
Coste et C'e c. époux Benoît 107<br />
Costesèque (héritiers) c. C>8 des chemins de fer P.-L. M 100<br />
Crouzat c, Sinègre 230<br />
D<br />
Daouia c. Ahmed ben Saïd 378<br />
Darnospil c. l'État 209<br />
De Marqué c. Lallemand 119<br />
Desvoisins c. Getten et consorts : 37<br />
Devaux (demoiselle)<br />
c. Ali ben Bahamed 211<br />
Dibos c. consorts-Deynat 333<br />
Dodin (consorts)<br />
Durand (dame, veuve)<br />
c. consorts Wœhrel 105<br />
c. Commune d'Alger 241<br />
E<br />
Ettoumi ben Mohamed et autres 146<br />
F<br />
Famin c. veuve Rémy<br />
169<br />
Fathma bent Mustapha c. Cherif ben Mohamed 380<br />
Ferveur c. Gallo 369<br />
G<br />
Gadot (veuve) et Lapeyre c. Daniel et autres 285<br />
Gérard, Arrazat et consorts c. Hernandez 6<br />
Grange 329<br />
H<br />
Habib (El) Ould Cadi 353<br />
Habib ben Zergoug<br />
99<br />
Hadj Ahmed ben Kaddour : 113<br />
Halima bent Osman Bey c. consorts Osman Bey<br />
60<br />
Hamda bent Amara c. Oum Hani bent Zerrouk 202<br />
Hamidou ben Mohamed c. Ahmed ben Mohamed ben el Zouaoui.. . ... 81<br />
HamoudouAli c. Saïd ben Amara 359<br />
Hamouda ben Cheickh el Islam c. Bou Beker El Lefegoun 163<br />
Hasnaoui ben Ramdam c. Abed ben Belkassem et consorts 39
- 14<br />
Haziza frères c. Jacob bou Aziz et Coefner syndic Bou AzizJ.<br />
Housset c. Ferrary<br />
Housset c .<br />
consorts Mestre<br />
Ismaëlben Cherif c. Ville de Constantine<br />
Jeantel c. Ahmetl ben Brahim, Mounic et Dournon<br />
Joly,<br />
curateur aux Successions vacantes<br />
Jouve c. Debard.<br />
Judas Aboab .<br />
Jumel de Noireterre c. Compagnie de Mokta el Haddid<br />
I<br />
J<br />
K<br />
Kheira bent Mohamed c. Ahmed ben Mohamed<br />
Khelil ben Turki c. le Beït el Mal<br />
L... (Veuve)<br />
Lakhdar ben Rahal c. M'ahmed ben Kouider<br />
c. A. D<br />
Lambert c. Commune de Blidah<br />
Legey<br />
c. Benêt<br />
Marais c. Bizot.<br />
Marquand et Cie c. Salgé et Giron<br />
Meihoffer c. Ventre<br />
M<br />
Pages.<br />
. 233<br />
.<br />
.<br />
75<br />
357<br />
129<br />
258<br />
53<br />
111<br />
254<br />
1<br />
235<br />
267<br />
487<br />
42<br />
'132<br />
' "**<br />
Menouillard ■ "<br />
Merzouga c. Bernard et autres<br />
Messine. Mantout, Demolins et Roussel<br />
184<br />
Mayer et<br />
Cie 230<br />
Mestre c. Dreyfus,<br />
Michel c. Dame Michel<br />
Ministère public c Aguillon<br />
Id. c. Judas 78<br />
Mimi bent Ali c. Nefissa. . . r 363<br />
Mohamed ben Abdelkerim c. Ahmed ben Charral 266<br />
Mohamed ben Ahmed 370<br />
Mohamed ben Ahmed Zenagui c. El-Hadj Ahmed ben Djafar 21g<br />
Mohamed ben Aouda c. Larbi ben Kouacb 203<br />
Mohamed ben Haffaf.<br />
Mohamed ben Hamadouch et consorts 4-71<br />
Mohamed bel Kassem c. Rrir ben Hassen 231<br />
Mohamed ben Merbach (Veuve) c. Mohamed ben Achour 233<br />
Mohamed El -Arbi c. Amar Mabrouck 360<br />
*"<br />
374<br />
214<br />
68<br />
73<br />
239<br />
227
- 15<br />
—<br />
Mohamed Sadoun c. Amar ou El-Hadj Haddduch 173<br />
Moïse ben Addi c. Gally Lelouch<br />
o<br />
Ouled Amrane c. Ouled Ziad et l'État 387<br />
p<br />
Pardiès c. Campillo 149<br />
Partouche c. Lascar 38<br />
Perron c. Perron<br />
Petitjean c. Blain et Herriot 381<br />
Pontus de Montlouis c. Aillaud et Cio 17<br />
Préfet d'Alger c . Cervera 279<br />
Id. c. Djelloul ben Moussa et Consorts 178<br />
Id. c. Fayolles et Caillol t.<br />
'<br />
v<br />
364<br />
20<br />
. . 102<br />
Id. c. Goussem, Nefissa et Mimi 396<br />
Procureur générale. Battandier 250<br />
Id. c. Bel Hassen. .<br />
, 154<br />
Id. c. Benjamin Attal 262<br />
Id. c. Compagnie des Chemins de .fer de Bône à Guelma. .<br />
120<br />
Id. c. Fulgoux 13<br />
Id. c. Grange 170<br />
Id. c. El-Hadj Ali ben Tabet 22<br />
Id. c. Lakhdar Ould M'ahmed 180<br />
Id. c. Lécuyer 265<br />
Id. c. Mesrine 346<br />
Id. c. Mohamed ben Diban 155<br />
Id. c. Mohamed ben Haffaf et consorts . . 124<br />
Id. c. Mohamed ben Messaoud et Mohamed ben El-Har. . . 25<br />
Id. c. Mohamed ben Mohamed 344<br />
Id. c. Mohamed ou Ramdan Saïd 109<br />
Id. c. Si Sliman Ould Mohamed 24<br />
Id. c. Tahar ben Abderrhaman 215<br />
Id. c. Témime 264<br />
Puccini c. Compagnie Valéry<br />
Raynard,<br />
Ricci<br />
R<br />
syndic Leclerc c. Chiche et autres 83<br />
Ricci c. Préfet d'Alger<br />
Richemont c. Défasques et Mérel 198<br />
Rivière (époux) c. Mahieu et autres. . 161<br />
Robert c. Vinot, syndic Toullier<br />
338<br />
Rolland (héritiers) c. veuve Rolland 372<br />
Rossi c. Schiltz et Velay<br />
63<br />
226<br />
98<br />
52
'<br />
Saïd ou Aomar c. Dellinger.<br />
- 16<br />
Sakar Giiedj c. Mustapha ben Ahmed 282<br />
.<br />
Sartor<br />
•<br />
-<br />
S<br />
.<br />
Pages.<br />
Scely c. Warot ■ • 135<br />
Sebaoun ben Amour c. Amar ben Aïssa<br />
177<br />
Seyman frères c. Pizzorno et dame Millière<br />
Tahar ben Aïech<br />
T<br />
•<br />
127<br />
243<br />
182<br />
. . . . 130<br />
Tassadit bent Bouzazous c. El Hadj Ahmed ben Zerrouk 137<br />
Tholance c. de Junnemann<br />
Tocqueville (de) c. Le Roy<br />
Vitalis<br />
Zohra bent Youssef c. Youssef et autres<br />
Doctrine. —<br />
V<br />
z<br />
Législation<br />
Du renvoi devant une nouvelle Cour d'assises après cassation 65<br />
Étude sur les art. 67, 69"<br />
et 463 actuels combinésadu Code Pénal 273<br />
Les lois, décrets et arrêtés relatifs à l'Algérie, d'octobre 1877 à octobre 1878. 289<br />
Nominations et Mutations<br />
Pages 14, 45, 95, 112, 128, 143, 160, 174, 190, 207, 222, 255, 272,<br />
336, 352, 366, 383, 400<br />
Décisions diverses<br />
Pages 15, 32, 47, 112, 176, 191, 208, 223, 240, 256, 288, 368, 384, 400<br />
ERRATA, 256<br />
A t ,r. F, c><br />
Alger. — Typographie A. JOURDAN.<br />
N<br />
y<br />
343<br />
61<br />
145<br />
253
%;***#<br />
>*•*« »,^<br />
*->M<br />
4 '