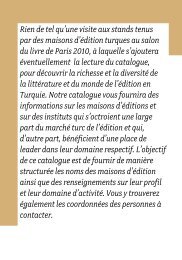Esquisse de 2000 ans d'Histoire de la Turquie - Books From Turkey
Esquisse de 2000 ans d'Histoire de la Turquie - Books From Turkey
Esquisse de 2000 ans d'Histoire de la Turquie - Books From Turkey
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong><br />
<strong>ans</strong> d’Histoire<br />
d e l a Tu r q u i e<br />
Par<br />
Süleyman SEYDİ<br />
EDITIONS DU MINISTERE DE LA CULTURE<br />
ET DU TOURISME DE LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
© Direction Générale <strong>de</strong>s Librairies et <strong>de</strong>s Editions du Ministère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture et du Tourisme <strong>de</strong> <strong>la</strong> République Turque.<br />
3253<br />
Collections <strong>de</strong>s Manuels<br />
11<br />
ISBN: 978-975-17-3475-4<br />
www.kulturturizm.gov.tr<br />
e-mail: yayim<strong>la</strong>r@kulturturizm.gov.tr<br />
Seydi, Süleyman<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>/Süleyman Seydi.<br />
1erè Edition-Ankara:<br />
168 p.; 20 cm.- (Editions du Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture et du Tourisme; 3253.<br />
Direction Générale <strong>de</strong>s librairies et <strong>de</strong>s Editions Collection <strong>de</strong>s manuels;11)<br />
ISBN: 978-975-17-3475-4<br />
I. Titre. II. Séries.<br />
956.1<br />
Photo <strong>de</strong> couverture:<br />
Collection du Musée du Pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> Topkapı. Istanbul / <strong>Turquie</strong><br />
Traduction en Français<br />
Berna Tunalı - Nadia Temimi - Sandrine Belikırık<br />
Imprimé par<br />
Grafiker Ltd. Şti.<br />
www.grafiker.com.tr<br />
Nombre <strong>de</strong> Tirages: 3000<br />
Imprimé a Ankara en 2010
Table <strong>de</strong>s Matières<br />
Introduction ............................................................................7<br />
I Les anciens Etats turcs d’Asie ....................................................11<br />
1. L’Empire <strong>de</strong>s Huns.....................................................................11<br />
2. Les Göktürks .............................................................................14<br />
3. Les Ouïghours ...........................................................................18<br />
4. Les Turgishs ...............................................................................20<br />
5. Les Kirghizes .............................................................................21<br />
6. Les Karlouks ..............................................................................21<br />
7. Les Oghouzes ............................................................................22<br />
II Les tribus et Etats turcs <strong>de</strong> l’Europe<br />
<strong>de</strong> l’est à l’époque médiévale ...........................................................23<br />
1. Les Huns <strong>de</strong> l’Ouest ...................................................................23<br />
2. Le Khanat Avar ..........................................................................27<br />
3. Les Sabars ..................................................................................27<br />
4. Le Khanat Khazar .....................................................................28<br />
5. Les Petchenègues .......................................................................28<br />
6. Le Khanat <strong>de</strong> Kiptchak ..............................................................29<br />
7. Les Oghours et les Etats bulgares ...............................................29<br />
III Les premiers Etats musulm<strong>ans</strong> Turcs ......................................32<br />
1. Le Khanat Karakhani<strong>de</strong> (840 - 1212) .........................................33<br />
2. L’Empire ghaznévi<strong>de</strong> (963 - 1187) .............................................35<br />
IV Le Grand Empire seldjouki<strong>de</strong> ..................................................38<br />
V Les Etats turcs en Egypte et en Syrie ........................................45<br />
1. Les Toulouni<strong>de</strong>s (868 - 905) .......................................................45<br />
2. Les Ikhchidi<strong>de</strong>s (935 - 969) ........................................................46<br />
3. Les Ayyoubi<strong>de</strong>s (1171 - 1252) .....................................................46<br />
4. Les Mamelouks (l’Etat <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong>) .............................................47<br />
VI L’Etat seldjouki<strong>de</strong> (turc) d’Anatolie .........................................50<br />
VII Les Etats turcs en In<strong>de</strong> ............................................................58<br />
1. Le sultanat turc <strong>de</strong> Delhi .............................................................58<br />
2. L’Empire <strong>de</strong> Bâbur (1526 - 1858) ................................................60<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
3
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
4<br />
VIII Les Khanats turcs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région<br />
Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire .....................................................................62<br />
1. L’Etat <strong>de</strong> La Hor<strong>de</strong> d’Or (Altınordu) .........................................62<br />
2. Le Khanat <strong>de</strong> Kazan ...................................................................62<br />
3. Le Khanat <strong>de</strong> Crimée .................................................................63<br />
4. Le Khanat d’Astrakhan ..............................................................64<br />
5. Le Khanat <strong>de</strong> Kasim (1445 - 1681) ............................................65<br />
6. Le Khanat <strong>de</strong> Sibir .....................................................................65<br />
7. Le Khanat <strong>de</strong> Nogaï ...................................................................65<br />
IX Les Etats turcs fondés en Anatolie et en Perse .........................66<br />
1. La dynastie timouri<strong>de</strong> .................................................................66<br />
2. La dynastie <strong>de</strong>s Ak koynulu (Aq Qoyunlu) .................................67<br />
3. La dynastie <strong>de</strong>s kara Koyunlu (Qara Qoyunlu) ...........................68<br />
4. La dynastie safavi<strong>de</strong> ....................................................................68<br />
X L’Empire Ottoman (1299 - 1922) ...............................................70<br />
A. L’âge c<strong>la</strong>ssique (1299 - 1600) .....................................................70<br />
B. Les crises et les consolidations (1600 - 1774) .............................89<br />
C. Le déclin (1774 - 1914) .............................................................98<br />
D. La dissolution (1914 - 1922) ................................................... 114<br />
XI La guerre d’indépendance turque (1919 - 1923) ..................... 124<br />
XII La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque .................................. 137<br />
A. L’ère Atatürk (1923 - 1938): Les réformes <strong>de</strong> base d’Atatürk .... 137<br />
B. L’ère d’İnönü (1938 - 1950) ...................................................... 145<br />
C. La politique étrangère turque pendant <strong>la</strong> Guerre froi<strong>de</strong> ............ 154<br />
Bibliographie et autres lectures ................................................... 161<br />
Annexe<br />
L’arbre généalogique <strong>de</strong> Seldjouk<br />
La liste <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> seldjouki<strong>de</strong>s d’Anatolie<br />
La liste <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong><br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque
Note<br />
Le turc mo<strong>de</strong>rne fait usage <strong>de</strong> l’alphabet <strong>la</strong>tin, modifié <strong>de</strong> façon à ce qu’il y ait<br />
une lettre séparée pour chaque son principal. L’orthographe reste principalement<br />
phonétique. Les consonnes ont plus ou moins le même son qu’en français à<br />
l’exception <strong>de</strong> :<br />
« ç » qui se prononce « tch » en français<br />
« c » qui se prononce « dj » en français<br />
« ş » qui se prononce « ch » en français<br />
« ğ » (le g doux) dont <strong>la</strong> prononciation dépend <strong>de</strong>s lettres qui l’entourent. Il peut<br />
être pratiquement muet, allonger <strong>la</strong> voyelle qui le précè<strong>de</strong>, ou être prononcé<br />
comme un « r » doux.<br />
« h » est marqué d<strong>ans</strong> sa prononciation comme en ang<strong>la</strong>is<br />
En ce qui concerne les voyelles :<br />
« ı » est une voyelle qui n’existe pas en français et qui se prononce comme un<br />
« eu » retenu.<br />
« ö » est une voyelle que l’on prononce « eu » <strong>de</strong> manière franche.<br />
« ü » se prononce « u » en français<br />
« u » lui se prononce « ou » en français.<br />
« e » se prononce « é »<br />
« y » se prononce « yé »<br />
Le « x » et le « w » n’existent pas d<strong>ans</strong> l’alphabet turc qui comprend au total 29<br />
lettres<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
5
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
6
Introduction<br />
Les Turcs ont joué un rôle crucial d<strong>ans</strong> l’Histoire. Durant les milliers<br />
d’années <strong>de</strong> leur Histoire, les Turcs ont fondé plus d’une centaine <strong>de</strong><br />
petits ou grands Etats sur les continents d’Asie, d’Europe et d’Afrique.<br />
L’un <strong>de</strong>s Etats les plus importants établis par les Turcs au début <strong>de</strong> leur<br />
Histoire a été le grand Empire <strong>de</strong>s Huns. Le grand Empire seldjouki<strong>de</strong><br />
et l’Empire ottoman sont d’autres grands Etats turcs fondés pendant<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique. L’Empire ottoman, en son temps, a réussi à créer<br />
une atmosphère <strong>de</strong> paix sur trois continents, s’étendant sur plus <strong>de</strong><br />
20 millions <strong>de</strong> kilomètres carré, sur une pério<strong>de</strong> d’environ 4 siècles<br />
avec <strong>de</strong>s gens <strong>de</strong> religions et d’origines ethniques différentes. Ces<br />
caractéristiques <strong>de</strong> l’Empire ottoman en font une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s<br />
et <strong>de</strong>s plus puissantes formations politiques jamais connues d<strong>ans</strong><br />
l’Histoire, comparable aux Empires romain et ang<strong>la</strong>is. Bien qu’ils aient<br />
formé le seul grand Etat is<strong>la</strong>mique du mon<strong>de</strong> au début du vingtième<br />
siècle, les Turcs ottom<strong>ans</strong> sont restés en retrait du mon<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne<br />
contemporain qui lui, s’éveil<strong>la</strong>it à l’Ouest. C’était également vrai pour le<br />
mon<strong>de</strong> turc en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s frontières <strong>de</strong> l’Empire ottoman.<br />
Les hommes d’Etat et les intellectuels ottom<strong>ans</strong> ont entamé<br />
un processus <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation au 18ème siècle afin d’éviter <strong>de</strong>s<br />
positions délicates. La mo<strong>de</strong>rnisation s’est faite parallèlement à <strong>la</strong><br />
prise d’importance <strong>de</strong> valeurs telles que le sécu<strong>la</strong>risme, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ïcité et le<br />
nationalisme qui sont venus mo<strong>de</strong>ler <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> mo<strong>de</strong>rne. La Première<br />
Guerre mondiale a marqué un tournant d<strong>ans</strong> l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
puisque les Turcs ont perdu une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> leur territoire. Après <strong>la</strong><br />
guerre, leur territoire sur <strong>la</strong> péninsule anatolienne a été occupée par <strong>de</strong>s<br />
troupes grecques soutenues par l’Ouest. Cependant, grâce à <strong>la</strong> présence<br />
charismatique <strong>de</strong> Mustafa Kemal Atatürk, les Turcs d’Anatolie se sont<br />
battus pour conserver l’indépendance <strong>de</strong> leur territoire d<strong>ans</strong> les régions<br />
d’Anatolie sur lequel ils avaient vécu un millier d’années et fondé <strong>la</strong><br />
République Turque en tant qu’Etat-nation. Faisant suite à un ensemble<br />
<strong>de</strong> réformes, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> a frappé aux portes <strong>de</strong> l’Union européenne, se<br />
présentant comme le seul Etat démocratique et sécu<strong>la</strong>ire du mon<strong>de</strong><br />
is<strong>la</strong>mique.<br />
Le concept <strong>de</strong> « turc » ne fait pas seulement référence aux personnes<br />
vivant d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> République mo<strong>de</strong>rne turque mais aussi à ceux ayant <strong>de</strong>s<br />
liens avec <strong>la</strong> culture turque et vivant en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, soit d<strong>ans</strong><br />
les états indépendants ou en tant que sujets d’autres nations. L’Histoire<br />
du mon<strong>de</strong> nous montre que <strong>de</strong>s personnes ayant parlé <strong>de</strong>s variantes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue turque ont porté le nom <strong>de</strong> Hun, Tabghatch, Ouïghour,<br />
Seldjouki<strong>de</strong>, Ottoman, Tatar, Kirghize, Ouzbek, Türkmen, Yakut,<br />
Chuvash et Pomak. Les Turcs, durant leur Histoire, n’ont jamais été<br />
réunis sous un même drapeau ni réunis au sein d’une même entité<br />
politique. Il en fut ainsi à l’Epoque <strong>de</strong>s Turcs <strong>de</strong> l’Histoire ancienne <strong>de</strong>s<br />
steppes <strong>de</strong> même qu’à l’époque <strong>de</strong>s Empires hun, göktürk et ottoman.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
7
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
8<br />
C’est toujours le cas aujourd’hui si nous considérons <strong>la</strong> République<br />
turque et les Turcs vivant hors <strong>de</strong> ses frontières.<br />
Il est d’usage <strong>de</strong> penser que le terme « turc » fait référence à une entité<br />
politique plutôt qu’à une i<strong>de</strong>ntité ethnique. Après <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’Etat<br />
göktürk, le terme « turc » a tout d’abord été utilisé en tant que nom <strong>de</strong><br />
cet Etat, puis en tant que nom désignant les tribus noma<strong>de</strong>s turques<br />
sujets <strong>de</strong>s Göktürks. Au fil du temps, « turc » a été utilisé pour désigner<br />
toute société ayant un lien avec <strong>de</strong>s groupes turcs. Aujourd’hui, une<br />
distinction subsiste entre le terme « turc » et « turki » (Turkic). « turc »<br />
fait référence aux personnes vivant d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> République mo<strong>de</strong>rne turque<br />
et « turki » désigne toute personne turque vivant sur le territoire turc<br />
ou à l’extérieur. Cette division entre les personnes vivant sur le sol turc<br />
est un héritage <strong>de</strong>s impérialistes russes du 19e siècle qui avaient <strong>de</strong>s<br />
raisons politiques particulières <strong>de</strong> différencier les Turcs <strong>de</strong> Russie et<br />
ceux <strong>de</strong> l’Empire ottoman. Cette différenciation a persisté durant <strong>la</strong><br />
pério<strong>de</strong> soviétique <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et est <strong>de</strong>venue encore plus<br />
importante d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fédération russe post-soviétique. On<br />
pourrait prétendre que cette distinction est inévitable pour distinguer<br />
les Turcs vivant sur le sol turc <strong>de</strong>s autres. Cependant, ce<strong>la</strong> ne change en<br />
rien le fait que le terme ‘’turc’’ est attribué à toute personne turque s<strong>ans</strong><br />
considération <strong>de</strong> son lieu d’habitation. Le mon<strong>de</strong> turc actuel comprend<br />
une <strong>la</strong>rge ceinture <strong>de</strong> territoires s’étendant en Asie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée<br />
<strong>de</strong> l’Est à <strong>la</strong> Mongolie, le bassin <strong>de</strong> <strong>la</strong> moyenne Volga à <strong>la</strong> frontière<br />
sibérienne du kazakistan. Sur ce territoire, on compte six Etats turcs<br />
indépendants <strong>de</strong> <strong>la</strong> République mo<strong>de</strong>rne turque :<br />
L’Azerbaïdjan, le Kazakistan, <strong>la</strong> Kirghizie, le Turkménistan,<br />
l’Ouzbékistan et <strong>la</strong> République turque <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie Nord <strong>de</strong> Chypre
(qui est reconnue seulement par <strong>la</strong> République <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong>). On compte<br />
également <strong>de</strong> nombreuses républiques autonomes comme Bashir,<br />
Chuvash, Yakut, Tatar, Kabardino-balkarie, KaraKalpak, Nakhitchevan,<br />
Touva et Xinjiang Ouighours. Il y a également <strong>de</strong>s régions turques<br />
autonomes dont <strong>la</strong> République Altaï, Karachay-Cherkessia, Khakasses,<br />
Gagaouze et Nogorno-Karabakh en Azerbaïdjan qui est passé sous<br />
l’occupation arménienne en 1991. Certains Turcs sont <strong>de</strong>s tatars <strong>de</strong><br />
Crimée, les Karaims et les Krymchaks d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Péninsule <strong>de</strong> Crimée,<br />
les Turcs <strong>de</strong> Meshetian, les Nogaïs et les Kumkys d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> République<br />
autonome du Daghestan. De plus, il y a plusieurs régions turques en<br />
Iran, en Irak, en Géorgie, en Bulgarie, en Grèce, en Macédoine, au<br />
Tadjikistan, en Afghanistan et en Mongolie <strong>de</strong> l’Ouest<br />
L’Origine <strong>de</strong>s Turcs<br />
L’origine et l’i<strong>de</strong>ntité <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque contemporaine<br />
remontent aux premiers Turcs et à leurs précurseurs d’Asie Mineure.<br />
La location exacte <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère patrie d’origine <strong>de</strong>s Turcs avant leurs<br />
migrations vers l’Ouest fait l’objet <strong>de</strong> discussions parmi les chercheurs<br />
<strong>de</strong> différents domaines : En prenant en considération les archives<br />
chinoises, les historiens considèrent les montagnes Altaï et les environs<br />
comme frontières <strong>de</strong> cette probable mère patrie. Des archéologues<br />
russes ont également leur avis sur <strong>la</strong> question et d’après eux, le<br />
prototype <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture turque se trouverait d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> culture Andronovo<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région Munisinks, au Nord-Ouest <strong>de</strong>s montagnes Altaï entre<br />
1700 et 1200 avant J.C. La culture Andronovo a émergé d’une culture<br />
Afanasyevo plus ancienne encore, datant <strong>de</strong> 2500 à 1700 avant J .C. La<br />
culture Afanasyevo se composait <strong>de</strong> <strong>la</strong> race b<strong>la</strong>nche <strong>de</strong>s brachycéphales<br />
ayant <strong>de</strong>s caractéristiques distinctes <strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>de</strong>s dolichocéphales <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Mongolie et <strong>de</strong>s Méditerranéens. Les <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>de</strong>s<br />
brachycéphales vivaient d<strong>ans</strong> les montagnes Altaï du Sud-Ouest.<br />
La première date <strong>de</strong> l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> malheureusement n’a<br />
pas été bien documentée. Cependant, les premiers Turcs connus sous<br />
le nom <strong>de</strong>s « Sakas » (Scythiques) vivaient près du Khazar et d<strong>ans</strong><br />
différentes régions <strong>de</strong> l’Asie mineure au 8e siècle avant J .C. Le nom <strong>de</strong><br />
Hsiung-nu (Xiongnu) apparaît sur d’anciennes sources chinoises (<strong>2000</strong><br />
avant J.C.) et était attribué aux gens vivant d<strong>ans</strong> les régions Ouest et<br />
Nord-Ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine. Bien qu’il y ait un débat entre chercheurs<br />
concernant l’origine <strong>de</strong>s Hsiung-nu (étaient-ils mongols ou turcs ?), le<br />
fait que le terme décrive un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> Turcs et <strong>de</strong> Mongols en plus <strong>de</strong><br />
tribus noma<strong>de</strong>s, est accepté à l’unanimité. Il est d’usage <strong>de</strong> croire que ce<br />
sont les Turcs qui ont établi et dirigé les Hsiung-nu.<br />
Les Turcs ont été obligés <strong>de</strong> quitter leur mère-patrie, le phénomène<br />
commençant en Asie Mineure, pour s’installer d<strong>ans</strong> <strong>de</strong>s endroits<br />
différents, se dép<strong>la</strong>çant principalement vers l’Ouest. Cette émigration<br />
s’est faite sur plusieurs siècles. Le manque <strong>de</strong> terres disponibles, manque<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
9
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
10<br />
occasionné par <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions croissantes, le besoin <strong>de</strong> se dép<strong>la</strong>cer<br />
avec leurs troupeaux, à ceci s’ajoutant les guerres contre <strong>de</strong>s forces<br />
étrangères ou entre eux expliquent les émigrations <strong>de</strong>s tribus turques<br />
noma<strong>de</strong>s ou semi noma<strong>de</strong>s. Ces émigrations peuvent être répertoriées<br />
en <strong>de</strong>ux : celles qui se sont effectuées d<strong>ans</strong> l’ancien temps, avant J.C. et<br />
celles plus récentes après J.C.<br />
D’après les trouvailles <strong>de</strong>s archéologues, <strong>la</strong> première gran<strong>de</strong> émigration<br />
<strong>de</strong>s Turcs s’est faite vers <strong>la</strong> portion Ouest <strong>de</strong> l’actuelle Chine et du<br />
Turkestan au début <strong>de</strong> <strong>2000</strong> avant J.C. Avant cette émigration, les<br />
Turcs s’étaient déjà installés d<strong>ans</strong> les montagnes <strong>de</strong> l’Altaï, celles <strong>de</strong><br />
Tien Shan (Les montagnes célestes, Tangri Tagh en <strong>la</strong>ngue ouighours),<br />
au Kazakhstan et en Harezm (Sud <strong>de</strong> Khawarizmi). Une autre gran<strong>de</strong><br />
émigration vers l’Ouest s’est effectuée durant les siècles suivants lors <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> chute du Premier Empire turc d’Asie centrale : L’Empire <strong>de</strong>s Huns<br />
d’Asie.<br />
Si nous observons <strong>la</strong> trajectoire historique suivie par les Turcs,<br />
considérant un point <strong>de</strong> départ au niveau historique, nous voyons non<br />
une seule route menant vers l’Ouest mais plusieurs routes partant <strong>de</strong><br />
l’intérieur <strong>de</strong> l’Asie <strong>de</strong> l’Est, se croisant sur leur chemin et se terminant<br />
à <strong>de</strong>s points différents en Eurasie et d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> entier. Certaines<br />
Tribus turques ont émigré en Europe <strong>de</strong> l’Est et d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>,<br />
passant par les terres au Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire où elles ont établi <strong>de</strong>s<br />
Etats puissants tels que celui <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong>s Huns <strong>de</strong> l’Ouest, l’Etat<br />
<strong>de</strong>s Avars et <strong>la</strong> Bulgarie. Ces Etats turcs ont fait pression sur les parties<br />
Est et Ouest <strong>de</strong> l’Empire Romain. D’autres tribus turques, comme<br />
celle <strong>de</strong>s Petchenègues et <strong>de</strong>s Kiptchaks se sont arrêtées et installées<br />
sur les terres au Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire alors qu’elles al<strong>la</strong>ient vers<br />
l’Ouest. Un autre groupe <strong>de</strong> tribus turques, les Ghaznévi<strong>de</strong>s, se sont<br />
dirigés vers l’Asie du Sud-Ouest. De nombreuses tribus sont restées en<br />
Asie centrale. D’autres, particulièrement les Oghouzes, sont allées en<br />
Anatolie et ont fondé <strong>de</strong> grands Etats, notamment l’Etat Seldjouki<strong>de</strong> et<br />
l’Etat Ottoman qui ont joué <strong>de</strong> grands rôles d<strong>ans</strong> l’Histoire du Mon<strong>de</strong>.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce livre est d’offrir une introduction à l’ensemble <strong>de</strong><br />
l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en étudiant certains <strong>de</strong> ses aspects les plus<br />
importants <strong>de</strong>s temps reculés à nos jours. Ce livre étant <strong>de</strong>stiné à tout<br />
le mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s notes <strong>de</strong> bas <strong>de</strong> pages ou <strong>de</strong> fin n’ont pas été utilisées d<strong>ans</strong><br />
le texte mais une bibliographie ainsi que <strong>de</strong>s suggestions <strong>de</strong> lectures<br />
complémentaires se trouvent à <strong>la</strong> fin du livre.
CHAPITRE 1<br />
Les anciens Etats turcs d’Asie<br />
1. L’empire <strong>de</strong>s Huns<br />
Bien que le premier Etat turc ayant <strong>la</strong>issé <strong>de</strong>s traces d<strong>ans</strong> l’Histoire soit<br />
celui <strong>de</strong>s Huns d’Asie au troisième siècle avant J.C., il est fortement<br />
probable que <strong>de</strong> nombreux siècles avant, <strong>de</strong>s Turcs aient émigré <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
région <strong>de</strong> l’Altaï, d’abord vers l’Est, puis vers le sud et vers l’Ouest. Ces<br />
émigrations peuvent être expliquées par plusieurs raisons : Les Sakas<br />
(Scythiques) composés principalement <strong>de</strong> tribus turques, s’étaient<br />
installés sur <strong>de</strong>s terres entre <strong>la</strong> rivière Dniepr et Dinitré, au sixième et<br />
quatrième siècle avant J.C. Le <strong>de</strong>uxième Etat turc plus ancien et un peu<br />
plus connu est celui <strong>de</strong>s Hsiung-nu.<br />
L’Etat Hsiung-nu est particulièrement important parce qu’il a fondé<br />
le premier empire d<strong>ans</strong> les Steppes. Les académiciens s’accor<strong>de</strong>nt à<br />
dire qu’il s’agit du premier Etat organisé, établi par les Turcs en Asie<br />
centrale. Les Hsiung-nu sont appelés les Huns par les historiens après<br />
leur unification avec les Huns d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du quatrième<br />
siècle avant J.C. Le premier document <strong>de</strong> leur histoire date <strong>de</strong> 318<br />
Av. J.C. avec <strong>la</strong> trouvaille d’un compte rendu chinois <strong>de</strong> leur accord<br />
avec les Huns. Le premier dirigeant connu aujourd’hui <strong>de</strong>s Huns était<br />
Tuman (Teoman). Son successeur a été Mete Khan (Mao-tun) (209-<br />
174 avant J.C) sous le règne duquel, les Huns ont développé une armée<br />
exceptionnelle.<br />
Mete Khan, le dirigeant le plus capable et le plus charismatique <strong>de</strong>s<br />
Huns, a commencé une série <strong>de</strong> conquêtes. Les Huns ont rapi<strong>de</strong>ment<br />
atteint l’apogée <strong>de</strong> leur puissance et <strong>de</strong> leur taille sous le règne <strong>de</strong> Mete<br />
Khan. Ils conquirent le Tibet, les Tunguzs, les Yuechis et d’autres tribus.<br />
Mete Khan s’est ensuite tourné vers <strong>la</strong> Chine pour <strong>la</strong> combattre en tant<br />
qu’ennemie <strong>de</strong> <strong>la</strong> nation. La Chine avait été capable, jusqu’alors, <strong>de</strong> faire<br />
face aux attaques <strong>de</strong>s tribus <strong>de</strong>s Steppes sur leur territoire s<strong>ans</strong> gran<strong>de</strong><br />
difficulté. Cependant, elle n’arrivait plus à protéger ses frontières <strong>de</strong><br />
manière efficace après l’unification <strong>de</strong>s Huns sous le règne <strong>de</strong> Mete<br />
Khan. Ayant vaincu l’armée chinoise, Mete signa un accord profitable<br />
avec <strong>la</strong> Chine d<strong>ans</strong> lequel les Huns prenaient possession d’une partie<br />
conséquente du territoire chinois. La Chine <strong>de</strong>vait également payer un<br />
tribut aux Huns. Durant les années suivantes, les Huns maintinrent<br />
une pression constante sur l’Empire chinois. Durant <strong>la</strong> longue guerre<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
11
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
12<br />
contre les Huns, <strong>de</strong>s dynasties successives chinoises ont construit<br />
plusieurs murs qui, ensemble, constituent aujourd’hui <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Muraille <strong>de</strong> Chine : Une fortification militaire <strong>de</strong> 1 845 kilomètres<br />
<strong>de</strong>stinée à protéger les frontières Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine contre les Huns.<br />
Par ailleurs, lorsque l’Empire chinois retrouva un certain pouvoir, <strong>la</strong><br />
Gran<strong>de</strong> Muraille servit aussi <strong>de</strong> tremplin pour les conquêtes chinoises<br />
vers le Nord.<br />
Quand Mete Khan mourut en 174 Avant J.C., l’Empire <strong>de</strong>s Huns<br />
était à son apogée. Les Huns avait fait passer vingt-six tribus sous<br />
leur autorité, dont les Chinois, les Mongols et les Tunguz sur un vaste<br />
territoire s’étendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Manchourie au <strong>la</strong>c Aral, et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sibérie <strong>de</strong><br />
l’Ouest au désert <strong>de</strong> Gobi. Kiok, le fils <strong>de</strong> Mete essaya <strong>de</strong> renforcer<br />
<strong>la</strong> puissance <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong>s Huns durant son règne (174-160 Avant<br />
J.C.). D’abord il força les Yuechis à l’exil et ensuite, il envahit <strong>la</strong> Chine,<br />
détruisant le pa<strong>la</strong>is impérial près <strong>de</strong> Chang-an en l’incendiant. Pendant<br />
cette campagne, Kiok prit pour épouse une princesse chinoise afin<br />
d’améliorer les re<strong>la</strong>tions commerciales avec <strong>la</strong> Chine. D’après les sources<br />
turques, c’était un mariage politique avec d’importantes répercussions<br />
pour les Huns. Grâce à ce mariage, les diplomates et autorités chinois<br />
ont gagné le droit <strong>de</strong> se dép<strong>la</strong>cer librement d<strong>ans</strong> le pa<strong>la</strong>is impérial et sur<br />
le territoire, tous <strong>de</strong>ux contrôlés par les Huns. Les diplomates chinois<br />
ont donné naissance à <strong>de</strong>s discor<strong>de</strong>s à l’intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s<br />
Huns et parmi les tribus vassales, en attisant une propagan<strong>de</strong> contre<br />
les Huns. Les effets inverses du mariage avec <strong>la</strong> princesse chinoise ne<br />
se firent pas sentir durant le règne <strong>de</strong> Kiok mais durant celui <strong>de</strong> son<br />
fils : Kun-chin (160-126) avant J.C. Durant le règne <strong>de</strong> Kun-Chin, <strong>la</strong><br />
dynastie chinoise Han consolida son pouvoir politique et renforça son<br />
armée en suivant l’exemple du modèle <strong>de</strong> l’armée Hun observée par les<br />
espions chinois à l’intérieur du pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong>s Huns. La dynastie <strong>de</strong>s H<strong>ans</strong><br />
entama un programme rigoureux d’élevage <strong>de</strong> chevaux et <strong>de</strong> formation<br />
d’une cavalerie comme celle <strong>de</strong>s Huns.<br />
L’un <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine était <strong>de</strong> trouver <strong>de</strong> nouveaux marchés<br />
à l’Ouest pour sa précieuse soie. Elle <strong>de</strong>vait donc assurer un passage<br />
pour <strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie qui mènerait à <strong>la</strong> Mer Méditerranée en passant<br />
pas l’Asie intérieure et <strong>la</strong> Perse. Vu sous cet angle, nous pouvons<br />
comprendre que le conflit entre <strong>la</strong> Chine et les Huns était avant tout<br />
motivé par le désir <strong>de</strong> vouloir contrôler <strong>la</strong> profitable route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie.<br />
Après 120 avant J.C., les Chinois ont réussi à retenir les attaques <strong>de</strong>s<br />
Huns au Nord et aussi à s’approprier <strong>de</strong>s territoires bordant <strong>la</strong> route <strong>de</strong>
<strong>la</strong> soie en Asie intérieure. Les Chinois ont également arrêté <strong>de</strong> payer<br />
un tribut aux Huns. Finalement, les Chinois ont pris comme objectif<br />
non plus seulement <strong>de</strong> vaincre les Huns mais <strong>de</strong> les détruire. En<br />
110 avant J.C., les Huns ont été repoussés au <strong>de</strong>là du désert <strong>de</strong> Gobi<br />
d<strong>ans</strong> les steppes du Nord et les zones forestières. Les choses avaient<br />
radicalement changé pour les Huns. Les revenus <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong>s<br />
Huns étaient à présent diminués du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin du tribut payé par les<br />
Chinois et <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> leurs régions les plus fertiles.<br />
En 60 avant J.C., une série <strong>de</strong> guerres commença. Les Chinois<br />
<strong>de</strong>mandaient à présent <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> leur suzeraineté comme<br />
condition aux traités à venir. La pression chinoise et <strong>de</strong>s ca<strong>de</strong>aux <strong>de</strong><br />
valeurs offerts à certains membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Huns créèrent un<br />
environnement chaotique d<strong>ans</strong> le système <strong>de</strong> régence <strong>de</strong>s Huns, ce qui<br />
généra <strong>la</strong> division <strong>de</strong> l’Empire entre Ho-Han-Yeh (58-31) et son grand<br />
frère Chi-Chi. Ho-Han-Yeh était d’avis d’accepter <strong>la</strong> suzeraineté<br />
chinoise afin <strong>de</strong> sortir <strong>de</strong> l’impasse financière mais cette proposition<br />
fut rejetée par le Conseil d’Etat. Sur l’insistance <strong>de</strong> Ho-Han-Yeh, Chi-<br />
Chi quitta le pays avec ses gens et partit vers l’Ouest. Il fonda un Etat<br />
indépendant appelé l’Etat <strong>de</strong>s Huns <strong>de</strong> l’Ouest d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
rivière Shu-Ta<strong>la</strong>s en 41 avant J.C., Etat possédant une nouvelle capitale<br />
protégée par <strong>de</strong>s remparts. Ce nouvel Etat avait pour but <strong>de</strong> recréer le<br />
puissant Empire <strong>de</strong>s Huns. Cependant, cet Etat fut rapi<strong>de</strong>ment détruit<br />
en 36 Avant J.C. par soixante-dix mille troupes chinoises soutenues<br />
par les hommes <strong>de</strong> Ho-Han-Yeh. Certaines tribus <strong>de</strong>s Huns <strong>de</strong> l’Ouest<br />
furent obligées d’émigrer sur les terres situées entre le <strong>la</strong>c Aral et <strong>la</strong> Mer<br />
Caspienne.<br />
En ce qui concerne l’Etat <strong>de</strong> Ho-Han-Yeh au Nord, il regagna son<br />
indépendance envers <strong>la</strong> Chine en é<strong>la</strong>rgissant son territoire entre <strong>la</strong><br />
Manchourie et le Kachgar pendant le règne <strong>de</strong> Yu (18 avant J.C – 46<br />
après J.C).<br />
Les Huns divisèrent leur empire en un empire du Nord et un empire du<br />
Sud en 48 après J.C. Ni l’un ni l’autre n’ont réussi à s’unifier pour faire<br />
face à l’exp<strong>ans</strong>ion chinoise. Bientôt, les tribus Huns du Nord furent<br />
forcées d’émigrer vers les p<strong>la</strong>ines Aral et Khazar. Les Huns du Sud eux<br />
non plus ne purent résister à <strong>la</strong> Chine dont l’armée finalement, mit fin<br />
à <strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong>s Huns en 216. Plus tard, les Huns établirent une<br />
série <strong>de</strong> petites principautés dont les vies furent <strong>de</strong> courtes durées telles<br />
que : Hsia, Liang et Chao jusqu’à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’Etat turc Tabghatch<br />
(Tabgaç) en 315.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
13
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
14<br />
Apres avoir fondé leur Etat avec Tai comme capitale à Shanxi, les<br />
Tabghatchs s’é<strong>la</strong>rgirent rapi<strong>de</strong>ment durant le quatrième et le cinquième<br />
siècle. Tout d’abord, ils vainquirent ceux qui restaient <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong>s<br />
Huns, puis ils étendirent leur souveraineté sur <strong>de</strong>s terres chinoises. Les<br />
Tabghatchs envahirent <strong>la</strong> Mongolie intérieure après avoir vaincu Juan-<br />
Juan (Ruanruan) en 425, un autre Etat turc successeur <strong>de</strong>s Huns et<br />
appelé plus tard Avar. Ensuite ils firent <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie<br />
en capturant k<strong>ans</strong>u en 439. Le développement du bouddhisme parmi<br />
les Tabghatchs a affecté l’Etat puisque <strong>la</strong> nature paisible du bouddhisme<br />
diminuait leurs capacités militaires. L’Etat Tabghatch disparut finalement<br />
au milieu du sixième siècle sous <strong>la</strong> domination chinoise.<br />
L’un <strong>de</strong>s Etats hunniques était celui <strong>de</strong>s Akhums –‘’les Huns<br />
b<strong>la</strong>ncs’’(Hephtalites) ou celui <strong>de</strong>s Huns du Moyen Orient fondé par<br />
les Hunniques qui s’étaient dirigés vers le sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Caspienne<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Volga alors que <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s Hunniques se dirigeait vers<br />
l’Ouest. Ils ont é<strong>la</strong>rgi leurs frontières <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Caspienne au Nord<br />
<strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>, à l’Afghanistan et à l’Asie intérieure au milieu du sixième<br />
siècle. Les Akhuns ne purent cependant défendre leur territoire face à<br />
l’alliance Sassanids-Göktürks en 557.<br />
2. Les Göktürks<br />
Les Göktürks, ou Kök-Türks, étaient originaires <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu <strong>de</strong>s Ashinas,<br />
<strong>de</strong>s Altaics qui vivaient d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> partie Nord du territoire appelé<br />
aujourd’hui Xinjiang Ouighours, région autonome <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine. Les<br />
Göktürks étaient les <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong>s Huns, d’après les archives chinoises<br />
et ils ont hérite <strong>de</strong>s traditions et <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s administratives <strong>de</strong>s Huns.<br />
L’Etat Göktürk a été le premier à porter le nom <strong>de</strong> ‘’turc’’. Plus tard, ce<br />
nom a été porté par <strong>de</strong> nombreuses personnes et Etats d<strong>ans</strong> l’Histoire.<br />
L’Etat Göktürk a constitué le second empire turc (Le premier ayant été<br />
l’Empire <strong>de</strong>s Huns). L’Etat Göktürk a réuni sous sa direction toutes les<br />
tribus d’origine turque sauf les Turcs Yakut à l’Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sibérie et les<br />
Turcs Oğurs à l’Ouest.<br />
Les Turcs d’Asie centrale, du Turkestan, <strong>de</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane<br />
(Maveraunnehir), d’In<strong>de</strong> du Nord, d’Iran, d’Anatolie, d’Irak, <strong>de</strong><br />
Syrie et <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> ont été « turquifiés » par les Göktürks. ‘’Göktürk’’<br />
signifierait « les Turcs célestes », mais ceci est contesté. Des<br />
interprétations alternatives seraient « les Turcs bleus », les « Turcs<br />
nombreux », « Gök » ou « Kök » signifiant à <strong>la</strong> fois ciel et bleu en<br />
<strong>la</strong>ngue Göktürk.
Le premier Empire göktürk a été fondé sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière<br />
Orkhon en réunissant huit tribus turques: les Ouïghours, les Oghouzes,<br />
les Onoqs et les Karlouks. Au milieu du sixième siècle, ils vivaient sous<br />
<strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong>s Avars ou Juan-Juan, sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Bumin.<br />
Bumin reçut le titre <strong>de</strong> ‘’Khan’’ par le Conseil d’Etat Göktürk en<br />
reconnaissance <strong>de</strong> sa victoire face à l’Etat Juan-Juan en 552. Bumin<br />
Khan a fait <strong>de</strong> Ötüken sa capitale. Cette ville était considérée comme<br />
une ville sainte pour les Turcs. Bumin Khan donna <strong>la</strong> région Ouest<br />
<strong>de</strong> l’Empire à son frère Istemi et lui accorda le titre <strong>de</strong> Yabghu. Istami<br />
Yabghu était dépendant <strong>de</strong>s affaires étrangères <strong>de</strong>s Göktürks <strong>de</strong><br />
l’Est mais avait le pouvoir <strong>de</strong> décision en ce qui concerne les affaires<br />
intérieures. Bumin Khan mourut à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> cette même année et sa<br />
succession fut assurée par son fils Mukhan. Sous le règne <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier,<br />
L’Empire göktürk fut un grand empire. Mukhan envoya ceux qui<br />
restaient encore <strong>de</strong>s Juan-Juan en Europe et mit les Kirghizes, les tribus<br />
turques, les Kit<strong>ans</strong> et les tribus mongoles sous sa domination.<br />
Istemi Yabghu é<strong>la</strong>rgit également sa souveraineté <strong>de</strong> l’Ouest <strong>de</strong>s<br />
montagnes Altaï au <strong>la</strong>c Issik et aux montagnes Tien Shan. Il prit<br />
ensuite l’initiative d’établir <strong>de</strong>s contacts avec l’Empire byzantin et les<br />
Sassanids. Tout d’abord, Istemi vainquit les Ak-Huns avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Sassanids. Il passa ensuite une alliance avec les Byzantins contre les<br />
Sassanids qui essayaient <strong>de</strong> prendre le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie.<br />
Ce contrôle faisait l’objet d’une forte rivalité entre les byzantins, les<br />
Sassanids et les Göktürks. Sous le règne <strong>de</strong> Istemi, les frontières Ouest<br />
<strong>de</strong> l’Empire al<strong>la</strong>ient jusqu’à <strong>la</strong> Crimée sur <strong>la</strong> cote Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire.<br />
Les Göktürks ont vu l’apogée <strong>de</strong> leur puissance à l’Ouest avec Istemi<br />
Ybabghu et à l’Est avec Mukan Khan. Bien que ce système <strong>de</strong> double<br />
régence fonctionnait assez bien avec Istemi et mukan, il se tr<strong>ans</strong>forma<br />
en faiblesse après leur mort et créa <strong>de</strong>s rivalités parmi les Khanats <strong>de</strong><br />
l’Est et <strong>de</strong> l’Ouest. Les dynasties chinoises Sui et Tang en profitèrent<br />
pour les monter les uns contre les autres. Tardu, le fils d’Istemi qui<br />
s’était déjà déc<strong>la</strong>ré indépendant du Khan après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> son père,<br />
n’accepta pas <strong>de</strong> se ranger sous l’autorité <strong>de</strong> Ishpara Khan à l’Est et<br />
entraîna une guerre civile qui créa une division <strong>de</strong> l’Empire göktürk en<br />
une partie Est et une partie Ouest en 582. Suite à une campagne, qui se<br />
solda par un échec, Ishpara <strong>de</strong>vint un vassal <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine en 585. Bien<br />
que <strong>de</strong>s générations <strong>de</strong> Kh<strong>ans</strong> se soient battues pour leur liberté, les<br />
Göktürks <strong>de</strong> l’Est furent conquis par <strong>la</strong> Chine en 630.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
15
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
16<br />
La Chute <strong>de</strong>s Göktürks<br />
Ayant réussi à conserver leur liberté, les Göktürks <strong>de</strong> l’Ouest rêvaient<br />
<strong>de</strong> rétablir <strong>la</strong> confédération Göktürk et d’é<strong>la</strong>rgir leurs frontières vers<br />
l’Ouest. Tardu obtint <strong>de</strong>s succès considérables (576-603). Ses succès<br />
dérangèrent cependant <strong>la</strong> Chine qui provoqua une guerre civile afin<br />
<strong>de</strong> contrer <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> Tardu. Des tribus turques, particulièrement<br />
les Töles (Tiele) se rebellèrent contre Tardu qui ne put contrôler ces<br />
rebellions. En 603, Tardu trouva refuge chez les Tu-Yu-Huns, une tribu<br />
mongole, ce qui créa une atmosphère chaotique d<strong>ans</strong> l’Etat göktürk <strong>de</strong><br />
l’Ouest jusqu’en 611. Durant le règne <strong>de</strong> She-Koei Khan (611-618) et<br />
<strong>de</strong> Tong Yabghu (618-630), les Göktürks retrouvèrent une partie <strong>de</strong><br />
leur pouvoir en reprenant le contrôle <strong>de</strong>s Töles qui s’étaient établis sur<br />
un territoire al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong>s rivières Orkhun au <strong>la</strong>c Aral. Cependant, En 630,<br />
le pouvoir <strong>de</strong>s Göktürks commença à diminuer en raison <strong>de</strong> rebellions<br />
tribales et <strong>de</strong> guerres contre <strong>la</strong> Chine. En 659, <strong>la</strong> Chine prit possession<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> partie Ouest <strong>de</strong> l’Etat Göktürk.<br />
Ainsi, entre 630 et 680, les Göktürks durent se soumettre à <strong>la</strong> Chine.<br />
Ces 50 <strong>ans</strong> <strong>de</strong> domination chinoise eurent <strong>de</strong>s effets négatifs sur les<br />
Turcs qui s’interrogèrent sur les raisons <strong>de</strong> <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> leur Etat et <strong>de</strong> leur<br />
esprit. D’après <strong>de</strong>s écrits Orkhon, les raisons <strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite du premier<br />
Empire göktürk étaient les suivantes : Un Khan peu intelligent avait<br />
succédé au trône et avait été entouré d’administrateurs incompétents,<br />
l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s turcs n’avait pas été adaptée aux circonstances et les<br />
chinois, quant à eux, avaient usé <strong>de</strong> mensonges et <strong>de</strong> duperies.
La renaissance <strong>de</strong>s Göktürks<br />
Entre 679 et 681, les Turcs se retournèrent contre les Chinois à<br />
plusieurs reprises. Ces retournements furent dirigés par <strong>de</strong>s personnes<br />
ayant gagné le statut <strong>de</strong> héro comme Kurshat. Bien que ces actions<br />
soient insuffisantes pour atteindre le but à court terme désiré, elles<br />
provoquèrent le réveil d’une conscience nationale chez les Turcs.<br />
L’arrivée <strong>de</strong> Kutluk, un <strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu Ashina, marqua un<br />
tournant puisqu’il réunifia et mobilisa les popu<strong>la</strong>tions turques pour<br />
fon<strong>de</strong>r le <strong>de</strong>uxième Empire göktürk qui subsista <strong>de</strong> 681 à 745.<br />
Kutluk reçut le titre <strong>de</strong> Ilterish. Il mena plusieurs campagnes contre<br />
certaines tribus turques ou étrangères, <strong>de</strong> même que contre les Chinois<br />
afin <strong>de</strong> renforcer l’économie et <strong>la</strong> position politique <strong>de</strong>s Göktürks.<br />
Quand il mourut en 692, les tribus turques et étrangères installées d<strong>ans</strong><br />
les montagnes <strong>de</strong> Khentei au Nord, le long <strong>de</strong>s rivières Onon et Kerulen<br />
à l’Est et d<strong>ans</strong> les montagnes Altaï à l’Ouest, étaient sous souveraineté<br />
Göktürk. Kapgan (692-716), le fils <strong>de</strong> Kutluk, continua à appliquer <strong>la</strong><br />
politique <strong>de</strong> son père en matière d’unification <strong>de</strong>s Turcs d’Asie sous<br />
un drapeau Göktürk. Il tenta <strong>de</strong> dominer <strong>la</strong> Chine afin <strong>de</strong> ramener les<br />
Turcs qui se trouvaient à l’intérieur <strong>de</strong>s frontières chinoises. A cette fin,<br />
il opéra vingt attaques contre <strong>de</strong>s armées au Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine. Sous <strong>la</strong><br />
menace turque, les Chinois firent une alliance avec les Kirghizes et les<br />
Onoqs en 696 et incitèrent les Turgishs, les Karlouks et bien d’autres à<br />
se retourner contre les Göktürks. Kapgan répondit <strong>de</strong> manière stricte<br />
envers les tribus turques, une erreur peut-être <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> Kapgan si<br />
l’on pense que certaines tribus auraient pu être convaincues s<strong>ans</strong> heurts<br />
<strong>de</strong> cesser les hostilités envers les Göktürks. Au lieu <strong>de</strong> ça, elles <strong>de</strong>vinrent<br />
les pires ennemis <strong>de</strong> Kapgan. Les Chinois profitèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation.<br />
En conséquence <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, Kapgan fut tué par les Bayirkus, (Une <strong>de</strong>s<br />
tribus turques) avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Chinois. Les Turgishs déc<strong>la</strong>rèrent leur<br />
indépendance et les Ouïghours passèrent sous contrôle chinois. Le<br />
successeur <strong>de</strong> Kapgan, Inel Kagan, ne fut pas capable <strong>de</strong> faire face à <strong>la</strong><br />
situation. Il fut détrôné par Bilge Khan et Kül Tigin, les fils <strong>de</strong> Ilterish.<br />
Quand Bilge Khan (signifiant le Khan sage) parvint au trône (716-<br />
734), Kül Tigin se vit donner le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’armée Gökturk et<br />
Kül Tigin <strong>de</strong>vint Vizir. Suivant les conseils <strong>de</strong> Tonyukuk, Bilge Khan<br />
et Kül Tigin déc<strong>la</strong>rèrent qu’un Khanat ne pouvait pas être dirigé par<br />
<strong>la</strong> guerre et <strong>la</strong> bravoure. Ils déc<strong>la</strong>rèrent également <strong>la</strong> sagesse comme<br />
étant <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance. C’est ainsi que Bilge Khan n’attaqua pas<br />
<strong>la</strong> Chine. Au lieu <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, il se concentra sur <strong>de</strong>s réformes intérieures,<br />
dont celle en vue <strong>de</strong> rétablir une re<strong>la</strong>tion amicale avec les tribus turques,<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
17
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
18<br />
re<strong>la</strong>tions qui s’étaient dégradées sous le règne <strong>de</strong> Kapgan. Pendant ce<br />
temps, les Chinois firent <strong>de</strong>s alliances en 720 avec <strong>de</strong>s tribus turques <strong>de</strong><br />
Kitan et Basmils d<strong>ans</strong> le but <strong>de</strong> conduire <strong>de</strong>s guerres contre les Göktürks.<br />
Bilge Khan détourna les pl<strong>ans</strong> <strong>de</strong>s Chinois grâce au conseil <strong>de</strong> son Vizir,<br />
Tonyukuk. Les Kit<strong>ans</strong> et les Basmils furent vaincus avant même <strong>de</strong><br />
pouvoir s’unifier aux troupes chinoises. Bilge Khan se tourna alors vers <strong>la</strong><br />
Chine et l’obligea à signer un accord en 724, par lequel elle consentait à<br />
établir un marché commun sur les frontières turco chinoises. Cet accord<br />
permit un avantage économique <strong>de</strong> taille pour les Göktürks.<br />
Tonyukuk mourut en 725. Certains académiciens l’ont appelé « Le<br />
Bismarck <strong>de</strong>s Göktürks » en raison du rôle crucial qu’il a joué d<strong>ans</strong> les<br />
politiques internes et étrangères <strong>de</strong>s Göktürks. Kül Tigin mourut en<br />
732 et Bilge Khan en 734. Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, les Göktürks<br />
n’ont pas pu résister longtemps à une alliance faite entre les Karlouks,<br />
les Basmils et les Ouïghours en 745.<br />
Bilge Khan et Kül Tigin ont pris p<strong>la</strong>ce parmi les Hommes d’Etat turcs<br />
les plus sages et les plus héroïques <strong>de</strong> l’Histoire. Les premiers textes<br />
écrits en <strong>la</strong>ngue turque sont <strong>de</strong>s textes qui immortalisent les réussites<br />
<strong>de</strong> ces Kh<strong>ans</strong> et <strong>de</strong> Tonyukuk.<br />
3. Les Ouïghours<br />
Le terme ‘’ Ouïghour’’ désignait une tribu par<strong>la</strong>nt le turc d<strong>ans</strong> les<br />
montagnes Altaï. Comme les Göktürks, les Ouïghours était l’une<br />
<strong>de</strong>s plus <strong>la</strong>rges tribus turques et l’une <strong>de</strong> celles qui vécurent le plus<br />
longtemps en Asie centrale. D’après les archives chinoises, les ancêtres<br />
<strong>de</strong>s Ouïghours étaient les Huns d’Asie. Ils étaient appelés ‘’Kao-kü’’<br />
durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> Tabghatch (386-534).<br />
Les Ouïghours ont installé une principauté d<strong>ans</strong> les vallées au Sud<br />
du <strong>la</strong>c Baïkal et près <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Yenisei d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du<br />
cinquième siècle. Bientôt, les Ouïghours participèrent à une coalition<br />
avec les Töles qui dominaient <strong>la</strong> partie Nord <strong>de</strong> l’Asie centrale. D<strong>ans</strong> le<br />
premier quart du septième siècle, ils prirent part à une coalition entre<br />
six tribus Syr-Tardush. A l’époque <strong>de</strong> Kapgan Khan, les Ouïghours<br />
étaient sous souveraineté Göktürk. Finalement, les Ouïghours avec<br />
d’autres tribus (Les Basmils et les Karlouks) vainquirent les Khanats<br />
göktürks et fondèrent l’Empire ouïghour sur le mont Ötüken. L’Empire<br />
ouïghour s’étendait <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Caspienne à <strong>la</strong> Manchourie et dura <strong>de</strong><br />
745 à 840. Sa capitale était Ordu Baliq, construite sur <strong>la</strong> rivière Orkhon<br />
près <strong>de</strong> là où les Mongols ont, plus tard, construit Karakorum.
La tribu <strong>de</strong>s Ouïghours qui vainquit les Göktürks était constituée <strong>de</strong>s<br />
Doquz Urug (<strong>la</strong> signification <strong>de</strong> ‘’Urug’’ n’est pas c<strong>la</strong>ire mais fait s<strong>ans</strong><br />
doute référence à une <strong>la</strong>rge famille). En se joignant aux Doquz-Oghuz,<br />
les Basmils et les Karlouks ont formé l’Empire ouïghour. Le premier<br />
dirigeant <strong>de</strong> l’Etat ouïghour fut Kutluk Bilge Khan. Quand celui-ci<br />
mourut en 747, il fut remp<strong>la</strong>cé par Moyunchur (747-759). Durant<br />
le règne <strong>de</strong> Moyunchur, <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> bataille entre les arabes et les<br />
chinois eut lieu en Asie centrale. C’est ainsi que <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Ta<strong>la</strong>s eut<br />
lieu en 751, qui vit <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong>s Chinois. Ce<strong>la</strong> engendra une guerre<br />
civile en Chine, celle-ci <strong>de</strong>vant appeler les Ouïghours à l’ai<strong>de</strong>. Profitant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> situation en Chine, les Ouïghours capturèrent le Tarim basin.<br />
Alors qu’ils auraient pu conquérir l’Empire chinois, les Ouïghours<br />
préférèrent mettre en p<strong>la</strong>ce une politique commerciale pour drainer les<br />
richesses <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine s<strong>ans</strong> <strong>la</strong> détruire. Bögü Khan conserva <strong>la</strong> même<br />
politique envers <strong>la</strong> Chine. Durant sa campagne chinoise, Böğü Khan<br />
fut si impressionné par le Manichéisme qu’il ramena avec lui quatre<br />
religieux Manichéistes en territoire Ouighours. Ainsi, les Ouïghours se<br />
convertirent au Manichéisme en 762. Ce<strong>la</strong> affecta leur perception <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> vie, le Manichéisme interdisant en effet <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> vian<strong>de</strong>.<br />
Leur esprit guerrier en fut affaibli.<br />
En 840, suite à une famine et une guerre civile, l’Empire ouïghour passa<br />
sous contrôle Kirghize, d’autres Turcs. En conséquent, <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s<br />
tribus qui se trouvaient sous <strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong>s Ouïghours avant,<br />
émigrèrent en Asie Intérieure.<br />
La plupart <strong>de</strong>s Ouïghours quittèrent Ötüken pour arriver à Kan-Chou<br />
(k<strong>ans</strong>u) où ils rencontrèrent leurs cousins qui y vivaient <strong>de</strong>puis 150<br />
<strong>ans</strong>. Les Ouïghours nouvellement arrivés créèrent un Etat en 911 sous<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Tigin. Ce <strong>de</strong>rnier, contrô<strong>la</strong>nt une partie importante <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie envoya <strong>de</strong>s délégations en Chine afin d’établir <strong>de</strong><br />
bonnes re<strong>la</strong>tions basées sur le commerce.<br />
Les Ouïghours ne réalisèrent pas d’exploit militaire important, passant<br />
rapi<strong>de</strong>ment sous le contrôle <strong>de</strong>s Kit<strong>ans</strong> au dixième siècle, puis sous celui<br />
<strong>de</strong>s Tanguts au onzième siècle. En 1226, cette région était dominée par<br />
les Mongols sous Gengis Khan.<br />
Après leur chute, certains Ouïghours émigrèrent vers les montagnes<br />
Tien Shan, Besh Baliq et vers <strong>la</strong> région Tourfan où ils créèrent un<br />
nouvel Etat en 856 appelé l’Etat Tourfan Ouïghour ou encore, l’Etat<br />
Ouïghour <strong>de</strong> l’Est. Cet Etat avait à sa tête Mengly, le neveu du <strong>de</strong>rnier<br />
Khan Ouighours à Ötüken. La Chine quant à elle, faisant face à <strong>de</strong>s<br />
guerres civiles, avait besoin <strong>de</strong> bons rapports <strong>de</strong> voisinage. L’Etat<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
19
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
20<br />
Ouïghour <strong>de</strong> l’Est passa sous contrôle Mongol grâce à Gengis Khan<br />
<strong>de</strong> 1209 à 1368, puis ce fut Timur qui domina cette région Ouïghour.<br />
Les <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> Timur et <strong>de</strong>s Mongols maintinrent leur autorité<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région jusqu’au milieu du dix-huitième siècle. D<strong>ans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
moitie du dix-neuvième siècle, <strong>la</strong> région Ouïghour <strong>de</strong>vint une région<br />
stratégique d<strong>ans</strong> <strong>la</strong>quelle l’Angleterre, <strong>la</strong> Russie et <strong>la</strong> Chine désiraient<br />
é<strong>la</strong>rgir leur influence. Aujourd’hui, une popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> dix millions<br />
d’Ouïghours vit encore d<strong>ans</strong> cette région, passée sous contrôle chinois.<br />
4. Les Turgishs<br />
Les Turgishs formaient une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> branche Tardush <strong>de</strong> l’Union<br />
tribale On-Oq (partie <strong>de</strong>s Göktürks <strong>de</strong> l’Ouest). Leur nom apparut<br />
tout d’abord d<strong>ans</strong> les archives chinoises en 651 lorsqu’ils vivaient d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> vallée Ili sous <strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong>s Göktürks. Apres <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong>s<br />
Göktürks, les Turgishs réussirent à prendre le contrôle <strong>de</strong>s territoires<br />
s’étendant jusqu’aux provinces <strong>de</strong> Tourfan et Kucha et prirent <strong>la</strong><br />
domination <strong>de</strong>s tribus Onoqs. Ceci se réalisa sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong><br />
Ushyly qui reçut le titre <strong>de</strong> ‘’Baga Tarkan’’. A l’apogée <strong>de</strong> son règne,<br />
Ushyly Kagan décida <strong>de</strong> s’allier avec les Chinois et les Kirghizes pour<br />
freiner l’exp<strong>ans</strong>ion <strong>de</strong>s Göktürks qui s’étaient reformés et qui étaient<br />
<strong>de</strong>venus puissants sous le règne <strong>de</strong> Kapgan Khan. Ushyly fut vaincu<br />
et fait prisonnier à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Bolchu en 698 par Tonyukuk, le<br />
commandant <strong>de</strong> l’armée Göktürk. Ainsi, les Turgishs <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s<br />
vassaux <strong>de</strong>s Göktürks.<br />
La <strong>de</strong>uxième défaite <strong>de</strong>s Turgishs face aux Göktürks arriva en 711 près<br />
<strong>de</strong> Bolchu. Soko, le fils <strong>de</strong> Ushyly fit <strong>de</strong> nouveau une alliance avec <strong>la</strong><br />
Chine. Avant <strong>la</strong> bataille avec les Göktürks, Le frère <strong>de</strong> Soko Chemu<br />
s’était rebellé contre lui et rallié à Kapgan Khan. Les Turgishs étaient<br />
donc à cette époque déjà séparés en <strong>de</strong>ux camps comme le montrent<br />
<strong>de</strong>s inscriptions Orkhun : Les Turgishs kara (noirs) et les Turgishs Sarı<br />
(jaunes).<br />
Le règne <strong>de</strong>s Göktürks sur les Turgishs n’a pas duré très longtemps<br />
puisqu’ils sont <strong>de</strong>venus indépendants en 717. Choisissant Chor Sulu<br />
comme nouveau Khan, <strong>de</strong> nombreux chefs Göktürks et autres nobles<br />
abandonnèrent Bilge Khan pour entrer au service <strong>de</strong> Sulu. Sulu instal<strong>la</strong><br />
sa capitale à Ba<strong>la</strong>saghun, au Nord Ouest <strong>de</strong> Ta<strong>la</strong>s. Ta<strong>la</strong>s était par ailleurs<br />
l’endroit où Sulu avait empêché l’armée Umawwid d’avancer en Asie<br />
Centrale. Après plusieurs victoires contre l’exp<strong>ans</strong>ionnisme arabe <strong>de</strong>s<br />
Umawwids, une guerre civile <strong>de</strong> longue durée éc<strong>la</strong>ta entre les Turgishs<br />
Kara et Sary en 738. Les <strong>de</strong>ux camps furent en fait vaincus par une<br />
autre tribu turque : les Karlouks en 766.
5. Les Kirghizes<br />
Bien que <strong>de</strong>s découvertes historiques récentes sur les Kirghizes fassent<br />
état <strong>de</strong> 203 avant J.C, nous ne disposons pas d’informations sur leur<br />
existence avant cette date. Les premiers Kirghizes vivaient d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
vallée supérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Yenisey. Au sixième siècle, ils étaient<br />
sous <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s Göktürks. Quand les Göktürks sont tombés<br />
sous domination chinoise entre 630 et 680, les Kirghizes sont <strong>de</strong>venus<br />
une tribu indépendante. Cependant, ils sont à nouveau passés sous<br />
contrôle Göktürk durant le <strong>de</strong>uxième Empire Göktürk, puis sous<br />
contrôle Ouighours en 758. Au septième et huitième siècle, ils ont fait<br />
connaissance avec <strong>la</strong> religion is<strong>la</strong>mique par <strong>de</strong>s commerçants arabes qui<br />
utilisaient <strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie.<br />
Apres avoir vaincu les Ouïghours en 840, les Kirghizes ont fait <strong>de</strong><br />
Ötüken leur capitale. En 920, ils ont été forcés par Khitan <strong>de</strong> quitter<br />
Ötüken et sont retournés d’où ils venaient. En 1207 <strong>la</strong> domination<br />
kirghize était réduite en raison <strong>de</strong>s invasions mongoles. Les Kirghizes<br />
finirent par émigrer vers le Sud.<br />
6. Les Karlouks<br />
Les Karlouks (ou Karluk) qui signifie ‘’masse <strong>de</strong> neige’’ étaient à<br />
l’origine une tribu noma<strong>de</strong> turque qui s’est installée d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
Kara-Irtish et Tarbagatay, à l’Ouest <strong>de</strong>s montagnes Altaï. Les Karlouks<br />
ont formé une partie <strong>de</strong> l’union Onoq avec trois autres tribus. Avec le<br />
temps, les Karlouks se dép<strong>la</strong>cèrent vers l’Ouest et vinrent s’ajouter aux<br />
tribus membres <strong>de</strong>s Göktürks. Ils jouèrent un rôle important d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
défaite <strong>de</strong>s Ouïghours et <strong>de</strong>s Basmils face aux Göktürks en 745. Après<br />
ce<strong>la</strong>, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Karlouks reconnurent le Khanat Ouïghour comme<br />
leur maître.<br />
Les Karlouks se rangèrent d<strong>ans</strong> le camp <strong>de</strong>s Arabes lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille<br />
<strong>de</strong> Ta<strong>la</strong>s en 751. Cette bataille se fit entre les Arabes umawwid et<br />
<strong>la</strong> dynastie chinoise Tang pour le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane où les<br />
autorités turgishes avaient perdu <strong>de</strong> leur pouvoir. En 766, les tribus<br />
Karlouks formèrent un Khanat sous <strong>la</strong> direction d’un Yabgu après<br />
que ceux-ci eurent pris le contrôle <strong>de</strong>s Turgishs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
Ta<strong>la</strong>s. Leur capital fut Ba<strong>la</strong>saghun tant qu’ils restèrent fidèles aux<br />
Ouïghours. Après <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers, les Karlouks déc<strong>la</strong>rèrent<br />
leur indépendance. Le peuple <strong>de</strong>s Karlouks fut le premier peuple turc à<br />
se convertir à l’Is<strong>la</strong>m et joua un rôle important d<strong>ans</strong> l’établissement du<br />
premier Etat turc is<strong>la</strong>mique Karakhani<strong>de</strong> (karahanly).<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
21
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
22<br />
7. Les Oghouzes<br />
Le nom Oghouze dérive du mot « ok » qui signifie « Tribu » ou<br />
« flèche » en turc. La lettre « z » en suffixe permet <strong>de</strong> former le pluriel en<br />
grammaire turque ancienne. « Okuz » se tr<strong>ans</strong>forma au sixième siècle<br />
en « Oguz » (Oghuz) ou « Uz » comme d<strong>ans</strong> les archives byzantines.<br />
Lorsqu’ils étaient sous contrôle göktürk, les Oghouzes étaient appelés<br />
les Üç (Trois) Oghouzes ou Sekiz (Huit) Oghouzes, mais surtout<br />
Dokuz (Neuf ) Oghouzes, et plus tard On (Dix) Oghouzes. Pendant<br />
<strong>la</strong> création <strong>de</strong> l’Etat göktürk, les Tribus oghouzes habitaient <strong>la</strong> région<br />
<strong>de</strong>s montagnes Altaï et aussi <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Tu<strong>la</strong>. En tant que<br />
communauté, ils étaient également présents près <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Barlik.<br />
A l’époque <strong>de</strong>s Göktürks, Les Oghouzes se sont é<strong>la</strong>rgis grâce à<br />
l’unification d’autres tribus turques avec eux. C’est pourquoi, le nom<br />
<strong>de</strong> Oghouze fut donné à une succession <strong>de</strong> tribus turques noma<strong>de</strong>s ou<br />
semi-noma<strong>de</strong>s en Asie Centrale qui s’étaient unifiées en une nouvelle<br />
confédération tribale (bodun).<br />
Suite à <strong>la</strong> chute <strong>de</strong>s Göktürks, les Oghouzes se sont rangés sous l’autorité<br />
ouïghour. A l’époque <strong>de</strong> Moyunchur (747-759) certains Oghouzes se<br />
sont battus contre l’autorité Ouïghour mais ils furent vaincus par trois<br />
fois près <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Selenga. Ils peuvent être arrivés en Tr<strong>ans</strong>oxiane<br />
vers <strong>la</strong> fin du huitième siècle. Nous savons qu’ils vivaient sur un territoire<br />
al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> l’Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Caspienne à <strong>la</strong> rivière Seyhun (Syr-darya) aux<br />
dixième et onzième siècles. Ils ont crée un Etat appelé Oghuz Yabghu<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> première moitié du dixième siècle, ayant les Petchenègues et les<br />
Khazars comme voisins hostiles. La re<strong>la</strong>tion avec les Karlouks à l’Est était<br />
également tendue. Ces Oghouzes se faisaient appeler « Turcs » et aussi<br />
« Turkmènes », qui <strong>de</strong>vint le nom <strong>de</strong>s Oghouzes après leur conversion<br />
à l’Is<strong>la</strong>m. Chaque confédération se composait <strong>de</strong> douze tribus, ce qui<br />
veut dire que <strong>la</strong> confédération oghuze se composait <strong>de</strong> vingt-quatre<br />
tribus turques. Les Oghouzes avaient été organisés par un système <strong>de</strong><br />
confédération tribale double sous le règne <strong>de</strong> Oghuz Yab’su, système qui<br />
portait le nom <strong>de</strong> Üç-Ok. Cette confédération Üç-Ok comprenait <strong>la</strong><br />
tribu Kynyk (qui a plus tard fondé l’Etat Seldjouki<strong>de</strong>), et <strong>la</strong> tribu <strong>de</strong>s<br />
Boz-ok et <strong>de</strong>s Kayy qui a fondé l’Empire ottoman.<br />
L’Etat Yabghu Oghouze fut vaincu en raison <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong>s<br />
Kiptchaks, <strong>de</strong>s Khazars et <strong>de</strong>s Karlouks. Une autre raison <strong>de</strong> cette<br />
défaite peut être le départ <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> confédération Oghuz<br />
à l’Ouest. Suite à <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> l’Etat Yabghu Oghuz, certains Oghuz<br />
émigrèrent vers l’Ouest à travers les terres au Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire et<br />
atteignirent les Balk<strong>ans</strong> où ils ont été renommés les « Uzs ». Les « Uzs »<br />
sont les ancêtres <strong>de</strong>s Gagaouzes en Roumanie. D’autres Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
sont partis vers Khorasan. Certains Oghouzes sont restés sur leur<br />
territoire d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s montagnes Altaï.
CHAPITRE 2<br />
Les Tribus et Etats turcs <strong>de</strong> l’Europe<br />
<strong>de</strong> l’est à l’époque médiévale<br />
1. Les Huns <strong>de</strong> l’Ouest<br />
Depuis <strong>de</strong>ux cents <strong>ans</strong>, <strong>de</strong>s savants <strong>de</strong> différentes branches <strong>de</strong>s sciences<br />
sociales proposent <strong>de</strong>s théories différentes en ce qui concerne l’origine<br />
<strong>de</strong>s Huns <strong>de</strong> l’Ouest. Des sources ethnographiques et culturelles<br />
récentes ont mis en évi<strong>de</strong>nce le fait que les Huns <strong>de</strong> l’Ouest étaient<br />
d’origine turque et qu’ils étaient les <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong>s Huns d’Asie.<br />
Les Huns du Nord ont commencé à émigrer vers l’ouest au début du<br />
<strong>de</strong>uxième siècle où ils se sont unis avec les tribus Chi-chi. En raison <strong>de</strong><br />
pressions <strong>de</strong> tribus noma<strong>de</strong>s au milieu du quatrième siècle, les Huns ont<br />
émigré massivement vers l’Ouest et sont arrivés à <strong>la</strong> rivière Itil (Volga)<br />
en 374. Sur leur chemin, ils ont rencontré <strong>de</strong>ux peuples germaniques<br />
installés le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> côte Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire : les Ostrogoths qu’ils<br />
ont vaincus et les Visigoths auxquels les romains avaient permis <strong>de</strong><br />
s’établir en tant que nation d<strong>ans</strong> l’Empire romain au Sud du Danube en<br />
remerciement à <strong>de</strong>s services militaires rendus.<br />
Alors que les Huns rencontraient les peuples germaniques, une autre<br />
bataille plus amère <strong>de</strong>venait inévitable entre <strong>de</strong>ux groupes noma<strong>de</strong>s :<br />
Les Huns, sous le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>mir (Premier chef connu<br />
<strong>de</strong>s Huns <strong>de</strong> l’Ouest) vainquirent les Ostrogoths en 374. Les attaques<br />
<strong>de</strong>s Huns continuèrent à l’Ouest grâce à l’efficacité surprenante <strong>de</strong> leur<br />
cavalerie. Quand ils atteignirent <strong>la</strong> rivière Dniepr en 375, les troupes<br />
<strong>de</strong>s Huns provoquèrent <strong>la</strong> chute <strong>de</strong>s Visigoths. Leur roi: Atanarik partit<br />
avec ses troupes en territoire sous contrôle romain à l’Ouest vers 395<br />
alors que l’Empire romain était divisé en Empire <strong>de</strong> l’Est et Empire <strong>de</strong><br />
l’Ouest. Cependant, <strong>la</strong> pression exercée par les Huns avec leur entrée<br />
en Europe <strong>de</strong> l’Est engendra une gran<strong>de</strong> fluctuation d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
européenne. Ainsi, tous les gens <strong>de</strong> l’Est et d’Europe Centrale ont<br />
été expulsés <strong>de</strong> leur pays, créant une émigration qui a profondément<br />
changé <strong>la</strong> composition ethnique <strong>de</strong> l’Europe.<br />
Les attaques soudaines <strong>de</strong>s Huns semaient <strong>la</strong> terreur parmi les tribus<br />
d’Europe <strong>de</strong> l’Est. Le mon<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntal a été marqué par l’apparence<br />
<strong>de</strong>s escadrons <strong>de</strong> Huns qui arrivaient là où on ne les attendait pas.<br />
De nombreux écrivains <strong>la</strong>tins ou grecs <strong>de</strong> l’époque ont exprimé une<br />
profon<strong>de</strong> hostilité envers les Huns, ce qui a joué d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mise en p<strong>la</strong>ce<br />
d’une image négative excessive d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> culture occi<strong>de</strong>ntale.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
23
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
24<br />
Durant <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière décennie du quatrième siècle, les Huns ont porté<br />
une série d’attaques en Anatolie et au Moyen Orient qui prit fin avec<br />
l’attaque contre Jérusalem à travers le Caucase, sous le comman<strong>de</strong>ment<br />
<strong>de</strong> Basil et Kursik. L’Empire romain <strong>de</strong> l’Est ne put mettre en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
mesures défensives contre ces attaques. En 400, une autre campagne<br />
<strong>de</strong>s Huns sous le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> Uldiz contre les Goths au Sud du<br />
Danube fut le point <strong>de</strong> départ d’une autre vague d’émigration massive<br />
<strong>de</strong>s Goths qui trouvèrent refuge d<strong>ans</strong> l’Empire romain. Les Romains<br />
étaient soucieux <strong>de</strong> l’intégrité territoriale <strong>de</strong> l’Empire, menacée par<br />
ces barbares. Les Romains <strong>de</strong>mandèrent <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> aux Huns afin<br />
d’affronter les Visigoths. Ce fut à Uldiz que cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> fut faite,<br />
Uldiz qui vainquit Radagais, le commandant <strong>de</strong>s Goths. Durant le<br />
règne <strong>de</strong> Uldiz, les Huns mirent en p<strong>la</strong>ce une politique étrangère qui<br />
durera jusqu’à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’époque d’Atil<strong>la</strong>. Cette politique étrangère<br />
préconisait un soutien aux forces en puissance contre les forces plus<br />
faibles. Ainsi, les Huns établirent <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec l’Empire<br />
romain <strong>de</strong> l’Ouest alors qu’il faisait pression contre les Byzantins.<br />
Les Huns ont ainsi gagné un certain nombre <strong>de</strong> victoires contre les<br />
Byzantins. Comme leur dictait leur politique, les Huns ont soutenu<br />
les efforts <strong>de</strong> l’Empire romain <strong>de</strong> l’Ouest pour prendre avantage sur<br />
les Visigoths et les Byzantins. Theodious, voyant à l’arrivée sur le trône<br />
Valentinianus âgé <strong>de</strong> quatre <strong>ans</strong>, envoya une armée et <strong>la</strong> marine en<br />
Italie afin <strong>de</strong> prendre possession <strong>de</strong> Rome. L’Empire romain <strong>de</strong> l’Ouest<br />
<strong>de</strong>manda à Theodious que Rua, le chef <strong>de</strong>s Huns, mette sur pieds une<br />
expédition en Italie avec soixante-mille cavaliers. Theodius ne put<br />
déc<strong>la</strong>rer <strong>la</strong> guerre aux Huns mais dut payer un tribut <strong>de</strong> 350 pounds<br />
romains aux Huns. L’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> Theodious II envers les Huns resta<br />
hostile.<br />
En 432, les Huns étaient réunis sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Rua. Après sa mort<br />
en 434, ses neveux Atti<strong>la</strong> et Bleda furent portés à <strong>la</strong> tête du contrôle <strong>de</strong><br />
toutes les tribus huns réunies. Au moment <strong>de</strong> leur accession, les Huns<br />
parlementaient avec les envoyés <strong>de</strong> Theodious II au sujet du retour <strong>de</strong><br />
plusieurs tribus rebelles qui avaient trouvé refuge d<strong>ans</strong> l’Empire byzantin.<br />
L’Empire byzantin signa un accord qui consentait sur quelques termes<br />
présentés par les Huns à Margus. Les Byzantins acceptèrent non<br />
seulement <strong>de</strong> relâcher les tribus fugitives mais aussi <strong>de</strong> doubler leur tribut<br />
précé<strong>de</strong>nt et d’ouvrir leur marché aux commerçants Huns.<br />
Comme Theodious tardait à appliquer cet accord, Atil<strong>la</strong> déclencha une<br />
guerre contre les Byzantins par <strong>la</strong> Trace. Aetius, le commandant <strong>de</strong><br />
l’armée romaine occi<strong>de</strong>ntale, empêcha cette guerre en garantissant que<br />
Theodious respecterait les conditions du traité. Mais rien ne changea
du côté <strong>de</strong> Theodious. Cette fois, il fit encore plus fort puisqu’il<br />
envisagea <strong>de</strong> faire assassiner Atil<strong>la</strong> en 448. Son projet ne fut pas mis<br />
à exécution puisque l’assassin fut arrêté avant sa tentative d’assassinat.<br />
Une atmosphère <strong>de</strong> peur s’instal<strong>la</strong> sur <strong>la</strong> capitale byzantine sachant<br />
que <strong>la</strong> réaction d’Atil<strong>la</strong> pouvait être terrible et causer <strong>de</strong>s conflits<br />
mortels. Prenant conscience <strong>de</strong> cette menace, Theodious II ne tarda<br />
pas à présenter <strong>de</strong>s excuses. Il évita une catastrophe immédiate grâce au<br />
fait qu’Atil<strong>la</strong> ne considérait pas l’Empire byzantin comme une menace<br />
immédiate. En effet, et il donnait <strong>la</strong> priorité à <strong>la</strong> question romaine <strong>de</strong><br />
l’Ouest et préparait une campagne militaire et politique <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux <strong>ans</strong>.<br />
En 450, <strong>la</strong> sœur <strong>de</strong> l’Empereur Valentinien III, Honoria, envoya à Atil<strong>la</strong><br />
une bague <strong>de</strong> fiançailles afin d’éviter un mariage forcé à un sénateur<br />
romain. Atil<strong>la</strong> y vit une occasion <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>la</strong> moitié <strong>de</strong> l’Empire<br />
<strong>de</strong> l’Ouest en tant que dote. Quand Valentinien III découvrit ceci,<br />
seule l’influence <strong>de</strong> sa mère l’empêcha <strong>de</strong> faire tuer sa sœur et <strong>de</strong> l’exiler<br />
plutôt. İl écrivit à Atil<strong>la</strong>, niant <strong>la</strong> légitimité d’une telle proposition <strong>de</strong><br />
mariage. Atil<strong>la</strong>, non convaincu, envoya un représentant à Valentinien<br />
III pour proc<strong>la</strong>mer <strong>la</strong> légitimité <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et pour annoncer<br />
qu’il viendrait prendre ce qui lui était dû.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
25
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
26<br />
La question <strong>de</strong> l’Ouest ne se limitait pas à ce mariage. Une lutte <strong>de</strong><br />
succession sévissait entre les <strong>de</strong>ux fils du Roi <strong>de</strong> Salian Franks et cette<br />
lutte opposait Atti<strong>la</strong>, qui soutenait le fils aîné alors que Aetius (un<br />
dirigeant <strong>de</strong> facto) soutenait le plus jeune. Atil<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ra son intention<br />
d’attaquer les Visigoths qui avaient passé une alliance avec Valentinien<br />
III contre les Vandals, qui à leur tour, <strong>de</strong>mandèrent le soutien <strong>de</strong>s Huns.<br />
Le but principal d’Atil<strong>la</strong> était d’empêcher les Romains d’étendre leur<br />
supériorité sur les tribus <strong>de</strong> l’Ouest acceptant le Christianisme, <strong>de</strong>venu<br />
<strong>la</strong> religion officielle <strong>de</strong> l’Empire romain en 330. Des 451, Atti<strong>la</strong> réunit<br />
<strong>de</strong>ux cent mille troupes (incluant ses vassaux s<strong>la</strong>ves et germaniques)<br />
et al<strong>la</strong> vers l’Ouest jusqu’à Orlé<strong>ans</strong>. Aetius agit afin <strong>de</strong> l’opposer aux<br />
Bourguignons et aux Visigoths sous <strong>la</strong> régence du Roi Théodoric I.<br />
Les <strong>de</strong>ux armées se firent face à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Chalons dont l’issue fait<br />
l’objet <strong>de</strong> discussions entre les historiens. Cependant, le fait que les<br />
tribus occi<strong>de</strong>ntales n’étaient plus en mesure d’ai<strong>de</strong>r les Romains d<strong>ans</strong><br />
une guerre entre Valentinien et Atil<strong>la</strong> en 452 <strong>la</strong>isse penser qu’Atil<strong>la</strong> en<br />
était sorti vainqueur.<br />
Pensant que les Romains n’étaient pas en mesure <strong>de</strong> rassembler <strong>de</strong>s<br />
troupes parmi les tribus occi<strong>de</strong>ntales, Atil<strong>la</strong> porta une <strong>de</strong>rnière attaque<br />
avec cent mille soldats contre Valentinien pour réc<strong>la</strong>mer son mariage<br />
avec Honoria. Il arriva à Rome en passant par Venise dont les habitants<br />
s’enfuirent vers <strong>de</strong> petites îles du <strong>la</strong>gon vénitien. Un climat <strong>de</strong> terreur<br />
s’instal<strong>la</strong> sur Venise. Aetius n’eut pas le courage <strong>de</strong> rencontrer Atil<strong>la</strong> en<br />
personne et une délégation composée <strong>de</strong> Trigetius, du Consul Aviennus<br />
et du Pape Léo I, fut envoyée pour obtenir le pardon d’Atil<strong>la</strong>. Cette<br />
requête fut accordée par Atil<strong>la</strong>. La paix fut établie et Atil<strong>la</strong> renvoya son<br />
armée, s<strong>ans</strong> avoir obtenu quoique ce soit.<br />
Cette action a été interprétée <strong>de</strong> manières différentes : Le fait que<br />
Rome se soit rendue à Atil<strong>la</strong> a pu être suffisant à ce <strong>de</strong>rnier, y voyant<br />
<strong>la</strong> fin d’une menace romaine <strong>de</strong> Rome contre les Huns. D’autre part,<br />
<strong>la</strong> campagne du nouvel Empereur byzantin Marciano contre les Huns<br />
peut également avoir influencé le retrait d’Atil<strong>la</strong>. Toujours est-il que<br />
Atil<strong>la</strong> quitta l’Italie et retourna d<strong>ans</strong> son pa<strong>la</strong>is <strong>de</strong> l’autre côté du<br />
Danube. Il prévoya une campagne contre l’Est mais il mourut au début<br />
<strong>de</strong> 453.<br />
Atil<strong>la</strong> avait trois fils : Ilek (El<strong>la</strong>k), Dengizik (Dengizich) et Irnek<br />
(Ernakh). Aucun d’entre eux ne possédaient le charisme d’Atil<strong>la</strong>. Ilek<br />
fut le premier à accé<strong>de</strong>r au trône mais il fut vaincu et mourut lors d’une<br />
bataille contre les tribus germaniques à Nedao en 454. Les efforts <strong>de</strong><br />
Dengizik en vue d’une unification furent un échec en raison <strong>de</strong> sa<br />
défaite contre l’Empire byzantin en 469. Irnek comprit que les Huns
dispersés ne pourraient survivre en Europe Centrale. Il emmena donc<br />
les Huns sur les côtes Ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire, sur un territoire al<strong>la</strong>nt<br />
<strong>de</strong>s bouches du Danube à <strong>la</strong> rivière Volga. Là-bas, il rencontra les<br />
tribus Oghours qui venaient <strong>de</strong> l’Est <strong>de</strong>s montagnes Oural en raison<br />
<strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong>s Sabars.<br />
2- Le Khanat Avar<br />
Les Avars étaient <strong>de</strong>s noma<strong>de</strong>s turcs d’Eurasie. Ils étaient parmi les<br />
successeurs <strong>de</strong>s Etats turcs <strong>de</strong>s Huns d’Asie Centrale. Des sources<br />
chinoises montrent que les Avars étaient <strong>de</strong>s Jun-Juan (Rouran) et<br />
qu’ils furent menés vers l’Ouest par les Göktürks en 552. Ils sont ensuite<br />
apparus en Europe Centrale et <strong>de</strong> l’Est suite à leur victoire contre les<br />
Sabars en 557. Leur règne sur une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’Europe Centrale<br />
dura jusqu’au début du neuvième siècle. Puis ils entrèrent en Allemagne,<br />
comme Atil<strong>la</strong> avait fait un siècle avant, atteignant <strong>la</strong> Mer Baltique au<br />
Nord. Les Avars se sont ensuite intéressés à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine <strong>de</strong> Pannonien<br />
que se disputaient plusieurs tribus germaniques (Les lombards et les<br />
Gepids). Apres les avoir vaincu, les Avars créèrent un Etat sur les bords<br />
du Danube. Les attaques <strong>de</strong>s Avars forcèrent les Lombards à aller vers le<br />
Nord <strong>de</strong> l’Italie, ce qui fut par ailleurs le <strong>de</strong>rnier dép<strong>la</strong>cement massif <strong>de</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion germanique d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> d’émigration.<br />
En 626, les Avars tentèrent <strong>de</strong> capturer Istanbul (Constantinople)<br />
mais ce fut un échec. Ils se replièrent donc vers leur centre. Ils prirent<br />
le contrôle <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> au profit <strong>de</strong> tribus s<strong>la</strong>ves. A part ceux <strong>de</strong><br />
Pannonie, <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s sujets avars prirent leur indépendance. Des<br />
pressions internes et externes commencèrent à affaiblir l’Etat avar<br />
au début du neuvième siècle. Ils furent finalement vaincus par le Roi<br />
<strong>de</strong> France Charlemagne en 805. Les Avars furent ensuite assimilés<br />
aux popu<strong>la</strong>tions indigènes d’Europe Centrale, principalement à <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion hongroise.<br />
3. Les Sabars<br />
Si nous savons peu <strong>de</strong> leur naissance, nous savons que les Sabars étaient<br />
<strong>de</strong>s Turcs vivant sous <strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong>s Huns d’Asie.<br />
Leur terre natale al<strong>la</strong>it <strong>de</strong> l’Est <strong>de</strong>s montagnes Tien Shan à <strong>la</strong> rivière Ili.<br />
Ils formaient l’un <strong>de</strong>s Etats turcs qui dominaient <strong>la</strong> Sibérie <strong>de</strong> l’Ouest<br />
et le Caucase du Nord au cinquième et sixième siècle. Ils émigrèrent<br />
vers l’Ouest à cause <strong>de</strong>s pressions <strong>de</strong>s avars d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitie<br />
du cinquième siècle. Ils s’installèrent d<strong>ans</strong> le bassin <strong>de</strong> <strong>la</strong> Volga Don<br />
au début du sixième siècle. Là, ils établirent un Etat politique et<br />
militaire puissant. Pendant ce temps, ils s’allièrent aux Sassanids contre<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
27
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
28<br />
les Byzantins. Ils avancèrent vers le centre <strong>de</strong> l’Anatolie. Les forces<br />
Sabares furent cependant affaiblies après <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième attaque <strong>de</strong>s Avars<br />
en 557. Bientôt, ils <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s sujets Göktürks. Au septième siècle,<br />
les Sabars formèrent le corps principal <strong>de</strong> l’Etat Khazar.<br />
4. Le Khanat Khazar<br />
Les Khazars étaient <strong>de</strong>s Turcs semi-noma<strong>de</strong>s d’Asie Centrale. Avant<br />
leur émigration vers l’Ouest, les Khazars composaient l’une <strong>de</strong>s tribus<br />
vivant sous <strong>la</strong> souveraineté <strong>de</strong>s Huns d’Asie. Certains historiens russes<br />
considèrent les Khazars comme <strong>de</strong>s indigènes du Nord Caucase. Ils<br />
étaient parents <strong>de</strong>s tribus Ashina, les fondateurs du premier Empire<br />
göktürk. Après <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier, les Khazars rejoignirent<br />
une confédération tribale <strong>de</strong> l’Ouest dirigée par les tribus Ashina.<br />
L’organisation étatique <strong>de</strong>s Khazars ressemb<strong>la</strong>it à celle <strong>de</strong>s Göktürks.<br />
La première apparition notable <strong>de</strong>s Khazars d<strong>ans</strong> l’Histoire remonte<br />
au début du septième siècle quand ils ont rallié leurs forces à celles<br />
<strong>de</strong> l’Empereur byzantin Héraclius contre les Sassanids. Les Khazars<br />
ont alors épargné une défaite aux Byzantins. Du septième au neuvième<br />
siècle, les Khazars ont entretenu <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec l’Empire<br />
byzantin. A cette même époque, les Khazars avaient <strong>de</strong> sérieuses<br />
altercations avec le Califat <strong>de</strong>s Umawwids Abbassids qui freinèrent<br />
leur exp<strong>ans</strong>ion d<strong>ans</strong> le Caucase en formant un front unifié avec les<br />
Göktürks en Tr<strong>ans</strong>oxiane. Les Khazars ont prospéré d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Mer Caspienne, celle du Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire et en Europe <strong>de</strong> l’Est.<br />
En Europe <strong>de</strong> l’Est, les Khazars réunirent plusieurs tribus qui vivaient<br />
déjà d<strong>ans</strong> cette région. Lorsque Khazaria <strong>de</strong>vint un pouvoir régional<br />
majeur, les Byzantins mirent fin à leur alliance avec les Khazars. Les<br />
Byzantins se tournèrent vers <strong>la</strong> Russie (Les proto-Russes) et les<br />
Petchenègues pour former une alliance contre les Khazars. En 965 les<br />
Khazars furent conquis par les Russes <strong>de</strong> Kiev.<br />
La Royauté et <strong>la</strong> noblesse khazar se convertirent au Judaïsme durant les<br />
<strong>de</strong>rnières décennies du huitième siècle et au début du neuvième siècle.<br />
Une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion Khazar se convertit aussi au Judaïsme alors<br />
qu’une autre partie se convertit à l’Is<strong>la</strong>m et au Christianisme.<br />
5. Les Petchenègues<br />
Après <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong>s Göktürks, les Petchenègues, alors sujets <strong>de</strong>s<br />
Göktürks, se dép<strong>la</strong>cèrent vers l’Ouest. Les Petchenègues dominèrent
le territoire entre <strong>la</strong> basse Volga, le Don et le Diniester au neuvième<br />
siècle. Ils ne parvinrent pas à établir un Etat et gardèrent leur forme<br />
d’organisation <strong>de</strong> confédération tribale. En tant que confédération<br />
tribale, ils jouèrent un rôle important d<strong>ans</strong> l’Histoire mondiale en<br />
obligeant les Oghours à se dép<strong>la</strong>cer <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Azov vers l’Europe<br />
Centrale (aujourd’hui <strong>la</strong> Bulgarie). Ils obligèrent aussi les tribus<br />
Finno-ougrien à se dép<strong>la</strong>cer vers l’Europe. Ils empêchèrent également<br />
les Russes <strong>de</strong> pénétrer <strong>la</strong> Mer Noire pendant un certain temps. Ils<br />
attaquèrent les territoires russes à <strong>de</strong> nombreuses reprises. Après une<br />
alliance <strong>de</strong> longue date, les Petchenègues commencèrent à déranger les<br />
Byzantins. En 1091, les Petchenègues furent vaincus par une alliance<br />
entre les Kiptchaks et les Byzantins. Ils ne se remirent jamais <strong>de</strong> cette<br />
défaite.<br />
6. Le Khanat <strong>de</strong> Kiptchak<br />
Il représenta <strong>la</strong> tribu <strong>la</strong> plus nombreuse et <strong>la</strong> plus puissante <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>rnière vague massive d’émigrations.<br />
Sa première apparition d<strong>ans</strong> l’Histoire n’est pas très c<strong>la</strong>ire. Cependant<br />
on estime que son histoire remonte au huitième ou au début du<br />
neuvième siècle en Asie Centrale <strong>de</strong> l’Est. Ils <strong>de</strong>vinrent les voisins <strong>de</strong>s<br />
Oghouzes lorsque les Qara-Khitaïs les obligèrent à se dép<strong>la</strong>cer vers<br />
l’Ouest. Les Kiptchaks virent leur nombre augmenter et ils s’allièrent<br />
avec les kimseks. Ils commencèrent à déranger les Oghouzes et<br />
provoquèrent leur émigration vers l’Ouest. Puis ils s’attaquèrent aux<br />
principautés russes. Ils dominèrent bientôt le territoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer<br />
Caspienne au Sud <strong>de</strong> l’Ukraine. Ce territoire s’appe<strong>la</strong>it les Steppes<br />
kiptchakes. Ils envahirent <strong>la</strong> Moldavie, <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>chie et une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Tr<strong>ans</strong>ylvanie au onzième siècle puis commencèrent à attaquer l’Empire<br />
Byzantin et le royaume <strong>de</strong> Hongrie. En 1239, les Kiptchaks furent<br />
vaincus par les envahisseurs mongols à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Khalka. Après <strong>la</strong><br />
chute <strong>de</strong> l’Empire mongol, les Kiptchaks qui restèrent sur leur terre<br />
constituèrent une partie importante <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’or. Les Kiptchaks<br />
étaient présents sur ce qui est aujourd’hui <strong>la</strong> Russie, l’Ukraine et<br />
le Kazakhstan. Ils ont joué un rôle important en ce qui concerne <strong>la</strong><br />
turquisation <strong>de</strong>s Mongols.<br />
7. Les Oghours et les Etats bulgares<br />
Les Oghours, comme les Oghouzes, formaient l’une <strong>de</strong>s principales<br />
confédérations tribales turques. Ceux qui émigraient vers l’Ouest en<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
29
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
30<br />
passant par les montagnes du Nord Tien Shan étaient appelés les<br />
« Oghours ». Ils s’installèrent d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région du Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire<br />
et formèrent une union tribale indépendante, comme les Oghouzes<br />
l’avaient fait. L’union tribale <strong>de</strong>s Oghours se composait <strong>de</strong>s Dokuz-<br />
Oghurs d<strong>ans</strong> les steppes <strong>de</strong> <strong>la</strong> région Dniepr, les On-Oghours d<strong>ans</strong> le<br />
Caucase du Nord et les Otuz-Oghours sur une terre s’étendant entre<br />
le Don et <strong>la</strong> Volga. Les Oghours <strong>de</strong> l’Ouest passèrent sous contrôle<br />
göktürk en 576. Quand l’Empire göktürk s’effondra en 630, les On-<br />
Oghours fondèrent <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bulgarie d<strong>ans</strong> le Caucase du Nord sous<br />
l’autorité du Kurt. Kurt venait <strong>de</strong>s Huns d’Asie et il fit une alliance<br />
avec Byzantium. La Gran<strong>de</strong> Bulgarie passa sous contrôle Khazar en<br />
665. Bientôt, les Oghours se dép<strong>la</strong>cèrent vers les Balk<strong>ans</strong> au nord du<br />
Danube sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Asparuh, le fils <strong>de</strong> Kurt. D<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>,<br />
ils fondirent l’Etat bulgare du Danube en 679 sur le territoire au sud <strong>de</strong><br />
l’actuel Bobrudzha (Dobruca).<br />
L’Etat bulgare du Danube entretint <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec les<br />
Byzantins. Il défendit Constantinople quand celle-ci fit assiégée par<br />
les Arabes Umawwids en 717-718. Ce faisant, les Bulgares obtinrent<br />
<strong>de</strong>s avantages économiques considérables et purent sécuriser leurs<br />
frontières Est. Cependant, ce<strong>la</strong> ne dura pas longtemps puisque les<br />
Byzantins attaquèrent les Bulgares lors d’une lutte interne pour le trône<br />
bulgare au milieu du huitième siècle.<br />
En 814, les Byzantins se trouvèrent d<strong>ans</strong> une situation difficile<br />
lorsque Krum Khan assiégea Constantinople. Heureusement pour les<br />
Byzantins, Krum Khan mourut brusquement. Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> son<br />
fils: Omurtag Khan (814-831), <strong>la</strong> Bulgarie connut son apogée d<strong>ans</strong> <strong>de</strong><br />
nombreux domaines. Pendant ce temps, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion turque <strong>de</strong> l’Etat<br />
bulgare du Danube commençait à perdre son i<strong>de</strong>ntité en raison d’une<br />
immigration massive <strong>de</strong> S<strong>la</strong>ves. Quand l’Etat bulgare fut converti au<br />
Christianisme Orthodoxe en 864 par Boris (852-889), les Bulgares du<br />
Danube s’éloignèrent <strong>de</strong>s pratiques culturelles turques pour adopter<br />
celles <strong>de</strong>s s<strong>la</strong>ves.<br />
Un autre Etat crée après <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bulgarie fut l’Etat<br />
bulgare Itıl (Volga). Cet Etat fut fondé au croisement <strong>de</strong>s rivières Itil<br />
et Kama. Sa capitale était Bulgar qui était aussi le principal centre<br />
commercial d’Europe <strong>de</strong> l’Est du neuvième siècle au douzième siècle.
Cet Etat bulgare Volga se convertit à l’Is<strong>la</strong>m en 922. Certains historiens<br />
déc<strong>la</strong>rent qu’il s’agit du premier Etat turc entré d<strong>ans</strong> l’Is<strong>la</strong>m. Les<br />
Bulgares Volga furent vaincus en 1237 par les Mongols. Les Bulgares<br />
Volga ont appartenu à <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or jusqu’à <strong>la</strong> moitié du quinzième<br />
siècle.<br />
Le cours <strong>de</strong> l’Histoire turque commença à changer quand les Turcs<br />
rencontrèrent les Etats musulm<strong>ans</strong> <strong>de</strong>s Umayya<strong>de</strong>s et Abbassi<strong>de</strong>s<br />
en émigrant vers le Moyen Orient et vers l’Anatolie. A travers ces<br />
rencontres, les Turcs se convertirent progressivement à l’Is<strong>la</strong>m.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
31
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
32<br />
CHAPITRE 3<br />
Les premiers Etats musulm<strong>ans</strong> turcs<br />
Le fait que les Turcs se soient convertis à l’Is<strong>la</strong>m peut être analysé d’un<br />
point <strong>de</strong> vue social, historique ou encore politique. Il n’en est pas moins<br />
que cette conversion fut un évènement d’une gran<strong>de</strong> importance.<br />
Considéré d’un point <strong>de</strong> vue socio-économique, le changement <strong>de</strong><br />
religion est s<strong>ans</strong> doute l’un <strong>de</strong>s évènements les plus importants qu’une<br />
personne ou une nation puisse vivre. Quand <strong>la</strong> question se pose pour<br />
une nation, ce changement a <strong>de</strong>s effets directs sur les structures sociales,<br />
politiques et économiques <strong>de</strong> cette nation. La conversion <strong>de</strong>s Turcs à<br />
l’Is<strong>la</strong>m eut donc <strong>de</strong>s répercussions importantes sur l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong> et sur l’Histoire du Mon<strong>de</strong> puisqu’il s’agit d’un évènement<br />
d’une gran<strong>de</strong> importance. En termes historiques, cet évènement<br />
marqua un tournant d<strong>ans</strong> l’Histoire turque, <strong>la</strong> divisant entre l’époque<br />
pré-is<strong>la</strong>mique et l’époque is<strong>la</strong>mique. Ce fut en effet le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong><br />
l’Histoire turque is<strong>la</strong>mique. D’un point <strong>de</strong> vue politique, cet évènement<br />
marqua <strong>la</strong> base d’une nouvelle ère d<strong>ans</strong> l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, qui a<br />
continué jusqu’au vingtième siècle.<br />
Les Turcs n’ont pas pris connaissance <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m durant <strong>la</strong> vie du Prophète<br />
Mohammed et donc, n’ont pas pu développer une connaissance <strong>de</strong><br />
l’Is<strong>la</strong>m tirée directement du Prophète. Les re<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s Turcs avec les<br />
Arabes commencèrent durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> du <strong>de</strong>uxième Calife Omar. Les<br />
Turcs rencontrèrent l’Is<strong>la</strong>m lorsqu’ils aidèrent les Perses d<strong>ans</strong> leur lutte<br />
contre les envahisseurs arabes. Cette première rencontre n’engendra pas<br />
<strong>de</strong> conversion. Mais leur découverte <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m se fit lorsque les armées<br />
is<strong>la</strong>miques conquirent <strong>la</strong> Perse au milieu du septième siècle. En 651, les<br />
armées is<strong>la</strong>miques commencèrent leurs expéditions vers <strong>la</strong> Perse. Elles<br />
passèrent <strong>la</strong> rivière Amu Darya (Ceyhun) reconnue comme <strong>la</strong> frontière<br />
turque, et conquirent <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane en 705. En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> mauvaise<br />
administration <strong>de</strong>s Umayya<strong>de</strong>s d<strong>ans</strong> cette région, les dirigeants turcs<br />
ne <strong>la</strong>issèrent pas les armées is<strong>la</strong>miques Umayya<strong>de</strong>s arriver facilement.<br />
Le Khanat Turgish conduisit une lutte efficace contre les Umayya<strong>de</strong>s.<br />
En 750, les Abbassi<strong>de</strong>s prirent en main l’administration <strong>de</strong> l’Etat<br />
is<strong>la</strong>mique. A ce moment s’opéra un changement d<strong>ans</strong> les re<strong>la</strong>tions<br />
turco-arabes. En Tr<strong>ans</strong>oxiane, alors que <strong>la</strong> lutte turco-arabe continuait,<br />
certains groupes turcs <strong>de</strong>mandèrent l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chine. Pensant qu’il<br />
s’agissait là d’une gran<strong>de</strong> opportunité <strong>de</strong> dominer le Turkménistan,<br />
<strong>la</strong> Chine envoya une armée importante à l’Ouest en 747. L’attitu<strong>de</strong>
grossière <strong>de</strong>s Chinois d<strong>ans</strong> cette région cependant fit que les Turcs<br />
se détachèrent <strong>de</strong> cette force. Ils <strong>de</strong>mandèrent l’ai<strong>de</strong> du gouverneur<br />
<strong>de</strong> Khorasan <strong>de</strong> l’Etat is<strong>la</strong>mique contre les Chinois. Le gouverneur<br />
Ebu Muslim accepta d’offrir son ai<strong>de</strong> et envoya une armée contre les<br />
Chinois. En juillet 751, les Chinois et les Turcs aidés par les musulm<strong>ans</strong><br />
se sont battus près <strong>de</strong> ce qui est aujourd’hui Almaty, sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
rivière Ta<strong>la</strong>s. Lors <strong>de</strong> cette guerre, qu’on a appelée <strong>la</strong> guerre Ta<strong>la</strong>s, les<br />
Chinois furent vaincus.<br />
Cette guerre Ta<strong>la</strong>s représente une pierre angu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> l’Histoire<br />
turque. En effet, les disputes entre Turcs et Arabes cessèrent, <strong>de</strong><br />
bonnes re<strong>la</strong>tions furent établies. La paix commença. Les re<strong>la</strong>tions<br />
commerciales commencèrent et les Turcs purent développer leur<br />
connaissance <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m. C’est ainsi que l’Is<strong>la</strong>m se répandit parmi les<br />
Turcs. Avant d’adopter cette religion, les Turcs croyaient en d’autres<br />
religions comme le Manichéisme, le bouddhisme et le Zoroastrisme.<br />
Ils avaient donc déjà avant changé <strong>de</strong> religion. Cependant, aucune <strong>de</strong>s<br />
précé<strong>de</strong>ntes religions n’avait été acceptée par une majorité aussi forte.<br />
Pendant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> Umayya<strong>de</strong>, <strong>la</strong> conversion à l’Is<strong>la</strong>m concerna <strong>de</strong>s<br />
groupes d’individus regroupés. Durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> Abbassi<strong>de</strong>, l’Is<strong>la</strong>m<br />
étendit son influence et commença à être adopté par beaucoup. Une<br />
politique modérée <strong>de</strong>s Abbassi<strong>de</strong>s envers les musulm<strong>ans</strong> non arabes<br />
joua une gran<strong>de</strong> importance d<strong>ans</strong> ce processus. A partir du neuvième<br />
siècle, une conversion à l’Is<strong>la</strong>m <strong>de</strong> masse se fit parmi les groupes turcs.<br />
Ils servirent tout d’abord l’Etat is<strong>la</strong>mique puis fondèrent <strong>de</strong>s Etats<br />
indépendants qui <strong>de</strong>vinrent par <strong>la</strong> suite suffisamment puissants pour<br />
déci<strong>de</strong>r du <strong>de</strong>stin du mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique.<br />
1. Le Khanat Karakhani<strong>de</strong> (840-1212)<br />
Ce Khanat fut fondé par les cl<strong>ans</strong> Yaghma, Cigil et Tohsi en 840. Ce<br />
Khanat fut fondé après <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> l’Etat ouïghour suite à <strong>la</strong> victoire<br />
<strong>de</strong>s Kirghizes et après que les Karlouks Yabghu se soient déc<strong>la</strong>rés<br />
comme étant les seuls <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> droit <strong>de</strong>s maîtres <strong>de</strong>s Steppes. En<br />
893, il <strong>de</strong>vint le centre <strong>de</strong> l’Etat Kashgar. Les Européens orientalistes<br />
donnèrent le nom <strong>de</strong> Karakhani<strong>de</strong> au premier Etat is<strong>la</strong>mique qui<br />
régna au Turkestan <strong>de</strong> l’Ouest et <strong>de</strong> l’Est. Ce nom vient du mot ‘’Kara’’<br />
(puissant) qui était souvent utilisé comme titre parmi les gens <strong>de</strong> cet<br />
Etat. Par exemple, lorsque le Qarluq Yabghu se déc<strong>la</strong>ra maître <strong>de</strong>s<br />
Steppes, il utilisa le nom <strong>de</strong> Kara Khan.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
33
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
34<br />
Le Khanat Karakhani<strong>de</strong>, conformément à <strong>la</strong> structure traditionnelle <strong>de</strong><br />
l’Etat turc, se divisait en <strong>de</strong>ux parties : une partie droite et une partie<br />
gauche. Le Grand Khan qui était le dirigeant <strong>de</strong> tout l’Etat, se situait sur<br />
<strong>la</strong> partie droite. D<strong>ans</strong> <strong>la</strong> partie gauche se trouvait <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième personne<br />
au pouvoir, qui aurait du être appelée Yabghu, mais qui, à cause du titre<br />
du Khan utilisé d<strong>ans</strong> l’Etat était plutôt appelé « le Khan dépendant ».<br />
Les provinces autonomes qui existaient <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux côtés étaient<br />
administrées par les fils du Sultan ou par <strong>de</strong>s gouverneurs militaires<br />
qui dépendaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie. Après que le Khanat Karakhani<strong>de</strong><br />
eut été divisé en partie Est-droite et Ouest-gauche, <strong>la</strong> tradition<br />
d’avoir une administration divisée s’instal<strong>la</strong>. Aucune information n’a<br />
été enregistrée d<strong>ans</strong> les textes historiques sur les grands Kh<strong>ans</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
partie Est. La seule information disponible sur cet Etat vient <strong>de</strong>s kh<strong>ans</strong><br />
secondaires <strong>de</strong> l’Ouest qui entretenaient <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec le<br />
mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique et qui présidaient <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Il est parfois difficile d’être sur quant à <strong>la</strong> personne à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Au début du Khanat khanid, (sur lequel nous avons peu d’informations)<br />
le premier dirigeant connu a été le Khan Bilge Kül Kadir. Seule sa<br />
bataille contre les Samanids a fait l’objet <strong>de</strong> récits écrits. Après lui, ses<br />
fils Khan Ogulcak Kadir et Khan Bazir Ars<strong>la</strong>n ont gouverné l’Etat.<br />
Le neveu <strong>de</strong> Khan Ogulcak Kadir : Satık Bughra arriva au pouvoir<br />
après avoir détrôné son oncle. Il fit <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m <strong>la</strong> religion officielle <strong>de</strong>s<br />
provinces dont il avait le contrôle. Durant son règne, il prit le nom <strong>de</strong><br />
Abdulkerim après sa conversion à l’Is<strong>la</strong>m et cette religion se répandit<br />
rapi<strong>de</strong>ment parmi les tribus turques. Durant le règne <strong>de</strong> ses successeurs,<br />
principalement celui <strong>de</strong> Baytash Ars<strong>la</strong>n Khan Suleyman, l’Is<strong>la</strong>m se<br />
répandit d<strong>ans</strong> tout le pays. Le Khanat Karakhani<strong>de</strong> poursuivit donc sa<br />
vie en tant qu’Etat musulman turc à partir <strong>de</strong> 960.<br />
En ce qui concerne son histoire politique, le khanat Karakhani<strong>de</strong> s’est<br />
battu contre les Samanids, les Ghaznévi<strong>de</strong>s et plus tard, contre les<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s. Pendant le règne <strong>de</strong> Kılıç Bughra Khan, l’Etat samanid<br />
fut détruit et <strong>la</strong> région Tr<strong>ans</strong>oxiane conquise. Cependant, les Khanids<br />
ne réussirent pas à prendre Khorasan <strong>de</strong>s Ghaznévi<strong>de</strong>s. Après que sa<br />
domination sur <strong>de</strong> nombreuses régions eut été établie d<strong>ans</strong> les années<br />
1030, <strong>de</strong>s luttes pour le pouvoir commencèrent à l’intérieur du Khanat<br />
et ce<strong>la</strong> entraîna <strong>la</strong> division du pays en <strong>de</strong>ux Etats indépendants en 1042 :<br />
le Khanat occi<strong>de</strong>ntal et le Khanat oriental. Le Khanat Karakhani<strong>de</strong><br />
occi<strong>de</strong>ntal dominait les régions al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane à Fergana.<br />
Son centre fut d’abord Özkent puis Samarkand. En 1074, cet Etat fut
intégré au Grand Empire Seldjouki<strong>de</strong>. Quand les Seldjouki<strong>de</strong>s furent<br />
vaincus par les Qara-Khitaï, l’Etat passa aux mains <strong>de</strong>s vainqueurs. En<br />
1212 les Harzemshahs mirent fin à <strong>la</strong> vie <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Le centre politique et militaire du Khanat occı<strong>de</strong>ntal Karakhani<strong>de</strong> était<br />
Ba<strong>la</strong>sagun, son centre culturel et religieux Kashgar. Le Khanat dominait<br />
les régions <strong>de</strong> Ba<strong>la</strong>sagun, Ta<strong>la</strong>s, Tashkent, Kashgar, Yarkent et Hotan.<br />
Ils luttèrent pour répandre l’Is<strong>la</strong>m parmi les turcs non musulm<strong>ans</strong> à<br />
l’Est <strong>de</strong> l’Etat. En 1089, l’Etat passa aux mains du Grand Empire<br />
seldjouki<strong>de</strong> et fut détruit en 1211 par les Qara-khitaï. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s<br />
Khanats Karakhani<strong>de</strong>s occi<strong>de</strong>ntaux et orientaux, un troisième khanat<br />
Karakhani<strong>de</strong> fut fondé en 1141, le Khanat Fergana, dont le centre était<br />
Ozkent. Il disparut en 1212.<br />
2. L’Empire ghaznévi<strong>de</strong> (963-1187)<br />
Il s’agissait d’un Etat is<strong>la</strong>mique turc fondé en 963 en Afghanistan.<br />
Cet Empire emprunta son nom <strong>de</strong> Ghazna, <strong>la</strong> ville où il fut fondé.<br />
Devenant un pouvoir régional important, particulièrement au Nord <strong>de</strong><br />
l’In<strong>de</strong>, cet empire prit une p<strong>la</strong>ce importante parmi les premiers Etats<br />
turcs is<strong>la</strong>miques.<br />
Aux neuvième et dixième siècles, les Turcs avaient commencé à<br />
participer et à servir d<strong>ans</strong> les Etats is<strong>la</strong>miques. Avec le temps, ils<br />
<strong>de</strong>vinrent un groupe <strong>de</strong> gouverneurs et commandants d’élite d<strong>ans</strong><br />
ces Etats. Ceux qui ont fondé l’Etat ghaznévi<strong>de</strong> étaient <strong>de</strong>s Turcs qui<br />
avaient d’abord servi l’Etat samanid. Lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> désintégration <strong>de</strong> l’Etat<br />
samanid, Alptegin qui était l’un <strong>de</strong>s commandants <strong>de</strong> l’Etat samanid<br />
fut nommé gouverneur <strong>de</strong> Khorasan. Bel’ami, le vizir <strong>de</strong> l’Etat samanid<br />
<strong>de</strong> l’époque, défia Alptegin pour <strong>la</strong> suprématie <strong>de</strong> l’Etat samanid mais<br />
ne réussit pas. Alptegin vainquit l’armée envoyée contre lui et vint<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Ghazna en Afghanistan d’où il fit fuir les rési<strong>de</strong>nts, les<br />
Leviks, en 962. Il commença à dominer <strong>la</strong> ville et se déc<strong>la</strong>ra dirigeant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> région en 963 puis fondit l’Empire Ghaznévi<strong>de</strong>.<br />
Du temps <strong>de</strong> son successeur, Ebu Ishak Ibrahim, Ghazna fut reprise<br />
par les Leviks. Puis reprise à nouveau par les Ghaznévi<strong>de</strong>s. Comme<br />
Ebu Ishak Ibrahim n’avait pas <strong>de</strong> fils, l’administration <strong>de</strong> l’Etat<br />
passa aux mains <strong>de</strong> son commandant. Bilge Tegin, le premier <strong>de</strong> ces<br />
commandants, déc<strong>la</strong>ra sa dépendance vis-à-vis <strong>de</strong>s Samanids. Après<br />
Bilge Tegin, Bori Tegin arriva au pouvoir mais les Ghaznévi<strong>de</strong>s<br />
n’apprécièrent pas son administration et invitèrent les leviks à dominer<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
35
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
36<br />
<strong>la</strong> cité. Un autre commandant : Sebüktigin, tout d’abord empêcha les<br />
Leviks d’entrer d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville, puis détrônant Bori Tegin, prit sa p<strong>la</strong>ce en<br />
977. Alors que Sebüktigin était indépendant d<strong>ans</strong> sa région, il accepta<br />
<strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s Samanids.<br />
Après l’arrivée au pouvoir <strong>de</strong> Sebuktigin, un changement important<br />
d<strong>ans</strong> l’administration <strong>de</strong> l’Etat Ghaznévi<strong>de</strong> se fit. L’Etat avait jusque<br />
là été administré par <strong>de</strong>s commandants. Sous Sebuktigin, le système<br />
administratif fut changé en dynastie. Il avait probablement pensé que<br />
<strong>la</strong> meilleure façon <strong>de</strong> préserver l’Etat était d’en é<strong>la</strong>rgir les frontières<br />
car à peine arrivé au pouvoir, il changea le système administratif et<br />
commença à é<strong>la</strong>rgir son territoire. Bientôt, le territoire comprit aussi<br />
le Toharistan, le Zabulistan, le Zemindaver, le Gur et le Belucistan.<br />
Plus tard, Sebuktigin envoya une expédition militaire vers l’In<strong>de</strong> afin <strong>de</strong><br />
pouvoir l’inclure d<strong>ans</strong> son territoire. Ce faisant, Sebüktigin joua un rôle<br />
important d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> dissémination <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m jusqu’à Peshaver, au Nord<br />
<strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. Il aida également son fils Mahmut à réprimer <strong>la</strong> rébellion<br />
samanid d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région Khorasan. Afin <strong>de</strong> le remercier <strong>de</strong> ses efforts,<br />
l’Etat samanid lui attribua le titre <strong>de</strong> ‘’Nair al-din’’, (celui qui propage <strong>la</strong><br />
religion) et nomma son fils Mahmut gouverneur <strong>de</strong> Khorasan. Quand<br />
il mourut en 997 à Ghazna, Mahmut lui succéda.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>vint un personnage important <strong>de</strong> l’Empire ghaznévi<strong>de</strong><br />
mais aussi, <strong>de</strong> l’Histoire turque. Il fut le premier dirigeant à utiliser le<br />
titre <strong>de</strong> Sultan. Au début <strong>de</strong> son règne, il lutta contre son frère pour<br />
le pouvoir. Lors <strong>de</strong> cette lutte pour le pouvoir au sein <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille, les<br />
Samanids envahirent Khorasan et y installèrent un gouverneur. Après<br />
qu’il ait vaincu son frère et après avoir garanti sa domination d<strong>ans</strong><br />
l’Etat, Mahmut <strong>de</strong>manda au dirigeant samanid <strong>de</strong> quitter Khorasan.<br />
Sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> étant rejetée, il envahit Khorasan. L’Etat samanid fut si<br />
affaibli après <strong>la</strong> perte <strong>de</strong> Khorasan que le Khanat Karakhani<strong>de</strong> finit pas<br />
disparaître. C’est ainsi que les Ghaznévi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vinrent indépendants.<br />
La première tâche du Sultan Mahmut fut <strong>de</strong> signer un traité avec les<br />
Karakhani<strong>de</strong>s. D’après ce traité, les terres <strong>de</strong>s Samanids furent partagées<br />
et <strong>la</strong> partie Nord <strong>de</strong> l’Etat fut sécurisée contre les invasions étrangères.<br />
Le Sultan Mahmut captura ensuite Sistan, Huttal et Khwarezm. Suite<br />
à cette série <strong>de</strong> victoires, il envoya <strong>de</strong>s expéditions militaires en In<strong>de</strong>.<br />
Ces expéditions avaient un double enjeu : répandre l’Is<strong>la</strong>m en In<strong>de</strong> et<br />
prendre possession <strong>de</strong>s richesses. Mahmut envoya donc 17 expéditions<br />
en In<strong>de</strong> entre 1001 et 1027. Ce faisant, il étendit <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s<br />
Turcs sur toute <strong>la</strong> partie Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>, incluant les régions <strong>de</strong> Pencap,
Indus, Und, Moltan, Tanisar, Lokhot, Gwalior et Somnat. L’Is<strong>la</strong>m<br />
se répandit massivement au Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> grâce à ses expéditions.<br />
C’est également à cette pério<strong>de</strong> que les fondations <strong>de</strong> l’actuel Pakistan<br />
furent posées. Mahmut jouissait d’un grand prestige d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong><br />
is<strong>la</strong>mique. Il fut l’un <strong>de</strong>s plus grands dirigeants <strong>de</strong> l’Histoire is<strong>la</strong>mique<br />
turque. Quand il arriva au pouvoir, l’Etat ghaznévi<strong>de</strong> était une petite<br />
principauté. Mais à sa mort, en 1030, c’était <strong>de</strong>venu un empire dont les<br />
frontières s’étendaient à l’Ouest à l’Azerbaïdjan, à l’Est aux vallées du<br />
Gange <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>, en Asie mineure <strong>de</strong> Kharezm à l’Océan Indien.<br />
D<strong>ans</strong> <strong>la</strong> lutte pour le pouvoir qui suivit <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Mahmut entre ses<br />
fils, Mesut sortit vainqueur et prit <strong>la</strong> succession. Il se montra aussi<br />
capable que son père d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> l’Empire. Durant son règne,<br />
l’armée du Grand Empire seldjouki<strong>de</strong> tenta d’envahir Khorasan et<br />
présenta donc une réelle menace pour les Ghaznévi<strong>de</strong>s. Ceux-ci furent<br />
battus à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Dandanaqan. Les Ghaznévi<strong>de</strong>s durent donc se<br />
retirer <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> et perdirent Khorasan, Khwarezm et toutes les régions<br />
du Nord. Mesut fut assassiné lors d’une rébellion lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> retraite. Les<br />
Ghaznévi<strong>de</strong>s ne purent pas récupérer après ces évènements. Ibrahim,<br />
qui <strong>de</strong>vint le sultan en 1059 accepta <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s.<br />
Cette dépendance continua jusqu’à <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers face<br />
aux Qara-Khitaï à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Katvan. La domination seldjouki<strong>de</strong><br />
prenant fin à Ghazna, le A<strong>la</strong>uddin Ghorid Afghan captura <strong>la</strong> ville.<br />
En 1187, les Ghorids prirent également le nouveau centre <strong>de</strong> Lahor et<br />
tuèrent son <strong>de</strong>rnier dirigeant : Husrev Melik. Ils mirent fin à l’empire<br />
ghaznévi<strong>de</strong>.<br />
L’Empire ghaznévi<strong>de</strong> occupe une p<strong>la</strong>ce importante d<strong>ans</strong> l’Histoire<br />
is<strong>la</strong>mique turque en raison <strong>de</strong> projets audacieux concernant l’In<strong>de</strong> qui<br />
contribuèrent à répandre l’Is<strong>la</strong>m.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
37
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
38<br />
CHAPITRE 4<br />
Le Grand Empire seldjouki<strong>de</strong><br />
Cet empire fut fondé par les Turcs Oghouzes et est aussi connu sous<br />
le nom <strong>de</strong> Kınık Seljuk. L’Empire tira son nom <strong>de</strong> Seldjouk Bey, un<br />
commandant d<strong>ans</strong> l’Etat Yabghu Oghouz qui immigra d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région<br />
Cend avec son c<strong>la</strong>n sous son règne et fonda l’Etat seldjouki<strong>de</strong>. Son<br />
père, Dukak, était également commandant d<strong>ans</strong> l’Etat Seljouki<strong>de</strong>. Son<br />
fils prit sa succession. En quittant le Yabghu, il émigra vers le Sud, vers<br />
<strong>la</strong> région Cend sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Syr-Darya. Une autre raison<br />
<strong>de</strong> cette émigration, comme d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> nombreuses émigrations, était <strong>la</strong><br />
recherche <strong>de</strong> terres pour nourrir <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion croissante.<br />
L’arrivée <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s d<strong>ans</strong> cette région marqua le commencement<br />
d’une pério<strong>de</strong> importante d<strong>ans</strong> l’Histoire. La région avait été habitée<br />
par <strong>de</strong>s musulm<strong>ans</strong> venus <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane et d’une ville frontalière<br />
entre les pays is<strong>la</strong>miques et les Turcs. A ce moment, <strong>de</strong> nombreux<br />
cl<strong>ans</strong> turcs s’étaient déjà convertis à l’Is<strong>la</strong>m. Seldjouk, lui, n’était pas<br />
encore musulman. Il fit venir <strong>de</strong>s gui<strong>de</strong>s religieux <strong>de</strong>s pays is<strong>la</strong>miques<br />
<strong>de</strong>s alentours comme <strong>de</strong> Boukhara et <strong>de</strong> Khwarezm (Harezm).<br />
Ceux-ci permirent une bonne instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> Seldjouk à Cend. En<br />
960, Seldjouk se convertit à l’Is<strong>la</strong>m avec les Oghouzes vivant sous<br />
sa domination. Ces <strong>de</strong>rniers convertis à l’Is<strong>la</strong>m se firent appelés les<br />
« Turkmens ». Ce nom fut porté aussi par les Oghouzes qui émigrèrent<br />
vers les pays musulm<strong>ans</strong>.<br />
Après avoir adopté l’Is<strong>la</strong>m, Seldjouk gagna du pouvoir d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région.<br />
Il décida <strong>de</strong> rompre ses liens politiques avec les Yabghus et renvoya<br />
les collecteurs d’impôts du Yabghu Oghouz en déc<strong>la</strong>rant qu’il ne<br />
payerait pas <strong>de</strong> taxes à <strong>de</strong>s non musulm<strong>ans</strong>. Ce faisant, il s’affirmait<br />
en tant que vétéran prêt à se battre pour l’Is<strong>la</strong>m. Il reçut ainsi le titre<br />
<strong>de</strong> El-Melikul Ghazi. Ce<strong>la</strong> offrait <strong>de</strong>ux avantages aux Seldjouki<strong>de</strong>s :<br />
d’abord, ils obtenaient le soutien <strong>de</strong> nombreux musulm<strong>ans</strong> et les<br />
Turcs se décidèrent à se joindre à eux et d’autre part, ils diminuèrent <strong>la</strong><br />
domination <strong>de</strong>s Yabghus autour d’eux afin d’établir une administration<br />
indépendante. Alors que l’Etat seldjouki<strong>de</strong> <strong>de</strong>venait plus puissant d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> région, il fut reconnu par les pays voisins comme une force majeure<br />
sur <strong>la</strong> scène internationale. Les Seldjouki<strong>de</strong>s gagnèrent tant d’estime<br />
que quand les Samanids et les Karakhani<strong>de</strong>s se battaient, les Samanids<br />
<strong>de</strong>mandèrent leur ai<strong>de</strong>. Celle-ci fut accordée et les Samanids furent<br />
victorieux. Ils remercièrent les Seldjouki<strong>de</strong>s en leur donnant comme
terre Nur, entre Bukhara et Samarkand en 985. D<strong>ans</strong> les décennies qui<br />
ont suivi, les Seldjouki<strong>de</strong>s ont continué à jouer un rôle important d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> lutte entre les Samanids et les Karakhani<strong>de</strong>s.<br />
Seldjouk Bey mourut vers l’âge <strong>de</strong> 100 <strong>ans</strong>, à Cend. Son successeur fut<br />
Ars<strong>la</strong>n qui arriva au pouvoir avec le titre <strong>de</strong> Yabghu. Les petits-enfants<br />
<strong>de</strong> Seldjouk Bey, Tugrul et Çağrı (Fils <strong>de</strong> Mikhail qui mourut quand<br />
son père était toujours vivant) rentrèrent d<strong>ans</strong> l’administration avec<br />
le titre <strong>de</strong> Bey. Ils envisageaient le futur du pays avec une vaste terre.<br />
Tugrul se dirigea donc vers <strong>de</strong>s déserts difficiles d’accès alors que son<br />
frère conduisait une expédition vers l’Anatolie <strong>de</strong> l’Est avec une force<br />
militaire importante <strong>de</strong> 1016 à 1021. L’armée <strong>de</strong> Çağrı se composait à<br />
l’origine <strong>de</strong> cinq ou six milles soldats auxquels s’ajoutaient <strong>de</strong>s hommes<br />
qui se joignirent à eux lors <strong>de</strong> leur passage par Khorasan. Ils firent<br />
face aux Géorgiens et aux Arméniens en Anatolie <strong>de</strong> l’Est. Ce fut une<br />
victoire pour Cağrı qui considéra qu’il n’y avait plus d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong><br />
force capable <strong>de</strong> leur résister. Cette confiance en eux les poussa à prendre<br />
<strong>de</strong>s décisions militaires et économiques importantes. Pendant ce temps<br />
Ars<strong>la</strong>n Yabghu et son successeur Yusuf moururent. Musa Inanç Yabghu<br />
vint à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s. Cependant, c’est Tugrul Bey et Çağrı<br />
Bey qui détenaient leur vrai pouvoir. Les expéditions en Anatolie <strong>de</strong><br />
l’Est augmentèrent l’importance <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux frères <strong>de</strong> telle manière que<br />
l’Empire ghaznévi<strong>de</strong> commença à considérer les Seldjouki<strong>de</strong>s comme<br />
une menace.<br />
En 1035, les Seldjouki<strong>de</strong>s entrèrent d<strong>ans</strong> Khorasan s<strong>ans</strong> l’autorisation<br />
<strong>de</strong>s Ghaznévi<strong>de</strong>s qui dirigeaient <strong>la</strong> ville. Ils rassemblèrent les groupes <strong>de</strong><br />
Turkmens <strong>de</strong> Khorasan sous leur influence et <strong>de</strong>mandèrent qu’on leur<br />
donne <strong>la</strong> ville. Le Sultan Mesut refusa et pour leur faire quitter <strong>la</strong> ville,<br />
mit en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>ux attaques militaires contre l’Etat Seldjouki<strong>de</strong>, l’une<br />
en 1035, l’autre en 1038. Les Seldjouki<strong>de</strong>s y résistèrent et comprirent<br />
aussi qu’ils pouvaient trouver un soutien à Khorasan. Ils y installèrent<br />
un pouvoir permanent. D’autre part, à Khorasan, un Khutba (ensemble<br />
<strong>de</strong> sermons sacrés faits <strong>la</strong> vielle <strong>de</strong> <strong>la</strong> prière du vendredi) fut lu au nom<br />
<strong>de</strong> Tugrul Bey. Des nouvelles terres conquises furent distribuées parmi<br />
les membres <strong>de</strong> sa famille. Mesut, le sultan ghaznévi<strong>de</strong> voulut mettre<br />
fin définitivement à ce problème et se dirigea avec une gran<strong>de</strong> armée<br />
vers Khorasan.<br />
Les <strong>de</strong>ux armées se rencontrèrent près du château <strong>de</strong> Dandanaqan.<br />
Après une bataille <strong>de</strong> trois jours (22-24 mai 1040), les Ghaznévi<strong>de</strong>s<br />
furent durement vaincus. Les conséquences politiques <strong>de</strong> cette bataille<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
39
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
40<br />
en font une bataille importante <strong>de</strong> l’Histoire. Elle était en effet<br />
<strong>de</strong>venue pour les Seldjouki<strong>de</strong>s une guerre d’indépendance. Ils étaient<br />
parvenus à créer un Etat indépendant à Khorasan, ce qui avait constitué<br />
un but important <strong>de</strong>puis leur établissement à Cend. Tugrul Bey fut<br />
déc<strong>la</strong>ré Sultan (1040-1063) après <strong>la</strong> bataille et l’Etat seldjouki<strong>de</strong> fut<br />
officiellement crée avec son centre d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Nishapur.<br />
La montée <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong><br />
La première action <strong>de</strong> Tugrul Bey en tant que souverain fut <strong>de</strong><br />
distribuer les nouvelles terres <strong>de</strong> l’empire parmi les membres <strong>de</strong><br />
sa famille. Il envoya également un délégué au Calife Abbassid à<br />
Bagdad pour déc<strong>la</strong>rer sa reconnaissance <strong>de</strong> l’autorité du Calife et son<br />
désir <strong>de</strong> suivre <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m. Sous Tugrul Bey, les frontières <strong>de</strong><br />
l’Empire seldjouki<strong>de</strong> s’é<strong>la</strong>rgirent rapi<strong>de</strong>ment. En dix <strong>ans</strong>, les frontières<br />
atteignirent Herat, Sistan, Khwarezm, Kirman et Amman. Rendant les<br />
dynasties <strong>de</strong> Perse dépendantes, Tugrul prit contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Rey.<br />
Il dép<strong>la</strong>ça ensuite le centre <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> à Rey.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> sa politique exp<strong>ans</strong>ionniste, l’une <strong>de</strong>s réussites <strong>de</strong> Tugrul<br />
Bey fut <strong>la</strong> série d’attaques qu’il porta en Anatolie avec le soutien <strong>de</strong>s<br />
Turkmens. Les Oghouzes commencèrent à émigrer en masse sur les<br />
terres sous contrôle seldjouki<strong>de</strong>. Afin d’établir l’ordre sur ces terres et<br />
afin <strong>de</strong> trouver une terre d’accueil pour les Turkmens qui semaient<br />
le trouble là où ils al<strong>la</strong>ient, Tugrul Bey les dirigea vers l’Anatolie qui<br />
était sous domination byzantine à ce moment. En 1048, les Turkmens<br />
portèrent plusieurs attaques en Anatolie. Ils vainquirent les Byzantins,<br />
les Arméniens et les Géorgiens plusieurs fois. Tugrul Bey commanda<br />
lui-même l’une <strong>de</strong> ces attaques en 1054. Après son départ d’Anatolie,<br />
les attaques et conquêtes furent continuées par les Princes, Emirs et<br />
Beys turkmens désignés par Tugul Bey. Toutes ces actions préparaient<br />
en réalité le terrain pour l’appropriation <strong>de</strong> l’Anatolie en tant que terre<br />
natale par les Turcs.<br />
Un autre fait remarquable durant le règne <strong>de</strong> Tugrul Bey fut<br />
l’établissement <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec le Calife Abbassid. Ainsi, les<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vinrent un Etat important du mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique. Au<br />
début <strong>de</strong> son règne, Tugrul Bey avait annoncé sa dépendance vis-àvis<br />
du califat et un Khutbe avait été lu en son honneur. Un lien fut<br />
établi entre les <strong>de</strong>ux parties avec le mariage du Calife Abbassid Kaim<br />
Biemril<strong>la</strong>h et <strong>la</strong> fille <strong>de</strong> Çağrı Bey. En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> cet arrangement, il<br />
y avait également une autre raison <strong>de</strong> ce respect et <strong>de</strong> cette p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong><br />
marque d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique gagné par les Seldjouki<strong>de</strong>s : A cette
époque, les Abassids souffraient d’une oppression exercée par les Shiites<br />
Fatimi<strong>de</strong>s et les Buveyhogul<strong>la</strong>rıs. A <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> du Calife <strong>de</strong> libérer<br />
Bagdad <strong>de</strong> l’oppresseur Shiite en 1055, l’armée <strong>de</strong> Tugrul Bey entra<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville et <strong>la</strong> libéra <strong>de</strong>s Fatimi<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s Buveyhogul<strong>la</strong>rıs. C’est<br />
ainsi que les Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vinrent les lea<strong>de</strong>rs du mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique<br />
et les protecteurs <strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m Sunnite. Tugrul Bey mourut un an après<br />
l’expédition <strong>de</strong> Bagdad, alors que son empire s’étendait <strong>de</strong> Amu Darya<br />
aux rivières Euphrates.<br />
Avant sa mort, Tugrul Bey avait désigné son neveu : Suleyman en<br />
tant que successeur. Cependant, après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> son oncle, Suleyman<br />
dut faire face à une lutte pour le pouvoir avec son frère : Alpars<strong>la</strong>n.<br />
C’est lui qui arriva au pouvoir en 1064, fit certains changements d<strong>ans</strong><br />
l’administration et nomma Nizamulmulk, l’auteur <strong>de</strong> Siyasetnama,<br />
Vizir. Il p<strong>la</strong>ça ses gens aux postes importants et partit en conquêtes. Au<br />
printemps 1064, Alpars<strong>la</strong>n partit pour une expédition en Azerbaïdjan.<br />
Les Arméniens <strong>de</strong> Arran furent p<strong>la</strong>cés sous sa dépendance. Ani, le<br />
centre <strong>de</strong>s Arméniens Bagrat et ville célèbre pour ses remparts, et Kars<br />
furent conquis. Ani était l’une <strong>de</strong>s villes chrétiennes les plus importantes<br />
<strong>de</strong> l’Est. C’est pourquoi sa prise eut un grand succès d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong><br />
is<strong>la</strong>mique. En récompense, Alpars<strong>la</strong>n reçut le titre <strong>de</strong> Ebul Feth (Le<br />
père <strong>de</strong> conquête). Plus tard, Alpars<strong>la</strong>n mit en p<strong>la</strong>ce une expédition vers<br />
l’Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> région et al<strong>la</strong> vers le Turkestan. Il captura Cend après une<br />
série <strong>de</strong> conflits. Cependant, l’un <strong>de</strong>s plus grands mérites d’Alpars<strong>la</strong>n<br />
fut sa victoire contre les Byzantins à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Manzikert. Cette<br />
victoire eut <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s conséquences sur l’Histoire du Grand Empire<br />
seldjouki<strong>de</strong> et sur l’Histoire turque. L’évènement qui mena à <strong>la</strong> bataille<br />
<strong>de</strong> Manzikert fut l’entrée <strong>de</strong> Alpars<strong>la</strong>n en Anatolie qui était sous<br />
domination Byzantine à cette époque. Il captura aussi <strong>la</strong> Géorgie lors<br />
<strong>de</strong> sa <strong>de</strong>uxième expédition caucasienne. En 1069, il entra en Anatolie<br />
et prévit d’attaquer l’Etat Fatimi en se dép<strong>la</strong>çant vers l’Egypte. En<br />
1070, il prit Manzikert, Ercis, Siverek, Aleppo et envisagea d’aller vers<br />
Damascus. Cependant, apprenant que l’Empereur byzantin Romanos<br />
Diogenes avait envoyé une gran<strong>de</strong> armée pour éliminer <strong>la</strong> menace<br />
turque <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, il changea d’avis et resta en Anatolie pour lutter<br />
contre les armées byzantines.<br />
La bataille <strong>de</strong> Manzikert (26 Août 1071)<br />
Les armées seldjouki<strong>de</strong>s et byzantines se firent face le 26 Août 1071<br />
à Manzikert. Ce fut une gran<strong>de</strong> victoire pour Alpars<strong>la</strong>n contre les<br />
forces ennemies. L’Empereur byzantin Diogenes fut capturé. Il fut<br />
libéré et renvoyé chez lui par <strong>la</strong> signature d’un traité le 3 septembre<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
41
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
42<br />
1071. D’après ce traité, les Byzantins payeraient un impôt annuel aux<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s et les ai<strong>de</strong>raient militairement quand ce<strong>la</strong> leur serait<br />
<strong>de</strong>mandé. Cependant, ce traité ne fut pas appliqué en raison d’un<br />
changement <strong>de</strong> pouvoir du coté byzantin.<br />
Une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s conséquences <strong>de</strong> cette bataille fut qu’elle établissait<br />
un précé<strong>de</strong>nt pour les attaques turques en Anatolie d<strong>ans</strong> le but d’en faire<br />
une terre <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce permanente. La victoire fut le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> ce projet. Alpars<strong>la</strong>n donna à ses commandants <strong>la</strong> mission<br />
<strong>de</strong> conquérir toute l’Anatolie. Cette bataille ainsi que son dénouement<br />
sollicita bien sûr <strong>de</strong>s réactions en Europe. Si le mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique se<br />
réjouissait, ce n’était pas le cas <strong>de</strong> l’Europe qui s’indignait et se préparait<br />
aux croisa<strong>de</strong>s pour sauver l’Empire byzantin <strong>de</strong>s Turcs.<br />
Le Sultan Alpars<strong>la</strong>n mourut le 24 novembre 1072 alors qu’il se dirigeait<br />
vers <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane pour se battre contre le Khanat Karakhani<strong>de</strong>. Son<br />
fils, Melikshah prit sa succession comme l’avait voulu son père. Il<br />
garda avec lui le Vizir <strong>de</strong> son père Nizamulmulk. Au début <strong>de</strong> son<br />
règne, il dut faire face à une rébellion organisée par son oncle Kavurt.<br />
Il dut également faire face à <strong>la</strong> vio<strong>la</strong>tion par les Karakhani<strong>de</strong>s et<br />
les Ghaznévi<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s frontières <strong>de</strong> l’Empire. Après avoir résolu ces<br />
problèmes, il s’atte<strong>la</strong> à d’autres conquêtes. L’Anatolie était le territoire<br />
que Melikshah convoitait le plus et sa conquête fut précipitée par<br />
<strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Beys efficaces et <strong>de</strong> commandants compétents. En<br />
1075, toute l’Anatolie sauf les régions côtières <strong>de</strong> l’Ouest, était passée<br />
sous contrôle turc. On pouvait même rencontrer <strong>de</strong>s turkmens d<strong>ans</strong><br />
<strong>de</strong>s régions aussi lointaines que Sapanca ou Izmit (Nicomedia). En<br />
profitant <strong>de</strong> luttes internes d<strong>ans</strong> l’Empire byzantin, Melikshah captura<br />
<strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Iznik (Niceae) et les territoires avoisinants.<br />
A Iznik, il établit les fondations <strong>de</strong> l’Empire seldjouki<strong>de</strong> Anatolien.<br />
La lutte contre les Shiites faisait également partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong>s<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s. Cette politique continua sous Melikshah. La lutte contre<br />
les Fatimids aussi. En 1072, La Palestine et Jérusalem furent prises.<br />
En 1076, Tripolidamascus et <strong>la</strong> Syrie furent incluses d<strong>ans</strong> l’Empire<br />
seldjouki<strong>de</strong>. En 1085, l’Etat Mervani près <strong>de</strong> Diyarbakir fut détruit.<br />
En 1089, le Khanat Karakhani<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntal et en 1090, le Khanat<br />
Karakhani<strong>de</strong> oriental furent détruits. Ainsi, les frontières <strong>de</strong> l’Etat<br />
furent é<strong>la</strong>rgies jusqu’à <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Muraille <strong>de</strong> Chine. En 1092. le Yemen<br />
et A<strong>de</strong>n furent pris. A <strong>la</strong> Mecque, un Khutbe fut lu en l’Honneur <strong>de</strong><br />
Melikshah et ce <strong>de</strong>rnier se vit remettre par le Calife le titre <strong>de</strong> ‘’dirigeant<br />
<strong>de</strong> l’Est et <strong>de</strong> l’Ouest’’. Le 20 novembre 1092, il fut empoisonné.
La désintégration<br />
Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Melikshah, une pério<strong>de</strong> qu’on appe<strong>la</strong> « <strong>la</strong> pério<strong>de</strong><br />
Hiatus » commença. Cette pério<strong>de</strong> fut caractérisée par <strong>de</strong>s luttes<br />
internes pour le pouvoir et par une certaine stagnation. Durant cette<br />
pério<strong>de</strong>, chacun <strong>de</strong>s quatre fils <strong>de</strong> Melikshah prirent le pouvoir :<br />
Mahmud ( 1092), Berkyaruk (1092-1104), Muhammed Tapar (1105-<br />
1118) et Sencer (1118-1156).<br />
Sous le règne <strong>de</strong> Sencer, une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> rémission et <strong>de</strong> réorganisation<br />
<strong>de</strong> l’Empire seldjouki<strong>de</strong> commença.<br />
Sencer rétablit le pouvoir seldjouki<strong>de</strong> sur les Etats qui s’en étaient<br />
défait après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> son père. Il renouve<strong>la</strong> et renforça <strong>la</strong> domination<br />
seldjouki<strong>de</strong> en Irak, en Azerbaïdjan, en Iran, en Tr<strong>ans</strong>oxiane et sur les<br />
terres ghaznévi<strong>de</strong>es. Malgré ce<strong>la</strong>, l’Empire perdit son pouvoir ancien<br />
en raison d’une série d’évènements négatifs. Le Calife Abbassid<br />
commença à se battre contre les Seldjouki<strong>de</strong>s afin <strong>de</strong> retrouver sa force<br />
politique d’autrefois. En 1141, l’Empire seldjouki<strong>de</strong> fut vaincu par les<br />
Qara-Khitais près <strong>de</strong> Samarqand (ce conflit est enregistré comme <strong>la</strong><br />
guerre <strong>de</strong> Katvan)<br />
En 1153, les Oghouzes se révoltèrent contre l’Empire seldjouki<strong>de</strong><br />
au sujet <strong>de</strong>s impôts. Ils avaient été avant pourtant les plus fervents<br />
supporters <strong>de</strong> l’Empire. Le Sultan seldjouki<strong>de</strong> fut capturé par les<br />
Oghouzes durant cette rébellion. Trois <strong>ans</strong> plus tard, il fut libéré<br />
et retourna au pouvoir. Cependant, l’Empire ne se remit pas <strong>de</strong> ses<br />
blessures et tomba en 1157 avec <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Sencer.<br />
D’après les règles du système administratif turc, Le Grand Empire<br />
seldjouki<strong>de</strong> avait partagé ses terres ainsi que celles nouvellement<br />
conquises entre les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie. Si les Etats comme celui<br />
<strong>de</strong> Iraqı, <strong>de</strong> Khorasan, <strong>de</strong> Kirman, <strong>de</strong> Syrie et celui <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
d’Anatolie avait été dépendants du système d’administration centralisée<br />
sous le Grand Empire seldjouki<strong>de</strong>, ils <strong>de</strong>vinrent <strong>de</strong>s structures<br />
indépendantes après s’être renforcés suite à <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Melikshah.<br />
Les Etats <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s d’Iraqi et <strong>de</strong> Khorasan (1092-1194) furent<br />
fondés par Le petit-fils <strong>de</strong> Melikshah : Mahmut. Celui-ci avait été en<br />
lutte pour le pouvoir avec son oncle Sencer pendant un certain temps<br />
mais Sencer en était sorti victorieux. Quand Sencer <strong>de</strong>vint le sultan<br />
seldjouki<strong>de</strong>, il <strong>la</strong>issa les régions Ouest (<strong>la</strong> Région d’Irak) à son neveu.<br />
C’est ainsi que l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Irak furent formé. Ils se sont fait<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
43
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
44<br />
connaître grâce à leur lutte contre le Calife Abbassid qui vou<strong>la</strong>it<br />
regagner son pouvoir politique d’autrefois. Cet Etat disparut à cause<br />
<strong>de</strong>s Harzemshahs.<br />
Les Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Kirman (1092-1187) virent leur Etat fondé à<br />
Kirman (Au Sud <strong>de</strong> l’Iran) par le fils <strong>de</strong> Çagri : Kavurd. Celui-ci s’était<br />
battu pour le pouvoir d<strong>ans</strong> le Grand Empire seldjouki<strong>de</strong> après <strong>la</strong> mort<br />
<strong>de</strong> Alpars<strong>la</strong>n mais il mourut pendant cette bataille. Les <strong>de</strong>scendants<br />
<strong>de</strong> Kavurd gardèrent Kirman sous <strong>la</strong> dépendance du Grand Etat<br />
seldjouki<strong>de</strong>. Les Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Kirman furent détruits par les<br />
Oghouzes qui s’étaient rebellés contre le Grand Etat seldjouki<strong>de</strong>.<br />
L’Etat seldjouki<strong>de</strong> <strong>de</strong> Syrie (1092-1117) fut fondé par le frère <strong>de</strong><br />
Melikshah : Tutup. Celui-ci resta dépendant du Grand Empire<br />
seldjouki<strong>de</strong> jusqu’en 1092. Quand Melikshah mourut, Tutup déc<strong>la</strong>ra<br />
son indépendance et mit en p<strong>la</strong>ce son propre Etat. Cependant, quand il<br />
mourut, l’Etat fut divisé en <strong>de</strong>ux parties : <strong>la</strong> première Alep, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
Damascus. A cause <strong>de</strong>s croisa<strong>de</strong>s, ces <strong>de</strong>ux parties s’affaiblirent et<br />
disparurent respectivement en 1118 et 1105.<br />
Les Seldjouki<strong>de</strong>s d’Anatolie ou les Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong> (1092-<br />
1277) seront traités d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> partie intitulée « Les Etats turcs anatoliens ».<br />
Les Khwarezmshahs (Harzemsah<strong>la</strong>r)<br />
Le bassin où se jette <strong>la</strong> rivière Amu Darya d<strong>ans</strong> le <strong>la</strong>c Aral était<br />
appelé Khwarezm. Les dirigeants <strong>de</strong> cette région étaient appelés<br />
les Khwarezmshahs. Les fondateurs <strong>de</strong> l’Etat khwarezmshah, les<br />
gouverneurs khwarezm du Grand Etat seldjouki<strong>de</strong> étaient les petits<br />
fils <strong>de</strong> Anushtegin. Les gouverneurs successeurs <strong>de</strong> Anushtegin<br />
tentèrent d’obtenir leur indépendance. Mais ils ne purent le faire tant<br />
que l’Empire seldjouki<strong>de</strong> était puissant. A <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Sencer en 1157,<br />
Il-Ars<strong>la</strong>n déc<strong>la</strong>ra l’indépendance <strong>de</strong>s Khwarezmshahs. La capitale <strong>de</strong><br />
l’Etat était Gulgenç. L’Etat Khwarezmshah se développa et se renforça<br />
rapi<strong>de</strong>ment sous Il-Ars<strong>la</strong>n. Ses frontières s’étendirent à <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>oxiane,<br />
à l’Est au Turkistan, vers l’Iran et à l’Ouest <strong>de</strong> l’Azerbaïdjan. L’Etat<br />
connut son apogée sous A<strong>la</strong>addin Muhammed. Il prit le contrôle<br />
<strong>de</strong>s Gurlus et vainquit les Qara-Khitais. Il ne réussit pas aussi bien<br />
cependant face aux Mongols. Ne résistant pas aux attaques mongoles,<br />
l’Etat khwarezmshah entama son déclin en 1220. Si l’Etat retrouva un<br />
peu <strong>de</strong> sa force sous Ce<strong>la</strong>leddin Khwarezmshah, sa chute fut inévitable.<br />
Sa popu<strong>la</strong>tion fuit les invasions mongoles en émigrant à l’Ouest.<br />
Certains vinrent en Anatolie.
CHAPITRE 5<br />
Les Etats turcs d’Egypte et <strong>de</strong> Syrie<br />
1. Les Toulouni<strong>de</strong>s (868-905)<br />
L’Egypte fut conquise par les armées is<strong>la</strong>miques en 639. Elle <strong>de</strong>vint<br />
alors l’une <strong>de</strong>s régions les plus importantes <strong>de</strong> l’Etat is<strong>la</strong>mique. Un<br />
gouverneur ainsi que <strong>de</strong>s administrateurs furent nommés en Egypte<br />
par l’Etat is<strong>la</strong>mique pour relever les impôts, <strong>de</strong>s informations secrètes<br />
et assurer <strong>la</strong> communication. Cette organisation avait pour but <strong>de</strong><br />
protéger l’autorité centrale <strong>de</strong> l’Etat en empêchant <strong>la</strong> concentration<br />
<strong>de</strong> pouvoirs d<strong>ans</strong> les mains <strong>de</strong>s administrateurs locaux. Ce système<br />
cependant présentait quelques faiblesses en ce qui était <strong>de</strong> résoudre<br />
<strong>de</strong>s problèmes. Il était donc nécessaire <strong>de</strong> nommer <strong>de</strong>s gouverneurs<br />
puissants d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. Parfois, c’était <strong>de</strong>s gouverneurs turcs d’origine<br />
qui étaient nommés.<br />
L’un <strong>de</strong> ces gouverneurs fut Ahmet Tolunoglu. Il fut nommé à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce<br />
<strong>de</strong> son père Bayik Bey comme gouverneur. A son arrivée en Egypte, il<br />
renvoya les administrateurs abbassids. Il se déc<strong>la</strong>ra tout puissant d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> région puis déc<strong>la</strong>ra son indépendance. En peu <strong>de</strong> temps, il construisit<br />
une armée et une flotte soli<strong>de</strong>s. Des découvertes et développements<br />
se firent d<strong>ans</strong> l’agriculture qui améliorèrent nettement <strong>la</strong> condition<br />
économique <strong>de</strong> l’Egypte. Fustat (l’ancien Caire), <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> l’Etat<br />
<strong>de</strong>vint un centre culturel prospère. Tolunoglu fit construire <strong>la</strong> mosquée<br />
qui porte son nom, qui existe toujours aujourd’hui et qui est considérée<br />
comme un travail architectural important. Il fit également construire<br />
un hôpital s<strong>ans</strong> précé<strong>de</strong>nt en Egypte.<br />
Il prit <strong>la</strong> Syrie en 878. Les terres entre l’Euphrate et le Maghreb furent<br />
unifiées sous son règne. Il tomba ma<strong>la</strong><strong>de</strong> lors <strong>de</strong> son voyage à Antioche<br />
pour réprimer <strong>la</strong> rébellion et mourut à son retour en Egypte. Durant<br />
ses seize années <strong>de</strong> règne, non seulement il sauva l’Egypte d’une crise<br />
économique mais aussi, en fit un centre culturel important. Après<br />
sa mort, l’Etat perdit <strong>de</strong> son pouvoir. En 905, il fut détruit par les<br />
Abbassids et rattaché <strong>de</strong> nouveau au Califat.<br />
Les Toulouni<strong>de</strong>s eurent une gran<strong>de</strong> importance d<strong>ans</strong> l’Histoire<br />
is<strong>la</strong>mique turque. Cette famille établit <strong>la</strong> première dynastie turque<br />
musulmane d<strong>ans</strong> une région où une toute petite partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
était turque. Ils administrèrent le pays correctement et fondèrent un<br />
Etat puissant.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
45
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
46<br />
2. Les Ikhchidi<strong>de</strong>s (935-969)<br />
Environ trente <strong>ans</strong> après <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie Tolunogul<strong>la</strong>ri, <strong>la</strong> famille<br />
Ihshid créa une nouvelle dynastie en Egypte. Il s’agissait d’une famille<br />
<strong>de</strong> militaires <strong>de</strong> Fergana. Le fondateur <strong>de</strong> cette dynastie était Ebubekir<br />
Muhammed. Son père Togaç était l’un <strong>de</strong>s gouverneurs <strong>de</strong> Damascus<br />
au temps <strong>de</strong>s Toulouni<strong>de</strong>s. Muhammed était un gouverneur qui avait<br />
d’abord travaillé en Syrie, puis en Egypte. Il fut nommé gouverneur<br />
d’Egypte en 935 et déc<strong>la</strong>ra son indépendance en s’appuyant sur <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion turque locale. Tout d’abord, il établit <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions<br />
avec le Calife Abbassid mais plus tard, il rompit les liens avec celui-ci.<br />
Alors que le pouvoir <strong>de</strong> Muhammed se faisait plus fort, il voulut<br />
protéger l’Egypte <strong>de</strong> <strong>la</strong> menace Fatimi<strong>de</strong> venant <strong>de</strong> l’Ouest et prendre<br />
sous son contrôle <strong>de</strong> nouveaux territoires. En 941, il prit <strong>la</strong> Syrie, <strong>la</strong><br />
Mecque et <strong>la</strong> Médina en 942 et é<strong>la</strong>rgit son territoire jusqu’au Yemen.<br />
L’époque <strong>de</strong> Muhammed, comme celle d’Ahmed Tolunoglu fut une<br />
pério<strong>de</strong> importante. Ses <strong>de</strong>scendants par contre n’eurent pas autant <strong>de</strong><br />
succès. Les Fatimids mirent fin à <strong>la</strong> dynastie Ihshid en 969.<br />
3. Les Ayyoubi<strong>de</strong>s (1171-1252)<br />
Le fondateur <strong>de</strong> l’Etat Ayyoubi<strong>de</strong>s fut Se<strong>la</strong>haddin Eyyubi. Il était un<br />
commandant d<strong>ans</strong> l’armée <strong>de</strong> Mosul Atabey Mahmud Zengi. En 1171,<br />
Se<strong>la</strong>haddin Eyyubi sauva l’Egypte <strong>de</strong>s Fatimids qui avaient détrôné les<br />
Ikhchidi<strong>de</strong>s. Se débarrassant du Calife fatimid, il fit faire <strong>de</strong>s pièces<br />
pour le Calife abbassid et fit lire un Khutbe en son nom. Il servit en<br />
tant que gouverneur sous l’autorité <strong>de</strong> Nureddin Mahmud jusqu’à <strong>la</strong><br />
mort <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier en 1174. Cette année là, Se<strong>la</strong>haddin Eyyubi déc<strong>la</strong>ra<br />
son indépendance et constitua son propre Etat. Les fonctionnaires <strong>de</strong><br />
l’administration <strong>de</strong> cet Etat et une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’armée étaient<br />
turcs. La <strong>la</strong>ngue officielle <strong>de</strong> l’Etat ayyubi était le turc. Sa politique était<br />
basée sur l’idéologie is<strong>la</strong>mique sunnite. Sa doctrine était donc <strong>la</strong> même<br />
que celle <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong>.<br />
Avec son frère Turan Shah, Se<strong>la</strong>haddin fit <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> <strong>la</strong> Syrie et<br />
étendit son royaume jusqu’à l’Irak. De nombreuses tribus turques se<br />
joignirent à lui, augmentant son pouvoir. En 1187, Se<strong>la</strong>haddin vainquit<br />
les Croisés d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Hittin et prit Jérusalem ainsi que <strong>la</strong><br />
région côtière <strong>de</strong> <strong>la</strong> Syrie. Après <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Hittin, une troisième<br />
croisa<strong>de</strong> fut organisée mais les Croisés ne réussirent pas à venir à bout<br />
<strong>de</strong> Se<strong>la</strong>haddin.
Après sa mort, une lutte pour le pouvoir se fit parmi les membres<br />
<strong>de</strong> sa famille pour <strong>la</strong> succession au trône. Pendant cette lutte, les<br />
commandants Memluk réussirent à prendre le pouvoir. Turan Shah fut<br />
le <strong>de</strong>rnier <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> Ayyoubi<strong>de</strong>s. Il fut éloigné du pouvoir par Ayberg,<br />
l’un <strong>de</strong>s commandants Mamelouk. Les Mamelouks étaient d’origine<br />
turque.<br />
4. Les Mamelouks (L’Etat <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong>)<br />
L’Etat mamelouk turc fut fondé en Egypte au treizième siècle. Les<br />
écrivains arabes <strong>de</strong> l’époque en parlent en tant que l’Etat <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong>.<br />
Contrairement aux autres Etats turcs is<strong>la</strong>miques, cet Etat ne fut pas<br />
fondé par une dynastie. Mamelouk signifie « Esc<strong>la</strong>ve b<strong>la</strong>nc », quelqu’un<br />
qui <strong>de</strong>vient un esc<strong>la</strong>ve soit en ayant été capturé pendant <strong>la</strong> guerre<br />
ou bien en ayant été acheté. D<strong>ans</strong> l’Histoire is<strong>la</strong>mique turque, le<br />
terme « mamelouk » finit par désigner les personnes travail<strong>la</strong>nt pour<br />
une dynastie en tant que gar<strong>de</strong>s sa<strong>la</strong>riés bénéficiant d’une position<br />
sociale et juridique distinguée. D<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique, les Turcs<br />
mamelouks étaient souvent utilisés comme esc<strong>la</strong>ves militaires venant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> abbassi<strong>de</strong>. Ils <strong>de</strong>vinrent ensuite un facteur important<br />
duquel dépendaient <strong>de</strong> nombreux pays is<strong>la</strong>miques du Moyen Orient.<br />
L’Etat Mamelouk fut fondé par les Mamelouks d<strong>ans</strong> l’Etat ayyubi.<br />
Le fondateur <strong>de</strong> l’Etat était Aybbek et-Turkmani. Se<strong>la</strong>haddin Eyyubi,<br />
arrivé au pouvoir en 1159, perpétua <strong>la</strong> tradition abbassi<strong>de</strong> qui vou<strong>la</strong>it<br />
qu’on forma une armée d’esc<strong>la</strong>ves. Ces esc<strong>la</strong>ves faisaient preuve d’une<br />
gran<strong>de</strong> force physique. Ils étaient soit capturés ou achetés d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
région <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire par l’armée ayyubi. Bien qu’il y ait quelques<br />
Circassiens parmi eux, <strong>la</strong> plupart était <strong>de</strong>s Turcs. Après Se<strong>la</strong>haddin<br />
Eyyubi, les Ayyoubi<strong>de</strong>s suivirent <strong>la</strong> tradition <strong>de</strong> l’armée d’esc<strong>la</strong>ves en<br />
al<strong>la</strong>nt un peu plus loin : Ils employèrent les plus intelligents à <strong>de</strong>s postes<br />
importants <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Ces Soldats esc<strong>la</strong>ves étaient entraînés d<strong>ans</strong> <strong>de</strong>ux casernes. L’une se<br />
situait sur l’Ile <strong>de</strong> Ravda sur le Nil près du Caire. D<strong>ans</strong> cette caserne, il y<br />
avait <strong>de</strong>s Turcs, principalement <strong>de</strong>s soldats Kiptchaks qui étaient appelés<br />
Memalik-i Bahriye (Esc<strong>la</strong>ves marins). L’autre caserne était aussi près<br />
du Caire et accueil<strong>la</strong>it les soldats circassiens qui étaient appelés Malik-i<br />
Çerakise. Les soldats esc<strong>la</strong>ves qui ont fondé l’Etat mamelouk étaient <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> caserne <strong>de</strong> Malik-i Bahriye. Plus tard, ces soldats prirent le contrôle<br />
<strong>de</strong> l’administration <strong>de</strong> l’Etat mamelouk. Les soldats esc<strong>la</strong>ves <strong>de</strong>vinrent<br />
influents d<strong>ans</strong> l’armée et d<strong>ans</strong> l’administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie ayyubi.<br />
Ils formèrent une rébellion. Le <strong>de</strong>rnier sultan ayyubi Turan Shah<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
47
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
48<br />
prit <strong>de</strong> sévères mesures contre les soldats esc<strong>la</strong>ves et officiers esc<strong>la</strong>ves<br />
rebelles avant que ceux-ci ne le tuent. Les rebelles nommèrent ensuite<br />
Muizzüddin Ayberg commandant <strong>de</strong> l’armée. Fiecer-Ud-Dur se maria<br />
avec Ayberg et lui offrit <strong>la</strong> couronne. L’Etat mamelouk fondé par <strong>de</strong>s<br />
soldats esc<strong>la</strong>ves et <strong>de</strong>s officiers esc<strong>la</strong>ves vécut plus <strong>de</strong> 250 <strong>ans</strong>. Durant le<br />
règne <strong>de</strong> Ayberg, il y eut <strong>de</strong> nombreux conflits internes. Après sa mort,<br />
son fils, Nurettin Ali prit sa succession. Le système administratif <strong>de</strong>s<br />
Mamelouks cependant n’était pas une dynastie et donc ne reconnaissait<br />
pas <strong>la</strong> passation du pouvoir <strong>de</strong> père en fils. En 1259, Nurettin Ali fut<br />
remp<strong>la</strong>cé par Seyfettin Kutuz.<br />
En 1260, alors que les Mamelouks tentaient <strong>de</strong> résoudre leurs conflits<br />
internes, les armées mongoles occupèrent Bagdad, tuèrent le Calife<br />
et se rapprochèrent <strong>de</strong>s frontières égyptiennes. Le sultan mamelouk<br />
Kutuz envoya une armée commandée par Baybars pour faire face aux<br />
attaquants mongols. Ils se firent face d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région Ayn Calud où les<br />
Mongols se firent vaincre. La victoire <strong>de</strong>s Mamelouks à Ayn Calud<br />
empêcha les Mongols d’occuper <strong>la</strong> Syrie et l’Egypte. Elle rapprocha<br />
également l’Egypte et <strong>la</strong> Syrie. Les Turcs fuyant l’invasion mongole se<br />
réfugièrent d<strong>ans</strong> l’Etat mamelouk et entrèrent d<strong>ans</strong> l’armée en tant que<br />
militaires sa<strong>la</strong>riés.<br />
Après Kutuz, Baybars prit <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> l’Etat. Il comprit que si les<br />
Chrétiens et les Mongols formaient une alliance contre lui, ce serait<br />
une gran<strong>de</strong> menace pour l’Etat mamelouk. Cette alliance inclurait<br />
<strong>la</strong> petite principauté arménienne du Nord, les Francs sur <strong>la</strong> côte, le<br />
Royaume <strong>de</strong> Chypre, les Ismails et Nuseyris <strong>de</strong> Syrie et d’Egypte qui<br />
étaient contre les politiques <strong>de</strong>s Mamelouks Sunnites. Baybars prit <strong>de</strong>s<br />
mesures diplomatiques pour éviter <strong>la</strong> formation <strong>de</strong> cette alliance. Il<br />
établit sa propre alliance avec <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or (L’Etat Altınordu) contre<br />
les Mongols ilkhanates en Iran. Il forma également une alliance avec<br />
les Byzantins contre les croisés en Syrie. Alors que Baybars rétablissait<br />
le Califat abbassid en Egypte, l’Etat Mamelouk commença à dominer<br />
le mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique. Baybars non seulement défendit <strong>la</strong> Syrie contre<br />
<strong>de</strong> nouvelles attaques ilkhanates mais il élimina également <strong>la</strong> présence<br />
ilkhanate en Syrie. En 1277, il pénétra l’Anatolie et vainquit les<br />
Mongols à Elbistan pour <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième fois. Plus tard, il élimina le<br />
Royaume Arménien Cilicia et repoussa les croisés <strong>de</strong> Antioche.<br />
Les conquêtes <strong>de</strong> Baybars renforcèrent l’Etat mamelouk. Après sa mort,<br />
ses fils Berke et Sulemish montèrent sur le trône. Ils furent bientôt<br />
renversés par Ka<strong>la</strong>vun qui <strong>de</strong>vint le nouveau dirigeant <strong>de</strong>s Mamelouks.
Les <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> Ka<strong>la</strong>vun dirigèrent le pays <strong>de</strong> 1279 à 1382. Berkuk<br />
mit fin à <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Ka<strong>la</strong>vuns en 1382 quand il prit <strong>la</strong> tête <strong>de</strong> l’Etat.<br />
Ce fut possible grâce à <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> pouvoir <strong>de</strong>s Mamelouks Circassiens.<br />
Ce fut le point <strong>de</strong> départ d’une nouvelle pério<strong>de</strong> d<strong>ans</strong> l’Histoire <strong>de</strong>s<br />
Mamelouks.<br />
Sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Berkuk, les Mamelouks passèrent <strong>de</strong>s alliances avec<br />
les Ottom<strong>ans</strong>, <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or et <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Kadi Burhanettin. Ces<br />
alliances avaient pour but <strong>de</strong> se protéger <strong>de</strong> <strong>la</strong> menace que représentait<br />
Timur. Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Berkuk en 1399, ces alliances furent dissolues.<br />
Le quinzième siècle ne fut pas clément pour les Mamelouks. Après une<br />
guerre entre les successeurs <strong>de</strong> Berkuk Ferec et Timur, le territoire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Syrie fut perdu. De plus, l’Egypte perdit <strong>de</strong> son importance sur <strong>la</strong> route<br />
commerciale tr<strong>ans</strong>-continentale comme les Portugais commencèrent à<br />
tr<strong>ans</strong>porter <strong>de</strong>s marchandises <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> par le Cap <strong>de</strong> bonne Espérance.<br />
L’économie mamelouk en fut fort atteinte.<br />
Les re<strong>la</strong>tions entre les Mamelouks et les Ottom<strong>ans</strong> se dégradèrent à<br />
cette pério<strong>de</strong>. Ils se battirent au sujet <strong>de</strong> <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s principautés<br />
Turkmens du Sud <strong>de</strong> l’Anatolie.<br />
Les Mamelouks commencèrent à prendre partie lors <strong>de</strong>s luttes entre<br />
les différents princes Shahza<strong>de</strong>s d<strong>ans</strong> l’Empire ottoman. Ces luttes<br />
donnèrent naissance à une guerre entre les Mamelouks et les Ottom<strong>ans</strong><br />
qui dura <strong>de</strong> 1485 à 1490. Personne ne sortit victorieux <strong>de</strong> cette guerre.<br />
L’Etat ottoman cependant se développait plus rapi<strong>de</strong>ment que l’Etat<br />
mamelouk et finalement, il en fit <strong>la</strong> conquête en 1517.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
49
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
50<br />
CHAPITRE 6<br />
L’Etat seldjouki<strong>de</strong> (turc) d’Anatolie<br />
Les Sult<strong>ans</strong> seldjouki<strong>de</strong>s dirigèrent systématiquement les Turcs vers<br />
l’Anatolie. Bien que leur Etat n’ait pas été établi avant <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong><br />
Manzikert en 1071, les Turcs avaient commencé à s’installer d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
région bien avant.<br />
L’intérêt <strong>de</strong>s Turcs pour l’Anatolie et leur établissement là-bas remonte<br />
à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> pré-is<strong>la</strong>mique. Comme nous l’avions déjà mentionné, les<br />
Huns avaient fait certaines attaques <strong>de</strong> courte durée en Anatolie entre<br />
395 et 398. La plus gran<strong>de</strong> attaque turque en Anatolie cependant a<br />
été faite après <strong>la</strong> conversion à l’Is<strong>la</strong>m. Kılıçars<strong>la</strong>n Bey, le père du sultan<br />
seldjouki<strong>de</strong> Alpars<strong>la</strong>n était arrivé à l’Est <strong>de</strong> l’Anatolie par Khorasan<br />
et par l’Iran avec une armée <strong>de</strong> trois mille soldats. Le succès <strong>de</strong> cette<br />
opération montra aux Seldjouki<strong>de</strong>s qu’il n’y avait d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région aucune<br />
force capable <strong>de</strong> leur résister. Ils considérèrent l’Anatolie comme un<br />
endroit convenable pour s’y installer. Pendant le règne du premier<br />
Empereur seldjouki<strong>de</strong> Tugrul Bey (1040-1063), ils firent plusieurs<br />
expéditions en Anatolie. Bien qu’il n’y ait pas d’instal<strong>la</strong>tion turque<br />
permanente d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région, les Turcs avaient commencé à se battre<br />
contre les Byzantins au sujet <strong>de</strong> ces terres. L’intérêt <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
pour l’Anatolie est encore démontré d<strong>ans</strong> le changement <strong>de</strong> capitale<br />
<strong>de</strong> Nishabur à Rey. Rey est située plus à l’Ouest que Nishabur et<br />
donc, plus près <strong>de</strong> l’Anatolie. Ce grand intérêt conduisit Tugrul Bey<br />
lui-même en Anatolie et le conduisit à prendre les comman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
bataille contre les Byzantins.<br />
L’avancée <strong>de</strong>s Turcs en Anatolie du temps <strong>de</strong> Çagri Bey et <strong>de</strong> sa<br />
première expédition à celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Tugrul Bey représente une<br />
série <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s conquêtes. Elles se firent entre <strong>la</strong> fondation du Grand<br />
Empire seldjouki<strong>de</strong> et <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Dandanaqan. Pendant le règne<br />
<strong>de</strong> Tugrul Bey, l’autorité <strong>de</strong>s Byzantins avait été affaiblie en Anatolie.<br />
Ce<strong>la</strong> représentait une opportunité pour <strong>la</strong> préparation <strong>de</strong> l’Anatolie en<br />
tant que terre pour les Turcs. La bataille <strong>de</strong> Manzikert en 1071 rendit<br />
possible l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s Turcs en Anatolie. A partir du douzième<br />
siècle, pendant le règne <strong>de</strong> Alpars<strong>la</strong>n, l’Anatolie prit le nom <strong>de</strong> <strong>Turquie</strong><br />
(Turkiye). Ayant vaincu les Byzantins à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Manzikert, les<br />
Turcs réalisèrent qu’aucune force ne pourrait leur résister d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
région. Ils firent donc plus d’attaques en Anatolie d<strong>ans</strong> l’intention d’y<br />
établir leur terre natale.
Alpars<strong>la</strong>n chargea ses commandants et ses princes <strong>de</strong> conquérir<br />
l’Anatolie. Alors que cette conquête touchait à sa fin, un autre Etat<br />
naquit qui fut appelé l’Etat Turc seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie.<br />
Après <strong>la</strong> victoire <strong>de</strong> Manzikert en 1071, l’Etat Seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie<br />
ne fut pas le seul état fondé en Anatolie. Des princes et commandants<br />
turkmens tels que Artuk, Danishmend, saltuk, Mengucuk, Savteginet<br />
Afshin qui s’étaient battus avec Alpars<strong>la</strong>n contre les Byzantins<br />
conquirent aussi d’autres régions d’Anatolie pour fon<strong>de</strong>r leur propre<br />
principauté. Alpars<strong>la</strong>n leur avait donné le droit d’établir leur royaume<br />
sur les terres qu’ils prendraient.<br />
L’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie naquit grâce à l’intense émigration <strong>de</strong>s<br />
Turcs en Anatolie après <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Manzikert. Le fondateur <strong>de</strong> l’Etat<br />
fut Shah Suleyman Kutalmıyoğlu, le petit fils <strong>de</strong> Ars<strong>la</strong>n Yabghu, l’un<br />
<strong>de</strong>s quatre fils <strong>de</strong> Seldjouk. Shah Suleyman fut l’un <strong>de</strong>s commandants<br />
ayant pris part à <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> l’Anatolie commencée en 1074. Il prit<br />
part aux opérations tout d’abord d<strong>ans</strong> le c<strong>la</strong>n sur <strong>la</strong> côte <strong>de</strong>s rivières<br />
Euphrate et Urfa. Il assiégea aussi Antioche et Aleppo. Cependant, il<br />
est ensuite rentré en conflit avec Atziz, le dirigeant seldjouki<strong>de</strong> <strong>de</strong> Syrie<br />
et s’est ensuite tourné vers l’Ouest.<br />
Pendant ce temps, l’Empire byzantin était secoué par <strong>de</strong>s conflits<br />
internes et <strong>de</strong>s rébellions d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. C’est pourquoi les Byzantins<br />
ne purent pas s’intéresser aux attaques turques en Anatolie et aux cl<strong>ans</strong><br />
turcs qui commençaient à émerger. Profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation, Le Shah<br />
Suleyman pénétra en Anatolie centrale et prit <strong>la</strong> forteresse qui entourait<br />
Konya. Ensuite, il profita <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte pour le pouvoir d<strong>ans</strong> l’administration<br />
byzantine et s’empara <strong>de</strong> nombreuses villes et forteresses s<strong>ans</strong> difficulté.<br />
Finalement, il conquit <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> ville byzantine historique <strong>de</strong> Iznik<br />
en 1078 et en fit <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> l’Etat. A travers ces conquêtes, le Shah<br />
Suleyman établit les fondations <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie.<br />
Il continua ses conquêtes et é<strong>la</strong>rgit les frontières <strong>de</strong> l’Etat au détriment<br />
<strong>de</strong>s Byzantins. Ayant vaincu l’armée byzantine venue à Iznik pour<br />
reprendre <strong>la</strong> ville, il continua vers Uskudar, (connu sous le nom <strong>de</strong><br />
Chrisopolis pendant l’ère byzantine), un quartier d’Istanbul. Avec le<br />
bureau <strong>de</strong> douane qu’il mit en p<strong>la</strong>ce là-bas, il commença à percevoir<br />
<strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> douane <strong>de</strong>s bateaux qui passaient le Bosphore. Quand<br />
Alexis Commenos arriva au pouvoir à Byzance, <strong>la</strong> situation changea<br />
et les Turcs commencèrent à se replier. Un traité signé en 1082 déc<strong>la</strong>ra<br />
Dragos, d<strong>ans</strong> le golfe d’Izmit, comme étant <strong>la</strong> frontière entre les <strong>de</strong>ux<br />
Etats. Ce traité était en faveur du Shah Suleyman.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
51
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
52<br />
Après <strong>la</strong> signature, il retourna en Anatolie et conquit Tarsus, Adana<br />
et Missis. Il commença également à percevoir <strong>de</strong>s taxes <strong>de</strong> Ma<strong>la</strong>tya.<br />
D’autre part, il al<strong>la</strong> à Antioche sur invitation <strong>de</strong>s Chrétiens qui n’étaient<br />
pas satisfaits <strong>de</strong> <strong>la</strong> création <strong>de</strong> <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong>s Arméniens d<strong>ans</strong> cette<br />
ville. Avec le soutien <strong>de</strong>s Chrétiens, il prit <strong>la</strong> ville. Puis il y eu <strong>la</strong> conquête<br />
d’Antep et d’Isken<strong>de</strong>run. Tutuş, l’Emir <strong>de</strong> <strong>la</strong> Syrie, fut mécontent <strong>de</strong>s<br />
conquêtes et du prestige du Shah Suleyman. D<strong>ans</strong> une guerre qui éc<strong>la</strong>ta<br />
entre ces <strong>de</strong>ux personnes le 5 juin 1086, le Shah Suleyman fut vaincu et<br />
tué. Comme il l’avait souhaité, Ebul Kasim reprit les rennes du pouvoir<br />
d<strong>ans</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie, empêcha cet Etat nouveau <strong>de</strong> se<br />
désintégrer et mena avec succès <strong>de</strong>s attaques contre Byzance. A ce<br />
moment là, le grand sultan seldjouki<strong>de</strong> Malikshah envoya une gran<strong>de</strong><br />
armée pour prendre le contrôle <strong>de</strong>s Turcs seldjouki<strong>de</strong>s. Il mourut et ne<br />
put donc venir à bout <strong>de</strong> ce projet. Sa mort eut également une autre<br />
conséquence : Kılıçars<strong>la</strong>n I,l’un <strong>de</strong>s fils du Shah Suleyman qui était<br />
alors avec Malikshah, revint <strong>de</strong> Khorasan à Iznik vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> 1092 et<br />
<strong>de</strong>vint le Sultan <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie.<br />
La Lutte pour l’unification entre les Turcs<br />
et les Croisés<br />
Quand Kılıçars<strong>la</strong>n I arriva au pouvoir, il vit qu’une autorité puissante<br />
centrale manquait à l’Etat, qui aurait pu unifier <strong>la</strong> région.<br />
Les commandants turcs <strong>de</strong>s différentes régions d’Anatolie avaient<br />
crée leur propre principauté. Les Byzantins <strong>de</strong>vaient quant à eux faire<br />
face aux Turcs et aux Croisés. Kılıçars<strong>la</strong>n pensa également que son<br />
beau-père Çaka Bey représentait une gran<strong>de</strong> menace pour les Turcs<br />
d’Anatolie. Il avait déjà fondé un Etat à Izmir, créé sa propre flotte et<br />
pris le contrôle <strong>de</strong>s îles avoisinantes et <strong>de</strong>s Dardanelles.<br />
Kılıçars<strong>la</strong>n I passa à l’action. D’abord il signa un contrat avec Byzance<br />
contre Çaka Bey et le renversa en 1094. Ayant éliminé cette menace <strong>de</strong><br />
l’Ouest, Kılıçars<strong>la</strong>n I se tourna vers l’Est. En 1096, il assiégea Ma<strong>la</strong>tya<br />
qui était aux mains <strong>de</strong>s Arméniens. Durant ce siège, Kılıçars<strong>la</strong>n apprit<br />
que les premiers Croisés arrivaient en Anatolie. Il mit fin au siège et<br />
retourna à <strong>la</strong> capitale. Les Croisés furent vaincus par l’armée seldjouki<strong>de</strong><br />
dirigée par le frère <strong>de</strong> Kılıçars<strong>la</strong>n I : Davud. Quand Kılıçars<strong>la</strong>n I arriva<br />
à Iznik, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième vague <strong>de</strong> Croisés avait déjà pris <strong>la</strong> ville. Il ne put<br />
rentrer d<strong>ans</strong> Iznik. Le siège durant un certain temps, Iznik fut accordé<br />
aux Byzantins par un contrat en 1097. Kılıçars<strong>la</strong>n I dép<strong>la</strong>ça alors <strong>la</strong><br />
capitale à Konya. Avec l’ai<strong>de</strong> militaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dynastie <strong>de</strong>s Danishmends,
Kılıçars<strong>la</strong>n se battit contre les Croisés près <strong>de</strong> Eskisehir. Il en sortit<br />
vainqueur mais ne put arrêter les Croisés. Considérant ce<strong>la</strong>, il décida <strong>de</strong><br />
se battre avec les Croisés non en menant <strong>de</strong>s attaques ponctuelles mais<br />
en suivant <strong>la</strong> politique d’affaiblissement <strong>de</strong> l’ennemi. Il le fit jusqu’en<br />
1102, date à <strong>la</strong>quelle il les détruisit complètement et élimina <strong>la</strong> menace<br />
qu’ils représentaient.<br />
Après <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> première croisa<strong>de</strong>, les Turcs commencèrent un<br />
processus <strong>de</strong> reconstruction politico-sociale. Iznik était passé aux mains<br />
<strong>de</strong>s Byzantins et Konya était <strong>la</strong> nouvelle capitale. Mais le désir était <strong>de</strong><br />
faire <strong>de</strong> l’Anatolie une région sure à nouveau. Kılıçars<strong>la</strong>n se battit avec<br />
les principautés turques pour établir une certaine unité d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région et<br />
pour é<strong>la</strong>rgir son Etat. Ainsi, l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie <strong>de</strong>vint voisin<br />
du grand Etat seldjouki<strong>de</strong>. Kılıçars<strong>la</strong>n I avait également prit Mosul<br />
durant son exp<strong>ans</strong>ion et cet évènement était désapprouvé par le grand<br />
Etat seldjouki<strong>de</strong>. Ce désaccord régional se tr<strong>ans</strong>forma rapi<strong>de</strong>ment en<br />
conflit entre les <strong>de</strong>ux Etats. La guerre se fit sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière<br />
Habur 1107. Kılıçars<strong>la</strong>n fut vaincu et tué.<br />
Comme celle du Shah Suleyman, <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Kılıçars<strong>la</strong>n I créa un<br />
problème administratif d<strong>ans</strong> l’Etat. Profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation, les<br />
Byzantins repoussèrent les Turcs jusqu’en Anatolie Centrale. Shehin<br />
Shah, le fils <strong>de</strong> Kılıçars<strong>la</strong>n prit le pouvoir mais fut renversé par son<br />
frère Mesud avec l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Danishmend. Mesud prit<br />
Konya en 1116 et monta sur le trône. Pendant son règne qui dura<br />
environ quarante <strong>ans</strong>, Mesud sauva l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
disparition et en fit le pouvoir le plus important en Anatolie.<br />
Les premières années <strong>de</strong> gouvernement <strong>de</strong> Mesud passèrent sous <strong>la</strong><br />
direction <strong>de</strong> Emir Gazi, le dirigeant <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Danishmends,<br />
le pays le plus puissant <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Emir Gazi était aussi le beau père<br />
<strong>de</strong> Mesud. Cette situation dura jusqu’à <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Emir Gazi en 1134.<br />
Ayant l’opportunité d’agir librement, Mesud reprit Ankara, Çankırı<br />
(autrefois Changra) et Kastamonu <strong>de</strong>s Danishmends. En 1144, il prit<br />
Elbistan et se dirigea vers Maraş qui appartenait aux Croisés. Quand<br />
il apprit que l’Empereur Byzantin Manuel Comnenos se dirigeait vers<br />
Konya, il retourna à <strong>la</strong> capitale et vainquit les Byzantins.<br />
Alors que Mesud renforçait ses troupes, les seconds Croisés conduits<br />
par le Roi allemand Konrad III et le Roi <strong>de</strong>s Francs St. Louis sont<br />
arrivés en Anatolie. Mesut vainquit l’armée alleman<strong>de</strong> en 1147 aux<br />
alentours <strong>de</strong> Eskisehir. Saint Louis renonça alors à entrer en Anatolie.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
53
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
54<br />
Au lieu <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, Il al<strong>la</strong> à Antalya par <strong>la</strong> côte, puis à Akka par voie <strong>de</strong><br />
mer. Mesud fit alors <strong>de</strong> sérieuses attaques sur les Arméniens ciliciens.<br />
Il rendit les Danishmends dépendants <strong>de</strong> lui. Il mourut en 1155, après<br />
avoir fait <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie, l’Etat le plus puissant <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
région.<br />
Avant sa mort, il avait divisé le pays entre ses fils. D’après ce partage,<br />
Kılıçars<strong>la</strong>n II resterait à Konya et ses frères dépendraient <strong>de</strong> lui.<br />
Cependant les frères n’acceptèrent pas ce<strong>la</strong> et entamèrent une lutte<br />
pour le pouvoir avec Kılıçars<strong>la</strong>n II. Il dut faire face à ses frères et en<br />
même temps, à <strong>de</strong>s forces extérieures qui essayaient <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
situation, parmi lesquelles : l’Empereur byzantin Manuel Commenos,<br />
le Prince arménien <strong>de</strong> Cilicie, Musul, Aleppo, Atabeg, Nureddin Zengi<br />
et le Yaghibasan Bey Danishmend. Il gagna tout d’abord sa lutte contre<br />
ses frères et rétablit l’ordre à l’intérieur <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie.<br />
Ensuite il renforça les frontières <strong>de</strong> l’Ouest en signant un pacte <strong>de</strong> nonagression<br />
avec les Byzantins en 1162. Puis il se concentra sur l’Est. En<br />
1163, il rendit <strong>la</strong> dynastie danishmend impuissante et reprit les terres<br />
autrefois prises par Nureddin Zengi. Il résolut aussi les problèmes avec<br />
les autres principautés.<br />
La bataille <strong>de</strong> Myriokephalon (1176)<br />
Le succès <strong>de</strong> kılıçars<strong>la</strong>n II commençait à déranger Byzance. La<br />
situation étant favorable, les Turcs <strong>de</strong> l’Est commencèrent à intensifier<br />
leurs attaques sur les régions byzantines <strong>de</strong> l’Ouest. Pour faire face à<br />
ce problème, l’Empereur byzantin Manuel Comnenos leva une gran<strong>de</strong><br />
armée contre les Turcs et refusa toutes les offres <strong>de</strong> paix exprimées<br />
par Kılıçars<strong>la</strong>n II. L’armée byzantine, renforcée par les troupes <strong>de</strong>s<br />
Francs, <strong>de</strong>s Hongrois, <strong>de</strong>s Serbes et <strong>de</strong>s Petchenègues, quitta Istanbul<br />
au printemps 1176. Le premier septembre 1176, ils furent vaincus par<br />
les Turcs conduits par Kılıçars<strong>la</strong>n II d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> Myriokephalon,<br />
près <strong>de</strong> Denizli. Comnenos fut libéré à <strong>la</strong> condition d’enlever ses<br />
fortifications d’Anatolie et <strong>de</strong> payer <strong>de</strong> lour<strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>s. Ce fut <strong>la</strong> fin<br />
<strong>de</strong> l’espoir byzantin <strong>de</strong> reprendre l’Anatolie <strong>de</strong>s Turcs après <strong>la</strong> bataille<br />
<strong>de</strong> Manzikert. Ce<strong>la</strong> montrait que l’Anatolie n’était pas envahie par les<br />
Turcs comme les Chrétiens vou<strong>la</strong>ient bien le dire mais que l’Anatolie<br />
était <strong>la</strong> véritable terre <strong>de</strong>s Turcs. Après <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Myriokephalon, les<br />
Byzantins n’osèrent plus attaquer les Turcs.<br />
Après que ce problème ait été réglé, Kılıçars<strong>la</strong>n II mit fin à <strong>la</strong> dynastie<br />
<strong>de</strong>s Danishmends et élimina ainsi son ennemi <strong>de</strong> l’Est. Les forces
turkmènes détruisirent <strong>la</strong> principauté arménienne <strong>de</strong> Cilicie et prirent<br />
leurs terres. Elles prirent également Silifke et s’étendirent jusqu’en Syrie<br />
et Al Jazeera. Les frontières à l’Ouest <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s al<strong>la</strong>ient jusqu’à<br />
Denizli.<br />
Le partage du pays entre les princes<br />
et les temps qui ont suivi.<br />
Après une longue vie à diriger et à se battre, Kılıçars<strong>la</strong>n II <strong>de</strong>vint vieux<br />
et fatigué. Il divisa donc le pays entre ses onze fils en 1186. Il resta à<br />
Konya et dirigea le pays avec l’ai<strong>de</strong> d’un Vizir. Cette situation engendra<br />
bientôt une lutte pour le pouvoir entre les fils. Ce désordre s’ajouta<br />
à <strong>la</strong> menace d’une troisième croisa<strong>de</strong>. En 1187, alors que Sa<strong>la</strong>haddin<br />
Eyyubi prenait Jérusalem, les Chrétiens décidèrent d’envoyer une<br />
troisième croisa<strong>de</strong>. Alors que Kılıçars<strong>la</strong>n tenta d’être prévoyant et<br />
chercha un terrain d’entente avec les Croisés, ses fils se comportèrent<br />
différemment. Les Croisés entrèrent d<strong>ans</strong> Konya et saccagèrent<br />
<strong>la</strong> ville. Suite à cette catastrophe, Kılıçars<strong>la</strong>n se réfugia chez son fils<br />
Giyaseddin Keyhusrev, chez qui il resta jusqu’à sa mort en 1192. Après<br />
sa mort, Giyaseddin Keyhusrev arriva au pouvoir. Ses frères par contre<br />
n’acceptèrent pas cet état <strong>de</strong> fait. Quiconque arriva au pouvoir à cette<br />
pério<strong>de</strong> était <strong>de</strong>stiné à faire face à <strong>de</strong>s difficultés et ce fut <strong>la</strong> principale<br />
faiblesse <strong>de</strong> l’Etat. Giyaseddin Keyhusrev ne resta pas au pouvoir très<br />
longtemps. En 1196, son frère Ruknuddin Suleyman Shah dirigea ses<br />
forces contre Konya. Giyaseddin, refusant <strong>de</strong> prendre le risque <strong>de</strong> se<br />
battre contre son frère, se réfugia à Byzance. Ruknuddin Suleyman<br />
Shah arriva donc au pouvoir d<strong>ans</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie.<br />
Il fit <strong>de</strong> nombreux efforts pour réunifier les Turcs. Il vainquit le roi<br />
arménien Léon et l’Empire byzantin. Il obligea cet empire à payer un<br />
tribut aux Turcs. Il prit <strong>de</strong>s terres <strong>de</strong>s Mengudjeks et <strong>de</strong>s Artuqids. En<br />
1201, il mit fin à <strong>la</strong> principauté Saltuk qui était une autre principauté<br />
turque d’Anatolie. Quand Suleyman Shah mourut en 1207, comme<br />
son fils Kılıçars<strong>la</strong>n III était très jeune, les commandants Turkmens<br />
invitèrent Giyaseddin Keyhusrev <strong>de</strong> Byzance à Konya. Son <strong>de</strong>uxième<br />
règne fut un succès. L’Empire rum <strong>de</strong> Trebizond fut vaincu et <strong>la</strong> route<br />
commerciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire fut mise sous son contrôle. Avec <strong>la</strong><br />
conquête d’Antalya en 1207, les Turcs eurent accès à une voie maritime.<br />
La royauté arménienne fut vaincue et les Ayyoubi<strong>de</strong>s ne purent prendre<br />
<strong>la</strong> Syrie ni l’Anatolie. Giyaseddin mourut en 1211.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
55
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
56<br />
L’apogée <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s d’Anatolie<br />
Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Giyaseddin, Izzedin Keykavus occupa le trône<br />
seldjouki<strong>de</strong> (1211-1220). Il fut suivi par A<strong>la</strong>adin Keykubad. Avec une<br />
flotte formée en 1226 à Sinop, A<strong>la</strong>adin Keykubad forma le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong><br />
conquérir Sagduk, un important port <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Crimée. Après<br />
cette conquête, il prit le contrôle <strong>de</strong> nombreuses principautés russes<br />
et <strong>de</strong> commandants Kiptchaks. Les soldats <strong>de</strong> l’armée <strong>de</strong> terre prirent<br />
toutes les régions côtières jusqu’à Silifke. Un autre évènement <strong>de</strong> poids<br />
d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> marine fut <strong>la</strong> prise d’un centre important <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Mer Méditerranée. Keykubad assiégea ce qui constitue aujourd’hui <strong>la</strong><br />
forteresse <strong>de</strong> A<strong>la</strong>nya <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre et <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer et en prit possession en<br />
1223. La ville et <strong>la</strong> tour furent reconstruites et renommées « A<strong>la</strong>iye »<br />
en mémoire du Sultan. Le premier port militaire <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong><br />
d’Anatolie y fut établi par Keykubad. A<strong>la</strong>iye <strong>de</strong>vint un lieu <strong>de</strong><br />
villégiature <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> pour les saisons d’hiver.<br />
Alors qu’A<strong>la</strong>adin s’occupait <strong>de</strong> problèmes internes à l’Anatolie, <strong>la</strong><br />
menace mongole née au cœur <strong>de</strong> l’Asie se rapprochait rapi<strong>de</strong>ment par<br />
l’Ouest. Ce<strong>la</strong>leddin, le dirigeant <strong>de</strong>s Khwarezmshahs, fuit les Mongols<br />
en 1225 et arriva en Azerbaïdjan. Les re<strong>la</strong>tions entre Ce<strong>la</strong>leddin et<br />
A<strong>la</strong>addin étaient tout d’abord bonnes. Cependant, quand Ce<strong>la</strong>leddin<br />
détruisit Ah<strong>la</strong>t qui appartenait aux Seldjouki<strong>de</strong>s, les <strong>de</strong>ux lea<strong>de</strong>rs<br />
s’affrontèrent. Keykubad reçut le soutien <strong>de</strong> ses alliés ayyoubi<strong>ans</strong> et se<br />
battit contre Ce<strong>la</strong>leddin. Alors qu’ils auraient du unifier leurs forces<br />
contre leur ennemi commun, les <strong>de</strong>ux armées se rencontrèrent le 10<br />
août 1230 à Yassi Cemen près <strong>de</strong> Erzincan. L’armée khwarezm fut<br />
vaincue. Pendant ce temps, <strong>la</strong> menace mongole avait atteint les portes<br />
<strong>de</strong> l’Anatolie. Keykubad, conscient <strong>de</strong> <strong>la</strong> menace, accepta les exigences<br />
<strong>de</strong>s Mongols afin d’éviter l’invasion. Il prit cependant <strong>de</strong>s précautions<br />
et renforça les tours <strong>de</strong>s remparts <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville et se mit à <strong>la</strong> recherche<br />
d’alliances. Il mourut cependant en 1237, avant d’avoir pu mener ses<br />
projets à bien. Son époque fut cependant <strong>la</strong> meilleure <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
d’Anatolie, d’un point <strong>de</strong> vue militaire, politique et économique.<br />
Les expéditions organisées sécurisèrent les routes commerciales.<br />
Les carav<strong>ans</strong>érails ainsi que sa politique commerciale permirent<br />
un développement économique. Il s’appliqua aussi à permettre le<br />
développement <strong>de</strong>s sciences et <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture d<strong>ans</strong> le pays. Grâce à sa<br />
façon <strong>de</strong> gouverner, le calife Abbassid lui donna le titre <strong>de</strong> « Grand<br />
Sultan ».
Le déclin<br />
Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Keykubad, les personnalités dominantes <strong>de</strong> l’Etat<br />
portèrent Giyaseddin Keyhusrev II au pouvoir. Il n’avait cependant<br />
pas les capacités <strong>de</strong> son père d<strong>ans</strong> les domaines <strong>de</strong> l’administration et<br />
<strong>de</strong> l’armée. Il resta tout d’abord sous l’influence <strong>de</strong> son commandant<br />
Saa<strong>de</strong>ttin Kopek qui lui fit se débarrasser <strong>de</strong> tous les hommes d’Etat<br />
qui auraient pu être ses adversaires. Il continua ainsi jusqu’en 1239.<br />
Kopek fut pendu et <strong>de</strong>s hommes d’Etat influents recommencèrent leur<br />
activité d<strong>ans</strong> l’Etat. Bien que ce<strong>la</strong> ait apporté un peu <strong>de</strong> mieux à l’Etat,<br />
celui-ci ne put se débarrasser <strong>de</strong> ses faiblesses politiques et religieuses.<br />
La rébellion Baba Ishak qui émergea pour <strong>de</strong>s motifs religieux et<br />
économiques fut difficilement réprimée. Elle montra que l’Etat était<br />
trop faible, ne serait-ce que pour réprimer une rébellion ou résoudre<br />
ses problèmes internes.<br />
Finalement, les Mongols entrèrent en Anatolie avec une gran<strong>de</strong><br />
armée et se battirent contre l’armée Seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie en 1243 à<br />
köşedağ, près <strong>de</strong> Sivas. En juillet 1243, les Seldjouki<strong>de</strong>s furent vaincus<br />
et les Mongols gouvernèrent l’Anatolie pendant près d’un <strong>de</strong>mi siècle.<br />
Les sult<strong>ans</strong> seldjouki<strong>de</strong>s qui succédèrent à Giyaseddin Keyhusrev<br />
gouvernaient comme <strong>de</strong>s marionnettes aux mains <strong>de</strong>s Mongols. L’Etat<br />
seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie finit par disparaître totalement en 1308.<br />
Après <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> Köşedağ en 1243, l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie<br />
fut sur <strong>la</strong> pente rapi<strong>de</strong> du déclin. Les sult<strong>ans</strong> au pouvoir avant 1308<br />
gouvernaient sur les ordres <strong>de</strong>s Mongols qui, finalement, gouvernaient<br />
indirectement le pays. La situation administrative entraîna une crise<br />
économique qui entraîna à son tour <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong><br />
d’Anatolie. Les commandants turkmens, vou<strong>la</strong>nt profiter <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation,<br />
se séparèrent <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s et créèrent leur principauté dès que les<br />
Mongols furent plus faibles. Ainsi, Eretna, Karam<strong>ans</strong>, Germiy<strong>ans</strong>,<br />
Aydins, Hamids, Karasi, Dulkadir et Ramazan furent construites. Ceci<br />
marqua le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s principautés qui se battirent<br />
contre les Byzantins et jouèrent un rôle important d<strong>ans</strong> l’is<strong>la</strong>misation<br />
et <strong>la</strong> turquisation <strong>de</strong> l’Anatolie.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
57
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
58<br />
CHAPITRE 7<br />
Les Etats turcs en In<strong>de</strong><br />
1. Le Sultanat turc <strong>de</strong> Dehli<br />
L’Is<strong>la</strong>m arriva en In<strong>de</strong> du temps <strong>de</strong>s Umayyads mais les conversions<br />
se firent en masse du temps <strong>de</strong> l’Etat ghaznévi<strong>de</strong> turc. Après <strong>la</strong><br />
<strong>de</strong>struction <strong>de</strong>s Ghaznévi<strong>de</strong>s, les Ghoris (Gurlu<strong>la</strong>r) commencèrent à<br />
dominer. Ensuite, les dynasties Ghoris furent fondées et gouvernées<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. La domination turque continua avec les Qutbis, les<br />
Shemsis, les Ba<strong>la</strong>b<strong>ans</strong> et les Ha<strong>la</strong>cs <strong>de</strong> 1206 à 1414.<br />
Muizuddin Muhammed, le dirigeant <strong>de</strong>s Ghoris qui arriva au pouvoir<br />
en 1203, donna <strong>la</strong> mission au commandant Turc Aybak <strong>de</strong> conquérir<br />
l’In<strong>de</strong>. L’importance <strong>de</strong> Aybak augmenta avec cette conquête. Il fit<br />
construire <strong>de</strong>s mosquées et <strong>de</strong>s Médressées (écoles théologiques) sur<br />
les terres qu’il conquit. Il y instaura <strong>la</strong> paix, <strong>la</strong> tranquillité et <strong>la</strong> justice. A<br />
<strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Muizuddin Muhammed en 1206, Aybak prit Delhi, déc<strong>la</strong>ra<br />
son indépendance et fondit son propre Etat. Bien qu’il occupa Ghazna<br />
pour quelques temps, il ne put contrôler cette région bien longtemps. Il<br />
prit tout le Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> <strong>de</strong> Peshaver aux montagnes du Tibet. Quand<br />
il mourut en 1210, Aram Shah <strong>de</strong>vint le Sultan. En 1211, Shemseddin<br />
Iltutmush, le beau fils <strong>de</strong> Aybak et un <strong>de</strong> ses commandants, renversa<br />
Aram et s’auto proc<strong>la</strong>ma Sultan.<br />
Iltutmush, le fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie shemsi qui dura jusqu’en 1266,<br />
prit d’abord sous son autorité les commandants qui s’étaient déc<strong>la</strong>rés<br />
indépendants après <strong>la</strong> mort d’Aybak. Il réussit ensuite <strong>de</strong>s conquêtes<br />
et é<strong>la</strong>rgit sa domination. Il inclut d<strong>ans</strong> son domaine Punjap, Lahor<br />
et Multan. Recueil<strong>la</strong>nt les popu<strong>la</strong>tions turques fuyant les Mongols, il<br />
aida <strong>la</strong> culture turque à se développer d<strong>ans</strong> le Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. Il fut le<br />
premier sultan <strong>de</strong> Delhi à être accepté par le Calife Abbassid. Après <strong>la</strong><br />
mort <strong>de</strong> Iltutmush en 1236, sa fille dirigea le pays pendant un certain<br />
temps. Mais bientôt, les commandants se rebellèrent et une lutte pour<br />
l’accession au trône s’engagea qui mit le pays sens <strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>ssous. Les<br />
Mongols entrèrent d<strong>ans</strong> Sind, Multan et Punjap. En 1241, ils ruinèrent<br />
Lahor. Ba<strong>la</strong>ban, l’un <strong>de</strong>s commandants <strong>de</strong> Iltutmush mit sur pied une<br />
soli<strong>de</strong> armée et repoussa l’attaque mongole en 1258 et 1259. Il récupéra<br />
le trône et <strong>de</strong>vint Sultan, portant le nom <strong>de</strong> Giyaseddin.<br />
Il établit une nouvelle dynastie du nom <strong>de</strong> Giyaseddin et renforça son<br />
autorité en obtenant le soutien <strong>de</strong>s Turcs qui s’étaient réfugiés en In<strong>de</strong>
à cause <strong>de</strong> l’invasion mongole. Il réprima sévèrement les rébellions<br />
éventuelles qui pouvaient se faire contre son autorité. Il établit une<br />
forte domination turque en In<strong>de</strong> jusqu’en 1287. Cependant, comme<br />
Giyaseddin n’avait pas <strong>de</strong> son vivant formé un bon successeur, les<br />
sult<strong>ans</strong> qui lui succédèrent restèrent sous l’influence et l’autorité <strong>de</strong>s<br />
commandants. En 1290, trois <strong>ans</strong> après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Giyaseedin, le chef<br />
<strong>de</strong>s Turcs Ha<strong>la</strong>c (Firuz Shah) mit fin à <strong>la</strong> Dynastie Bab<strong>la</strong>ban et <strong>de</strong>vint<br />
le nouveau sultan <strong>de</strong> New Delhi avec le nom <strong>de</strong> Ce<strong>la</strong>leddin.<br />
Le Shah Ce<strong>la</strong>leddin Firuz réussit à empêcher les invasions mongoles<br />
<strong>de</strong> 1291 à 1292 et captura <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Mongols. Ceux qui étaient<br />
musulm<strong>ans</strong> furent p<strong>la</strong>cés près <strong>de</strong> Delhi et commencèrent à servir le<br />
Sultanat turc <strong>de</strong> Delhi. Quand Ce<strong>la</strong>leddin mourut en 1296, A<strong>la</strong>adin<br />
Muhammed Shah <strong>de</strong>vint son successeur. A<strong>la</strong>adin Muhammed<br />
Shah qui <strong>de</strong>vint l’un <strong>de</strong>s plus importants dirigeants <strong>de</strong> Ha<strong>la</strong>c, fit <strong>de</strong><br />
nombreuses réformes économiques et administratives qui permirent<br />
au pays <strong>de</strong> <strong>de</strong>venir prospère. Repoussant les Mongols et les Indous, il<br />
é<strong>la</strong>rgit les frontières <strong>de</strong> l’Etat aux régions côtières du Sud <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>, prit<br />
le contrôle <strong>de</strong> presque tout le Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. Après sa mort en 1316,<br />
son fils Mubarek Khan prit sa succession. Il ne fut pas aussi bon que<br />
son père d<strong>ans</strong> les affaires <strong>de</strong> l’Etat. Il fut critiqué et désapprouvé d<strong>ans</strong><br />
son utilisation <strong>de</strong> métho<strong>de</strong>s violentes afin <strong>de</strong> réprimer les rébellions. Il<br />
fut assassiné en 1320. Après sa mort, le commandant <strong>de</strong>s régions du<br />
front, Melik Tugluk mit fin à <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Ha<strong>la</strong>cs et commença l’ère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Tugluk<strong>la</strong>rs en <strong>de</strong>venant le nouveau sultan <strong>de</strong> Delhi.<br />
Peu après son arrivée au pouvoir, Gazi Melik Tugluk rétablit <strong>la</strong> paix et <strong>la</strong><br />
tranquillité d<strong>ans</strong> l’Etat et partit à <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> nouveaux territoires. Il<br />
prit Varandal et Birdar. Quand il mourut en 1325, son fils Muhammed<br />
Tuluk Shah <strong>de</strong>vint son successeur. Afin <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le contrôle sur les<br />
terres, Devletabad fut crée en tant que nouveau centre administratif.<br />
Muhammed mourut en 1351. Après ce<strong>la</strong>, ce fut une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> grand<br />
Chaos d<strong>ans</strong> le pays. Les commandants se déc<strong>la</strong>rèrent indépendants et<br />
cinq différents Etats émergèrent. Quand le Shah Firuz vint au pouvoir,<br />
il rétablit l’Etat et l’unité d<strong>ans</strong> le pays. Il mit en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> nombreuses<br />
réformes financières, économiques et administratives. Il réorganisa le<br />
système <strong>de</strong>s impôts. Son administration juste et équitable lui valut <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> reconnaissance parmi les musulm<strong>ans</strong> comme les non musulm<strong>ans</strong>.<br />
Cependant, quand il mourut en 1388, le chaos revint d<strong>ans</strong> le pays et les<br />
Shahza<strong>de</strong>s se battirent pour accé<strong>de</strong>r au trône. Ce<strong>la</strong> continua jusqu’à ce<br />
que Timur Khan prennent les terres du Sultanat <strong>de</strong> Delhi. Les Seyidis<br />
Afg<strong>ans</strong> mirent ensuite fin à <strong>la</strong> dynastie Tugluk.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
59
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
60<br />
2. L’Empire <strong>de</strong> Bâbur (1526-1858)<br />
Vers <strong>la</strong> fin du seizième siècle, hormis l’Empire ottoman, <strong>de</strong>ux Etats<br />
jouaient un rôle décisif d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique du mon<strong>de</strong> is<strong>la</strong>mique: L’Empire<br />
<strong>de</strong> Bâbur et les Safavi<strong>de</strong>s.<br />
L’Empire <strong>de</strong> Bâbur fut fondé en 1526 en In<strong>de</strong> par Bâbur, le petit fils<br />
<strong>de</strong> Chagatay Turk, Timur Kan. Baur, le fils du Shah Omer Mirza <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> dynastie Fergana, vint au pouvoir au lieu <strong>de</strong> son père. Pendant <strong>la</strong><br />
lutte entre les Safavi<strong>de</strong>s et les Ouzbeks qui eut lieu d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région au<br />
début du seizième siècle, il s’instal<strong>la</strong> à Samarqand avec le soutien <strong>de</strong>s<br />
Safavi<strong>de</strong>s. Quand les Ouzbeks vainquirent les Safavi<strong>de</strong>s en 1512, il dut<br />
se retirer à Kabul. Pensant qu’il ne pourrait survivre en Asie centrale, il<br />
se tourna vers l’In<strong>de</strong>. En 1526, après avoir gagné <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Panipat,<br />
il al<strong>la</strong> vers le Sultanat <strong>de</strong> Lodi et créa un Etat en In<strong>de</strong>. Sa capitale était<br />
Agra. Quand le Shah Bâbur mourut en 1530, les frontières <strong>de</strong> son Etat<br />
s’étendaient <strong>de</strong>s montagnes Vindiya au Sud à <strong>la</strong> rivière Amu Darya au<br />
Nord. Son fils Humayun lui succéda à sa mort.<br />
Humayun passa les premières années <strong>de</strong> son règne à rétablir l’ordre<br />
et l’unité d<strong>ans</strong> son pays. A cette époque, son plus grand ennemi : le<br />
Shirshah afgan le vainquit et l’obligea à se retirer à Lahor. Humayun<br />
dut quitter Agra et trouva refuge d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Dynastie <strong>de</strong>s Safavi<strong>de</strong>s. Les<br />
Suris (Pashtuns) prirent le gouvernement <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. Humayun qui resta<br />
avec les Safavi<strong>de</strong>s les soutint et prit l’Afghanistan, Punjap et les régions<br />
avoisinantes. Il vainquit les Suris à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Machivera en 1555 et<br />
put ainsi <strong>de</strong> nouveau diriger l’In<strong>de</strong>. Cette victoire est considérée comme<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième date <strong>de</strong> <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong> Bâbur Le fils <strong>de</strong><br />
Humayun, Akbar, prit <strong>la</strong> succession <strong>de</strong> son père à <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.<br />
Le Shah Akbar fut l’un <strong>de</strong>s plus grands dirigeants <strong>de</strong>s Bâbur. Il prit<br />
<strong>de</strong>s terres somme Bengal, Kabul et Kashmir et é<strong>la</strong>rgit les frontières<br />
<strong>de</strong> l’Etat. Il fit <strong>de</strong>s réformes d<strong>ans</strong> le domaine <strong>de</strong> l’économie et<br />
d’administration. Il établit <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec les Ottom<strong>ans</strong>, les<br />
Safavi<strong>de</strong>s et les Ouzbeks et suivit une politique <strong>de</strong> paix. Il proposa que<br />
les Ottom<strong>ans</strong> suivent une politique commune contre les Portugais qui<br />
étaient actifs d<strong>ans</strong> l’Océan Indien. En raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> distance entre les<br />
<strong>de</strong>ux Etats, ce<strong>la</strong> ne fonctionna pas. Cihangir, qui arriva au pouvoir en<br />
1603 après Akbar, réprima <strong>la</strong> rébellion afghane au Bengale. Pendant le<br />
règne <strong>de</strong> Cihangir, les Pays bas, le Portugal, <strong>la</strong> France et l’Angleterre<br />
mirent en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s politiques colonialistes en In<strong>de</strong>. Cihangir donna<br />
aux Européens <strong>la</strong> permission <strong>de</strong> faire du commerce. Ainsi, il y prépara<br />
<strong>la</strong> future domination ang<strong>la</strong>ise. Quand Cihangir mourut en 1627, son<br />
fils le Shah Cihan prit le pouvoir.
Le Shah Cihan prit le contrôle <strong>de</strong> tous les Etats musulm<strong>ans</strong> existants<br />
en In<strong>de</strong> et les unifia. Il établit également <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec les<br />
Ottom<strong>ans</strong>, les Safavi<strong>de</strong>s et les Européens. Cependant, en 1632, alors<br />
que les colonies portugaises à Hugli commencèrent à chercher <strong>de</strong>s<br />
esc<strong>la</strong>ves au Bengale, il intervint et les força à rester seulement d<strong>ans</strong><br />
une ville et à ne pas entrer d<strong>ans</strong> d’autres villes sous le règne d’autres<br />
gouvernants. Le Shah Cihan tomba ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et mourut en 1652. Après<br />
sa mort, ses fils se battirent pour lui succé<strong>de</strong>r. Evrengzib Alemgir en<br />
sortit victorieux et se déc<strong>la</strong>ra Sultan d’Agra en 1658.<br />
C’est sous le règne <strong>de</strong> Evrengzip que les Bâburs connurent leur apogée.<br />
L’amitié avec les Safavi<strong>de</strong>s continuait. Des délégués d’amitié furent<br />
envoyés à <strong>la</strong> Mecque et un grand soutien financier se mit en p<strong>la</strong>ce. Du<br />
temps du Sultan Suleyman II, les Ottom<strong>ans</strong> envoyèrent un délégué<br />
d<strong>ans</strong> l’Empire <strong>de</strong> Bâbur L’amitié avec les Ottom<strong>ans</strong> n’en était que<br />
renforcée. Afin <strong>de</strong> faire un équilibre entre les Musulm<strong>ans</strong> et les Indous,<br />
une popu<strong>la</strong>tion musulmane importante fut tr<strong>ans</strong>férée d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région,<br />
venant du Turkestan. Elle fut installée d<strong>ans</strong> les gran<strong>de</strong>s villes et enrôlée<br />
d<strong>ans</strong> l’armée. Evregzip tomba ma<strong>la</strong><strong>de</strong> et mourut en 1707.<br />
Après lui, l’Etat s’affaiblit et les dirigeants qui lui succédèrent ne<br />
furent pas aussi bons que lui pour protéger l’Etat <strong>de</strong>s menaces et <strong>de</strong>s<br />
intrusions. Pendant ce temps, Le Shah Nadir Afshar qui avait détruit<br />
les Safavi<strong>de</strong>s en Perse et y avait fondé sa propre dynastie, mit en p<strong>la</strong>ce<br />
une expédition en In<strong>de</strong> en 1738. D’abord il envahit Kabul puis Punjcap<br />
et Delhi. A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’expédition, il emmena les trésors indous en Perse.<br />
Les Européens profitèrent aussi <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation. Le Shah Alem, arrivé<br />
au pourvoir en 1760, fut le premier Sultan à accepter <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s<br />
Ang<strong>la</strong>is. Sous son règne, les Ang<strong>la</strong>is rendirent leur domination en In<strong>de</strong><br />
plus permanente et é<strong>la</strong>rgirent leur sphère d’influence. Avec le temps, les<br />
noms <strong>de</strong>s dirigeants <strong>de</strong> Bâbur disparurent <strong>de</strong> <strong>la</strong> surface <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong><br />
monnaie et lire <strong>de</strong>s « Khutbe » en leur nom fut interdit.<br />
Le <strong>de</strong>rnier Empereur <strong>de</strong> Bâbur, le Shah Bahadır, mit sur pied une<br />
gran<strong>de</strong> rébellion contre les Ang<strong>la</strong>is en 1857. Il fit frapper <strong>de</strong>s pièces <strong>de</strong><br />
monnaie à son effigie et fit lire <strong>de</strong>s « Khutbe » à son nom. Les Ang<strong>la</strong>is<br />
réprimèrent durement cette rébellion. 30 000 personnes furent tuées à<br />
Delhi. Le Shah Bahadır fut capturé et mourut en 1862, aux mains <strong>de</strong>s<br />
Ang<strong>la</strong>is. C’était <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong> Bâbur . Après ce<strong>la</strong>, les Ang<strong>la</strong>is<br />
firent <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> leur colonie et l’administrèrent <strong>de</strong> Londres en 1858.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
61
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
62<br />
CHAPITRE 8<br />
Les Khanats turcs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire<br />
1. L’Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or<br />
L’Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or fut fondé en 1241 par le petit fils <strong>de</strong> Genghis<br />
Khan : Batu Khan, sur une terre s’étendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire à <strong>la</strong> Hongrie.<br />
Sa capitale était Sarai ou Saray, l’une <strong>de</strong>s plus gran<strong>de</strong>s villes du mon<strong>de</strong><br />
médiéval. Batu Khan prit les régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> basse et moyenne Volga, les<br />
terres Caucasiennes entre Khwarezm et l’Azerbaïdjan et les steppes<br />
Kiptchak. En 1257, le frère <strong>de</strong> batu : Berke, <strong>de</strong>vint Sultan. Berke fut<br />
le premier dirigeant mongol à se convertir à l’Is<strong>la</strong>m. Ayant passé une<br />
alliance avec Baybars, le sultan égyptien, il attaqua Hu<strong>la</strong>gu, le dirigeant<br />
perse, l’Irak et l’Anatolie et détruisit son administration en 1262.<br />
Durant le règne <strong>de</strong> Berke Khan, l’Is<strong>la</strong>m se répandit rapi<strong>de</strong>ment parmi<br />
les Mongols qui venaient d<strong>ans</strong> les régions Nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire.<br />
Après leur conversion à l’Is<strong>la</strong>m, les Mongols sous le règne <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong><br />
d’Or, se trouvant d<strong>ans</strong> les régions turques <strong>de</strong> Kiptchak et Kuman<br />
commencèrent à être influencés par <strong>la</strong> culture turque. Ils oublièrent<br />
leur <strong>la</strong>ngue natale et <strong>de</strong>vinrent turcs. Après Berke Khan, <strong>de</strong>s dirigeants<br />
musulm<strong>ans</strong> vinrent au pouvoir. Uzbek Khan (1313-1341) et tous les<br />
dirigeants qui lui succédèrent étaient musulm<strong>ans</strong>. Uzbek Khan fit <strong>de</strong><br />
l’Is<strong>la</strong>m <strong>la</strong> religion officielle <strong>de</strong> l’Etat. Sarayberke <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong><br />
l’Etat. Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Canibek Khan en 1359, <strong>de</strong>s conflits internes<br />
commencèrent d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or qui eurent comme conséquence<br />
l’affaiblissement <strong>de</strong> l’Etat. Les Russes en profitèrent et vainquirent <strong>la</strong><br />
Hor<strong>de</strong> d’or en 1380. L’unité et <strong>la</strong> reconstruction <strong>de</strong> l’Etat achevées par<br />
Toktamış Khan arrivé au pouvoir un peu plus tard, continuèrent jusqu’à<br />
ce que commence l’expédition militaire <strong>de</strong> Timur contre <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or<br />
en 1395. En 1398, Toktamış Khan dut se réfugier chez le Prince <strong>de</strong><br />
Lituanie. L’Etat se désintégra ensuite en Etats tels que <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Hor<strong>de</strong> d’Or (1432-1502), le Khanat d’Astrakhan (1466-1557), le<br />
Khanat <strong>de</strong> Kazan (1445-1552), le Khanat <strong>de</strong> Crimée (1430-1783) et<br />
le Khanat Uzbek.<br />
2. Le Khanat <strong>de</strong> Kazan<br />
Le Khanat <strong>de</strong> Kazan fut fondé en 1437 d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région où les Bulgares<br />
Volga vivaient du temps <strong>de</strong> Ulug Muhammed Khan, l’un <strong>de</strong>s anciens<br />
Kh<strong>ans</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or. Sa popu<strong>la</strong>tion se composait <strong>de</strong> Turcs noma<strong>de</strong>s<br />
ou sé<strong>de</strong>ntaires et <strong>de</strong> Finns. Ulug Muhammed Khan (1437-1445) se<br />
battit contre les principautés <strong>de</strong> Moscou. Vaincus, les Russes acceptèrent
<strong>la</strong> domination <strong>de</strong> Ulug Muhammed Khan ainsi que <strong>de</strong> payer un impôt<br />
annuel, <strong>de</strong> <strong>la</strong>isser les officiers kaz<strong>ans</strong> travailler d<strong>ans</strong> les villes russes et <strong>de</strong><br />
donner <strong>la</strong> région sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Oka à Shahza<strong>de</strong> Kasim pour<br />
qu’il y installe son Etat. Grâce au Khanat <strong>de</strong> Kasim fondé sur les bords<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Oka, Moscou Kniaz fut gardé sous contrôle.<br />
Alors que <strong>la</strong> lutte pour le trône se faisait plus intense, Ivan III <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Moscou se maria avec Sofia <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille royale<br />
Byzantine et déc<strong>la</strong>ra son indépendance face à <strong>la</strong> domination turque<br />
en 1480. Les Russes entrèrent d<strong>ans</strong> Kazan en été 1487. Alors que le<br />
Khan Kazan Muhammed Emin (1502-1518) repoussa les Russes hors<br />
<strong>de</strong> Kazan en 1506, il ne put faire disparaître complètement <strong>la</strong> menace<br />
qu’ils représentaient. Kazan <strong>de</strong>vint le domaine du Khanat <strong>de</strong> Crimée en<br />
1521 et du Khanat d’Astrakhan en 1552. Pendant cette pério<strong>de</strong>, il dut<br />
faire face en permanence à <strong>de</strong>s attaques russes. Ivan le Terrible, avec le<br />
support <strong>de</strong>s Européens, entra d<strong>ans</strong> Kazan au début d’Août 1552. Après<br />
une lutte féroce entre les <strong>de</strong>ux camps, les Russes entrèrent d<strong>ans</strong> Kazan<br />
et capturèrent Muhammed Khan et ses gens. Des édifices culturels et<br />
historiques furent saccagés pendant l’invasion. Les trésors <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville et<br />
<strong>de</strong> l’Etat furent pris par les Russes. Finalement, <strong>la</strong> domination russe fut<br />
établie à Kazan. Les rébellions qui se firent pour l’indépendance furent<br />
sévèrement réprimées. Les Turks kaz<strong>ans</strong> qui ont survécu sont connus<br />
sous le nom <strong>de</strong> Tatars.<br />
3. Le Khanat <strong>de</strong> Crimée<br />
Le fondateur du Khanat <strong>de</strong> Crimée fut le frère <strong>de</strong> Batu Khan : Haci<br />
Giray. Le Khanat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or et son dirigeant Toktamış furent<br />
secoués par leur défaite <strong>de</strong>vant Timur en 1391-1395. Après cette<br />
défaite, les commandants <strong>de</strong> <strong>la</strong> Crimée commencèrent à se battre<br />
pour leur indépendance. Haci Giray, l’un <strong>de</strong> ses commandants, déc<strong>la</strong>ra<br />
son indépendance en 1441 et fonda le Khanat <strong>de</strong> Crimée. Alors qu’il<br />
était le Khan, Haci Giray prit le contrôle <strong>de</strong> Taman Kabartay et <strong>de</strong><br />
Kiptchak. Il fit une alliance avec les principautés <strong>de</strong> Moscou contre<br />
<strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or et avec les Ottom<strong>ans</strong> contre les Genevois. La lutte<br />
pour le pouvoir qui arriva après sa mort rendit le pays vulnérable aux<br />
attaques externes. Les administrateurs <strong>de</strong> Crimée <strong>de</strong>mandèrent l’ai<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> contre <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’or et les Genevois. Sur ce, Mehmed<br />
II prit les colonies genevoises sur <strong>la</strong> côte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Crimée grâce à une<br />
gran<strong>de</strong> flotte qu’il envoya d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région et p<strong>la</strong>ça le Khanat <strong>de</strong> Crimée<br />
sous <strong>la</strong> protection <strong>de</strong> l’Empire ottoman en 1475. Avec <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
Ottom<strong>ans</strong>, les Criméens réussirent à tenir les Russes à distance <strong>de</strong> leurs<br />
terres pendant longtemps.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
63
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
64<br />
Quand l’Empire ottoman commença à s’affaiblir au dix-septième<br />
siècle, les Russes qui vou<strong>la</strong>ient étendre leur domination à <strong>la</strong> Mer Noire,<br />
ont commencé à intensifier leurs attaques pour envahir <strong>la</strong> Crimée. En<br />
1736, <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Crimée fut envahie pour <strong>la</strong> première fois. La<br />
guerre entre les Ottom<strong>ans</strong> et les Russes qui se dérou<strong>la</strong> entre 1768 et<br />
1774 mit fin au Khanat <strong>de</strong> Crimée. Avec le traité <strong>de</strong> Küçük Kaynarca<br />
(Kuchuk Kainarji), signé par les Ottom<strong>ans</strong> vaincus, ces <strong>de</strong>rniers durent<br />
accepter l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Crimée. Cette indépendance fut <strong>de</strong><br />
courte durée puisque les Russes prirent <strong>la</strong> Crimée en 1783.<br />
4. Le Khanat d’Astrakhan<br />
Le Khanat d’Astrakhan fut fondé en 1466 par Kasim Khan, un<br />
<strong>de</strong>scendant du Khan Muhammed <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or. Le Khanat<br />
d’Astrakhan fut fondé d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville d’Astrakhan (Ej<strong>de</strong>rhan, Astragan)<br />
et d<strong>ans</strong> ses environs, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région où <strong>la</strong> rivière Itil (Volga) se jette<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mer Caspienne. Astrakhan, <strong>la</strong> capitale du Khanat, se situait<br />
sur une route commerciale importante. Elle <strong>de</strong>vint riche grâce à <strong>de</strong>s<br />
contacts avec <strong>de</strong>s pays prospères et <strong>de</strong>s tribus nomadiques faisant leur<br />
commerce d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville. L’autorité centrale commença à s’affaiblir avec<br />
le temps en raison d’attaques étrangères permanentes. Un autre facteur<br />
<strong>de</strong> cet affaiblissement fut que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion était nomadique et que<br />
les principautés locales gagnaient du pouvoir pendant les attaques<br />
étrangères. C’est pourquoi Le khanat n’ayant réussi à assurer une<br />
certaine force et permanence ne put vivre longtemps.<br />
Du temps <strong>de</strong> Kasim Khan (1466-1490) et <strong>de</strong> son frère Abdulkerim<br />
Khan (1490-1504), <strong>de</strong>s alliances furent passées avec <strong>la</strong> Russie et <strong>la</strong><br />
Hor<strong>de</strong> d’Or, ce qui permit une atmosphère <strong>de</strong> paix. Quand <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong><br />
d’Or s’effondra en 1502, Le Khanat <strong>de</strong> Crimée et <strong>de</strong> Nogaï tentèrent<br />
<strong>de</strong> prendre Astrakhan. Ainsi, le Khanat fut marqué par <strong>de</strong>s batailles<br />
avec ces Etats, batailles qui continuèrent jusqu’en 1525 ainsi que par<br />
le changement constant <strong>de</strong> Khan. Bien que Huseyin Khan ait signé<br />
un accord avec le Khanat <strong>de</strong> Crimée en 1523, le Khanat souffrait <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> pression <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie, désireuse d’étendre son territoire vers l’Est.<br />
Le Khan <strong>de</strong> Crimée : Shahin Bey, entra d<strong>ans</strong> Astrakahan en 1549.<br />
Il détruisit <strong>la</strong> ville et captura une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, y<br />
compris Yagmurcu Khan. Ce <strong>de</strong>rnier réussit à se libérer et à remonter<br />
sur le trône grâce à l’intervention <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>.<br />
Cette lutte entre <strong>la</strong> Crimée, les Khanats <strong>de</strong> Kazan et d’Astrakhan<br />
servaient les intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie. Profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation, les Russes<br />
rayèrent le Khanat <strong>de</strong> Kazan en 1552 <strong>de</strong> l’Histoire et attaquant<br />
soudainement Astrakhan en 1552, ils mirent également fin au Khanat<br />
d’Astrakhan en 1556.
5. Le Khanat <strong>de</strong> Kasim (1445-1681)<br />
Ce Khanat fut fondé en 1445 par Kasim, le fils du Kazan Kahn Ulug<br />
Muhammed. Ce Khanat se situait d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Goro<strong>de</strong>ts (Kasım),<br />
qui se trouvait sur les bords <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Oka afin <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r un<br />
contrôle sur Moscou. Cependant, ce Khanat <strong>de</strong>vint une propriété <strong>de</strong>s<br />
principautés <strong>de</strong> Moscou en peu <strong>de</strong> temps et fut utilisé par ces <strong>de</strong>rnières<br />
afin <strong>de</strong> contrôler les Turcs. Les administrateurs du Khanat, contrôlés<br />
par <strong>de</strong>s Gouverneurs russes, restèrent à leur poste en 1681.<br />
6. Le Khanat <strong>de</strong> Sibir<br />
Ce Khanat fut parmi ceux qui émergèrent <strong>de</strong> <strong>la</strong> désintégration <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Hor<strong>de</strong> d’Or. Son fondateur était Taybuga. Sa capitale était <strong>la</strong> ville <strong>de</strong><br />
Sibir, à coté <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville actuelle <strong>de</strong> Tumen et son territoire s’étendait <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Mongolie actuelle du Nord vers <strong>la</strong> Sibérie.<br />
Avec le règne <strong>de</strong> Sibir Khan (1563-1598), l’Etat prit son nom. Sibir<br />
Khan repoussa les Russes <strong>de</strong> Sibérie en 1584. Cependant, les forces<br />
russes puissantes rentrèrent à nouveau bientôt d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Sibérie. A <strong>la</strong><br />
mort <strong>de</strong> Sibir Khan en 1598, le principal obstacle qui se dressait <strong>de</strong>vant<br />
les Russes tomba et ils envahirent toute <strong>la</strong> Sibérie jusqu’en 1683.<br />
7. Le Khanat <strong>de</strong> Nogaï<br />
Nogaï, l’un <strong>de</strong>s commandants important <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or, fit preuve<br />
d’une certaine indépendance lorsqu’il était sous les ordres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong>.<br />
Avec <strong>la</strong> désintégration <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière, il créa le Khanat <strong>de</strong> Nogaï<br />
avec les tribus sous son autorité. La capitale du Khanat <strong>de</strong> Nogaï était<br />
Saraycık, <strong>la</strong> région où <strong>la</strong> rivière Yayık se jetait d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mer Caspienne.<br />
La popu<strong>la</strong>tion du Khanat se composait principalement <strong>de</strong> Turcs<br />
kiptchak. Le Khanat était influent d<strong>ans</strong> les territoires qui composent<br />
le Kazakhstan actuel. Le Khanat se divisait en quelques branches<br />
après sa <strong>de</strong>struction par les Kaz<strong>ans</strong> et les Astrakh<strong>ans</strong>. Certaines <strong>de</strong> ces<br />
branches formaient <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Hor<strong>de</strong> Nogaï qui accepta <strong>la</strong> domination<br />
russe. Ceux qui n’acceptèrent pas <strong>la</strong> domination russe continuèrent leur<br />
existence d<strong>ans</strong> différentes parties du Nord Caucase. A <strong>la</strong> fin, <strong>la</strong> Russie<br />
prit l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sibérie en 1604. Elle étendit sa souveraineté sur<br />
les Kirghizes vivant sur <strong>la</strong> partie haute <strong>de</strong> <strong>la</strong> rivière Yenisei, puis sur <strong>la</strong><br />
Crimée en 1783, au Nord du Caucase en 1859, sur Tachkent (capitale<br />
<strong>de</strong> l’Ouzbékistan) en 1865, et sur le Khanat <strong>de</strong> Bkuhara en 1868.<br />
Finalement, en prenant le contrôle du Turkménistan en 1884, tous les<br />
pays ou régions turcs <strong>de</strong> Sibérie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire du Nord, du Nord<br />
Caucase et d’Asie centrale, sauf les Ouïghours <strong>de</strong> l’Est, furent p<strong>la</strong>cés<br />
sous domination russe.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
65
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
66<br />
CHAPITRE 9<br />
Les Etats turcs fondés en Anatolie et en Perse<br />
1. La Dynastie Timouri<strong>de</strong><br />
Cette dynastie fut fondée par Timur Khan qui était d’origine mongole<br />
mais proche <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture turque. D<strong>ans</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième moitié du<br />
quatorzième siècle, il y eut un chaos d<strong>ans</strong> le Khanat <strong>de</strong> Chagatai du<br />
Turkestan. L’autorité <strong>de</strong>s Kh<strong>ans</strong> qui <strong>de</strong>scendaient <strong>de</strong> Gengis Khan fut<br />
ébranlée et l’administration passa aux mains <strong>de</strong>s chefs <strong>de</strong> tribus. Timur,<br />
un membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu <strong>de</strong>s Baru<strong>la</strong>s, forma un petit Etat en Tr<strong>ans</strong>oxiane<br />
en 1370 et arriva au pouvoir à Samarqand.<br />
Timur Khan est le meilleur stratège militaire que l’Histoire ait connu.<br />
Il organisa <strong>de</strong> nombreuses expéditions afin d’étendre le territoire <strong>de</strong><br />
l’Etat. Tout d’abord, grâce à <strong>la</strong> première expédition qu’il organisa<br />
en 1371 et 1379, il rattacha Khwarzem à sa dynastie. Il mena cinq<br />
expéditions contre les Ouïghours jusqu’à ce qu’il prenne leur contrôle.<br />
Il soutenu Toktamış Khan durant <strong>la</strong> bataille pour le pouvoir au sein<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or et l’aida à monter sur le trône. Cependant, Toktamış<br />
<strong>de</strong>vint plus puissant et commença à voir en Timur Khan un adversaire<br />
et ils s’affontèrent. Toktamış fut vaincu par trois fois et Timur Khan<br />
<strong>de</strong>vint le maître <strong>de</strong> l’Etat <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or. Puis il al<strong>la</strong> jusqu’à l’Ukraine<br />
et prit possession <strong>de</strong>s colonies genevoises et vénitiennes en Crimée<br />
ainsi que <strong>de</strong>s alentours. Il vainquit aussi les groupes chrétiens, unifia<br />
les princes s<strong>la</strong>ves au Nord du Caucase et prit le Nord <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong> et Delhi<br />
en 1399.<br />
En 1399, après que Timur ait gagné toutes les batailles, il mit sur pied<br />
une expédition qui dura sept <strong>ans</strong>. Il força le royaume <strong>de</strong> Géorgie à<br />
lui obéir. Le dirigeant Kara Yusuf <strong>de</strong>s Kara Koyunlu (Qara Qoyunlu<br />
ou Turkmen moutons noirs) déserta l’Irak après que Timur soit entré<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. Timur prit Sivas, Ma<strong>la</strong>tya et Besni puis se dirigea vers<br />
<strong>la</strong> Syrie. Il prit Antep, Aleppo, Hama, Humus et Damascus sous son<br />
autorité. Le gouvernement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Syrie et du Liban aux mains <strong>de</strong>s<br />
Mamelouks passa également sous son contrôle.<br />
Le pouvoir croissant <strong>de</strong> Timur fit <strong>de</strong> lui le principal adversaire <strong>de</strong>s<br />
Ottom<strong>ans</strong> d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. Quand <strong>la</strong> principauté qui avait été prise<br />
par Bayezid I passa aux mains <strong>de</strong> Timur et quand les commandants<br />
le fuyant trouvèrent refuge d<strong>ans</strong> l’Etat ottoman, une guerre inévitable<br />
éc<strong>la</strong>ta. La guerre d’Ankara vit <strong>la</strong> victoire <strong>de</strong> Timur mais cette victoire
al<strong>la</strong>it avoir <strong>de</strong>s conséquences négatives sur l’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
d<strong>ans</strong> les années suivantes. Après <strong>la</strong> guerre d’Ankara, Timur occupa<br />
<strong>la</strong> capitale ottomane Bursa et saisit les trésors <strong>de</strong> l’Etat ottoman. Il<br />
redistribua leurs terres aux commandants d’Anatolie en leur faisant<br />
jurer fidélité à son pouvoir.<br />
C’est ainsi que l’unité turque en Anatolie fut touchée. Il força également<br />
les Byzantins à payer <strong>de</strong>s impôts. Ainsi, Timur avait fait <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>,<br />
<strong>de</strong>s Mamelouks, <strong>de</strong>s Byzantins, <strong>de</strong>s Rums <strong>de</strong> Trebizonds, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong><br />
d’or et <strong>de</strong>s Etats indous, <strong>de</strong>s Etats dépendants <strong>de</strong> son empire. Sur les<br />
terres qu’il prit, il remp<strong>la</strong>ça <strong>la</strong> loi Genghis qui était en application<br />
<strong>de</strong>puis longtemps avec <strong>la</strong> loi is<strong>la</strong>mique. Ensuite, il commença son<br />
expédition vers l’Est. Timur mourut pendant cette expédition en 1405,<br />
alors qu’il faisait route vers <strong>la</strong> Chine.<br />
L’Empire fut partagé parmi ses fils et ses petits-fils. L’Etat perdit <strong>de</strong><br />
son pouvoir. Après une bataille pour le pouvoir <strong>de</strong> quinze <strong>ans</strong> avec ses<br />
frères et ses neveux, Shahruh <strong>de</strong>vint le dirigeant. A sa mort, <strong>la</strong> lutte<br />
pour le pouvoir reprit. Ulug Bey en sortit vainqueur et monta sur le<br />
trône Timouri<strong>de</strong> après avoir été un astronome et mathématicien se<br />
consacrant à <strong>la</strong> recherche d<strong>ans</strong> les librairies et les observatoires. Il était<br />
alors un sage, détaché <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique. En 1449, il fut tué par son fils,<br />
encouragé par ses adversaires politiques. Les luttes pour le pouvoir<br />
recommencèrent <strong>de</strong> nouveau d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> dynastie Timouri<strong>de</strong>, affaiblie par<br />
<strong>de</strong>s conflits internes. Elle fut détruite par les Ouzbeks en 1507.<br />
2. La dynastie <strong>de</strong>s Ak Koyunlu (Aq Qoyunlu)<br />
Cette dynastie dominait au quinzième siècle l’Anatolie <strong>de</strong> l’Est,<br />
l’Azerbaïdjan et l’Irak. Les fondateurs <strong>de</strong> cette dynastie venaient <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
tribu Bayindir <strong>de</strong>s Oghouzes. Cette dynastie apparut d<strong>ans</strong> l’Histoire<br />
en 1340 sous le règne <strong>de</strong> Tur Ali Bey. Le véritable fondateur <strong>de</strong> l’Etat<br />
fut Karayuluk Osman Bey qui établit d’abord une alliance avec Kadi<br />
Burhaneddin contre les Kara Koyunlu puis, peu après, repoussa l’attaque<br />
<strong>de</strong>s Kara Koyunlu et tua Kadi Burhaneddin. Il établit une alliance cette<br />
fois avec les Mamelouks contre les Ottom<strong>ans</strong>. Son armée fut détruite<br />
par Timur entré en Anatolie. Il s’instal<strong>la</strong> ensuite en Anatolie avec l’ai<strong>de</strong><br />
et le soutien <strong>de</strong> Timur.<br />
Uzun Hasan Bey (1453-1478), l’un <strong>de</strong>s fils <strong>de</strong> Osman Bey, vainquit<br />
les Kara Koyunlu et les Timouri<strong>de</strong>s et prit le contrôle d’une partie <strong>de</strong><br />
l’Anatolie <strong>de</strong> l’Est et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Perse. Il soutint <strong>la</strong> principauté Karaman<br />
contre les Ottom<strong>ans</strong>. Il tenta également d’établir une alliance avec les<br />
Croisés contre les Ottom<strong>ans</strong>. Après cette tentative, le sultan ottoman<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
67
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
68<br />
Mehmed II vainquit Hasan lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Otlukbeli. La dynastie<br />
<strong>de</strong>s Ak koyunlu ne put se remettre <strong>de</strong> cette défaite. Hasan mourut en<br />
1478. Après sa mort, il y eu <strong>de</strong>s luttes pour le trône qui eurent comme<br />
conséquence <strong>la</strong> mise à mort <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Ak koyunlu par le<br />
dirigeant Safavi<strong>de</strong> Shah Ismail.<br />
3. La dynsatie <strong>de</strong>s Kara Koyunlu (Qara Qoyunlu)<br />
Cette dynastie fut fondée d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> moitié du quatorzième siècle<br />
à Ercis, sur les bords du <strong>la</strong>c <strong>de</strong> Van, sur un territoire al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> Erzurum<br />
au Nord à Mosul au Sud. Le fondateur <strong>de</strong> cet Etat était Bayram Hoca,<br />
le chef <strong>de</strong>s Turkmens kara koyunlu. La dynastie <strong>de</strong>s Kara Koyunlu<br />
fut renforcée d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région en se joignant à d’autres tribus turques.<br />
La dynastie <strong>de</strong>s Kara koyunlu commença à dominer toute <strong>la</strong> Perse<br />
et l’Azerbaïdjan excepté Khorasan. En mettant fin à <strong>la</strong> domination<br />
mongole d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région, cette dynastie joua un rôle important d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
turquisation <strong>de</strong> l’Azerbaïdjan.<br />
Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Bayram Hoca, son successeur Kara Mehmed (1380-<br />
1389) vainquit les Artuqids. La lutte avec les Timouri<strong>de</strong>s eut pour<br />
conséquence <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> Tabriz, tr<strong>ans</strong>formée en capitale. Du temps<br />
<strong>de</strong> Kara Yusuf (1389-1420) monté au pouvoir après Kara Mehmad,<br />
les Kara Koyunlu continuèrent leur lutte contre les Timouri<strong>de</strong>s. A <strong>la</strong><br />
fin <strong>de</strong> cette lutte, Kara Yusuf fuit Timur et trouva refuge auprès du<br />
sultan ottoman Bayezid I. Ce fut une <strong>de</strong>s raisons principales <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Guerre d’Ankara. Yusuf reprit l’Etat après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Timur. Il mit fin<br />
aux Artuqids en 1409. En 1415, il prit Bagdad et mit fin à l’autorité<br />
timouri<strong>de</strong> en Azerbaïdjan.<br />
Avec <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Kara Yusuf en 1420, <strong>de</strong>s luttes internes commencèrent<br />
entre ses <strong>de</strong>scendants. Ces luttes affaiblirent <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s Kara<br />
Koyunlu. Par ailleurs, ils furent vaincus par <strong>de</strong>ux fois par <strong>la</strong> dynastie <strong>de</strong>s<br />
Ak koyunlu en 1457 et 1467. En 1469, <strong>la</strong> dynastie disparut.<br />
4. La dynastie Safavi<strong>de</strong><br />
Il s’agissait d’un Etat turc fondé en Perse au début du seizième siècle. Le<br />
nom <strong>de</strong> l’Etat provient <strong>de</strong> Safiyuddin, un dirigeant <strong>de</strong> <strong>la</strong> secte religieuse<br />
safavi<strong>de</strong>ye. Bien que Safavi<strong>de</strong> ait été d’abord une secte religieuse, elle<br />
<strong>de</strong>vint ensuite une dynastie politique. Elle resta Sunnit jusqu’en 1392<br />
puis <strong>de</strong>vint chiite.<br />
La secte safiyuddin s’étendit en Anatolie, en Perse et en Irak. Même<br />
les sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong>, Timur et les Ak koyunlu s’y intéressèrent pour<br />
quelque temps. Timur Khan donna même à Hoca Ali, l’un <strong>de</strong>s petits-
fils Safiyuddin, <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Er<strong>de</strong>bil ainsi que le droit à l’indépendance.<br />
Sheik Cuneyd, un autre petit-fils <strong>de</strong> Hoca Ali, se sépara <strong>de</strong> <strong>la</strong> secte <strong>de</strong><br />
ses prédécesseurs par l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> secte Batini (une secte ésotérique<br />
<strong>de</strong> l’Is<strong>la</strong>m Shi’i). Tirant profit <strong>de</strong> l’intérêt et du respect accordés aux<br />
Safavi<strong>de</strong>s à l’époque <strong>de</strong> son grand-père, il s’engagea d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique.<br />
Ayant soulevé une rébellion contre les Kara koyunlu, il dut déserter<br />
sa patrie et trouver refuge chez les Ottom<strong>ans</strong> et les Karam<strong>ans</strong>. Ne<br />
changeant cependant pas d’attitu<strong>de</strong>, il ne put y rester non plus. Il tenta<br />
<strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r une principauté d<strong>ans</strong> le Sud <strong>de</strong> l’Anatolie et en Syrie en y<br />
exposant ses opinions parmi les Turkmens. Il dut faire face cependant<br />
à l’opposition <strong>de</strong>s Mamelouks. Les Ak koyunlu établirent une royauté<br />
avec lui par voie d’alliance afin d’utiliser son influence. Cependant, les<br />
Safavi<strong>de</strong>s ne purent établirent <strong>de</strong> structure administrative indépendante<br />
avant l’arrivée au pouvoir d’Ismail en 1499.<br />
En 1499, Ismail <strong>de</strong>vint le lea<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Safavi<strong>de</strong>s et rassemb<strong>la</strong> autour<br />
<strong>de</strong> lui les tribus turques d’Anatolie sous influence et contrôle <strong>de</strong>s<br />
Safavi<strong>de</strong>s. En 1501, il vainquit <strong>la</strong> dynastie Ak Koyunlu et prit Tabriz. Il<br />
se proc<strong>la</strong>ma Shah et créa l’Etat Safavi<strong>de</strong> en faisant <strong>de</strong> Tabriz sa capitale.<br />
En 1509, il occupa Bagdad. Il se dirigea ensuite vers les Ottom<strong>ans</strong> à<br />
l’Ouest. Afin <strong>de</strong> provoquer l’effondrement <strong>de</strong> l’Empire ottoman <strong>de</strong><br />
l’intérieur, il envoya <strong>de</strong>s califes shiites chargés <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagan<strong>de</strong><br />
et <strong>de</strong> monter une rébellion religieuse et politique contre l’Etat. Ces<br />
califes <strong>de</strong> nom <strong>de</strong>vinrent si influents que l’un d’entre eux, Shahkulu<br />
réussit à soulever une rébellion. Celle-ci fut éliminée <strong>de</strong> justesse par<br />
l’Etat ottoman.<br />
Selim I, arrivé au pouvoir en 1512 d<strong>ans</strong> l’Empire ottoman, était<br />
conscient <strong>de</strong> <strong>la</strong> menace Safavi<strong>de</strong>. Ainsi, il envoya une expédition en<br />
Perse en 1514 pour mettre fin à cette menace et en même temps, il<br />
vainquit durement les Safavi<strong>de</strong>s à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Caldiran. Ensuite,<br />
les Ottom<strong>ans</strong> entrèrent d<strong>ans</strong> Tabriz et prirent l’Anatolie <strong>de</strong> l’Est,<br />
l’Azerbaïdjan et Diyarbakir. Après <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> Caldiran, Shah İsmail<br />
ne fit rien d’autre contre les Ottom<strong>ans</strong>. Il mourut en 1524. Du temps<br />
<strong>de</strong> son successeur Tahmasp (1524-1576), <strong>la</strong> lutte contre les Ottom<strong>ans</strong><br />
fut finie. La lutte entre les Ottom<strong>ans</strong> et les Safavi<strong>de</strong>s fut officiellement<br />
terminée par <strong>la</strong> signature du traité <strong>de</strong> Amasya en 1555.<br />
L’Etat Safavi<strong>de</strong> commença à sombrer au milieu du dix-septième siècle.<br />
Différents groupes tentèrent <strong>de</strong> prendre leur indépendance par rapport<br />
à l’autorité centrale en se rebel<strong>la</strong>nt contre l’Etat. Nadir Shah mit fin à <strong>la</strong><br />
dynastie safavi<strong>de</strong> en 1736, profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation chaotique et fonda<br />
<strong>la</strong> dynastie afsharid.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
69
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
70<br />
CHAPITRE 10<br />
L’Empire ottoman (1299-1922)<br />
L’histoire <strong>de</strong> l’Empire ottoman est conventionnellement divisée en<br />
quatre pério<strong>de</strong>s : L’Age c<strong>la</strong>ssique (1299-1600), <strong>la</strong> Consolidation (1600-<br />
1774), le Déclin (1774-1914) et <strong>la</strong> Dissolution (1914-1922).<br />
A. L’âge c<strong>la</strong>ssique (1299-1600)<br />
Le terme « ottoman » provient du nom du fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie,<br />
Osman (Ottoman en ang<strong>la</strong>is). La Dynastie ottomane était un membre<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> tribu Kayi <strong>de</strong>s Turcs oghouzes (Turkmens) qui commencèrent<br />
à se dép<strong>la</strong>cer vers l’Iran au neuvième siècle. Ils se sont installés à<br />
Merv, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Khorasan avec les Seldjouki<strong>de</strong>s et les Kayis<br />
qui furent obligés d’émigrer vers l’Azerbaïdjan. En Anatolie <strong>de</strong> l’Est,<br />
ils s’installèrent avec d’autres tribus turques. Une partie <strong>de</strong>s Kayis<br />
s’instal<strong>la</strong> d’abord à l’Ouest d’Ankara au milieu du treizième siècle.<br />
Puis ils s’installèrent d<strong>ans</strong> les environs <strong>de</strong> Sogut et <strong>de</strong> Domanic,<br />
sur les frontières <strong>de</strong> l’Empire byzantin, qui avaient été donnés à<br />
Ertuğrul Ghazi, le lea<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kayis par le Sultan A<strong>la</strong>adin en 1231. Ce<br />
territoire correspond globalement à <strong>la</strong> province romaine <strong>de</strong> Bithynia<br />
que les Seldjouki<strong>de</strong>s avaient prise aux Byzantins un siècle auparavant.<br />
Osman Bey fut nommé commandant avec l’accord <strong>de</strong> toutes les tribus<br />
oghouzes. Il s’instal<strong>la</strong> à <strong>la</strong> frontière <strong>de</strong> Byzance quand Ertugrul mourut<br />
en 1281 ou 1288. Osman épousa <strong>la</strong> fille <strong>de</strong> Sheikh E<strong>de</strong>bali, qui s’était<br />
montré un bon maître spirituel. Ce<strong>la</strong> permit à Osman d’établir son<br />
autorité sur <strong>la</strong> communauté. Bientôt, il prit les territoires s’étendant <strong>de</strong><br />
Eskishehir à <strong>la</strong> frontière <strong>de</strong> Bursa et d’Iznik. Il mit en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> bonnes<br />
re<strong>la</strong>tions avec le dirigeant Tekfur byzantin (Dirigeant d’une ville ou<br />
d’une localité d’Anatolie ou <strong>de</strong> Roumélie). Bien que Osman ait déc<strong>la</strong>ré<br />
sa principauté indépendante <strong>de</strong> l’Etat seldjouki<strong>de</strong> anatolien en 1299, il<br />
reconnut le sultanat <strong>de</strong>s Ilkhanates comme son maître.<br />
Pendant ce temps, <strong>de</strong> nombreuses tribus turques échappaient aux<br />
Mongols et se dirigeaient vers l’Anatolie plus sûre que le Turkestan<br />
<strong>de</strong> l’Ouest. Quand <strong>la</strong> menace mongole diminua d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> partie<br />
du treizième siècle, <strong>de</strong> nombreuses principautés turques apparurent<br />
en Anatolie centrale et en Anatolie du Nord Ouest. La principauté<br />
Karaman, <strong>la</strong> plus puissante, déc<strong>la</strong>ra être le successeur <strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s.<br />
Les autres principautés étaient les Hamids, les Germiy<strong>ans</strong>, les Aydins,<br />
les Karesis, les Menteshes, les Saruh<strong>ans</strong> et les Candars. Ils étaient
Osman Bey<br />
tout d’abord occupés à se battre entre eux afin d’é<strong>la</strong>rgir leur territoire<br />
respectif. La priorité <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>stes Ottom<strong>ans</strong> était <strong>de</strong> se battre contre<br />
les Byzantins et ils se tenaient à distance <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte pour le trône <strong>de</strong><br />
l’Etat seldjouki<strong>de</strong> d’Anatolie. Ils eurent donc l’avantage <strong>de</strong> se battre<br />
contre les Byzantins plutôt que contre les principautés consanguines.<br />
La plupart <strong>de</strong>s guerriers turcs qui avaient fui <strong>la</strong> cruauté mongole au<br />
Turkestan à <strong>la</strong> fin du treizième siècle participèrent à <strong>la</strong> guerre sainte<br />
contre les infidèles avec un grand enthousiasme. Un autre avantage<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> principauté ottomane consistait en <strong>la</strong> position plus faible <strong>de</strong>s<br />
Byzantins qui créa une atmosphère souhaitable pour leur exp<strong>ans</strong>ion<br />
vers l’Ouest. De nombreux Chrétiens sous <strong>la</strong> direction <strong>de</strong> Byzance ne<br />
résistèrent pas aux attaques ottomanes et se montrèrent contents <strong>de</strong><br />
passer sous l’autorité d’une politique exp<strong>ans</strong>ionniste avec <strong>de</strong>s impôts<br />
assez bas. Pendant ce temps, Osman Bey eut <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> coopérer<br />
avec les popu<strong>la</strong>tions locales <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, même avec quelques tekfurs<br />
byzantins. L’un <strong>de</strong> ses tekfurs, Mikhail, se convertit plus tard à l’Is<strong>la</strong>m.<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> renoncèrent à cette pratique <strong>de</strong> partage <strong>de</strong> leurs territoires<br />
entre plusieurs héritiers comme ce<strong>la</strong> était d’usage chez les tribus<br />
noma<strong>de</strong>s turques. En effet, les sang<strong>la</strong>ntes batailles pour le trône entre<br />
les successeurs légaux entraînaient le plus souvent <strong>la</strong> désintégration rapi<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> ces Etats. L’abandon <strong>de</strong> cette pratique serait l’une <strong>de</strong>s raisons<br />
principales qui expliquerait qu’une principauté aussi mo<strong>de</strong>ste que celle<br />
<strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> ait été capable un siècle plus tard <strong>de</strong> se hisser au rang <strong>de</strong>s<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
71
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
72<br />
plus grands empires non seulement d<strong>ans</strong> l’histoire du mon<strong>de</strong> musulman<br />
ou turc, mais tout autant d<strong>ans</strong> l’histoire mondiale.<br />
C’est en 1302, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Bapheus près d’Izmit et <strong>la</strong> défaite<br />
<strong>de</strong>s Byzantins, que <strong>la</strong> principauté ottomane est mentionnée pour <strong>la</strong><br />
première fois. Quelques p<strong>la</strong>ces fortes furent occupées par Osman Bey<br />
après une série <strong>de</strong> campagnes contre les Byzantins, prenant avantage<br />
<strong>de</strong> leur infériorité et exploitant l’affaiblissement <strong>de</strong> leur autorité. En<br />
1320, il désigna son fils Orhan (ou Orkhan) chef <strong>de</strong> l’armée avec pour<br />
mission <strong>de</strong> conquérir les villes <strong>de</strong> Bursa et d’Iznik (Nicée). Lorsque<br />
ce <strong>de</strong>rnier fut entré d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Bursa en 1326, son père Osman<br />
était mourant. Par <strong>la</strong> suite, Orhan tr<strong>ans</strong>féra sa capitale <strong>de</strong> Bilecik (Mocadène)<br />
à Bursa (Brousse) et poursuivit <strong>la</strong> politique d’exp<strong>ans</strong>ion <strong>de</strong>s<br />
territoires ottom<strong>ans</strong> aux dépens <strong>de</strong> l’Empire byzantin. L’une <strong>de</strong>s plus<br />
importantes conquêtes pour Orhan fut celle <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d’Iznik (Nicée/<br />
Nikaia en grec) en 1331 dont les Seldjouki<strong>de</strong>s d’Anatolie avaient perdu<br />
le contrôle lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> première croisa<strong>de</strong> en 1096. Deux <strong>ans</strong> plus tard, en<br />
1333, l’Empereur byzantin dut accepter <strong>de</strong> payer un tribut contre l’assurance<br />
<strong>de</strong> ses territoires restants en Anatolie. Une fois le pouvoir <strong>de</strong>s<br />
Ilkhani<strong>de</strong>s ruiné, <strong>la</strong> principauté ottomane amorça sa tr<strong>ans</strong>formation en<br />
un Etat, encore loin cependant <strong>de</strong> ce qu’il sera à son apogée.<br />
En s’emparant <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville d’Izmit (Nicomédie) en 1337, les Ottom<strong>ans</strong><br />
privèrent les Byzantins <strong>de</strong> leur <strong>de</strong>rnier territoire en Anatolie. Continuant<br />
sur sa <strong>la</strong>ncée, Orhan annexa en 1345 <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Karesi<br />
située d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong>s Dardanelles et <strong>la</strong> mer <strong>de</strong> Marmara, permettant<br />
ainsi aux Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong> prendre pied durablement sur <strong>la</strong> rive européenne<br />
<strong>de</strong>s Dardanelles. Quelques années plus tard, en 1354, Suleyman Pacha,<br />
fils d’Orhan Ghazi, étendit son contrôle sur <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Gallipoli<br />
(rive nord <strong>de</strong>s Dardanelles), puis après sa mort survenue en 1357, Murad,<br />
un autre fils d’Orhan, prit le contrôle d’Edirne (Andrinople) avant<br />
d’achever <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> toute <strong>la</strong> Thrace orientale.<br />
Au fur et à mesure que leurs conquêtes s’étendaient vers les Balk<strong>ans</strong>,<br />
les Ottom<strong>ans</strong> mirent en p<strong>la</strong>ce une politique d’imp<strong>la</strong>ntation signifiant<br />
c<strong>la</strong>irement <strong>la</strong> restriction <strong>de</strong>s actes <strong>de</strong> razzias et <strong>de</strong> pil<strong>la</strong>ges. La conquête<br />
<strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> ne fut donc pas le seul fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> force, mais tout aussi<br />
le résultat d’une politique ottomane <strong>de</strong> pacification et <strong>de</strong> conciliation<br />
qui garantissait aux non musulm<strong>ans</strong> <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> leurs vies, <strong>de</strong> leurs<br />
biens et leur liberté <strong>de</strong> culte. Cette politique fut le gage <strong>de</strong> <strong>la</strong> loyauté<br />
<strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions indigènes qui avaient subi <strong>de</strong>s pressions politiques et<br />
religieuses <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s anciennes autorités féodales. Cette politique
d’imp<strong>la</strong>ntation prévoyait entre autres d’installer <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions yürük<br />
et turkmène ne possédant pas <strong>de</strong> terres cultivables en Anatolie d<strong>ans</strong><br />
les régions balkaniques récemment occupées où ils établirent fermes<br />
et vil<strong>la</strong>ges, une migration qui accéléra le processus <strong>de</strong> turquisation <strong>de</strong>s<br />
régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Thrace occi<strong>de</strong>ntale et orientale, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Macédoine, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dobroudja et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ludogorie.<br />
Le sultan Murad Ier C’est sous le règne <strong>de</strong> Murad Ier (1359-1389) que les Ottom<strong>ans</strong> entrent<br />
d<strong>ans</strong> le champ <strong>de</strong> <strong>la</strong> macro-politique. La principauté ottomane se mua<br />
en un Etat aux frontières toujours plus é<strong>la</strong>rgies à mesure que les Ottom<strong>ans</strong><br />
avançaient d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. Dès lors, une réorganisation <strong>de</strong>s<br />
institutions <strong>de</strong> l’Etat s’imposait afin <strong>de</strong> conserver les nouveaux territoires<br />
conquis. Les <strong>de</strong>ux premiers chefs ottom<strong>ans</strong>, Osman et Orhan, ne<br />
se sont jamais attribués <strong>de</strong>s titres au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> Bey ou Ghazi, et ce pour<br />
<strong>de</strong>ux raisons principales: d’abord, ils dépendaient encore <strong>de</strong>s Khanats<br />
(bien que cette dépendance relevait davantage d’une simple formalité) ;<br />
ensuite, ils n’étaient pas encore capables <strong>de</strong> mener un Etat. Murad fut<br />
le premier gouvernant ottoman qui prit le titre royal <strong>de</strong> Hünkar et <strong>de</strong><br />
Sultan.<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> développèrent une force <strong>de</strong> cavalerie constituée par les<br />
officiers spahis et soutenus par les timariotes. Le timar était une forme<br />
<strong>de</strong> dotation foncière ou plus précisément <strong>de</strong> dotation fiscale sur une<br />
terre concédée par le sultan à une personne en contrepartie <strong>de</strong>s services<br />
rendus, notamment militaires. Le système du timar était d’autant<br />
plus nécessaire que l’extension <strong>de</strong> l’Empire ne pouvait plus compter<br />
sur <strong>la</strong> seule base <strong>de</strong>s volontaires. Murad I er fonda un nouveau groupe<br />
militaire, celui du corps d’infanterie constitué d’esc<strong>la</strong>ves appelés janissaires<br />
(Yeniçeri). Les janissaires servaient aussi <strong>de</strong> gar<strong>de</strong> personnelle du<br />
sultan (les Kapı Ku<strong>la</strong>rı ou esc<strong>la</strong>ves <strong>de</strong> <strong>la</strong> Porte). Ils étaient recrutés périodiquement<br />
à travers une pratique appelée Devchirmé, littéralement<br />
‘ramassage’ ou ‘récolte’ d’enfants <strong>de</strong>s sujets ottom<strong>ans</strong> non-musulm<strong>ans</strong>, y<br />
compris en temps <strong>de</strong> paix. Ainsi fut créée une élite d’esc<strong>la</strong>ves <strong>de</strong>venue<br />
très vite indispensable à l’Etat ottoman. Le rôle <strong>de</strong>s janissaires et <strong>de</strong>s<br />
Kapı Ku<strong>la</strong>rı fut crucial d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> survie et l’unification <strong>de</strong> l’Etat en 1413,<br />
du fait que leur i<strong>de</strong>ntité et leur statut dépendaient du pouvoir <strong>de</strong> leur<br />
maîtres ottom<strong>ans</strong>. De nouvelles organisations administratives, autres<br />
que militaires, furent entreprises tel l’établissement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux Beylerbeyi<br />
(Bey <strong>de</strong>s Beys ou gouverneur général), l’un en Anatolie, l’autre en Roumélie<br />
(partie européenne <strong>de</strong> l’Empire).<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
73
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
74<br />
Lorsque Murad Ier conquit <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> Philippoupoli (Plovdiv<br />
en bulgare), le pape Urbain<br />
V appe<strong>la</strong> à <strong>la</strong> croisa<strong>de</strong> afin <strong>de</strong><br />
contenir l’avancée <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong><br />
d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. L’esprit<br />
<strong>de</strong>s croisa<strong>de</strong>s, quoique affaibli,<br />
était toujours vivant. Les Etats<br />
<strong>de</strong> l’Europe <strong>de</strong> l’ouest convinrent<br />
donc d’affronter les Ottom<strong>ans</strong>.<br />
Mais les croisés furent<br />
écrasés par les troupes ottomanes<br />
en Bulgarie, en Serbie,<br />
en Hongrie, en Va<strong>la</strong>chie (Ef<strong>la</strong>k<br />
en turc) et en Bosnie — d’abord<br />
à Chernomen lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille<br />
<strong>de</strong> Maritsa, puis au Kosovo en 1389. Après cette victoire, le sultan Murad<br />
Ier fut assassiné par un nationaliste serbe, Miloch Obilich. Avec<br />
<strong>la</strong> guerre du Kosovo, aucun pouvoir ne subsista, hormis <strong>la</strong> Hongrie,<br />
capable d’affronter les Ottom<strong>ans</strong> au sud du Danube. A <strong>la</strong> mort <strong>de</strong><br />
Murad Ier Mehmed II<br />
, les territoires ottom<strong>ans</strong> couvraient quelques 500.000 km².<br />
D’une mo<strong>de</strong>ste principauté, les Ottom<strong>ans</strong> étaient passés à un Etat avec<br />
<strong>de</strong> nouvelles institutions, maintenant ils se préparaient à <strong>de</strong>venir un<br />
Empire.<br />
Efforts avortés <strong>de</strong> construction d’un Empire<br />
En Anatolie, les principautés turques sous souveraineté ottomane commencèrent<br />
à se rebeller à l’annonce <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Murad Ier. En 1392,<br />
son fils le sultan Bayezid Ier (1389-1402), appelé Yıldırım (<strong>la</strong> foudre),<br />
parvint à annexer les principautés <strong>de</strong> Saruhan, d’Aydin, <strong>de</strong> Candars,<br />
<strong>de</strong> Menteche et <strong>de</strong> Germiyan en Anatolie et poursuivit <strong>la</strong> politique<br />
d’exp<strong>ans</strong>ion <strong>de</strong> son père d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. Il défit <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Va<strong>la</strong>chie<br />
en 1391, annexa <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Thessalonique et mit le siège<br />
<strong>de</strong>vant Constantinople (Istanbul) pour achever d’unifier ses territoires<br />
en mettant fin à l’Empire byzantin. Une nouvelle croisa<strong>de</strong> commandée<br />
par le roi <strong>de</strong> Hongrie, Sisigmond Ier, fit route vers Nicopolis (Niğbolu<br />
en turc) en vue <strong>de</strong> chasser les Turcs <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> et porter secours à<br />
Constantinople. Mais encore une fois, les Ottom<strong>ans</strong> défirent l’armée<br />
croisée à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Nicopolis en 1396. Il <strong>de</strong>venait c<strong>la</strong>ir que plus<br />
aucune puissance en Europe n’était capable <strong>de</strong> secourir Byzance. Cette<br />
victoire fit <strong>la</strong> célébrité <strong>de</strong> Bayezid Ier d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> musulman.
En écartant toute menace susceptible <strong>de</strong> se retourner contre lui, Bayezid,<br />
avec l’assurance acquise à Nicopolis, se tourna vers <strong>la</strong> principauté<br />
<strong>de</strong> Karaman afin <strong>de</strong> cimenter l’unité turque. Il commença par annexer<br />
Karaman en 1398, puis poussa ses frontières <strong>de</strong> l’est jusqu’à l’Euphrate<br />
en annexant au passage Ma<strong>la</strong>tya (Mélitène) et Elbistan où les Mamelouks<br />
étaient stationnés. Ainsi, en joignant tous les Etats turcs <strong>de</strong><br />
l’Anatolie centrale et d’une partie <strong>de</strong> l’Anatolie <strong>de</strong> l’Ouest, Bayezid Ier<br />
mit fin au système <strong>de</strong> vassalité et réussit à centraliser son Etat. Dès lors,<br />
il prit le titre <strong>de</strong> Sultan <strong>de</strong>s Roums (Anatolie), titre porté auparavant<br />
par les sult<strong>ans</strong> seldjouki<strong>de</strong>s, se revendiquant par là comme successeur<br />
<strong>de</strong>s Seldjouki<strong>de</strong>s.<br />
Toutefois, le succès ne fut que <strong>de</strong> courte durée puisqu’en 1402 Tamer<strong>la</strong>n<br />
<strong>la</strong>nça l’assaut contre les Ottom<strong>ans</strong>. Se réc<strong>la</strong>mant héritier <strong>de</strong>s<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s Ilkhani<strong>de</strong>s, Tamer<strong>la</strong>n avait fondé un puissant empire<br />
au Turkestan et s’étendait vers l’ouest. Il considérait les Ottom<strong>ans</strong><br />
comme constituant une principauté frontalière sous sa dépendance. Ce<br />
fut pour Bayezid Ier une infortune <strong>de</strong> vivre au temps <strong>de</strong> Tamer<strong>la</strong>n, bien<br />
qu’il ait régné sur un Empire couvrant un million <strong>de</strong> km² et qu’il fût<br />
victorieux <strong>de</strong>s armées croisées. Lorsque les <strong>de</strong>ux puissants gouvernants,<br />
pleins d’assurance, <strong>de</strong>vinrent voisins, le conflit semb<strong>la</strong>it inévitable.<br />
L’imminent conflit éc<strong>la</strong>ta quand Ahmed, chef <strong>de</strong>s Jalâyiri<strong>de</strong>s, et Kara<br />
Yusuf, chef <strong>de</strong>s Kara Koyunlu (moutons noirs), se réfugièrent auprès<br />
<strong>de</strong> Bayezid. Lorsque certains beys prirent <strong>la</strong> fuite et vinrent se réfugier<br />
auprès <strong>de</strong> Tamer<strong>la</strong>n, celui-ci prit avantage <strong>de</strong> l’opportunité qui se présentait<br />
à lui.<br />
Hiatus (1402-1413)<br />
Bayezid Ier fut vaincu et capturé avec ses <strong>de</strong>ux fils, Musa et Mustapha,<br />
par Tamer<strong>la</strong>n, lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille d’Ankara en 1402. Par <strong>la</strong> suite, Tamer<strong>la</strong>n<br />
tenta <strong>de</strong> restaurer les anciennes principautés, <strong>de</strong> sorte que les frontières<br />
anatoliennes furent repoussées, retrouvant les limites <strong>de</strong> l’époque<br />
<strong>de</strong> Murad Ier . Devant reconnaître <strong>la</strong> supériorité <strong>de</strong> Tamer<strong>la</strong>n après cette<br />
défaite, l’Etat ottoman était sur le point <strong>de</strong> s’effondrer et, en tout cas,<br />
n’avait plus <strong>de</strong> prétention à être une gran<strong>de</strong> puissance. Le sultan Bayezid<br />
supportait mal d’être prisonnier malgré les égards avec lesquels il<br />
fut traité par Tamer<strong>la</strong>n. Au départ <strong>de</strong> Tamer<strong>la</strong>n d’Anatolie, le territoire<br />
ottoman était divisé entre les trois fils <strong>de</strong> Bayezid : Suleyman prit le<br />
contrôle d’Edirne, Mehmed celui d’Amasya et Isa administrait Bursa.<br />
Comme le veut le système <strong>de</strong> succession ottoman - qui datait <strong>de</strong>s<br />
temps anciens en Anatolie centrale - tous les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
75
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
76<br />
régnante pouvait prétendre légitimement au trône, et même les Etats<br />
turcs étaient partagés entre les membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille régnante. Cependant,<br />
les Ottom<strong>ans</strong> avaient abandonné cette pratique au tout début<br />
<strong>de</strong> leur histoire. Ils refusaient d’associer quiconque au gouvernement<br />
afin d’éviter le morcellement du territoire et les cruelles luttes <strong>de</strong> succession.<br />
Pour régner sur l’Empire, le souverain ottoman du moment,<br />
préparait le jeune prince en lui assignant les fonctions <strong>de</strong> gouverneur<br />
d’une province. Cet exercice, pratiqué <strong>de</strong>puis le temps <strong>de</strong> Murad I er , ne<br />
fut entériné que sous Mehmed II.<br />
Ces changements intervenus d<strong>ans</strong> les procédures administratives furent<br />
l’une <strong>de</strong>s principales causes <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre civile qui s’ensuivit et qui<br />
dura près <strong>de</strong> 11 <strong>ans</strong> (1402-1413), pério<strong>de</strong> appelée ‘ère hiatus’. Finalement,<br />
Mehmed I er réalisa l’unité <strong>de</strong> l’Etat ottoman et accéda au trône en<br />
1413. Bien que l’autorité ottomane fût affaiblie durant cette ère hiatus,<br />
<strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s provinces balkaniques sont <strong>de</strong>meurées loyales aux Ottom<strong>ans</strong>.<br />
Après avoir éliminé ses frères, Mehmed I er évita toute provocation<br />
envers les Byzantins et les croisés afin <strong>de</strong> se donner le temps <strong>de</strong><br />
regagner les territoires anatoliens perdus suite à <strong>la</strong> bataille d’Ankara.<br />
Il parvint à réunifier une partie <strong>de</strong>s territoires appartenant à <strong>la</strong> principauté<br />
et à affaiblir l’influence <strong>de</strong>s Karamani<strong>de</strong>s en Anatolie en matant<br />
les rébellions <strong>de</strong> Cheikh Bedreddin et <strong>de</strong> son frère Mustapha Chelebi<br />
(Mustafa Çelebi). A sa mort, il lègue à Murad II un Etat réorganisé qui<br />
a recouvré sa puissance après un an <strong>de</strong> troubles.<br />
Nouvelle tentative pour reconstruire l’Empire<br />
Au début <strong>de</strong> son règne, Murad II dut affronter les rébellions <strong>de</strong> son<br />
oncle Mustafa Çelebi et <strong>de</strong> son frère ca<strong>de</strong>t Mustapha et ne réussit à<br />
les écraser qu’au prix <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s difficultés. Puis, il assiégea Istanbul,<br />
profitant <strong>de</strong>s conflits internes au pouvoir byzantin. Ensuite, il visa le<br />
renforcement du gouvernement ottoman d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong> : en 1430,<br />
il s’empara <strong>de</strong> Thessalonique et écarta l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hongrie sur <strong>la</strong><br />
Serbie et <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>chie. Mais en 1440, l’échec du siège ottoman <strong>de</strong>vant<br />
l’importante et stratégique ville <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong>, incita les Hongrois à attaquer<br />
les Ottom<strong>ans</strong> et remportèrent même <strong>de</strong>s victoires décisives, ce<br />
qui amena Murad II à adopter une politique extérieure plus conciliante.<br />
Il signa un accord avec les Hongrois s’engageant à ne pas traverser le<br />
Danube. Désormais, plus aucun danger ne pesait sur l’Etat, Murad<br />
II se retira et <strong>la</strong>issa le trône à son fils Mehmed. Les Byzantins et les<br />
Hongrois y virent l’occasion <strong>de</strong> mener une croisa<strong>de</strong> qui écarterait <strong>la</strong><br />
menace turque. Mais ils se rendirent vite compte <strong>de</strong> leur erreur quand
en 1444 les croisés furent sévèrement défaits à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Varna par<br />
l’armée ottomane commandée par Murad II qui reprit provisoirement<br />
les choses en main face à l’imminence du danger. Jean Hunyadi fit une<br />
nouvelle tentative en 1448 qui se solda par une autre défaite. Après<br />
ces succès militaires, l’autorité ottomane n’en fut que plus forte au<br />
sud du Danube, et les croisés perdirent tout espoir <strong>de</strong> porter secours à<br />
Constantinople face aux Turcs.<br />
Au temps <strong>de</strong> Murad II, <strong>la</strong> cité-capitale d’Edirne <strong>de</strong>vint un centre <strong>de</strong><br />
culture et <strong>de</strong> science. Elle attira nombre d’activités culturelles et scientifiques<br />
qui avaient lieu d<strong>ans</strong> les principautés anatoliennes. A sa mort<br />
en 1451, son fils Mehmed II hérita d’un Etat puissant ayant étouffé<br />
les expéditions croisées et réparé les effets désastreux <strong>de</strong> l’invasion <strong>de</strong><br />
Tamer<strong>la</strong>n. Les frontières ottomanes étaient alors revenues comme au<br />
temps d’avant <strong>la</strong> bataille d’Ankara.<br />
Le sultan Mehmed II:<br />
La construction d’un Empire, une puissance mondiale<br />
Lorsque Mehmed II accéda au trône, aucune menace sérieuse ne<br />
pesait sur l’unité ottomane, sauf que, prenant en compte l’expérience<br />
passée, il vit qu’un danger pouvait venir <strong>de</strong>s Byzantins. Et bien que<br />
vivant constamment sous le blocus ottoman, les empereurs byzantins<br />
cherchaient à provoquer <strong>de</strong>s luttes intestines parmi les membres <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> dynastie ottomane et ne cessaient <strong>de</strong> faire appel à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s croisés.<br />
L’un <strong>de</strong>s principaux objectifs <strong>de</strong> Mehmed II était d’établir une administration<br />
centralisée capable <strong>de</strong> juguler toute force qui risquerait <strong>de</strong><br />
rompre l’union <strong>de</strong> l’Empire ottoman ; aussi, les Byzantins constituaient<br />
à ses yeux un obstacle à cet objectif. Rappelons aussi que <strong>la</strong> plupart<br />
<strong>de</strong>s conquérants musulm<strong>ans</strong> et turcs visaient <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> Constantinople,<br />
non seulement pour sa position extrêmement stratégique et<br />
symbolique, mais également en raison d’un dire du prophète Muhammad<br />
qui a déc<strong>la</strong>ré sacré le but <strong>de</strong> conquête <strong>de</strong> <strong>la</strong> ville. En somme, pour<br />
le sultan Mehmed II, <strong>la</strong> centralisation <strong>de</strong> l’Etat signifiait ôter toute<br />
influence aux dynasties d’Anatolie et aux puissantes familles telle <strong>la</strong><br />
famille <strong>de</strong>s Çandarlı (Tchandarli) dont certains membres furent nommés<br />
grands vizirs <strong>de</strong>puis le règne <strong>de</strong> Murad Ier . Mehmed II chercha <strong>de</strong><br />
même à se débarrasser <strong>de</strong>s princes susceptibles <strong>de</strong> menacer le pouvoir<br />
et même l’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie ottomane.<br />
Pendant que les préparatifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> Constantinople étaient<br />
à leur comble en 1452-1453, le grand vizir Çandarlı Halil Pacha tenta<br />
<strong>de</strong> dissua<strong>de</strong>r le sultan Mehmed II d’assiéger <strong>la</strong> ville, arguant que toute<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
77
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
78<br />
action entreprise contre les Byzantins déclencherait d’autres croisa<strong>de</strong>s.<br />
Mais le sultan n’en fut pas convaincu. Il <strong>de</strong>manda à Urbain (qui était<br />
d’origine hongroise) <strong>de</strong> préparer <strong>de</strong>s canons pour abattre les remparts<br />
byzantins et <strong>de</strong> construire <strong>la</strong> forteresse <strong>de</strong> Roumélie sur <strong>la</strong> rive européenne<br />
du Bosphore afin <strong>de</strong> faire barrage à <strong>la</strong> flotte vénitienne qui viendrait<br />
au secours <strong>de</strong>s Byzantins. Constantinople, aujourd’hui Istanbul<br />
(mais les Ottom<strong>ans</strong> continuèrent très longtemps à utiliser le premier<br />
nom), fut finalement conquise le 29 mai 1453. Ce<strong>la</strong> valut à Mehmed<br />
II le surnom <strong>de</strong> Fatih (le conquérant, le victorieux). A partir <strong>de</strong> ce moment,<br />
les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong>venaient une puissance mondiale. Les sult<strong>ans</strong><br />
ottom<strong>ans</strong> dès lors pouvaient prétendre être les héritiers <strong>de</strong> l’Empire<br />
romain. Le Pape Pie II se résigna à accepter cette prétention. Il écrivit<br />
au Conquérant que tout ce qui pourrait faire <strong>de</strong> lui « le plus grand<br />
homme <strong>de</strong> votre temps avec votre consentement universel est un peu<br />
d’eau avec <strong>la</strong>quelle vous seriez baptisé ». Mais Mehmed le Conquérant<br />
rejeta cette invitation à se convertir au christianisme, son but n’étant<br />
pas seulement d’étendre son pouvoir vers l’Ouest, mais plus fondamentalement,<br />
comme chez tous les sult<strong>ans</strong> antérieurs et futurs, d’ériger un<br />
Empire mondial, ou plutôt un nouvel ordre mondial bâti sur le bonheur<br />
<strong>de</strong> l’humanité tel qu’il est défini par les enseignements is<strong>la</strong>miques et les<br />
traditions turques.<br />
La conquête d’Istanbul permit d’unifier les territoires ottom<strong>ans</strong> et <strong>de</strong><br />
consoli<strong>de</strong>r <strong>la</strong> position <strong>de</strong> leur Empire <strong>de</strong>venu <strong>la</strong> puissance prééminente<br />
en Europe du sud, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Méditerranée orientale et d<strong>ans</strong> toute <strong>la</strong> Mer<br />
Noire. La capitale fut tr<strong>ans</strong>férée d’Edirne vers Istanbul peu <strong>de</strong> temps<br />
après <strong>la</strong> conquête <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière. Il est à souligner que l’un <strong>de</strong>s effets<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> conquête d’Istanbul fut le maintien d’une capitale internationale<br />
qui était périssante. La cité <strong>de</strong>meura le centre ecclésiastique <strong>de</strong> l’Eglise<br />
grecque orthodoxe dont Mehmed II se déc<strong>la</strong>ra le protecteur et désigna<br />
un nouveau patriarche comme le veut <strong>la</strong> coutume chez les empereurs<br />
byzantins. En effet, il se considérait comme le successeur direct <strong>de</strong>s empereurs<br />
byzantins et pour cette raison, il écartait quelconque dynastie<br />
qui prétendait au trône byzantin comme le fit David Comnène à Trébizon<strong>de</strong>,<br />
et Démétrios et Thomas, frères du <strong>de</strong>rnier empereur byzantin,<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Morée (le Péloponnèse). Mehmed le Conquérant<br />
ne tarda pas à envahir <strong>la</strong> péninsule et mit fin au pouvoir <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux frères<br />
en 1460. L’annexion <strong>de</strong> Trébizon<strong>de</strong> un an plus tard al<strong>la</strong>it déclencher<br />
une guerre entre les Ottom<strong>ans</strong> et <strong>la</strong> République <strong>de</strong> Venise, guerre qui<br />
dura 16 longues années en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> faiblesse <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte ottomane.<br />
Entre temps, Venise s’était alliée aux Ak Koyunlu plutôt qu’avec <strong>la</strong>
Hongrie ou l’Albanie. Voyant son empire encerclé d’est en ouest, Mehmed<br />
II mena une double campagne contre l’Albanie en 1466 et 1467.<br />
De son côté, Uzun Hasan, le chef <strong>de</strong>s Ak Koyunlu, s’allia avec <strong>la</strong> principauté<br />
karamani<strong>de</strong> et aux chevaliers <strong>de</strong> Chypre et <strong>de</strong> Rho<strong>de</strong>s, et chercha<br />
à s’étendre vers l’Asie centrale. Mais Mehmed II s’empressa d’annexer<br />
<strong>la</strong> principauté karamani<strong>de</strong> en 1468 et soumit Hasan en écrasant son<br />
armée à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Otlukbeli en 1473, neutralisant <strong>de</strong> fait les principaux<br />
adversaires venant <strong>de</strong> l’est. Et ce fut l’un <strong>de</strong>s plus grands exploits<br />
<strong>de</strong> Mehmed II d’avoir pu restaurer le pouvoir ottoman parmi les autres<br />
Etats turcs en Anatolie et d’avoir écarté toute menace venant <strong>de</strong> l’est.<br />
Il poursuivit ses conquêtes en annexant <strong>de</strong>s territoires sur les côtes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Mer Noire et en soumettant le Khanat <strong>de</strong> Crimée à <strong>la</strong> suzeraineté<br />
ottomane. La Mer Noire <strong>de</strong>vint ainsi un ‘<strong>la</strong>c ottoman’. De son côté,<br />
ayant perdu l’un <strong>de</strong> ses principaux alliés, Venise dut signer un accord<br />
avec les Ottom<strong>ans</strong> selon lequel elle <strong>de</strong>vait cé<strong>de</strong>r Shkodra (en Albanie)<br />
et les îles <strong>de</strong> Lemnos (Limni en turc) et d’Evia (Egriboz) et consentit<br />
à payer un tribut. L’une <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rnières campagnes <strong>de</strong> Mehmed II fut<br />
menée contre l’Italie. Il espérait conquérir Rome, capitale <strong>de</strong> l’Empire<br />
romain d’Occi<strong>de</strong>nt, vu qu’il se considérait comme le véritable héritier<br />
<strong>de</strong> tout l’Empire romain. La prise d’Otrante eut lieu en 1480, mais <strong>la</strong><br />
conquête <strong>de</strong> l’Italie s’interrompit au décès du sultan en 1481.<br />
Comme il a été dit, l’objectif principal <strong>de</strong> Mehmed II était <strong>de</strong> constituer<br />
un Empire centralisé, ce qu’il fit en éliminant tout membre d’une<br />
dynastie qui se serait avisé <strong>de</strong> prétendre un droit au trône, et une<br />
quelconque c<strong>la</strong>sse influente aristocratique ou privilégiée qui aurait pu<br />
<strong>de</strong>venir un pouvoir alternatif. L’exécution du grand vizir Halil Pacha<br />
peut être envisagée comme faisant partie <strong>de</strong> cette politique. En outre,<br />
il ‘nationalisa’ plusieurs domaines privés afin d’affaiblir le pouvoir <strong>de</strong>s<br />
aristocrates et <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r <strong>la</strong> situation financière <strong>de</strong> l’Empire.<br />
Asseoir l’Empire sous l’ombre<br />
d’une lutte <strong>de</strong> succession<br />
La pratique du fratrici<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’assassinat <strong>de</strong>s enfants d’un prince qui<br />
accè<strong>de</strong> au trône fut légitimée par le sultan pour éviter toute rébellion<br />
ou prétentions rivales au trône. En d’autres termes, cette politique était<br />
prévue par les Ottom<strong>ans</strong> pour faciliter <strong>la</strong> réalisation d’un nouvel ordre<br />
mondial (Nizam-ı Alem). Lorsque Mehmed II mourut, <strong>de</strong>ux <strong>de</strong> ses<br />
fils, Cem et Bayezid, entrèrent en lutte pour le pouvoir. La plupart <strong>de</strong>s<br />
fonctionnaires <strong>de</strong> l’Etat étaient en faveur du <strong>de</strong>rnier. D’autres, comme<br />
le grand vizir Karamani Mehmed Pacha, soutenaient plutôt le premier.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
79
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
80<br />
Finalement, <strong>la</strong> succession revint<br />
à Bayezid II, mais <strong>la</strong> division en<br />
<strong>de</strong>ux factions rivales était déjà<br />
palpable parmi les fonctionnaires<br />
<strong>de</strong> l’Etat. Les janissaires<br />
assassinèrent le grand vizir à<br />
cause du soutien apporté à Cem<br />
qui s’était déc<strong>la</strong>ré sultan d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
ville <strong>de</strong> Bursa et avait proposé<br />
à son frère <strong>de</strong> diviser l’Empire<br />
en <strong>de</strong>ux parties : l’une en Anatolie,<br />
l’autre en Roumélie. Mais<br />
cette idée fut catégoriquement<br />
rejetée. L’affrontement entre les<br />
armées <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux frères <strong>de</strong>venait<br />
inévitable. L’armée <strong>de</strong> Cem fut<br />
Soliman le Magnifique<br />
écrasée sur le champ <strong>de</strong> bataille<br />
<strong>de</strong> Yenichehir (Yenişehir) le 20<br />
juin 1481. Il prit alors <strong>la</strong> fuite d’abord vers Konya, ensuite il se réfugia<br />
en Egypte. Puis, lorsque Karamanoglu Mehmed Bey fit appel à lui,<br />
il revint en Anatolie mais fut une nouvelle fois défait par Bayezid II.<br />
Cette fois, il prit refuge chez les Hospitaliers <strong>de</strong> Rho<strong>de</strong>s, et <strong>de</strong> là chercha<br />
à rejoindre <strong>la</strong> Roumélie pour fomenter <strong>la</strong> lutte <strong>de</strong> succession ; mais<br />
il finit prisonnier <strong>de</strong>s Etats européens, et parmi eux <strong>la</strong> papauté, qui<br />
usèrent <strong>de</strong> lui comme moyen <strong>de</strong> pression sur les Ottom<strong>ans</strong>. C’est ainsi<br />
que Bayezid II dut payer gros ses ravisseurs pour qu’ils le gardassent<br />
prisonnier.<br />
Au moment où Cem prit refuge chez les Hospitaliers <strong>de</strong> Rho<strong>de</strong>s,<br />
Bayezid décida <strong>de</strong> faire exécuter Gedik Ahmed Pacha. Celui-ci avait<br />
joué un rôle crucial d<strong>ans</strong> le rétablissement <strong>de</strong> l’autorité ottomane en<br />
Anatolie. Le grand vizir Ishak Pacha fut également démis <strong>de</strong> sa fonction.<br />
En écartant ainsi les <strong>de</strong>ux personnages prééminents <strong>de</strong> l’Empire<br />
qui l’avaient aidé d<strong>ans</strong> sa lutte contre Cem, Bayezid II s’est arrogé un<br />
pouvoir exclusif.<br />
Nonobstant, grâce au soulèvement <strong>de</strong> Cem, Bayezid II dut changer <strong>de</strong><br />
stratégie et adopter une politique plus conciliante d<strong>ans</strong> les affaires intérieures<br />
et extérieures. Il chercha à s’attirer <strong>la</strong> bienveil<strong>la</strong>nce <strong>de</strong> ceux dont<br />
les terres et les biens avaient été confisqués par Mehmed II en les leur<br />
rendant. A l’égard <strong>de</strong> Venise et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hongrie, les Ottom<strong>ans</strong> vou<strong>la</strong>ient<br />
éviter <strong>de</strong> provoquer une nouvelle croisa<strong>de</strong> du moment que Cem était
encore entre leurs mains. Ce<strong>la</strong> ne l’empêcha pas d’annexer Belgorod<br />
(Akkerman en turc) et Kili en Bogdan - qui était un point stratégique<br />
sur les routes <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer noire. Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Cem<br />
en 1495, Lépante, Modon et Coron furent conquises après une série<br />
<strong>de</strong> batailles avec Venise entre 1499 et 1503. A partir <strong>de</strong> ce moment,<br />
les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong>vinrent <strong>la</strong> plus gran<strong>de</strong> puissance navale d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer<br />
Méditerranée. L’un <strong>de</strong>s plus grands amiraux ottom<strong>ans</strong> était un certain<br />
Kemal Reis qui sauva <strong>de</strong>s milliers <strong>de</strong> musulm<strong>ans</strong> et <strong>de</strong> juifs persécutés<br />
et chassés du royaume d’Espagne. Sous les instructions du sultan, il<br />
tr<strong>ans</strong>féra un grand nombre <strong>de</strong> musulm<strong>ans</strong> d’Espagne (les Morisques)<br />
en Afrique du nord et d<strong>ans</strong> les territoires ottom<strong>ans</strong>. C’est ainsi que<br />
l’Empire ouvra ses portes aux musulm<strong>ans</strong> et juifs d’Espagne afin qu’ils<br />
puissent vivre au sein <strong>de</strong> l’Empire.<br />
Durant le règne <strong>de</strong> Bayezid II, les Ottom<strong>ans</strong> durent également faire<br />
face à <strong>de</strong>ux autres menaces : l’une venant <strong>de</strong> l’Etat musulman mamelouk,<br />
l’autre <strong>de</strong> l’Etat safavi<strong>de</strong>. Alors que le conflit avec les Mamelouks<br />
était plutôt d’ordre politique, celui avec les Safavi<strong>de</strong>s relevait davantage<br />
<strong>de</strong> paramètres idéologiques et sectaires. Depuis le règne <strong>de</strong> Mehmed<br />
II, les Ottom<strong>ans</strong> se considéraient comme les lea<strong>de</strong>rs du mon<strong>de</strong> musulman,<br />
d’où leur intérêt croissant à incarner ce rôle et c’est pourquoi ils<br />
menèrent une longue campagne contre les Mamelouks <strong>de</strong> 1485 à 1491<br />
lorsque ceux-ci interférèrent d<strong>ans</strong> les affaires <strong>de</strong>s Dulkadirites - un Etat<br />
tampon dont le centre était Marach-Elbistan. Au final, aucun <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<br />
ne pouvaient se prétendre victorieux. Avec le temps, les re<strong>la</strong>tions entre<br />
Ottom<strong>ans</strong> et Mamelouks se sont améliorées <strong>de</strong>puis que ces <strong>de</strong>rniers<br />
ont fait appel à l’ai<strong>de</strong> ottomane contre <strong>la</strong> flotte portugaise qui commençait<br />
à étendre sa domination sur l’Océan Indien et <strong>la</strong> Mer Rouge visant<br />
à contrôler <strong>la</strong> route et le commerce <strong>de</strong>s épices. La flotte ottomane se<br />
joignit donc à <strong>la</strong> flotte mamelouk d<strong>ans</strong> son combat contre cet ennemi<br />
venu d’ailleurs.<br />
La souveraineté ottomane sur le mon<strong>de</strong> musulman<br />
La menace que faisaient peser les Safavi<strong>de</strong>s était d’une tout autre nature<br />
que celle ressentie du côté <strong>de</strong>s Mamelouks. L’émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie<br />
safavi<strong>de</strong> en Iran avec Shah Ismail, donna naissance à un Etat<br />
militairement puissant et idéologiquement hostile aux Ottom<strong>ans</strong>. Le<br />
chiisme, branche <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m favorisée par les Safavi<strong>de</strong>s, attirait aussi au<br />
sein même <strong>de</strong> l’Empire ottoman beaucoup <strong>de</strong> forces dissi<strong>de</strong>ntes qui se<br />
sont ralliées à <strong>la</strong> nouvelle dynastie en Iran à l’incitation <strong>de</strong> Shah Ismail.<br />
Une série <strong>de</strong> soulèvements d’inspiration chiite parmi les tribus <strong>de</strong> l’est<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
81
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
82<br />
anatolien durant les <strong>de</strong>rnières années du règne <strong>de</strong> Bayezid II ont vu<br />
le jour et se sont multipliés sous l’effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> propagan<strong>de</strong> safavi<strong>de</strong>. Le<br />
soutien apporté par les Turkmènes aux Safavi<strong>de</strong>s n’était pas seulement<br />
d’ordre religieux sectaire, mais aussi politique, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où ils<br />
étaient mécontents du système <strong>de</strong> taxation tel qu’il était établi par les<br />
Ottom<strong>ans</strong>. Tirant avantage <strong>de</strong> ces mécontentements, Shah Ismail en<br />
usa pour faire pression sur les Ottom<strong>ans</strong>. Aussi, en 1511, un soulèvement<br />
mené par les Shahkulu éc<strong>la</strong>ta d<strong>ans</strong> l’ouest <strong>de</strong> l’Anatolie. Mais <strong>la</strong><br />
difficulté à écraser ce soulèvement fit l’objet <strong>de</strong> critiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> part du<br />
prince Selim, gouverneur <strong>de</strong> <strong>la</strong> province <strong>de</strong> Trébizon<strong>de</strong> et très attentif<br />
aux agissements <strong>de</strong> Shah Ismail. Il pensait que les précautions prises<br />
contre le Shah étaient loin d’être satisfaisantes et qu’il était nécessaire<br />
d’adopter une attitu<strong>de</strong> plus ferme.<br />
En attendant, une lutte <strong>de</strong> succession éc<strong>la</strong>ta entre les fils du sultan<br />
vieillissant. Selim qui avait l’appui <strong>de</strong>s janissaires, accéda au trône en<br />
1512 après avoir renversé son père, malgré le soutien apporté par plusieurs<br />
fonctionnaires <strong>de</strong> l’Etat au prince Ahmad. Une fois son règne<br />
consolidé à Istanbul, Selim Ier (dit ‘le Cruel’ ou ‘l’Inflexible’, ‘Yavuz’ en<br />
turc) entreprit <strong>de</strong>s pourparlers <strong>de</strong> paix avec les Etats européens, car sa<br />
priorité était <strong>de</strong> traiter avec Shah Ismail et les Mamelouks. Sous son<br />
règne, le mouvement <strong>de</strong> conquête changea <strong>de</strong> direction <strong>de</strong> l’Ouest vers<br />
l’Est. C’est ainsi qu’en 1514 il vainquit les Safavi<strong>de</strong>s à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong><br />
Tchaldiran obligeant Shah Ismail à s’échapper du champ <strong>de</strong> bataille.<br />
Poursuivant son objectif <strong>de</strong> détruire l’Etat safavi<strong>de</strong>, le sultan Selim progressa<br />
aussi loin que Tabriz, mais dut rebrousser chemin à cause <strong>de</strong>s<br />
troubles surgis au sein <strong>de</strong> l’armée. L’est anatolien fut sécurisé pour un<br />
temps et <strong>la</strong> menace d’un séparatisme religieux écartée. Les Ottom<strong>ans</strong><br />
s’emparèrent au passage <strong>de</strong>s plus importants centres <strong>de</strong> commerce sur<br />
<strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie qu’étaient Tabriz-Alep et Tabriz-Bursa, ce qui assura<br />
<strong>de</strong> grands profits au Trésor ottoman. D’autre part, l’annexion du territoire<br />
<strong>de</strong>s Dulkadirites en 1515 mit pour <strong>la</strong> première fois les Ottom<strong>ans</strong><br />
en contact direct avec l’Empire mamelouk. Les Portugais avaient alors<br />
détruit une gran<strong>de</strong> partie du commerce arabe musulman d<strong>ans</strong> l’Océan<br />
Indien et menaçaient les Villes Saintes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mecque et <strong>de</strong> Médine. Les<br />
gouverneurs <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux villes espéraient envoyer un émissaire auprès<br />
du sultan Selim I er pour solliciter son ai<strong>de</strong> contre les Portugais, mais le<br />
sultan mamelouk s’y opposa. Selim I er avait hâte <strong>de</strong> prendre le contrôle<br />
<strong>de</strong>s possessions mamelouks afin <strong>de</strong> sécuriser <strong>la</strong> route commerciale <strong>de</strong><br />
l’est qui a été dévoyée aux dépens <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> suite à l’incursion<br />
portugaise d<strong>ans</strong> l’Océan Indien et d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer Rouge. Finalement, en<br />
1516, Selim conquit <strong>la</strong> Syrie et un an plus tard envahit le Caire mettant
ainsi fin au pouvoir politique et militaire mamelouk et ramenant <strong>de</strong><br />
facto les Villes Saintes et tout le Hedjaz sous le contrôle ottoman. Le<br />
chérif <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mecque s’empressa <strong>de</strong> faire acte d’obédience aux Ottom<strong>ans</strong><br />
et reconnut le sultan ‘serviteur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux Lieux Saints’ qui impliquait <strong>la</strong><br />
remise <strong>de</strong>s saintes reliques du Prophète Mohammad. Ce qui fit <strong>de</strong> Selim<br />
le chef le plus illustre du mon<strong>de</strong> musulman. L’une <strong>de</strong>s conséquences<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite mamelouk c’est que le califat passa au sultanat ottoman.<br />
En son temps, le califat abbasi<strong>de</strong> était passé sous <strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s Mamelouks<br />
du Caire lorsque ceux-ci réussirent à battre les Mongols en<br />
1258. En fait, les sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong> utilisaient déjà ce titre <strong>de</strong> Calife<br />
<strong>de</strong>puis Murad I er , convaincus qu’ils <strong>de</strong>vaient suivre l’exemple du Calife<br />
en garantissant <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s routes du hadj (pèlerinage à <strong>la</strong> Mecque),<br />
<strong>la</strong> protection <strong>de</strong>s Lieux Saints et en assurant l’exp<strong>ans</strong>ion et <strong>la</strong> défense<br />
<strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m.<br />
Selim le Terrible visait, entre autres objectifs, à étendre son hégémonie<br />
sur l’In<strong>de</strong> pour chasser <strong>la</strong> flotte portugaise <strong>de</strong> <strong>la</strong> région, car les Portugais<br />
faisaient peser <strong>la</strong> menace sur les terres saintes <strong>de</strong> l’is<strong>la</strong>m autant<br />
que sur les routes traditionnelles du commerce <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. La campagne<br />
d’Egypte montra cependant les limites <strong>de</strong> <strong>la</strong> puissance navale<br />
ottomane. C’est ainsi qu’au retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne d’Egypte fut créé<br />
un chantier naval sur <strong>la</strong> Corne d’Or. A <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Selim I er en 1520,<br />
l’Empire s’étendait <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Rouge à <strong>la</strong> Crimée, <strong>de</strong> Tabriz à <strong>la</strong> Bosnie,<br />
<strong>de</strong>venant <strong>de</strong> fait un sérieux rival et un élément incontournable d<strong>ans</strong> les<br />
re<strong>la</strong>tions politiques internationales <strong>de</strong> l’époque. En outre, les migrations<br />
massives <strong>de</strong>s Turcs musulm<strong>ans</strong> vers les Balk<strong>ans</strong> ancrèrent durablement<br />
les mutations <strong>de</strong>s structures démographiques et ethniques <strong>de</strong><br />
cette région.<br />
L’âge d’or <strong>de</strong> l’Empire ottoman (1520-1566)<br />
Soliman hérita du trône s<strong>ans</strong> autre prétendant et entama le gouvernement<br />
d’un Empire puissant. Son règne aura été le plus long <strong>de</strong> tous les<br />
sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong>, <strong>de</strong> 1520 à 1566. Il fut connu en Occi<strong>de</strong>nt comme le<br />
Magnifique et pour les Turcs il était célèbre comme étant le Légis<strong>la</strong>teur<br />
(Kanuni) en vertu <strong>de</strong>s réformes profon<strong>de</strong>s qu’il apporta au système<br />
juridique ottoman. Il était également connu pour être un souverain<br />
équitable et un fervent adversaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> corruption et s’était distingué<br />
comme un grand poète is<strong>la</strong>mique. Considéré comme l’un <strong>de</strong>s souverains<br />
les plus importants d’Europe au XVIème siècle, il était un rival<br />
respecté du Saint Empereur Romain Charles Quint (1519-1556), <strong>de</strong><br />
François Ier <strong>de</strong> France (1515-1547), d’Henri VIII d’Angleterre (1509-<br />
1547), <strong>de</strong> Sigismond II <strong>de</strong> Pologne (1548-1572) et d’Ivan IV <strong>de</strong> Russie<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
83
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
84<br />
dit Ivan le Terrible (1530-1584). Sous son règne, l’Empire ottoman<br />
connut son âge d’or et <strong>de</strong>vint une puissance mondiale incontournable.<br />
En succédant à son père, Soliman dut affronter une révolte menée par<br />
le gouverneur ottoman nommé à Damas et provoquée par Shah Ismail.<br />
Une fois les frontières <strong>de</strong> l’est consolidées, Soliman le Magnifique porta<br />
son attention vers l’Ouest où <strong>de</strong>ux obstacles entravaient l’exp<strong>ans</strong>ion ottomane<br />
: <strong>la</strong> Hongrie et Rho<strong>de</strong>s. Sa priorité était <strong>de</strong> conquérir Belgra<strong>de</strong>,<br />
<strong>de</strong>ux fois assiégée s<strong>ans</strong> succès par Mehmed II et qui constituait une<br />
première étape à l’évincement <strong>de</strong>s Hongrois <strong>de</strong>meurés <strong>la</strong> seule gran<strong>de</strong><br />
puissance freinant l’exp<strong>ans</strong>ion ottomane vers l’Europe. Belgra<strong>de</strong> tomba<br />
en août 1521 après une série <strong>de</strong> bombar<strong>de</strong>ments intenses <strong>la</strong>ncés à partir<br />
d’une île située sur le Danube. La ville <strong>de</strong>venait une base importante<br />
pour l’armée ottomane d<strong>ans</strong> ses expéditions vers l’Europe.<br />
Conquêtes en Europe<br />
Face au soutien apporté par les Chevaliers <strong>de</strong> Rho<strong>de</strong>s à ceux qui s’opposaient<br />
au pouvoir ottoman, il <strong>de</strong>venait maintenant indispensable à<br />
Soliman <strong>de</strong> régler l’affaire <strong>de</strong> l’île. A l’été 1522, il envoya une armada<br />
<strong>de</strong> quelques 4000 navires hérités <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte <strong>de</strong> son père vers l’île <strong>de</strong><br />
Rho<strong>de</strong>s. Au même moment, il dirigea en personne une armée <strong>de</strong> 1000<br />
soldats à travers l’Asie mineure, à un point opposé à l’île <strong>de</strong> Rho<strong>de</strong>s.<br />
Au bout <strong>de</strong> cinq mois d’un terrible siège, Rho<strong>de</strong>s capitu<strong>la</strong>. Soliman<br />
consentit à <strong>la</strong>isser partir les Chevaliers qui firent route vers Malte où<br />
ils fixèrent leur nouvelle base. En écartant ainsi toute menace sérieuse,<br />
Soliman put reprendre sa campagne en Europe <strong>de</strong> l’est et d’abord en<br />
Hongrie. Il <strong>de</strong>vint un acteur majeur d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique européenne en<br />
poursuivant une diplomatie déstabilisante à <strong>la</strong> fois pour l’Eglise Catholique<br />
Romaine et pour le Saint Empire Romain, stratégie qui al<strong>la</strong>it<br />
assurer à l’Empire ottoman un pouvoir considérable.<br />
L’ambition poursuivie par <strong>la</strong> campagne <strong>de</strong> Hongrie avait un double enjeu<br />
: d’une part, étendre les territoires <strong>de</strong> l’Empire, <strong>de</strong> l’autre, semer <strong>de</strong>s<br />
dissensions entre les Hongrois et les autres Etats européens. Pendant<br />
que Soliman était occupé par les préparatifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> campagne, François<br />
Ier <strong>de</strong> France - vaincu par le Saint Empereur Romain Charles Quint à<br />
Pavie en 1525 - incita les Ottom<strong>ans</strong> à attaquer les Habsbourgs et ce fut<br />
l’occasion rêvée d’intervenir d<strong>ans</strong> les affaires politiques européennes. Le<br />
29 août 1526, Soliman infligea une défaite à Louis II <strong>de</strong> Hongrie lors<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Mohács où il trouva <strong>la</strong> mort. La résistance hongroise<br />
ainsi que le pouvoir central s’effondrèrent à <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> cette bataille.<br />
Soliman entra à Buda et p<strong>la</strong>ça sur le trône Jean Zsapolyai ( Jean I er
<strong>de</strong> Hongrie) qui bénéficiait <strong>de</strong> l’appui <strong>de</strong>s adversaires <strong>de</strong>s Habsbourgs.<br />
Contrairement à Soliman, certains nobles hongrois proposèrent <strong>de</strong> désigner<br />
roi <strong>de</strong> Hongrie l’Archiduc Ferdinand d’Autriche qui était lié à<br />
<strong>la</strong> famille <strong>de</strong> Louis II par <strong>de</strong>s liens matrimoniaux. Ces nobles hongrois<br />
qui s’opposaient à Soliman invoquaient <strong>de</strong>s accords passés selon lesquels<br />
les Habsbourgs <strong>de</strong>venaient les successeurs légitimes au trône au<br />
cas où Louis II viendrait à mourir s<strong>ans</strong> héritier. Il s’ensuivit un conflit<br />
qui opposa trois camps après que Ferdinand tenta <strong>de</strong> soumettre son<br />
autorité au royaume <strong>de</strong> Hongrie. Deux rois se firent ainsi concurrence :<br />
Ferdinand au nord-ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hongrie, et Jean I er en Hongrie centrale<br />
et en Tr<strong>ans</strong>ylvanie. Et ce fut le début d’une guerre interminable entre<br />
Ottom<strong>ans</strong> et Habsbourgs.<br />
Trois <strong>ans</strong> plus tard, Soliman mena une nouvelle campagne contre <strong>la</strong><br />
Hongrie pour affirmer <strong>la</strong> suprématie <strong>de</strong> Jean. Ferdinand n’osa pas se<br />
battre contre les troupes ottomanes qui réinvestirent Buda en 1528<br />
mais qui échouèrent l’automne d’après <strong>de</strong>vant Vienne assiégée. En<br />
1531, Ferdinand reprit Buda obligeant Soliman à reprendre sa campagne<br />
contre lui. Cette fois-ci, il vou<strong>la</strong>it organiser une bataille rangée<br />
contre les Ottom<strong>ans</strong> avec l’appui <strong>de</strong> son allié l’empereur Charles Quint.<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> s’enfoncèrent d<strong>ans</strong> les terres autrichiennes, mais Ferdinand<br />
s’abstint <strong>de</strong> les affronter en une bataille rangée. Les Ottom<strong>ans</strong><br />
durent donc rebrousser chemin en direction <strong>de</strong> l’Anatolie pour combattre<br />
les Safavi<strong>de</strong>s. Soliman trouva un arrangement avec Ferdinand<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
85
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
86<br />
qui concéda le titre <strong>de</strong> roi à Jean et accepta <strong>de</strong> payer tribut pour les territoires<br />
qui étaient sous son autorité. La question du choix d’un héritier<br />
pour le trône <strong>de</strong> Hongrie refit surface à l’occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Jean<br />
I er en 1540. Ferdinand en profita pour assiéger Buda, ce qui contraignit<br />
Soliman à revenir avec ses troupes en Hongrie. La conséquence en fut<br />
une partition du royaume en trois : <strong>la</strong> plupart du territoire correspondant<br />
à <strong>la</strong> Hongrie d’aujourd’hui fut annexé en tant que Beylerbeyi <strong>de</strong><br />
Buda (gouvernement provincial) ; le fils <strong>de</strong> Jean Ier Zsapolyai fut installé<br />
comme souverain indépendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Tr<strong>ans</strong>ylvanie<br />
qui était un Etat vassal <strong>de</strong> l’Empire ottoman ; Ferdinand revendiquait<br />
<strong>la</strong> ‘Hongrie royale’ d<strong>ans</strong> le nord et le nord-ouest, fixant temporairement<br />
les frontières entre les Habsbourgs et les Ottom<strong>ans</strong>, et accepta <strong>de</strong> payer<br />
un tribut à <strong>la</strong> Porte. La lutte entre Ottom<strong>ans</strong> et Hongrois ne cessa<br />
pas pour autant durant le règne <strong>de</strong> Soliman, mais s<strong>ans</strong> dép<strong>la</strong>cements<br />
significatifs <strong>de</strong>s frontières.<br />
Les luttes ne se limitaient pas au seul continent européen, elles se dép<strong>la</strong>çaient<br />
aussi sur le terrain <strong>de</strong>s batailles navales en Méditerranée.<br />
Les conquêts à l’est<br />
Tirant parti <strong>de</strong> l’engagement <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> en Europe, les Safavi<strong>de</strong>s<br />
ne cessèrent <strong>de</strong> les harasser à l’est. En réalité, ce sont les Habsbourgs<br />
qui attisèrent les tensions entre Ottom<strong>ans</strong> et Safavi<strong>de</strong>s afin <strong>de</strong> contreba<strong>la</strong>ncer<br />
l’alliance franco-ottomane à l’ouest. En 1533-1534, Bagdad<br />
et Tabriz passèrent sous <strong>la</strong> domination <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> intégrant du<br />
même coup sous leur contrôle <strong>la</strong> route <strong>de</strong> <strong>la</strong> soie et <strong>la</strong> route <strong>de</strong>s épices<br />
<strong>de</strong> Bagdad-Basra - qui étaient vitales pour l’économie ottomane. D<strong>ans</strong><br />
l’espoir d’en finir avec Shah Ismail, Soliman s’embarqua d<strong>ans</strong> une secon<strong>de</strong><br />
expédition en 1548-1549. Mais le shah, à l’instar <strong>de</strong> ce qu’il fit<br />
précé<strong>de</strong>mment, évita tout affrontement avec l’armée ottomane et choisit<br />
<strong>de</strong> se retirer. Cette campagne permit aux Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong> prendre Van<br />
et ses environs ainsi que quelques p<strong>la</strong>ces fortes en Géorgie. En 1553,<br />
Soliman Ier engagea sa troisième et <strong>de</strong>rnière campagne contre le Shah<br />
qui se conclut par l’accord d’Amasya en 1555 au terme duquel les Safavi<strong>de</strong>s<br />
acceptèrent <strong>de</strong> reconnaître <strong>la</strong> souveraineté ottomane sur Bagdad,<br />
Tabriz et l’Anatolie <strong>de</strong> l’est, mettant ainsi fin à un état <strong>de</strong> guerre qui<br />
avait commencé d<strong>ans</strong> les années 1514.<br />
Suprématie en Méditerranée<br />
Depuis l’époque <strong>de</strong> Mehmed II, les Ottom<strong>ans</strong> accordèrent une gran<strong>de</strong><br />
importance à l’amélioration <strong>de</strong> leur flotte, et <strong>de</strong>vint même une question<br />
centrale au temps <strong>de</strong> Selim Ier alors que les Portugais s’imposèrent, grâce
à leur flotte, comme pouvoir dominant sur <strong>la</strong> route <strong>de</strong>s épices asiatique.<br />
1517 marqua un tournant d<strong>ans</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte ottomane lorsque<br />
Hizir Bey en prit le comman<strong>de</strong>ment — appelé également Barberousse<br />
Khayr ad-Din Pacha qui avait conquis Alger et s’était proc<strong>la</strong>mé Bey.<br />
En 1534 il fut nommé amiral en chef (Kaptan-ı Derya) et chargé <strong>de</strong><br />
reconstruire <strong>la</strong> flotte ottomane. Bientôt celle-ci al<strong>la</strong>it égaler toutes les<br />
flottes mises ensemble <strong>de</strong>s autres pays du pourtour méditerranéen. La<br />
forteresse stratégique <strong>de</strong> Coron en Morée (le Péloponnèse) perdue au<br />
profit <strong>de</strong> Charles Quint et grâce à son amiral Andrea Doria en 1532,<br />
fut reprise en 1533 et <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Tunis passa sous domination ottomane.<br />
En 1535, cependant, Charles Quint remporta une victoire importante<br />
contre les Ottom<strong>ans</strong> à Tunis. Mais <strong>la</strong> flotte <strong>de</strong> Barberousse reprit le<br />
<strong>de</strong>ssus en infligeant une défaite à <strong>la</strong> flotte espagnole à <strong>la</strong> Bataille <strong>de</strong><br />
Préveza en 1538, ce qui assura le contrôle ottoman sur <strong>la</strong> Méditerranée<br />
orientale durant 33 <strong>ans</strong>. La flotte ottomane remporta encore quelques<br />
victoires significatives en Méditerranée contre les Espagnols, mais fut<br />
défaite <strong>de</strong>vant Malte en 1565.<br />
Quant aux Portugais, les Ottom<strong>ans</strong> observaient <strong>de</strong> près leurs agissements<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer Rouge et l’Océan Indien <strong>de</strong>puis le temps <strong>de</strong> Bayezid<br />
II. En 1530, ils réinvestirent le Golfe <strong>de</strong> Basra et reprirent <strong>la</strong> Mer<br />
Rouge à <strong>la</strong> flotte portugaise. Tous ces efforts <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong><br />
étaient <strong>de</strong>stinés à sécuriser les routes commerciales <strong>de</strong> l’In<strong>de</strong>. En 1538,<br />
une flotte ottomane soumit A<strong>de</strong>n (à l’entrée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Rouge). Après<br />
l’annexion <strong>de</strong> Basra en 1547, une nouvelle flotte fut mise sur pied. Les<br />
Portugais tentèrent <strong>de</strong> faire obstacle à l’hégémonie ottomane d<strong>ans</strong> le<br />
golfe Persique en construisant les forteresses <strong>de</strong> Muscat et Hormuz,<br />
<strong>de</strong>ux p<strong>la</strong>ces stratégiques qui contrô<strong>la</strong>ient l’entrée du golfe. Piri Reis prit<br />
le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte ottomane d<strong>ans</strong> l’Océan Indien et fut<br />
l’amiral <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte à suez. Grâce à lui, les Ottom<strong>ans</strong> reprirent A<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> main <strong>de</strong>s Portugais en 1549. Il mit le siège <strong>de</strong>vant Hormuz après<br />
avoir pris en 1552 <strong>la</strong> forteresse <strong>de</strong> Muscat qu’occupaient les Portugais<br />
<strong>de</strong>puis 1507. Mais voyant sa flotte encerclée par celle <strong>de</strong>s Portugais,<br />
Piri Reis dut retourner en Egypte. Aucun <strong>de</strong> ses successeurs ne parvint<br />
à mettre fin à <strong>la</strong> suprématie portugaise d<strong>ans</strong> l’Océan Indien et d<strong>ans</strong> le<br />
golfe Persique, et ce principalement en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
flotte ottomane qui comptait <strong>de</strong>s galères munies <strong>de</strong> canons à courte<br />
portée. Il reste que grâce à ces expéditions contre les Portugais, les Ottom<strong>ans</strong><br />
réussirent à les empêcher <strong>de</strong> s’installer à A<strong>de</strong>n, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer<br />
rouge et sur les côtes du golfe Persique. D<strong>ans</strong> <strong>la</strong> foulée, les Ottom<strong>ans</strong><br />
imposèrent leur contrôle sur le Yémen et les côtes sud <strong>de</strong> l’Arabie.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
87
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
88<br />
A <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Soliman le Magnifique en 1566, les territoires <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman s’étendaient <strong>de</strong> <strong>la</strong> Péninsule arabique à <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong>s<br />
Balk<strong>ans</strong>. Et ce n’était pas encore <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’é<strong>la</strong>rgissement <strong>de</strong> l’Empire<br />
puisque <strong>de</strong> nouvelles conquêtes al<strong>la</strong>ient s’accomplir jusqu’au milieu du<br />
XVIIème siècle. De leur côté, n’ayant plus d’adversaires d<strong>ans</strong> l’Océan<br />
Indien, l’émergence <strong>de</strong>s Portugais marqua l’avènement d’une puissance<br />
mondiale en Europe. Les Ottom<strong>ans</strong> ne pouvaient rivaliser avec une<br />
puissance navale d<strong>ans</strong> le pacifique bien que leur force navale fit ses<br />
preuves en Méditerranée. De même, ils ne pouvaient bénéficier <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
manne commerciale fournie par les routes at<strong>la</strong>ntiques, ils continuaient<br />
à profiter du commerce méditerranéen encore florissant. Partant, l’économie<br />
européenne, qui se p<strong>la</strong>çait loin <strong>de</strong>rrière celle <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>,<br />
commença à se développer plus rapi<strong>de</strong>ment. Quoiqu’il en soit du développement<br />
<strong>de</strong> l’Europe, les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong>meuraient l’Etat le plus puissant<br />
au mon<strong>de</strong> jusqu’au XVIIème siècle. Mais il se peut qu’ils n’aient<br />
pas pris toute <strong>la</strong> mesure <strong>de</strong>s effets négatifs qui al<strong>la</strong>ient en découler à<br />
l’intérieur et hors <strong>de</strong> l’empire. Ce<strong>la</strong> ne signifie pas nécessairement que<br />
les Ottom<strong>ans</strong> méconnaissaient l’essor européen compte tenu <strong>de</strong>s tentatives<br />
pour freiner l’avancée portugaise d<strong>ans</strong> l’Océan Indien.<br />
Les conquêtes ottomanes après Soliman Ier Après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Soliman, l’Empire fut gouverné par une série <strong>de</strong> sult<strong>ans</strong><br />
incompétents. Selim II (1566-1574), fils <strong>de</strong> Soliman, fut le premier<br />
sultan qui ne mena aucune campagne. Il fut pourtant l’homme qui<br />
traça les contours d’une politique <strong>de</strong> conquête <strong>de</strong> l’Empire, malgré que<br />
le grand vizir Sokullu Mehmed Pacha dirigeât <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s affaires<br />
<strong>de</strong> l’Etat. Ce <strong>de</strong>rnier n’était pas favorable à une conquête <strong>de</strong> Chypre<br />
craignant que ce<strong>la</strong> puisse provoquer une nouvelle croisa<strong>de</strong>. Chypre fut<br />
finalement prise aux Vénitiens en 1571. Les campagnes du Hedjaz et<br />
du Yémen furent également couronnées <strong>de</strong> succès. Mais une expédition<br />
navale <strong>la</strong> même année, sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Espagne et <strong>de</strong> l’Italie, pour<br />
sauver Chypre, asséna une défaite cuisante aux Ottom<strong>ans</strong> à Lépante<br />
(Inebahtı en turc). Mais tout <strong>de</strong> suite après, les Ottom<strong>ans</strong> al<strong>la</strong>ient<br />
démontrer leur supériorité en Méditerranée, dont ils avaient déjà fait<br />
preuve à Préveza en 1538. Ils reconstruirent rapi<strong>de</strong>ment leur flotte et<br />
reprirent le contrôle <strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée orientale.<br />
Au temps <strong>de</strong> Selim, les Ottom<strong>ans</strong> percevaient <strong>la</strong> Russie comme une<br />
figure menaçante <strong>de</strong>puis qu’elle avait conquis Astrakhan en 1556. En<br />
effet, <strong>de</strong>puis le début du XVIème siècle, <strong>la</strong> Russie gagnait <strong>de</strong> plus en<br />
plus en puissance. A l’été 1569, Sokullu Mehmed Pacha é<strong>la</strong>bora un<br />
p<strong>la</strong>n pour unir <strong>la</strong> Volga et le fleuve du Don à l’ai<strong>de</strong> d’un canal, afin <strong>de</strong>
prévenir toute extension <strong>de</strong>s Russes plus avant vers le sud. La conquête<br />
<strong>de</strong>s khanats <strong>de</strong> Kazan et d’Astrakhan et ce qui restait après l’éc<strong>la</strong>tement<br />
du territoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hor<strong>de</strong> d’Or, permit d’une part <strong>de</strong> circonscrire<br />
les Safavi<strong>de</strong>s à <strong>la</strong> mer Caspienne, d’autre part <strong>de</strong> rendre les Ottom<strong>ans</strong><br />
maîtres <strong>de</strong>s routes <strong>de</strong> commerce d’Asie centrale situées à l’ouest. L’un<br />
<strong>de</strong>s buts <strong>de</strong> ce projet était d’atteindre les musulm<strong>ans</strong> sunnites d’Asie<br />
centrale avec le concours <strong>de</strong>squels les Ottom<strong>ans</strong> pouvaient contenir les<br />
Safavi<strong>de</strong>s.<br />
L’autre projet <strong>de</strong> Sokullu Mehmed Pacha était d’ouvrir le canal <strong>de</strong> Suez<br />
pour mieux contrôler les routes <strong>de</strong> commerce indiennes. Mais ce p<strong>la</strong>n<br />
resta lettre morte. Les Ottom<strong>ans</strong> atteignirent néanmoins <strong>la</strong> mer Caspienne<br />
en 1590 après une série <strong>de</strong> victoires contre les Safavi<strong>de</strong>s, s<strong>ans</strong><br />
pour autant parvenir à imposer leur autorité longtemps.<br />
Les frontières <strong>de</strong> l’est sécurisées pour un temps, les Ottom<strong>ans</strong> dirigèrent<br />
une nouvelle fois leur attention vers l’ouest où les tensions étaient<br />
<strong>la</strong>tentes <strong>de</strong>puis 1587. La guerre contre l’Autriche débuta en 1593 et al<strong>la</strong>it<br />
durer 14 <strong>ans</strong> s<strong>ans</strong> aucun avantage au final pour les Ottom<strong>ans</strong>. L’Autriche<br />
organisa une croisa<strong>de</strong> afin <strong>de</strong> reprendre aux Ottom<strong>ans</strong> les Etats<br />
vassaux <strong>de</strong> Va<strong>la</strong>chie, Bogdan et <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>ylvanie. Mehmed III - qui fut<br />
contraint <strong>de</strong> prendre le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> son armée - vainquit les<br />
Croisés à <strong>la</strong> Bataille <strong>de</strong> Keresztes (Haçova en turc, d<strong>ans</strong> le nord <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Hongrie) en 1596. Au beau milieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille, on dut dissua<strong>de</strong>r le<br />
sultan <strong>de</strong> fuir le champ d’affrontement. Mais ce ne fut pas <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
guerre austro-ottomane qui <strong>de</strong>vait durer jusqu’en 1606. Au moment<br />
où les Safavi<strong>de</strong>s attaquaient à l’est, un soulèvement <strong>de</strong>s protestants en<br />
Tr<strong>ans</strong>ylvanie obligea les <strong>de</strong>ux parties à signer en 1606 un accord dit<br />
<strong>de</strong> ‘La paix <strong>de</strong> Zsitvatorok’. Avec cette paix, les ceci sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong><br />
<strong>de</strong>venaient les égaux <strong>de</strong>s empereurs autrichiens et annonça un tournant<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> diplomatie et <strong>la</strong> politique étrangère <strong>de</strong> l’Empire ottoman. D’autant<br />
que cette époque marqua le début <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’exp<strong>ans</strong>ion ottomane<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où les Habsbourgs en Europe centrale et les Safavi<strong>de</strong>s<br />
en Asie centrale constituaient <strong>de</strong> soli<strong>de</strong>s barrières contre toute avancée<br />
<strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. De son côté, <strong>la</strong> Russie apparue comme un pouvoir fort<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région, bloquait l’exp<strong>ans</strong>ion ottomane vers le nord.<br />
B. Crises et consolidation (1600-1774)<br />
Comme il a été dit, après <strong>la</strong> mort <strong>de</strong> Soliman Ier , les conquêtes se poursuivirent<br />
mais à un rythme plus lent. Certains changements intervinrent<br />
d<strong>ans</strong> le système c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l’administration ottomane. Du reste,<br />
contrairement aux sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong> qui commandaient traditionnel-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
89
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
90<br />
lement leurs troupes durant une campagne, Selim II - fils <strong>de</strong> Soliman<br />
- et son fils Murad III (1574-1595), se désengagèrent <strong>de</strong>s affaires<br />
militaires. Vers <strong>la</strong> fin du XVIème siècle, les sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong> abandonnèrent<br />
<strong>la</strong> pratique du fratrici<strong>de</strong> mais restaient méfiants à l’égard <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
loyauté filiale. Mehmed III (1595-1603) fut le <strong>de</strong>rnier sultan qui eut<br />
recours au fratrici<strong>de</strong> et qui fit assassiner son fils. Les frères du sultan<br />
furent enfermés au harem du pa<strong>la</strong>is. Alors qu’ils vivaient d<strong>ans</strong> le luxe,<br />
ils durent restés cloîtrés d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> petites pièces isolés du mon<strong>de</strong> : on<br />
appe<strong>la</strong>it ce<strong>la</strong> le système <strong>de</strong>s cages (kafes). La coutume <strong>de</strong> confier le<br />
gouvernement provincial aux princes pour les préparer au sultanat fut<br />
également dé<strong>la</strong>issée. Un nouveau co<strong>de</strong> juridique fut introduit par le<br />
sultan Ahmed Ier (1603-1617) stipu<strong>la</strong>nt que le trône reviendrait au<br />
plus ancien membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> dynastie ottomane.<br />
Au début du XVIIème siècle, l’Empire ottoman était encore l’Etat le<br />
plus puissant d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> d’alors sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> <strong>la</strong> richesse et <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité<br />
militaire. Pourtant, le style <strong>de</strong> pratique gouvernementale cultivé<br />
parmi les premiers sult<strong>ans</strong> avait complètement disparu à cause <strong>de</strong>s ajustements<br />
apportés au système <strong>de</strong> succession, et dès lors que les sult<strong>ans</strong><br />
accédèrent au trône s<strong>ans</strong> préparations préa<strong>la</strong>bles - c’est-à-dire <strong>la</strong> charge<br />
<strong>de</strong> gouverneur provincial et les luttes sang<strong>la</strong>ntes pour <strong>la</strong> succession - ils<br />
<strong>de</strong>vinrent moins compétents et eurent plus <strong>de</strong> mal à tenir leur propre<br />
maison ainsi que les affaires <strong>de</strong> l’Etat. Ce déclin du pouvoir du sultanat<br />
est considéré comme l’une <strong>de</strong>s causes principales <strong>de</strong> <strong>la</strong> crise d<strong>ans</strong> l’Empire.<br />
Aussi, <strong>la</strong> désintégration <strong>de</strong> l’Empire entraîna un dép<strong>la</strong>cement du<br />
centre du pouvoir en son sein. Des luttes <strong>de</strong> pouvoir se manifestèrent<br />
d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> nombreux milieux <strong>de</strong> l’administration : le grand vizir, le Divan<br />
ou Conseil Suprême, et surtout parmi les janissaires ; par conséquent,<br />
ce fut le début d’une longue instabilité du pouvoir au sein du gouvernement,<br />
s<strong>ans</strong> oublier l’influence grandissante <strong>de</strong>s mères <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong><br />
(Vali<strong>de</strong> sultan) d<strong>ans</strong> les affaires <strong>de</strong> l’Etat. Elles étaient un maillon clé<br />
d<strong>ans</strong> les réseaux <strong>de</strong> complots, et ce <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> Hürrem Sultan (Roxe<strong>la</strong>ne),<br />
femme <strong>de</strong> Soliman le Magnifique. Avec elle, le pa<strong>la</strong>is principal<br />
<strong>de</strong>s femmes –celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> mère du sultan et <strong>de</strong> ses femmes– acquit une<br />
influence grandissante pouvant aller jusqu’à <strong>la</strong> nomination à <strong>de</strong>s postes<br />
élevés au sein <strong>de</strong> l’Empire. En réalité, ce dont avait besoin l’Empire en<br />
ce temps là c’était d’un sultan puissant aux comman<strong>de</strong>s au moment où<br />
l’Empire faisait face à <strong>de</strong> graves problèmes sociaux et économiques.<br />
En effet, <strong>de</strong>puis <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> moitié du XVIème siècle, l’Empire connaissait<br />
une inf<strong>la</strong>tion préoccupante en raison <strong>de</strong> l’affaiblissement <strong>de</strong> son<br />
autorité sur les routes traditionnelles du commerce maritime asiatique
au profit <strong>de</strong>s européens. Les mutations démographiques furent l’autre<br />
cause <strong>de</strong> l’inf<strong>la</strong>tion : alors que <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion croissait considérablement,<br />
le nombre <strong>de</strong>s terres cultivables <strong>de</strong> l’Empire –dont l’économie<br />
était principalement basée sur l’agriculture– stagnait. La dévaluation<br />
provoqua inévitablement <strong>la</strong> hausse <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s marchandises due à<br />
l’augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, et ce<strong>la</strong> accrut les besoins du Trésor<br />
pour financer les réformes du système militaire. Les métaux précieux<br />
importés d’Amérique affectèrent tout aussi défavorablement l’économie<br />
ottomane.<br />
Par ailleurs, l’importance qu’accordaient les monarques européens à<br />
l’infanterie munie d’armes à feu, poussa les Ottom<strong>ans</strong> à faire <strong>de</strong> même,<br />
exigeant ainsi <strong>de</strong>s tr<strong>ans</strong>formations d<strong>ans</strong> leur système militaire c<strong>la</strong>ssique.<br />
Le système financier <strong>de</strong>vait à son tour s’adapter à cette politique militaire.<br />
Comme les corps d’infanterie <strong>de</strong>venaient un facteur décisif d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> guerre, particulièrement avec les Habsbourgs, les hommes d’Etat<br />
ottom<strong>ans</strong> durent recruter <strong>de</strong>s mercenaires armés parmi leurs sujets :<br />
ceux-ci sont connus sous le nom <strong>de</strong> ‘infanterie sekban’.<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> encouragèrent également les pachas et nobles provinciaux<br />
fortunés à recruter <strong>de</strong>s fantassins sekban pour remp<strong>la</strong>cer les spahis<br />
timariotes (<strong>la</strong> cavalerie). Parallèlement aux nouveaux recrutements<br />
<strong>de</strong> fantassins, le nombre <strong>de</strong>s janissaires al<strong>la</strong>it croissant — alors que se<br />
dégradaient <strong>la</strong> discipline et l’efficacité. Tout ce<strong>la</strong> faisait peser un far<strong>de</strong>au<br />
supplémentaire sur l’économie ottomane. Pour faire face à ces dépenses<br />
militaires, les Ottom<strong>ans</strong> introduirent un nouveau système <strong>de</strong> fiscalité<br />
connu sous le nom <strong>de</strong> ‘Iltizam’. Les Iltizam étaient affermés par l’Etat<br />
à <strong>de</strong> riches notables (mültezim) qui prélevaient cinq fois <strong>la</strong> valeur du<br />
montant fixé <strong>de</strong> l’impôt en taxant les pays<strong>ans</strong> et récoltant les productions<br />
agricoles. Les fantassins sekban, qui ne percevaient pas <strong>de</strong> sa<strong>la</strong>ire<br />
en temps <strong>de</strong> paix, se rebellèrent sous <strong>la</strong> conduite <strong>de</strong>s puissants Je<strong>la</strong>lis.<br />
Plusieurs terres cultivées et <strong>de</strong>s vil<strong>la</strong>ges furent abandonnés.<br />
De retour à Istanbul, les janissaires terrorisaient les responsables et le<br />
peuple. Ils <strong>de</strong>vinrent d’influents acteurs d<strong>ans</strong> le gouvernement et ce<strong>la</strong><br />
est dû principalement à <strong>la</strong> détérioration du système du <strong>de</strong>vchirmé. Tout<br />
au long du XVIIème siècle, les janissaires se sont petit à petit accaparés<br />
<strong>de</strong>s postes militaires et administratifs importants d<strong>ans</strong> le gouvernement<br />
et les ont tr<strong>ans</strong>mis à leurs enfants, très souvent en soudoyant<br />
quelques-uns. En prenant <strong>de</strong> l’ascendance d<strong>ans</strong> les affaires du pouvoir,<br />
les janissaires fomentèrent <strong>de</strong>s révoltes afin <strong>de</strong> faire accé<strong>de</strong>r au pouvoir<br />
l’homme <strong>de</strong> leur choix avec parfois l’aval <strong>de</strong>s Vali<strong>de</strong> sultanes.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
91
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
92<br />
Après Soliman Ier, les sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong> étaient trop crédules pour pouvoir<br />
surmonter <strong>de</strong> tels troubles. Osman II (1618-1622), dit ‘Le Jeune’<br />
(Genç), tenta <strong>de</strong> restaurer l’autorité <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> mais fut assassiné par<br />
les janissaires. Lui succéda Murad IV âgé <strong>de</strong> 8 <strong>ans</strong> et fils d’Ahmad I er .<br />
Le jeune Murad IV <strong>de</strong>meura longtemps sous le contrôle <strong>de</strong> sa mère, <strong>la</strong><br />
passionnée sultane Kosem qui gouverna à travers lui. L’Empire tomba<br />
d<strong>ans</strong> l’anarchie : les Safavi<strong>de</strong>s envahirent l’Irak, <strong>de</strong>s révoltes éc<strong>la</strong>tèrent<br />
en Anatolie du nord, et en 1631, les janissaires prirent d’assaut le pa<strong>la</strong>is<br />
et tuèrent entre autres le grand vizir. Murad VI, craignant <strong>de</strong> subir le<br />
même sort que son frère aîné Osman II, résolut d’affirmer son autorité.<br />
Il voulut s’attaquer à <strong>la</strong> corruption qui gangrenait le système <strong>de</strong>puis les<br />
sult<strong>ans</strong> précé<strong>de</strong>nts et qu’il ne put régler au temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> régence <strong>de</strong> sa<br />
mère. Il parvint à limiter le gaspil<strong>la</strong>ge financier du gouvernement. Et<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> foulée, il prohiba l’alcool et le tabac à Istanbul.<br />
L’un <strong>de</strong>s plus remarquables exploits <strong>de</strong> Murad IV fut <strong>la</strong> victoire contre<br />
les Safavi<strong>de</strong>s qui permit aux Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong> récupérer Tabriz, Hamadhan<br />
et Bagdad en 1638. Il dirigea lui-même <strong>la</strong> campagne d’Iran et d’Irak<br />
et se révé<strong>la</strong> un extraordinaire commandant sur le champ <strong>de</strong> bataille. Il<br />
fut le <strong>de</strong>rnier sultan ottoman à comman<strong>de</strong>r une armée sur le champ <strong>de</strong><br />
bataille. La campagne contre les Safavi<strong>de</strong>s se termina en 1539 par <strong>la</strong><br />
signature d’un accord appelé le Kasr-i Shirin. Durant cette expédition,<br />
il soumit les rebelles en Anatolie et restaura l’ordre <strong>de</strong> l’Etat. Mais cette<br />
accalmie ne dura pas longtemps puisqu’il mourut à l’âge <strong>de</strong> 27 <strong>ans</strong>.<br />
Son frère Ibrahim lui succéda (1640-1648) et avec lui les intrigues et<br />
les révoltes que Murad IV en son temps avait réussi à apaiser ont tôt<br />
fait <strong>de</strong> resurgir.<br />
Ibrahim était incapable <strong>de</strong> prendre en charge le gouvernement après<br />
qu’il ait été ‘relâché’ <strong>de</strong> <strong>la</strong> ‘cage’ (kafes). Il n’avait reçu aucune éducation<br />
sur <strong>la</strong> lour<strong>de</strong> tâche qui l’attendait, à savoir gouverner un immense<br />
Empire. Plusieurs historiens pensent qu’il était atteint d’une ma<strong>la</strong>die<br />
mentale et il est probable que son état mental fut gravement affecté<br />
par son long séjour d<strong>ans</strong> le kafes du pa<strong>la</strong>is. Durant son règne, l’Empire<br />
ottoman était au bord <strong>de</strong> l’effondrement. On craignit également qu’il<br />
ne mît fin à <strong>la</strong> dynastie étant donné qu’il n’avait pas d’enfant mâle. Par<br />
chance, il eut un fils, Mehmed, ce qui sauva l’existence <strong>de</strong> l’Empire.<br />
Au début, Ibrahim se tint à l’écart <strong>de</strong>s affaires politiques, mais il finit<br />
par s’investir d<strong>ans</strong> les affaires du pouvoir et exécuta un grand nombre<br />
<strong>de</strong> vizirs. Néanmoins, il ne put mettre fin aux intrigues du pa<strong>la</strong>is. Il<br />
fut assassiné par un coup d’Etat en 1648. Ce fut une aubaine que les<br />
Européens étaient tout occupés avec <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> trente <strong>ans</strong> (1618-
1648) quand les Ottom<strong>ans</strong> affrontaient les Safavi<strong>de</strong>s et faisaient face à<br />
d’autres problèmes s<strong>ans</strong> craindre qu’un danger vienne <strong>de</strong> l’ouest.<br />
La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Köprülü<br />
Lorsque Mehmed IV (1648-1687) succéda à son père, il avait à peine 7<br />
<strong>ans</strong>. Sa grand-mère, Kosem Sultan fut <strong>la</strong> régente <strong>de</strong> 1648 à 1651. Cette<br />
situation créa une vacance du pouvoir : s<strong>ans</strong> surprise, l’appareil <strong>de</strong> l’Etat<br />
était pratiquement contrôlé par le chef <strong>de</strong>s janissaires et les spahis qui<br />
jouaient un rôle déterminant d<strong>ans</strong> le choix <strong>de</strong>s vizirs. Ces chefs <strong>de</strong> l’armée<br />
terrorisaient le pays et n’hésitaient pas à éliminer tous leurs rivaux.<br />
La structure politique et économique <strong>de</strong> l’Empire n’en <strong>de</strong>vint que plus<br />
vulnérable. Les luttes parmi les plus âgées <strong>de</strong>s femmes du pa<strong>la</strong>is causèrent<br />
encore plus <strong>de</strong> dommages à l’Etat étant donné qu’elles prenaient<br />
une part active d<strong>ans</strong> les activités <strong>de</strong> complot au sein du pa<strong>la</strong>is. L’affrontement<br />
ouvert entre Kosem sultan et Turhan Hadice Sultan –mère <strong>de</strong><br />
Mehmed IV– se termina par l’étranglement <strong>de</strong> <strong>la</strong> première. Turhan, qui<br />
n’était pas aussi passionnée que sa belle-mère, <strong>de</strong>vint régente. Peu après,<br />
les chefs et leurs complices furent pendus.<br />
Entre temps, les Ottom<strong>ans</strong> avaient envahi <strong>la</strong> Crète en 1644 en représailles<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> capture d’un navire ottoman faisant route vers l’Egypte par<br />
les corsaires maltais en Crète. Hania, <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième gran<strong>de</strong> ville <strong>de</strong> Crète,<br />
tomba aux mains <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. Mais <strong>la</strong> guerre dura plus longtemps<br />
que prévu puisque les Vénitiens bloquaient l’embouchure du Bosphore<br />
et les ports <strong>de</strong> Morée (le Péloponnèse). En 1656, <strong>la</strong> panique gagna<br />
Istanbul à l’annonce <strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> par une flotte vénitienne<br />
à l’entrée <strong>de</strong>s Dardanelles et <strong>la</strong> prise <strong>de</strong>s îles Ténédos et Lemnos.<br />
Turhan Sultan chercha un homme compétent pouvant faire face aux<br />
difficultés que vivaient l’Empire. Elle désigna Mehmed Köprülü, un<br />
homme âgé, grand vizir en octobre 1656 et se retira <strong>de</strong>s affaires <strong>de</strong><br />
l’Etat. Mehmed IV, connu comme ‘Le Chasseur’ (Avcı) -cette activité<br />
occupait en effet le plus c<strong>la</strong>ir <strong>de</strong> son temps - renonça à <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong> ses<br />
prérogatives au profit <strong>de</strong> son grand vizir. Dès lors, <strong>la</strong> famille Köprülü<br />
al<strong>la</strong>it dominer <strong>la</strong> scène politique pour 28 <strong>ans</strong>. Cette pério<strong>de</strong> est désignée<br />
par ‘époque <strong>de</strong>s Köprülü’ (1656-1683). Pour <strong>la</strong> première fois d<strong>ans</strong><br />
l’histoire ottomane, une pério<strong>de</strong> est désignée du nom du grand vizir<br />
plutôt que <strong>de</strong> celui du sultan.<br />
Durant les gouvernements <strong>de</strong> Mehmed Pacha Köprülü (1656-1661)<br />
et <strong>de</strong> Fazil Ahmad Pacha Köprülü (1661-1676), l’Empire ottoman retrouva<br />
une certaine gloire <strong>de</strong> l’époque <strong>de</strong> Soliman I er . Ils reprirent les<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
93
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
94<br />
îles <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Egée <strong>de</strong>s Vénitiens et menèrent <strong>de</strong>s campagnes victorieuses<br />
contre <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>ylvanie en 1664 et <strong>la</strong> Pologne en 1670-1674. Ils<br />
réussirent également à mettre fin aux révoltes <strong>de</strong>s janissaires. A <strong>la</strong> mort<br />
<strong>de</strong> Mehmed Pacha en 1676, l’Empire était <strong>de</strong> nouveau stable et puissant.<br />
Kara Mustapha Pacha, le <strong>de</strong>rnier membre <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille Köprülü,<br />
prit <strong>la</strong> suite d’Ahmad Pacha comme grand vizir.<br />
L’Empire Ottoman fournissait une assistance militaire aux Hongrois<br />
et aux minorités non catholiques habitant les territoires occupés par les<br />
Habsbourg en Hongrie. En 1681, les protestants et autres forces anti-<br />
Habsbourg menés par Imre Thokoly se rebellèrent contre Léopold I er<br />
et firent appel à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. Ces <strong>de</strong>rniers reconnurent Imre roi<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> ‘Hongrie supérieure’ –correspondant à l’est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Slovaquie et <strong>de</strong>s<br />
parties du nord-est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hongrie actuelle– et décidèrent <strong>de</strong> marcher<br />
contre l’Autriche. La prise <strong>de</strong> Vienne constituait <strong>de</strong>puis longtemps<br />
un objectif stratégique d’importance pour les Ottom<strong>ans</strong> puisqu’elle<br />
contrô<strong>la</strong>it le croisement <strong>de</strong>s routes danubiennes du sud <strong>de</strong> l’Europe (<strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> mer Noire à l’Europe <strong>de</strong> l’ouest) et <strong>de</strong>s routes commerciales terrestres<br />
(<strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée orientale à l’Allemagne).<br />
La première gran<strong>de</strong> défaite<br />
En septembre <strong>de</strong> l’année 1683, les troupes ottomanes commandées<br />
par le grand vizir Kara Mustapha Pacha mirent le siège <strong>de</strong>vant Vienne<br />
après avoir vaincu l’armée dirigée par Charles V, duc <strong>de</strong> Lorraine. Cependant,<br />
l’armée ottomane fut défaite par une Ligue catholique menée<br />
par le roi polonais Jean III Sobieski. La trahison <strong>de</strong> Murad Giray, Khan<br />
<strong>de</strong> Crimée, fut l’une <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite ottomane. Mustapha Pacha<br />
avait <strong>de</strong>mandé à Murad Giray <strong>de</strong> freiner l’avancée <strong>de</strong> Jean Sobieski<br />
sur le Danube, mais celui-ci n’entreprit aucune action contre les troupes<br />
polonaises. La bataille <strong>de</strong> Vienne mit fin à l’hégémonie ottomane d<strong>ans</strong><br />
le sud <strong>de</strong> l’Europe. En 1684, une nouvelle Ligue Sainte fut <strong>la</strong>ncée par<br />
le Pape Innocent XI et comprenait le Saint Empire romain dirigé par<br />
les Habsbourg d’Autriche, <strong>la</strong> République <strong>de</strong> Venise et <strong>la</strong> Pologne. En<br />
1686, <strong>la</strong> Russie rejoignit <strong>la</strong> Sainte Ligue. Les Ottom<strong>ans</strong> durent affronter<br />
<strong>la</strong> Sainte Ligue sur plusieurs fronts pendant 16 <strong>ans</strong>. Finalement, <strong>la</strong><br />
Sainte Ligue sortit victorieuse en 1699 et força les Ottom<strong>ans</strong> à signer<br />
le Traité <strong>de</strong> Karlowitz. En conséquence <strong>de</strong> quoi, les Ottom<strong>ans</strong> durent<br />
cé<strong>de</strong>r une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Hongrie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tr<strong>ans</strong>ylvanie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Slovénie<br />
à l’Autriche, tandis que <strong>la</strong> Podolie passa aux mains <strong>de</strong> <strong>la</strong> Pologne.<br />
De même, Venise s’empara <strong>de</strong> <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dalmatie et du<br />
Péloponnèse. La Russie fit main basse sur <strong>la</strong> forteresse d’Azov durant<br />
<strong>la</strong> guerre et étendit ses territoires jusqu’à <strong>la</strong> Mer Noire.
Le Traité <strong>de</strong> Karlowitz marqua ainsi le début du déclin ottoman d<strong>ans</strong><br />
l’Europe <strong>de</strong> l’est et fit <strong>de</strong> <strong>la</strong> monarchie <strong>de</strong>s Habsbourg <strong>la</strong> puissance<br />
dominante du moment en Europe centrale. Il restait aux Ottom<strong>ans</strong> à<br />
réorganiser leur flotte et leur armée. Ils <strong>de</strong>vaient aussi bien remanier le<br />
fonctionnement financier et administratif <strong>de</strong> l’Empire en accord avec<br />
les nouvelles pratiques étatiques européennes plutôt que suivre leurs<br />
pratiques traditionnelles. L’un <strong>de</strong> leurs objectifs du moment était <strong>de</strong><br />
récupérer les territoires perdus avec le Traité <strong>de</strong> Karlowitz. Pour ce<br />
faire, ils durent mener une série <strong>de</strong> guerres contre <strong>la</strong> Russie, Venise et<br />
l’Autriche. Ils marquèrent quelques victoires importantes lors <strong>de</strong> ces<br />
guerres.<br />
Une série <strong>de</strong> guerres pour une reconquête<br />
<strong>de</strong>s territoires perdus<br />
L’ambition <strong>de</strong> Pierre le Grand d’avoir un accès à un port <strong>de</strong>s mers du<br />
sud conduisit inévitablement à un conflit avec les Ottom<strong>ans</strong>. Il convoitait<br />
<strong>la</strong> mer d’Azov, puis <strong>de</strong> là Istanbul et finalement les détroits du<br />
Bosphore avec un œil sur <strong>la</strong> Méditerranée. Les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong> leur côté<br />
vou<strong>la</strong>ient rétablir leur position d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mer d’Azov. Le conflit qui se<br />
préparait éc<strong>la</strong>ta lorsque Pierre le Grand s’attira l’hostilité <strong>de</strong>s Suédois<br />
durant ses campagnes d<strong>ans</strong> le nord. Carl XII <strong>de</strong> Suè<strong>de</strong> envahit <strong>la</strong> Russie<br />
mais fut vaincu à Poltava en 1709, et pour ne pas être fait prisonnier,<br />
il chercha asile en <strong>Turquie</strong> qui lui fut accordé par le sultan Ahmad III<br />
(1703- 1730). Pierre le Grand envoya son ambassa<strong>de</strong>ur, Tolstoï, pour<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong>r qu’il soit extradé mais essuya un refus. Et comme les Russes<br />
s’obstinaient, Ahmad III fit emprisonner l’ambassa<strong>de</strong>ur d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> forteresse<br />
<strong>de</strong>s Sept Tours à Istanbul (Yedikule Zindanı en turc) entraînant<br />
<strong>la</strong> guerre entre les <strong>de</strong>ux pays.<br />
En juillet <strong>de</strong> l’année 1711, les troupes ottomanes défirent l’armée russe<br />
à Prout. Pour <strong>de</strong>s raisons mystérieuses, les ottom<strong>ans</strong> furent incapables<br />
<strong>de</strong> tirer avantage <strong>de</strong> cette victoire qui leur aurait permis d’avancer<br />
jusqu’à Moscou. Au lieu <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, Pierre le Grand fut contraint selon<br />
les termes du Traité <strong>de</strong> Prout <strong>de</strong> retirer son ambassa<strong>de</strong> permanente à<br />
Istanbul et <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r <strong>la</strong> mer d’Azov qui était sous contrôle russe <strong>de</strong>puis<br />
1700. En battant ainsi l’un <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Sainte Ligue, les Ottom<strong>ans</strong><br />
reprirent <strong>de</strong> l’assurance. Ils se tournèrent alors vers Venise en<br />
plein déclin et récupérèrent <strong>la</strong> majeure partie du Péloponnèse. Sachant<br />
bien qu’elle serait <strong>la</strong> prochaine cible, l’Autriche s’empressa <strong>de</strong> former<br />
une alliance offensive avec Venise en 1716, obligeant les Ottom<strong>ans</strong> affaiblis<br />
à accepter les accords du traité <strong>de</strong> paix <strong>de</strong> Passarowitz en 1718,<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
95
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
96<br />
selon lequel tout le Péloponnèse resterait aux mains <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>,<br />
Belgra<strong>de</strong> et Timisoara (Temeşvar en turc) seraient cédés à l’Autriche.<br />
La perte <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong> fut le signe <strong>de</strong> <strong>la</strong> vulnérabilité <strong>de</strong> <strong>la</strong> position ottomane<br />
d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>.<br />
L’Ère <strong>de</strong>s Tulipes (1718-1730)<br />
Face à <strong>de</strong> telles pertes, le grand vizir Damad Ibrahim Pacha –celui-là<br />
même qui avait signé le Traité <strong>de</strong> Passarowitz avec l’Autriche– pensait<br />
à juste titre que l’Empire avait besoin <strong>de</strong> mener certaines réformes susceptibles<br />
<strong>de</strong> mettre fin aux gaspil<strong>la</strong>ges et à <strong>la</strong> corruption politique et<br />
socioéconomique. Il travail<strong>la</strong> également à une politique d’apaisement.<br />
Cette conception inaugura ainsi une nouvelle ère d<strong>ans</strong> l’histoire ottomane<br />
<strong>de</strong> 1718 à 1730, appelée l’Ère <strong>de</strong>s Tulipes (Lale Devri). Ce nom<br />
vient du fait que <strong>la</strong> tulipe était en vogue à cette époque, très <strong>la</strong>rgement<br />
recherchée par <strong>la</strong> noblesse, et finit par désigner <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce temps.<br />
Ibrahim Pacha envoya <strong>de</strong>s représentants d<strong>ans</strong> les capitales européennes<br />
afin d’acquérir <strong>de</strong>s savoirs sur le mouvement <strong>de</strong> renaissance en Europe.<br />
Une imprimerie fut établie à Istanbul pour publier <strong>de</strong>s ouvrages en<br />
turc. De nouvelles librairies virent le jour et certains livres occi<strong>de</strong>ntaux<br />
et orientaux furent traduits en turc. Les productions culturelles et artistiques<br />
typiquement ottomanes connurent un essor considérable à travers<br />
tout l’Empire. La capitale établit <strong>de</strong> nouveaux projets <strong>de</strong> construction,<br />
spécialement avec les yalis sur le Bosphore. Ce fut une pério<strong>de</strong><br />
re<strong>la</strong>tivement calme et pour <strong>la</strong> première fois <strong>de</strong> son histoire, l’Empire<br />
ottoman regardait vers l’Ouest, ayant réalisé l’importance <strong>de</strong>s progrès<br />
effectués en Europe. Jusqu’alors, les hommes d’Etat ottom<strong>ans</strong> croyaient<br />
que <strong>la</strong> corruption politique et socioéconomique d<strong>ans</strong> l’Empire était due<br />
à <strong>la</strong> perte <strong>de</strong>s valeurs c<strong>la</strong>ssiques <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> seules susceptibles <strong>de</strong><br />
mettre fin à <strong>la</strong> corruption et au désordre interne. Avec l’Ère <strong>de</strong>s Tulipes<br />
néanmoins, on ne croyait plus que <strong>la</strong> solution était d<strong>ans</strong> le retour à ces<br />
valeurs traditionnelles, mais bien plutôt <strong>de</strong> s’imprégner <strong>de</strong>s innovations<br />
européennes. Mais tout ce<strong>la</strong> ne correspondait pas aux besoins pressants<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion qui vivait d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> pauvreté alors que l’élite gouvernante<br />
baignait d<strong>ans</strong> le luxe. Un autre événement important provoqua <strong>la</strong> colère<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, ce fut <strong>la</strong> prise <strong>de</strong> Tabriz par les Safavi<strong>de</strong>s. C’est ainsi<br />
qu’en 1730 une insurrection exprimant le mécontentement du peuple<br />
et menée par Patrona Halil éc<strong>la</strong>ta d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> capitale. Ahmad III fut détrôné,<br />
Mahmud Ier (1730-1754) lui succéda et le grand vizir fut assassiné.<br />
L’Ère <strong>de</strong>s Tulipes était révolue les réformes furent <strong>de</strong> courte durée.<br />
Profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation à <strong>la</strong>quelle faisait face l’Empire, Catherine I re <strong>de</strong><br />
Russie (1725-1727) poursuivit <strong>la</strong> politique <strong>de</strong> son mari Pierre le Grand
qui convoitait un accès vers les mers du sud. Elle s’allia à l’impératrice<br />
Anne d’Autriche (1730-1740) contre les Ottom<strong>ans</strong>. La Russie obtint<br />
d’éc<strong>la</strong>tantes victoires avec <strong>la</strong> prise d’Otchakov (Özü en turc) en Crimée<br />
en 1737. Les Russes commençaient à caresser l’idée <strong>de</strong> conquérir<br />
Istanbul et restaurer l’ancien Empire byzantin. Mais les Ottom<strong>ans</strong><br />
réagirent en reprenant Belgra<strong>de</strong> à l’Autriche qui se retira <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
contraignant ainsi <strong>la</strong> Russie à signer avec Istanbul en 1739 un accord<br />
dit Traité <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong>. Avec <strong>la</strong> médiation <strong>de</strong> <strong>la</strong> France, le Traité <strong>de</strong><br />
Belgra<strong>de</strong> entérina <strong>la</strong> cession par l’Autriche <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong> et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Serbie<br />
en faveur <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. La Russie accepta <strong>de</strong> détruire <strong>la</strong> forteresse<br />
d’Azov et <strong>de</strong> ne pas construire leur flotte sur <strong>la</strong> mer d’Azov et <strong>la</strong> mer<br />
Noire. Du coup, les Russes perdirent le droit d’y naviguer. Dorénavant<br />
ils <strong>de</strong>vaient commercer sur <strong>de</strong>s navires ottom<strong>ans</strong>, sous pavillon ottoman.<br />
Somme toute, l’Empire ottoman regagna non seulement certains<br />
<strong>de</strong>s territoires qu’il avait perdus avec les accords <strong>de</strong> Karlowitz et <strong>de</strong> Passarowitz,<br />
mais aussi l’assurance d’être capable d’affronter <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s<br />
puissances en même temps.<br />
Après le traité <strong>de</strong> Belgra<strong>de</strong>, les Ottom<strong>ans</strong> étaient plutôt enclins à préserver<br />
<strong>la</strong> paix et n’envisageaient plus <strong>la</strong> guerre comme unique solution<br />
aux problèmes extérieurs. Et c’est un signe du climat <strong>de</strong> cette époque<br />
où <strong>la</strong> diplomatie s’est imposée comme <strong>la</strong> voie privilégiée d<strong>ans</strong> les re<strong>la</strong>tions<br />
internationales. Pendant une trentaine d’années, les Ottom<strong>ans</strong><br />
suivirent cette politique dont le plus fervent avocat n’était autre que<br />
le grand vizir Koca Ragıb Pacha (1757-1763) qui évita <strong>de</strong> contracter<br />
une alliance avec un quelconque Etat contre d’autres. Mais à sa mort<br />
en 1763, les Ottom<strong>ans</strong> abandonnèrent cette politique, décision qui se<br />
termina par une tragédie en partie parce que Catherine II <strong>de</strong> Russie<br />
(1762-1796) provoqua les Ottom<strong>ans</strong> à <strong>la</strong> guerre en ranimant <strong>la</strong> politique<br />
exp<strong>ans</strong>ionniste <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie vers <strong>la</strong> Méditerranée. La guerre avec<br />
<strong>la</strong> Russie entraîna <strong>de</strong>s tensions internationales à l’intérieur même <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Pologne où les dissensions battaient leur plein entre les nationalistes et<br />
le roi Stanis<strong>la</strong>s Poniatowski qui bénéficiait du soutien militaire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Russie. Les troupes russes poursuivaient tous les nationalistes polonais<br />
qui cherchaient refuge d<strong>ans</strong> les territoires ottom<strong>ans</strong> et jusque d<strong>ans</strong> le<br />
vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> Balta où ils les massacrèrent. Cette accusation fut rejetée par<br />
les autorités russes. Suite à cet inci<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> frontière à Balta, le sultan<br />
Mustapha III déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre à <strong>la</strong> Russie le 25 septembre <strong>de</strong> l’année<br />
1768 s<strong>ans</strong> aucun préparatif militaire préa<strong>la</strong>ble du fait que ce massacre<br />
souleva <strong>de</strong> vives réactions parmi <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ottomane.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
97
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
98<br />
La guerre turco-russe (1768-1774)<br />
Ce fut une guerre dévastatrice qui dura six années et se dérou<strong>la</strong> sur<br />
terre comme sur mer. La Russie était soutenue par le Royaume Uni qui<br />
procura <strong>de</strong>s conseillers à <strong>la</strong> flotte russe. Les hostilités commencèrent<br />
d’abord d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>, en Crimée et sur <strong>la</strong> frontière caucasiennegéorgienne.<br />
Une flotte russe venant <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer d’Azov ravagea les côtes<br />
ottomanes <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer Noire et parvint même à percer quelques ouvertures<br />
à travers les détroits. Au même moment, une autre flotte russe fit<br />
route <strong>de</strong> <strong>la</strong> Baltique vers <strong>la</strong> Méditerranée où elle fut assistée par une<br />
flotte britannique sous le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> l’amiral Elphinstone. Le<br />
5 juillet 1770, <strong>la</strong> flotte ottomane fut écrasée par les navires russo-britanniques<br />
lors d’un affrontement à Chesmé (Çeşme), un <strong>de</strong>s districts<br />
d’Izmir sur <strong>la</strong> mer Égée.<br />
Ces revers pressèrent les Turcs à entamer <strong>de</strong>s négociations <strong>de</strong> paix que<br />
les Russes rejetèrent. Tandis que le conflit traînait en longueur, les Turcs<br />
finirent par repousser les Russes au-<strong>de</strong>là du Danube en 1773 quoique<br />
pas pour longtemps. Peu <strong>de</strong> temps après, ils attaquèrent <strong>de</strong> nouveau<br />
Dobroudja mais ne parvinrent pas à reprendre Silistra et Varna. Durant<br />
ce conflit, Mustapha III trouva <strong>la</strong> mort le 24 décembre 1773. Abdulhamid<br />
I er lui succéda (1774-1789). Après une série <strong>de</strong> défaites, celui-ci fit<br />
tout ce qui était en son pouvoir pour sauver ce qui pouvait l’être. Ainsi,<br />
il fut contraint le 21 juillet 1774 <strong>de</strong> signer un accord appelé Traité <strong>de</strong><br />
Kutchuk-Kaïnardji (Küçük Kaynarca) aux conditions sévères imposées<br />
par <strong>la</strong> Russie et très défavorable aux Ottom<strong>ans</strong>.<br />
C. Le déclin (1774-1914)<br />
Le Traité <strong>de</strong> Kutchuk-Kaïnardji fut dévastateur pour l’empire ottoman<br />
et marqua le début du déclin <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> en Europe du sud et d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> Mer Noire. Les Russes s’assurèrent le droit <strong>de</strong> naviguer librement<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer Noire, le libre accès à <strong>la</strong> Méditerranée, un traitement<br />
bienveil<strong>la</strong>nt à l’égard <strong>de</strong> ses ambassa<strong>de</strong>urs, le libre passage aux Saintes<br />
sépultures à ses pèlerins en route vers Jérusalem et <strong>la</strong> protection <strong>de</strong><br />
tous les chrétiens sur le sol ottoman. Cette <strong>de</strong>rnière concession généra<br />
<strong>de</strong> terribles conflits <strong>de</strong>puis que ce privilège a été garanti aux Français<br />
sous Soliman le Magnifique. En outre, les Ottom<strong>ans</strong> perdirent <strong>la</strong> Mer<br />
d’Azov et durent renoncer à toute prétention sur <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>chie. Ils cédèrent<br />
également le Khanat <strong>de</strong> Crimée auquel ils furent forcés <strong>de</strong> reconnaître<br />
l’indépendance. Quoiqu’en principe le Khanat <strong>de</strong> Crimée fût indépendant,<br />
d<strong>ans</strong> les faits il dépendait <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et fut définitivement<br />
annexé par l’Empire russe en 1783. L’aspect le plus significatif <strong>de</strong> ce
traité et lié à l’histoire navale est qu’il octroya à <strong>la</strong> Russie le droit d’accé<strong>de</strong>r<br />
aux ports <strong>de</strong>s mers du sud et le passage à travers les Dardanelles.<br />
Abdulhamid I er chercha les moyens <strong>de</strong> réparer <strong>la</strong> disgrâce du Traité <strong>de</strong><br />
Kutchuk-Kaïnardji. Pourtant, <strong>la</strong> menace que faisait peser <strong>la</strong> Russie sur<br />
l’Empire ottoman ne cessait d’enfler d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où Catherine II<br />
continuait à inciter les Chrétiens d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong> à se rebeller contre<br />
les Ottom<strong>ans</strong>. Elle engagea aussi une alliance avec l’Autriche à <strong>de</strong>ssein<br />
<strong>de</strong> partager les territoires ottom<strong>ans</strong> et conquérir Istanbul. Face à ces<br />
constantes provocations, <strong>la</strong> Porte ottomane (nom donné en référence<br />
au gouvernement ottoman) déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre à <strong>la</strong> Russie le 19 août 1787,<br />
répondant ainsi au souhait <strong>de</strong> reprendre <strong>la</strong> Crimée et Kutchuk-Kaïnardji<br />
aux Russes. Mais encore une fois, les préparatifs <strong>de</strong> guerre n’étaient<br />
pas au point et le moment mal choisi en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> toute nouvelle<br />
alliance austro-russe. Se battant contre <strong>de</strong>ux gran<strong>de</strong>s puissances sur<br />
<strong>de</strong>ux fronts différents, les Ottom<strong>ans</strong> se mirent d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> graves difficultés.<br />
Le jeune sultan Selim III (1789-1807) se souciait <strong>de</strong> restaurer<br />
le prestige <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> grâce à une victoire avant d’entreprendre <strong>de</strong>s<br />
pourparlers <strong>de</strong> paix, mais l’état <strong>de</strong> ses troupes rendit ses espoirs vains.<br />
Les circonstances tournèrent en faveur <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> lorsque <strong>la</strong> Suè<strong>de</strong><br />
et <strong>la</strong> Prusse, inquiètes <strong>de</strong> <strong>la</strong> montée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et <strong>de</strong> l’Autriche et <strong>de</strong>s<br />
effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> Révolution française <strong>de</strong> 1789, signèrent <strong>de</strong>s traités d’assistance<br />
mutuelle avec l’Empire ottoman mettant ainsi fin à <strong>la</strong> guerre. La<br />
Révolution française sauva l’Empire ottoman. L’Autriche dut restituer<br />
les territoires qu’elle avait acquis lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre contre les Ottom<strong>ans</strong><br />
–y compris Belgra<strong>de</strong>– et donna les garanties d<strong>ans</strong> le traité dit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Paix<br />
b<strong>la</strong>nche <strong>de</strong> Sistova en 1791 qu’elle ne contractera aucune alliance avec<br />
<strong>la</strong> Russie contre l’Empire ottoman. Le traité <strong>de</strong> Jassy ou Iassy (Yaş en<br />
turc) signé en 1792 avec <strong>la</strong> Russie sou<strong>la</strong>gea quelque peu les Ottom<strong>ans</strong><br />
du poids du Traité <strong>de</strong> Kutchuk-Kaïnardji. Toutefois, les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong>vaient<br />
renoncer à leur prétention sur <strong>la</strong> Crimée et <strong>la</strong> Bessarabie, encore<br />
que les gran<strong>de</strong>s puissances <strong>de</strong> l’époque avaient <strong>de</strong> plus pressants problèmes<br />
que <strong>de</strong> prêter attention à ceux <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>. Désormais, leur<br />
intérêt ne se situait plus à l’Est mais bien plutôt à l’Ouest. À Paris, <strong>la</strong><br />
Révolution triomphait.<br />
Des efforts pour <strong>la</strong> réforme<br />
du système militaire ottoman<br />
Depuis le début du XVIIIème siècle, les autorités ottomanes cherchaient<br />
à améliorer leur armée selon les standards occi<strong>de</strong>ntaux. À cet<br />
effet, Mahmud I er nomma le Conte <strong>de</strong> Bonneval en 1731 pour qu’il<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
99
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
100<br />
forme <strong>la</strong> division d’artillerie (Humbaracı Ocagı) <strong>de</strong> l’armée ottomane<br />
conformément aux modèles européens. Le Conte <strong>de</strong> Bonneval s’était<br />
réfugié d<strong>ans</strong> l’Empire ottoman et converti à l’is<strong>la</strong>m. Plus tard, il <strong>de</strong>vint<br />
célèbre sous le nom <strong>de</strong> Humbaraci Ahmed Pacha. En 1734, une école<br />
appelée Hen<strong>de</strong>sehane fut fondée d<strong>ans</strong> le but d’entraîner le personnel<br />
militaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> division d’artillerie qui se montra très efficace lors <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
guerre avec <strong>la</strong> Russie et l’Autriche d<strong>ans</strong> les années 1736-1739. Mais<br />
l’école ne fit pas long feu et ferma ses portes en 1747 en raison <strong>de</strong> l’opposition<br />
<strong>de</strong>s janissaires. Il est vrai que les hommes d’Etat ottom<strong>ans</strong> y<br />
compris les sult<strong>ans</strong> ont opté pour <strong>de</strong>s réformes radicales <strong>de</strong> leur système<br />
militaire, options non suivies d’effet à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> défiance <strong>de</strong>s janissaires<br />
qui en arrivèrent au point d’assassiner les sult<strong>ans</strong>. Après <strong>la</strong> défaite<br />
ottomane contre <strong>la</strong> Russie lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> 1768-1774, Abdulhamid<br />
I er remit les réformes militaires à l’ordre du jour. Afin <strong>de</strong> rivaliser avec<br />
les puissances européennes, il fit appel à plusieurs étrangers comme<br />
conseillers <strong>de</strong> l’armée ottomane s<strong>ans</strong> tenir compte <strong>de</strong> leur confession ou<br />
<strong>de</strong> leur engagement pour <strong>la</strong> cause ottomane. L’un <strong>de</strong> ses réformateurs<br />
européens auquel il a été fait appel était le Baron <strong>de</strong> Tott, un officier<br />
français. Il réussit à construire une nouvelle fon<strong>de</strong>rie <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> mortiers et forma <strong>de</strong>s unités d’artillerie mobiles. Il fit édifier <strong>de</strong>s<br />
fortifications sur le Bosphore et dirigea <strong>la</strong> construction d’un nouveau<br />
chantier naval. Grâce à ses conseils et ses initiatives, les Ottom<strong>ans</strong> s’investirent<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> course à <strong>la</strong> science navale qui aboutit à <strong>la</strong> fondation<br />
en 1775 <strong>de</strong> l’école d’ingénierie navale, <strong>la</strong> Mühendishane-i Bahri Humayun.<br />
Durant le règne <strong>de</strong> Selim III, l’école <strong>de</strong> l’armée <strong>de</strong> terre, <strong>la</strong><br />
Mühendishane-i Berri Humayun, fut fondée en 1795 pour répondre<br />
au besoin d’entraînement <strong>de</strong>s officiers d’artillerie à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntale.<br />
Selim III était persuadé que l’établissement d’une armée mo<strong>de</strong>rne selon<br />
les critères occi<strong>de</strong>ntaux était le seul moyen pour l’Empire <strong>de</strong> regagner<br />
sa puissance d’antan. Après son accession au trône, il envoya Ebu Bekir<br />
Ratıb Efendi à Vienne en tant qu’ambassa<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Porte. Celui-ci<br />
était chargé <strong>de</strong> rédiger un rapport sur les puissances européennes, particulièrement<br />
sur <strong>la</strong> formation administrative et militaire <strong>de</strong> l’Autriche.<br />
Plus tard, il <strong>la</strong>nça un grand projet <strong>de</strong> réformes d<strong>ans</strong> les domaines <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
finance, du commerce, <strong>de</strong> l’administration et d<strong>ans</strong> le domaine militaire.<br />
On appe<strong>la</strong> cet ensemble <strong>de</strong> réformes Nizam-i Cedid (le Nouvel Ordre).<br />
La plus importante <strong>de</strong> ces réformes fut <strong>la</strong> création d’une nouvelle unité<br />
d’élite <strong>de</strong> l’infanterie, les nizam-i cedid (les nizamis). On leur donna <strong>de</strong>s<br />
uniformes à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> occi<strong>de</strong>ntale, <strong>de</strong>s armes à feu et <strong>de</strong> l’entraînement.<br />
Très vite ils se distinguèrent par leurs succès contre l’armée napoléo-
nienne à Acre (Akka) pendant l’expédition d’Egypte. Ce fut <strong>la</strong> preuve<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nécessité et <strong>de</strong> l’importance d’une nouvelle armée ottomane qui<br />
leur attira par ailleurs les faveurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion. Néanmoins, ce nouveau<br />
groupe mécontenta <strong>la</strong>rgement les janissaires <strong>de</strong>venus du coup une<br />
élite conservatrice usant <strong>de</strong> leur pouvoir militaire au profit <strong>de</strong> leurs intérêts<br />
commerciaux et politiques.<br />
Enhardi par ce succès, Selim III édita un ordre selon lequel les janissaires<br />
<strong>de</strong>vaient à l’avenir servir tous les <strong>ans</strong> d<strong>ans</strong> les Nizam-i Cedid.<br />
Là-<strong>de</strong>ssus, les janissaires et autres ennemis du progrès se manifestèrent<br />
à Edirne. Au regard <strong>de</strong> leur nombre, plus <strong>de</strong> 10.000, et <strong>la</strong> violence<br />
<strong>de</strong> leur opposition, décision fut prise <strong>de</strong> suspendre momentanément<br />
le mouvement <strong>de</strong>s réformes. Les janissaires fomentèrent une nouvelle<br />
insurrection et incitèrent le cheikh al is<strong>la</strong>m –<strong>la</strong> plus haute autorité sur<br />
les questions religieuses– à édicter une fatwa contre les réformes. Ils allèrent<br />
jusqu’à détrôner le sultan Selim III et l’emprisonner, et p<strong>la</strong>cèrent<br />
sur le trône son neveu Mustapha IV (1807-1808). Un an après, il fut<br />
remp<strong>la</strong>cé par Mahmud II (1808-1839). La même année, une loi martiale<br />
fut introduite par Alemdar Mustapha Pacha qui renoua toutefois<br />
avec les efforts <strong>de</strong> réforme. Sa première action fut <strong>de</strong> s’allier aux janissaires<br />
pour fragiliser le pouvoir <strong>de</strong>s gouverneurs <strong>de</strong> province. Ensuite, il<br />
s’en prit aux janissaires, les massacrant d<strong>ans</strong> leurs casernes à Istanbul et<br />
d<strong>ans</strong> les capitales provinciales en 1826. Le sultan Mahmud envisagea<br />
<strong>de</strong> se débarrasser <strong>de</strong>s janissaires et les remp<strong>la</strong>cer par d’autres troupes<br />
régulières appelées Asakir-i M<strong>ans</strong>ure-i Muhammediye. Il est à noter<br />
un fait révé<strong>la</strong>teur : par un aimable euphémisme, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ottomane<br />
désigna le massacre <strong>de</strong>s janissaires sous le nom <strong>de</strong> Vak’a-i Hayriyye,<br />
littéralement l’« heureux événement ».<br />
L’Empire ottoman au XIXème siècle<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> déployèrent une gran<strong>de</strong> énergie à défendre leur intégrité<br />
territoriale souvent mise en péril par les mouvements nationalistes<br />
instigués par les puissances européennes. Ils <strong>de</strong>vaient en même<br />
temps contenir les interventions européennes d<strong>ans</strong> les affaires internes<br />
<strong>de</strong> l’Empire. Pour répondre à ces <strong>de</strong>ux exigences, les Ottom<strong>ans</strong> s’investirent<br />
d<strong>ans</strong> une série <strong>de</strong> réformes d<strong>ans</strong> les domaines militaire, économique<br />
et bureaucratique pour mo<strong>de</strong>rniser <strong>la</strong> structure <strong>de</strong> l’Empire.<br />
Il reste que tout au long du XIXème siècle, l’Empire ottoman a connu<br />
<strong>de</strong>s crises majeures impliquant les gran<strong>de</strong>s puissances européennes qui<br />
ne manquaient pas <strong>de</strong> provoquer les sujets ottom<strong>ans</strong> contre <strong>la</strong> Porte.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
101
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
102<br />
Les implications du déclin du pouvoir ottoman, <strong>la</strong> vulnérabilité et l’attrait<br />
<strong>de</strong> ses vastes possessions, les velléités nationalistes parmi ses sujets<br />
et les crises périodiques que tous ces éléments et bien d’autres facteurs<br />
entraînaient, furent communément désignés par les diplomates européens<br />
au XIXème siècle du nom <strong>de</strong> « <strong>la</strong> question d’Orient ». En 1853,<br />
le Tsar Nico<strong>la</strong>s I er <strong>de</strong> Russie décrivit l’Empire ottoman d’« homme<br />
ma<strong>la</strong><strong>de</strong> » <strong>de</strong> l’Europe. La question qui se posait <strong>de</strong> <strong>la</strong> perspective <strong>de</strong>s<br />
diplomates européens était <strong>de</strong> savoir comment disposer <strong>de</strong> l’Empire <strong>de</strong><br />
façon à ne pas léser les intérêts d’une puissance aux dépens d’une autre<br />
et ne pas risquer <strong>de</strong> rompre l’équilibre politique <strong>de</strong> l’Europe.<br />
L’Empire ottoman entama le siècle avec une grave crise due à l’invasion<br />
<strong>de</strong> l’Egypte par Napoléon en 1798. Selim III, qui accordait une gran<strong>de</strong><br />
importance aux re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> France, une alliée <strong>de</strong> longue date, accéda<br />
au trône juste avant l’avènement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Révolution. Il entretenait<br />
même une correspondance avec Louis XVI et Napoléon Bonaparte.<br />
En fait, <strong>la</strong> Révolution ne suscita aucune réaction tant qu’elle était vue<br />
comme un problème propre à <strong>la</strong> France. D’ailleurs, les Ottom<strong>ans</strong> ne se<br />
préoccupaient guère <strong>de</strong>s autres Etats par manque <strong>de</strong> temps et <strong>de</strong>vant<br />
eux-mêmes surmonter leurs difficultés, en plus <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre qu’ils menaient<br />
sur <strong>de</strong>ux fronts simultanément contre l’Autriche et <strong>la</strong> Russie.<br />
La Porte n’a pas envisagé les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> Révolution sur son Empire<br />
multiethnique. L’Empire ottoman al<strong>la</strong>it <strong>de</strong>venir <strong>la</strong> proie <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
puissances dont les positions politiques pesaient comme une menace<br />
sur son existence. Et ce fut <strong>la</strong> stupeur pour les autorités ottomanes en<br />
apprenant que Napoléon avait envahi l’Egypte. La raison <strong>de</strong> l’insistance<br />
<strong>de</strong> Napoléon à conquérir l’Egypte n’est pas c<strong>la</strong>ire. Les objectifs<br />
apparents prétendaient vouloir reprendre le contrôle <strong>de</strong> l’Empire indien<br />
<strong>de</strong>s mains <strong>de</strong>s Britanniques. D<strong>ans</strong> ses mémoires, Napoléon ne<br />
donne qu’une seule raison, à savoir <strong>la</strong> ‘gloire’. Quelques fussent les motivations<br />
d’une telle invasion, ses conséquences mirent l’Empire d<strong>ans</strong><br />
une périlleuse situation. D’abord, il ne parvint à chasser les Français<br />
<strong>de</strong> l’Egypte qu’avec l’assistance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne<br />
qui avaient leurs propres vues sur <strong>la</strong> région. Les forces françaises se<br />
retirèrent et l’Egypte se tr<strong>ans</strong>forma en champ <strong>de</strong> bataille <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
puissances, l’autorité ottomane s’affaiblissait. Le vainqueur d<strong>ans</strong> ce qui<br />
fut effectivement une guerre civile était Méhémet Ali. C’était un commandant<br />
militaire ottoman, présent à <strong>la</strong> première bataille d’Aboukir en<br />
1799. Lorsque les armées <strong>de</strong> Napoléon eurent quitté l’Egypte, il y fut<br />
envoyé en tant que second commandant d’un contingent albanais pour<br />
apporter appui aux troupes ottomanes les plus professionnelles. Vers
1805, il était <strong>de</strong>venu le vrai commandant <strong>de</strong> l’Egypte et sa position fut<br />
reconnue par le sultan d’Istanbul. Il al<strong>la</strong>it régner sur l’Egypte près <strong>de</strong> 40<br />
<strong>ans</strong> et <strong>de</strong> manière quasi indépendante.<br />
Après avoir quitté l’Egypte, les Français et les Ottom<strong>ans</strong> retrouvèrent<br />
<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions ‘normalisées’, ce qui suscita l’irritation <strong>de</strong>s Russes et <strong>de</strong>s<br />
Britanniques. Ces <strong>de</strong>rniers expédièrent une flotte vers les Dardanelles<br />
pour intimi<strong>de</strong>r Istanbul alors que les Ottom<strong>ans</strong> étaient en guerre contre<br />
<strong>la</strong> Russie qui avait envahi en 1806 <strong>la</strong> Va<strong>la</strong>chie et Bogdan. La Porte chercha<br />
alors <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong>s Britanniques contre <strong>la</strong> Russie qui aboutit à<br />
<strong>la</strong> signature d’un accord en 1809. La secon<strong>de</strong> guerre russo-turque qui se<br />
prolongea jusqu’en 1812, s’acheva par le Traité <strong>de</strong> Bucarest conformément<br />
auquel les Ottom<strong>ans</strong> cédaient <strong>la</strong> Bessarabie à <strong>la</strong> Russie, et d’autres<br />
concessions étaient faites aux Serbes en pleine révolte.<br />
Mouvements nationalistes et rébellions<br />
Dès le début du XIXème siècle, l’empire ottoman était confronté à <strong>de</strong>ux<br />
problèmes: d’abord, il <strong>de</strong>vait parer aux attaques <strong>de</strong>s pouvoirs impérialistes<br />
sur son territoire; ensuite, faire face aux rébellions <strong>de</strong> ses sujets<br />
chrétiens entraînés par les effets <strong>de</strong>s mouvements nationalistes impulsés<br />
par <strong>la</strong> Révolution française. La première rébellion nationaliste que<br />
connut l’Empire eut lieu en Serbie en 1804. En réalité, <strong>la</strong> résistance <strong>de</strong>s<br />
groupes serbes qui s’étaient p<strong>la</strong>int <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong>s janissaires et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
pression exercée par les notables provinciaux (Ayan) revêtit un caractère<br />
national à cause <strong>de</strong>s mauvaises pratiques <strong>de</strong>s autorités ottomanes.<br />
Etant donné les affinités d’ordre religieux et culturel avec les Serbes, <strong>la</strong><br />
Russie leur apporta son appui. Du coup, pour éviter toute provocation<br />
à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie, les Ottom<strong>ans</strong> durent accor<strong>de</strong>r son autonomie<br />
à <strong>la</strong> Serbie en 1816.<br />
Néanmoins, les mouvements serbes éveillèrent les velléités <strong>de</strong> révolte<br />
<strong>de</strong>s Grecs. La Filiki Eterya (<strong>la</strong> Société Amicale) fut fondée en 1814<br />
et avait pour objectif <strong>de</strong> chasser le gouvernement ottoman <strong>de</strong> Grèce et<br />
établir un Etat grec indépendant. Durant les premiers mois <strong>de</strong> l’année<br />
1821, <strong>la</strong> Société comptait environ 1000 membres, parmi lesquels se<br />
trouvaient <strong>de</strong>s commerçants, <strong>de</strong>s membres du clergé, <strong>de</strong>s fonctionnaires<br />
<strong>de</strong> l’Empire originaires <strong>de</strong> Phanar, et bien d’autres. L’Empire fut pris au<br />
dépourvu quand en 1821 <strong>la</strong> révolte grecque éc<strong>la</strong>ta en Morée et s’étendit<br />
en peu <strong>de</strong> temps à travers <strong>la</strong> Grèce centrale et les régions du sud. Le sultan<br />
Mahmud sollicita l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> son gouverneur d’Egypte. Méhémet Ali<br />
Pacha accepta d’envoyer son armée en Grèce en échange <strong>de</strong> <strong>la</strong> Crète et<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
103
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
104<br />
du Péloponnèse, le sultan dut accé<strong>de</strong>r à sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Lorsque <strong>la</strong> révolte<br />
fut sur le point d’être maîtrisée grâce à l’ai<strong>de</strong> égyptienne, les puissances<br />
européennes intervinrent en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grèce.<br />
Ainsi, <strong>la</strong> guerre d’indépendance grecque fut <strong>la</strong> première crise du siècle<br />
qui mena à l’intervention européenne. Le 20 octobre 1827, <strong>la</strong> flotte<br />
franco-russo-britannique, à l’initiative <strong>de</strong>s chefs locaux mais tacitement<br />
avec l’accord <strong>de</strong> leurs gouvernements respectifs, attaqua et détruisit <strong>la</strong><br />
flotte ottomane, y compris <strong>la</strong> flotte égyptienne, à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Navarin,<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> baie <strong>de</strong> Navarin à l’ouest du Péloponnèse. Ce fut un moment<br />
décisif d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre d’indépendance. Alors que <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne restèrent silencieuses, <strong>la</strong> Russie s’empara une nouvelle fois <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Va<strong>la</strong>chie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Moldavie, et les troupes russes pénétrèrent aussi loin<br />
qu’Edirne et d<strong>ans</strong> les régions est <strong>de</strong> l’Anatolie. La guerre se conclut par<br />
<strong>la</strong> paix d’Edirne en 1829. Les marchands russes acquirent le droit <strong>de</strong><br />
passer librement à travers les Dardanelles, en contrepartie, <strong>la</strong> Russie<br />
céda les territoires conquis et l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grèce fut confirmée.<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> durent accepter l’établissement d’un Empire grec indépendant.<br />
Cet événement marqua le début du morcellement progressif<br />
<strong>de</strong> l’Empire ottoman, tandis que les autres popu<strong>la</strong>tions non turques <strong>de</strong><br />
l’Empire amorçaient leurs propres mouvements d’indépendance.<br />
La question égyptienne<br />
Méhémet Ali mit sur pied une armée et une marine mo<strong>de</strong>rnes en<br />
Egypte avec l’assistance <strong>de</strong> <strong>la</strong> France désireuse <strong>de</strong> contrer l’influence<br />
britannique en Méditerranée orientale. N’ayant pas été récompensé<br />
comme promis pour son assistance durant <strong>la</strong> révolte grecque, il envahit<br />
en 1831 <strong>la</strong> Syrie et poursuivit l’armée ottomane qui battait en retraite<br />
jusqu’au cœur <strong>de</strong> l’Anatolie. Désespérée, <strong>la</strong> Porte, fit appel à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Russes. C’est alors que <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne s’entremit forçant Méhémet<br />
Ali à retirer ses troupes d’Anatolie vers <strong>la</strong> Syrie. Le prix que dut payer<br />
le sultan à <strong>la</strong> Russie est compris d<strong>ans</strong> le Traité <strong>de</strong> Hunkar Iskelesi <strong>de</strong><br />
1833 qui stipu<strong>la</strong>it, à <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Russes, que le Bosphore et les<br />
détroits <strong>de</strong>s Dardanelles <strong>de</strong>vaient être fermés aux navires <strong>de</strong>s autres<br />
gran<strong>de</strong>s puissances.<br />
Il est intéressant <strong>de</strong> noter ici le fait que <strong>la</strong> Porte fit appel à l’ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Russie contre <strong>la</strong> révolte <strong>de</strong> son propre gouverneur. Par conséquent, les<br />
puissances européennes furent encouragées à intervenir d<strong>ans</strong> les affaires<br />
internes <strong>de</strong> l’Empire ottoman. La France et <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne, inquiètes<br />
<strong>de</strong> voir <strong>la</strong> Russie gagner <strong>la</strong> Porte, déc<strong>la</strong>rèrent qu’ils n’acceptaient
aucune modification du statu quo sur les détroits turcs –le Bosphore<br />
et les Dardanelles. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> question égyptienne, vint s’ajouter<br />
<strong>la</strong> question <strong>de</strong>s détroits. Ainsi, à <strong>la</strong> reprise <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre avec Méhémet<br />
Ali en 1839, les cinq puissances européennes menées par <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne préoccupée par l’exp<strong>ans</strong>ion russe, soumirent un mémorandum<br />
à <strong>la</strong> Porte afin <strong>de</strong> trouver un accord avec l’Egypte. C’est ainsi qu’un<br />
problème interne à l’Empire <strong>de</strong>vint une affaire internationale. Après <strong>la</strong><br />
nouvelle défaite <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> face à Méhémet Ali, ils signèrent avec<br />
<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne l’accord dit <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Balta Liman qui<br />
profita <strong>la</strong>rgement à cette <strong>de</strong>rnière sur les pl<strong>ans</strong> économiques et politiques<br />
en échange <strong>de</strong> son assistance à <strong>la</strong> Porte.<br />
Suite à <strong>la</strong> convention <strong>de</strong> Londres <strong>de</strong> 1840, Méhémet Ali fut obligé<br />
<strong>de</strong> renoncer à ses prétentions sur <strong>la</strong> Syrie, mais fut confirmé comme<br />
gouvernant héréditaire <strong>de</strong> l’Egypte sous l’autorité nominale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Porte.<br />
Selon un nouveau protocole datant <strong>de</strong> 1841, <strong>la</strong> Porte décida <strong>de</strong> fermer<br />
les détroits à tous les navires <strong>de</strong> guerre d’une quelconque puissance.<br />
Mahmud II et les réformes civiles<br />
Durant son sultanat, Mahmud II entreprit <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s réformes malgré<br />
les difficultés intérieures et extérieures auxquelles faisait face l’Empire.<br />
Il commença par supprimer les janissaires en 1826 qu’il considérait<br />
comme un obstacle à <strong>la</strong> mise en oeuvre <strong>de</strong>s réformes nécessaires. Il<br />
établit également les fondations d’institutions mo<strong>de</strong>rnes pour l’Empire<br />
ottoman. A cet effet, il envoya <strong>de</strong>s étudiants en Europe s’entraîner à<br />
l’art militaire mo<strong>de</strong>rne. Après avoir créé <strong>de</strong>s écoles militaires et <strong>de</strong> mé<strong>de</strong>cine,<br />
il fit venir <strong>de</strong>s instructeurs et <strong>de</strong>s spécialistes <strong>de</strong> l’Europe afin<br />
d’améliorer le niveau éducatif. A l’exception <strong>de</strong> <strong>la</strong> brève pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Ère<br />
<strong>de</strong>s Tulipes, ce fut une première d<strong>ans</strong> l’histoire ottomane que <strong>de</strong> voir<br />
fleurir les influences occi<strong>de</strong>ntales d<strong>ans</strong> les arts et <strong>la</strong> culture ottom<strong>ans</strong>.<br />
Les uniformes <strong>de</strong>s officiers et <strong>de</strong>s fonctionnaires administratifs se mirent<br />
à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> européenne. Le Divan se tr<strong>ans</strong>forma en système <strong>de</strong> cabinet.<br />
Suivant une série d’autres mesures importantes, l’administration<br />
fut simplifiée et renforcée. Un grand nombre <strong>de</strong> fonctions inefficaces<br />
furent abolies et le sultan donna l’exemple parfait d’un bon sens économique<br />
en réorganisant <strong>la</strong> maison impériale et fut impitoyable quand il<br />
décida <strong>de</strong> supprimer tous les titres ne correspondant pas à <strong>de</strong>s responsabilités<br />
et tous les sa<strong>la</strong>ires <strong>de</strong>s officiels n’ayant pas <strong>de</strong> fonction.<br />
Les réformes <strong>de</strong> Mahmud II étaient vues par les historiens ottom<strong>ans</strong><br />
comme un projet <strong>de</strong> changement <strong>de</strong> civilisation. De leur côté, les his-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
105
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
106<br />
toriens européens le comparèrent à Pierre le Grand <strong>de</strong> Russie qui en<br />
son temps avait mené <strong>de</strong>s réformes radicales et donnèrent au sultan le<br />
nom <strong>de</strong> ‘Pierre le Grand <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>’. De l’avis <strong>de</strong> certains historiens<br />
turcs, Mahmud II fut l’un <strong>de</strong>s plus imminents sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong> après<br />
Soliman le Magnifique, car ses réformes préparèrent <strong>la</strong> voie qui al<strong>la</strong>it<br />
mener à <strong>la</strong> République turque.<br />
L’ère <strong>de</strong>s Tanzimat (1839-1876)<br />
Les Tanzimat –signifiant littéralement ‘réorganisations’– furent une ère<br />
<strong>de</strong> réformes commencées en 1839 avec <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation par le sultan<br />
Abdulmedjid Ier (1839-1861) d’un édit appelé le Tanzimat Firman. Il<br />
fut é<strong>la</strong>boré par Mustapha Rachid Pacha, un sympathisant <strong>de</strong>s Britanniques,<br />
et soumis au sultan Mahmud qui mourut quelque temps après,<br />
et ce fut au nouveau sultan <strong>de</strong> l’approuver. Les Tanzimat consolidèrent<br />
et renforcèrent les réformes initiées sous le règne <strong>de</strong> Mahmud II. Ils<br />
garantirent en outre aux sujets ottom<strong>ans</strong> <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> leur vie, <strong>de</strong> leur<br />
dignité et <strong>de</strong> leurs biens, ainsi que l’égalité <strong>de</strong>vant l’impôt, le droit <strong>de</strong><br />
propriété à tout le mon<strong>de</strong> et l’établissement <strong>de</strong> tribunaux en charge <strong>de</strong><br />
défendre ces acquis.<br />
Il semblerait que le but recherché par ces réformes était <strong>de</strong> s’assurer du<br />
soutien occi<strong>de</strong>ntal face aux menaces tant externes qu’internes –comme<br />
ce fut le cas avec Méhémet Ali. Néanmoins, il ne faudrait pas omettre<br />
le fait que le Tanzimat Firman avait déjà reconnu <strong>la</strong> nécessité <strong>de</strong>s réformes<br />
bien avant les Tanzimat. Les Ottom<strong>ans</strong> cherchaient d’abord à<br />
prévenir le démembrement <strong>de</strong> l’Empire. Par <strong>la</strong> suite, les réformes visèrent<br />
à encourager l’ottomanisme parmi les nations séparatistes et empêcher<br />
<strong>la</strong> progression <strong>de</strong>s mouvements nationalistes au sein <strong>de</strong> l’Empire.<br />
Ces tentatives n’aboutirent pas en dépit <strong>de</strong>s efforts faits pour intégrer<br />
complètement les non musulm<strong>ans</strong> et les non turcs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> société ottomane<br />
avec <strong>de</strong> nouvelles lois et <strong>de</strong>s réformes.<br />
Les puissances européennes essayèrent <strong>de</strong> tirer avantage <strong>de</strong>s Tanzimat<br />
à leurs fins propres. En effet, les Tanzimat leur offraient l’opportunité<br />
d’interférer d<strong>ans</strong> les affaires <strong>de</strong> l’Empire ottoman. Elles revendiquèrent<br />
que les droits <strong>de</strong>s sujets chrétiens <strong>de</strong> l’Empire ottoman soient é<strong>la</strong>rgis.<br />
Ces sujets chrétiens pouvaient alors servir à fragiliser l’Empire au profit<br />
<strong>de</strong>s puissances européennes selon qui ces chrétiens <strong>de</strong> l’Empire ottoman<br />
ne jouissaient pas <strong>de</strong> suffisamment <strong>de</strong> liberté et les Tanzimat<br />
n’avaient pas satisfait leurs <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s. La pression constante imposée<br />
aux Ottom<strong>ans</strong> par ces puissances, obligea <strong>la</strong> Porte à introduire en 1856
<strong>de</strong>s droits nouveaux pour les sujets non musulm<strong>ans</strong> avec <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation<br />
du rescrit impérial (le Hatt-ı Humayun) : <strong>la</strong> taxe <strong>de</strong> capitation qui<br />
imposait <strong>de</strong>s tarifs plus élevés sur les non musulm<strong>ans</strong> fut abolie, garantissant<br />
ainsi l’égalité entre tous les sujets ottom<strong>ans</strong> ; les non musulm<strong>ans</strong><br />
eurent en plus le droit d’accé<strong>de</strong>r aux fonctions militaires et <strong>de</strong> nouvelles<br />
dispositions furent introduites pour une meilleur administration <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> l’Etat et pour le développement du commerce. Mais non<br />
contentes <strong>de</strong> ces mesures, les puissances européennes maintinrent leur<br />
pression sur l’Empire ottoman jusqu’à son effondrement.<br />
Le Royaume-Uni n’eut <strong>de</strong> cesse <strong>de</strong> s’ingérer d<strong>ans</strong> les affaires internes<br />
et <strong>la</strong> politique étrangère <strong>de</strong> l’Empire. Depuis le Traité <strong>de</strong> Balta Liman<br />
et son rôle d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong>s Tanzimat, sa position auprès <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Porte s’était renforcée. De leur côté, les hommes d’Etat ottom<strong>ans</strong> et<br />
particulièrement Mustapha Rachid Pacha, pensaient que l’Etat ottoman<br />
ne pouvait être en sécurité sauf à repousser <strong>la</strong> menace russe, raison<br />
pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> Porte s’allia aux Français et aux Ang<strong>la</strong>is. Ce mauvais<br />
calcul tomba à un moment où <strong>la</strong> Russie posait une série <strong>de</strong> revendications<br />
difficilement acceptables pour <strong>la</strong> Porte et entraîna une guerre<br />
majeure connue sous le nom <strong>de</strong> guerre <strong>de</strong> Crimée (1854-1856). Alors<br />
que l’Empire était tout à ses réformes, les gran<strong>de</strong>s puissances, excepté<br />
<strong>la</strong> Russie, luttaient contre les révoltes <strong>de</strong> 1830 et 1848 qui visaient à<br />
tr<strong>ans</strong>former l’ordre social européen et à établir <strong>de</strong>s frontières nettes aux<br />
Etats <strong>de</strong> l’Europe. Profitant <strong>de</strong> ces désordres en Europe, <strong>la</strong> Russie désirait<br />
manœuvrer <strong>la</strong> question d’Orient à son avantage. Ce qui l’intéressait<br />
en premier lieu c’était d’acquérir <strong>de</strong> nouveaux territoires. Tout au long<br />
<strong>de</strong>s XVIIème et XVIIIème siècles, elle était parvenue à annexer les<br />
Etats musulm<strong>ans</strong> <strong>de</strong> l’Asie centrale. Vers 1854, elle se trouvait sur les<br />
côtes <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire. Soucieux <strong>de</strong> conquérir <strong>de</strong>s territoires en Europe<br />
<strong>de</strong> l’est, les Russes entrèrent en guerre avec les Ottom<strong>ans</strong> sous <strong>de</strong> spécieux<br />
et dérisoires prétextes : les Ottom<strong>ans</strong> auraient garanti à <strong>la</strong> France<br />
catholique plutôt qu’à <strong>la</strong> Russie orthodoxe le droit <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s<br />
chrétiens <strong>de</strong>s Lieux Saints qui étaient sous contrôle ottoman. Cette<br />
raison justifiait l’entrée en guerre contre les Ottom<strong>ans</strong>. L’alliance entre<br />
l’Empire ottoman, <strong>la</strong> France et le Royaume-Uni ne tarda pas à se former<br />
contre <strong>la</strong> Russie. Les trois années que dura <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> Crimée se<br />
conclurent par le Traité <strong>de</strong> Paris en 1856 : <strong>la</strong> Russie abandonnait ses<br />
prétentions à un protectorat sur les chrétiens <strong>de</strong> l’Empire ottoman <strong>de</strong><br />
rite orthodoxe et renonçait au droit d’intervenir d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. En<br />
outre, le tsar et le sultan conclurent à un arrangement selon lequel il ne<br />
<strong>de</strong>vait pas être établi d’arsenaux militaires ou navals d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Mer Noire.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
107
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
108<br />
Les c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong> cet arrangement tournèrent à l’immense désavantage <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Russie réduisant ainsi toute menace navale sur les Turcs. Et au-<strong>de</strong>là,<br />
toutes les gran<strong>de</strong>s puissances s’engagèrent à respecter l’indépendance<br />
et l’intégrité territoriale <strong>de</strong> l’empire ottoman. Mais très vite tout ce<strong>la</strong><br />
s’avéra être <strong>de</strong>s paroles creuses.<br />
Le Traité <strong>de</strong> Paris resta en vigueur jusqu’en 1871 lorsque <strong>la</strong> France fut<br />
écrasée par les Etats germaniques pendant <strong>la</strong> guerre franco-prussienne.<br />
Après que <strong>la</strong> Prusse et <strong>de</strong> nombreux autres Etats germaniques s’unirent<br />
pour former le puissant Empire germanique, l’empereur <strong>de</strong> France,<br />
Napoléon III, fut déposé à <strong>la</strong> proc<strong>la</strong>mation <strong>de</strong> <strong>la</strong> troisième République.<br />
Et tandis que l’équilibre du pouvoir penchait avec l’émergence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
nouveaux Etats puissants en Europe, l’Italie et l’Allemagne, <strong>la</strong> Russie<br />
s’empressa <strong>de</strong> dénoncer les termes du Traité <strong>de</strong> Paris concernant particulièrement<br />
<strong>la</strong> présence navale en Mer Noire, et décida <strong>de</strong> régler <strong>la</strong><br />
question balkanique en sa faveur.<br />
Les difficultés auxquelles <strong>de</strong>vait faire face l’Empire après <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong><br />
Crimée étaient le signe <strong>de</strong> l’approche <strong>de</strong> sa fin. Et quand bien même<br />
l’Empire ne fut pas <strong>de</strong> nouveau en guerre jusqu’en 1877, les révoltes et<br />
les conflits violents d<strong>ans</strong> ses différentes parties, ainsi que les lour<strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ttes qui entraînèrent <strong>la</strong> faillite <strong>de</strong> l’économie impériale, le mirent au<br />
bord <strong>de</strong> l’effondrement. Les conflits entre communautés musulmanes<br />
et chrétiennes à Djedda en 1858 et au Liban en 1860-1861, fomentés<br />
par les Français et les Britanniques, conduisirent à l’immixtion étrangère<br />
avec l’établissement d’une administration privilégiée d<strong>ans</strong> ces régions.<br />
La Va<strong>la</strong>chie et Bogdan s’unirent pour former <strong>la</strong> principauté <strong>de</strong><br />
Roumanie en 1861, et <strong>la</strong> révolte <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong> Crète soutenue par <strong>la</strong> Grèce<br />
marqua le début <strong>de</strong> son détachement <strong>de</strong> l’Empire ottoman. De son<br />
côté, <strong>la</strong> Russie initia une politique fondée sur le p<strong>ans</strong><strong>la</strong>visme appe<strong>la</strong>nt<br />
<strong>la</strong> solidarité <strong>de</strong> tous les S<strong>la</strong>ves et les nations orthodoxes à se joindre<br />
sous l’autorité russe. Du coup, <strong>de</strong>s rébellions éc<strong>la</strong>tèrent, d’abord en<br />
Herzégovine en 1875, puis en Bulgarie en 1876, et ce fut au tour <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Serbie et du Monténégro <strong>de</strong> déc<strong>la</strong>rer <strong>la</strong> guerre. La riposte ottomane<br />
à ces révoltes en Bulgarie fit l’objet <strong>de</strong> propagan<strong>de</strong> en Europe sous le<br />
terme d’« atrocités turques » qui créa un sentiment anti-turc parmi <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion britannique servant du même coup les <strong>de</strong>sseins <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie.<br />
La première Constitution monarchique (1876-1908)<br />
La popu<strong>la</strong>tion turque était exaspérée par les tueries et l’expulsion <strong>de</strong><br />
nombreux Turcs <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> durant les révoltes nationalistes. Au milieu<br />
<strong>de</strong> ces événements, le sultan Abdu<strong>la</strong>ziz (1861-1876) fut déposé
par ses ministres le 30 mai et remp<strong>la</strong>cé par Murad V qui fut à son tour<br />
détrôné après seulement 3 mois <strong>de</strong> règne à cause <strong>de</strong> sa ma<strong>la</strong>die mentale.<br />
En accédant au trône, Abdülhamid II (1876-1909) promit l’établissement<br />
d’une constitution. Il fut le <strong>de</strong>rnier sultan ottoman à régner<br />
s<strong>ans</strong> être inquiété par un pouvoir contestataire. Et malgré sa déposition<br />
après <strong>la</strong> révolution Jeunes Turcs <strong>de</strong> 1908, d’aucuns lui reconnaissent le<br />
fait d’avoir retardé <strong>de</strong> quelques décennies l’effondrement <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman. Il gouverna l’Empire avec autoritarisme et <strong>de</strong>s manœuvres<br />
diplomatiques habiles jouant sur un pouvoir européen contre un autre.<br />
Alors que les tensions d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong> s’intensifiaient, les gran<strong>de</strong>s<br />
puissances tinrent une conférence à Istanbul pour discuter du statut<br />
d’autonomie à donner à <strong>la</strong> Bosnie-herzégovine et à <strong>la</strong> Bulgarie. Pour<br />
déjouer les effets <strong>de</strong> <strong>la</strong> Conférence, Abdülhamid proc<strong>la</strong>ma <strong>la</strong> constitution<br />
qui fut immédiatement rejetée comme insignifiante par les puissances<br />
présentes à <strong>la</strong> conférence. La Russie se préparait à <strong>la</strong> mobilisation<br />
pour <strong>la</strong> guerre qui fut déc<strong>la</strong>rée le 24 avril 1877. Au début <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
guerre, <strong>la</strong> Russie détruisit tous les navires bordant le long du Danube,<br />
puis marchèrent sur <strong>la</strong> Bulgarie. En atteignant Pleven, Osman Pacha<br />
organisa une défense exemp<strong>la</strong>ire et repoussa <strong>de</strong>ux attaques russes qui<br />
firent subir <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s pertes aux Russes. Mais <strong>la</strong> défense héroïque<br />
<strong>de</strong> Pleven échoua et incita les Russes à marcher contre Istanbul. Et<br />
bien que les Russes aient accepté <strong>la</strong> trêve proposée par les Turcs en<br />
janvier 1878, ils poursuivirent leur avancée vers Istanbul. En chemin,<br />
ils tuèrent <strong>de</strong>s milliers d’enfants, <strong>de</strong> femmes et <strong>de</strong> vieux parmi <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
turque avec <strong>la</strong> complicité <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s bulgares. Suite à ces atrocités,<br />
plusieurs popu<strong>la</strong>tions turques migrèrent <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> vers Istanbul<br />
et l’Anatolie. La Russie accepta finalement un accord avec <strong>la</strong> Traité<br />
<strong>de</strong> San Stefano (Ayastefanos) le 3 mars 1878. Selon les c<strong>la</strong>uses <strong>de</strong><br />
ce traité, l’Empire ottoman <strong>de</strong>vait reconnaître l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Roumanie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Serbie et du Monténégro, ainsi que l’autonomie <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Bulgarie. A<strong>la</strong>rmés par l’exp<strong>ans</strong>ion du pouvoir russe d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>,<br />
les puissances européennes exigèrent plus tard certaines modifications<br />
du traité au congrès <strong>de</strong> Berlin, entre autres le partage <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bulgarie<br />
comme prévu par les accords antérieurs entre les gran<strong>de</strong>s puissances,<br />
pour empêcher <strong>la</strong> création d’un nouvel Etat s<strong>la</strong>ve é<strong>la</strong>rgi. Les parties<br />
nord et est <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bulgarie donnèrent naissance à <strong>de</strong>s principautés séparées<br />
avec à leur tête <strong>de</strong>s gouverneurs différents comme ce<strong>la</strong> était le<br />
cas par le passé (<strong>la</strong> principauté <strong>de</strong> Bulgarie et <strong>la</strong> Roumélie <strong>de</strong> l’est). Le<br />
congrès <strong>de</strong> Berlin ramena <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Macédoine, qui selon le Traité <strong>de</strong><br />
San Stefano faisait partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bulgarie, sous l’administration directe<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
109
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
110<br />
<strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>, et suggéra une série <strong>de</strong> réformes en faveur <strong>de</strong>s sujets<br />
arméniens <strong>de</strong> l’Empire ottoman.<br />
Avec le Traité <strong>de</strong> Berlin, les gran<strong>de</strong>s puissances réalisèrent que l’Empire<br />
ottoman était faible au point <strong>de</strong> ne pouvoir résister aux mouvements<br />
d’indépendance qui se multipliaient à l’intérieur <strong>de</strong> ses frontières. Les<br />
gran<strong>de</strong>s puissances cessèrent alors <strong>de</strong> considérer l’intégrité territoriale<br />
<strong>de</strong> l’Empire : <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne s’établit à chypre en 1878 et en 1882<br />
occupa l’Egypte pour un temps ; <strong>de</strong> son côté, <strong>la</strong> France soumit son protectorat<br />
à <strong>la</strong> Tunisie en 1881 ; <strong>la</strong> Roumélie <strong>de</strong> l’est s’unit à <strong>la</strong> Bulgarie en<br />
1885. La révolte en Crète provoquée par <strong>la</strong> Grèce entraîna une guerre<br />
avec cette <strong>de</strong>rnière dont les Turcs sortirent victorieux en 1897, mais une<br />
administration autonome y fut établie par suite <strong>de</strong> l’intervention <strong>de</strong>s<br />
Britanniques et <strong>de</strong>s Russes.<br />
Hormis les pertes subies, les embarras financiers qu’éprouvaient l’Empire<br />
forcèrent le sultan Abdulhamid II à consentir à une tutelle étrangère<br />
sur les <strong>de</strong>ttes <strong>de</strong> l’Etat. Par un décret impérial issu en décembre<br />
1881, une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong> l’Empire était dorénavant perçue<br />
par l’organisme <strong>de</strong> l’Administration <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dette Publique Ottomane<br />
majoritairement au profit <strong>de</strong>s obligataires étrangers. Face à <strong>la</strong><br />
Triple-Entente regroupant <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne, <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> Russie<br />
qui firent cause commune contre l’Empire ottoman après le Traité <strong>de</strong><br />
Berlin, le sultan Abdulhamid se approcha <strong>de</strong> l’Empire allemand d<strong>ans</strong><br />
l’espoir d’y trouver un allié potentiel. L’empereur Guil<strong>la</strong>ume II fut <strong>de</strong>ux<br />
fois reçu à Istanbul par Abdulhamid II, une première fois le 21 octobre<br />
1889, et une secon<strong>de</strong> fois neuf <strong>ans</strong> plus tard le 5 octobre 1898. Des<br />
officiers allemands tels le Baron von <strong>de</strong>r Goltz furent employés pour<br />
superviser <strong>la</strong> réorganisation <strong>de</strong> l’armée ottomane, ainsi que <strong>de</strong>s fonctionnaires<br />
gouvernementaux chargés <strong>de</strong> <strong>la</strong> mission <strong>de</strong> réorganisation<br />
<strong>de</strong>s finances <strong>de</strong> l’Empire ottoman. En 1899, <strong>la</strong> concession tant convoitée<br />
du Chemin <strong>de</strong> fer <strong>de</strong> Bagdad fut accordée aux Allemands. C’était<br />
l’un <strong>de</strong>s aspects <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique étrangère d’Abdulhamid que <strong>de</strong> jouer<br />
une puissance contre une autre. L’ambition <strong>de</strong> l’Empereur germanique<br />
d’étendre sa présence au Moyen-Orient impliqua une influence croissante<br />
auprès <strong>de</strong> <strong>la</strong> Porte.<br />
L’émergence <strong>de</strong> <strong>la</strong> question arménienne<br />
Le Traité <strong>de</strong> Berlin souleva à <strong>la</strong> table <strong>de</strong>s discussions <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s puissances<br />
<strong>la</strong> question arménienne. Le fait qu’elle pouvait conduire à l’éc<strong>la</strong>tement<br />
<strong>de</strong>s territoires ottom<strong>ans</strong> d’Anatolie en fit une affaire <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
importance pour <strong>la</strong> Russie et <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne qui avaient toutes
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s visées concurrentes sur le Moyen-Orient. D’un côté, <strong>la</strong> Russie<br />
sollicitait <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration <strong>de</strong>s Arméniens pour atteindre <strong>la</strong> Méditerranée<br />
orientale et <strong>la</strong> Mésopotamie. De son côté, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne<br />
avait besoin <strong>de</strong>s Arméniens afin <strong>de</strong> prévenir l’exp<strong>ans</strong>ion <strong>de</strong>s Russes vers<br />
le sud. Ainsi, <strong>la</strong> question arménienne apparut au moment où les Arméniens<br />
commencèrent à fomenter <strong>de</strong>s actions terroristes d<strong>ans</strong> l’est <strong>de</strong><br />
l’Anatolie sous les incitations <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne.<br />
Ces provocations invoquaient le prétexte <strong>de</strong>s réformes suggérées par le<br />
Traité <strong>de</strong> Berlin.<br />
Depuis longtemps, les communautés arméniennes, musulmanes et<br />
turques <strong>de</strong> l’Empire ottoman vivaient paisiblement jusqu’à l’implication<br />
<strong>de</strong>s pouvoirs impérialistes d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région et les intérêts qu’ils y<br />
manifestèrent. Avec l’intervention <strong>de</strong> ces pouvoirs, une multitu<strong>de</strong> d’organisations<br />
politiques et sociales arméniennes vit le jour.<br />
En effet, dès le début <strong>de</strong>s années 1860, <strong>de</strong>s organisations arméniennes<br />
locales furent créées à Adana, à Van et à Muş. En 1880, toutes ces organisations<br />
s’unifièrent pour former les Organisations arméniennes unies<br />
et <strong>la</strong> même année furent établies <strong>de</strong> nouvelles organisations révolutionnaires<br />
arméniennes telles que <strong>la</strong> Croix Noire, les Sociétés arméniennes<br />
à Van et les Gar<strong>de</strong>s Nationales à Erzurum.<br />
Réalisant qu’ils pouvaient être plus influents en étant à l’étranger grâce<br />
au soutien actif et direct <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s puissances, les nationalistes arméniens<br />
décidèrent <strong>de</strong> baser leurs organisations en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s territoires<br />
ottom<strong>ans</strong>. Le Parti Hentchak fut alors établi à Genève en 1887 et le<br />
Parti Dachnak à Tbilissi en 1890. Ils déc<strong>la</strong>rèrent que leur objectif premier<br />
était <strong>de</strong> « libérer les territoires <strong>de</strong> l’est anatolien et les Arméniens<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> domination ottomane ». Les émeutes débutèrent juste après <strong>la</strong><br />
création <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux institutions politiques actives.<br />
Vingt années durant, <strong>de</strong> 1889 à 1909, une quarantaine d’émeutes et<br />
d’actions terroristes eurent lieu et entraînèrent plusieurs épiso<strong>de</strong>s violents.<br />
En 1905 un attentat fut perpétré contre le sultan Abdulhamid<br />
qui y échappa par chance. Très souvent, les mesures prises par <strong>la</strong> Porte<br />
provoquèrent l’immixtion <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s puissances. La question arménienne<br />
prit une tournure pus dangereuse durant <strong>la</strong> première guerre<br />
mondiale.<br />
La restauration <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution en 1908<br />
Quand le sultan Abdulhamid décida <strong>de</strong> suspendre <strong>la</strong> Constitution en<br />
mai 1878, une opposition vit le jour contre lui et al<strong>la</strong>it prendre <strong>de</strong> l’am-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
111
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
112<br />
pleur durant <strong>la</strong> première déca<strong>de</strong> du XXème siècle. Cette opposition<br />
violente se manifesta surtout à travers le Comité Union et Progrès,<br />
CUP (Ittihad ve Terakki Cemiyeti). Le CUP était l’une <strong>de</strong>s organisations<br />
Jeunes Turcs ( Jöntürkler) qui réc<strong>la</strong>maient le retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> constitution<br />
et du parlementarisme. Il était très popu<strong>la</strong>ire parmi les officiers<br />
<strong>de</strong> l’armée dont <strong>la</strong> participation rendait le mouvement plus fort et plus<br />
actif. Les opposants exilés à l’étranger commencèrent à retourner d<strong>ans</strong><br />
l’Empire ottoman. Vers le milieu <strong>de</strong> l’année 1908, <strong>la</strong> branche du CUP<br />
présente à Thessalonique fomenta une révolte en réponse à <strong>la</strong> crise venue<br />
<strong>de</strong> Macédoine. Ils pensaient que le seul moyen <strong>de</strong> prévenir le détachement<br />
<strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> <strong>de</strong> l’Empire ottoman était <strong>de</strong> leur apporter les<br />
réformes nécessaires. Le CUP exigea le retour <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution, et <strong>la</strong><br />
tentative du sultan <strong>de</strong> mater <strong>la</strong> révolte échoua en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>rité<br />
du mouvement parmi les troupes elles-mêmes. Face à l’envergure<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> rébellion, le sultan dut se résigner à restaurer <strong>la</strong> Constitution le<br />
23 juillet 1908. Le 13 avril 1909, une contre révolte éc<strong>la</strong>ta à Istanbul<br />
contre <strong>la</strong> monarchie constitutionnelle. Elle fut matée par le Mouvement<br />
Armé (Haraket Ordusu). Abdulhamid fut accusé <strong>de</strong> soutenir <strong>la</strong><br />
contre révolte et fut déposé. Son frère Mehmed Rechad (Mehmed VI)<br />
lui succéda. Ce sultan se maintint au pouvoir <strong>de</strong> 1909 à 1918 mais fut<br />
en fait un sultan incompétent. Après <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution,<br />
le CUP <strong>de</strong>vint un parti politique très influent avec une majorité au<br />
Parlement <strong>de</strong> 1908 à 1913. Toutefois, les élections parlementaires n’ont<br />
pas bouleversé <strong>la</strong> configuration du gouvernement ottoman toujours dominé<br />
par les personnalités non partisanes <strong>de</strong> <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> prérévolutionnaire<br />
qui <strong>de</strong>vinrent <strong>la</strong> cible du CUP. Le 23 janvier 1913, le CUP prit<br />
le pouvoir par un coup d’Etat connu sous le nom <strong>de</strong> Bab-ı Ali Baskını<br />
et ses lea<strong>de</strong>rs, Enver Pacha, Djemal Pacha et Ta<strong>la</strong>at Pacha, restèrent au<br />
pouvoir jusqu’aux <strong>de</strong>rnières années <strong>de</strong> l’Empire ottoman.<br />
La monarchie constitutionnelle ne parvint pas à empêcher le démembrement<br />
<strong>de</strong> l’Empire comme le prétendaient les Jeunes turcs et<br />
le CUP. Peu <strong>de</strong> temps après <strong>la</strong> restauration <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution, l’Autriche<br />
annexa <strong>la</strong> Bosnie-Herzégovine le 5 octobre 1908. Le len<strong>de</strong>main,<br />
<strong>la</strong> Bulgarie déc<strong>la</strong>ra son indépendance et <strong>la</strong> Grèce annexa <strong>la</strong> Crète le 9<br />
mai 1910. Profitant <strong>de</strong> <strong>la</strong> situation, l’Italie envahit <strong>la</strong> Tripolitaine (aujourd’hui<br />
<strong>la</strong> Lybie) avec le soutien <strong>de</strong>s puissances européennes le 29<br />
septembre 1911. Grâce à l’appui local, les troupes turques commandées<br />
par Mustapha Kemal Pacha et Enver Pacha repoussèrent les Italiens<br />
pour au moins un an. L’Italie se tourna alors contre les îles du Dodécanèse<br />
pour rompre <strong>la</strong> résistance turque. Vers <strong>la</strong> fin, les Ottom<strong>ans</strong> si-
gnèrent le Traité d’Ouchy avec l’Italie le 15 octobre 1912. Ils n’y furent<br />
pas forcés en raison <strong>de</strong>s succès militaires <strong>de</strong>s Italiens mais bien plutôt à<br />
cause <strong>de</strong>s guerres balkaniques qui battaient leur plein et exigeaient tout<br />
leur rassemblement. Le Traité d’Ouchy céda à l’Italie <strong>la</strong> Tripolitaine et<br />
les îles du dodécanèse.<br />
Les guerres balkaniques (1912-1913)<br />
Alors que les Ottom<strong>ans</strong> étaient occupés par <strong>la</strong> guerre en Tripolitaine,<br />
<strong>la</strong> Russie signait <strong>la</strong> fin du pouvoir ottoman d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>. Plusieurs<br />
années durant, elle ne cessait d’inciter les Etats balkaniques à se rebeller<br />
contre l’autorité ottomane. Au printemps 1912, nombre <strong>de</strong> chrétiens<br />
<strong>de</strong>s nations balkaniques formèrent un réseau d’alliances appelé <strong>la</strong> Ligue<br />
Balkanique. A <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> septembre, les armées <strong>de</strong> <strong>la</strong> Ligue et <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong><br />
étaient mobilisées. Après avoir <strong>la</strong>ncé un ultimatum difficilement<br />
acceptable à <strong>la</strong> Porte, le Monténégro déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre contre l’Empire<br />
ottoman en octobre 1913. Trois autres Etats balkaniques suivirent<br />
l’exemple du Monténégro. La Ligue vint finalement à bout <strong>de</strong>s forces<br />
ottomanes. L’une <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> <strong>la</strong> défaite ottomane était <strong>la</strong> présence<br />
<strong>de</strong> dissi<strong>de</strong>nce politique au sein même <strong>de</strong> l’armée ottomane. Les forces<br />
bulgares avancèrent jusqu’à Chataldja, l’un <strong>de</strong>s districts d’Istanbul. La<br />
Grèce s’empara <strong>de</strong> Thessalonique, et <strong>la</strong> Serbie <strong>de</strong> Bito<strong>la</strong> (Manastır). Eut<br />
alors lieu <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> Londres le 29 novembre 1912. La Porte sollicitait<br />
<strong>la</strong> médiation <strong>de</strong>s puissances européennes. Celles-ci reconnurent<br />
l’indépendance <strong>de</strong> l’Albanie le 17 décembre 1913 et forcèrent même<br />
l’Empire ottoman à cé<strong>de</strong>r <strong>la</strong> Roumélie y compris <strong>la</strong> Thrace orientale et<br />
les îles égéennes aux Etats balkaniques. C’est à ce moment que le parti<br />
Union et Progrès prit le pouvoir par un coup d’état le 23 janvier 1913. A<br />
<strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> conférence, <strong>la</strong> Bulgarie reçut <strong>la</strong> partie nord <strong>de</strong> <strong>la</strong> Thrace entre<br />
Enos sur <strong>la</strong> mer Égée et Midia sur <strong>la</strong> mer Noire. Ce fut une gran<strong>de</strong><br />
perte pour l’Empire et le ressentiment envahit <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion turque.<br />
Les termes du Traité <strong>de</strong> Londres eurent pour conséquence l’éc<strong>la</strong>tement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième guerre balkanique entre les belligérants en juin 1913 à<br />
cause <strong>de</strong>s <strong>la</strong>rges concessions territoriales obtenues par <strong>la</strong> Bulgarie. Finalement,<br />
une paix fut trouvée avec le Traité <strong>de</strong> Bucarest en août 1913.<br />
A travers les multiples traités conclus avec <strong>la</strong> Bulgarie et <strong>la</strong> Grèce, les<br />
Ottom<strong>ans</strong> récupérèrent <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> leurs pertes subies pendant<br />
<strong>la</strong> première guerre balkanique. Les frontières actuelles entre <strong>la</strong><br />
République turque, <strong>la</strong> Bulgarie et <strong>la</strong> Grèce, sont le résultat <strong>de</strong>s tracés<br />
<strong>de</strong> cette époque.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
113
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
114<br />
Les conséquences <strong>de</strong>s guerres balkaniques furent <strong>de</strong>s plus catastrophiques<br />
auxquelles les Turcs eurent à faire face d<strong>ans</strong> leur histoire. Cinq<br />
siècles d’hégémonie turque sur <strong>la</strong> Roumélie prirent soudain fin, excepté<br />
sur <strong>la</strong> Thrace orientale. Des milliers <strong>de</strong> Turcs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région subirent<br />
<strong>de</strong>s atrocités et durent abandonner leurs biens pour migrer vers l’Anatolie.<br />
Cette immigration mit l’Empire d<strong>ans</strong> une grave situation alors<br />
qu’il était déjà accablé par sa situation économique. Quant aux Turcs<br />
qui vivaient encore d<strong>ans</strong> les Balk<strong>ans</strong>, ils souffraient <strong>de</strong> discriminations<br />
économiques et sociales.<br />
D. La dissolution (1914-1922)<br />
La première guerre mondiale:<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière guerre <strong>de</strong> l’Empire<br />
Le 28 juin 1914, l’Archiduc François Ferdinand fut assassiné par<br />
un étudiant serbe bosniaque à Sarajevo. L’archiduc était l’héritier du<br />
trône <strong>de</strong> l’Empire austro-hongrois. Son assassin était membre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
société Jeune Bosnie qui avait pour objectif premier <strong>la</strong> création d’une<br />
fédération rassemb<strong>la</strong>nt les s<strong>la</strong>ves du sud et l’indépendance vis-à-vis <strong>de</strong><br />
l’Empire austro-hongrois. L’assassinat <strong>de</strong> Sarajevo déclencha une casca<strong>de</strong><br />
d’événements qui rapi<strong>de</strong>ment se muèrent en une guerre à gran<strong>de</strong><br />
échelle. L’Autriche-Hongrie déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre à <strong>la</strong> Serbie sous le prétexte<br />
que celle-ci fut incapable <strong>de</strong> punir les responsables <strong>de</strong> l’assassinat.<br />
En quelques semaines, les puissances européennes entrèrent en guerre<br />
en raison <strong>de</strong>s systèmes imbriqués d’alliances <strong>de</strong> défense collective et<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> nature complexe <strong>de</strong>s accords internationaux. Ce conflit mondial<br />
impliquait néanmoins <strong>de</strong>s causes plus complexes.<br />
Les Alliés, c’est à dire <strong>la</strong> France, l’Angleterre et <strong>la</strong> Russie, furent vite<br />
poussés d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre lorsque l’Allemagne, l’Etat à <strong>la</strong> tête <strong>de</strong>s Empires<br />
centraux, déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre à <strong>la</strong> Russie le 1 er août 1914. L’Allemagne<br />
était en effet une puissance mondiale émergente qui commençait à<br />
convoiter les possessions d’outre-mer <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne. Pour se<br />
prémunir <strong>de</strong>s ambitions alleman<strong>de</strong>s, cette <strong>de</strong>rnière fit cause commune<br />
avec <strong>la</strong> Russie sur <strong>la</strong> scène internationale, ce qui signifiait qu’elle accédait<br />
aux prétentions historiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie à savoir sur les Balk<strong>ans</strong><br />
et sur les détroits turcs en échange <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> ses propres<br />
intérêts stratégiques au Moyen-Orient. Cette alliance russo-britannique<br />
menaçait l’intégrité territoriale <strong>de</strong> l’Empire ottoman. Pourtant,<br />
<strong>la</strong> position <strong>de</strong> l’Empire au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre restait ambiguë, et malgré<br />
l’alliance qui liait l’Empire à l’Allemagne <strong>de</strong>puis le Traité <strong>de</strong> Berlin <strong>de</strong>
1878, les chefs du parti Union et Progrès au pouvoir <strong>de</strong>puis 1913 cherchèrent<br />
à s’allier avec <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne pour parer à <strong>la</strong> pression russe.<br />
Ils considéraient <strong>de</strong> même les intérêts allemands sur les territoires ottom<strong>ans</strong><br />
excessifs. Mais ni <strong>la</strong> France ni <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne n’acceptèrent<br />
l’offre d’alliance ottomane. Ta<strong>la</strong>at Pacha proposa alors une alliance à <strong>la</strong><br />
Russie, mais elle fut rejetée. Le gouvernement ottoman comprit finalement<br />
que les puissances alliées s’étaient déjà arrangées pour diviser<br />
l’Empire d<strong>ans</strong> une guerre d’envergure. Par conséquent, le parti Union<br />
et Progrès, dont les partis<strong>ans</strong> étaient plutôt favorables aux Allemands,<br />
s’allia à l’Empereur Guil<strong>la</strong>ume II le 2 août 1914. Il est intéressant <strong>de</strong><br />
rapporter le fait suivant : en 1911, le gouvernement ottoman avait commandé<br />
<strong>de</strong>ux navires <strong>de</strong> guerre à <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne, le Sultan Osman<br />
et le Reshadiye. Il avait à cet effet collecté les donations <strong>de</strong> ses sujets<br />
pour payer ces navires. Mais <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne en avait délibérément<br />
retardé <strong>la</strong> livraison et les captura le 3 août. Il était c<strong>la</strong>ir qu’elle ne vou<strong>la</strong>it<br />
pas que ces navires soient utilisés contre elle.<br />
L’entrée <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong> d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> première guerre mondiale<br />
En réalité, ni l’Assemblé ottomane ni <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion ne<br />
vou<strong>la</strong>ient entrer en guerre. Les chefs du parti au pouvoir étaient quant à<br />
eux impatients <strong>de</strong> se ranger du côté <strong>de</strong>s Empires centraux croyant ainsi<br />
pouvoir prévenir le démembrement <strong>de</strong> l’Empire au profit <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
puissances. Les événements qui ont poussé l’Empire ottoman à s’engager<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre se rapportent au moment où celui-ci accepta d’abriter<br />
les <strong>de</strong>ux croiseurs allemands, le Goeben, croiseur lourd d’un dép<strong>la</strong>cement<br />
<strong>de</strong> 19.000 tonnes et le Bres<strong>la</strong>u, croiseur léger d’un dép<strong>la</strong>cement<br />
<strong>de</strong> 5.000 tonnes. Le gouvernement ottoman déc<strong>la</strong>ra que ces croiseurs<br />
avaient été acquis et renommés respectivement Yavuz et Midilli. En<br />
faisant ce<strong>la</strong>, il pensait compenser <strong>la</strong> perte <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux navires commandés<br />
à l’Angleterre, le Sultan Osman et le Reshadiye. Peu <strong>de</strong> temps<br />
après, le 29 octobre 1914, les ports russes <strong>de</strong> Sébastopol et d’O<strong>de</strong>ssa<br />
furent bombardés par ces <strong>de</strong>ux navires allemands sous le comman<strong>de</strong>ment<br />
<strong>de</strong> l’amiral Souchon s<strong>ans</strong> l’autorisation préa<strong>la</strong>ble du Parlement<br />
ou du cabinet ottoman. Ce fut en fait une provocation voulue par les<br />
Allemands afin d’entraîner l’Etat ottoman d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre. L’entrée <strong>de</strong>s<br />
Ottom<strong>ans</strong> d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong>vait <strong>de</strong>sserrer <strong>la</strong> pression <strong>de</strong>s Alliées sur<br />
les fronts <strong>de</strong> l’est et <strong>de</strong> l’ouest où les forces alleman<strong>de</strong>s (et austro-hongroises)<br />
subissaient leurs premiers revers à <strong>la</strong> Marne et en Galicie. Cet<br />
inci<strong>de</strong>nt obligea <strong>la</strong> Russie à déc<strong>la</strong>rer <strong>la</strong> guerre à l’Empire ottoman le 3<br />
novembre, suivie par <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne le 5 novembre.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
115
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
116<br />
Les Ottom<strong>ans</strong> se trouvaient impliqués au cœur même <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre. Le<br />
sultan appe<strong>la</strong> alors tous les musulm<strong>ans</strong> au djihad, <strong>la</strong> guerre sainte, le 23<br />
novembre, y compris les musulm<strong>ans</strong> vivant en Russie, en France et en<br />
Gran<strong>de</strong> Bretagne, et c’est ce que vou<strong>la</strong>ient les Allemands en prenant<br />
en compte <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> révoltes <strong>de</strong>s sujets musulm<strong>ans</strong> <strong>de</strong>s colonies<br />
britanniques, particulièrement en In<strong>de</strong>, qui pouvaient mettre <strong>la</strong><br />
Gran<strong>de</strong> Bretagne d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s difficultés. Ce<strong>la</strong> va<strong>la</strong>it tout autant<br />
pour <strong>la</strong> Russie qui comptait <strong>de</strong> nombreux sujets musulm<strong>ans</strong> matière<br />
à inquiétu<strong>de</strong>.<br />
L’armée turque se battait sur plusieurs fronts en même temps : au Caucase,<br />
en Irak, d<strong>ans</strong> les Dardanelles, en Egypte, au Yémen et en Macédoine.<br />
Au début <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, les troupes turques reçurent l’ordre <strong>de</strong><br />
leur commandant en chef Enver Pacha <strong>de</strong> marcher sur le Caucase pour<br />
encercler les troupes russes. Mais en raison <strong>de</strong> mauvaises p<strong>la</strong>nifications,<br />
près <strong>de</strong> 90 mille soldats turcs périrent : <strong>la</strong> méconnaissance <strong>de</strong>s conditions<br />
hivernales, un hiver ru<strong>de</strong>, le manque d’uniformes, <strong>la</strong> famine et <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die eurent raison <strong>de</strong>s soldats d<strong>ans</strong> leur ascension du mont Al<strong>la</strong>hu<br />
Ekber pour affronter les troupes russes. Finalement, celles-ci envahirent<br />
Manzikert, Van, Erzincan, Erzurum et Trébizon<strong>de</strong> vers le mois<br />
<strong>de</strong> février 1916. Juste après, les popu<strong>la</strong>tions arméniennes vivant d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
région se soulevèrent contre les Ottom<strong>ans</strong> et firent <strong>de</strong> grands massacres<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion turque et musulmane <strong>de</strong> <strong>la</strong> région sous les incitations<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie. Il ressort <strong>de</strong>s archives et <strong>de</strong>s sources civiles qu’un nombre<br />
non négligeable <strong>de</strong> sujets arméniens <strong>de</strong> l’Empire ottoman col<strong>la</strong>borèrent<br />
et furent impliqués d<strong>ans</strong> certaines activités visant à faciliter l’invasion<br />
ennemie.<br />
La question arménienne <strong>de</strong> 1915<br />
Pour contrer les nombreuses rébellions qui éc<strong>la</strong>tèrent après 1890 suite<br />
aux massacres <strong>de</strong>s Arméniens qui conduisirent à l’assassinat <strong>de</strong> plusieurs<br />
milliers <strong>de</strong> Turcs, le gouvernement ottoman informa les plus imminents<br />
personnages <strong>de</strong>s congrégations arméniennes et les députés arméniens<br />
que « le gouvernement va prendre les précautions nécessaires<br />
si les Arméniens continuaient à poignar<strong>de</strong>r les Turcs d<strong>ans</strong> le dos et à les<br />
assassiner ». Il <strong>de</strong>venait urgent au gouvernement ottoman <strong>de</strong> garantir<br />
<strong>la</strong> sécurité à l’intérieur <strong>de</strong> ses frontières, étant engagé d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
sur plusieurs fronts. Mais les inci<strong>de</strong>nts, loin <strong>de</strong> cesser, se multiplièrent<br />
ainsi que les assauts contre les femmes et enfants turcs s<strong>ans</strong> défense. A<br />
<strong>la</strong> suite <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, le gouvernement ottoman décida <strong>de</strong> ‘dép<strong>la</strong>cer’ (tehcir<br />
en turc-ottoman) les Arméniens impliqués d<strong>ans</strong> les insurrections vers
<strong>de</strong>s lieux plus sûrs, notamment <strong>la</strong> Syrie et le Liban, parties <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman. Notons un point important : le terme tehcir d’origine arabe<br />
signifie littéralement ‘faire migrer’ et n’a pas du tout le sens <strong>de</strong> ‘déportation’<br />
ou d’‘exil’. Ainsi, <strong>la</strong> loi communément appelée ‘Loi <strong>de</strong> tehcir’ n’était<br />
en fait que « <strong>la</strong> Loi provisoire sur <strong>de</strong>s mesures à mettre en pratique<br />
par l’armée pour ceux qui s’opposent aux décisions du gouvernement<br />
pendant <strong>la</strong> guerre ». La protection <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et <strong>de</strong>s biens <strong>de</strong>s Arméniens<br />
durant cette étape <strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement et le soin apporté à leur approvisionnement<br />
en eau, nourriture et hébergement, ont été confiés aux autorités<br />
régionales le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> route du dép<strong>la</strong>cement. Il a été décrété que les<br />
Arméniens dép<strong>la</strong>cés étaient autorisés à emporter leurs biens et <strong>de</strong>s arrangements<br />
concernant leurs propriétés <strong>de</strong>vaient être établis et soumis<br />
aux autorités concernées.<br />
Ce fut une action fâcheuse mais une mesure militaire inévitable pour<br />
le gouvernement ottoman impliqué d<strong>ans</strong> une guerre majeure. Aucune<br />
puissance au mon<strong>de</strong> n’aurait pu rester indifférente face à une telle situation.<br />
Le dép<strong>la</strong>cement fut également décidé sous l’insistance du général<br />
en chef <strong>de</strong> l’armée alleman<strong>de</strong>. En effet, l’une <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> ce dép<strong>la</strong>cement<br />
était d’éviter un conflit entre Arméniens et Turcs en Anatolie<br />
<strong>de</strong> l’est du fait que les assauts arméniens avaient provoqué les réactions<br />
<strong>de</strong>s Turcs. N’oublions pas que <strong>la</strong> Loi du tehcir fut émise au moment où<br />
les troupes turques étaient en pleine bataille <strong>de</strong>s Dardanelles, l’une <strong>de</strong>s<br />
plus féroces côté turc durant <strong>la</strong> première guerre mondiale. Le processus<br />
<strong>de</strong> dép<strong>la</strong>cement fut mené avec succès puisque <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s Arméniens<br />
furent sûrement tr<strong>ans</strong>férés vers <strong>la</strong> Syrie. Bien entendu, certaines<br />
autorités locales ont agi <strong>de</strong> manière irresponsable et quelques ban<strong>de</strong>s<br />
attaquèrent les convois arméniens pour se venger.<br />
Il n’est guère possible <strong>de</strong> qualifier ce<strong>la</strong> <strong>de</strong> ‘génoci<strong>de</strong>’ que les Arméniens<br />
préten<strong>de</strong>nt. Il est vrai que ce qui eut lieu en 1915 fut une histoire malheureuse<br />
pour les Arméniens. Mais on ne <strong>de</strong>vrait pas omettre <strong>la</strong> souffrance<br />
<strong>de</strong>s Turcs et autres popu<strong>la</strong>tions musulmanes en Anatolie due<br />
aux assauts arméniens. D<strong>ans</strong> ce sens, Turcs et Arméniens s’entretuèrent<br />
d<strong>ans</strong> une lutte réciproque.<br />
Un autre point souvent perdu <strong>de</strong> vue est que les <strong>de</strong>ux nations ont vécu<br />
ensemble en paix durant <strong>de</strong>s siècles sous le gouvernement ottoman<br />
jusqu’au milieu du XIXème siècle. Dès que les puissances européennes<br />
manifestèrent leurs intérêts d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région, <strong>la</strong> nature <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions entre<br />
Arméniens et Turcs prit une tournure dramatique. Si l’on <strong>de</strong>vait blâmer<br />
quiconque, ce <strong>de</strong>vrait être les pouvoirs impériaux <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt mais ni<br />
les Turcs ni les Arméniens.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
117
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
118<br />
A regar<strong>de</strong>r <strong>la</strong> position actuelle <strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions turco-arméniennes, indéniablement<br />
certains obstacles existent toujours à <strong>la</strong> réconciliation et à<br />
<strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong>s problèmes, et le premier d’entre eux est d’ordre<br />
politique. Celui-ci provient en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> diaspora arménienne<br />
qui cherche à forcer les politiques <strong>de</strong>s différents pays, davantage préoccupés<br />
par leurs affaires intérieures et leurs électeurs que par <strong>la</strong> question<br />
du génoci<strong>de</strong> arménien, à passer <strong>de</strong>s résolutions contre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. Ceci<br />
ne mena à rien d’autre qu’à faire <strong>de</strong> cette affaire une question politique<br />
et creuser le fossé entre les parties désirant une réconciliation. Le plus<br />
important d<strong>ans</strong> tout ce<strong>la</strong>, c’est que ce processus a ouvert <strong>la</strong> voie à une liquidation<br />
<strong>de</strong> l’histoire. En effet, les résolutions adoptées pour le respect<br />
du prétendu ‘génoci<strong>de</strong>’ arménien par certains parlements <strong>de</strong> pays tiers,<br />
n’en constituent pas, loin <strong>de</strong> là, une preuve historique, mais ren<strong>de</strong>nt<br />
bien plutôt <strong>la</strong> question délicate et d’un enjeu politique. A contre-pied<br />
<strong>de</strong> ces actions, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> use <strong>de</strong> son pouvoir politique, économique<br />
et diplomatique pour déjouer les impacts <strong>de</strong> telles actions politiques.<br />
La Bataille <strong>de</strong>s Dardanelles ou<br />
Campagne <strong>de</strong>s Dardanelles<br />
L’une <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s batailles <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre prit p<strong>la</strong>ce à Gallipoli, connue<br />
sous le nom <strong>de</strong> bataille <strong>de</strong> Çanakkale en turc, <strong>de</strong> campagne <strong>de</strong> Gallipoli<br />
ou <strong>de</strong>s Dardanelles en France, en Gran<strong>de</strong> Bretagne, en Australie<br />
et en Nouvelle Zé<strong>la</strong>n<strong>de</strong>. Une opération conjointe franco-britannique<br />
fut conduite d<strong>ans</strong> le but <strong>de</strong> conquérir éventuellement <strong>la</strong> capitale ottomane<br />
Istanbul. A travers cette bataille, les Alliés cherchaient à ouvrir<br />
une route sûre d’approvisionnement vers <strong>la</strong> Russie qui faisait face à<br />
<strong>la</strong> révolte menée par Lénine. L’Empire allemand et austro-hongrois<br />
bloquaient les routes terrestres <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie vers l’Europe<br />
et aucune route maritime praticable n’existait. Le seul accès à <strong>la</strong><br />
Mer Noire se faisait par les Dardanelles et le Bosphore contrôlés par<br />
l’Empire ottoman.<br />
Le premier lord <strong>de</strong> l’Amirauté du Royaume-Uni, Winston Churchill,<br />
exposa ses premiers pl<strong>ans</strong> d’une attaque navale sur les Dardanelles. Un<br />
p<strong>la</strong>n d’attaque et d’invasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Gallipoli finit par être<br />
approuvé par le cabinet britannique en janvier 1915.<br />
La première gran<strong>de</strong> attaque navale <strong>de</strong>s Alliés fut <strong>la</strong>ncée sur les Dardanelles<br />
le 18 mars 1915. Une flotte massive commandée par l’Amiral<br />
<strong>de</strong> Robeck comptant pas moins <strong>de</strong> 16 cuirassés tenta <strong>de</strong> pénétrer d<strong>ans</strong><br />
le détroit <strong>de</strong>s Dardanelles. Mais <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s navires furent endom-
magés par une série <strong>de</strong> mines sous-marines disposées le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> rive<br />
asiatique par le poseur <strong>de</strong> mines turc Nusret. Des chalutiers furent utilisés<br />
par les Britanniques comme démineurs. Les Alliés se retirèrent dès<br />
que les Turcs ouvrirent le feu sur eux, <strong>la</strong>issant le champ <strong>de</strong> mines intact.<br />
Puis, 3 cuirassés furent coulés par l’artillerie turque : <strong>de</strong>ux navires britanniques,<br />
l’Ocean et l’Irresistible, et un navire français, le Bouvet. Le<br />
cuirassé britannique l’Inflexible et les <strong>de</strong>ux cuirassés français, le Suffren<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
119
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
120<br />
et le Gaulois, furent sévérement endommagés. Ces pertes incitèrent les<br />
Alliés à suspendre toute autre tentative <strong>de</strong> forcer les détroits par <strong>la</strong> seule<br />
puissance navale. La défaite <strong>de</strong> <strong>la</strong> flotte britannique remonta le moral<br />
<strong>de</strong>s troupes turques. Après l’échec <strong>de</strong> ces attaques navales, il fut décidé<br />
d’engager les forces terrestres pour abattre l’artillerie mobile turque.<br />
Au début <strong>de</strong> l’année 1915, <strong>de</strong>s soldats volontaires australiens et néozé<strong>la</strong>ndais<br />
furent campés en Egypte. Ces troupes furent organisées en<br />
Corps d’armée australien et néo-zé<strong>la</strong>ndais (Australia and New Zea<strong>la</strong>nd<br />
Army Corps, ANZAC). Le Général Hamilton avait également sous<br />
son comman<strong>de</strong>ment les 29è et 10è divisions régulières britanniques<br />
ainsi que les Corps expéditionnaire français <strong>de</strong> l’Orient. Les forces alliées<br />
entamèrent dès lors l’invasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> péninsule <strong>de</strong> Gallipoli le 25<br />
avril 1915. Ils durent néanmoins faire face à une extraordinaire résistance<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s Turcs. Au début, il fut difficile aux troupes turques<br />
<strong>de</strong> contenir l’avancée <strong>de</strong>s envahisseurs, mais ceux-ci ne parvenaient pas<br />
à avancer comme prévu, à peine trois kilomètres en trois mois. C’est<br />
alors que le 2 août, l’infanterie alliée accosta à Suv<strong>la</strong>. Une fois <strong>de</strong> plus,<br />
les Turcs sous comman<strong>de</strong>ment du lieutenant Mustapha Kemal, parvinrent<br />
à gagner les hauteurs <strong>de</strong>s collines d’Anafarta, ce qui tr<strong>ans</strong>forma le<br />
front <strong>de</strong> Suv<strong>la</strong> en guerre statique <strong>de</strong> tranchée.<br />
La bataille dura jusqu’à <strong>la</strong> fin du mois <strong>de</strong> décembre s<strong>ans</strong> grand succès<br />
du côté <strong>de</strong>s Alliés. Comble <strong>de</strong> l’ironie, l’évacuation commencée en décembre<br />
fut le plus grand succès <strong>de</strong>s Alliés pendant cette campagne. La<br />
<strong>de</strong>rnière troupe alliée quitta Gallipoli à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> première semaine<br />
<strong>de</strong> janvier 1916. En fin <strong>de</strong> compte, les Turcs perdirent environ 250 000<br />
personnes, et les pertes alliées s’élevaient à environ 150 000.<br />
La Bataille <strong>de</strong>s Dardanelles fut l’un <strong>de</strong>s meilleurs moments et <strong>de</strong>s plus<br />
glorieux d<strong>ans</strong> l’histoire <strong>de</strong>s Turcs. Ce fut l’é<strong>la</strong>n ultime d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> défense<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> patrie alors que <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s siècles l’Empire ottoman s’écrou<strong>la</strong>it ;<br />
c’est ainsi que furent jetées les bases <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte nationale turque menant<br />
à <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle République huit <strong>ans</strong> plus tard par<br />
Atatürk, lui-même commandant lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Gallipoli. Encore<br />
aujourd’hui, <strong>la</strong> journée <strong>de</strong> l’ANZAC est célébrée en Australie et en<br />
Nouvelle Zé<strong>la</strong>n<strong>de</strong>, et l’on considère que <strong>la</strong> Bataille marqua <strong>la</strong> naissance<br />
<strong>de</strong>s i<strong>de</strong>ntités nationales collectives <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux nations supp<strong>la</strong>ntant le<br />
sentiment collectif d’affiliation à l’Empire britannique.<br />
Les Turcs ont courageusement résisté et défait les gigantesques flotte<br />
et armée alliées à Gallipoli. Mais <strong>la</strong> situation sur le front <strong>de</strong> l’Egypte<br />
n’al<strong>la</strong>it pas s<strong>ans</strong> problèmes. L’objectif <strong>de</strong> cette campagne encouragée
par l’Allemagne, était <strong>de</strong> rétablir le contrôle ottoman sur l’Egypte et<br />
particulièrement Suez d’où l’on pouvait couper <strong>la</strong> route vers l’In<strong>de</strong> à<br />
l’Empire britannique. Mais l’entreprise fut un échec.<br />
Les accords secrets<br />
Le chérif Hussein Ibn Ali, l’émir du Hedjaz, <strong>la</strong>nça <strong>la</strong> Révolte arabe<br />
contre les Ottom<strong>ans</strong> en 1916. Il visait à établir un Etat arabe indépendant<br />
s’étendant d’Alep en Syrie à A<strong>de</strong>n au Yémen. C’était là <strong>la</strong> promesse<br />
<strong>de</strong>s Britanniques en contrepartie <strong>de</strong> <strong>la</strong> révolte qu’il <strong>la</strong>nça contre<br />
les Ottom<strong>ans</strong>. En réalité, ce<strong>la</strong> faisait partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
puissances pour le partage <strong>de</strong> l’Empire ottoman. La Gran<strong>de</strong> Bretagne<br />
et <strong>la</strong> France établirent <strong>de</strong>s accords secrets dits les accords Sykes-Picot<br />
<strong>de</strong> mai 1916 délimitant les zones d’influence respectives après <strong>la</strong> première<br />
guerre mondiale et le partage du Moyen-Orient après <strong>la</strong> chute<br />
attendue <strong>de</strong> l’Empire ottoman. Conformément aux accords, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne contrôlerait <strong>la</strong> zone comprenant à peu près <strong>la</strong> Jordanie, l’Irak<br />
et une partie autour <strong>de</strong> Haïfa pour permettre l’accès aux ports <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Méditerranée, tandis que <strong>la</strong> France étendrait son mandat sur le sud-est<br />
<strong>de</strong> l’Anatolie. Plus tard, les accords s’é<strong>la</strong>rgirent pour <strong>la</strong>isser p<strong>la</strong>ce à <strong>la</strong><br />
Russie et à l’Italie. La Russie recevrait l’Anatolie <strong>de</strong> l’est, les Italiens<br />
prendraient les îles égéennes et étendrait son influence sur <strong>la</strong> zone autour<br />
d’Izmir d<strong>ans</strong> le sud-ouest <strong>de</strong> l’Anatolie. Et ce n’était pas tout :<br />
<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne soutenait également les pl<strong>ans</strong> sionistes pour un<br />
‘foyer national’ pour le peuple juif en Palestine à travers <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration<br />
Balfour <strong>de</strong> 1917, du nom du ministre <strong>de</strong>s Affaires Étrangères britannique<br />
Arthur James Balfour, suivant le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> dépècement <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman.<br />
La Révolution russe <strong>de</strong> 1917 fut désavantageuse pour <strong>la</strong> Russie qui<br />
s’est vue désavouée d<strong>ans</strong> ses prétentions sur l’Empire ottoman. Lénine<br />
divulgua alors le texte confi<strong>de</strong>ntiel <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Sykes-Picot ainsi<br />
que d’autres traités causant <strong>de</strong> l’embarras d<strong>ans</strong> le camp <strong>de</strong>s Alliés et<br />
éveil<strong>la</strong>nt le sentiment <strong>de</strong> méfiance chez les Arabes. La Révolution<br />
russe eut également pour conséquence le retrait <strong>de</strong>s troupes russes <strong>de</strong><br />
là où elles avaient envahies les territoires ottom<strong>ans</strong> en signant le Traité<br />
<strong>de</strong> Brest-Litovsk en mars 1918, tandis que <strong>la</strong> situation militaire <strong>de</strong>s<br />
troupes turques stationnées en Irak et en Syrie empirait. Les autres<br />
membres <strong>de</strong>s pouvoir centraux se retirèrent à leur tour <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
en acceptant leur défaite. Confiants d<strong>ans</strong> le programme du Prési<strong>de</strong>nt<br />
américain Wilson qui garantissait qu’« aux régions turques <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman actuel <strong>de</strong>vraient être assurées <strong>la</strong> souveraineté et <strong>la</strong> sécurité », le<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
121
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
122<br />
gouvernement ottoman décida d’offrir une trêve aux Alliés et signa le<br />
30 octobre 1918 l’armistice <strong>de</strong> Moudros.<br />
L’Empire ottoman qui couvrait tous les Balk<strong>ans</strong>, <strong>la</strong> plupart du Moyen-<br />
Orient et l’Afrique du nord aussi bien que le Caucase, avait réussi à<br />
maintenir une quasi stabilité à l’apogée <strong>de</strong> son pouvoir aux XVIème et<br />
XVIIème siècles et une gran<strong>de</strong> partie du XVIIIème siècle. Cette pério<strong>de</strong><br />
fut appelée <strong>la</strong> Pax-Ottomana par certains historiens ottom<strong>ans</strong>. Le<br />
terme est significatif si l’on comparait <strong>la</strong> situation d’instabilité sociale,<br />
économique et politique qu’ont vécue ces régions après <strong>la</strong> fin du gouvernement<br />
ottoman, particulièrement après <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>.<br />
L’armistice <strong>de</strong> Moudros<br />
L’armistice qui mit fin aux hostilités entre l’Empire ottoman et les Alliés<br />
fut signé par le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Marine Rauf Bey et l’amiral ang<strong>la</strong>is<br />
Calthorpe à bord du HMS Agamemnon d<strong>ans</strong> le port <strong>de</strong> Moudros sur<br />
l’île <strong>de</strong> Lemnos, entérinant <strong>la</strong> défaite <strong>de</strong> l’Empire durant <strong>la</strong> première<br />
guerre mondiale. Avant <strong>la</strong> signature du Traité, l’amiral Calthorpe apporta<br />
<strong>la</strong> garantie à Rauf Bey qu’Istanbul ne serait pas occupée et que les<br />
navires <strong>de</strong> guerres grecs ne s’en approcheraient pas. Conformément aux<br />
25 articles <strong>de</strong> l’armistice, les Ottom<strong>ans</strong> <strong>de</strong>vaient renoncer à leur Empire<br />
à l’exception <strong>de</strong> l’Anatolie, et <strong>de</strong>vaient abandonner leurs garnisons au<br />
Hedjaz, au Yémen, en Syrie, en Irak, en Tripolitaine et en Cyrénaïque.<br />
Les Alliés occupèrent les détroits <strong>de</strong>s Dardanelles et du Bosphore<br />
et les tunnels <strong>de</strong>s montagnes du Taurus. Ils s’acquirent également le<br />
droit d’occuper six provinces peuplées d’Arméniens d<strong>ans</strong> le nord-est<br />
<strong>de</strong> l’Anatolie en cas <strong>de</strong> désordres, aussi bien que <strong>de</strong>s lieux stratégiques<br />
lorsqu’il s’agissait <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s Alliés. Leur objectif premier était<br />
<strong>de</strong> contrôler toutes les munitions et leur distribution. Leur <strong>de</strong>uxième<br />
objectif était <strong>de</strong> disperser les différentes petites unités armées soit en<br />
les intégrant d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> plus gran<strong>de</strong>s unités mieux contrôlées, soit en les<br />
renvoyant chez elles.<br />
A y regar<strong>de</strong>r <strong>de</strong> plus près, on peut déceler à travers les articles <strong>de</strong> l’armistice<br />
que <strong>la</strong> vraie visée <strong>de</strong>s Alliés était d’ouvrir l’Anatolie à l’invasion<br />
s<strong>ans</strong> rencontrer <strong>de</strong> résistance. S<strong>ans</strong> même attendre <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> paix<br />
qui <strong>de</strong>vait se tenir après <strong>la</strong> guerre, les Alliés commencèrent à envahir<br />
l’Anatolie invoquant divers prétextes. D’abord, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne<br />
envahit illégalement Mossoul trois jours seulement après <strong>la</strong> signature<br />
<strong>de</strong> l’armistice. En fait, au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> signature, les troupes britanniques<br />
étaient stationnées à une soixantaine <strong>de</strong> kilomètres au sud <strong>de</strong> <strong>la</strong>
province. Ils ne <strong>de</strong>vaient pas avancer vers le nord selon les termes <strong>de</strong><br />
l’armistice.<br />
Au mépris <strong>de</strong>s promesses déjà faites, 73 unités <strong>de</strong> navires <strong>de</strong> guerre britanniques,<br />
françaises, italiennes et grecques jetèrent l’ancre <strong>de</strong>vant Istanbul<br />
le 12 novembre 1918. Les provinces turques d’Adana et Mersin<br />
d<strong>ans</strong> le sud <strong>de</strong> l’Anatolie furent envahies par les Français en décembre<br />
1918 ; à son tour, Antep fut prise par les Ang<strong>la</strong>is le 17 décembre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
même année, tout comme Marach le 22 février et Urfa le 24 mars 1919.<br />
Les Italiens, <strong>de</strong> leur côté, s’emparèrent d’Anta<strong>la</strong>ya, <strong>de</strong> Fethiye, <strong>de</strong> Bodrum<br />
et <strong>de</strong> Konya. Par <strong>la</strong> suite, les Ang<strong>la</strong>is étendirent leur contrôle sur<br />
les régions <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire en s’emparant <strong>de</strong> Samsun et <strong>de</strong> Merzifon et<br />
cédèrent Antep et Marach à <strong>la</strong> France, manifestant plus d’intérêt pour<br />
l’Irak, région riche en pétrole.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
123
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
124<br />
CHAPITRE 11<br />
La guerre d’indépendance turque (1919-1923)<br />
La lutte nationale turque (1919-1923)<br />
Signalons <strong>de</strong> prime abord que <strong>la</strong> lutte nationale turque fut <strong>la</strong> conséquence<br />
<strong>de</strong>s développements politiques et militaires qui prirent p<strong>la</strong>ce<br />
entre 1919 et 1922 et matérialisés par les conditions <strong>de</strong> l’armistice <strong>de</strong><br />
Moudros. Néanmoins, cette lutte revêtit un autre aspect d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure<br />
où elle a accéléré le processus <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation turc entamé <strong>de</strong>puis <strong>de</strong><br />
XVIIIème siècle. Au terme <strong>de</strong> cette lutte nationale, son chef, Mustapha<br />
Kemal Atatürk, fonda <strong>la</strong> République turque. Ce fut un moment important<br />
d<strong>ans</strong> l’histoire turque car, pour <strong>la</strong> première fois, il vit le passage <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> souveraineté aux mains du peuple.<br />
L’armistice <strong>de</strong> Moudros mit pratiquement fin à l’Empire ottoman dont<br />
les territoires, hormis l’Anatolie et <strong>la</strong> Thrace orientale, furent abandonnés<br />
à l’autorité <strong>de</strong>s Alliés. Lorsque les officiers chefs <strong>de</strong> l’armée<br />
ottomane comme Mustapha Kemal, Kazim Karabekir et bien d’autres,<br />
retournèrent à Istanbul en novembre 1918, ils trouvèrent <strong>la</strong> capitale<br />
quasiment occupée. Une anecdote célèbre rapporte que lorsque Mustapha<br />
Kemal vit les navires ennemis accostés d<strong>ans</strong> le Bosphore, il aurait<br />
dit : « Ils (les ennemis) retourneront <strong>de</strong> là où ils sont venus ». Ce<strong>la</strong><br />
démontre sa détermination à <strong>la</strong> résistance contre l’invasion.<br />
Le gouvernement ottoman et le sultan étaient trop affaiblis pour<br />
pouvoir imposer leurs décisions ou restaurer <strong>la</strong> loi et l’ordre d<strong>ans</strong> les<br />
différentes régions, principalement parce que <strong>la</strong> capitale était occupée<br />
par les Alliés. Bien pis encore, les membres du gouvernement ottoman<br />
ne voyaient d’autres solutions que <strong>de</strong> coopérer avec les occupants<br />
dont les intentions ont été soulignées plus haut. Ainsi, <strong>de</strong>puis que le<br />
pays était en état d’effondrement et que le gouvernement d’Istanbul<br />
n’avait aucune perspective pour surmonter <strong>la</strong> situation d<strong>ans</strong> <strong>la</strong>quelle se<br />
trouvait l’Empire, Mustapha Kemal et ses collègues tinrent une série<br />
<strong>de</strong> réunions à Istanbul pour débattre <strong>de</strong> l’avenir du pays. Des factions<br />
adverses et <strong>de</strong>s visions contradictoires s’affrontaient, mais tous étaient<br />
unis par <strong>la</strong> conviction que l’objectif <strong>de</strong>s Alliés était l’éviction <strong>de</strong> leur<br />
souveraineté d<strong>ans</strong> leur propre patrie. Cette vision fut <strong>la</strong> force motrice<br />
<strong>de</strong>rrière l’union <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions turques d’Anatolie. Il fut décidé que<br />
puisque le gouvernement d’Istanbul et le sultan lui-même étaient sous<br />
contrôle étranger, <strong>la</strong> seule manière d’échapper à cette domination était
<strong>de</strong> rejoindre l’Anatolie afin d’y organiser le mouvement national contre<br />
les occupants. Et ce fut un changement inattendu pour les nationalistes<br />
lorsque certains collègues <strong>de</strong> Mustapha Kemal tels Refet Bele, Kazim<br />
Karabekir, Ali Fuad Cebesoy, etc., en majorité <strong>de</strong>s officiers nationalistes,<br />
furent nommés par le Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Défense (Harbiye Naziri)<br />
d<strong>ans</strong> les corps militaires en différentes parties <strong>de</strong> l’Anatolie.<br />
Entre-temps, les gouvernements alliés étaient sur le point <strong>de</strong> prendre<br />
une décision sur le sort <strong>de</strong> l’Anatolie <strong>de</strong> l’ouest. Izmir et l’ouest anatolien<br />
furent concédés à l’Italie par <strong>de</strong>s accords secrets établis pendant<br />
<strong>la</strong> guerre visant à partager l’Anatolie entre les Alliés. Mais lorsque <strong>la</strong><br />
Gran<strong>de</strong> Bretagne mit sur <strong>la</strong> table <strong>de</strong>s discussions <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> l’invasion<br />
grecque d’Izmir, l’Italie quitta <strong>la</strong> Conférence <strong>de</strong> Paix le 24 avril<br />
1919 et n’y retourna que le 5 mai. En son absence, Llyod Georges persuada<br />
<strong>la</strong> France et les Etats-Unis <strong>de</strong> favoriser les intérêts <strong>de</strong> <strong>la</strong> Grèce<br />
à Izmir et en Anatolie occi<strong>de</strong>ntale aux dépens <strong>de</strong> l’Italie. L’ on peut<br />
aisément affirmer que l’invasion d’Izmir par <strong>la</strong> Grèce le 15 mai 1919<br />
réveil<strong>la</strong> le sentiment national et accéléra l’adhésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion aux<br />
mouvements <strong>de</strong> lutte nationale en organisant localement <strong>la</strong> Société <strong>de</strong><br />
Défense <strong>de</strong>s Droits et Intérêts (Müdafa-i Hukuk Cemiyetleri) et en<br />
établissant <strong>de</strong>s Milices nationales (Kuvay-i Milliye) pour faire front<br />
aux occupants d<strong>ans</strong> leurs régions. A ce moment, l’occasion fut donnée à<br />
Mustapha Kemal d’obtenir un poste officiel en Anatolie lorsque l’amiral<br />
Calthorpe, l’intermédiaire britannique d<strong>ans</strong> l’Empire ottoman, remit<br />
un mémorandum au gouvernement alléguant que les Grecs en Mer<br />
Noire étaient sujets aux assauts <strong>de</strong>s civils Turcs. Le ton du mémorandum<br />
monta d’un cran et menaça que: « si ce<strong>la</strong> ne cessait pas, l’intervention<br />
alliée serait inévitable ». En fait, même si <strong>la</strong> menace existait pour<br />
les Turcs qui subissaient <strong>de</strong>s attaques <strong>de</strong> ban<strong>de</strong>s grecques encouragées<br />
par les forces alliées, tout ce<strong>la</strong> ne fut qu’une excuse pour justifier l’intervention<br />
alliée. Pour éviter que l’immixtion étrangère ne prenne plus<br />
d’ampleur, le sultan Mehmed Vah<strong>de</strong>din (Mehmed VI, 1918-1922), le<br />
36è et <strong>de</strong>rnier sultan, nomma Mustapha Kemal inspecteur général <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> neuvième armée le 30 avril 1919 en lui accordant <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges pouvoirs.<br />
Sa tâche consistait à désarmer l’armée turque et rétablir le calme d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> région ; en d’autres termes, il <strong>de</strong>vait inspecter les progrès <strong>de</strong> l’application<br />
<strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l’armistice. En réalité, Mustapha Kemal al<strong>la</strong>it se<br />
servir <strong>de</strong> cette mission pour accomplir son objectif principal qui était<br />
d’organiser le mouvement <strong>de</strong> résistance nationale. Deux motivations<br />
animaient Mustapha Kemal : l’une était <strong>de</strong> lutter contre l’invasion<br />
étrangère, l’autre visait l’établissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> souveraineté nationale qui<br />
conduisait forcément à <strong>la</strong> lutte contre le sultan et le gouvernement ot-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
125
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
126<br />
toman. Le nom <strong>de</strong> Mustapha Kemal était déjà familier à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
turque étant donné que ses succès passés à Gallipoli lui avaient donné<br />
quelque crédit.<br />
Le réveil national<br />
Mustapha Kemal quitta Istanbul en embarquant sur un paquebot, le<br />
Bandirma, l’après-midi du 16 mai 1919 en direction <strong>de</strong> Samsun, un<br />
district au milieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> Mer Noire, où il débarqua le 19<br />
mai. Cette date est communément acceptée comme le début du Mouvement<br />
<strong>de</strong> lutte nationale. Il fit prendre conscience à <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ville du débarquement <strong>de</strong>s Grecs et <strong>de</strong> l’invasion étrangère du pays et <strong>la</strong><br />
mit au courant <strong>de</strong> l’incapacité du gouvernement d’Istanbul à faire face<br />
à cette situation. Il informa ses collègues par télégraphe <strong>de</strong> sa présence<br />
à Samsun et <strong>de</strong> son intention d’avancer d<strong>ans</strong> l’Anatolie intérieure. Sa<br />
<strong>de</strong>stination finale était Sivas, beaucoup plus sûre qu’un autre lieu, pour<br />
y organiser le Mouvement <strong>de</strong> résistance nationale. Sivas fut choisie<br />
entre autres en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> son ami Kazim Karabekir à<br />
<strong>la</strong> tête d’un corps d’armée à Erzurum toute proche et en raison <strong>de</strong> son<br />
éloignement du champ d’influence du gouvernement d’Istanbul.<br />
Pour atteindre Sivas, il se dép<strong>la</strong>ça vers Havza où il établit <strong>de</strong>s liens avec<br />
les différents groupes nationalistes et appe<strong>la</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion à un grand<br />
congrès. Il envoya également <strong>de</strong>s télégrammes <strong>de</strong> protestation aux ambassa<strong>de</strong>s<br />
étrangères et au Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre à Istanbul au sujet<br />
<strong>de</strong>s renforts ang<strong>la</strong>is d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région et du soutien ang<strong>la</strong>is aux ban<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
brigands grecs. Alors qu’il était officiellement chargé du désarmement<br />
<strong>de</strong>s militaires, Mustapha Kemal multipliait ses contacts pour donner <strong>de</strong><br />
l’impulsion à son mouvement. Il passa à Amasya où il rencontra Rauf<br />
Bey, Ali Fuat Bey et Refet Bey. Après un travail préparatoire, le 22 juin<br />
1919 ils émirent un document dit ‘<strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire d’Amasya’ appe<strong>la</strong>nt <strong>la</strong><br />
popu<strong>la</strong>tion turque à être vigi<strong>la</strong>nte aux attaques étrangères qui menaçaient<br />
leur existence. Distribuée à travers l’Anatolie, <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire déc<strong>la</strong>rait<br />
que l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et son intégrité étaient en danger.<br />
Elle appe<strong>la</strong>it aussi à un congrès national qui al<strong>la</strong>it se tenir à Sivas, mais<br />
avant, à un congrès à Erzurum qui comprendrait les représentants <strong>de</strong>s<br />
province <strong>de</strong> l’est anatolien.<br />
Pour le gouvernement d’Istanbul, Mustapha Kemal était allé trop loin<br />
en publiant <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>ire.<br />
Le sultan le rappe<strong>la</strong> à Istanbul d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> nuit du 7 juillet 1919 et Mustapha<br />
Kemal n’eut d’autre choix que <strong>de</strong> démissionner <strong>de</strong> ses postes officiels.<br />
Cependant, son lea<strong>de</strong>rship d<strong>ans</strong> le mouvement national <strong>de</strong>meura
intact. Il continua à préparer avec d’autres le congrès d’Erzurum qui eut<br />
lieu du 23 juillet au 7 août. Ce fut <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> étape d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> constitution<br />
<strong>de</strong> l’unité nationale.<br />
Par ailleurs, l’invasion grecque suscita un éveil national d<strong>ans</strong> l’ouest <strong>de</strong><br />
l’Anatolie où également certains congrès se tenaient. Des délégués <strong>de</strong><br />
cette région furent envoyés au congrès <strong>de</strong> Sivas (4-11 septembre 1919).<br />
Ce congrès prit certaines décisions qui al<strong>la</strong>ient fondamentalement déterminer<br />
<strong>la</strong> future politique du Mouvement national. Il fut décidé <strong>de</strong><br />
reconnaître les frontières <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> telles qu’elles ont été établies par<br />
l’armistice <strong>de</strong> Moudros et <strong>de</strong> donner aux organisations locales le nom<br />
<strong>de</strong> ‘Société <strong>de</strong> Défense <strong>de</strong>s Droits et Intérêts <strong>de</strong>s provinces d’Anatolie<br />
et <strong>de</strong> Roumélie’. On décida également à Sivas que le parlement <strong>de</strong>vrait<br />
se réunir à Istanbul même s’il paraissait c<strong>la</strong>ir qu’il ne pourrait pas fonctionner<br />
sous occupation étrangère. Ce fut une occasion exceptionnelle<br />
<strong>de</strong> jeter les bases et affirmer <strong>la</strong> légitimité du Mouvement national. Une<br />
autre décision tout aussi importante fut prise au Congrès : <strong>la</strong> création<br />
d’un Comité exécutif qui sera chargé <strong>de</strong> <strong>la</strong> diffusion et <strong>de</strong> l’application<br />
<strong>de</strong>s décisions du Congrès. Toute cette organisation pouvait très bien<br />
représenter un nouveau gouvernement si les Alliés décidaient <strong>de</strong> dissoudre<br />
<strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> structure gouvernementale ottomane. Mustapha<br />
Kemal fut élu chef du Comité. A partir du congrès <strong>de</strong> Sivas, le Mouvement<br />
d’Anatolie dirigé par Mustapha Kemal <strong>de</strong>vint une structure<br />
organisée qui couvrait pratiquement tout le pays. Le Comité agissait tel<br />
un réel gouvernement dès que Ali Fuat Pacha fut nommé commandant<br />
<strong>de</strong>s forces miliciennes nationales d’Anatolie occi<strong>de</strong>ntale ayant pour<br />
mission <strong>de</strong> lutter contre l’armée grecque.<br />
Le Mouvement national en Anatolie <strong>de</strong>vint si efficace que le gouvernement<br />
d’Istanbul dut prêter une plus gran<strong>de</strong> attention aux nationalistes.<br />
Ainsi, le premier ministre Damat Ferid Pacha, un farouche opposant au<br />
Mouvement national et un probritannique fervent, dut démissionner et<br />
fut remp<strong>la</strong>cé par Ali Riza Pacha plus comp<strong>la</strong>isant à l’égard du Mouvement.<br />
Ce <strong>de</strong>rnier dépêcha le ministre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Marine, Salih Pacha, auprès<br />
<strong>de</strong> Mustapha Kemal pour négocier. Les <strong>de</strong>ux hommes se rencontrèrent<br />
à Amasya les 20 et 22 octobre 1919 et signèrent un protocole par lequel<br />
ils s’engageaient à défendre l’intégrité territoriale telle qu’elle a été<br />
définie par l’armistice <strong>de</strong> Moudros. Salih Pacha accepta également que<br />
le parlement ottoman se tienne en quelque lieu <strong>de</strong> l’Anatolie et non à<br />
Istanbul. Le 27 décembre, Mustapha Kemal tr<strong>ans</strong>féra son Comité exécutif<br />
à Ankara pour y établir le centre permanent <strong>de</strong>s Mouvements nationaux.<br />
En outre, Ankara fut choisie car plus proche du front <strong>de</strong> l’ouest<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
127
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
128<br />
et d’Istanbul. De <strong>la</strong> sorte, Mustapha Kemal était en position d’é<strong>la</strong>rgir<br />
son contrôle sur le Parlement via ses partis<strong>ans</strong> choisis en Anatolie pour<br />
<strong>de</strong>venir membres du Parlement. Ankara acquit très vite <strong>de</strong> l’importance<br />
pour Mustapha Kemal et son Comité exécutif.<br />
Le Serment national<br />
A cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> pression que faisait subir les Ang<strong>la</strong>is, Ali Riza était<br />
d<strong>ans</strong> l’incapacité <strong>de</strong> faire reconnaître <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s termes du Protocole<br />
d’Amasya. Il parvint néanmoins le 12 janvier 1920 à rassembler<br />
le Parlement ottoman à Istanbul. Avant ce<strong>la</strong>, <strong>de</strong> nouvelles élections<br />
parlementaires avaient eu lieu. Le gouvernement d’Ali Riza était probablement<br />
perçu comme une aubaine par les nationalistes si ce n’est<br />
que le Parlement vivait sous <strong>la</strong> menace du bataillon ang<strong>la</strong>is stationné à<br />
Istanbul. Le Serment national fut toutefois reconnu par le Parlement<br />
comme l’avait suggéré Mustapha Kemal aux députés venus lui rendre<br />
visite avant son arrivée à Istanbul.<br />
La première c<strong>la</strong>use du Serment était d’une gran<strong>de</strong> importance : elle<br />
stipu<strong>la</strong>it que l’avenir <strong>de</strong>s territoires habités par une popu<strong>la</strong>tion majoritairement<br />
arabe au moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> signature du Traité <strong>de</strong> Moudros le<br />
30 octobre 1918, serait déterminé par un référendum. Les territoires<br />
qui n’étaient pas occupés à ce moment et qui étaient habités majoritairement<br />
par <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions turques musulmanes appartiendraient à<br />
<strong>la</strong> patrie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Nation turque. Une autre c<strong>la</strong>use du Serment réc<strong>la</strong>mait<br />
l’indépendance et <strong>la</strong> liberté du pays afin <strong>de</strong> pouvoir le développer d<strong>ans</strong><br />
tous les domaines et ajoutait que toute restriction sur le développement<br />
politique, constitutionnel, et financier du pays serait levée.<br />
Les chefs du Mouvement national turc énoncèrent leurs objectifs d<strong>ans</strong><br />
un Serment national d<strong>ans</strong> lequel ils proc<strong>la</strong>mèrent leur détermination<br />
à poursuivre <strong>la</strong> résistance pour le salut et l’indépendance totale <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Nation turque. Le Serment délimita également les frontières d’une<br />
nouvelle <strong>Turquie</strong> habitée par une majorité <strong>de</strong> musulm<strong>ans</strong>, unis d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
foi, <strong>la</strong> culture et <strong>la</strong> race.<br />
Les puissances alliées n’étaient forcément pas ravies <strong>de</strong> cette déc<strong>la</strong>ration<br />
du Serment national. Elles manifestèrent leur réaction en occupant<br />
officiellement Istanbul le 16 mars 1920. Le Parlement ottoman<br />
fut dissous le 11 avril par le sultan. Les députés arrêtés par les Britanniques<br />
furent envoyés à Malte. D’autres, qui sont parvenus à échapper à<br />
l’arrestation, rejoignirent Mustapha Kemal à Ankara. Ce <strong>de</strong>rnier avait<br />
voulu que le Parlement se tienne à Ankara ou en un lieu en Anatolie<br />
comme Bursa, et ce qu’il avait prévu arriva.
La renaissance d’une Nation<br />
Mustapha Kemal envoya un mémorandum aux représentants <strong>de</strong>s Alliés<br />
à Istanbul et aux parlements français, ang<strong>la</strong>is et italien en signe <strong>de</strong><br />
protestation contre l’invasion. De son côté, Kazim Karabekir, le commandant<br />
du 15è corps <strong>de</strong> l’armée, arrêta le colonel ang<strong>la</strong>is Rawlinson<br />
ainsi que 20 autres ressortissants ang<strong>la</strong>is en protestation contre l’invasion<br />
d’Istanbul. Après ce<strong>la</strong>, Mustapha Kemal défendit toute re<strong>la</strong>tion<br />
<strong>de</strong> quelque nature que ce soit avec le gouvernement d’Istanbul. Il émit<br />
une circu<strong>la</strong>ire le 19 mars déc<strong>la</strong>rant qu’un nouveau parlement au pouvoir<br />
extraordinaire <strong>de</strong>vait être rassemblé à Ankara. Il serait composé<br />
<strong>de</strong> députés <strong>de</strong> l’ancien Parlement et <strong>de</strong> nouveaux membres élus par le<br />
peuple turc. La question à ce point <strong>de</strong> développement était <strong>de</strong> savoir si<br />
le nouveau parlement serait <strong>la</strong> continuation du Parlement ottoman ou<br />
non. Mustapha Kemal vou<strong>la</strong>it que ce Parlement soit ‘constitutionnel’.<br />
Mais pour échapper à <strong>de</strong> longs débats sur sa nature, il décida <strong>de</strong> le<br />
nommer <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Assemblée Nationale (GAN) qui se composerait<br />
<strong>de</strong> 300 députés. Elle ouvrit sa première séance le 23 avril 1920 avec<br />
Mustapha Kemal pour prési<strong>de</strong>nt. Il est évi<strong>de</strong>nt que cette nouvelle formation<br />
en Anatolie n’était pas seulement un mouvement dirigé contre<br />
les puissances d’occupation, mais marquait aussi <strong>la</strong> fondation d’un Etat<br />
nouveau. L’Assemblée Générale adopta <strong>la</strong> première Constitution le 20<br />
janvier 1921, qui stipu<strong>la</strong>it que :<br />
1. Le pouvoir national investi d<strong>ans</strong> l’Assemblée nationale est le<br />
principe fondamental pour l’avenir du pays.<br />
2. La Gran<strong>de</strong> Assemblée Nationale est investie <strong>de</strong>s pouvoirs légis<strong>la</strong>tifs<br />
et exécutifs.<br />
3. Un Comité qui sera élu au sein <strong>de</strong> l’Assemblée, exercera le pouvoir<br />
exécutif. Le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’Assemblée prési<strong>de</strong>ra aussi ce Comité.<br />
Les événements qui suivirent l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> GAN mirent <strong>la</strong> nouvelle<br />
administration <strong>de</strong>vant un choix difficile, entre <strong>la</strong> vie et <strong>la</strong> mort. Ils <strong>de</strong>vaient<br />
lutter sur <strong>de</strong>ux fronts : d’abord avec Istanbul et les puissances<br />
alliées ; puis contre les révoltes en Anatolie, fomentées pour <strong>la</strong> plupart<br />
par ces mêmes puissances. Après <strong>la</strong> dissolution du pouvoir ottoman,<br />
Ali Riza Pacha fut remp<strong>la</strong>cé par Damat Ferit Pacha favorable aux Ang<strong>la</strong>is<br />
et qui coopérait avec les Alliés pour mettre à mal le gouvernement<br />
d’Ankara. Au même moment, se tenait à San Remo une conférence<br />
internationale organisée par les puissances alliées (18-26 avril 1920)<br />
autour <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle on discutait <strong>de</strong>s termes du traité <strong>de</strong> paix qui <strong>de</strong>vait<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
129
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
130<br />
être signé avec les Turcs. Une première ébauche du traité fut proposée<br />
aux Turcs qui le rejetèrent comme inacceptable vu qu’il suggérait le démembrement<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. Le 22 juin, les forces grecques envahirent<br />
<strong>la</strong> ligne ouest entre Uşak et Bursa pour forcer les Turcs à accepter les<br />
offres <strong>de</strong> paix <strong>de</strong>s Alliés. Le 8 juillet, l’invasion <strong>de</strong> Bursa était effective,<br />
et <strong>de</strong> là, toute <strong>la</strong> région égéenne et <strong>la</strong> Thrace orientale. Sous <strong>de</strong> telles<br />
pressions, le gouvernement <strong>de</strong> Damat Ferit Pacha dut signer le Traité<br />
<strong>de</strong> Sèvres le 10 août 1920. Ce traité consacrait le dépeçage <strong>de</strong> l’Empire<br />
ottoman conformément aux accords secrets établis par les puissances<br />
alliées. La <strong>Turquie</strong>, dont les frontières avaient été définies par le Serment<br />
national, se voyait limitée à Istanbul et son arrière-pays et à une<br />
mince partie <strong>de</strong> l’Anatolie. Les Alliés ne <strong>la</strong>issèrent que peu d’espace aux<br />
Turcs en Anatolie. Le Traité <strong>de</strong> Sèvres fut catégoriquement rejeté par <strong>la</strong>
GAN et ceux qui signèrent le Traité furent déc<strong>la</strong>rés ‘traîtres’. Ce fut un<br />
accord avorté en l’absence du Parlement ottoman aboli après l’occupation<br />
d’Istanbul par les Alliés. Dû à cette absence, le Traité ne fut donc<br />
pas envoyé au sultan Mehmed VI pour être ratifié, et ne parut même<br />
pas d<strong>ans</strong> le journal officiel, le Takvim-i Vakayi. De surcroît, aucun autre<br />
pays hormis <strong>la</strong> Grèce ne ratifia le Traité.<br />
La lutte pour <strong>la</strong> liberté<br />
Le Traité ne fut pas ratifié en raison <strong>de</strong> <strong>la</strong> forte opposition <strong>de</strong> <strong>la</strong> GAN et<br />
du rejet très vif <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion turque. Pour autant, les Alliés n’abandonnèrent<br />
pas leurs objectifs en <strong>Turquie</strong>. Ils fomentèrent <strong>de</strong>s insurrections<br />
par-ci par-là en Anatolie avec <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration du gouvernement<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
131
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
132<br />
d’Istanbul et menèrent une propagan<strong>de</strong> d<strong>ans</strong> l’est anatolien appe<strong>la</strong>nt à<br />
l’établissement <strong>de</strong>s Etats arménien et kur<strong>de</strong> indépendants. Les Arméniens,<br />
impatients d’avoir leur part <strong>de</strong> l’Anatolie orientale pour réaliser<br />
leur projet <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong> Arménie qui fut à chaque fois repoussé par les<br />
Alliés, attaquèrent et massacrèrent <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Kazim<br />
Karabekir fut chargé d’attaquer les forces arméniennes et les repoussa<br />
au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s frontières turques. Le 18 novembre 1920, on appe<strong>la</strong> à un<br />
cessez-le-feu sur le front <strong>de</strong> l’est et un traité <strong>de</strong> paix dit Traité <strong>de</strong> Gumri<br />
fut signé le 3 décembre 1920.<br />
Une autre lutte commencée juste après l’armistice <strong>de</strong> Moudros se dérou<strong>la</strong>it<br />
sur le front du sud. Les forces françaises avaient occupé les régions<br />
sud <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> après l’armistice mais durent faire face à un<br />
immense mouvement <strong>de</strong> résistance organisée <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion locale<br />
soutenue par <strong>la</strong> GAN. Le conflit avec les Français prit fin avec les Accords<br />
d’Ankara le 20 octobre 1921.<br />
Un nouveau conflit éc<strong>la</strong>ta en Thrace orientale lorsque les Grecs envahirent<br />
<strong>la</strong> région en 1920. Déjà, <strong>de</strong> ru<strong>de</strong>s affrontements eurent lieu au<br />
moment <strong>de</strong> l’occupation grecque <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie ouest <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. Avec<br />
<strong>la</strong> prise d’Izmir par les Grecs, les popu<strong>la</strong>tions vivant d<strong>ans</strong> les zones<br />
occupées organisèrent <strong>de</strong>s milices pour se défendre <strong>de</strong> <strong>la</strong> cruauté <strong>de</strong>s<br />
Grecs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. Ces milices commencèrent à s’organiser en une<br />
armée nationale après l’ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> GAN. Ainsi, vers <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année<br />
1920, le gouvernement d’Ankara se trouvait en présence d’une armée<br />
nationale organisée. Ce fut une étape <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> importance pour<br />
<strong>la</strong> GAN à un moment où les Grecs entamèrent leur campagne à l’intérieur<br />
<strong>de</strong> l’Anatolie au début <strong>de</strong> l’année 1921.<br />
Le 6 janvier 1921, les troupes grecques marchèrent d’abord <strong>de</strong> Bursa et<br />
d’Uşak vers Eskişehir et Afyon mais furent défaits à <strong>la</strong> première bataille<br />
menée par Inönü le 11 janvier 1921 et durent battre en retraite. Suite<br />
à ces premiers succès <strong>de</strong>s Turcs sur le front ouest, les Alliés crurent<br />
nécessaire d’apporter quelques modifications aux c<strong>la</strong>uses du Traité <strong>de</strong><br />
Sèvres. Ils invitèrent donc les Turcs à <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> Londres qui se<br />
tint du 21 février au 12 mars 1921. Quand bien même les Turcs ne<br />
parvinrent pas à prendre d’importantes résolutions, cette conférence<br />
leur fut utile d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où elle fit connaître le Mouvement national<br />
turc à travers le mon<strong>de</strong>. Comme <strong>la</strong> GAN rejetait l’offre <strong>de</strong>s Alliés,<br />
les troupes grecques furent encouragées par les Britanniques à <strong>la</strong>ncer<br />
une nouvelle attaque. Le 30 mars marqua une nouvelle fois leur défaite<br />
<strong>de</strong>vant l’armée d’Inönü.
Entre-temps, l’Italie qui avait établi <strong>de</strong>puis peu <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions<br />
avec Ankara, commençait à retirer ses troupes d’Anta<strong>la</strong>ya et <strong>de</strong> ses<br />
environs vers le mois <strong>de</strong> juin. Cette décision marquait une rupture<br />
entre les Alliés. Néanmoins, les forces grecques furent victorieuses aux<br />
batailles d’Eskişehir et <strong>de</strong> Kutahya les 10 et 24 juin 1921. Mustapha<br />
Kemal ordonna alors à l’armée turque <strong>de</strong> se retirer en position défensive<br />
à l’est <strong>de</strong> Sakarya, à une cinquantaine <strong>de</strong> kilomètres d’Ankara. Ce<br />
retrait tactique <strong>de</strong>vait donner le temps <strong>de</strong> réorganiser l’armée. Mais<br />
cette opération suscita <strong>de</strong> nombreuses réactions critiques à <strong>la</strong> GAN<br />
qui était en état <strong>de</strong> panique. C’est alors que Mustapha Kemal convint<br />
<strong>la</strong> GAN <strong>de</strong> lui remettre les pleins pouvoirs et se fit nommer commandant<br />
en chef grâce à une loi entérinée le 5 août 1921. Il mit en p<strong>la</strong>ce<br />
les préparatifs nécessaires pour un assaut final sur les troupes grecques<br />
en Anatolie. De leur côté, les troupes grecques avaient hâte, après leurs<br />
victoires, d’attaquer les troupes turques pour leur infliger <strong>la</strong> défaite<br />
finale. Mais à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Sakarya (entre le 23 août et le<br />
13 septembre 1921) qui s’étendait sur un front <strong>de</strong> 100 kilomètres, les<br />
troupes grecques furent obligées <strong>de</strong> se replier vers l’ouest mettant fin<br />
à l’offensive en Anatolie. La GAN qui avait formulé <strong>de</strong>s critiques à<br />
l’encontre <strong>de</strong> Mustapha Kemal avant <strong>la</strong> bataille, le récompensa en lui<br />
accordant le titre <strong>de</strong> Maréchal et <strong>de</strong> Ghazi (Héros Vétéran) pour ses<br />
exploits à <strong>la</strong> bataille <strong>de</strong> Sakarya.<br />
Grâce à ces exploits, <strong>la</strong> GAN gagna en crédibilité, non seulement aux<br />
yeux <strong>de</strong>s Turcs, mais également vis-à-vis du mon<strong>de</strong> entier et même<br />
parmi les Alliés. Le Traité d’Ankara fut signé avec <strong>la</strong> France le 20 octobre<br />
1921. Les traité <strong>de</strong> Kars fut quant à lui signé avec les Etats <strong>de</strong><br />
l’Azerbaïdjan, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Géorgie et <strong>de</strong> l’Arménie, rendant <strong>de</strong> <strong>la</strong> sorte les<br />
frontières turques <strong>de</strong> l’est plus sûres. Après Sakarya, <strong>la</strong> coopération<br />
gréco-britannique prit fin.<br />
Suite à ces développements, <strong>la</strong> Grèce voulut que les forces alliées jouent<br />
les médiateurs en faveur d’une trêve avec les Turcs mais Ankara <strong>la</strong> rejeta.<br />
Malgré <strong>la</strong> victoire <strong>de</strong> l’armée turque, elle n’était pas encore en position<br />
<strong>de</strong> pouvoir repousser complètement les occupants d’Anatolie. Les<br />
Turcs avaient besoin <strong>de</strong> temps pour mettre sur pied une armée soli<strong>de</strong><br />
prête à donner l’assaut final contre l’armée grecque, et ce<strong>la</strong> prit un an,<br />
temps pendant lequel les troupes <strong>de</strong>s fronts est et sud furent tr<strong>ans</strong>férées<br />
vers le front occi<strong>de</strong>ntal ainsi que les munitions. Mustapha Kemal, le<br />
commandant en chef, ordonna que tous les préparatifs soient prêts le<br />
15 août 1922.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
133
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
134<br />
La gran<strong>de</strong> offensive fut <strong>la</strong>ncée le 26 août, sous le comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong><br />
Mustapha Kemal, du général Fevzi (Çakmak) et du général Ismet<br />
(Inönü). Les forces grecques furent encerclées et ce fut <strong>la</strong> débâcle<br />
d<strong>ans</strong> ses rangs. Certains furent faits prisonniers. Le 30 août, les forces<br />
turques vainquirent les Grecs d<strong>ans</strong> une bataille rangée dite ‘La bataille<br />
du Commandant en chef ’ qui n’était autre que Mustapha Kemal. L’armée<br />
turque poursuivit son opération, et le 9 septembre pénétra à Izmir,<br />
le 11 à Bursa et finalement, le 18 septembre, tout le pays fut libéré <strong>de</strong><br />
l’occupation grecque.<br />
La phase finale du conflit:<br />
La formidable victoire <strong>de</strong> Mustapha Kemal<br />
La <strong>de</strong>rnière chose à faire pour Mustapha Kemal était <strong>de</strong> libérer Istanbul,<br />
les détroits <strong>de</strong>s Dardanelles et du Bosphore et <strong>la</strong> Thrace orientale.<br />
Toutefois, <strong>la</strong> tension entre les troupes turques et britanniques était<br />
à son comble lorsque le premier ministre ang<strong>la</strong>is, Llyod Georges, dé-
c<strong>la</strong>ra que ce<strong>la</strong> justifiait un casus belli. Cette fois, <strong>la</strong> guerre était imminente<br />
entre <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne et <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, les troupes d’occupation<br />
britanniques étant postées pas loin <strong>de</strong> Chanak (Çanakkale), un petit<br />
port situé sur les bords du détroit <strong>de</strong>s Dardanelles. Le 15 septembre, <strong>la</strong><br />
Gran<strong>de</strong> Bretagne envoya un télégramme faisant appel à <strong>la</strong> contribution<br />
<strong>de</strong> ses colonies en soldats pour démontrer <strong>la</strong> solidarité au sein <strong>de</strong> son<br />
Empire contre les Turcs. Cette crise fut appelée l’‘Affaire <strong>de</strong> Chanak’.<br />
Le len<strong>de</strong>main, <strong>la</strong> requête fut rendue publique, accusant ainsi une tr<strong>ans</strong>gression<br />
<strong>de</strong> l’étiquette impériale et du bon sens politique. En fait, <strong>la</strong><br />
France et l’Italie se sont désolidarisées <strong>de</strong> l’Angleterre, <strong>la</strong> <strong>la</strong>issant seule<br />
d<strong>ans</strong> cette affaire. Le public britannique n’étant pas non plus favorable<br />
à une guerre et les Turcs <strong>de</strong> leur côté s’engageant à ne pas fermer les<br />
détroits, <strong>la</strong> crise prit fin rapi<strong>de</strong>ment.<br />
Les pourparlers <strong>de</strong> paix<br />
Les victoires remportées par l’armée turque amenèrent les Alliés à discuter<br />
les modalités d’une trêve avec Mustapha Kemal. Finalement, le<br />
11 octobre 1922, l’armistice <strong>de</strong> Mudanya fut signé, ouvrant <strong>la</strong> voie au<br />
Traité <strong>de</strong> Lausanne. Conformément à cet armistice, les Grecs <strong>de</strong>vaient<br />
évacuer d<strong>ans</strong> les 15 jours <strong>la</strong> Thrace orientale qui revenait aux Turcs.<br />
Les forces alliées présentes à Istanbul et d<strong>ans</strong> le Bosphore y resteraient<br />
jusqu’à <strong>la</strong> signature du traité <strong>de</strong> paix. Sous occupation étrangère <strong>de</strong>puis<br />
le traité <strong>de</strong> Moudros, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> était maintenant délivrée <strong>de</strong> l’occupation.<br />
Le moment était venu <strong>de</strong> discuter les termes d’un nouveau traité<br />
<strong>de</strong> paix. A l’époque, le Traité <strong>de</strong> Sèvres, imposé au gouvernement ottoman<br />
par les Alliés, entérinait <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> guerre, mais fut rejeté<br />
par <strong>la</strong> GAN, entraînant une série <strong>de</strong> conflits due au rejet <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>uses<br />
qu’il contenait. Les nationalistes et leur chef Mustapha Kemal firent<br />
en sorte <strong>de</strong> rendre le Traité <strong>de</strong> Sèvres inapplicable. Le 20 novembre,<br />
s’ouvrirent à Lausanne, en Suisse, les négociations pour remp<strong>la</strong>cer le<br />
Traité <strong>de</strong> Sèvres, négociations entamées cette fois sur un pied d’égalité.<br />
Les Alliés convoquèrent à <strong>la</strong> table <strong>de</strong>s négociations aussi bien le gouvernement<br />
ottoman d’Istanbul que le gouvernement national d’Ankara<br />
pour mieux jouer <strong>de</strong> l’un contre l’autre et insinuer l’existence <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux<br />
gouvernements en <strong>Turquie</strong>. Cette dualité <strong>de</strong>s apparences aurait pu<br />
mettre l’intégrité du pays en danger. C’est à cette occasion que Mustapha<br />
Kemal abolit le sultanat perçu comme un système suranné. Le 1 er<br />
novembre 1922 signa officiellement <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’Empire ottoman. Mais<br />
comme les sult<strong>ans</strong> portaient aussi le titre <strong>de</strong> Califes, Abdulmedjid fut<br />
désigné calife à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> Mehmed VI déchu <strong>de</strong> sa position <strong>de</strong> sultan.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
135
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
136<br />
La dynastie ottomane garda le pouvoir <strong>de</strong> califat entre ses mains, mais<br />
<strong>la</strong> GAN <strong>de</strong>vint <strong>la</strong> seule autorité du pays.<br />
Les négociations entre les Alliés et <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> commencèrent alors à <strong>la</strong><br />
conférence qui se tenait à Lausanne à partir du 20 novembre 1922. La<br />
délégation turque était menée par Ismet Bey (Inönü). La conférence<br />
s’interrompit le 4 février 1923 et ne reprit que le 23 avril. Tandis que<br />
les délégations turques insistaient sur les termes du Serment national<br />
<strong>de</strong> 1920, les puissances alliées tenaient davantage aux termes du Traité<br />
<strong>de</strong> Sèvres. Les principales querelles néanmoins tournaient autour <strong>de</strong>s<br />
questions <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte ottomane, <strong>de</strong>s capitu<strong>la</strong>tions, du statut <strong>de</strong>s détroits<br />
turcs et <strong>de</strong> <strong>la</strong> frontière irakienne.<br />
Au bout <strong>de</strong> longues discussions, un accord fut finalement arrêté à<br />
Lausanne le 24 juillet 1923. Le Traité confirma l’indépendance <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
République turque et marqua <strong>la</strong> reconnaissance internationale du gouvernement<br />
<strong>de</strong> Mustapha Kemal à Ankara et <strong>de</strong> l’Etat turc. Ce fut une<br />
immense victoire pour les Turcs qui recouvraient leur totale indépendance.<br />
Les capitu<strong>la</strong>tions furent abolies. Désormais, il n’y aurait plus<br />
d’Etat autonome arménien ou kur<strong>de</strong>, ni aucune forme d’organisation<br />
politique d<strong>ans</strong> l’est <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. L’Anatolie occi<strong>de</strong>ntale ne ferait pas<br />
non plus partie du territoire grec. Les objectifs du Serment national<br />
voulu par Mustapha Kemal étaient presque remplis. Certaines questions<br />
<strong>de</strong>meuraient en suspens comme celles <strong>de</strong> Mossoul, Hatay (province<br />
d’Alexandrette) et <strong>de</strong>s détroits qui ne purent être résolues à <strong>la</strong><br />
conférence tel que l’avait envisagé le Serment national <strong>de</strong> 1920. La<br />
Gran<strong>de</strong> Bretagne persistait à vouloir rattacher Mossoul à l’Irak contrairement<br />
à ce qui a été suggéré par l’armistice <strong>de</strong> Moudros. Les détroits<br />
turcs furent démilitarisés et leur administration <strong>de</strong>vait être prise en<br />
charge par une commission internationale. La <strong>Turquie</strong> ne s’obstina pas<br />
sur ces questions et préféra conclure sur une paix <strong>de</strong>puis longtemps<br />
espérée. Elle pensa que ces problèmes seraient réglés par <strong>de</strong>s voies diplomatiques<br />
après un <strong>la</strong>ps <strong>de</strong> temps.
CHAPITRE 12<br />
La fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque<br />
Après les exploits militaires et politiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, <strong>de</strong>ux autres décisions<br />
importantes mais attendues furent prises : <strong>la</strong> première proc<strong>la</strong>ma<br />
Ankara capitale <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en 1923, le 13 octobre ; <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième fut<br />
<strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration par <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Assemblée Nationale <strong>de</strong> <strong>la</strong> République<br />
turque le 29 octobre 1923. La GAN élut Mustapha Kemal premier<br />
prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> nouvelle République, lui qui avait joué un rôle primordial<br />
d<strong>ans</strong> sa fondation. Il reste le fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> mo<strong>de</strong>rne. La<br />
popu<strong>la</strong>tion turque lui donna le nom d’ « Atatürk » qui signifie ‘ancêtre<br />
<strong>de</strong>s Turcs’.<br />
A. L’ère Atatürk (1923-1938): Les premières réformes<br />
Atatürk chargea Inönü <strong>de</strong> constituer un cabinet, puis il mena une série<br />
<strong>de</strong> réformes révolutionnaires pour jeter les fon<strong>de</strong>ments d’un Etat<br />
mo<strong>de</strong>rne basé sur <strong>de</strong>s principes démocratiques et <strong>la</strong>ïques. Le 3 mars<br />
1924, <strong>la</strong> GAN accepta une loi abolissant le califat. Le même jour, furent<br />
promulguées <strong>de</strong>ux autres lois : l’une abolissant le ministère <strong>de</strong>s<br />
Affaires religieuses et <strong>de</strong>s fondations pieuses (waqfs), l’autre au sujet<br />
<strong>de</strong> l’unification <strong>de</strong> l’éducation. Toutefois, pour régler les affaires religieuses<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> société, fut établi le Département <strong>de</strong>s Affaires religieuses.<br />
Pour satisfaire le besoin en personnel religieux, une faculté <strong>de</strong> théologie<br />
ouvrit ses portes à Darulfunun rebaptisée Université d’Istanbul<br />
en 1933. Du coup, toutes les écoles contrôlées par le Ministère <strong>de</strong>s<br />
Affaires religieuses et le Ministère <strong>de</strong>s Fondations pieuses fermèrent<br />
leurs portes. Avec l’unification <strong>de</strong> l’éducation, toutes les écoles passèrent<br />
sous le contrôle du Ministère <strong>de</strong> l’Education nationale en accord<br />
avec les principes nationaux et <strong>la</strong>ïques. L’un <strong>de</strong>s principaux objectifs<br />
d’Atatürk était <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rniser l’Etat et <strong>la</strong> société turque. Pour ce faire, il<br />
fal<strong>la</strong>it se battre pour promouvoir un système d’éducation mo<strong>de</strong>rne. De<br />
nombreuses écoles et universités virent le jour en 1930.<br />
Le 20 avril 1924, <strong>la</strong> nouvelle Constitution visant à réorganiser l’Etat fut<br />
promulguée par <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Assemblée Nationale turque. Les Lois du<br />
Commerce qui avaient été réformées durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Tanzimat<br />
selon les principes <strong>de</strong> <strong>la</strong> charia (loi is<strong>la</strong>mique) furent abolies. Le Co<strong>de</strong><br />
Civil turc entra en vigueur le 4 avril 1926 grâce auquel les femmes<br />
turques obtinrent <strong>de</strong>s droits fondamentaux ; ainsi <strong>de</strong> nouveaux jalons<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
137
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
138<br />
étaient posés sur <strong>la</strong> voie du progrès. La Loi Municipale <strong>de</strong> 1930 et <strong>la</strong><br />
Loi <strong>de</strong> l’Assemblée Nationale <strong>de</strong> 1934 garantissaient le droit <strong>de</strong> vote<br />
aux femmes qui se voyaient acquérir tous les droits politiques fondamentaux.<br />
En 1928, <strong>la</strong> mention « l’is<strong>la</strong>m est <strong>la</strong> religion officielle <strong>de</strong> l’Etat » fut<br />
retirée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Constitution en conformité avec l’esprit <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ïcité. La<br />
Constitution <strong>de</strong> 1937 posa comme principe d’élever <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> vers <strong>la</strong><br />
civilisation mo<strong>de</strong>rne et <strong>la</strong>ïque.<br />
Tentative avortée d’un système multipartite<br />
Aspirant à un système démocratique, Atatürk établit le Parti du Peuple<br />
le 9 septembre 1923 qu’il renommera le Parti Républicain du Peuple<br />
(PRR) lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> déc<strong>la</strong>ration <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
Evi<strong>de</strong>mment, l’un <strong>de</strong>s principes d’un système démocratique est l’existence<br />
<strong>de</strong> divers partis politiques. La <strong>Turquie</strong> avait déjà connu plusieurs<br />
partis <strong>de</strong>puis 1908, puisque durant <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> secon<strong>de</strong> Constitution,<br />
certains partis furent fondés. Mais <strong>la</strong> prise forcée du pouvoir en<br />
1913 par le parti Union et Progrès qui établit sa dictature marqua <strong>la</strong><br />
naissance du système du parti unique.<br />
Après <strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, le nouvel Etat <strong>de</strong>vait faire face à<br />
une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> problèmes intérieurs et extérieurs. Les débats autour<br />
<strong>de</strong> ces problèmes provoquèrent le départ <strong>de</strong> certains députés du PRR<br />
tels Kazim Karabekir, Refet Bele et Rauf Orbay qui étaient les compagnons<br />
d’Atatürk pendant <strong>la</strong> lutte nationale. Ils formèrent un nouveau<br />
parti sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong> Karabekir appelé le Parti du Progrès Républicain<br />
(PPR) qui fut le premier parti d’opposition d<strong>ans</strong> l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
Au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique intérieure, ce parti était généralement<br />
considéré comme un parti à tendance is<strong>la</strong>miste. En fait, ce parti était<br />
respectueux à l’égard <strong>de</strong>s principes religieux et rassemb<strong>la</strong> tous ceux qui<br />
s’opposaient aux principes <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation voulus par Atatürk. Le<br />
programme du Parti du Progrès Républicain menaçait l’unité <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong> vu que cette opposition fut à l’origine <strong>de</strong> quelques événements<br />
regrettables. A cette époque, alors que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> était accaparée par <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong> Mossoul qui ne fut pas réglée pendant les négociations <strong>de</strong><br />
Lausanne, une rébellion menée par Cheikh Saïd éc<strong>la</strong>ta à l’Est. Elle fut<br />
matée avec grand peine le 31 mai 1925, puis on déc<strong>la</strong>ra que le PPR<br />
avait encouragé cette rébellion ainsi que <strong>de</strong>s activités séparatistes d<strong>ans</strong><br />
le pays. Le parti fut interdit le 5 juin 1925 mettant ainsi fin aux espoirs<br />
<strong>de</strong> créer un système multipartite du temps d’Atatürk.
Atatürk était pleinement conscient qu’un système <strong>de</strong> parti unique était<br />
incompatible avec <strong>la</strong> démocratie, et en dépit <strong>de</strong> l’échec <strong>de</strong> <strong>la</strong> première<br />
tentative, il <strong>de</strong>manda à son associé proche, Fethi Okyar, <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r un<br />
nouveau parti pour apaiser les mécontentements engendrés par les<br />
difficultés économiques et les programmes radicaux du gouvernement.<br />
Fethi Okyar quitta son poste d’ambassa<strong>de</strong>ur en France et retourna en<br />
<strong>Turquie</strong> pour assumer <strong>la</strong> direction du parti. Le Parti Républicain Libre<br />
vit le jour le 12 août 1930. Il favorisait une politique économique libérale<br />
et respectait les principes <strong>la</strong>ïques et démocratiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée<br />
d’Atatürk. Mais quand <strong>de</strong>s éléments religieux et d’autres commencèrent<br />
à s’organiser autour <strong>de</strong> ce nouveau parti, Fethi Okyar réalisa le<br />
danger que ce<strong>la</strong> posait au régime et décida par conséquent <strong>de</strong> mettre<br />
fin à ce parti le 17 novembre 1930. Ne parvenant pas à instaurer un<br />
système multipartite <strong>de</strong> son vivant, Atatürk préféra maintenir <strong>la</strong> démocratie<br />
en préservant le système parlementaire. N’oublions pas qu’à<br />
l’époque les systèmes dictatoriaux prédominaient à travers le mon<strong>de</strong>.<br />
La politique étrangère d’Atatürk<br />
On <strong>de</strong>vrait accor<strong>de</strong>r une importance particulière aux re<strong>la</strong>tions diplomatiques<br />
avec les pouvoirs impérialistes établies par Atatürk au len<strong>de</strong>main<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte nationale menée contre eux. En effet, le mon<strong>de</strong> au<br />
temps d’Atatürk était entraîné d<strong>ans</strong> une crise où le libéralisme était au<br />
bord <strong>de</strong> <strong>la</strong> faillite et les régimes dictatoriaux et tyranniques préva<strong>la</strong>ient<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> l’Europe. En considérant tout ce<strong>la</strong>, l’émergence<br />
d’un lea<strong>de</strong>r comme Atatürk était un atout non seulement pour<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> mais aussi pour le mon<strong>de</strong>. Lui qui s’était longtemps battu<br />
contre les pouvoirs impérialistes occi<strong>de</strong>ntaux pour défendre son pays,<br />
choisit finalement d’adopter un système politique <strong>de</strong> style occi<strong>de</strong>ntal.<br />
Ainsi, il <strong>de</strong>vint l’un <strong>de</strong>s rares lea<strong>de</strong>rs d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> à se faire l’avocat <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> paix usant <strong>de</strong> <strong>la</strong> diplomatie comme moyen <strong>de</strong> résoudre les problèmes.<br />
Les objectifs du Mouvement national furent <strong>la</strong>rgement atteints avec le<br />
Traité <strong>de</strong> Lausanne <strong>de</strong> 1923 qui accepta juridiquement l’existence <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong> mo<strong>de</strong>rne reconnue par l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> communauté internationale.<br />
Encore que, pour <strong>la</strong> première fois d<strong>ans</strong> son histoire, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
restait privée <strong>de</strong> son entière souveraineté sur les détroits pour <strong>la</strong> sécurité<br />
<strong>de</strong>squels les puissances européennes se sentaient tant concernées.<br />
La <strong>Turquie</strong> d’Atatürk était loin d’être satisfaite tant que subsistaient <strong>la</strong><br />
commission <strong>de</strong>s détroits et les zones démilitarisées, d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong><br />
question <strong>de</strong>s détroits constituait une barrière <strong>de</strong>vant l’aspiration à une<br />
pleine souveraineté nationale. Elle ne put insister davantage sur une ré-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
139
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
140<br />
solution finale à Lausanne avec<br />
<strong>la</strong> menace <strong>de</strong>s navires ang<strong>la</strong>is<br />
amarrés à l’extérieur d’Istanbul,<br />
elle attendait donc le moment<br />
opportun. Tevfik Rüştü Aras,<br />
l’un <strong>de</strong>s délégués <strong>de</strong> l’Assemblée<br />
Nationale engagé d<strong>ans</strong> les négociations<br />
<strong>de</strong> Lausanne et <strong>de</strong>venu<br />
plus tard ministre <strong>de</strong>s Affaires<br />
étrangères, déc<strong>la</strong>ra qu’après <strong>de</strong><br />
longues discussions il fut conclu<br />
que, même si <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong>s<br />
détroits ne contredisait pas le<br />
Serment National <strong>de</strong> 1920, les<br />
c<strong>la</strong>uses concernant <strong>la</strong> démilitarisation<br />
<strong>de</strong>s détroits mettraient à<br />
coup sûr <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> d<strong>ans</strong> une situation d’insécurité. Pour arriver à un<br />
règlement pacifique, il fut décidé finalement que tant que les quatre<br />
puissances (<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne, <strong>la</strong> France, l’Italie et le Japon) garantissaient<br />
<strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong>s détroits et <strong>la</strong> possibilité d’une base militaire en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s zones, ceci apporterait les mesures <strong>de</strong> protection militaire<br />
nécessaires.<br />
En somme, <strong>la</strong> ligne poursuivie par les responsables <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<br />
étrangère turque, essentiellement Atatürk, était le fruit <strong>de</strong> leur expérience<br />
<strong>de</strong>puis l’époque ottomane et <strong>la</strong> lutte du Mouvement national<br />
après 1918 qui, d<strong>ans</strong> une certaine mesure, les incita à adopter une politique<br />
étrangère pragmatique et pru<strong>de</strong>nte. Après le démembrement<br />
<strong>de</strong> l’Empire ottoman, l’élite kémaliste était déterminée à établir un<br />
Etat-nation reposant sur <strong>de</strong>s modèles occi<strong>de</strong>ntaux contemporains.<br />
L’approche pragmatique <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique étrangère dictait également le<br />
besoin d’un climat pacifique afin <strong>de</strong> mener à bien les réformes à l’intérieur<br />
du pays, et ce<strong>la</strong> faisait partie du processus <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation visant<br />
une complète indépendance tant politique qu’économique et idéologique<br />
et par conséquent, aligner <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> au niveau <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt<br />
et remédier à sa faiblesse économique. En réalité, l’élite gouvernante<br />
était suffisamment consciente du fait que cette attitu<strong>de</strong> était le seul<br />
moyen d’instaurer un climat pacifique d<strong>ans</strong> une telle région géographiquement<br />
au carrefour <strong>de</strong> l’Est et l’Ouest, où les puissances européennes<br />
avaient d’immenses intérêts, particulièrement d<strong>ans</strong> le cas <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne et <strong>de</strong> l’Union Soviétique (URSS).
Quelques mois après les accords <strong>de</strong> Lausanne, <strong>la</strong> première préoccupation<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en matière <strong>de</strong> politique étrangère était <strong>de</strong> résoudre<br />
les problèmes restés en suspens d<strong>ans</strong> le Traité, et le plus important<br />
d’entre eux était l’épineuse question <strong>de</strong> Mossoul disputée à <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne. Finalement, ce fut à <strong>la</strong> faveur <strong>de</strong> cette <strong>de</strong>rnière qu’un arrangement<br />
fut trouvé par le biais du Conseil <strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>s Nations le<br />
6 décembre 1925. La décision du conseil conduisit inévitablement à<br />
un rapprochement entre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et l’URSS. Le len<strong>de</strong>main même <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> décision du Conseil, les <strong>de</strong>ux pays signèrent un traité d’amitié nullement<br />
fondé sur <strong>de</strong>s affinités idéologiques, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> mo<strong>de</strong>rne ayant<br />
adopté les principes occi<strong>de</strong>ntaux incompatibles avec le bolchevisme.<br />
Toujours est-il que les circonstances <strong>de</strong> l’époque rendaient <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
vulnérable à l’influence économique et politique <strong>de</strong>s Soviétiques <strong>de</strong>puis<br />
que ces <strong>de</strong>rniers, prenant <strong>de</strong> l’ascendant, cherchaient à imposer leur<br />
empreinte politique sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. En effet, l’Union Soviétique justifiait<br />
cette attitu<strong>de</strong> par <strong>la</strong> lenteur du rapprochement entre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et<br />
l’Occi<strong>de</strong>nt après <strong>la</strong> résolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> Mossoul par le traité<br />
anglo-turc du 6 juin 1926.<br />
Etant donné que les principes d’intégrité territoriale et d’indépendance<br />
totale étaient d’une importance capitale pour <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> kémaliste<br />
<strong>de</strong>puis son origine, le pays voyait <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Lausanne<br />
sur les détroits comme une solution insatisfaisante qui empiétait sur<br />
son indépendance, l’exposait à <strong>de</strong> sérieuses agressions et affaiblissait<br />
sa position sur <strong>la</strong> scène diplomatique internationale. Et comme elle<br />
ne se sentait pas en sécurité, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> trouva le moyen <strong>de</strong> minimiser<br />
l’impact <strong>de</strong> cette convention en construisant une nouvelle route à<br />
l’intérieur <strong>de</strong>s zones démilitarisées afin <strong>de</strong> lui permettre <strong>de</strong> mobiliser<br />
son armée, d’installer une artillerie à <strong>la</strong> limite et même à l’intérieur <strong>de</strong>s<br />
zones, et p<strong>la</strong>cer <strong>de</strong>s mines aux débouchés <strong>de</strong>s Dardanelles et à l’entrée<br />
du Bosphore pour pouvoir fermer les détroits en cas d’agression. Cette<br />
solution était malgré tout encore insatisfaisante d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> mesure où le<br />
Traité <strong>de</strong> Lausanne maintenait <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> dépendante <strong>de</strong> son amitié<br />
avec l’URSS.<br />
Les re<strong>la</strong>tions étroites avec l’URSS, qui ne durèrent d’ailleurs qu’une<br />
décennie, ont montré que <strong>la</strong> politique soviétique vis-à-vis <strong>de</strong>s détroits<br />
n’était pas si différente <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique tsariste. Les soviétiques maintenaient<br />
leur pression sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> pour s’assurer une position plus<br />
favorable et ce au mépris <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Lausanne. Ceci étant, l’URSS,<br />
al<strong>la</strong>nt à l’encontre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Lausanne, proposa au gouverne-<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
141
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
142<br />
ment turc, en tant que mesure défensive commune au cas où elle serait<br />
impliquée d<strong>ans</strong> une guerre, <strong>de</strong> fermer les détroits aux navires <strong>de</strong> guerre<br />
<strong>de</strong>s parties belligérantes. En d’autres termes, Moscou essayait par un<br />
moyen ou un autre <strong>de</strong> tirer avantage <strong>de</strong> ses bonnes re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>.<br />
D<strong>ans</strong> cet ordre, le gouvernement soviétique cherchait à faire <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong> une barrière entre lui et les autres puissances navales, particulièrement<br />
<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne. Mais l’approche <strong>de</strong> l’URSS fut mal accueillie<br />
par les déci<strong>de</strong>urs politiques turcs qui pensaient qu’entretenir <strong>de</strong><br />
bonnes re<strong>la</strong>tions avec l’URSS <strong>la</strong> p<strong>la</strong>cerait d<strong>ans</strong> une position plus forte,<br />
ce qui était contraire aux principes <strong>de</strong> politique étrangère d’Atatürk.<br />
Par conséquent, l’élite kémaliste était décidée à établir avec les pays occi<strong>de</strong>ntaux<br />
<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions basées sur l’égalité et à travers lesquelles <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
pourrait s’assurer une position plus stable d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région. D’autre<br />
part, les politiques turcs savaient pertinemment, ayant faits l’expérience<br />
avec l’affaire <strong>de</strong> Mossoul, qu’un éventuel conflit avec les pays occi<strong>de</strong>ntaux<br />
mettrait l’URSS d<strong>ans</strong> une position prédominante par rapport à <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong>. Il était c<strong>la</strong>ir que cette <strong>de</strong>rnière n’apprécierait pas <strong>la</strong> présence<br />
constante <strong>de</strong> l’URSS le long <strong>de</strong> ses frontières. Au lieu <strong>de</strong> ce<strong>la</strong>, <strong>la</strong> politique<br />
étrangère turque se tourna vers l’Occi<strong>de</strong>nt et tous ses voisins<br />
avec qui elle cherchait à établir <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions afin <strong>de</strong> se faire une<br />
p<strong>la</strong>ce respectable d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> diplomatie internationale en tant que puissance<br />
régionale. En outre, on pensait qu’avoir <strong>de</strong> bonnes re<strong>la</strong>tions avec<br />
l’Occi<strong>de</strong>nt atténuerait <strong>la</strong> pression soviétique sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. A cette fin,<br />
l’amitié avec <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne était l’approche <strong>la</strong> plus pragmatique<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique étrangère.<br />
Parmi les premières mesures prises par <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> pour établir <strong>de</strong><br />
bonnes re<strong>la</strong>tions avec tous ses voisins, il y avait <strong>la</strong> signature <strong>de</strong> traités<br />
d’amitié rég<strong>la</strong>nt les questions <strong>de</strong> frontières ; elle orienta ensuite sa politique<br />
étrangère vers l’Occi<strong>de</strong>nt et parvint à un accord avec <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> Mossoul préférant ce<strong>la</strong> à <strong>de</strong>s revendications<br />
territoriales s<strong>ans</strong> fin.<br />
Après avoir insisté longtemps sur <strong>la</strong> préservation du régime <strong>de</strong>s capitu<strong>la</strong>tions<br />
et sur le remboursement <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>tte due à l’intervention passée<br />
<strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt d<strong>ans</strong> l’économie <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, <strong>la</strong> France trouva finalement<br />
<strong>de</strong>s arrangements avec <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> sur les questions financières<br />
et économiques en juin 1928. Toujours sur cette même ligne politique<br />
d’apaisement avec l’Occi<strong>de</strong>nt, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> signa un traité <strong>de</strong> neutralité<br />
avec l’Italie en mai 1928, et les difficiles re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> Grèce en-
trèrent d<strong>ans</strong> une phase <strong>de</strong> normalisation à partir <strong>de</strong> juin 1930. Des<br />
accords semb<strong>la</strong>bles furent conclus avec les pays orientaux : l’Irak, l’Iran<br />
et l’Afghanistan, ainsi qu’avec les pays balkaniques comme l’Albanie, <strong>la</strong><br />
Bulgarie et <strong>la</strong> Yougos<strong>la</strong>vie à <strong>la</strong> même pério<strong>de</strong>.<br />
Au <strong>de</strong>meurant, <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> comprise entre Lausanne et le début <strong>de</strong>s<br />
années 30 fut d’abord une phase d’introspection, <strong>la</strong> politique étrangère<br />
venait en second. La <strong>Turquie</strong> s’employait activement à définir son<br />
i<strong>de</strong>ntité nationale et à mener <strong>de</strong>s réformes intérieures et n’avait que<br />
peu <strong>de</strong> temps à consacrer aux affaires extérieures. Ce n’est qu’à partir <strong>de</strong><br />
1930 qu’elle entreprit une politique étrangère plus active. Elle se tourna<br />
vers les organisations internationales et s’impliqua davantage d<strong>ans</strong> les<br />
réunions bi<strong>la</strong>térales et multinationales d<strong>ans</strong> lesquelles <strong>la</strong> priorité était<br />
donnée à <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s détroits. En fait, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> profita <strong>de</strong> toutes<br />
les opportunités pour pointer le fait que les zones démilitarisées <strong>de</strong>s détroits<br />
mettaient non seulement en danger sa sécurité, mais menaçaient<br />
aussi <strong>la</strong> paix <strong>de</strong> <strong>la</strong> région. Il ne fait aucun doute que ces arguments<br />
faisaient écho à <strong>la</strong> prise en compte plus <strong>la</strong>rge <strong>de</strong> l’existence d’une réelle<br />
menace extérieure pesant sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et incarnée par les ambitions<br />
<strong>de</strong> l’Italie fasciste <strong>de</strong> dominer militairement <strong>la</strong> Méditerranée orientale<br />
et l’Anatolie. En effet, au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> <strong>la</strong> première guerre mondiale,<br />
on se rendait bien compte que le Traité <strong>de</strong> paix <strong>de</strong> Versailles avait exacerbé<br />
les ressentiments nationalistes qui avaient affligé toute l’Europe.<br />
La lutte pour <strong>la</strong> création d’un système <strong>de</strong> sécurité international afin <strong>de</strong><br />
maintenir les statu quo établis par les traités <strong>de</strong> paix, fut vaine et l’espoir<br />
frustré par les pays dépités par les accords au len<strong>de</strong>main <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
Mustapha Kemal prédisait l’imminence d’un autre grand conflit. Il fit<br />
remarquer lors <strong>de</strong> sa conversation avec le Général Mc Arthur en 1931<br />
que le Traité <strong>de</strong> Versailles n’avait pas supprimé les causes qui ont mené<br />
à <strong>la</strong> première guerre. Au contraire, il n’a fait qu’aggraver les désaccords<br />
entre les ennemis d’hier. Or, si une nouvelle guerre venait à éc<strong>la</strong>ter,<br />
aussi loin que ce<strong>la</strong> mettait <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en jeu, les détroits<br />
turcs auraient été en mauvaise posture. Dès lors, il était nécessaire <strong>de</strong><br />
prendre <strong>de</strong>s mesures préa<strong>la</strong>bles afin <strong>de</strong> garantir <strong>la</strong> sécurité <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>.<br />
Contrairement aux métho<strong>de</strong>s adoptées par les anciens Etats ennemis,<br />
le gouvernement turc était déterminé à atteindre son objectif en usant<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> diplomatie. En ce sens, l’adhésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> à <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>s<br />
Nations en 1932 fut considérée comme un grand succès, <strong>la</strong> sortant ainsi<br />
<strong>de</strong> son iso<strong>la</strong>tion diplomatique voulue par les pays occi<strong>de</strong>ntaux au len<strong>de</strong>main<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, et du champ d’influence <strong>de</strong> l’URSS. Alors que les<br />
re<strong>la</strong>tions turco-ang<strong>la</strong>ises s’amélioraient, les re<strong>la</strong>tions turco-soviétiques<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
143
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
144<br />
se détérioraient. Craignant, à juste titre, l’influence grandissante <strong>de</strong>s<br />
Britanniques sur les détroits, le gouvernement soviétique reprit <strong>la</strong> politique<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Russie impériale et chercha à conclure une alliance avec<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> qui lui aurait permis d’établir une base militaire d<strong>ans</strong> les<br />
détroits. Face à <strong>la</strong> pression croissante <strong>de</strong>s Soviétiques et à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong><br />
plus en plus préoccupante en Méditerranée orientale due à <strong>la</strong> présence<br />
italienne, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> accéléra son rapprochement <strong>de</strong>s pays occi<strong>de</strong>ntaux<br />
à qui elle <strong>de</strong>manda <strong>la</strong> révision <strong>de</strong> l’administration <strong>de</strong>s détroits.<br />
L’espoir <strong>de</strong> paix<br />
Pour <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, obtenir l’appui <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne d<strong>ans</strong> cette révision<br />
lui était d’une gran<strong>de</strong> importance, car elle pouvait espérer une<br />
conclusion en sa faveur. A cet égard, il est généralement accepté que<br />
l’année 1934 avec <strong>la</strong> nomination <strong>de</strong> Sir Percy Loraine comme ambassa<strong>de</strong>ur<br />
à Ankara, et Fethi Okyar, l’ami proche d’Atatürk, comme<br />
ambassa<strong>de</strong>ur turc à Londres, marqua le début d’une nouvelle ère d<strong>ans</strong><br />
le rapprochement turco-ang<strong>la</strong>is. Loraine noua une amitié personnelle<br />
avec Atatürk ; les <strong>de</strong>ux hommes jouaient souvent au poker jusqu’à tard<br />
d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> nuit. Évi<strong>de</strong>mment, ce que vou<strong>la</strong>it avant tout Atatürk, c’étaient<br />
les signes d’une amitié plus concrète qu’il attendait <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s années.<br />
Loraine recommanda au Foreign Office <strong>de</strong> renforcer les liens avec <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong>, mais Londres hésitait à s’engager plus avant d<strong>ans</strong> cette voie<br />
craignant que ce<strong>la</strong> n’aboutisse à <strong>de</strong>s gages <strong>de</strong> sécurité avec <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
au moment même où elle se réarmait et ne pouvait guère assumer une<br />
telle entreprise. Reste que cet épiso<strong>de</strong> a créé une atmosphère <strong>de</strong> compréhension<br />
entre les <strong>de</strong>ux pays.<br />
Face aux intentions agressives <strong>de</strong> l’Italie qui visaient aussi <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>,<br />
Ankara chercha par tous les moyens diplomatiques à obtenir les garanties<br />
<strong>de</strong> sa sécurité. La signature d’un Pacte <strong>de</strong>s Balk<strong>ans</strong> le 9 février<br />
1934 réunissant <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, <strong>la</strong> Yougos<strong>la</strong>vie, <strong>la</strong> Grèce et <strong>la</strong> Roumanie,<br />
ne fit qu’augmenter <strong>la</strong> pression pour une révision en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s<br />
accords d’après-guerre. L’un <strong>de</strong>s objectifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en formant ce<br />
pacte fut d’y intégrer <strong>la</strong> Bulgarie à <strong>de</strong>ssein <strong>de</strong> <strong>la</strong> séparer <strong>de</strong> l’Italie. Les<br />
Bulgares rejetèrent l’offre, mais Ankara s’assura du soutien <strong>de</strong>s autres<br />
pays balkaniques concernant <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s détroits.<br />
A partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> mi-mars 1936, ce fut un tournant d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s<br />
détroits, car le Traité <strong>de</strong> Versailles qui assurait à <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong>s motifs<br />
favorables à ces revendications était contesté <strong>de</strong> toute part, d’abord par
<strong>la</strong> campagne militaire italienne en Abyssinie en vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong> charte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Société <strong>de</strong>s Nations, et ensuite par <strong>la</strong> réoccupation alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
zone démilitarisée en Rhénanie le 7 mars 1936 en vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s traités<br />
<strong>de</strong> Versailles et <strong>de</strong> Locarno. Ces évènements ébranlèrent <strong>la</strong> crédibilité<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> loi internationale et permirent à <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong> se présenter comme<br />
le « bon élève » montrant qu’il était encore possible <strong>de</strong> modifier les<br />
traités s<strong>ans</strong> recourir à <strong>la</strong> force et « nous donner notre seul vrai espoir<br />
<strong>de</strong> paix » selon les mots <strong>de</strong> Ren<strong>de</strong>l, chef du Département <strong>de</strong> l’Est au<br />
Foreign Office. Encouragée, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> souleva à nouveau <strong>la</strong> question<br />
<strong>de</strong>s détroits et profita <strong>de</strong>s développements ultérieurs pour <strong>de</strong>venir <strong>la</strong><br />
« gardienne » <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux passages maritimes grâce à <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong><br />
Montreux <strong>de</strong> 1936. Ce fut une gran<strong>de</strong> victoire pour <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> due à<br />
l’obstination d’Atatürk à n’utiliser que les voies diplomatiques.<br />
A partir <strong>de</strong> 1937, Atatürk montra les premiers signes d’une santé déclinante<br />
et tomba sérieusement ma<strong>la</strong><strong>de</strong> pendant un voyage à Yalova<br />
au début <strong>de</strong> 1938. Mustapha Kemal Atatürk, fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
mo<strong>de</strong>rne, mourut le 10 novembre 1938 à l’âge <strong>de</strong> 57 <strong>ans</strong>.<br />
B. L’ère İnönü (1938-1950)<br />
Ismet İnönü fut élu <strong>de</strong>uxième prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République le len<strong>de</strong>main<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> mort d’Atatürk, poste qu’il conservera jusqu’en mai 1950, et remporta<br />
les élections au Congrès général du Parti Républicain du Peuple<br />
(Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) le 26 décembre 1938 pour en <strong>de</strong>venir<br />
« le prési<strong>de</strong>nt immuable ». Le Congrès conféra à Atatürk le titre <strong>de</strong><br />
« chef éternel » et à İnönü celui <strong>de</strong> « chef national » (Milli Şef ). D<strong>ans</strong> le<br />
système du parti unique en vigueur en <strong>Turquie</strong> à l’époque, les appareils<br />
<strong>de</strong> l’Etat et du parti étaient étroitement imbriqués : le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
République était aussi le prési<strong>de</strong>nt du parti ; le ministre <strong>de</strong> l’Intérieur<br />
occupait le poste <strong>de</strong> secrétaire général du parti ; et les gouverneurs <strong>de</strong>s<br />
provinces étaient les chefs locaux du parti. İnönü eut donc sous son<br />
contrôle direct à <strong>la</strong> fois l’Etat et le parti, concentra entre ses mains le<br />
pouvoir <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique intérieure et extérieure et fit tout pour empêcher<br />
l’émergence d’un <strong>de</strong>uxième homme. Au congrès extraordinaire du<br />
CHP du 29 mai 1939, et en l’absence d’opposition, un groupe <strong>de</strong> députés<br />
se constitua « groupe indépendant » au sein du parti avec l’objectif<br />
<strong>de</strong> pouvoir critiquer le gouvernement. Mais les membres <strong>de</strong> ce groupe<br />
se conduisirent plutôt comme le reste du CHP et ne soulevèrent aucune<br />
objection sérieuse contre <strong>la</strong> politique gouvernementale ; <strong>la</strong> seule<br />
opposition venait d’autres députés du parti.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
145
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
146<br />
Il faut dire que si İnönü concentra tous les pouvoirs, ce fut moins par<br />
ambition dictatoriale que par désir <strong>de</strong> maintenir vivaces les réformes<br />
d’Atatürk. N’oublions pas qu’İnönü arriva au sommet <strong>de</strong> l’Etat à <strong>la</strong><br />
veille <strong>de</strong> <strong>la</strong> Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale, d<strong>ans</strong> un pays où l’expérience<br />
démocratique était toute récente, et que l’homme lui-même manquait<br />
du charisme dont jouissait son prédécesseur. Il n’est pas facile <strong>de</strong> se<br />
maintenir au pouvoir d<strong>ans</strong> <strong>de</strong> pareilles conditions, et l’on peut supposer<br />
qu’une contestation sérieuse aurait menacé les acquis <strong>de</strong> <strong>la</strong> République.<br />
Enfin, ce fut İnönü lui-même qui introduisit le multipartisme en <strong>Turquie</strong><br />
et préféra quitter toutes ses fonctions après <strong>la</strong> guerre.<br />
La politique intérieure et extérieure <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> sous İnönü fut façonnée<br />
par <strong>la</strong> Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale. Le pays ne participa pas au<br />
conflit, mais son armée fut constamment en état d’alerte et une part<br />
importante du budget national consacré à <strong>la</strong> défense. Afin <strong>de</strong> sou<strong>la</strong>ger<br />
le pays du poids <strong>de</strong>s contraintes économiques, le gouvernement fit voter<br />
le 18 janvier 1940 <strong>la</strong> Loi <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection nationale (Milli Korunma<br />
Kanunu). Cette loi avait pour but d’éviter le chaos économique dû à <strong>la</strong><br />
guerre, mais se solda par un échec. Un <strong>de</strong>uxième programme fut mis<br />
en p<strong>la</strong>ce pour redresser <strong>la</strong> situation économique par le biais d’une taxe<br />
sur les citoyens les plus fortunés qui, selon le gouvernement, profitaient<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre pour spéculer au marché noir et dont les bénéfices étaient<br />
insuffisamment taxés. Ainsi, vit le jour <strong>la</strong> loi du 11 novembre 1942 dite<br />
<strong>la</strong> Loi sur l’impôt sur <strong>la</strong> fortune (Varlik vergisi) qui visait à lever les<br />
fonds nécessaires à <strong>la</strong> défense du pays en taxant les citoyens les plus<br />
riches, parmi lesquels beaucoup étaient <strong>de</strong>s non-musulm<strong>ans</strong>. L’impôt<br />
s’appliqua aux « immobilisations » - tels les biens immobiliers et les entreprises<br />
commerciales ou industrielles - <strong>de</strong> tous les citoyens, y compris<br />
les minorités. Ceux qui ne pouvaient pas payer furent envoyés d<strong>ans</strong> <strong>de</strong>s<br />
camps <strong>de</strong> travail. Le gouvernement essuya <strong>de</strong> violentes critiques, car les<br />
non-musulm<strong>ans</strong> furent les plus fortement touchés par ces mesures qui<br />
furent finalement abandonnées le 15 mars 1944. Les riches ne furent<br />
pas les seuls à pâtir : les pays<strong>ans</strong> aussi durent payer en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi<br />
du 15 mai 1943 sur les produits agricoles. La situation d<strong>ans</strong> les campagnes<br />
fut bien pire que d<strong>ans</strong> les zones urbaines, ce qui amena certains<br />
à considérer <strong>la</strong> loi sur les produits agricoles comme une prolongation<br />
<strong>de</strong> l’impôt sur <strong>la</strong> fortune.<br />
Projets culturels<br />
L’un <strong>de</strong>s projets phares <strong>de</strong> l’ère İnönü fut <strong>la</strong> création <strong>de</strong>s « instituts <strong>de</strong><br />
vil<strong>la</strong>ges » en 1940, une initiative qui constitua <strong>la</strong> pierre angu<strong>la</strong>ire <strong>de</strong> <strong>la</strong>
politique <strong>de</strong> développement rural. Il s’agissait <strong>de</strong> former les habitants<br />
<strong>de</strong>s zones rurales à pouvoir enseigner d<strong>ans</strong> les écoles <strong>de</strong>s vil<strong>la</strong>ges. A<br />
l’époque, les zones rurales manquaient d’enseignants et l’on estima que<br />
l’une <strong>de</strong>s causes fut l’incapacité <strong>de</strong>s enseignants venus <strong>de</strong>s villes à supporter<br />
les conditions <strong>de</strong> vie ru<strong>de</strong>s d<strong>ans</strong> les vil<strong>la</strong>ges. D<strong>ans</strong> ces nouvelles<br />
écoles, les élèves étaient chargés <strong>de</strong> construire les bâtiments et produire<br />
leur propre nourriture. L’éducation dispensée couvrait <strong>de</strong>s sujets<br />
pratiques comme l’agriculture, <strong>la</strong> construction et les métiers manuels,<br />
ainsi que les sujets plus c<strong>la</strong>ssiques tels les mathématiques, <strong>la</strong> science, <strong>la</strong><br />
littérature et l’histoire. Produits du système <strong>de</strong> parti unique, ces écoles<br />
ne lui survécurent pas et furent fermées en 1954 avec l’avènement du<br />
multipartisme.<br />
Un autre projet important <strong>de</strong> cette époque porte le nom <strong>de</strong> « maisons<br />
du peuple » (Halkevleri) dont le but était d’éduquer les adultes<br />
à travers <strong>de</strong>s conférences, <strong>de</strong>s séminaires et d’autres activités. Les premières<br />
maisons ouvrirent à l’époque d’Atatürk d<strong>ans</strong> les villes en 1932 ;<br />
İnönü étendit le programme aux vil<strong>la</strong>ges à partir <strong>de</strong> 1940 sous forme<br />
<strong>de</strong> « chambres du peuple», plus petites que les « maisons ». Afin <strong>de</strong><br />
promouvoir <strong>la</strong> vie culturelle et familiariser les gens avec les principes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> République, <strong>la</strong> maison du peuple d’Ankara publia un magazine<br />
trimestriel sous le nom d’Ülkü (choisi par Atatürk lui-même) <strong>de</strong> février<br />
1933 jusqu’en août 1950. D’autres maisons suivirent l’exemple et publièrent<br />
<strong>de</strong>s magazines du même style, mais sous différents noms. Ce<br />
ne fut pas <strong>la</strong> meilleure manière d’éduquer une popu<strong>la</strong>tion qui à l’époque<br />
était <strong>la</strong>rgement analphabète, on créa donc une organisation nommée<br />
« les orateurs du peuple » au sein <strong>de</strong>s « maisons ».<br />
Sous İnönü les maisons et chambres du peuple s’intégrèrent d<strong>ans</strong> les<br />
structures du parti unique, le CHP. Comme avec les écoles <strong>de</strong>s vil<strong>la</strong>ges,<br />
les maisons du peuple sont nées du système <strong>de</strong> parti unique et furent<br />
abolies à l’arrivée du Parti démocrate au pouvoir en 1950 sous prétexte<br />
qu’elles s’étaient éloignées <strong>de</strong> leurs objectifs premiers.<br />
La Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale<br />
et <strong>la</strong> politique étrangère turque<br />
Atatürk avait compris qu’un second conflit à l’échelle mondiale al<strong>la</strong>it<br />
prendre <strong>de</strong>s proportions énormes. Il songea à former une alliance avec<br />
<strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne, <strong>la</strong> France et l’Union soviétique pour contrer <strong>la</strong><br />
politique exp<strong>ans</strong>ionniste d’Hitler et <strong>de</strong> Mussolini en Europe centrale<br />
et en Méditerranée orientale. Fixé sur <strong>la</strong> politique d’apaisement vers<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
147
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
148<br />
l’Allemagne et l’Italie, Londres rejeta cette idée et mit du temps à comprendre<br />
que sa position conciliatrice ne faisait qu’encourager Berlin et<br />
Rome à poursuivre leur programme pour dominer politiquement et<br />
économiquement l’Europe centrale et <strong>la</strong> Méditerranée orientale. Ce<br />
ne fut qu’avec l’occupation alleman<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Tchécoslovaquie le 15 mars<br />
1939 et les menaces contre <strong>la</strong> Pologne et <strong>la</strong> Romanie que <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-<br />
Bretagne abandonna sa ligne conciliatrice envers les régimes fascistes et<br />
chercha une alliance calquée sur celle qu’avait proposée Atatürk. Mais<br />
le fondateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque mourut au moment où les tensions<br />
et <strong>la</strong> course aux alliances battaient leur plein. İnönü lui succéda<br />
quelques mois avant le déclenchement <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
Suivant <strong>la</strong> même ligne, le nouveau prési<strong>de</strong>nt cherchait activement à<br />
établir <strong>de</strong>s alliances avec l’Occi<strong>de</strong>nt tout en insistant pour y intégrer<br />
l’URSS, car il estimait qu’une alliance s<strong>ans</strong> <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> cette<br />
<strong>de</strong>rnière serait inefficace. On peut dire que les inquiétu<strong>de</strong>s d’Ankara<br />
vis-à-vis <strong>de</strong> l’Union soviétique furent l’une <strong>de</strong>s considérations majeures<br />
<strong>de</strong>rrière <strong>la</strong> ligne suivie par <strong>la</strong> politique étrangère turque pendant <strong>la</strong> Secon<strong>de</strong><br />
Guerre mondiale. L’URSS espérait <strong>de</strong>puis longtemps pouvoir<br />
accé<strong>de</strong>r aux détroits turcs, et Ankara <strong>de</strong> son côté vou<strong>la</strong>it éviter tout acte<br />
qui pourrait donner le prétexte à une attaque <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong> Moscou. Or,<br />
Berlin aussi avait <strong>de</strong>s <strong>de</strong>sseins sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>la</strong>rgement dépendante<br />
économiquement <strong>de</strong> l’Allemagne. Franz von Papen, le nouvel ambassa<strong>de</strong>ur<br />
allemand à Ankara, s’appuya sur <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> neutralité turque<br />
pour persua<strong>de</strong>r les dirigeants du pays <strong>de</strong> ne pas aller plus loin d<strong>ans</strong> <strong>la</strong><br />
direction <strong>de</strong> l’alliance occi<strong>de</strong>ntale. Il avertit que l’Allemagne pourrait<br />
arrêter toute coopération économique et culturelle avec <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> si<br />
celle-ci ne <strong>de</strong>meurait pas neutre.<br />
Mais <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> ne fut pas le seul pays que l’Allemagne courtisait afin<br />
d’empêcher son encerclement par les pouvoirs occi<strong>de</strong>ntaux. Après<br />
avoir réussi à détacher Ankara <strong>de</strong> l’alliance occi<strong>de</strong>ntale, l’Allemagne se<br />
mit à chercher un pacte avec l’Union soviétique espérant <strong>la</strong> dissua<strong>de</strong>r<br />
d’intégrer l’alliance franco-britannique et <strong>de</strong> s’ingérer d<strong>ans</strong> un conflit<br />
entre l’Allemagne et <strong>la</strong> Pologne. Ces négociations secrètes continuèrent<br />
jusqu’à <strong>la</strong> signature du pacte <strong>de</strong> non-agression germano-soviétique le<br />
23 août 1939. L’accord entre Berlin et Moscou mit Ankara d<strong>ans</strong> une<br />
position délicate, car elle ne pouvait rester à <strong>la</strong> fois pro-Alliés et pro-<br />
URSS, mais ne pouvait pas non plus se ranger d’un côté ou <strong>de</strong> l’autre<br />
s<strong>ans</strong> prendre <strong>de</strong> grands risques. La <strong>Turquie</strong> avait basé toute sa politique<br />
sur l’hypothèse que l’URSS finirait par rejoindre l’alliance occi<strong>de</strong>ntale,<br />
mais elle ne se <strong>la</strong>issa pas décourager pour autant. D’un côté, elle main-
tint les négociations avec <strong>la</strong> France et <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne en vue d’un<br />
pacte, et <strong>de</strong> l’autre, dépêcha son ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères, Sükrü<br />
Saraçoglu, à Moscou le 26 septembre 1939 afin <strong>de</strong> son<strong>de</strong>r les intentions<br />
soviétiques. A son arrivée à <strong>la</strong> capitale soviétique, le ministre turc se<br />
trouva face à face non seulement avec son homologue russe, mais aussi<br />
avec le ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères allemand que les Russes avaient<br />
invité s<strong>ans</strong> l’en avoir prévenu, cherchant s<strong>ans</strong> doute à améliorer leur<br />
position <strong>de</strong> négociations vis-à-vis <strong>de</strong> Berlin et d’Ankara.<br />
La visite <strong>de</strong> Saraçoglu ne donna rien, et à partir <strong>de</strong> ce moment, le gouvernement<br />
turc forma <strong>la</strong> conviction que l’Union soviétique était déterminée<br />
à poursuivre l’ancienne politique russe <strong>de</strong> chercher un accès aux<br />
détroits par tous les moyens. Par conséquent, Ankara adopta une attitu<strong>de</strong><br />
qui consistait à ne prendre aucun engagement concernant <strong>la</strong> Russie<br />
qui pourrait affaiblir <strong>la</strong> position turque sur <strong>la</strong> scène internationale.<br />
Cette politique fut mise en avant d<strong>ans</strong> le traité d’assistance mutuelle<br />
entre <strong>la</strong> France, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne et <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> signé le 19 octobre<br />
1939 et dont l’article troisième dispensait Ankara d’entreprendre une<br />
quelconque action qui pourrait entraîner l’hostilité <strong>de</strong> l’URSS.<br />
La question <strong>de</strong> savoir si <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> al<strong>la</strong>it entrer en guerre suscitait<br />
beaucoup d’intérêt en Gran<strong>de</strong>-Bretagne, surtout pour Churchill. La<br />
politique turque, cependant, consistait à essayer <strong>de</strong> gagner du temps<br />
et espérer ne pas être rattrapé par <strong>la</strong> guerre, au moins jusqu’à ce que<br />
le réarmement du pays atteignît un niveau lui permettant <strong>de</strong> résister<br />
à une invasion alleman<strong>de</strong>. La <strong>Turquie</strong> avait tout misé sur une alliance<br />
avec <strong>la</strong> France, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong>-Bretagne et l’URSS, et voilà que <strong>la</strong> Russie se<br />
rangeait du côté <strong>de</strong> l’Allemagne et que <strong>la</strong> France sortait <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre<br />
après sa défaite face aux Allemands. Tout ce<strong>la</strong> ne fit que renforcer <strong>la</strong><br />
détermination turque à rester à l’écart du conflit.<br />
La <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong> l’époque n’était pas une gran<strong>de</strong> puissance militaire, mais<br />
sa position géostratégique lui confèrait une p<strong>la</strong>ce importante d<strong>ans</strong> les<br />
stratégies <strong>de</strong>s camps adverses. Avec l’arrivée <strong>de</strong> troupes alleman<strong>de</strong>s à <strong>la</strong><br />
frontière turco-bulgare en mars 1941 et d<strong>ans</strong> les îles <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer Egée en<br />
mai, s<strong>ans</strong> parler <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>puis 1912 <strong>de</strong> l’Italie d<strong>ans</strong> le Dodécanèse,<br />
<strong>la</strong> position turque <strong>de</strong>vint une question <strong>de</strong> première importance<br />
pour les <strong>de</strong>ux camps <strong>de</strong> belligérants. Mais au lieu <strong>de</strong> tenter d’atteindre<br />
le Moyen Orient via <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, Hitler préféra envahir l’Union soviétique<br />
à partir du 22 juin 1941. Ce<strong>la</strong> ne mit pas fin pour autant à <strong>la</strong> menace<br />
contre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> qui voyait sa frontière ouest entourée <strong>de</strong> troupes<br />
alleman<strong>de</strong>s.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
149
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
150<br />
Les <strong>de</strong>ux parties belligérantes faisaient pression sur <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> pour<br />
qu’elle facilite l’accès à leurs navires <strong>de</strong> guerre, pour arrêter le passage<br />
<strong>de</strong>s ennemis à travers les détroits et pour ouvrir ses bases aériennes et<br />
ses ports pour leur propre usage. La position stratégique <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
fit d’Ankara une amie convoitée. Mais <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> resta neutre jusqu’au<br />
<strong>de</strong>rnier moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, ce qui lui valut une importance au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> ses moyens en tant que petite puissance au potentiel militaire limité<br />
qui a su résisté aux pressions <strong>de</strong> toutes les gran<strong>de</strong>s puissances. En effet,<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> ne vou<strong>la</strong>it pas s’embarquer d<strong>ans</strong> une politique aventurière<br />
comme ce fut le cas pendant <strong>la</strong> première guerre mondiale. Elle n’avait<br />
pas non plus d’ambitions territoriales. Elle avait surtout besoin <strong>de</strong><br />
temps pour mener à bien les réformes kémalistes pour pouvoir ancrer<br />
le pays d<strong>ans</strong> le mon<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne.<br />
En réalité, les Allemands avaient promis à <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong> faire <strong>de</strong>s<br />
amen<strong>de</strong>ments en sa faveur en échange <strong>de</strong> sa coopération. Mais <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
n’avait aucune prétention territoriale sur les pays voisins à ce moment.<br />
La propagan<strong>de</strong> alleman<strong>de</strong> qui chercha à unifier les popu<strong>la</strong>tions<br />
turques <strong>de</strong> l’URSS n’eut pas d’écho d<strong>ans</strong> les cercles officiels turcs, bien<br />
que les mouvements panturkistes fussent enthousiasmés par cette idée.<br />
Les déci<strong>de</strong>urs politiques turcs étaient conscients qu’il n’y avait pas <strong>de</strong><br />
p<strong>la</strong>ce à <strong>de</strong> telles revendications idéologiques d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> real politik, et particulièrement<br />
İnönü, <strong>la</strong> figure majeure <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique étrangère du pays,<br />
n’accorda aucun crédit à ceux qui cherchaient une politique aventurière.<br />
Il ne serait pas exact d’affirmer que <strong>la</strong> politique étrangère turque d<strong>ans</strong><br />
cette guerre fut strictement neutre. La meilleure définition qu’on puisse<br />
donner à <strong>la</strong> position turque est <strong>la</strong> non-belligérance ou, comme l’a dit<br />
Selim Derengil, <strong>la</strong> neutralité bienveil<strong>la</strong>nte. D’abord, <strong>de</strong>puis le début,<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> se rangea du côté <strong>de</strong>s Alliés en signant le Pacte tripartite.<br />
Pendant <strong>la</strong> guerre, elle leur fournit une ai<strong>de</strong> considérable al<strong>la</strong>nt au-<strong>de</strong>là<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> stricte neutralité. D’aucuns pourraient prétendre que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
tenait également une position pro-alleman<strong>de</strong> du fait qu’elle ait signé<br />
un traité d’amitié avec l’Allemagne le 18 juin 1941 qui permit à cette<br />
<strong>de</strong>rnière d’envahir facilement l’URSS (nom <strong>de</strong> co<strong>de</strong> Opération Barbarossa)<br />
le 22 juin. Mais <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> n’avait d’autre choix que <strong>de</strong> signer<br />
ce traité au risque <strong>de</strong> se voir à son tour envahir par l’Allemagne alors<br />
qu’elle ne disposait pas d’une armée mo<strong>de</strong>rne pour pouvoir faire face à<br />
une telle éventualité.<br />
La <strong>Turquie</strong> vou<strong>la</strong>it ar<strong>de</strong>mment que le bloc occi<strong>de</strong>ntal gagnât <strong>la</strong> guerre,<br />
mais <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong>s Soviétiques avec les Britanniques après l’Opé-
ation Barbarossa, souleva <strong>la</strong> question d<strong>ans</strong> les cercles officiels turcs du<br />
rôle <strong>de</strong> l’Union soviétique d<strong>ans</strong> l’après-guerre. Ce<strong>la</strong> ne signifiait pas que<br />
le choix <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> al<strong>la</strong> vers les Nazis. Pour les autorités du pays, les<br />
objectifs nazis n’étaient pas si éloignés <strong>de</strong> ceux <strong>de</strong> l’URSS. La Gran<strong>de</strong><br />
Bretagne était d<strong>ans</strong> l’incapacité d’ai<strong>de</strong>r l’armée turque car elle <strong>de</strong>vait se<br />
préparait pleinement et être bien équipée face à l’armée alleman<strong>de</strong>. La<br />
seule chose qui restait à faire à <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> était <strong>de</strong> se tenir aussi loin que<br />
possible <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre et ce fut <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> conduite d’İnönü. Et même<br />
si <strong>la</strong> position <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> penchait du côté <strong>de</strong>s Alliés, elle dut faire<br />
quelques concessions à l’Allemagne.<br />
Cette position était parfaitement compréhensible aux Ang<strong>la</strong>is jusqu’en<br />
1943, autant qu’ils pouvaient tirer avantage <strong>de</strong> cette neutralité. Mais<br />
dès que <strong>la</strong> situation tourna en faveur <strong>de</strong>s Alliés, ils pressèrent <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
d’entrer en guerre <strong>de</strong> leur côté ; et pour ce faire, Churchill vint à Adana,<br />
une province turque d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> <strong>la</strong> Méditerranée orientale, le 30<br />
janvier 1943, afin <strong>de</strong> discuter avec İnönü et Saraçoglu, à l’époque premier<br />
ministre, <strong>de</strong> l’éventualité d’une entrée en guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>.<br />
Churchill vou<strong>la</strong>it que celle-ci entre en guerre à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> l’année en<br />
contrepartie <strong>de</strong> son approvisionnement en armement. A ce sta<strong>de</strong>, l’opinion<br />
<strong>de</strong>s Alliés sur <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> à <strong>la</strong> guerre était affaire<br />
<strong>de</strong> discussion. Certains <strong>de</strong>mandaient <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> sous<br />
forme d’autorisations pour utiliser ses bases plutôt qu’une participation<br />
militaire active ; d’autres, particulièrement l’URSS, souhaitaient une<br />
plus gran<strong>de</strong> implication militaire. Suite à <strong>de</strong> longs pourparlers diplomatiques,<br />
İnönü accepta « en principe » <strong>la</strong> participation <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> à<br />
<strong>la</strong> guerre lors dune réunion tenue au Caire entre le 4 et le 8 décembre<br />
1943. Il sollicita beaucoup d’équipements militaires pour mo<strong>de</strong>rniser<br />
son armée, et sa <strong>de</strong>man<strong>de</strong> fut prise en compte par les Alliés. A ce moment,<br />
Moscou était réticent à l’entrée en guerre <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, pensant<br />
que c’était trop tard. Cette attitu<strong>de</strong> aiguisa <strong>la</strong> méfiance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
quant aux intentions soviétiques d’après-guerre à son égard. Finalement,<br />
<strong>la</strong> guerre arriva à son terme s<strong>ans</strong> que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> y participât.<br />
La ligne politique adoptée par <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> fut contestée par l’Angleterre<br />
et les USA, ce qui conduisit à une rupture d<strong>ans</strong> leurs re<strong>la</strong>tions en<br />
1944. Les développements ultérieurs ne tournaient plus à l’avantage <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. Les Alliés préparaient l’Opération Overlod, nom <strong>de</strong> co<strong>de</strong><br />
donné au débarquement <strong>de</strong> Normandie. C’est alors que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> se<br />
rallia aux termes <strong>de</strong>s Alliés en juin 1944 et le 2 août elle rompit ses<br />
re<strong>la</strong>tions diplomatiques et économiques avec l’Allemagne comme le<br />
vou<strong>la</strong>ient les Alliés qui lui avaient assuré qu’elle serait traitée comme un<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
151
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
152<br />
membre allié à <strong>la</strong> fin <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre. Ceci ne contenta pas du tout l’URSS.<br />
A <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> Yalta entre le 4 et le 11 février 1944, Staline souleva<br />
<strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> modification <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> Montreux <strong>de</strong> 1936<br />
qui rég<strong>la</strong>it le passage <strong>de</strong>s navires <strong>de</strong> guerre à l’entrée et à <strong>la</strong> sortie <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Mer Noire, mais ni les Ang<strong>la</strong>is ni les Américains ne vou<strong>la</strong>ient satisfaire<br />
ses <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s. Une autre décision importante prise à Yalta au sujet <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> était d’inviter à <strong>la</strong> Conférence <strong>de</strong> San Francisco les pays<br />
qui avaient rompu leurs re<strong>la</strong>tions diplomatiques avec l’Allemagne s<strong>ans</strong><br />
avoir pris part à <strong>la</strong> guerre. C’était une preuve pour <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> que l’Angleterre<br />
ne l’abandonnerait pas après <strong>la</strong> guerre seule face à l’URSS, au<br />
nom <strong>de</strong>s intérêts anciens qui <strong>la</strong> lient à <strong>la</strong> région.<br />
Le 23 février 1945, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> déc<strong>la</strong>ra <strong>la</strong> guerre au Japon et à l’Allemagne<br />
comme il avait été décidé à Yalta afin qu’elle puisse assister à <strong>la</strong><br />
Conférence <strong>de</strong> San Francisco qui al<strong>la</strong>it établir les Nations Unies. Ainsi,<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> aura été l’un <strong>de</strong>s membres fondateurs <strong>de</strong>s NU.<br />
Finalement, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> avait réussi à se p<strong>la</strong>cer du côté <strong>de</strong>s vainqueurs<br />
alors qu’elle s’était tenue à l’écart <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre.<br />
La pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> tr<strong>ans</strong>ition:<br />
vers une démocratie libérale (1945-1950)<br />
Bien que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> n’ait pas participé au conflit, elle en fut très affectée.<br />
Tout au long <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre, une armée était prête et maintenue en alerte,<br />
les prix avaient augmenté <strong>de</strong> façon prodigieuse, beaucoup <strong>de</strong> matières<br />
premières alimentaires étaient rationnées et souvent inexistantes ou<br />
vendues au marché noir. Une <strong>la</strong>rge contestation sociale se manifesta<br />
contre le PRP dont les projets sociaux et économiques ne répondaient<br />
pas aux attentes <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion, surtout d<strong>ans</strong> les zones rurales. En<br />
outre, un mouvement <strong>de</strong> forte opposition émergea au sein même du<br />
PRP se p<strong>la</strong>ignant <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion autoritaire du parti et réc<strong>la</strong>mant plus <strong>de</strong><br />
liberté et <strong>de</strong> démocratie. L’attitu<strong>de</strong> bienveil<strong>la</strong>nte d’İnönü encouragea ce<br />
mouvement, car il ne pouvait rester sourd aux contestations sociales. En<br />
fait, il fut le premier à mentionner <strong>la</strong> nécessité d’une « libéralisation du<br />
régime » en 1945. Dès lors, il commença à évoquer « le besoin d’avoir<br />
un parti d’opposition ».<br />
D’autres facteurs extérieurs ont motivé İnönü d<strong>ans</strong> son désir <strong>de</strong> démocratisation.<br />
La <strong>Turquie</strong> craignait d’être mise à l’écart du mon<strong>de</strong> libre à<br />
cause <strong>de</strong> sa position <strong>de</strong> neutralité durant <strong>la</strong> Secon<strong>de</strong> guerre. Un isolement<br />
l’aurait livré aux Soviétiques qui ne cessaient <strong>de</strong> faire pression sur
elle en réc<strong>la</strong>mant <strong>de</strong>s bases militaires et une défense commune d<strong>ans</strong> les<br />
détroits turcs. La <strong>Turquie</strong> ne pouvait rien contre eux s<strong>ans</strong> un soutien<br />
<strong>de</strong> l’extérieur. Afin d’obtenir ce soutien occi<strong>de</strong>ntal, elle accéléra <strong>la</strong> tr<strong>ans</strong>ition<br />
à un système multipartite, mais ce<strong>la</strong> est à rattacher aussi au fait<br />
que le système du parti unique n’était plus compatible avec les pratiques<br />
démocratiques occi<strong>de</strong>ntales d’après-guerre.<br />
Il ne fait aucun doute que le mouvement qui inaugura <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
tr<strong>ans</strong>ition émana <strong>de</strong> l’opposition à l’intérieur du PRP. Quatre membres<br />
<strong>de</strong> ce parti, Ce<strong>la</strong>l Bayar, le <strong>de</strong>rnier premier ministre d’Atatürk, Refik<br />
Koraltan, Fuat Köprülü et Adnan Men<strong>de</strong>res, déposèrent une motion<br />
au groupe parlementaire du PRP <strong>de</strong>venue fameuse sous le nom <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
‘Motion du Quartet’. Ils vou<strong>la</strong>ient apporter <strong>de</strong>s changements aux réglements<br />
intérieurs du parti et modifier certaines lois. Suite au rejet <strong>de</strong><br />
leur motion, Bayar démissionna du Parti et du Parlement. Men<strong>de</strong>res,<br />
Köprülü et Koraltan furent exclus du Parti pour ne pas s’être conformés<br />
à sa discipline. Ils fondèrent alors le Parti Démocratique (PR) le 7 juin<br />
1946 qui fut accueilli avec beaucoup d’enthousiasme par <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />
exténuée par les politiques intr<strong>ans</strong>igeantes du régime du parti unique.<br />
Le PD défendait <strong>la</strong> démocratie et une approche libérale <strong>de</strong> l’économie.<br />
Il connut un développement rapi<strong>de</strong> en peu <strong>de</strong> temps. Mais le premier<br />
parti d’opposition fut le Parti du Développement National (PDN)<br />
fondé le 8 juillet 1945. Il ne connut pas le succès fulgurant du PD. En<br />
1946, 11 autres partis virent le jour.<br />
L’apparition d’un aussi grand nombre <strong>de</strong> partis poussa le PRP à réévaluer<br />
son programme démocratique. Le 10 mai 1946, İnönü abandonna<br />
les titres <strong>de</strong> Chef éternel et <strong>de</strong> Chef national lors d’un extraordinaire<br />
Congrès du Parti. Le groupe indépendant au sein du PRP fut aboli, le<br />
système d’élection fut révisé et <strong>de</strong>s lois concernant <strong>la</strong> libéralisation <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
presse furent promulguées.<br />
Entre-temps, le PD réussit à entrer au Parlement suite aux élections <strong>de</strong><br />
1946. Aux élections du 14 mai 1950, le PD accéda au pouvoir. La pério<strong>de</strong><br />
du parti unique prenait fin en <strong>Turquie</strong> et pour <strong>la</strong> première fois, un<br />
changement <strong>de</strong> pouvoir se réalisait grâce au vote du peuple. Ce<strong>la</strong>l Bayar<br />
fut choisi comme Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque par le Parlement.<br />
Ensuite, il chargea Adnan Men<strong>de</strong>res <strong>de</strong> former un cabinet.<br />
Ainsi, après 27 <strong>ans</strong> <strong>de</strong> pouvoir, le Parti Républicain du Peuple était<br />
remp<strong>la</strong>cé par le Parti Démocratique à travers un processus démocratique.<br />
Ce fut le premier jalon sur <strong>la</strong> voie <strong>de</strong> <strong>la</strong> démocratie en <strong>Turquie</strong>. A<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
153
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
154<br />
partir <strong>de</strong> là, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> al<strong>la</strong>it expérimenter, et le fait encore, un système<br />
politique multipartite. Cependant, <strong>la</strong> démocratie turque eut à traverser<br />
<strong>de</strong>s difficultés telles que l’armée fut obligée d’intervenir pour « sauver<br />
<strong>la</strong> démocratie ». L’intervention militaire eut lieu <strong>de</strong>ux fois, en 1960 et<br />
en 1980. Le gouvernement fut chaque fois remp<strong>la</strong>cé et un nouveau<br />
système démocratique mis en p<strong>la</strong>ce. En 1971, <strong>la</strong> démocratie turque fut<br />
<strong>de</strong> nouveau affectée par un coup d’état via un mémorandum, forçant<br />
un changement <strong>de</strong> gouvernement. En 1997, l’armée turque exerça <strong>de</strong>s<br />
pressions à travers le Conseil <strong>de</strong> Sécurité National pour sauver l’Etat<br />
<strong>la</strong>ïque <strong>de</strong> <strong>la</strong> prétendue tentative <strong>de</strong> sabotage du Parti du bien-être (Refah<br />
Partisi) qui gouvernait alors. À chaque fois, ces interventions interrompaient<br />
le processus démocratique, mais ne proposaient aucune<br />
alternative au système démocratique.<br />
C. La politique étrangère turque pendant<br />
<strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong><br />
Avec <strong>la</strong> défaite d’Hitler disparaît <strong>la</strong> principale raison d’être <strong>de</strong> <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong><br />
Alliance entre les pouvoirs occi<strong>de</strong>ntaux et l’URSS, et à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre chaque pays suivit sa propre politique. Les Etats-Unis et<br />
l’Union soviétique émergèrent comme les super puissances dont les intérêts<br />
et les alliances partageaient le mon<strong>de</strong> en <strong>de</strong>ux blocs - l’Occi<strong>de</strong>nt<br />
démocratique mené par les USA et l’Est communiste autour <strong>de</strong> l’URSS<br />
- qui s’affrontaient d<strong>ans</strong> une guerre froi<strong>de</strong>. Durant toute cette pério<strong>de</strong>,<br />
chaque pays <strong>de</strong>vait choisir son camp selon ses intérêts.<br />
La <strong>Turquie</strong> fit le choix <strong>de</strong> l’Occi<strong>de</strong>nt. Il faut dire que pour Ankara <strong>la</strong><br />
neutralité n’était pas une option viable étant donné les pressions que<br />
l’Union soviétique exerçait sur elle pour obtenir <strong>de</strong>s bases militaires<br />
sur les détroits. İnönü s’empressa d’adopter une politique étrangère basée<br />
sur une coopération étroite avec les Etats-Unis, mais ces <strong>de</strong>rniers<br />
mirent du temps à apprécier l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> position stratégique<br />
turque. L’intégration <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> d<strong>ans</strong> l’Alliance occi<strong>de</strong>ntale fut donc<br />
lente, mais n’en a pas été moins profon<strong>de</strong>. Le passage du cuirassé américain<br />
l’USS Missouri à Istanbul en 1946, et l’arrivée <strong>de</strong> <strong>la</strong> première ai<strong>de</strong><br />
économique et militaire avec <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> <strong>la</strong> doctrine <strong>de</strong> Truman<br />
en 1947 ainsi que le p<strong>la</strong>n Marshall en 1948, renforcèrent les fon<strong>de</strong>ments<br />
pro-occi<strong>de</strong>ntaux <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique étrangère turque instaurée par<br />
İnönü et suivie par le Parti Démocrate. Ankara montra sa préférence<br />
pro-occi<strong>de</strong>ntale en s’impliquant activement d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> guerre <strong>de</strong> Corée<br />
en 1950-53 et <strong>de</strong>vint membre <strong>de</strong> l’OTAN le 17 février 1952. Pendant
<strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>, les détroits étaient particulièrement importants pour<br />
neutraliser <strong>la</strong> menace <strong>de</strong>s sous-marins soviétiques d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Méditerranée.<br />
La <strong>Turquie</strong> était en quelque sorte <strong>la</strong> garante <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité du front<br />
sud <strong>de</strong> l’Alliance, une position prééminente au sein du système sécuritaire<br />
occi<strong>de</strong>ntal qu’elle gar<strong>de</strong>ra tout au long <strong>de</strong> <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong>.<br />
Si les re<strong>la</strong>tions étroites entre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et l’Occi<strong>de</strong>nt étaient basées<br />
principalement sur <strong>de</strong>s considérations économiques et sécuritaires, elles<br />
peuvent aussi être interprétées comme une prolongation <strong>de</strong> <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rnisation<br />
et <strong>de</strong> l’occi<strong>de</strong>ntalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> société turque entreprises <strong>de</strong>puis<br />
<strong>la</strong> fondation <strong>de</strong> <strong>la</strong> République. Ce<strong>la</strong> peut expliquer cette sorte <strong>de</strong> dérive<br />
pro-occi<strong>de</strong>ntale uni<strong>la</strong>térale qu’on observe <strong>de</strong> temps à autre d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> politique<br />
étrangère turque (comme ce fut le cas sous le Parti Démocrate) et<br />
qui affaiblissait l’autorité du pays vis-à-vis <strong>de</strong> ses alliés occi<strong>de</strong>ntaux. Par<br />
exemple, le gouvernement du Parti Démocrate se montra très enthousiaste<br />
à l’idée <strong>de</strong> coopérer avec <strong>la</strong> politique moyen-orientale <strong>de</strong>s Etats-<br />
Unis, al<strong>la</strong>nt jusqu’à autoriser le déploiement <strong>de</strong>s missiles américains<br />
Jupiter sur son territoire, mais n’obtint jamais l’ai<strong>de</strong> financière qu’il<br />
espérait. La donne changea avec <strong>la</strong> crise <strong>de</strong>s missiles cubains en 1962,<br />
car il <strong>de</strong>vint c<strong>la</strong>ir que les Etats-Unis et l’Union soviétique étaient déterminés<br />
à ne pas se <strong>la</strong>isser entraîner d<strong>ans</strong> une guerre directe. La politique<br />
étrangère <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> déçue par le manque <strong>de</strong> soutien financier <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
part <strong>de</strong> ses alliés occi<strong>de</strong>ntaux, évolua vers un peu plus <strong>de</strong> multi<strong>la</strong>téralisme.<br />
De temps en temps, Ankara tenta <strong>de</strong>s ouvertures diplomatiques<br />
en direction <strong>de</strong> l’Union soviétique ou les pays non-alignés, mais n’al<strong>la</strong><br />
jamais jusqu’à revoir en profon<strong>de</strong>ur l’orientation pro-occi<strong>de</strong>ntale <strong>de</strong> sa<br />
politique étrangère. La <strong>Turquie</strong> ne pouvait ou ne vou<strong>la</strong>it pas suivre une<br />
autre ligne: en ce qui concerne <strong>la</strong> politique étrangère, <strong>la</strong> seule alternative<br />
aux USA fut <strong>la</strong> Communauté économique européenne (qui <strong>de</strong>viendra<br />
plus tard l’Union européenne) ; autrement dit, <strong>la</strong> seule alternative à une<br />
puissance occi<strong>de</strong>ntale était une autre puissance occi<strong>de</strong>ntale.<br />
En ce qui concerne <strong>la</strong> politique étrangère, les principales préoccupations<br />
<strong>de</strong>s déci<strong>de</strong>urs turcs pendant <strong>la</strong> guerre froi<strong>de</strong> et même après<br />
étaient doubles: <strong>la</strong> question <strong>de</strong> Chypre et l’entrée d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> Communauté<br />
européenne.<br />
La question chypriote<br />
Les racines du problème chypriote remonte aux temps <strong>de</strong>s Ottom<strong>ans</strong>.<br />
En 1878, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne s’empara temporairement <strong>de</strong> l’île <strong>de</strong><br />
Chypre en contrepartie <strong>de</strong> son soutien pendant <strong>la</strong> guerre russo-turque.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
155
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
156<br />
Après <strong>la</strong> chute <strong>de</strong> l’Empire ottoman, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> reconnut <strong>la</strong> souveraineté<br />
britannique sur Chypre à <strong>la</strong> conférence <strong>de</strong> Lausanne. Néanmoins,<br />
les Grecs chypriotes adoptèrent une politique appelée ‘enosis’ grâce à<br />
<strong>la</strong>quelle Chypre <strong>de</strong>vait s’unir à <strong>la</strong> Grèce qu’ils considèrent comme leur<br />
mère patrie. Et comme les Grecs chypriotes poursuivaient cette politique<br />
<strong>de</strong> l’unification, l’enosis, les Chypriotes turcs <strong>de</strong> leur côté s’organisèrent<br />
en partis et groupes pour défendre leurs droits et prévenir<br />
un éventuel rattachement <strong>de</strong> l’île à <strong>la</strong> Grèce. La Grèce vou<strong>la</strong>it pour sa<br />
part examiner <strong>la</strong> question avec <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne lors <strong>de</strong> pourparlers<br />
bi<strong>la</strong>téraux qui eurent lieu en 1954. Elle offrit même une base aux Britanniques<br />
en échange <strong>de</strong> leur reconnaissance <strong>de</strong> l’enosis, mais ceux-ci<br />
refusèrent alléguant qu’il n’y avait aucune question chypriote à discuter.<br />
La <strong>Turquie</strong> ne voulut pas s’impliquer d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> question aussi longtemps<br />
que Chypre restait sous contrôle britannique. Toutefois, elle se réservait<br />
le droit d’intervenir si une quelconque modification d<strong>ans</strong> le statu quo<br />
intervenait. Pendant ce temps, lorsque fut créé à Chypre en 1955 le<br />
mouvement <strong>de</strong> guéril<strong>la</strong> l’EOKA (Organisation Nationale <strong>de</strong>s Combattants<br />
Chypriotes), qui visait à mettre fin à <strong>la</strong> présence britannique<br />
sur l’île et rattacher celle-ci à <strong>la</strong> Grèce, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne commença<br />
à parler d’évacuation. L’EOKA menait une série d’actions terroristes<br />
contre les Chypriotes turcs et les Britanniques. A <strong>la</strong> suite <strong>de</strong> ces événements,<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong>vint une partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> question surtout que les<br />
Britanniques étaient en train d’appliquer leur p<strong>la</strong>n d’évacuation et que<br />
les attaques terroristes se multipliaient contre les Chypriotes turcs.<br />
Après <strong>de</strong> longues discussions entre <strong>la</strong> Grèce, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne et <strong>la</strong><br />
<strong>Turquie</strong>, les Chypriotes grecs et <strong>la</strong> Grèce durent accepter <strong>la</strong> formation<br />
d’une Chypre indépendante en 1960. La République <strong>de</strong> Chypre fut<br />
fondée avec les accords <strong>de</strong> Zurich <strong>de</strong> 1959 et les accords <strong>de</strong> Londres <strong>de</strong><br />
1960. Conformément à ces accords, une administration collective entre<br />
<strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et les Chypriotes grecs <strong>de</strong>vait être mise en p<strong>la</strong>ce : le prési<strong>de</strong>nt<br />
serait grec ; son député serait un chypriote turc qui aurait le droit <strong>de</strong><br />
veto sur les décisions du prési<strong>de</strong>nt. Les Turcs et les Grecs auraient les<br />
mêmes droits. La Grèce, <strong>la</strong> Gran<strong>de</strong> Bretagne et <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> seraient les<br />
garantes <strong>de</strong> <strong>la</strong> République. S’il y avait <strong>la</strong> moindre vio<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s statu<br />
quo tels qu’ils ont été établis en 1960, n’importe lequel <strong>de</strong> ces pays avait<br />
le droit d’intervenir seul ou avec <strong>la</strong> coopération <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres.<br />
L’archevêque Makarios, prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> République, ne manifesta aucun<br />
empressement à mettre en œuvre <strong>la</strong> Constitution <strong>de</strong> 1960. Au<br />
contraire, il traita les turcs comme une minorité enfreignant les statu
quo établis en 1960. Il poursuivait également une politique favorable<br />
à <strong>la</strong> ligne <strong>de</strong> l’enosis qui entraîna une rupture <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> 1960. Ensuite,<br />
les Chypriotes turcs qui travail<strong>la</strong>ient d<strong>ans</strong> les instituions <strong>de</strong> l’Etat<br />
furent chassés en 1963 et <strong>de</strong>puis, <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion chypriote turque subit<br />
<strong>de</strong> graves attaques <strong>de</strong> <strong>la</strong> part <strong>de</strong>s chypriotes grecs. Lorsque <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
rappe<strong>la</strong> aux Chypriotes grecs que, selon les conditions <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong><br />
Zurich et <strong>de</strong> Londres, une intervention turque était possible face à leur<br />
méprise et à leur cruauté envers <strong>la</strong> société turque <strong>de</strong> l’île, le prési<strong>de</strong>nt<br />
américain Lyndon B. Johnson prévint <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong> ne pas mettre à<br />
exécution ses menaces. Puis, <strong>de</strong>s discussions furent entamées entre <strong>la</strong><br />
Grèce et <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> afin <strong>de</strong> trouver une solution diplomatique au problème.<br />
Entre-temps, l’EOKA-B, une organisation paramilitaire chypriote<br />
grecque radicale pro-enosis, fut fondée en 1971 et activement soutenue<br />
par <strong>la</strong> junte militaire grecque au pouvoir <strong>de</strong>puis 1967. Au départ, le<br />
EOKA-B était une organisation terroriste qui assassina <strong>de</strong>s civils et<br />
était sous le contrôle direct et l’influence <strong>de</strong> <strong>la</strong> junte militaire à Athènes<br />
qui avait renversé Makarios et installé à sa p<strong>la</strong>ce Nikos Sampson en<br />
1974 comme dictateur <strong>de</strong> Chypre d<strong>ans</strong> le but <strong>de</strong> réaliser l’enosis par<br />
<strong>de</strong>s moyens violents. Ces circonstances mettaient les Chypriotes turcs<br />
d<strong>ans</strong> une situation encore plus dangereuse qui entraîna l’intervention<br />
militaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> en 1974 sous réserve <strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> Zurich et <strong>de</strong><br />
Londres <strong>de</strong> 1959 et 1960. Cette intervention est justifiée par <strong>la</strong> volonté<br />
<strong>de</strong> mettre fin aux assauts <strong>de</strong>s Chypriotes grecs sur les Chypriotes turcs.<br />
Finalement, l’île est divisée en <strong>de</strong>ux: les Chypriotes grecs au sud, les<br />
turcs au nord.<br />
La <strong>Turquie</strong> dut souffrir, à cause <strong>de</strong> son intervention à Chypre, un embargo<br />
américain jusqu’en 1978. Vu que les longues discussions n’apportèrent<br />
aucune solution, les Chypriotes turcs finirent par déc<strong>la</strong>rer<br />
leur indépendance en établissant <strong>la</strong> République turque <strong>de</strong> Chypre du<br />
nord le 5 novembre 1983. Rauf Denktaş en <strong>de</strong>vint le premier prési<strong>de</strong>nt.<br />
Néanmoins, aucune organisation ni aucun pays ne voulut reconnaître<br />
son existence hormis <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>. Il est intéressant <strong>de</strong> noter que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
et Chypre du nord sont souvent blâmées comme étant ceux qui<br />
ne vou<strong>la</strong>ient aucune solution au problème <strong>de</strong> Chypre, alors même que<br />
Denktaş fit <strong>de</strong> grands efforts pour tenter <strong>de</strong> régler <strong>la</strong> question. Ce<strong>la</strong><br />
apparut plus c<strong>la</strong>irement lorsque <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et Chypre du nord accueillirent<br />
avec enthousiasme les résolutions <strong>de</strong> Kofi Anan sur <strong>la</strong> question<br />
chypriote d<strong>ans</strong> un référendum qui eut lieu simultanément en chypre du<br />
nord et du sud en avril 2004, pourtant les Chypriotes grecs le rejetèrent.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
157
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
158<br />
La longue quête <strong>de</strong> l’Union européenne<br />
C’est en 1959 que <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> fit sa première <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’adhésion à <strong>la</strong><br />
CEE et fut acceptée comme membre associé en 1963. La <strong>Turquie</strong> a<br />
toujours voulu être acceptée comme une partie <strong>de</strong> l’Europe mais ne mit<br />
pas suffisamment d’énergie pour faire avancer sa candidature, principalement<br />
pour <strong>de</strong>s raisons économiques, craignant les effets <strong>de</strong> l’ouverture<br />
<strong>de</strong> son marché à l’Europe. Néanmoins, lorsque Turgut Özal prit le pouvoir<br />
en 1983, il adopta une politique favorisant l’économie <strong>de</strong> marché,<br />
mais sa candidature fut rejetée en 1987. Depuis lors, les re<strong>la</strong>tions avec<br />
l’Union Européenne occupent une p<strong>la</strong>ce décisive et primordiale d<strong>ans</strong><br />
<strong>la</strong> politique étrangère turque. En juin 1983, <strong>la</strong> réunion du conseil européen<br />
à Copenhague mit en évi<strong>de</strong>nce certains critères politiques pour<br />
<strong>de</strong>venir membre <strong>de</strong> l’Union.<br />
En 1995, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> signa un accord d’union douanière avec l’UE<br />
complétant le processus d’intégration économique. Cette étape fut<br />
consacrée comme une étape majeure vers son adhésion à l’UE, mais fut<br />
amèrement déçue à <strong>la</strong> réunion du Conseil <strong>de</strong> l’Europe au Luxembourg<br />
en 1997 où elle ne trouva pas sa p<strong>la</strong>ce comme pays candidat. Après<br />
<strong>de</strong>ux années <strong>de</strong> froi<strong>de</strong>s re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong>, le conseil <strong>de</strong> l’Europe<br />
l’accepta comme pays membre à <strong>la</strong> réunion <strong>de</strong> Helsinki en 1999 qui<br />
permit <strong>de</strong> normaliser les re<strong>la</strong>tions. Alors, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> s’imposa un strict<br />
agenda <strong>de</strong> réformes à appliquer et réalisa <strong>de</strong>s efforts légis<strong>la</strong>tifs colossaux<br />
qui incluent entre autres <strong>de</strong>s mesures telles que l’é<strong>la</strong>rgissement<br />
<strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments constitutionnels en octobre 2001 et mai 2004. Les<br />
re<strong>la</strong>tions entre <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> et l’UE prirent un tournant important en<br />
direction <strong>de</strong> l’adhésion avec l’ouverture <strong>de</strong>s négociations d’adhésion le<br />
3 octobre 2005.<br />
Le fait est que <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> post guerre froi<strong>de</strong> a conduit à <strong>de</strong>s changements<br />
majeurs d<strong>ans</strong> <strong>la</strong> région poussant les déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> <strong>la</strong> politique<br />
étrangère <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> à s’adapter au nouveau contexte international et<br />
régional. Ainsi, Ankara encouragea une politique étrangère multi<strong>la</strong>térale<br />
concrétisée par les rapprochements diplomatiques avec le Caucase,<br />
l’Asie centrale, le Balk<strong>ans</strong>, et même plus tard avec le Moyen-Orient,<br />
rapprochements perçus comme géographiques mais aussi comme<br />
culturels et politiques. La <strong>Turquie</strong> essaya également d’établir <strong>de</strong> bonnes<br />
re<strong>la</strong>tions avec <strong>la</strong> Fédération russe et ce fut avec un remarquable succès<br />
qui vaut aussi pour ses re<strong>la</strong>tions avec Israël. Néanmoins, ce trait <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
politique étrangère turque ne doit pas faire oublier <strong>la</strong> coopération avec<br />
les USA et l’UE qui <strong>de</strong>meure une priorité. Récemment, <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong> dut
faire face à <strong>de</strong> grands défis avec <strong>la</strong> crise du golfe en 1990 et l’invasion <strong>de</strong><br />
l’Irak par les troupes internationales sous comman<strong>de</strong>ment américain en<br />
2003, et les conséquences <strong>de</strong> tout ce<strong>la</strong> y compris l’instabilité <strong>de</strong> l’Irak.<br />
La <strong>Turquie</strong> <strong>de</strong>vait aussi affronter <strong>la</strong> question du PKK, une organisation<br />
qui mena <strong>de</strong>s actions terroristes à l’intérieur du pays, mais elle fut<br />
gran<strong>de</strong>ment déçue lorsqu’elle sollicita l’ai<strong>de</strong> internationale d<strong>ans</strong> sa lutte<br />
contre le terrorisme.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
159
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
160
Bibliographie et autres lectures<br />
- Armaoğlu, Fahir, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara, Imprimerie Se-<br />
vinç, 1964.<br />
- Bainbridge, Margaret (ed.), Turkich People of the World, Colombia<br />
University Press, 1993.<br />
- Beeley, Brain W. (ed.), Turkish Tr<strong>ans</strong>formation : New Century, New<br />
Chal<strong>la</strong>nges, Huntingdon, The Eothen Press, 2002.<br />
- Çavdar, Tevfik, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (18391950), Ankara :<br />
İmge, 2004.<br />
- Deringil, Selim, Turkish Foreign Policy during the Second World War :<br />
an Active Neutrality, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.<br />
- Ersanlı Bahar, Büşra (ed.), Bağımsızlığın ilk Yıl<strong>la</strong>rı: Azerbaycan, Kazakistan,<br />
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Ankara, Kültür Bakanlığı<br />
(Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture), 1994.<br />
- Findley, Carter V., The Turks in World History, New York, Oxford University<br />
Press, 2005.<br />
- Finkel, Caroline, Osman’s Dream : The Story of the Ottoman Empire,<br />
1300–1923, John Murray, 2005.<br />
- Ha<strong>la</strong>çoğlu, Yusuf, Ermeni Tehciri ve Göç, İstanbul, Editions Bab-ı Ali<br />
Kültür, 2004.<br />
- Hale, William, Turkish Foreign Policy, 1774-<strong>2000</strong>, Londres, Frank<br />
Cass, <strong>2000</strong>.<br />
- Heper, Metin, İsmet İnönü : Yeni Bir Yorum Denemesi, Istanbul, Editions<br />
Tarih Vakfı Yurt, 1999.<br />
- Hostler, Charles Warren, The Turks of Central Asia, London, Praeger,<br />
1993.<br />
- Güvenç, Bozkurt, Türk Kimliği : Kültür Tarihinin Kaynak<strong>la</strong>rı, Ankara,<br />
Kültür Bakanlığı (Ministère <strong>de</strong> <strong>la</strong> Culture), 1994.<br />
- Imber, Collin, Osmanlı Imparatorluğu 1300–1650, İstanbul, Editions<br />
Bilgi Üniversitesi, 2006.<br />
- İnalcık Halil, The Ottoman Empire : The C<strong>la</strong>ssical Age, 1300-1600,<br />
Londres, Phoenix, 1994.<br />
- İnan, S. & Haytaoğlu, E (eds.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Ankara,<br />
Editions Anı, 2006.<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
161
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
162<br />
- Kafesoğlu, İbrahim, Türk Milli Kültürü, İstanbul, Editions Boğaziçi,<br />
1995.<br />
- Köseoğlu, Nevzat, Türk Dünyası Tarihi ve Türk Me<strong>de</strong>niyeti Üzerine<br />
Düşünceler, İstanbul, Ötüken, 1997.<br />
- Lewis, Bernard, The Emergence of Mo<strong>de</strong>rn <strong>Turkey</strong>, Oxford, Oxford<br />
University Press, 2001.<br />
- Lord Kinross, Atatürk : Bir Milletin Yeni<strong>de</strong>n Doğuşu, İstanbul, Altın<br />
Kitap<strong>la</strong>r, 2006.<br />
- Mango, Andrew, Atatürk : The Biography of the Foun<strong>de</strong>r of Mo<strong>de</strong>rn <strong>Turkey</strong>,<br />
John Murray, 2004.<br />
- Mango, Andrew, The Turks Today, Woodstock, The Overlook Press,<br />
2004.<br />
- Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Ankara, TTK (Institut<br />
d’Histoire turque), 1991.<br />
- Merçil, Erdoğan, Büyük Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi, Ankara, Editions<br />
Nobel, 2005.<br />
- Oran Baskın, (ed.), Türk Dış Politikası, İstanbul, İletişim, 2001.<br />
- Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İstanbul,<br />
Alkım, 2006.<br />
- Özey, Ramazan, Türk Dünyası, İstanbul, Eğitim, 1997.<br />
- Rasonyi, Laszlo, Tarihte Türklük, Ankara : Türk Kültürünü Araştırma<br />
Enstitüsü (Institut <strong>de</strong> Recherches sur <strong>la</strong> culture turque), 1993.<br />
- Roux, Jean-Paul, Türklerin Tarihi: Pasifik’ten Ak<strong>de</strong>niz’e <strong>2000</strong> yılı,<br />
İstanbul, Kabalcı, 2007. Histoire <strong>de</strong>s Turcs, Fayard, 1984, réédit. <strong>2000</strong>.<br />
- Sevim, A. & Yücel, Y., Türkiye Tarihi : Fetih, Selçuklu ve Beylikler<br />
Dönemi, Ankara, TTK(Institut d’Histoire turque) , 1989.<br />
- Sevim, A, & Merçil, E., Selçuklu Devletleri Tarihi: Siyaset, Teşki<strong>la</strong>t ve<br />
Kültür, Ankara, TTK (Institut d’Histoire turque), 1995.<br />
- Seydi, Süleyman, The Turkish Straits and the Great Powers : <strong>From</strong> the<br />
Montreaux Convention to the Early Cold War, 1936-1947, İstanbul, the<br />
Isis Pres, 2003.<br />
- Shaw, Stanford, History of the Ottoman Empire and Mo<strong>de</strong>rn <strong>Turkey</strong>,<br />
Vol I; Empire of Gazis : The Rise and Decline of the Ottoman Empire<br />
1290–1808, Cambridge, Cambridge University Press, 1976
- Sonyel, Sa<strong>la</strong>hi Ramsdan, Turkish Diplomacy 1918-1923 : Mustafa Ke-<br />
mal and the Turkish National Movement, Londres, SAGE, 1975.<br />
- Şahin, Muhammet, Türk Tarihi ve Kültürü, Ankara, Gündüz Eğitim<br />
ve Yayıncılık, 2003.<br />
- Turan, Ahmet Nezihi (ed.), Tarih El Kitabı : Selçuklu<strong>la</strong>rdan Bugüne,<br />
Ankara, Grafiker, 2004.<br />
- Turan, Osman, Selçuklu<strong>la</strong>r Zamanında Türkiye, İstanbul, Ötüken,<br />
2004.<br />
- Türk Dünyası El Kitabı, Birinci Cilt, Ankara, Türk Kültürünü<br />
Araştırma Enstitüsü (Institut <strong>de</strong> Recherches sur <strong>la</strong> culture turque),<br />
1992.<br />
- The Important Events of Turkish History, Ankara, The General Staff<br />
Printing House, 2003.<br />
- Yazıcı, Nesimi, İlk Türk - İs<strong>la</strong>m Devletleri Tarihi, Ankara, Türk Diyanet<br />
Vakfı, 2005.<br />
- Yücel, Yaşar, Timur’un Ortadoğu - Anadolu Seferleri ve Sonuç<strong>la</strong>rı (1393<br />
- 1402), Ankara, TTK (Institut d’Histoire turque), 1989.<br />
- Zürcher, Erik Jan, Mo<strong>de</strong>rnleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, Editions<br />
İletişim, 2006.<br />
- www.theottom<strong>ans</strong>.org<br />
- http://en.wikipedia.org<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
163
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
164
ANNEXES<br />
Ars<strong>la</strong>n İsrail<br />
Kutalmış<br />
Süleyman<br />
(1077-1086)<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
d’Anatolie<br />
La généalogie <strong>de</strong> Seldjouk<br />
Tugrul Bey<br />
(1038-1063)<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
Kirman<br />
Mahmut Berkyaruk I. Mehmed<br />
Mikail Musa<br />
Kavurd<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s<br />
d’Irak<br />
Çağrı Bey<br />
Melik Shah Tutuş<br />
Sencer<br />
Alpars<strong>la</strong>n<br />
(1063-1073)<br />
Rıdvan<br />
Dukak<br />
Seldjouki<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Syrie<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
165
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
166<br />
Liste <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> seldjouki<strong>de</strong>s d’Anatolie<br />
Süleyman Ier Shah (1074-1086)<br />
Kılıç Ars<strong>la</strong>n Ier (1092-1107)<br />
Malik Shah Ier (1107-1116)<br />
Mas`ûd Ier (1116-1155)<br />
Kılıç Ars<strong>la</strong>n II (1155-1188)<br />
Malik Shah II (1188-1192)<br />
Kay Khusraw Ier (1192-1196) (premier règne)<br />
Süleyman II Shah (1196-1204)<br />
Kılıç Ars<strong>la</strong>n III (1204-1205)<br />
Kay Khusraw Ier (1205-1210) (second règne)<br />
Kay Kâwus Ier (1210-1219)<br />
Kay Qubadh Ier (1219-1237)<br />
Kay Khusraw II (1237-1246)<br />
Kay Kâwus II (1246-1256)<br />
Kılıç Ars<strong>la</strong>n IV (1248-1265)<br />
Kay Qubadh II (1249-1257)<br />
Kay Khusraw III (1265-1284)<br />
Mas`ûd II (1284-1298) (premier règne)<br />
Kay Qubadh III (1298-1303)<br />
Mas`ûd II (1303-1307) (second règne)<br />
Mas’ûd III (1307-1308, règne incertain)<br />
Liste <strong>de</strong>s sult<strong>ans</strong> ottom<strong>ans</strong><br />
Osman I (1299-1326)<br />
Orhan Ghazi (1326-1359)<br />
Murad I (1359-1389)<br />
Bayezid I (1389-1402)<br />
Mehmed I (1413-1421)<br />
Murad II (1421-1451)<br />
Mehmed II (1451-1581)<br />
Bayezid II (1481-1512)<br />
Selim I (1512-1520)<br />
Soliman I (1520-1566)<br />
Selim II (1566-1574)<br />
Murad III (1574-1595)<br />
Mehmed III (1595-1603)<br />
Ahmed I (1603-1622)<br />
Mustapha I (1622-1623)<br />
Osman II (1618-1622)
Murad VI (1623-1640)<br />
Ibrahim (1640-1648)<br />
Mehmed IV (1648-1687)<br />
Suleyman II (1687-1691)<br />
Ahmed II (1691-1695)<br />
Mustapha II (1695-1703)<br />
Ahmed III (1703-1730)<br />
Mahmud I (1730-1754)<br />
Osman III (1754-1757)<br />
Mustapha III (1757-1774)<br />
Abdulhamid I (1774-1789)<br />
Selim III (1789-1807)<br />
Mustapha IV (1807-1808)<br />
Mahmud II (1808-1839)<br />
Abdulmedjid (1839-1861)<br />
Abdu<strong>la</strong>ziz (1861-1876)<br />
Murad V (1876)<br />
Abdulhamid II (1876-1909)<br />
Mehmed V (1909-1918)<br />
Mehmed VI (1918-1922)<br />
Les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> <strong>la</strong> République turque<br />
Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938)<br />
İsmet İnönü (1938-1950)<br />
Ce<strong>la</strong>l Bayar (1950-1960)<br />
Cemal Gürsel (1960-1966)<br />
Cev<strong>de</strong>t Sunay (1966-1973)<br />
Fahri Korutürk (1973-1980)<br />
Kenan Evren (1982-1989)<br />
Turgut Özal (1989-1993)<br />
Süleyman Demirel (1993-<strong>2000</strong>)<br />
Ahmet Nec<strong>de</strong>t Sezer (<strong>2000</strong>-2007)<br />
Abdul<strong>la</strong>h Gül (2007-)<br />
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
167
<strong>Esquisse</strong> <strong>de</strong> <strong>2000</strong> <strong>ans</strong> d’Histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Turquie</strong><br />
168