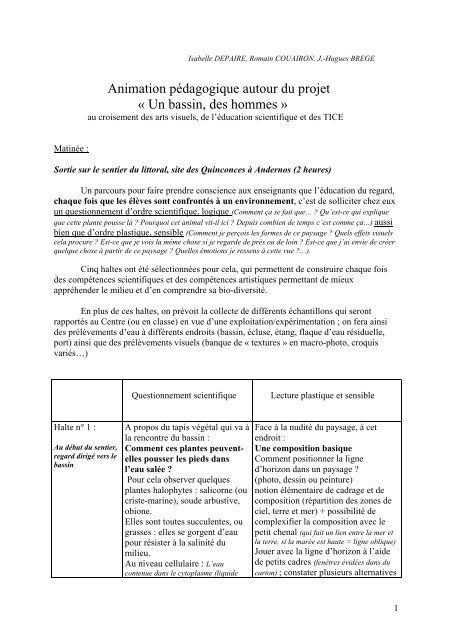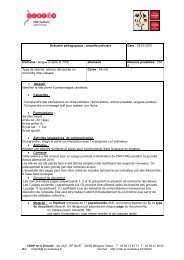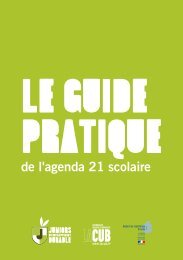Animation pédagogique autour du projet « Un bassin, des hommes »
Animation pédagogique autour du projet « Un bassin, des hommes »
Animation pédagogique autour du projet « Un bassin, des hommes »
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Matinée :<br />
Isabelle DEPAIRE, Romain COUAIRON, J.-Hugues BREGE<br />
<strong>Animation</strong> <strong>pédagogique</strong> <strong>autour</strong> <strong>du</strong> <strong>projet</strong><br />
<strong>«</strong> <strong>Un</strong> <strong>bassin</strong>, <strong>des</strong> <strong>hommes</strong> <strong>»</strong><br />
au croisement <strong>des</strong> arts visuels, de l’é<strong>du</strong>cation scientifique et <strong>des</strong> TICE<br />
Sortie sur le sentier <strong>du</strong> littoral, site <strong>des</strong> Quinconces à Andernos (2 heures)<br />
<strong>Un</strong> parcours pour faire prendre conscience aux enseignants que l’é<strong>du</strong>cation <strong>du</strong> regard,<br />
chaque fois que les élèves sont confrontés à un environnement, c’est de solliciter chez eux<br />
un questionnement d’ordre scientifique, logique (Comment ça se fait que… ? Qu’est-ce qui explique<br />
que cette plante pousse là ? Pourquoi cet animal vit-il ici ? Depuis combien de temps c’est comme ça…) aussi<br />
bien que d’ordre plastique, sensible (Comment je perçois les formes de ce paysage ? Quels effets visuels<br />
cela procure ? Est-ce que je vois la même chose si je regarde de près ou de loin ? Est-ce que j’ai envie de créer<br />
quelque chose à partir de ce paysage ? Quelles émotions je ressens à cette vue ?…).<br />
Cinq haltes ont été sélectionnées pour cela, qui permettent de construire chaque fois<br />
<strong>des</strong> compétences scientifiques et <strong>des</strong> compétences artistiques permettant de mieux<br />
appréhender le milieu et d’en comprendre sa bio-diversité.<br />
En plus de ces haltes, on prévoit la collecte de différents échantillons qui seront<br />
rapportés au Centre (ou en classe) en vue d’une exploitation/expérimentation ; on fera ainsi<br />
<strong>des</strong> prélèvements d’eau à différents endroits (<strong>bassin</strong>, écluse, étang, flaque d’eau rési<strong>du</strong>elle,<br />
port) ainsi que <strong>des</strong> prélèvements visuels (banque de <strong>«</strong> textures <strong>»</strong> en macro-photo, croquis<br />
variés…)<br />
Halte n° 1 :<br />
Au début <strong>du</strong> sentier,<br />
regard dirigé vers le<br />
<strong>bassin</strong><br />
Questionnement scientifique<br />
A propos <strong>du</strong> tapis végétal qui va à<br />
la rencontre <strong>du</strong> <strong>bassin</strong> :<br />
Comment ces plantes peuventelles<br />
pousser les pieds dans<br />
l’eau salée ?<br />
Pour cela observer quelques<br />
plantes halophytes : salicorne (ou<br />
criste-marine), soude arbustive,<br />
obione.<br />
Elles sont toutes succulentes, ou<br />
grasses : elles se gorgent d’eau<br />
pour résister à la salinité <strong>du</strong><br />
milieu.<br />
Au niveau cellulaire : L’eau<br />
contenue dans le cytoplasme (liquide<br />
Lecture plastique et sensible<br />
Face à la nudité <strong>du</strong> paysage, à cet<br />
endroit :<br />
<strong>Un</strong>e composition basique<br />
Comment positionner la ligne<br />
d’horizon dans un paysage ?<br />
(photo, <strong>des</strong>sin ou peinture)<br />
notion élémentaire de cadrage et de<br />
composition (répartition <strong>des</strong> zones de<br />
ciel, terre et mer) + possibilité de<br />
complexifier la composition avec le<br />
petit chenal (qui fait un lien entre la mer et<br />
la terre, si la marée est haute = ligne oblique)<br />
Jouer avec la ligne d’horizon à l’aide<br />
de petits cadres (fenêtres évidées dans <strong>du</strong><br />
carton) ; constater plusieurs alternatives<br />
1
Halte n° 2 :<br />
Après l’écluse,<br />
regard dirigé vers<br />
l’étang<br />
intracellulaire) a tendance à sortir de la<br />
cellule, pour équilibrer la salinité <strong>du</strong><br />
milieu et la sienne (phénomène<br />
d’osmose). Ceci a tendance à augmenter<br />
la pression à l’intérieur de la cellule.<br />
Pour éviter que la cellule n’éclate, il<br />
existe aussi un phénomène de dialyse (le<br />
sel traverse la membrane cellulaire <strong>du</strong><br />
milieu extérieur vers le cytoplasme pour<br />
équilibrer les concentrations.<br />
Il existe <strong>des</strong> salicornes non-comestibles<br />
dont les cendres contiennent de la soude<br />
et servaient à faire <strong>des</strong> savons.<br />
En parallèle avec l’étude en arts<br />
visuels : Comment se compose<br />
le paysage ? Pourquoi un<br />
étagement de la végétation?<br />
La partie de végétation recouverte<br />
par la mer régulièremement<br />
(slikke) ne ressemble pas à la<br />
partie peu fréquemment<br />
recouverte par la mer c'est-à-dire<br />
simplemement lors <strong>des</strong> vive-eaux<br />
ou gran<strong>des</strong> marées (shorre).<br />
La délimitation entre ces deux milieux<br />
est visible grâce à la laisse de mer<br />
(débris d’algues apportés par la<br />
dernière marée).<br />
Par endroits <strong>des</strong> touffes de spartine se<br />
concentrent : c’est un refuge pour<br />
certains mollusques<br />
De retour en classe, on peut<br />
repro<strong>du</strong>ire cet étagement en<br />
construisant une maquette avec<br />
les plantes séchées que l’on<br />
aura récoltées (herbier).<br />
Le marigot, refuge <strong>des</strong> oiseaux :<br />
Pourquoi tant d’oiseaux se<br />
regroupent à cet endroit ?<br />
(nourriture, perchoirs/séchoirs<br />
naturels = arbres mort)<br />
A marée basse, la table est mise<br />
pour une très grande majorité<br />
d’oiseaux, ceux qui trouvent leur<br />
nourriture dans la vase, comme<br />
les canards ou les foulques.<br />
Les chasseurs appellent le<br />
possibles(1/3 terre/mer + 2/3 ciel ou le<br />
contraire, 50% de chaque, très peu de terre et<br />
beaucoup de ciel…) et les fixer avec<br />
l’appareil photo<br />
De retour en classe, comment<br />
représenter ce tapis végétal, sa<br />
densité ? (essais graphiques variés,<br />
frottages, collages, empreintes à<br />
l’éponge, avec de la mousse<br />
végétale…)<br />
<strong>Un</strong>e composition plus complexe avec<br />
étagement <strong>des</strong> plans (les buissons de<br />
baccharis <strong>du</strong> premier plan, le marais, l’îlot au<br />
bois mort, re-le marais, les buissons de la<br />
berge opposée, la ligne <strong>des</strong> pins et quelques<br />
lignes de force verticales les roseaux <strong>du</strong> 1er<br />
plan, les arbres morts de la berge)<br />
Faire <strong>des</strong> relevés au crayon sur carnet de<br />
croquis + photos<br />
<strong>Un</strong>e gamme chromatique subtile <br />
camaïeu de verts<br />
Comment la repro<strong>du</strong>ire en classe ?<br />
(avec les outils habituels <strong>des</strong> arts plastiques :<br />
2
moment où les oiseaux vont se<br />
nourrir sur le <strong>bassin</strong> à marée<br />
basse : la passe.<br />
Pourquoi les <strong>hommes</strong>, si<br />
soucieux de la propreté <strong>du</strong><br />
littoral, lieu prisé par les<br />
touristes, ont-ils laissé <strong>des</strong><br />
arbres morts en place ?<br />
Les arbres morts servent de<br />
perchoir aux oiseaux qui se<br />
réfugient une fois nourris.<br />
Faire la sortie avec les enfants si<br />
possible avec <strong>des</strong> jumelles pour<br />
observer cormorans, aigrettes…<br />
Parler <strong>du</strong> cormoran et de son<br />
plumage particulier non étanche.<br />
Cet oiseau possède une certaine<br />
glande qui sécrète une graisse<br />
(située au niveau <strong>du</strong> croupion)<br />
qui est atrophiée. Les autres<br />
oiseaux s’en<strong>du</strong>isent le plumage<br />
avec pour le rendre étanche, ce<br />
que ne peut pas faire le cormoran.<br />
Les espèces végétales le long <strong>du</strong><br />
sentier sont-elles toutes les<br />
mêmes ?<br />
Certaines espèces sont indigènes,<br />
c'est-à-dire qu’elles poussent et<br />
ont évolué dans le même milieu<br />
depuis toujours : prunelliers,<br />
aubépine, églantier, tamaris<br />
arbousiers.<br />
D’autres sont <strong>des</strong> espèces<br />
rapportées qui se sont acclimatées<br />
au Bassin d’Arcachon, comme le<br />
baccharis, jusqu’à en devenir<br />
quasiment invasives.<br />
Le baccharis se répand très rapidement<br />
sur le Bassin, compte tenu <strong>du</strong> fait que le<br />
vent dissémine très facilement les<br />
graines (<strong>du</strong>vets blancs).<br />
C’est est une plante aromatique<br />
d’Amazonie qui peut atteindre 2 mètres<br />
de hauteur. De nombreuses populations<br />
indigènes <strong>des</strong> pays d’Amérique <strong>du</strong> Sud<br />
utilisent le baccharis comme aliment<br />
mais surtout comme régulateur <strong>du</strong><br />
poids. Dans l’in<strong>du</strong>strie pharmaceutique<br />
(avec les outils habituels <strong>des</strong> arts plastiques :<br />
les feutres, les pastels, les encres colorées, la<br />
peinture…mais aussi le papier-revue déchiré,<br />
le papier peint, etc ; mixer les techniques ;<br />
réaliser une collection de verts différents, <strong>des</strong><br />
nuanciers ; les nommer <strong>«</strong> vert baccharis <strong>»</strong>,<br />
<strong>«</strong> vert olive <strong>»</strong>…<br />
Retravailler ce paysage avec un logiciel de<br />
traitement-photo en gardant ses lignes de<br />
composition principales, injecter d’autres<br />
couleurs, d’autres textures<br />
Interpréter : Et si ce paysage était bleu ou<br />
orange retravailler le camaïeu avec les<br />
outils et les techniques de son choix<br />
Autre piste possible : intro<strong>du</strong>ire un intrus dans<br />
ce paysage (par collage : un oiseau impossible<br />
<strong>Un</strong>e créature insolite perchée, un objet<br />
incongru…)<br />
3
Halte n° 3 :<br />
En arrivant à la<br />
plage, près <strong>des</strong><br />
palissa<strong>des</strong> de<br />
protection et <strong>du</strong><br />
grand pin<br />
il est utilisé pour lutter contre les<br />
troubles digestifs. La Baccharine<br />
extraite <strong>du</strong> Baccharis inhibe les<br />
métalloprotéinases, enzymes<br />
responsables <strong>du</strong> développement <strong>du</strong> tissu<br />
adipeux.<br />
Quelles sont les traces <strong>«</strong> de<br />
mort <strong>»</strong> à cet endroit ?<br />
- les pins : certains sont tombés<br />
au sol, ils sont percés de petits<br />
trous, leur consistance est<br />
friable. On retrouve <strong>des</strong> épines<br />
marrons au sol alors qu’elles<br />
sont vertes sur les arbres. Les<br />
pommes de pins sont<br />
déchiquetées et sont sèches à<br />
l’inverse de celles qui sont<br />
dans l’arbre.<br />
- les glands : ils sont au sol et<br />
troués.<br />
- le sable : il est noirâtre et non<br />
pas clair comme près de la<br />
mer : il est chargé d’humus,<br />
ensemble de végétaux en<br />
décomposition.<br />
Quelles sont les traces de vie à<br />
cet endroit ?<br />
Ce sont les traces <strong>des</strong> animaux<br />
qui se nourrissent <strong>des</strong> végétaux<br />
morts ou parfois vivants.<br />
- les arbres :<br />
. Trous ronds de moins de 8 mm de<br />
diamètre : capricornes <strong>«</strong> Cytus (noir et<br />
jaune), coléoptères buprestes.<br />
. Trous ronds de plus de 8 mm de<br />
diamètre : papillons (trous avec une<br />
peau de chrysalide engagée), bourdons<br />
ou abeilles (galeries divisées par <strong>des</strong><br />
cloisons : chaque loge correspondant à<br />
une larve).<br />
. Trous ovales : Ergate Forgeron, grand<br />
bupreste ou sirex <strong>des</strong> pins.<br />
. Gran<strong>des</strong> galeries sous l’écorce :<br />
scolytes <strong>du</strong> pin<br />
. Déformation ou renflement <strong>des</strong> tiges<br />
(galles) : papillon Sésie ou guêpe<br />
Cynipide (toute petite guêpe).<br />
Attention ! les galles ne sont pas <strong>du</strong>es<br />
aux animaux mais à <strong>des</strong> bactéries et <strong>des</strong><br />
champignons microscopiques. Ces<br />
galles nourrissent les larves d’insectes.<br />
- les pignes de pins<br />
. Trous : différentes sortes de<br />
Approche sensorielle : un<br />
environnement où se côtoient 2<br />
matériaux dominants, le bois et le<br />
sable :<br />
Faire remarquer la rigidité <strong>du</strong> bois<br />
le bois vivant (les troncs <strong>des</strong> pins)<br />
le bois mort (les branches rassemblées<br />
par les promeneurs au pied de l’arbre) et,<br />
par contraste, la fluidité/malléabilité <strong>du</strong><br />
sable<br />
Remarquer l’absence d’écorce sur le<br />
bois mort et les veinage lisse <strong>du</strong> bois.<br />
Les branches mortes assemblées en<br />
équilibre contre le tronc <strong>du</strong> pin vivant<br />
donnent envie d’intervenir et de jouer<br />
à faire <strong>des</strong> constructions (comme une<br />
invite de la part <strong>des</strong> promeneurs<br />
précédents)<br />
Réaliser <strong>des</strong> compositions plastiques<br />
éphémères avec les matériaux<br />
ramassés alentour (bois mort, aiguilles de<br />
pin, sable) = démarche <strong>du</strong> Land’art (Richard<br />
Long, Goldsworthy…) ; les assembler selon<br />
<strong>des</strong> règles plastiques de son choix : répétition,<br />
accumulation, chevauchement, en cercle, en<br />
spirale, en cœur, en quinconces… ; les fixer<br />
par le biais de la photo ; les laisser au<br />
regard <strong>des</strong> promeneurs ou les démonter<br />
Observer attentivement les<br />
<strong>«</strong> <strong>des</strong>sins <strong>»</strong> <strong>du</strong> bois (vivant ou mort),<br />
en faire <strong>des</strong> relevés dans le carnet de<br />
croquis (reliefs marqués de l’écorce <strong>des</strong><br />
pins, lignes longitudinales <strong>des</strong> veines <strong>du</strong> bois<br />
mort, trous d’insectes, nœuds <strong>du</strong> bois, cercles<br />
concentriques à la coupe <strong>des</strong> branches…) ;<br />
faire aussi <strong>des</strong> relevés photographiques<br />
En classe, à partir <strong>des</strong> croquis, faire<br />
<strong>des</strong> recherches graphiques avec<br />
plusieurs outils : crayons différents,<br />
fusain, plume et encre de chine, calame, feutre<br />
noir, pinceaux…<br />
Réaliser <strong>des</strong> sculptures avec <strong>des</strong><br />
morceaux de bois provenant de la<br />
4
Halte n° 4 :<br />
Sur le sable<br />
mouillé, au bord <strong>du</strong><br />
massif de salicornes<br />
...<br />
coléoptères<br />
. Grignotage : écureuils<br />
- les feuilles<br />
. Grignotage en arc de cercle :<br />
chenilles<br />
. Petits disques d’environ 1cm de<br />
diamètre : Mégachile (abeille<br />
coupeuse de feuilles)<br />
. Limbes de la feuille qui a été<br />
mangée entre les nervures qui sont<br />
restées : chenille <strong>du</strong> papillon<br />
Ptérophore ou larve de la guêpe<br />
Tenthrède.<br />
. Feuille enroulée : charançon<br />
cigarier<br />
- les glands : coléoptères<br />
<strong>«</strong> charançon <strong>»</strong><br />
Insister avec les élèves sur le<br />
cycle de vie : Ce qui est mort<br />
dans la nature n’est pas bon à<br />
jeter comme un simple détritus, il<br />
servira de nourriture pour un<br />
autre animal. Il y a bien<br />
longtemps que la nature fait elle-<br />
même son propre recyclage !<br />
Que nous laisse la mer sur la<br />
plage comme témoignage de la<br />
vie marine ?<br />
Elle laisse en fait essentiellement<br />
<strong>des</strong> témoignages de la mort :<br />
Aller pieds nus dans la vase :<br />
crabes échoués, puces de mer<br />
(talitres), cadavres de cygne,<br />
coquillages + odeur de<br />
putréfaction.<br />
Observer la laisse de mer (délimitation<br />
de la dernière marée) : on y trouve<br />
principalement trois algues : Les<br />
entéromorphes, la laitue de mer (ulva :<br />
cf. pollution et <strong>des</strong> marées vertes en<br />
Bretagne <strong>du</strong>es principalement ), et le<br />
cladophore (algue filamenteuse).<br />
Plus généralement, les algues peuvent<br />
servir dans l’in<strong>du</strong>strie <strong>des</strong> engrais (le<br />
varech a été très longtemps utilisé pour<br />
la fabrication de la soude et de la<br />
potasse), elles peuvent aussi servir<br />
comme liant dans l’in<strong>du</strong>strie agroalimentaire<br />
(carraghénanes pour les<br />
liants dans les flancs ou le dentifrice, et<br />
algine pour les liants en charcuterie).<br />
morceaux de bois provenant de la<br />
nature ; se poser <strong>des</strong> questions de<br />
fixation ( collage, ficelage, clouage,<br />
chevillage ?) et d’équilibre pour la<br />
composition souhaitée<br />
Comment se servir de la plage<br />
comme d’une feuille de papier ?<br />
Observer les différentes textures<br />
visuelles <strong>du</strong> sable (sec, mouillé, gardant<br />
les on<strong>du</strong>lations <strong>des</strong> vagues et <strong>du</strong> vent,<br />
retravaillé en serpentins par les vers<br />
arénicoles, marqué de signes laissés par les<br />
traces <strong>des</strong> pattes <strong>des</strong> oiseaux marins…)<br />
Explorer le plaisir de laisser <strong>des</strong><br />
traces de différentes façons sur le<br />
sable<br />
Mieux qu’une feuille de papier, on<br />
peut laisser <strong>des</strong> traces en creux dans le<br />
sable aussi bien qu’en relief (il a la<br />
particularité d’être à la fois support et<br />
matière)<br />
En écrivant son prénom (avec le<br />
doigt, <strong>du</strong> bout d’un bâton, en formant <strong>des</strong><br />
lettres en relief avec <strong>des</strong> matériaux ramassés –<br />
coquillages, varech, branches, crabes<br />
morts…- , en modelant les lettres en relief<br />
dans le sable mouillé<br />
En <strong>des</strong>sinant un visage (en<br />
combinant les trois solutions : tracés en creux,<br />
tracés en relief-bosses- et apports d’éléments<br />
extérieurs)<br />
En réalisant une collection<br />
5
Halte n°5 :<br />
Au port ostréicole<br />
Pourquoi la mer nous laisse<br />
uniquement sur la plage <strong>des</strong><br />
coquillages vi<strong>des</strong> ?<br />
Les coquillages qui se retrouvent<br />
sur la plage sont <strong>des</strong> anciens<br />
mollusques en fin de vie ou bien<br />
mangés par <strong>des</strong> prédateurs.<br />
Etudier certains coquillages<br />
(palour<strong>des</strong>, coques, turitelles,<br />
scalaires, bigorneaux noirs,<br />
bigorneaux perceurs, donaces…),<br />
et leur place dans la chaîne<br />
alimentaire de la mer.<br />
Les coquillages,dans leur très grande<br />
majorité se nourrissent <strong>du</strong><br />
phytoplancton et <strong>du</strong> zooplancton marins<br />
(ce sont <strong>des</strong> filtreurs) sauf pour les<br />
bigorneaux (herbivores) et sont mangés<br />
par :<br />
- les poissons<br />
- les crabes<br />
- les étoiles de mer<br />
- la nasse (cyclonassa)<br />
En quoi l’activité ostréicole estelle<br />
compatible avec le<br />
développement <strong>du</strong>rable ?<br />
C’est une activité agricole<br />
relativement peu polluante (pas<br />
d’engrais, pas de nourriture<br />
in<strong>du</strong>strielle qui aurait un impact<br />
sur l’environnement<br />
On recycle même les coquilles<br />
vi<strong>des</strong> en sacs pour le remblais <strong>des</strong><br />
chemins ou l’édification de<br />
digues ou pontons. <strong>Un</strong> bel<br />
exemple est celui <strong>des</strong> pontons<br />
construits par les pêcheurs aux<br />
prés salés d’Arès.<br />
L’homme, récemment, a créé de<br />
nouvelles activités <strong>autour</strong> de<br />
l’ostréiculture : édification de<br />
restaurants sur le port ostréicole,<br />
emplacement <strong>des</strong> sièges d’ associations<br />
de plaisanciers pour la pinasse à voile.<br />
Pour plus de renseignements<br />
techniques sur l’activité :<br />
d’empreintes, (pieds chaussés, pieds<br />
nus, pattes d’oiseaux…)<br />
Exploiter la variété <strong>des</strong> graphismes<br />
<strong>des</strong> semelles <strong>des</strong> chaussures <strong>des</strong> élèves<br />
en constituant un relevé de toutes les<br />
empreintes <strong>des</strong> souliers de la classe ;<br />
trouver différentes solutions<br />
d’agencement (anarchique, en carré, en<br />
spirale, alignés en quinconces…)<br />
Photographier tous les essais un peu<br />
aboutis<br />
Sur le carnet de croquis :<strong>des</strong>sin <strong>des</strong><br />
motifs chevelus <strong>du</strong> varech mouillé<br />
on<strong>du</strong>lant sur le sable<br />
Autres pistes possibles : modelage de vase<br />
argileuse et collecte de cette glaise grise pour<br />
essayer de l’inclure dans <strong>des</strong> pro<strong>du</strong>ctions<br />
plastiques (la colorer avec de la peinture,<br />
épaissir la peinture avec, observer les<br />
craquelures au séchage…)<br />
<strong>Un</strong>e collection de tas<br />
Dès qu’il y a travail de l’homme, il y a<br />
organisation de l’espace (et dans<br />
l’espace) et notamment rangement<br />
Orienter le regard <strong>des</strong> élèves sur<br />
les indices visuels témoignant de ces<br />
activités de rangement, à savoir tous<br />
les entassements présents sur le port<br />
(tas de tuiles, fagots de tiges métalliques, de<br />
<strong>«</strong> pinhots <strong>»</strong>, tas de palettes de bois,<br />
alignements de coupelles plastiques, de tubes<br />
collecteurs, tas de poches grillagées appelées<br />
<strong>«</strong> ambulances <strong>»</strong>…)<br />
Tous ces agencements ont en commun<br />
de s’appuyer sur <strong>des</strong> principes de<br />
géométrie, qui rationalisent<br />
l’utilisation de l’espace et facilitent<br />
l’activité humaine<br />
Faire <strong>des</strong> relevés graphiques et<br />
photographiques de ces empilements<br />
pour le musée de classe ; remarquer les<br />
effets de rythmes visuels<br />
Evoquer pour chaque tas l’utilité de<br />
ses éléments dans le circuit de l’huître<br />
Apport culturel en classe : le<br />
procédé de l’accumulation/répétition<br />
6
http://www.ostrea.org<br />
Midi : déjeuner au Centre de Mer<br />
Après–midi<br />
se rencontre dans l’art ; en présenter<br />
plusieurs exemples (Arman, César,<br />
Warhol, Richard Long…)<br />
Les stagiaires se répartissent en trois ateliers conçus <strong>autour</strong> de 8 affiches issues <strong>du</strong><br />
pack <strong>«</strong> Le développement <strong>du</strong>rable, pourquoi ?<strong>»</strong> (photographies de Yann Arthus-Bertrand)<br />
sélectionnées parce qu’elles évoquent <strong>des</strong> problématiques qui peuvent concerner le milieu <strong>du</strong><br />
Bassin d’Arcachon :<br />
1er groupe d’affiches (l’environnement) :<br />
- Ecosystèmes, source de vie / Ne pas surexploiter les ressources de la planète<br />
- Protéger la vie marine / La biodiversité en danger<br />
2ème groupe d’affiches (les <strong>hommes</strong>) :<br />
- Vivre de son travail<br />
- Accéder à l’eau potable<br />
- Davantage d’énergies renouvelables<br />
- Ré<strong>du</strong>ire nos déchets<br />
3 ateliers tournants sur l’après-midi (ou 1 en fin de matinée et 2 l’après-midi, si le déjeuner est<br />
à 13h))<br />
- Atelier Arts visuels ( 45 min) : Isabelle DEPAIRE<br />
1) Lecture d’image savoir décoder les affiches de Yann Artus Bertrand<br />
<strong>Un</strong> sens qui n’est pas donné d’emblée !<br />
Toutes ces affiches sont complexes. Les élèves peuvent très bien passer devant<br />
pendant plusieurs années sans en saisir le sens. Elles demandent un effort d’ investigation<br />
visuelle accompagnée par le maître, qui peut ritualiser ces moment de lecture d’image en<br />
interrogeant une affiche par semaine, par exemple. C’est par l’échange et la négociation<br />
langagière que s’élaboreront progressivement les significations, fruits <strong>du</strong> regard de toute la<br />
classe, avec forcément <strong>des</strong> divergences d’interprétations, parce que ce sont <strong>des</strong> œuvres d’art et<br />
qu’elles ne résonnent pas pareil pour tout le monde. Mais comme elles font appel à <strong>des</strong><br />
références scientifiques, pour accéder au sens, le rôle <strong>du</strong> maître sera primordial ; c’est en<br />
s’appuyant sur ce que les élèves voient et sur ce qu’ils ressentent qu’il pourra apporter aux<br />
élèves les concepts (géographiques, scientifiques, économiques) qui leur font défaut pour<br />
tenter de résoudre -à plusieurs- les énigmes visuelles que sont ces images et faire fonctionner<br />
les capacités dé<strong>du</strong>ctives et symboliques qui amèneront au sens.<br />
Pour ce faire, je vous conseille de masquer dans un premier temps les zones de texte et<br />
les titres (par <strong>des</strong> caches en papier maintenus par <strong>du</strong> Patafix) ; ils sont porteurs de<br />
l’extrapolation environnementale (de la dimension campagne de sensibilisation) et l’étude de<br />
leur lien avec l’image demande à elle-seule un temps d’analyse (en cycle 3). Dans certains<br />
cas, ce n’est qu’au moment de leur dévoilement que le message se fera jour ( voir l’affiche <strong>du</strong><br />
cœur de Voh en Nouvelle Calédonie) ou sera consolidé.<br />
7
Lors d’une séance de lecture d’image, l’élève doit être amené à se poser les questions<br />
suivantes :<br />
Qu’est-ce que je vois ?<br />
(<strong>du</strong> côté de la perception visuelle)<br />
pour construire<br />
…pour le message construire<br />
le message<br />
Que nous dit cette<br />
image ?<br />
Qu’est-ce que je ressens ? Qu’est-ce que je comprends ?<br />
(<strong>du</strong> côté <strong>des</strong> sensations) (<strong>du</strong> côté de la dé<strong>du</strong>ction, <strong>du</strong><br />
raisonnement logique)<br />
Examen de 5 affiches en détail (la composition : la répartition <strong>des</strong> masses, les lignes de force,<br />
la lumière, le rôle de la couleur…analyse de ces choix plastiques mis au service d’un<br />
message (dimension de propagande) celui de la préservation de la planète, de sa biodiversité en<br />
compatibilité avec l’activité de l’homme (son travail, ses besoins en énergie, ses<br />
nuisances…) ; bref, la problématique <strong>du</strong> développement <strong>du</strong>rable !<br />
Ce n’est pas la première fois que la photo esthétique se met au service de l’information et surtout de la publicité<br />
(montrer exemples de photos de campagnes de pub de GDF qui jouent à fond la carte environnementale au point<br />
qu’on penserait presque avoir affaire à <strong>des</strong> organismes à vocation de protection de l’environnement)<br />
2) Pistes de pro<strong>du</strong>ction plastique sur sollicitation de ces affiches et <strong>du</strong> matériau rapporté de<br />
la sortie (confortées par <strong>des</strong> apports culturels émanant de la pro<strong>du</strong>ction artistique : sélection<br />
d’œuvres utilisant <strong>des</strong> matériaux de l’environnement ou jouant avec <strong>des</strong> procédés plastiques<br />
évoqués ; ex. : l’accumulation, l’alignement…) (Diaporama)<br />
- Atelier Informatique (45 min) : Jean-Hugues BREGE<br />
1) Créer de nouvelles images avec l’ordinateur avec un logiciel de traitement d’image<br />
Travail sur les textures photographiées (retouche d’image avec le logiciel<br />
<strong>«</strong> photofiltre <strong>»</strong> ; association de ces textures avec une photo de paysage pour réaliser<br />
un paysage matiériste qui intègre à la fois le regard de loin (le paysage photographié)<br />
et le regard de près (les textures en macro-photo : cotonniers, sable, varech,<br />
salicorne…)<br />
- Créer un damier <strong>des</strong> textures (présentation kaléidoscope), tester d’autres<br />
possibilités d’agencements géométriques (ex. : en cible);<br />
- Détournement de l’affiche <strong>du</strong> cœur (déboisement de la mangrove d’Arthus-<br />
Bertrand),<br />
Modalités : démonstration JH et éventuellement manipulation par les stagiaires<br />
Technique<br />
Photofiltre http://www.g<strong>des</strong>roches.com/formation/cphotofiltre.htm<br />
profondeur de champ http://www.g<strong>des</strong>roches.com/formation/fprofchamp.htm<br />
filé http://www.g<strong>des</strong>roches.com/formation/ffile.htm<br />
8
composition, cadrage http://www.linternaute.com/photo_numerique/cadrage/<br />
CRTICE : http://crtice33.ac-bordeaux.fr/site<br />
2) Savoir utiliser les ressources documentaires en sciences sur Internet (en lien avec<br />
les notions abordées pendant la sortie <strong>du</strong> matin)<br />
http://www.ledeveloppement<strong>du</strong>rable.fr/<br />
http://www.yannarthusbertrand.com/<br />
http://www.yannarthusbertrand.com/yann2/index.php<br />
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil<br />
http://www.ostrea.org/<br />
http://www.geoportail.fr/<br />
http://www.lamap.fr/<br />
http://www.lamap.fr/bdd_image/973_intro<strong>du</strong>ction.pdf<br />
Ecologie : Environnement<br />
http://www.lamap.fr/?Page_Id=4&DomainScienceType_Id=5&ThemeType_Id=15<br />
Les documents d'accompagnement<br />
http://www.lamap.fr/bdd_image/19_enseigner_sciences.pdf<br />
CRDP http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/sciences_et_techno_a_lecole_primaire.asp?loc=2<br />
http://e<strong>du</strong>scol.e<strong>du</strong>cation.fr/D0027/StatutRechercheDocTICE.htm<br />
Ecole <strong>des</strong> sciences : http://www.perigord.tm.fr/~ecole-scienc/<br />
Frapna.Org : http://www.frapna..org/<br />
Sites artistiques :<br />
http://www.richardlong.org (artiste de Land Art)<br />
www.cnac-gp.fr (toute la collection <strong>du</strong> Centre Pompidou en ligne : 58 000 œuvres ; 5200<br />
artistes )<br />
3) Les espaces de publication<br />
CliClass’33 http://cc33.ac-bordeaux.fr/<br />
Réseau Sciences http://crdp.ac-bordeaux.fr/reseau-sciences/<br />
- Atelier Sciences et technologie (45 min) : Romain COUAIRON<br />
Accéder à l’eau potable :<br />
Plusieurs échantillons d’eau sont réunis (bouteille d’eau <strong>du</strong> robinet, bouteille d’eau de<br />
source (Abatilles par exemple…), bouteille d’eau de mer, bouteille d’eau de pluie, bouteille<br />
d’eau de rivière (BETEY), bouteille d’eau saumâtre (réservoir près <strong>du</strong> sentier <strong>du</strong> littoral).<br />
- Comment rendre une eau sale la plus propre possible ?<br />
Faire l’expérience avec l’eau boueuse et salée <strong>du</strong> BETEY ou bien de l’eau <strong>des</strong><br />
réservoirs. On a beau filtrer une eau avec un maillage le plus petit possible, il reste toujours<br />
une petite couleur ou un aspect trouble. On utilise alors <strong>des</strong> procédés chimiques pour<br />
purifier l’eau (ozonation, chloration, bactéries qui détruisent les molécules organiques… :<br />
parler <strong>des</strong> différentes étapes dans une station d’épuration)<br />
Matériel : Bouteilles d’eau minérale vi<strong>des</strong>, coton, filtres à café, charbon actif, grilles<br />
maillées en fer, poster <strong>du</strong> CDDP sur les stations d’épuration.<br />
9
- L’eau de mer, transparente, est-elle pure ?<br />
Faire l’expérience avec l’eau de mer.<br />
La goûter avec le bout de la langue, La chauffer, ou la laisser évaporer (si l’on avait <strong>du</strong><br />
temps) on un récupère alors un dépôt blanchâtre. On peut aussi prendre la même quantité<br />
d’eau <strong>du</strong> robinet et la peser avec une balance Roberval : l’eau salée est plus lourde .<br />
Matériel : Balance Roberval (CDDP), gazinière <strong>du</strong> centre , tubes à essai <strong>du</strong> centre,<br />
casseroles.<br />
- L’eau minérale est-elle si pure qu’on nous le dit dans les messages publicitaires ?<br />
Faire évaporer l’eau minérale (qui contient <strong>des</strong> oligo-éléments) en la chauffant : <strong>des</strong><br />
dépôts blancs restent au fond de la casserole.<br />
Matériel : Gazinière <strong>du</strong> centre, casseroles<br />
- L’eau <strong>du</strong> robinet est-elle la même que l’eau de pluie ?<br />
Utiliser les papiers de <strong>du</strong>reté pour voir que l’eau de pluie ne contient pas de calcaire<br />
(elle ne contient d’ailleurs quasiment aucuns minéraux)<br />
Matériel : bandelettes Nitrates, Ph, Dureté, récipients <strong>du</strong> centre<br />
- Prolongements : Si une eau claire peut ne pas être potable, que contient-elle alors ?<br />
- Sucre, sel, : travailler sur la dissolution<br />
- Microbes : demander à un laboratoire d’analyse un peu de gélose<br />
(milieu de culture) gratuitement. En mettant de l’eau dedans, les<br />
microbes se développent ou non (prolifération de mousses …etc)<br />
On peut l’essayer avec de l’eau de pluie, de l’eau avec un peu de<br />
chlore dedans…etc<br />
L’écosystème, source de vie :<br />
Travail sur les Artémias : apporter le mini aquarium avec les artémias à l’intérieur<br />
L’élevage de ces animaux est intéressant <strong>du</strong> point de vue de l’étude <strong>des</strong> écosystèmes : les<br />
artémias vivent grâce au phytoplancton contenu dans l’eau de mer (dans le kit c’est une algue<br />
bien spécifique Dunaliella salina). En se développant, l' Artémia rejette <strong>du</strong> gaz carbonique qui<br />
se dissout dans l’eau de l’aquarium. Le Phytoplancton transforme ce gaz en oxygène dont l'<br />
Artémia a besoin pour respirer. Les déchets émis par l’Artémia servent d’engrais pour le<br />
phytoplancton. En se développant, celui-ci deviendra ensuite une nourriture pour l’espèce de<br />
zooplancton qu’est l' Artémia.<br />
Si l’on met le mini-aquarium dans le noir : pas de lumière, pas de photosynthèse, au bout d’un<br />
certain temps les artémias deviennent rouges : ils développent <strong>des</strong> hématies en grande quantité<br />
puis si on les laisse encore plus longtemps dans l’obscurité, ils meurent...<br />
10