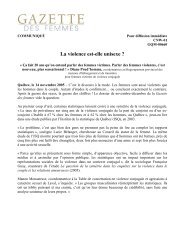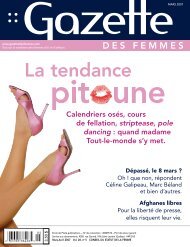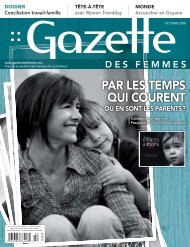Le dilemme genre/culture ou comment penser la citoyenneté
Le dilemme genre/culture ou comment penser la citoyenneté
Le dilemme genre/culture ou comment penser la citoyenneté
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
au patriarcat le plus dur de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète. En dernier ressort, ce n’est plus le respect de<br />
l’égalité des sexes et du libre arbitre qui fait loi en France 28 ».<br />
Attribuer au port du f<strong>ou</strong><strong>la</strong>rd un sens unique, soit l’oppression des femmes, et le voir<br />
comme une imposition des pères et des frères qui incarneraient le patriarcat le plus dur<br />
de <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète, sans jamais poser qu’il p<strong>ou</strong>rrait relever du choix des filles, figurent parmi<br />
les éléments clés des procédés discursifs utilisés par les partisans d’une loi interdisant<br />
les signes religieux « ostensibles », dont le voile is<strong>la</strong>mique et <strong>la</strong> kippa, à l’école<br />
publique 29 .<br />
Il ressort que les débats actuels sur les femmes et les religions, et plus spécifiquement<br />
sur l’égalité des sexes et l’accommodement de <strong>la</strong> diversité religieuse et ethno<strong>culture</strong>lle,<br />
doivent s’inscrire dans un contexte plus <strong>la</strong>rge tenant compte du racisme et d’autres<br />
formes d’exclusion, auxquels sont confrontés les gr<strong>ou</strong>pes minoritaires dont les<br />
pratiques illibérales sont dénoncées 30 . Sans cette prise en considération des<br />
dissymétries de p<strong>ou</strong>voir entre les majoritaires et les minoritaires et des inégalités<br />
sociales qui en déc<strong>ou</strong>lent, les préoccupations concernant le bien-être des femmes et<br />
des jeunes filles issues des minorités, aussi légitimes qu’elles puissent être, risquent de<br />
répéter les erreurs d’un certain féminisme colonial et de consolider des rapports<br />
hégémoniques entre femmes, et entre féministes. Cette contextualisation est<br />
impérative p<strong>ou</strong>r quiconque veut interroger les s<strong>ou</strong>bassements des disc<strong>ou</strong>rs dominants<br />
sur <strong>la</strong> condition féminine chez les « autres » et, de façon plus <strong>la</strong>rge, les manières dont<br />
les rapports de <strong>genre</strong> se tr<strong>ou</strong>vent entremêlés aux rapports sociaux et politiques<br />
constitutifs des identités et des altérités nationales et transnationales 31 .<br />
En prenant une distance critique à l’endroit de <strong>la</strong> conception dominante du<br />
« problème » qui prend <strong>la</strong> forme d’une opposition irréconciliable entre le féminisme et<br />
le multiculturalisme, il a donc été possible de faire émerger <strong>la</strong> complexité des clivages<br />
intra-femmes qui sont loin de reproduire les frontières ethno<strong>culture</strong>lles entre majorité<br />
28 «Profs, ne capitulons pas!» par Elisabeth Badinter, Régis Debray, A<strong>la</strong>in Finkielkraut, Elisabeth de<br />
Fontenay, Catherine Kintzler. <strong>Le</strong> N<strong>ou</strong>vel Observateur, 2-8 novembre 1989. <strong>Le</strong> texte est disponible sur le<br />
site : http://www.<strong>la</strong>icite-<strong>la</strong>ligue.org/<strong>la</strong>ligue/<strong>la</strong>icite-<strong>la</strong>ligue/pdf/badinter.pdf (consulté le 2 décembre 2005).<br />
29 Cette loi est en vigueur depuis le 1 er septembre 2004.<br />
30 Floya Anthias. “Beyond Feminism and Multiculturalism: Locating Difference and the Politics of<br />
Location”, Women’s Studies International Forum, Vol. 25, N° 3, p. 275-286.<br />
31 La littérature féministe postcoloniale est remarquablement éc<strong>la</strong>irante sur l’appropriation des femmes et<br />
l’instrumentalisation de <strong>la</strong> « question féminine », par les colonisateurs comme par les m<strong>ou</strong>vements de<br />
libération nationale, dans des contextes de colonisation, d’esc<strong>la</strong>vagisme <strong>ou</strong> de guerre. Voir entre autres les<br />
travaux de E. Accad, L. Ahmed, R. Radhakrishna, M. Lazreg, A. Loomba et P. Chatterjee. P<strong>ou</strong>r une étude<br />
en français, voir A. Gautier. « Femmes et colonialisme », dans M. Ferro (dir.). <strong>Le</strong> livre noir du<br />
colonialisme, Paris, Robert Laffont, 2003, p. 569-607.<br />
11