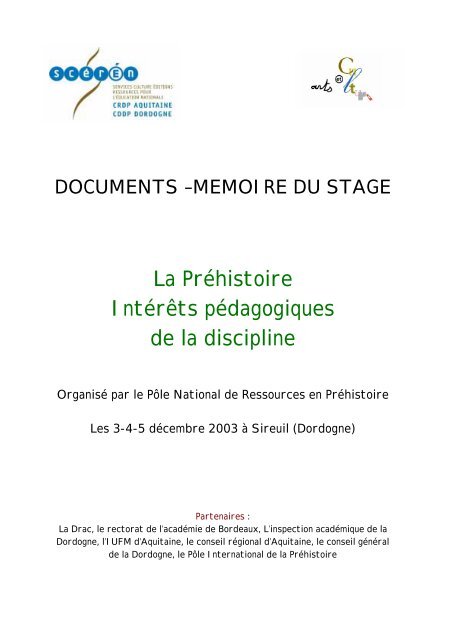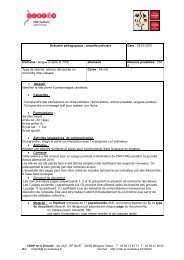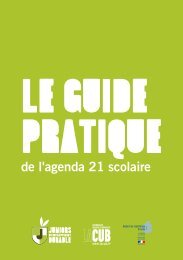La Préhistoire Intérêts pédagogiques de la discipline - CRDP ...
La Préhistoire Intérêts pédagogiques de la discipline - CRDP ...
La Préhistoire Intérêts pédagogiques de la discipline - CRDP ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DOCUMENTS –MEMOIRE DU STAGE<br />
<strong>La</strong> <strong>Préhistoire</strong><br />
<strong>Intérêts</strong> <strong>pédagogiques</strong><br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>discipline</strong><br />
Organisé par le Pôle National <strong>de</strong> Ressources en <strong>Préhistoire</strong><br />
Les 3-4-5 décembre 2003 à Sireuil (Dordogne)<br />
Partenaires :<br />
<strong>La</strong> Drac, le rectorat <strong>de</strong> l’académie <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, L’inspection académique <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Dordogne, l’IUFM d’Aquitaine, le conseil régional d’Aquitaine, le conseil général<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Dordogne, le Pôle International <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Préhistoire</strong>
Avant-propos<br />
Depuis son instal<strong>la</strong>tion, le Pôle National <strong>de</strong> Ressources en préhistoire a mené une<br />
politique active tant dans le secteur documentaire que sur le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> l’animation et <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
formation.<br />
Devenu dans le domaine <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire un partenaire respecté, pour son apport<br />
dans l’expertise pédagogique, il accompagne <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation<br />
initiale et continue <strong>de</strong>s enseignants et <strong>de</strong>s acteurs culturels<br />
Ce « document-mémoire » que vous avez en main aujourd’hui est le reflet <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
qualité <strong>de</strong> l’action <strong>de</strong> formation nationale proposée.<br />
Nous tenons à vous remercier, vous tous, stagiaires, intervenants, organisateurs,<br />
pour votre contribution à <strong>la</strong> rédaction <strong>de</strong> ce dossier.<br />
Le stage fut riche en échanges d’expériences. Que l’organisation <strong>de</strong> ces quelques<br />
notes puisse vous remettre en mémoire tous les regards portés en <strong>de</strong>ux jours sur<br />
l’évolution <strong>de</strong> l’homme, sur nous.<br />
Le Directeur du <strong>CRDP</strong> d’Aquitaine Le directeur du CDDP <strong>de</strong> <strong>la</strong> Dordogne<br />
Jean-Marie PUSLECKI Max GAILLARD<br />
2
Sommaire<br />
• Pourquoi une sensibilisation à <strong>la</strong> préhistoire ? ….……………………………………..………. 3<br />
Serge MAURY, conservateur départemental <strong>de</strong> l’archéologie<br />
• Le colloque <strong>de</strong>s enfants au Musée d’Aquitaine ……………………………………………..…… 9<br />
Sigolène LOIZEAU, assistante <strong>de</strong> conservation et I. Gubri-Lépine, enseignante détachée<br />
• Compte-rendu <strong>de</strong>s ateliers du 3 décembre 2003 ..……………………………..………………..12<br />
Ateliers d’é<strong>la</strong>boration d’un parcours à partir <strong>de</strong> 2 projets<br />
validés par l’Education nationale<br />
- Le statut <strong>de</strong> l’objet <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire à nos jours,<br />
Bruno CAUDRON, professeur <strong>de</strong>s écoles<br />
- Créations p<strong>la</strong>stiques à partir <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire,<br />
Patrick PICOLLIER, conseiller pédagogique<br />
• Compte-rendu <strong>de</strong>s ateliers du 4 décembre 2003 ………………………….…..……………..….. 19<br />
Décrypter les représentations<br />
- Images <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire au XIXè siècle : clefs <strong>de</strong> lecture et mo<strong>de</strong>s d’analyse,<br />
Noël COYE, docteur en <strong>Préhistoire</strong><br />
- Quels visages pour nos ancêtres ?<br />
Sigolène LOIZEAU, responsable <strong>de</strong>s collections préhistoire du Musée d’Aquitaine<br />
- Réflexions sur le thème <strong>de</strong> <strong>la</strong> représentation du corps humain,<br />
Patrick PICOLLIER, conseiller pédagogique<br />
- « Histoire d’Hommes »,<br />
B. CAUDRON, professeur <strong>de</strong>s écoles et M. O’FARELL, archéologue,<br />
- Représentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire dans <strong>la</strong> littérature pour <strong>la</strong> jeunesse,<br />
Valérie BALIER, documentaliste et Florence LANDAIS, conférencière nationale<br />
- Pour faire le portrait d’un objet,<br />
S MAURY, conservateur et archéologue et Y MALHACHE, Médiateur du Patrimoine<br />
3
Conférence inaugurale<br />
Pourquoi une<br />
sensibilisation à <strong>la</strong><br />
préhistoire ?<br />
Serge MAURY, conservateur départemental <strong>de</strong> l’archéologie<br />
4
POURQUOI UNE SENSIBILISATION A LA PREHISTOIRE?<br />
Universalité <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l'homme<br />
<strong>La</strong> préhistoire représente 99,9 % <strong>de</strong> l’histoire humaine. Imaginons 2 000 ans d’histoire dans son<br />
rapport à 2,5 millions d’années <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’humanité et matérialisons ces durées en espace. Sur 2,5<br />
km, seuls les 2 <strong>de</strong>rniers mètres appartiennent à l’histoire, les 10 <strong>de</strong>rniers à une sé<strong>de</strong>ntarisation progressive<br />
qui annonce nos mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie mo<strong>de</strong>rne fondés sur l’exploitation du sol et du vivant : agriculture et élevage.<br />
Les 2 490 mètres qui précè<strong>de</strong>nt sont le fait <strong>de</strong> chasseurs-collecteurs, vivant d’autres formes <strong>de</strong> vie en<br />
société, et constituent ce que l’on appelle <strong>la</strong> préhistoire ancienne ou paléolithique. Ce petit exercice n’est<br />
pas sans intérêt pour mesurer l’épaisseur du temps. Il redonne à l’histoire et à <strong>la</strong> préhistoire leurs<br />
dimensions respectives dans <strong>la</strong> genèse <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s sociétés.<br />
Pour être comprise, cette très longue pério<strong>de</strong> (très re<strong>la</strong>tive par rapport aux 500 millions d’années <strong>de</strong>s<br />
premiers vertébrés voire aux 3 milliards d’années <strong>de</strong>s premières bactéries) doit être évaluée et réévaluée<br />
constamment dans le temps et dans l’espace. Si l’on en réduit <strong>la</strong> complexité et les dynamiques, il est<br />
impossible d’en saisir <strong>la</strong> riche diversité malheureusement trop souvent compressée et caricaturée.<br />
Si aujourd’hui <strong>la</strong> préhistoire prend un sens nouveau, c’est non seulement grâce au progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
connaissance (nous y reviendrons) mais parce qu’elle nous oblige à avoir un regard sur l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
p<strong>la</strong>nète, qu’elle casse les frontières du temps et <strong>de</strong> l’espace. Elle n'est pas locale, pas nationale, elle est<br />
mondiale, car quelles que soient les nations du mon<strong>de</strong> qui en possè<strong>de</strong>nt les vestiges, les questions qu'elle<br />
nous pose appartiennent à tous. Elle contient l’universalité <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’homme dans ses fon<strong>de</strong>ments et<br />
ses développements.<br />
Universalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche en préhistoire<br />
Ce positionnement n’est pas anodin, ce n’est pas un hasard si, aujourd’hui, dans les fouilles <strong>de</strong><br />
grands sites préhistoriques - <strong>de</strong> cette région par exemple - les col<strong>la</strong>borations internationales sont très<br />
développées. Il n’est pas rare que certains gisements aient vu passer une bonne dizaine <strong>de</strong> nationalités<br />
différentes, que leurs représentants soient chercheurs ou étudiants. Ils ont partagé et partagent toujours <strong>de</strong>s<br />
questionnements communs sur les origines malgré <strong>de</strong>s différences <strong>de</strong> culture qui, comme par le passé,<br />
n’expriment pas forcément les mêmes représentations du mon<strong>de</strong>.<br />
Nous passerons sur l’histoire <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire qui est un sujet en soi : histoire très récente mais riche<br />
et signifiante dans l’expression <strong>de</strong>s croyances et <strong>de</strong>s idéologies du XIXème siècle colonisateur, par<br />
exemple, et sur l’histoire <strong>de</strong> l’archéologie et les actions pionnières <strong>de</strong>s premiers découvreurs. (Je vous<br />
renvoie pour ce<strong>la</strong> au site du PIP qui en a rassemblé <strong>la</strong> riche expression et aux historiens <strong>de</strong> préhistoire, ici<br />
présents, comme Noël Coye). Je m’attacherai à l’examen <strong>de</strong> ces quarante <strong>de</strong>rnières années marquées par<br />
un fort développement <strong>de</strong>s implications scientifiques pluridisciplinaires.<br />
Archéologie médiatique : d’Habilis à Toumaï en passant par Lucy<br />
Cette longue distance <strong>de</strong> temps présentée tout à l’heure ne peut se documenter en un jour…<br />
Certaines pério<strong>de</strong>s contiennent <strong>de</strong>s vi<strong>de</strong>s avec seulement quelques vestiges c<strong>la</strong>irsemés. C’est dans les<br />
années 60 que les recherches se sont accélérées dans une sorte <strong>de</strong> "ruée vers l’os" encouragées par les<br />
prémices <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s découvertes africaines mais aussi étayées par <strong>de</strong>s progrès méthodologiques et<br />
scientifiques certains… Les grands vi<strong>de</strong>s se comblent peu à peu, mais les questions sont <strong>de</strong> plus en plus<br />
nombreuses au fur et à mesure <strong>de</strong> l’enrichissement <strong>de</strong>s connaissances. Quand un chercheur semble<br />
détenir, enfin, une "vérité" qui le hisse vers une gloire naissante une nouvelle découverte vient mettre à bas<br />
ses pseudo certitu<strong>de</strong>s. Ce<strong>la</strong> nous rappelle à plus d’humilité face à <strong>de</strong>s vestiges extrêmement ténus…<br />
Affrontements d’os, affrontements d’homme… au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s découvertes, il y a souvent <strong>de</strong>s intérêts qui<br />
dépassent le seul fait scientifique.<br />
Les fondamentaux <strong>de</strong> l’Archéologie<br />
Cette médiatisation <strong>de</strong>s découvertes a eu pour effet <strong>de</strong> fortement développer l’intérêt du public pour <strong>la</strong><br />
préhistoire même si elle en a donné une vision déformante en sur valorisant <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s origines.<br />
5
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ces gran<strong>de</strong>s découvertes médiatiques liées aux vestiges pré-humains ou humains, <strong>de</strong>s<br />
milliers <strong>de</strong> fouilles d’habitats anciens ont eu lieu. Elles ont permis d’explorer, d’étudier, <strong>de</strong> questionner<br />
d’analyser jusqu’aux plus petits indices et vestiges constituants ces espaces <strong>de</strong> vie. C’est cette archéologie,<br />
beaucoup plus humble et patiente, qui a, aujourd’hui, rassemblé <strong>de</strong>s centaines <strong>de</strong> milliers <strong>de</strong> données sur<br />
les socio-économies, les dép<strong>la</strong>cements, les savoir-faire techniques, les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie, les expressions<br />
symboliques… en un mot tout ce qui fait <strong>la</strong> culture <strong>de</strong>s groupes d’hommes du passé ancien. C’est dans ces<br />
domaines que les progrès <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance ont été les plus significatifs et, plus particulièrement, pour les<br />
popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong>s cent <strong>de</strong>rniers millénaires.<br />
De nombreuses <strong>discipline</strong>s scientifiques ont été mises à contribution, et au-<strong>de</strong>là, avec le<br />
développement <strong>de</strong> nouveaux secteurs <strong>de</strong> recherche créés pour les besoins spécifiques <strong>de</strong> l’archéologie.<br />
C’est le cas, aussi bien, <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre, du vivant comme <strong>de</strong>s sciences humaines, <strong>de</strong> <strong>la</strong> physique<br />
ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> chimie, nous l’évoquerons plus loin.<br />
Au-<strong>de</strong>là d’une meilleure connaissance du passé <strong>de</strong> l’humanité que nous enseigne l’archéologie en<br />
préhistoire ?<br />
Elle nous apprend à regar<strong>de</strong>r les hommes autrement… Pourquoi ?<br />
• parce qu’elle est confrontée au manque <strong>de</strong> témoignage direct (à part l’art qui est une représentation<br />
immédiate… mais sans glossaire, ni lexique) ;<br />
• qu’elle a pour seul recours l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s vestiges (leur seul inventaire n’apporte que très peu<br />
d’éc<strong>la</strong>irage) ;<br />
• parce que pour être étudié et prendre sens, ces mêmes vestiges doivent obligatoirement être<br />
contextualisé.<br />
<strong>La</strong> contextualisation, c’est quoi ?<br />
Leur mise en situation globale et toutes leurs interactions avec l’environnement, le climat, les<br />
ressources minérales, le milieu vivant, les matières disponibles, etc.<br />
<strong>La</strong> connaissance <strong>de</strong>s hommes et <strong>de</strong>s groupes ne peut exister sans ces mises en re<strong>la</strong>tion avec les<br />
réalités matérielles <strong>de</strong> leur époque qu’ils ont gérées au regard <strong>de</strong> leur besoin et <strong>de</strong> ce que leur offrait leur<br />
milieu.<br />
Autrement dit, <strong>la</strong> préhistoire nous apprend que l’homme n’est pas qu’une représentation avec un<br />
menton ou pas, <strong>de</strong>s bourrelets sub-orbitaux ou pas, petit ou grand, trapu ou gracile, b<strong>la</strong>nc, noir ou<br />
rouge…tout ce<strong>la</strong> n'est qu'apparence.<br />
Il existe parce que :<br />
• il vit dans un environnement qui lui offre <strong>de</strong>s ressources... mais quelles ressources ?<br />
• il a <strong>de</strong>s besoins pour vivre... mais quels besoins ?<br />
• il maîtrise <strong>de</strong>s savoir-faire <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s techniques... mais quels savoir-faire ?…<br />
• il crée, il invente, il innove… mais que crée t’il ? En quoi innove t’il ?<br />
• il a <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie, une organisation socio-économique... mais quels mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie, quelle socioéconomie<br />
?<br />
• il a une vision du mon<strong>de</strong>, <strong>de</strong>s expressions symboliques et artistiques... mais quelle vision du mon<strong>de</strong>,<br />
quelles… etc.<br />
C’est tout ce<strong>la</strong> (et encore plus) qui fait l’homme. L’enjeu principal <strong>de</strong> l’archéologie et d’essayer <strong>de</strong><br />
répondre à toutes ces questions. Cette démarche est porteuse d’ouverture du regard sur le phénomène<br />
humain, tout en se focalisant sur le moindre indice, le moindre détail elle va en rechercher le sens dans le<br />
contexte général en l’éc<strong>la</strong>irant et en l’analysant dans toutes ses composantes.<br />
Cette démarche est à l’inverse <strong>de</strong> l’obscurantisme qui ne connaît l’homme que par dés "a priori"<br />
projetés sur lui (souvent limités à son apparence physique individuelle juxtaposée à <strong>de</strong>s performances et<br />
<strong>de</strong>s comportements imaginés)… <strong>la</strong> préhistoire elle-même a eu beaucoup <strong>de</strong> mal (et en a toujours beaucoup)<br />
à se défaire <strong>de</strong>s idéologies. Un seul exemple encore d’actualité concerne l’homme <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal qui nous<br />
renvoie à l’existence d’un homme "autre" qui partage pourtant nos préoccupations… peut-il exister en<br />
6
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille ? Le débat n’est pas que paléoanthropologique mais aussi philosophique : <strong>de</strong>s humains<br />
différents, ont-ils <strong>la</strong> même valeur que nous... ?!<br />
En bref, ce regard archéologique sur le passé n’est-il pas tout sauf passéiste. Il s'avère très pertinent<br />
pour examiner le présent, contrairement à <strong>la</strong> perception majoritaire du grand public. « Ils s’occupent <strong>de</strong>s<br />
vieux os et <strong>de</strong>s vieux cailloux » intérêt dérisoire parce que perçu comme un ailleurs tellement différent que<br />
l’on se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> si ce<strong>la</strong> peut avoir un sens. L’archéologie est avec l’ethnologie porteuse d’apprentissage<br />
d’un examen mo<strong>de</strong>rne pluri et interdisciplinaire du mon<strong>de</strong> et <strong>de</strong>s hommes. Elle nous permet <strong>de</strong> porter un<br />
autre regard sur les hommes d’aujourd’hui, un regard archéologique ancré dans les réalités et non dans les<br />
fantasmes.<br />
Contexte et protection du patrimoine<br />
Cette explicitation <strong>de</strong> l’importance majeure du contexte et <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong> l’homme pour le<br />
connaître et le comprendre porte en lui-même les bases d’une prise <strong>de</strong> conscience sur <strong>la</strong> nécessité<br />
impérative <strong>de</strong> protéger les sites d’occupations et d’habitats anciens. Si les sites sont perturbés ou pillés les<br />
possibilités d’appliquer une métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> recherche s’effondrent et les informations escomptées aussi… seul<br />
un inventaire <strong>de</strong>s dégâts restera possible permettant <strong>de</strong> mesurer l’ampleur <strong>de</strong>s connaissances à jamais<br />
perdues.<br />
C’est l’occasion dans toute action d’éducation ou <strong>de</strong> médiation d’une prise <strong>de</strong> conscience <strong>de</strong><br />
l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection d’un patrimoine commun au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s barrières et <strong>de</strong>s interdits. L’intérêt partagé<br />
par le plus grand nombre pour <strong>la</strong> <strong>Préhistoire</strong> doit être pour nous un levier important pour cette prise <strong>de</strong><br />
conscience <strong>de</strong> <strong>la</strong> privation <strong>de</strong> connaissance que représente toute atteinte au patrimoine.<br />
<strong>Préhistoire</strong>, culture scientifique et construction <strong>de</strong>s savoirs<br />
Les nombreuses <strong>discipline</strong>s qui examinent les vestiges préhistoriques et leur contexte constituent<br />
avec les matières étudiées, leurs métho<strong>de</strong>s et leurs techniques un ensemble homogène riche et <strong>de</strong>s plus<br />
judicieux pour le développement d’une culture scientifique. Pourquoi ?<br />
• parce qu’elles partagent le même objet d’étu<strong>de</strong> global : les groupes humains du passé ;<br />
• parce ce que l’humain ne pouvant se comprendre que dans son contexte, les traces n’en étant que<br />
<strong>de</strong>s vestiges conservés <strong>de</strong> différentes natures : elles ont obligation <strong>de</strong> travailler ensemble dans <strong>la</strong><br />
tranversalité et l’interdisciplinarité.<br />
<strong>La</strong> préhistoire oblige au dialogue les sciences, dites exactes ou dures et les sciences humaines qui<br />
s’attachent aux comportements <strong>de</strong>s hommes. Ses différentes <strong>discipline</strong>s se confrontent aux mêmes<br />
ensembles <strong>de</strong> vestiges qui sont porteurs par leur origine même et le contexte <strong>de</strong> leur dépôt, d’intérêts : pour<br />
les sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre, du vivant, <strong>de</strong> <strong>la</strong> physique ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> chimie mais aussi <strong>de</strong> celles <strong>de</strong> l’homme pour ses<br />
propres actions, ses comportements techniques ou symboliques qui en sous-ten<strong>de</strong>nt leur transport, leur<br />
transformation, leur mo<strong>de</strong> d’utilisation ou d’abandon. C’est cette communauté d’intérêts et <strong>de</strong><br />
questionnements multiples qui fon<strong>de</strong> l’archéologie mo<strong>de</strong>rne. Elle transcen<strong>de</strong> l’importance symbolique<br />
accordée à tels ou tels vestiges emblématiques qui peuvent à certains moments masquer <strong>la</strong> réalité<br />
matérielle quotidienne <strong>de</strong> ces groupes humains.<br />
<strong>La</strong> construction <strong>de</strong>s savoir : base pédagogique et <strong>de</strong> médiation <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire<br />
C’est à travers l’examen d’un ensemble archéologique <strong>de</strong> sites bien conservés et récemment fouillés<br />
que l’on peut visualiser les différentes <strong>discipline</strong>s scientifiques qui composent l’archéologie. L’archéologie est<br />
une approche dynamique qui examine ces ensembles conservés dans le temps et dans l’espace : macro<br />
temps macro espace, micro temps micro espace.<br />
Les vestiges étant décrits et définis dans leur nature, origine et éventuelle transformation, il reste à<br />
nommer les <strong>discipline</strong>s que ce<strong>la</strong> intéresse et leur métho<strong>de</strong> d’intervention : les questions qu’elles posent; <strong>la</strong><br />
façon <strong>de</strong> les traiter dans leur mise en œuvre, leur condition d’application et d’analyse; leurs limites; les<br />
résultats attendus et leur confrontation aux autres <strong>discipline</strong>s intéressées par les mêmes objets ou le<br />
contexte <strong>de</strong> ces objets. Les résultats peuvent faire part d’une impossibilité <strong>de</strong> réponse, <strong>de</strong> l’émission <strong>de</strong><br />
plusieurs hypothèses dans le meilleur <strong>de</strong>s cas d’une réponse argumentée qu’il reste à confronter aux<br />
résultats <strong>de</strong>s autres <strong>discipline</strong>s. (Les ateliers <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux journées permettront, pour certains d'entre eux, <strong>la</strong><br />
mise en pratique <strong>de</strong> ces processus).<br />
7
Ces démarches multiples confèrent à <strong>la</strong> connaissance sa valeur d’ouverture et <strong>de</strong> véritable aventure<br />
où transparaît <strong>la</strong> passionnante complexité <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche sur le passé lointain mais aussi <strong>la</strong> gran<strong>de</strong><br />
richesse <strong>de</strong> questions qui pénètrent <strong>de</strong>s horizons insoupçonnés. C’est le cas, par exemple :<br />
• <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> technologique et tracéologique <strong>de</strong>s matières transformées ou travaillées d’où<br />
émergent <strong>de</strong>s chaînes opératoires très é<strong>la</strong>borées, précieuses pour connaître les comportements socioéconomiques<br />
mais aussi pour mesurer les capacités et les potentialités techniques et leur mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion<br />
du milieu.<br />
• <strong>de</strong> <strong>la</strong> biologie et <strong>de</strong> ses rythmes qui nous précise les re<strong>la</strong>tions au milieu vivant, <strong>la</strong> microbiologie<br />
et <strong>de</strong>s liens qu’elle permet <strong>de</strong> tisser entre les espèces...<br />
• <strong>de</strong> <strong>la</strong> physique dans l’étu<strong>de</strong> du comportement mécanique <strong>de</strong>s matières minérales et dans <strong>la</strong><br />
mesure du temps par les faibles radioactivités...<br />
• <strong>de</strong>s sciences <strong>de</strong> <strong>la</strong> terre avec ses apports précieux pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ressources naturelles<br />
minérales et <strong>de</strong> <strong>la</strong> climatologie...<br />
• <strong>de</strong> <strong>la</strong> paléontologie animale et <strong>de</strong> l’archéozoologie pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> faune et les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
prédation et <strong>de</strong> consommation par l'homme...<br />
• <strong>de</strong> <strong>la</strong> botanique avec <strong>la</strong> palynologie, l’anthracologie, <strong>la</strong> carpologie, etc., indispensables à <strong>la</strong><br />
connaissance du milieu végétal et <strong>de</strong> son exploitation par l'homme…<br />
Bref il nous faudrait plusieurs pages pour énumérer et détailler l’ensemble <strong>de</strong>s sciences connexes qui<br />
apportent leur contribution à l’archéologie et peuvent supporter <strong>de</strong>s démarches disciplinaires <strong>de</strong> construction<br />
<strong>de</strong> savoir ou du moins d’enrichissement du savoir. En effet, le savoir n’est pas accumu<strong>la</strong>tion mais remise en<br />
question, abandons d’hypothèses jusque là retenues, apparition <strong>de</strong> nouvelles questions… il s’é<strong>la</strong>rgit, se<br />
diversifie… il est à l’opposé du dogme et <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérité révélée.<br />
C’est justement parce que c’est autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> l’homme que s’ancrent les plus grands<br />
risques d’enfermement <strong>de</strong> <strong>la</strong> pensée que <strong>la</strong> préhistoire doit nous permettre par sa transversalité sa riche<br />
diversité <strong>de</strong> regard d’ouvrir <strong>de</strong> nouveaux champs <strong>de</strong> communication, <strong>de</strong> discussions, d’échange et <strong>de</strong><br />
médiation avec tous les publics.<br />
<strong>Préhistoire</strong> et outils <strong>pédagogiques</strong><br />
Pour ce<strong>la</strong> nous avons <strong>la</strong> possibilité d’utiliser un certain nombres d’outils et supports <strong>pédagogiques</strong>.<br />
Certains existent d’autres sont à inventer en fonction <strong>de</strong>s projets et <strong>de</strong>s situations. Nous en approfondirons<br />
certains durant ces journées, je n’en ferai pas l’inventaire ni ne les détaillerai. Je proposerai cependant<br />
quelques règles essentielles pour nous gui<strong>de</strong>r dans leur conception.<br />
Ils doivent, pour le public faciliter l’échange, <strong>la</strong> communication, l’expression et <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong><br />
construction <strong>de</strong>s connaissances telle que nous l’avons défini dans sa pluralité. Pour le médiateur, il est<br />
nécessaire qu’ils fassent l’objet d’une évaluation continue et qu’ils soient évolutifs afin <strong>de</strong> s’approcher au<br />
plus prêt d’une réponse aux besoins définis. S’ils facilitent <strong>la</strong> conduite d’activités éducatives ou ai<strong>de</strong>nt à<br />
structurer <strong>de</strong>s projets, il est souhaitable qu’ils ne provoquent pas <strong>la</strong> mise au p<strong>la</strong>card <strong>de</strong> <strong>la</strong> créativité et <strong>de</strong><br />
l’inventivité. <strong>La</strong> pédagogie doit être vivante et adaptée comme le public et vivant et varié.<br />
Médias et médiateurs<br />
Je terminerai par quelques constats et réflexions sur l’approche actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire dans les<br />
grands médias. J’avais eu l’occasion <strong>de</strong> l’évoquer lors <strong>de</strong>s journées sur "le documentaire jeunesse en<br />
préhistoire". Je suis à peu près sûr que nous l’abor<strong>de</strong>rons lors du débat sur "l’Odyssée <strong>de</strong> l’espèce".<br />
Elle retraduit en fait cette archéologie à <strong>de</strong>ux vitesses du début <strong>de</strong> mon intervention. Il me paraît<br />
important qu’en tant que médiateur nous puissions prendre en compte ce phénomène dans notre re<strong>la</strong>tion<br />
avec le public.<br />
Ce<strong>la</strong> se traduit par <strong>de</strong>ux écueils principaux :<br />
• <strong>la</strong> transmission <strong>de</strong> connaissances non questionnées comme abouties et chassées du champ<br />
<strong>de</strong>s dynamiques scientifiques pluridisciplinaires ;<br />
• l’ignorance ma<strong>la</strong>dive, dans les représentations proposées <strong>de</strong>s groupes d’hommes<br />
préhistoriques, <strong>de</strong>s avancées majeures <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance <strong>de</strong>s cultures techniques et matérielles.<br />
8
Nous ne reviendrons pas sur le premier point. Quant au second, il traduit une "non prise en compte"<br />
<strong>de</strong> marqueurs importants qui particu<strong>la</strong>risent les différentes cultures. Ces manques sont faussement<br />
compensés par un recentrage sur <strong>la</strong> représentation humaine, très mo<strong>de</strong> et très médiatisée, <strong>de</strong><br />
l’hyperréalisme qui contraste fortement avec <strong>la</strong> pauvreté et le flou <strong>de</strong> <strong>la</strong> restitution <strong>de</strong> l’environnement<br />
culturel et <strong>de</strong> l’environnement tout court. Ce<strong>la</strong> a pour effet d’effacer toute documentation pouvant nous<br />
informer plus concrètement sur l’i<strong>de</strong>ntité culturelle <strong>de</strong>s groupes d’hommes présentés.<br />
Cette approche, centrée sur l’apparence <strong>de</strong> l’homme, est porteuse <strong>de</strong> risque <strong>de</strong> simplification<br />
caricaturale Ce qui caractériserait un homme ou <strong>de</strong>s hommes par rapport à d’autres ne serait pas : ce qu’ils<br />
créent... ce qu’ils échangent... ce qu’ils expriment... ce qu’ils font et comment ils le font, mais : ce qu’ils<br />
paraissent être… ce qu’ils ont l’air d’être... à quoi ils ressemblent…!<br />
<strong>La</strong> différence d’apparence n’est pas en soi-même, surtout seule, support d’échanges, car elle n’éc<strong>la</strong>ire<br />
en rien ce qu’est l’autre, elle est potentiellement porteuse <strong>de</strong> curiosité, mais aussi, on le sait, <strong>de</strong> méfiance ou<br />
<strong>de</strong> rejet. Les différences montrées et perçues au travers <strong>de</strong>s savoirs, <strong>de</strong>s savoir-faire, <strong>de</strong>s adaptations aux<br />
différentes situations <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> créativité, <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> pensée définissent, elles, les<br />
contours <strong>de</strong> l’autre dans son altérité positive et donne matière à question et à échange. Cet autre regard est<br />
celui que porte l’archéologie, il va au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> <strong>la</strong> différence et surtout s’en enrichit.<br />
Ces <strong>de</strong>ux trop courtes journées nous permettrons, je l’espère, d’en enclencher le processus puisque<br />
nous venons, riches <strong>de</strong> nos expériences et <strong>de</strong> nos différences, à partager et discuter.<br />
SERGE MAURY<br />
(janvier 2004)<br />
9
Colloque <strong>de</strong>s enfants au<br />
Musée d’Aquitaine<br />
Sigolène Loizeau, responsable préhistoire au Musée d’Aquitaine et<br />
Isabelle Gubri-Lépine, enseignante détachée au Musée d’Aquitaine<br />
10
1 - Idée/Concept<br />
Colloque <strong>de</strong>s enfants au musée d’Aquitaine.<br />
Le musée d’Aquitaine a organisé le 25 mars 2003, en partenariat avec l’inspection académique un colloque<br />
où les enfants étaient les principaux participants.<br />
Le déroulement est i<strong>de</strong>ntique aux colloques professionnels : recherche scientifique, présentation au public et<br />
réponses aux diverses questions.<br />
Cinq c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> niveaux CM1 et CM2 sont sélectionnées pour participer au colloque. Soit environ 150<br />
élèves. Chaque c<strong>la</strong>sse choisit un thème parmi 12 proposés.<br />
En 2003, les enfants ont travaillé sur <strong>la</strong> préhistoire en lien avec l’exposition Vénus et Caïn. Ce type <strong>de</strong><br />
rencontre pouvant être appliqué à toutes les époques historiques, nous avons choisi <strong>de</strong> commencer avec <strong>la</strong><br />
préhistoire.<br />
APPORTS DANS LE TRAVAIL EN CLASSE<br />
Nouveaux programmes : accent sur l’oral, l’éducation civique, le contact avec les professionnels.<br />
Aspect pluridisciplinaire, compétences transversales<br />
2 - Temps <strong>de</strong> préparation<br />
Sélection <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses<br />
<strong>La</strong> sélection <strong>de</strong>s enseignants se fait sur candidature et motivation.<br />
Le choix final est revenu à Isabelle Gubri-Lépine (enseignante détachée au musée). Elle a fait son choix<br />
selon <strong>de</strong>s critères géographique en 2003 : 2 c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, 2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> CUB et une extérieur. En 2004 : 2<br />
<strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux, 1 <strong>de</strong> <strong>la</strong> CUB et 2 extérieures (Libournais, B<strong>la</strong>yais). A chaque fois, 2 c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> ZEP.<br />
Première visite au musée (en décembre)<br />
Vision globale <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong> préhistoire.<br />
Retour en c<strong>la</strong>sse<br />
Découverte <strong>de</strong>s 12 thèmes : habitat, feu, production manufacturée, art, environnement, homme <strong>de</strong><br />
Nean<strong>de</strong>rtal, homme <strong>de</strong> Cro-Magnon, Chasse-pêche-cueillette, Agriculture, Les sépultures, Age du bronze,<br />
Fouilles.<br />
Définition <strong>de</strong> chaque thème.<br />
Discussions sur le contenu.<br />
Vote et dépouillement.<br />
Communication <strong>de</strong>s différents choix au musée (3 par c<strong>la</strong>sse, avec un ordre <strong>de</strong> préférence).<br />
Chaque c<strong>la</strong>sse a émis plusieurs vœux, pour chacune, c’est le premier qui a été retenu.<br />
Le choix est définitif avant Noël.<br />
Entre Noël et février : recherches documentaires.<br />
Février à mars : synthèse, rédaction et entraînement <strong>de</strong>s élèves à présenter leurs résultats <strong>de</strong> recherches.<br />
Les textes ont été remis au musée 15 jours avant le colloque.<br />
<strong>La</strong> recherche s’est effectuée en c<strong>la</strong>sse et chez soi :<br />
Livres personnels<br />
Internet<br />
CD-Rom<br />
Bibliothèque du quartier, <strong>de</strong> l’école.<br />
<strong>La</strong> synthèse <strong>de</strong>s infos<br />
Travail en groupes<br />
Photocopies, découpages, col<strong>la</strong>ges et c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong>s informations dans <strong>de</strong>s boites thématiques.<br />
Rédaction <strong>de</strong>s textes<br />
Travail en groupe.<br />
Discussions.<br />
Choix iconographique pour illustrer le propos<br />
Ce choix est difficile. Les enfants ne se ren<strong>de</strong>nt pas compte du rendu et <strong>de</strong> <strong>la</strong> pertinence <strong>de</strong>s images.<br />
11
Choix <strong>de</strong>s rapporteurs<br />
Ils sont volontaires, <strong>de</strong>s remp<strong>la</strong>çants sont prévus.<br />
<strong>La</strong> c<strong>la</strong>sse participe aux entraînements et donne son avis sur les interventions.<br />
Problèmes rencontrés<br />
1 : Difficulté pour trouver une chronologie unique. Chaque livre présente <strong>de</strong>s références différentes et <strong>de</strong>s<br />
termes parfois trop précis pour <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong> cet âge. Exemple : le feu 400.00, 450.000 ou 500.000 ans.<br />
Une chronologie unique et simple a été proposée par Isabelle à toutes les c<strong>la</strong>sses : tirée <strong>de</strong> « image doc. »<br />
2 : faire une synthèse <strong>de</strong> tous les documents n’est pas une chose facile.<br />
3 : <strong>la</strong> préparation du colloque a pris beaucoup <strong>de</strong> temps sur l’année.<br />
3 – Déroulement<br />
Présentation<br />
Toute <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse est mise en valeur, elle est assise en face <strong>de</strong>s autres. Les 2 à 6 intervenants volontaires sont<br />
installés sur une estra<strong>de</strong>.<br />
Trois c<strong>la</strong>sses ont utilisé <strong>de</strong>s nouvelles technologies (Power Point) pour présenter leurs résultats, une a<br />
présenté <strong>de</strong>s diapos, <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière a réalisé un mime.<br />
Intermè<strong>de</strong>s/ récréations<br />
Les présentations sont coupées par <strong>de</strong>s intermè<strong>de</strong>s cinématographiques : <strong>de</strong>s séquences <strong>de</strong> L’odyssée <strong>de</strong><br />
l’espèce ont été présentées, <strong>de</strong>s récréations et bien sûr le repas <strong>de</strong> midi pris sur p<strong>la</strong>ce, dans diverses salles<br />
du musée.<br />
Complément scientifique/ questions<br />
Après chaque intervention <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses, un conservateur du musée intervient, complète le discours <strong>de</strong>s<br />
enfants, et surtout, répond aux multiples questions.<br />
Les enfants sont restés attentifs tout au long <strong>de</strong> <strong>la</strong> journée.<br />
Conclusion :<br />
Chaque élève a été récompensé nominativement et a reçu entre autre 2 livres.<br />
Les élèves ont gardé un bon souvenir <strong>de</strong> cette journée.<br />
Une couverture <strong>de</strong> presse importante a été réalisée.<br />
Des élus étaient présents à <strong>la</strong> remise <strong>de</strong>s prix, ainsi que plusieurs représentants <strong>de</strong> l’éducation Nationale et<br />
du CDDP.<br />
Suite<br />
En guise <strong>de</strong> conclusion à tout ce travail, les c<strong>la</strong>sses ont visité l’exposition temporaire Vénus et Caïn.<br />
4 - Conception et partenaires<br />
Conception<br />
Isabelle Gubri-Lépine, enseignante détachée : lien avec les enseignants, suivi du travail en c<strong>la</strong>sse.<br />
Christian Block, responsable du service pédagogique : conception, organisation.<br />
Philippe Chauveau : gestion <strong>de</strong> l’intendance et logistique.<br />
Tout le service éducatif : prise en charge <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>sses durant toute <strong>la</strong> journée.<br />
Sigolène Loizeau : présente le jour du colloque pour répondre aux diverses questions et présenter son point<br />
<strong>de</strong> vue sur les interventions.<br />
En tout, six mois <strong>de</strong> travail pour réaliser ce colloque.<br />
Partenariat<br />
CDDP : journée entièrement filmée. Actes du colloque sur le site Web du CDDP :<br />
http ://crdp.ac-bor<strong>de</strong>aux.fr/cddp33/art/colloque_prehistoire.htm<br />
Education Nationale, le partenariat se renforce pour l’année prochaine.<br />
12
5 – Reconduction<br />
Le partenariat se renforce entre l’éducation nationale et le musée.<br />
2004 : Mythologie, en re<strong>la</strong>tion avec l’expo Saint-Augustin<br />
2005 : Gallo-Romain<br />
2006 : Médiéval en re<strong>la</strong>tion avec l’exposition Gracia Deï<br />
Pour en savoir +<br />
Consulter le site Internet du CDDP <strong>de</strong> Mérignac :<br />
http://crdp.ac-bor<strong>de</strong>aux.fr/cddp33/art/colloque_prehistoire.htm<br />
Ce site regroupe :<br />
• les travaux réalisés par les élèves<br />
• Les interventions <strong>de</strong> Sigolène Loizeau, responsable <strong>de</strong>s collections <strong>de</strong> préhistoire musée<br />
d'Aquitaine, et <strong>de</strong> Joëlle Perroux, archéologue à l'Institut National <strong>de</strong> Recherches<br />
Archéologiques Préventives (INRAP)<br />
• <strong>de</strong>s bibliographies <strong>de</strong>stinées aux enfants et aux enseignants, é<strong>la</strong>borées par Sigolène Loizeau<br />
13
Compte-rendu <strong>de</strong>s ateliers du<br />
3 décembre 2003<br />
Ateliers d’é<strong>la</strong>boration d’un parcours à partir <strong>de</strong> 2 projets<br />
validés par l’Education nationale.<br />
14
« LE STATUT DE L’OBJET DE LA PREHISTOIRE A NOS JOURS »<br />
Faire raconter une histoire aux objets anciens<br />
Reconstituer <strong>de</strong>s scénarios à partir <strong>de</strong> traces enfouies<br />
Décrire l’itinéraire <strong>de</strong> l’objet archéologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> fouille au musée<br />
Bruno CAUDRON, professeur <strong>de</strong>s écoles<br />
Parcours avec qui et comment :<br />
les publics sco<strong>la</strong>ires du département<br />
Les dispositifs subventionnées (PAC, TPE…).<br />
Les dispositifs hors subventions (majorité <strong>de</strong>s parcours)<br />
Pas d’atelier hors projet.<br />
Proposition d’une procédure pour utiliser les ressources du PIP :<br />
définition du projet : modalités, thématiques à préciser, rencontres avec les enseignants<br />
chronogramme : durée du projet fixée avec l’enseignant en fonction <strong>de</strong>s questions posées, actions qui<br />
déterminent un calendrier.<br />
définitions <strong>de</strong>s besoins : visites <strong>de</strong> sites, lister les ressources pour servir le projet, préciser le temps que les<br />
enseignants peuvent y consacrer.<br />
analyse <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> réalisation du projet<br />
validation / Evaluation :<br />
<strong>La</strong> validation du projet n’est pas du ressort <strong>de</strong> l’animateur, mais il est <strong>de</strong> son ressort <strong>de</strong> préciser les<br />
modalités pour qu’il ait un sens pour l’élève (au moins 6 heures au préa<strong>la</strong>ble avec les enseignants).<br />
Première définition du projet :<br />
Définition <strong>de</strong> <strong>la</strong> philosophie du projet avec les enseignants et les élèves. Re<strong>la</strong>tion contractuelle (IUFM,<br />
INRAS, DRAC, Musée…) et « partenariale ». Articu<strong>la</strong>tion entre les lieux ressources, les ressources<br />
humaines et le projet. Propositions <strong>de</strong> dispositifs <strong>pédagogiques</strong>.<br />
Exemple d’un parcours en cycle 1 (GS) :<br />
Ce parcours avait pour thème l’art pariétal.<br />
Premier atelier : outils et supports utilisés à partir d’un <strong>de</strong>ssin d’animal.<br />
Deuxième atelier : différentes techniques <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin.<br />
A l’issue <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux ateliers, l’enfant doit être capable <strong>de</strong> choisir son outil, son support, l’animal et<br />
l’éc<strong>la</strong>irage.<br />
Ce travail a été illustré par <strong>la</strong> visite d’une grotte : Font <strong>de</strong> Gaume.<br />
Exemple d’un parcours en cycle 2/3 (CE1/CE2) :<br />
Ce parcours s’est déroulé sur <strong>de</strong>ux trimestres<br />
Partir <strong>de</strong>s représentations initiales et <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> départ permettant <strong>de</strong> lister les problématiques.<br />
Première approche par le <strong>de</strong>ssin, permettant à l’élève <strong>de</strong> commenter ses représentations. Il est alors<br />
intéressant <strong>de</strong> vérifier si les représentations initiales sont remises en cause en fin <strong>de</strong> parcours.<br />
Exemples <strong>de</strong> questions <strong>de</strong> départ :<br />
« L’Homme <strong>de</strong> Cro-magnon par<strong>la</strong>it-il ?», « avait-il <strong>de</strong>s animaux domestiques ?», « se soignait-il ?»,<br />
« avaient-ils les même goûts que nous ?», « quel était le climat ?», « pourquoi existe t-il toujours <strong>de</strong>s<br />
singes ?»…<br />
On part alors <strong>de</strong>s questions et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins pour que l’enfant puisse exprimer ce qu’il sait et comment il le<br />
sait. Ce<strong>la</strong> évolue vers « comment obtient on <strong>de</strong> l’information en préhistoire ?», puis « comment les<br />
scientifiques g<strong>la</strong>nent-ils <strong>de</strong> l’information ? ». On peut alors choisir les outils et les ressources qui permettront<br />
<strong>de</strong> répondre, comme le module <strong>de</strong> fouille (outil pédagogique d’apprentissage <strong>de</strong>s techniques <strong>de</strong> fouille<br />
reconstituant une partie d’un habitat du paléolithique supérieur) qui permet d’approcher <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong><br />
l’archéologue et <strong>de</strong> comprendre à quelles questions peut répondre <strong>la</strong> fouille. Cet outil permet d’insister alors<br />
sur <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> <strong>la</strong> fouille, l’importance <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection du patrimoine et <strong>de</strong>s liens entre les objets sans<br />
lesquels ces <strong>de</strong>rniers ne sont plus porteurs d’informations. Le travail autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> fouille est particulièrement<br />
intéressant pour développer les repères dans l’espace et dans le temps.<br />
Etape suivante du parcours : réalisation d’un chantier <strong>de</strong> fouilles à l’école : les archéologues du futur vont<br />
fouiller un site dans lequel ont été p<strong>la</strong>cés <strong>de</strong>s objets du XXI ème siècle choisis pour raconter une histoire<br />
15
(habitat provisoire en tente). Les enfants étant trop jeunes pour assimiler l’enregistrement <strong>de</strong>s coordonnées,<br />
ils se sont servis d’un appareil photographique numérique. Pour l’enregistrement <strong>de</strong> l’information, ils<br />
disposaient d’une fiche simplifiée permettant <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiner l’objet, <strong>de</strong> coller sa photographie, indiquer son<br />
utilisation éventuelle, si l’objet semble entier … Les objets ont ensuite été mis en re<strong>la</strong>tion, confrontés à une<br />
documentation après recherche documentaire. Ce travail a permis <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s hypothèses et <strong>de</strong> les<br />
confronter, pour évoluer vers le débat argumenté. Certains ont choisi l’exposition pour restituer l’information,<br />
ce qui a <strong>de</strong>mandé l’étu<strong>de</strong> du parcours <strong>de</strong> l’objet après <strong>la</strong> fouille jusqu’au musée et développé <strong>de</strong>s<br />
problématiques autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> muséographie.<br />
D’autres ont choisi <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s maquettes d’habitat à partir d’un sol archéologique carroyé, ce qui a<br />
permis <strong>de</strong> travailler sur les problèmes d’hypothèses et d’interprétations.<br />
Un troisième groupe a réalisé un diaporama du site, permettant une approche d’un paléo-environnement.<br />
Exemple <strong>de</strong> projet dans un lycée (Terminale) :<br />
Concerne les TPE <strong>de</strong> c<strong>la</strong>sse Terminale sur les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datation. Les élèves ont été confrontés à <strong>la</strong><br />
mise en p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong>s cadres chronologiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire au 19 ème siècle, ont rencontré <strong>de</strong>s professionnels<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> science (archéologues, palynologues…), ont testé l’adaptation <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> datation en fonction<br />
du type <strong>de</strong> site lors d’une visite d’un chantier <strong>de</strong> fouille préventive. Une ai<strong>de</strong> à <strong>la</strong> recherche documentaire<br />
leur a été fournie par une équipe formée d’un archéologue, d’un documentaliste et d’un enseignant qui s’est<br />
dép<strong>la</strong>cé dans l’établissement.<br />
16
« CREATIONS PLASTIQUES A PARTIR DES TECHNIQUES<br />
DE LA PREHISTOIRE »<br />
Intégration du projet PAC dans le projet d’école. Articu<strong>la</strong>tion avec un second<br />
projet PAC concernant une autre c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> l’école.<br />
Présentation du travail <strong>de</strong> l’artiste participant au projet.<br />
Réflexion sur les rapports à établir entre les techniques préhistoriques et une<br />
production contemporaine.<br />
Patrick PICOLLIER, conseiller pédagogique<br />
P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> l’intervention :<br />
Proposition <strong>de</strong> départ : atelier à partir d’un projet validé<br />
Rappel du contexte institutionnel<br />
Présentation du projet <strong>de</strong> <strong>La</strong> Force<br />
Sources préhistoriques :<br />
o Thèmes<br />
o Techniques<br />
Sources contemporaines :<br />
o Connaissances scientifiques<br />
o Création artistique<br />
Quelques exemples<br />
Rappel du cadre institutionnel :<br />
Le projet d’école<br />
<strong>La</strong> c<strong>la</strong>sse à PAC<br />
Présentation du projet <strong>de</strong> <strong>La</strong> Force<br />
Intentions : créations contemporaines au moyen <strong>de</strong> :<br />
o Techniques anciennes<br />
o Mo<strong>de</strong>s d’expression anciens<br />
Rôle <strong>de</strong> l’artiste :<br />
o Intégrer ces démarches « préhistoriques » dans une création contemporaine et non<br />
pour une paraphrase « à <strong>la</strong> manière <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire »<br />
Les supports :<br />
Art pariétal (sur paroi)<br />
Art sur blocs<br />
Art mobilier<br />
- Les thèmes :<br />
Faune<br />
o Isolée<br />
o En panneaux <strong>La</strong>scaux salle <strong>de</strong>s taureaux<br />
Représentations humaines<br />
o Représentations figurées plus ou moins réalistes Vénus Willendorf<br />
o Figures composites Trois-Frères sorcier<br />
Signes <strong>La</strong>scaux b<strong>la</strong>son + tableaux + Pech-Merle points<br />
Traces du corps :<br />
o Fortuites (empreintes <strong>de</strong> pieds) Pech-Merle<br />
o Intentionnelles (mains) Gargas<br />
17
Les techniques préhistoriques :<br />
<strong>La</strong> peinture et le <strong>de</strong>ssin (au pinceau, soufflée…) <strong>La</strong>scaux, Cougnac, Pech-Merle<br />
<strong>La</strong> gravure Niaux, <strong>La</strong>ugerie-Basse, <strong>La</strong> Vache<br />
<strong>La</strong> sculpture sur paroi ou sur bloc Bour<strong>de</strong>illes, Cap-B<strong>la</strong>nc, Gorge d’Enfer<br />
<strong>La</strong> sculpture en ron<strong>de</strong>-bosse Be<strong>de</strong>ilhac, Willendorf<br />
Le mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge Tuc d’Audoubert<br />
Les objets <strong>de</strong> parure<br />
o Objets naturels (<strong>de</strong>nts, coquil<strong>la</strong>ges, fossiles…) Doni Vestonice<br />
o Objets fabriqués (perles, ron<strong>de</strong>lles, disques…)<br />
Quelques exemples <strong>de</strong> réalisations (travaux d’élèves ou d’artistes) :<br />
Tixador Pas <strong>de</strong> photos<br />
Quelquesexemples à éviter :<br />
o « pseudo-<strong>La</strong>scaux »<br />
o « pseudo-panneau »<br />
Dubuffet<br />
Merz<br />
Oppenheim<br />
Gabo<br />
Tapies<br />
Klein<br />
Fioretti<br />
o Matières, peinture <strong>de</strong> sable<br />
Pech-Merle (empreintes <strong>de</strong> pieds)<br />
o Traces<br />
o Marquages<br />
o Grattages<br />
o Empreintes<br />
Gargas (empreintes <strong>de</strong> mains)<br />
o Empreintes<br />
Emergence<br />
Cheval Mas d’Azil<br />
o Galets peints<br />
P<strong>la</strong>quette au bison<br />
o Interprétation<br />
Levielle + Silhouettes <strong>La</strong>lin<strong>de</strong><br />
Les c<strong>la</strong>sses <strong>de</strong> CM1 et CM2 <strong>de</strong> l’école <strong>de</strong> <strong>La</strong> Force ont choisi <strong>de</strong> travailler toute l’année sur un projet axé sur<br />
<strong>la</strong> préhistoire, sous forme d’un P.A.C. validé par l’Education Nationale. <strong>La</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> CM1 a travaillé sur un<br />
volet scientifique : « les techniques <strong>de</strong> <strong>la</strong> recherche en préhistoire ». <strong>La</strong> c<strong>la</strong>sse <strong>de</strong> CM2 a choisi <strong>de</strong> travailler<br />
sur l’art visuel. C’est ce projet que Monsieur Picollier nous présente à l’occasion <strong>de</strong> cet atelier.<br />
Le p<strong>la</strong>n <strong>de</strong> travail, réparti sur toute l’année sco<strong>la</strong>ire, comporte :<br />
- <strong>la</strong> présentation du contexte <strong>de</strong> l’art préhistorique aux élèves,<br />
- <strong>de</strong>s visites <strong>de</strong> sites alternées avec <strong>de</strong>s applications artistiques,<br />
- 12 à 15 heures <strong>de</strong> travail avec un artiste p<strong>la</strong>sticien dont les références sont préhistoriques,<br />
- <strong>la</strong> réalisation finale d’une fresque sous le préau.<br />
L’art préhistorique est utilisé dans ce projet comme support <strong>de</strong> création, il ne s’agit pas <strong>de</strong> copier <strong>de</strong>s<br />
œuvres <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire mais d’observer <strong>de</strong>s techniques, <strong>de</strong>s supports, <strong>de</strong> comprendre une démarche, et <strong>de</strong><br />
les transposer pour créer une nouvelle œuvre. Il ne s’agit pas non plus d’essayer d’interpréter les<br />
motivations <strong>de</strong>s artistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire, dont on ne sait rien, mais <strong>de</strong> transposer les indices témoignant <strong>de</strong><br />
leur comportement.<br />
18
Selon les instructions officielles <strong>de</strong> l’Education Nationale, l’enfant doit savoir produire un art visuel et, pour<br />
ceci, acquérir un bagage artistique et culturel. Lorsque l’on fait reproduire à un enfant un <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> cheval<br />
préhistorique sur un galet, il ne s’agit que <strong>de</strong> copie. Sans confrontation avec <strong>de</strong>s expériences d’artistes<br />
actuels, cette démarche est restrictive.<br />
1 - Présentation aux élèves du contexte <strong>de</strong> l’art préhistorique<br />
Tête <strong>de</strong> cheval, réalisée<br />
par Marion.<br />
Art du Paléolithique supérieur :<br />
– Les supports : pariétal, mobilier, sur bloc.<br />
– Les thèmes : les sujets représentés. <strong>La</strong> présentation aux élèves se fait sans essai d’interprétation.<br />
- <strong>la</strong> faune : animaux isolés / en groupe (<strong>La</strong>scaux) / enchevêtrés / en scène.<br />
- les humains : réalistes / figuratifs (<strong>La</strong>ussel) / hybri<strong>de</strong>s.<br />
- les signes (<strong>La</strong>scaux / recueil d’A. Leroi-Gourhan / ponctuations <strong>de</strong> Pech-Merle).<br />
- les traces : fortuites (Pech-Merle) / intentionnelles (Gargas) / tracés digitaux (Gargas).<br />
– Les techniques.<br />
- peinture et <strong>de</strong>ssin : cerfs <strong>de</strong> <strong>La</strong>scaux, bouquetin <strong>de</strong> Cougnac (utilisation du support), mammouth <strong>de</strong><br />
Pech-Merle (en volume).<br />
- l’outil<strong>la</strong>ge : les pinceaux (archéologie expérimentale), les bâtons, les tubes (crachats).<br />
- les matériaux : ocres, oxy<strong>de</strong>s, liants (chevaux <strong>de</strong> Pech-Merle : mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> techniques).<br />
- les pochoirs, les tamponnements (scène du puits <strong>de</strong> <strong>La</strong>scaux).<br />
Une première réaction <strong>de</strong>s élèves est provoquée par <strong>la</strong> comparaison <strong>de</strong> ces peintures avec leurs propres<br />
façons <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssiner : les œuvres du Paléolithique ne sont pas <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, il n’y a pas<br />
<strong>de</strong> paysage, pas <strong>de</strong> ligne <strong>de</strong> sol, pas <strong>de</strong> ciel. Une réflexion est menée sur les conventions <strong>de</strong> représentation.<br />
- gravure : au doigt (Niaux) / avec <strong>de</strong>s outils (bâtonnet, silex).<br />
<strong>La</strong> photographie d’une ron<strong>de</strong>lle décorée d’une biche <strong>de</strong> <strong>La</strong>ugerie-Basse sert à abor<strong>de</strong>r l’adaptation au<br />
support et le respect <strong>de</strong>s proportions. <strong>La</strong> lionne gravée sur os <strong>de</strong> <strong>La</strong> Vache permet d’illustrer l’association <strong>de</strong><br />
techniques <strong>de</strong> gravure : le tracé net est utilisé pour le contour <strong>de</strong> l’animal, les petites entailles légères<br />
figurent le pe<strong>la</strong>ge.<br />
- sculpture : aurochs <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>illes, cheval du Cap B<strong>la</strong>nc, salmonidé <strong>de</strong> l’abri du Poisson.<br />
- ron<strong>de</strong>-bosse : faon <strong>de</strong> Bé<strong>de</strong>ilhac, vénus <strong>de</strong> Willendorf, Lespugue, Brassempouy, Tursac,<br />
Sireuil. Ces vénus, dont les mou<strong>la</strong>ges sont présentés, permettent d’ouvrir une réflexion sur l’idée <strong>de</strong><br />
géométrisation du corps, <strong>de</strong> faire <strong>la</strong> différence entre réalisme et figuration.<br />
- mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge : bison du Tuc d’Audoubert.<br />
- objets <strong>de</strong> parure : <strong>de</strong>nts percées, reconstitution <strong>de</strong> colliers <strong>de</strong> Dolni Vestonice retrouvés en<br />
connexion, comprenant <strong>de</strong>s coquil<strong>la</strong>ges. Ces objets permettent d’abor<strong>de</strong>r les dép<strong>la</strong>cements <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> préhistoire, leurs préoccupations esthétiques et l’utilisation <strong>de</strong> matériaux <strong>de</strong> récupération.<br />
19
2 - Présentation aux élèves <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong> quelques artistes contemporains<br />
- <strong>La</strong>urent Tixador a voulu appliquer un principe <strong>de</strong> transposition du mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie préhistorique, sans vouloir le<br />
copier, sous forme d’une instal<strong>la</strong>tion-performance. Pendant un mois, il a vécu dans un bunker en béton et a<br />
essayé <strong>de</strong> vivre en chassant les pigeons avec <strong>de</strong>s armes qu’il a fabriquées à partir <strong>de</strong> matériaux <strong>de</strong><br />
récupération. Cette tentative <strong>de</strong> chasse ayant échoué, l’artiste a survécu en faisant du troc avec les visiteurs<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> galerie. Pour cet artiste, <strong>la</strong> peinture <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire est un marquage <strong>de</strong> territoire. Il a donc utilisé ces<br />
co<strong>de</strong>s pour reproduire <strong>de</strong>s signes commerciaux actuels sur <strong>de</strong>s rochers.<br />
- Jean Dubuffet : pour abor<strong>de</strong>r l’intérêt du support (travail <strong>de</strong> « matériologie »).<br />
- L’Arte Povera, dont l’igloo <strong>de</strong> Merz.<br />
- <strong>La</strong>nd’s Art : <strong>la</strong> montagne marquée d’Oppenheim, permettant une réflexion sur les traces durables ou<br />
fugaces dans le paysage.<br />
- <strong>La</strong> sculpture <strong>de</strong>s arts premiers.<br />
- Les signes sur matériaux naturels <strong>de</strong> Tapiès.<br />
- Les « Anthropométries » <strong>de</strong> Klein.<br />
- Le travail du support, les traces <strong>de</strong> Gérard Fioretti.<br />
- Les toiles peintes avec <strong>de</strong>s matériaux naturels <strong>de</strong> Levielle, qui s’est inspiré <strong>de</strong>s silhouettes féminines <strong>de</strong><br />
<strong>La</strong>lin<strong>de</strong>, ont permis d’abor<strong>de</strong>r <strong>la</strong> suggestion dans <strong>la</strong> représentation.<br />
3 - Travaux <strong>de</strong>s élèves<br />
Les élèves ont travaillé sur <strong>la</strong> matière : ils ont tracé <strong>de</strong>s signes avec un mé<strong>la</strong>nge <strong>de</strong> pigments, <strong>de</strong> terre, <strong>de</strong><br />
sable et <strong>de</strong> résine.<br />
Ils ont ensuite travaillé sur l’empreinte : <strong>de</strong>s empreintes <strong>de</strong> pieds dans le sable sont <strong>de</strong>s traces fugaces,<br />
alors que ces empreintes dans l’argile sont transmissibles. En transposant <strong>la</strong> métho<strong>de</strong> vers d’autres<br />
matériaux, les élèves ont marché dans <strong>la</strong> peinture pour <strong>la</strong>isser <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> plus en plus organisées.<br />
Les micro-traces d’usure <strong>de</strong>s outils préhistoriques forment <strong>de</strong>s figures abstraites. Elles sont mises en<br />
parallèle avec les mouvements graphiques <strong>de</strong> prises d’empreintes.<br />
Un autre travail a consisté à faire <strong>de</strong>s grattages sur <strong>de</strong>s supports périssables ou protégés, avec les doigts et<br />
avec divers objets.<br />
Des élèves ont peint <strong>de</strong>s galets dont les formes naturelles les inspiraient.<br />
L’objectif <strong>de</strong> ce travail est <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le geste <strong>de</strong> l’artiste <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire en changeant le matériau et le<br />
support. Il a aussi permis d’apprendre à voir <strong>la</strong> forme du sujet (un animal par exemple) dans l’objet brut, à<br />
s’adapter au support.<br />
<strong>La</strong> leçon à retirer <strong>de</strong> ce travail est que tout le mon<strong>de</strong> a un bagage culturel, plus ou moins fort, qui ressort<br />
dans son travail artistique.<br />
NB : les élèves qui ont travaillé avec Monsieur Picollier ont réalisé <strong>de</strong>s œuvres splendi<strong>de</strong>s, qui illustrent très<br />
bien les différentes démarches présentées ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
Mammouth, réalisé par<br />
Marion.<br />
20
Compte-rendu <strong>de</strong>s ateliers du<br />
4 décembre 2003<br />
Décrypter les représentations<br />
21
IMAGES DE LA PREHISTOIRE AU XIX è SIECLE : CLEFS DE LECTURE<br />
ET MODES D’ANALYSE<br />
Cet exercice a un double but :<br />
montrer comment <strong>de</strong>s images qui nous semblent constituer une connaissance vaguement familière <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
préhistoire sont en fait <strong>de</strong> pures constructions intellectuelles du XIX e siècle et par là-même nous faire<br />
réfléchir sur les images <strong>de</strong> préhistoire actuellement produites.<br />
Noël COYE, Docteur en <strong>Préhistoire</strong> — Historien <strong>de</strong>s sciences<br />
Atelier d’analyse d’images du 19è siècle.<br />
Ce siècle est celui <strong>de</strong> <strong>la</strong> naissance <strong>de</strong> l’archéologie, c’est aussi celui <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s idées sur l’origine <strong>de</strong><br />
l’Homme, idées qui ont encore leur p<strong>la</strong>ce dans notre imaginaire collectif. L’objet <strong>de</strong> cet atelier est <strong>de</strong><br />
permettre à l’homme du 20è siècle <strong>de</strong> remettre <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong>s images du 19 ème dans leur contexte.<br />
Cinq grands thèmes ont été dégagés par l’animateur : l’ancienneté <strong>de</strong> l’homme, l’ancêtre singe, les savants<br />
et vulgarisateurs, l’évolution biologique et culturelle, <strong>la</strong> lutte pour l’existence.<br />
Ancienneté <strong>de</strong> l’homme<br />
Figuier, Luis, <strong>La</strong> terre avant le déluge. 1862.<br />
Cet ouvrage a connu neuf éditions entre 1862 et 1883. Les <strong>de</strong>rniers chapitres illustrent l’apparition <strong>de</strong><br />
l’homme :<br />
Analyse <strong>de</strong> l’image « Scène <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie préhistorique par Rioux »<br />
<strong>La</strong> juxtaposition <strong>de</strong> l’homme et <strong>de</strong>s animaux traduit bien <strong>la</strong> découverte d’ossements fossiles d’animaux et<br />
d’homme dans <strong>la</strong> même couche archéologique, impliquant que l’homme est aussi ancien que les animaux<br />
fossiles. Mais <strong>la</strong> convivialité totale qui existe entre le groupe humain et <strong>de</strong>s animaux actuels l’apparente à<br />
l’imagerie biblique où Adam nomme les animaux, et réfute <strong>la</strong> théorie <strong>de</strong> Darwin sur l’évolution en illustrant<br />
celle du catastrophisme <strong>de</strong> Cuvier où <strong>de</strong>s créations multiples suivent <strong>de</strong>s déluges successifs. Cette<br />
illustration faussement scientifique conforte le récit biblique.<br />
Analyse <strong>de</strong> l’image « Faune quaternaire »<br />
Grand ours, mammouth, auroch, rhinocéros… sont mis en scène. Il s’agit d’une vue idéale, le propos n’est<br />
pas anecdotique, c’est une somme, et ce type <strong>de</strong> présentation est à l’origine <strong>de</strong>s panoramas présentés dans<br />
les musées actuels.<br />
« L’Homme primitif » chez Hachette. L’édition <strong>de</strong> 1870 est dépoussiérée en 1872 et utilise une autre<br />
gravure pour l’apparition <strong>de</strong> l’homme.<br />
Les animaux représentés sont bien <strong>de</strong>s animaux fossiles et l’homme est aussi ancien qu’eux. Mais il<br />
est désormais sorti du paradis, il y a séparation entre l’homme et l’animal, matérialisée sur l’image<br />
par un fossé. Cette séparation indique bien que l’homme n’appartient pas au règne animal, il est<br />
différent. Cette représentation se réfère au créationnisme où évolution et ancienneté sont <strong>de</strong>ux<br />
questions différentes.<br />
Ces <strong>de</strong>ux images montrent ainsi que tenants du catastrophisme et du créationnisme arrivent à <strong>la</strong> même<br />
conclusion par <strong>de</strong>s chemins différents.<br />
Ancêtre singe<br />
Boitard « Paris avant les hommes » 1861<br />
<strong>La</strong> vulgarisation du 19 ème refuse <strong>la</strong> représentation <strong>de</strong> l’homme singe. Il s’agit ici d’une vue idéale, l’homme<br />
est sur un îlot matérialisé par <strong>la</strong> terrasse d’une fa<strong>la</strong>ise, le singe fait pendant à droite sur un arbre.<br />
Boitard Frontispice <strong>de</strong> « L’homme fossile »<br />
Il apparaît que <strong>la</strong> différence entre l’homme fossile et l’homme actuel est <strong>la</strong> même qu’entre le mammouth et<br />
l’éléphant. Mais l’homme reste différent <strong>de</strong> l’animal. Il s’agit donc d’une image inspirée par le créationnisme,<br />
et qui peut donner l’idée fausse que l’on représente un homme-singe.<br />
Gravure apparue en 1838 en illustration d’un article <strong>de</strong> Boitard dans le « Magasin universel » et rééditée à<br />
l’infini jusqu’en 1886.<br />
22
Elle présente l’image défaitiste d’un homme fossile qui part en <strong>la</strong>issant traîner un outil, suggérant qu’il <strong>la</strong>isse<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce à l’homme préhistorique. C’est l’illustration c<strong>la</strong>ssique <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong> l’homme, toujours créé « exnihilo<br />
». C’est bien un ancêtre-singe mais pas un homme puisque ce <strong>de</strong>rnier est apparu après le déluge.<br />
Savants et vulgarisateurs<br />
Figuier « L’homme primitif », 1 ère édition.<br />
Scène anecdotique <strong>de</strong> l’affrontement entre l’homme et l’ours<br />
Du Cleuzioux « <strong>La</strong> création <strong>de</strong> l’homme » 1887<br />
Les hommes préhistoriques ressemblent à <strong>de</strong>s esquimaux. Leur présentation a été actualisée et ils sont tous<br />
accompagnés <strong>de</strong> leurs outils et bien différenciés (homme du Moustier, homme <strong>de</strong> <strong>La</strong> Ma<strong>de</strong>leine…).<br />
Vers 1870-1880, il y a passage <strong>de</strong> re<strong>la</strong>is <strong>de</strong> <strong>La</strong>rtet à Mortillet et sa c<strong>la</strong>ssification. L’outil <strong>de</strong>vient le moteur <strong>de</strong><br />
l’évolution humaine, au moment où l’homme est inclus dans le mon<strong>de</strong> animal et entre dans l’évolution.<br />
Evolution biologique et culturelle<br />
Jules Renga<strong>de</strong>, « <strong>La</strong> création naturelle et les êtres vivants »<br />
Evolutionniste et matérialiste.<br />
« Variation selon le milieux » :<br />
L’image suggère un parallèle entre l’évolution <strong>de</strong> <strong>la</strong> main humaine et celle du mon<strong>de</strong> marin. Elle présente<br />
également <strong>la</strong> transition <strong>de</strong>s poissons aux amphibiens et le développement <strong>de</strong> <strong>la</strong> grenouille. Cette<br />
présentation rappelle <strong>la</strong> théorie biologique p<strong>la</strong>quée sur <strong>la</strong> culture selon <strong>la</strong>quelle l’ontogenèse reproduit <strong>la</strong><br />
phylogenèse, et où apparaît une échelle <strong>de</strong>s êtres (gradation <strong>de</strong>s espèces) hiérarchisées où une espèce<br />
supérieure ancienne ressemble à l’espèce actuelle qui lui est directement inférieure (= loi <strong>de</strong> récapitu<strong>la</strong>tion,<br />
pilier <strong>de</strong> <strong>la</strong> théorie darwinienne, utilisée dans le comparatisme ethnographique). Dans cette optique, l’homme<br />
<strong>de</strong> Solutré ancien est illustré comme un esquimau actuel, ce qui revient à assimiler ces gens à une espèce<br />
directement inférieure à l’homme actuel. Cette analyse permet <strong>de</strong> retrouver les racines du comparatisme<br />
ethnographique dans <strong>la</strong> biologie.<br />
<strong>La</strong> démarche du comparatisme ethnographique peut ainsi illustrer <strong>de</strong>ux concepts radicalement différents,<br />
d’un côté le racisme et <strong>de</strong> l’autre l’expérimentation archéologique. Ce qui était au départ un comparatisme<br />
ethnographique basé sur <strong>la</strong> culture a glissé au comparatisme anthropologique par une assimi<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
culture et du sta<strong>de</strong> évolutif.<br />
<strong>La</strong> lutte pour l’existence<br />
« Combat contre l’ours <strong>de</strong>s cavernes ».<br />
Affrontement homme / animal où le p<strong>la</strong>ntigra<strong>de</strong> est <strong>de</strong>bout et se présente en tant que rival pour <strong>la</strong> chasse<br />
comme pour le logement. L’illustration transmet ainsi un message évolutionniste où l’homme à remp<strong>la</strong>cé<br />
l’ours dans <strong>la</strong> lutte pour <strong>la</strong> vie. Dans <strong>la</strong> théorie darwinienne, chaque espèce est en lutte en permanence<br />
contre toutes les autres, ce qui est facteur important <strong>de</strong> cohésion sociale.<br />
Comparaison avec une gravure <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Du Cleuziou (1887) : « Gravure sur os <strong>de</strong> renne trouvée à<br />
<strong>La</strong> Ma<strong>de</strong>leine », où les hommes emportés par les animaux sont sans armes, symboles <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture qui a<br />
donné son véritable avantage à l’homme.<br />
« L’homme vainqueur <strong>de</strong> l’ours <strong>de</strong>s cavernes » :<br />
L’affrontement singulier homme/ours apparaît comme le raccourcis <strong>de</strong> l’histoire naturelle <strong>de</strong> l’homme. Dans<br />
le chapitre sur l’homme « moustérien », il y a conjonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux processus évolutifs : le processus<br />
<strong>de</strong>scendant <strong>de</strong> l’évolution <strong>de</strong> l’ours parallèlement au mouvement ascendant <strong>de</strong> l’homme (au moment du<br />
progrès industriel). Le moustérien étant considéré comme le moment <strong>de</strong> <strong>la</strong> première industrie offensive où il<br />
assoit sa suprématie comme le montre <strong>la</strong> légen<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> gravure qui ne présente plus un affrontement. Les<br />
os humains sont les restes d’hommes mangés appartenant à une espèce disparue. Idée évolutionniste <strong>de</strong><br />
célébration <strong>de</strong> <strong>la</strong> culture, le progrès étant une loi immuable <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature.<br />
<strong>La</strong> préhistoire permet bien à cette époque <strong>de</strong> célébrer le mouvement industriel. Présente dans les<br />
expositions universelles, elle permet <strong>de</strong> constater rapi<strong>de</strong>ment le chemin parcouru. <strong>La</strong> préhistoire a alors un<br />
rôle vraiment social, permettant <strong>de</strong> démontrer que le progrès industriel est une loi <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature et <strong>la</strong> source<br />
d’un progrès global (éducation, morale…). A l’origine d’une mission civilisatrice qui justifie toutes les<br />
disparitions et tous les abus.<br />
23
QUEL VISAGE POUR NOS ANCETRES ?<br />
Au 19e siècle <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> reconstitutions se côtoient, certaines ne s'inspirent que vaguement <strong>de</strong>s<br />
découvertes archéologiques, les autres sont issues d'une col<strong>la</strong>boration étroite entre artistes et savants.<br />
Quelles sont les diverses sources d'inspirations ? Pourquoi les scientifiques ont-il souhaité mettre un visage<br />
sur les crânes qu'ils exhumaient ? Quels sont les type humains les plus souvent représentés au 19e siècle ?<br />
Sigolène LOIZEAU, Responsable <strong>de</strong>s collections préhistoire du Musée d’Aquitaine à Bor<strong>de</strong>aux<br />
Introduction<br />
L’exposition « Vénus et Caïn, figures <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire, 1830.1930 » a été conçue par le musée d’Aquitaine à<br />
Bor<strong>de</strong>aux où elle a été présentée <strong>de</strong> mars à juin 2003. Elle a ensuite été présentée à Altamira, haut lieu <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> préhistoire espagnole. Elle est actuellement au musée <strong>de</strong>s Beaux-arts <strong>de</strong> Québec.<br />
Près <strong>de</strong> 200 objets ont été réunis : un mé<strong>la</strong>nge d’objets archéologiques (ossements, silex taillés), manuscrits<br />
et publications <strong>de</strong> préhistoriens, sculptures, peintures, photos, mettant en scène l’homme préhistorique.<br />
Au 19 e siècle <strong>de</strong>ux types <strong>de</strong> reconstitutions se côtoient, certaines ne s’inspirent que vaguement <strong>de</strong>s<br />
découvertes archéologiques, les autres sont issues d’une col<strong>la</strong>boration étroite entre artistes et savants.<br />
Quelles sont les sources d’inspiration ?<br />
Quelles sont les re<strong>la</strong>tions entre savants et artistes ?<br />
I - LES RECONSTITUTIONS PUREMENT ARTISTIQUES.<br />
Des thématiques récurrentes<br />
Les <strong>la</strong>custres<br />
Toutes sortes d’images représentant <strong>de</strong>s cités <strong>la</strong>custres ont été produites.<br />
Ces scènes <strong>de</strong> vie sont imaginées suite aux découvertes faites, au cours <strong>de</strong>s années 1850, dans les <strong>la</strong>cs<br />
suisses et <strong>de</strong> l’Est <strong>de</strong> <strong>la</strong> France. Les artistes s’inspirent également <strong>de</strong> l’imagerie ethnographique présentant<br />
les cités <strong>la</strong>custres d’Océanie et d’Asie.<br />
Diapo : Hegi, 1865. Retour du chasseur au temps <strong>de</strong>s <strong>la</strong>custres.<br />
Aquarelle réalisée par un enseignant suisse pour les élèves <strong>de</strong> son école. C’est une <strong>de</strong>s plus anciennes<br />
représentations <strong>de</strong> l’homme préhistorique. <strong>La</strong> femme attend sur le ponton le retour <strong>de</strong> son mari, le chasseur<br />
et pourvoyeur.<br />
Diapo : Anker, Femme <strong>la</strong>custre, 1973<br />
Diapo : Hippolyte Couteau, Un soir dans un vil<strong>la</strong>ge <strong>la</strong>custre, 1896, Huile sur toile, 260 x 174 cm,<br />
musée d’art et d’Histoire <strong>de</strong> Genève.<br />
Cette toile présentée dans les salles <strong>de</strong> préhistoire du musée <strong>de</strong> Genève est le point <strong>de</strong> départ <strong>de</strong> notre<br />
exposition.<br />
Diapo : Alfred Berthoud, sans date, Idylle <strong>la</strong>custre<br />
Diapo : Achille Lemoine, 1905-1908, vues stéréoscopiques. Nus <strong>de</strong> style préhistorique<br />
Les luttes<br />
Les artistes ont représenté les hommes luttant entre eux mais également les luttes hommes-animaux. Un<br />
animal est d’ailleurs fréquemment représenté, il s’agit <strong>de</strong> l’ours. L’homme est parfois chasseur mais aussi<br />
chassé.<br />
24
Diapo, Léon Perrault, Le premier meurtre, 1899<br />
Les scènes bibliques présentant Abel et Caïn sont traitées à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> préhistorique, les personnages sont<br />
vêtus <strong>de</strong> peaux <strong>de</strong> bêtes.<br />
Diapo : Léon Maxime FAIVRE, L’envahisseur, 1884, Huile sur toile, Vienne<br />
Diapo : Paul JAMIN, Rapt à l’âge du bronze, 1900, Huile sur toile, Reims<br />
Dans ces <strong>de</strong>ux toiles les artistes présentent <strong>de</strong>s luttes pour <strong>la</strong> possession <strong>de</strong>s femmes.<br />
Diapo : Paul JAMIN, <strong>La</strong> fuite <strong>de</strong>vant le mammouth, esquisse, 1885, Huile sur toile, Dédié « à l’ami<br />
Capitan », Paris, collection particulière<br />
Diapo : Paul JAMIN, Un drame à l’âge <strong>de</strong> pierre, esquisse, 1886, Huile sur toile, Dédié « à l’ami<br />
Capitan », Paris, collection particulière<br />
Pour ces <strong>de</strong>ux toiles, Paul Jamin s’est inspiré <strong>de</strong>s informations que lui fournissait son ami, le préhistorien<br />
Louis Capitan.<br />
Le mythe <strong>de</strong> l’ours <strong>de</strong>s cavernes<br />
Luttes pour l’habitat : au XIX e siècle on pensait que, comme l’ours, les hommes préhistoriques vivaient<br />
exclusivement dans les grottes. Les artistes ont régulièrement utilisé cette thématique dans leurs tableaux.<br />
Diapo : Emmanuel BENNER, L’alerte, dite aussi Une famille à l’âge <strong>de</strong> pierre, 1892, Huile sur toile,<br />
Colmar, musée d’Unterlin<strong>de</strong>n<br />
Diapo : Léon Maxime FAIVRE, Deux mères, 1888, Huile sur toile, Paris, musée d’Orsay<br />
Lutte entre <strong>de</strong>ux mères et leur progéniture, une ourse et une femme. <strong>La</strong> femme préhistorique, vêtue d’une<br />
peau <strong>de</strong> bête accrochée sur l’épaule, est armée d’une hache polie. Il existe un déca<strong>la</strong>ge chronologique entre<br />
l’utilisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> hache (Néolithique) et ce type <strong>de</strong> vêtement non cousu (<strong>la</strong> couture étant maîtrisée dès le<br />
Paléolithique).<br />
Le travail<br />
Diapo : <strong>La</strong> Chasse, Cormon. Décoration <strong>de</strong> l’amphi du muséum<br />
Cormon a été sélectionné pour réaliser le décor du p<strong>la</strong>fond <strong>de</strong> l’amphithéâtre du muséum d’Histoire<br />
Naturelle <strong>de</strong> Paris. Cet artiste a lu énormément d’ouvrages sur <strong>la</strong> préhistoire. Dans <strong>la</strong> fresque du muséum, il<br />
retrace l’évolution <strong>de</strong> l’homme, le <strong>la</strong> barbarie vers <strong>la</strong> civilisation.<br />
<strong>La</strong> famille<br />
Diapo : Emmanuel BENNER, L’affût, 1879, Huile sur toile, Limoux, musée Petiet<br />
Le thématique préhistorique est utilisée par les peintres pour réaliser <strong>de</strong>s corps nus.<br />
Conclusion/ Discussion<br />
Des reconstitutions à l’image <strong>de</strong> <strong>la</strong> société du XIX e siècle, on retrouve les valeurs importantes <strong>de</strong> l’époque (le<br />
travail, <strong>la</strong> famille...). NB : <strong>la</strong> préhistoire a été présentée pour <strong>la</strong> première fois dans une exposition universelle<br />
dans les années 1860 : le matériel était présenté dans une salle sur l’histoire du travail !<br />
Dans ces représentations les visages <strong>de</strong>s hommes préhistoriques sont très mo<strong>de</strong>rnes.<br />
Quelques anachronismes : les hommes domestiquent les chiens, utilisent <strong>de</strong>s haches polies mais sont vêtus<br />
<strong>de</strong> peaux <strong>de</strong> bêtes non cousues. Les <strong>de</strong>ux premières observations sont liées à <strong>la</strong> pério<strong>de</strong> Néolithique alors<br />
que <strong>la</strong> couture apparaît dès le Paléolithique. Ces mé<strong>la</strong>nges s’expliquent en parti par une chronologie<br />
préhistorique encore mal établie à cette époque.<br />
Diapo : Lucien PORCHERON, Scène préhistorique, 1930, Huile sur toile, Le Grand-Pressigny<br />
Les sources d’inspiration <strong>de</strong>s artistes sont multiples :<br />
- Quelques découvertes archéologiques : les hommes représentés sont souvent armés <strong>de</strong> haches polies<br />
(ont-elles réellement servi d’arme ou d’outils)<br />
25
- Des informations ethnographiques : les citées <strong>la</strong>custres par exemple.<br />
- <strong>La</strong> vie courante et les valeurs du XIX e siècle.<br />
Ces représentations ne sont pas scientifiques.<br />
II - LES RECONSTITUTIONS SCIENTIFIQUES.<br />
Les scientifiques ne sont pas totalement d’accord avec les reconstitutions qui sont faites. Le plus bel<br />
exemple est celui <strong>de</strong> l’ouvrage <strong>de</strong> Figuier. <strong>La</strong> première édition <strong>de</strong> « L’homme primitif » sort au début <strong>de</strong><br />
l’année 1870, très vite épuisée, elle doit être réimprimée fin 1870. Entre temps les scientifiques critiquent les<br />
représentations, selon eux elles sont plus proches <strong>de</strong> l’homme actuel que <strong>de</strong> nos ancêtres qu’ils pensaient<br />
venir d’Asie. <strong>La</strong> secon<strong>de</strong> édition <strong>de</strong> l’ouvrage, revue et corrigée, présente <strong>de</strong>s hommes, non plus avec un<br />
faciès aryen mais mongoloï<strong>de</strong>.<br />
Diapo : Figuier, illustration <strong>de</strong> « L’homme primitif » (x 2)<br />
Peu à peu les préhistoriens fournissent <strong>de</strong>s preuves archéologiques aux artistes, ensembles ils tentent <strong>de</strong>s<br />
reconstitutions ; <strong>la</strong> plus remarquable col<strong>la</strong>boration est celle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux Belges : Louis Mascré et Aimé Rutot.<br />
A- <strong>La</strong> col<strong>la</strong>boration Mascré, Rutot.<br />
Leurs reconstitutions sont basées sur <strong>de</strong>s découvertes archéologiques. Elles retracent l’état <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
connaissance en préhistoire entre 1909 et 1914.<br />
Diapo Précurseur <strong>de</strong> l’ère tertiaire. Industrie éolithique<br />
A Trinil en 1891, Eugène Dubois, savant hol<strong>la</strong>ndais, exhume quelques ossements humains (dont une calotte<br />
crânienne et un fémur) qu’il baptise Pithecanthropus erectus. Mascré et Rutot imaginent ce premier<br />
représentant <strong>de</strong> l’espèce humaine à <strong>la</strong> cime d’un arbre, s’apprêtant à cueillir un fruit.<br />
Diapo L’Homme <strong>de</strong> Galley-Hill. Industrie strépyenne, entre 1909 et 1914<br />
Découverts à Galley-Hill dans le Kent en 1888, <strong>de</strong>s ossements humains sont alors datés <strong>de</strong> 200 000 ans.<br />
Cet homme est considéré comme un contemporain <strong>de</strong> l’homme du Sussex. En 1949, on a prouvé qu’il<br />
s’agissait d’ossements récents attribués à <strong>de</strong>s couches plus anciennes.<br />
Selon Aimé Rutot, l’outil porté autour du cou est une arme <strong>de</strong> rechange qui rend l’homme<br />
redoutable ; Ce type d’arme <strong>de</strong>venu à <strong>la</strong> mo<strong>de</strong> est alors inutile, <strong>la</strong> taille <strong>de</strong> l’outil diminue et c’est <strong>la</strong><br />
naissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> parure.<br />
(Lire le livre d’Herbert Thomas, récemment publié)<br />
Diapo Homme <strong>de</strong> Mauer. Descendant <strong>de</strong>s Précurseurs. Âge chelléen<br />
Une mâchoire inférieure d’Homo hei<strong>de</strong>lbergensis découverte en 1907 au sud d’Hei<strong>de</strong>lberg (Allemagne) est à<br />
l’origine <strong>de</strong> cette reconstitution. Cette mandibule est aujourd’hui attribuée aux Homo erectus d’Europe.<br />
Non loin <strong>de</strong>s restes humains, <strong>de</strong>s vestiges osseux <strong>de</strong> lions, <strong>de</strong> sangliers, <strong>de</strong> rhinocéros sont mis au jour.<br />
Aimé Rutot en déduit que l’homme <strong>de</strong> Mauer est un chasseur et lui associe un sanglier.<br />
Diapo Le Brachycéphale <strong>de</strong> Grenelle. Industrie moustérienne<br />
Le gisement <strong>de</strong> Grenelle a livré en 1867 <strong>de</strong>s restes osseux appartenant à un individu brachycéphale (<strong>de</strong><br />
crâne <strong>la</strong>rge) que Rutot attribue à une industrie moustérienne. L’individu reconstitué tient dans sa main un<br />
nucléus Levallois qu’il débite à l’ai<strong>de</strong> du percuteur.<br />
Diapo Chasseur <strong>de</strong> rennes <strong>de</strong> Furfooz. Industrie du magdalénien supérieur, entre 1909 et 1914<br />
Outre <strong>de</strong> nombreux vestiges <strong>de</strong> rennes et <strong>de</strong> rongeurs, <strong>de</strong>s ossements humains exhumés à Furfooz<br />
(Belgique), évoquant le type mongoloï<strong>de</strong>, ont inspiré Rutot et Mascré pour leur chasseur <strong>de</strong> rennes. Selon<br />
Rutot, il reste <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scendants <strong>de</strong> cette race <strong>de</strong> Furfooz dans les forêts ar<strong>de</strong>nnaises. Il les décrit comme <strong>de</strong>s<br />
hommes <strong>de</strong> petite taille, aux yeux et cheveux noirs, <strong>de</strong> caractère sournois, batailleurs et vivant <strong>de</strong>s produits<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> forêt.<br />
Diapo Mineur néolithique d’Obourg. Industrie campignyenne, entre 1909 et 1914<br />
26
À Obourg (Belgique), les ossements d’un homme que l’on pensait préhistorique, un pic en bois <strong>de</strong> cerf en<br />
main, ont été exhumés. À l’époque on pensait qu’il <strong>de</strong>vait être en train d’extraire du silex d’une tranchée<br />
quand les parois se sont effondrées sur lui. Les vêtements et le chapeau <strong>de</strong>vaient le protéger <strong>de</strong>s éc<strong>la</strong>ts <strong>de</strong><br />
silex.<br />
Diapo Chef néolithique <strong>de</strong> Spiennes. Âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> pierre polie (spiennien supérieur)<br />
Selon Rutot, cet homme protège les réserves <strong>de</strong> silex <strong>de</strong> sa tribu, son casque ailé signale à l’envahisseur<br />
son agilité au combat. Le Spiennien supérieur est considéré au XIX e comme l’âge <strong>de</strong> <strong>la</strong> hache polie, <strong>de</strong>s<br />
<strong>la</strong>nces et <strong>de</strong>s poignards, c’est donc une époque guerrière.<br />
B- Travaux d’autres préhistoriens.<br />
Les préhistoriens critiquent souvent les reconstitutions <strong>de</strong> leurs collègues.<br />
Plusieurs exemples <strong>de</strong> col<strong>la</strong>boration savants/artistes : Marcellin Boule et Joanny Durand, Henri Martin et<br />
Charles Bousquet, Faure et Parvillée.<br />
De nombreuses reconstitutions se sont inspirées <strong>de</strong>s restes <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal. Les premiers<br />
restes sont découverts dans <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> Néan<strong>de</strong>r en Allemagne en 1856. Puis en 1909 à <strong>La</strong>-Chapelleaux-Saints<br />
en Corrèze, et en 1911 à <strong>La</strong> Quina.<br />
Diapo : Joanny DURAND et Marcellin BOULE, Reconstitution <strong>de</strong>s muscles <strong>de</strong> <strong>la</strong> tête et du cou <strong>de</strong><br />
Néan<strong>de</strong>rtalien <strong>de</strong> <strong>la</strong> Chapelle-aux-Saints, 1921<br />
Charles BOUSQUET et Léon HENRI-MARTIN, Reconstitution <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme <strong>de</strong> <strong>La</strong> Quina, 1913<br />
C- Conclusion/ Discussion<br />
Quels sont les type humains les plus souvent représentés au 19 e siècle ?<br />
Cro-Magnon/ artiste<br />
Diapo Figuier, artistes<br />
Diapo : Paul RICHER, Premier artiste, vers 1890, Plâtre, Le Puy-en-Ve<strong>la</strong>y<br />
Le mé<strong>de</strong>cin Paul Richer s’est inspiré du crâne <strong>de</strong> Cro-Magnon pour réaliser cette sculpture. Sur le socle, <strong>de</strong>s<br />
vestiges archéologiques sont représentés : gravure <strong>de</strong> mammouth sur fragment d’ivoire <strong>de</strong> mammouth<br />
retrouvé à <strong>La</strong> Ma<strong>de</strong>leine. Cette œuvre d’art est une preuve supplémentaire quant à l’ancienneté <strong>de</strong> l’homme<br />
(l’homme a été capable <strong>de</strong> graver un mammouth (animal disparu) ils ont donc été contemporains).<br />
Diapo L’artiste magdalénien <strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>de</strong> Cro-magnon.<br />
Mascré et Rutot sont partis <strong>de</strong>s restes humains mis au jour à Cro-Magnon en Dordogne en 1968. Dans <strong>la</strong><br />
main <strong>de</strong> l’homme ils ont glissé le poignard exhumé à <strong>La</strong>ugerie-Basse. Dans <strong>la</strong> chevelure on retrouve <strong>la</strong><br />
parure en coquil<strong>la</strong>ges découverte sur le gisement <strong>de</strong> Cro-Magnon.<br />
Diapo : Jamin, Peintre décorateur à l’âge <strong>de</strong> pierre, 1903<br />
L’artiste s’est inspiré <strong>de</strong>s éléments fournis par son ami Louis Capitan, peu après <strong>la</strong> découverte <strong>de</strong>s peintures<br />
paléolithiques <strong>de</strong> <strong>la</strong> grotte <strong>de</strong> Font-<strong>de</strong>-Gaume.<br />
Nean<strong>de</strong>rtal<br />
Diapo L’homme <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal. Descendant <strong>de</strong>s Précurseurs. Âge moustérien<br />
Réalisé d’après le crâne découvert dans <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> Néan<strong>de</strong>r en Allemagne à côté <strong>de</strong> Düsseldorf. Selon<br />
Rutot, l’homme <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal serait asservi par les races <strong>de</strong> Cro-Magnon : « un esc<strong>la</strong>ve soumis, avachi,<br />
souvent mal traité, couvert à cause <strong>de</strong> <strong>la</strong> température, <strong>de</strong>s peaux <strong>de</strong> bêtes abandonnées après usage,<br />
exécutant d’un œil terne et résigné le travail commandé par le maître et consistant, dans le cas présent, à<br />
briser un os pour en extraire <strong>la</strong> moelle. ».<br />
Les reconstitutions <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> sont très fréquentes et très diverses, al<strong>la</strong>nt <strong>de</strong> <strong>la</strong> plus g<strong>la</strong>bre <strong>de</strong>s<br />
représentations à <strong>la</strong> plus velue.<br />
27
Diapo <strong>La</strong> préhistoire <strong>de</strong> l’humanité reconstituée, Carnet <strong>de</strong> cartes postales édité par l’Institut<br />
international d’anthropologie à Nice ; Maurice Faure et Yvonne Parvillée<br />
Maurice Faure estime que les reconstitutions s’apparentent <strong>la</strong> plupart du temps à <strong>de</strong>s « fictions ou <strong>de</strong>s<br />
allégories [...] <strong>de</strong>s écorchés ou <strong>de</strong>s momies » 1 , elles manquent <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> mouvement. Avec <strong>la</strong><br />
col<strong>la</strong>boration du sculpteur Yvonne Parvillée, il exécute <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal à partir <strong>de</strong><br />
squelettes. Il met en scène ces figurines dans un décor végétal afin <strong>de</strong> réaliser <strong>de</strong>s photographies, diffusées<br />
ensuite sous forme <strong>de</strong> cartes postales.<br />
Diapo Habitant du Moustier il y a cinq mille ans, Tursac, collection Bernard Henriette<br />
Diapo Fre<strong>de</strong>rick BLASCHKE, Reconstitutions <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal, 1920, Photographies <strong>de</strong>s étapes<br />
intermédiaires <strong>de</strong>s reconstitutions réalisées pour le Field Museum <strong>de</strong> Chicago<br />
Diapo Femme <strong>de</strong> <strong>la</strong> race <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal. Descendant <strong>de</strong>s précurseurs. Âge moustérien<br />
Sculpture réalisée d’après le crâne <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme <strong>de</strong> <strong>la</strong> Quina découverte en Charente en 1911. Cette femme<br />
porte un enfant et « sort <strong>de</strong> <strong>la</strong> caverne sombre et enfumée qui sert <strong>de</strong> refuge à <strong>la</strong> famille, et se trouve tout à<br />
coup en présence d’un groupe <strong>de</strong> grands Ours <strong>de</strong>s Cavernes [...]<br />
Diapo Fre<strong>de</strong>rick BLASCHKE, Reconstitutions <strong>de</strong> Nean<strong>de</strong>rtal, 1920, Photographies <strong>de</strong>s étapes<br />
intermédiaires <strong>de</strong>s reconstitutions réalisées pour le Field Museum <strong>de</strong> Chicago<br />
Quelles sont les diverses sources d’inspirations ?<br />
Matériel archéologique connu à l’époque<br />
Les faux<br />
Diapo Homme du Sussex. Eonthropus Dawsoni. Sm. Wood. Industrie préchelléenne<br />
Entre 1911 et 1912, dans <strong>la</strong> gravière <strong>de</strong> Piltdown (Sussex) <strong>de</strong>s chercheurs ang<strong>la</strong>is mettent au jour un crâne<br />
fossile : Eonthropus Dawsoni. Une étu<strong>de</strong> réalisée en 1953 révèle qu’il s’agit d’un faux réalisé à partir d’un<br />
crâne d’homme actuel et d’une mandibule d’orang-outang dont les <strong>de</strong>nts auraient été limées et les os<br />
teintés.<br />
<strong>La</strong>ussel<br />
Diapo <strong>La</strong> femme négroï<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>La</strong>ussel. Industrie aurignacienne<br />
Diapo Vénus à <strong>la</strong> corne <strong>de</strong> <strong>La</strong>ussel<br />
En 1911 les fouilleurs employés par le Docteur <strong>La</strong><strong>la</strong>nne sur le site <strong>de</strong> <strong>La</strong>ussel en Dordogne mettent au jour<br />
plusieurs bas-reliefs peints, dont un figurant une femme portant une corne dans sa main droite. <strong>La</strong><br />
corpulence <strong>de</strong> cette femme a parfois été associée à une grossesse en cours, ou encore assimilée à <strong>la</strong><br />
morphologie <strong>de</strong> certaines africaines (telle <strong>la</strong> célèbre Saartjie Baartman, surnommée <strong>la</strong> Vénus hottentote).<br />
Ainsi, lorsque Rutot et Mascré imaginent le portrait <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme <strong>de</strong> <strong>La</strong>ussel, c’est une femme noire qu’ils<br />
représentent.<br />
<strong>La</strong> découverte <strong>de</strong> ce bas-relief à figuration humaine a eu un retentissement considérable dans <strong>la</strong> presse<br />
internationale, chaque journaliste interprétant à loisir.<br />
Dans Paris Journal, en janvier 1912, on pouvait lire:<br />
C’est M. C. Jullian, professeur au Collège <strong>de</strong> France, qui a annoncé hier à l’Académie <strong>de</strong>s inscriptions et<br />
belles lettres cette sensationnelle découverte qui vient d’être faite par un préhistorien bien connu, le Dr<br />
Gaston <strong>La</strong><strong>la</strong>nne <strong>de</strong> Bor<strong>de</strong>aux [...] <strong>la</strong> Vénus <strong>de</strong> <strong>La</strong>ussel n’est pas un type raffiné <strong>de</strong> beauté : par ses jambes<br />
courtau<strong>de</strong>s et tassées, par ses seins tombants et f<strong>la</strong>sques, par son ventre flou et rebondi, elle évoque<br />
l’esthétique spéciale <strong>de</strong> <strong>la</strong> Vénus Hottentote [ethnie d’Afrique du Sud].<br />
Et dans Le Temps du 28 mars 1912 :<br />
L’accumu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong> masses considérables <strong>de</strong> graisse dans <strong>la</strong> région inférieure du corps n’est pas d’ailleurs un<br />
caractère <strong>de</strong> race ; il paraît se rattacher plutôt à <strong>la</strong> vie sé<strong>de</strong>ntaire <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme, qui déjà était <strong>la</strong> ménagère<br />
1 Faure Maurice, « Reconstitution <strong>de</strong> l’Homo mousteriensis ou nean<strong>de</strong>rthalensis », Compte rendu <strong>de</strong> <strong>la</strong> 46 e<br />
session du Congrès <strong>de</strong> l’Association française pour l’avancement <strong>de</strong>s sciences, Paris, Masson, 1923, p. 439-444.<br />
28
attendant patiemment au fond <strong>de</strong> sa grotte, entourée <strong>de</strong> sa progéniture, le retour du hardi chasseur, son<br />
maître et pourvoyeur [...]<br />
Culte féminin, <strong>de</strong>stin biologique <strong>de</strong> <strong>la</strong> femme - <strong>la</strong> Vénus serait enceinte - sont les convictions les plus<br />
partagées aujourd’hui.<br />
CONCLUSION<br />
Importance <strong>de</strong> mettre <strong>de</strong>s visages sur <strong>de</strong>s squelettes, <strong>de</strong> même, nous souhaitons mettre un visage sur <strong>de</strong>s<br />
personnages historiques.<br />
Les reconstitutions sont le reflet <strong>de</strong> notre société.<br />
Diapo Nean<strong>de</strong>rtal, coll. Hamy<br />
Diapo Buste <strong>de</strong> <strong>La</strong><strong>la</strong>nne<br />
Les reconstitutions que l’on réalise aujourd’hui avec <strong>de</strong>s moyens mo<strong>de</strong>rnes, comme « L’Odyssée <strong>de</strong><br />
l’espèce », ne sont pas forcément plus exactes que les reconstitutions <strong>de</strong> Mascré au début du XX e siècle.<br />
En 1919, le musée <strong>de</strong> San Diego, aux Etats-Unis, a commandé une copie <strong>de</strong> <strong>la</strong> série <strong>de</strong>s bustes réalisés par<br />
Mascré et Rutot, mais les conservateurs n’ont pas voulu <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux reconstitutions <strong>de</strong> négroï<strong>de</strong>s.<br />
Diapo Le Négroï<strong>de</strong> <strong>de</strong> Menton. Industrie aurignacienne<br />
En 1901, <strong>de</strong>ux squelettes issus d’une même sépulture sont exhumés à Menton. Les crânes, en partie<br />
déformés par le poids <strong>de</strong>s sédiments, présentent un certain prognathisme ; rapi<strong>de</strong>ment, les anthropologues<br />
i<strong>de</strong>ntifient ces individus comme les ancêtres <strong>de</strong> <strong>la</strong> « race noire ».<br />
Cet homme achève <strong>la</strong> sculpture d’une statuette féminine retrouvée à Willendorf (Autriche). <strong>La</strong> couronne <strong>de</strong><br />
coquilles qu’il porte rappelle <strong>la</strong> parure exhumée à Menton, tout comme les bracelets <strong>de</strong> coquil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
femme.<br />
Diapo Cro Magon présenté à San Diego<br />
29
REFLEXIONS SUR LE THEME DE LA REPRESENTATION DU CORPS HUMAIN<br />
<strong>La</strong> figuration humaine au cours <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire (peinture, sculpture, mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge…).<br />
<strong>La</strong> représentation du corps par les artistes préhistoriques : réalisme (« vénus stéatopyges », « sorciers »…)<br />
ou interprétation ?<br />
Les traces <strong>la</strong>issées par le corps (empreintes, tracés), <strong>la</strong> parure.<br />
Un regard actuel sur les productions préhistoriques (aspects techniques et esthétiques)<br />
Ateliers <strong>de</strong> pratique :<br />
Réalisation d’un production sur le thème du corps en utilisant <strong>de</strong>s techniques préhistoriques : mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge,<br />
gravure, empreintes.<br />
Réalisation d’objets <strong>de</strong> « parure » en utilisant <strong>de</strong>s matériaux actuels<br />
Patrick PICOLLIER, conseiller pédagogique<br />
On ne traitera ici que <strong>de</strong>s traces directes (empreintes) et <strong>de</strong>s représentations figurées du corps humain, et<br />
pas <strong>de</strong>s représentations animales ou <strong>de</strong>s signes, qui sont bien entendu <strong>de</strong>s traces <strong>la</strong>issées par l’homme.<br />
Problèmes posés par l’art préhistorique :<br />
Aucun texte d’accompagnement<br />
o Hypothèses fondées sur :<br />
<strong>La</strong> fouille archéologique (localisation, datation…)<br />
L’analyse scientifique <strong>de</strong>s traces (techniques, pigments…)<br />
L’archéologie expérimentale<br />
L’observation et l’analyse <strong>de</strong>s caractères p<strong>la</strong>stiques et stylistiques<br />
<strong>La</strong> comparaison ethnographique<br />
<strong>La</strong> comparaison avec les mythes et les religions<br />
<strong>La</strong> représentation du corps : plusieurs niveaux d’interprétation :<br />
l’homme préhistorique a une perception <strong>de</strong> son corps dans son environnement. <strong>La</strong>quelle ? on n’en<br />
sait rien.<br />
o Il marque l’environnement <strong>de</strong> ses empreintes :<br />
Fortuites (traces <strong>de</strong> pas) Pech-Merle<br />
Intentionnelles (mains, tracés digités…) Gargas (mains), Pech-Merle, Gargas<br />
o Il se représente (peinture, gravure, sculpture, mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge) :<br />
Silhouettes <strong>La</strong>lin<strong>de</strong><br />
Sexes Gorge d’Enfer, Monpazier<br />
« Vénus » Willendorf<br />
Individus composites (« chamanes », « sorciers »…) Trois Frères, Hollenstadt, Mas<br />
d’Azil<br />
« Portraits » Dolni Vestonice<br />
o Il orne son corps :<br />
Parure Collier ivoire, <strong>de</strong>nts percées, collier + sépultures<br />
Vêtements ?<br />
Peintures corporelles (traces d’ocre ?)<br />
Tatouages, scarifications ?<br />
Coiffure ? Brassempouy<br />
L’homme mo<strong>de</strong>rne interprète ces représentations :<br />
o L’exemple <strong>de</strong>s Vénus :<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’anatomie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> physiologie (représentation d’une réalité<br />
biologique) :<br />
• Réserves <strong>de</strong> graisse Vénus hottentote, Dora Maar<br />
• Femmes enceintes <strong>La</strong>ussel<br />
30
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mythologie et <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s religions :<br />
• Culte <strong>de</strong> <strong>la</strong> Fécondité, <strong>de</strong> <strong>la</strong> sexualité Angles, .<strong>La</strong>urent<br />
• Déesses-mères Catal Hüyük<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’art (analyse stylistique, évolution <strong>de</strong>s formes…) :<br />
• Analyse stylistique (géométrie) Tableau<br />
• Evolution <strong>de</strong>s formes Tableaux<br />
• Productions ultérieures Cap<strong>de</strong>nac, Cyc<strong>la</strong><strong>de</strong>s, Statue-menhir<br />
o L’exemple <strong>de</strong>s représentations composites :<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’ethnographie (comparaison avec d’autres civilisations) :<br />
• Scènes <strong>de</strong> chasse (cf. Indiens d’Amérique) Trois Frères<br />
• Scènes <strong>de</strong> guerre Hommes blessés, <strong>La</strong>scaux<br />
• Sorciers (cf. Breuil) Gabillou<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> <strong>la</strong> mythologie et <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong>s religions :<br />
• Chamanes (cf. Clottes) Chamane 1705<br />
• Divinités (cf. Ganesh) Combarelles, Chauvet<br />
• Tabou <strong>de</strong> <strong>la</strong> représentation du corps ou du visage (cf. Is<strong>la</strong>m)<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’art (analyse stylistique, évolution <strong>de</strong>s formes…) :<br />
• Incapacité à représenter le corps humain Marsou<strong>la</strong>s, Rouffignac<br />
• Caricatures Profils<br />
o Les représentations plus réalistes :<br />
• Des portraits ? Malta, <strong>La</strong> Marche<br />
Atelier <strong>de</strong> pratique :<br />
o Mo<strong>de</strong><strong>la</strong>ge<br />
o Gravure sur p<strong>la</strong>que d’argile<br />
Réaliser une production représentant tout ou partie d’un corps humain, en mettant<br />
en évi<strong>de</strong>nce une partie <strong>de</strong> ce corps.<br />
31
"HISTOIRE D'HOMMES"<br />
A partir <strong>de</strong> 4 restitutions humaines proposées dans le cadre <strong>de</strong> l'exposition "Histoire d'Hommes" au prieuré<br />
<strong>de</strong> Montignac, on pourra distinguer ce qui relève <strong>de</strong>s affirmations scientifiques du moment <strong>de</strong> ce qui<br />
appartient plutôt au champ <strong>de</strong> l'imaginaire.<br />
B. CAUDRON, professeur <strong>de</strong>s écoles et M. O’FARELL, archéologue<br />
Cette exposition présente l’évolution <strong>de</strong> l’Homme en partant <strong>de</strong>s pério<strong>de</strong>s récentes (Paléolithique supérieur)<br />
pour aller vers les plus anciennes (époque <strong>de</strong> Lucy).<br />
Elle se compose <strong>de</strong> nombreux textes et surtout <strong>de</strong> plusieurs reconstitutions humaines pour moitié locale.<br />
L’intérêt pédagogique <strong>de</strong> cette exposition ne rési<strong>de</strong> pas tant dans l’information portée écrite mais plutôt dans<br />
ces quatre « interprétations très subjectives » <strong>de</strong> nos ancêtres : l’Homme mo<strong>de</strong>rne, l’Homme <strong>de</strong> Néan<strong>de</strong>rtal,<br />
l’Homo erectus et l’Australopithèque (Lucy).<br />
Elle peut s’adapter à tous les niveaux, <strong>de</strong>s enfants <strong>de</strong> maternelle aux jeunes <strong>de</strong> lycée et introduire ou clore<br />
<strong>de</strong>s projets établis par les « éducateurs ».<br />
Elle constitue un bon support à une activité <strong>de</strong> découverte et à une approche <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche scientifique.<br />
Ce<strong>la</strong> dit il est c<strong>la</strong>ir qu’elle ne peut se suffire à elle-même. Certaines notions (abandon, enfouissement,<br />
conservation, fouilles, spécialités scientifiques, …) doivent être abordées afin <strong>de</strong> pouvoir porter une vue<br />
critique sur les éléments présentés.<br />
Il est évi<strong>de</strong>nt ces représentations humaines (et américaines) posent problème et soulèvent <strong>de</strong>s questions.<br />
Quelle est <strong>la</strong> part <strong>de</strong> certitu<strong>de</strong>s et celle <strong>de</strong> l’imaginaire ?<br />
Les certitu<strong>de</strong>s scientifiques sont celles portées par les témoins archéologiques (<strong>la</strong>mpe à graisse, aiguilles à<br />
coudre, …) et anthropologiques (squelette : forme du crâne, taille).<br />
Le reste relève <strong>la</strong> plupart du temps d’hypothèses basées sur <strong>de</strong>s observations archéologiques, sur <strong>de</strong>s<br />
comparaisons actualistes, voire sur <strong>de</strong> pures spécu<strong>la</strong>tions : utilisation <strong>de</strong>s outils, forme <strong>de</strong>s vêtements,<br />
pilosité, couleur <strong>de</strong> peau, <strong>de</strong>s yeux…<br />
<strong>La</strong> morphologie et surtout les traits <strong>de</strong> visage sont aussi à c<strong>la</strong>sser dans cette catégorie, les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
police scientifique pour <strong>la</strong> reconstitution <strong>de</strong>s masses muscu<strong>la</strong>ires n’étant pas forcément fiable, d’autant plus<br />
les p<strong>la</strong>sticiens y projettent leurs propres représentations culturelles…<br />
32
REPRESENTATION DE LA PREHISTOIRE DANS LA LITTERATURE<br />
POUR LA JEUNESSE<br />
<strong>La</strong> documentation : élément clé du parcours. Présentation d’outils bibliographiques, ai<strong>de</strong>s au choix d’un<br />
documentaire ; réflexion autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’une fiche d’analyse pour enfants.<br />
Valérie BALIER, documentaliste et Florence LANDAIS , conférencière nationale<br />
Présentation <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux bibliographies analytiques sur <strong>la</strong> préhistoire, jointes au dossier distribué aux<br />
stagiaires :<br />
<strong>la</strong> bibliographie complète conçue et éditée par le musée <strong>de</strong> préhistoire du Nord Pas <strong>de</strong> Ca<strong>la</strong>is ;<br />
les fiches d’analyse <strong>de</strong> documentaires pour <strong>la</strong> jeunesse qui ont plusieurs objectifs :<br />
- ai<strong>de</strong>r les enseignants non-spécialistes <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire à choisir <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> travail,<br />
- ai<strong>de</strong>r les bibliothécaires à orienter leurs achats d’ouvrages,<br />
- ai<strong>de</strong>r les lecteurs néophytes,<br />
- développer <strong>la</strong> lecture du documentaire, moins répandue que <strong>la</strong> lecture <strong>de</strong> fictions.<br />
Au vu <strong>de</strong> ces réalisations, il est c<strong>la</strong>ir qu’il manque au moins <strong>de</strong>ux produits :<br />
Une sélection thématique (vie quotidienne, art, anthropologie…) d’ouvrages en fonction <strong>de</strong> l’âge.<br />
Un modèle <strong>de</strong> fiche d’analyse <strong>de</strong>stiné aux enfants et conçu par eux auquel cet atelier se proposait <strong>de</strong><br />
réfléchir…., et a abouti à une réflexion sur l’intégration d’une démarche documentaire basée sur les<br />
représentations <strong>de</strong>s élèves dans le cadre d’un parcours préhistoire.<br />
Objectifs : s’initier à une démarche documentaire en accompagnant <strong>de</strong>s pratiques <strong>de</strong> lecture, d’oral,<br />
d’expression écrite, d’esprit critique ; et en enrichissant les connaissances scientifiques et leur construction.<br />
Méthodologie :<br />
Les documentaires jeunesse sur <strong>la</strong> préhistoire comportent certaines inexactitu<strong>de</strong>s et <strong>de</strong>s stéréotypes. Pour<br />
que <strong>de</strong>s enfants, pour <strong>la</strong> plupart néophytes, puissent initier une analyse critique <strong>de</strong> ces ouvrages, il faut<br />
intégrer cette démarche dans un parcours culturel, permettant <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration d’un spécialiste.<br />
Cette démarche pourra s’intégrer au début ou au cours du parcours. Un travail sur le thème choisi par <strong>la</strong><br />
c<strong>la</strong>sse (habitat, scène <strong>de</strong> chasse, art, représentation <strong>de</strong> l’homme, représentation <strong>de</strong>s outils, <strong>de</strong>s animaux…),<br />
en col<strong>la</strong>boration avec un scientifique et en liaison avec les représentations initiales <strong>de</strong>s élèves sera donc<br />
complémentaire, soit en préa<strong>la</strong>ble, soit à l’occasion du travail sur les documentaires.<br />
Faut-il faire travailler <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse sur un ou plusieurs livres ? Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> diversité, <strong>de</strong> liberté <strong>de</strong> choix,<br />
<strong>de</strong> richesse <strong>de</strong> recherche et d’analyse permettant <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong> l’information par <strong>la</strong> mise en réseau, il<br />
semble que plusieurs ouvrages soient préférables.<br />
Analyse du document :<br />
-Travailler par petits groupes, avec plusieurs livres <strong>de</strong> thème(s) comparable(s).<br />
-Faire circuler les livres parmi les groupes qui choisissent ensuite un titre. Les enfants peuvent-ils<br />
expliquer leur choix ?<br />
Retenir quelques critères qui pourront être intégrés à <strong>la</strong> fiche d’analyse.<br />
-A partir du titre du livre, faire réfléchir et argumenter sur les représentations globales <strong>de</strong>s élèves.<br />
- Analyse <strong>de</strong> l’image à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> première <strong>de</strong> couverture et/ou d’une double page illustrant <strong>la</strong><br />
thématique choisie par <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse :<br />
Lecture <strong>de</strong> l’image par <strong>de</strong>scription orale et confrontation <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> l’enfant et <strong>de</strong><br />
l’auteur/illustrateur du document, <strong>de</strong> manière à contrer immédiatement les erreurs possibles et faire<br />
comprendre que les illustrateurs <strong>de</strong>s ouvrages ont aussi représenté leur propre préhistoire.<br />
<strong>La</strong> comparaison et <strong>la</strong> démarche <strong>de</strong> vérification <strong>de</strong>s informations apportées par les images peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />
une recherche sur l’origine <strong>de</strong> ces images, qui font partie <strong>de</strong> l’histoire <strong>de</strong> l’archéologie. Un spécialiste <strong>de</strong><br />
33
cette approche a un rôle à jouer dans <strong>la</strong> compréhension <strong>de</strong> <strong>la</strong> vulgarisation (voir les images du 19 ème<br />
siècle en ligne sur www.pole-prehistoire.com).<br />
Retenir quelques critères qui pourront être intégrés à <strong>la</strong> fiche d’analyse.<br />
Eventuellement, établissement <strong>de</strong> critères d’alerte transposables, comme l’absence <strong>de</strong> photographies (se<br />
servir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fiche d’analyse documentaire et <strong>de</strong> sa bibliographie, ainsi que <strong>de</strong> <strong>la</strong> bibliographie d’Arras).<br />
Eventuelle restitution écrite.<br />
- Travail sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion image/texte et sur le texte : légen<strong>de</strong>s, chapitres et sous-chapitres, texte<br />
général.<br />
Etudier <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> l’image par rapport au texte (redondante…).<br />
Favoriser <strong>la</strong> manipu<strong>la</strong>tion et le repérage par <strong>la</strong> familiarisation avec le péritexte (auteurs, sommaire,<br />
glossaire…) à partir du texte (vérifier si les titres <strong>de</strong>s chapitres correspon<strong>de</strong>nt à leur contenu, s’il existe un<br />
glossaire lors <strong>de</strong> <strong>la</strong> rencontre <strong>de</strong> termes scientifiques, à quelle partie du sommaire correspond <strong>la</strong> double<br />
page consultée, si ce sommaire est compréhensible sans préa<strong>la</strong>bles, s’il s’agit d’une traduction …).<br />
On peut se baser sur les questions posées dans <strong>la</strong> fiche d’analyse documentaire (adultes) pour lister les<br />
points à étudier.<br />
Retenir quelques critères qui pourront être intégrés à <strong>la</strong> fiche d’analyse.<br />
Eventuellement, établissement <strong>de</strong> critères d’alerte transposables : souligner les erreurs éventuelles<br />
relevées, vocabu<strong>la</strong>ire utilisé en fonction du type <strong>de</strong> texte annoncé (découverte ou approfondissement),<br />
image <strong>de</strong>s connaissances à un moment donné (date d’édition)….<br />
Etablir un parallèle entre les représentations <strong>de</strong>s enfants et celles <strong>de</strong> l’auteur et vali<strong>de</strong>r un choix.<br />
Les critères <strong>de</strong> choix d’un document ont-ils évolués, se sont-ils enrichis, sont-ils transposables à d’autres<br />
thématiques, aux revues ?<br />
Restitutions possibles :<br />
- Fiche listant les critères d’alerte dans <strong>la</strong> lecture d’un documentaire (confusion dans le temps, absence <strong>de</strong><br />
photographies…)<br />
- Constitution d’un « bêtisier <strong>de</strong> <strong>la</strong> préhistoire », un inventaire <strong>de</strong>s stéréotypes.<br />
- Le livre idéal est il possible ou souhaitable ? Débat à partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> réalisation d’une page sur le thème.<br />
Comparaison <strong>de</strong>s pages produites avec celles <strong>de</strong>s livres étudiés, favorisant une re<strong>la</strong>tivisation du statut<br />
d’auteur.<br />
- Réalisation d’une fiche d’analyse terminale, qui peut s’articuler autour <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> choix.<br />
- Réalisation d’une fiche évolutive, qui permettra <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r trace <strong>de</strong>s représentations successives et <strong>de</strong><br />
vérifier si les représentations initiales ont été mises en cause en fin <strong>de</strong> parcours.<br />
34
POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UN OBJET<br />
Serge MAURY (conservateur et archéologue) et Yann MALHACHE (Médiateur du Patrimoine)<br />
Encore aujourd’hui, à l’exception <strong>de</strong> quelques nouvelles muséographies, les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> présentation<br />
<strong>de</strong>s objets archéologiques restent très c<strong>la</strong>ssiques. Amorphes, décontextualisés, privés <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance<br />
dont ils sont porteurs, <strong>de</strong> leur dynamique <strong>de</strong> fabrication et <strong>de</strong> leur mo<strong>de</strong> éventuel d’utilisation, ces objets<br />
n’ont, <strong>de</strong> surcroît, le droit d’être exposés dans une vitrine <strong>de</strong> musée que lorsqu’ils sont représentatifs <strong>de</strong><br />
« leur catégorie». A leurs pieds, <strong>la</strong> lecture d’une épitaphe avec un nom et une date « grattoir sur <strong>la</strong>me<br />
Magdalénien, aux environs <strong>de</strong> 15000 ans » fige leur image <strong>la</strong>isse peu <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ce au questionnement.<br />
L’atelier proposé dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation PNR avait pour but <strong>de</strong> casser ce modèle, en<br />
postu<strong>la</strong>nt que l’objet existe uniquement s’il est porteur <strong>de</strong> questionnement. Nous avons tenté <strong>de</strong> montrer<br />
que :<br />
• Bien plus que <strong>la</strong> seule fonction supposée <strong>de</strong> l’objet exposé, l’intérêt <strong>de</strong> celui-ci rési<strong>de</strong><br />
surtout dans ce qu’il peut nous raconter <strong>de</strong> <strong>la</strong> vie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> structuration <strong>de</strong> <strong>la</strong> société et <strong>de</strong>s<br />
hommes qui l’ont fabriqué.<br />
• Cette histoire peut être racontée <strong>de</strong> manière différente mais complémentaire selon l’orateur<br />
: scientifiques, techniciens, géologues ou encore par ceux dont le savoir est habituellement<br />
considéré comme «vulgaire» c'est-à-dire le public directement.<br />
• Cette histoire évolue au rythme <strong>de</strong> nouvelles découvertes, <strong>de</strong> nouvelles hypothèses, elle est<br />
ainsi complétée, corrigée, remise en cause en permanence.<br />
C’est aussi <strong>la</strong> question <strong>de</strong>s représentations <strong>de</strong> l’objet qui a été abordée : qu’est-il vraiment ? <strong>La</strong><br />
représentation que l’on se fait aujourd’hui d’un burin par exemple, ou un objet fonctionnel différent <strong>de</strong> ce que<br />
l’on imaginait ? Il faut s’abstraire du déterminisme <strong>de</strong> l’objet, mettre <strong>de</strong> coté nos images, nos préjugés,<br />
essayer afin <strong>de</strong> ne négliger aucune piste, d’avoir un regard neuf et distancié.<br />
Nous avons mené pendant <strong>de</strong>ux heures une investigation, afin <strong>de</strong> faire émerger <strong>de</strong>s<br />
problématiques autour <strong>de</strong> <strong>la</strong> reconstitution <strong>de</strong> l’histoire d’un objet.<br />
Les participants ont choisi dans l’ensemble <strong>de</strong> fac-similés d’objets archéologiques (bifaces,<br />
grattoirs…) proposés, un petit objet rouge d’environ 5 cm et ils l’ont soumis à un interrogatoire en règle.<br />
Nous l’avons <strong>de</strong>ssiné sous toutes ses faces. Nous avons cherché :<br />
à savoir s’il portait à sa surface : <strong>de</strong>s traces <strong>de</strong> fabrication, <strong>de</strong> façonnage et d’usage,<br />
liées à <strong>de</strong>s actions humaines et <strong>de</strong> qualifier mécaniquement et physiquement ces traces.<br />
à déterminer : sa nature ; <strong>la</strong> culture à <strong>la</strong>quelle il pourrait appartenir, donc son âge ;<br />
sa provenance, le pourquoi <strong>de</strong> sa couleur ? Etait- ce un outil ? Si oui était-il<br />
emmanché ? « Il est pointu, a-t-il servi à percer ? » Sa couleur impliquerait-elle un<br />
traitement particulier (thermique ?) ? Ce traitement est il intentionnel ? Si oui pourquoi ? A-til<br />
été appliqué avant ou après son façonnage?..........<br />
Après avoir posé toutes ces questions et bien d’autres, sans évi<strong>de</strong>mment apporter toutes les<br />
réponses nous avons listé les moyens et les ressources que nous avions et/ou qu’il faudrait mettre en œuvre<br />
pour y répondre. Ce questionnement nous a rapproché <strong>de</strong> <strong>la</strong> démarche « hypothético-déductive » et permis<br />
<strong>de</strong> répertorier une partie du <strong>la</strong>rge éventail <strong>de</strong>s métiers et <strong>de</strong>s spécialités qui interviennent dans l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
traces du passé.<br />
35
Ainsi à travers ce petit bout <strong>de</strong> matière pourpre, nous avons abordé successivement : <strong>la</strong> géographie,<br />
<strong>la</strong> géologie 1 , <strong>la</strong> pétrographie 2 , <strong>la</strong> tracéologie 3 , <strong>la</strong> technologie 4 et l’archéologie expérimentale. Nous avons<br />
montré comment l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’origine <strong>de</strong>s matières premières lithiques (lithologie) utilisées pour façonner cet<br />
objet nous permettait <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce l’espace parcouru par l’homme, <strong>la</strong> socio économie <strong>de</strong>s<br />
groupes, et l’exploitation du milieu. (Certains types <strong>de</strong> silex, <strong>de</strong> bonne qualité, facilement i<strong>de</strong>ntifiables et<br />
ayant une origine géographique et géologique précise, comme les silex du « Bergeracois » ou « du<br />
Fumelois » ont une diffusion qui recouvre pratiquement <strong>la</strong> totalité du bassin aquitain. Les transports sur <strong>de</strong><br />
longues distances pourraient correspondre, en partie, à <strong>de</strong>s échanges.) Nous avons également évoqués <strong>la</strong><br />
paléontologie avec les microfossiles marins contenus dans le silex, <strong>la</strong> micromorphologie, et sommes rentré<br />
dans le détail <strong>de</strong> sciences très pointues comme les datations par thermoluminescences. Enfin nous avons<br />
fait un crochet par les sciences sociales telles que l’ethnologie et <strong>la</strong> sociologie. En bref nous avons abordé<br />
l’archéologie dans toute sa pluridisciplinarité.<br />
En conclusion même si l’archéologie est absente <strong>de</strong>s programmes sco<strong>la</strong>ires elle reste une véritable<br />
« mine » <strong>de</strong> par son contenu pluridisciplinaire. Elle est un excellent moyen <strong>de</strong> fournir <strong>de</strong>s cas concrets et<br />
passionnants pour mener <strong>de</strong>s projets <strong>pédagogiques</strong> transdisciplinaires vivants et dynamiques, adaptés aux<br />
problématiques les plus diverses.<br />
Enfin n’oublions pas que d’ici quelques dizaines d’années, peut être même avant ce petit objet, que<br />
nous avons, grâce à un faisceau convergent d’indices reconnu comme un perçoir, sera peut être, au vue <strong>de</strong><br />
l’avancement <strong>de</strong>s moyens d’analyse, réexaminé, revisité et encore mieux documenté.<br />
---------------------------------------------------------<br />
1 Le silex est une roche sédimentaire, formée à l'intérieur du calcaire. Un échantillon <strong>de</strong> silex présente, le<br />
plus souvent, <strong>de</strong>s caractéristiques qui permettent <strong>de</strong> le rattacher à l'étage géologique dans lequel il s'est<br />
formé. <strong>La</strong> carte géologique indique les endroits où affleurent l'étage. On détermine ainsi une aire<br />
géographique à l'intérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong>quelle les hommes ont pu collecter le silex. Les raisonnements sont conduits<br />
en considérant l'origine <strong>la</strong> plus proche .Une fois l'origine géologique déterminée, l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> répartition <strong>de</strong>s<br />
affleurements permet <strong>de</strong> proposer une origine géographique. En croisant ces données avec celles <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
technologie lithique, il est possible <strong>de</strong> déterminer à quels niveaux <strong>de</strong> transformation les objets ont été<br />
introduits dans le gisement : bloc brut, préforme, support, produit<br />
2 Pétrographie Science qui décrit les roches et étudie leurs structures et leur composition<br />
3 L'analyse tracéologique permet <strong>de</strong> préciser <strong>la</strong> fonction <strong>de</strong>s outils à partir <strong>de</strong>s traces d'usure qu'ils portent,<br />
par comparaison avec <strong>de</strong>s répliques expérimentales dont on connaît précisément l'utilisation.<br />
4 <strong>La</strong> lecture technologique permet <strong>de</strong> reconstituer <strong>la</strong> totalité <strong>de</strong> <strong>la</strong> séquence <strong>de</strong> production <strong>de</strong>s outils. En<br />
effet, chaque éc<strong>la</strong>t porte, sur <strong>la</strong> face opposée à <strong>la</strong> surface d'éc<strong>la</strong>tement, les traces <strong>de</strong>s enlèvements<br />
précé<strong>de</strong>nts. L'observation <strong>de</strong> chaque éc<strong>la</strong>t permet <strong>de</strong> reconstituer <strong>la</strong> séquence <strong>de</strong>s gestes qui ont précédé<br />
son propre détachement. De proche en proche, il est possible <strong>de</strong> reconstituer les chaînes opératoires <strong>de</strong><br />
production <strong>de</strong>s outil<strong>la</strong>ges et <strong>de</strong> comprendre les métho<strong>de</strong>s é<strong>la</strong>borées par les hommes préhistoriques.<br />
Pour tous renseignements complémentaires concernant l’archéologie et les sciences connexes qui<br />
lui sont liées nous vous invitons à consulter notre site internet : www.perigord.tm.fr ou www.cg24.fr<br />
36