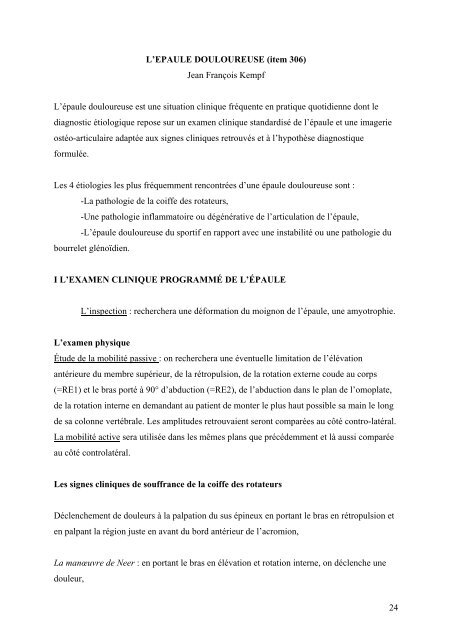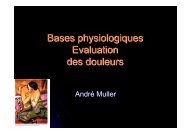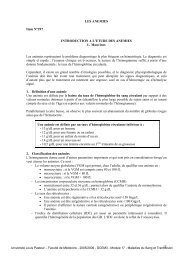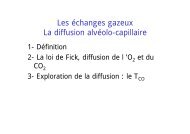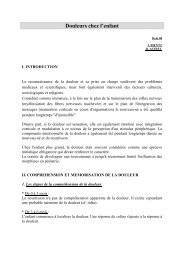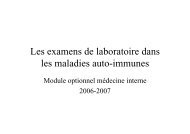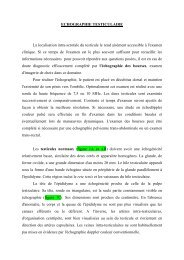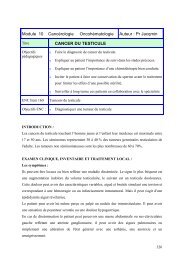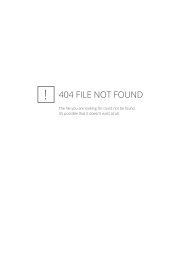24 L'EPAULE DOULOUREUSE (item 306) Jean François Kempf L ...
24 L'EPAULE DOULOUREUSE (item 306) Jean François Kempf L ...
24 L'EPAULE DOULOUREUSE (item 306) Jean François Kempf L ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’EPAULE <strong>DOULOUREUSE</strong> (<strong>item</strong> <strong>306</strong>)<br />
<strong>Jean</strong> <strong>François</strong> <strong>Kempf</strong><br />
L’épaule douloureuse est une situation clinique fréquente en pratique quotidienne dont le<br />
diagnostic étiologique repose sur un examen clinique standardisé de l’épaule et une imagerie<br />
ostéo-articulaire adaptée aux signes cliniques retrouvés et à l’hypothèse diagnostique<br />
formulée.<br />
Les 4 étiologies les plus fréquemment rencontrées d’une épaule douloureuse sont :<br />
-La pathologie de la coiffe des rotateurs,<br />
-Une pathologie inflammatoire ou dégénérative de l’articulation de l’épaule,<br />
-L’épaule douloureuse du sportif en rapport avec une instabilité ou une pathologie du<br />
bourrelet glénoïdien.<br />
I L’EXAMEN CLINIQUE PROGRAMMÉ DE L’ÉPAULE<br />
L’inspection : recherchera une déformation du moignon de l’épaule, une amyotrophie.<br />
L’examen physique<br />
Étude de la mobilité passive : on recherchera une éventuelle limitation de l’élévation<br />
antérieure du membre supérieur, de la rétropulsion, de la rotation externe coude au corps<br />
(=RE1) et le bras porté à 90° d’abduction (=RE2), de l’abduction dans le plan de l’omoplate,<br />
de la rotation interne en demandant au patient de monter le plus haut possible sa main le long<br />
de sa colonne vertébrale. Les amplitudes retrouvaient seront comparées au côté contro-latéral.<br />
La mobilité active sera utilisée dans les mêmes plans que précédemment et là aussi comparée<br />
au côté controlatéral.<br />
Les signes cliniques de souffrance de la coiffe des rotateurs<br />
Déclenchement de douleurs à la palpation du sus épineux en portant le bras en rétropulsion et<br />
en palpant la région juste en avant du bord antérieur de l’acromion,<br />
La manœuvre de Neer : en portant le bras en élévation et rotation interne, on déclenche une<br />
douleur,<br />
<strong>24</strong>
La manœuvre de Hawkins : le bras est porté à 90° d’élévation antérieure et l’examinateur<br />
imprime un mouvement en rotation interne qui déclenche une douleur,<br />
La manœuvre de Yocum : le patient porte sa main sur l’épaule contro-latérale et on lui<br />
demande d’élever le coude le plus haut possible ce qui déclenche une douleur.<br />
Ces trois signes lorsqu’ils sont positifs témoignent d’une souffrance de la coiffe des rotateurs<br />
qu’il y ait rupture ou non.<br />
Les signes de rupture de la coiffe des rotateurs sont :<br />
La manœuvre de Jobe :on demande au patient de faire une élévation dans le plan de<br />
l’omoplate c’est-à-dire à 30° d’antépulsion et ceci contre-résistance en comparant du côté<br />
contro-latéral. Un déficit de la force et spécifique d’une rupture du sus épineux,<br />
Rupture du sous épineux : on demande au patient de faire une<br />
rotation externe coude au corps contre-résistance (RE1) ou encore<br />
de faire la même rotation externe à 90° d’abduction (RE2) : un<br />
déficit témoigne d’une atteinte du sous<br />
épineux et/ou du petit rond,<br />
Atteinte du sous scapulaire : le test de<br />
Gerber : on demande au patient de mettre la<br />
25
main dans le dos le plus haut possible puis de décoller le dos de sa main de son dos : en cas<br />
d’impossibilité d’effectuer une rotation interne le test est positif et témoigne d’une rupture du<br />
sous scapulaire.<br />
Si cette manœuvre est trop douloureuse, on peut réaliser le Press Belly test :On demande au<br />
patient de mettre la main sur le ventre et de porter vers l’avant son coude : s’il ne peut le faire,<br />
cela témoigne d’une rupture du sous scapulaire.<br />
II LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES<br />
Ceux-ci seront dictés par l’examen clinique. Des radiographies standard sont toujours<br />
nécessaires : une face de l’épaule le bras en rotation neutre puis en rotation interne et en<br />
rotation externe, un profil axillaire et un profil de l’omoplate appelé profil de Lamy.<br />
Une imagerie plus sophistiquée sera indiquée dans certaine pathologie : arthroscanner ou<br />
IRM.<br />
III LA PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS<br />
La coiffe des rotateurs est constituée du tendon du supra spinatus, de l’infra spinatus et du<br />
tersminor en arrière, et du sous scapulaire en avant. Entre le supra spinatus et le sous<br />
scapulaire, chemine le long biceps qui peut être le siège lui aussi d’une pathologie.<br />
LA CLASSIFICATION DE LA PATHOLOGIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS :<br />
Les calcifications,<br />
Les tendinopathies non calcifiées et non rompues de la coiffe des rotateurs,<br />
Les ruptures partielles ou complète de la coiffe des rotateurs,<br />
Les tendinopathies du long biceps.<br />
Les calcifications de la coiffe des rotateurs<br />
Elles sont représentées par un dépôt calcique au sein de l’un des tendons de la coiffe des<br />
rotateurs, le supra spinatus étant de loin le plus souvent touché.<br />
26
Il s’agit d’une pathologie bénigne susceptible de cicatriser et dont l’histoire naturelle aboutie<br />
dans l’immense majorité des cas à la résorption et à la guérison spontanée.<br />
Sur le plan clinique, le patient peu se plaindre de douleurs chroniques de son épaule de siège<br />
plutôt antérieur ou externe. Toutes les manœuvres de conflit sont positives à l’examen<br />
clinique, mais il n’y a pas de signe témoignant d’une rupture<br />
(manœuvre de Jobe par exemple).<br />
L’autre tableau clinique beaucoup plus expressif est la crise<br />
hyper algique de l’épaule : il s’agit d’une douleur lancinante,<br />
insomniante, résistant volontiers médical. Cette crise hyper<br />
algique correspond la plupart du temps à la libération dans la<br />
bourse sous acromial de cristaux calciques qui déclenchent une<br />
bursite micro cristalline.<br />
Ces calcifications touchent plutôt les femmes que les hommes, entre 40 et 50 ans.<br />
Le diagnostic repose sur la radiographie standard qui objective le dépôt calcique.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent est avant tout médical, mise aux repos, antiinflammatoires,<br />
glace et éventuellement une infiltration<br />
sous acromial d’un mélange d’anesthésique local et de<br />
corticoïde.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent chirurgical n’est indiqué que chez les patients résistants au tra<strong>item</strong>ent médical et<br />
dont la pathologie évolue depuis plus de 6 mois. Il repose à l’heure actuelle sur l’exérèse<br />
endoscopique de la calcification.<br />
Les tendinopathies non rompues et non calcifiées de la coiffe des rotateurs<br />
Parfa<strong>item</strong>ent décrites par Neer en 1972, elles sont très souvent appelées épaules douloureuses<br />
par conflit sous acromial. En réalité, la souffrance tendineuse chronique du supra spinatus<br />
s’explique par 4 causes qui interviennent à des degrés variables :<br />
-Une cause vasculaire : on sait depuis longtemps que la portion terminale du sus épineux est<br />
une zone mal vascularisée et particulièrement fragile,<br />
-Une cause dégénérative : le vieillissement normal des tendons de cette articulation<br />
particulièrement sollicitée,<br />
27
-Une cause traumatique qu’il s’agisse d’un traumatisme vrai ou<br />
d’une surcharge tendineuse par hyper utilisation de l’épaule chez<br />
les sportifs ou chez certains travailleurs manuels,<br />
-Une cause mécanique et anatomique : c’est-à-dire le conflit entre<br />
le supraspinatus et la voûte ostéo-ligamentaire acromiocoracoïdienne<br />
c’est-à-dire le bord antérieur de l’acromion et le<br />
ligament acromio-coracoïdien.<br />
Sur le plan clinique, ces patients présentent une douleur chronique survenant à l’usage de<br />
leurs membres supérieurs mais aussi au repos voir la nuit. Tous les signes de conflits sont<br />
positifs, mais il n’y a pas de signe de rupture de la coiffe des rotateurs. La radiographie<br />
standard permet surtout d’analyser la forme de l’acromion et d’objectiver sur le profil de<br />
Lamy un acromion courbé voir crochu, agressif pour la coiffe sous jacente.<br />
A priori, il n’est pas nécessaire de demander une imagerie complémentaire à moins que l’on<br />
ne craigne une rupture.<br />
Sur le plan thérapeutique, un tra<strong>item</strong>ent médical s’impose pendant au moins 6 mois. Il<br />
comportera un tra<strong>item</strong>ent anti-inflammatoire, 2 ou 3 infiltrations en sous acromial, la mise au<br />
repos de l’articulation et enfin une kinésithérapie spécialisée pour apprendre au patient à<br />
éviter le conflit entre sa coiffe et la voûte osseuse sus jacente par le travail des muscles<br />
abaisseurs de l’épaule.<br />
Si ce tra<strong>item</strong>ent n’est pas<br />
suffisant, il est alors indiqué de<br />
proposer au patient une<br />
acromioplastie sous arthroscopie.<br />
Cette technique consiste à aplanir<br />
à l’aide d’une fraise motorisée<br />
l’acromion et de supprimer sa<br />
forme courbe agressive pour le<br />
tendon et d’autre part à section le ligament acromio-coracoïdien.<br />
28
Les ruptures de la coiffe des rotateurs<br />
Il peut s’agir de ruptures partielles ou complètes.<br />
Les ruptures partielles de la coiffe des rotateurs,<br />
peuvent porter sur la face superficielle, boursale du<br />
sus épineux, sur sa face profonde, articulaire ou encore être de siège intra-tendineux.<br />
Le tableau clinique est très proche du conflit sous acromial sans<br />
rupture décrit précédemment. L’imagerie peut là être utile :<br />
arthroscanner qui permettra de retrouver une rupture de la face<br />
profonde sous la forme d’une petite image d’addition du produit<br />
de contraste mais sans passage de celui-ci dans la bourse sous<br />
acromial ou encore IRM qui objectivera la lésion soit<br />
superficielle soit profonde soit intra-tendineuse.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent repose sur le même schéma thérapeutique que<br />
précédemment : tra<strong>item</strong>ent médical et en cas d’échec<br />
acromioplastie sous arthroscopie, plus rarement si la profondeur de la lésion partielle dépasse<br />
50% une suture endoscopique y est associée.<br />
Les ruptures complètes de la coiffe des rotateurs<br />
Par définition, ces lésions entraînent des signes déficitaires c’est-à-dire qu’en fonction du<br />
tendon atteint, l’un ou plusieurs des signes précédemment décrits (manœuvre de Jobe, rotation<br />
externe contrariée, manœuvre de Gerber) seront positifs.<br />
Cette épaule douloureuse doit alors être explorée par une imagerie complémentaire :<br />
arthroscanner ou IRM.<br />
L’arthroscanner a pour l’instant notre préférence car il permet parfa<strong>item</strong>ent d’analyser le siège<br />
de la rupture : supra spinatus, infra spinatus, teres-minor, sous scapulaire.<br />
Mais il permettra aussi d’analyser le degré de rétraction du tendon :<br />
-Celui-ci peut être proche de son insertion sur le trochiter : il s’agit d’une rupture distale,<br />
(stade I de Bernageau),<br />
-Moignon tendineux à l’apex de la tête humérale : il s’agit d’une rupture intermédiaire (stade<br />
II de Bernageau)<br />
29
- Et enfin moignon, tendineux à l’aplomb de la glène : il s’agit d’une rupture rétractée stade<br />
III de Bernageau.<br />
L’arthroscanner permettra aussi d’analyser la trophicité musculaire en recherchant une<br />
infiltration graisseuse qui se traduit par une zone noire au sein du muscle qui est gris. Plus<br />
l’infiltration graisseuse est importante plus le muscle est de mauvaise qualité et moins il est<br />
susceptible de récupérer si on décide de réparer la coiffe des rotateurs.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent clinique dépens énormément de l’âge du patient, de sa demande fonctionnelle,<br />
de sa motivation et de la trophicité tendineuse et musculaire.<br />
Schématiquement, un tra<strong>item</strong>ent médical sera plus volontiers proposé à un patient âgé de plus<br />
de 60 ans, à faible demande fonctionnelle et ce d’autant plus que les lésions sont évoluées<br />
avec rétraction, atrophie tendineuse ou<br />
dégénérescence musculaire. À l’opposée, plus le<br />
patient est jeune, plus la lésion est récente, avec un<br />
moignon tendineux de bonne qualité, une faible<br />
dégénérescence graisseuse et une faible rétraction,<br />
plus on sera enclin à proposer une réparation<br />
chirurgicale de cette rupture. Il est actuellement<br />
prouvé, toutes choses égales par ailleurs, que la réparation d’une rupture de la coiffe des<br />
rotateurs donnera de meilleurs résultats que l’abstention chirurgicale ou l’acromioplastie.<br />
Cette réparation se fait le plus souvent maintenant sous arthroscopie.<br />
Néanmoins, cette intervention chirurgicale a des suites plus longues, et n’a de bonnes chances<br />
de succès que si les conditions anatomiques locales sont satisfaisantes (trophicité tendineuse,<br />
dégénérescence graisseuse, rétraction faible).<br />
Les tendinopathies du long biceps<br />
On évoque ce diagnostic devant des douleurs souvent<br />
importantes exacerbées par la palpation de la gouttière<br />
bicipitale ou encore lors de la manœuvre du Palm up test : on<br />
demande au patient de porter son bras en rotation externe<br />
élévation antérieure contre-résistance ce qui déclenche une<br />
douleur antérieure. Le biceps peut alors être le siège soit d’une<br />
inflammation (téno-synovite) soit d’une pathologie<br />
30
dégénérative, plus volontiers rencontrée lorsqu’il existe une rupture associée de la coiffe des<br />
rotateurs.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent médical prime en cas de téno-synovite du long biceps et comportera une ou<br />
plusieurs infiltrations.<br />
Lorsque cette pathologie du long biceps survient dans le contexte d’une rupture de la coiffe<br />
des rotateurs, un tra<strong>item</strong>ent chirurgical est préférable : la ténotomie du long biceps ou la<br />
ténodèse celui-ci dans la gouttière bicipitale, a un effet antalgique remarquable.<br />
IV L’ÉPAULE DÉGÉNÉRATIVE OU INFLAMMATOIRE<br />
L’omarthrose<br />
L’arthrose de l’articulation gléno-humérale est infiniment moins fréquente que l’arthrose du<br />
genou ou de la hanche. Elle est par contre particulièrement douloureuse et invalidante.<br />
Schématiquement, ces omarthroses sont classées en 3 groupes :<br />
-L’omarthrose post-traumatique.<br />
-L’omarthrose centrée : la tête humérale<br />
reste centrée en face de la glène car il n’y a<br />
pas d’atteinte ou peu d’atteinte<br />
concomitante de la coiffe des rotateurs,<br />
-L’omarthrose excentrée : la tête humérale<br />
migre vers le haut et vient rentrer en<br />
contact avec l’acromion en raison d’une<br />
rupture massive de la coiffe des rotateurs,<br />
Un tra<strong>item</strong>ent médical est toujours proposé en premier à ces patients visant à obtenir la<br />
meilleure antalgie possible (AINS, infiltrations, antalgiques).<br />
31
Le tra<strong>item</strong>ent chirurgical repose essentiellement sur la prothèse totale d’épaule qui apportera<br />
un excellent résultat antalgique dans<br />
tous les cas. Sur le plan fonctionnel,<br />
les résultats dépendent essentiellement<br />
de l’état de la coiffe des rotateurs. Ils<br />
seront bons et excellents lorsqu’il<br />
n’y a pas de rupture, ils ne pourront être<br />
que moyens en cas de rupture associée<br />
de la coiffe des rotateurs.<br />
L’ostéonécrose aseptique de la tête humérale<br />
Cette ostéonécrose bien que moins fréquente qu’à la hanche est assez fréquente. On lui<br />
retrouve les mêmes facteurs favorisant qu’au niveau de l’articulation coxo-fémorale<br />
(alcoolisme, tra<strong>item</strong>ent immuno suppresseur ou aux corticoïdes, etc).<br />
On lui décrit 5 stades :<br />
- Le stade I correspond à la phase pré-radiologique où les radiographies sont normales et où<br />
seule la scintigraphie ou la RMN sont capables d’en faire le diagnostic,<br />
- Le stade II se traduit radio logiquement par une ostéoporose de la tête humérale associée à<br />
une ligne de sclérose mais sans déformation de la tête,<br />
- Le stade III se traduit par une image de fracture<br />
sous chondral détachant un fragment de la calotte<br />
céphalique qui commence à se déformer,<br />
- Le stade IV se traduit par un effondrement<br />
évident de la tête humérale,<br />
- Le stade V correspond au stade IV associé à des<br />
images de remaniements de la glène c’est-à-dire<br />
en fait à une ostéo-arthrose secondaire de<br />
l’articulation gléno-humérale.<br />
32
Si le tra<strong>item</strong>ent médical symptomatique ne suffit pas à soulager le patient, le tra<strong>item</strong>ent<br />
reposera sur la mise en place d’une prothèse humérale simple pour les stades II et III et sur<br />
une prothèse totale pour les stades IV et V.<br />
Les atteintes inflammatoires de l’épaule<br />
Si de nombreuses maladies<br />
inflammatoires peuvent comporter une<br />
localisation à l’épaule, la<br />
polyarthrite rhumatoïde est de loin<br />
l’étiologie principale de ce groupe.<br />
Au début, l’atteinte est purement<br />
synoviale et il n’y a pas de remaniement<br />
visible à la radiographie. À ce stade, une<br />
action sur la synoviale par<br />
synoviorthèse ou synovectomie<br />
chirurgicale arthroscopique peut être<br />
proposée au patient.<br />
Lorsque la maladie continue à évoluer, survient des atteintes destructives portant sur le<br />
cartilage et l’os sous chondral de la tête humérale et de la glène. À partir du moment où les<br />
destructions ostéo-cartilagineuses s’installent, 3 aspects radiologiques peuvent être<br />
objectivés : une forme concentrique où la tête reste en regard de la glène mais l’interligne se<br />
pince progressivement, une forme ascendante qui est l’aspect le plus fréquent où la tête<br />
humérale a tendance à migrer progressivement vers le haut tout en s’usant et enfin il existe<br />
une forme destructive, particulièrement difficile à traiter où la tête humérale perd sa<br />
sphéricité, est le siège d’érosion en particulier polaire supérieur qui lui donne un aspect en<br />
bouchon de champagne.<br />
L’évolution de cette maladie se fait aussi vers la destruction progressive de la coiffe des<br />
rotateurs. Cette rupture aggravera le handicap fonctionnel du patient et compliquera son<br />
tra<strong>item</strong>ent chirurgical.<br />
Celui-ci repose essentiellement sur la mise en place d’une prothèse totale d’épaule. La<br />
stratégie thérapeutique se fait toujours de concert avec le médecin rhumatologue car s’il ne<br />
33
faut pas prothéser trop vite ces patients souvent jeunes, il ne faut pas non plus attendre de trop<br />
car lorsque les destructions osseuses et surtout lorsque les lésions de la coiffe sont installées le<br />
résultat fonctionnel que l’on pourra obtenir sera nettement moins bon.<br />
V L’ÉPAULE <strong>DOULOUREUSE</strong> DU SPORTIF<br />
Le contexte est ici complètement différent : il s’agit de patients jeunes, en bonne santé,<br />
pratiquant un sport comportant l’usage du membre supérieur de façon fréquente et répétée et<br />
exposé bien sûr à des traumatismes. Schématiquement, 2 grands groupes peuvent être isolés<br />
dans cette rubrique : les instabilités de l’épaule et la pathologie du bourrelet glénoïdien.<br />
L’instabilité de l’épaule<br />
Toute instabilité de l’épaule peut entraîner des douleurs à l’usage du membre supérieur et<br />
surtout lors de la pratique sportive. L’instabilité de l’épaule est classée en fonction de la<br />
direction du déplacement de la tête humérale par rapport à la glène : instabilité antérieure : de<br />
loin la plus fréquente, instabilité postérieure, instabilité inférieure.<br />
Cette instabilité peut être d’origine traumatique ou au contraire être atraumatique, elle peut se<br />
traduire par une luxation de la tête humérale qui perd alors tout contact et tout rapport<br />
anatomique avec la glène, une subluxation qui correspond à une perte transitoire des rapports<br />
anatomiques normaux avec réintégration de la tête humérale dans la cavité glénoïdienne soit<br />
spontanément soit par le patient lui-même. L’instabilité enfin peut se traduire par une simple<br />
douleur par exemple à l’armée du bras (smatch, lancé etc.) : c’est l’épaule douloureuse par<br />
instabilité<br />
L’instabilité antérieure de l’épaule<br />
Celle-ci est de loin la situation clinique la plus<br />
fréquente. Elle est presque toujours d’origine<br />
traumatique et une première luxation ou<br />
subluxation survient dans ce contexte. Puis le<br />
patient après un intervalle libre plus ou moins<br />
long, décrit d’autres épisodes d’instabilité mais cette fois alors qu’il n’y a pas nécessairement<br />
de traumatisme ou un traumatisme modéré : nous sommes alors en présence d’une instabilité<br />
chronique antérieure récidivante.<br />
34
L’examen clinique recherchera les signes spécifiques<br />
d’instabilité antérieure : tiroir antérieur, appréhension, lors du<br />
mouvement d’adduction rotation externe c’est-à-dire lors du<br />
mouvement d’armer du bras.<br />
La luxation récidivante est toujours de tra<strong>item</strong>ent chirurgical : il s’agira de procéder à la<br />
réparation de la lésion capsulo-ligamentaire antéro-inférieure qui est la cause principale de la<br />
récidive par une suture de ces structures capsulo-ligamentaires au bord antérieur de la glène,<br />
soit à ciel ouvert soit arthroscopiquement ou par une intervention appelée butée osseuse préglénoïdienne.<br />
Les instabilités postérieures<br />
Elles sont beaucoup plus rares et se traduisent le plus souvent par des subluxations<br />
postérieures qui sont douloureuses. Lorsqu’elles surviennent dans un contexte traumatique,<br />
qu’il n’y a pas d’hyperlaxité constitutionnelle, elles relèvent d’un tra<strong>item</strong>ent chirurgical :<br />
plastie capsulaire postérieure ou butée osseuse postérieure.<br />
Les hyper laxités constitutionnelles :<br />
35
Ce groupe doit être connu car les patients consultent volontiers pour des douleurs de l’épaule.<br />
Il s’agit presque toujours de jeunes, plus souvent des filles que des garçons, de moins de 20<br />
ans, qui présentent une hyper laxité constitutionnelle existante à d’autres articulations (coude,<br />
poignet, doigt, colonne) et qui sont capables volontairement de subluxer vers l’avant, vers<br />
l’arrière ou encore vers le bas leur épaule. Dans ce contexte, il existe souvent des<br />
perturbations psychologiques associées dont l’hyperlaxité n’est qu’un symptôme. Ces jeunes<br />
patients ne relèvent donc jamais d’un tra<strong>item</strong>ent chirurgical mais d’une prise en charge à la<br />
fois psychologique et kinésithérapique pour renforcer les muscles de la ceinture scapulaire. En<br />
règle général, tout rentre dans l’ordre à la fin de l’adolescence.<br />
Il est des formes beaucoup moins fréquentes d’hyper laxité multidirectionnelle qui ne<br />
deviennent douloureuses qu’après un traumatisme avec luxation en avant ou en arrière. Il<br />
s’agit alors de patient plus âgé, souvent très sportifs, et dans ces formes traumatiques et non<br />
volontaires d’instabilité multidirectionnelle, il peut alors être indiqué de réaliser un geste<br />
chirurgical de stabilisation : la capsulorraphie, visant à resserrer la capsule articulaire pour<br />
supprimer le jeu anormal de l’articulation gléno-humérale.<br />
La pathologie du bourrelet glénoïdien de l’épaule<br />
Comme le ménisque du genou, le bourrelet glénoïdien peut être le siège d’une déchirure ou<br />
d’une désinsertion entraînant des douleurs mécaniques lors de la pratique du sport, une<br />
sensation d’accrochage, de corps étrangers<br />
intra-articulaires.<br />
Le diagnostic repose sur l’arthro-scanner et<br />
l’arthroscopie, ce dernier geste permettant en<br />
outre de traiter la lésion par suture ou<br />
résection.<br />
36
LES POINTS IMPORTANTS :<br />
L’épaule douloureuse est une situation clinique fréquente qui la plupart du temps peut-être<br />
analysée par un examen clinique standardisé et un bon interrogatoire.<br />
En présence d’un jeune pratiquant un sport impliquant le membre supérieur, on n’évoquera en<br />
tout premier lieu une instabilité, la plupart du temps antérieure et la recherche de signes<br />
cliniques spécifiques (tiroir antérieur, appréhension à l’armée du bras) associée à<br />
l’interrogatoire minutieux à la recherche de luxations ou de subluxations récidivantes voir de<br />
simples douleurs à l’armé du bras, permettra de faire le diagnostic et de proposer un<br />
tra<strong>item</strong>ent chirurgical adapté.<br />
En présence d’une adolescente ou d’un adolescent capable volontairement de subluxer son<br />
épaule vers l’avant, le bas ou l’arrière, on évoquera le diagnostic d’instabilité<br />
multidirectionnelle et dans ce contexte, la kinésithérapie sera le seul tra<strong>item</strong>ent à proposer.<br />
En présence d’une épaule douloureuse chronique ou hyper algique, chez un patient de moins<br />
de 50 ans (plus souvent de sexe féminin que de sexe masculin), on évoquera en tout premier<br />
lieu une calcification de la coiffe des rotateurs dont le diagnostic repose sur les radiographies<br />
standards. L’échec du tra<strong>item</strong>ent médical fera alors poser l’indication d’une exérèse<br />
endoscopique de sa calcification.<br />
37
Une épaule douloureuse chronique chez un patient de plus de 50 ans fait évoquer en tout<br />
premier lieu une pathologie de la coiffe des rotateurs. L’examen clinique retrouvera des<br />
signes de souffrance de la coiffe (manœuvre de Neer, de Hawkins, de Yocum) voir des signes<br />
de rupture (manœuvre de Jobe, manœuvre de Gerber, déficit de la rotation externe contrariée).<br />
Dans ce contexte, un arthroscanner ou une IRM sont indiqués pour affiner le diagnostic et<br />
proposer une thérapeutique adaptée :<br />
Tra<strong>item</strong>ent médical pour les tendinopathies simples,<br />
Tra<strong>item</strong>ent médical de principe pour les ruptures de la coiffe des rotateurs, qui sera un<br />
préalable au tra<strong>item</strong>ent chirurgical si le patient est jeune et si la lésion se prête à la réparation.<br />
Chez un patient de plus de 60 ans, on évoquera aussi en tout premier lieu une pathologie de la<br />
coiffe des rotateurs : il s’agira là plus volontiers d’une rupture qu’une tendinopathie simple.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent médical s’impose sur une durée d’au moins 12 mois avant d’envisager un<br />
tra<strong>item</strong>ent chirurgical qui sera le plus souvent une acromioplastie sous arthroscopie.<br />
Le 2 e diagnostic à évoquer dans cette population est une pathologie dégénérative c’est-à-dire<br />
une omarthrose qui sera très facilement diagnostiquée par les radiographies standard. Un<br />
tra<strong>item</strong>ent médical sera en premier lieu instauré en sachant qu’une prothèse totale d’épaule<br />
sera une excellente solution si celui-ci s’avérait insuffisant.<br />
Enfin, quel que soit l’âge, un patient souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde qui commence à<br />
souffrir de son épaule fera porter le diagnostic d’une atteinte rhumatoïde de cette articulation.<br />
Le tra<strong>item</strong>ent médical devra être entrepris mais en cas de poursuite de l’évolution et en cas de<br />
dégradation radiologique de l’articulation gléno-humérale, une prothèse totale d’épaule sera la<br />
solution chirurgicale.<br />
38