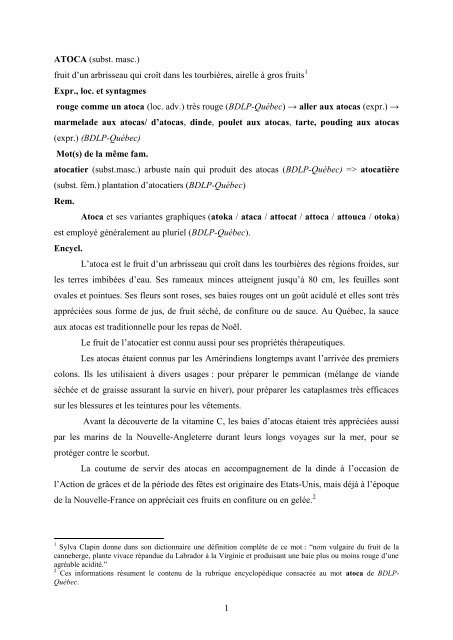Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ATOCA (subst. masc.)<br />
fruit d‟un arbrisseau qui croît dans les tourbières, airelle à gros fruits 1<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
rouge comme un atoca (loc. adv.) très rouge (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → aller aux atocas (expr.) →<br />
marmelade aux atocas/ d’atocas, dinde, poulet aux atocas, tarte, pouding aux atocas<br />
(expr.) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Mot(s) de la même fam.<br />
atocatier (subst.masc.) arbuste nain qui produit des atocas (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) => atocatière<br />
(subst. fém.) plantation d‟atocatiers (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Rem.<br />
Atoca et ses variantes graphiques (atoka / ataca / attocat / attoca / attouca / otoka)<br />
est employé généralement au pluriel (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>).<br />
Encycl.<br />
L‟atoca est le fruit d‟un arbrisseau qui croît dans les tourbières des régions froides, sur<br />
les terres imbibées d‟eau. Ses rameaux minces atteignent jusqu‟à 80 cm, les feuilles sont<br />
ovales et pointues. Ses fleurs sont roses, ses baies rouges ont un goût acidulé et elles sont très<br />
appréciées sous forme de jus, de fruit séché, de confiture ou de sauce. Au <strong>Québec</strong>, la sauce<br />
aux atocas est traditionnelle pour les repas de Noël.<br />
Le fruit de l‟atocatier est connu aussi pour ses propriétés thérapeutiques.<br />
Les atocas étaient connus par les Amérindiens longtemps avant l‟arrivée des premiers<br />
colons. Ils les utilisaient à divers usages : pour préparer le pemmican (mélange de viande<br />
séchée et de graisse assurant la survie en hiver), pour préparer les cataplasmes très efficaces<br />
sur les blessures et les teintures pour les vêtements.<br />
Avant la découverte de la vitamine C, les baies d‟atocas étaient très appréciées aussi<br />
par les marins de la Nouvelle-Angleterre durant leurs longs voyages sur la mer, pour se<br />
protéger contre le scorbut.<br />
La coutume de servir des atocas en accompagnement de la dinde à l‟occasion de<br />
l‟Action de grâces et de la période des fêtes est originaire des Etats-Unis, mais déjà à l‟époque<br />
de la Nouvelle-France on appréciait ces fruits en confiture ou en gelée. 2<br />
1 Sylva Clapin donne dans son dictionnaire une définition complète de ce mot : “nom vulgaire du fruit de la<br />
canneberge, plante vivace répandue du Labrador à la Virginie et produisant une baie plus ou moins rouge d‟une<br />
agréable acidité.”<br />
2 Ces informations résument le contenu de la rubrique encyclopédique consacrée au mot atoca de <strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong>.<br />
1
Etymol. et hist.<br />
Le mot d'origine iroquoienne est relevé dans la langue huronne sous les formes atoxa<br />
et toxa “petit fruit rouge” (où x rend la prononciation [kh]). 1 La variante toxa est attestée déjà<br />
en 1632 chez le père Sagard, sous l'orthographe toca : “Il y a aussi d'autres graines rouges,<br />
nommés [sic] [par les Hurons] Toca ressemblans [sic] à nos Cornioles ; mais elles n'ont ny<br />
noyaux ny pepins, les Hurons les mangent crües & en mettent aussi dans leurs petits pains.”<br />
(Le grand voyage du pays des Hurons, 328).<br />
Atoca a été relevé dans les parlers franco-américains de la Nouvelle-Angleterre et du<br />
Missouri et a pénétré en outre en anglais canadien. 2<br />
Le sens rencontré dans le texte de Louis Hémon apparaît dans plusieurs corpus<br />
littéraires ou scientifiques étant donné la fréquence de la notion et la spécificité autochtone de<br />
son référent :<br />
1658 : “Nous ne trouviõs en Toutes nos Hostelleries ny pain, ny vin, ny chair, ny poisson.<br />
Dieu nous dõna un petit fruict sauvage qu'on nomme icy Atoka; la jeunesse en alloit<br />
ramasser dans les prairies voisines, & quoy qu'il heust presque ny goust ny substance, la<br />
faim nous le faisoit trouver excellent : il est presque de la couleur & de la grosseur d'une<br />
petite cerise.” (Paul Le Jeune, The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and<br />
Explorations of the Jesuit Missionaries in New France, 1899, ed. by Reuben Gold<br />
Thwaites, Cleveland, Burrows Brothers Company, t. 43, 1 re partie, 146, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1712: “Latoca [sic] est un fruit a pepin de la grosseur des cerises la plante qui vient<br />
rampante dans les maraists produit son fruit dans l'eau qui est âcre on s'en sert a faire des<br />
confitures.” (Gédéon de Catalogne, «Mémoire de Gédéon de Catalogne sur les plans des<br />
seigneuries et habitations des gouvernements de <strong>Québec</strong>, les Trois-Rivières et Montréal»,<br />
dans Bulletin des recherches historiques, Beauceville, t. 21, n° 9, 1915, 262, d‟après le<br />
Fichier lexical du TLFQ)<br />
1723 : “Ils ont cependant une habitation où ils recueillent des fruits, qui sont bien<br />
différens de ceux du bas du fleuve du Mississipy, comme des cerises qui sont en grappes<br />
ainsi que nos raisins de France, des atoquas [sic] qui est un fruit semblable à nos fraises,<br />
mais plus grosses et carrées, des topinambours qui ressemblent à nos truffes [...]” (André<br />
Pénicaut (éd.), Découvertes et établissement des Français dans l'ouest et dans le sud de<br />
1 Dans le TLFi, atoca est considéré un mot d‟origine inconnue qui est mis en relation avec le mot espagnol<br />
atocha, qui désigne pourtant une plante toute à fait différente, le sparte.<br />
2 Ces informations sont un résumé des données trouvées dans la rubrique étymologique consacrée au mot atoca<br />
dans <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>.<br />
2
l'Amérique septentrionale, 1614-1698. t. 5, Première formation d'une chaîne de poste<br />
entre le fleuve Saint-Laurent et le golfe du Mexique (1683-1724), recueillis et publiés par<br />
P. Margry, Paris, Imprimerie de D. Jouaust, 417, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1756 : “Le pays produit peu de fruits, des petites pommes, un petit fruit aigrelet<br />
approchant de la cerise appelé atocha, qui vient sous la neige, et dont on fait des<br />
compotes dans le printemps, des noix appelées noix de Niagara, qui ne sont pas plus<br />
grosses que des noisettes, une coque très vive, et en dedans un fruit qui a le goût de la noix<br />
de France, mais moins bonne.” (Louis-Joseph de Montcalm, Journal du marquis de<br />
Montcalm durant ses campagnes en Canada de 1756 à 1759, 1895 publié sous la<br />
direction de l'abbé Henri-Raymond Casgrain, <strong>Québec</strong>, Imprimerie de L.-J. Demers &<br />
Frère, 62-63, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Atoca désigne également l‟arbrisseau des tourbières qui produit de petites baies au goût<br />
acidulé et qui deviennent rouges en mûrissant (Dict. québécois d’aujourd.) (Vaccinum<br />
macrocarpon - Europe, Vaccinum oxiccocos - en Amérique du Nord, famille des éricacées) :<br />
1709 : “Il y a des arbrisseaux parmy lesquels est le blüet et l'atoca. Ce premier rapporte en<br />
grappe un petit fruit gros comme un pois dont le nom de bluet denote la couleur et dont les<br />
sauvages amassent beaucoup pour l'hyver. Le second croit dans les endroits mareacageux<br />
[sic]et porte un fruit de la couleur et de la grosseur d'une cerise; l'un et l'autre de ces fruits<br />
ont une grande propriété pour guerir la dissenterie.” (Antoine-Denis Raudot, Relation par<br />
lettres de l'Amérique septentrionalle (années 1709 et 1710), 1904, éditée et annotée par<br />
Camille de Rochemonteix, Paris, Letouzey et Ané éditeurs, 13-14, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
Le terme a été pris en compte par la lexicographie québécoise et la <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> lui<br />
consacre un article complet.<br />
Le mot est attesté pour la première fois dans le discours métalexical en 1841 ([MAGUIRE<br />
Thomas], Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune<br />
âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie (impr.), 1841 , 14)<br />
(ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 − <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du TLFQ − ILQ – TLFi –<br />
Ø FEW.<br />
3
BILLOT (subst. masc.)<br />
tronçon de bois non-équarri, bille de bois qui était transportée aux cours d‟eau avec des<br />
chevaux de traits<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
descente des billots 1<br />
Encycl.<br />
Le terme billot du français québécois doit être mis en relation avec l‟industrie du bois qui<br />
est très riche au Canada. Au XIX e siècle et dans la première moitié du XX e siècle, dès la fin<br />
août, les colons quittaient leurs fermes pour aller travailler sur les chantiers forestiers.<br />
Souvent, les adultes restaient à la ferme pour les travaux courants et seulement les jeunes<br />
partaient travailler dans les bois. Les équipes de bûcherons étaient composées d‟environ 25<br />
hommes et d‟attelages de chevaux. Ils abattaient jusqu'à 2000 arbres par saison et ensuite ils<br />
les coupaient en les transformant en billots. Ils les transportaient ensuite au cours d‟eau le plus<br />
proche avec les chevaux. Lors de la fonte des neiges, de petits barrages étaient construits sur<br />
les ruisseaux pour permettre le flottage des billes jusqu‟aux rivières principales. Les billots<br />
flottaient sur les rivières et parfois ils formaient des embâcles. Dans ce cas, les draveurs<br />
intervenaient et, à l‟aide des perches, ils sautaient de bille en bille, essayant de décoincer et de<br />
guider les billots pour qu‟ils se libèrent et continuèrent leur route. Des que les billots<br />
arrivaient sur les grandes rivières, ils étaient assemblés en radeaux appelés cages, pour éviter<br />
qu‟ils ne se dispersent.<br />
Les billots transportés par la pratique de la drave ont eu parfois une influence nocive pour<br />
le paysage fluvial. Les billots perdus pourrissaient parfois dans les eaux, polluant et modifiant<br />
le milieu naturel. Ils labouraient les berges, accroissant l‟érosion du sol d‟une façon<br />
spectaculaire. La circulation en canot devenait à cause de cela dangereuse pour les derniers<br />
Indiens et coureurs de bois qui risquaient à tout moment dans leur chemin de heurter des<br />
billots et de chavirer.<br />
cessé. 2<br />
Une fois les routes et les chemins de fer apparus, le transport des billots par la drave a<br />
1<br />
Cette expression se dit des amas de troncs d‟arbres qui descendent à chaque printemps emportés par les eaux<br />
grossies des rivières après une saison de chantier (Clapin).<br />
2<br />
Ces paragraphes de la rubrique Encyclopédie sont une synthèse des informations trouvées dans l‟Encyclopédie<br />
canadienne à l‟adresse<br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0007186.<br />
4
Etym. et hist.<br />
Billot est un héritage de France, un mot formé de bille “portion de tronc d'arbre<br />
débitée à la scie et non équarrie” (TLFi) à l‟aide du suffixe -ot. 1 Il a maintenu en français<br />
québécois la forme et le sens des parlers dialectaux de Picardie et de Poitou (GFPC).<br />
Le sens du mot présent dans le roman Maria Chapdelaine se rencontre chez d‟autres<br />
écrivains canadiens aussi :<br />
1874 : “l‟on peut juger de sa solidarité, lorsqu‟on se rappelle que, depuis cinquante<br />
ans, cette chaussée est restée inébranlable : - résistant chaque année, à l‟inondation<br />
des eaux refoulées par la pression des milliers de billots qu‟entassent sur ces<br />
jetées, la rapidité du courant.” (Joseph Bonin, Biographies de l’honorable<br />
Barthélémi Joliette et de M. le grand vicaire A. Manseau, Montréal, Eusèbe<br />
Senécal Imprimeur-Editeur, 57, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1881 : “On nous annonce que les estacades de barrage au dessus du village<br />
menacent de se rompre. Vingt-cinq mille billots les assiègent.” (André-Napoléon<br />
Montpetit, « Pêche et chasse. Saint-Thomas », dans l’Opinion publique, Montréal,<br />
10 mars 1881, 160, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part la signification rencontrée dans le texte de Louis Hémon, billot désigne aussi le<br />
tronçon de bille de bois dur, coupé à hauteur utile, et servant d‟appui pour poser, façonner,<br />
couper, broyer quelque chose (Bélisle) :<br />
1864 : “[…] mais généralement les enfants prenaient leur repas sur le billot<br />
[…] / Ces billots suppléaient dans l‟occasion à la rareté des chaises, et<br />
servaient aussi à débiter et hacher la viande pour les tourtières (tourtes) et les<br />
pâtés des jours de fêtes.” (Aubert de Gaspé, Les anciens Canadiens, Montréal<br />
− Paris, Fides, 349, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot billot est attesté pour la première fois dans une source métalexicale québécoise<br />
en 1880 (DUNN Oscar, Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses<br />
usitées au Canada, <strong>Québec</strong>, Imprimerie A. Côté et Cie, 1880, 22) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 − Ditchy, J. K., Les Acadiens français…, 1932 – Bélisle, 1957 – Fichier<br />
lexical du TLFQ – ILQ – TLFi − FEW.<br />
1 cf. FEW 1, 364a, *BILIA.<br />
5
BLEUET (BLUET) (subst. masc.)<br />
petit fruit comestible du bleuetier, myrtille (vaccinum myrtillus)<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
tourtière aux bleuets (rég. Saguenay-Lac-St-Jean) pâtisserie faite d‟une abaisse de pâte<br />
brisée garnie d‟une préparation sucrée, souvent à base de fruits, qu‟on peut recouvrir (<strong>BDLP</strong>-<br />
Acadie)<br />
Encycl.<br />
Les bleuets sont des baies que l‟on trouve particulièrement dans la région du lac Saint-<br />
Jean, le fruit des petits arbustes reconnaissables à ses feuilles, qui poussent en talles ou<br />
massifs et sont le paradis des perdrix de savane qui mangent leurs fruits. Ils poussent en sol<br />
acide et terrain tourbeux.<br />
Les Amérindiens du <strong>Québec</strong> les utilisaient en abondance pour améliorer les mets et<br />
incorporaient les fruits dans la viande séchée et les galettes de pain.<br />
Le fruit est originaire de l‟Amérique du Nord et se rencontre seulement dans les zones<br />
tempérées. Il est rond à peau lisse, de 8 mm environ, bleuté tirant sur le noir à certains<br />
endroits, avec un aspect givré. Le bleuet est d‟abord tout blanc pendant environ deux<br />
semaines, il rougit ensuite et lorsqu‟il est bien mûr, il devient bleu. 1<br />
Rem.<br />
Le substantif bleuet existe aussi en français de France où il désigne une plante à fleurs<br />
bleues de la famille des composacées (centaurea cyanus) qui pousse dans les champs de blé:<br />
“Lorsque les blés sont en fleur, c‟est alors qu‟ils sont revêtus de toute leur<br />
magnificence. Le coquelicot éblouissant, le bleuet azuré, la nielle pourprée, le<br />
liseron couleur de chair, relèvent de l‟éclat de leurs fleurs l‟aimable verdure des<br />
guérets.”(Bernardin de Saint-Pierre, Harmonies de la nature, 1814, 57, d‟après<br />
TLFi).<br />
Bleuet peut également désigner en français de France l‟un des noms du canot bleu ou<br />
squale glauque et, en ornithologie, le nom vulgaire du martin-pêcheur d‟Europe 2 .<br />
Le sens du mot bleuet présent dans le roman de Louis Hémon est exprimé en français de<br />
France par l‟un des termes : airelle, brimbelle, luce (en Bretagne), teint-vin, vaciet. La<br />
différence entre airelle et myrtille est due à la répartition de ces deux mots dans l‟espace : le<br />
1<br />
Les informations de la rubrique encyclopédique sont un résumé des données trouvées dans l’Encyclopédie<br />
canadienne à la <strong>page</strong><br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0003090.<br />
2<br />
Ces significations ont été extraites de l‟article du TLFi consacré au mot bleuet.<br />
6
premier se rencontre plutôt dans le sud de la France, dans le Midi, tandis que le deuxième se<br />
rencontre notamment au nord.<br />
Airelle et myrtille circulent en français québécois aussi, mais ils sont moins fréquents<br />
que bleuet et ils sont sentis comme propres au français de France.<br />
Etymol. et hist.<br />
Bleuet (FEW 15/1, 148b, 149a, 2b, *BLAO) est un héritage des parlers de France.<br />
Marcel Juneau 1 croit que bluet relève d‟une forme préromane, bulluca, variante *belluca, qui<br />
désigne une prunelle ou une prune. Par la suite, il a subi l‟influence de l‟adjectif bleu.<br />
En galloroman, blue ou ses variantes, défini par “myrtille” ou “airelle” est connu en<br />
normand (d‟où il est probablement venu au Canada), en lorrain, en franc-comtois et dans les<br />
parlers de la Suisse romande. 2 Le terme se rencontre également dans les régions suivantes :<br />
Moselle (blü “myrtilles ou airelles”), Tholy (blouï “myrtilles”), Autrey (blü “myrtille”) etc.<br />
(FEW).<br />
Le sens de “myrtille“ du mot bleuet présent dans le roman de Louis Hémon a été déjà<br />
pris en compte dans la lexicographie et il apparaît avec fréquence dans les ouvrages littéraires<br />
québécois et dans les articles de journaux :<br />
1744 : “Il y a trois sortes de Grosseilles naturelles au Pays. Ce sont les mêmes qu‟en<br />
France. Le bleuet est ici comme en Europe, par Contrées. Ce Fruit est merveilleux<br />
pour guérir en peu de temps la Dysenterie. Les Sauvages le font sécher, comme on fait<br />
en France les Cerises.” (François Xavier de Charlevoix, Histoire et description<br />
générale de la Nouvelle-France, avec le Journal historique d’un voyage fait par ordre<br />
du rois dans l’Amérique septentrionalle, Paris, t.5, 239-240, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
1888 : “Disons pour les étrangers qui pourraient nous lire, que les Canadiens appellent<br />
bleuets non pas la Centaurée des blés, mais l‟Hediotis carulea avec ses baies d‟un bleu<br />
foncé fort recherché dans notre pays.” (Napoléon Caron, Deux voyages sur le Saint-<br />
Maurice, Sillery Septentrion, 87, 2000, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1920 : “Le commerce de bleuets a été très actif dans notre région cette année. Dans la<br />
paroisse de Grands Bergeronnes il s‟en est vendu pour plus de 20, 000 dollars.” (La<br />
Presse, 11 novembre, 24, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1925 : “Le menu était celui de tous les jours chez un cultivateur bas-canadien : une<br />
soupe aux pois avec persil et herbes salées, un carreau de lard bouilli avec un collier<br />
1 « Québécois bleuet, français berlue, même souche » dans RLiR n°197-198, t 50, (1986), Strasbourg, 133-137.<br />
2 Ces paragraphes sont un résumé de l‟article de Marcel Juneau.<br />
7
de pomme de terre, de choux, de carottes et de navets ; un grand plat rempli d‟épis de<br />
blé d‟Inde également bouillis et que les convives avaient le droit d‟enduire de beurre à<br />
même une miche placée dans un large beurrier posé au milieu de la table ; comme<br />
dessert, des bleuets séchés couverts d‟une couche de sucre d‟érable râpé.” (Damase<br />
Potvin, Le Français : roman paysan du « pays de <strong>Québec</strong> », Montréal, Editions<br />
Edouard Garand, 174, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1930 : “La baie que nous mangeons, surnommée le bleuet, ou raisin des bois, est<br />
aigrelette et agréable, mangée crue ; en compote, elle est préférable ; on en fait aussi<br />
des sirops pour se désaltérer. On la mélange à la crème ou au lait, ou bien on en fait<br />
des tartes.” (Almanach du peuple, Montréal, Librairie Beauchemin Limitée, 336,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1931 :“Le bleuet est un peu sauvage et il n‟aime pas à pousser et à mûrir aux bruits de<br />
la haute industrie, sous le panache des fumées noires des locomotives qui passent près<br />
de lui, et aux cliquetis stridents des machines aratoires trop perfectionnées. Il<br />
s‟accommode fort bien de l‟humble et silencieux travail de la faucille et de la petite<br />
faulx, du rateau à bras, de la petite herse simple et de la charrue à rouelles ; mais<br />
quand arrivent la tintamarresque moissonneuse-lieuse, la stridente faucheuse à cheval,<br />
le rateau idem et les herses-camions, il se renfrogne, devient sec, perd son jus et sa<br />
saveur et, alors, jugeant avec calme qu‟il n‟a plus de raison d‟être, intelligemment il<br />
préfère disparaître. Et c‟est ce qu‟ont fait les bleuets du «Banc du sable ».” (Damase<br />
Potvin, Plaisant Pays de Saguenay…, <strong>Québec</strong>, 1931, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
1937 : “Hémon avait pourtant averti les cinéastes que les bleuets canadiens ne sont<br />
pas, comme les bluets [sic] de France, des fleurs de champs, mais des baies sauvages,<br />
les airelles du Canada, qui poussent « dans les brûlés », au flanc des coteaux pierreux,<br />
partout où les arbres plus rares laissent passer le soleil.” (Louvigny de Montigny, La<br />
revanche de Maria Chapdelaine : essai d’initiation à un chef-d’œuvre inspiré du pays<br />
de <strong>Québec</strong>, Montréal, Editions de l‟Action canadienne-française, 87-88, d‟après le<br />
Fichier lexical du TLFQ)<br />
1945 : “En France, le bluet, − orthographié aussi parfois bleuet – est le Centaurea<br />
Cyanus. Bluet appliqué au Vaccinum n‟est pas un canadianisme, bien que Littré et<br />
Bescherelle aient consacré le nom bluet du Canada. André Martignon le mentionne<br />
pour la région des Pyrenées, et Henri Pourrat pour l‟Auvergne. Dans tous ces<br />
8
exemples on écrit bluet, d‟ailleurs plus conforme à la dérivation populaire. Bleuet, de<br />
formation plutôt savante, employé d‟abord par les personnes s‟appliquant à soigner<br />
leur langage, se répand de plus en plus.” (Jacques Rousseau, Etudes ethnobotaniques<br />
québécoises, Montréal, Institut Botanique de L‟Université de Montréal, 96-97, d‟après<br />
le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1946 : “Plusieurs sont sous l‟impression que les bleuets ont été apportés ici par les<br />
Français à l‟origine de La Nouvelle-France. Sûrement, le bleuet existe en France<br />
depuis des siècles sous le nom d‟airelle. Mais le bleuet canadien est bien indigène, et<br />
les sauvages, avant la venue de Cartier et, plus tard, de Champlain, faisaient leurs<br />
délices de ce met succulent qu‟ils aimaient d‟autant plus qu‟ils en faisaient la récolte<br />
sans être obligés d‟en prendre soin.” (Le Bulletin des recherches historiques, Lévis,<br />
<strong>Québec</strong>, t. 52, 79, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
En français québécois, le mot bleuet peut désigner aussi le petit arbrisseau ligneux à<br />
feuilles coriaces qui fait partie de la famille des vaccinées.<br />
Le terme plus “scientifique” pour désigner l‟arbrisseau est bleuetier (Dict. québécois<br />
d’aujourd.).<br />
Ecrit avec majuscule, le mot désigne le blason populaire pour les personnes de la région<br />
du Lac Saint-Jean (Fichier lexical du TLFQ) :<br />
1930 : “BLEUET− n.m. Natif de Saguenay” (Le goglu : journal humoristique,<br />
Montréal, 22 août, 7, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot bleuet est attesté pour la première fois dans le discours métalexical québécois en<br />
1875 (FOUBERT Auguste, La vie d'émigrant en Amérique (République Argentine, États-Unis<br />
et Canada), Paris, Imprimerie Paul Dupont, 1875, 212). La variante bluet est attesté à partir<br />
de 1831(Anonyme, «Noms scientifiques et populaires de quelques plantes du Canada», dans<br />
L'Observateur, Montréal, 1831, 4 juin, 342) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. encycl. Quillet 1961 - Le Grand Larousse, t.1, 1972 − RLiR 50 (1986) − Dict. québécois<br />
d’aujourd., 1992 - Lexis, 1994 – Bérgeron, Léandre, Dict. de la langue québécoise, 1997 –<br />
<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi − FEW.<br />
BOSS (subst. masc.)<br />
maître, patron, propriétaire<br />
9
Expr., loc. et syntagmes<br />
faire le boss agir comme un maître (GPFC) → faire son boss prendre de faux airs de<br />
supériorité, d‟indépendance, vouloir se faire passer pour maître, pour propriétaire, pour<br />
patron, pour un homme riche (GPFC) → big boss, grand boss grand patron # petit boss petit<br />
chef (péj.) (ILQ) → le boss des bécosses celui qui veut tout contrôler, tout dominer (dans une<br />
famille, dans un groupe) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>).<br />
Mots de la même famille<br />
bosser (vb. trans.) commander, diriger 1 (DRFTN) –> bossy (adj) autoritaire (DRFTN)<br />
Rem.<br />
Le terme se rencontre aussi en français de France (FEW 18, 31b, BOSS), écrit comme en<br />
français canadien boss ou bos, mais son usage est limité au registre familier. Les synonymes<br />
les plus fréquents sont : propriétaire et chef. Ces mots se rencontrent également en français<br />
québécois.<br />
Etymol. et hist.<br />
Boss [bOs] est un emprunt direct à l‟anglais sans adaptation phonétique.<br />
A part le roman de Louis Hémon, son sens apparaît également dans d‟autres œuvres<br />
littéraires québécoises et dans des articles:<br />
1873 : “Malheureusement, les circonstances étaient contre lui, et Michel juraient [sic]<br />
ses grands dieux qu‟ils parleraient au boss et qu‟il s‟en irait si le voleur n‟était pas<br />
chassé.” (Napoléon Légendre, « Le voyageur », dans Album de La Minerve, Montréal,<br />
13 mars, t. 2, 194-196, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1968 : “Une fois, ma femme était tombée malade d‟urgence, fait que l‟hôpital a<br />
téléphoné vers deux heures et quart, c‟est l‟boss qu‟a répondu, y vient m‟voir, y dit : ta<br />
femme est tombée malade d‟urgence… y l‟ont rentrée… y dit, voyons donc, énarve-<br />
toé pas avec ça, fait [sic] comme si de rien n‟était, continue ton ouvrage, si y a quelque<br />
chose, j‟te l‟dirai…çé pas n‟importe quel boss qu‟aurait faite ça…” (Yvon<br />
Deschamps, Monologues, [Montréal], Leméac, 19-20, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
1 Le verbe bosser du français de France qui a le sens de “travailler fort” n‟est pas un dérivé du nom boss “chef”<br />
comme le verbe inclus dans notre glossaire. En plus, il a une autre origine (il est dérivé du nom bosse + -er). Il a<br />
eu au début une existence limitée aux dialectes régionaux de l‟Ouest de la France et avait le sens de “se courber”.<br />
Son sens a évolué vers “se courber sur un travail” et ensuite vers “travailler dur” (TLFi).<br />
10
1976 : “Le garçon du boss était parti à la chasse un matin. Y revient à la fin de l‟après-<br />
midi : pas une maudite perdrix !” (Bertrand Leblanc, Moi, Ovide Leblanc, j’ai pour<br />
mon dire, [Montréal], Leméac, 218, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part les deux sens apparentés présents dans le roman de Louis Hémon, le nom boss a<br />
deux autres sens en français québécois qui n‟apparaissent pas en français de France :<br />
1. le plus fort, le plus habile individu de la communauté (GPFC)<br />
1992 : “Le vieux Siméon était connu pour avoir de nombreux tours dans son sac […].<br />
Sa malice proverbiale en incita plus d‟un à insinuer qu‟il avait fait exprès pour se<br />
venger de la rébellion tardive et bien innocente de son fils. Quoi qu‟il en soit, pour<br />
Rogatien, l‟autorité de son père avait bel et bien brûlé avec la maison.<br />
− Maintenant, c‟est moi le boss, annonça-t-il victorieusement à sa femme<br />
Alphonsine.” (Bernadette Renaud, Un homme comme tant d’autres. t. 1. Charles,<br />
Montréal, Libre Expression, 262, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
2. bourgeois (GPFC)<br />
1999 : “[…] avec l‟aide de quelques échevins, du vieux curé Jodoin, de ses<br />
marguilliers et des boss de la Pulpe, le maire Jack, un homme bien charpenté à l‟œil<br />
froid et dur, tenait les citoyens de Murray dans le creux de sa main” (Dominique<br />
Demers, Le pari, Montréal, <strong>Québec</strong> Amérique, 123, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
Le mot été pris en compte dans la plupart des ouvrages métalexicaux du <strong>Québec</strong>. Il n‟a<br />
pas d‟entrée dans la <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>, mais ses sens sont largement illustrés par de nombreuses<br />
citations dans le Fichier lexical.<br />
Le mot est attesté pour la première fois en 1870 (LARUE Hubert, «Nos qualités et nos<br />
défauts. I. La langue française en Canada», dans Mélanges historiques, littéraires et<br />
d'économie politique, t. 1, <strong>Québec</strong>, Garant et Trudel éditeurs, 1870, 16). Boss de gang est<br />
attesté pour la première fois dans ce genre de discours en 1977 (ROGERS David,<br />
Dictionnaire de la langue québécoise rurale, Montréal, VLB éditeur, 1977, 26, 62) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du TLFQ – ILQ.<br />
BOUCANE (subst. fém.)<br />
fumée quelconque et plus spécialement fumée épaisse ou nauséabonde (Clapin)<br />
Mots de la même famille<br />
11
oucaner (vb. trans.) 1 dégager, produire de la fumée 1 2. (en parlant de la cigarette) fumer,<br />
faire de la fumée (DRFTN) ; se faire boucaner se faire enfumer => boucanerie (subst. fém.)<br />
petite construction extérieure à la maison qui sert à fumer les viandes et les poissons 2 (<strong>BDLP</strong>-<br />
Acadie) => boucanier (subst. masc.) personne qui fume la viande (Bélisle) => boucan (subst.<br />
masc.) sorte de grill pour fumer les viandes et les poissons 3 (Dict. québécois d’aujourd.,<br />
Bélisle)<br />
Rem.<br />
Dans le TLFi, boucane est considéré un régionalisme du Canada.<br />
Etymol. et hist.<br />
Boucane est usité dans tout le Canada francophone, en Acadie, à Saint-Pierre et<br />
Miquelon et en Louisiane. Son enregistrement dans certains parlers de France, notamment en<br />
Normandie (FEW, 20, 72b, MOKAEM) pousse à croire que sa présence en français québécois<br />
est due au maintien de la forme et du sens d‟un de ces dialectes (DRFTN). Le sens de “fumée”<br />
a été enregistré aussi en Saintonge (FEW).<br />
En ce qui concerne la forme, le nom est un déverbal de boucaner, verbe attesté aussi<br />
dans les parlers de Normandie (DRFTN).<br />
A part le texte écrit par Louis Hémon, le sens principal du mot boucane apparaît dans<br />
plusieurs ouvrages littéraires canadiens et dans les journaux, même à partir du XVIII e siècle :<br />
1727 : “[…] on fait de la boucane, c‟est-à-dire, un grand feu, que l‟on étouffe ensuite<br />
avec des feuilles vertes.” (Paul du Poisson, The Jesuit Relations and Allied<br />
Documents. Travel and Explorations of the Jesuit Missionaries in New France,<br />
Reuben Gold Thwaites, Cleveland, Burrows Brothers Company, t.67, 294, d‟après le<br />
Fichier lexical du TLFQ)<br />
1817: “Deux hommes ont été trouvés morts […]. Il paraît qu‟ils ont été étouffés par la<br />
boucane. […] ” (Le Canadien, 1 nov. 1817, 84, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1965 : “Les sauvages dansaient quand ils venaient chez nous… Ils ont tous des tentes<br />
en écorce, faites en rond et pointues du haut / Pas de poêle, rien qu‟un feu au milieu ;<br />
ils sentaient la boucanne [sic]. C‟est inmourable [sic] un sauvage…” (Rolland<br />
Coulombe, « Mémoires d‟anciens : Monsieur et Madame Alexis Guay », dans<br />
1 Le verbe boucaner appartient aussi au français de France au sens de “faire sécher de la viande en fumant”.<br />
Selon DMR, boucaner signifie aussi en français réunionnais “fumer les vignes, les terres et les prés.”<br />
2 Le terme du français de France qui correspond au terme boucanerie est fumoir. Il est connu également en<br />
français québécois, mais il est perçu comme propre au français de France.<br />
3 En créole martiniquais, le mot boucan désigne un grand feu sur lequel on fait cuire les aliments.<br />
12
Saguenayensia : revue de la Société historique du Saguenay, Chicoutimi, t. 7, n° 1,<br />
15-17, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Un autre sens du mot boucane (dérivé du premier) est “fumée de cigarette” (Dict.<br />
québecois d’aujourd.):<br />
2004 : “Depuis toujours, les non-fumeurs ont pris l‟habitude d‟endurer. Ils se disent<br />
qu‟ils n‟ont pas le choix, que c‟est le prix à payer pour sortir et voir du monde. Ils<br />
passent donc la soirée à se faire souffler de la fumée dans la figure. Leurs vêtements<br />
empestent la boucane. Ils ont mal à la gorge, ils toussent. Mais ils endurent.” (Le<br />
Devoir, Montréal, 10 janvier, A5, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
2004 : “On dira ce qu‟on voudra, mais il en faut des couilles à un politicien pour dire à<br />
des millions d‟Irlandais qu‟ils ne pourront plus fumer dans les pubs. Surtout lorsqu‟on<br />
connaît leur attachement pour cette vénérable institution gaillarde, lieu de tant<br />
d‟affrontements virils sur fond de boucane et d‟effluves de Guinness.” (Le Soleil, 1 er<br />
avril 2004, A5, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Un autre sens du mot est “vapeur d‟eau” (GPFC) :<br />
1992 : “Ils érigeaient aussi une cheminée, longue et étroite, qui dépassait à peine le<br />
toit très élevé de la grange mais largement le futur toit de la scierie.<br />
− Avec ma chute [d‟eau], j‟avais pas de boucane, pointilla Vanasse.<br />
− Mais avec la vapeur, on va pouvoir scier à la longueur de l‟année, père Vanasse,<br />
rappela Charles qui était fier de construire une scierie plus moderne.” (Bernadette<br />
Renaud, Un homme comme tant d’autres, t.1, Montréal, Libre Expression, 251,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot boucane est attesté pour la première fois dans une source métalexicale<br />
québécoise en 1831 (BOUCHER-BELLEVILLE Jean-Philippe, Nouvelle grammaire<br />
française, ou l'art de parler et d'écrire correctement, rédigée par les meilleurs grammairiens,<br />
et la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française, en deux parties, Montréal,<br />
Presses de Ludger Duvernay, Imprimerie de la Minerve, 1831, 78) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Clapin, 1894 − SPFC, GPFC, 1930 − Brasseur, P., Chauveau, J.-P., SPM, 1990 − Dict.<br />
québécois d’aujourd., 1992 − DMR, 1999 – Brasseur, P., DRFTN , 2001 – <strong>BDLP</strong>-Acadie –<br />
Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi – FEW.<br />
13
BRÛLÉS (subst. masc. pl.)<br />
partie d‟une forêt dévastée par un incendie et où les arbres n‟ont plus repoussé ; terrain<br />
brûlé ; brûlis<br />
Encycl.<br />
Les incendies sont assez fréquents dans les forêts canadiennes non seulement à cause<br />
de la négligence des humains, mais aussi à cause des conditions atmosphériques et de la<br />
fréquence des foudres. A la suite des incendies, les terrains des forêts se transforment en<br />
brulés. Ceux-ci couvrent donc, autant le sol des anciennes forêts mixtes que la surface des<br />
forêts boréales qui sont, en général, éloignées des zones habitées.<br />
Parfois, sur le sol de l‟ancienne forêt on pratique une agriculture itinérante et la<br />
végétation forestière est remplacée par des massifs de bleuets. 1<br />
Rem.<br />
Le sens du mot brûlés présent dans le roman de Louis Hémon n‟est pas attesté en<br />
français contemporain de France (TLFi). Pourtant, en France il y a des localités qui sont<br />
appelées : Le Brûlé (en Bretagne), Les Brûlés ou Les Brûlées (localités nivernaises) ce qui<br />
peut pousse à croire que le nom a eu une existence comme nom commun dans certaines aires<br />
dialectales de la France et, en français québécois son origine s‟explique par le maintien d‟un<br />
sens d‟un des parles régionaux de France. Des noms de localités dont le noyau est le mot<br />
brûlés se rencontrent au Canada aussi : Grand-Brûle, Petit-Brûlé, Grand-Pays-Brûlé,Petit-<br />
Pays-Brûle(GPFC).<br />
Etymol. et hist.<br />
Brûlé au sens présent dans le texte de Louis Hémon (FEW 14, 78ab, 79a, USTULARE) s‟est<br />
formé par la substantivation au masculin pluriel du participe passé brûlé du verbe brûler. Il<br />
est largement attesté dans les parlers du Canada, généralement au masculin avec cet emploi.<br />
Brûlés doit être mis en relation avec le mot masculin bruleis “partie de forêt incendiée, de<br />
champ dont les herbes ont été brûlées pour améliorer le sol” (en ancien français) et avec burlá<br />
“partie de forêt détruite par un incendie ou défrichée par le feu” (Vaud) (FEW).<br />
Il est attesté en Nouvelle-France depuis 1752 dans le syntagme bois brûlés :<br />
“Après avoir fait environ deux lieues, l'on découvrit, de loin, une maison de face au<br />
cours de la rivière; l'on nous dit que son origine était à un quart de lieue au-dessus, et<br />
qu'il était à propos, crainte de manquer d'eau plus avant, de mettre à terre à la rive<br />
droit vis-à-vis l'habitation de la veuve Gentil, nous y vîmes de près des grains de la<br />
1 Ces idées sont un résumé des informations trouvées dans l‟Encyclopédie canadienne à l‟adresse<br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCESearch&Params=F1.<br />
14
plus grande beauté, et le chemin de là au havre St-Pierre étant frayé, large de 6 à 7<br />
pieds et propre à des charrettes attelées de deux boeufs, on le suivit à pied, il traverse<br />
des bois brûlés dans lesquels est une grande quantité de bleuets qu'on mange en<br />
rafraîchissement, il va aboutir au ruisseau à Comeau où la mer forme une espèce de<br />
barachois qu'on traverse à sec, à marée basse, et à haute mer sur deux pieds et demi<br />
d'eau; cet endroit est réputé le point milieu du chemin d'entre la dite veuve Gentil et le<br />
havre St-Pierre.” (Louis Franquet, «Iles Royale et St-Jean, 1751: voyage du sieur<br />
Franquet», dans Rapport de l'archiviste de la province de <strong>Québec</strong> pour 1923-1924,<br />
[<strong>Québec</strong>], 118, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Brûlés au sens illustré dans Maria Chapdelaine apparaît tout seul depuis 1895 :<br />
“Ce qui nous surprit le plus, ce fut de voir la quantité de framboises que les habitants<br />
du Nord descendaient à la ville de St-Jérôme, où quelques commerçants achetaient<br />
toutes celles qui leur étaient apportées. Avant cette époque, on laissait se perdre une<br />
quantité considérable de ces fruits qui viennent avec tant d'abondance dans les terrains<br />
incultes que le feu a visités. Chose singulière, tandis qu'aux Etats-Unis on cultive la<br />
framboise et qu'elle rapporte jusqu'à $500 piastres l'arpent, on ne profitait pas d'une<br />
abondante récolte que nous offrent spontanément nos brûlés pour la seule peine de les<br />
cueillir. Aujourd'hui c'est un commerce à St-Jérôme comme les bluets (myrtilles) au<br />
Saguenay.” (Benjamin-Antoine Testard de Montigny, La colonisation: le Nord de<br />
Montréal ou la région Labelle, Montréal, C.O. Beauchemin & Fils, Libraires-<br />
Imprimeurs, 74, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1920 : “Et voilà la vérité sur les zones à bleuets du Lac-Saint-Jean. A part cela, on en<br />
trouvera quelques tales, ici et là, dans les brûlés de Coushpagan, de<br />
l‟Ashuapmouchouan et de Metabetchouan, mais il reste superflu de dire et d‟aller<br />
répéter à tout venant que les bleuets poussent dans les interstices des murs, au Lac-<br />
Saint-Jean.” (Damase Potvin, Le tour du Saguenay : historique, légendaire et<br />
descriptif, <strong>Québec</strong>, [s. é], 163, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1988 : “Les brûlés fourmillaient généralement de bleuets. Tom savait donc qu‟il<br />
faisait toujours plus mauvais dans ce secteur. Les vents étaient plus intenses là qu‟à la<br />
Réserve.” (Serge Côté, L’indien. Les trois jours de la nation, Chicoutimi, Editions<br />
JCL, 220, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot est attesté pour la première fois dans une source métalexicale québécoise assez<br />
tard, en 1968 (CORMIER France-Pauline, Les canadianismes et leurs correspondants<br />
anglais…, Université de Montréal, 1968, 44). Bois-Brûlés apparaît pour la première fois<br />
15
Bbg.<br />
en 1907 (GAGNON Philéas, «La langue parlée au Nord-Ouest canadien», dans BPFC, t.<br />
6, n° 4, 1907 déc., 133) (ILQ).<br />
SPFC, GPFC, 1930 − Dict. québécois d’aujourd., 1992 – <strong>BDLP</strong> -<strong>Québec</strong> − TLFQ – Fichier<br />
lexical – ILQ − TLFi – FEW.<br />
CANADA (subst. masc.)<br />
pays situé en Amérique du Nord qui s‟étend d‟est en ouest de l‟océan Atlantique à l‟océan<br />
Pacifique, vers le nord jusqu‟à l‟océan Arctique et qui a comme voisin au sud les Etats-Unis<br />
Mots de la même famille<br />
canadien (subst. masc.) habitant du Canada d‟origine française (par opposition à anglais qui<br />
désigne les habitants d‟origine britannique (Bélisle)<br />
“Lorsque les Canadiens français parlent d‟eux-mêmes, ils disent toujours Canadiens,<br />
sans plus ; et à toutes les autres races qui ont derrière eux peuplé le pays jusqu‟au<br />
Pacifique, ils ont gardé pour parler d‟elles leurs appellations d‟origine : Anglais,<br />
Irlandais, Polonais ou Russes, sans admettre un seul instant que leurs fils, même nés<br />
dans le pays, puissent prétendre aussi au nom de Canadiens. […]“ (73)<br />
=> canadien (adj.)<br />
“Aller à la messe de minuit, c‟est l‟ambition naturelle et le grand désir de tous les<br />
paysans canadiens, même de ceux qui demeurent le plus loin dans les villages.” (108)<br />
“Les Français, arrivés dans le pays depuis quelques mois seulement, devaient ressentir<br />
une curiosité du même ordre, car ils écoutaient et ne parlaient guère. Samuel<br />
Chapdelaine, qui les rencontrait pour la première fois, se crut autorisé à leur faire subir<br />
un interrogatoire, selon la candide coutume canadienne.” (144)<br />
=> canadianisme (subst. masc.) mentalité, attitude politique des Canadiens (Bélisle)<br />
Encycl.<br />
Canada était utilisé à l‟époque de l‟arrivée des premiers colons français de façon<br />
générale comme synonyme de Nouvelle-France, terme qui désignait toutes les terres<br />
appartenant à la France. La synonymie entre les deux mots n‟est pas parfaite, car le mot<br />
Canada ne s‟appliquait à proprement parler qu‟à la partie qui couvre les côtes du grand<br />
fleuve et du golfe du Saint-Laurent. Au fur et à mesure que les explorateurs français et les<br />
16
commerçants de fourrures avancent vers l'ouest et vers le sud, le territoire qu'on appelle le<br />
Canada s'agrandit. 1<br />
Etymol. et hist.<br />
Le nom Canada vient du mot huron-iroquois Kanata signifiant “village”,<br />
“agglomération”. 2 En Nouvelle-France, il commence d‟être attesté depuis 1538 :<br />
“Il y a entre les terres du su et celles du nort envyron trente lieues, et plus de deulx<br />
cens brasses de parfond. Et nous ont lesditz sauvaiges certiffyé estre le chemyn et<br />
commancement du grand fleuve de Hochelaga et chemyn de Canada, lequel alloit<br />
tousjours en estroissisant jusques à Canada [...].” (Jacques Cartier, The Voyages of<br />
Jacques Cartier, published from the originals with translations, notes and appendices,<br />
Ottawa, F.A. Acland, 1924, 106, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Canada apparaît pour la première fois dans le discours métalexical en 1851 (MARMIER<br />
X[avier], Lettres sur l'Amérique, t. 1, Paris, A. Bertrand éditeur, 1851, 151) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Encyclopédie canadienne – Fichier lexical du TLFQ – ILQ.<br />
CLAIR (adj.)<br />
1. libre (après avoir fini une activité)<br />
“ – […] Les racines n‟ont pas pourri dans la terre autant que j‟aurais cru. Je calcule<br />
2. disponible<br />
que nous ne serons pas clairs avant trois semaines.“ (61)<br />
“– Je vais travailler tout l‟été à deux piastres et demie par jour et je mettrai de l‟argent<br />
de côté, certain. […] Au printemps prochain j‟aurai plus de cinq cent piastres de<br />
sauvée, claires, et je reviendrai.”<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
être clair de (loc. verb.) être débarrasé de (DRFTN)<br />
Mots de la même famille<br />
clairer (vb. trans.) éclaircir (en parlant du temps) (Bélisle) => clairance (subst. fém.) congé<br />
(Bélisle)<br />
1 Ce paragraphe résume les données trouvées dans l‟Encyclopédie canadienne à la <strong>page</strong><br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0001216.<br />
2 Cette information se trouve dans l‟Encyclopédie canadienne à la <strong>page</strong><br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0001216.<br />
17
Etymol. et hist.<br />
Clair au sens de “libre (après avoir fini une activité)” est un calque par interférence<br />
sémantique sur l‟anglais clear (DRFTN).<br />
Pour le deuxième sens de l‟adjectif clair présent dans le roman Maria Chapdelaine, on<br />
peut avancer l‟hypothèse d‟un héritage de France. La raison de cette hypothèse est l‟existence<br />
en moyen français de certains syntagmes comme : argent clair “somme que l‟on verse<br />
comptant en prenant une livraison”, chose clere [sic] “argent comptant” (1462), fait cler [sic]<br />
(1462), clers deniers (1467) (FEW).<br />
Au sens de “disponible”, la première attestation de l‟adjectif clair est dans le roman<br />
Maria Chapdelaine. Dans le Fichier lexical du TLFQ, ce sens est attesté chez Claude-Henri<br />
Grignon, mais dix-sept années après la parution de Maria Chapdelaine :<br />
1933 : “Je paierais le père Blanchet, pis il vous resterait un beau cent piasses, clair.”<br />
(Claude-Henri Grignon, Homme, 36, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
L‟adjectif clair est attesté pour la première fois dans le discours métalexical en 1860<br />
([GINGRAS J.-F.], Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents,<br />
<strong>Québec</strong>, E.-R. Fréchette (impr.), 1860, 13) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Brasseur, P., DRFTN, 2001 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi −FEW.<br />
CLAIRER (vb. trans., pron.)<br />
éclaircir, dégager, libérer<br />
Rem.<br />
Le verbe n‟existe pas en français de France, ses sens étant désignés par des verbes<br />
synonymes : dégager, éclaircir, libérer, débarrasser, verbes qui se rencontrent également en<br />
français québécois.<br />
Etymol. et hist.<br />
Clairer est attesté dans les parlers régionaux de France, mais pas dans l‟Ouest (FEW,<br />
2, 741a, CLARUS). En français canadien, l‟usage du verbe s‟explique plutôt par une évolution<br />
locale que par la survivance et le maintien d‟une forme et d‟un sens rencontrés dans les<br />
parlers régionaux de France. La forme clairer serait donc un calque de l‟anglais to clear qui a<br />
18
les mêmes sens que le verbe français ou une évolution phonétique locale (aphérèse) du verbe<br />
éclairer sous l‟influence de l‟adjectif clair 1 (DRFTN).<br />
Le sens de ”dégager” est assez fréquent dans la presse et dans les œuvres littéraires :<br />
1882 : “Je me suis rendu hier chez notre bonne bourgeoise Mame Victorie. En entrant<br />
dans la salle la famille venait souper et la servante commençait à clairer la table.” (Le<br />
Grognard, 28 janv. 2, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1885 : “Les termes impropres sont choses communes dans la bouche de tous les<br />
peuples du monde. On en relève chez nous que nous avouons de bonne grâce. Par<br />
exemple : on dira tombe pour remblai ou terrassement ; l‟action d‟approfondir un<br />
fossé s‟exprimer [sic] par le verbe caler ; faire un découvert dans la forêt, c‟est<br />
clairer. […]” (Benjamin Sulte, Situation de la langue française au Canada, Montréal,<br />
Imprimerie générale, 16, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1981 : “− Il travaillait comme claireur et comme guide pour les Baptist, poursuivit ma<br />
grand-mère, et quand il n‟avait plus rien à clairer dans les hauts, il redescendait au<br />
village.” (Jean Pellerin, Au pays de Pépé moustache, Montréal – Paris, Stanké, 62-63,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part le sens présent dans le roman de Louis Hémon, le verbe clairer a d‟autres<br />
emplois en français canadien qui sont aussi valables pour le verbe anglais to clear:<br />
1. acquitter (trans.)<br />
1871 : “On pensait qu‟il allait nous clairer parce qu‟on ne se sentait pas fautif ; on ne<br />
2. licencier<br />
pensait pas que les témoins allaient jaser comme ils ont jasé sous serement [sic].”<br />
(Archives Nationales de <strong>Québec</strong> [les archives judiciaires], doc. d‟env. 1874, 4, d‟après<br />
le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1933 : “I‟dit, sire, i‟dit, j‟charche d‟l‟ouvrage. I‟dit, mon véritable métier, i‟dit, chus<br />
un bûcheron. Si vous avez d‟l‟ouvrage à me donner dans l‟bois…<br />
− Mais, i‟dit, tu t‟adonnes ben, i‟dit, j‟viens d‟éclairer mes neuf hommes à matin,<br />
là. Pis… i‟me faisaient pas d‟la bonne ouvrage, j‟les ai clairés.” (Luc Lacourcière,<br />
Archives de folklore, oct. 1949, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
3. (pron.) se débarrasser de qqch., se libérer de qqch.<br />
1980 : “C‟était trop beau, ou trop calme, ou trop plate, choisissez !/// Il était écrit<br />
quelque part dans les prophéties des temps anciens de l‟époque des Iroquois ou des<br />
1 Clairer est également attesté en créole antillais (Brasseur, DRFTN).<br />
19
Algonquins que Saint-Gildas ne pouvait se clairer d‟une assemblée sans chicane… Et<br />
bien ! argent comptant… et sonnant !” (Réal-Gabriel Bujold, Le p’tit ministre-les-<br />
pommes, [Montréal], Leméac, 172, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le verbe et ses sens multiples ont été pris en compte dans les ouvrages de lexicographie<br />
canadienne, mais le sens le plus fréquent est celui illustré dans l‟œuvre de Louis Hémon.<br />
Dans le discours métalexical, le mot apparaît depuis 1841 ([MAGUIRE Thomas], Manuel<br />
des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune âge et suivi d'un<br />
Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie (impr.), 1841, 145) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Brasseur, P., DRFTN, 2001 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – FEW.<br />
COUREUR DE BOIS (subst. masc.)<br />
chasseur et guide de chasse dans les forêts<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
donner retraite à un coureur de bois héberger secrètement un coureur de bois (<strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong>)<br />
Mots de la même famille<br />
coureux (subst. masc.) celui qui est agile à la course (GPFC) => courir (vb. trans.)<br />
poursuivre en courant Le chien a couru les vaches (Bélisle)<br />
Encycl.<br />
Le coureur de bois était un aventurier adapté à la vie en forêt possédant un permis qui<br />
l‟autorisait à aller dans les territoires amérindiens pour faire le commerce des pelleteries avec<br />
les autochtones, soit pour son propre compte, soit pour celui d'un marchand ou d'une<br />
entreprise avec lesquels il signait un contrat.<br />
Figure héroïque, folklorique de l'histoire canadienne, symbole d'errance,<br />
d'indépendance, de liberté, d'esprit d'aventure et de métissage avec les autochtones, le coureur<br />
de bois est considéré comme un des archétypes traditionnels des Canadiens français. 1<br />
Le type traditionnel du coureur de bois est représenté dans le roman Maria<br />
Chapdelaine par François Paradis.<br />
1 Ces deux paragraphes sont un résumé des données trouvées dans la <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>, à la Rubrique<br />
encyclopédique.<br />
20
Etymol. et hist.<br />
Coureur de bois (FEW 2, 1570b, I.1.e, CURRERE 1 ) découle de l‟expression courir les<br />
bois (variante de courir dans les bois), attesté au Canada à partir de 1616, surtout en parlant<br />
des Amérindiens. L‟emploi transitif du verbe courir est relevé en français depuis le début du<br />
XIII e siècle. Le mot coureur de bois s‟est appliqué ensuite aux Français qui imitaient les<br />
Amérindiens et qui faisaient de la contrebande avec des pelleteries. Il tient ses connotations<br />
négatives également de l‟emploi de coureur au sens de “débauché”, attesté en français depuis<br />
1566 d‟après TLFi et au sens de “libertin”, “vagabond”, attesté dans différents parlers du<br />
nord, du centre et de l‟ouest de la France, notamment sous la forme coureux. En anglais, le<br />
mot a donné lieu au calque wood(s)-runner. (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>).<br />
Le mot est attesté en Nouvelle-France à partir du XVII e siècle :<br />
1680 : “[...] il ne se trouve plus aucun coureur de bois dans toute l'étendue de Canada<br />
[...].” (Guy Frégault ; Marcel Trudel, Histoire du Canada par les textes, t.1, (1534-<br />
1854), éd. rev. et augm., Montréal-Paris, Fides, 55, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
Coureur de bois apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois<br />
en 1882 (Bédard T[héophile]-P[ierre], «A propos du mot 'habitant'», dans Nouvelles Soirées<br />
canadiennes, t. 1, n° 1-2, <strong>Québec</strong>, 1882 janvier, 42) (ILQ).<br />
La variante coureur des bois est attestée pour la première fois dans le discours<br />
métalexical québécois en 1894 (CHAMBERLAIN A[lexander] F., «The Life and Growth of<br />
Words in the French Dialect of Canada», dans Modern Language Notes, t. 9, n° 3, Baltimore,<br />
1894 mars, 69) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi<br />
– FEW.<br />
DÉJEUNER (subst.masc.)<br />
repas du matin, petit déjeuner, premier repas de la journée<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
préparer, faire le déjeuner (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) –> heure du déjeuner (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Mots de la même famille<br />
1 cf. courou de champ “batteur de campagne” (St-Maurice-de-l‟Exil) (FEW).<br />
21
déjeuner-dîner (vb. intrans.) prendre un déjeuner tardif, par ex. dimanche, à la maison<br />
(<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) => déjeuner-causerie (subst. masc.) conférence ou exposé présenté devant<br />
les convives réunis pour le repas du midi (ou, plus rarement, du matin) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Rem.<br />
Dans la langue soignée, au <strong>Québec</strong>, se rencontre aussi l‟expression petit déjeuner.<br />
Toujours dans ce registre de langue, déjeuner peut désigner le second repas de la journée<br />
(<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>).<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot et son sens présent dans le roman Maria Chapdelaine est un héritage de<br />
France. Il est attesté depuis 1634, mais seulement à partir de 1970 les lexicographes français<br />
donnent ce mot comme marque de référence au repas de matin. Déjeuner (FEW 3, 95a,<br />
DISJEJUNARE) a commencé de désigner le second repas de la journée dans la première moitié<br />
du XIX e siècle. Cette innovation sémantique originaire de Paris a été conditionnée par<br />
l‟évolution des pratiques sociales dans la Capitale. A Paris, l‟heure du second repas de la<br />
journée a commencé de connaître un déplacement de plus en plus accentué vers la fin de<br />
l‟après-midi et le début de la soirée. “Par ricochet, le premier repas de la journée s‟est<br />
dédoublé, donnant lieu à un repas très léger pris au lever, et à un autre, beaucoup plus<br />
substantiel, pris en fin de la matinée“ (DRF). Tout le système de la désignation des repas y<br />
subit à cette époque-là un déplacement qui a eu pour conséquence l‟apparition du petit-<br />
déjeuner et l‟abandon du mot souper. Cette réorganisation du système ne s‟est pas imposée<br />
dans toute la France et encore moins dans les communautés francophones situées à l‟extérieur<br />
de la France. Déjeuner au sens de “premier repas de la journée” est courant non seulement au<br />
Canada, mais aussi en Belgique (d‟où il est passé au Rwanda) ainsi qu‟en Suisse. En France,<br />
il est courant dans les dialectes de nord-ouest, du nord, du nord-est et dans le Midi (DHFQ,<br />
<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>, DRF).<br />
En Nouvelle-France il est attesté à partir du XVII e siècle :<br />
1635 : “Pour ne m'éloigner davantage de mon chemin, si tost qu'il est jour chacun se<br />
prepare pour déloger, on commence [...] par le déjeuner, s'il y a dequoy; car par fois<br />
on part sans desjeuner, on poursuit sans disner et on se couche sans souper [...].” (Paul<br />
Le Jeune, The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of the<br />
Jesuit Missionaries in New France, ed. by Reuben Gold Thwaites, Cleveland,<br />
Burrows Brothers Company, t. 7, 110, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part le sens présent dans l‟œuvre de Louis Hémon, le mot a aussi le sens de “repas<br />
de noces faisant suite à un mariage célébré dans la matinée” :<br />
22
1874 : “Le lundi suivant ils étaient mariés, et au déjeuner qui suivit la messe<br />
nuptiale, Jean me disait joyeusement : - Sans l'amour, vois-tu, Henri, la vie n'est rien.”<br />
(Faucher de Saint-Maurice, À la brunante, 157, d‟après <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>, déjeuner –<br />
Citations)<br />
Déjeuner est employé aussi comme verbe intransitif exprimant l‟action de prendre le<br />
repas du matin, le premier repas de la journée :<br />
1788 : “Ceux qui souhaiteront loger chez lui, y trouveront des bons lits, et s'ils jugent<br />
à-propos de déjeuner avant de partir le matin, ils auront s'ils le desirent, du Thé, du<br />
Caffé ou du Chocolat.” (La Gazette de <strong>Québec</strong>, 10 juillet, 3, d‟après <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>,<br />
déjeuner – Citations)<br />
Le verbe se rencontre au Canada, à Terre-Neuve et en Louisiane (DRFTN).<br />
Déjeuner est un exemple classique de maintien d‟un archaïsme en périphérie. Ce n‟est<br />
que depuis le début des années 1970 que la lexicographie française donne cet emploi comme<br />
marqué. Le mot possède encore le sens de “premier repas de la journée” dans de nombreuses<br />
zones de la France : En Normandie, en Lorraine, dans le Haut-Jura, dans la Côte-d‟Or, l‟Ain,<br />
le Rhône, l‟Isère, ça et là dans le Midi, dans les régions rurales. Il est également courant en<br />
Belgique (d‟où il est passé au Rwanda) et dans toute l‟Amérique francophone. Aucun<br />
dictionnaire français ne rend bien compte de l‟extension géographique du mot (DSR).<br />
Le verbe déjeuner apparaît pour la première fois dans le discours métalexical<br />
québécois en 1841 ([MAGUIRE Thomas], Manuel des difficultés les plus communes de la<br />
langue française, adapté au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>,<br />
Fréchette et Cie (impr.), 1841, 321). Le nom déjeuner apparaît pour la première fois en 1904<br />
(Rivard-Laglanderie A., «Compte rendu de l'Atlas linguistique de la France de J. Gilliéron et<br />
E. Edmont», dans BPFC, t. 3, n° 2, 1904 oct., 67) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Brasseur, P., DRFTN, 2001 – DRF, 2001 – DSR, 2004 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du<br />
TLFQ – ILQ – TLFi – FEW.<br />
DÉPAREILLÉ (adj.)<br />
sans comparaison, exceptionnel<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
sans dépareillé sans comparaison (GPFC)<br />
23
Etymol. et hist.<br />
Le sens de l‟adjectif dépareillé présent chez Louis Hémon est spécifique pour la<br />
variété québécoise. Il est enregistré dans le TLFi avec la mention “région. (Centre et<br />
Canada)”.<br />
Le mot commence d‟être attesté en français québécois à partir de la première moitié<br />
du XIX e siècle :<br />
1918 : “Donc, il est huit heures du soir à la grande horloge de chêne brun. Assis<br />
devant le poêle à fourneau qui se dresse au beau mitan de la place, le Père Louis<br />
Robichaud du Petit Village fume tranquillement sa pipe avec Joseph qui a depuis<br />
longtemps [sic] faire son train. La maman achève de laver sa vaisselle pendant que<br />
Marie-Louise qui est alerte et dépareillée voyage assidûment de l'armoire au salon,<br />
du salon à l'armoire, sans doute pour quelques mystérieux préparatifs.” (Paul-Emile<br />
Lavallée, Les premiers coups d'ailes, Montréal, Les Clers de Saint-Viateur, 1, d‟après<br />
le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Dépareillé a en français de France le sens principal “qui est séparé d‟un ou de plusieurs<br />
autres objets avec lesquels il formait un ensemble assorti”, sens qui est enregistré aussi dans le<br />
Dict. québécois d’aujourd. et dans le TLFi:<br />
“un volume dépareillé de Racine” (MICHELET, Peuple, 1846, 107, d‟après TLFi).<br />
Le mot apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en 1880<br />
(DUNN Oscar, Glossaire franco-canadien et vocabulaire de locutions vicieuses usitées au<br />
Canada, <strong>Québec</strong>, Imprimerie A. Côté et Cie, 1880, 59) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi.<br />
DÎNER (subst.masc., vb. intrans.)<br />
1. (subst.masc.) repas de midi, déjeuner<br />
2. (vb. intrans.) prendre le repas de midi<br />
Mots de la même famille<br />
dîner-causerie (subst.masc.) conférence ou exposé présenté devant des convives réunis pour<br />
le repas du soir (ou, plus rarement, du midi) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) –> dînette (subst. fém.) partie<br />
d‟une cuisine ou petite pièce spécialement aménagée avec un comptoir ou une petite table et<br />
quelques sièges pour prendre des repas simples ; coin-repas (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) –> dîneur<br />
(subst. masc.) personne qui prend part à un dîner avec d‟autres ; personne qui mange le midi<br />
dans un lieu public (restaurant, cafétéria) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
24
Etymol. et hist.<br />
Comme le substantif déjeuner, dîner (FEW 3, 94b, 95a, DISJEJUNARE) est un héritage<br />
de France. L‟emploi de dîner en parlant du repas du midi est attesté depuis le Moyen Âge en<br />
français. Dans l‟usage de Paris, l‟heure des repas s‟est graduellement déplacée et, par<br />
conséquent, le mot dîner a commencé de désigner le repas du soir. (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Le sens de “repas de midi“ est attesté en Nouvelle-France depuis le XVIII e siècle :<br />
1738: “Nous fimes un bon feu, autant pour nous secher que pour aprêter le dîner.<br />
Nicolas avoit déja mis la chaudière sur le feu avec un peu de farine, dont il vouloit<br />
faire une bouillie ou plutôt une Sagamité, car il commençoit aussi à s'y mettre des<br />
pois & du lard, lorsque le sauvage Abenakis leur dit, que le deux canadiens nous<br />
avoient vû échouer & qu'ils ne venoient que de disparoître.” (Claude Le Beau,<br />
Avantures du Sr. C. Le Beau, avocat en parlement, ou Voyage curieux et nouveau<br />
parmi les Sauvages de l'Amérique septentrionale, Yorkshire - New York - The<br />
Hague, S. R. Publishers Limited - Johnson Reprint Corporation - Mouton & Co.<br />
N.V., 1966, 132, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le verbe au sens de “prendre le repas de midi” est attesté en Nouvelle-France à partir<br />
de la première moitié du XVII e siècle :<br />
1609: “Et cependant que nous voguions par le milieu du port, voici que Membertou,<br />
le plus grand sagamos des Souriquois, vint au fort français [...] crier comme un<br />
homme insensé, disant en son langage : «Quoi! vous vous amusez ici à dîner (il était<br />
environ midi), et ne voyez point un grand navire qui vient ici [...].” (Marc Lescarbot,<br />
Histoire des Canadiens-français, 1608-1880: origine, histoire, religion, guerres,<br />
découvertes, colonisation, costumes, vie domestique, sociale et politique,<br />
développement, avenir, Montréal, Éditions Élysée, t. 1, 1977, 62, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
Le mot est un archaïsme largement maintenu dans plusieurs pays francophones :<br />
Suisse, Belgique (d‟où il est passé au Zaïre et au Rwanda) et dans toute l‟Amérique<br />
francophone. En France, il se rencontre dans les régions suivantes : Nord, Normandie,<br />
Bretagne, Lorraine, Alsace, Champagne, Bourgogne, Franche-Comté, Ain, Isère, Lyonnais,<br />
Auvergne, Midi. Aucun dictionnaire français ne rend bien compte de l‟extension diatopique<br />
du mot (DSR).<br />
Le nom dîner est attesté dans le discours métalexical depuis 1908 (ROULLAUD<br />
Henri, Rectification du vocabulaire, Montréal, A. Bouesnel éditeur, 1908, 11). Le verbe dîner<br />
apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en 1841 (MAGUIRE<br />
25
Thomas, Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune<br />
âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie (impr.), 1841, 35)<br />
(ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Brasseur, P., DRFTN, 2001 – DRF, 2001 – DSR, 2004 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> et<br />
Louisiane – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi – FEW.<br />
DRAVE (subst. fém.)<br />
transport des billots de bois par flottage<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
faire la drave (loc. verb.) pratiquer le métier de la drave (Fichier lexical de TLFQ)<br />
Mots de la même fam.<br />
draver (vb. trans.) faire flotter des troncs d'arbres sur un cours d'eau pour les acheminer<br />
jusqu'à leur destination (Fichier lexical de TLFQ)<br />
Encycl.<br />
La drave, occupation très répandue dans le nord de l‟Amérique vers le début du XX e<br />
siècle, consistait à diriger les billes jusqu‟à la scierie ou à l‟usine. A la fin de la saison, au<br />
printemps, les bûcherons se faisaient “draveurs”. Munis d‟une graffe, ils dirigeaient les troncs,<br />
prévenaient les embâcles ou les défaisaient à la dynamite.<br />
Le flottage du bois a cessé depuis le milieu des années „80 afin de protéger<br />
l‟environnement car il était une menace pour certaines espèces animales (poissons) de même<br />
que pour la flore aquatique. 1<br />
La vie des bûcherons, qui devenaient des draveurs après l‟abattage des arbres, est<br />
comparée par Louis Caron dans son livre La tuque et le béret à la vie des moines. Isolés dans<br />
leurs forêts pendant les longs mois de l‟hiver, logés dans des camps dépourvus d‟installations<br />
sanitaires, mal nourris, ils exerçaient le métier dangereux de la drave quand ils devaient<br />
surveiller le flottage des billes sur les rivières.<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot drave est un déverbal du verbe draver, qui est un emprunt direct à l‟angl. to<br />
drive “conduire les billes sur les rivières”.<br />
1 Ces informations sont un résumé des idées trouvées dans l‟Encyclopédie canadienne à la <strong>page</strong><br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0008014.<br />
26
Il est attesté depuis la deuxième moitié du XIX e siècle, période où l‟occupation<br />
désignée par le terme était très fréquente au nord de l‟Amérique :<br />
1890 : “- Avez-vous offert quelque chose à l'autre veuve, Mme Leblanc?<br />
- Oui, Monsieur, je lui ai offert cinquante piastres.<br />
- A peu près dans le même temps?<br />
- C'est une secousse après [...] Le témoin est contremaître de la drave<br />
et quatre de ses ouvriers se sont noyés.” (Archives Nationales de <strong>Québec</strong>, Cour<br />
d‟appel de <strong>Québec</strong>, Artabasca, 15, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1914 : “[...] s'il lui faut parfois employer un mot anglais, il le francise, et de<br />
meeting il fait «mitaine», de climber «clameur», de drive «drave», de peppermint<br />
«papermane», de pouding «poutine» [...].” (Adjutor Rivard, Etudes sur les parlers<br />
de France au Canada, <strong>Québec</strong>, 55, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1937 : “Que l'auteur de Menaud emploie couramment des beaux mots du pays de<br />
<strong>Québec</strong>, tels que «drave», «draveur», «bleuetière», «abatis», «corps-morts»,<br />
«portage», «boucane», «poudrerie» et combien d'autres, nous devons l'en féliciter.<br />
Mais là surtout, où il honore le génie de la langue, c'est lorsqu'il utilise des<br />
vocables ou des expressions essentiellement de France, qui existent encore au<br />
Canada français et que seul un écrivain de talent et de goût pouvait nous offrir.<br />
Jugez : «collets de chasse», «tissure», «on venait de cuire», «chemins balisés»,<br />
«icitte», «veilleux», «bourdignons», «une perdrix se mit à battre», «avoir des<br />
mottons dans la gorge», «l'embruni», «mangeaille», «crique», «seillon», (pour<br />
sillon), «escousse», «talle», «la belle défaite qu'il se donne», «faire un ravaud» et<br />
peut-être une vingtaine d'autres plus beaux encore.” (Valdombre, Les pamphlets de<br />
Valdombre, Ste-Adèle, Claude-Henri Grignon, 392-393, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
1963 : “Les compagnies de bois ont à peu près toujours été anglaises. La piastre<br />
étant anglaise, le langage fut anglais. D'où les canadianismes d'origine anglaise :<br />
drave, cantouque, boume, couque, dam, raffmanne, etc.” (Godin, Ecrits et parlés<br />
I : 1. Culture, Montréal, Editions de l‟Hexagone-Gérald Godin, 31, d‟après le<br />
Fichier lexical du TLFQ)<br />
1970 : ”Le commerce du bois prenant chaque année plus d'importance, le transport<br />
de l'outillage, des vivres et des chevaux, fit abandonner les barges dites de drave.<br />
On ne les utilisa que pour le flottage des billes. Le chaland, embarcation d'une plus<br />
27
forte capacité, fit alors son apparition. [/] Les chalands d'un tonnage de vingt mille<br />
livres, construits presque exclusivement aux Piles, mesuraient cinquante pieds de<br />
long par neuf pieds de large. Ils étaient rectangulaires, l'avant et la poupe<br />
légèrement relevés et taillés en biseau. Certains possédaient à la poupe une cabine<br />
rudimentaire ou tout simplement un toit de toile soutenu par des poteaux.”<br />
(Normand Lafleur, La drave en Mauricie des origines à nos jours : histoire et<br />
traditions, Trois-Rivières, Editions du Bien public, 85-86, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1979 : “Au 19 e siècle, l‟exploitation de la forêt donnera lieu à deux industries<br />
différentes : à celle du bois de pièce et à celle du bois scié. Dans le premier cas, les<br />
pièces de bois étaient taillées en forêt, puis descendues (à la drave) jusqu‟à la<br />
Grande-Rivière. Là, on construisait des «cages» ou «rafts», immenses trains de<br />
pièces de bois que l‟on faisait flotter jusqu‟au port de <strong>Québec</strong>. C‟étaient les<br />
«raftsmen» qui, s‟aidant de perches, de voiles et plus tard de remorqueurs à<br />
vapeur, étaient chargés d‟accomplir cette tâche.” (Robert Choquette, Villages et<br />
visages de l’Ontario français, Toronto-Montréal, Office de la télécommunication<br />
éducative de l‟Ontario-Editions Fides, 9, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part du sens du mot présent dans le texte de Louis Hémon, la drave désigne aussi, par<br />
métonymie, la période pendant laquelle on pratique ce métier :<br />
1936 : “Et comme il n'y a pas de bordels ni de cafés de nuit à Sainte-Catherine, pour la<br />
bonne raison que la plupart des filles fourrent pour le seul plaisir, je remets mes vacances<br />
à ma rentrée en ville, après la drave, au printemps prochain.” (Hector de Saint-Denys<br />
Garneau, Lettres à ses amis, Montréal, Editions HMH, 190, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ).<br />
En français de France, le mot synonyme de drave est flottage. Il se rencontre<br />
également en français québécois, mais on préfère quand-même le terme drave.<br />
Dans le discours métalexical québécois, le mot apparaît depuis 1880 (CARON<br />
N[apoléon] (abbé), Petit vocabulaire à l'usage des Canadiens-français, contenant les mots<br />
dont il faut répandre l'usage, et signalant les barbarismes qu'il faut éviter, pour bien parler<br />
notre langue, Trois-Rivières, Journal des Trois-Rivières (impr.), 1880, 24, 58) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 − Brasseur, P., DRFTN, 2001 – Fichier lexical du TLFQ –<br />
ILQ – TLFi.<br />
28
DRAVEUR (subst. masc.)<br />
ouvrier qui travaille à la drave<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot est un dérivé du verbe draver “faire la drave”, ou un emprunt avec adaptation<br />
morphologique du mot anglais driver, de même sens.<br />
Il se rencontre dans les œuvres littéraires du début du XX e siècle :<br />
1937 : “Cela s'intitule: Menaud, maître-draveur, et l'auteur s'appelle Savard. [...]<br />
L'intrigue rappelle (mais sans aucune imitation) La Brière. C'est un bonhomme,<br />
coureur de bois, «maître-draveur», qui est indigné de voir le patrimoine ancestral,<br />
grâce à la lâcheté de la race, être dilapidé par les étrangers” (Hector Saint-Denys<br />
Garneau, Lettres à ses amis, Montréal, Editions HMH, 292-293, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1971 : “Au printemps, les lacs «calent» et la fonte des neiges grossit les cours<br />
d'eau. C'est l'époque de la «drave» ou de la descente du bois sur les ruisseaux et les<br />
rivières. Les bûcherons se font «draveurs». Le métier de «draveur» est périlleux ;<br />
il exige des qualités d'endurance physique et d'agilité peu communes.” (Jean<br />
Hamelin, Roby, Yves, Histoire économique du <strong>Québec</strong>, 1851-1896, Montréal,<br />
Fides, 215-216, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1973 : “L'enquête orale que nous avons menée auprès des coureurs de bois dans les<br />
régions de l'Outaouais, de la Mauricie et de Charlevoix nous a permis de relever la<br />
permanence de ces techniques et, grâce aux imprimés, de les comparer, à<br />
l'occasion, à celles du 17 e siècle. [...] Comme le chasseur du 19 e et 20 e siècle fut<br />
aussi, à l'occasion, un bûcheron et un draveur, nous avons décrit les moeurs, la vie<br />
et le travail du forestier.” (Normand Lafleur, La vie traditionnelle du coureur de<br />
bois aux XIX e siècle et XX e siècle, [Montréal], Leméac, 69, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
Dans le discours métalexical québécois, le mot est attesté depuis 1880 (Petit vocabulaire à<br />
l'usage des Canadiens-français, contenant les mots dont il faut répandre l'usage, et signalant<br />
les barbarismes qu'il faut éviter, pour bien parler notre langue, Trois-Rivières, Journal des<br />
Trois-Rivières (impr.), 1880, 24, 58) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 − Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi.<br />
29
FLEUR (subst. fém.)<br />
farine<br />
Rem.<br />
chose”(TLFi).<br />
En France, le sens courant du substantif fleur est la “partie la plus belle d‟une<br />
Etymol. et hist.<br />
Fleur au sens de “farine” est un héritage des parlers de France qui, en français<br />
québécois, commence d‟être attesté à partir du XVIII e siècle :<br />
1789 : “pour 6 quarts de fleur à 6 piastres, 216 [livres]” (AUQ, oct. 1789, 325,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot est attesté dans les parlers du <strong>Québec</strong> et de l‟Acadie ainsi qu‟en Louisiane. Les<br />
dictionnaires français (TLF 8, 974b) considèrent comme un régionalisme du Canada cet<br />
emploi d‟origine bas-normande qui s‟étend dans l‟ouest de la France jusqu‟à la côte nord de la<br />
Bretagne (FEW 3, 632a, II.2, FLOS).<br />
Le mot apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois dans les<br />
contextes suivantes : fleur d’avoine – 1979 (DORION Jacques, Les écoles de rang au<br />
<strong>Québec</strong>, Montréal, Les éditions de l'Homme, 1979, 419), fleur de farine – 1876 (DUNN<br />
Oscar, Dix ans de journalisme. Mélanges, Montréal, Duvernay frères et Dansereau éditeurs,<br />
1876, 267) et fleur de farine de maïs – 1902 (Anonyme, «Fautes à corriger», dans L'Union<br />
des Cantons de l'Est, Arthabaska (<strong>Québec</strong>), 1902, 11 avril, 1) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi.<br />
FOREMAN (subst. masc.)<br />
contremaître, chef d‟équipe, chef d‟atelier, chef de chantier, agent de maîtrise, boss<br />
Etymol. et hist.<br />
Foreman [fORman] est un emprunt direct au mot anglais qui a la même forme et<br />
la prononciation [fORmFn]. Il a subi au passage dans la variété québécoise deux<br />
adaptations phonétiques.<br />
Il est inconnu en français de France (FEW 18, 64b, I, FOREMAN) où son sens est<br />
exprimé par l‟un des termes : chef, contremaître, agent de maîtrise, noms qui sont en usage<br />
aussi au Canada.<br />
30
Il apparaît dans les œuvres littéraires et dans les articles des journaux québécois assez<br />
fréquemment :<br />
1873 : “− Avez-vous un bourgeois ?<br />
− Pas encore, mais il paraît que l‟ouvrage ne manque pas.<br />
− C‟est égal ; c‟est toujours mieux d‟avoir son homme d‟avance. Voulez-vous<br />
travailler pour mon boss ? Un homme propre ; […] ça n‟est pas trop dur au pauvre<br />
monde, et ça paye comme un anglais. Tel que vous me voyez, je suis un de ses<br />
foreman.” (Napoléon Légendre, « Le voyageur », dans Album de la Minerve,<br />
Montréal, 13 mars, t. 2, 180, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1899 :“Je watchais surtout deux véreux de sauvages qu‟avaient l‟air de manigancer<br />
queuque [sic] frime avec not‟ foreman.” (La Presse, 23 déc., 2, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1953 : “A la fin du dîner, aujourd‟hui, le foreman a annoncé que les portageux<br />
arriveraient cette semaine […].” (Pierre Dupin, Anciens chantiers du Saint-<br />
Maurice, Trois-Rivières, Editions du Bien public, 108, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
1962 : “Mon père était foreman pour les vieux Price. Il a resté quasiment rien qu‟à<br />
Laterrièrre. Il avait deux frères / Raphael et Célestin. Raphaël était marié à une<br />
Morin” (Léo Potvin (coll.), « Mémoires d‟un ancien : Pierre Desbiens », dans<br />
Saguenayensia : revue de la Société historique de Saguenay, Chicoutimi, t. 4, n° 6,<br />
125, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le terme a été pris en compte par la lexicographie québécoise, mais son interprétation<br />
ne pose pas de problèmes spéciaux. C‟est pourquoi les articles qui lui sont consacrés dans les<br />
dictionnaires sont assez courts.<br />
Dans le discours métalexical, le mot apparaît depuis 1818 («[sans titre]», dans<br />
L'Aurore, Montréal, 1818 18 avril, 62, 63) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Ditchy, J. K., Les Acadiens louisianais…, 1932 −Bélisle, 1957 − Fichier lexical du TLFQ –<br />
ILQ – TLFi – Ø FEW.<br />
GAGES (subst. fém. pl.)<br />
somme que l‟on verse mensuellement ou annuellement pour payer les services d‟un<br />
domestique ou d‟un ouvrier, salaire<br />
31
Expr., loc. et syntagmes<br />
travailler à gages (loc. adv.) être payé à l‟heure (DRFTN) → travailleur à gages (loc. nom.)<br />
ouvrier salarié (Fichier lexical du TLFQ, exemple 66) → de bonnes / grosses gages # de<br />
maigres gages (Fichier lexical du TLFQ, exemple 54)<br />
Mots de la même famille<br />
engager 1 (vb. trans.) 1. embaucher, recruter, prendre à gages, attacher à son service par un<br />
contrat de travail 2. lier une personne ou son existence par une promesse de fidélité<br />
concernant sa vie sentimentale ou spirituelle, promettre en mariage, fiancer => engagé (adj.)<br />
indiquant le statut de salarié et de subalterne ex. : voyageur engagé (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Rem.<br />
(DRFTN).<br />
Gages est un nom féminin au Canada alors qu‟en français de France il est masculin<br />
Etymol. et hist.<br />
En français québécois, la présence du mot s‟explique par le maintien de sa forme et de son<br />
sens du français de France (FEW 17, 441b, I., *WADDI), cf. néerl. Wedde, a. all. wetti “gages,<br />
amende”, all. Wette “pari”. Il n‟est pas exclu que le lat. vas, vadis “caution” ait pu participer<br />
à la naissance du mot (TLFi).<br />
Gages au sens de “salaire”, “appointement” se rencontre sous diverses formes dans<br />
plusieurs régions dialectales : Dauphiné (gajos), Givet (gâdjes), Haut-Maine (gaige “salaire<br />
annuel d‟un domestique”) etc. (FEW).<br />
Il est attesté en Nouvelle-France depuis le XVII e siècle car il exprime une notion de la vie<br />
courante :<br />
1614 : “ La malheur a voulu que ceste année n'a ressemblé à l'an passé pour le regard de la<br />
pelleterie. Je n'ay peu faire que trois cens septante-sept castors, que je vous envoye avec<br />
cinquante-deux peaux d'orignac. Je vous envoye un mémoire par lequel verrez ce qui<br />
appartient de castors pour le voyage passé et pour celuy-cy; ensemble, ce qui est à moy,<br />
dont vous disposerez. J'ay faict mettre ce que j'ay peu de bois dans le navire. Je vous<br />
envoye les quittances des gages des hommes qui ont hyverné à l'habitation avec moy,<br />
lesquels j'ay payez ou rendus contens, ou peu s'en faut; ensemble, un mémoire pour rendre<br />
compte aux Pères jésuites pour le voyage passé.” (Anonyme, Monumenta Novae Franciae<br />
T. 1 La première mission d'Acadie (1602-1616), Roma-<strong>Québec</strong>, Monumenta Historica<br />
1 Ce sens est enregistré dans TLFi comme étant spécifique au français québécois.<br />
32
Societatis Jesu, Les Presses de l'Université Laval, 372, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
1645 : “Le 17 fut receu a nostre Service chrestiennant à trente escus de gages par an [...].”<br />
(Jérôme Lalemant, Le journal des Jésuites, <strong>Québec</strong>, Léger Brousseau imprimeur-éditeur,<br />
1871, 7, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1885 : “Les gages pour <strong>Québec</strong> sont de £ 35 [livres] par mois, avances ordinaires.” (La<br />
Presse, 4 mai, 1, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Dans le discours métalexical québécois, le mot apparaît depuis 1841 ([MAGUIRE<br />
Thomas], Manuel des difficultés les plus communes de la langue française, adapté au jeune<br />
âge et suivi d’un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie (impr.), 1841, 153)<br />
(ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 − − Ø DRF, 2001 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi –<br />
FEW.<br />
HABITANT (subst. masc.)<br />
cultivateur, fermier, propriétaire, paysan<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
beurre d’habitant (loc. nom.) beurre fabriquée à la ferme, artisanalement (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
–> pain d’habitant (loc. nom.) pain de confection artisanale, fait à la maison (<strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong>) –> faire l’habitant agir avec mesquinerie (Clapin)<br />
Mots de la même famille<br />
s’habiter (vb. pron.) s‟installer (DRFTN)<br />
Rem.<br />
Le mot habitant est archi-connu en français colonial et s‟est perpétué dans les îles et<br />
en français d‟Amérique.<br />
Etymol. et hist.<br />
Le nom est un héritage de France inventorié dans le TLFi comme “régionalisme” au<br />
sens de “paysan”, “cultivateur” 1 Ce sens était attesté dans le français du XVII e siècle. Il est<br />
attesté en Nouvelle-France à partir du XVII e siècle :<br />
1665 : “[...] le tempérament que l'on y pourroit apporter seroit, par exemple, qu'un<br />
habitant qui auroit une concession pour 500 arpens de terre dont il n'auroit défriché<br />
1 FEW 4, 369a, I.1.a, HABITARE.<br />
33
que 50 arpens, en abbandonneroit cent arpens au nouveau François qui viendroit<br />
s'habituer au pays; à quoy s'il s'opposoit, on pourroit mesme le menacer de luy oster<br />
toutes celles qu'il n'auroit pas encore mises en culture, et effectivement en cas de<br />
besoin, il sera expédié une déclaration pour estre enregistrée aud. Conel Souverain<br />
de <strong>Québec</strong>, portant que lesd. habitans seront obligez de défricher toutes les terres qui<br />
leur ont esté concédées [...].” (Jean Talon, «Correspondance échangée entre la cour<br />
de France et l'intendant Talon pendant ses deux administrations dans la Nouvelle-<br />
France», dans Rapport de l'archiviste de la province de <strong>Québec</strong> pour 1930-1931,<br />
[<strong>Québec</strong>], Rédempti Paradis, 1931, 8, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Sylva Clapin affirme dans son dictionnaire qu‟une explication très intéressante du mot<br />
habitant est donnée par les chasseurs d‟animaux à fourrures. Ceux-ci disent qu‟un animal<br />
devient habitant lorsqu‟il tend à se fixer dans un certain endroit et quand il manifeste un<br />
retour à des habitudes relativement régulières. Il s‟agit ici d‟un sens secondaire du mot<br />
habitant.<br />
Habitant se dit également dans les zones acadiennes et en Louisiane (<strong>BDLP</strong>-Louisiane).<br />
Dans la zone de l‟Océan Indien et dans les Caraïbes, on emploie la variante zhabitant<br />
(<strong>BDLP</strong>-Louisiane et Réunion). En Suisse, le mot habitant désigne une personne simple, qui a<br />
le droit de résider dans une commune moyennant bon comportement et payement d‟une taxe<br />
(FEW).<br />
Le mot apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en 1818<br />
(Anonyme, «Un solitaire, n° 3», dans L'Aurore, Montréal, 1818, 5 déc., 2) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Clapin, 1894 – Bélisle, 1957 – Brasseur, P., DRFTN, 2001 – Ø DRF, 2001– <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>,<br />
Louisiane et Réunion – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi − FEW.<br />
HEURE (subst. masc.)<br />
(dans la loc. adv. à cette heure) maintenant, de nos jours (par rapport à un moment passé)<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
heures de bureau (loc. nom.) période pendant laquelle un médecin, un avocat est disponible<br />
pour recevoir des patients (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
34
Etymol. et hist.<br />
La locution adverbiale à cette heure présente dans le texte de Louis Hémon a aussi les<br />
formes graphiques asteur et astheure 1 (<strong>BDLP</strong>-Acadie et Louisiane). Elle est un héritage de<br />
France qui se rencontre encore dans les régions suivantes : Yvelines, Nord, Pas-de-Calais,<br />
Picardie, Normandie, Indre-et-Loire, Bretagne, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Eure-et-<br />
Loire, Loire-et-Cher, Champagne, Ardennes, Lorraine (DRF).<br />
En français Nouvelle-France, elle est attestée à partir du XVII e siècle :<br />
1639 : “Nous avons tous ressenti le mal de la mer ; mais cela n'est rien : Nous<br />
sommes à cette heure dans une aussi bonne disposition que si nous étions dans notre<br />
Monastère.“ (Marie Guyart, Marie de l'Incarnation Ursuline (1599-1672):<br />
correspondance, nouv. éd. par Dom Guy Oury, Solesmes, Abbaye Saint-Pierre, 1971,<br />
86, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Dans le discours métalexical, à cette heure est attestée depuis 1879 (BIBAUD<br />
[Maximilien], Le mémorial des vicissitudes et des progrès de la langue française en Canada,<br />
Montréal, J.-B. Byette, 1879, 4) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – DRF, 2001 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>, Acadie et Louisiane – Fichier lexical du TLFQ –<br />
ILQ – TLFi – FEW.<br />
JOB (subst. fém. et masc.)<br />
travail, tâche (souvent difficile)<br />
Rem.<br />
En français de France, le mot job est toujours masculin (TLFi).<br />
Mots de la même famille<br />
jobbable (adj.) qu‟on peut entreprendre à forfait (GPFC) => jobbage (subst. masc.) action de<br />
jobber (GPFC) => jobber (vb. trans., intrans.) 1. entreprendre un ouvrage à forfait ; 2. faire<br />
négligemment un ouvrage (GPFC) => jobbeur (subst. masc.) 1. celui qui entreprend un<br />
ouvrage à forfait ; 2. spéculateur qui achète en gros des marchandises pour les revendre aux<br />
détaillants ; 3. ouvrier à la tâche ; 4.ouvrier typographique employé aux ouvrages de ville<br />
(GPFC)<br />
1 Asteure / steur est enregistré depuis le moyen français et est largement répandu dans les parlers d‟oïl (FEW 4,<br />
468ab, I.2.α, HORA). Il est considéré comme populaire, vieilli ou régional (TLF 9, 813b) ou encore vieilli ou<br />
rural. Il est bien attesté au Canada, Louisiane aussi bien que dans les créoles français. Steure, par aphèrese, a<br />
également été noté à l‟Ile-du-Prince-Edouard (DRFTN).<br />
35
Etymol. et hist.<br />
Job [dGOb] est un emprunt direct au mot anglais de même forme, prononcé<br />
[dGAb], avec adaptation phonétique ([A] > [O]).<br />
Job au sens présent dans le roman Maria Chapdelaine est attesté dans le Fichier<br />
lexical depuis 1912 :<br />
“C'est ben de valeur, une si belle «job» à l'année, pas de temps de perte!” (La Presse,<br />
suivants :<br />
2 nov. 1912, 4)<br />
A part le sens présent dans le roman de Louis Hémon, job peut avoir aussi les sens<br />
1. entreprise, affaire<br />
obtenir une bonne job “obtenir une bonne entreprise” (GPFC);<br />
frapper une job “trouver une affaire” (GPFC);<br />
2. forfait<br />
travailler à la job “travailler à forfait ou à la pièce” (GPFC);<br />
3. occasion, solde de marchandises<br />
vendre des jobs “faire une vente en solde” (GPFC);<br />
4. entreprise véreuse, tripotage 1<br />
monter une job “monter une entreprise véreuse”(GPFC).<br />
Le mot entre aussi dans la structure de la locution adverbiale à la job “sans soin” :<br />
Cet ouvrage ne vaut rien, c‟est fait à la job. (GPFC).<br />
Le mot job apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en 1860<br />
([GINGRAS J.-F.], Recueil des expressions vicieuses et des anglicismes les plus fréquents,<br />
<strong>Québec</strong>, E.-R. Fréchette (impr.), 1860, 22) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi – Ø FEW.<br />
MISÈRE (subst. fém.)<br />
1. difficulté, peine<br />
2. avoir de la misère avoir de la peine<br />
1. “−A cinq hommes, dit Eutrope, on fait gros de terre en peu de temps. Mais quand<br />
on travaille seul comme moi, sans cheval pour traîner les grosses pièces, ça n‟est guère<br />
d‟avance et on a de la misère.“ (67)<br />
1 Ces sens ne figurent pas dans le TLFi.<br />
36
Rem.<br />
2. “−J‟ai eu des nouvelles par Ferdinand Larouche, un garçon de Thadée Larouche de<br />
Honfleur, qui est revenu de la Tuque le mois dernier. Il a dit que ça [la drave] allait<br />
bien ; les hommes n’avaient pas trop de misère.” (67)<br />
3. “− De la misère, s‟exclama Légaré avec mépris. Les jeunes d‟à présent ne savent<br />
pas ce que c‟est que d‟avoir de la misère.” (68)<br />
4. “[…] Plusieurs familles de sauvages étaient déjà descendues à Sainte-Anne de<br />
Chicoutimi et on n‟a pas pu les voir ; et pour finir, ils ont chaviré un des canots à la<br />
descente en sautant un rapide et nous avons eu de la misère à repêcher les pelleteries<br />
sans compter qu‟un « boss » a manqué de se noyer, celui qui avait eu des fièvres.” (76)<br />
5. “− […] Voyez-vous, quand un garçon a passé six mois dans le bois à travailler fort<br />
et à avoir de la misère et jamais de plaisir, et qu‟il arrive à la Tuque ou à Jonquière<br />
avec toute la paye de l‟hiver dans sa poche, c‟est quasiment toujours que la tête lui<br />
tourne un peu.” (83)<br />
6. “ Là où les arbres sont pas mal drus on ne sent pas le vent. Je te dis qu‟Esdras et Da‟<br />
Bé n’ont pas de misère.” (105)<br />
7. “− […] Qu’il n’ait pas de misère dans le bois …” (105)<br />
Les sens communs du nom misère en français québécois et en français de France<br />
sont: (1) état d‟extrême pauvreté et (2) ensemble de gens qui vivent dans la misère (TLFi).<br />
L‟expression avoir de la misère à est caractéristique pour le <strong>Québec</strong>. En français de<br />
France on exprime respectivement le même sens par les expressions : avoir de la peine, avoir<br />
de la difficulté, avoir du mal à etc.<br />
Etymol et hist.<br />
L‟emploi du mot misère pour “peine”, “difficulté” est une particularité du français<br />
québécois par rapport au français de France. Le sens se rencontre aussi dans certains dialectes<br />
de l‟ouest de la France 1 , ce qui nous donnerait la possibilité d‟interpréter son évolution au<br />
Canada comme étant due au maintien d‟un sens d‟un parler régional de France.<br />
Le même sens existe en créole de Guadeloupe, en Louisiane et à Terre-Neuve 2 .<br />
Misère (FEW 6/2, 169ab, MISERIA) entre aussi dans la structure chercher misère à<br />
qqn “faire des misères à qqn”, qui est caractéristique pour la Belgique francophone (TLFi).<br />
A part le roman Maria Chapdelaine qui offre déjà beaucoup de contextes illustratifs,<br />
l‟expression apparaît aussi chez d‟autres écrivains canadiens à partir du XVIII e siècle :<br />
1 v Patrice Brasseur, DRFTN et FEW (avoir de la misère “avoir de la peine à faire qqch.” est attesté à Jonne).<br />
2 v. Patrice Brasseur, DRFTN.<br />
37
1752 : “Je luy donné tous les Ecclaircissements qui dependoient de moy, après quoy<br />
nous nous separames. J‟arrivé apres avoir Eu bien de la misere à Montreal le [il<br />
manque cette partie] 1 et j‟arrivé le [il manque cette partie] 2 à <strong>Québec</strong>, ou jay Eu<br />
l‟honneur de faire ma Reverence tres humble à Monsieur le Marquis DuQuesne et de<br />
luy remettre le présent journal signé le Gardeur de St. Pierre. [sic]” (Jacques<br />
Repentigny, « Mémoire ou journal sommaire du voyage de Jacques Repentigny<br />
Legardeur de Saint Pierre […] chargé de la découverte de la Mer de L‟Ouest », dans<br />
Rapport sur les archives canadiennes, 1886, Ottawa, Imprimerie Maclean, CLVI−<br />
CLVXIII, 1887, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1934 : “Dans ce temps-là on mangeait du pain fait avec de la farine de grain qui avait<br />
gelé. C‟était des petits pains de 7 pouces ; c‟était collant, on avait toutes les misères à<br />
le manger. On en a eu de la misère ! Malgré tout c‟était bon avec tout ça ; on<br />
ramassait des bleuets, des fraises et des framboises, on faisait la chasse ; il fallait dire<br />
qu‟on était bien.” (Victor Tremblay, Saguenayensia : revue de la Société historique du<br />
Saguenay, 1959, Chicoutimi, Société historique du Saguenay, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1962 : “Une fois, il y en avait un qui avait de la misère et qui jurait. Je pars pour lui<br />
aider ; je revire de bord et m‟en reviens, puis je retourne.” (V. Tremblay<br />
(collecteur), « Mémoires d‟un vieillard : Alex Gagnon », dans Saguenayensia : revue<br />
de la Société historique de Saguenay, Chicoutimi, t. 4, n° 1, 18-19, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
1989 : “Est-ce que les mouches ont des soucis comme nous ? s‟interrogeait l‟enfant.<br />
Est-ce qu‟elles ont parfois de la misère à dormir ?” (Yves Beauchemin, Juliette<br />
Pomerleau, Montréal, Editions <strong>Québec</strong>/Amérique, 656, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
A part les deux expressions qui apparaissent dans notre corpus à analyser, misère<br />
représente le noyau de deux autres expressions assez fréquentes en français québécois qui<br />
apparaissent aussi en français de France (TLFi) :<br />
− faire des misères 3 “causer de la peine, du tourment” :<br />
1895 : “− Or dans cette entrevue vous l‟avez informé que vous alliez lui faire des<br />
misères ?<br />
1 La notice appartient aux auteurs du Fichier lexical.<br />
2 v. la notice antérieure.<br />
3 Cette expression appartient au registre familier.<br />
38
− Il me dit qu‟il était magané, je venais de donner au collecteur, M. Adam,<br />
l‟action, c‟était malaisé de ne pas déclarer mon intention, j‟ai dit que j‟allais le<br />
poursuivre.” (Archives Nationales du <strong>Québec</strong>, 6 février, 9, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
1962 : “C‟était un vrai bel homme. Il les ont rejoints à La Malbaie ou à la Baie<br />
Saint-Paul. Quand il l‟a ramenée il leur a dit que, puisqu‟ils voulaient faire des<br />
misères, ils pouvaient la garder sans crainte, qu‟elle était encore fille. Mais ils les<br />
laissèrent se marier. C‟est là que j‟ai été marraine.” (Catherine Villeneuve −<br />
collectrice, « Mémoires d‟une ancienne Madame Ligori Bergeron », dans<br />
Saguenayensia : revue de la Société historique du Saguenay, Chicoutimi, t. 4, n° 2,<br />
32-34, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
−manger de la misère “subir des épreuves, avoir du mal à se tirer d‟affaires” :<br />
1932 : “Les temps sont trop durs. Ça veut pas dire qu‟un homme courageux, qu‟a<br />
pas peur de travailler, pourrait pas réchapper sa vie. Non ; ça veut pas dire ça ! Il y<br />
a toutes sortes de colons. Les uns réussissent où d‟autres font rien de bon. […] En<br />
tout cas, j‟aimerais mieux en arracher un peu, indépendant sur mes lots, qu‟être<br />
sans travail à Montréal et manger de la misère.” (Harry Bernard, Dolorès,<br />
Montréal, Editions Albert Lévesque, 223, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1994 : “J‟ai de quoi être fier, j’en ai mangé de la misère, à tout bout de champ<br />
dérangé, torturé, par les ouvriers des portes et châssis. Ils travaillent à l‟heure et il<br />
manquait toujours une bricole.” (Réjean Ducharme, Va savoir, Paris, Gallimard,<br />
80, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
L‟expression avoir de la misère fait pour la première fois l‟objet d‟un commentaire<br />
métalexical au <strong>Québec</strong> en 1880 (GINGRAS J.-F., Manuel des expressions vicieuses les plus<br />
fréquentes, 3 e édition, Ottawa, Imprimerie MacLean, Roger et Cie, 1880, 35) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 − Ditchy, J.K., Les Acadiens louisianais…, 1932 − Naud, Chantal, Dict.<br />
des rég. du fr. parlé des Iles- de- la-Madeleine, 1999 − Brasseur, P., DRFTN, 2001 – Fichier<br />
lexical du TLFQ– ILQ − TLFi −FEW.<br />
MOCASSIN (subst. masc.)<br />
chaussure plate, de marche ou de sport, en peau très souple (souvent en daim ou en<br />
maroquin), cousue sur le dessus, imitée de celle des Indiens de l‟Amérique du Nord :<br />
39
Rem.<br />
En général, la forme ayant le sens présent dans le roman Maria Chapdelaine est<br />
employée au pluriel (mocassins). Le mot est enregistré aussi dans le TLFi, mais par référence<br />
à des contextes québécois (la citation qui doit illustrer le terme est extraite du roman Maria<br />
Chapdelaine, la première attestation est enregistré dans Hist. de la Nouvelle France de M.<br />
Lescarbot, t. 4, chap.6 ds KÖNIG,147). Dans le même dictionnaire on fait la précision que,<br />
chez Chateaubriand (Atala, éd. A. Weil, 1950 [1801], 63), on rencontre aussi la variante<br />
féminine mocassine.<br />
Encycl.<br />
Le mocassin communément appelé soulier mou autrefois au <strong>Québec</strong> est la chaussure<br />
d‟hiver par excellence, surtout pour le marcheur à la raquette. Il possède trois précieuses<br />
qualités : la souplesse, la légèreté et la chaleur. Depuis quelques temps on le fabrique à<br />
l‟épreuve de l‟eau, ce qui mérite qu‟on lui attribue le quatrième qualificatif d‟imperméable. 1<br />
Etymol. et hist.<br />
Mocassin 2 est un emprunt à l‟algonquien makasin / mokissin / mockisin, / mekesen<br />
(makisin, v. Joseph E. Guinard) par l‟intermédiaire de l‟anglais mocassin (TLFi).<br />
Dans le Fichier lexical, le mot est attesté depuis 1861:<br />
“ Quand je m'approchai de sa cabane il [le chef maléchite] était debout en pein air :<br />
sa grande et belle stature se dessinait dans le ciel bleu, sur le rebord du coteau<br />
qu'occupait le campement; sa noble tête était nue à la brise et sa longue chevelure,<br />
encore noire, malgré son âge, flottait avec majesté sur ses larges épaules : il portait<br />
un ample capot de drap bleu, noué sous la gorge avec des larges agrafes d'argent<br />
tant aimées des Sauvages : ses jambes, encore solides alors, étaient enveloppées de<br />
mitasses blanches et noires, tombant avec une grâce sévère sur ses mocassins<br />
brodés.” (Joseph-Charles Taché, «Trois légendes de mon pays ou l'Évangile<br />
ignoré, l'Évangile prêché, l'Évangile accepté», dans Les Soirées canadiennes,<br />
<strong>Québec</strong>, t. 1, 22) ;<br />
1885 : “En hiver, elle se chaussait d'un mocassin noir, en été d'un soulier que<br />
Cendrillon eut eu de la peine à mettre.” (André-Napoléon Montpetit, «Chefs hurons:<br />
Odilonroasti-Odasio-Athatuistrari», dans La Presse, Montréal, t. I, n° 235, 3, d‟après<br />
le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1 Ces informations sont un résumé de la rubrique consacré au mot mocassin dans le livre de Joseph E. Guinard,<br />
Les noms indiens de mon pays, Montréal, Rayonnement, [1960].<br />
2 FEW, 20, 73a, MOCKASIN.<br />
40
1967 :“Autre contribution du fleuve [Saint-Laurent] : la peau d'anguille en guise de<br />
ruban pour nouer la chevelure sur la nuque, à la mode d'alors. Sans contact avec les<br />
Esquimaux, ils [les Canadiens] en ignoraient les incomparables bottes en peau de<br />
loup-marin d'une étanchéité remarquable, mais ils chaussèrent le mocassin algique en<br />
peau de cerf (chevreuil au Canada) ou d'orignal, qui fournissaient aussi la babiche, une<br />
lanière aux usages divers.” (Jacques Rousseau, «Pour une esquisse biogéographique<br />
du Saint-Laurent», dans Cahiers de géographie de <strong>Québec</strong>, <strong>Québec</strong>, t. 11, n° 23, 181-<br />
241, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot apparaît dans le discours métalexical québécois depuis 1879 (BIBAUD<br />
[Maximilien], Le mémorial des vicissitudes et des progrès de la langue française en Canada,<br />
Montréal, J.-B. Byette, 1879, 56) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle,1957 – Joseph E. Guinard, Les noms indiens… – Dict. québécois d’aujourd., 1992 –<br />
Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi.<br />
OUVRAGE (subst. masc., fém.)<br />
travail, au sens général d‟activité humaine en vue d‟obtenir quelque chose<br />
Rem.<br />
L‟emploi au féminin, bien représenté dans les parlers dialectaux de France, est<br />
aujourd‟hui populaire ou plaisant en français de France (DRFTN, Bélisle).<br />
Etymol. et hist.<br />
Ouvrage est un héritage de France (FEW 7, 362a, OPERA) qui se rencontre aussi en :<br />
Anjou, Berry, Nivernais, Normandie, Orléanais, Picardie et en Suisse (GPFC).<br />
En Nouvelle-France, il est attesté dans les corpus littéraires à partir du XVII e siècle :<br />
1663 : “Ce liberal Sauvage protecteur des François, ne cessoit de se loüer des presens<br />
qu'on luy avoit faits, entr'autres, d'un beau colier de pourceline travaillé par les mains<br />
des Meres Ursulines, avec des gentillesses, & des ornemens qui agreent, & qui<br />
ravissent ces peuples; sur tout, quand on leur dit, que c'estoit l'ouvrage de celles qui<br />
n'ont pas eu peur de passer la mer, pour eux, & pour l'instruction de leurs petites<br />
filles, qu'elles attendent à Kebec quand ils les voudront envoyer: que s'ils veulent y<br />
aller eux mesmes, ils y trouveront encor d'autres filles saintes (c'est ainsi qu'ils<br />
nomment les Religieuses) qui les recevront en leurs maladies dans un grand Hospital<br />
basty pour eux, & leur rendront les mesmes services, que les Hospitalieres de<br />
41
Montreal ont rendu tout fraischement à quelques uns de leur nation.“ (Jérôme<br />
Lalemant, The Jesuit Relations and Allied Documents. Travels and Explorations of<br />
the Jesuit Missionaries in New France, ed. Reuben Gold Thwaites, Cleveland,<br />
Burrows Brothers Company, t. 47, 1899, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot apparaît pour la première fois dans le discours métalexical en 1841<br />
([MAGUIRE Thomas], Manuel des difficultés les plus communes de la langue française,<br />
adapté au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie<br />
(impr.), 1841, 153) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – Brasseur, P.– Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi – FEW.<br />
PIASTRE (subst. fém.)<br />
dollar canadien ou américain<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
faire la piastre (loc. verb.) gagner beaucoup d‟argent, faire un bon profit (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) →<br />
ça vaut 100 piastres (loc. verb.) cela en vaut la peine (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → c’est avec des<br />
sous, des cents qu’on fait des piastres (proverbe) en accumulant de petites choses on en bâtit<br />
des grandes, on s‟enrichit (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → cent, dix cents dans la piastre (loc. adv.) cent,<br />
dix pour cent de la valeur estimée (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → payer, donner cent, mille piastres<br />
pour voir qqn, pour faire qqch. (loc. verb.) tenir absolument à voir qqn, à faire qqch.<br />
(<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → ne pas manquer qqch. pour cent piastres (loc. verb.) ne pas manquer<br />
qqch. pour rien au monde (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → question à cent piastres (loc. nom.) question<br />
dont la réponse est difficile, impossible à trouver (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → mot à une piastre et<br />
quart (loc. nom.) mot savant, trop recherché (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → comme un cheval de<br />
quatre piastres (loc. adv.) (en parlant de qqn) comme un vieux canasson (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) →<br />
avoir les yeux grands comme des piastres (loc. verb.) avoir les yeux grands ouverts<br />
(d‟étonnement, d‟admiration, etc.) (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → pour une poignée de piastres (loc.<br />
prép.) pour pas cher (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → être à la piastre (loc. verb.) être à l‟argent (<strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong>) → faire la piastre (fam.) se faire de l‟argent, gagner beaucoup d‟argent (<strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong>) → faire la piastre (loc. verb.) se faire de l‟argent, gagner beaucoup d‟argent, à<br />
gagner (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → avoir les yeux en signe de piastre (loc. verb.) ne penser qu‟à<br />
l‟argent, ne voir que l‟argent, le gain possible (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → avoir un signe de piastre à<br />
la place du cœur (loc. verb.) faire passer l‟argent avant ses sentiments, avant les<br />
42
considérations humaines (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) → question de sous et de piastres (loc. nom.)<br />
question d‟argent (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Mots de la même famille<br />
baise-la-piastre (subst. masc., adj.) (fam.) (personne) avare, qui fait passer l‟argent avant<br />
d‟autres considérations (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Rem.<br />
d’aujourd.).<br />
Encycl.<br />
La variante graphique piasse est très fréquente au Canada (Dict. québécois<br />
Au XVII e siècle, la piastre espagnole circule un peu partout en Europe et en Amérique<br />
du Nord. On la retrouve aussi en Nouvelle-France, en dépit des réticences des autorités.<br />
La piastre y valait environ quatre livres françaises. À la suite de la Conquête, la piastre<br />
se fixe au taux de cinq chelins (shillings), ou six livres françaises, soit 120 anciens sous, après<br />
quelques années de fluctuation.<br />
Dans la première moitié du XIX e siècle, la piastre tient généralement lieu de monnaie<br />
de compte dans les transactions, mais il y a de moins en moins de pièces d'argent pour<br />
représenter cette unité monétaire. L'utilisation de la monnaie de papier émise par les banques<br />
(et même par des particuliers) est de plus en plus courante.<br />
C'est à partir de 1851 que les autorités tentent d'introduire par législation un système<br />
monétaire décimal calqué sur le modèle du dollar américain, d'où les premières attestations de<br />
piastre au sens de “unité monétaire divisée en cent centins”.<br />
Par l'Acte concernant le cours monétaire qui entre en vigueur en 1858, l'ancien<br />
système britannique (louis, chelin et denier) continuera d'avoir cours parallèlement au<br />
nouveau système décimal (piastre, centin et millin) dans le Haut et le Bas-Canada. Le<br />
symbole $ apparaît dans les documents en français pour représenter la piastre dans les années<br />
1850 (au départ souvent utilisé en plus du mot piastre écrit en toutes lettres), mais il était déjà<br />
couramment employé pour l'équivalent anglais dollar qui référait tantôt à la piastre<br />
espagnole, tantôt au dollar américain, comme en font foi les billets de l'époque.<br />
Le mot piastre prend donc à cette époque une valeur officielle (désignation de l'unité<br />
monétaire canadienne), s'ajoutant aux divers emplois que le mot connaissait.<br />
43
On l'utilisait déjà jusque là en effet non seulement pour parler de la monnaie<br />
espagnole, mais aussi en parlant de pièces d'argent de valeur équivalente frappées en<br />
Angleterre et en France. 1<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot piastre (FEW 3, 223a, III. 2, EMPLASTRUM) est attesté en France depuis 1595.<br />
Il est relevé dans les dictionnaires français depuis Cotgrave 1611 et, de façon plus précise,<br />
depuis Trévoux 1771 (“monnoie d'argent qui vaut un écu [...]. Il y a des piastres [...] que l'on<br />
appelle piastres du Pérou ; d'autres [...] piastres Mexicaines”) 2 .<br />
Dans le Fichier lexical, le mot piastre apparaît depuis 1700 :<br />
“pour une piastre que ie [sic] Luy ay donnée au Saut a la puce... 4 [livres].” (Archives<br />
suivantes :<br />
du Petit Séminaire de <strong>Québec</strong>, <strong>Québec</strong>, 715)<br />
A part le sens présent dans le roman Maria Chapdelaine, piastre a encore les acceptions<br />
1. pièce d'argent frappée en Espagne, puis dans les colonies espagnoles d'Amérique (Mexique,<br />
Pérou, etc.), qui a cours au Canada dès le XVII e siècle et qui, sous le Régime anglais, vaut<br />
généralement 120 anciens sous (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>):<br />
1681 : [...] il a été apporté en ce pays quantité de monnoies étrangères comme réaux,<br />
piastres et autres de toutes façons, qui sont pour la plupart légères [ne pesant pas leur<br />
poids d'or ou d'argent], ce qui cause une très grande perte à ceux qui sont obligés d'en<br />
recevoir, pourquoi les marchands les refusent [...], attendu le pressant besoin que les<br />
réaux et piastres, et même toute monnoie étrangère tant d'or que d'argent, soient prises<br />
aux poids selon leur prix [...] et que les dits réaux ou piastres du poids de vingt-un<br />
deniers trébuchant, soient pris en ce pays pour trois livres, dix-neuf sols un denier [...].<br />
(Décret du Conseil supérieur, cité dans A. Shortt (éd.), Documents relatifs à la<br />
monnaie, au change et aux finances du Canada sous le Régime français, t. 1, 1925,<br />
50, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
2. pièce d'argent frappée en Angleterre (par ex. la couronne) ou en France (par ex. l'écu), de<br />
même valeur environ que la piastre espagnole (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) :<br />
1865 : “Il y avait cinquante louis [« livres anglaises »] en or ; c'étaient des pièces d'or<br />
de $5 [dollars américains] ; il a remarqué qu'il y avait des aigles sur ces pièces. Il y<br />
avait aussi dans cette boîte dix à onze piastres françaises. Il y avait cent quarante<br />
1 Ces paragraphes résument les idées de la rubrique encyclopédique du mot piastre de la <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>.<br />
2 Ces paragraphes résument les informations trouvées dans la rubrique étymologique du mot piastre de la<br />
<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>.<br />
44
piastres en trente sous, en rouleaux de $10. Il y avait aussi $150 en argent monnayé, de<br />
diverses descriptions ; cette somme n'était pas en rouleau, mais avait été mise pêle-<br />
mêle dans la boîte.” (Montréal, dans Procès de Barreau, 18, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
3. (du milieu du XVIII e siècle jusqu'au début du XIX e ) mesure de poids pour des objets en<br />
argent (vases précieux, couverts, ustensiles de cuisine), prenant la pièce de monnaie comme<br />
référence (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) :<br />
1810 : “Un petit vase aussi d'argent fait en forme d'une petite écuelle à oreilles pour<br />
recevoir les quêtes faites dans l'Eglise a couté huit piastres et a pesé cinq piastres et<br />
deux chelins.” (L'Islet, ANQQ, fonds J. Panet, 2 janvier, 9, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
4. argent (par extension du sens premier), montant indéterminé d‟argent (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>) :<br />
1866 : “L'erreur de mon huissier me coûta quelques piastres que je ne regrettai guère ;<br />
j'avais ri pour mon argent, et mes amis en avaient profité.” (Ph. Aubert de Gaspé,<br />
Mémoires, 330, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot a été pris en compte par les ouvrages de lexicographie québécoise. La <strong>BDLP</strong>-<br />
<strong>Québec</strong> lui consacre un vaste article. Dans le discours métalexical, il est attesté depuis 1841<br />
(MAGUIRE Thomas, Manuel des difficultés les plus communes de la langue française,<br />
adapté au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie<br />
(impr.), 1841, 63) ( ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 – <strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong> – Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi.<br />
PLACE (subst.fém.)<br />
localité, bourg, ville<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
à des places (région. Canada) par endroits, à certains endroits (TLFi) => prendre place (loc.<br />
verb.) se passer, arriver (<strong>BDLP</strong>-Louisiane) => ne pas avoir de place (loc. verb.) être déplacé,<br />
malvenu (<strong>BDLP</strong>-Louisiane)<br />
Mots de la même famille<br />
nulle-place (loc. adv.) nulle part (<strong>BDLP</strong>-Louisiane)<br />
Etymol. et hist.<br />
Le nom place (FEW 9, 37ab, 38a, I, PLATEA) au sens illustré dans le roman Maria<br />
Chapdelaine est attesté en Nouvelle-France depuis le XVI e siècle :<br />
45
1538 : “Et tout incontinent revyndrent plusieurs [femmes] qui apporterent chacune une<br />
natte carree en façon de tapisserie et les estandirent sus la terre au meilleu de ladite<br />
place et nous firent mectre sus icelles. Apres esquelles choses fut apporté par neuf ou<br />
dix hommes le roy et seigneur du pays qu'ilz appellent en leur langue agouhanna<br />
lequel estoit assiz sus une grande peau de serf et le vindrent poser dedans ladite place<br />
sus lesdites nattes aupres du cappitaine en faisant signe que c'estoit leur seigneur.<br />
Cestuy agouhanna estoit de l'aige d'envyron cinquante ans et n'estoit poinct mieulx<br />
acoustré que les aultres fors qu'il avoyent alentout de sa teste une maniere de liziere<br />
rouge pour sa couronne faicte de poil d'herisson et estoit celluy seigneur tout percluz<br />
et malade de ses membres.” (Jacques Cartier, Relations, éd. critique par Michel<br />
Bideaux, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1986, 155, d‟après le<br />
Fichier lexical du TLFQ).<br />
Le fait que le sens présent chez Louis Hémon est attesté dans le Fichier lexical depuis<br />
1538 démontre qu‟il est un anglicisme de maintien qui s‟est maintenu dans la variété<br />
québécoise grâce aussi au mot anglais place”. Cette opinion est renforcée par l‟existence du<br />
mot en moyen français (place “terrain où se trouvait une maison”) et dans quelques régions :<br />
Aveyron (place “métairie”), Percy (place “ensemble des bâtiments d‟une ferme”), Pont-<br />
Audemer-Eure (place “ensemble d‟une propriété”) (FEW).<br />
A part le sens de Maria Chapdelaine, place a aussi les acceptions suivantes :<br />
1. propriété, terrain (maison, ferme)” :<br />
1949 : “Paul a acheté une place auras [sic] Pont-Breaux.” (E.T. Voorhies, A glossary<br />
of variants from Standard French in St. Martin's Parish, Louisiana followed by some<br />
of the folklore of the parish, d‟après <strong>BDLP</strong>-Louisiane);<br />
2. plancher (<strong>BDLP</strong>-Louisiane) ;<br />
3. pièce, chambre 1 (<strong>BDLP</strong>-Louisiane) ;<br />
1932: “Son logement est composé de trois places.” (J. Ditchy, Les Acadiens<br />
louisianais et leur parler, 166, d‟après <strong>BDLP</strong>-Louisiane)<br />
En français de France, place a plusieurs acceptions qui se rencontrent aussi au <strong>Québec</strong> :<br />
1. emploi rétribué (souvent modeste, notamment en parlant du personnel de maison), poste,<br />
situation, travail, job<br />
“Ce n'est pas une place pour vous, Maria. Le pays est trop dur, et le travail est dur<br />
aussi: on se fait mourir rien que pour gagner son pain. Là-bas, dans les<br />
1 Ce sens se rencontre aussi en Belgique (TLFi).<br />
46
manufactures, (...) vous auriez vite fait de gagner quasiment autant que moi...”<br />
(Maria Chapdelaine, 1916, 181)<br />
2. partie d‟espace qu‟on occupe ou qu‟on peut occuper, endroit, lieu :<br />
“place libre”, “place vacante” ;<br />
“prendre beaucoup / peu de place” ;<br />
3. lieu où une personne se trouve<br />
“demeurer, rester à la même place” ;<br />
4. emplacement aménagé, destiné à une fonction particulière<br />
“voiture à quatre places” ;<br />
5. emplacement, siège réservé dans un lieu public tel qu‟une salle de spectacle, un stade ou<br />
dans un moyen de transport en commun<br />
“place d‟avion” ;<br />
6. rôle assigné à quelqu'un ou à quelque chose dans un ensemble hiérarchisé ou structuré<br />
“la première, la dernière place” ;<br />
7. situation, position ou disposition de quelque chose ou de quelqu'un par rapport à un<br />
ensemble<br />
“une place pour chaque chose et chaque chose à sa place” ;<br />
8. rang obtenu par un étudiant, un élève, dans un classement à une composition, à une<br />
épreuve, à un concours ou par un concurrent dans une compétition sportive<br />
“lutter pour garder sa place” ;<br />
9. (dans une ville, une agglomération ou un village) lieu public consistant en un espace plus<br />
ou moins large, découvert et le plus souvent entouré de bâtiments publics, où aboutissent<br />
plusieurs rues ou avenues et où ont lieu souvent des activités commerciales, festives ou<br />
publiques<br />
“place municipale”, “place de l‟église”, “place du marché” 1 ;<br />
Le mot place apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en<br />
1872 (Anonyme, «Mots et tournures à éviter», dans Journal de l'instruction publique, t. 16, n°<br />
10-11, <strong>Québec</strong>, 1872 oct.-nov., 144) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 – <strong>BDLP</strong>-Louisiane – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi – FEW.<br />
1 Ces acceptions du nom place ont été reproduites conformément au TLFi.<br />
47
QUÉBEC (subst. masc.)<br />
1. la ville de <strong>Québec</strong><br />
2. la province francophone de Canada ayant comme capitale la ville de <strong>Québec</strong><br />
Expressions, loc. et syntagmes<br />
se faire passer un québec se duper (Bélisle)<br />
Mots de la même famille<br />
québecois (adj. et subst. masc) 1. de la ville de <strong>Québec</strong> 2. de la province de <strong>Québec</strong> 3. (subst.<br />
masc.) variété de français en usage au <strong>Québec</strong>, le français québécois (Dict. québécois<br />
d’aujourd.) => québécisme (Dict. québécois d’aujourd.) (subst. masc.) fait de langue (forme,<br />
sens, locution, tournure, prononciation) propre au français de <strong>Québec</strong>, canadianisme (Dict.<br />
québécois d’aujourd.) => québécitude (subst. fém.) ensemble de caractères, des manières, de<br />
pensées propres aux Québécois (Dict. québécois d’aujourd.) => québécité (subst. fém.)<br />
ensemble de traits propres aux Québécois (Dict. québécois d’aujourd.)<br />
Rem.<br />
La distinction entre les deux sens du nom se fait par la marque grammaticale de<br />
l‟article (cf. <strong>Québec</strong> “la capitale” et le <strong>Québec</strong> “la province”).<br />
Encycl.<br />
Le <strong>Québec</strong> est le seul ensemble géopolitique de l‟Amérique du Nord où la langue<br />
française est majoritaire.<br />
<strong>Québec</strong> est le nom d‟une province canadienne, d‟un comté et d‟une ville fondée en<br />
1608 par Champlain, la plus ancienne du Canada. 1<br />
Jusqu‟à la Proclamation royale de 1763, le mot <strong>Québec</strong> est utilisé exclusivement pour<br />
désigner la ville. Les premiers qui ont appliqué le nom à l‟ensemble de la province ont été les<br />
Britanniques. 2 Autrefois on disait “le Bas-Canada”, puis auparavant, la Nouvelle-France.<br />
Etymol. et hist.<br />
Le nom propre <strong>Québec</strong> est un amérindianisme. Il provient du nom algonquin Kebek “là<br />
où le fleuve se rétrécit”.<br />
Le sens de “rétrécissement”, “détroit” peut être retrouvé dans la plupart des langues<br />
indiennes. Les Iroquois appellent <strong>Québec</strong> Tekiatontarikon “deux montagnes qui se<br />
rejoignent” ; les Micmacs Gépeg “rétrécissement“, “détroit”, les Algonquins Wabitikweiang<br />
1 Joseph E. Guinard, Les noms indiens de mon pays, Montréal, Rayonnement, 1960.<br />
2 Ces idées sont un résumé des données trouvées dans L’Encyclopédie canadienne à la <strong>page</strong><br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=F1ARTF0006591.<br />
48
“au rétréci de la rivière”. Seuls les Tête-de-Boule appellent <strong>Québec</strong> Kapawin<br />
“débarcadaire”. 1<br />
Il est attesté au début dans les documents des missionnaires jésuites :<br />
1627 : “Sa Majesté donnera à perpétuité aux dits cent associés, leurs hoirs et ayans cause,<br />
en toute propriété, justice et seigneurie, le fort et habitation de <strong>Québec</strong>, avec tout le dit<br />
pays de la Nouvelle-France, dite Canada [...].” (Édits, ordonnances royaux, déclarations<br />
et arrêts du conseil d'état du Roi concernant le Canada, <strong>Québec</strong>, E.R. Fréchette, 1854, 7,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1703 : “Ébauche D'un projet pour enlever Kebec et plaisance; avec une briefve<br />
description de ces deux places; et le recensement des habitans de Canada comme aussi<br />
celuy des sauvages qui demeurent aux environs des trois villes françoises [celles de<br />
<strong>Québec</strong>, Montréal et Trois-Rivières].” (Louis-Armand de Lom d‟Arce de Lahontan,<br />
Nouveaux documents de Lahontan sur le Canada et Terre-Neuve, 1940, édités avec<br />
introduction par Gustave Lanctôt, Ottawa, J. O. Patenaude, 38, d‟après le Fichier lexical<br />
du TLFQ)<br />
1790 : “Les habitants de Montréal qualifièrent ceux de <strong>Québec</strong> de moutons; ces derniers<br />
ont effectivement le caractère plus doux et moins orgueilleux, ils appellent par<br />
représailles les Montréalais loups; qualification assez juste parce qu'ils ne fréquentent que<br />
les Sauvages et les bois.” (Jean Carmine Bonnefons, La civilisation traditionnelle de<br />
l'«habitant» aux 17 e et 18 e siècles: fonds matériel, 2 e éd. rev., Montréal, Fides, 1973, 49,<br />
d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
1859 : “Le mot <strong>Québec</strong> prononcé Ouabec dans la langue algonquine, dit M. Stanislas<br />
Vassal, signifie détroit. Ce monsieur, né d'une mère abénaquise, parle plusieurs dialectes<br />
des indigènes, au milieu desquels il a passé la plus grande partie de sa vie, et il nous<br />
assure que ce mot est purement sauvage. M. Malo, missionnaire en 1843 chez les tribus<br />
du golfe Saint-Laurent, nous a assuré pareillement que le mot Kibec dans l'idiôme<br />
micmac a la même signification. Ce monsieur n'a aucun doute que le nom de notre<br />
ancienne capitale ne soit d'origine sauvage. Le sens propre du mot est fermé, obstrué.”<br />
(François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours, t.<br />
1, 3 e éd. rev. et corr., <strong>Québec</strong>, P. Lamoureux (impr.), 52, d‟après le Fichier lexical du<br />
TLFQ)<br />
1 Joseph E. Guinard, op. cit.<br />
49
1861 : “Suivant M. Richer Laflèche, ancien missionnaire, Stadaconé, dans la langue des<br />
Sauteurs signifie une aile. La pointe de <strong>Québec</strong> ressemble par sa forme à une aile<br />
d'oiseau. Quant au mot Kebbek, il n'y a pas à douter qu'il soit d'origine algonquine.<br />
Champlain et Lescarbot le disent expressément; le premier le répète jusqu'à deux fois.<br />
Dans les différents dialectes algonquins, Kepak ou Kebbek signifie rétrécissement d'une<br />
rivère. «<strong>Québec</strong>» dit M. Richer Laflèche, «veut dire, chez les Cris, c'est bouché. Il vient<br />
de Kepak, temps indéfini du verbe Kipao.» [/] Voici ce qu'écrivait à ce sujet, M. Jean-<br />
Marie Bellanger, ancien missionnaire, un des hommes de notre temps qui ont le mieux<br />
connu la langue des Micmacs. «Kébek, en micmac, veut dire rétrécissement des eaux<br />
formé par deux langues ou pointes de terre qui se croisent. Dans les premiers temps que<br />
j'étais dans les missions, je descendais de Ristigouche à Carleton; les deux sauvages qui<br />
me menaient en canot, répétant souvent le mot Kébek, je leur demandai s'ils se<br />
préparaient à aller bientôt à <strong>Québec</strong>. Ils me répondirent : Non; regarde les deux pointes et<br />
l'eau qui est resserrée en dedans : on appelle cela Kébek en notre langue.» [/] En<br />
présence d'affirmations si positives et si bien fondées, il est inutile de réfuter les traditions<br />
populaires qui attribuent le nom de <strong>Québec</strong> au cri de surprise d'un matelot normand: Quel<br />
bec! c'est-à-dire, Quel cap! L'on doit aussi laisser de côté les longues dissertations de M.<br />
Hawkins, pour prouver que les De La Pole, comtes de Suffolk portaient, au quinzième<br />
siècle, le titre de seigneurs de <strong>Québec</strong>. M. Hawkins a depuis reconnu qu'il s'était trompé<br />
et que les De La Pole étaient seigneurs, non de <strong>Québec</strong>, mais de Brequebec en<br />
Normandie.” (Antoine-Jean-Baptiste Ferland, Cours d'histoire du Canada. Première<br />
partie, 1534-1663, <strong>Québec</strong>, Augustin Côté Éditeur-Imprimeur, 90, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
Dans le discours métalexical québécois, le mot est attesté depuis 1842 (Anonyme,<br />
«Etudes grammaticales», dans L'Encyclopédie canadienne, journal littéraire et scientifique, t.<br />
1, n° 3, Montréal, 1842 mai, 102) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Bélisle, 1957 − Joseph E. Guinard, Les noms indiens…, 1960 − Dict. québécois d’aujourd.,<br />
1992 − Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi.<br />
RAISON (subst. masc.)<br />
(dans la loc. adv. comme de raison) il va sans dire, il va de soi, naturellement<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
avoir des raisons avec qqn avoir une altercation avec qqn (GPFC)<br />
50
Mots de la même famille<br />
raisonneux (subst. masc.) qqn qui réplique incessament (Clapin) => raisonner (vb. trans.)<br />
chercher à faire entendre raison à qqn (Clapin) => raisons (subst. fém. pl.) querelle, injures<br />
(Clapin)<br />
Rem.<br />
En français de France, comme de raison (FEW 10, 108a, I. 2. b. β. a‟, RATIO). a le<br />
sens de “comme il est raisonnable de le faire”(GPFC). Le sens présent dans le texte de Louis<br />
Hémon est exprimé en France par la loc. adv. par raison (FEW).<br />
Etymol. et hist.<br />
L‟expression est un héritage de France. En français québécois elle se rencontre à partir<br />
de la deuxième moitié du XIX e siècle :<br />
1863 : “Le 12, je visitai les établissements de pêche de l'île de Bonaventure, dont les<br />
pêcheurs avaient récolté une abondante moisson dans les eaux avoisinantes jusqu'au<br />
commencement de juillet; après cette époque, la boitte était devenue d'une extrême<br />
rareté, et la pêche de la morue s'en était sentie, comme de raison; cependant, la<br />
morue n'avait pas cessé d'affluer près des côtes pour cela, et depuis quelques jours que<br />
l'encornet avait fait son apparition près des rivages, il s'était fait d'excellentes journées<br />
de pêche.” (Pierre-Etienne Fortin, Rapports annuels de Pierre Fortin, Ecr., magistrat,<br />
commandant l'expédition pour la protection des pêcheries dans le golfe St Laurent<br />
pendant les saisons de 1861 et 1862, <strong>Québec</strong>, Hunter, Rose et Lemieux (impr.), 1863,<br />
12, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en 1894<br />
(CLAPIN Sylva, Dictionnaire canadien-français ou lexique-glossaire des mots, expressions<br />
et locutions ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants et dont l'usage appartient<br />
surtout aux Canadiens-français ..., Montréal-Boston, C. O. Beauchemin et fils-Sylva Clapin,<br />
1894, 269, 87) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Clapin, 1894 – SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi–<br />
FEW.<br />
RÈGNE (subst. masc.)<br />
vie, existence<br />
Rem.<br />
51
Le sens du mot règne présent dans le roman Maria Chapdelaine est enregistré dans le<br />
TLFi comme régionalisme spécifique au français québécois.<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
faire son règne (loc. verb.) faire son temps, arriver au bout de l‟usure (Bélisle, GPFC).<br />
Etymol. et hist.<br />
L‟origine de la forme doit être cherchée dans le mot latin regnum “souveraineté”,<br />
“royaume”, “autorité royale”, dérivé de rex, regis “roi” (TLFi, FEW 10, 216a).<br />
Règne au sens de “vie”, “existence” est présent dans le FEW seulement dans le contexte<br />
passer un bon règne “avoir une existence heureuse, tranquille” (St-Paul – Haute-Savoie,<br />
Thonon, Evian).<br />
Le sens du mot présent dans le roman de Louis Hémon est attesté dans d‟autres ouvrages<br />
littéraires depuis le XVII e siècle :<br />
1632 : “Pour les maringoins, c'est l'importunité mesme. On ne sçauroit travailler,<br />
notamment à l'air, pendant leur règne, si on n'a de la fumée auprès soy pour les chasser. Il<br />
y a des personnes qui sont contraintes de se mettre au lit venans des bois, tant ils sont<br />
offensez. J'en ay veu qui avoient le col, les joues, tout le visage si enflé qu'on ne leur<br />
voyoit plus les yeux. Ils mettent un homme tout en sang quand ils l'abordent. Ils font la<br />
guerre aux uns plus qu'aux autres. Ils m'ont traité jusques icy assez doucement. Je n'enfle<br />
point quand ils me piquent, ce qui n'arrive qu'à fort peu de personnes, si on y est<br />
accoustumé. Si le païs estoit essarté et habité, ces bestioles ne s'y trouveroient point. Car<br />
dèsja il s'en trouve fort peu au fort de Kébec, à cause qu'on couppe les bois voisins.” (Paul<br />
Le Jeune (éd.), Monumenta Novae Franciae t. 2 Etablissement à <strong>Québec</strong> (1616-1634),<br />
Rome - <strong>Québec</strong>, Monumenta Historica Societatis Jesu - Les Presses de l'Université Laval,<br />
308, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
A part cela, le nom a encore trois sens qui peuvent être rencontrés aussi en français de<br />
France :<br />
1. période pendant laquelle un monarque est le chef de l‟Etat<br />
1798 : “Un Bill [...] qui révoque un acte passé dans la trente sixième année du règne de la<br />
présente Majesté, et qui appointe de nouveaux commissaires [...].” (La Gazette de <strong>Québec</strong>,<br />
12 avril 1798, 3, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
2. groupe d‟êtres présentant des principes, des caractères communs<br />
1897 : “A part les chiens et les animaux sauvages, tout le règne animal leur est [aux<br />
enfants du Labrador] à peu près inconnu. Tous les oiseaux, indistinctement, sont pour eux<br />
52
des "gibiers" (Victor Alphonse Huard, Labrador et Anticosti, Journal de voyage, histoire,<br />
topographie, pêcheurs canadiens et acadiens, Indiens montagnais, Montréal, C.-O.<br />
Beauchemin & Fils, 489, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le mot apparaît dans le discours métalexical québécois depuis 1888 (BUIES A[rthur],<br />
Anglicismes et canadianismes, <strong>Québec</strong>, Typographie de C. Darveau, 1888, 91) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 – Ø DRF, 2001− Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi −<br />
FEW.<br />
ROUGH (adj. et adv.)<br />
costaud<br />
Expr, loc. et syntagmes<br />
rough and tough (expr.) puissant, costaud (Dict. québécois d’aujourd.)<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot est un emprunt direct à l‟anglais nord-américain.<br />
A part le sens présent dans le roman de Louis Hémon, rough a encore l‟acception “qui<br />
présente des inégalités (surfaces, sols)” (Dict. québécois d’aujourd.) :<br />
1977 : “On allait à l'église avec nos parents. On n'avait pas de ch'mins; c'était trop<br />
«rough» pour se servir des chevaux. On allait à pied. Tout l'monde du rang, y avait même<br />
du monde de six milles de chez nous, qui prenaient la «track» pis y'venaient à l'église, pas<br />
tous les dimanches, mais à tous les deux dimanches.” (René Brodeur, Robert Choquette,<br />
Villages et visages de l'Ontario français, Toronto − Montréal, Office de la<br />
télécommunication éducative de l'Ontario - Éditions Fides, 1979, 38, d‟après le Fichier<br />
lexical du TLFQ)<br />
En français de France, rough en tant que nom a le sens de “partie de parcours non<br />
entretenue“, par opposition à green “espace gazonné, tondu et roulé, aménagé autour de<br />
chaque trou” (TLFi).<br />
Le mot apparaît dans le discours métalexical depuis 1881 (MANSEAU J.-A.,<br />
Dictionnaire des locutions vicieuses du Canada avec leur correction, suivi d'un Dictionnaire<br />
canadien, <strong>Québec</strong>, J.-A. Langlais libraire-éditeur, 1881, III) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Dict. québécois d’aujourd., 1992 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ − TLFi − Ø FEW.<br />
53
SIAU (subst. masc.)<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
mouiller à siaux pleuvoir à verse (Clapin) –> aller sur le siau (fig.) aller paître (GPFC)<br />
Rem.<br />
Au Canada, siau désignait d‟habitude un vaisseau en bois. Les vaisseaux de zinc ou<br />
d‟un autre métal étaient désignés par le mot chaudière. En France, le nom désigne d‟habitude<br />
un vaisseau ordinairement en bois ou de zinc qui sert à puiser et porter de l‟eau (Bélisle).<br />
Etymol. et hist.<br />
La variante siau (11, 661a, I, SITELLUS) est un héritage des parlers de France qui se<br />
rencontre dans toutes les régions atlantiques et au centre de la France ainsi qu‟en Suisse<br />
romande (GPFC).<br />
Le mot commence d‟être attesté depuis 1723 :<br />
“Ils [les Arkansas] ont une maniere de guerir leurs malades qui est assez particuliere.<br />
Il y a environ un an qu‟ils furent presque tous affligés de la petite vérolle (mal inconnu<br />
parmys les Sauvages auparavant que les François fussent chez eux). Leurs medecins<br />
qui sont jongleurs commençoient par s‟aprocher du malade en faisant des hurlements<br />
horribles et des contorsions epouvantables qu‟ils continüe pendant une heure en<br />
conjurant le mauvais esprit de se retirer, au bout de ce temps ils font une aspersion sur<br />
le malade de cinq ou six siaux d‟eau qui estoit presque de la glace (car s‟estoit dans<br />
l‟hyver). Apres quoy ils chassent l‟esprit avec des imprecations et en faisant comme<br />
s‟ils le tenoient. Ils le mette dehors de la cabane, c‟est par ou finit leur maniere de<br />
guerir qu‟ils réitere tous les jours deux foys jusqu‟a ce que le malade soit ou mort ou<br />
guery. S‟il en revient, le jongleur autrement le medecin est fort estimé et bien payé,<br />
mais sy au contraire il meurt, le medecin n‟a rien mais au contraire il pert beaucoup de<br />
l‟estime que l‟on avoit de luy.” (Bernard Diron D‟Artaguiette, Journal de Vaugine de<br />
Nuisement (ca 1765): un témoignage sur la Louisiane du XVIII e siècle, éd. critique par<br />
Steve Canac-Marquis et Pierre Rézeau, [<strong>Québec</strong>], Les Presses de l'Université Laval,<br />
2005, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Dans le discours métalexical, le mot apparaît pour la première fois en 1842 (Anonyme,<br />
«Locutions vicieuses», dans Le Fantasque, <strong>Québec</strong>, 1842, 12 mai, 2) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
Clapin, 1894 – SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi.<br />
54
VEILLÉE (subst. fém.)<br />
1. soirée, réunion en compagnie des voisins, d‟amis<br />
2. fait de rester debout pendant la soirée pour travailler<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
donner une veillée donner une soirée (Clapin) –> avoir qqn en veillée avoir chez soi qqn qui<br />
passe la soirée (GPFC) –> gens de la veillée ceux qui passent la soirée ensemble, qui<br />
assistent à une soirée (GPFC) –> de veillée pendant la soirée (GPFC) –> faire un bout de<br />
veillée passer une partie de la soirée chez autrui (GPFC)<br />
Encycl.<br />
“La veillée était au centre de la culture populaire et de sa transmission par la<br />
conversation qu‟elle favorisait, alimentée par la lecture des almanachs. On disait parfois<br />
veille.” (DRM)<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot est un héritage de France (FEW 14, 439ab, I.1.a.β, VIGILIA) qui se rencontre<br />
sous diverses formes graphiques en gaumet (vèye “réunion de personnes qui passent leurs<br />
soirées, surtout en hiver, à converser, à jouer etc.”, Belgique) et en ancien français (veile<br />
“soirée passée en commun”, veilliee “soirée passée en commun pour travailler ou causer”<br />
(FEW).<br />
En français québécois, il est attesté à partir de la première moitié du XIX e siècle :<br />
1845 : “Il va s'en [sic ; sans] dire que Morin soupa et coucha à la maison. Durant la<br />
veillée, pendant que les deux vieux voyageurs étaient animés à parler de leur jeunesse et<br />
de la misère qu'ils avaient eue dans le Nord-Ouest, mon oncle s'arrête tout à coup : - Ah!<br />
Morin, dit-il, pendant que j'y pense, il y a assez longtemps que je passe pour un menteur,<br />
conte à la compagnie ce qui nous est arrivé en telle année, te le rappelles-tu?” (Alphonse<br />
Poitras, Conteurs canadiens-français du XIX e siècle, 1 re série, Montréal, Librairie<br />
Beauchemin, 1845, 44, d‟après le Fichier lexical du TLFQ)<br />
Le nom veillée est attestée pour la première fois dans le discours métalexical<br />
québécois en 1894 (CLAPIN Sylva, Dictionnaire canadien-français ou lexique-glossaire des<br />
mots, expressions et locutions ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants et dont<br />
l'usage appartient surtout aux Canadiens-français ..., Montréal-Boston, C. O. Beauchemin et<br />
fils-Sylva Clapin, 1894, 329) (ILQ).<br />
55
Bbg.<br />
Clapin, 1894 – SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – FEW.<br />
VOYAGE (subst. masc.)<br />
déplacement, généralement répétitif, sur de courtes distances, qu'un particulier ou un<br />
spécialiste effectue pour transporter, livrer, voiturer quelque chose d'un endroit à un autre ;<br />
va-et-vient, aller-retour, allée et venue, navette<br />
Rem.<br />
Le sens présent dans le roman Maria Chapdelaine est enregistré dans le TLFi aussi,<br />
mais il est illustré par une citation tirée de l‟oœuvre Le Survenant de Germaine Guèvremont,<br />
une romancière québécoise, citation qui rappelle le contexte de Maria Chapdelaine (Cent<br />
voyages par jour, de la maison à l'étable et aux bâtiments ne parvenaient pas à tromper son<br />
ennui) (Guèvremont, Survenant, 1945, 271). En français de France, voyage a aussi le sens de<br />
“parcours effectué sur une courte distance” comme au <strong>Québec</strong>, mais, en réalité, la courte<br />
distance est assimilée souvent à un déplacement au loin (“Aucun voisin n'ayant pu ou voulu<br />
faire pour elle cette course, elle avait entrepris, elle, ce voyage horrible, de sa mansarde au<br />
boulanger.” (Maupassant, Contes et nouv., t. 2, Mis. hum., 1886, 647) (TLFi).<br />
Expr., loc. et syntagmes<br />
bureau de voyages (loc. nom.) agence de voyage (<strong>BDLP</strong>-<strong>Québec</strong>)<br />
Mots de la même famille<br />
voyagement (subst. masc.) allés et venues (Bélisle) => voyager (vb. trans.) se transporter ou<br />
être transporté (Bélisle)<br />
Etymol. et hist.<br />
Le sens du nom voyage 1 présent dans le texte de Louis Hémon n‟est enregistré dans<br />
aucune citation du Fichier lexical et non plus dans des ouvrages métalexicaux québécois de<br />
référence comme étant différent de l‟acception courante de “déplacement à un lieu plus<br />
éloigné”(Ø GPFC, Ø Dict. québécois d’aujourd.). Pourtant, nous croyons qu‟il doit être mis<br />
en relation avec quelques termes qui ont en France une existence dialectale : viages “allées et<br />
venues successives d‟un lieu à un autre lieu rapproché” (Normandie), “allées et venues qu‟on<br />
1 FEW 14, 382ab, I. 2. b. α, VIATICUM.<br />
56
fait pour transporter quelque chose” (Agen), viager “faire de nombreuses allées et venues<br />
inutiles” (Normandie) (FEW).<br />
Au sens de “déplacement à un lieu plus éloigné”, voyage est attesté Nouvelle-France<br />
depuis le XVI e siècle :<br />
1536 : “Auxs environ d'icelles illes y a de grandes marees qui portent comme suest et<br />
norouaist. Je presume mielx que aultrement à ce que j'ai veu qu'il luy aict aulcun<br />
passaige entre la Terre Neuffve et la Terre des Bretons. Sy ainsi estoict se seroict une<br />
grande abreviacion tant pour le temps que pour le chemyn si se treuve parfection en<br />
ce voyage. A quatre lieues de ladite ille il luy a ung beau cap que nommames Cap du<br />
Daulphin pour ce que c'est le commancement des bonnes terres.” (Jacques Cartier,<br />
Relations, éd. critique par Michel Bideaux, Montréal, Les Presses de l'Université de<br />
Montréal, 1986, 105-106 (relation du premier voyage fait au Canada en 1534),<br />
d‟après le fichier lexical du TLFQ)<br />
Par métonymie, le nom voyage a le sens de “contenu de la charge (le plus souvent du foin<br />
ou du bois)” :<br />
1977 : “J'ai 'té avec Louis charcher un vouyâge [sic] de prusses pour faire un abrique<br />
à la porte de dârrière [de la maison].” (F. Thibodeau, Dans note temps avec Marc et<br />
Philippe, 89 d‟après <strong>BDLP</strong>-Acadie)<br />
Le sens de “déplacement servant à transporter des choses et parfois des personnes” se<br />
rencontre dans les régions suivantes : Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Île-du-Prince<br />
Edouard, Îles-de-la-Madeleine, le sud de la Gaspésie et Basse-Côte-Nord. (<strong>BDLP</strong>-Acadie) et à<br />
Terre-Neuve (sauf la côte ouest) (Cormier).<br />
Le mot voyage apparaît pour la première fois dans le discours métalexical québécois en<br />
1841 (MAGUIRE Thomas], Manuel des difficultés les plus communes de la langue française,<br />
adapté au jeune âge et suivi d'un Recueil de locutions vicieuses, <strong>Québec</strong>, Fréchette et Cie<br />
(impr.), 1841, 171). Pour la locution verbale faire un voyage, le ILQ n‟offre qu‟une seule<br />
source : BERGERON, Bertrand, Le franco-canadien, [s.l.], 1973, 41) (ILQ).<br />
Bbg.<br />
SPFC, GPFC, 1930 – Bélisle, 1957 – Brasseur, P., Chauveau, J.-P., SPM, 1990 – Cormier,<br />
1993 – <strong>BDLP</strong>-Acadie – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – TLFi.<br />
WENDIGO (subst. masc.)<br />
esprit puissant chez les Amérindiens<br />
57
Encycl.<br />
Un wendigo est un esprit qui, selon les Algonquins, s'empare des personnes<br />
vulnérables et les pousse à adopter divers attitudes antisociaux, dont la plus frappante est le<br />
cannibalisme. Le plus grand risque survient lorsqu'on est isolé dans les bois durant une longue<br />
période de temps. 1<br />
Les Algonquins se servaient du mot windigo pour empêcher les enfants de pleurer, de<br />
faire un ta<strong>page</strong> ou de désobéir en les menaçant de ce vilain esprit. (Joseph E. Guinard, Les<br />
noms indiens de mon pays, Montréal, Rayonnement, 1960).<br />
Etymol. et hist.<br />
Le mot est un amérindianisme qui provient du mot algonquin Witikow (Joseph E.<br />
Guinard, Les noms indiens de mon pays, Montréal, Rayonnement, 1960).<br />
Wendigo est attesté pour la première fois chez Louis Hémon. La citation tirée du<br />
roman Maria Chapdelaine est, d‟ailleurs, la seule citation consacrée à ce nom dans le Fichier<br />
lexical du TLFQ.<br />
Le mot est attesté pour la première fois dans le discours métalexical en 1894 (CLAPIN<br />
Sylva, Dictionnaire canadien-français ou lexique-glossaire des mots, expressions et locutions<br />
ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants et dont l'usage appartient surtout aux<br />
Canadiens-français ..., Montréal-Boston, C. O. Beauchemin et fils-Sylva Clapin, 1894, 337)<br />
(ILQ).<br />
Bbg.<br />
Ø SPFC, GPFC, 1930 – Ø Bélisle, 1957 – Joseph E. Guinard, Les noms indiens…, [1960] – Ø<br />
Dict. québécois d’aujourd. – Fichier lexical du TLFQ – ILQ – Ø TLFi – Ø FEW.<br />
1 Ce paragraphe résume les données trouvées dans l‟Encyclopédie canadienne à l‟adresse<br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0008635.<br />
58
Bibliographie :<br />
Bibliographie sur l’auteur Louis Hémon et le roman Maria Chapdelaine<br />
BOURDEAU, Nicole, Une étude de Maria Chapdelaine, <strong>Québec</strong>, Boréal, 1997.<br />
DESCHAMPS, Nicole; HEROUX, Raymonde ; VILLENEUVE, Normand, Le mythe de<br />
Maria Chapdelaine, Montréal, Les Presses de L‟Université de Montréal, 1980.<br />
LEYMARIE, A.-Léo, Maria Chapdelaine. Un récit du Canada français, Bruxelles, Maurice<br />
Lamertin, 1922.<br />
ROBIDOUX, R.; RENAUD, A., Le roman canadien-français du XX e siècle, Ottawa, éd. de<br />
l‟Université d‟Ottawa, 1966.<br />
VIGH, Arpad, L’écriture de Maria Chapdelaine, <strong>Québec</strong>, Septentrion, 2004.<br />
Ouvrages sur le français nord-américain :<br />
BARBEAU, Victor, Le français du Canada, Montréal, Les Publications de l‟Académie<br />
canadienne-française, 1963.<br />
GASQUY-RESCH, Yannik, Littérature du <strong>Québec</strong>, Vanves, EDICEF, 1994.<br />
***, Livres et auteurs canadiens 1968, Panorama de l’année littéraire, Montréal, Editions<br />
Jumonville, 1969.<br />
MAJOR, Henriette, Comment vivent les Québécois, Paris, Hachette, 1979.<br />
MARTEL, Pierre ; CAJOLET-LAGANIÈRE, Hélène, Le français québécois. Usages,<br />
standard et aménagement, <strong>Québec</strong>, Les Presses de L‟Université Laval, 1996.<br />
Dictionnaires et glossaires :<br />
BÉLISLE, Louis-Alexandre, Dictionnaire général de la langue française au Canada,<br />
<strong>Québec</strong>, Bélisle éditeur, 1957.<br />
BOULANGER, Jean-Claude, Dictionnaire québécois d’aujourd’hui, Montréal, Dicorobert,<br />
1992.<br />
BRASSEUR, Patrice, Dictionnaire des régionalismes du français de Terre-Neuve, Tübingen,<br />
Niemeyer, 2001 (Canadiana Romanica 15).<br />
BRASSEUR, Patrice ; CHAUVEAU, Jean-Paul, Dictionnaire des régionalismes de Saint-<br />
Pierre et Miquelon, Tübingen, Niemeyer, 1990 (Canadiana Romanica 5).<br />
CLAPIN, Sylva, Dictionnaire canadien-français ou lexique glossaire des mots, expressions et<br />
locutions ne se trouvant pas dans les dictionnaires courants et dont l’usage appartient surtout<br />
aux Canadiens-Français, <strong>Québec</strong>, Les Presses de L‟Université Laval, 1974 (reprint de<br />
l‟original de 1894).<br />
60
DITCHY, J. K., Les Acadiens louisianais et leur parler, Paris, Droz, 1932.<br />
DUBUC, Robert ; BOULANGER Jean-Claude, Régionalismes québécois usuels, Paris,<br />
Conseil International de la langue française, 1983.<br />
DULONG, Gaston, Dictionnaire correctif du français au Canada, <strong>Québec</strong>, Les Presses de<br />
l‟Université Laval, 1968.<br />
DULONG, Gaston, Dictionnaire des canadianismes, Montréal, Larousse Canada, 1989.<br />
DUNN, Oscar, Glossaire franco-canadien et vocabulaire des locutions vicieuses usitées au<br />
Canada reproduction de l‟édition originale de 1880, <strong>Québec</strong>, Les Presses de L‟Université<br />
Laval, 1976.<br />
LACHIVER, Marcel, Dictionnaire du monde rural : les mots du passé, Paris, France, 1999.<br />
GUINARD, Joseph E., Les noms indiens de mon pays, Montréal, Rayonnement, [1960].<br />
MASSIGNON, Geneviève, Les parlers français d’Acadie. Enquête linguistique, 2 t., Paris,<br />
Librairie C. Klincksieck, [1962].<br />
NAUD, Chantal, Dictionnaire des régionalismes du français parlé des Îles de la Madeleine,<br />
L‟Etang du Nord, Ed. Vinaud, 1999.<br />
RESEAU, Pierre, Dictionnaire des régionalismes de France, Bruxelles, Boeck-Duculot,<br />
2001.<br />
Société du parler français au Canada, Glossaire du parler français au Canada, <strong>Québec</strong>, Les<br />
Presses de l‟Université Laval, 1930.<br />
THIBAULT, André (sous la direction de Pierre Knecht), Dictionnaire suisse romand :<br />
particularités lexicales du français contemporain, Genève, Editions Zoé, 2004.<br />
Trésor de la langue française au <strong>Québec</strong> (TLFQ), Dictionnaire historique du français<br />
québécois : Monographies lexicographiques de québécismes, sous la direction de Claude<br />
Poirier, Sainte-Foy (<strong>Québec</strong>), Les Presses de L‟Université Laval, 1988.<br />
VIGER, Jacques, Néologie canadienne, ou dictionnaire des mots créés en Canada et<br />
maintenant en vogue…, manuscrits édités par Suzelle Blais, <strong>Québec</strong>, 1982.<br />
WARTBURG (Walther von), Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine Darstellung<br />
des galloromanischen Sprachschatzes, Bonn/Leipzig/Basel, [en cours de publication depuis<br />
1922].<br />
Articles:<br />
JUNEAU, Marcel, «Québécois bleuet, français berlue, même souche» dans RLiR n°197-198,<br />
t. 50, (1986), Strasbourg, 133-137.<br />
THIBAULD, André, «Glossairistique et littérature francophone» dans la RLiR, t. 70 (2006),<br />
Strasbourg, 277-278.<br />
61
DE GRANDPRÉ, A., «Maria Chapdelaine» dans Parler français, t. 15, n°10 (1917), <strong>Québec</strong>,<br />
433-437.<br />
Sites Internet :<br />
http://atilf.atilf.fr/tlf.htm. (TLFi).<br />
http://pewebdic2.cw.idm.fr/ (Longman Dictionnary of Contemporary English Online).<br />
http://www.province-quebec.com/dico.php.<br />
(Dictionnaire québécois-français en ligne)<br />
http://www.tlfq.ulaval.ca/ (TLFQ).<br />
http://www.thecanadianencyclopedia.com/<strong>index</strong>.cfm?PgNm=TCESearch&Params=F1.<br />
(Encyclopédie canadienne en ligne)<br />
62