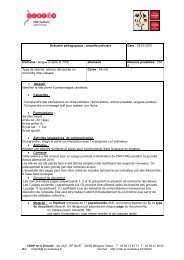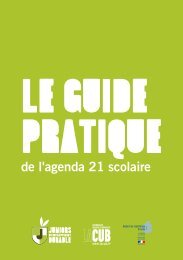La musique - CRDP Aquitaine
La musique - CRDP Aquitaine
La musique - CRDP Aquitaine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Clés pour<br />
enseigner l’histoire des arts<br />
EXTRAITS<br />
Séquences pédagogiques<br />
Christine CARRERE<br />
Professeur des écoles<br />
Pascale DARDEY<br />
Conseillère pédagogique éducation artistique<br />
Pierre MARTINET<br />
Inspecteur de l’Éducation nationale<br />
Nathalie MOUNET<br />
Conseillère pédagogique arts visuels<br />
en cycle 3<br />
Le Moyen Âge<br />
Guillaume LACHAUD<br />
Professeur d’histoire<br />
Carol ZIMMERMANN<br />
Professeur d’histoire<br />
pour la partie <strong>musique</strong><br />
Henri GONZALEZ<br />
Professeur d’éducation musicale — IUFM<br />
Conseil scientifi que<br />
Philippe ARAGUAS<br />
Professeur d’université<br />
Marc SABOYA<br />
Professeur d’université<br />
5
14<br />
Sommaire<br />
PRÉFACE 7<br />
PRÉSENTATION : COMMENT ENSEIGNER L’HISTOIRE DES ARTS ? 9<br />
INTRODUCTION À L’ART MÉDIÉVAL OCCIDENTAL 17<br />
EXTRAITS<br />
L’ARCHITECTURE MILITAIRE<br />
. L’architecture militaire : cinq siècles d’évolution 21<br />
. Carcassonne, une cité fortifi ée au cœur de l’histoire occidentale 29<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Une cité fortifi ée, Carcassonne 40<br />
2. L’architecture militaire 42<br />
L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE<br />
. L’architecture de l’église médiévale 47<br />
. <strong>La</strong> cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse de Carcassonne 52<br />
LE VITRAIL<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. L’architecture religieuse 58<br />
2. Du roman au gothique 60<br />
. Le vitrail : technique et évolution 65<br />
. Les vitraux de la cathédrale de Carcassonne :<br />
un programme iconographique 72<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Verre et couleurs 78<br />
2. Un récit en lumière 80
LA SCULPTURE ROMANE<br />
. <strong>La</strong> sculpture romane 85<br />
. Un chef d’œuvre de l’art roman : le portail de Moissac 89<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Un récit sculpté 98<br />
2. Sculpter le mouvement 100<br />
EXTRAITS<br />
LE MANUSCRIT ENLUMINÉ<br />
. Le livre au Moyen Âge 105<br />
. L’évangéliaire de Saint-Nazaire, un manuscrit du XIII e siècle 111<br />
LA MUSIQUE<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Une lettre historiée 114<br />
2. Le tournoi, une fête nobiliaire 116<br />
. <strong>La</strong> <strong>musique</strong> au Moyen Âge 121<br />
. Les instruments de <strong>musique</strong> 127<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Le chant grégorien 130<br />
2. <strong>La</strong> chanson des troubadours 131<br />
POUR CONCLURE... 133<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Les arts racontent 134<br />
2. Les arts dialoguent 136<br />
GLOSSAIRE (lexique repéré dans l’ouvrage par *) 140<br />
SOMMAIRE DU CD AUDIO 145<br />
SOMMAIRE DU CÉDÉROM 147<br />
CRÉDITS 150<br />
15
<strong>La</strong> <strong>musique</strong><br />
au Moyen Âge<br />
Comme les autres formes de l’art médiéval occidental,<br />
la <strong>musique</strong> résulte d’un croisement d’héritages<br />
anciens et d’infl uences aussi diverses que les régions<br />
concernées : les plus méridionales encore marquées<br />
par la civilisation romaine et à partir du VIII e siècle en<br />
contact avec l’Espagne mauresque proche, les plus<br />
au nord pénétrées de courants mêlant cultures celtes,<br />
scandinaves ou germaniques. L’Église, organisée<br />
sur le modèle de l’ancienne administration des Césars,<br />
reste le seul pouvoir unifi cateur de ce qui fut autrefois<br />
l’Empire romain ; elle favorisera pendant des siècles<br />
le développement d’une culture artistique religieuse,<br />
au service de la louange divine, de la prière<br />
et de l’édifi cation des fi dèles issus de ces vastes territoires<br />
contrastés.<br />
EXTRAITS<br />
Le savoir antique subsiste à l’abri des monastères,<br />
mais, en ce qui concerne la <strong>musique</strong> des premiers<br />
siècles, seuls quelques écrits théoriques, des documents<br />
littéraires ou iconographiques, sont préservés,<br />
comme le célèbre traité De musica de Boèce (470-<br />
525) qui sert de fondement à la pensée des théoriciens<br />
ultérieurs jusqu’à la Renaissance. Jusqu’au<br />
IX e siècle au moins (époque carolingienne), le répertoire<br />
circule oralement et nous ne connaissons rien<br />
de la <strong>musique</strong> de ces neuf premiers siècles. <strong>La</strong> notation<br />
exacte des hauteurs musicales, essentielle pour<br />
une restitution correcte, n’apparaît qu’au début du<br />
XI e siècle, grâce à des repères linéaires attribués à des<br />
notes fi xes qui déboucheront sur l’invention de la<br />
portée. Quant aux premières tentatives de notation<br />
rythmique, elles commencent seulement au XIII e siècle,<br />
et encore de manière très imparfaite.<br />
Les moines, dépositaires du savoir, ne jugent dignes<br />
de mettre par écrit que ce qui est sérieux, utile à<br />
l’Église et au culte ; pour cette raison, les documents<br />
de <strong>musique</strong> conservés de cette époque lointaine ne<br />
concernent que la <strong>musique</strong> religieuse. Ce n’est que<br />
très progressivement que des fragments de <strong>musique</strong><br />
profane ou de divertissement bénéfi cient d’un support<br />
écrit. Cette hiérarchie des genres entre <strong>musique</strong><br />
au service du divin et <strong>musique</strong> profane perdurera<br />
longtemps jusqu’à la fi n du XVI e siècle où la <strong>musique</strong><br />
poétique, théâtrale ou instrumentale d’inspiration<br />
non religieuse arrivera à s’imposer comme étant un<br />
objet aussi digne d’intérêt et d’étude que le répertoire<br />
sacré. Cette mentalité explique également le fait que<br />
la <strong>musique</strong> vocale, comme expression d’une parole<br />
et donc de la raison, soit considérée pendant des siècles<br />
comme supérieure à la <strong>musique</strong> instrumentale<br />
qui touche directement les sens, donc en dehors du<br />
contrôle de la raison et suspecte d’entraîner vers les<br />
faiblesses de la chair. Le fait d’être tributaire d’un objet<br />
pour produire des sons assimile également la <strong>musique</strong><br />
instrumentale à une activité manuelle, toujours<br />
selon les mentalités de l’époque, moins bien considérée<br />
que le chant, plus proche des activités de l’esprit.<br />
Les premières traces de <strong>musique</strong> profane (chansons<br />
de banquet, danses de cour ou danses paysannes)<br />
datent du renouveau de la civilisation européenne<br />
au XI e siècle, mais malheureusement, très souvent, les<br />
copistes n’ont l’idée de conserver que les poésies des<br />
troubadours* et des trouvères*, non les <strong>musique</strong>s ou<br />
alors sous une forme trop rudimentaire.<br />
Monodique depuis des temps immémoriaux, avec<br />
sans doute quelques ajouts éventuels de bourdons<br />
ou variantes hétérophoniques improvisées ponctuellement<br />
sans qu’on puisse parler de véritable polyphonie,<br />
la <strong>musique</strong> occidentale va se démarquer des<br />
autres cultures en introduisant la polyphonie, d’abord<br />
à deux voix, puis trois et quatre. Cette invention de la<br />
polyphonie, d’abord dans le domaine religieux, est<br />
favorisée par les progrès de la notation musicale qui<br />
permet de réaliser, grâce au support écrit, des combinaisons<br />
de lignes de plus en plus complexes, des<br />
« contrepoints », qui ne relèvent plus des techniques<br />
improvisées sur le champ, mais d’un travail d’élaboration<br />
à la table, beaucoup plus long, selon des règles<br />
qui s’établissent peu à peu en fonction de ce qui<br />
est jugé comme sonnant « bien » ou non. Ces règles<br />
de composition évolueront constamment avec les<br />
générations et les changements du goût.<br />
<strong>La</strong> <strong>musique</strong> sacrée médiévale monodique ou plainchant<br />
est avant tout une <strong>musique</strong> fonctionnelle, faite<br />
pour la prière et le service divin (messes et offi ces)<br />
qui rythmait la journée des moines et religieuses,<br />
et du clergé séculier des paroisses ou cathédrales.<br />
Au centre de cette activité musicale, le chant des<br />
150 psaumes exécutés durant le cycle hebdomadaire<br />
des Offi ces. Les autres mélodies reposent sur des<br />
textes bibliques (Ancien et Nouveau Testament) ou<br />
autres ; ils peuvent être d’inspiration poétique libre,<br />
comme les hymnes. <strong>La</strong> pluralité des Églises (grecque,<br />
romaine, milanaise, bénéventine, gallicane,<br />
hispanique...) entraîne la constitution de rites et de<br />
répertoires propres ; Charlemagne, frappé par les divergences<br />
entre la manière de chanter des Romains<br />
et celle des Gallicans, décide d’unifi er les pratiques,<br />
autour d’un corpus de synthèse qu’on attribua abusivement<br />
à la divine inspiration de Saint-Grégoire<br />
121
(pape en 590-604), d’où l’appellation ultérieure de<br />
« chant grégorien » donnée au plain-chant ainsi réformé.<br />
Des transformations continuèrent à s’opérer<br />
tout au long des siècles.<br />
<strong>La</strong> volonté d’unifi cation de Charlemagne s’étendait<br />
bien au-delà de la <strong>musique</strong> et visait à asseoir sa<br />
puissance politique en s’appuyant sur un empire qui<br />
fût une entité géographique, religieuse et culturelle<br />
la moins morcelée possible.<br />
EXTRAITS<br />
1. <strong>La</strong> monodie :<br />
le plain-chant<br />
Entre le VI e et le IX e , un répertoire est déjà constitué<br />
à partir d’un fonds musical ancien synagogal<br />
de psaumes et d’hymnes (terme féminin dans ce<br />
sens), les premiers chrétiens étant pour la plupart<br />
des juifs convertis ; sont vraisemblablement mêlés<br />
à ce substrat, des emprunts à d’autres traditions<br />
détournées, marches militaires romaines à trois<br />
temps qu’on retrouve dans le rythme de certaines<br />
hymnes, ou chants sacrés païens. Le psaume est interprété<br />
par le chantre soliste alors que les hymnes<br />
sont chantées selon la technique responsoriale (le<br />
soliste chante un verset et le chœur des chantres<br />
ou l’assemblée répond à l’unisson).<br />
Le plain-chant est une <strong>musique</strong> vocale monodique<br />
(à une seule voix), a cappella (sans accompagnement<br />
instrumental). Il suit la prosodie c’est-à-dire<br />
que c’est le rythme du texte qui va défi nir celui de<br />
la <strong>musique</strong> et non l’inverse. Il n’y a pas de notation<br />
rythmique précise dans le plain-chant. Le système<br />
musical médiéval est régi par des échelles modales<br />
dont l’usage déclinera à la fi n du XVI e siècle, pour céder<br />
peu à peu la place au XVII e siècle à la conception<br />
tonale du style baroque.<br />
<strong>La</strong> première forme de notation musicale est l’écriture<br />
neumatique : c’est un ensemble de signes dérivés<br />
des accents grammaticaux servant plus d’aidemémoire<br />
sur le contour mélodique général que de<br />
véritable indication précise des hauteurs de notes ;<br />
les neumes individuels ou composés sont indiqués<br />
au-dessus ou au-dessous du texte liturgique.<br />
À partir du XIII e siècle, on utilise l’écriture neumatique<br />
carrée sur une portée de quatre lignes, écriture<br />
dont s’est inspirée la notation moderne du plainchant<br />
dans l’édition vaticane. L’avènement de la<br />
notation musicale marque un tournant dans la <strong>musique</strong><br />
et notamment dans sa diff usion. Jusque-là,<br />
seule la transmission orale permettait de faire vivre<br />
le répertoire. <strong>La</strong> notation musicale autorise donc<br />
une diff usion plus large, plus « sûre », en évitant les<br />
122 LA MUSIQUE AU MOYEN ÂGE<br />
déformations inhérentes à la transmission orale. Cependant,<br />
la <strong>musique</strong> étant désormais écrite, elle se<br />
fi ge et le corpus grégorien évolue désormais peu,<br />
sauf son interprétation, qui se modifi e sensiblement<br />
en fonction de l’évolution musicale générale.<br />
Jusqu’au XIV e siècle, seule la <strong>musique</strong> vocale s’écrit<br />
pour des raisons - évoquées en introduction - de<br />
préséance et de hiérarchie à l’intérieur des genres<br />
musicaux. Le répertoire de plain-chant infl uence<br />
largement les répertoires qui vont suivre.<br />
Tropaire de l’abbaye Saint-Martial de Limoges, XIe siècle<br />
Un exemple de première notation musicale : écriture neumatique directionnelle<br />
non diastématique (sans indication précise de hauteur).
2. <strong>La</strong> polyphonie<br />
<strong>La</strong> <strong>musique</strong> sacrée<br />
Tout comme le chant grégorien, la polyphonie*<br />
s’épanouit d’abord dans la <strong>musique</strong> sacrée avant de<br />
se développer aussi dans le domaine profane. Elle<br />
emprunte au grégorien sa notation neumatique,<br />
ses lignes (les portées) et ses modes. Les premières<br />
formes improvisées (bourdons, organum parallèle<br />
EXTRAITS<br />
et oblique), documentées depuis l’époque de Charlemagne<br />
(IX e siècle) sont le résultat de pratiques<br />
beaucoup plus anciennes. Le style polyphonique<br />
s’enrichit et se raffi ne considérablement entre 1050<br />
et 1250, d’abord en <strong>Aquitaine</strong> grâce aux recherches<br />
de grands monastères comme Saint-Martial de<br />
Limoges, puis à Paris au sein de la cathédrale Notre-<br />
Dame. <strong>La</strong> polyphonie de base à deux voix (déchant)<br />
passe volontiers à trois et parfois même quatre voix,<br />
pour des pièces importantes destinées aux célébrations<br />
les plus solennelles.<br />
L’organum simple ou L’organum parallèle<br />
<strong>La</strong> première voix est un chant mélodique grégorien<br />
avec paroles latines. Mais la mélodie est<br />
plus étirée, plus rythmée et n’a plus la souplesse<br />
du plain-chant. C’est une obligation dictée par<br />
la polyphonie elle-même. Lorsque plusieurs<br />
voix chantent simultanément, elles doivent se<br />
retrouver sur des moments précis. On s’oriente<br />
donc vers la <strong>musique</strong> mesurée.<br />
<strong>La</strong> deuxième voix part sur la même note puis<br />
suit parallèlement à la quarte ou à la quinte<br />
(4 notes ou 5 notes au-dessus ou en dessous)<br />
et termine à l’unisson (sur la même note) ou à<br />
l’octave (sur la même note mais plus aiguë ou<br />
plus grave).<br />
Le déchant<br />
C’est un organum simple mais les lignes mélodiques<br />
vont en sens contraire. Il donne naissance<br />
au début du XIII e siècle à l’organum à vocalise, au<br />
conduit et au motet.<br />
L’organum à vocalises ou fl euri<br />
<strong>La</strong> première voix (grégorienne), appelée teneur<br />
ou voix principale, s’étire considérablement.<br />
Au-dessus, la deuxième voix, ou voix organale,<br />
est très ornée (mélismatique).<br />
Le conduit (conductus)<br />
Il apparaît au XII e siècle et sert, comme son<br />
nom l’indique, à accompagner ou « conduire »<br />
un mouvement liturgique (procession) ou un<br />
déplacement de personnages (drames liturgiques).<br />
C’est une composition monodique ou<br />
polyphonique originale, le plus souvent sans<br />
emprunt à un thème grégorien préexistant, et<br />
de style essentiellement syllabique (sauf parfois<br />
en début ou en conclusion). Le texte est une<br />
poésie rimée sur des sujets religieux, mais aussi<br />
politiques ou satiriques.<br />
Le motet<br />
<strong>La</strong> teneur est le plus souvent liturgique et extrêmement<br />
étirée ; au XIV e siècle, Guillaume de<br />
Machaut emprunte parfois les teneurs de ses<br />
motets au répertoire de la chanson. Les voix<br />
supérieures (une, deux, voire trois) possèdent<br />
chacune un texte diff érent, en latin ou en français,<br />
commentant en paroles syllabiques le sujet<br />
principal. Comme le conduit et selon les périodes,<br />
le motet peut être d’inspiration religieuse<br />
ou aborder d’autres thématiques politiques,<br />
morales ou liées à l’amour courtois (par exemple,<br />
chez Guillaume de Machaut). Le mélange<br />
étonnant, pour notre culture actuelle, du sacré<br />
et du profane au sein d’une même composition,<br />
est caractéristique des mentalités médiévales<br />
où le religieux est profondément enraciné au<br />
cœur du quotidien humain.<br />
<strong>La</strong> langue des chants sacrés<br />
Le latin se répand avec les conquêtes romaines, d’abord<br />
dans toute l’Italie, puis dans les régions de l’Ouest qui<br />
forment progressivement l’Empire romain d’Occident, se<br />
détachant au cours des III e et IV e siècles de l’Empire d’Orient,<br />
où le grec est la langue commune. Le latin devient alors le<br />
vecteur unique de la religion, de la politique, de l’administration,<br />
du droit et du commerce dans une large partie de<br />
l’Europe de l’Ouest.<br />
À la chute de l’Empire d’Occident, au V e siècle, le latin, dont<br />
l’unité n’est plus maintenue par les échanges et un pouvoir<br />
politique central, se fragmente en différentes langues.<br />
L’Église catholique et le pouvoir carolingien s’inquiètent<br />
des conséquences de cette évolution et rétablissent l’étude<br />
du latin qui connaît alors une seconde vie.<br />
Au Moyen Âge, le latin est la langue de l’Église catholique,<br />
la langue d’étude et celle de nombreux actes officiels. <strong>La</strong><br />
littérature en latin, riche et variée, côtoie la production littéraire<br />
dans les langues nouvelles et ce jusqu’à la Renaissance,<br />
au XVI e siècle, même si l’édit de Villers-Cotterêts pris<br />
par François 1er en 1539 impose alors le français dans tous<br />
les actes officiels.<br />
Le latin subsiste comme langue philosophique et scientifique<br />
internationale tout au long du XVII e siècle, et n’est progressivement<br />
remplacé dans cet usage que par le français<br />
au XVIII e siècle puis par l’anglais. Il reste aujourd’hui la langue<br />
de l’Église catholique.<br />
123
EXTRAITS<br />
Dégager l’essentiel<br />
<strong>La</strong> <strong>musique</strong> au Moyen Âge est plurielle ; dans ses premières expressions, elle n’est pas assimilée<br />
à un art mais, sous l’infl uence conjuguée des pouvoirs religieux et politiques, elle accède peu à peu<br />
à ce statut.<br />
Musique sacrée, essentiellement tournée vers Dieu, le chant grégorien ou plain-chant est une production<br />
vocale à une seule voix ; il est diff usé par les chœurs de moines. <strong>La</strong> notation neumatique est<br />
sa première forme d’écriture : les neumes suivent le texte en ne donnant que le mouvement mélodique.<br />
Peu à peu le chant évolue vers des formes plus complexes, polyphoniques, transcrites sur des<br />
portées (notation vaticane).<br />
Musique profane, la poésie des troubadours exalte l’amour courtois et l’engagement politique.<br />
Cette <strong>musique</strong>, qui échappe à la sphère religieuse, apparaît dès le IX e siècle. Les troubadours développent<br />
de nouveaux modes d’expressions comme la fi n’amor et le sirventes. Les rythmes musicaux,<br />
asservis au texte dans un premier temps, font l’objet d’une notation spécifi que à partir du XIII e siècle,<br />
l’art musical et sa théorisation prennent alors toute leur ampleur.<br />
Traiter le sujet en classe<br />
Séquence 1 Le chant grégorien page 130<br />
Séquence 2 <strong>La</strong> chanson des troubadours page 131<br />
129
Séquence pédagogique 1<br />
130<br />
Le chant grégorien<br />
Du chœur de l’église monte un plain-chant…<br />
on y prélève facilement des indices sonores<br />
pour permettre au jeune auditeur de percevoir<br />
les caractéristiques de ce registre vocal, a priori<br />
nouveau pour lui, et de le lui faire écouter et apprécier.<br />
EXTRAITS<br />
Domaine artistique<br />
Arts du son<br />
Prolongements<br />
Écoutes satellites<br />
<br />
<br />
Vocabulaire<br />
Chœur<br />
A cappella<br />
Chant à l’unisson<br />
Orchestre symphonique<br />
Matériel<br />
pédagogique<br />
<strong>La</strong> séquence détaillée<br />
1 fi che élève<br />
- <strong>La</strong> grille d’écoute<br />
Une proposition de<br />
corrigé<br />
Piste n° 1 : extrait du Dies iræ<br />
Incise grégorienne attribuée à Thomas de Celano -<br />
XIII e siècle<br />
Par les moines de l’abbaye d’En Calcat<br />
Piste n° 2 : extrait du 5 e mouvement de la<br />
Symphonie Fantastique<br />
Hector Berlioz - XIX e siècle<br />
Par l’orchestre national de Lille,<br />
direction J.-C. Casadesus<br />
Piste n°3 : Dies iræ – Requiem<br />
Wolfgang Amadeus Mozart - XVIII e siècle<br />
Par l’orchestre des Champs-Élysées,<br />
direction P. Herreweghe<br />
Collegium Vocale Gent
LA MUSIQUE MÉDIÉVALE<br />
1. Découverte<br />
Écoute de l’extrait n°1<br />
SÉQUENCE 1<br />
Le chant grégorien<br />
RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES OBJECTIFS<br />
Domaine<br />
artistique :<br />
les « arts<br />
du son »<br />
Liste de référence<br />
* Le Moyen Âge<br />
- […]<br />
- Une <strong>musique</strong> religieuse (chant<br />
grégorien) et profane (chanson<br />
de troubadours).<br />
- […]<br />
EXTRAITS<br />
DOCUMENTS, MATÉRIEL<br />
Pour l’enseignant<br />
- Ressources générales :<br />
ouvrage chapitre 6<br />
- Ressources spécifi ques<br />
DÉROULEMENT<br />
Échange oral<br />
L’échange s’organise autour de questions simples : « qu’est-ce que c’est ?.... »<br />
<strong>La</strong> référence et la date de l’extrait sont portées au tableau :<br />
extrait n°1 : Dies irae (Thomas de Celano 1200-1260) – Moyen Âge.<br />
- Susciter la curiosité et enrichir la mémoire de<br />
l’élève d’un registre musical nouveau.<br />
- Favoriser une écoute attentive.<br />
- Développer la capacité à relever des indices<br />
sonores.<br />
- Faire percevoir la dimension religieuse du chant<br />
grégorien.<br />
- Favoriser la formulation des perceptions.<br />
Vocabulaire à acquérir<br />
Chœur<br />
A cappella<br />
Chant à l’unisson<br />
Orchestre symphonique<br />
Matériel musical<br />
Extrait n° 1 :<br />
Dies irae (incise grégorienne attribuée à Thomas de Celano 1200-1260)<br />
Extrait n° 2 :<br />
5 e mouvement de la Symphonie Fantastique de Berlioz « Songe d’une nuit de sabbat »<br />
Extrait n°3 :<br />
Dies irae du Requiem de Mozart<br />
Dies irae (incise grégorienne attribuée à Thomas de Celano 1200-1260) – Moyen Âge<br />
Dies irae est une locution latine signifi ant Jour de colère.<br />
C’est un poème apocalyptique en latin attribué à Thomas de Celano, frère Franciscain (ordre mendiant). Cette séquence a<br />
été sauvegardée grâce à un manuscrit de la fi n du XVII e siècle. Elle se trouve souvent dans le Requiem (Messe des morts de<br />
l’offi ce catholique).<br />
Écoute de l’extrait n°2<br />
Échange oral<br />
L’échange s’organise autour de questions simples : « qu’est-ce que c’est ?.... »<br />
<strong>La</strong> référence et la date de l’extrait sont portées au tableau :<br />
extrait n°2 : 5 e mouvement de la Symphonie Fantastique de Berlioz « Songe d’une nuit de sabbat » XIX e siècle.<br />
Berlioz reprend le Dies irae dans le 5 e mouvement de la Symphonie Fantastique « Songe d’une nuit de sabbat ».
Écoute de l’extrait n°3<br />
Échange oral<br />
L’échange s’organise autour de questions simples : « qu’est-ce que c’est ?... »<br />
<strong>La</strong> référence et la date de l’extrait sont portées au tableau :<br />
extrait n° 3 : Dies irae du Requiem de Mozart - XVIII e siècle.<br />
Cette <strong>musique</strong> est destinée à être interprétée lors d’une cérémonie d’enterrement.<br />
Repérage dans le temps<br />
L’enseignant réalise au tableau une échelle du temps du X e siècle au XXI e siècle pour resituer le Moyen Âge par<br />
rapport à nos jours et placer les trois extraits musicaux (extrait n° 1 au XII e – extrait n°2 au XIX e – extrait n°3<br />
au XVIII e )<br />
EXTRAITS<br />
Le texte du Dies irae<br />
L’enseignant peut éventuellement recopier au tableau le début du texte du Dies irae et sa traduction :<br />
Dies irae – Dies illa – Solvet saeculum en favilla<br />
Jour de colère – que ce jour là - qui verra les siècles réduits en cendres<br />
2. Analyse guidée<br />
Travail de recherche<br />
Les élèves reçoivent la fi che de travail, ils prennent connaissance des rubriques à alimenter ; ils travaillent en<br />
groupe.<br />
L’enseignant explique comment va être organisée leur écoute.<br />
Phase 1<br />
- 2 nouvelles écoutes collectives de l’extrait n°1<br />
- 5 minutes de travail sur la fi che – colonne 1<br />
Phase 2<br />
- 2 nouvelles écoutes collectives de l’extrait n°2<br />
- 5 minutes de travail sur la fi che – colonne 2<br />
Phase 3<br />
- 2 nouvelles écoutes collectives de l’extrait n°3<br />
- 5 minutes de travail sur la fi che – colonne 2<br />
Mise en commun, à l’oral<br />
Dans un premier temps, l’enseignant recueille les similitudes et les différences relevées par les élèves dans leur<br />
écoute des 3 extraits musicaux et cherche à les classer au tableau ; il apporte le vocabulaire nécessaire.<br />
Dans un deuxième temps, l’enseignant s’appuie sur le classement qui vient d’être fait pour dégager les<br />
caractéristiques du chant grégorien; il apporte le vocabulaire nécessaire.<br />
• Similitudes<br />
D’après les intitulés des colonnes, les trois extraits utilisent le même texte liturgique du Dies irae, cependant Berlioz n’emprunte<br />
que la mélodie au chant grégorien et Mozart ne reprend que le texte.<br />
• Différences<br />
- Les périodes de production : repérage sur l’échelle du temps (extrait n°1 du XIIIe siècle Moyen Âge / extrait n°3 du XVIII e<br />
période classique / extrait n°2 du XIX e période romantique).<br />
- L’effectif choral ou instrumental est différent dans les trois versions ; les relevés peuvent être classés et mis en opposition :<br />
Musique vocale (extrait n°1) / Musique instrumentale (extrait n°2) / Musique mixte (extrait n°3)<br />
Chant a cappella (extrait n°1) / Chant accompagné (extrait n°3)<br />
Chant monodique (extrait n°1) / Chant polyphonique (extrait n°2).<br />
- Les fonctions et lieux de représentation ; même travail de classement et mise en opposition :<br />
Musique sacrée (extraits n°1 et n°3) / Musique profane (extrait n°2).<br />
p. 2 LA MUSIQUE MÉDIÉVALE . SÉQUENCE 1
LE CHANT GRÉGORIEN<br />
On écoute…<br />
Les voix<br />
Qui chante (hommes,<br />
femmes, enfants) ?<br />
Voix seules ?<br />
Voix accompagnées<br />
d’instruments ?<br />
<strong>La</strong>ngue utilisée ?<br />
Avez-vous reconnu<br />
quelques mots ?<br />
Les voix chantentelles<br />
la même<br />
chose ou des choses<br />
différentes ?<br />
Extrait n° 1<br />
Dies irae<br />
Chant grégorien<br />
de Thomas de Celano<br />
XIII e siècle<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
EXTRAITS<br />
Les instruments<br />
Quels instruments ?<br />
Le caractère<br />
Est-il doux, marqué,<br />
puissant ?<br />
Qu’évoque-t-il ?<br />
Le tempo<br />
Sentez-vous une<br />
pulsation ? Est-elle<br />
rapide ou lente ?<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
Extrait n° 2<br />
Symphonie Fantastique<br />
extrait du 5 e mouvement<br />
de Berlioz<br />
XIX e siècle<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
Extrait n°3<br />
Requiem<br />
Dies irae<br />
de Mozart<br />
XVIII e siècle<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
………………………………………………<br />
1
Séquence pédagogique 2<br />
<strong>La</strong> chanson des troubadours<br />
Au XII e siècle, l’art poétique et musical des troubadours<br />
investit le champ de la <strong>musique</strong> jusque là<br />
réservé au monde religieux. Ces chansons profanes<br />
nous donnent à entendre des rythmes et des<br />
sonorités qui, à la première écoute, surprennent et<br />
retiennent l’attention.<br />
EXTRAITS<br />
Domaine artistique<br />
Arts du son<br />
Prolongements<br />
Écoutes satellites<br />
<br />
<br />
Vocabulaire<br />
Troubadour<br />
Ménestrel<br />
Vielle<br />
Luth<br />
Matériel<br />
pédagogique<br />
<strong>La</strong> séquence détaillée<br />
1 fi che élève<br />
- <strong>La</strong> grille d’écoute<br />
Une proposition de<br />
corrigé<br />
Piste n° 4 : extrait de Calenda maia<br />
Chanson d’amour courtois de Raimbaut de<br />
Vaqueiras - XII e siècle<br />
Par l’Ensemble Fin’ Amor<br />
Piste n° 5 : extrait de Rassa, tan creis...<br />
Sirventes de Bertan de Bòrn - XII e siècle<br />
Par l’Ensemble Tre Fontane<br />
Piste n°6 : extrait de Sirventes de Peire<br />
Sirventes de Peire Cardinal - XII e siècle<br />
Par Joan-Pau Verdier<br />
131