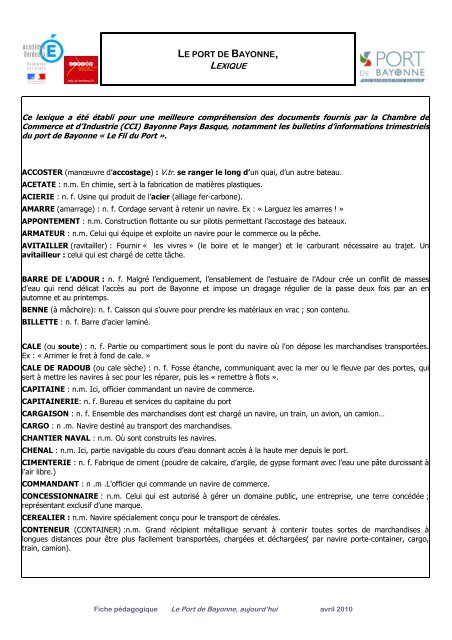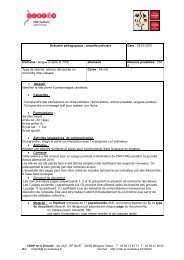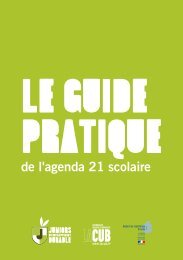Le lexique du port
Le lexique du port
Le lexique du port
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LE PORT DE BAYONNE,<br />
LEXIQUE<br />
Ce <strong>lexique</strong> a été établi pour une meilleure compréhension des documents fournis par la Chambre de<br />
Commerce et d’In<strong>du</strong>strie (CCI) Bayonne Pays Basque, notamment les bulletins d’informations trimestriels<br />
<strong>du</strong> <strong>port</strong> de Bayonne « <strong>Le</strong> Fil <strong>du</strong> Port ».<br />
ACCOSTER (manœuvre d’accostage) : V.tr. se ranger le long d’un quai, d’un autre bateau.<br />
ACETATE : n.m. En chimie, sert à la fabrication de matières plastiques.<br />
ACIERIE : n. f. Usine qui pro<strong>du</strong>it de l’acier (alliage fer-carbone).<br />
AMARRE (amarrage) : n. f. Cordage servant à retenir un navire. Ex : « Larguez les amarres ! »<br />
APPONTEMENT : n.m. Construction flottante ou sur pilotis permettant l’accostage des bateaux.<br />
ARMATEUR : n.m. Celui qui équipe et exploite un navire pour le commerce ou la pêche.<br />
AVITAILLER (ravitailler) : Fournir « les vivres » (le boire et le manger) et le carburant nécessaire au trajet. Un<br />
avitailleur : celui qui est chargé de cette tâche.<br />
BARRE DE L’ADOUR : n. f. Malgré l’endiguement, l’ensablement de l’estuaire de l’Adour crée un conflit de masses<br />
d’eau qui rend délicat l’accès au <strong>port</strong> de Bayonne et impose un dragage régulier de la passe deux fois par an en<br />
automne et au printemps.<br />
BENNE (à mâchoire): n. f. Caisson qui s’ouvre pour prendre les matériaux en vrac ; son contenu.<br />
BILLETTE : n. f. Barre d’acier laminé.<br />
CALE (ou soute) : n. f. Partie ou compartiment sous le pont <strong>du</strong> navire où l’on dépose les marchandises trans<strong>port</strong>ées.<br />
Ex : « Arrimer le fret à fond de cale. »<br />
CALE DE RADOUB (ou cale sèche) : n. f. Fosse étanche, communiquant avec la mer ou le fleuve par des <strong>port</strong>es, qui<br />
sert à mettre les navires à sec pour les réparer, puis les « remettre à flots ».<br />
CAPITAINE : n.m. Ici, officier commandant un navire de commerce.<br />
CAPITAINERIE: n. f. Bureau et services <strong>du</strong> capitaine <strong>du</strong> <strong>port</strong><br />
CARGAISON : n. f. Ensemble des marchandises dont est chargé un navire, un train, un avion, un camion…<br />
CARGO : n .m. Navire destiné au trans<strong>port</strong> des marchandises.<br />
CHANTIER NAVAL : n.m. Où sont construits les navires.<br />
CHENAL : n.m. Ici, partie navigable <strong>du</strong> cours d’eau donnant accès à la haute mer depuis le <strong>port</strong>.<br />
CIMENTERIE : n. f. Fabrique de ciment (poudre de calcaire, d’argile, de gypse formant avec l’eau une pâte <strong>du</strong>rcissant à<br />
l’air libre.)<br />
COMMANDANT : n .m .L’officier qui commande un navire de commerce.<br />
CONCESSIONNAIRE : n.m. Celui qui est autorisé à gérer un domaine public, une entreprise, une terre concédée ;<br />
représentant exclusif d’une marque.<br />
CEREALIER : n.m. Navire spécialement conçu pour le trans<strong>port</strong> de céréales.<br />
CONTENEUR (CONTAINER) :n.m. Grand récipient métallique servant à contenir toutes sortes de marchandises à<br />
longues distances pour être plus facilement trans<strong>port</strong>ées, chargées et déchargées( par navire <strong>port</strong>e-container, cargo,<br />
train, camion).<br />
Fiche pédagogique <strong>Le</strong> Port de Bayonne, aujourd’hui avril 2010
DIGUE : n. f. Enrochement et haute construction solide, étanche, en béton armé, servant à endiguer un fleuve, ou la<br />
mer, pour dévier, freiner sa force, canaliser son courant et la montée des eaux.<br />
DOCK : n .m. Bassin entouré de quais servant au chargement et déchargement des navires. DOCKS : n.m .pl.<br />
immenses hangars servant d’entrepôts dans les <strong>port</strong>s.<br />
DOCKER : n .m. Ouvrier manutentionnaire <strong>du</strong> <strong>port</strong> (qui travaille à charger et décharger les navires).<br />
DRAGAGE : n.m. Action de draguer, d’extraire des profondeurs <strong>du</strong> chenal <strong>du</strong> <strong>port</strong> ou <strong>du</strong> fond de la rivière des<br />
matériaux à l’aide d’une drague (ou bateau dragueur) afin d’éviter son ensablement ou envasement. Deux campagnes<br />
de dragage de l’Adour, une en automne et une au printemps ont lieu chaque année pour l’entretien <strong>du</strong> chenal <strong>du</strong> <strong>port</strong> de<br />
Bayonne. En outre les débris flottants sont filtrés et retirés plus en amont de l’estuaire, au niveau d’Urt.<br />
DROITS PORTUAIRES : n .m .pl. Taxe, péage, droit d’entrée, d’enregistrement pour l’utilisation <strong>du</strong> <strong>port</strong>.<br />
DEPOT : n.m. Action de déposer, stocker ; lieu où l’on dépose.<br />
ECLUSE : n. f. Ouvrage étanche sur un canal de navigation, délimité par deux <strong>port</strong>es, une dalle de fond et deux parois<br />
latérales permettant à un bateau le passage d’un « bief »à un autre.<br />
EMBOUCHURE : n. f. Endroit où un cours d’eau se jette dans la mer.<br />
ENGRAIS : n.m. En agriculture, c’est tout ce qui fertilise le sol en constituant une nourriture supplémentaire, pour que<br />
les plantes profitent davantage. On distingue des engrais naturels (guano, fumier, boues, sang, algues séchées), des<br />
engrais chimiques (nitrates, phosphates, sels de potassium, calcium), des engrais enrichissant le sol en azote (trèfle),<br />
phosphore (déchets de poissons), des engrais fournissant des traces de métaux en oligo-éléments (fer, manganèse,<br />
chrome…), des engrais verts (légumineux) enfouis par un labour.<br />
EQUIPAGE : n.m. Ensemble <strong>du</strong> personnel à bord d’un navire.<br />
ESCALE : n. f. Action ou lieu d’arrêt pour embarquer ou débarquer et se ravitailler.<br />
ESTUAIRE : n.m. Embouchure d’un fleuve formant un golfe profond.<br />
ESTRAN : n.m. Espace littoral entre la basse et la haute mer.<br />
EVITAGE : n.m. Rotation d’un navire : la zone d’évitage est une zone plus large <strong>du</strong> chenal <strong>du</strong> <strong>port</strong> ou <strong>du</strong> fleuve où les<br />
bateaux peuvent se croiser ou faire demi-tour.<br />
FEEDERING (le) : terme anglais utilisé pour désigner le trans<strong>port</strong> de conteneurs (containers) ; le trafic ro-ro (roll on-roll<br />
off) et feeder consiste à transférer, depuis les tracteurs ou wagons-<strong>port</strong>eurs, directement dans un navire, les conteneurs<br />
véhiculés par route ou chemin de fer.<br />
FERRAILLE : n. f. Déchets de métaux ferreux, pièces hors d’usage récupérées, recyclables, en fer, en fonte, en acier.<br />
FERROUTAGE : n .m. Trans<strong>port</strong> par remorques routières acheminées sur wagons.<br />
FERROVIAIRE : adj. par chemin de fer.<br />
FLEUVE : n.m. Grand cours d’eau aux multiples affluents qui se jette dans la mer.<br />
FRET : n.m. Cargaison trans<strong>port</strong>ée par un navire, une péniche, un train, un camion, un avion… <strong>Le</strong> coût <strong>du</strong> trans<strong>port</strong> de<br />
marchandises par mer, terre, air… L’affréteur est celui qui donne en location.<br />
GESTIONNAIRE : n.m. Officier ou spécialiste chargé de la gestion, de l’administration d’une entreprise et qui s’assure<br />
de sa bonne rentabilité.<br />
GOUF DE CAPBRETON : n.m. A l’époque glaciaire, l’Adour a creusé un fjord aujourd’hui sous-marin, le « Gouf de<br />
Capbreton », qui entaille profondément le plateau continental sur 50 km au large de l’ancienne rade de Capbreton dont<br />
les lacs d’Hossegor et de Moissan sont les traces visibles.<br />
GRUE : n. f. Enorme engin de levage, actionné par un grutier, pour soulever de très lourdes charges, charger,<br />
décharger et transborder les marchandises.<br />
GRUE-RAILS ou chemin de roulement : grue roulante sur rails le long <strong>du</strong> quai.<br />
GRUME : n. f. Tronc d’arbre ébranché mais non écorcé.<br />
Fiche pédagogique <strong>Le</strong> Port de Bayonne, aujourd’hui avril 2010
HANGAR : n.m. Vaste et haut entrepôt pour garer des engins, des véhicules de grande taille, pour stocker des pro<strong>du</strong>its<br />
et marchandises à l’abri.<br />
HYDROCARBURE : n .m. En chimie, c’est un composé de carbone et d’hydrogène abondant dans la nature (paraffines,<br />
méthane, oléfines, benzène…) que l’on raffine dans des raffineries pour en extraire les pro<strong>du</strong>its chimiques voulus.<br />
IMPORT/EXPORT : n.m. Commerce avec l’étranger. (Im<strong>port</strong>ation : entrée des marchandises dans le pays ;<br />
ex<strong>port</strong>ation : sortie des marchandises vers d’autres pays.)<br />
LAMINAGE : n.m. Action de laminer le métal, de le presser dans un laminoir (entre deux cylindres inversés) pour le<br />
rendre plat et fin et lui donner la forme voulue.<br />
LATITUDE/LONGITUDE : n. f. Distance angulaire (en degrés°) indiquant la position dans l’hémisphère nord ou sud<br />
sur le globe depuis l’Equateur/la position est ou ouest depuis le méridien de Greenwich.<br />
LIT: n .m. Espace occupé par le fleuve ou le courant d’un cours d’eau. « Lors de crues, le fleuve peut quitter son lit. »<br />
LOGISTIQUE : n. f. Organisation matérielle des moyens, maintenance <strong>du</strong> matériel, moyens de communication d’une<br />
entreprise…<br />
MANUTENTION : n. f. Chargement, déchargement, trans<strong>port</strong> court des marchandises <strong>du</strong> navire à un autre lieu de<br />
stockage ou d’exploitation ou à un autre véhicule, à l’aide de machines de levage et autres automatismes.<br />
MARINE MARCHANDE : n. f. Navires et équipages humains employés pour le commerce maritime.<br />
MAREE : n. f. Phénomène d’élévation ou de baisse périodique régulière <strong>du</strong> niveau des eaux sur la planète Terre <strong>du</strong>e à<br />
l’attraction causée par la masse de la Lune et <strong>du</strong> Soleil.<br />
METEO. ou bulletin météorologique qui annonce d’après les phénomènes observés le temps prévisible pour faciliter<br />
et sécuriser les trajets maritimes par zones maritimes. « Avis de gros temps sur le golfe de Gascogne.»<br />
MILLE NAUTIQUE ou marin : n.m. Unité de mesure de distance utilisée en navigation aérienne et maritime<br />
(1852mètres). En astronomie, distance entre deux points d’un méridien terrestre séparés par une minute d’arc. Ne pas<br />
confondre avec le mille anglo-saxon valant 1609 m.<br />
MOUILLAGE : n.m. Action ou lieu où l’on jette l’ancre. Mettre à l’eau.<br />
PALAN électrique: n .m. Appareil de levage à deux poulies permettant de ré<strong>du</strong>ire, en la démultipliant, la force à exercer<br />
pour soulever et déplacer une très lourde charge.<br />
PANNEAU DE PARTICULES : n.m. Pan de bois en miettes agglomérées (par opposition au « bois massif » taillé dans<br />
la masse brute <strong>du</strong> tronc d’arbre solide et robuste).<br />
PAQUEBOT : n .m .Grand navire pour le trans<strong>port</strong> de passagers.<br />
PILOTE : n.m. Celui qui est chargé de guider un navire à son entrée dans le chenal <strong>du</strong> <strong>port</strong>, de le diriger dans ses<br />
manœuvres au niveau des passages difficiles (bancs de sable rochers…)<br />
PILOTINE : n. f. Bateau-pilote qui con<strong>du</strong>it le pilote à bord <strong>du</strong> navire qu’il doit guider.<br />
PLATE-FORME : n. f. Surface plane équipée de différents matériels.<br />
PORT : n.m. Abri naturel ou artificiel aménagé pour recevoir les bateaux, charger et décharger leur cargaison, assurer<br />
leur entretien.<br />
PORTAGE : n. m. Trans<strong>port</strong> à dos d’homme<br />
PORTIQUE de levage: n.m. Sup<strong>port</strong> métallique roulant sur des rails, com<strong>port</strong>ant un chariot mobile auquel est accroché<br />
un palan.<br />
PRODUITS CHIMIQUES : n.m. Fabrications issues de la transformation chimique (engrais, colles, diluants, matières<br />
premières pour plastiques, matières synthétiques pour textiles…<br />
PRODUITS PETROLIERS : pro<strong>du</strong>its plus ou moins épais, gluants, liquides ou volatiles, issus <strong>du</strong> pétrole : goudron,<br />
bitume, entrant dans la composition <strong>du</strong> macadam ou revêtement des routes, carburants : mazout, essence, gasoil…<br />
PRODUITS SIDERURGIQUES : issus de la fonte des métaux et d’alliages métalliques de l’in<strong>du</strong>strie de la sidérurgie,<br />
plus ou moins transformés : en barres, billettes, plaques laminées ou en éléments moulés, formés, martelés...<br />
Fiche pédagogique <strong>Le</strong> Port de Bayonne, aujourd’hui avril 2010
QUAI : n.m. Ouvrage élevé en bor<strong>du</strong>re d’un cours d’eau pour l’empêcher de déborder et retenir ses berges, le long<br />
<strong>du</strong>quel accostent les bateaux et sur lequel sont déchargées et chargées les marchandises ou les passagers.<br />
RADE : n .f. Vaste bassin naturel donnant sur la mer, où les bateaux peuvent trouver de bons mouillages.<br />
RAFFINERIE : n. f. Usine de transformation (au moyen de tours ou colonnes de distillation) de pro<strong>du</strong>its lourds et<br />
impurs en pro<strong>du</strong>its plus légers, purs et subtiles.<br />
RO/RO (trafic): Expression anglaise « roll on and roll off », mot à mot : « entrer et sortir en roulant», pour désigner le<br />
transfert direct dans la soute d’un navire de quantités de conteneurs de marchandises trans<strong>port</strong>ées par ferroutage ou<br />
de remorques de camions afin de les faire transiter par voie maritime. Elles peuvent ainsi être récupérées telles quelles<br />
et poursuivre leur route ensuite sur terre par camions ou sur wagons de trains.<br />
REMORQUAGE : n .m. <strong>Le</strong> fait de traîner derrière soi un véhicule inactif.<br />
RIVE : n. f. Berge d’un cours d’eau, d’un plan d’eau.<br />
SIGNAUX : n.m.pl. Des signaux lumineux ou feux d’alignement vert et rouge permettent, en les alignant, de<br />
s’orienter face à l’entrée <strong>du</strong> chenal d’accès au <strong>port</strong>. <strong>Le</strong>s éclats lumineux et les phases de pauses <strong>du</strong> phare côtier<br />
permettent de déterminer aux marins de quel <strong>port</strong> il s’agit à 50 miles de là depuis la mer dans l’obscurité de la nuit. Des<br />
signaux sonores comme la corne de brume permettent aux navires de repérer la distance de la côte dans le brouillard.<br />
Des signaux <strong>du</strong> sémaphore permettent de savoir si la marée est montante ou descendante. Des balises ou bouées<br />
flottantes de couleurs vives voire munies de signaux clignotants permettent de visualiser les chenaux de passage où le<br />
fond est sans écueils et suffisamment profond… <strong>Le</strong> morse, les appels de détresse, les messages radios sont d’autres<br />
moyens de communication ou de détection comme le radar et le sonar…<br />
SILOS : n.m.pl. Volumineux réservoirs servant à conserver des pro<strong>du</strong>its agricoles périssables grains de céréales, qu’il<br />
faut aérer, ventiler, assécher (pour éviter la putréfaction et l’explosion par dégagement de gaz).<br />
SOUFRE : n.m. Elément chimique naturel employé pour la vulcanisation <strong>du</strong> caoutchouc. Combiné avec d’autres<br />
substances, son usage est diversifié : acide sulfurique, sulfures, sulfates pour le traitement des maladies de la vigne,<br />
pro<strong>du</strong>its désinfectants, protéines…<br />
TAXE D’OUTILLAGE : n. f. Péage pour l’utilisation, la location de matériel et outils de levage et autres<br />
TERMINAL SOUFRIER : n.m. Point où aboutit une ligne de trans<strong>port</strong> fluvial ou ferroviaire, lieu de stockage d’un tas de<br />
soufre en poudre pour embarquement par voie maritime ou traitement, conditionnement, transformation sur place.<br />
TERRE-PLEIN :n.m. Vaste espace aplani réservé pour le stockage et l’entrepôt de marchandises avant d’être ex<strong>port</strong>ées.<br />
TONNAGE : n.m. Capacité intérieure d’un navire mesurée en tonneaux, unité de volume valant 2,83 mètres-cubes<br />
(m3).<br />
TONNE : n. f. Unité de masse valant 1000kilogrammes(KG)<br />
TONNEAU : n.m. Unité de capacité ou contenance.<br />
TRANSIT : n.m. En commerce possibilité de faire traverser des marchandises d’un pays à un autre sans payer de droits<br />
de douane.<br />
TRANSITAIRE : n.m. Commissionnaire qui fait voyager les marchandises en transit.<br />
TREMIE : n. f. Sorte de grand récipient pyramidal inversé, déversoir pour stocker et transvaser des pro<strong>du</strong>its livrés en<br />
vrac transitant <strong>du</strong> bateau.<br />
VEDETTE : n. f. Petite embarcation rapide à moteur utile généralement pour la surveillance ou les secours en mer.<br />
ZONE INDUSTRIELLE : n. f. Vaste espace où les hommes ont implanté leurs in<strong>du</strong>stries à proximité de grands axes<br />
pratiques de circulation (zones <strong>port</strong>uaires, ferroviaires)…<br />
Fiche pédagogique <strong>Le</strong> Port de Bayonne, aujourd’hui avril 2010