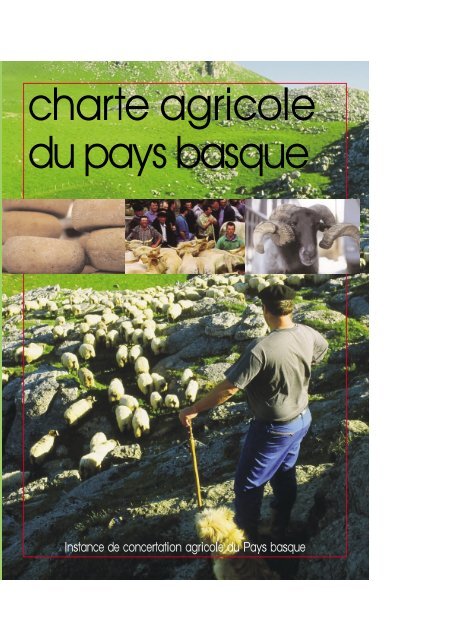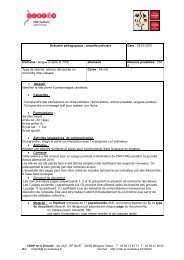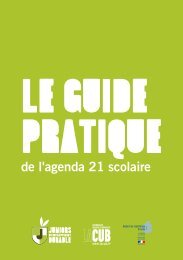Charte agricole du Pays Basque
Charte agricole du Pays Basque
Charte agricole du Pays Basque
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
charte <strong>agricole</strong><br />
<strong>du</strong> pays basque<br />
Instance de concertation <strong>agricole</strong> <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> basque
A<br />
u démarrage de la mise en œuvre de la Convention Spécifique <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong>, les représentants des organisations syndicales <strong>agricole</strong>s <strong>du</strong><br />
<strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> (JA, ELB, FDSEA), la Chambre d’Agriculture, les élus<br />
représentés par le Conseil des Elus <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et les institutions<br />
(Conseil Général, Conseil Régional, Etat) ont choisi de se rassembler au sein<br />
d’une instance de concertation afin de convenir des orientations à promouvoir<br />
dans le cadre des politiques <strong>agricole</strong>s menées en <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et de valoriser<br />
l’activité <strong>agricole</strong> au cœur des projets de développement et d’aménagement<br />
<strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>.<br />
Créée en novembre 2001, cette instance se propose de construire des points<br />
de vue partagés sur les choix à privilégier dans la mise en application des<br />
politiques <strong>agricole</strong>s y compris en matière de critères d’affectation des aides<br />
ou d’examen de dossiers indivi<strong>du</strong>els.<br />
Le programme de travail de l’instance a d’ores et déjà permis de mobiliser ses<br />
différents membres sur un certain nombre de thèmes : la répartition des<br />
quotas laitiers, l’organisation de la filière ovine, la prise en compte des handicaps<br />
naturels, l’installation des jeunes ou les questions foncières…<br />
Pour nourrir ces réflexions, l’instance de Concertation Agricole a souhaité au<br />
préalable se doter d’un cadre de référence précisant les grands principes sur<br />
lesquels les différents acteurs (professionnels et pouvoirs publics) pouvaient<br />
construire ensemble cette démarche.<br />
Porter un regard partagé sur la situation de l’agriculture au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et<br />
fixer les orientations pour demain, tel est l’objet de la charte <strong>agricole</strong> <strong>du</strong><br />
<strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>, outil pour rassembler, convaincre et concrétiser.
<strong>Charte</strong> Agricole<br />
<strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong><br />
I<br />
Porter un regard partagé<br />
Malgré ses fragilités, l’agriculture dispose d’un potentiel fort<br />
Avec ses 6.000 exploitations recensées en 2000, de 26 ha de moyenne, représentant<br />
7.000 emplois équivalent temps plein, l’agriculture reste le secteur<br />
dominant de la zone intérieure <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>. Même si elle résiste mieux<br />
qu’ailleurs aux mutations <strong>du</strong> monde rural, elle a connu de 1988 à 2000 une<br />
évolution importante :<br />
Une pression foncière forte sur la côte et une partie de la zone<br />
intermédiaire, un phénomène de déprise marqué sur le canton de<br />
Tardets<br />
La diminution des surfaces <strong>agricole</strong>s a été modérée et moins marquée au <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong> (- 2%) que dans le reste des Pyrénées Atlantiques (- 4%). On note<br />
cependant un impact marqué de la pression foncière sur la zone côtière et tout<br />
particulièrement au cours de la dernière décennie sur les cantons d’Hendaye (-<br />
10%) et de Saint Jean de Luz (- 29%), ainsi que sur 3 cantons de la zone intermédiaire<br />
: Saint Pierre d’Irube (–26%), La Bastide Clairence (- 7%), et Ustaritz<br />
(- 4%). Par ailleurs un phénomène de déprise important apparaît sur le canton<br />
de Tardets (- 5%).
Une baisse <strong>du</strong> nombre<br />
total d’exploitations mais<br />
un maintien <strong>du</strong> nombre<br />
d’exploitations professionnelles<br />
La baisse <strong>du</strong> nombre des exploitations,<br />
générale et continue sur le<br />
plan national et départemental, a<br />
été moins accentuée au <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong> (- 16%) que sur l’ensemble<br />
<strong>du</strong> Département (- 27%)<br />
et de la Région (- 28%). De plus<br />
au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>, cette baisse <strong>du</strong><br />
nombre d’exploitations a touché<br />
principalement les exploitations<br />
« non professionnelles », le<br />
nombre d’exploitations « professionnelles<br />
» augmentant légèrement<br />
sur l’ensemble <strong>du</strong> <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong>, excepté sur les cantons<br />
de Bidache et Saint Palais où il<br />
décline assez fortement.<br />
Une diminution <strong>du</strong> nombre d’installations et une augmentation<br />
<strong>du</strong> nombre d’exploitations sans suite<br />
Le nombre d’installations aidées au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> a été en 2001 de 68 installations<br />
aidées sur un total de 131 pour le Département. Le nombre d’installations<br />
non aidées est estimé par l’ADASEA à 50 % <strong>du</strong> nombre d’installations aidées soit<br />
de 30 à 40 annuellement pour le <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> à l’heure actuelle. Le nombre total<br />
d’installations a cependant été divisé par 2 en 10 ans et le nombre d’exploitations<br />
sans suite a fortement augmenté. Cette situation pourrait s’aggraver, les<br />
évolutions démographiques montrant qu’à partir de 2006 les départs en retraite<br />
et donc le nombre d’exploitations à reprendre vont fortement augmenter.
Une surface moyenne de 26 ha en forte augmentation mais très<br />
inférieure à la moyenne nationale (42 ha)<br />
La surface moyenne des exploitations <strong>agricole</strong>s <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> a sensiblement<br />
augmenté (+ 16 %) <strong>du</strong> fait de la disparition de nombreuses exploitations « non<br />
professionnelles ». Les principales caractéristiques des structures d’exploitations,<br />
surface, main d’œuvre notamment apparaissent maintenant relativement<br />
similaires au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et dans le reste <strong>du</strong> Département (26 ha pour 1.2 UTA).<br />
Une SAU presque exclusivement dédiée à la pro<strong>du</strong>ction fourragère<br />
89 % de la SAU est consacrée à la pro<strong>du</strong>ction de fourrages et 72 % de cette<br />
surface est constituée de surfaces toujours en herbe (STH). Le <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> se<br />
trouve en effet essentiellement en zone de montagne (66 %) et la pro<strong>du</strong>ction<br />
de fourrages paraît mieux adaptée aux conditions locales (pente, sols, climat).<br />
Une activité orientée essentiellement<br />
vers les pro<strong>du</strong>ctions animales<br />
Le <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> est avant tout une terre d’élevage, principalement d’élevage<br />
ovin lait et bovins viande. 85 % des exploitations sont principalement orientées<br />
vers l’élevage, 60 % sont spécialisées en ovins lait. Au niveau régional et départemental,<br />
l’élevage ne concerne majoritairement respectivement que 32 % et<br />
57 % des exploitations. Le canton de Bidache s’indivi<strong>du</strong>alise cependant forte-
ment au sein d’un ensemble par ailleurs très homogène que forme le <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong> avec 47 % « seulement » des exploitations spécialisées en élevage.<br />
Une spécialisation accrue en faveur des pro<strong>du</strong>ctions fourragères à<br />
destination des élevages ovins lait et bovins viande<br />
En termes de tendance, le <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> se concentre sur ses points « forts », les<br />
cultures fourragères (+ 22 %), les élevages de bovins allaitant (+ 26 %) et<br />
d’ovins lait (+ 14 %). Autrement dit, le <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> se spécialise de plus en<br />
plus, la part des pro<strong>du</strong>ctions « secondaires » diminuant (ex : porc - 20 %,<br />
céréales – 20 %) ou croissant moins vite qu’au niveau départemental et<br />
national. On peut regretter notamment le faible développement ou la régression<br />
apparents de spéculations bien adaptées à de petites structures d’exploitations<br />
telles que le maraîchage (+ 5 %) et la viticulture (- 26 %).<br />
Une valeur de pro<strong>du</strong>ction <strong>agricole</strong> estimée à environ 217 millions<br />
d’Euros en 2001 soit 32 % de celle <strong>du</strong> Département<br />
Cette plus faible valeur de la pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> rapportée au nombre<br />
d’exploitations ou à la surface est directement liée aux types et aux conditions<br />
de pro<strong>du</strong>ction : importance relative de la zone montagne, forte dominance de<br />
l’élevage, faible développement des ateliers hors sols.
Un territoire caractéristique au sein de l’espace départemental<br />
<strong>agricole</strong><br />
■ Au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>, la filière ovins lait représente plus <strong>du</strong> 1/3 de la valeur de la<br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>. Le plus souvent associées à l’élevage de bovins<br />
viande, ces deux filières représentent au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> près des 2/3 de la pro<strong>du</strong>ction<br />
globale. Les deux autres filières relativement développées en particulier sur<br />
les cantons de Bidache et de Saint Palais sont le maïs et le bovin lait.<br />
■ Au Béarn, trois filières sont sensiblement d’égale importance : le maïs, les<br />
bovins viande et la volaille grâce à la pro<strong>du</strong>ction de palmipèdes à foie gras. Ces<br />
trois filières n’assurent cependant qu’un peu moins des 2/3 de la pro<strong>du</strong>ction<br />
globale <strong>du</strong> Béarn, les filières laitières (bovins) et porcines étant également bien<br />
développées.<br />
Les différences entre l’agriculture <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et <strong>du</strong> Béarn apparaissent donc<br />
davantage liées à l’adaptation des systèmes de pro<strong>du</strong>ction aux différences de<br />
contexte naturel qu’à des différences de structures de pro<strong>du</strong>ction.
L’agriculture <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> apparaît comme relativement<br />
dynamique et homogène.<br />
Traditionnellement diversifiée, elle s’est progressivement recentrée sur la<br />
pro<strong>du</strong>ction de lait de brebis associée à la pro<strong>du</strong>ction de broutards (jeunes<br />
bovins maigres), deux pro<strong>du</strong>ctions bien adaptées aux conditions locales. Cette<br />
spécialisation progressive de l’agriculture <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> pourrait cependant la<br />
fragiliser notamment lors de crises de pro<strong>du</strong>ction bovine (viande) ou surtout<br />
ovine (lait).<br />
Jusqu’à présent la diminution sensible <strong>du</strong> nombre d’exploitations non professionnelles<br />
a permis l’agrandissement et le maintien <strong>du</strong> nombre des exploitations<br />
professionnelles. Cependant, la baisse <strong>du</strong> nombre d’installations, le<br />
nombre croissant d’exploitations sans suite, la hausse <strong>du</strong> prix <strong>du</strong> foncier <strong>agricole</strong>,<br />
la concurrence des usages non <strong>agricole</strong>s de ce foncier et la petite taille<br />
des exploitations nécessite qu’une attention particulière continue d’être portée<br />
au devenir de l’agriculture et plus particulièrement à l’installation des jeunes<br />
agriculteurs dans des conditions économiquement satisfaisantes.
Données <strong>du</strong> recensement <strong>agricole</strong><br />
Données Pyr. Atl. <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> PB/64<br />
1988 2000 Evolution 1988 2000 Evolution 2000<br />
Nb exploitations 18964 14695 -23 7043 5939 -16 40 %<br />
Surface totale (ha) 419203 401744 -4 157791 154601 -2 38 %<br />
Surface moyenne (ha) 22 27 24 22 26 16<br />
SAU Totale (ha) 338759 356425 5 117793 136979 16 38 %<br />
SFP Totale (ha) 215821 228492 6 99856 121740 22 53 %<br />
STH totale (ha) 163754 140983 -14 84174 88282 5 63 %<br />
Brebis laitières (nbr) 408002 473677 16 349302 406129 16 86 %<br />
Vaches nourrices (nbr) 101784 120086 18 40883 51734 27 43 %<br />
Vaches laitières (nbr) 70767 51348 -27 19073 13928 -27 27 %<br />
Truies (nbr) 24373 21206 -13 6960 5356 -23 25 %<br />
Porcs (nbr) 146714 143354 -2 41611 36065 -13 25 %<br />
Volailles (nbr) 1786308 2438399 37 343948 419976 22 17 %<br />
Maïs grain (ha) 101654 97956 -4 14540 11820 -19 12 %<br />
Vignes (ha) 2514 2450 -3 419 312 -26 13 %<br />
Horticulture 1653 3991 141 159 140 -12 4 %<br />
UTA totales 22181 17468 -21 8831 6936 -21 40 %<br />
UTA tot./expl. 1,17 1,19 2 1,25 1,17 -7<br />
exploitants - 30 ans 1500 934 -38 657 417 -37 45 %<br />
exploitants 30 à 40 ans 3606 3380 -6 1497 1404 -6 42 %<br />
exploitants 55 à 65 ans 5392 2691 -50 1804 969 -46 36 %<br />
Fermage 79527 116779 47 23403 40757 74 35 %<br />
Estimations technico-économiques<br />
Millions d’euros Pyr. Atl % <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>/Pyr. Atl <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> % <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> Béarn % Béarn<br />
Maïs 122 12 % 15 7 % 107 24 %<br />
Autres céréales 5 13 % 1 0 % 4 1 %<br />
Oléagineux 1 13 % 0 0 % 1 0 %<br />
Tabac 2 10 % 0 0 % 2 0 %<br />
Légumes 15 30 % 5 2 % 11 2 %<br />
Fruits 4 38 % 2 1 % 2 1 %<br />
Vins qualité 18 13 % 2 1 % 16 3 %<br />
Autres vegétaux 10 38 % 4 2 % 6 1 %<br />
Total prod. végétale 177 16 % 29 13 % 149 32 %<br />
Bovins (viande) 154 36 % 55 25 % 99 23 %<br />
Porcins (viande) 54 25 % 14 6 % 41 9 %<br />
Ovins 89 85 % 76 35 % 13 3 %<br />
Volailles (viande) 97 17 % 16 8 % 81 18 %<br />
Bovins (lait) 90 27 % 24 11 % 66 14 %<br />
Autres pro<strong>du</strong>its animaux 10 38 % 4 2 % 6 1 %<br />
Total prod. animale 494 38 % 189 87 % 306 68 %<br />
Totaux 671 32 % 218 100 455 100
II<br />
Des orientations pour demain<br />
Un tissu rural dense est essentiel au maintien de la qualité de vie et des<br />
paysages propres au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>. Si le monde rural ne se limite pas aux agriculteurs<br />
et aux exploitations <strong>agricole</strong>s, ils en forment la trame et le support<br />
principal.<br />
Maintenir un tissu rural dense suppose une politique foncière bien définie et<br />
affirmée permettant de limiter les effets de la pression foncière et favorisant la<br />
transmission des exploitations existantes. Cela suppose également des exploitations<br />
<strong>agricole</strong>s viables sur de petites surfaces aux revenus suffisamment<br />
attractifs en particulier pour les jeunes agriculteurs. Cela suppose une gestion<br />
<strong>du</strong>rable des ressources naturelles.<br />
1.<br />
Miser sur une agriculture créatrice d’emplois et de revenus<br />
1.1 Affirmer les enjeux <strong>agricole</strong>s<br />
dans l‘élaboration des documents d’urbanisme<br />
Soumise à une pression foncière croissante et à l’étalement urbain, la pérennité<br />
de l’agriculture notamment sur la zone côtière et sur la zone intermédiaire<br />
pourrait être compromise à défaut d’une volonté clairement affirmée de la part<br />
des agriculteurs et des collectivités locales pour y maintenir une activité <strong>agricole</strong><br />
dynamique.
La mise en place d’une politique foncière globale, affichant une ambition forte<br />
pour donner à l’agriculture un rôle majeur dans cette zone, est absolument<br />
nécessaire. Il ne s’agit pas de se limiter à une agriculture de périphérie urbaine<br />
qui développerait ses activités en lien avec les marchés de proximité, mais<br />
bien d’affirmer une agriculture de pro<strong>du</strong>ction contribuant au développement et<br />
à l’aménagement de ce territoire.<br />
Il est donc nécessaire de définir clairement une stratégie et des priorités d’ensemble<br />
au niveau <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> qui puissent être ensuite déclinées au cas<br />
par cas, au fur et à mesure de l’élaboration des SCOT et des PLU.<br />
1.2<br />
Renforcer et soutenir l’agriculture de montagne<br />
Malgré de nombreuses petites exploitations et une volonté forte des jeunes de<br />
s’installer, l’agriculture de montagne reste fragile. Des handicaps importants,<br />
une pro<strong>du</strong>ctivité faible, une tendance à la délocalisation des pro<strong>du</strong>ctions vers<br />
les zones de coteaux, un déclin des modes de valorisation des ressources des<br />
zones pastorales, sont autant de défis auxquels l’agriculture de montagne est<br />
confrontée. Pourtant, elle dispose d’atouts importants notamment en termes<br />
d’image et de qualité. Pour les développer, il convient de faire exister une réelle<br />
différenciation de rémunération selon la qualité des pro<strong>du</strong>ctions. Il serait également<br />
souhaitable que les politiques publiques en faveur de l’agriculture de<br />
montagne soient plus fines, notamment pour une meilleure prise en compte des<br />
handicaps naturels et pour une adaptation des aides contractuelles à la réalité<br />
des petites exploitations. Afin de mieux cibler le dispositif d’aides existant, une<br />
étude devra être menée afin de mieux définir et de mieux mesurer les handicaps<br />
affectant les exploitations situées en zone de montagne. Par ailleurs une<br />
complémentarité entre les zones de montagne et les zones de plaine devrait être<br />
recherchée notamment au travers de la création de banques de fourrages.
1.3<br />
Privilégier, là où les exploitations en place n’ont pas<br />
besoin d’être confortées, la reprise par des jeunes<br />
des exploitations sans succession<br />
Le maintien de la qualité de vie des agriculteurs et de certaines filières <strong>agricole</strong>s<br />
notamment laitières nécessite le maintien d’un nombre suffisant d’exploitations.<br />
Si le nombre d’exploitations professionnelles s’est maintenu sur le<br />
<strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>, le nombre total des exploitations <strong>agricole</strong>s a diminué. Par<br />
ailleurs, les installations sont de plus en plus difficiles à réaliser. La transmission<br />
patrimoniale de l’exploitation tend à disparaître au profit d’une transmission<br />
entrepreneuriale.<br />
Cette remise en cause des modes traditionnels de transmission des exploitations<br />
au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> et le nombre important d’exploitations sans successions<br />
déclarées, rendent souhaitable une adaptation et un renforcement <strong>du</strong> dispositif<br />
d’aides à l’installation, notamment en direction des hors cadres familiaux.<br />
Un accent particulier devrait être mis sur la sensibilisation de proximité, des<br />
cédants pour qu’ils ne décapitalisent pas leurs entreprises, et des jeunes afin<br />
qu’ils s’investissent dans l’agriculture. Par ailleurs, les dispositifs de formation
2.<br />
par alternance et notamment sur les exploitations sans succession devraient<br />
être renforcés et développés. Enfin le schéma des structures d’exploitation<br />
devrait être évalué et le cas échéant révisé.<br />
1.4<br />
Développer les opérations<br />
de communication sur l’agriculture<br />
L’installation des jeunes et notamment des hors cadres familiaux ne pourra se<br />
développer que si la profession parvient à projeter une image positive de son<br />
métier et de son activité. Une véritable campagne de communication devrait<br />
être mise en place et pérennisée, en développant notamment les visites d’exploitations<br />
<strong>agricole</strong>s permettant de présenter l’exploitant dans son cadre de<br />
travail. Une telle campagne devrait cibler l’ensemble des jeunes qu’ils soient<br />
ou non déjà orientés dans le système d’enseignement <strong>agricole</strong>.<br />
Développer toutes les initiatives<br />
contribuant à la création de la valeur ajoutée<br />
Face à la taille moyenne des exploitations (26 ha) et aux handicaps naturels<br />
subis par la majorité des exploitations <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>, la volonté de maintenir<br />
un tissu rural dense nécessite de maximiser la valeur ajoutée pro<strong>du</strong>ite à l’hectare<br />
au travers d’une pro<strong>du</strong>ction de qualité liée au terroir et de la valorisation<br />
des niches offertes notamment par l’importance <strong>du</strong> tourisme et la proximité d’un<br />
centre urbain important.
2.1<br />
Soutenir le développement<br />
des pro<strong>du</strong>ctions <strong>agricole</strong>s de qualité<br />
De nombreuses AOC (Vins d’Irouleguy, Fromage Ossau-Iraty, Piment<br />
d’Espelette…), labels rouges (Agneaux de lait des Pyrénées, Blonde la tradition…),<br />
IGP (Jambon de Bayonne…) et marques collectives (IDOKI, Accueil<br />
paysan, Bienvenue à la ferme…) ont déjà été développées au <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong><br />
pour mieux valoriser les pro<strong>du</strong>its de qualité.<br />
Ils concernent aussi bien les pro<strong>du</strong>ctions fermières que les pro<strong>du</strong>ctions in<strong>du</strong>strielles,<br />
deux types de pro<strong>du</strong>ction complémentaires qui peuvent permettre<br />
d’atteindre des volumes suffisants et réguliers souvent nécessaires à la reconnaissance<br />
d’une appellation ou d’une marque.<br />
Il paraît nécessaire de développer les marchés respectifs et la reconnaissance<br />
de ces différents signes de qualité par un important effort<br />
de communication qui peut s’appuyer notamment sur l’importance<br />
<strong>du</strong> tourisme local et l’image de marque <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> dans son<br />
ensemble et de sa zone montagne en particulier.<br />
Par ailleurs d’autres signes de qualité pourraient être reconnus et<br />
permettre de mieux faire connaître ou de mieux valoriser un certain<br />
nombre de pro<strong>du</strong>its de qualité attachés au terroir, le porc basque, le<br />
piment doux, etc.<br />
Les ressources techniques et financières devront être mobilisées<br />
dans ce sens au travers notamment de la Convention Spécifique <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong>.<br />
2.2 Soutenir le développement<br />
et l’organisation des filières courtes<br />
Le développement des pro<strong>du</strong>ctions fermières (fromage, foie gras, charcuterie<br />
notamment) peut s’appuyer sur l’importance <strong>du</strong> tourisme sur le littoral mais<br />
aussi en montagne (agri-tourisme).
La vente directement aux consommateurs ou par l’intermédiaire de filières<br />
courtes, de pro<strong>du</strong>its animaux ou maraîchers en particulier, est également assez<br />
développée <strong>du</strong> fait de l’existence de nombreux centres urbains (BAB et bourgs<br />
de l’intérieur)<br />
Cette importance relative des filières courtes repose également sur l’existence<br />
de facilités collectives de transformation (saloir, abattoir et ateliers de<br />
découpes), de conseil et d’organisations collectives. Ces facilités et organisations<br />
collectives doivent donc être pérennisées et développées.<br />
2.3<br />
Renforcer les organisations inter-professionnelles et notamment<br />
celles relatives à la pro<strong>du</strong>ction ovine<br />
L’engagement dans des démarches de qualité peut permettre d’évoluer vers des<br />
concepts de co-élaboration <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it, de gestion de la pro<strong>du</strong>ction, de différentiation<br />
des prix et de partage de la valeur ajoutée entre les différents partenaires<br />
d’une filière. Cette évolution vers une responsabilité partagée dans l’élaboration<br />
des pro<strong>du</strong>its nécessite une organisation adaptée à cet enjeu au sein<br />
des filières.<br />
La prépondérance de l’élevage ovin dans l’agriculture <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> commande<br />
de mettre la priorité sur le renforcement de cette filière. Si le lait de brebis est<br />
menacé, c’est toute l’agriculture <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong> qui est en danger. La pérennité<br />
de cette filière dépend en grande partie de la force des organisations interprofessionnelles<br />
que les acteurs sauront animer et développer, notamment l’interprofession<br />
lait de brebis et le syndicat d’appellation Ossau-Iraty.<br />
2.4<br />
Mobiliser et gérer de façon équitable les droits à pro<strong>du</strong>ire<br />
Dans les domaines où les pro<strong>du</strong>ctions sont soumises à des droits à pro<strong>du</strong>ire ou<br />
des droits à prime, il est essentiel de se mobiliser collectivement pour maintenir,<br />
voire gagner des droits nouveaux, et de les répartir selon des règles simples<br />
prenant en compte le projet des agriculteurs, les différentes pro<strong>du</strong>ctions et la<br />
main d’œuvre présentes sur l’exploitation.
3.<br />
Contribuer à pro<strong>du</strong>ire un espace<br />
et un environnement de qualité<br />
Au cours de l’histoire, les agriculteurs ont apporté dans le domaine de l’environnement,<br />
une contribution majeure dans la pro<strong>du</strong>ction et l’entretien de<br />
paysages de très grande qualité, participant ainsi à l’image et à l’attractivité de<br />
ce territoire.<br />
Les nouveaux enjeux liés au développement de l’agriculture et leurs incidences<br />
potentielles sur l’environnement notamment, posent néanmoins de nouvelles<br />
questions auxquelles il convient d’apporter des réponses et ce au moins dans<br />
quatre domaines.<br />
3.1 Encourager les formes d’agriculture<br />
respectueuses de l’environnement<br />
Comparativement à d’autres territoires, les effets négatifs de l’agriculture au <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong> sont très limités et ponctuels. Cependant de nombreuses démarches<br />
collectives sont actuellement initiées pour améliorer au niveau des exploitations<br />
les pratiques sanitaires et la gestion des effluents. Elles constituent un complément<br />
voir un préalable nécessaire au développement de la pro<strong>du</strong>ction sous signe<br />
de qualité et doivent donc être soutenues et favorisées par l’ensemble de la<br />
profession et de l’administration. Il s’agit notamment des chartes de bonnes<br />
pratiques de l’élevage mais aussi de l’agriculture raisonnée et <strong>du</strong>rable.<br />
3.2 Innover dans les modes d’organisation<br />
<strong>du</strong> travail et de gestion de l’emploi<br />
L’amélioration des conditions de travail et de vie en agriculture constitue un axe<br />
de travail également important car il est de nature à renforcer l’attractivité <strong>du</strong><br />
métier d’agriculteurs et, de fait, l’installation des jeunes.<br />
On cherchera donc à développer de nouvelles formes de travail, de regroupement<br />
d’exploitations, de gestion de l’emploi partagé au travers <strong>du</strong> développement<br />
de groupements d’employeurs, de systèmes de travaux collectifs.
3.3<br />
Innover dans les modes de gestion des espaces pastoraux<br />
L’avenir <strong>du</strong> pastoralisme constitue un enjeu économique et paysager majeur en<br />
<strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong>. Les espaces pastoraux, estives et landes communales, constituent<br />
en effet un complément fourrager indispensable à de nombreux troupeaux qu’ils<br />
soient gérés par de petites exploitations des zones de montagne ou de coteaux<br />
ou encore par les bergers sans terre.<br />
Cependant, selon les zones géographiques,<br />
les espaces pastoraux sont<br />
sur-utilisés, notamment <strong>du</strong> fait <strong>du</strong><br />
développement des troupeaux<br />
équins, ou au contraire plus ou<br />
moins abandonnés (cf. « étage des<br />
bordes » de l’étude INRA).<br />
La généralisation des politiques intensives dans les exploitations et parallèlement<br />
le déficit fourrager de nombreuses exploitations nécessitent donc une<br />
modernisation et une adaptation des pratiques notamment dans les domaines<br />
de la ré-organisation des systèmes de gestion des espaces, de la répartition de<br />
la pression pastorale, de la facilité d’accès aux espaces pastoraux, <strong>du</strong> gardiennage<br />
et des soins aux troupeaux en transhumance, de la qualification des<br />
fromages pro<strong>du</strong>its en estives.<br />
3.4<br />
Gérer la ressource en eau en <strong>Pays</strong> <strong>Basque</strong><br />
Bien que le recours à l’irrigation soit limité actuellement au canton de Bidache<br />
et à l’Amikuze, l’utilisation de l’eau pour le développement futur <strong>du</strong> <strong>Pays</strong><br />
<strong>Basque</strong> fait l’objet de points de vue divergents et se sont exprimés notamment<br />
à l’occasion <strong>du</strong> projet Elordoy sur Saint Palais. Il est préconisé de faire réaliser<br />
une étude globale sur les ressources et les besoins en eau. Cette étude ne<br />
devrait cependant pas se baser uniquement sur les systèmes de pro<strong>du</strong>ction en<br />
place mais également proposer des alternatives culturales moins consommatrices<br />
en eau mais tout autant rentables.
© Photos : Association AFI - Ibaifoto - Conseil des élus <strong>du</strong> <strong>Pays</strong> basque