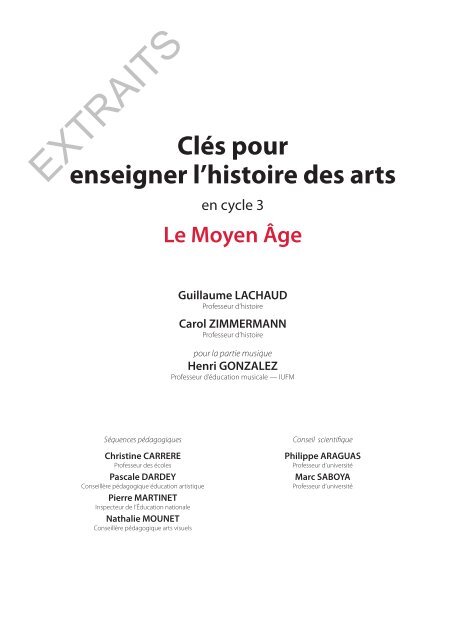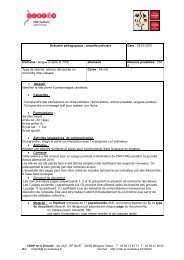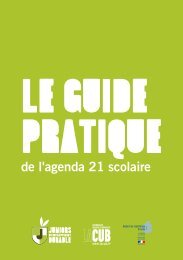Le manuscrit enluminé - CRDP Aquitaine
Le manuscrit enluminé - CRDP Aquitaine
Le manuscrit enluminé - CRDP Aquitaine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Clés pour<br />
enseigner l’histoire des arts<br />
EXTRAITS<br />
Séquences pédagogiques<br />
Christine CARRERE<br />
Professeur des écoles<br />
Pascale DARDEY<br />
Conseillère pédagogique éducation artistique<br />
Pierre MARTINET<br />
Inspecteur de l’Éducation nationale<br />
Nathalie MOUNET<br />
Conseillère pédagogique arts visuels<br />
en cycle 3<br />
<strong>Le</strong> Moyen Âge<br />
Guillaume LACHAUD<br />
Professeur d’histoire<br />
Carol ZIMMERMANN<br />
Professeur d’histoire<br />
pour la partie musique<br />
Henri GONZALEZ<br />
Professeur d’éducation musicale — IUFM<br />
Conseil scientifi que<br />
Philippe ARAGUAS<br />
Professeur d’université<br />
Marc SABOYA<br />
Professeur d’université<br />
5
14<br />
Sommaire<br />
PRÉFACE 7<br />
PRÉSENTATION : COMMENT ENSEIGNER L’HISTOIRE DES ARTS ? 9<br />
INTRODUCTION À L’ART MÉDIÉVAL OCCIDENTAL 17<br />
EXTRAITS<br />
L’ARCHITECTURE MILITAIRE<br />
. L’architecture militaire : cinq siècles d’évolution 21<br />
. Carcassonne, une cité fortifi ée au cœur de l’histoire occidentale 29<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Une cité fortifi ée, Carcassonne 40<br />
2. L’architecture militaire 42<br />
L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE<br />
. L’architecture de l’église médiévale 47<br />
. La cathédrale Saint-Nazaire et Saint-Celse de Carcassonne 52<br />
LE VITRAIL<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. L’architecture religieuse 58<br />
2. Du roman au gothique 60<br />
. <strong>Le</strong> vitrail : technique et évolution 65<br />
. <strong>Le</strong>s vitraux de la cathédrale de Carcassonne :<br />
un programme iconographique 72<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Verre et couleurs 78<br />
2. Un récit en lumière 80
LA SCULPTURE ROMANE<br />
. La sculpture romane 85<br />
. Un chef d’œuvre de l’art roman : le portail de Moissac 89<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Un récit sculpté 98<br />
2. Sculpter le mouvement 100<br />
EXTRAITS<br />
LE MANUSCRIT ENLUMINÉ<br />
. <strong>Le</strong> livre au Moyen Âge 105<br />
. L’évangéliaire de Saint-Nazaire, un <strong>manuscrit</strong> du XIII e siècle 111<br />
LA MUSIQUE<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. Une lettre historiée 114<br />
2. <strong>Le</strong> tournoi, une fête nobiliaire 116<br />
. La musique au Moyen Âge 121<br />
. <strong>Le</strong>s instruments de musique 127<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. <strong>Le</strong> chant grégorien 130<br />
2. La chanson des troubadours 131<br />
POUR CONCLURE... 133<br />
Présentation des séquences pédagogiques<br />
1. <strong>Le</strong>s arts racontent 134<br />
2. <strong>Le</strong>s arts dialoguent 136<br />
GLOSSAIRE (lexique repéré dans l’ouvrage par *) 140<br />
SOMMAIRE DU CD AUDIO 145<br />
SOMMAIRE DU CÉDÉROM 147<br />
CRÉDITS 150<br />
15
<strong>Le</strong> livre<br />
au Moyen Âge<br />
EXTRAITS<br />
La décoration peinte des <strong>manuscrit</strong>s, essentiellement<br />
médiévale, est peu à peu<br />
abandonnée avec le développement de<br />
l’imprimerie. Si l’enluminure* est d’abord<br />
une ornementation des lettres, des bordures<br />
et des encadrements, parfois même<br />
une page entière de décor, elle guide aussi<br />
la lecture en mettant en évidence les titres<br />
et chapitres du <strong>manuscrit</strong>.<br />
Dans la société médiévale où la religion est<br />
au cœur de la vie de chacun, l’ornementation<br />
des livres religieux tient une place<br />
privilégiée. La Bible, livre de la Révélation,<br />
fait l’objet d’un soin extrême pour sa décoration<br />
par les peintures et les reliures.<br />
Aussi ces enluminures doivent-elles être<br />
exploitées avec prudence car, plus qu’un<br />
décor, elles sont chargées de sens : elles<br />
transmettent, au même titre que le verbe,<br />
la parole divine.<br />
Aux côtés des ateliers monastiques et<br />
cathédraux, se développent, à partir du<br />
XIII e siècle, des ateliers professionnels qui<br />
travaillent pour de riches mécènes laïcs :<br />
les livres de droit, de philosophie, d’histoire,<br />
de poésie, de chasse, sont ornés<br />
d’enluminures. Ils demeurent aujourd’hui<br />
une source documentaire d’une grande<br />
qualité.<br />
1. <strong>Le</strong>s techniques<br />
Dès l’Antiquité, l’écriture utilise des supports variés : tablettes<br />
de cire attachées par des cordes et qui constituent les<br />
premiers livres de bois, papyrus assemblés en rouleaux (volumen)<br />
pouvant atteindre 12 m de long. Mais la naissance<br />
du livre tel que nous le connaissons prend forme entre le<br />
II e et IV e siècle avec le codex, livre constitué de feuilles pliées<br />
pour former des cahiers, et l’emploi d’un support nouveau,<br />
le parchemin. Celui-ci, fait de cuir travaillé jusqu’à off rir une<br />
surface lisse des deux côtés, est souple, facile à assembler<br />
et résiste mieux à la peinture. Fort coûteux, il est réservé<br />
aux productions luxueuses. <strong>Le</strong> papier, obtenu à partir d’une<br />
pâte de chanvre ou de coton, est une technique connue<br />
depuis le III e millénaire en Chine qui se répand en Occident<br />
à partir du XII e siècle.<br />
<strong>Le</strong>s formes d’écriture varient selon les outils utilisés par<br />
les copistes : des calames (roseaux taillés) ou des plumes<br />
d’oiseaux. <strong>Le</strong>s encres sont obtenues à partir de minéraux ou<br />
végétaux. Sont principalement utilisés : le noir, avec du carbone<br />
mélangé à des liants, et le rouge, avec du minium (un<br />
sulfate de mercure à l’origine du mot miniature) ; les ors et<br />
argents sont réservés aux noms importants et sacrés (dorure<br />
à la feuille d’or). <strong>Le</strong>s couleurs sont à base de colorants tels<br />
que le safran pour le jaune, la lazurite pour le bleu d’azur,<br />
l’argile pour les ocres mais aussi le cinabre pour le rouge,<br />
la céruse pour le blanc d’argent, le vert-de-gris, le pourpre,<br />
l’indigo et le pastel. <strong>Le</strong>s recettes sont transmises de maître<br />
à élève, parfois consignées dans des traités à l’usage des<br />
enlumineurs.<br />
<strong>Le</strong>s principaux centres de production des livres sont ecclésiastiques.<br />
Avec la renaissance carolingienne, les ateliers de<br />
copie (les scriptoria) se multiplient dans les monastères et<br />
les cathédrales*. Dans le scriptorium, proche de l’église, le<br />
travail a un caractère sacré. Plusieurs personnes concourent<br />
à l’élaboration du <strong>manuscrit</strong> : le parchemin est d’abord poli,<br />
la mise en page est organisée par les lignes et les marges,<br />
le texte est copié avec le souci constant d’occuper toute<br />
la surface (les paragraphes s’enchaînent, les titres se détachent<br />
par l’usage de la couleur, généralement rouge, et les<br />
mots sont abrégés). Plusieurs copistes peuvent travailler à<br />
la transcription d’un même ouvrage que les rubricateurs<br />
ornent des têtes de chapitre et les enlumineurs du décor.<br />
On assemble ensuite les feuillets en cahiers ; ceux-ci sont<br />
cousus les uns aux autres afi n de constituer le livre. La couverture<br />
fait l’objet de soins particuliers : une peau parfois<br />
sertie de métaux précieux (argent ciselé pour l’évangéliaire<br />
de Saint-Nazaire).<br />
105
L’écriture latine, héritière de la tradition romaine, est déclinée<br />
jusqu’au IX e siècle, notamment l’onciale. L’écriture<br />
caroline est ensuite la plus usitée avec des lettres régulières,<br />
rondes et bien individualisées. À partir du XII e siècle l’écriture<br />
gothique s’impose progressivement à tout l’Occident. Au<br />
XV e siècle, avec la taille de la plume (fente du bec), le trait remonte<br />
et permet au copiste de ne plus lever la main entre<br />
chaque lettre, gagnant ainsi de la place et du temps.<br />
EXTRAITS<br />
2. <strong>Le</strong>s <strong>manuscrit</strong>s<br />
Au Moyen Âge, les <strong>manuscrit</strong>s sacrés sont les plus nombreux<br />
assurant la transmission à la postérité des Écritures Saintes.<br />
Lorsque le pape Grégoire le Grand fi xe et harmonise les<br />
rituels de célébration au VII e siècle, il faut des livres de messe<br />
: le sacramentaire contient un calendrier, le canon de la<br />
messe, les prières et les rituels (baptême, funérailles…) ; le<br />
graduel (ou antiphonaire) rassemble les parties chantées. <strong>Le</strong><br />
missel les remplace dès le XI e siècle et devient le principal<br />
livre liturgique du prêtre car il contient en un seul ouvrage<br />
les textes essentiels de la liturgie, les prières mais aussi les<br />
chants. Peu à peu le rite romain propose deux lectures essentielles<br />
au cours de la messe : l’épitre et l’Évangile.<br />
L’évangéliaire présente dans un premier temps une liste<br />
de références de textes évangéliques à rechercher dans<br />
le Nouveau Testament, puis, au X e siècle, l’intégralité des<br />
passages eux-mêmes. Recueil de la parole de Dieu, il off re<br />
une décoration extérieure et intérieure particulièrement<br />
soignée. L’épistolier contient les épitres lues à la messe. <strong>Le</strong><br />
lectionnaire, composé de toutes les lectures de l’Ancien et<br />
du Nouveau Testament, remplace l’évangéliaire et l’épistolier<br />
dès le XII e siècle.<br />
<strong>Le</strong>s monastères produisent aussi des livres d’offi ce, les prières<br />
de jour et de nuit qui rappellent la vie du Christ (lever<br />
du soleil) jusqu’à sa mort (coucher du soleil) : matines (offi ce<br />
de nuit), laudes (point du jour, heure où le Christ ressuscita),<br />
prime (première heure du jour), tierce (vers 9 heures), sexte<br />
(vers midi), none (vers 15 heures, heure de sa mort), vêpres<br />
(au coucher du soleil) et complies (dernière heure de l’offi ce<br />
de jour). Pour réciter ces diff érents offi ces, les moines disposent<br />
de psautiers et de martyrologes (les saints vénérés<br />
jour par jour). Pour faciliter la récitation privée de l’offi ce on<br />
compose des ouvrages abrégés, les bréviaires, très utilisés<br />
par les ordres mendiants aux activités souvent itinérantes.<br />
À partir du XV e siècle, des livres d’heures richement ornés,<br />
qui comprennent les psaumes mais aussi des passages des<br />
Évangiles, connaissent un grand succès auprès des laïcs<br />
aisés.<br />
Avec l’importance des cultes des saints sont composés des<br />
textes lus durant l’offi ce ou au réfectoire : ce sont les légendiers,<br />
textes hagiographiques qui racontent la vie des saints<br />
(La légende dorée par le dominicain Jacques de Voragine au<br />
XIII e siècle).<br />
106 LE MANUSCRIT ENLUMINÉ<br />
Miniature,<br />
évangéliaire<br />
de Saint-Nazaire<br />
D’autres livres commentent, dès le XI e siècle, le « savoir<br />
sur Dieu » : ce sont les traités de théologie qui,<br />
avec l’essor de l’exégèse, permettent de critiquer,<br />
d’interpréter les textes bibliques et les textes des<br />
pères de l’Église (Abélard). <strong>Le</strong>s traités de droit sont<br />
essentiellement religieux et fondent la science canonique<br />
enseignée dans les universités alors que le<br />
droit civil se développe aussi au XIII e siècle.<br />
Cependant les <strong>manuscrit</strong>s profanes, considérés<br />
comme utiles à la réfl exion philosophique et<br />
théologique, sont essentiellement des textes de<br />
l’Antiquité classique. Ils servent d’abord à l’apprentissage<br />
de la grammaire et de la versifi cation latine.<br />
<strong>Le</strong>s textes des philosophes et poètes antiques sont<br />
toujours interprétés dans une perspective chrétienne,<br />
participant à la glorifi cation de Dieu : Virgile<br />
et Ovide sont régulièrement copiés. <strong>Le</strong>s auteurs<br />
comme Suétone, Tite-Live, César et Flavius Josèphe<br />
sont aussi étudiés. Mais du XI e au XIV e siècle on ne<br />
compte que 5 à 10 % de textes non chrétiens dans<br />
les bibliothèques médiévales.
3. La décoration peinte<br />
des <strong>manuscrit</strong>s<br />
Enluminer un texte, du latin lumen (lumière), c’est le<br />
rendre lumineux en l’embellissant avec des peintures.<br />
S’inspirant des traditions antiques, les enluminures<br />
entretiennent avec les autres formes d’art médiéval,<br />
notamment les peintures murales ornant les<br />
églises, des liens d’infl uences mutuelles.<br />
EXTRAITS<br />
<strong>Le</strong>ttre ornée, évangéliaire de Saint-Nazaire, XIII e siècle<br />
Dès le VI e siècle la lettre ornée apparaît en Italie. Elle<br />
facilite la compréhension du <strong>manuscrit</strong> car, en se distinguant<br />
des autres lettres par sa taille et son décor, elle a<br />
une fonction de signal visuel qui diff érencie les grandes<br />
parties du texte. Dès l’époque carolingienne les lettres<br />
sont ornées de décorations végétales et animales qui<br />
s’adaptent aux formes géométriques de la lettre. En<br />
Irlande elle se pare d’entrelacs et de spirales (art insulaire).<br />
Parfois elle est rehaussée d’or et de pourpre.<br />
La lettre historiée (ou habitée) apparaît à la fi n de l’époque<br />
carolingienne. Elle sert d’encadrement à l’histoire<br />
(lettres à panse telles que les O, B, Q), les personnages<br />
et animaux pouvant devenir le corps même de la lettre<br />
(lettres à hampe telles que les F, H, P). <strong>Le</strong>s décors végétaux<br />
privilégient les rinceaux d’acanthe. La lettre I (In<br />
illo tempore… début des Évangiles) fait l’objet d’un soin<br />
particulier car elle correspond souvent à la première<br />
lettre du <strong>manuscrit</strong> et son allongement sert à organiser<br />
la page. La lettre T a une symbolique forte par sa forme<br />
de croix.<br />
Jusqu’au XIII e siècle le décor est lié au texte même et à la<br />
lettre que l’on veut mettre en valeur. Puis il envahit tous<br />
les espaces libres : les ornementations de la lettre courent<br />
dans les marges, les bordures représentent fl eurs,<br />
fruits, feuilles, animaux fantastiques ou encore armoiries<br />
du commanditaire. Il occupe parfois une pleine page.<br />
<strong>Le</strong>ttre historiée,<br />
évangéliaire<br />
de Saint-Nazaire<br />
XIII e siècle<br />
107
Dégager l’essentiel<br />
EXTRAITS<br />
La production des <strong>manuscrit</strong>s est principalement religieuse dans une société chrétienne où le<br />
livre le plus lu et commenté est la Bible. <strong>Le</strong>s codex du Moyen Âge, faits de parchemin de cuir souple<br />
ou de papier, aux écritures particulièrement soignées, sont produits dans les scriptoria, les ateliers de<br />
copies ecclésiastiques.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>manuscrit</strong>s sacrés comme profanes sont richement décorés. Ils sont ornés de lettres, bordures,<br />
voire pages entières de motifs qui « enluminent » ou éclairent le texte. Ainsi la lettre ornée de<br />
végétaux et animaux facilite la lecture en marquant le début d’une partie, et la lettre historiée, représentant<br />
une scène avec des personnages, sert d’encadrement au texte et illustre une histoire.<br />
<strong>Le</strong>s ouvrages profanes, notamment les romans de chevalerie comme ceux de Chrétien de Troyes<br />
au XII e siècle, exaltent les valeurs chevaleresques. Là encore, la lettre sert de cadre à l’imagerie médiévale<br />
du preux et courageux combattant.<br />
L’évangéliaire de Carcassonne, ouvrage religieux qui cite les parties du Livre Saint à lire durant les<br />
messes, commandé pour la cathédrale au XIII e siècle, est un parchemin qui met en image des initiales<br />
telles que le « C » de l’adoration des Mages (avec au centre une scène de l’épiphanie) ou le long « I »<br />
représentant saint Michel terrassant le dragon.<br />
Traiter le sujet en classe<br />
Séquence 1 Une lettre historiée pages 114 et 115<br />
Séquence 2 <strong>Le</strong> tournoi, une fête nobiliaire pages 116 et 117<br />
113
Séquence pédagogique 1<br />
114<br />
En ouvrant l’épistolaire de Cambrai, on découvre toute la chaîne du livre au<br />
Moyen Âge et une forme d’expression artistique saisissante : l’enluminure.<br />
Toute la maîtrise de l’enlumineur -- conception, composition, tracé, couleur et<br />
dorure -- est au service de l’illustration et de la valorisation du texte.<br />
Domaine artistique<br />
Arts du visuel<br />
EXTRAITS<br />
Liens<br />
Pratiques artistiques<br />
<br />
<br />
Vocabulaire<br />
Manuscrit<br />
Parchemin<br />
Enluminure<br />
<strong>Le</strong>ttrine<br />
Matériel<br />
pédagogique<br />
La séquence détaillée<br />
3 fi ches élève<br />
- <strong>Le</strong> <strong>manuscrit</strong> médiéval<br />
- L’enluminure médiévale<br />
- <strong>Le</strong> chevalier<br />
Des propositions de<br />
corrigés
EXTRAITS<br />
Document en pages 20 et 21<br />
115
Séquence pédagogique 2<br />
116<br />
<strong>Le</strong> tournoi fait partie de notre imagerie médiévale. La lecture guidée de ces miniatures<br />
permet de se représenter plus fi dèlement cette fête nobiliaire et d’en<br />
comprendre ses fondements militaires.<br />
Domaine artistique<br />
Arts du spectacle vivant<br />
EXTRAITS<br />
Liens<br />
Pratiques artistiques<br />
Français<br />
Jeu théâtral<br />
<br />
Vocabulaire<br />
Tournoi<br />
Joute<br />
Chevalerie<br />
Lice<br />
Matériel<br />
pédagogique<br />
La séquence détaillée<br />
2 fi ches élève<br />
- <strong>Le</strong>s composantes du<br />
tournoi<br />
- Un spectacle festif<br />
Des propositions de<br />
corrigés
EXTRAITS<br />
Document en pages 22 et 23<br />
117
LE MANUSCRIT ENLUMINÉ<br />
En amont de la séquence, l’enseignant pourra demander aux élèves de faire une recherche à la bibliothèque sur<br />
l’équipement du chevalier au Moyen Âge (cavalier et destrier).<br />
1. Découverte<br />
Observation silencieuse<br />
<strong>Le</strong>s élèves découvrent seuls la double page durant quelques minutes.<br />
L’enseignant leur demande d’identifi er le type de production dont il s’agit et d’établir le lien entre les images<br />
[1] à [3].<br />
• Trois documents mais une seule source : une page de l’épistolier de Cambrai, XIII e siècle ; repérer l’échelle des trois images<br />
et le lien d’extraction qui les lie ; mettre en relation le titre de la double page et l’effet zoom (de [1] à [3].<br />
• Défi nition des mots :<br />
- épistolaire : livre religieux chrétien qui recueille des passages de lectures qui doivent être faites pendant la messe ;<br />
- évangéliaire : recueil de textes de l’Évangile.<br />
• Il s’agit donc d’un <strong>manuscrit</strong> religieux.<br />
• Datation XIII e siècle à situer.<br />
SÉQUENCE 1<br />
Une lettre historiée<br />
RÉFÉRENCES AUX PROGRAMMES OBJECTIFS<br />
Domaine<br />
artistique :<br />
les « arts<br />
du visuel »<br />
Liste de référence<br />
* <strong>Le</strong> Moyen Âge<br />
- […]<br />
- Une fresque ; une sculpture<br />
romane ; une sculpture gothique<br />
; un <strong>manuscrit</strong> <strong>enluminé</strong>.<br />
EXTRAITS<br />
DOCUMENTS, MATÉRIEL<br />
Pour l’enseignant<br />
- Ressources générales :<br />
ouvrage chapitre 5<br />
- Ressources spécifi ques<br />
DÉROULEMENT<br />
Pour l’élève<br />
Livre de l’élève :<br />
pages 20 et 21<br />
- Faire découvrir une technique et une forme<br />
d’expression : l’enluminure.<br />
- Enrichir la mémoire de l’élève de connaissances<br />
sur le livre au Moyen Âge.<br />
- Développer la capacité d’observation et de<br />
description d’une œuvre.<br />
- Faire comprendre que l’enluminure a une double<br />
fonction : l’ornementation et l’illustration d’un<br />
propos.<br />
- Favoriser la créativité.<br />
Vocabulaire à acquérir<br />
Manuscrit<br />
Parchemin<br />
Enluminure<br />
<strong>Le</strong>ttrine<br />
• Cet épistolaire a été commandé à un atelier monastique par l’évêque de la cathédrale de Cambrai.
2. Analyse guidée<br />
Travail de recherche - Première partie : le <strong>manuscrit</strong> médiéval<br />
En petits groupes : fi che 1.<br />
Mise en commun, à l’oral<br />
L’enseignant recueille les éléments au tableau, en apportant le vocabulaire et les informations nécessaires à la<br />
compréhension de l’image.<br />
• Des propositions de réponses sur le corrigé de la fi che 1.<br />
• Au Moyen Âge les <strong>manuscrit</strong>s sacrés sont les plus nombreux, les textes bibliques sont au cœur de la production.<br />
• La production médiévale de livres se fait principalement dans les ateliers monastiques, les scriptoria.<br />
EXTRAITS<br />
• <strong>Le</strong> parchemin et le vélin (parchemin obtenu à partir d’une peau de veau mort-né) sont les supports les plus fréquemment<br />
utilisés au Moyen Âge mais, à partir du XIIe siècle, commence à se développer l’usage du papier (pâte de chanvre et de coton)<br />
technique connue depuis le IIIe millénaire en Chine.<br />
• Enluminures : enluminer un texte, du latin lumen (lumière), c’est le rendre lumineux en l’embellissant avec des peintures<br />
et des dorures à la feuille ; les motifs et images sont intégrés dans des cadres, des bordures, des lettrines ou des miniatures.<br />
Travail de recherche - Deuxième partie : l’enluminure médiévale<br />
En petits groupes : fi che 2.<br />
Mise en commun, à l’oral<br />
L’enseignant recueille les éléments au tableau, en apportant le vocabulaire et les informations nécessaires.<br />
• Des propositions de réponses sur le corrigé de la fi che 2.<br />
• <strong>Le</strong>ttre « I » : le corps du dragon descend le long de la marge, le haut du « I » fait une boucle (qui ressemble à un C) qui se<br />
prolonge vers la droite ; la lettre ornée est un repère fort de début de paragraphe, elle encadre « l’histoire ».<br />
• Décor intégré dans la boucle du « I » au-dessus de la tige verticale du « I » (corps du dragon bélier-lézard) et avec un prolongement<br />
horizontal (dragon ailé).<br />
• Motifs : des végétaux, des animaux extraordinaires (un dragon ailé, un dragon bélier-lézard) et un chevalier en charge sur<br />
son destrier (il transperce de sa lance la gorge du dragon horizontal).<br />
• Motifs et fonds très détaillés : armoiries sur l’écu du chevalier et sur le caparaçon du cheval, détails de la cote de mailles,<br />
rendu des sabots du cheval… Une observation très fi ne des détails pourra être proposée aux élèves dans le cadre d’un prolongement<br />
(voir fi che 3).<br />
• Motifs très colorés : polychromie (bleu, rouge, vert, ocre, blanc) sur fond doré très brillant (dorure à la feuille) ; le cerne<br />
noir contraste avec le fond de page et met en relief le décor.<br />
• Illustration forte : par le réalisme des détails et par la dynamique de la composition de la charge du chevalier (corps du cheval<br />
et lance dirigés vers le haut de la page, prolongement de la queue ailée du dragon vers le bord libre droit de la page…).<br />
• Interprétation : le chevalier est le défenseur des valeurs religieuses et morales, il représente le Bien terrassant le Mal (le<br />
dragon).<br />
• L’enluminure n’est pas seulement un décor, elle porte, au même titre que le verbe, la parole divine.<br />
En conclusion, l'enseignant interroge les élèves sur la fonction de l’enluminure, n’est-elle qu’un décor ?<br />
Il fait émerger sa fonction d’illustration du texte ou même parfois de production de sens.<br />
p. 2 LE MANUSCRIT ENLUMINÉ . SÉQUENCE 1
1<br />
UNE LETTRE HISTORIÉE<br />
1. Lisez attentivement le texte.<br />
<strong>Le</strong>s <strong>manuscrit</strong>s du Moyen Âge sont souvent des livres religieux faits dans les monastères pour être utilisés<br />
pendant les messes ; leurs textes sont rédigés en latin, la langue de l’Église, et ils sont reproduits, à partir<br />
du XII e siècle, en écriture gothique, reconnaissable à ses lettres anguleuses aux traits droits et serrés.<br />
<strong>Le</strong>s moines copistes recopient tout à la main avec des plumes d’oiseaux (faisan, aigle, paon, corbeau…) ou<br />
des roseaux taillés et des encres faites à partir de végétaux (le safran pour le jaune, le pastel pour le<br />
bleu…) et de minéraux (le charbon pour le noir, la chaux pour le blanc…) ; ils travaillent sur des parchemins<br />
(peaux de mouton, de chèvre, de veau…), supports coûteux.<br />
<strong>Le</strong>s textes ne sont pas affichés seuls, ils sont <strong>enluminé</strong>s c’est-à-dire ornés, embellis et illustrés par des<br />
moines spécialisés dans ces tâches. Des lettrines, grandes lettres décorées, marquent le début d’un<br />
paragraphe ; elles se prolongent souvent en frise le long du texte. <strong>Le</strong>s enluminures sont des décors inscrits<br />
dans des lettres, des frises et des bordures de textes ; elles sont très détaillées et colorées avec parfois des<br />
parties dorées à la feuille d’or ou d’argent.<br />
Au Moyen Âge, la fabrication d’un livre est donc une entreprise longue et coûteuse qui ne permet pas une<br />
grande diffusion : les livres sont réservés au clergé et aux riches.<br />
EXTRAITS<br />
2. Recopiez dans les cadres ci-dessous les parties du texte qui conviennent pour légender l’image.<br />
Manuscrit :<br />
………………………………………………………………………………<br />
<strong>Le</strong>ttrine :<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
Enluminures :<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
L’écriture gothique :<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
<strong>Le</strong> support :<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
<strong>Le</strong>s encres et dorures :<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………<br />
Moine copiste : ………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
Moine enlumineur : ………………………………………………………………………………………………………………………<br />
<strong>Le</strong>urs outils : ………………………………………………………………………………………………………………………………<br />
1