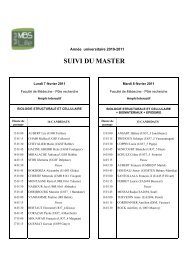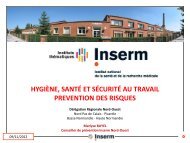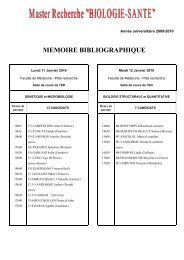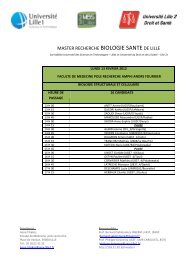Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ÉCOLE DOCTORALE BIOLOGIE SANTÉ DE LILLE<br />
<strong>Cahier</strong> <strong>des</strong> <strong>Résumés</strong><br />
6ème Journée André VERBERT<br />
Colloque Annuel <strong>des</strong> Doctorants<br />
27 septembre 2006<br />
Polytech'Lille (USTL - Lille 1)<br />
Programme détaillé sur http://www.edbsl.net/JAV2006<br />
<strong>Résumés</strong> sur http://www.edbsl.net/JAV2006/resumes
Les Journées André Verbert entrent dans leur sixième édition. Depuis<br />
l’ouverture de l’Ecole Doctorale Biologie santé de Lille elles constituent un<br />
moment privilégié. Elles se veulent avant tout un lieu d’échange<br />
scientifique et intellectuel, mais sont aussi un lieu d’échange informel pour<br />
nos étudiants, l’occasion de partager ses propres expériences dans<br />
l’apprentissage du passionnant métier de chercheur. Nous voudrions aussi<br />
qu’elles puissent créer un esprit de « Grande Ecole » et celui<br />
d’appartenance à une communauté scientifique lilloise unique et<br />
pluridisciplinaire. Elles sont l’occasion pour tous ceux qui participent à la vie<br />
de notre ED d’apprécier la qualité et la diversité <strong>des</strong> recherches menées au sein de nos deux<br />
universités de Lille 1 et Lille 2.<br />
Cette sixième édition coïncide avec le renouvellement quadriennal de notre ED. Le travail de tous a<br />
permis de franchir avec succès cet « examen ». Les changements imposés par la réforme LMD ont<br />
été pleinement assimilés, <strong>des</strong> efforts restent néanmoins à accomplir dans l’ouverture à la mobilité <strong>des</strong><br />
différents thèmes de recherche proposés par les équipes, ainsi que pour ramener la durée de la thèse<br />
à trois ans. Ce dernier point passe par la mise en place d’entretiens avec les étudiants et leurs tuteurs<br />
lors <strong>des</strong> inscriptions de première et troisième année. Le phasage et le mode d’attribution <strong>des</strong><br />
allocations et bourses (bourses établissements, bourses INSERM-Region, BDI CNRS-Region …)<br />
permet d’assurer un nombre croissant de financements de thèses. Les politiques de chaque<br />
établissement s’affirment en outre par l’attribution <strong>des</strong> allocations « Président » visant à assurer la<br />
pluridisciplinarité de notre ED en maintenant un équilibre entre les différents masters , en favorisant<br />
aussi le soutien aux jeunes équipes , l’interdisciplinarité et l’ouverture européenne . Cette année a<br />
notamment vu la mise en place du Collège Doctoral Européen (CDE) rassemblant toutes les ED<br />
régionales .Le CDE s’inscrit pleinement dans le processus de Bologne et confirme l’engagement <strong>des</strong><br />
EDs dans la construction d’une architecture commune <strong>des</strong> systèmes de formation de l’enseignement<br />
supérieur. Le CDE a pour but de favoriser la mobilité européenne de nos doctorants en leur<br />
permettant d’effectuer leur thèse dans deux institutions différentes .Ces étudiants peuvent bénéficier<br />
d’allocations spécifiques après audition et sélection de leur projet par le grand jury. Dés cette année<br />
l’EDBSL , deux étudiants <strong>des</strong> universités belges de Gand et de Leuven ont été sélectionnés<br />
.Rappelons enfin que l’ED se veut un outil essentiel dans le renforcement du potentiel recherche<br />
régional , et qu’elle continue à ouvrir 3 allocations de recherche à la mobilité fléchées vers les<br />
différents IFR .<br />
Rappelons enfin que l’ED a mis en place un dispositif d’appui à l’insertion professionnelle <strong>des</strong><br />
docteurs, tant dans les établissements publics que dans le secteur privé en proposant aux doctorants<br />
<strong>des</strong> formations utiles à leur projet de recherche et à leur projet professionnel, ainsi que <strong>des</strong> formations<br />
nécessaires à l’acquisition d’une culture scientifique élargie. Nous sommes à l’écoute <strong>des</strong> doctorants<br />
pour diversifier ces formations, en les mutualisant pour certaines avec d’autres ED. Il appartient<br />
également au doctorant de justifier du suivi de ces formations pour être autorisé à présenter son<br />
dossier de thèse.<br />
Jean-Paul Dessaint se joint à moi pour remercier, au nom de tous , les doctorants du comité<br />
d’organisation de ses sixième JAV qui aux côtés de Maud Collyn d’Hooghe et de Jean-Jacques<br />
Hauser ont œuvré tout au long de cette année pour assurer le succès de ce colloque .<br />
Merci également à tous les sponsors, et à Jean-Louis Bonte, Directeur de Polytech, pour avoir mis à<br />
notre disposition ses locaux.<br />
Et maintenant place à l’échange, place à la convivialité, place à la science.<br />
Jean-Claude Michalski<br />
Co-responsable EDSBL
08h30 : Accueil par le directeur de l'ED<br />
09h00 - 10h00 : Session orale "PHYSIOLOGIE"<br />
modérateurs : Sophie ROGEE et Mathieu FLOURAKIS<br />
Ecole polytechnique universitaire de Lille<br />
mercredi 27 septembre 2006<br />
• MOLENDI-COSTE OLIVIER (EA2701 - directeur de thèse : Christophe BRETON)<br />
Effets d'une dénutrition maternelle périnatale sur la différenciation neuronale et neuroendocrine dans la médullosurrénale chez le rat mâle<br />
• VENNA VENUGOPAL REDDY (EA1046 - directeur de thèse : Dominique DEPLANQUE)<br />
Les effets anti-immobilité en nage forcée de l'acide alpha-linolénique peuvent être potentialisés par l'administration unique d'une faible dose de clonidine ou d'imipramine.<br />
• HOUDAYER ELISE (EA2683 - directeur de thèse : Philippe DERAMBURE)<br />
Etude de l'excitabilité corticale liée au mouvement: rôle du contrôle moteur inhibiteur et implications physiopathologiques<br />
• CLASADONTE JÉRÔME (U422 - directeur de thèse : Pierre POULAIN)<br />
Effets du Monoxyde d'Azote et de la Prostaglandine E2 sur le neurone à Gonadolibérine chez la souris.<br />
Pause - café<br />
10h00 - 11h00 : Session Poster 1<br />
11h00 - 12h00 : Session orale "NEUROPATHOLOGIES"<br />
modérateurs : Chrystelle LE DANVIC et Paul PEIXOTO<br />
• DOURLEN PIERRE (U422 - directeur de thèse : Luc BUÉE)<br />
Rôle de Pin1 dans les cellules neuronales et la maladie d'Alzheimer<br />
• BRETTEVILLE ALEXIS (U422 - directeur de thèse : Claude-Alain MAURAGE)<br />
Développement et Caractérisation d'un modèle in vivo de Dégénérescence Neurofibrillaire : Un outil de choix pour comprendre les mécanismes d'une mort neuronale liée a Tau.<br />
• LARVOR LYDIE (EA2683 - directeur de thèse : Marie-Christine CHARTIER-HARLIN)<br />
Variations d'expression du gène de l'a-synucléine, cause et conséquences sur la physiopathologie de la maladie de Parkinson<br />
• BENSEMAIN FAÏZA (U508 - directeur de thèse : Nicole HELBECQUE)<br />
Induction de l'expression de l'ornithine transcarbamylase dans la maladie d'Alzheimer.<br />
Pause - déjeuner<br />
13h00 - 14h00 : Session Poster 2
14h00 - 15h00 : Session orale "TRANSPORTEURS SIGNALISATION"<br />
modérateurs : Maria KATSOGIANNOU et Maxime CULOT<br />
• FLOURAKIS MATTHIEU (EMI0228 - directeur de thèse : Natacha PREVARSKAYA)<br />
Mise en évidence du rôle du translocon dans la fuite passive de calcium et dans l'activation <strong>des</strong> canaux calciques de type SOC.<br />
• PLAISIER FABRICE (EA1046 - directeur de thèse : Michèle BASTIDE)<br />
Implication <strong>des</strong> canaux potassiques de l'unité neurogliovasculaire dans la plasticité cérébrale suite à l'ischémie-reperfusion.<br />
• FOVEAU BENEDICTE (UMR8117 - directeur de thèse : David TULASNE)<br />
Amplification de l'apoptose par le clivage séquentiel du récepteur tyrosine kinase MET par les caspases.<br />
• RUCKTOOA PRAKASH (UMR8525 - directeur de thèse : Vincent VILLERET)<br />
Étu<strong>des</strong> structurales de transporteurs périplasmiques potentiellement liés à la virulence de Bordetella pertussis<br />
15h00 - 16h30 : Session orale "REGULATION GENETIQUE"<br />
modérateurs : Valérie FAUQUETTE et Gabriel BIDAUX<br />
• MARTIEN SEBASTIEN (UMR8117 - directeur de thèse : Corinne ABBADIE)<br />
Rôle du stress oxydant induit par les facteurs NF-kB dans la sénescence et l'émergence tumorale <strong>des</strong> cellules épithéliales<br />
• VINCENT AUDREY (U560 - directeur de thèse : Isabelle VAN SEUNINGEN)<br />
Régulation épigénétique <strong>des</strong> gènes de mucines 11p15 (MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6) dans les cancers épithéliaux<br />
• DEGERNY CINDY (UMR8117 - directeur de thèse : Jean-Luc BAERT)<br />
Sumoylation et répression de l'activité transcriptionnelle de ERM<br />
• ROGEE SOPHIE (U524 - directeur de thèse : Jean-Claude D'HALLUIN)<br />
Biodistribution et mécanisme d'infection d'un vecteur adénoviral portant <strong>des</strong> fibres chimériques<br />
• PEIXOTO PAUL (U524 - directeur de thèse : Amélie LANSIAUX)<br />
Ciblage de l'ADN par <strong>des</strong> petites molécules et modulation de la fixation <strong>des</strong> partenaires protéiques<br />
• PENEL NICOLAS (EA2694 - directeur de thèse : Yazdan YAZDANPANAH)<br />
Infections nosocomiales en cancérologie: évaluation de l'incidence, <strong>des</strong> facteurs de risque, <strong>des</strong> conséquences économiques et mise en place d'action préventive.<br />
16h30 - 18h00 : Conférence Plénière<br />
• Ronald MELKI<br />
Le repliement alternatif <strong>des</strong> protéines et l'hérédité structurale qui y est associée. Illustration à l'aide <strong>des</strong> prions de levure<br />
Cocktail de clôture
6ème Journée André VERBERT<br />
Session<br />
P H Y S I O L O G I E
MOLENDI-COSTE Olivier EA2701 - Christophe BRETON<br />
Effets d'une dénutrition maternelle périnatale sur la différenciation neuronale et neuroendocrine dans la<br />
médullosurrénale chez le rat mâle<br />
Un nombre croissant de données épidémiologiques et cliniques suggère que certaines pathologies métaboliques et cardiovasculaires pourraient être<br />
programmées de façon précoce durant la vie fœtale et postnatale. Même si les mécanismes sont encore mal documentés, l’altération de la mise en<br />
place et de la fonctionnalité de l’axe corticotrope semble jouer un rôle prépondérant dans cette programmation. A l’aide d’un modèle de restriction<br />
alimentaire maternelle périnatale de 50% chez le rat (FR50), nous avons montré que la malnutrition maternelle altère non seulement les taux<br />
plasmatiques <strong>des</strong> glucocorticoï<strong>des</strong> mais également ceux <strong>des</strong> catécholamines. Afin de déterminer si le système sympathosurrénalien pourrait participer,<br />
au moins en partie, à la programmation <strong>des</strong> pathologies observées chez l’adulte, nous avons décidé d’étudier la mise en place de la médullosurrénale<br />
ainsi que son activité de la naissance à l’âge adulte chez les animaux FR50.<br />
Le développement de la médullosurrénale se caractérise par la prolifération et la différenciation <strong>des</strong> précurseurs sympathosurrénaliens en cellules<br />
chromaffines neuroendocrines et s’accompagne de la mise en place de l’innervation splanchnique. Des étu<strong>des</strong> morphologiques par immunocytochimie<br />
et microscopie électronique montrent que la dénutrition maternelle affecte l’organisation et l’ultrastructure <strong>des</strong> cellules chromaffines ainsi que<br />
l’architecture <strong>des</strong> fibres innervant la glande. Sur le plan fonctionnel, ces altérations morphologiques s’accompagnent d’une sécrétion accrue <strong>des</strong><br />
catécholamines dosées par HPLC. De plus, la prolifération cellulaire observée dans la médulla <strong>des</strong> animaux FR50 au sevrage par incorporations de<br />
BrdU est fortement réduite, tandis que le nombre de cellules en apoptose détectées à l’aide de la méthode TUNEL est augmenté. Parallèlement, une<br />
approche moléculaire complémentaire d’analyse d’expression différentielle utilisant <strong>des</strong> biopuces à ADN montre <strong>des</strong> modifications de l’expression de<br />
plusieurs gènes impliqués dans la différenciation neuronale et neuroendocrine ainsi que dans la prolifération cellulaire et l’apoptose dans la surrénale<br />
de animaux FR50 au sevrage. Les altérations anatomo-fonctionnelles de la médullosurrénale perdurent chez les rats FR50 de 8 mois et sont<br />
accompagnées d’une hypertension artérielle.<br />
L’ensemble de ces résultats indique que la dénutrition maternelle périnatale perturbe la maturation de la médullosurrénale au cours de la période<br />
postnatale et modifie l’activité <strong>des</strong> cellules chromaffines à long terme chez l’adulte. Ces altérations constitueraient une réponse adaptative de la glande<br />
surrénale à l’environnement délétère et pourraient participer à la programmation <strong>des</strong> maladies chroniques de l’adulte.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cellules chromaffines & Dénutrition & Programmation & Catécholamines<br />
VENNA Venugopal Reddy EA1046 - Dominique DEPLANQUE<br />
Les effets anti-immobilité en nage forcée de l’acide alpha-linolénique peuvent être potentialisés par<br />
l’administration unique d’une faible dose de clonidine ou d’imipramine.<br />
Introduction: Les aci<strong>des</strong> gras poly-insaturés de type oméga-3 pourraient jouer un rôle dans la pathogenèse et le traitement <strong>des</strong> troubles de l’humeur, en<br />
particulier de la dépression. Dans cette étude, nous avons d'abord évalué dans quelle mesure un traitement chronique avec un acide gras poly-insaturé<br />
oméga-3, l’acide alpha-linolénique (AAL), pouvait avoir un effet anti-immobilité (anti-dépresseur) au test de nage forcée chez la souris. Dans un<br />
deuxième temps, nous avons évalué l’impact de l’administration unique d’une faible dose de clonidine (un agoniste <strong>des</strong> récepteurs alpha2 centraux) ou<br />
d’imipramine (un anti-dépresseur tricyclique) chez <strong>des</strong> souris traitées par AAL pendant une durée insuffisante à elle seule à produire un effet antidépresseur.<br />
Métho<strong>des</strong> : Des souris mâles de souche Swiss (20-25g) ont reçu un traitement par AAL (250 mg/kg/j en gavage) ou un placebo pendant une période de<br />
2 à 6 semaines. Pour évaluer les éventuels effets anti-dépresseurs de ce traitement, les souris étaient soumises au test de Porsolt, un test de nage<br />
forcée couramment utilisé pour évaluer les modifications comportementales consécutives à l'administration de médicaments anti-dépresseurs. En<br />
pratique, les souris sont plongées dans un récipient de taille calibrée, rempli d'eau à une température de 23-24 C. Le test, d'une durée de 6 minutes est<br />
entiérement filmé pour permettre une analyse du comportement de nage en aveugle. L'effet de type anti-dépresseur est notamment définie par la<br />
diminution de l'immobilité de l'animal au cours <strong>des</strong> 240 dernières secon<strong>des</strong> du test. Dans cette étude, nous avions par ailleurs évalué les effets de<br />
l’administration d’une dose unique de clonidine (0,06 mg/kg) ou d’imipramine (10 mg/kg), injectées par voie intra-péritonéale, 30 minutes avant le test<br />
de nage forcée, chez <strong>des</strong> souris préalablement traitées par AAL pendant une durée insuffisante à produire un effet anti-dépresseur.<br />
Résultats : Un traitement chronique par AAL pendant une durée d’au moins 5 semaines permettait d’induire, au test de nage forcée, un effet antidépresseur<br />
(Immobilité : Placebo, 231 ± 1 sec ; AAL 2 sem., 215 ± 4 sec ; AAL 3 sem., 219 ± 4 sec ; AAL 4 sem., 214 ± 6 sec ; AAL 5 sem., 201 ± 7 sec<br />
; AAL 6 sem., 194 ± 15 sec ; ANOVA, p < 0.005). De plus, l’administration unique d’une faible dose de clonidine ou d’imipramine, 30 minutes avant le<br />
test de nage forcée, permettait de révéler l’effet anti-dépresseur d’un traitement préalable par AAL d’une durée de 3 semaines, durée de traitement pour<br />
laquelle aucun effet n’avait préalablement été montré (% de diminution de l’immobilité au cours <strong>des</strong> 240 sec. : Placebo, 4 ± 1 ; AAL 3 sem., 9 ± 2 ; AAL<br />
3 sem. et clonidine, 21 ± 4 ; AAL 3 sem. et imipramine, 34 ± 6 ; p < 0.005). En revanche, l’administration à faible dose de clonidine ou d’imipramine ne<br />
permettait pas à elle seule d’induire un effet anti-dépresseur (% de diminution de l’immobilité au cours <strong>des</strong> 240 sec.: Placebo, 4 ± 1 ; clonidine, 6 ± 1 ;<br />
imipramine, 10 ± 3 ; p > 0.05).<br />
Conclusion : Notre étude apporte <strong>des</strong> arguments en faveur de l’existence d’effets anti-dépresseurs <strong>des</strong> oméga-3 en traitement chronique chez la souris.<br />
Ces effets pourraient par ailleurs être révélés ou potentialisés par la modulation pharmacologique <strong>des</strong> voies plus classiquement impliquées dans le<br />
traitement de la dépression. Les mécanismes sous-jacents, en particulier les processus impliqués dans la plasticité du système nerveux central,<br />
demeurent à explorer.<br />
Mot(s)-clé(s) : dépression & omega 3 & comportement & plasticité du système nerveux<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Physiologie" (2) - 9h00 à 10h
HOUDAYER Elise EA2683 - Philippe DERAMBURE<br />
Etude de l’excitabilité corticale liée au mouvement: rôle du contrôle moteur inhibiteur et implications<br />
physiopathologiques<br />
Tout mouvement volontaire doit être en permanence régulé par <strong>des</strong> structures corticales et sous corticales. C’est ce qu’on appelle le contrôle moteur.<br />
Le contrôle moteur inhibiteur, intervenant notamment dans la phase d’arrêt du mouvement, nécessite l’activation de mécanismes inhibiteurs corticaux et<br />
est en relation étroite avec le traitement cortical <strong>des</strong> informations sensorielles ou intégration sensorimotrice. Ces phénomènes cérébraux peuvent être<br />
étudiés au moyen de deux techniques électrophysiologiques : l’ElectroEncéphaloGraphie (EEG) et la Stimulation Magnétique Transcrânienne (SMT).<br />
L’EEG permet de quantifier les variations d’amplitude <strong>des</strong> rythmes électrocorticaux par la méthode <strong>des</strong> Désynchronisations et Synchronisations Liées à<br />
l’Evénement (DLE/SLE). La SLE <strong>des</strong> rythmes bêta reflète une augmentation de la puissance du signal qui survient à la fin d’un mouvement. Initialement<br />
interprétée comme le reflet de l’inhibition corticale ou de la mise au repos <strong>des</strong> neurones corticaux après le mouvement, elle serait également liée à<br />
l’intégration <strong>des</strong> afférences sensorielles. La SMT quant à elle permet de mesurer l’état d’excitabilité du cortex moteur primaire. Cela consiste à activer<br />
focalement les neurones du cortex en délivrant un stimulus magnétique à la surface du scalp. Appliquée en regard du cortex moteur, la SMT évoque un<br />
potentiel évoqué moteur dans un ou plusieurs muscles en fonction du site de stimulation. Différents paradigmes permettent d’étudier l’excitabilité<br />
corticale, les mécanismes inhibiteurs et facilitateurs intracorticaux ou encore l’intégration sensorimotrice. La SMT répétitive (SMTr), délivrée sous forme<br />
de trains, permet de moduler l’excitabilité corticale en fonction <strong>des</strong> paramètres de stimulation.<br />
L’objectif de ce travail est d’approfondir nos connaissances sur le contrôle moteur cortical en évaluant le rôle de l’intégration sensorimotrice et de<br />
l’inhibition intracorticale grâce à l’EEG et la SMT. Ceci nous permettra de mieux caractériser les anomalies d’excitabilité corticale qui sous-tendent <strong>des</strong><br />
pathologies telles que les myoclonies corticales, la maladie de Parkinson, les dystonies ou l’épilepsie. L’objectif secondaire est d’identifier de nouvelles<br />
cibles de stimulation par SMTr, en vue d’améliorer le traitement de certaines de ces pathologies.<br />
La première partie de ce travail s’est portée sur l’analyse de la SLE bêta chez <strong>des</strong> sujets sains. Cette étude a permis de montrer que les paramètres de<br />
la SLE (amplitude et durée) dépendent du type de fibres sensitives stimulées (Houdayer et al, 2006). Dans un deuxième temps, nous avons analysé<br />
cette SLE bêta chez <strong>des</strong> patients souffrant de myoclonies corticales. Les myoclonies sont de brèves secousses musculaires involontaires et<br />
incontrôlables, générées par une population de neurones corticaux hyperexcitables. Cette hyperexcitabilité corticale serait associée à une anomalie de<br />
l’intégration sensorimotrice. Les premiers résultats tendent à montrer une anomalie de la SLE bêta chez ces patients. Par ailleurs, tous bénéficièrent<br />
d’une exploration par SMT qui permit de mettre en évidence <strong>des</strong> anomalies <strong>des</strong> systèmes inhibiteurs intracorticaux ainsi que <strong>des</strong> défauts d’intégration<br />
sensorimotrice. Les effets de la SMTr furent évalués à trois reprises chez une de ces patients. Une amélioration de son tremblement fut observée<br />
excepté après la troisième séance. Par conséquent, la dernière partie de ce travail de thèse est <strong>des</strong>tinée à mieux comprendre les effets de la SMTr<br />
basse et haute fréquence chez le sujet sain. Pour cela, nous comparons les effets de la SMTr basse et haute fréquence appliquée en regard du cortex<br />
moteur primaire et du cortex prémoteur. Nous évaluons les effets de cette stimulation sur l’hémisphère cérébral stimulé et sur l’hémisphère opposé et<br />
sur différents muscles. L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes d’action de la SMTr ainsi que ses conséquences sur l’activité corticale afin<br />
d’obtenir une plus grande maîtrise de ce nouvel outil thérapeutique<br />
Mot(s)-clé(s) : Intégration sensorimotrice & Inhibition corticale & EEG & Stimulation Magnétique Transcrânienne<br />
CLASADONTE Jérôme U422 - Pierre POULAIN<br />
Effets du Monoxyde d’Azote et de la Prostaglandine E2 sur le neurone à Gonadolibérine chez la souris.<br />
Chez les mammifères, la fertilité est sous le contrôle direct <strong>des</strong> neurones à gonadolibérine (GnRH), localisés dans le septum et l’aire préoptique. Ces<br />
neurones permettent la libération <strong>des</strong> hormones gonadotropes par l’hypophyse antérieure grâce à la sécrétion de GnRH au niveau de leurs<br />
terminaisons axonales et ce processus dépend principalement de leur activité électrique. L’activité électrique du neurone à GnRH est soumise à <strong>des</strong><br />
contrôles modulateurs exercés par les neurones qui les contactent. Toutefois, <strong>des</strong> facteurs « non synaptiques » comme le monoxyde d’azote (NO : un<br />
neuromédiateur gazeux) et la Prostaglandine E2 (PGE2), sont reconnus pour faciliter la cession <strong>des</strong> hormones gonadotropes. Ils pourraient agir<br />
directement sur le corps cellulaire du neurone à GnRH mais cela n’est pas démontré. De plus, ces deux facteurs interagissent car, dans certains<br />
modèles, la PGE2 peut être produite sous l’action du NO.<br />
J’ai développé une méthodologie pour visualiser et enregistrer en patch-clamp les neurones à GnRH chez <strong>des</strong> souris transgéniques GnRH-GFP <strong>des</strong><br />
deux sexes. A partir de tranches de cerveau adulte perfusées, j’ai étudié l’action du NO et de la PGE2 sur les neurones à GnRH. Les substances ont<br />
été appliquées dans le milieu de perfusion.<br />
Le NO amené dans la tranche par application d’un donneur, le DEA-NONOate (30-100 µM), exerce <strong>des</strong> effets inhibiteurs sur 11 parmi 17 neurones<br />
testés. Il n’a pas d’effet sur les autres neurones. Les effets se manifestent par une hyperpolarisation membranaire de 2,5 à 17,5 mV d’où une diminution<br />
de la fréquence de décharge. L’hyperpolarisation s’accompagne d’une baisse de la résistance membranaire. Elle persiste sous tétrodotoxine 0,5 µM<br />
(pour bloquer la transmission synaptique dépendante <strong>des</strong> potentiels d’action), démontrant ainsi que le NO agit directement sur le corps cellulaire du<br />
neurone enregistré. Le NO produit de manière endogène par l’application d’un précurseur de sa synthèse, la L-Arginine (10-20 mM), provoque aussi<br />
une inhibition de la décharge pour 9 neurones. Cette inhibition est réduite par l’application préalable d’un inhibiteur de la NO synthétase, la L-NAME (1<br />
mM).<br />
L’action de la PGE2 a été étudiée sur 110 neurones. La substance exerce <strong>des</strong> effets excitateurs sur 86 neurones (78%). Elle n’a pas d’effet sur les<br />
autres neurones. Les effets se manifestent par une dépolarisation membranaire moyenne de 8 mV (1µM), déclenchant une décharge de potentiels<br />
d’action. La dépolarisation s’accompagne d’une baisse de la résistance membranaire. Le maintien de l’effet sous tétrodotoxine démontre que le<br />
mécanisme d’action de la PGE2 est direct. Le courant entrant responsable de la dépolarisation membranaire a une valeur moyenne de - 23 pA et<br />
s’annule pour une valeur du potentiel de membrane qui suggère son appartenance à la famille <strong>des</strong> courants cationiques non sélectifs. La PGE2 peut se<br />
lier à quatre types distincts de récepteurs. Seul le Butaprost 10 µM, un agoniste sélectif du récepteur EP2, mime l’effet de la PGE2, alors que les<br />
agonistes pour les récepteurs EP1/3 et EP3 sont sans effet.<br />
Ces résultats démontrent que le NO et la PGE2 sont <strong>des</strong> modulateurs directs de l’activité du neurone à GnRH. Le NO est inhibiteur, bien que<br />
l’hypothèse couramment admise propose un effet facilitateur. La PGE2 est ici excitatrice, bien que la production de PGE2 puisse être reliée à l’activité<br />
NO.<br />
En conclusion, le NO et la PGE2 exercent <strong>des</strong> actions opposées sur l’activité électrique du neurone à GnRH et peuvent ainsi influencer différemment la<br />
libération <strong>des</strong> hormones gonadotropes. Des expériences en cours tentent de démontrer l’origine astrocytaire de la PGE2, pour confirmer l’hypothèse<br />
selon laquelle la PGE2 est un « gliotransmetteur » qui agit sur la fertilité suite à l’activation <strong>des</strong> récepteurs erbB présents sur l’astrocyte.<br />
Mot(s)-clé(s) : GnRH-GFP & Monoxyde d’azote & Prostaglandine E2 & Patch-clamp<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Physiologie" (4) - 9h00 à 10h
6ème Journée André VERBERT<br />
Session<br />
NEUROPATHOLOGIES
DOURLEN Pierre U422 - Luc BUÉE<br />
Rôle de Pin1 dans les cellules neuronales et la maladie d’Alzheimer<br />
La peptidyl prolyl cis-trans isomérase Pin1 facilite l’isomérisation de la liaison peptidique reliant une Sérine ou une Thréonine à une Proline (motifs<br />
Ser/Thr-Pro) entre les conformations cis et trans. La particularité de cette PPIase est d’être spécifique de motifs phosphorylés. La phosphorylation<br />
inhibe l’isomérisation spontanée de la liaison ce qui rend nécessaire l’action de cette enzyme. Elle prend une place croissante dans la biologie cellulaire<br />
sachant que de nombreuses kinases (cdk, MAPK, GSK3…) et phosphatases (PP2A, Fcp1…) ciblent ces motifs. En régulant leur conformation, Pin1<br />
pourrait faciliter la déphosphorylation <strong>des</strong> protéines. De tels mécanismes sont fondamentaux dans la régulation du cycle cellulaire. Ainsi, il a été montré<br />
que dans les cellules en prolifération, Pin1 contrôlerait le cycle cellulaire, notamment la transition G2/M, et faciliterait l’apoptose. Ces mécanismes ont<br />
été impliqués dans une pathologie cérébrale, la maladie d’Alzheimer. L’une <strong>des</strong> deux lésions de cette maladie, la dégénérescence neurofibrillaire, est<br />
caractérisée par l’agrégation de la protéine Tau hyper phosphorylée et anormalement phosphorylée. Or dans la dégénérescence neurofibrillaire, <strong>des</strong><br />
marqueurs <strong>des</strong> phases G1, S et G2-M sont exprimés anormalement dans les neurones. Un défaut d’activité de Pin1 dans ces cellules différenciées<br />
pourrait faciliter cette reprise du cycle cellulaire. Par ailleurs, il a été décrit in vitro que Pin1 faciliterait la déphosphorylation de la protéine Tau en<br />
favorisant l’accès <strong>des</strong> phosphatases (PP2A) à certains sites pSer/Thr-Pro. En effet, cette phosphatase est spécifique de motifs en conformation trans et<br />
en facilitant l’échange <strong>des</strong> conformations, Pin1 faciliterait l’activité de cette enzyme. Au total Pin1 pourrait avoir un rôle clé dans la dégénérescence<br />
neurofibrillaire. Cependant, le rôle physiologique de Pin1 reste inconnu dans les cellules neuronales.<br />
Dans le cadre de ce travail, nous avons évalué le rôle de Pin1 sur la phosphorylation de tau et la régulation du cycle cellulaire dans <strong>des</strong> cellules de type<br />
neuronal.<br />
Nous avons étudié le rôle de Pin1 dans la déphosphorylation de tau dans deux modèles cellulaires, un modèle de lignée SY5Y issue de neuroblastome<br />
et un modèle de culture primaire mixte de neurones. Nos résultats ont montré que parmi 9 <strong>des</strong> 17 motifs Ser/Thr-Pro que possède Tau, seule la<br />
phosphorylation d’un site, la Thr231, est régulée par Pin1. Dans le contexte de la maladie d’Alzheimer, la phosphorylation à ce site est considérée<br />
comme pathologique. En facilitant la déphosphorylation de Tau, la protéine Pin1 semble avoir un rôle neuroprotecteur. Ceci a été confirmé tout d’abord,<br />
par le phénotype <strong>des</strong> souris invalidées pour Pin1 qui montre une pathologie Tau mais aussi par un défaut d’activité de Pin1 observé dans la maladie<br />
d’Alzheimer.<br />
Le rôle de Pin1 a été évalué dans le cycle <strong>des</strong> cellules SY5Y, différenciables en neurones. Les résultats montrent que la surexpression de Pin1 altère la<br />
croissance <strong>des</strong> cellules et la répartition de ces cellules dans les phases du cycle. Ils diffèrent de ceux publiés pour d’autres lignées cellulaires ce qui<br />
laisse envisager un rôle original de Pin1 dans ces cellules ainsi qu’une interaction avec de nouveaux partenaires moléculaires.<br />
CONCLUSION<br />
Au total, nos résultats montrent un rôle de Pin1 dans la régulation de la phosphorylation de tau et potentiellement dans la réactivation du cycle cellulaire<br />
observée dans la maladie d’Alzheimer.<br />
Mot(s)-clé(s) : PPIase & Phosphorylation & Tau & cycle cellulaire<br />
BRETTEVILLE Alexis U422 - Claude-Alain MAURAGE<br />
Développement et Caractérisation d’un modèle in vivo de Dégénérescence Neurofibrillaire : Un outil de choix<br />
pour comprendre les mécanismes d’une mort neuronale liée a Tau.<br />
Les maladies neurodégénératives se caractérisent par une perte neuronale qui, suivant les pathologies, affecte <strong>des</strong> populations neuronales spécifiques<br />
expliquant en partie la diversité <strong>des</strong> signes cliniques observés. Parmi ces pathologies, la maladie d’Alzheimer et certaines démences familiales<br />
présentent une lésion neurohistopathologique spécifique appelée Dégénérescence NeuroFibrillaire (DNF). Cette lésion est définie par une agrégation<br />
intraneuronale de protéines Tau qui sont retrouvées hyperphosphorylées, anormalement phosphorylées et agrégées sous la forme de filaments<br />
appariés en hélice (PHF). Cependant, si cette dérégulation de phosphorylation semble être au cœur du processus dégénératif de ces pathologies, le<br />
rôle exact de celle-ci et les mécanismes mis en jeu, plus généralement, au cours de la mort neuronale sont encore mal connus. En 1998, la découverte<br />
de mutations dans le gène de Tau associées à <strong>des</strong> démences héréditaires (mutations DFTP-17) a permis d’élaborer <strong>des</strong> modèles murins qui<br />
reproduisent <strong>des</strong> caractéristiques de la DNF. Néanmoins, ces modèles présentent <strong>des</strong> troubles moteurs qui constituent un handicap majeur pour<br />
évaluer les capacités mnésiques de ces souris à l’aide <strong>des</strong> tests comportementaux usuels. Dans ce contexte, notre laboratoire a entrepris de<br />
développer un nouveau modèle murin de DNF ne présentant pas ces troubles moteurs. Ce modèle transgénique est basé sur la surexpression d’une<br />
protéine Tau comportant deux mutations pathologiques. De plus, la séquence codante du transgène a été placée sous le contrôle d’un promoteur<br />
neuronal afin de cibler l’expression au niveau <strong>des</strong> neurones. L’étude de ce modèle a révélé la présence, au cours du vieillissement, <strong>des</strong> caractéristiques<br />
majeures de la DNF avec une hyperphosphorylation de Tau, une phosphorylation anormale de Tau et une agrégation de Tau qui précèdent la mort<br />
neuronale. De plus, l’absence de troubles moteurs au cours de la fenêtre d’étude, a permis de mettre en évidence l’existence de troubles<br />
d’apprentissages et de mémoire spatiale chez ces souris. En conclusion, nous disposons d’un modèle physiopathologique pertinent pour approfondir la<br />
compréhension <strong>des</strong> mécanismes impliqués dans la DNF et qui représentera un outil de choix pour l’évaluation de stratégies pharmacologiques.<br />
Mot(s)-clé(s) : Maladie d’Alzheimer & mutations DFTP-17 & agrégation & phosphorylation<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Neuropathologies" (2) - 11h00 à 12h
LARVOR Lydie EA2683 - Marie-Christine CHARTIER-HARLIN<br />
Variations d’expression du gène de l’α-synucléine, cause et conséquences sur la physiopathologie de la<br />
maladie de Parkinson<br />
La maladie de Parkinson est l’atteinte neurodégénérative motrice la plus courante dans la population âgée. Sa prévalence est d’environ 1,8 % après 65<br />
ans (de Rijk et al, 2000). Quatre signes cliniques majeurs caractérisent cette maladie: un tremblement de repos, une bradykinésie, une rigidité<br />
musculaire et une instabilité posturale. Des problèmes neuropsychologiques, <strong>des</strong> perturbations du sommeil ou encore <strong>des</strong> dysautonomies peuvent être<br />
observés et dépendent de l’étendue de l’atteinte du système dopaminergique (pour revue voir: Chaudhuri et al, 2006).<br />
L’étude de cas familiaux et sporadiques a permis l’identification de plusieurs gènes délétères menant ainsi à une meilleure compréhension de la<br />
physiopathologie de la maladie. En particulier, pour le gène de l’α-synucléine (SNCA), l’identification d’une multiplication du locus de ce gène<br />
(Farrer et al, 2004) a souligné l’importance de son niveau d’expression. L’augmentation d’expression résultante semble suffisante au développement<br />
d’un syndrome parkinsonien chez les porteurs de la mutation (Singleton et al, 2003; Chartier-Harlin et al, 2004; Ibanez et al, 2004). Certains allèles du<br />
polymorphisme de répétition REP1 sont associés à la maladie (Chiba-Falek et al, 2005) et induisent également une augmentation d’expression de<br />
SNCA en système rapporteur (Chiba-Falek and Nussbaum, 2001; Chiba-Falek et al, 2003). D’autre part, la surexpression de l’α-synucléine<br />
humaine chez <strong>des</strong> animaux transgéniques provoque l’apparition d’un syndrome parkinsonien (Hashimoto et al, 2003). Dans <strong>des</strong> modèles cellulaires,<br />
elle entraîne l’activation <strong>des</strong> voies de l’apoptose et de l’inflammation, ainsi que l’altération de l’adhésion cellulaire (Seo et al, 2002; Takenouchi et al,<br />
2001). L’augmentation du taux en α-synucléine semble donc être un <strong>des</strong> promoteurs de la cascade d’évènements menant au développement de<br />
la maladie de Parkinson.<br />
Au vu de ces données, nous nous sommes intéressés aux conséquences pathogéniques <strong>des</strong> variations du taux d’expression de l’α-synucléine.<br />
Nous avons ainsi identifié une duplication du locus de SNCA par PCR semi-quantitative, confirmé par hybridation in situ (FISH), dans la famille P59<br />
(Chartier-Harlin et al, 2004). En parallèle, l’examen clinique a été approfondi par une évaluation neuropsychologique et un DaTScan® (analyse par<br />
imagerie cérébrale) pour déterminer l’impact du taux d’expression sur les symptômes non moteurs chez les porteurs de multiplications géniques.<br />
Ensuite, nous avons analysé <strong>des</strong> cas familiaux ne présentant pas de mutations de SNCA, <strong>des</strong> porteurs d’une duplication et <strong>des</strong> porteurs d’une<br />
triplication. Nous avons observé que l’augmentation du taux d’ARNm de SNCA est corrélée au nombre de copies du gène mais également à <strong>des</strong><br />
phénotypes cliniques différents. Afin de déterminer l’impact pathogénique du taux d’expression de SNCA, nous avons mesuré l’expression de 360<br />
gènes <strong>des</strong> voies de l’apoptose, de l’inflammation et de l’adhésion cellulaire chez les membres de la famille P59 en comparaison avec <strong>des</strong> contrôles<br />
sans altérations du gène SNCA. Nous avons ainsi identifié deux gènes différentiellement exprimés chez les porteurs de duplication de SNCA, SDF1<br />
(Stromal cell Derived Factor-1) et TIMP2 (Tissue Inhibitor of MetalloProteinase 2), potentiellement impliqués dans un mécanisme de<br />
neurodégénérescence. Nous avons mesuré leur taux d’expression chez les mala<strong>des</strong> précédemment cités. Nous avons ainsi observé que les niveaux en<br />
SDF1 et TIMP2 corrèlent avec le taux d’α-synucléine. Enfin, nous analysons actuellement les conséquences moléculaires et cellulaires de<br />
l'invalidation et de la surexpression (respectivement par transfection de siRNA et de vecteurs d'expression) du gène SNCA dans une lignée de<br />
neuroblastome (SK-N-SH SY5Y). Nos résultats préliminaires suggèrent que SDF1 et TIMP2 sont modulés par le taux d'α-synucléine et les<br />
conséquences phénotypiques (survie, prolifération et différenciation cellulaire) sont en cours d'étude.<br />
Mot(s)-clé(s) : Parkinson & Synucléine & Expression<br />
BENSEMAIN Faïza U508 - Nicole HELBECQUE<br />
Induction de l’expression de l’ornithine transcarbamylase dans la maladie d’Alzheimer.<br />
Afin de caractériser de nouveaux déterminants génétiques localisés dans <strong>des</strong> régions chromosomiques d’intérêt définies par criblage génomique dans<br />
la maladie d’Alzheimer, nous avons développé une biopuce thématique nous permettant d’étudier 2741 gènes localisés dans ces régions. Cette étude<br />
nous a permis de mettre en évidence 106 gènes différentiellement exprimés dans le tissu cérébral de 12 mala<strong>des</strong> par rapport à celui de 12 témoins. Sur<br />
11 gènes localisés sur le chromosome X et différentiellement exprimés, nous nous sommes plus particulièrement intéressés au gène de l’ornithine<br />
transcarbamylase (OTC), enzyme clé du cycle de l’urée. Ce gène s’est avéré être exprimé dans le tissu cérébral <strong>des</strong> patients mais pas celui <strong>des</strong><br />
témoins, observation confirmée par RT-PCR. Par ailleurs, nous avons détecté l’ARNm <strong>des</strong> autres enzymes du cycle de l’urée. Ceci suggère donc que<br />
ce cycle est actif dans le tissu cérébral pathologique, alors que celui-ci est normalement restreint au tissu hépatique. En complément de cette analyse<br />
transcriptomique, <strong>des</strong> expériences d’immunohistochimie ont permis de confirmer la présence spécifique de la protéine dans le tissu cérébral <strong>des</strong><br />
mala<strong>des</strong> et de la localiser au niveau <strong>des</strong> cellules endothéliales vasculaires.<br />
Finalement, nous avons analysé l’association avec le risque de développer la MA, de 2 polymorphismes localisés dans le promoteur du gène de l’OTC.<br />
Des combinaisons spécifiques de ces deux polymorphismes ont été significativement associées au risque de développer la MA, ces combinaisons<br />
correspondant potentiellement à <strong>des</strong> niveaux de méthylation différents du promoteur de l’OTC.<br />
En conclusion, cette approche nous a permis d’identifier une nouvelle voie métabolique dans le cerveau <strong>des</strong> mala<strong>des</strong> pouvant être associée au risque<br />
de développer la MA.<br />
Mot(s)-clé(s) : Maladie d'Alzheimer & Ornithine transcarbamylase & Expression<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Neuropathologies" (4) - 11h00 à 12h
6ème Journée André VERBERT<br />
Session<br />
T R A N S P O R T E U R S<br />
S I G N A L I S A T I O N
FLOURAKIS Matthieu U 800 - Natacha PREVARSKAYA<br />
Mise en évidence du rôle du translocon dans la fuite passive de calcium et dans l’activation <strong>des</strong> canaux<br />
calciques de type SOC.<br />
L’ion calcium est considéré comme un second messager ubiquitaire utilisé par tous les types cellulaires. C’est un facteur essentiel impliqué dans de<br />
nombreux processus aussi divers que l’apoptose, la prolifération, la différenciation, la fécondation et la sécrétion.<br />
Le Réticulum Endoplasmique (RE), principale source de calcium mobilisable pour la cellule, est un acteur important pour la régulation de la signalisation<br />
calcique. L’homéostasie calcique du RE est donc finement régulée. L’un <strong>des</strong> mécanismes les plus énigmatique responsable de la régulation de la<br />
concentration de calcium dans le RE est la « fuite passive » de calcium : en effet la nature moléculaire <strong>des</strong> canaux responsables de cette fuite est<br />
inconnue. Des étu<strong>des</strong> récentes ont démontré que le translocon, un complexe multiprotéique présent sur la membrane du RE et jouant un rôle dans la<br />
traduction, serait perméable au calcium. Cependant le rôle de ce complexe dans la fuite passive de calcium n’a jamais été clairement démontré.<br />
Par ailleurs, il est connu que la fuite passive de calcium peut stimuler les canaux calciques de type SOC (Store Operated Channels). Ces canaux sont<br />
activés suite à la libération du calcium contenu dans le RE. Ils assurent, après la déplétion, le remplissage <strong>des</strong> stocks calciques jusqu'à leurs<br />
concentrations physiologiques et jouent donc un rôle important dans la physiologie de la cellule. Dans ce cadre, il était tout particulièrement intéressant<br />
de savoir si la fuite passive transitant par le translocon peut activer les canaux SOC.<br />
Dans ce cadre, notre travail nous a permis de démontrer que le translocon est le canal de fuite majoritaire <strong>des</strong> cellules cancéreuses prostatiques<br />
humaines. Cette fuite de calcium via le translocon serait responsable de l’activation <strong>des</strong> canaux calciques de type SOC. Nos résultats suggèrent ainsi<br />
que la fuite de calcium par le translocon pourrait être un processus ubiquitaire dans la physiologie cellulaire et serait un élément majeur de la<br />
signalisation calcique en régulant la concentration de calcium dans le RE.<br />
Mot(s)-clé(s) : CALCIUM & RETICULUM ENDOPLASMIQUE & TRANSLOCON & STORE OPERATED CHANNELS<br />
PLAISIER Fabrice EA1046 - Michèle BASTIDE<br />
Implication <strong>des</strong> canaux potassiques de l’unité neurogliovasculaire dans la plasticité cérébrale suite à l’ischémiereperfusion.<br />
Au sein du tissu cérébral, les cellules neuronales, astrocytaires et vasculaires forment une unité fonctionnelle permettant le couplage entre l’activité<br />
neuronale et le débit sanguin. Suite à un accident vasculaire cérébral, un important découplage fonctionnel apparaît au sein de cette unité en particulier<br />
au niveau <strong>des</strong> mouvements ioniques.<br />
L’objectif de mon étude est de mettre en évidence les altérations <strong>des</strong> conductances potassiques (Kir, Kv, …) au sein de l’unité neurogliovasculaire suite<br />
à l’ischémie/reperfusion et leur plasticité au cours de la période post-ischémique. Mes travaux sont réalisés sur un modèle d’ischémie-reperfusion focale<br />
chez le rat et par l’utilisation de différentes techniques, électrophysiologiques (patch-clamp) et biochimiques (western blot et immunohistochimie). En<br />
parallèle, le déficit sensorimoteur est évalué par <strong>des</strong> tests comportementaux sur l’animal afin de reproduire le handicap fonctionnel <strong>des</strong> patients<br />
consécutif à un accident vasculaire cérébral.<br />
Il a d’abord été mis en évidence au niveau vasculaire une réduction significative de la densité de courant Kir2.1du muscle lisse après 24h de<br />
reperfusion. La relaxation potassium dépendante qui lui est associée ainsi que la relaxation dépendante de l’endothélium sont également altérées.<br />
Après 7 jours de reperfusion, la récupération progressive au cours du temps de la densité de courant est totale et montre une aptitude intrinsèque du<br />
canal à retrouver son activité. Une étude de l’expression de celui-ci au décours de l’ischémie est en réalisation dans le but de confirmer si ces résultats<br />
sont dus à une variation de l’expression de la protéine. Les étu<strong>des</strong> de vasoréactivité menées au cours de cette même période montre de façon similaire<br />
une récupération spontanée de la relaxation potassium-dépendante contrairement à la relaxation endothélium-dépendante. D’un point de vue moteur,<br />
l’ischémie-reperfusion entraîne un déficit sensorimoteur qui est caractérisé par l’utilisation de deux tests (test du ruban adhésif et test de traction). Les<br />
résultats montrent que suite à l’ischémie-reperfusion une phase de récupération spontanée intervient reflétée par une amélioration partielle et<br />
progressive <strong>des</strong> performances de l’animal.<br />
L’administration d’un agent antioxydant tel que la stobadine (2 mg/kg) induit une neuroprotection qui se traduit par <strong>des</strong> volumes d’infarctus plus faibles.<br />
En parallèle, la stobadine induit une protection du courant Kir2.1 dès 24h sous-tendant une protection du canal vis-à vis <strong>des</strong> radicaux libres générés lors<br />
de la phase de reperfusion. Alors que la stobadine protège dès 24h la relaxation endothélium-dépendante, elle ne semble pas accélérer la récupération<br />
potassium-dépendante montrant que d’autres mécanismes délétères doivent ainsi être mis en jeu. Néanmoins, d’un point de vue comportemental, elle<br />
permet une accélération significative de la récupération motrice <strong>des</strong> animaux.<br />
Mes travaux se poursuivent actuellement selon deux axes distincts. D’une part, les conductances potassiques voltage dépendantes qui sont elles aussi<br />
impliquées dans la réactivité vasculaire ainsi que leur régulation (NO) sont étudiées afin d’évaluer l’étendue <strong>des</strong> perturbations ioniques au niveau<br />
vasculaire suite à l’ischémie. D’autre part, la technique de patch-clamp sur tranche de cerveau est actuellement en phase de mise au point. Celle-ci<br />
permettra l’étude <strong>des</strong> conductances potassiques <strong>des</strong> autres compartiments cellulaires (notamment neuronal) situés dans la zone de pénombre<br />
ischémique et dans la zone homotopique contralatérale pouvant intervenir lors <strong>des</strong> mécanismes de plasticité observés après ischémie-reperfusion.<br />
Mot(s)-clé(s) : Ischémie cérébrale & Canaux ioniques & Antioxydant & Plasticité cérébrale<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Transporteurs signalisation" (2) - 14h00 à 15h
FOVEAU Benedicte UMR8117 - David TULASNE<br />
Amplification de l’apoptose par le clivage séquentiel du récepteur tyrosine kinase MET par les caspases.<br />
L’Hepatocyte Growth Factor / Scatter Factor (HGF/SF) est un facteur de croissance pléïotropique qui agit via le récepteur tyrosine kinase MET dans<br />
divers types cellulaires. Suite à la liaison de l’HGF/SF, le récepteur MET se dimérise et son activité tyrosine kinase est stimulée par<br />
autophosphorylation, permettant l’activation de voies de signalisation. MET activé par son ligand induit la prolifération, la dispersion, l’invasion et la<br />
morphogenèse de cellules épithéliales. L’HGF/SF est également un facteur de survie qui protège de nombreux types cellulaires contre la toxicité et<br />
l’apoptose induites par divers stimuli.<br />
Néanmoins, nous avons montré que MET est une cible fonctionnelle <strong>des</strong> caspases. En effet, <strong>des</strong> stress induisent le clivage de MET par les<br />
caspases dans sa région juxtamembranaire, générant un fragment pro-apoptotique de 40 kDa (p40 MET).<br />
Nous avons récemment découvert l’existence d’un autre clivage de MET par les caspases, situé dans son extrémité C-terminale. De façon intéressante,<br />
nous avons mis en évidence une organisation hiérarchique de ces clivages, celui en C-terminal favorisant celui en juxtamembranaire. De plus, la<br />
délétion <strong>des</strong> derniers aci<strong>des</strong> aminés de MET, suite au clivage C-terminal, augmente les capacités apoptotiques de p40 MET. Enfin, <strong>des</strong> cellules<br />
exprimant stablement un récepteur MET muté sur le site caspase C-terminal génèrent moins de fragment p40 MET et sont plus résistantes à<br />
l’apoptose, indiquant que la génération de ce fragment amplifie la mort cellulaire.<br />
Ces résultats révèlent un clivage du récepteur MET par les caspases en deux étapes séquentielles réorientant ses activités biologiques de<br />
récepteur de survie vers une activité pro-apoptotique.<br />
Mot(s)-clé(s) : récepteur tyrosine kinase MET - Hepatocyte Growth Factor - apoptose - caspase<br />
RUCKTOOA Prakash UMR8525 - Vincent VILLERET<br />
Étu<strong>des</strong> structurales de transporteurs périplasmiques potentiellement liés à la virulence de Bordetella pertussis<br />
Les systèmes de transport <strong>des</strong> bactéries sont généralement reliés à leur métabolisme d'une part, et à la niche écologique dans laquelle elles évoluent<br />
d'autre part. Chez les bactéries à Gram négatif, le passage de solutés du périplasme vers le cytoplasme est en partie dévolu aux transporteurs<br />
périplasmiques ATP-indépendants à trois partenaires (TRAP). Ce mode de transport fait intervenir deux protéines situées dans la membrane interne<br />
ainsi qu'un composant périplasmique, DctP.<br />
Bordetella pertussis, l'agent étiologique de la coqueluche, possède une quinzaine de transporteurs de type TRAP. Les gènes codant pour deux de ces<br />
transporteurs (TRAP6 et TRAP7), sont situés dans une région adjacente au locus de trois facteurs de virulence (FhaC, FHA et Fim) régulés au niveau<br />
transcriptionnel par le système à deux composants BvgAS. La proximité <strong>des</strong> gènes de TRAP6 et TRAP7 avec ce locus de virulence pourrait suggérer<br />
que les substrats qu'ils transportent, seraient impliqués dans la modulation de la réponse du couple BvgA/S. Une étude structurale <strong>des</strong> composants<br />
périplasmiques respectifs <strong>des</strong> TRAP6 et TRAP7 (DctP6 et DctP7) a donc été initiée afin d'identifier ces substrats.<br />
DctP6 et DctP7 ont été cristallisés et leur structure tridimensionnelle a été déterminée à une résolution de 1,9 Å. Le repliement de ces deux DctP est<br />
similaire à celui <strong>des</strong> transporteurs périplasmiques. L'analyse de la structure a montré que le substrat transporté par DctP6 et DctP7 serait<br />
vraisemblablement l'acide pyroglutamique.<br />
Cette identification du substrat de DctP6 et DctP7 servira de base de départ pour l'étude <strong>des</strong> effets potentiels de l'acide pyroglutamique sur la<br />
modulation du système à deux composants BvgAS de même que sur le métabolisme de B. pertussis.<br />
Mot(s)-clé(s) : Structure & Cristallographie & Transporteur périplasmique<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Transporteurs signalisation" (4) - 14h00 à 15h
6 ème Journée André VERBERT<br />
Session<br />
R E G U L A T I O N<br />
G E N E T I Q U E
MARTIEN Sebastien UMR-CNRS 8161 - Corinne ABBADIE<br />
Rôle du stress oxydant induit par les facteurs NF-kB dans la sénescence et l’émergence tumorale <strong>des</strong> cellules<br />
épithéliales<br />
Au fur et à mesure du temps et <strong>des</strong> divisions successives, les cellules primaires en culture entrent en sénescence. Deux mécanismes concourent à<br />
l’établissement du phénotype sénescent : le raccourcissement <strong>des</strong> télomères et l’accumulation de dommages oxydants. Il a été montré au laboratoire<br />
que les facteurs Rel/NF-kB étaient impliqués dans la survenue de la sénescence <strong>des</strong> cellules épithéliales via l’induction de la MnSOD. Cette enzyme<br />
dégrade les anions superoxy<strong>des</strong> (O2 -) en peroxyde d’hydrogène (H2O2), dont l’accumulation induit un stress oxydant qui contribue à l’établissement<br />
du phénotype sénescent.<br />
La sénescence est généralement considérée comme une barrière au développement tumoral, principalement parce qu’il a été décrit qu’au plateau de<br />
sénescence les cellules sont arrêtées dans le cycle cellulaire de façon irréversible. Cependant, il a été observé, notamment au laboratoire avec <strong>des</strong><br />
cultures de kératinocytes et de cellules épithéliales mammaires, qu’un petit nombre de cellules présentant <strong>des</strong> caractères transformés est capable<br />
d’émerger spontanément à partir de cellules sénescentes. Cette émergence in vitro pourrait constituer un modèle d’étude <strong>des</strong> mécanismes initiaux de<br />
tumorigenèse. En effet, contrairement aux cellules épithéliales, les fibroblastes sont incapables d’une telle émergence, ce que l’on peut corréler avec le<br />
fait que les carcinomes ont une incidence élevée et liée à l’âge, alors que les sarcomes sont beaucoup plus rares et surviennent à un âge moins<br />
avancé.<br />
Notre objectif est d’étudier les mécanismes moléculaires à l’origine de cette émergence prétumorale et en particulier l’implication <strong>des</strong> activités Rel/NFkB<br />
et MnSOD. Nous avons d’ores et déjà montré que le stress oxydant résultant de l’augmentation de ces activités Rel/NF-kB et MnSOD au cours de la<br />
sénescence était impliquée dans l’émergence. En effet, dans les kératinocytes, l’inhibition de l’activité Rel/NF-kB ainsi que l’addition de catalase,<br />
<strong>des</strong>tinée à empêcher l’accumulation de H2O2, diminuent la fréquence d’émergence. Dans les fibroblastes, malgré une activité Rel/NF-kB stable au<br />
cours du temps, l’activité MnSOD et le niveau d’espèces réactives de l’oxygène (ROS) augmentent à la sénescence. Cependant, la culture de<br />
fibroblastes en présence de catalase ou d’autres antioxydants ne retarde pas la survenue de la sénescence <strong>des</strong> fibroblastes. Dans les kératinocytes,<br />
certains dommages oxydants (ponts amino-imino-propènes) sont accumulés principalement au niveau <strong>des</strong> noyaux ; dans les fibroblastes, ces<br />
dommages sont principalement observés au niveau cytoplasmique. A l’inverse, <strong>des</strong> micronoyaux (un signe d’altérations chromosomiques) et <strong>des</strong> foyers<br />
d’histones H2AX phosphorylées (réponse aux cassures double brin de l’ADN) sont beaucoup plus fréquemment observés dans <strong>des</strong> fibroblastes<br />
sénescents que dans <strong>des</strong> kératinocytes. De même, à l’aide d’une technique de FISH utilisant une sonde spécifique <strong>des</strong> télomères, nous avons pu<br />
montrer une érosion importante <strong>des</strong> télomères lors de la sénescence <strong>des</strong> fibroblastes, alors que dans les kératinocytes, cette érosion est beaucoup<br />
moins importante.<br />
Ainsi, lors de la sénescence <strong>des</strong> kératinocytes, les facteurs Rel/NF-kB, via la MnSOD, induiraient <strong>des</strong> dommages oxydants, en particulier au niveau du<br />
noyau, qui pourraient avoir <strong>des</strong> effets mutagènes favorisant l’émergence de cellules transformées à partir de cellules possédant <strong>des</strong> télomères encore<br />
assez longs pour autoriser une reprise de prolifération. Dans les fibroblastes, les dommages oxydants à l’ADN seraient insuffisants pour être<br />
mutagènes et l’important raccourcissement <strong>des</strong> télomères induirait <strong>des</strong> altérations chromosomiques et un arrêt irréversible dans le cycle, incompatible<br />
avec une émergence.<br />
Mot(s)-clé(s) : sénescence & stress oxydant & NF-kappaB & tumorigenèse<br />
VINCENT Audrey U560 - Isabelle VAN SEUNINGEN<br />
Régulation épigénétique <strong>des</strong> gènes de mucines 11p15 (MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6) dans les cancers<br />
épithéliaux<br />
Les gènes de mucines humaines 11p15 (MUC2, MUC5AC, MUC5B, MUC6) sont organisés en un cluster sur le chromosome 11 dans une région riche<br />
en CpG et soumise à de nombreux phénomènes de régulation par méthylation dans les cancers. Les gènes de mucines codent <strong>des</strong> protéines sécrétées<br />
de haute masse moléculaire fortement glycosylées qui participent à la formation du mucus. Le mucus est indispensable à une protection efficace de<br />
l’épithélium sous-jacent face à <strong>des</strong> agressions variées selon la muqueuse considérée (trachéobronche, œsophage, estomac, intestin, voies génitales).<br />
La composition du mucus est d’ailleurs spécifique de chacune de ces muqueuses, ce qui implique une régulation fine <strong>des</strong> gènes de mucines.<br />
La répression de l’expression <strong>des</strong> gènes MUCs dans certains cancers épithéliaux nous a amenée à étudier leur profil d’expression dans un large panel<br />
de lignées cellulaires cancéreuses d’origines épithéliales variées. Nous avons évalué le taux de méthylation <strong>des</strong> gènes et l’état chromatinien (degré<br />
d’acétylation <strong>des</strong> histones) par l’utilisation d’agents chimiques spécifiques (5-aza-2’-désoxycytidine, trichostatine A) dans les cellules en phase<br />
proliférative et en phase stationnaire. Nous avons ensuite étudié le degré de méthylation <strong>des</strong> sites CpG au sein <strong>des</strong> promoteurs <strong>des</strong> quatre gènes du<br />
cluster par les techniques de « Methylation specific-PCR » et de séquençage d’ADN traité par le bisulfite. Les modifications <strong>des</strong> histones (acétylation,<br />
méthylation) ont été analysées par immunoprécipitation de chromatine (ChIP).<br />
Les résultats montrent que MUC2 et MUC5B sont les deux gènes les plus soumis à régulation par méthylation et désacétylation <strong>des</strong> histones.<br />
L’inhibition de l’expression de MUC2 par méthylation est cytosine-spécifique tandis que la répression de MUC5B dépend de l’hyperméthylation d’une<br />
vaste région distale de son promoteur. Cette régulation par méthylation est cellule-spécifique, dépend de l’état de différenciation de la cellule et, dans la<br />
plupart <strong>des</strong> cas, est étroitement associée à la désacétylation <strong>des</strong> histones. En revanche, les phénomènes épigénétiques n’interviennent que<br />
partiellement, ou indirectement, dans la régulation de MUC5AC et ne semble pas intervenir pour MUC6. Enfin, malgré leur regroupement en cluster, les<br />
quatre gènes de mucines 11p15 ne semblent pas régulés de manière concertée.<br />
Mot(s)-clé(s) : Mucines, méthylation, acétylation, cancer<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Régulation génétique" (2) - 15h00 à 16h
DEGERNY Cindy UMR8117 - Jean-Luc BAERT<br />
Sumoylation et répression de l’activité transcriptionnelle de ERM<br />
ERM est un facteur de transcription de la famille ETS appartenant au groupe PEA3. Ce groupe est composé de trois protéines apparentées (ERM,<br />
ER81 et PEA3) qui sont impliquées dans la morphogenèse <strong>des</strong> organes se développant via <strong>des</strong> interactions épithélio-mésenchymateuses et jouent un<br />
rôle dans le cancer mammaire, principalement dans le processus métastatique. En particulier, ces facteurs de transcription activent l’expression de<br />
gènes codant certaines métalloprotéases et molécules d’adhérence intervenant dans le processus invasif. Ces protéines sont de faibles activateurs<br />
transcriptionnels. Leur activation dépend de l’assemblage avec <strong>des</strong> co-facteurs transcriptionnels et de modifications post-traductionnelles telles que la<br />
phosphorylation et l'acétylation. D’autres modifications post-traductionnelles affectent ERM. Ainsi, la mise en évidence récente d’une interaction entre<br />
ERM et Ubc9, la seule enzyme connue de conjugaison de SUMO, a suggéré que ERM pouvait être sumoylé. La sumoylation est en fait la conjugaison<br />
d’une protéine SUMO (Small Ubiquitin-related MOdifier) sur <strong>des</strong> lysines de la protéine cible. Les lysines cibles appartiennent à une séquence<br />
consensus YKXE (Y acide aminé hydrophobe). Cette modification post-traductionnelle emprunte une voie enzymatique analogue à celle de<br />
l’ubiquitination. Toutefois, à la différence de celle-ci, la conjugaison de SUMO ne conduit pas à la dégradation de la protéine modifiée mais influence<br />
certaines de ses propriétés comme sa localisation subcellulaire, la stabilité de ses interactions et son activité transcriptionnelle. La sumoylation joue<br />
donc un rôle clé dans la régulation de l'activité <strong>des</strong> facteurs de transcription qui en sont la cible.<br />
ERM interagit avec Ubc9 et possède en outre cinq lysines situées dans une séquence consensus de sumoylation. Les expériences que nous avons<br />
menées in vitro et ex vivo ont montré que la protéine est sumoylée sur 4 de ces sites. Pour évaluer l’impact de la sumoylation sur l’activité<br />
transcriptionnelle de ERM, nous avons muté les lysines cibles de la sumoylation ou l’acide glutamique du site consensus afin de générer <strong>des</strong> formes<br />
non sumoylables du facteur de transcription. Sur <strong>des</strong> promoteurs répondant à ERM, ces mutants non sumoylables ont une activité supérieure à celle de<br />
la protéine sauvage, suggérant un rôle inhibiteur de la sumoylation. De plus, la surexpression de protéines inhibant la voie de conjugaison de SUMO<br />
endogène conduit à une augmentation de l’activité transcriptionnelle de ERM. L’ensemble de ces résultats démontre que la sumoylation conduit à la<br />
répression de l’activité transcriptionnelle du facteur de transcription. Cette répression n’est liée ni à un défaut de localisation cellulaire, ni à une<br />
diminution de la fixation à l’ADN de la protéine. Nous recherchons actuellement les mécanismes de répression mis en jeu par la sumoylation ainsi que<br />
les voies de signalisation impliquées dans la régulation de la sumoylation de ERM.<br />
Mot(s)-clé(s) : sumoylation, transcription, famille ETS<br />
ROGEE Sophie U 817 - Jean-Claude d'HALLUIN<br />
Biodistribution et mécanisme d'infection d'un vecteur adénoviral portant <strong>des</strong> fibres chimériques<br />
Les vecteurs dérivés <strong>des</strong> adénovirus du sous-groupe C sont largement utilisés en thérapie génique. Néanmoins, ceux-ci provoquent chez l'Homme une<br />
importante toxicité hépatique et induisent une forte réponse immune. Un moyen pour pallier ces problèmes consiste à modifier le tropisme <strong>des</strong><br />
adénovirus. Pour cela, un vecteur portant <strong>des</strong> fibres chimériques constituées de l'extrémité Nterminale d'un adénovirus humain et l'extrémité Cterminale<br />
d'un adénovirus bovin : HAdV2/BAdV-4 a été construit au sein de notre équipe. La biodistribution de ce vecteur chez la souris et la réponse immune ont<br />
été étudiées. In vivo, la présence réduite de ce vecteur au niveau du foie à 24 heures post-injection, suppose une élimination plus rapide par cet<br />
organe. De plus, le dosage d'IL6 ou d'IFNgamma montre une induction amoindrie de la réponse inflammatoire par HAdV2/BAdV-4 par rapport au virus<br />
sauvage. De même, la neutralisation de l'adénovirus chimérique par <strong>des</strong> sérums humains est plus faible.<br />
Parallèlement, la voie d'endocytose de HAdV2/BAdV-4 a été étudiée sur <strong>des</strong> cellules permissives à ce vecteur : les CHO hCAR négatives. Notre<br />
analyse montre que le virus modifié utilise principalement la voie <strong>des</strong> cavéoles pour infecter la lignée cellulaire CHO. L'utilisation de cette voie permet<br />
probablement à HAdV2/BAdV-4, comme cela a été démontré pour le SV40, de transférer son génome directement vers le noyau évitant ainsi sa<br />
dégradation par les lysosomes.<br />
En réduisant l'induction de la réponse inflammatoire et en empruntant la voie <strong>des</strong> cavéoles, le transfert du vecteur adénoviral vers <strong>des</strong> cellules cibles<br />
sera amélioré et ainsi permettre une meilleure expression du transgène. Par conséquence, HAdV2/BAdV-4 pourrait servir de modèle à l'élaboration de<br />
nouveaux vecteurs chimériques ciblant <strong>des</strong> récepteurs spécifiquement internalisés par la voie <strong>des</strong> cavéoles.<br />
Mot(s)-clé(s) : adénovirus modifié & biodistribution & endocytose & réponse immune<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Régulation génétique" (6) - 15h00 à 16h
PEIXOTO Paul U 817 - Amélie LANSIAUX<br />
Ciblage de l'ADN par <strong>des</strong> petites molécules et modulation de la fixation <strong>des</strong> partenaires protéiques<br />
L’éventail thérapeutique utilisé actuellement en chimiothérapie anti-tumorale fait appel à <strong>des</strong> molécules qui possèdent un indice thérapeutique limité dû<br />
tout particulièrement à leur faible sélectivité d’action. C’est pourquoi nous souhaitons développer au laboratoire de nouvelles approches qui guideraient<br />
la conception de nouveaux agents anti-tumoraux plus sélectifs. Cette approche s’intègre dans un « <strong>des</strong>ign » rationnel de ligands de l’ADN qui<br />
inhiberaient l’expression de certains gènes. Les dérivés DB, que nous avons retenus pour cette étude, sont <strong>des</strong> molécules se fixant sur <strong>des</strong> séquences<br />
spécifiques riches en paires de bases AT, tandis que d’autres reconnaissent <strong>des</strong> séquences beaucoup plus originales contenant <strong>des</strong> paires de<br />
bases GC comme la séquence ATGA.<br />
C’est à la fin <strong>des</strong> années 70 que six oncogènes parmi les premiers décrits ont été identifiés comme étant <strong>des</strong> facteurs de transcription. Leur<br />
dysfonctionnement est impliqué dans de nombreux cancers. La compréhension <strong>des</strong> mécanismes de régulation <strong>des</strong> facteurs de transcription apparaît<br />
donc essentielle pour le traitement de ce type de pathologie. Certains facteurs de transcription sont surexprimés ou exprimés sous forme d’une protéine<br />
de fusion dans de nombreux cancers. C’est notamment le cas du facteur de transcription Hox-A9, une protéine à homéodomaine, responsable de la<br />
diversité morphogénétique et dont la surexpression est associée à de nombreuses leucémies. Il a été montré que ce facteur de transcription est<br />
impliqué dans <strong>des</strong> translocations comme la t(7;11) aboutissant à l’expression de la protéine chimérique Nup98/Hox-A9 responsable de certaines<br />
leucémies myéloï<strong>des</strong> aiguës et chroniques. L’activité de liaison à l’ADN constitutive de cette protéine de fusion est responsable du phénotype<br />
transformant. Au niveau fonctionnel la protéine Hox-A9 se dimérise avec la protéine PBX pour former un hétérodimère reconnaissant une séquence<br />
contenant le motif ATGA.<br />
Ainsi, le ciblage spécifique de la séquence consensus de fixation de Hox-A9 à l’ADN permettrait de lever son pouvoir transformant. Le site consensus<br />
de liaison à l’ADN de Hox-A9 comportant un site ATGA, nous avons envisagé l’inhibition de la reconnaissance de ce facteur de transcription à sa cible<br />
par nos petites molécules.<br />
Pour cela, la sélection de dérivés les plus intéressants en terme de sélectivité de séquence et d’affinité pour l’ADN à été effectuée par différentes<br />
approches physicochimiques et biochimiques. Par la suite, l’utilisation de protéines exprimées en lysats de réticulocytes a montré l’inhibition de la<br />
fixation de la protéine par nos dérivés. Pour terminer, les conséquences cellulaires de cette inhibition ont été abordées en utilisant pour modèle <strong>des</strong><br />
cellules progénitrices de moelle osseuse transformées par le gène Hox-A9. Le traitement de ces cellules par notre composé a montré une forte action<br />
cytotoxique, probablement liée à la levée de la capacité de liaison à l’ADN de la protéine Hox-A9.<br />
Mot(s)-clé(s) : petites molécules & DNA binding & modulation & facteurs de transcription<br />
PENEL Nicolas EA 2694 - Yazdan YAZDANPANAH<br />
Infections nosocomiales en cancérologie: évaluation de l’incidence, <strong>des</strong> facteurs de risque, <strong>des</strong> conséquences<br />
économiques et mise en place d’action préventive.<br />
Introduction : Les infections nosocomiales les plus fréquentes en cancérologie sont : les infections de voies veineuses centrales (ILC) et les infections<br />
du site opératoire (ISO). Dans la population générale, leurs caractéristiques sont bien connues. En revanche, en cancérologie, la littérature est pauvre.<br />
Notre objectif est de mieux connaître leurs caractéristiques épidémiologiques (incidence, facteurs de risque) et leurs conséquences économiques afin<br />
de mettre en place <strong>des</strong> mesures préventives adaptées.<br />
Métho<strong>des</strong> : Nous avons choisi 3 modèles : ISO après chirurgie carcinologique mammaire (classée chirurgie propre), ISO après chirurgie carcinologique<br />
cervico-faciale « lourde » (classée propre contaminée) et ILC précoces.<br />
Pour chacun de ces modèles, <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> prospectives unicentriques (Centre Oscar Lambret) ont été réalisées (1421 patients différents).<br />
L’incidence puis les facteurs de risque sont identifiés par <strong>des</strong> régressions logistiques multivariés.<br />
Pour les ISO en chirurgie carcinologique cervico-faciale lourde, étant donné leur fréquence, nous avons évalué leur impact économique en terme de<br />
coût médical direct (méthode de macro-costing réalisé de point de vue de l’hôpital) puis analyser à partir d’un modèle de Cox l’impact de ces infections<br />
sur la durée d’hospitalisation.<br />
Concernant les ISO en chirurgie carcinologique mammaire, les facteurs de risque étant identifiés, nous avons mis en place une mesure prophylactique<br />
puis évalué son impact par une étude avant après.<br />
Résultats : Infections précoces <strong>des</strong> voies veineuses centrales.<br />
L’incidence estimée est de 14/371 (3.7% 95%-IC 1.8-5.7). Les deux facteurs de risque observés le jour de la pose sont, en analyse multivariée : age<br />
inférieur à 18 ans (OR 14.4 [1.9-106.7]) et difficultés durée l’insertion (OR 25.6 [4.2-106.0]). Un arbre de décision permet de présenter les incidences<br />
observées en fonction de ces facteurs de risque. Une stratégie préventive est proposée selon le risque.<br />
Infections du site opératoire en chirurgie carcinologique mammaire.<br />
Deux étu<strong>des</strong> prospectives sont réalisées successivement. La première permet d’estimer l’incidence <strong>des</strong> ISO à 19/542 (3.5% [1.9-5.05]) et d’identifier en<br />
analyse multivariée 2 facteurs de risque : antécédents de chimiothérapie (OR = 3.5 [1.4-8.7]) et reconstruction immédiate (OR= 4.4 [1.8-11]). De fait,<br />
nous avons mis en place une mesure prophylactique (antibioprophylaxie) sur la population à haut risque. L’impact de cette intervention a été mesurée<br />
dans la seconde étude, où le taux d’ISO observé est de 2/247 (0.8% [0.0-1.8]). Le risque d’ISO est réduit de 87%. Ce bénéfice est conservé après prise<br />
en compte <strong>des</strong> facteurs de confusion (paramètres significativement différents au sein <strong>des</strong> 2 cohortes de patients) dans un modèle de régression<br />
logistique.<br />
Infections du site opératoire en chirurgie carcinologique cervico-faciale lourde.<br />
Leur incidence est estimée à 95/261 (36.4%). Le seul facteur de risque apparaissant en analyse multivariée est la laryngectomie (OR=1.9 IC95% [1.4-<br />
2.2]). Etant donné l’importance de l'incidence, nous avons mesuré l’impact économique de ces ISO. Les patients avec ISO ont une durée médiane<br />
d’hospitalisation de 35 jours (±26) contre 19 jours (±9) pour ceux sans ISO (p=6.2 10-8) ; ceci entraîne un surcoût médical direct moyen évalué à 17<br />
000€. Nous avons donc analysé les paramètres influençant la durée de séjour en chirurgie carcinologique cervico-faciale lourde. L’analyse de Cox a<br />
identifié 3 paramètres : le mauvais état général (1.68 [1.53-1.83]), les ISO (2.59 [2.44-2.74]) et les pneumopathies post-opératoires (1.60 [1.40-1.80]).<br />
Conclusions : Ce travail a permis d’établir l’incidence et les facteurs de risque <strong>des</strong> infections nosocomiales en cancérologie dans 3 modèles. Il a<br />
permis d’estimer les surcoûts induits et de proposer <strong>des</strong> stratégies préventives.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cancer & Epidémiologie analytique et évaluative & Evaluation économique & Infections nosocomiales<br />
6 ème Journée André VERBERT session orale "Régulation génétique" (6) - 15h00 à 16h
6ème Journée André VERBERT<br />
Sessions<br />
POSTERS
ADAM Estelle U416 - Philippe LASSALLE<br />
Endocan, ou ESM-1 (Endothelial cell Specific Molecule-1) est surexprimé dans <strong>des</strong> cellules humaines de<br />
glioblastomes<br />
Les glioblastomes sont <strong>des</strong> tumeurs de très mauvais prognostic et sont caractérisés par une très forte vascularisation VEGF dépendante. Endocan, ou<br />
ESM-1 (Endothelial cell Specific Molecule-1), est un protéoglycane circulant de type dermatan sulfate, initialement décrit dans <strong>des</strong> cellules<br />
endothéliales. Dans ce travail, nous avons étudié l’expression d’Endocan dans <strong>des</strong> lignées cellulaires de glioblastomes humains ainsi que sur <strong>des</strong><br />
coupes de tissus issues de tumeurs cérébrales. Les deux isoformes connues d’Endocan ont été identifiées dans ces lignées cellulaires par RT-PCR, et<br />
la sécrétion de la protéine a été démontrée par dosage ELISA. Nous avons également montré que la sécrétion d’Endocan était régulée in vitro par <strong>des</strong><br />
facteurs pro-inflammatoires tels que le TNF-a, et par <strong>des</strong> facteurs angiogéniques comme le FGF-2. Nous avons également montré que la sécrétion<br />
d’Endocan pouvait être corrélée avec le grade de la tumeur, puisque Endocan est exprimé dans <strong>des</strong> cellules de glioblastomes U118MG (haut grade)<br />
mais n’est pas exprimé dans <strong>des</strong> cellules d’astrocytomes CCF-STTG1 (bas grade). Ces résultats ont été confortés par l’étude de coupes de tumeurs<br />
cérébrales par immunohistologie à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-Endocan. Nos résultats montrent qu’Endocan est exprimé au niveau <strong>des</strong><br />
vaisseaux sanguins localisés dans la zone corticale péri-tumorale mais pas du tout au niveau <strong>des</strong> vaisseaux sanguins du cortex sain. Endocan a<br />
également été détecté dans le cytoplasme <strong>des</strong> cellules tumorales, et ceci dans tous les cas étudiés de glioblastomes de haut grade. Par contre, aucun<br />
astrocytome étudié n’a présenté de marquage anti-Endocan. En conclusion, nous avons montré pour la première fois que l’expression d’Endocan n’est<br />
pas seulement limitée au compartiment endothélial. Elle apparaît également liée à la progression tumorale dans les cas de glioblastomes.<br />
Mot(s)-clé(s) : Endocan & glioblastomes & angiogenèse<br />
ALLART Laurent EA3614 - Mohamed LEMDANI<br />
Mise au point d'une station d'acquisition et de gestion de connaissances.<br />
La médecine, à l'instar <strong>des</strong> la bio-informatique, devient un domaine où le recueil de données gènère une quantité de plus en plus importantes<br />
d'informations qu'il est nécessaire d'une part de stocker et d'autre part de manipuler. Dans le cadre du projet ISIS débuté en avril 2005, nous mettons<br />
au point un outil d'aide à la décision dans le domaine <strong>des</strong> soins intensifs. Ce projet est une collaboration entre notre laboratoire et le service de<br />
réanimation polyvalente du CHR de Fort de France.<br />
Cet outil, nommé Aiddiag, n'est pas qu'une simple station de recueil mais également un outil de gestion de base de connaissances et d'évaluation de la<br />
pratique médicale (permettant notamment une évaluation du coût total de la prise en charge).<br />
Les connaissances sont issues de l'expertise médicale et contribuent à l'amélioration de l'aide au diagnostic. L'élaboration d'une connaissance implique<br />
plusieurs étapes : la modélisation, la validation et l'exploitation. Pour la modélisation, nous utilisons le formalisme Think! développé, en interne, par<br />
notre équipe de recherche. Une fois modélisée, la connaissance est validée par son application sur <strong>des</strong> données précédement recueillies (offline) ainsi<br />
que sur <strong>des</strong> patients actuellement hospitalisés (phase de pré-exploitation). Si la connaissance se comporte correctement face aux données réelles, elle<br />
est alors incorporée à la station Aiddiag. Dans le cas contraire, elle est modifiée pour être à nouveau validée. L'utilisation de base de connaissances<br />
permet, par exemple, la mise au point d'alarmes plus évoluées que celles disponibles sur les appareils bio-médicaux actuellement utilisés par les<br />
équipes soignantes.<br />
Le station essaie, dans la mesure du possible, d'acquirir un maximun d'informations sans l'intervention du personnel soignant. Elle utilise les protocoles<br />
de communication propre à chaque appareil bio-médical. Cependant, cela n'est pas toujours possible. Aiddiag offre donc un ensemble d'interfaces<br />
graphiques <strong>des</strong>tinées à la saisie <strong>des</strong> informations telles que les soins pratiqués sur le patient. L'ensemble de ces données va permettre d'effectuer un<br />
suivi de protocoles de soins dont les implications sont autant médicales que médico-économiques.<br />
Notre travail s'est actuellement axé sur la partie acquisition <strong>des</strong> informations : données issues <strong>des</strong> appareils bio-médicaux, développement <strong>des</strong><br />
interfaces graphiques de visualisation <strong>des</strong> données et de saisie <strong>des</strong> informations non disponibles sur les appareils bio-médicaux. Nous travaillons<br />
maintenant sur l'élaboration <strong>des</strong> bases de connaissances qui vont, dans un proche avenir, faire évoluer la station vers un outil de surveillance du patient<br />
et d'aide à la décision.<br />
Enfin, le dernier objectif de notre travail, et plus généralement du projet ISIS, est de mettre à la disposition <strong>des</strong> communautés scientifique et médicale<br />
une base d'informations de données médicales documentées.<br />
Mot(s)-clé(s) : gestion de connaissances & recueil de données & suivi de protocole<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
AMNIAI Latiffa U416 - Benoît WALLAERT<br />
INHIBITION D’UNE REACTION PULMONAIRE ALLERGIQUE ETABLIE PAR UN BCG PRODUISANT DE L’IL-18<br />
Ces dernières années ont vu l’augmentation de la prévalence <strong>des</strong> pathologies allergiques en même temps qu’une diminution <strong>des</strong> infections<br />
microbiennes dans les pays industrialisés. L’hypothèse de l’hygiène suggère que ces deux phénomènes sont liés : la stimulation microbienne au cours<br />
de la petite enfance permettrait le développement de mécanismes de régulation conduisant à un état de tolérance vis-à-vis d’antigènes inoffensifs de<br />
l’environnement. Dans ce contexte il a été montré que <strong>des</strong> mycobactéries comme le Bacille de Calmette et Guérin (BCG) et Mycobacterium vaccae<br />
étaient capables de moduler la réponse pulmonaire allergique dans <strong>des</strong> modèles murins. Afin d’augmenter les propriétés immunomodulatrices du BCG,<br />
nous avons construit un BCG recombinant produisant de l’IL-18 (BCG-IL-18). L’IL-18 est une cytokine dont le rôle dans la réaction allergique est<br />
complexe : activateur ou inhibiteur selon l’environnement en cytokines.<br />
Le but de notre travail a été d’évaluer l’effet curatif du BCG-IL-18 sur la réaction allergique pulmonaire dans un modèle murin.<br />
Les souris ont été sensibilisées à l’ovalbumine (OVA) par deux injections intrapéritonéales d’OVA et d’alum (jours (J) 0 et 10). Pour que la réaction<br />
allergique s’installe au niveau pulmonaire, ces souris ont ensuite été soumises à <strong>des</strong> aérosols d’OVA (J21 à 23). Pour évaluer l’effet du BCG-IL-18,<br />
celui-ci a été administré par voie intra-trachéale, en comparaison du BCG non recombinant (J24). L’effet du traitement a été analysé sur différents<br />
paramètres de la réaction allergique : l’hyperréactivité bronchique (HRB), l’inflammation pulmonaire dans le tissu et le lavage broncho-alvéolaire (LBA),<br />
la production de cytokines dans le LBA et les taux d’IgE sériques.<br />
Nous avons montré que les souris sensibilisées n’ayant reçu aucun traitement développaient une HRB qui était inhibée par le traitement par le BCG ou<br />
le BCG-IL-18 ; cependant, seule l’inhibition par le BCG-IL-18 était significative. Au niveau du LBA, la sensibilisation à l’OVA entraîne une augmentation<br />
du nombre d’éosinophiles et du taux d’IL-5. Comme pour l’HRB, cette inflammation était inhibée par le BCG et le BCG-IL-18. Du point de vue<br />
histologique, au niveau du poumon, les souris non sensibilisées et non traitées avaient une production de mucus augmentée et présentaient <strong>des</strong><br />
infiltrats cellulaires. Le BCG et le BCG-IL-18 inhibaient la production de mucus mais on a observé une persistance de l’infiltrat bien que sa nature n’ait<br />
pas été déterminée. Enfin les taux sériques d’IgE totales, IgE, IgG1 et IgG2a spécifiques de l’OVA étaient augmentés par rapport aux souris non<br />
sensibilisées. Le traitement par le BCG ou le BCG-IL-18 ne modifiait pas ces taux.<br />
Cette étude montre que le BCG-IL-18 peut inhiber une réaction pulmonaire allergique établie et semble avoir un potentiel immuno-modulateur plus<br />
important que le BCG. Ce modèle d’inhibition pourrait se révéler intéressant pour étudier les mécanismes de régulation induits par un agent microbien.<br />
Plus particulièrement, nous analyserons les populations cellulaires impliquées dans cette régulation.<br />
Mot(s)-clé(s) : asthme & modèle murin & régulation<br />
ANDO Kunie U422 - Luc BUÉE<br />
Isovariants de la prolyl isomerase Pin1 dans les cerveaux de la madadie d’Alzheimer. Modification anormale<br />
dans les cerveaux de la maladie d’Alzheimer?<br />
Au cours de la maladie d’Alzheimer (MA), on retrouve une lésion caractéristique appelée Dégénérescence Neurofibrillaire (DNF). Celle-ci est<br />
caractérisée par la présence de protéines Tau hyper- et anormalement phosphorylées. Actuellement, les mécanismes qui conduisent à la DNF sont<br />
encore mal connus. Parmi les candidats qui pourraient jouer un rôle dans ces mécanismes, Pin1 semble être un candidat intéressant. En effet, <strong>des</strong><br />
travaux récents sur un modèle de souris transgéniques invalidées pour le gène PIN1 ont montré qu’une absence de Pin1 était associée au<br />
développement d’une DNF. Pin1 est une peptidyl prolyl cis/trans isomérase qui régule ses cibles par isomérisation de sites phospho Thr / phospho Ser<br />
suivies d’une Proline. Pin1 elle-même est régulée par certaines modifications post-traductionnelles (oxydation ou phosphorylation). Des étu<strong>des</strong> récentes<br />
ont montré dans la MA que la fonction de Pin1 était diminuée par <strong>des</strong> modifications post-traductionnelles comme l’oxydation.<br />
Nous avons cherché à étudier la présence d’éventuelles variations <strong>des</strong> modifications post-traductionnelles de Pin1 qui seraient associées à la maladie<br />
d’Alzheimer. Et, en particulier voir s’il existait <strong>des</strong> modifications de phosphorylation de Pin1 dans la MA.<br />
Deux sites de phosphorylation, la Ser16 et la Ser 65 ont été décrits pour réguler sa fonction. Nous avons donc cherché à savoir si la Ser16 et Ser65<br />
sont ses seuls sites de phosphorylation ou si Pin1 est régulée par phosphorylation en plusieurs sites. Nous avons trouvé que la Ser16 et la Ser65 ne<br />
sont pas les deux seules sites de phosphorylation. Pin1 serait phosphorylée sur au moins 6 sites, comme le suggère nos analyses par electrophorèse<br />
bidimensionnelle. Dans <strong>des</strong> conditions pathologiques telles que la maladie d’Alzheimer, nous avons observé une augmentation de l’isoforme monophosphorylée<br />
au niveau d’extraits cérébraux de patients mala<strong>des</strong> par rapport aux cas témoins.<br />
Nous avons également analysé les isovariants de Pin1 de souris transgéniques qui expriment la Tau humaine mutée en G272V et P301S sous le<br />
promoteur neurospécifique Thy1. Ce modèle surexprime Tau qui s’agrège dès l’âge de 6 mois. On observe que Pin1 est hypophosphorylée dans les<br />
cerveaux <strong>des</strong> souris transgéniques par rapport aux souris sauvages à l’âge de 10 mois. Comme dans les cerveaux de la MA, on a également observé<br />
une augmentation de l’isoforme mono-phosphorylée dans les extraits cérébraux de souris Tau transgéniques par rapport aux souris sauvages.<br />
Par ces travaux, nous mettons en évidence que la protéine Pin1 est régulée par phosphorylation en de nombreux sites. Or, si les modifications posttraductionnelles<br />
régulent la fonction de la protéine Pin1, une dérégulation de ces modifications serait associée à une perte de fonction de Pin1 et<br />
pourrait avoir un rôle dans le développement de la DNF.<br />
Mot(s)-clé(s) : Maladie d’Alzheimer & Pin1 & tau & phosphorylation<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
ARAFAH Sonia EMI364 - Michael MARCEAU<br />
Induction de la résistance de Yersinia pseudotuberculosis aux pepti<strong>des</strong> antimicrobiens par une carence en fer<br />
Les pepti<strong>des</strong> anti-microbiens sont largement distribués dans le monde vivant et à ce jour, plusieurs centaines de représentants ont été identifiés.<br />
Agissant sur les procaryotes, certains mycètes, virus et protozoaires, ces composés sont produits chez les mammifères par les phagocytes et <strong>des</strong><br />
cellules spécialisées <strong>des</strong> muqueuses, lieux d'entrée <strong>des</strong> microorganismes pathogènes. Ces molécules constituent donc un <strong>des</strong> premiers obstacles que<br />
doivent surmonter les agents infectieux pour coloniser un hôte. Ainsi, au cours de leur évolution, les microorganismes, en particulier ceux qui sont<br />
pathogènes pour le monde animal, ont développé <strong>des</strong> mécanismes défensifs à l'égard de ces effecteurs de l'immunité innée.<br />
Nous avons montré que lorsque Y.pseudotuberculosis - une bactérie pathogène pour le tractus digestif de l'homme et de nombreux animaux- est<br />
cultivée dans un milieu carencé en ions ferriques, sa survie en présence d'un peptide anti-bactérien, la polymyxine B, est significativement augmentée.<br />
A l'opposé, celle de Y. enterocolitica, une espèce phylogénétiquement proche, reste inchangée dans les mêmes conditions expérimentales. Nous avons<br />
donc émis l'hypothèse que <strong>des</strong> gènes, présents uniquement chez Y. pseudotuberculosis, conféreraient à la bactérie la capacité de résister à la<br />
polymyxine B. Afin de les caractériser, nous avons construit une banque contenant dix mille fragments génomiques (obtenus aléatoirement) de Y.<br />
pseudotuberculosis, puis recherché le(s)quel(s) d'entre eux permettai(en)t l'induction d'une résistance à la polymyxine B chez Y. enterocolitica privée de<br />
fer. Par cette approche de complémentation fonctionnelle, nous avons isolé un clone recombinant de Y. enterocolitica, dont la résistance à la<br />
polymyxine B est effectivement accrue lorsque les bactéries ont été cultivées dans un environnement appauvri en fer. L'analyse de la région génomique<br />
clonée a montré l'existence de plusieurs gènes, dont trois sont nécessaires à Y.enterocolitica pour développer une résistance induite par la carence<br />
martiale : or0242 et or0243 sont organisés en opéron et codent <strong>des</strong> protéines de fonction inconnue tandis que or4966 spécifie un régulateur<br />
transcriptionnel de la famille LysR. L'implication de ces gènes a été confirmée après mutagenèse chez Y. pseudotuberculosis. Aucun gène homologue<br />
à or4966 n'a été retrouvé chez Y. enterocolitica ni même chez les autres espèces bactériennes dont la séquence génomique est actuellement<br />
accessible : ce fait tend à confirmer l'originalité du phénotype étudié. Des étu<strong>des</strong> seront menées afin de modéliser le mode intime de résistance à la<br />
polymyxine B régi par le produit de ces gènes et d 'éprouver la contribution <strong>des</strong> mécanismes étudiés dans le pouvoir pathogène de Y.<br />
pseudotuberculosis.<br />
Mot(s)-clé(s) : Yersinia pseudotuberculosis & résistance aux pepti<strong>des</strong> antimicrobiens<br />
BALLY Julia UMR 2847 CNRS/BAYER Cropsciences - Dominique JOB<br />
Etude du repliement <strong>des</strong> protéines dans le chloroplaste pour l’optimisation de la surexpression de protéines<br />
exogènes complexes.<br />
Les avancées récentes en ingénierie génétique ont permis l’expression dans les plantes de protéines exogènes à valeurs industrielles ou<br />
pharmaceutiques. Cette méthodologie autorise désormais un usage nouveau <strong>des</strong> plantes, pour la production de molécules à usage thérapeutique, se<br />
substituant ainsi à d’autres systèmes d’expression, aux synthèses chimiques ou à l’extraction de substances issues d’organes humain ou animaux. La<br />
production de protéines dans les plantes représente une alternative attractive par rapport à d’autres systèmes d’expression, notamment grâce à la<br />
transformation chloroplastique. Cette dernière technique permet la production de protéines en quantités importantes, et contourne aussi <strong>des</strong> problèmes<br />
tels que la pollinisation croisée avec l’environnement végétal non génétiquement modifié.<br />
Cependant, la plupart <strong>des</strong> protéines recombinantes nécessitent <strong>des</strong> modifications post-traductionnelles qui peuvent faire défaut dans les chloroplastes,<br />
système d’expression de type bactérien, comme la glycosylation ou potentiellement la formation de ponts disulfures. Ces mécanismes sont très bien<br />
décrits pour les levures, les bactéries et les cellules animales, mais les connaissances relatives au repliement <strong>des</strong> protéines dans les cellules végétales<br />
sont assez pauvres et spécialement en ce qui concerne les chloroplastes.<br />
La transformation du génome chloroplastique a été achevée seulement pour un petit nombre d’espèces, ainsi, il y a actuellement dans la littérature peu<br />
d’exemples de protéines contenant <strong>des</strong> ponts disulfures qui aient été exprimées avec succès dans les chloroplastes. Toutefois, même pour ces<br />
exemples, il n’est toujours pas démontré si les ponts disulfures sont correctement formés, et si ces ponts se sont formés in planta ou spontanément<br />
durant l’extraction. Aussi, le réel potentiel du chloroplaste pour l’expression et l’accumulation <strong>des</strong> protéines contenants <strong>des</strong> ponts disulfures mérite d’être<br />
clarifié.<br />
Pour étudier le mécanisme de conformation <strong>des</strong> protéines exogènes au sein du chloroplaste, nous avons choisi d’exprimer dans cet organite<br />
la phosphatase alcaline bactérienne (PhoA), une protéine contenant <strong>des</strong> ponts disulfures nécessaires pour sa stabilité et son activité et originellement<br />
exprimée chez les bactéries dans le périplasme. Pour obtenir une expression élevée de l’enzyme cible, son gène a été introduit directement dans le<br />
génome chloroplastique de plantes de tabacs. Nous montrerons à travers cette étude que la phosphatase alcaline peut-être correctement formée et<br />
active dans le chloroplaste. Les travaux effectués seront discutés en regard avec ceux obtenus lors de l’expression de la protéine dans les systèmes<br />
bactériens.<br />
De telles étu<strong>des</strong> pourraient clarifier les mécanismes de repliement de protéines recombinantes exprimées dans les chloroplastes utilisés comme outils<br />
de production, ce qui pourrait être un intérêt majeur pour les applications du « molecular farming ».<br />
Mot(s)-clé(s) : transformation chloroplastique & repliement <strong>des</strong> protéines<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
BIGGIO Valeria U524 - Claude PREUDHOMME<br />
La quantification de l’expression de certains gènes comme facteur de pronostic dans la LAM à caryotype normal<br />
de l’adulte<br />
Les patients LAM à caryotype normal représentent un groupe hétérogène, considéré comme à risque intermédiaire. Des anomalies génétiques comme<br />
les mutations de certains gènes (CEBPa, FLT3/ITD, MLL/PTD) ou la différenciation d’expression d’autres gènes (EVI1, BAALC) nous permet de mieux<br />
préciser le pronostic de ce type de leucémie. Dans une étude rétrospective incluant 120 patients LAM à caryotype normal, on a évalué la contribution<br />
globale au pronostic de l’expression de 7 gènes, tous individuellement déjà rapportés associés à la survie <strong>des</strong> patients : BAALC, EVI1, FLT3, HOXA9,<br />
TGIF1 et TRIM16. La quantification de l’expression de ces gènes a été réalisée par real-time PCR, (TBP étant le gène de référence).<br />
FLT3/ITD a été retrouvé chez 38/120 patients (32%), Les mutations de CEBPa chez 20/120 patients (17%) et MLL/PTD chez 3/120 patients (3%). La<br />
récente mutation de NPM a été mise en évidence chez 47% <strong>des</strong> patients examinés (50/106). Un premier cluster hiérarchique non supervisé a mise en<br />
évidence 4 subgroupes de patients : 1) un groupe (n=13) avec une faible expression de HOXA9, composé en majorité de patients muté CEBPa (66%)<br />
avec un pronostic favorable; 2) un second groupe (n=18) avec une forte expression de EVI1, un faible pourcentage de mutation récurrent et un<br />
pronostic défavorable ; 3-4) deux groupes (n=29 et 60) avec une haute fréquence de mutations NPM (70 et 56%) et un pronostic intermédiaire. La<br />
survie globale est significativement différente dans les 4 groupes (p=.03). Dans un deuxième approche, on a considéré l’apport pronostic individuelle<br />
de chaque gène comme aient le même pois. L’analyse du meilleur cut-off pour chaque gène, par rapport à l’OS et l’EFS, nous a permis de construire<br />
un index de risque moléculaire (MRI). Les trois class qui composent cet index (risque favorable n=31 ; risque intermédiaire, n=58 ; haute risque n=31)<br />
sont fortement prédictives sur la RC (100%, 86%, et 77% ; p=.02), l’OS (6y-OS : 70%, 40%, 14% ; p
BOISSE Thomas EA2692 - Benoît RIGO<br />
Synthèse de nouveaux analogues de luotonine A, potentiels inhibiteurs de topoisomérase I<br />
Le nombre croissant de cancers diagnostiqués ainsi que le manque de sélectivité <strong>des</strong> agents anticancéreux utilisés actuellement nécessitent la<br />
recherche de nouvelles molécules plus actives et plus sélectives.<br />
Isolée à la fin <strong>des</strong> années 1960, la camptothécine possède une activité antitumorale puissante.(1) Depuis, de nombreux analogues structuraux ont été<br />
synthétisés afin d’augmenter sa solubilité et de diminuer sa toxicité. En particulier, deux composés sont actuellement utilisés en clinique dans le<br />
traitement du cancer de l’ovaire, du colon ou du poumon (Irinotécan, Topotécan).<br />
Découvert dans les années 1980, le mécanisme d’action <strong>des</strong> camptothécines s’appuie sur l’inhibition de la topoisomérase de type I en se liant avec le<br />
complexe binaire ADN-enzyme.(2) Toute modification du cycle E de la molécule a longtemps conduit à <strong>des</strong> composés inactifs, rendant cette partie de la<br />
molécuule intouchable. Cependant, l’efficacité <strong>des</strong> homocamptothécines, où le cycle lactone est à sept chaînons, a fait tomber ce dogme. Récemment,<br />
il a été décrit que la luotonine A, qui présente un atome d’azote en position 14 et un cycle benzénique comme cycle E, inhibe la topoisomérase I.(3)<br />
Bien que dix fois moins active que la camptothécine, cette structure représente un nouveau lead pour le <strong>des</strong>ign de nouveaux inhibiteurs de l’enzyme.<br />
Plusieurs étu<strong>des</strong> se sont intéressées à établir <strong>des</strong> relations structure-activité en substituant les postions aromatiques de la molécule.(4) Cependant,<br />
presque aucune substitution de la position 5 n’a été décrite. L’objectif de ce travail est donc la synthèse de dérivés de la luotonine substitués en 5,<br />
notamment par <strong>des</strong> fonctions esters et ami<strong>des</strong>.<br />
La voie de synthèse de ces molécules a été mise au point à partir de l’acide pyroglutamique en utilisant une condensation de Friedländer comme étape<br />
finale. Nous avons ensuite validé cette synthèse par <strong>des</strong> produits également substitués sur les cycles A, B et E. Nous présenterons les différentes<br />
étapes de cette synthèse ainsi que les composés obtenus.<br />
1. Wall, M. E., et al., J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 3888-3890.<br />
2. Hertzberg, R. P., et al., Biochemistry 1989, 28, 4629-4638.<br />
3. Cagir, A., et al., J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 13628-13629.<br />
4. Ma, Z.-Z., et al., Heterocycles 2005, 65, 2203-2219.<br />
Mot(s)-clé(s) : Anticancéreux & Topoisomérase & Camptothécine & Luotonine<br />
BOUHLEL Mohamed Amine U545 - Giulia CHINETTI<br />
La régulation de l’enzyme 11b-HSD1 par les récepteurs nucléaires PPARs et son rôle dans la réponse<br />
inflammatoire.<br />
L’athérosclérose est une pathologie inflammatoire chronique à l’origine de la plupart <strong>des</strong> maladies cardiovasculaires. Elle correspond à une réaction<br />
inflammatoire de la paroi artérielle initiée par l’activation <strong>des</strong> cellules endothéliales responsables du recrutement massif de monocytes circulant. Ces<br />
monocytes se différencient en macrophages qui se chargent en lipi<strong>des</strong>, se transforment en cellules spumeuses et s’accumulent dans la paroi artérielle<br />
en formant <strong>des</strong> stries lipidiques. Ces lésions artérielles peuvent être aggravées par <strong>des</strong> facteurs de risque parmi lesquels les dyslipidémies et le diabète.<br />
Des molécules, telles que les glitazones, sont utilisées dans le traitement du diabète de type 2. Les glitazones sont <strong>des</strong> agonistes du récepteur<br />
nucléaire PPARg (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor). La famille <strong>des</strong> récepteurs nucléaires PPAR comporte trois membres : PPARa, PPARb/d<br />
et PPARg. Les agonistes de PPARg jouent un rôle anti-inflammatoire local, notamment au niveau <strong>des</strong> macrophages dérivés <strong>des</strong> monocytes en inhibant<br />
la production de molécules pro-inflammatoires telles que IL-6, TNF-a, IL-1...<br />
Grâce à une analyse du génome entier par la technique de DNA Array Affymetrix, notre laboratoire a identifié un nouveau gène régulé positivement par<br />
<strong>des</strong> agonistes synthétiques de PPARg au niveau <strong>des</strong> macrophages primaires humains différenciés, la 11b-HydroxyStéroïde Déshydrogénase1 (11b-<br />
HSD1). Ce gène code l’enzyme responsable de la conversion de la cortisone cellulaire en cortisol. Le cortisol cellulaire active les récepteurs nucléaires<br />
aux glucocorticoï<strong>des</strong> qui figurent parmi les principaux médiateurs de la réponse anti-inflammatoire. La régulation de cette enzyme exprimée par les<br />
macrophages pourraient alors contribuer à l’atténuation de la réponse inflammatoire locale et diminuer la progression <strong>des</strong> lésions d’athérosclérose.<br />
Nos travaux montrent que les agonistes synthétiques de PPARg activent l’expression génique et protéique de la 11b-HSD1 au niveau <strong>des</strong><br />
macrophages différenciés à partir de monocytes primaires humains. Cependant, l’effet <strong>des</strong> agonistes de PPARg sur l’activité enzymatique de la 11b-<br />
HSD1 ne s’est pas révélé significatif. Les monocytes primaires humains exprimant également l’enzyme 11b-HSD1, nous avons ainsi décidé d’étudier la<br />
régulation de la 11b-HSD1 par les récepteurs nucléaires au niveau <strong>des</strong> monocytes non différenciés. Les agonistes de PPARg ainsi que les agonistes de<br />
PPARa, PPARd et LXR (Liver X Receptor, un autre récepteur nucléaire activé par les oxystérols et ayant <strong>des</strong> propriétés anti-inflammatoires) se sont<br />
alors révélés <strong>des</strong> inhibiteurs efficaces de l’expression de l’ARN de la 11b-HSD1 ainsi que de son activité enzymatique au niveau <strong>des</strong> monocytes. Cette<br />
régulation devrait naturellement se traduire par une atténuation de la réponse anti-inflammatoire. Cependant, une étude récente réalisée sur <strong>des</strong><br />
monocytes humains montre que dans certaines conditions les corticostéroï<strong>des</strong> sont également dotés d’un effet pro-inflammatoire. Ainsi, l’inhibition de la<br />
11b-HSD1 pourrait se traduire par <strong>des</strong> réponses anti-inflammatoires.<br />
Les données bibliographiques montrent que les corticostéroï<strong>des</strong> perturbent la différenciation <strong>des</strong> monocytes en cellules dendritiques myéloï<strong>des</strong>. Ces<br />
cellules dendritiques sont essentiellement impliquées dans la réponse inflammatoire immune puisqu’elles constituent les principales cellules<br />
présentatrices d’antigènes.<br />
L’intérêt de cette étude réside dans l’identification d’un nouvelle voie de modulation de la réponse inflammatoire au niveau <strong>des</strong> cellules sanguine à<br />
travers la régulation de l’enzymes 11b-HSD1 par les récepteurs nucléaires. Enfin, les agonistes <strong>des</strong> PPARs auraient un champ d’action très large<br />
puisqu’ils pourraient être utilisés aussi bien dans les traitements de l’athérosclérose que dans certaines pathologies associées à <strong>des</strong> désordres<br />
immunitaires.<br />
Mot(s)-clé(s) : Inflammation - Récepteurs Nucléaires - Monocytes - Cellules dendritiques<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
BRUANDET Amelie U508 - Philippe AMOUYEL<br />
Histoire naturelle <strong>des</strong> démences vasculaires : comparaison avec la maladie d’Alzheimer et les démences mixtes.<br />
Objectifs: La démence vasculaire (VaD) est la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer (AD) mais son histoire naturelle est mal<br />
connue. L’objectif de cette étude était de comparer les caractéristiques démographiques, le déclin du MMSE et la survie chez <strong>des</strong> patients ayant une<br />
VaD, une AD ou une démence mixte (MD).<br />
Métho<strong>des</strong> : 1290 patients consécutifs ayant consulté à la clinique de la mémoire de Lille – Bailleul entre 1995 et 2001, et examinés au moins 2 fois, ont<br />
été inclus. Le statut cognitif a été mesuré avec le MMSE. Les changements du MMSE au cours du temps ont été analysés avec un modèle mixte à effet<br />
aléatoire. La survie a été étudiée avec un modèle de Cox. Les analyses ont été ajustées sur l’age, le sexe, l’éducation, le traitement par inhibiteur de<br />
l’acétylcholinesterase et le MMSE à l’inclusion. Résultats : La série était constituée de 1290 patients dont 141 VaD, 1004 AD et 145 MD. L’âge de début<br />
de la maladie et l’âge au diagnostic différaient de manière significative selon la démence (respectivement p=0,05 et p=0,006) : ils étaient plus jeunes<br />
pour les VaD (69 ±8 et 73 ±8 ans), intermédiaires pour les AD (70±8 et 74 ±8 ans) et plus âgés pour les MD (71±7 et 75±6 ans). A la première visite, la<br />
durée de la maladie (3,3±2,8 ans) ne différait pas selon la démence. Le MMSE à l’inclusion était plus élevé dans le groupe VaD (23±5, p=0,0004). Le<br />
déclin du MMSE au cours <strong>des</strong> 4 années de suivi était plus lent chez les patients VaD comparés aux patients AD ou MD (p=0,003). Le risque de décès<br />
était similaire quelque soit la démence. Conclusion: Au sein de notre série, les patients ayant une VaD, AD ou MD présentent <strong>des</strong> caractéristiques<br />
cliniques à l’inclusion et <strong>des</strong> évolutions différentes.<br />
Mot(s)-clé(s) : demence vasculaire & declin cognitif & mortalite & maladie d'Alzheimer<br />
BUYCK Julien EA 2689 - Régis MATRAN<br />
Effets de l’Exotoxine A et du LPS de Pseudomonas aeruginosa sur le calcium intracellulaire et la sécrétion de<br />
chlore <strong>des</strong> cellules épithéliale bronchique.<br />
Pseudomonas aeruginosa (PA) est un pathogène fréquemment retrouvé dans les pathologies pulmonaires qu’elles soient chroniques (mucoviscidose,<br />
CF) ou aiguës (sepsis). Il est souvent lié à l’aggravation de la pathologie pulmonaire. Ce bacille Gram– possède de nombreux mécanismes de virulence<br />
et plusieurs étu<strong>des</strong> ont montrés que PA est capable d’induire <strong>des</strong> lésions au niveau de l’épithélium respiratoire mais aussi <strong>des</strong> modifications au niveau<br />
<strong>des</strong> voies de signalisation cellulaire, au niveau génomique et au niveau <strong>des</strong> transports ioniques (Kunzelmann et al, 2004). Les lipopolysacchari<strong>des</strong><br />
(LPS) qui sont connus pour avoir <strong>des</strong> effets pro-inflammatoires sont présent sur la membrane de PA et peuvent diminuer l’absorption de sodium<br />
(Tamaoki, 1991) et l’exotoxine A, un facteur de virulence secrété, a aussi <strong>des</strong> effets sur l’absorption de fluide au niveau <strong>des</strong> bronches de rats (Pittet JF,<br />
1996). En utilisant <strong>des</strong> techniques d’imagerie de fluorescence calcique nous avons montré que le LPS (10 a 50µg/ml) stimule une augmentation<br />
maintenue du calcium intracellulaire de façon dose dépendante sur <strong>des</strong> cellules épithéliales <strong>des</strong> bronches humaines (16HBE14o-). Des<br />
expérimentations en milieu externe dépourvu de calcium indiquent que l’augmentation de calcium induite par le LPS est provoquée par une entrée<br />
massive du calcium externe. Le calcium ayant un rôle majeur dans la régulation <strong>des</strong> transports ioniques épithéliaux, nous avons étudié le rôle du LPS<br />
sur la sécrétion de chlore en utilisant la technique de chambres de Ussing en courant de court circuit (Isc). Lorsqu’on crée un gradient de chlore du coté<br />
basolatéral vers le coté apical, l’Isc basal moyen est de 37,24 +/- 2,67 µA/cm² (N=24). Nous avons montré que le LPS (50µg/ml) du coté apical était<br />
capable d’induire une augmentation transitoire de l’Isc de 7,59 +/- 1.97 µA/cm² (N=10). Cet effet du LPS n’est pas modifié par l’amiloride (Inhibiteur<br />
ENaC) ni par le NPPB, par contre le DPC et le Glybenclamide, 2 inhibiteurs <strong>des</strong> canaux chlore CFTR, abolissent totalement la réponse au LPS.<br />
Ces résultats montrent que l’effet du LPS sur le courant de court circuit serait dû à une activation du canal chlore CFTR. L’ExoA induit une<br />
augmentation transitoire de l’Isc, mais les effets <strong>des</strong> différents inhibiteurs n’ont pas encore été étudiés.<br />
Mot(s)-clé(s) : epithelium & pseudomonas aeruginosa<br />
CERTAD Gabriela EA3609 - Thérèse DURIEZ<br />
Epidémiologie moléculaire de la cryptosporidiose humaine et animale au Venezuela: caractérisation moléculaire<br />
et phénotypique <strong>des</strong> espèces et variétés infra-spécifiques du genre Cryptosporidium<br />
Introduction: Le genre Cryptosporidium comprend <strong>des</strong> espèces qui infectent l’intestin d’un grand nombre de vertébrés, y compris l'homme. Ils sont la<br />
cause de la cryptosporidiose, maladie opportuniste émergente avec un impact considérable chez les patients immunodéprimés, notamment sidéens.<br />
Ces protistes infectent aussi <strong>des</strong> sujets immunocompétents dans toutes les latitu<strong>des</strong>, et peuvent provoquer <strong>des</strong> diarrhées en général autorésolutives.<br />
De plus, la morphologie étant insuffisante à la distinction <strong>des</strong> espèces de ce genre, leur identification, qui fait appel à <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> moléculaires, est<br />
rarement pratiquée. Cependant, elle constitue le seul moyen de déterminer les sources, les voies et les mécanismes de l'infection, informations<br />
essentielles au développement de stratégies rationnelles de prévention. Les buts de cette étude sont de déterminer le génotype ainsi que les<br />
caractéristiques phénotypiques <strong>des</strong> populations parasitaires de Cryptosporidium sp. au Venezuela. Rien à propos de ces facteurs n’est connu au<br />
Venezuela où la prévalence de l'infection symptomatique ou asymptomatique par Cryptosporidium dans les écoles primaires peut dépasser 50%<br />
d'après <strong>des</strong> données récentes. Matériel et métho<strong>des</strong>: Pour l’étude génotypique <strong>des</strong> prélèvements fécaux d’origine humaine diagnostiqués positifs pour<br />
Cryptosporidium par microscopie, une PCR-RFLP ciblant l’ADNr 18S a permis la caractérisation au niveau de l’espèce de l’isolat parasitaire, puis un<br />
génotypage à <strong>des</strong> loci mini- et microsatellites, plus polymorphes, a autorisé une résolution à un niveau infra-spécifique. L’évaluation phénotypique <strong>des</strong><br />
isolats se fait d’une part in vivo, avec l’utilisation de modèles murins (inoculation de différentes espèces Cryptosporidium à <strong>des</strong> souris SCID), et d’autre<br />
part in vitro, avec <strong>des</strong> cellules épithéliales intestinales humaines (co-culture de différentes espèces de Cryptosporidium dans un système de cellules<br />
HCT-8). Résultats: Trois espèces de Cryptosporidium ont été identifiées parmi les échantillons fécaux de 10 patients vénézuéliens VIH+: 8 C. hominis,<br />
1 C. parvum, 1 C. canis. L’analyse avec les marqueurs mini- et microsatellites a révélé que les échantillons de C. hominis présentaient la même<br />
combinaison d’allèles. Ces résultats s’étoffent au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux échantillons du Venezuela. Les résultats <strong>des</strong> étu<strong>des</strong><br />
phénotypiques sont actuellement en cours et seront développés le jour de la communication.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cryptosporidium & caractérisation moléculaire et phénotypique & Venezuela<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
COQUART Jeremy EA3608 - Murielle GARCIN<br />
Influence de la durée ou de la distance attendue sur l’échelle de perception de l’effort et d’estimation du temps<br />
limite<br />
INTRODUCTION :: De nos jours, la perception de l’effort est utilisée dans <strong>des</strong> domaines aussi variés que la réhabilitation, l’entraînement ou l’éducation<br />
physique. L’échelle de cotations de la perception de l’effort (RPE), construite par Borg (1970), est l’outil le plus fréquemment utilisé pour évaluer la<br />
pénibilité de l’effort. Cependant, pour avoir <strong>des</strong> renseignements complémentaires sur le temps de maintien estimé de l’exercice, Garcin et Billat (2001)<br />
recommandent d’associer à l’échelle RPE une seconde échelle basée sur l’estimation subjective du temps limite (ETL, Garcin et al., 1999). Les valeurs<br />
de perception de l’effort, mesurées à l’aide de ces échelles, proviennent de l’interprétation de la combinaison de multiples facteurs d’ordres<br />
physiologiques, cognitifs, psychologiques ou sociologiques. Plusieurs étu<strong>des</strong> ont déjà étudié l’influence de ces facteurs sur les valeurs de RPE. Par<br />
exemple, il a été montré que la durée d’exercice attendue influençait les valeurs de RPE (Rejeski et Ribisl, 1980 ; Baden et al., 2004 ; Baden et al.,<br />
2005). Cependant, aucune étude n’a analysé l’influence de la durée ou distance attendue sur le temps limite estimé (ETL). En conséquence, l’objectif<br />
de cette étude est d’examiner l’influence de la durée ou distance de course attendues sur les valeurs de RPE et d’ETL lors de test de terrain.<br />
SUJETS : 39 hommes (âge = 24,4 ± 3,8 ans ; masse = 73,9 ± 9,1 kg ; taille = 180 ± 6,2 cm) qui courraient régulièrement ont été recrutés.<br />
MATERIEL : Les perceptions de l’effort étaient relevées grâce à l’échelle RPE (Borg, 1970) et l’échelle ETL (Garcin et al., 1999). La fréquence<br />
cardiaque (FC) était enregistrée à l’aide d’un cardio-fréquence-mètres (Accurex +, Polar®).<br />
METHODES : Chaque sujet a réalisé un test progressif et exhaustif afin de mesurer sa vitesse maximale aérobie (VMA). Ensuite, un test exhaustif à<br />
vitesse constante (90% VMA) a été réalisé pour déterminer le temps limite (Tlim) et la distance limite (Dlim) à cette intensité. A la suite de ces tests, 3<br />
groupes homogènes ont été formés. Ensuite tous les sujets ont réalisé 2 tests avec une intensité (90% VMA) et un volume (80% Tlim ou Dlim) relatifs<br />
similaires. Cependant, le volume de ces tests était exprimé soit en terme de durée soit en terme de distance. De plus, les groupes avaient <strong>des</strong><br />
consignes différentes. En effet, le groupe 1 (G1) pensait maintenir la vitesse imposée durant 60% Tlim (ou Dlim), tandis que le groupe 2 (G2) et le<br />
groupe 3 (G3) s’attendaient à maintenir leur effort pendant 80 et 100% Tlim (ou Dlim), respectivement. Durant chaque test, les valeurs de RPE, ETL et<br />
FC étaient relevées. Tous les tests ont été réalisés dans les mêmes conditions.<br />
ANALYSE STATISTIQUE : Les valeurs de RPE, ETL et FC étaient comparées à l’aide d’une analyse de la variance à 3 facteurs (Temps × Groupes ×<br />
Tests). De plus, lorsque <strong>des</strong> différences étaient obtenues, un test post-hoc de Bonferroni était réalisé.<br />
RESULTATS : Les résultats ont révélé : 1) un effet du temps sur les valeurs de RPE, ETL et FC (p < 0,01) ; 2) aucune différence significative entre les<br />
groupes pour RPE et ETL (p > 0,05) mais un effet significatif entre G1-G2 pour la FC (p < 0,02) ; 3) aucun effet du type de test (80% Tlim ou Dlim) (p ><br />
0,05).<br />
DISCUSSION : Notre étude a montré que : 1) les valeurs de RPE, d’ETL et de FC augmentaient avec la durée d’exercice ; 2) une tendance (non<br />
significative) suggérant que les sujets (G1) qui s’attendaient à une plus faible durée (ou distance) d’exercice cotent <strong>des</strong> valeurs de RPE et d’ETL plus<br />
élevées que les autres sujets (G2 et G3) (i.e., les sujets percevaient l’exercice comme étant plus dur et pensaient être moins endurants) ; 3) un effet de<br />
la consigne sur les valeurs de FC ; 4) les valeurs de perception ne semblent pas être influencées par le type de test (volume exprimé en terme de durée<br />
ou distance).<br />
Mot(s)-clé(s) : durée et distance attendue & cotations de perception de l’effort (RPE) & cotations du temps limite estimé (ETL) &<br />
téléoanticipation<br />
CORDONNIER Charlotte EA2691 - Hilde HENON<br />
Pronostic <strong>des</strong> hémorragies cérébrales parenchymateuses non malformatives (PITCH)<br />
Contexte : Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) occupent une place importante en matière de santé publique. Les AVC sont fréquents: dans une<br />
population occidentale d'un million d'habitants, 2400 nouveaux AVC surviennent chaque année. Ils sont graves: les AVC représentent la 1ère cause de<br />
handicap physique chez l’adulte, la 2ème cause de démence et la 3ème cause de mortalité chez les adultes <strong>des</strong> pays industrialisés. Les accidents<br />
ischémiques représentent environ 80% <strong>des</strong> AVC et les hémorragies cérébrales 20%.<br />
Une meilleure connaissance de la physiopathologie et l’avènement de nouveaux traitements pour la phase aiguë ont changé la prise en charge <strong>des</strong><br />
AVC. L’AVC est aujourd’hui reconnu comme une urgence. La prise en charge <strong>des</strong> AVC dans <strong>des</strong> unités spécialisées (unités neurovasculaires) a prouvé<br />
son efficacité et le traitement thrombolytique offre une option thérapeutique supplémentaire pour les infarctus cérébraux. Jusqu’à présent, la recherche<br />
sur les AVC a principalement concerné les infarctus cérébraux et les hémorragies malformatives. Peu de données sont disponibles concernant les<br />
hémorragies non malformatives. Alors que le pronostic vital et fonctionnel <strong>des</strong> infarctus cérébraux s’améliore, le pronostic <strong>des</strong> hémorragies cérébrales<br />
reste grevé d’une lourde mortalité (40 à 50%) et morbidité. L’identification précise <strong>des</strong> étiologies <strong>des</strong> hémorragies cérébrales primitives, l’identification<br />
<strong>des</strong> facteurs de risque, dont certains pourraient être modifiables, et la définition de nouvelles stratégies thérapeutiques sont indispensables. Les<br />
résultats récents de STICH, suggérant que la prise en charge <strong>des</strong> HIC est essentiellement médicale et le développement de nouveaux agents<br />
hémostatiques, potentiellement efficaces mais non dénués d’effets indésirables et extrêmement coûteux, justifient une meilleure connaissance <strong>des</strong><br />
données pronostics <strong>des</strong> HIC.<br />
Objectifs : Au sein d’une population de patients ayant eu une HIC non malformative, déterminer l'histoire naturelle <strong>des</strong> HIC non malformatives (mortalité,<br />
récidive, pronostic cognitif et épilepsie). Les objectifs secondaires sont de déterminer: les facteurs pronostics en phase aiguë avec un suivi à moyen et<br />
long terme, les mécanismes d’aggravation de l’hémorragie et la chronologie, la prévalence <strong>des</strong> microhémorragies et leur influence sur le pronostic et le<br />
risque de récidive hémorragique.<br />
Métho<strong>des</strong> : Inclusions consécutives de tous les patients de plus de 18 ans admis au CHRU de Lille pour une HIC non malformative, le diagnostic<br />
d’hémorragie cérébrale étant posé sur l’imagerie cérébrale réalisée à l’admission. Sont exclus les patients porteurs d’hémorragie liée à une<br />
malformation vasculaire ou à une tumeur. Sont également exclus les patients transférés au CHRU en deuxième intention afin d’éviter les biais de<br />
sélection. L’étude est purement observationnelle. Les patients sont ensuite suivis en consultation pendant 3 ans, comme le sont habituellement les<br />
patients ayant eu une HIC.<br />
Résultats attendus : Entre Novembre 2004 et Mai 2006, 235 patients ont été admis au CHU de Lille en 1ère intention pour une hémorragie cérébrale<br />
d’allure non malformative. Les inclusions se poursuivent avec un objectif d’une cohorte de 400 patients. L’ensemble <strong>des</strong> données recueillies devrait<br />
permettre de préciser l’étiologie <strong>des</strong> HIC non malformatives, d’en préciser les facteurs de risque et le pronostic, aidant ainsi à définir de nouvelles<br />
stratégies de prise en charge multidisciplinaire. Des données relatives au risque de démence, d’épilepsie seront également disponibles.<br />
Mot(s)-clé(s) : accident vasculaire cérébral & hémorragie cérébrale & démence & pronostic<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
DELANGLE Aurelie UMR-CNRS 8576 - Jean-Marie LACROIX<br />
Analyse protéomique d’un mutant non virulent d’Erwinia chrysanthemi, une bactérie phytopathogène : l’absence<br />
de glucanes périplasmiques osmorégulés induit <strong>des</strong> réarrangements de l’enveloppe et la réponse générale au<br />
stress.<br />
Les glucanes périplasmiques osmorégulés (OPG) sont <strong>des</strong> constituants généraux de l’enveloppe <strong>des</strong> bactéries à Gram négatif. L’absence d’OPG chez<br />
de nombreuses bactéries pathogènes pour les plantes et/ou les animaux aboutit à une forte réduction ou une perte totale de leur virulence. Erwinia<br />
chrysanthemi est une bactérie phytopathogène provoquant la pourriture molle chez un large spectre d’espèces végétales. En plus de l’absence totale<br />
de virulence, les mutants dépourvus d’OPG chez E. chrysanthemi présentent un phénotype pléiotrope incluant une diminution de la motilité et une<br />
surproduction <strong>des</strong> exopolysacchari<strong>des</strong> traduisant une forte perturbation de l’enveloppe. Une analyse protéomique comparative en électrophorèse<br />
bidimensionnelle <strong>des</strong> protéines solubles a été entreprise entre la souche sauvage et un mutant opgG. Des protéines dont l’expression est modifiée chez<br />
le mutant ont été identifiées par spectrométrie de masse. En absence d’OPG, la biosynthèse <strong>des</strong> constituants de l’enveloppe est modifiée, les protéines<br />
du métabolisme énergétique et celles nécessaires à la conformation et la dégradation <strong>des</strong> protéines sont surexprimées. Ces nouveaux phénotypes<br />
indiquent que l’absence d’OPG induit la réponse générale au stress.<br />
Mot(s)-clé(s) : bactérie phytopathogène & glucanes périplasmiques osmorégulés & enveloppe & réponse au stress<br />
DESAILLOUD Rachel EA3610 - Alain DUBREUIL<br />
Infection persistante à coxsackievirus B4E2 dans une lignée de thyrocytes<br />
Le rôle <strong>des</strong> entérovirus et notamment celui <strong>des</strong> coxsackievirus B4, virus nus à ARN positif, dans la pathogenèse du diabète de type 1 est suspecté. Il<br />
est fréquent d’observer chez les patients diabétiques de type 1 une thyroïdite lymphocytaire chronique. Dans ce contexte, nous avons émis l’hypothèse<br />
du rôle <strong>des</strong> virus dans la survenue de l’auto-immunité thyroïdienne associée au diabète de type 1<br />
Objectifs : etudier in vitro l’infection de thyrocytes par coxsackievirus B4E2 (souche diabétogène) et évaluer les conséquences de l’infection sur la<br />
viabilité et la fonctionnalité <strong>des</strong> cellules.<br />
Métho<strong>des</strong> : la culture <strong>des</strong> thyrocytes de la lignée de carcinome papillaire K1 est réalisée en plaques de 24 puits à raison de 5.105 cellules par puits. A<br />
24 h, les thyrocytes sont infectés avec la souche CVB4E2. Les virus sont laissés en contact 3 jours au-delà <strong>des</strong>quels le milieu est régulièrement<br />
renouvelé. L’infection <strong>des</strong> cellules est étudiée par la recherche d’ARN viral positif (+) et négatif (-) (intermédiaire de réplication) à l’aide de la RT-PCR et<br />
par la recherche de la protéine de capside VP1 par immunofluorescence indirecte. La viabilité <strong>des</strong> cultures est évaluée à l’aide d’une méthode reposant<br />
sur l’incorporation de MTT. Des cellules K1 non infectées servent de contrôle.<br />
Résultats : Il n’y a pas d’effet cytopathogène spécifique visible au microscope optique dans les cultures de cellules K1 infectées cependant l’aspect <strong>des</strong><br />
tapis cellulaire est différent par rapport aux contrôles. La détection d'ARN + et d'ARN – est positive avec une prédominance d’ARN- détecté pendant<br />
toute la durée de la culture jusque J21 post-infection. Le nombre de cellules VP1+ diminue rapidement de J1 à J6 (280 cellules par puits à 110 cellules<br />
à J3 11 cellules à J6 dans une expérience représentative. Les viabilités à J3 J6 J14 J21 <strong>des</strong> cultures de cellules contrôles et de cellules infectées sont<br />
comparables<br />
Conclusion : Le virus se multiplie dans notre modèle de thyrocytes (lignée K1) dans les premiers jours de culture (ARN+/ARN- et VP1) puis persiste<br />
dans les cellules pendant toute la durée de l’étude (21 jours) sous forme ARN. Le virus n’altère pas la viabilité de la culture. Dans ce modèle de<br />
thyrocytes infectés par CVB4E2, <strong>des</strong> travaux sont en cours pour déterminer les conséquences de l’infection virale persistante sur la fonction <strong>des</strong><br />
cellules. Nous montrons pour la première fois que l’infection à CVB4 de thyrocytes est possible. Il est important d’approfondir l’étude de l’infection et de<br />
ses effets dans les cellules thyroïdiennes car ils pourraient jouer un rôle dans les pathologies autoimmunes.<br />
Mot(s)-clé(s) : enterovirus & thyrocytes K1<br />
DESSEIN Rodrigue EMI364 - Michel SIMONET<br />
L’immunité de la muqueuse intestinale face à l’agression par Yersinia pseudotuberculosis<br />
Les cryptidines sont <strong>des</strong> pepti<strong>des</strong> anti-microbiens produits par la muqueuse de l’intestin grêle de la souris. Ces effecteurs solubles de l’immunité innée,<br />
apparentés aux défensines humaines, regroupent à ce jour six représentants qui sont tous synthétisés par les cellules de Paneth <strong>des</strong> glan<strong>des</strong> de<br />
Lieberkühn et stockés dans leurs granules zymogènes. Formées d’une trentaine d’aci<strong>des</strong> aminés, les cryptidines comportent six résidus cystéyl et<br />
adoptent une structure en feuillet plissé b. Pour une concentration d’environ 1 mg/ml, ces courts pepti<strong>des</strong> lysent les bactéries en perméabilisant, tel un<br />
détergent, leur membrane avec éventuellement formation de pores. Près de 400 pg de cryptidines peuvent être produits par une crypte ce qui, rapporté<br />
à la taille et au volume de celle-ci, correspond à une concentration approximative de 100 mg/ml de pepti<strong>des</strong>! La biogenèse <strong>des</strong> cryptidines implique une<br />
protéase la matrilysine MMP-7, qui est requise pour l’activation <strong>des</strong> précurseurs <strong>des</strong> cryptidines. La régulation génique de ces défensines reste à l’heure<br />
actuelle inconnue.<br />
Yersinia pseudotuberculosis est bactérie entéropathogène pour l’homme et l’animal, dont la virulence s’exerce à l’égard de l’hôte via <strong>des</strong> protéines<br />
dénommées Yop (Yersinia outer proteins). Elles interfèrent avec différentes voies de signalisation cellulaire, bloquant notamment l’activation de NF-kB<br />
et, par conséquent, la production de cytokines pro-inflammatoires par les macrophages ainsi que les cellules épithéliales et endothéliales. Nous avons<br />
étudié chez la souris C57Bl6/J infectée per os par Ypst l’expression dans la muqueuse de l’iléon terminal de gènes codant deux défensines alpha, la<br />
cryptidine-1 et -4, et celle de la matrilysine. Les taux tissulaires d’ARNm spécifiques ont été mesurés par PCR en temps réel (chimie SYBR GREEN).<br />
Après 24 heures d’infection, la quantité de transcrits est significativement diminuée. Cette interaction favoriserait ainsi l’implantation bactérienne dans la<br />
muqueuse iléale. Les perspectives à court terme sont d’établir la dépendance éventuelle du plasmide de virulence dans le phénomène obtenu et de voir<br />
si <strong>des</strong> résultats semblables sont observés lorsque le gène myd88 qui code l’un <strong>des</strong> facteurs de la voie de signalisation cellulaire initiée par les<br />
récepteurs homologues de Toll, a été inactivé chez la souris.<br />
Mot(s)-clé(s) : Défensine & Yersinia pseudotuberculosis<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
DILLY Sebastien EA1043 - Philippe CHAVATTE<br />
MODELISATION DU RECEPTEUR SEROTONINERGIQUE 5HT2C PAR HOMOLOGIE COMPARATIVE<br />
La sérotonine ou 5-hydroxytryptamine (5-HT) exerce sa fonction d’hormone et de neuromédiateur en se liant à une quinzaine de récepteurs distincts<br />
regroupés en 7 familles (5-HT1 à 5-HT7). Elle est présente dans la muqueuse intestinale, dans les plaquettes sanguines et au niveau du système<br />
nerveux central où elle est plus particulièrement impliquée dans la régulation du sommeil, de l’appétit et de l’humeur.<br />
Ses propriétés ont été mises à profit dans le traitement de nombreuses pathologies, telles que la migraine, l’allergie ou l’hyperacidité gastrique. Elle<br />
présente également de très intéressantes potentialités thérapeutiques dans les pathologies du système nerveux central, comme l’anxiété ou la<br />
dépression.<br />
L’agomélatine est le chef de file d’une nouvelle classe thérapeutique d’antidépresseurs qui possède <strong>des</strong> propriétés pharmacologiques originales<br />
agoniste mélatoninergique et antagoniste sélectif 5HT2C (concept MASSA : Melatonin Agonist and Selective Serotonin Antagonist). Afin d’étudier les<br />
interactions de l’agomélatine avec le récepteur 5HT2C, nous avons entrepris sa construction par homologie comparative en nous basant sur la structure<br />
tridimensionnelle de la rhodopsine bovine qui est le seul récepteur couplé à une protéine G dont la structure ait été déterminée expérimentalement par<br />
diffraction <strong>des</strong> rayons X.<br />
NB: Mes travaux de thése étant confidentiels pour <strong>des</strong> raisons de protection industrielle, ce poster concerne <strong>des</strong> travaux annexes également réalisés au<br />
cours de cette thèse.<br />
Mot(s)-clé(s) : récepteur 5HT2c & RCPGs & homologie comparative & agomelatine<br />
DINON Jean-Francois UMR8160 - Muriel BOUCART<br />
Perception <strong>des</strong> expressions faciales chez les patients atteints de Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA).<br />
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA) est actuellement la première cause de cécité légale (acuité visuelle inférieure à 1/20ème) dans les<br />
pays industrialisés chez les personnes de plus de 50 ans. La DMLA affecte la macula, la zone de la rétine dévolue à la vision centrale. Elle est<br />
caractérisée par une disparition massive <strong>des</strong> photorécepteurs entraînant une diminution de la sensibilité aux contrastes et aux détails fins. L’une <strong>des</strong><br />
plaintes majeures <strong>des</strong> patients atteints de DMLA porte sur <strong>des</strong> difficultés dans la reconnaissance <strong>des</strong> visages et <strong>des</strong> expressions faciales. C’est sur ce<br />
dernier aspect que notre étude s'est intéressée.<br />
La reconnaissance <strong>des</strong> visages est basée sur <strong>des</strong> mécanismes cérébraux mettant en jeu la perception <strong>des</strong> composantes faciales (e.g. les yeux, le nez<br />
et la bouche) et la perception <strong>des</strong> interactions géométriques existantes entre eux. Ces informations sont portées par les contours, les plages d'ombre et<br />
de lumière, et les textures ; données physiques véhiculées par différentes gammes de fréquences spatiales. Les fréquences spatiales (FS) constituent<br />
la base du traitement de l’information visuelle. En effet, nous percevons le monde selon un large spectre de FS allant <strong>des</strong> plus basses aux plus hautes.<br />
Ainsi, les contours et les détails fin d’un visage sont véhiculés par les fréquences spatiales hautes (FSH) tandis que la pigmentation et la forme globale<br />
du visage sont véhiculées par les fréquences spatiales basses (FSB). La reconnaissance d’un visage nécessitera l’analyse <strong>des</strong> différentes gammes de<br />
FS.<br />
Schyns et Oliva (Schyns & Oliva, 1998 Cognition 69, 243-265) ont montré que selon la tâche, relative à la perception de l’expression du visage, <strong>des</strong><br />
sujets sains pouvaient utiliser soit les FSH, soit les FSB. Ainsi une tâche qu’ils ont qualifiée de CATEX (pour CATégorisation de l’EXpression) nécessite<br />
l’utilisation <strong>des</strong> FSB tandis qu’une tâche appelée EXNEX (pour EXpressif/Non-EXpressif) nécessite l’utilisation <strong>des</strong> FSH.<br />
L’objectif de cette étude est de déterminer l’influence d’une perte de sensibilité aux contrastes et aux FSH sur la perception <strong>des</strong> expressions faciales<br />
chez <strong>des</strong> patients atteints de DMLA. Pour cela, nous leur avons proposé d’effectuer <strong>des</strong> tâches d’EXNEX et de CATEX. Nous leur avons présenté <strong>des</strong><br />
visages (soit expressifs soit non expressifs) pendant 300ms. Selon la tâche, ils devaient soit discriminer l’expressivité du visage soit catégoriser<br />
l’expression du visage. Les visages pouvaient être soit très expressifs soit peu expressifs. En outre, nous avons demandé à <strong>des</strong> participants sains<br />
d’effectuer le même type de tâche. Les images étaient présentées pendant 35ms et pouvaient avoir un contraste d’origine abaissé. Cette manipulation<br />
<strong>des</strong> images ayant pour but de simuler la perte de sensibilité aux contrastes observée chez les patients. En faisant cela, on élimine une partie <strong>des</strong><br />
canaux portant les FSH.<br />
Les résultats obtenus auprès <strong>des</strong> patients montrent une performance significativement meilleure dans la tâche de CATEX par rapport à EXNEX. De<br />
plus, la performance obtenue avec <strong>des</strong> visages peu expressifs est significativement meilleure en CATEX qu’en EXNEX.<br />
La DMLA se caractérise par une perte de la sensibilité aux contrastes et aux FSH. Les patients conservent cependant une bonne perception <strong>des</strong> FSB.<br />
Les résultats obtenus auprès <strong>des</strong> patients montrent que la tâche de CATEX peut être effectuée en ne percevant que <strong>des</strong> FSB, ce qui n’est pas le cas<br />
pour la tâche d’EXNEX. Cela est en adéquation avec les résultats obtenus par Schyns et Oliva. En outre, il semblerait que les patients atteints de DMLA<br />
soit tout a fait capables de reconnaître les expressions faciales. Les difficultés évoquées par ces patients seraient donc plutôt liées à <strong>des</strong> facteurs<br />
environnementaux (e.g. luminosité ambiante, taille du visage) qui gêneraient la reconnaissance <strong>des</strong> expressions faciales.<br />
Les tests effectués auprès <strong>des</strong> participants sains étant en cours, nous présenterons les résultats obtenus lors de la Journée André VERBERT.<br />
Mot(s)-clé(s) : DMLA & Expression faciale & Fréquences spatiales<br />
EL BEYROUTHY Marc EA2692 - Annick DELELIS<br />
Etude ethnopharmacologique <strong>des</strong> plantes médicinales du Liban Nord<br />
Une étude ethnopharmacologique a été effectuée au Liban Nord sur les plantes (indigènes, endémiques, naturalisées ou importées) qui sont réputées<br />
médicinales et utilisées par les différentes populations rurales, les herboristes et tradipraticiens qui pratiquent la médecine traditionnelle.<br />
Dans ce travail de recherche 50 espèces sont reportées, basé sur la fréquence d’utilisation et la sélection <strong>des</strong> données obtenues du travail du terrain.<br />
Les usages médicinaux les plus courants, aussi bien que les métho<strong>des</strong> de préparation et d’administration sont décrits et comparés avec la littérature<br />
citée.<br />
Mot(s)-clé(s) : Ethnopharmacologie & Liban & Plantes médicinales<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
FAID Valegh UMR-CNRS 8576 - Jean-Claude MICHALSKI<br />
Approches glycomique et glycoprotéomique de l'urine humaine applicables à l'étude <strong>des</strong> anomalies de<br />
glycosylation<br />
La glycosylation est une modification post-traductionnelle majeure chez les eucaryotes si bien qu’elle confère aux glycoprotéines diverses propriétés<br />
physicochimiques (solubilité, stabilité…) et biologiques (reconnaissance moléculaire, adhésion, trafic intracellulaire…). L’importance de cette<br />
glycosylation a notamment été démontrée au cours de nombreuses pathologies (acquises ou congénitales) pour lesquelles sont associées <strong>des</strong><br />
anomalies de glycosylation. En clinique, l’urine constitue une source importante de biomarqueurs d’intérêts diagnostics et/ou pronostics. Parmi ces<br />
biomarqueurs, les glycoprotéines, d’origines tissulaires diverses (hépatique, splénique et urogénitale), forment le groupe le plus important. La<br />
détermination de leur profil de glycosylation et d’expression constitue une étape essentielle pour la mise en évidence <strong>des</strong> anomalies de glycosylation<br />
lors de pathologies. Pour ces raisons, l’objectif de notre étude consiste en la mise au point de méthodologies sensibles de glycomique et de<br />
protéomique applicables à l’étude <strong>des</strong> anomalies de glycosylation de glycoprotéines totales, isolées de l’urine. Pour ce faire, les profils de glycosylation<br />
<strong>des</strong> glycoprotéines urinaires totales seront, dans un premier temps, déterminés par <strong>des</strong> micrométho<strong>des</strong> chimiques, enzymatiques et spectrométriques.<br />
Les abondances relatives <strong>des</strong> glycanes seront alors déterminées après couplage à un fluorophore aromatique par Chromatographie Liquide Haute<br />
Performance (CLHP) en phase normale. Dans un second temps, l’analyse protéomique <strong>des</strong> glycoprotéines urinaires sera envisagée, après<br />
enrichissement par chromatographie sur colonne de lectines immobilisées, par électrophorèse d’acrylamide bidimensionnelle (2-DE). A terme,<br />
appliquées à l’étude de pathologies de glycosylation, ces méthodologies pourraient permettre de déterminer : (1) la nature <strong>des</strong> voies métaboliques<br />
potentiellement affectées au cours de ces pathologies ; (2) les marqueurs glycoprotéiniques associées à la pathogénèse ; et (3) le degré d’atteinte ainsi<br />
que la spécificité cellulaire éventuelle de ces pathologies.<br />
Mot(s)-clé(s) : Glycomique & Glycoprotéomique & Glycopathologies & Spectrométrie de masse<br />
FAVORY Raphael EA2689 - Rémy NEVIÈRE<br />
Effets cardiocirculatoires bénéfiques de la protéine C activée dans un modèle de choc endotoxinique chez le rat.<br />
Dans le choc septique, l’apparition d’une dysfonction myocardique et d’une hypotension artérielle réfractaire sont <strong>des</strong> éléments pronostiques<br />
défavorables. Il a été récemment montré que la protéine C activée améliore la mortalité <strong>des</strong> patients en choc septique (1). Nous étudions les propriétés<br />
cardiovasculaires et les mécanismes d’action de la protéine C activée dans un modèle de choc endotoxinique chez le rat.<br />
MATERIEL ET METHODES<br />
1. Préparation <strong>des</strong> animaux :<br />
Un cathéter carotidien et un cathéter jugulaire sont tunnelisés chez <strong>des</strong> rats.<br />
Quatre groupes sont étudiés :<br />
-rats contrôles (perfusion de sérum salé (SSI) à 2ml/h)<br />
-rats contrôles PCA (protéine C activée 240μg/kg/min à 2ml/h)<br />
-rats LPS (injection IV en bolus de 10mg/kg d’endotoxine d’E.coli et SSI 2ml/h)<br />
-rats LPS-PCA (PCA 30 minutes avant LPS)<br />
2. Etu<strong>des</strong> cardiovasculaires :<br />
a. Cœur isolé-perfusé avec mesure <strong>des</strong> paramètres de contractilité LVEDP, dP/dtmax<br />
b. Mesure de la pression artérielle et vasoréactivité à la noradrénaline<br />
c. Microscopie intravitale avec quantification du « rolling » et de l’adhésion leucocytaire et de la densité capillaire,<br />
3. Etu<strong>des</strong> biologiques :<br />
a. Dosage <strong>des</strong> nitrates/nitrites plasmatiques par réaction de Griess<br />
b. Taux plasmatiques de TNF-α et de MIF (macrophage migration inhibiting factor) par méthode ELISA<br />
c. Mesure de l’activité myéloperoxydase (spectrophotométrie)<br />
4. Analyse statistique ANOVA avec post-hoc Bonferroni.<br />
RESULTATS<br />
1. Au niveau cardiaque, la protéine C activée prévient la baisse de LVEDP 82 ± 4 mmHg par rapport au rat LPS 60 ± 3 mmHg (p
FREALLE Emilie EA3609 - Daniel CAMUS<br />
Place de la MnSOD dans la défense antioxydante d’Aspergillus fumigatus<br />
Les superoxyde dismutases (SODs) sont indispensables pour la survie <strong>des</strong> cellules fongiques, en particulier au cours <strong>des</strong> phases de colonisation puis<br />
d’invasion <strong>des</strong> voies respiratoires, où leur capacité de détoxification <strong>des</strong> anions superoxyde joue un rôle primordial dans la résistance au stress oxydatif<br />
induit par les cellules phagocytaires (neutrophiles et macrophages alvéolaires). Elles peuvent être classées en 3 isoformes en fonction de leur métal<br />
cofacteur : les Cu/ZnSODs (cuivre et zinc), les MnSODs (manganèse) et les FeSODs (fer). Les champignons, comme la plupart <strong>des</strong> eucaryotes,<br />
possèdent classiquement une Cu/ZnSOD cytosolique et une MnSOD mitochondriale.<br />
Etant donné le rôle important de ces enzymes, ainsi que l’intérêt de la MnSOD comme marqueur phylogénétique, nous avons réalisé une<br />
analyse phylogénétique <strong>des</strong> champignons d’intérêt médical basée sur le gène de la MnSOD. Nous avons ainsi démontré que de nombreux<br />
champignons possédaient, en plus d’une MnSOD mitochondriale classique, une MnSOD de localisation cytosolique. La présence du second gène de la<br />
MnSOD pourrait résulter de duplications successives, ancestrales ou tardives, au cours de l’évolution, suivies ou non de la perte d’un <strong>des</strong> 2 gènes. La<br />
conservation de 2 gènes de MnSOD chez les Euascomycetes, et notamment chez Aspergillus fumigatus, le champignon filamenteux le plus<br />
fréquemment isolé au cours de mycoses opportunistes systémiques, pose la question du rôle respectif de ces 2 enzymes dans la défense antioxydante<br />
de ce champignon, et de leur implication dans les mécanismes de pathogénicité.<br />
Nous avons donc exploré le rôle de ces 2 isoenzymes (i) en testant leur capacité à restaurer la résistance aux agents oxydants (ménadione<br />
ou H2O2) d’une souche de Saccharomyces cerevisiae déficiente en MnSOD mitochondriale, et (ii) en étudiant par RT-PCR la régulation de leur<br />
transcription, ainsi que celle <strong>des</strong> principales autres enzymes antioxydantes (Cu/ZnSOD, Glutathion transférase, Catalases 1 et 2) chez A. fumigatus au<br />
cours de chocs oxydatifs induits in vitro par la ménadione ou par H2O2.<br />
Nos premiers résultats montrent que la transcription <strong>des</strong> MnSODs cytosolique et mitochondriale d’A. fumigatus semble ne pas être induite par la<br />
ménadione, contrairement à celle de la Cu/ZnSOD et de la catalase 1. De façon intéressante, nous avons observé une induction importante de la<br />
transcription de la MnSOD cytosolique au cours de la phase stationnaire de croissance du champignon, alors que le niveau de transcription de la<br />
MnSOD mitochondriale reste stable.<br />
Cette première approche montre la complexité <strong>des</strong> mécanismes de régulation du système antioxydant chez A. fumigatus. Elle sera complétée<br />
par une étude transcriptomique par microarrays visant non seulement à aborder en détail les mécanismes de défense anti-radicalaire chez A. fumigatus<br />
mais également à identifier <strong>des</strong> métabolismes pouvant être reliés à l'expression de pathogénicité.<br />
Mot(s)-clé(s) : Aspergillus fumigatus & MnSOD & Phylogénie & Choc oxydatif<br />
GACKIERE Florian EMI0228 - Pascal MARIOT<br />
Couplage fonctionnel entre canaux calciques de type T alpha1H et canaux potassiques calcium-activés dans les<br />
cellules cancéreuses prostatiques humaines.<br />
Des canaux calciques voltage-dépendants activés par de faibles dépolarisations membranaires sont surexprimés lors de la différenciation<br />
neuroendocrine <strong>des</strong> cellules cancéreuses prostatiques humaines. Nos travaux précédents montrent que la sous-unité alpha1H (CaV3.2) est<br />
responsable du courant de type T observé dans les cellules épithéliales prostatiques humaines LNCaP (Lymph Node Carcinoma of the Prostate). En<br />
utilisant la technique électrophysiologique de patch-clamp, nous avons mis en évidence ici que l’entrée de calcium à travers les canaux de type T<br />
alpha1H active <strong>des</strong> canaux potassiques. Les cellules LNCaP expriment trois familles de canaux potassiques activés par le calcium : SK (smallconductance<br />
potassium channels), IK (intermediate) et BK (big). Nous avons utilisé <strong>des</strong> outils pharmacologiques (tels que : apamine, clotrimazole,<br />
slotoxine et tetra ethyl ammonium) pour identifier la nature du courant potassique induit par les canaux calciques alpha1H. La sensibilité du courant<br />
potassique aux agents pharmacologiques suggère que les canaux BK sont couplés fonctionnellement aux canaux calciques de type T alpha1H dans les<br />
cellules LNCaP. Nous avons effectué <strong>des</strong> expériences pour étudier si ce couplage fonctionnel était dû à la colocalisation moléculaire <strong>des</strong> deux canaux.<br />
Nos données obtenues en configuration « single channel » montrent que bien que les canaux alpha1H et les canaux potassiques soient présents dans<br />
les mêmes fragments membranaires, ces canaux ne colocalisent pas dans <strong>des</strong> rafts lipidiques étant donné que ni la méthyl-béta-cyclodextrine ni la<br />
filipine inhibent l’activation <strong>des</strong> canaux potassiques induite par le calcium. Finalement, nous démontrons que le courant de fenêtre calcique occasionné<br />
par les canaux calciques de type T est capable de réguler le potentiel de repos membranaire en permettant l’hyperpolarisation de la membrane <strong>des</strong><br />
cellules LNCaP.<br />
Mot(s)-clé(s) : canal calcique de type T alpha1H & cancer & prostate humaine & cellules neuroendocrines<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
GARCIA Frederic EA2694 - Paul FRIMAT<br />
Dimensions collectives du travail et santé <strong>des</strong> soignants dans les Etablissements Publics de Santé Mentale en<br />
restructuration<br />
L’Ergonomie se heurte aux lacunes <strong>des</strong> modélisations <strong>des</strong> dimensions collectives du travail, pour comprendre les situations de travail et agir<br />
efficacement <strong>des</strong>sus. De plus, l’objectif central de l’Ergonomie de compromis entre santé et efficacité, et la variabilité et la complexité du réel,<br />
nécessitent <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> relatives à chaque secteur professionnel. La précision d’écueils théoriques et d’interventions, est nécessaire pour le secteur<br />
hospitalier en général et le personnel soignant en particulier, notamment dans le milieu psychiatrique en restructuration et aux conditions de travail<br />
spécifiques.<br />
Plusieurs disciplines exploitables ont développé <strong>des</strong> théories et méthodologies sur les dimensions collectives du travail (Ergonomie, Psychologie…).<br />
Classiquement, on appréhende en Ergonomie une réalité à trois facettes aux interactions complexes : l’agent (opérateur - sujet), la tâche (but, moyens<br />
et conditions) et l’activité (processus et réalisation). En fonction <strong>des</strong> marges de manœuvres, représentations et compétences de l’opérateur, celui-ci<br />
établit un compromis entre atteinte <strong>des</strong> objectifs / performance, et impacts sur la santé (immédiats ou dans la durée). Ce compromis se situe toujours<br />
par rapport aux autres. De plus, le modèle de l’activité peut être considéré comme un modèle pour analyser et comprendre la structuration <strong>des</strong> collectifs<br />
de travail, de l’activité collective et <strong>des</strong> liens entre travail et santé psychique.<br />
L’objectif théorique majeur est la compréhension de la dynamique de la confrontation « individu – collectif – organisation » et de ses conséquences sur<br />
le travail et la santé psychique <strong>des</strong> soignants. Cet objectif se décline en deux points. Premièrement, nous étudions la diversité et la coordination <strong>des</strong><br />
collectifs, <strong>des</strong> activités collectives et individuelles, et <strong>des</strong> organisations. Deuxièmement, nous étudions l’impact différentiel <strong>des</strong> modalités de<br />
transformation et de réorganisation du travail, sur la re- conception <strong>des</strong> dimensions collectives de l’activité, en lien avec la santé psychique <strong>des</strong><br />
soignants. Diverses interrogations en découlent : liens entre modèles d’activité et de santé, rapport à la conception <strong>des</strong> situations et à la conduite de<br />
projet, lien entre recherche et intervention…<br />
Les restructurations organisationnelles d’Etablissements Publics de Santé Mentale (EPSM) nous ont offert <strong>des</strong> terrains de recherche et d’intervention<br />
(encore en cours) propices, pour exploiter l’Analyse Ergonomique du Travail. Celle-ci semble pertinente pour concilier d’une part les acquis de diverses<br />
disciplines, d’autre part les approches théorique et empirique. Les besoins, temporalités et méthodologies varient selon le temps et le lieu, mais vont de<br />
l’analyse <strong>des</strong> projets de restructuration à l’analyse <strong>des</strong> traces spontanées et provoquées de l’activité soignante. Le va et vient entre recherche et<br />
intervention est constant pour modéliser les activités collectives soignantes. Le processus de recherche, évolue de l’approche empirique vers l’approche<br />
analytique, <strong>des</strong> processus en jeu et <strong>des</strong> interrelations entre le travail <strong>des</strong> agents, leur santé psychique et la prise en charge <strong>des</strong> patients.<br />
Mot(s)-clé(s) : activité individuelle et collective & EPSM & travail soignant<br />
GARENAUX Estelle UMR8576 - Jean-Claude MICHALSKI<br />
Etude de la biodiversité structurale <strong>des</strong> glycoconjugués.<br />
Le terme glycosylation renvoie à <strong>des</strong> molécules très diverses : glycoprotéines, glycolipi<strong>des</strong>, polysacchari<strong>des</strong> ou oligosacchari<strong>des</strong> libres. Ces molécules<br />
sont impliquées dans de nombreuses fonctions biologiques : réserve, structure (parois <strong>des</strong> bactéries et <strong>des</strong> végétaux ou matrice extracellulaire <strong>des</strong><br />
cellules eucaryotes), interactions intercellulaires.<br />
L’analyse de ces molécules apparaît relativement difficile du fait de l’incroyable diversité <strong>des</strong> structures existantes. En effet, la nature <strong>des</strong><br />
monosacchari<strong>des</strong> les composant (anomérie, conformation, configuration), leur séquence, la position <strong>des</strong> liaisons (branchement) et les éventuelles<br />
substitutions (sulfates, phosphates…) sont autant de facteurs permettant de générer un nombre extraordinaires d’isomères.<br />
Ces glycannes sont synthétisés après ajout séquentiel par <strong>des</strong> enzymes particulières : les glycosyltransférases. Chacune de ces enzymes présente une<br />
spécificité de substrats (donneurs et accepteurs), ainsi qu’une spécificité de liaison (anomérie et position). Or l’équipement enzymatique est fonction à<br />
la fois de l’espèce, de l’individu, du type cellulaire ou tissulaire, et de l’état physio-pathologique considéré. Il est donc impossible de prédire quelles<br />
seront les structures glycanniques présentes dans un échantillon sans effectuer une analyse structurale fine.<br />
La stratégie développée dans notre laboratoire afin d’effectuer cette étude structurale consiste à utiliser les métho<strong>des</strong> classiques de la chimie <strong>des</strong><br />
sucres (-élimination, hydrazinolyse, méthanolyse, perméthylation…) et de les associer à une analyse en spectrométrie de masse après<br />
séparation <strong>des</strong> glycannes par <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> chromatographiques usuelles (échange d’ions, tamisage moléculaire, HPLC, GC, colonnes d’affinité avec<br />
<strong>des</strong> lectines…). En particulier, une étude combinant l’analyse <strong>des</strong> glycannes natifs et perméthylés par spectrométrie de masse en tandem permet<br />
d’accéder à la structure fine <strong>des</strong> glycannes. Les produits natifs nous informent sur l’aspect global de la molécule, alors que l’observation de clivages<br />
préférentiels sur les produits perméthylés permet un séquençage fin, discriminant ainsi d’éventuels isomères. Complétée dans la mesure du possible<br />
par une analyse RMN rendue plus sensible depuis le développement <strong>des</strong> très hauts champs et <strong>des</strong> cryoson<strong>des</strong>, cette stratégie globale permet<br />
d’accéder sans ambiguïté à toutes les informations structurales relatives au mélange de glycannes étudié.<br />
Mot(s)-clé(s) : biodiversité<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
GARGOURI Imed EA2690 - Daniel MARZIN<br />
Repérage <strong>des</strong> expositions professionnelles aux solvants organiques dans l’industrie de la fabrication <strong>des</strong> colles<br />
et chaussures dans la ville de Sfax (Tunisie)<br />
Objectifs : L’utilisation de solvants industriels constitue un problème de santé au travail dans la ville de Sfax dans la mesure où environ 6000 artisans de<br />
fabrication de chaussures et de colles sont implantés dans la région. L’objectif de notre étude est de repérer les différentes expositions professionnelles<br />
aux solvants et/ou aux colles en tenant compte du secteur d’activité et du poste de travail.<br />
Métho<strong>des</strong> : Pour le repérage <strong>des</strong> entreprises de fabrication de colles et chaussures nous avons fait appel aux listes fournies par la Chambre Régionale<br />
du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat et par le Centre Régional <strong>des</strong> Cuirs et Chaussures à Sfax. Cette liste a été complétée par la recherche<br />
<strong>des</strong> autres entreprises concernées par porte à porte dans les 4 zones industrielles de Sfax et dans la vieille ville (médina). A l’aide d’un questionnaire,<br />
les informations suivantes ont été recherchées : 1) le procédé de fabrication : industriel, semi-industriel ou artisanal ; 2) le nombre total <strong>des</strong> salariés<br />
dans l’entreprise et l’effectif concerné par l’exposition aux solvants et/ou aux colles ; 3) la liste <strong>des</strong> solvants et <strong>des</strong> colles manipulés ainsi que les<br />
quantités annuelles ; 4) un <strong>des</strong>criptif global de l’ambiance générale de travail et de la ventilation <strong>des</strong> ateliers.<br />
Résultats : Au total, 96 entreprises ont pu être repérées : 4 de fabrication de colles (2 industrielles et 2 semi-industrielles) et 92 de fabrication de<br />
chaussures (26 industrielles, 6 semi-industrielles et 60 artisanales). Le nombre total de salariés concernés est de 1248 : 99 dans la fabrication <strong>des</strong><br />
colles et 1149 dans la fabrication <strong>des</strong> chaussures. Différents solvants sont utilisés dans les 2 secteurs, tels que l’hexane, le toluène, le trichloroéthylène,<br />
l’acétone, … ; dans 10 % <strong>des</strong> cas le solvant n’est pas défini. Dans la fabrication de chaussures nous avons noté un éventail de colles utilisées avec un<br />
approvisionnement essentiellement régional. Les quantités d’utilisation de colles varient de 100 à 9000 l/an. Si les entreprises de fabrications de colles<br />
sont bien entretenues, disposent d’une ventilation générale et/ou à la source et sont toutes installées dans les zones industrielles, celles de la<br />
fabrication de chaussures sont préférentiellement installées dans <strong>des</strong> habitations dans la vieille ville, ne sont pas bien entretenues et dans 25% <strong>des</strong> cas<br />
la porte d’entrée est la seule aération.<br />
Conclusions : Suite à cette phase préliminaire, une identification plus spécifique <strong>des</strong> colles et solvants est nécessaire afin d’identifier et prévenir les<br />
risques professionnels dans la fabrication <strong>des</strong> colles et chaussures.<br />
Mot(s)-clé(s) : Solvants & Fabrication de chaussure & Impact sanitaire<br />
GINESTE Romain U545 - Jean-Charles FRUCHART<br />
Protein Kinase C pathway promotes the farnesoid X receptor transcriptional activity<br />
The farnesoid X receptor (FXR, NR1H4) belongs to nuclear receptor superfamily and is activated by bile acids such as chenodeoxycholic acid (CDCA)<br />
or synthetic ligand as GW4064. FXR is implicated in the modulation of bile acids, lipid and carbohydrate metabolism. Although its mechanism of action<br />
is well characterized, post-translational modifications regulating its activity have not yet been investigated. Here, we demonstrate for the first time that<br />
calcium dependant PKC inhibitor prevents the ligand-mediated regulation of FXR target gene. Additionally, using transactivation assay, we show that<br />
the FXR transcriptional activity is modulated by calcium dependant protein kinase C (PKC) and particularly the PKCa isoform. Furthermore, in HepG2,<br />
the phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), a PKC activator, induces the phosphorylation of endogenous FXR and, in vitro, PKCa phosphorylates FXR<br />
in its ligand binding domain (LBD). Finally, by using two mammalian hybrid assay and GST pull-down, we show that phosphorylation of the LBD<br />
promotes the recruitment of the steroid receptor coactivator 1 (SRC1). These results demonstrate, for the first time, a link between FXR activity and the<br />
PKC phosphorylation pathway.<br />
Mot(s)-clé(s) : Farnesoid X receptor & Protein kinase C (PKC) & phosphorylation & SRC1 recruitment<br />
GLUSZOK Sébastien EA2692 - Patrick DEPREUX<br />
Conception, synthèse et évaluation pharmacologique de nouveaux dérivés pyrroliques<br />
potentiellement inhibiteurs de PDK-1<br />
Le manque de sélectivité et d’efficacité à long terme <strong>des</strong> traitements anticancéreux actuels impose la recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques.<br />
Dans le cas du cancer de la prostate, les acteurs de la voie de transduction PI3K/Akt sont fréquemment mutés, conduisant à une activation constante<br />
de la cascade enzymatique. Plusieurs étu<strong>des</strong> ont montré que cette voie de transduction intervenait de façon majeure dans certaines fonctions<br />
cellulaires telles que le métabolisme, la transcription, la croissance cellulaire, ou encore l’apoptose et constituait donc une cible de choix pour la<br />
conception de nouvelles molécules anticancéreuses. La kinase PDK-1 (phosphoinositide dependant kinase-1) joue un rôle de relais au sein de cette<br />
voie de transduction en activant Akt ; on peut donc espérer limiter les effets carcinogènes de la suractivation de la voie de transduction en inhibant cette<br />
enzyme.<br />
En tenant compte du pharmacophore issu de nouveaux inhibiteurs PDK-1 dérivés du Célécoxib comme le OSU-02067, nous avons réalisé par<br />
synthèse parallèle en phase solide sur synthétiseur Quest 205® une série de dérivés pyrroliques.<br />
Les mesures d’inhibition de prolifération cellulaire <strong>des</strong> composés synthétisés réalisées sur la lignée cancéreuse prostatique PC3 (métastases osseuses)<br />
ont fait apparaître plusieurs composés présentant de très bonnes activités antiprolifératives. Quatre composés présentent ainsi <strong>des</strong> IC50 inférieures à<br />
10 µM. Les tests sur l’enzyme PDK-1 recombinante sont en cours.<br />
Mot(s)-clé(s) : PDK-1 & voie PI3K/Akt & dérivés pyrroliques<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
GUTIERREZ-AGUILAR Ruth UMR8090 - Philippe FROGUEL<br />
Le variant AS–1659 G>C de KLF11, associé au Diabète de Type 2, modifie la transcription de KLF11<br />
Introduction: KLF11 est un facteur de transcription induit par le TGF b et capable de réguler l’expression du gène de l’insuline. Il a été précédemment<br />
montré que les variants Q62R, ainsi que AS–1659 G>C du promoteur putatif de KLF11 (SNP1) sont associés avec la susceptibilité au diabète de type 2<br />
(DT2). SNP1 se situe dans un site d’accrochage putatif du facteur RBP-Jk ou STAT3 ((G>C)TGGGAA). La transition de l’allèle G en C entraîne la<br />
disparition de cette prédiction. RBP-Jk joue un rôle clé dans la voie de signalisation de Notch, permettant la différenciation <strong>des</strong> cellules pancréatiques<br />
endocrines. D’ailleurs, STAT3 est indispensable à la régulation de la gluconéogenèse <strong>des</strong> hépatocytes. Dans cette étude, nous analyserons le facteur<br />
qui s’accroche au SNP1 de KLF11 et son effet sur la transcription du gène, pour évaluer l’implication de cette régulation dans la susceptibilité au DT2.<br />
Métho<strong>des</strong>: Nous avons analysé les protéines nucléaires qui s’accrochent aux son<strong>des</strong> du SNP1, dans les cellules β pancréatiques et dans les<br />
hépatocytes, par <strong>des</strong> expériences de retard sur gel. Ensuite, nous avons cloné la région promotrice de KLF11, contenant SNP1 sauvage ou muté pour<br />
étudier l’induction de l’activité de la luciférase dans <strong>des</strong> cellules transfectées. Résultats: Nous avons mis en évidence la fixation d’un complexe<br />
protéique sur la séquence sauvage, qui est absent sur la séquence mutée du SNP1. Nos résultats montrent que le facteur STAT3 est présent dans ce<br />
complexe. L’analyse de la région promotrice de KLF11 montre qu’il existe une différence de régulation transcriptionnelle entre la forme sauvage et la<br />
forme mutée. Cette régulation est en cours de caractérisation pour différentes concentrations de glucose et de stimulation de STAT3. Conclusion: Nous<br />
avons montré que STAT3 s’accrochait à la forme sauvage du SNP1 situé dans la région promotrice de KLF11. Cette fixation pourrait expliquer la<br />
différence d’activation observée entre la forme sauvage et mutée du promoteur de KLF11. Ces résultats suggèrent que AS–1659 G>C, associé avec le<br />
DT2, régule l’expression de KLF11 via STAT3, qui joue un rôle important dans la sensibilité au glucose au niveau du foie.<br />
Mot(s)-clé(s) : KLF11<br />
HELLE Francois UPR2511 - Jean DUBUISSON<br />
La cyanovirin-N inhibe l’entrée du Virus de l’Hépatite C en interagissant avec les glycannes associés aux<br />
protéines d’enveloppe<br />
Plus de 170 millions de personnes dans le monde sont chroniquement infectées par le virus de l’hépatite C (VHC). Ce virus est responsable de la<br />
majorité <strong>des</strong> hépatites chroniques, <strong>des</strong> cirrhoses et <strong>des</strong> hépatocarcinomes. De plus, les infections chroniques par le VHC sont la cause majeure <strong>des</strong><br />
transplantations du foie. Le traitement actuel consiste en une bithérapie composée d’interféron-? pégylé et de ribavirine. Cependant, ce traitement est<br />
très coûteux, relativement toxique et n’est efficace que chez la moitié <strong>des</strong> patients traités. Par ailleurs, aucun vaccin contre le VHC n’est disponible à ce<br />
jour. Le développement de traitements anti-VHC plus efficaces et mieux tolérés est donc nécessaire pour combattre cet agent pathogène majeur.<br />
Le VHC est un virus enveloppé qui appartient au genre Hepacivirus dans la famille <strong>des</strong> Flaviviridae. Le cycle viral du VHC reste encore mal<br />
connu en raison <strong>des</strong> difficultés à propager ce virus dans un système de culture cellulaire. Le développement de particules rétrovirales pseudotypées par<br />
les glycoprotéines d’enveloppe, E1 et E2, du VHC (VHCpp) a été une avancée majeure dans la recherche sur l’entrée du virus (1). Ce système est très<br />
utile pour l’identification et la caractérisation de molécules qui bloquent l’entrée du VHC. Par ailleurs, les données obtenues avec les VHCpp peuvent<br />
aujourd’hui être confirmées à l’aide d’un système de culture cellulaire récemment développé qui permet une amplification efficace du VHC (VHCcc) (2).<br />
Durant leur biogenèse, les deux glycoprotéines d’enveloppe du VHC, E1 et E2, s’assemblent sous forme d’hétérodimères non-covalents qui<br />
sont retenus dans le réticulum endoplasmique. Dans ce compartiment, 4 ou 5 sites de glycosylation sur E1 et 11 sites de glycosylation sur E2 sont<br />
modifiés par N-glycosylation. L’analyse <strong>des</strong> glycannes liés aux formes intracellulaires <strong>des</strong> glycoprotéines d’enveloppe a montré que les glycannes<br />
associés étaient de type oligomannosidique. Néanmoins, certains de ces glycannes sont très probablement modifiés après l’assemblage et le relargage<br />
<strong>des</strong> particules virales. Les sites de glycosylation présents sur E1 et E2 sont très conservés et certains glycannes associés jouent un rôle majeur dans le<br />
repliement de ces protéines et dans l’entrée du VHC (3). Pour ces raisons, les glycannes présents sur les glycoprotéines d’enveloppe du VHC semblent<br />
être une cible intéressante pour le développement de nouvelles molécules antivirales efficaces contre le VHC.<br />
La cyanovirin-N (CV-N) est une protéine de 101 aci<strong>des</strong> aminés (11 kDa) qui a été isolée à partir d’extraits de cyanobactéries Nostoc<br />
ellipsosporum (4). Cette lectine a été identifiée comme un agent actif contre le VIH ainsi que d’autres virus enveloppés. L’activité antivirale de la CV-N<br />
implique <strong>des</strong> interactions spécifiques avec les glycannes oligomannosidiques présents sur les protéines d’enveloppe virales, ce qui empêche l’entrée du<br />
virus dans la cellule. Les glycoprotéines d’enveloppe du VHC étant très glycosylées et contenant probablement <strong>des</strong> glycannes oligomannosidiques,<br />
nous avons testé si la CV-N avait une activité antivirale contre ce virus. Nous avons ainsi montré que la CV-N inhibait l’entrée <strong>des</strong> VHCpp et VHCcc<br />
dans <strong>des</strong> cellules cibles, à <strong>des</strong> concentrations nanomolaires. Cette inhibition est due à une interaction spécifique de la CV-N avec les glycannes<br />
associés aux protéines E1 et E2, ce qui empêche l’interaction de E2 avec CD81, une protéine cellulaire de surface impliquée dans l’entrée du VHC.<br />
En conclusion, nos données montrent que les glycannes présents sur les protéines d’enveloppe du VHC sont une cible prometteuse pour le<br />
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques.<br />
1 – Bartosch, B., & al., J. Exp. Med. (2003)<br />
2 – Wakita, T., & al., Nat. Med. (2005)<br />
3 – Goffard, A., & al., J. Virol. (2005)<br />
4 – Boyd, M.R., & al., Antimicrob. Agents Chemother. (1997)<br />
Mot(s)-clé(s) : Virus de l’Hépatite C & cyanovirin-N & entrée virale & N-glycosylation<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
JARDIN-MATHE Olivia FRE 2933 - Michel SALZET<br />
Développement d’un logiciel de reconstruction d’images en vue d’une application à l’imagerie par spectrométrie<br />
de masse<br />
Grâce au principe de production d’ions par Désorption/Ionisation Laser Assistée par Matrice en spectrométrie de masse, il devient possible de<br />
développer <strong>des</strong> techniques d’imagerie moléculaire pour la détection de pepti<strong>des</strong> et de protéines sur <strong>des</strong> sections fines de tissus. Des informations<br />
spécifiques sur la composition moléculaire locale, l’abondance relative et la distribution spatiale sont ainsi obtenues.<br />
L’intensité du courant mesuré, en fonction du rapport m/z, est reportée sur le spectre de masse. A un point de l’échantillon correspond un spectre qui<br />
sera représentatif de la composition en ce point. Il est aussi possible d’enregistrer plusieurs spectres en différents points de l’échantillon car la plaque<br />
métallique (ou porte échantillon) sur laquelle est déposé l’analyte est montée sur un plateau xy piloté par deux moteurs pas à pas permettant un<br />
déplacement précis dans les deux dimensions du plan. Par exemple, pour une coupe de tissu, une zone rectangulaire à étudier peut être définie. Un<br />
balayage de cette zone par laser en mode automatique donnera <strong>des</strong> spectres représentatifs de chacun <strong>des</strong> points. En enregistrant pour chaque spectre<br />
les coordonnées spatiales localisant le point où l’analyse à été effectuée, une collection de données est obtenue.<br />
Cependant l’analyse MALDI est limitée spatialement au diamètre du faisceau laser et la distance entre deux positions (le pas) du balayage, l'image sera<br />
donc plus ou moins précise.<br />
Une fois l’acquisition <strong>des</strong> spectres terminée, la sélection d’un pic sur les spectres, correspondant à un composé d’intérêt, puis la mesure de ce pic,<br />
permet de reconstruire une image de la répartition de ce composé au sein de la coupe. Pour cela, le logiciel va rechercher la présence ou non de ce pic<br />
dans chaque spectre enregistré lors du balayage : parcours <strong>des</strong> fichiers obtenus. Il faut ensuite choisir la méthode à utiliser pour parcourir les pics. La<br />
recherche peut se faire soit selon l’intensité maximum du pic, soit selon l’aire du pic. Il faudra aussi définir un seuil d’intensité en <strong>des</strong>sous duquel le<br />
signal ne sera pas considéré comme significatif. Puis le parcours <strong>des</strong> spectres pourra se faire. Pour chaque couple de coordonnées (désignant un<br />
spectre, ou un point sur la plaque) une valeur sera attribuée puis utilisée pour la reconstruction de l’image. L’intensité <strong>des</strong> couleurs sur l’image obtenue<br />
dépend donc de l’intensité de présence du peptide. La reconstitution de l’image se fera avec 1 pixel par point (spectre).<br />
De nombreuses applications peuvent déboucher de cette technologie. L’une <strong>des</strong> principales est la recherche de biomarqueurs et en particulier de<br />
biomarqueurs de pathologies. Pour l’instant l’Imaging Mass Spectrometry donne <strong>des</strong> images de coupes planes. Une équipe a récemment montré qu’il<br />
était possible, à partir de la cartographie de coupes de cerveau de rat, de reconstituer une image en 3D, ce qui permet de voir la localisation d’une<br />
protéine cible non plus dans une coupe, mais dans l’organe ou dans l’animal en entier.<br />
Lemaire R, Tabet JC, Ducoroy P, Hendra JB, Salzet M, Fournier I, Solid ionic matrixes for direct tissue analysis and MALDI imaging. Anal Chem,<br />
2006,78(3)<br />
Fournier I, Day R, Salzet M, Direct analysis of neuropepti<strong>des</strong> by in situ MALDI-TOF mass spectrometry in the rat brain. Neuroendocrinol. Lett, 2003,24<br />
Caprioli RM, Farmer TB, and Gile J, Molecular imaging of biological samples: localization of pepti<strong>des</strong> and proteins using MALDI-TOF MS. Anal Chem,<br />
1997,69(23)<br />
Stoeckli M, Farmer TB, Caprioli RM, Automated mass spectrometry imaging with a matrix-assisted laser <strong>des</strong>orption ionization time-of-flight instrument. J<br />
Am Soc Mass Spectrom, 1999;10(1)<br />
Caprioli RM, Farmer TB, Gile J, Molecular imaging of biological samples: localization of pepti<strong>des</strong> and proteins using MALDI-TOF MS. Anal Chem,<br />
1997;69(23)<br />
Mot(s)-clé(s) : bioinformatique & imagerie & spectrométrie de masse<br />
JEANNE Mathieu EA 1046 - Benoit TAVERNIER<br />
Etude de l'activité du SNA au cours d'agression cérébrales aigues<br />
L'activité du système nerveux autonome (SNA) peut être mesurée par l'analyse de la variabilité sinusale du rythme cardiaque (Heart Rate Variability –<br />
HRV). L'état du SNA est modifié par de nombreuses situations physiologiques et pathologiques ayant fait l’objet d’étu<strong>des</strong> essentiellement dans le<br />
contexte de pathologies chroniques. En cas d'agression aigue, l’intérêt de ce type d’analyse est apparu le plus souvent limité. Nous faisons l’hypothèse<br />
que l’étude de l’activité du SNA au cours d’agressions cérébrales aigues peut avoir un intérêt diagnostique, pronostique et/ou thérapeutique, à condition<br />
d’utiliser <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> d’analyse et de mesure mises au point spécifiquement dans ce but.<br />
1- mise au point d'un traitement original du tachogramme : La mise au point d'un logiciel <strong>des</strong>tiné au traitement du tachogramme (suite <strong>des</strong> intervalles R-<br />
R d'un électrocardiogramme) a été réalisée en langage Borland® Delphi® 4.0. Le traitement du tachogramme réalisait un rééchantillonage à 8 Hz sur<br />
64 sec, la mesure de la norme du vecteur ainsi obtenu puis un filtrage entre 0.125 et 1 Hz en utilisant la transformée en Ondelettes (Daubechies 4). Le<br />
traitement du signal filtré reposait sur le calcul de multiples indices HRV, en utilisant les patterns spécifiques liés à la ventilation ("patterns<br />
ventilatoires"). Nous avons observé que la normalisation était fondamentale (article original en projet sur ce résultat). L'enveloppe inférieure – reliant les<br />
minina locaux – et son aire sous la courbe nous a permis de calculer les indices "AUCmax" et "MinRPA", respectivement maximum et minimum <strong>des</strong><br />
quatre aires de 16 sec sous l'enveloppe inférieure de 64 sec.<br />
2- modèle d’agression cérébrale aigue: douleur chirurgicale sous AG : Un protocole d'étude clinique prospectif réalisé au CHRU de Lille nous a permis<br />
d'obtenir <strong>des</strong> enregistrements ECG au cours d'anesthésies générales (AG) à deux niveaux d'analgésie : légère ou profonde. Nous avons observé que<br />
l'amplitude <strong>des</strong> "patterns ventilatoires" augmentait en cas d'analgésie profonde et diminuait en cas d'analgésie insuffisante. Plusieurs indices HRV<br />
présentaient <strong>des</strong> différences significatives entre ces deux groupes, "MinRPA" et "AUCmax" permettant d'anticiper jusqu'à 12 min la réinjection du<br />
morphinique (résultats présentés en congrès, article en cours de rédaction).<br />
3- modèle d’agression aigue : douleur chez le patient conscient : La nécessité de valider ces indices chez <strong>des</strong> patients conscient, interrogeables sur leur<br />
douleur nous a conduit à réaliser deux étu<strong>des</strong> cliniques prospectives, actuellement en cours au CHRU de Lille : 1) au cours du travail de<br />
l'accouchement, lors de pério<strong>des</strong> non douloureuses puis douloureuses et enfin après analgésie péridurale; 2) lors de la douleur post opératoire après<br />
chirurgie du pied, et après anesthésie loco régionale.<br />
4- modèle d’agression cérébrale aigue réversible : hémorragie méningée spontanée et traumatisme crânien grave : L'hémorragie méningée par rupture<br />
d'anévrisme n'altère pas nécessairement la conscience, tandis que le traumatisme crânien grave est, par définition, à l'origine d'un coma (score de<br />
Glasgow < 8). Les patients hospitalisés pour ces pathologies feront l'objet d'une étude prospective observationnelle à la recherche de corrélations entre<br />
les indices HRV et les données du monitorage cérébral (pression intra crânienne, oxygénation tissulaire cérébrale), de l'imagerie cérébrale (TDM et<br />
IRM), et <strong>des</strong> indices pronostiques cliniques.<br />
5- modèle d’agression cérébrale aigue irréversible : état de mort encéphalique : Le traumatisé crânien grave peut évoluer vers l'état de mort<br />
encéphalique. La mesure de l'activité du SNA pourrait permettre d'anticiper cette évolution, afin de tenter d'une part de la prévenir par une prise en<br />
charge rapide spécifique, ou de permettre, d’autre part, un diagnostic plus précoce de l’état de mort encéphalique en vue d’un prélèvement multi<br />
organe. Cette recherche fait actuellement l'objet d'une étude observationnelle prospective au CHRU de Lille.<br />
Mot(s)-clé(s) : systeme nerveux autonome & variabilité sinusale du rythme cardiaque & agression cérébrale aigue & analgesie/douleur<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
JEBARA Najate UMR8160 - Delphine PINS<br />
Préférence pour certaines catégories d’objets chez les sujets sains et chez les patients atteints de maculopathie<br />
Des étu<strong>des</strong> en IRMf suggèrent une influence de la perception visuelle sur l’organisation fonctionnelle cérébrale. En particulier, Levy et al. (2001)<br />
proposent que nos habitu<strong>des</strong> d’explorations seraient à l’origine de notre organisation fonctionnelle cérébrale. Ils ont en effet montré que la présentation<br />
de visages explorés habituellement en vision centrale (VC), générait une activité cérébrale dans une région du cortex visuel correspondant au champ<br />
visuel central tandis que la présentation de constructions classiquement perçues en vision périphérique (VP) était à l’origine d’une activité dans une<br />
région du cortex visuel correspondant au champ visuel périphérique.<br />
Ces travaux nous ont conduit à l’idée que nos habitu<strong>des</strong> d’exploration de l’environnement pourraient conduire à une préférence en VP pour la<br />
perception de certaines catégories d’objets. Ainsi, <strong>des</strong> constructions qui sont vues habituellement en VP devraient conduire à de meilleures<br />
performances lorsqu’ils sont présentés en VP que <strong>des</strong> visages que nous avons l’habitude d’explorer en VC. Nous avons testé cette préférence dans 3<br />
expériences de niveaux de traitement différents: <strong>des</strong> tâches de catégorisation (présence ou absence), de discrimination (identique ou non), et de<br />
reconnaissance (connu ou non). Des sujets sains et <strong>des</strong> patients présentant une maculopathie plus ou moins étendue ont été testés. Nous faisons<br />
l’hypothèse que <strong>des</strong> modifications <strong>des</strong> habitu<strong>des</strong> perceptives, en particulier, l’usage restrictif de la VP, pourraient moduler les préférences observées.<br />
Chez les sujets sains, alors qu’aucune différence significative entre les 2 catégories sémantiques n’a été trouvée en VC, une préférence a été mise en<br />
évidence en VP. Néanmoins, cette préférence dépendait aussi de la tâche à réaliser. En effet, les visages étaient mieux catégorisés que les<br />
constructions en VP alors que les constructions étaient mieux discriminées et reconnues. Ainsi, le contenu sémantique ne peut être tenu pour seul<br />
responsable de cette préférence. Des stimuli appartenant à <strong>des</strong> catégories sémantiques différentes ne requièrent pas le traitement <strong>des</strong> mêmes<br />
informations. La structure plus spécifique et homogène <strong>des</strong> visages comparée aux constructions permettrait d’effectuer une catégorisation sur la seule<br />
base de leur forme globale (fréquences spatiales –FS- basses). A l’inverse, une analyse plus détaillée serait nécessaire pour discriminer ou reconnaître<br />
<strong>des</strong> visages (FS élevées) tandis qu’un traitement global serait suffisant pour discriminer ou reconnaître <strong>des</strong> constructions. La VP, de part ses propriétés<br />
anatomiques, favoriserait les situations impliquant le traitement de la forme globale <strong>des</strong> objets.<br />
Un profil similaire a été retrouvé chez les patients. Ils montraient une préférence pour les visages dans la tâche de catégorisation et à l’inverse pour les<br />
constructions dans les tâches de discrimination et de reconnaissance. Néanmoins, ces effets de la catégorie sémantique étaient atténués comparés à<br />
ceux observés chez les sujets sains. Par ailleurs, la performance en VP semble reliée à la taille du scotome. Les patients ayant <strong>des</strong> scotomes peu<br />
étendus avaient de meilleures performances que les sujets sains en VP, alors que ceux ayant <strong>des</strong> scotomes plus larges avaient <strong>des</strong> performances<br />
moindres. Une compensation semble n’être possible en VP que lorsque le déficit visuel reste très localisé en VC.<br />
Ainsi, nos habitu<strong>des</strong> perceptives conduiraient à une préférence pour la perception de certains objets, puisque les visages que nous explorons<br />
habituellement en VC nécessitent un niveau de résolution plus élevé pour être discriminés ou reconnus en VP alors que les constructions qui sont<br />
classiquement perçues en VP nécessitent un niveau de résolution plus bas. Ces préférences en VP traduiraient alors notre organisation fonctionnelle<br />
cérébrale (Levy et al., 2001). Modifier nos habitu<strong>des</strong> perceptives, comme c’est le cas chez les patients étudiés, pourrait alors contribuer à une<br />
réorganisation fonctionnelle cérébrale.<br />
Mot(s)-clé(s) : Vision centrale & Vision Périphérique & contenu sémantique & caractéristiques physiques<br />
LALLET Helene EMI0228 - Natacha PREVARSKAYA<br />
Implication <strong>des</strong> canaux potassiques calcium-dépendants dans la prolifération et la cancérogenèse de la prostate<br />
humaine<br />
Le cancer de la prostate est la deuxième cause de mortalité par cancer dans la population masculine. Le développement normal et pathologique de la<br />
prostate est sous la dépendance du taux d’androgènes circulants. Les approches thérapeutiques actuelles (hormonales ou non) consistent à réduire au<br />
maximum le taux <strong>des</strong> androgènes circulants. Bien que ces traitements conduisent à une régression tumorale à court terme, ils restent souvent<br />
inefficaces à long terme où il se produit un échappement thérapeutique <strong>des</strong> tumeurs qui évoluent vers un cancer androgéno-indépendant. Il est donc<br />
évident que d'autres facteurs non androgéniques interviennent dans le développement <strong>des</strong> tumeurs prostatiques. L'étude de nouvelles cibles<br />
permettrait à long terme de développer de nouvelles stratégies pharmacologiques dans le traitement <strong>des</strong> cancers de la prostate.<br />
Des étu<strong>des</strong> récentes montrent que les canaux ioniques membranaires (calciques, potassiques,…) et le calcium intracellulaire sont <strong>des</strong> éléments clés<br />
<strong>des</strong> casca<strong>des</strong> d’événements conduisant à la stimulation de la prolifération ou au déclenchement de l'apoptose. Toutefois, le rôle <strong>des</strong> canaux ioniques et<br />
du calcium dans le développement et la croissance normale et pathologique de la prostate humaine reste assez mal connu et aucune approche<br />
thérapeutique visant les canaux ioniques comme cible pharmacologique n’est actuellement envisagée dans le traitement du cancer de la prostate.<br />
Ce travail est axé sur l’étude de l’expression, de la fonctionnalité et de l’implication <strong>des</strong> canaux potassiques activés par une augmentation du<br />
calcium intracellulaire dans la physiologie et dans la croissance <strong>des</strong> cellules cancéreuses prostatiques. Les canaux potassiques activés par le calcium<br />
intracellulaire (IK, BK, SK) font partie de la superfamille multigénique <strong>des</strong> canaux potassiques. Des étu<strong>des</strong> récentes montrent l’implication de ces<br />
canaux potassiques calcium-dépendants (Kca) et plus particulièrement celui à conductance intermédiaire (IK) dans la modulation de la croissance <strong>des</strong><br />
différents systèmes cellulaires comme notamment les lymphocytes T et les cellules pancréatiques humaines. Une surexpression du canal potassique<br />
de type IK a été également démontrée dans les cellules cancéreuses humaines.<br />
Grâce aux techniques de biologie molèculaire, de biologie cellulaire et d’électrophysiologie, nous avons pu identifier les canaux potassiques<br />
KCa de type IK dans les cellules cancéreuses prostatiques humaines androgéno-dépendantes et indépendantes : en effet, l’expression de ce canal<br />
paraît être dépendante du phénotype cellulaire . De plus, nous avons démontré l’implication de l’activité de ce canal dans la croissance <strong>des</strong> cellules<br />
cancéreuses prostatiques humaines en intervenant dans le cycle cellulaire. L’étude <strong>des</strong> mécanismes d’action de la fonctionnalité de ce canal montre<br />
son implication dans le potentiel de membrane et dans l’homéostasie calcique cellulaire et plus particulièrement dans l’entrée capacitive de calcium<br />
dans les cellules cancéreuses de la prostate. Comme l’entrée capacitive de calcium est connue pour être impliquée dans le contrôle de la croissance<br />
<strong>des</strong> cellules cancéreuses, nos résultats sont prometteurs car l’activité de ce canal peut être une nouvelle voie de contrôle de la croissance cellulaire par<br />
le calcium.<br />
Mot(s)-clé(s) : Prostate humaine & Cancer & Canaux potassiques & Calcium<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
LAUNAY David EA2686 - Lionel PRIN<br />
Identification par une approche immuno-protéomique de cibles antigéniques dans le neurolupus<br />
Introduction : la physiopathologie exacte du neurolupus reste à établir. L’analyse du répertoire anticorps vis à vis du tissu cible suivie d’une approche<br />
protéomique est une méthode reconnue pour l’identification de cibles antigéniques dans certains processus auto-immuns.<br />
Objectifs : identifier certaines cibles antigéniques cérébrales caractéristiques du répertoire anticorps d’isotype IgG dans le neurolupus par une approche<br />
immuno-protéomique.<br />
Métho<strong>des</strong> : Le profil de réactivité <strong>des</strong> autoanticorps d’isotype IgG dirigés contre <strong>des</strong> antigènes cérébraux a été étudié chez 7 patients ayant un<br />
neurolupus par western blot. Ces profils ont été comparés à ceux de 12 patients lupiques sans atteinte neurologique, de patients ayant un syndrome de<br />
Sjögren avec (n=26) ou sans (n=6) atteinte du système nerveux central (SNC), de 82 patients ayant une sclérose en plaque (SEP) et de 27 sujets sains<br />
par une analyse statistique de type ALD (Analyse Linéaire Discriminante).<br />
Résultats : 1. Seize réactivités immunitaires singulières permettaient de différencier le répertoire <strong>des</strong> sujets sains, <strong>des</strong> patients ayant une SEP et celui<br />
<strong>des</strong> connectivites. 2. Cinq réactivités immunitaires particulières permettaient de différencier le profil <strong>des</strong> connectivites selon qu’il existait une atteinte du<br />
SNC 3. Quatre réactivités immunitaires différenciaient le profil <strong>des</strong> neurolupus par rapport aux lupus non neurologiques et aux Sjögren avec atteinte du<br />
SNC. 4. Une analyse protéomique permettait d’identifier de MAP-2B et de la septin 7 comme 2 de ces 4 antigènes.<br />
Discussion : L’analyse du répertoire <strong>des</strong> autoanticorps d’isotype IgG dirigées contre <strong>des</strong> antigènes cérébraux a permis d’identifier un profil de réactivité<br />
immunitaire très spécifique du neurolupus. L’analyse protéomique a pu identifier certains de ces antigènes cibles caractéristiques ce qui a d’importantes<br />
implications diagnostiques et physiopathologiques potentielles. Plusieurs autres cibles antigéniques sont en cours d’identification.<br />
Conclusion : l’approche immunoprotéomique est une approche efficace qui a permis de caractériser <strong>des</strong> antigènes cibles du neurolupus dont l’analyse<br />
fonctionnelle ultérieure pourrait apporter de nouveaux éléments pour la compréhension <strong>des</strong> mécanismes physiopathologiques.<br />
Mot(s)-clé(s) : neurolupus & proteomique & autoanticorps & systeme nerveux central<br />
LE BRAS Alexandra UMR8526 - Fabrice SONCIN<br />
Analyse in vitro et in vivo du promoteur du gène VE-Statine.<br />
Notre équipe a identifié un gène, la VE-statine (ou egfl7), qui est impliqué dans l’angiogenèse, la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de<br />
vaisseaux déjà établis (Soncin F. et al EMBO J 2003 22:5700-11). Les rôles physiologiques de la VE-statine et ses mécanismes d’action ne sont pas<br />
encore bien connus. Le gène VE-statine est spécifiquement exprimé dans les cellules endothéliales très tôt au cours du développement et tout au long<br />
de la vie embryonnaire. Notre projet consiste à identifier les mécanismes <strong>des</strong> régulations responsables de cette expression spécifique dans les cellules<br />
endothéliales.<br />
Nous avons réalisé une analyse in vitro de l’activité transcriptionnelle du gène VE-statine murin afin de rechercher les régions impliquées. Nous avons<br />
progressivement découpé l’extrémité 5’ du gène et placé les différents fragments obtenus dans un vecteur rapporteur. L’activité transcriptionnelle de<br />
ces constructions a alors été comparée dans les cellules endothéliales et dans <strong>des</strong> fibroblastes. Nous avons ainsi pu mettre en évidence le rôle<br />
combiné du promoteur minimal et de deux régions régulatrices (enhancer) placées en amont du gène dans la forte expression du gène dans les<br />
cellules endothéliales.<br />
En parallèle de cette analyse in vitro, nous menons <strong>des</strong> expériences de transgénèse chez la souris afin de valider nos résultats. Un premier fragment de<br />
promoteur comportant l’ensemble <strong>des</strong> régions régulatrices identifiées a ainsi été placé en amont du gène codant la ß-galactosidase dans un vecteur<br />
rapporteur et utilisé comme vecteur de transgénèse. L’analyse <strong>des</strong> embryons obtenus montre que ces régions orientent préférentiellement l’expression<br />
de la ß-galactosidase dans les cellules endothéliales. Nous avons maintenant créé d’autres vecteurs de transgénèse qui seront testés afin de<br />
déterminer si l’ensemble <strong>des</strong> régions nécessaires à l’expression du gène dans les cellules endothéliales ont été identifiées.<br />
Nous avons également montré que, suite à <strong>des</strong> traitements par <strong>des</strong> inhibiteurs de modification <strong>des</strong> histones, l’expression de la VE-statine était<br />
inversement régulée dans les fibroblastes et dans les cellules endothéliales. Nous avons établi que les fibroblastes et les cellules endothéliales<br />
présentent <strong>des</strong> profils d’acétylation et méthylation <strong>des</strong> histones différents le long de la région promotrice du gène VE-statine, suggérant une structure<br />
chromatinienne différente dans les deux types cellulaires.<br />
L’ensemble de nos résultats suggère donc que l’expression spécifique <strong>des</strong> cellules endothéliales du gène VE-statine est due à la fois à l’activité d’un<br />
‘enhancer’ situé en région 5’ du gène et à un ensemble de régulations épigénétiques.<br />
Mot(s)-clé(s) : Angiogenèse & VE-Statine & Régulation transcriptionnelle & Transgénèse<br />
LE NAOUR Morgan EA1043 - Pascal BERTHELOT<br />
Synthèse et évaluation pharmacologique de nouveaux agonistes PPARs alpha/gamma à potentiel antidiabétique.<br />
Depuis quelques dizaines d’années les pays développés ont vu une importante hausse de la prévalence du diabète de type II et de surcroît de l’obésité<br />
1.<br />
Les PPARs (Peroxisome Proliferator-Activated Receptors) sont <strong>des</strong> facteurs de transcription faisant partie de la superfamille <strong>des</strong> récepteurs nucléaires2<br />
qui comprend 3 isoformes alpha, beta, gamma, bien distincts et dont la distribution tissulaire est variée selon les formes. Leurs fonctions biologiques<br />
sont aussi diverses que la régulation du métabolisme lipidique au niveau hépatique (PPAR alpha), le contrôle de la différentiation adipocytaire (PPAR<br />
gamma) ou la prolifération cellulaire (PPAR delta).2,3<br />
La recherche de nouveaux agonistes mixtes alpha/gamma pourrait donc être un axe intéressant dans le traitement de l’insulinorésistance et <strong>des</strong><br />
pathologies associées au diabète de type II ainsi qu’au syndrome métabolique.<br />
De nombreux composés décrits dans la littérature comme agonistes mixtes alpha/gamma portent un motif alpha-alkoxyacide tel le tésaglitazar4<br />
(AZ242), aujourd’hui en phase III <strong>des</strong> essais cliniques en indication pour le traitement du diabète de type 2.<br />
Ce motif se révèle être très important pour l’activité mixte d’où la nécessité d’une synthèse simple et peu onéreuse. Différentes voies d’accès ont été<br />
décrites5,6 mais mettent en jeu un nombre important d’étapes ainsi, les travaux effectués au laboratoire ont porté sur une nouvelle méthodologie de<br />
synthèse en trois étapes et donnant accès à une large variété de motifs alpha-alkoxyaci<strong>des</strong>.<br />
1 Données OMS 2000. 2 K. Schoonjans, B. Staels, J. Auwerx ; Biochim. Biophys. Acta ; 1996 ; 1302 ;93-109. 3 J. Rieusset, W. Wahli, B. Desvergne ;<br />
Revue : les récepteurs nucléaires PPARs ; 2001 ; 7/9 ; 656-671. 4 P. Cronet, et al., Structure, 2001, 9, 699-706. 5 D. Haigh, Tetrahedron, 1994, 50,<br />
3177-3194. 6 D. Lansky, J. Chem. (Slovakian Ed.), 1997, 13, 352-357.<br />
Mot(s)-clé(s) : agonistes mixtes PPARs<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
LEGRAND Fanny U547 - Monique CAPRON<br />
Etude de la fonction du polynucléaire éosinophile dans les mécanismes de défense antitumorale<br />
Longtemps considérées comme <strong>des</strong> cellules principalement dévolues aux réactions allergiques et parasitaires, les éosinophiles se révèlent doués de<br />
multiples potentialités fonctionnelles. Acteurs importants de l’immunité adaptative, ils sont aussi capables de participer à la réponse immunitaire locale<br />
en raison de leur localisation tissulaire préférentielle, colonisant spontanément les tissus muqueux. Leur capacité de libération de cytokines, la<br />
découverte de molécules de co-stimulation et de différents récepteurs de l'immunité innée renforcent l'hypothèse que les éosinophiles puissent<br />
participer aux processus précoces intervenant dans l'immunité innée.<br />
Actuellement, la majorité <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> sur l’immunité antitumorale porte sur les mécanismes effecteurs <strong>des</strong> lymphocytes T (immunité adaptative) et <strong>des</strong><br />
cellules natural killer (immunité innée), mais de récentes étu<strong>des</strong> in vivo ont suggéré <strong>des</strong> interactions possibles entre les cellules tumorales et les<br />
éosinophiles. Il a été observé au cours de nombreux cancers (tumeurs hématologiques ou carcinomes) <strong>des</strong> éosinophilies sanguines et/ou un<br />
recrutement péritumoral d’éosinophiles plus ou moins important (appelé TATE : Tumour Associated Tissue Eosinophilia). Bien que chez certains<br />
patients, ces TATE ont été décrites comme ayant une valeur pronostique positive, peu de choses sont cependant connues sur le rôle exact joué par les<br />
éosinophiles dans la réponse antitumorale.<br />
Notre projet de recherche vise à analyser l’activité cytotoxique <strong>des</strong> éosinophiles vis-à-vis de deux lignées tumorales, un lymphome T et un<br />
adénocarcinome du côlon, et vise à définir les mécanismes impliqués. Nous avons constaté que les éosinophiles purifiés du sang périphérique<br />
pouvaient induire in vitro une apoptose plus ou moins importante de ces deux lignées tumorales, ceci grâce à l’intervention d’un récepteur de l’immunité<br />
innée récemment découvert par notre laboratoire sur l’éosinophile.<br />
Ce projet de recherche pourra permettre de mieux comprendre le rôle joué par les éosinophiles dans les réactions de défense de notre système<br />
immunitaire vis à vis du cancer et pourra peut être ainsi ouvrir <strong>des</strong> perspectives thérapeutiques nouvelles.<br />
Mot(s)-clé(s) : Tumour Associated Tissue Eosinophilia (TATE) & micro-environnement tumoral & immunité innée<br />
LY Ousmane EA2694 - Jean-Marc BRUNETAUD<br />
Apport <strong>des</strong> technologies de l’information et de la communication dans l’amélioration du système de recueil<br />
d’information sanitaire au Mali : cas <strong>des</strong> régions pilotes de Kayes, Koulikoro et Mopti.<br />
Le système d'information sanitaire du Mali est mis en oeuvre par deux structures du ministère de la santé, qui sont la direction nationale de la santé à<br />
travers la division prévention et lutte contre la maladie et le centre national d'information et d'éducation en communication pour la santé. La première<br />
assure la surveillance <strong>des</strong> maladies transmissibles, les maladies à potentiel épidémique et les maladies cibles du programme élargi de vaccination. A<br />
cet effet cette division produit un compte rendu hebdomadaire d'information sur la situation <strong>des</strong> maladies à fort potentiel épidémique à l’attention du<br />
cabinet du ministre de la santé et publie un bulletin épidémiologique mensuel à l’attention <strong>des</strong> professionnels de santé. Cette information est récoltée<br />
auprès de l'ensemble <strong>des</strong> structures sanitaires périphériques par l'intermédiaire du réseau de rac mis en place à cet effet et pour les besoins de<br />
référence en cas de complication. Le rac est un système de communication par radiofréquence qui équipe l'ensemble <strong>des</strong> centres de santé<br />
communautaire, centres de santé de référence, hôpitaux secondaire et régionaux.<br />
Les activités de cette division feront l’objet de notre étude. Qui consistent à analyser les données qui proviennent <strong>des</strong> messages RAC journaliers, <strong>des</strong><br />
enquêtes sur le terrain ainsi que <strong>des</strong> missions de supervision du personnel impliqué dans les activités de surveillance épidémiologique intégrée et de<br />
riposte aux épidémies. Les informations remontent progressivement <strong>des</strong> centres de santé périphériques vers la division en passant par les centres de<br />
santé de référence de cercle et les directions régionales de la santé.<br />
Les maladies actuellement sous surveillance sont : la méningite cérébro-spinale, la rougeole, la fièvre jaune, le choléra, les paralysies flasques aiguës,<br />
le tétanos maternel et néonatal, le paludisme et la dysenterie bacillaire.<br />
Le dispositif de remontée de l’information utilise classiquement les formulaires papiers et les registres de notification au sein <strong>des</strong> centres de santé. La<br />
radiophonie médicale est utilisée pour transmettre quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement les relevés effectués.<br />
L’une <strong>des</strong> faiblesses de ce système est la perte d’information lors du recueil sur les supports papiers et lors de la transmission radiophonique <strong>des</strong><br />
données. L’autre faiblesse est l’absence de standard d’exploitation <strong>des</strong> données entre les différents niveaux du circuit de recueil et de remonté <strong>des</strong><br />
informations.<br />
Ce système classique peu être améliorer par la proposition d’un modèle standard et on proposera un modèle évolué utilisant les nouvelles technologies<br />
de l’information et de la communication. Ces deux modèles complémentaires seront mis en service dans une phase test dans les régions de Kayes,<br />
Koulikoro et Mopti.<br />
Pour le système classique on procédera à :<br />
- L’état <strong>des</strong> lieux du système de recueil d'information sanitaire<br />
- L’analyse de cet système: force, faiblesse et qualité.<br />
- Etude <strong>des</strong> support de recueil de donnée: formulaires et fiches d'investigation<br />
- Proposition d’un modèle standard pour le système classique<br />
- Test et mise en exploitation de ce modèle<br />
Pour le système évolué on procédera à :<br />
- Proposition de modèle informatique pour les supports du système classique<br />
- Recueil rétrospectif de donnée sur ces supports<br />
- Sur les pathologies faisant l'objet d'une surveillance épidémiologiques continues, le choléra sera choisi comme pathologie d'étude<br />
- Développement de version informatique orientée web service: intégrant <strong>des</strong> système de calcul automatique <strong>des</strong> indicateurs statistique (Khi<br />
carré, Médiane , Ratio etc.)<br />
- Ajout <strong>des</strong> fonctionnalités de statscan: permettant de coupler les données statistiques à un système d'information géographique, avec sortie de<br />
résultats sous forme de cartes et de graphiques.<br />
- Analyse <strong>des</strong> bénéfices que peut apporter un tel système en terme de rapidité et de qualité.<br />
Mot(s)-clé(s) : Informatique Médicale & Système d'information sanitaire & TICs & Statistiques médicales<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
MELCHIOR Aurelie UMR8576 - Joël MAZURIER<br />
Rôle de la cyclophiline B dans la migration <strong>des</strong> macrophages<br />
La cyclophiline B (CyPB) est une peptidyl prolyl cis/trans isomérase initialement décrite pour sa propriété à réguler l’activité d’un médicament<br />
immunosuppresseur, la cyclosporine A. Elle possède une activité chimiotactile pour les lymphocytes T et induit leur adhérence à la fibronectine via<br />
l’activation <strong>des</strong> intégrines. Ces réponses sont dépendantes de sa fixation sur son récepteur composé du CD147 et du syndécan-1. Présente dans la<br />
matrice extracellulaire, elle est libérée en réponse à <strong>des</strong> stimuli inflammatoires. Les macrophages seraient donc les premières cellules inflammatoires<br />
susceptibles d’être stimulées par la CyPB. Pour vérifier cette hypothèse, nous utilisons comme modèle cellulaire, la lignée THP1 différenciée en<br />
macrophage. Comme pour les lymphocytes T, la CyPB induit la migration <strong>des</strong> cellules THP1 et l’activation <strong>des</strong> intégrines. L’étude <strong>des</strong> voies de<br />
signalisation révèle que l’activité de la CyPB est dépendante de l’activation <strong>des</strong> MAPK p44/p42, d’une protéine kinase C atypique, la PKC delta, et<br />
d’une PI-3 kinase. Un traitement <strong>des</strong> cellules par la CyPB induit la sécrétion de métalloprotéinases (MMP-9), suggérant que la CyPB induit un<br />
mécanisme impliqué dans la dégradation de la matrice extracellulaire. De plus, l’exposition prolongée <strong>des</strong> cellules à la CyPB augmente leur sensibilité à<br />
la chimiokine RANTES (CCL5), ce qui est corrélée à une surexpression de son récepteur membranaire CCR5. Ces données suggèrent que la CyPB<br />
pourrait intervenir dans la régulation <strong>des</strong> différents mécanismes favorables à la migration <strong>des</strong> macrophages vers le site de l’inflammation.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cyclophiline B & macrophage & inflammation<br />
MEURICE Edwige UMR8576 - Stanislas TOMAVO<br />
Etude fonctionnelle de deux facteurs de transcription putatifs associés à la TBP chez Plasmodium falciparum :<br />
pfTAF10 et pfTAF7<br />
Les mécanismes de régulation de l’expression <strong>des</strong> gènes sont encore mal connus chez Plasmodium falciparum, l’agent causatif du paludisme. Les<br />
étu<strong>des</strong> transcriptomiques effectuées à ce jour montrent qu’il existe une régulation extrêmement fine de l’expression <strong>des</strong> gènes au cours du<br />
développement parasitaire. En revanche, l’analyse du génome de Plasmodium falciparum après son séquençage en 2002, n’a révélé à ce jour que très<br />
peu de facteurs régulant la transcription chez le parasite y compris les facteurs de transcription généraux tels que ceux associés à l’ARN polymérase II.<br />
C’est dans ce contexte que la méthode de prédiction HCA (Hydrophobic Cluster Analysis) a été utilisée pour retrouver ces facteurs. Cette méthode de<br />
reconnaissance <strong>des</strong> structures secondaires a permis d’éviter le biais en aci<strong>des</strong> aminés introduit par la richesse en AT du génome et d’identifier<br />
plusieurs facteurs de transcription généraux associés à l’ARN polymérase II (Callebaut et al, 2005) dont 2 TAFs (« TBP-associated factors »),<br />
composant la TFIID : pfTAF10 et pfTAF7.<br />
La transcription <strong>des</strong> 2 gènes a été mise en évidence par RT-PCR dans les sta<strong>des</strong> intra-érythrocytaires de Plasmodium falciparum, éliminant la<br />
possibilité que les logiciels aient identifié <strong>des</strong> pseudogènes. Nous avons donc entrepris de caractériser ces deux protéines.<br />
Le premier facteur, TAF10, est connu pour interagir séparément avec 3 protéines : TAF3, TAF8 et SPT7. Nous avons mis en évidence par GSTpulldown<br />
que le pfTAF10 interagit avec ses homologues humain TAF8 et SPT7, mais pas avec TAF3. Il semble donc qu’une partie <strong>des</strong> fonctions de<br />
TAF10 soient conservées chez Plasmodium. Néanmoins, aucun de ses partenaires n’a pu être identifié dans le génome de Plasmodium, mais il est<br />
possible qu’une grande divergence ne permette pas de les identifier actuellement par <strong>des</strong> approches bioinformatiques. Nous envisageons donc de<br />
purifier les partenaires de pfTAF10, par GST-pulldown ou immunoprécipitation <strong>des</strong> protéines parasitaires. A ce jour, nous n’avons pu mettre en<br />
évidence la présence de la protéine pfTAF10 dans le parasite, soit parce que la quantité de protéine est trop faible, soit parce que l’affinité de l’anticorps<br />
synthétisé à partir de pfTAF10 recombinant n’est pas suffisante.<br />
Chez Saccharomyces cerevisiae, TAF10 régule l’expression de gènes impliqués dans la progression du cycle cellulaire et chez la drosophile, la souris<br />
et l’homme, il régule l’expression de gènes de la différenciation. Afin de déterminer si pfTAF10 assure le même genre de régulation et de résoudre les<br />
difficultés rencontrées avec les anticorps polyclonaux, nous sommes en train de créer <strong>des</strong> parasites transgéniques sur-exprimant pfTAF10 par la<br />
transfection d’un vecteur d’expression spécifique de Plasmodium falciparum. Le second facteur de transcription TAF7, qui fait également l’objet de notre<br />
étude, est connu comme une <strong>des</strong> clés du démarrage de la transcription par l’ARN polymérase II : la dissociation de TAF7 de son partenaire TAF1, dont<br />
il inhibe l’activité acétyltransférasique, coïncide avec la mise en mouvement du complexe de transcription. Nous avons produit plusieurs protéines<br />
recombinantes exprimant pfTAF7, tronquée ou complète, qui serviront à caractériser ce facteur de transcription. L’étude de ces deux TAFs a pour but<br />
de mieux préciser les mécanismes de la transcription chez Plasmodium falciparum afin de dégager les points de convergence et/ou de divergence par<br />
rapport à la transcription chez les eucaryotes supérieurs. Ensuite, de part leur rôle de médiateur entre le complexe de transcription basal et les facteurs<br />
de transcription spécifiques, les TAFs pourraient nous permettre d’isoler <strong>des</strong> facteurs spécifiques du parasite.<br />
Callebaut I, Prat K, Meurice E, Mornon JP, Tomavo S. (2005) Prediction of the general transcription factors associated with RNA polymerase II in<br />
Plasmodium falciparum : conserved features and differences relative to other eukaryotes. BMC Genomics. 6:100.<br />
Mot(s)-clé(s) : TBP-associated factor (TAF) & Plasmodium falciparum & facteur de transcription<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
MORTIER Laurent U459 - Philippe MARCHETTI<br />
Arguments en faveur de l’engagement précoce d’un processus apoptotique spontané <strong>des</strong> cellules dendritiques<br />
matures.<br />
Introduction : Les essais cliniques de vaccination antitumorale utilisant les cellules dendritiques matures (Dcm) montrent une réponse antitumorale de<br />
type CTL. Mais ces réponses sont inconstantes et généralement transitoires. Une <strong>des</strong> hypothèses pour expliquer ces effets limités serait que les Dcm<br />
meurent rapidement par apoptose après réinjection, avant d’atteindre le ganglion pour stimuler le système immunitaire 72h après. L’apoptose <strong>des</strong> Dcm<br />
serait alors un mécanisme d’échappement <strong>des</strong> tumeurs à la vaccinothérapie par cellules dendritiques (DC). Afin détailler cette hypothèse nous avons<br />
voulu vérifier si les Dcm humaines étaient douées d’apoptose spontanée et chercher à comprendre les processus mis en œuvre en étudiant de manière<br />
comparative l’expression d’un panel de gènes intervenant dans l’apoptose à deux temps de la culture : en fin de la maturation (J6) et après 24h<br />
d’évolution spontanée (j7) (GEArray Q series Human ApoptosisTM (Superarray®)). Enfin, nous avons voulu corréler ces variations d’expression<br />
génique à l’apparition d’événements précoces de l’apoptose en étudiant, aux mêmes temps, la libération du cytochrome C de la mitochondrie vers le<br />
cytosol et l’activation de la caspase 3. Résultats : Sur 96 gènes analysés, 1 gène est sur-exprimés (Bim) et 6 gènes sont sous-exprimés dans les mDCs<br />
à J7 lors de l’analyse Superarray® (C-Flip, Mcl-1, Bcl-X, Ripk2,Fas, TNFR10) . Après RT-PCR, nous avons confirmé que sont sous-exprimés à J7<br />
significativement Bcl-X (p=0,0313), C-Flip (p=0,0313), Fas (p=0,0313). Il y a donc, 24 h après maturation, une dérégulation de l’expression génique de<br />
protéines anti-apoptotiques tels qu’un inhibiteur de la voie intrinsèque Bcl-X et un inhibiteur de la voie extrinsèque c-Flip. D’autre part, nous avons<br />
montré que <strong>des</strong> manifestations précoces de l’apoptose apparaissent de manière simultanée à ces modifications d’expression génique. En effet, 24h<br />
après maturation, nous avons mis en évidence, dans une grande majorité <strong>des</strong> cellules, une libération du cytochrome C de la mitochondrie vers le<br />
cytosol accompagnée d’une activation de la caspase 3. Conclusion : Nous avons donc démontré que les Dcm entent spontanément en apoptose in<br />
vitro, rapidement après la maturation, en réponse à un programme génétique comme le suggère la dérégulation <strong>des</strong> gènes de Bcl-X et c-Flip. Ce<br />
phénomène, s’il se déroule in vivo après réinjection <strong>des</strong> Dcm à un patient, pourrait expliquer en partie les échecs à la vaccination antitumorale. Enfin, la<br />
compréhension <strong>des</strong> mécanismes impliqués dans l’apoptose spontanée <strong>des</strong> Dcm pourra, à terme, nous aider à optimiser de manière rationnelle les<br />
protocoles de préparation <strong>des</strong> Dcm afin d’améliorer les réponses antitumorales.<br />
Mot(s)-clé(s) : cellules dendritiques & apoptose & cancer<br />
NGOUANESAVANH Tra My EA3609 - Jean-Charles CAILLIEZ<br />
Epidémiologie moléculaire de la cryptosporidiose en France et en Haiti : Caractérisation génétique et<br />
phénotypique <strong>des</strong> variétés infra spécifiques de Cryptosporidium (Protiste Apicomplexa).<br />
Les coccidies du genre Cryptosporidium peuvent infecter le tractus gastro-intestinal de nombreuses espèces de vertébrés dont l’homme. Elles sont<br />
l’agent étiologique de la cryptosporidiose, maladie émergente et cause reconnue de diarrhée chronique grave chez le patient sidéen. Des diarrhées<br />
sévères de plus en plus fréquentes chez les individus immunocompétents, soit de façon sporadique, soit en contexte épidémique, ont également été<br />
reportées, faisant de Cryptosporidium un réel problème de santé publique. Ubiquitaires, persistants et résistants à la désinfection (chloration), ces<br />
parasites représentent un risque infectieux environnemental non négligeable. L’identification <strong>des</strong> espèces et génotypes du parasite est essentielle pour<br />
résoudre les sources, voies et mécanismes de l’infection, mais elle est rendue difficile par l’insuffisance <strong>des</strong> clés usuelles de la taxonomie (morphologie,<br />
spécificité d’hôte).<br />
Dans ce contexte, la stratégie de ce travail est double : Une approche moléculaire basée sur la combinaison de marqueurs mini- et microsatellites, très<br />
polymorphes, a identifié 34 groupes parmi 117 isolats parasitaires humains et animaux, de France et de Haïti. A partir de ces génotypes multiloci, une<br />
analyse de génétique <strong>des</strong> populations a révélé une structure génétique à prédominance clonale, malgré l’existence d’un stade sexuel obligatoire au<br />
cours du cycle biologique de Cryptosporidium. Il s’agit d’une donnée essentielle pour estimer la stabilité spatio-temporelle <strong>des</strong> génotypes, dont<br />
dépendent la possibilité de traçage du pathogène dans les écosystèmes ainsi que les risques de propagation <strong>des</strong> résistances aux antiparasitaires.<br />
D’autre part, afin de définir l’impact médical et épidémiologique de ces populations (transmissibilité, pouvoir pathogène, distribution géographique), il est<br />
nécessaire de les caractériser d’un point de vue phénotypique, in vitro sur culture cellulaire (système de cellules épithéliales intestinales humaines HCT-<br />
8) et in vivo, grâce à <strong>des</strong> modèles murins (modèle de souris génétiquement immunodéprimées SCID). De tels systèmes permettront dans un premier<br />
temps de comparer les différences phénotypiques d’une espèce de Cryptosporidium à une autre. Ils seront ensuite affinés afin de permettre une<br />
discrimination à un niveau infra spécifique.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cryptosporidium & microsatellite & génétique <strong>des</strong> populations & modèles d'infection<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
OUK Thavarak EA1046 - Régis BORDET<br />
Conséquences vasculaires <strong>des</strong> processus d'ischémie-reperfusion cérébrales : approches pharmacologiques <strong>des</strong><br />
phénomènes de plasticité et de récupération fonctionnelle<br />
A la phase aiguë <strong>des</strong> accidents vasculaires cérébraux, les stratégies thérapeutiques reposent essentiellement sur l’utilisation d’agents fibrinolytiques à<br />
usage limitée en raison d’une fenêtre thérapeutique courte et de l’incidence <strong>des</strong> hémorragies intra-cérébrales. L’échec <strong>des</strong> traitements neuroprotecteurs<br />
évalués en thérapeutique humaine explique l’intérêt de la modulation d’autres cibles pharmacologiques, y compris vasculaires.<br />
Ce travail a pour objectif de déterminer par plusieurs approches pharmacologiques si la paroi vasculaire pourrait représenter une cible pharmacologique<br />
pertinente à la phase aiguë du processus d’ischémie-reperfusion en testant plusieurs hypothèses : (i) l’induction d’une neutropénie prévient <strong>des</strong><br />
complications hémorragiques induites par la fibrinolyse (ii) l’activation <strong>des</strong> récepteurs nucléaires PPAR-α (à actions anti-inflammatoire et antioxydante)<br />
induit une protection cérébro-vasculaire associée à une diminution <strong>des</strong> hémorragies intra-cérébrales (iii) une stratégie antioxydante permet<br />
une protection vasculaire et cérébrale parallèlement à une récupération fonctionnelle.<br />
Nous avons utilisé un modèle d’occlusion intraluminale de l’artère cérébrale moyenne et un modèle de complications hémorragiques par le rtPA chez le<br />
rat afin de simuler une ischémie cérébrale. Le volume d’infarctus <strong>des</strong> animaux ischémiés était déterminé par histomorphométrie. Les complications<br />
hémorragiques ont été quantifiées de façon visuelle, au moment de la coupe <strong>des</strong> cerveaux. Quant à l’analyse de la réactivité vasculaire, elle se faisait à<br />
l’aide de l’artériographe d’Halpern : la relaxation endothélum-dépendante ainsi que la relaxation musculaire lisse dépendante <strong>des</strong> canaux Kir2.1 étaient<br />
ainsi évaluées. Pour étudier le rôle <strong>des</strong> polynucléaires neutrophiles, une neutropénie était induite par injection de vinblastine ou d’un anticorps<br />
monoclonal anti-RP3 avant l’ischémie. Dans un second protocole, le fénofibrate, activateur synthétique <strong>des</strong> récepteurs nucléaires PPAR-α, était<br />
administré par gavage bi-quotidien <strong>des</strong> rats pendant 72 heures après l’ischémie. Enfin dans un dernier protocole, <strong>des</strong> rats étaient traités par la<br />
stobadine, antioxydant de synthèse, à 1h et 6h de l’ischémie. Ces rats étaient sacrifiés soit à 24h, 72h ou 7jours de reperfusion.<br />
L’induction d’une neutropénie par la vinblastine diminuait les complications hémorragiques associées à une prévention de la dysfonction endothéliale<br />
post-ischémique et à une diminution du volume d’infarctus. Par contre l’inactivation <strong>des</strong> polynucléaires neutrophiles par un anticorps monoclonal<br />
prévenait uniquement les altérations vasculaires post-ischémiques en parallèle d’une diminution <strong>des</strong> complications hémorragiques.<br />
Le fénofibrate, administré à la phase aiguë de l’ischémie, protégeait <strong>des</strong> altérations vasculaires post-ischémiques en parallèle d’une diminution <strong>des</strong><br />
lésions ischémiques et <strong>des</strong> complications hémorragiques.<br />
Un traitement <strong>des</strong> rats par la stobadine à la phase aiguë de l’ischémie permettait une récupération fonctionnelle à 7 jours en comparaison <strong>des</strong> animaux<br />
traités par le véhicule. La stobadine prévenait la dysfonction endothéliale mais n’accélérait pas la restauration de la relaxation musculaire lisse<br />
dépendante <strong>des</strong> canaux Kir2.1.<br />
En conclusion, la protection <strong>des</strong> vaisseaux sanguins cérébraux après une ischémie- reperfusion suivie ou non d’une fibrinolyse apparaît<br />
comme une cible intéressante susceptible de prévenir la maturation de l’ischémie cérébrale et éventuellement les complications hémorragiques. Les<br />
récepteurs nucléaires PPAR-α représentent expérimentalement une stratégie thérapeutique potentielle de protection de la paroi vasculaire au<br />
décours du processus d’ischémie-reperfusion et de fibrinolyse, posant la question de la pertinence de cette protection fonctionnelle dans l’installation<br />
d’une neuroprotection. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour déterminer les mécanismes moléculaires de ces protections vasculaire et<br />
cérébrale.<br />
Mot(s)-clé(s) : ischémie cérébrale & paroi vasculaire & thrombolyse & PPAR-alpha<br />
PELAYO Sylvia EA2694 - Paul FRIMAT<br />
La coopération médecin-infirmier au sein du circuit du médicament à l’hôpital:modalités d’ajustement du<br />
référentiel commun et conséquences pour l’informatisation <strong>des</strong> situations de travail<br />
La publication du rapport « To Err is Human » a bouleversé l’intérêt porté à la gestion <strong>des</strong> risques en Santé. Il met effectivement l’accent sur les<br />
nombreuses erreurs qui interviennent lors de la prise en charge médicale d’un patient, notamment au cours du processus de prescription –<br />
administration <strong>des</strong> médicaments. Aux Etats Unis, pour la seule année 1997, environ 98000 morts seraient imputables aux erreurs médicales en milieu<br />
hospitalier. Les erreurs concernant les médicaments seraient responsables de « seulement » 7000 décès. En France, de telles estimations chiffrées ne<br />
sont pas disponibles, mais l’absence de mesure ne signifie évidemment pas que ce problème de santé publique n’existe pas.<br />
L’informatisation du processus de prescription thérapeutique en milieu hospitalier est considéré par beaucoup comme LA solution pour améliorer sa<br />
qualité. De nombreuses étu<strong>des</strong> ont confirmé l’impact positif de ces systèmes qui permettent de diminuer significativement les taux d’erreurs<br />
médicamenteuses et d’accidents iatrogéniques. Toutefois leur implémentation demeure extrêmement difficile. En effet, l’impact de l’introduction d’un tel<br />
système sur la structuration du travail individuel, mais surtout coopératif est indéniable. Il déstabilise la nature profonde de l’activité coopérative entre le<br />
médecin et l’infirmier et génère ainsi <strong>des</strong> erreurs et <strong>des</strong> risques nouveaux pour le patient. Les objectifs de la thèse sont de (1) modéliser les activités<br />
coopératives mises en œuvre dans le processus et (2) évaluer l’impact de l’introduction d’un système informatisé sur les situations de travail et au final<br />
sur le contrôle de processus. Les résultats obtenus permettront de mettre en lumière les facteurs critiques dans une telle situation de travail et ainsi de<br />
prévenir les nouveaux risques et erreurs non anticipables provoqués par l’introduction d’un système nouveau.<br />
Globalement, le cadre théorique et la méthode employés ont permis de modéliser les activités coopératives mises en jeu dans les situations de travail «<br />
traditionnelles », c’est-à-dire avec un dispositif papier et de mettre en lumière les facteurs « déterminants » pour un processus de prescription<br />
thérapeutique sécurisé et de qualité. L’ajustement <strong>des</strong> prescriptions thérapeutiques se fait essentiellement pendant le tour médical pour lequel deux<br />
types d’organisations peuvent exister entre le médecin et l’infirmière : une coopération synchrone lorsque l’infirmière accompagne le médecin lors de<br />
son tour et une coopération asynchrone lorsque le médecin fait le tour seul. Le partage <strong>des</strong> informations est facilité lorsqu’il y a une coopération<br />
synchrone au lit du malade. Les deux acteurs peuvent échanger directement et simultanément les informations, ce qui permet d’obtenir un ordre<br />
négocié, tenant compte <strong>des</strong> contraintes de chacun et facilitant l’exécution de la tâche pour chacun <strong>des</strong> partenaires. Les deux acteurs, en partageant<br />
leurs connaissances et représentations complémentaires de la situation, peuvent prendre en charge le patient efficacement avec chacun une vision<br />
globale sur le processus. Dans la situation de coopération asynchrone, l’absence d’échanges synchrones systématiques génère <strong>des</strong> ordres davantage<br />
détaillés, mais qui paradoxalement induisent plus d’incertitude et d’anxiété chez les infirmiers. Dans cette situation de coopération asynchrone, les<br />
acteurs fonctionnent « à l’aveugle » quant aux informations échangées pendant le tour, ce qui fragilise le bon déroulement du processus de prescription<br />
thérapeutique. Ces résultats doivent maintenant être généralisés aux situations de travail informatisées. Tout au moins, un outil de soutien à cette<br />
activité ne devrait pas seulement permettre la coordination <strong>des</strong> actions et la planification <strong>des</strong> prescriptions thérapeutiques, mais devrait également<br />
permettre la transmission <strong>des</strong> informations nécessaires au contrôle du processus pour l’ensemble <strong>des</strong> acteurs et ainsi leur permettre une vision globale<br />
sur ce processus.<br />
Mot(s)-clé(s) : ingénierie <strong>des</strong> facteurs humains & circuit du médicament & coopération synchrone/asynchrone & Aspects cognitifs<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
PHAM Van Minh EA2683 - André THEVENON<br />
ETUDE DES PRESSIONS APPLIQUEES PAR CORSET DE CHÊNEAU POUR CORRECTION D'UNE SCOLIOSE<br />
IDIOPATHIQUE DE L'ADOLESCENT<br />
INTRODUCTION<br />
Dans les scolioses, les corsets cherchent à réduire les courbures vertébrales par l'application de pressions appliquées sur le tronc. Il existe cependant<br />
peu d'étude quantitative <strong>des</strong> pressions effectivement appliquées. Nous avons voulu tester une méthode de mesure <strong>des</strong> pressions d'interface entre<br />
corset et peau, apprécier l'effet de la tension <strong>des</strong> sangles et analyser la variabilité de ces pressions en différentes positions.<br />
MATERIEL ET METHODE<br />
Etude prospective portant sur 20 patients (1 garçon et 19 filles) présentant une scoliose idiopathique traitée par corset de Chêneau. L'âge moyen est<br />
de 13,3 ± 1,9 ans. Douze patients ont <strong>des</strong> courbures dorsales droites, 8 ont <strong>des</strong> courbures dorso-lombaires droites. Sans corset l'angle moyen de Cobb<br />
était de 30,9 ± 6,9 pour les scolioses dorsales droites et 33,6 ± 7,3 pour les scolioses dorso-lombaires droites. Nous avons utilisé le système Tekscan.<br />
Celui comprend un capteur de pression Clinseat inséré dans une poignée d'interface et relié à un connecteur USB. Deux essais à 15' d'intervalle sont<br />
réalisés.Lors du premier essai les tensions <strong>des</strong> sangles sont déterminées de façon empirique par le médecin consultant. Lors du second essai les<br />
sangles sont resserrées de 2 cm. Pendant chaque essai on demande au patient d'assumer 9 positions correspondant à <strong>des</strong> tâches ordinaires.<br />
RESULTATS<br />
Le matériel permet d'identifier les zones de pression correspondant aux points d'appui du corset. Le resserrement <strong>des</strong> sangles entraîne dans chaque<br />
cas une augmentation significative <strong>des</strong> pressions quelque soit la position étudiée et le type de scoliose. Le décubitus latéral droit augmente<br />
significativement l'effet correcteur du corset (p
POURCET Benoit U545 - Corine GLINEUR<br />
Rôle <strong>des</strong> phosphorylations sur la régulation de l’activité du récepteur nucléaire Peroxisome Proliferator-<br />
Activated Receptor alpha (PPARα)<br />
PPARα est un facteur de transcription appartenant à la famille <strong>des</strong> récepteurs nucléaire. Il régule l’expression de gènes en se liant à <strong>des</strong> éléments<br />
de réponse spécifiques sous la forme d’hétérodimères avec le récepteur nucléaire RXRα (Retinoid X Receptor). PPARα joue un rôle<br />
important dans la régulation du métabolisme <strong>des</strong> lipi<strong>des</strong>, <strong>des</strong> lipoprotéines et dans le contrôle de la réponse inflammatoire. Ces différentes fonctions lui<br />
confèrent donc un rôle protecteur contre l’athérosclérose.<br />
L’activité de PPARα peut être régulée de différentes manières. Il est activé par <strong>des</strong> ligands naturels tels que les aci<strong>des</strong> gras ou par <strong>des</strong> ligands<br />
synthétiques tels que les fibrates. De plus, différents stimuli comme l’insuline, le glucose peuvent modifier l’expression de cette protéine. PPARα<br />
est une protéine instable qui peut être dégradée par le système ubiquitine/proteasome. Enfin, les phosphorylations représentent un mécanisme majeur<br />
impliqué dans la régulation de l’activité de PPARα. Nous avons montré que les Proteines Kinases C/PKC sont capables de phosphoryler<br />
PPARα au niveau <strong>des</strong> résidus sérine S179 et S230 du domaine charnière situé entre le domaine de liaison à l’ADN et le domaine de liaison au<br />
ligand.<br />
Notre projet consiste à comprendre le mécanisme d’action <strong>des</strong> PKC sur l’activité de PPARα. Différents mutants de la protéine PPARα ont<br />
été générés: la protéine mutante PPARα S179,230A dans laquelle les deux résidus cibles <strong>des</strong> PKC ont été remplacés par <strong>des</strong> résidus alanine (A)<br />
non phosphorylables et la protéine mutante PPARα S179,230D dans laquelle les résidus Ser ont été remplacés par <strong>des</strong> résidus aspartates (D)<br />
capables de mimer la charge négative du phosphate. La protéine mutante S179,230D pourrait donc agir comme une protéine constitutivement<br />
phosphorylée. Tandis que PPARα S179,230A a une activité transactivatrice ligand-dépendante significativement réduite suggérant que la<br />
phosphorylation <strong>des</strong> S179 et S230 favorisent l’activation par le ligand, la protéine mutante PPARα S179,230D a une activité transactivatrice<br />
basale et dépendante du ligand réduite.<br />
Nous avons montré que cette diminution d’activité n’est pas liée à un défaut de conformation ou de localisation cellulaire de la protéine mais à une<br />
liaison différentielle avec ses cofacteurs. Ainsi, la protéine mutante PPARα S179,230D est plus exprimée dans les cellules que la protéine<br />
sauvage suggérant une augmentation de sa stabilité. De plus, nous avons montré précédemment que le co-répresseur nucléaire N-CoR stabilise la<br />
forme sauvage de PPARα. Enfin, nos résultats montrent que la surexpression de la protéine N-CoR stabilise davantage la protéine mutante<br />
PPARα S179,230D. Le remplacement <strong>des</strong> S179 et S230 par un acide aspartique favorise donc l’interaction de PPARα avec N-CoR. De<br />
plus, nous avons montré que la surexpression de la protéine RXRα permet d’augmenter l’activité transcriptionnelle de PPARα S179,230D<br />
de manière significative suggérant que la phosphorylation <strong>des</strong> résidus S179 et S230 pourraient moduler l’interaction de PPARα avec RXRα.<br />
La partie amino terminale de PPARα contient une région d’activation, AF-1, dont la fonction est indépendante du ligand et dépendante de la<br />
phosphorylation par les MAPKinases (mitogen activated protein kinase). Puisque la protéine PPARα S179,230D a perdu son activité basale, nous<br />
avons émis l’hypothèse que le remplacement <strong>des</strong> S179 et S230 par <strong>des</strong> Asp pourrait bloquer la phosphorylation <strong>des</strong> sérines cibles <strong>des</strong> MAPK (S12 et<br />
S21). Nous allons donc étudier l'activité de mutants de PPARα combinant le remplacement <strong>des</strong> Ser cibles <strong>des</strong> MAPK et <strong>des</strong> PKC par une Ala ou<br />
un Asp.<br />
En conclusion, il est probable que la phosphorylation de PPARα par les PKC favorise son interaction avec ses corépresseurs permettant ainsi la<br />
constitution d’une réserve nucléaire de PPARα rapidement mobilisable et active pour une réponse métabolique immédiate.<br />
Mot(s)-clé(s) : PPARalpha & PKC & regulations post-traductionnelles<br />
RZEPKA Marie-Amelie EA2690 - Chantal VAN HALUWYN<br />
Epuration de l’air intérieur par les plantes : Rendement épuratoire et effets du formaldéhyde, de composés<br />
organiques volatils, et du monoxyde de carbone observés chez 3 plantes test exposées en laboratoire.<br />
Diverses étu<strong>des</strong> ont montré que la qualité de l'air est, pour de nombreux polluants, moins satisfaisante à l'intérieur qu'à l'extérieur <strong>des</strong> bâtiments. Or, la<br />
majorité <strong>des</strong> citadins passe environ 80 à 90 % de leur temps à l'intérieur d'ouvrages construits ; la maîtrise de la pollution <strong>des</strong> ambiances intérieures<br />
apparaît donc essentielle. Pendant les années 80, le Dr Bill WOLVERTON, chercheur à la NASA, a commencé à mettre en évidence le pouvoir<br />
épurateur de certaines plantes d'intérieur sur <strong>des</strong> polluants tels que le formaldéhyde, le benzène ou le monoxyde de carbone. Dans le même esprit, en<br />
association avec le CSTB, nous menons actuellement <strong>des</strong> travaux sur les capacités épuratoires <strong>des</strong> plantes d’intérieur et les effets <strong>des</strong> polluants sur<br />
celles-ci.<br />
Les différents gaz étudiés sont introduits dans une enceinte expérimentale étanche de 300L, en verre, qui contient les plantes testées (6 Chlorophytum<br />
comosum, 6 Dracæna marginata ou 6 Scindapsus aureus). Les paramètres d’exposition (notamment le taux d’humidité relative) sont contrôlés et le<br />
suivi de la teneur en gaz dans l’enceinte nous permet de déterminer les cinétiques d'élimination sur 24 heures.<br />
Selon les premiers résultats, la vitesse d’épuration du polluant et la quantité éliminée varient en fonction de sa nature et de l’espèce utilisée. Ainsi le<br />
monoxyde de carbone est éliminé en totalité en moins de 24 heures, contre 55% pour le formaldéhyde. Au niveau <strong>des</strong> plantes, Chlorophytum comosum<br />
semble être l’espèce la plus efficace, suivie de Scindapsus aureus pour l’élimination du formaldéhyde.<br />
Les polluants se comportent différemment au sein <strong>des</strong> plantes. En effet, la quantité de toluène dosée dans les feuilles est proportionnelle à la quantité<br />
injectée, alors que nous n’y retrouvons pas de benzène. Quant au formaldéhyde, il est utilisé dans le métabolisme de la plante.<br />
Nous n’observons pas d’effet macroscopique <strong>des</strong> polluants sur les végétaux. En revanche, le test comètes, pratiqué sur <strong>des</strong> plantes exposées sous<br />
cloche à différentes concentrations de benzène a permis de mettre en évidence un effet génotoxique de ce polluant proportionnel à sa concentration.<br />
Les dosages de glutathion montrent une tendance à la diminution de la forme réduite en fonction de la concentration en polluant, ce qui étaye<br />
l’hypothèse d’un stress oxydant subi par la plante, mais aussi, dans le cas du benzène, de l’existence possible de mécanismes de conjugaison.<br />
Actuellement, nous complétons ces résultats par le dosage de marqueurs de stress oxydant enzymatiques tels que l’ascorbate peroxydase et la<br />
guaiacol peroxydase. En outre, d’autres paramètres physiologiques, tels que la photosynthèse seront étudiés.<br />
Mot(s)-clé(s) : épuration de l'air intérieur & plante & génotoxicité & stress oxydant<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
SABAOUNI Ahmed EA1043 - Said YOUS<br />
Conception et synthèse de dérivés benzofuraniques, ligands potentiels <strong>des</strong> récepteurs mélatoninergiques<br />
La mélatonine (1) est une neurohormone synthétisée la nuit, principalement par la glande pinéale. Son intervention dans de nombreux processus<br />
physiologiques ne fait plus aucun doute et justifie les recherches intenses qui lui sont consacrées. Ses perspectives thérapeutiques essentielles<br />
concernent la resynchronisation <strong>des</strong> rythmes biologiques comme par exemple le cycle veille-sommeil dans les cas du décalage horaire, du travail posté<br />
et <strong>des</strong> désordres affectifs saisonniers. Toutefois l’intérêt thérapeutique de la mélatonine se trouve limité par un certain nombre d’inconvénients : temps<br />
de demi-vie court et action ubiquitaire, due notamment à sa lipophilie et à la pluralité de ses récepteurs. Chez l’homme, deux sous-types réceptoriels<br />
MT1 et MT2 ont été clonés et séquencés mais leur rôle physiologique et leur mécanisme d’action restent à clarifier. L’objectif de ce travail réside dans la<br />
conception et la synthèse de nouveaux ligands mélatoninergiques qui serviraient d’outils pharmacologiques et qui, en outre, pourraient conduire à la<br />
découverte de nouvelles approches thérapeutiques.<br />
Mot(s)-clé(s) : mélatonine & agomélatine<br />
SCHIKORSKI David FRE 2933 - Michel SALZET<br />
Pepti<strong>des</strong> intervenant dans les phénomènes de neuroprotection/régénération du système nerveux central chez la<br />
sangsue Hirudo medicinalis<br />
Lorsqu’il est endommagé et/ou infecté, le système nerveux central (SNC) <strong>des</strong> vertébrés est capable de mettre en place une réponse immunitaire innée<br />
puis une réponse adaptative bien organisée. Une certaine dualité existe en ce qui concerne les effets <strong>des</strong> molécules et <strong>des</strong> cellules de l’immunité<br />
engagées dans ces processus. Certaines seraient bénéfiques en participant à la réparation et/ou la protection alors que d’autres seraient néfastes en<br />
prenant part à la dégénérescence neuronale caractéristique <strong>des</strong> neurones de SNC lésé ou infecté de vertébrés.<br />
Chez les invertébrés, très peu de données nous renseignent sur l’immunité du SNC. Nos premiers résultats suggèrent l’existence d’une réponse<br />
immunitaire au sein du SNC de notre modèle la sangsue Hirudo medicinalis. Contrairement à ce que l’on observe chez les vertébrés, la réponse<br />
immunitaire chez la sangsue ne semble pas développer d’effets délétères puisqu’elle est capable de régénérer entièrement son SNC après lésion. Sur<br />
ces bases, nos objectifs sont de déterminer par une approche ciblée le rôle <strong>des</strong> molécules et <strong>des</strong> cellules « immunitaires » du SNC de la sangsue<br />
impliquées lors <strong>des</strong> phénomènes de neuroprotection/réparation.<br />
A l’heure actuelle, différentes approches à la fois biochimiques et moléculaires ont permis de caractériser <strong>des</strong> pepti<strong>des</strong> pouvant intervenir dans les<br />
phénomènes de protection et/ou de réparation du SNC de la sangsue Hirudo medicinalis. Ainsi <strong>des</strong> cultures différentielles de chaînes nerveuses lésées<br />
nous ont permis d’isoler par HPLC un nouveau peptide antimicrobien particulièrement intéressant car exprimé au sein du SNC. Ce peptide joue un rôle<br />
important dans la protection du site de lésion vis-à-vis <strong>des</strong> pathogènes. En ce qui concerne la réparation, tout comme chez les vertébrés, un<br />
recrutement <strong>des</strong> cellules microgliales est observé après lésion du SNC chez la sangsue. La cytokine proinflammatoire EMAP-II (endothélial monocyte<br />
activating factor II) bien connue chez les vertébrés pour son rôle dans le recrutement <strong>des</strong> cellules microgliales au site de lésion du SNC, a été retrouvée<br />
chez la sangsue Hirudo medicinalis grâce aux banques d’EST embryonnaires.<br />
La caractérisation de ces molécules mais également l’étude combinée de leurs rôles fonctionnels dans un système biologique simple nous permettra<br />
peut-être de mieux comprendre les processus liés à la régénération totale du SNC chez la sangsue Hirudo medicinalis.<br />
Mot(s)-clé(s) : Peptide antimicrobien & immunité & régénération & sangsue<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
SIMERABET Malika EA1046 - Benoit VALLET<br />
les premieres minutes de reperfusion une autre fenêtre de protection<br />
L’accident vasculaire cérébral constitue l’un <strong>des</strong> problèmes majeurs de santé publique dans les pays industrialisés. Les possibilités thérapeutiques étant<br />
limitées, la reperfusion reste le traitement de choix à la phase aigue de l’infarctus. Un nouveau concept baptisé récemment « postconditionnement »,<br />
s’est avéré capable de protéger le cœur et de réduire la taille de l’infarctus, il s’agit de succession de brèves occlusion-reperfusion au décours<br />
immédiat d’une occlusion nécrosante, cette manœuvre correspond à une modulation de la reperfusion.<br />
L'objectif de ce travail était de tester si cette nouvelle approche de modulation de la reperfusion à la phase aigue d’une ischémie cérébrale<br />
expérimentale, permet l’installation d’un effet neuroprotecteur. Et ensuite étudier les mécanismes mis en jeu dans cette cytoprotection, notamment<br />
l’implication du canal potassique mitochondrial ATP dépendant mito K ATP, le monoxyde d’azote NO, les espèces réactives de l’oxygène ROS et le<br />
pore de transition de la perméabilité membranaire mitochondriale mptp.<br />
L’ischémie cérébrale est induite par occlusion endoluminale de l’artère cérébrale moyenne chez le rat pendant 60 minutes suivie de 24 heures de<br />
reperfusion. Le postconditionnement ischémique (postC) est réalisé après la période de l’ischémie, par l’application de 3 cycles de 30 sec d’ischémiereperfusion<br />
I/R à partir de la première minute de la reperfusion. Un troisième groupe le postconditionnement retardé pour lequel les séquences I/R de<br />
30 sec sont décalées de 5 minutes de reperfusion.<br />
L’implication du canal potassique était vérifiée par l’administration de diazoxide (10 mg/kg), un agoniste sélectif du mito K ATP, et de 5hydroxydécanoate<br />
5-HD (40 mg/kg), un antagoniste spécifique du mito K ATP. Le N (oméga)-nitro-L-arginine-methyl ester (L-NAME), un inhibiteur de<br />
toutes les isoformes de la NO synthétase a été administré pour démontrer le rôle du NO. Pour caractériser la relation entre le mito K ATP et le NO,<br />
nous avons administré le nitroprussiate de sodium snp (3mg/kg/min), un donneur de NO avec le 5-HD, un deuxième groupe a été traité par (diazoxide<br />
+L NAME). La ciclosporine A (10mg/kg, i.v) a été administrée pour mettre en évidence le rôle du mptp dans l’effet du postC<br />
le postC induit une neuroprotection qui se traduit par une diminution de 41% de la taille de l’infarctus, cet effet est perdu quand les séquences sont<br />
décalées.<br />
L’administration de diazoxide en lieu et place du postC mime l’effet neuroprotecteur, alors que l’administration de 5-HD abolit cette protection.<br />
L’inhibition de la synthèse de NO bloque cette protection également<br />
Le NO est impliqué en amont et en aval du mito K ATP<br />
Le blocage de l’ouverture du pore de transition de perméabilité membranaire, par la ciclosporine A induit une protection.<br />
Les premières minutes de la reperfusion sont critiques et constituent une autre fenêtre de protection. Ce nouveau concept réactive le débat sur la<br />
nécrose liée à la reperfusion.<br />
Deux directions principales sont envisageables, la première est la poursuite <strong>des</strong> travaux sur la voie de signalisation intracellulaire convergeant vers la<br />
mitochondrie, à l'origine de la limitation de la mort cellulaire. Et la deuxième, l’étude de l’impact de la modulation de la reperfusion dans la limitation du<br />
stress oxydant suite à l’ischémie-reperfusion analysée par la technique de fluorescence à l’hydroéthidine.<br />
Mot(s)-clé(s) : ischemie_ reperfusion & mito K-ATP & NO & ROS<br />
STANDAERT Annie EMI360 - Daniel POULAIN<br />
Candida albicans est un immunogène potentiel <strong>des</strong> anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) marqueurs<br />
de la maladie de Crohn.<br />
La maladie de Crohn (MC) est, avec la rectocolite hémorragique (RCH), une maladie inflammatoire chronique de l’intestin. Les mécanismes<br />
physiopathologiques de la MC reposent sur <strong>des</strong> facteurs environnementaux et de susceptibilité génétique, associés à une dérégulation de la réponse<br />
immunitaire intestinale, notamment vis-à-vis de la flore endogène. Parallèlement au processus inflammatoire responsable <strong>des</strong> lésions, les patients<br />
développent une réponse humorale dirigée contre divers antigènes microbiens. Parmi eux, <strong>des</strong> anticorps (Acs) anti-levures sont fréquemment rapportés<br />
chez les patients atteints de MC. Il s’agit <strong>des</strong> anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae. Le laboratoire est à l’origine du test immuno-enzymatique de<br />
détection de ces Acs, qui utilise le mannane d’une souche de S. cerevisiae (SU1) et qui ont été dénommés ASCA. Les étu<strong>des</strong> séro-épidémiologiques<br />
issues du laboratoire ont montré que les ASCA sont présents chez 60% <strong>des</strong> patients MC, 10% <strong>des</strong> patients RCH mais qu’ils sont également présents<br />
chez 20% <strong>des</strong> parents sains du premier degré de patients MC, contre 7% dans la population témoin. Les ASCA sont maintenant largement utilisés pour<br />
le diagnostic et la stratification phénotypique <strong>des</strong> patients MC. Le laboratoire a également montré que les ASCA sont dirigés principalement contre un<br />
épitope de structure Man α-1,3 (Man α-1,2 Man)n [n=1 ou 2], mais l’immunogène à l’origine <strong>des</strong> Acs contre cet haptène restait inconnu.<br />
Ces dernières années les étu<strong>des</strong> structurales et génétiques ont établi que C. albicans possédait les mannosyltransférases impliquées dans la synthèse<br />
<strong>des</strong> structures oligomannosidiques « ASCA » et que leur expression était modulée par les conditions de milieu. Ce travail a pour objectif de déterminer<br />
si C. albicans peut être un immunogène <strong>des</strong> ASCA.<br />
L’étude humaine a concerné l’analyse sérologique de patients atteints de MC ou de candidose systémique. L’étude expérimentale a concerné <strong>des</strong><br />
lapins infectés par C. albicans. Les réponses humorales ont été déterminées avec les test ASCA et Platelia Candida Ac®. Les Acs ont été purifiés par<br />
affinité sur <strong>des</strong> analogues de synthèse <strong>des</strong> épitopes majeurs ASCA. Ils ont ensuite été utilisés pour analyser l’expression <strong>des</strong> épitopes ASCA sur<br />
différentes molécules, ainsi qu’à la surface <strong>des</strong> cellules de C. albicans et de S. cerevisiae obtenues dans diverses conditions environnementales.<br />
Nous avons montré que chez l’homme et les lapins, l’infection par C. albicans pouvait être à l’origine d’une réponse humorale ASCA. L’utilisation d’Acs<br />
purifiés a permis de montrer que C. albicans était capable d’exprimer les épitopes majeurs ASCA sur une mannoprotéine, similaire à une<br />
mannoprotéine de S. cerevisiae. En modifiant les conditions de croissance, le mannane de C. albicans était capable de mimer les caractéristiques<br />
antigéniques du mannane de S. cerevisiae dans sa capacité à détecter <strong>des</strong> ASCA chez les patients MC. Cette surexpression <strong>des</strong> épitopes ASCA par C.<br />
albicans a été observée dans les tissus humains infectés.<br />
L’ensemble <strong>des</strong> éléments expérimentaux et cliniques de cette étude démontre donc que C. albicans peut être un immunogène <strong>des</strong> ASCA, suggérant<br />
que cette levure endogène pourrait être l’un <strong>des</strong> micro-organismes vis-à-vis <strong>des</strong>quels se manifeste une rupture de tolérance du système immunitaire<br />
lors de la MC.<br />
Les travaux actuels concernent l’analyse <strong>des</strong> relations entre la colonisation intestinale par C. albicans et les ASCA dans le cadre <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> familiales<br />
sur la MC conduites en France et en Belgique. Parallèlement, nous participons avec le CIC à la mise en place d’un essai thérapeutique chez <strong>des</strong><br />
patients opérés pour une MC, dont l’objectif est d’évaluer l’effet d’un traitement antifongique sur les taux d’ASCA et sur la survenue <strong>des</strong> récidives postopératoires.<br />
Ces travaux menés avec le service de gastroentérologie du CHRU, devrait nous permettre de confirmer ou non l'implication de C. albicans<br />
dans la production <strong>des</strong> ASCA et, par la suite, dans la physiopathologie de la MC.<br />
Mot(s)-clé(s) : Maladie de Crohn & Candida albicans & Saccharomyces cerevisiae<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
STAUBER Jonathan UMR8017 - Michel SALZET<br />
NOUVELLE APPROCHE D’IMAGERIE SPECIFIQUE PAR SPECTROMETRIE DE MASSE ET PROTEOMIQUE<br />
CLINIQUE<br />
L’imagerie par spectrométrie de masse est une technique en pleine expansion et extrêmement prometteuse. Grâce à un nouvel axe d’utilisation et une<br />
automatisation simplifiée, l’analyse directe de tissu permet de cartographier l’état dynamique du protéome/lipidome au sein d’un tissu (frais ou paraffiné)<br />
ou de cellules. Ainsi, une localisation spatiale de la répartition <strong>des</strong> biomolécules au sein d’un tissu est obtenu par l’automatisation de cette méthode<br />
avec l’aide d’un logiciel de reconstruction d’image. Cette technique permet la localisation de plus d’une centaine de pepti<strong>des</strong> dans une seule coupe de<br />
tissu. L’avantage de cette technique est de s’affranchir de toutes les métho<strong>des</strong> d’extraction, de purification et de séparation pouvant entraîner une perte<br />
de reproductibilité et de sensibilité.<br />
Au delà de l’amélioration <strong>des</strong> performances de cette technologie, nous nous sommes également focalisés sur le développement d’un nouveau<br />
concept d’imagerie spécifique par l’analyse indirecte du tissu par tag-mass (brevet ). Dans ce concept, la molécule cible est recherchée à l’aide d’une<br />
sonde présentant une affinité spécifique pour la cible, la sonde portant un groupement photoclivable à la longueur d’onde du laser de l’instrument et luimême<br />
relié à un marqueur de masse connue (e.g. peptide). Après balayage du laser sur la coupe, le tag-mass est libérée par clivage et une image est<br />
alors reconstituée avec la répartition de la biomolécule sur la coupe.<br />
Cette nouvelle approche permet de localiser au sein du tissu <strong>des</strong> biomarqueurs d’intérêts comme <strong>des</strong> protéines, <strong>des</strong> lipi<strong>des</strong>, et <strong>des</strong> ARN en fonction du<br />
tag-mass utilisé qui peut être un anticorps, une ribosonde.<br />
Il est alors possible de colocaliser plusieurs protéines, ARN, lipi<strong>des</strong> sur le tissu dans une seule analyse et de réaliser une image multicomplexe. De<br />
plus, la superposition de différentes images permet de définir une carte de corrélation entre l’expression d’une protéine et la transcription de l’ARN<br />
correspondant, et d’ainsi faire le lien entre lipidomique, protéomique et transcriptomique par imagerie spécifique.<br />
R.M. Caprioli, T.B. Farmer, J. Gil, Anal Chem. (1997) 69, 4751-4760<br />
R. Lemaire, J. C. Tabet, P. Ducoroy, J. B. Hendra, M. Salzet, and I. Fournier, Anal. Chem.; 2006; 809 - 819<br />
R.Lemaire, M.Wirstorski, A. Desmons, J.C. Tabet, R.Day, M.Salzet, I. Fournier MALDI MS direct tissu analysis of proteins : Improving signal sensitivity<br />
using organic treatments, Anal chem, En révision.<br />
Fournier, I, Dechamps, M, Lemaire, R, Tabet, J.C., Salzet, M. Use of conjugates with photocleavable linkers and ionic matrices for MALDI mass<br />
spectrometry analysis of tissue section. PCT , Déposé aux USA, 2005<br />
Mot(s)-clé(s) : Protéomique & spectrométrie de masse & recherche clinique<br />
TARONT Solenne U416 - André-Bernard TONNEL<br />
Régulation par les particules de diesel et les PAMP <strong>des</strong> interactions entre cellules épithéliales bronchiques et<br />
cellules dendritiques<br />
De nombreuses étu<strong>des</strong> montrent une corrélation nette entre les pics de pollution atmosphérique et la fréquence d’apparition de maladies respiratoires<br />
telles que l’asthme. La pollution par les particules de diesel (DEP ou Diesel Exhaust Particles) est en partie responsable de ces effets sur la santé.<br />
Cependant, le mode d’action de ces particules n’est pas élucidé. Pour se défendre <strong>des</strong> agressions par <strong>des</strong> polluants ou <strong>des</strong> agents microbiens, la<br />
muqueuse respiratoire dispose d’un réseau d’immuno-surveillance constitué de cellules dendritiques (DC) localisées au sein de la muqueuse<br />
respiratoire. Les DC jouent un rôle clé dans le développement et le contrôle de la réponse immune locale. La discrimination du soi par rapport au non<br />
soi est permise par les Pattern Recognition Receptors (PRR) (Toll-like Receptors ou TLR, Scavenger Receptors ou SR) qui reconnaissent les PAMP<br />
(Pathogen-Associated Molecular Pattern ou PAMP). De façon intéressante, les SR semblent impliqués dans l’élimination de particules inertes inhalées.<br />
Au niveau de la barrière épithéliale, la capture de l’antigène par les DC et par conséquent le développement de la réponse immune locale est limitée par<br />
les jonctions intercellulaires, et plus particulièrement les jonctions serrées, établies entre les cellules épithéliales bronchiques (CEB). Au niveau<br />
intestinal, la capture <strong>des</strong> bactéries par les DC, implique la participation <strong>des</strong> cellules épithéliales, qui vont ouvrir les jonctions intercellulaires, permettant<br />
aux DC d’insinuer <strong>des</strong> pseudopo<strong>des</strong> afin de capturer l’antigène. Dans ce contexte, nous supposons que l’ouverture <strong>des</strong> jonctions intercellulaires de<br />
l’épithélium pourrait également contrôler le remaniement <strong>des</strong> PRR à la surface <strong>des</strong> CEB, mais aussi au niveau <strong>des</strong> pseudopo<strong>des</strong> <strong>des</strong> DC, facilitant ainsi<br />
la capture de l’antigène dans la lumière bronchique. Ainsi, les PRR exprimés par les CEB pourraient réguler l’expression <strong>des</strong> protéines de jonctions<br />
intercellulaires (PJI) après exposition à <strong>des</strong> PAMP ou <strong>des</strong> DEP et altérer le maintien <strong>des</strong> jonctions intercellulaires<br />
L’objectif de ce projet est de définir l’influence de l’exposition à <strong>des</strong> DEP en association avec <strong>des</strong> PAMP sur le dialogue entre CEB et DC, en étudiant<br />
plus particulièrement la régulation de l’expression <strong>des</strong> SR SREC, LOX-1, CXCL16 et CD36 et <strong>des</strong> PJI E-Cadhérine, -Caténine, Occludine, ZO-<br />
1, Claudines-1 et 4, ainsi que les interactions entre ces deux types de protéines.<br />
Concernant les SR, les CEB et les DC ont été activées par <strong>des</strong> DEP associées ou non à <strong>des</strong> PAMP. L’exposition <strong>des</strong> CEB à <strong>des</strong> DEP augmente<br />
l’expression de SREC, LOX-1 et CD36. Associées aux ligands de TLR2 et 3, elles ont un effet antagoniste sur l’expression <strong>des</strong> 3 SR. Par ailleurs, les<br />
DEP induisent une augmentation de la production par les CEB d’IL-6 et d’IL-8 seuls ou en présence de ligand de TLR3. Au niveau <strong>des</strong> DC, les DEP<br />
augmentent l’expression de LOX-1, CD36, SR-A1 et CXCL16.<br />
Cette approche sera poursuivie par l’analyse du rôle <strong>des</strong> SR dans la reconnaissance <strong>des</strong> DEP et de certains composés isolés à l’aide de lignées<br />
exprimant spécifiquement un seul type de SR et en réalisant une compétition avec les ligands naturels <strong>des</strong> SR (Ox-LDL)<br />
Concernant la régulation <strong>des</strong> PJI, les DEP modulent l’expression de la E-Cadhérine, β-Caténine, et Claudine-4 sans induire leur maturation. De<br />
plus, , les ligands de TLR2, 3 et 4 induisent la maturation <strong>des</strong> DC et l’augmentation de l’expression de la E-Cadhérine, de la β-Caténine, de<br />
l’Occludine et de ZO-1. L’inhibition de l’activation de NF-κB bloque ces modulations<br />
A terme, l’implication de l’expression de ces protéines dans l’activation <strong>des</strong> DC et la capture de l’antigène sera définie, en analysant la délocalisation<br />
<strong>des</strong> SR et <strong>des</strong> TLR lors de la capture d’antigènes par les DC au niveau de l’épithélium.<br />
Mot(s)-clé(s) : Inflammation & Cellules épithéliales bronchiques & Cellules dendritiques & Pollution<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
TASCHNER Christian EA2691 - Xavier LECLERC<br />
ARM DYNAMIQUE 3D AVEC IMAGERIE PARALLELLE ET ACQUISITION CENTRA KEYHOLE POUR L’ETUDE DES<br />
MALFORMATIONS ARTERIO-VEINEUSES CEREBRALES<br />
Objectifs: L’ARM dynamique a prouvé son intérêt pour l’étude <strong>des</strong> vaisseaux intracrâniens permettant de séparer les phases artérielle et veineuse de<br />
l’angiogramme. L’objectif de ce travail est d’évaluer une séquence d’ARM dynamique 3D pour l’étude <strong>des</strong> malformations artério-veineuses (MAV)<br />
utilisant <strong>des</strong> techniques d’imagerie parallèle en combinaison avec une acquisition stochastique de l’espace <strong>des</strong> k appelée CENTRA Keyhole.<br />
Matériels et métho<strong>des</strong>: L’ARM dynamique 3D était réalisée sur un imageur 1.5 Tesla avec une antenne tête à huit canaux. Le protocole d’imagerie<br />
comprenait une séquence 3D fast field-echo avec injection de 20 mL de gadolinium à un débit de 5mL /sec. 140 coupes de 1.1 mm d’épaisseur étaient<br />
acquises avec un facteur SENSE de 3 et un CENTRA key hole de 16%. La résolution temporelle était de 0,8 s pour l’acquisition d’un volume couvrant<br />
l’ensemble de la tête. La séquence présentait une résolution spatiale isotrope de 1,1 x 1,1 x 1,1 mm. La séquence a été évaluée chez 15 patients<br />
présentant une MAV connue.<br />
Résultats : Les examens étaient interprétables chez tous les patients et constituaient un outil diagnostique robuste pour l’analyse <strong>des</strong> différentes phases<br />
de la circulation cérébrale. Les reconstructions MIP obtenues à partir d’une seule acquisition 3D fournissaient <strong>des</strong> informations fiables pour l’étude <strong>des</strong><br />
artères nourricières, du nidus et <strong>des</strong> veines de drainage de la malformation.<br />
Conclusion : L’ARM dynamique 3D avec imagerie parallèle et acquisition CENTRA Keyhole permet d’optimiser la résolution temporelle et spatiale de<br />
l’image et obtenir une analyse précise de l’angioarchitecture de la MAV en ARM.<br />
Mot(s)-clé(s) : Malformation Arterio-veineuse & ARM & Gamma Knife<br />
THURU Xavier EPI114 - Jean-Frédéric COLOMBEL<br />
Récépteur aux cannabinoï<strong>des</strong> 2 : nouvelle stratégie thérapeutique dans le traitement <strong>des</strong> Maladies<br />
Inflammatoires Chroniques Intestinales.<br />
Introduction : Les récepteurs aux cannabinoï<strong>des</strong> (CB1 et CB2) sont exprimés au niveau du système nerveux central et périphérique, ce qui leur donne<br />
un effet analgésique ainsi qu’une action sur la motricité intestinale. Le récepteur CB2 est essentiellement exprimé sur les cellules immunitaires.<br />
Plusieurs étu<strong>des</strong> réalisées suggèrent que le récepteur CB2 serait également impliqué dans la régulation de l’inflammation. But du travail : Evaluer in<br />
vivo l’implication de CB2 dans le contrôle de l’inflammation dans différents modèles de colite expérimentale. Métho<strong>des</strong> : 1) L’action d’un agoniste de<br />
CB2 (Fe200859) a été testée dans le modèle de colite au TNBS. L’intensité de la colite a été évaluée cinq jours (J5) après administration intra-rectale<br />
du TNBS par un score macroscopique (0 à 10), un score histologique (0 à 6), le dosage et la quantification de l’activité de la myéloperoxidase (MPO) et<br />
<strong>des</strong> ARNm du TNFα et de l’IL1β. Les résultats ont été comparés chez <strong>des</strong> groupes d’animaux recevant de manière préventive (J-1) ou<br />
curative (J0) un placebo ou du Fe200859 par voie sous-cutanée. 2) L’effet anti-inflammatoire de notre agoniste a été testé dans un modèle de colite au<br />
DSS 4% comme précédemment. La colite a été évaluée sept jours (J7) après l’administration de DSS par voie orale par un score clinique (0 à 8), un<br />
score histologique (O à 6). 3) L’intensité de la colite au TNBS a été comparée chez <strong>des</strong> animaux contrôles et invalidés pour le récepteur CB2 (CB2-/-).<br />
4) L’effet anti-inflammatoire de notre agoniste a été testé dans un modèle de colite chronique induite par l’administration chronique de DSS 2,5%.<br />
L’intensité de la colite était réalisée comme précédemment 40 jours après l’administration du DSS. Résultats : 1) L’administration intra-rectale de TNBS<br />
induisait à J5 une colite sévère macroscopiquement et histologiquement avec <strong>des</strong> concentrations élevées de MPO, d’ARNm du TNFα et de l’IL-<br />
1β. L’administration préventive ou curative de Fe200859 entraînait une diminution significative par rapport au placebo <strong>des</strong> scores<br />
macroscopiques, <strong>des</strong> scores histologiques et <strong>des</strong> concentrations de MPO, d’ARNm du TNFα et de l’IL-1β. 2) De la même manière<br />
l’administration préventive entraînait une diminution du score macroscopique et histologique lors de la colite au DSS. 3) Les souris CB2-/- développaient<br />
une colite nécrosante sévère et diffuse, rapidement fatale. 4) L’injection curative de l’agoniste permettait de prévenir l’apparition de la colite aigue par<br />
une diminution de production de collagène et donc de prévenir l’apparition de fibrose. Conclusion : L’activation de CB2 exerce un puissant effet antiinflammatoire<br />
in vivo. L’effet combiné <strong>des</strong> agonistes sélectifs sur la motricité, la douleur abdominale et l’inflammation pourrait rendre attractif leur<br />
utilisation dans les MICI.<br />
Mot(s)-clé(s) : Cannabinoï<strong>des</strong> & Inflammation & Colon & Nouveaux ligands<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
TIFFREAU Vincent EA3608 - Christian FONTAINE<br />
Evaluation isocinétique <strong>des</strong> muscles déficitaires appliquée aux maladies neuromusculaires<br />
La quantification objective de la force musculaire est devenue nécessaire à la mise en place de protocoles d’évaluation de patients atteints de<br />
pathologies neuromusculaires, inclus dans <strong>des</strong> protocoles thérapeutiques. Les dynamomètres isocinétiques offrent la possibilité de mesurer la force en<br />
condition dynamique, mais seule leur utilisation dans le cadre de pathologies locomotrices orthopédiques pour <strong>des</strong> sujets présentant un déficit de force<br />
modéré est véritablement documentée.<br />
L’évaluation isocinétique de sujets très déficitaires affectés par <strong>des</strong> pathologies neuromusculaires est possible, mais son développement nécéssite un<br />
travail d’élaboration de protocoles spécifiques en mode passif. Il est possible de programmer un enregistrement du régime de force pendant une<br />
mobilisation passive isocinétique robotisée et d’enregistrer durant une mobilisation passive de même vitesse et de même amplitude la force développée<br />
en demandant une effort maximal au sujet. La soustraction <strong>des</strong> deux enregistrements permet de calculer la force développée par le sujet,<br />
indépendamment <strong>des</strong> résistances passives et de la gravité.<br />
La pertinence d’une telle évaluation ne peut être retenue que si l’outil et la méthode de mesure offrent un sensibilité, une fiabilité et une validité<br />
suffisante : l’objectif de ce travail est d’explorer les qualités métrologiques d’un protocole d’évaluation isocinétique de ce type. Pour cela , différentes<br />
étapes sont nécessaires<br />
1. Le développement d’un protocole d’évaluation standardisé, pour différents groupes musculaires, et l’étude de la faisabilité du protocole auprès de<br />
sujets atteints de pathologies neuromusculaires<br />
2. L’évaluation de la précision et de la sensibilité du dynamomètre dans les conditions du protocole, déterminant le seuil de détection et le pourcentage<br />
d’erreur <strong>des</strong> mesures.<br />
3. Le développement d’outils informatiques permettant une quantification standardisée de la force à partir du signal produit par le capteur de force.<br />
4. l’étude de la reproductibilité <strong>des</strong> mesures répétées chez <strong>des</strong> sujets atteints de pathologies neuromusculaires<br />
5. L’étude de validité en relation avec les évaluations quantifiées utilisées en pratique clinique<br />
6. La sensibilité au changement d’un état clinique par le suivi prospectif <strong>des</strong> sujets atteints de pathologies neuromusculaires évolutives.<br />
7. A terme, la diffusion du protocole et <strong>des</strong> outils informatiques qui y sont associés devrait s’étendre aux dynamomètres isocinétiques commercialisés<br />
équipés d’une sortie analogique, permettant le traitement du signal<br />
Avancement <strong>des</strong> travaux :<br />
Actuellement, un protocole d’évaluation est décrit et appliqué pour quantifier la force <strong>des</strong> fléchisseurs et extenseurs <strong>des</strong> genoux et <strong>des</strong> cou<strong>des</strong>, dans<br />
<strong>des</strong> conditions standardisées, pour <strong>des</strong> vitesses de 10 /s et 30 /s. Le protocole est appliqué sur deux dynamomètres : le cybex 6000® au CHU de Lille<br />
(Service de Médecine Physique et de Réadaptation) et le Biodex 3® à l’insitut de myologie de Paris (Laboratoire d’évaluation neuromusculaire, Hôpital<br />
de la Salpêtrière).<br />
Le développement de logiciels de traitement de signal (Labview® ) et de calcul simple pour la quantification de la force (moment maximal, travail,<br />
puissance) est effectué sur les deux sites.<br />
L’achat de capteurs externe va permettre d’étudier la précision du signal du capteur dynamomètrique.<br />
L’étude de reproductibilité est effectuée sur 15 sujets atteints de pathologies neuromusculaires sur le biodex 3®, pour l’évaluation de la force <strong>des</strong><br />
fléchisseurs et extenseurs <strong>des</strong> genoux.<br />
Une première étude de validité de la mesure en comparaison du testing musculaire manuel auprès de sujets atteints de polyradiculonevrite aigue en<br />
cours de récupération a été publiée (Tiffreau V, Turlure A, Viet G, Thevenon A. Isokinetic dynamometry of weak muscles. Isokinetics and exercise<br />
science 2003; 11 (1) : 13-20.<br />
Un suivi de cohorte de patients atteints de dystrophies musculaires est commencé au CHU de Lille sur Cybex 6000®.<br />
Mot(s)-clé(s) : isocinétisme & évaluation & force & neuromusculaire<br />
TONNELLE Veronique U422 - Jean-Claude BEAUVILLAIN<br />
Caractérisation <strong>des</strong> récepteurs erbB dans <strong>des</strong> cultures primaires d'astrocytes humains issus de différentes<br />
régions cérébrales et dans <strong>des</strong> échantillons tumoraux de glioblastome<br />
Problématique: Les astrocytes participent activement au traitement <strong>des</strong> informations dans le cerveau. La voie de signalisation erbB participe activement<br />
à la communication inter cellulaire et au controle de fonctions tels que la croissance, la différenciation, l'apoptose...<br />
Matériel et méthode: pour la première fois nous étudions cette voie de signalisation en condition physiologique, chez l'homme, dans <strong>des</strong> cultures<br />
d'astrocytes embryonnaires corticaux ou hypothalamiques. Nous réalisons également <strong>des</strong> cultures à partir d'échantillons tumoraux (glioblastome) et<br />
péri-tumoraux.Les récepteurs erbB ont été caractérisés par <strong>des</strong> techniques de Western blot et de RT-PCR, leur voir d'activation a été étudiée par <strong>des</strong><br />
métho<strong>des</strong> d'immunoprécipitation et de Western blot aprés réalisation de différents traitements activateurs ou inhibiteurs. Les résultats obtenus en<br />
condition physiologique ont été comparés à ceux obtenus à partir d'un écantillon glioblastome.<br />
Résultats : le profil d’expression <strong>des</strong> récepteurs erbB est différent dans les astrocytes corticaux (erbB1-2-3) et hypothalamiques (erbB1-2-4). Les<br />
astrocytes corticaux et hypothalamiques expriment tous les composants nécessaire à l’activation autocrine/paracrine de la voie de signalisation erbB.<br />
L’échantillon glioblastome est caractérisé par une surexpression du récepteur erbB-1, une activation spontanée <strong>des</strong> quatres récepteurs erbB, la<br />
présence du récepteur erbB-4 non retrouvé dans les astrocytes corticaux.<br />
Conclusion : Il s’agit de la première caractérisation de la voie de signalisation erbB dans les astrocytes humains en condition physiologique. Cette étude<br />
confirme partiellement les connaissances déjà acquises chez le rat et la souris.L'étude se poursuit pour les échantillons de glioblastome.<br />
Mot(s)-clé(s) : Récepteur erbB & Astrocytes & Humain<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
VAN HECKE Elsa EA1033-Inserm ESPRI - Hubert HONDERMARCK<br />
Expression et activité biologique de la NT-4/5, du BDNF et de leurs récepteurs dans le cancer du sein.<br />
Les neurotrophines sont une famille de quatre facteurs de croissance comprenant le membre prototypique nerve growth factor (NGF), les<br />
neurotrophines 3 et 4/5 (NT-3 et NT-4/5) et le Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF). Les neurotrophines (NT), connues pour induire la<br />
différenciation et le maintien <strong>des</strong> neurones, sont désormais référencées dans bon nombre de cancers non neuronaux pour leur implication dans la<br />
croissance clonale <strong>des</strong> cellules cancéreuses et l’invasion tumorale. Dans le cancer du sein, notre laboratoire a déjà montré que le NGF et ses<br />
récepteurs membranaires TrkA (Tropomyosine Related Kinase A) et p75NTR (Neurotrophin Receptor) sont synthétisés. De plus, le NGF sécrété par les<br />
cellules de cancer du sein stimule leur prolifération et leur survie via une boucle autocrine. Mes travaux de recherche portent sur l’expression et les<br />
effets biologiques <strong>des</strong> autres neurotrophines (NT-3, NT-4/5, BDNF) et de leurs récepteurs tyrosine kinase (TrkB et TrkC). La PCR en temps réél, le<br />
western-blot et l’immunocytochimie indiquent que la NT-4/5, le BDNF et leur récepteur TrkB sont exprimés dans les cellules cancéreuses mammaires,<br />
alors que la NT-3 est faiblement exprimé et son récepteur TrkC n’est pas détecté. Par ailleurs ces même neurotrophines sont présentes dans <strong>des</strong><br />
biopsies tumorales de sein. De plus, nous avons pu démontré que le BDNF et la NT-4/5 agissent comme facteur de survie dans les cellules<br />
cancéreuses de sein en empêchant l’action pro-apoptototique de diverses molécules chimiothérapeutiques. En conclusion cette étude indique que non<br />
seulement le NGF et ses récepteurs TrkA et P75NTR contribuent à la tumorigénèse mammaire, mais que les autres neurotrophines jouent un rôle dans<br />
cette pathologie.<br />
Mot(s)-clé(s) : cancer du sein & neurotrophines & Trk & p75NTR<br />
VAN WAES Vincent EA 4052 - Muriel DARNAUDERY<br />
Impact d'un stress prénatal sur l’activation de l’axe corticotrope<br />
en réponse à un traitement à l’éthanol et sur la consommation<br />
spontanée d’éthanol chez le rat adolescent<br />
L’axe corticotrope est un composant majeur de la réponse au stress et la relation entre cet axe et la vulnérabilité à l’éthanol est double. D’une part,<br />
l’éthanol est connu pour être un activateur puissant de l’axe corticotrope, d’autre part, <strong>des</strong> manipulations expérimentales de cet axe sont associées chez<br />
l’animal à <strong>des</strong> modifications de la consommation spontanée d’éthanol. Chez le rat, le stress chronique de la mère gestante induit chez la <strong>des</strong>cendance<br />
de profonds dysfonctionnements de l’axe corticotrope, caractérisés notamment par une hyperactivité de l’axe en réponse à une exposition à la<br />
nouveauté ou à un stress de contention. Les animaux stressés prénatalement présentent par ailleurs une augmentation du comportement d’autoadministration<br />
d’amphétamine, de la réactivité locomotrice à la nicotine et de la sensibilité au MDMA (ecstasy). Bien que le stress prénatal induise <strong>des</strong><br />
dysfonctionnements de l’axe corticotrope et que cet axe soit impliqué dans la vulnérabilité à l’éthanol, peu de travaux se sont focalisés sur l’impact du<br />
stress prénatal sur l’activation de l’axe corticotrope par l’éthanol et sur ses conséquences sur la propension à consommer de l’éthanol.<br />
Le but de notre travail était d’évaluer l’impact du stress prénatal d’une part sur l’activation de l’axe corticotrope en réponse à un challenge à l’éthanol, et<br />
d’autre part sur la consommation spontanée d’éthanol dans un modèle d’animaux adolescents. Pour cela, nous avons mesuré les taux plasmatiques<br />
d’ACTH et de corticostérone (RIA) suite à une injection intrapéritonéale d’éthanol (1.5 g/kg) chez <strong>des</strong> animaux adolescents stressés prénatalement ou<br />
témoins. Nous avons évalué en parallèle la cinétique d’élimination <strong>des</strong> taux sanguins d’éthanol (chromatographie). L’impact de l’éthanol sur l’expression<br />
génique (ARNm) de plusieurs acteurs centraux de l’axe corticotope (récepteurs aux glucocorticoï<strong>des</strong> et aux minéralocorticoï<strong>des</strong> hippocampiques, CRH<br />
hypothalamique, POMC hypophysaire) a été également évalué (HIS). Comparés aux témoins, les animaux stressés prénatalement présentaient une<br />
augmentation <strong>des</strong> taux de corticostérone et d’ACTH de moindre ampleur suite à l’injection d’éthanol. De plus, l’éthanol augmentait les taux d’ARNm<br />
codant la CRH (dans le NPV de l’hypothalamus) et la POMC (dans l’anté-hypophyse) chez les témoins alors que ces taux n’étaient pas modifiés chez<br />
les animaux stressés. Ces résultats suggèrent une atténuation de la réponse de l’axe corticotrope à l’éthanol chez les animaux adolescents stressés en<br />
période prénatale, et ceci, en l'absence de modification de la cinétique d’élimination de l’éthanol. De façon intéressante, une hyporéponse de l’axe<br />
corticotrope en réponse à une administration d’éthanol semble être associée chez l’Homme à une plus grande vulnérabilité à l’éthanol. Nous avons<br />
mesuré pendant 10 jours lors de l’adolescence la consommation spontanée d’éthanol <strong>des</strong> rats en leur laissant comme accès à la boisson le libre choix<br />
entre un biberon rempli d’eau et un biberon rempli d’éthanol (2.5%, 5% ou 10%). La préférence pour l’éthanol variait de manière importante en fonction<br />
de la dose utilisée mais était similaire chez les animaux stressés prénatalement et les animaux témoins. Les modifications de l’activation de l’axe<br />
corticotrope chez les adolescents stressés prénatalement, observées à la fois au niveau périphérique et au niveau central, ne semblent donc pas soustendre<br />
une consommation spontanée d’éthanol plus importante chez ces animaux dans nos conditions d’expérimentation. Des expériences<br />
complémentaires seront nécessaires pour déterminer si <strong>des</strong> différences de consommations pourraient être observées en conditions stressantes ou<br />
dans le cadre de conditionnements opérants.<br />
Mot(s)-clé(s) : stress prénatal & éthanol & axe corticotrope & consommation spontannée<br />
VANHOUTTE Francois U547 - François TROTTEIN<br />
Rôle <strong>des</strong> récepteurs Toll-like dans l'activation <strong>des</strong> cellules dendritiques par le parasite helminthe Schistosoma<br />
mansoni<br />
Les récepteurs Toll-like (TLRs) jouent un rôle important dans les mécanismes de reconnaissance innée <strong>des</strong> pathogènes par les cellules dendritiques<br />
(DCs) chez les Mammifères. Alors que l’implication <strong>des</strong> TLRs lors de l’initiation et la polarisation <strong>des</strong> réponses immunes pendant les infections virales et<br />
bactériennes est bien documentée, relativement peu d’étu<strong>des</strong> décrivent leur fonction dans les réponses acquises dirigées contre <strong>des</strong> microorganismes<br />
eucaryotes complexes, tels que les parasites helminthes. Nos travaux ont récemment montré que TLR2 et TLR3 sont activés en réponse au stade œuf<br />
du parasite helminthe Schistosoma mansoni. TLR3, un TLR connu pour sa participation dans les réponses antivirales, est activé par de l’ARN double<br />
brin isolé du stade œuf. Nous démontrons ici que les œufs activent <strong>des</strong> DCs dérivées de précurseurs de moelle osseuse de souris WT via la production<br />
de cytokines inflammatoires et une maturation alors que cette réponse est complètement abrogée dans le cas d’une double déficience en TLR2 et<br />
TLR3. De plus, l’activation de TLR3, et dans une moindre mesure celle de TLR2, chez les cellules dendritiques joue un rôle important lors de la mise en<br />
place de la réponse immune adaptative à la fois in vitro et in vivo. Pris dans leur ensemble, ces résultats suggèrent l’importance de TLR2 et TLR3 dans<br />
les interactions hôte/schistosome.<br />
Mot(s)-clé(s) : Toll-like receptors & schistosome & cellules dendritiques<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
YAKOUB-AGHA Ibrahim EA2686 - Jean-Paul DESSAINT<br />
Impact de la composition du greffon en lymphocytes T naïfs et mémoires sur le devenir de l’allogreffe de cellules<br />
souches hématopoïétiques.<br />
L'allogreffe de Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH) constitue l'une <strong>des</strong> alternatives thérapeutiques aux affections hématologiques et à certaines<br />
maladies génétiques. Le greffon est source non seulement de CSH, mais aussi de cellules différenciées. Ces lymphocytes participent directement à la<br />
prévention du rejet du greffon, à la reconstitution du système immunitaire du receveur et à l'élimination <strong>des</strong> cellules tumorales résiduelles (GVL : Graft-<br />
Versus-leukemia). Les lymphocytes T transférés sont également responsables d'effets indésirables, tout particulièrement la réaction du greffon contre<br />
l'hôte (GVH). Deux types de CSH peuvent être prélevés chez un donneur: les CSH issues de la moelle osseuse (MO) et les CSH issues du sang<br />
périphérique (CSP) après leur mobilisation par un facteur de croissance (G-CSF).<br />
Des travaux récents soulignent l'hétérogénéité <strong>des</strong> lymphocytes T mémoires chez l'Homme, et ont permis la distinction de trois sous-populations<br />
mémoires selon leur expression <strong>des</strong> isoformes de CD45 et <strong>des</strong> molécules de domiciliation, CCR7 ou CD62L. Quatre sous-populations principales sont<br />
donc maintenant individualisables à l'aide d'un panel de marqueurs membranaires : cellules T naïves CD45RA+CCR7+CD62L+ (TN), mémoires<br />
centrales CD45RAnegCCR7+CD62L+ (TCM), mémoires effectrices CD45RAnegCCR7neg CD62L+/- (TEM) et effecteurs à différentiation terminale<br />
CD45RA+CCR7neg CD62Lneg (TTD).<br />
Des expériences menées chez la souris ont montré que <strong>des</strong> lymphocytes T CD8+ mémoires étaient capables de s'opposer à l'établissement de la<br />
tolérance d'une allogreffe. Les cellules impliquées possédaient les caractéristiques phénotypiques de cellules mémoires centrales CD62L+ et non de<br />
cellules mémoires effectrices CD62Lneg. De plus, <strong>des</strong> cellules mémoires effectrices purifiées se sont avérées incapables d'induire une GVH. A<br />
l'inverse, en ce qui concerne la population T CD4+, il a été montré que les lymphocytes T naïfs et non pas mémoires étaient capable d'induire une GVH<br />
chez la souris. Dans une autre étude, il a été montré que les animaux invalidés pour le gène du CCR7 présentaient une alloréactivité diminuée. Chez<br />
l'Homme, certaines observations cliniques soulignent l'influence <strong>des</strong> expériences immunologiques passées du donneur. La survenue de la GVH pourrait<br />
donc être favorisée par la réactivité <strong>des</strong> lymphocytes T mémoires du donneur vis-à-vis <strong>des</strong> tissus cibles du receveur. Très récemment, <strong>des</strong> cellules TCM<br />
humaines ont été impliquées dans un modèle de GVH induite chez la souris SCID. Foster et al. ont démontré, in vitro, que <strong>des</strong> cellules T CD4+CD62L+<br />
(naïves et mémoires centrales) avaient un potentiel alloréactif plus important que les cellules mémoires CD62Lnég.<br />
L'ensemble de ces données nous a conduit à émettre l'hypothèse que la composition du greffon en cellules T naïves et/ou mémoires pourrait influencer<br />
la survenue et la sévérité de la GVH aiguë.<br />
Les rôles respectifs de lymphocytes T naïfs et mémoires dans les réactions allogéniques post-greffes restent à établir.<br />
Le but principal de notre travail, qui a commencé en 2003, est d’étudier les lymphocytes T naïfs et mémoires de greffons de CSH médullaires et<br />
périphériques et de suivre la reconstitution immunologique chez le receveur.<br />
Nous avons mené une analyse préliminaire de la composition <strong>des</strong> greffons. Cette étude a permis de révéler, par analyse multivariée (modèle de Cox)<br />
un risque significatif de GVH aiguë (p = 0,008) quand le pourcentage <strong>des</strong> lymphocytes T CD4+CCR7+ est élevé, sans influence sur les autres<br />
complications post-greffe. Ce risque excède même celui lié à un greffon de donneur non apparenté (p = 0,023). La sévérité de la GVH aiguë (grade III<br />
et IV vs I et II) s'accroît parallèlement à l'augmentation de ce rapport. En ce qui concerne la GVH chronique, notre étude n'a montré qu'une corrélation<br />
avec le type de greffon quelque soit la composition en cellules T naïves et mémoires. D’autres résultats seront présentés lors de la journée André<br />
VERBERT.<br />
Mot(s)-clé(s) : allogreffe de cellules souches hématopoïétiques & lymphocytes T & CCR7 & Greffon<br />
6 ème Journée André VERBERT sessions poster - 10h00 à 11h00 et 13h00 à 14h00
Nom de l'auteur (adresse électronique) (Unité de Recherche-Directeur de thèse) Session (horaire)<br />
ADAM Estelle (estelleadam@endotis.com) - U416 - Philippe LASSALLE poster 1 (n°1) - 10h00 à 11h<br />
ALLART Laurent (laurent.allart@univ-lille2.fr) - EA3614 - Mohamed LEMDANI poster 2 (n°2) - 13h00 à 14h<br />
AMNIAI Latiffa (amniai@yahoo.fr) - U416 - Benoît WALLAERT poster 1 (n°3) - 10h00 à 11h<br />
ANDO Kunie (kunie29@yahoo.co.jp) - U422 - Luc BUÉE poster 2 (n°4) - 13h00 à 14h<br />
ARAFAH Sonia (sonia.arafah@ibl.fr) - EMI364 - Michael MARCEAU poster 1 (n°5) - 10h00 à 11h<br />
BALLY Julia (julia.bally@bayercropscience.com) - UR_hors ED - Dominique JOB poster 2 (n°6) - 13h00 à 14h<br />
BENSEMAIN Faïza (faiza.bensemain@pasteur-lille.fr) - U508 - Nicole HELBECQUE orale "Neuropathologies" (4) - 11h00 à 12h<br />
BIGGIO Valeria (biggio@lille.inserm.fr) - U524 - Claude PREUDHOMME poster 1 (n°7) - 10h00 à 11h<br />
BILLIET Ludivine (ludivine.billiet@pasteur-lille.fr) - U545 - Graciela CASTRO poster 2 (n°8) - 13h00 à 14h<br />
BOISSE Thomas (thomas.boisse@hei.fr) - EA2692 - Benoît RIGO poster 1 (n°9) - 10h00 à 11h<br />
BOUHLEL Mohamed Amine (amine.bouhlel@pasteur-lille.fr) - U545 - Giulia CHINETTI poster 2 (n°10) - 13h00 à 14h<br />
BRETTEVILLE Alexis (bretteville@lille.inserm.fr) - U422 - Claude-Alain MAURAGE orale "Neuropathologies" (2) - 11h00 à 12h<br />
BRUANDET Amelie (a-bruandet@chru-lille.fr) - U508 - Philippe AMOUYEL poster 1 (n°11) - 10h00 à 11h<br />
BUYCK Julien (julien.buyck@univ-lille2.fr) - EA 2689 - Régis MATRAN poster 2 (n°12) - 13h00 à 14h<br />
CERTAD Gabriela (gabriela.certad@pasteur-lille.fr) - EA3609 - Thérèse DURIEZ poster 1 (n°13) - 10h00 à 11h<br />
CLASADONTE Jérôme (clasadonte@lille.inserm.fr) - U422 - Pierre POULAIN orale "Physiologie" (4) - 9h00 à 10h<br />
COQUART Jeremy (coquart.jeremy@voila.fr) - EA3608 - Murielle GARCIN poster 2 (n°14) - 13h00 à 14h<br />
CORDONNIER Charlotte (charlotte.cordonnier2@wanadoo.fr) - EA2691 - Hilde HENON poster 1 (n°15) - 10h00 à 11h<br />
DEGERNY Cindy (cindy.degerny@ibl.fr) - UMR8117 - Jean-Luc BAERT orale "Régulation génétique" (3) - 15h00 à 16h<br />
DELANGLE Aurelie (aurelie.delangle@ed.univ-lille1.fr) - UMR-CNRS 8576 - Jean-Marie LACROIX poster 2 (n°16) - 13h00 à 14h<br />
DESAILLOUD Rachel (<strong>des</strong>ailloud.rachel@chu-amiens.fr) - EA3610 - Alain DUBREUIL poster 1 (n°17) - 10h00 à 11h<br />
DESSEIN Rodrigue (r-<strong>des</strong>sein@chru-lille.fr) - EMI364 - Michel SIMONET poster 2 (n°18) - 13h00 à 14h<br />
DILLY Sebastien (seb_dilly@yahoo.fr) - EA1043 - Philippe CHAVATTE poster 1 (n°19) - 10h00 à 11h<br />
DINON Jean-Francois (jf-dinon@chru-lille.fr) - UMR8160 - Muriel BOUCART poster 2 (n°20) - 13h00 à 14h<br />
DOURLEN Pierre (dourlen@lille.inserm.fr) - U422 - Luc BUÉE orale "Neuropathologies" (1) - 11h00 à 12h<br />
EL BEYROUTHY Marc (mr_tulipes@hotmail.com) - EA2692 - Annick DELELIS poster 1 (n°21) - 10h00 à 11h<br />
FAID Valegh (Valeghfaid@yahoo.fr) - UMR-CNRS 8576 - Jean-Claude MICHALSKI poster 2 (n°22) - 13h00 à 14h<br />
FAVORY Raphael (R-favory@chru-lille.fr) - EA2689 - Rémy NEVIÈRE poster 1 (n°23) - 10h00 à 11h<br />
FLOURAKIS Matthieu (flourakismatt@yahoo.fr) - U 800 - Natacha PREVARSKAYA orale "Transporteurs signalisation" (1) - 14h00 à 15h<br />
FOVEAU Benedicte (benedicte.foveau@ibl.fr) - UMR8117 - David TULASNE orale "Transporteurs signalisation" (3) - 14h00 à 15h<br />
FREALLE Emilie (emilie.frealle@pasteur-lille.fr) - EA3609 - Daniel CAMUS poster 2 (n°24) - 13h00 à 14h<br />
GACKIERE Florian (florian.gackiere@wanadoo.fr) - EMI0228 - Pascal MARIOT poster 1 (n°25) - 10h00 à 11h<br />
GARCIA Frederic (garcia.frederic2@caramail.com) - EA2694 - Paul FRIMAT poster 2 (n°26) - 13h00 à 14h<br />
GARENAUX Estelle (Estelle.Garenaux@ed.univ-lille1.fr) - UMR8576 - Jean-Claude MICHALSKI poster 1 (n°27) - 10h00 à 11h<br />
GARGOURI Imed (Imed.Gargouri@fmsf.rnu.tn) - EA2690 - Daniel MARZIN poster 2 (n°28) - 13h00 à 14h<br />
GINESTE Romain (romain.gineste@genfit.com) - U545 - Jean-Charles FRUCHART poster 1 (n°29) - 10h00 à 11h<br />
GLUSZOK Sébastien (sebastien.gluszok1@wanadoo.fr) - EA2692 - Patrick DEPREUX poster 2 (n°30) - 13h00 à 14h<br />
GUTIERREZ-AGUILAR Ruth (ruth.gutierrez@good.ibl.fr) - UMR8090 - Philippe FROGUEL poster 1 (n°31) - 10h00 à 11h<br />
HELLE Francois (francois.helle@ibl.fr) - UPR2511 - Jean DUBUISSON poster 2 (n°32) - 13h00 à 14h<br />
HOUDAYER Elise (elisehoudayer@hotmail.com) - EA2683 - Philippe DERAMBURE orale "Physiologie" (3) - 9h00 à 10h<br />
JARDIN-MATHE Olivia (olivia.jardin-mathe@ed.univ-lille1.fr) - FRE 2933 - Michel SALZET poster 1 (n°33) - 10h00 à 11h<br />
JEANNE Mathieu (mathieu_jeanne@yahoo.fr) - EA 1046 - Benoit TAVERNIER poster 2 (n°34) - 13h00 à 14h<br />
JEBARA Najate (n-jebara@chru-lille.fr) - UMR8160 - Delphine PINS poster 1 (n°35) - 10h00 à 11h<br />
Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille 6ème Journée André VERBERT 27 septembre 2006
Nom de l'auteur (adresse électronique) (Unité de Recherche-Directeur de thèse) Session (horaire)<br />
LALLET Helene (hlallet@nomade.fr) - EMI0228 - Natacha PREVARSKAYA poster 2 (n°36) - 13h00 à 14h<br />
LARVOR Lydie (lydie.larvor@lille.inserm.fr) - EA2683 - Marie-Christine CHARTIER-HARLIN orale "Neuropathologies" (3) - 11h00 à 12h<br />
LAUNAY David (d-launay@chru-lille.fr) - EA2686 - Lionel PRIN poster 1 (n°37) - 10h00 à 11h<br />
LE BRAS Alexandra (alexandra.lebras@ibl.fr) - UMR8526 - Fabrice SONCIN poster 2 (n°38) - 13h00 à 14h<br />
LE NAOUR Morgan (morgan.le-naour@voila.fr) - EA1043 - Pascal BERTHELOT poster 1 (n°39) - 10h00 à 11h<br />
LEGRAND Fanny (fanny.legrand@pasteur-lille.fr) - U547 - Monique CAPRON poster 2 (n°40) - 13h00 à 14h<br />
LY Ousmane (ousmane.ly@sim.hcuge.ch) - EA2694 - Jean-Marc BRUNETAUD poster 1 (n°41) - 10h00 à 11h<br />
MARTIEN Sebastien (sebastien.martien@ibl.fr) - UMR-CNRS 8161 - Corinne ABBADIE orale "Régulation génétique" (1) - 15h00 à 16h<br />
MELCHIOR Aurelie (aurelie.melchior@ed.univ-lille1.fr) - UMR8576 - Joël MAZURIER poster 2 (n°42) - 13h00 à 14h<br />
MEURICE Edwige (edwige.meurice@ed.univ-lille1.fr) - UMR8576 - Stanislas TOMAVO poster 1 (n°43) - 10h00 à 11h<br />
MOLENDI-COSTE Olivier (oliviermolendi@hotmail.com) - EA2701 - Christophe BRETON orale "Physiologie" (1) - 9h00 à 10h<br />
MORTIER Laurent (l-mortier@chru-lille.fr) - U459 - Philippe MARCHETTI poster 2 (n°44) - 13h00 à 14h<br />
NGOUANESAVANH Tra My (tramy.ngouanesavanh@pasteur-lille.fr) - EA3609 - Jean-Charles CAILLIEZ poster 1 (n°45) - 10h00 à 11h<br />
OUK Thavarak (thavouk@yahoo.fr) - EA1046 - Régis BORDET poster 2 (n°46) - 13h00 à 14h<br />
PEIXOTO Paul (peixotopaul@yahoo.fr) - U524 - Amélie LANSIAUX orale "Régulation génétique" (5) - 15h00 à 16h<br />
PELAYO Sylvia (sylvia.pelayo@univ-lille2.fr) - EA2694 - Paul FRIMAT poster 1 (n°47) - 10h00 à 11h<br />
PENEL Nicolas (n-penel@o-lambret.fr ) - EA2694 - Yazdan YAZDANPANAH orale "Régulation génétique" (6) - 15h00 à 16h<br />
PHAM Van Minh (pvminhrehab@yahoo.com) - EA2683 - André THEVENON poster 2 (n°48) - 13h00 à 14h<br />
PIESSEN Guillaume (piessen@lille.inserm.fr) - U560 - Isabelle VAN SEUNINGEN poster 1 (n°49) - 10h00 à 11h<br />
PLAISIER Fabrice (fabriceplaisier@YAHOO.fr) - EA1046 - Michèle BASTIDE orale "Transporteurs signalisation" (2) - 14h00 à 15h<br />
POURCET Benoit (benoit.pourcet@pasteur-lille.fr) - U545 - Corine GLINEUR poster 2 (n°50) - 13h00 à 14h<br />
ROGEE Sophie (rogee@lille.inserm.fr) - U524 - Jean-Claude D'HALLUIN orale "Régulation génétique" (4) - 15h00 à 16h<br />
RUCKTOOA Prakash (prakash.rucktooa@ibl.fr) - UMR8525 - Vincent VILLERET orale "Transporteurs signalisation" (4) - 14h00 à 15h<br />
RZEPKA Marie-Amelie (marie-amelie.rzepka@etu.univ-lille2.fr) - EA2690 - Chantal VAN HALUWYN poster 1 (n°51) - 10h00 à 11h<br />
SABAOUNI Ahmed (sabaouni@yahoo.fr) - EA1043 - Said YOUS poster 2 (n°52) - 13h00 à 14h<br />
SCHIKORSKI David (david.schikorski@ed.univ-lille1.fr) - FRE 2933 - Michel SALZET poster 1 (n°53) - 10h00 à 11h<br />
SIMERABET Malika (smmalika@yahoo.fr) - EA1046 - Benoit VALLET poster 2 (n°54) - 13h00 à 14h<br />
STANDAERT Annie (astandaert@univ-lille2.fr) - EMI360 - Daniel POULAIN poster 1 (n°55) - 10h00 à 11h<br />
STAUBER Jonathan (jostauber@hotmail.com) - UMR8017 - Michel SALZET poster 2 (n°56) - 13h00 à 14h<br />
TARONT Solenne (solenne.taront@pasteur-lille.fr) - U416 - André-Bernard TONNEL poster 1 (n°57) - 10h00 à 11h<br />
TASCHNER Christian (c.taschner@web.de) - EA2691 - Xavier LECLERC poster 2 (n°58) - 13h00 à 14h<br />
THURU Xavier (x-thuru@chru-lille.fr) - EPI114 - Jean-Frédéric COLOMBEL poster 1 (n°59) - 10h00 à 11h<br />
TIFFREAU Vincent (v-tiffreau@chru-lille.fr) - EA3608 - Christian FONTAINE poster 2 (n°60) - 13h00 à 14h<br />
TONNELLE Veronique (tonnelle2001@yahoo.fr) - U422 - Jean-Claude BEAUVILLAIN poster 1 (n°61) - 10h00 à 11h<br />
VAN HECKE Elsa (elsa.van-hecke@ed.univ-lille1.fr) - EA1033-Inserm ESPRI - Hubert HONDERMARCK poster 2 (n°62) - 13h00 à 14h<br />
VAN WAES Vincent (vincent.van-waes@ed.univ-lille1.fr) - EA 4052 - Muriel DARNAUDERY poster 1 (n°63) - 10h00 à 11h<br />
VANHOUTTE Francois (francois.vanhoutte@pasteur-lille.fr) - U547 - François TROTTEIN poster 2 (n°64) - 13h00 à 14h<br />
VENNA Venugopal Reddy (venu.venna@univ-lille2.fr) - EA1046 - Dominique DEPLANQUE orale "Physiologie" (2) - 9h00 à 10h<br />
VINCENT Audrey (vincent@lille.inserm.fr) - U560 - Isabelle VAN SEUNINGEN orale "Régulation génétique" (2) - 15h00 à 16h<br />
YAKOUB-AGHA Ibrahim (i-yakoub-agha@chru-lille.fr) - EA2686 - Jean-Paul DESSAINT poster 1 (n°65) - 10h00 à 11h<br />
Ecole Doctorale Biologie Santé de Lille 6ème Journée André VERBERT 27 septembre 2006
ÉCOLE DOCTORALE BIOLOGIE SANTÉ DE LILLE<br />
6ème Journée André VERBERT<br />
Colloque Annuel <strong>des</strong> Doctorants – 27 Septembre 2006<br />
Comité d’Organisation<br />
Gabriel Bidaux Maxime Culot Yohann Demont Caroline Dupont<br />
Valérie Fauquette Matthieu Flourakis Maria Katsogiannou Christelle Le Danvicq<br />
Paul Peixoto Louisa Rafa Sophie Rogée Audrey Vincent<br />
Maud Collyn d’Hooghe Jean-Jacques Hauser<br />
Avec l’aide précieuse du Comité d’Animation Scientifique de l’Ecole Doctorale Biologie<br />
et Santé de Lille :<br />
Jean-Claude D’Halluin, Malika Hamdame, Albin Pourtier, Christophe Tastet,<br />
Stanilas Tomavo, Bernard Vandenbunder<br />
Le Comité d’Organisation exprime ses remerciements aux Institutions et Sociétés qui<br />
ont participé à l’organisation du Congrès 2006 :