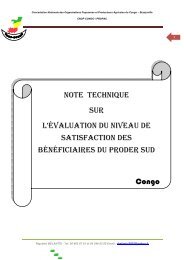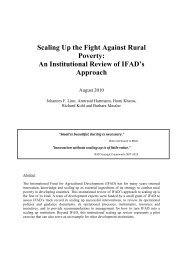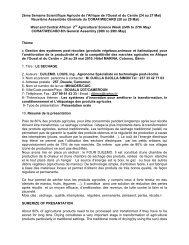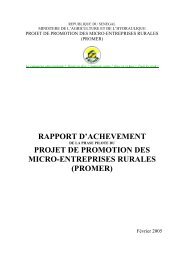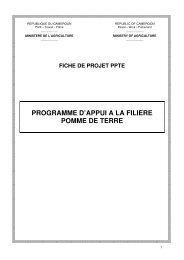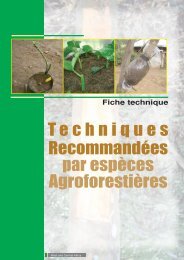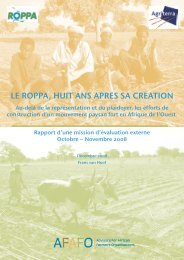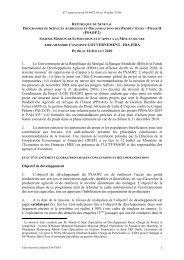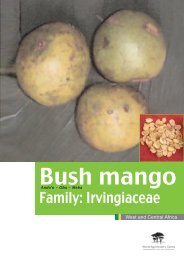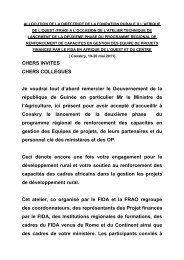Rapport atelier de capitalisation du PROMER - FIDAfrique
Rapport atelier de capitalisation du PROMER - FIDAfrique
Rapport atelier de capitalisation du PROMER - FIDAfrique
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
DR THIENDOU NIANG<br />
Consultant en Capitalisation d’expérience<br />
21, Mermoz Pyrotechnie BP 9033 Dakar Yoff<br />
Tel. : +221 33 860 62 60/77 644 47 47<br />
E-mail : acs1@orange.sn /niangthiendou@yahoo.fr<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE<br />
DU <strong>PROMER</strong> II<br />
RAPPORT PEDAGOGIQUE<br />
MAI 2011
TABLE DES MATIERES<br />
I. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE ............................................................................... 2<br />
1.1 CONTEXTE ............................................................................................................................... 2<br />
1.2 NATURE DE LA MISSION ....................................................................................................................... 2<br />
II- METHODE DE TRAVAIL ........................................................................................................ 3<br />
III. FORMATION-ACTION ........................................................................................................... 4<br />
3.1. DEROULEMENT DE LA FORMATION ACTION .................................................................................... 4<br />
Jour 1 - Ouverture, concept <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> ..................................................................... 4<br />
Jour 2 - Description <strong>de</strong>s experiences ................................................................................... 7<br />
Jour 3 - Analyse <strong>de</strong> l’experience .......................................................................................... 7<br />
Jour 4 - Rédaction <strong>de</strong>s <strong>capitalisation</strong>s .................................................................................. 8<br />
Jour 5 - Analyse critique, correction <strong>de</strong> texte ...................................................................... 8<br />
3.2. PRODUITS DE CAPITALISATION ......................................................................................................... 9<br />
IV. EVALUATION ET PLAN D’ACTION DE SUIVI ............................................................... 10<br />
IV. CONCLUSION ET CLOTURE ............................................................................................... 12<br />
V. ANNEXES .................................................................................................................................. 13<br />
ANNEXE 1 : CHRONOGRAMME ................................................................................................................ 13<br />
ANNEXE 2 : FICHES DE DESCRIPTION REMPLIES ................................................................................. 15<br />
ANNEXE 3 : LISTE DES PARTICIPANTS................................................................................................... 26<br />
ANNEXE 4 : GRILLE D’EVALUATION DES TEXTES ................................................................................. 27<br />
ANNEXE 5 : DE LA FICHE AU A LA REDACTION ..................................................................................... 29<br />
ANNEXE 6 : 4 TEXTES DE CAPITALISATION .......................................................................................... 30<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
1
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
2<br />
I. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCE<br />
1.1 CONTEXTE<br />
Le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural (<strong>PROMER</strong>), phase 2 a pour<br />
objectif <strong>de</strong> lutter contre la pauvreté en milieu rural par la création et/ou la<br />
consolidation <strong>de</strong> micro et petites entreprises.<br />
Ce projet est mis en œuvre par l’Etat <strong>du</strong> Sénégal avec l’appui <strong>du</strong> Fonds<br />
International <strong>de</strong> Développement Agricole (FIDA) et la Banque Ouest Africaine <strong>de</strong><br />
Développement (BOAD). Ses objectifs sont :<br />
la consolidation et/ou création <strong>de</strong> micro ou petites entreprises rémunératrices<br />
et créatrices d’emplois <strong>du</strong>rables dans les zones <strong>de</strong> concentration <strong>du</strong> projet,<br />
bénéficiant d’accès à <strong>de</strong>s services d’appui financiers et non-financiers<br />
adaptés, <strong>du</strong>rables et décentralisés ;<br />
la structuration ou professionnalisation <strong>du</strong> secteur <strong>de</strong> l’entreprenariat rural<br />
suivant les créneaux et filières développés dans les zones <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong><br />
façon à favoriser une meilleure performance <strong>de</strong>s entreprises, une intégration<br />
dans les organisations professionnelles, une meilleure prise en compte <strong>de</strong> ses<br />
contraintes et problèmes, et une participation effective aux cadres <strong>de</strong><br />
concertation et au dialogue avec les autres acteurs aux niveaux local, régional<br />
et national ;<br />
l’amélioration <strong>de</strong> l’environnement politique, législatif et institutionnel<br />
facilitant la création et le développement <strong>de</strong> Moyennes et Petites Entreprises<br />
Rurales (MPER).<br />
Les résultats enregistrés par le <strong>PROMER</strong> lors <strong>de</strong> sa phase I <strong>de</strong> 1997 à 2005 et <strong>de</strong> sa<br />
phase II <strong>de</strong> 2006 à 2010 ont permis l’émergence d’un entreprenariat rural<br />
dynamique en milieu rural.<br />
1.2 NATURE DE LA MISSION<br />
Le <strong>PROMER</strong> a accumulé, au cours <strong>de</strong>s 13 <strong>de</strong>rnières années, une expérience riche et<br />
diversifiée sur la promotion <strong>de</strong> l’entreprenariat rural dans les régions <strong>de</strong><br />
Tambacounda, Kolda, Kaolack et Fatick. Celle-ci concerne entre autres la<br />
boulangerie traditionnelle, les filières telles que la noix d’acajou, le néré, le lait, le<br />
karité, les appuis financiers, l’accompagnement <strong>de</strong>s MPER.<br />
Cependant, les connaissances et savoirs acquis <strong>de</strong> ces initiatives et expériences ne<br />
sont pas suffisamment documentés et capitalisés et accessibles aux autres acteurs<br />
<strong>du</strong> développement, ce qui en limite la portée.<br />
Parmi les raisons d’une telle situation, on peut citer le faible niveau <strong>de</strong> compétences<br />
<strong>de</strong>s agents et <strong>de</strong>s MPER en matière d’i<strong>de</strong>ntification, <strong>de</strong> caractérisation et <strong>de</strong><br />
formalisation <strong>de</strong>s bonnes pratiques et <strong>de</strong> génération <strong>de</strong> connaissances. Il en résulte<br />
une non traçabilité et une non visibilité <strong>de</strong>s expériences <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> et une sousvalorisation<br />
<strong>de</strong>s savoirs pro<strong>du</strong>its.
La mission d’appui méthodologique à la Composante Services d’Informations aux<br />
Entreprises (juin 2010) avait recommandé la <strong>capitalisation</strong> <strong>de</strong>s expériences sur les<br />
thèmes porteurs <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> et le renforcement <strong>de</strong>s capacités sur les techniques <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong> d’expérience.<br />
En 2011, FIDAFRIQUE a accompagné le <strong>PROMER</strong> dans l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong><br />
thèmes prioritaires <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience. Il s’agit <strong>de</strong> thèmes tels que la<br />
boutique <strong>de</strong>s MER, l’offre <strong>de</strong> service SDE, le partage <strong>de</strong>s risques.<br />
C’est dans ce cadre que s’inscrit cette mission <strong>de</strong> formation action <strong>de</strong>stinée à<br />
renforcer les capacités <strong>de</strong>s porteurs d’expérience <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> en techniques <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong> d’expérience et <strong>de</strong> les accompagner à i<strong>de</strong>ntifier, décrire, analyser et<br />
rédiger <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>.<br />
Au terme <strong>de</strong> la formation-action, les participants <strong>de</strong>vaient être capables d’expliquer<br />
le concept <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience, d’i<strong>de</strong>ntifier <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>,<br />
<strong>de</strong> décrire et d’analyser les expériences <strong>de</strong> développement. Ils <strong>de</strong>vaient être<br />
également capables d’utiliser les règles d’écriture <strong>de</strong> base et d’élaborer <strong>de</strong>s<br />
supports <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience.<br />
La présente mission comportait <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> préparation et d’animation <strong>de</strong> la<br />
formation, d’appui conseils à la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
d’expérience, <strong>de</strong> mise en forme <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et <strong>de</strong> rédaction<br />
d’un rapport pédagogique.<br />
II- METHODE DE TRAVAIL<br />
Notre métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail a consisté en la conception <strong>du</strong> programme et <strong>de</strong>s supports<br />
pédagogiques, l’animation d’un <strong>atelier</strong> <strong>de</strong> formation-action, la mise en forme <strong>de</strong>s<br />
documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et la rédaction <strong>du</strong> rapport pédagogique.<br />
Phase 1 : Conception <strong>du</strong> programme et <strong>de</strong>s supports pédagogiques<br />
La première étape a consisté à l’analyse sommaire <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong><br />
formation <strong>de</strong>s agents <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> en <strong>capitalisation</strong> d’expérience : collecte<br />
d’informations sur les profils et parcours et les expériences en documentation<br />
d’expérience, les principales préoccupations et les attentes <strong>de</strong> la formation.<br />
Cette phase a permis <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>de</strong>s attentes liées à la maîtrise <strong>de</strong>s<br />
concepts, étapes, outils et métho<strong>de</strong>s ainsi que les techniques d’écriture.<br />
La <strong>de</strong>uxième étape a consisté à la conception <strong>du</strong> programme <strong>de</strong> formation.<br />
Il s’agissait d’abord <strong>de</strong> définir les compétences visées par la formation, les<br />
objectifs pédagogiques, les contenus <strong>de</strong> formation. Il s’agissait ensuite<br />
d’élaborer les supports pédagogiques, les métho<strong>de</strong>s d’animation, le<br />
chronogramme (voir annexe 1) et les outils d’évaluation <strong>de</strong> la formation ainsi<br />
que le powerpoint <strong>de</strong> la formation.<br />
La troisième étape a consisté à élaborer un outil <strong>de</strong> planification <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong> d’expérience, d’une matrice <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription d’une<br />
expérience (voir annexe 3) et d’un cadre d’analyse globale <strong>de</strong> la<br />
contribution <strong>de</strong> l’entreprenariat rural à la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la pauvreté.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
3
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
4<br />
La quatrième et <strong>de</strong>rnière étape <strong>de</strong> cette phase a consisté à l’accompagnement<br />
<strong>de</strong>s experts <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> à collecter <strong>de</strong>s informations préalables sur les<br />
expériences.<br />
Phase 2 : Animation <strong>de</strong> la formation-action<br />
La <strong>de</strong>uxième phase a porté sur l’animation d’une session <strong>de</strong> formation <strong>de</strong> 6 jours<br />
sur la <strong>capitalisation</strong> d’expérience regroupant 11 personnes (agents <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, un<br />
MPER et un partenaire prestataire) (voir annexe 4).<br />
Les contenus <strong>de</strong> formation centrés sur le concept <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience,<br />
l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>, la <strong>de</strong>scription et l’analyse<br />
d’expérience, la rédaction <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et les stratégies <strong>de</strong><br />
diffusion et <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> d’expérience.<br />
La formation a té complétée par une session <strong>de</strong> lecture critique et <strong>de</strong> correction<br />
approfondie <strong>de</strong>s textes (orthographe, syntaxe, lisibilité). Ce processus a débouché<br />
sur la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> 4 articles/documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expériences rédigés au<br />
cours <strong>de</strong> la formation.<br />
Phase 3: Mise en forme <strong>de</strong>s documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Il s’est agi essentiellement <strong>de</strong> faire la relecture critique <strong>de</strong>s documents, la réécriture<br />
<strong>de</strong> certaines parties et leur mise en forme définitive suivie d’une proposition<br />
d’orientation pour création graphique et l’édition d’un livret <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>. En<br />
outre, <strong>de</strong>s conseils ont été fournis pour la consolidation <strong>de</strong>s enseignements et le<br />
processus <strong>de</strong> mise en forme finale et d’impression.<br />
Phase 4 : Rédaction d’un rapport pédagogique<br />
Il s’agissait <strong>de</strong> la rédaction <strong>du</strong> rapport pédagogique <strong>de</strong> la formation-action sur la<br />
<strong>capitalisation</strong> d’expérience en mettant l’accent sur les aspects suivants : contexte,<br />
objet <strong>de</strong> la mission, objectifs, résultats atten<strong>du</strong>s, déroulement <strong>de</strong> la mission,<br />
difficultés rencontrées conclusions, apprentissage et recommandations.<br />
III. FORMATION-ACTION<br />
3.1. DEROULEMENT DE LA FORMATION ACTION<br />
JOUR 1 - OUVERTURE, CONCEPT DE CAPITALISATION<br />
La session a débuté à 9 heures 30 par un mot <strong>de</strong> bienvenue <strong>de</strong> M. Hyacinthe<br />
Mbengue, directeur <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>. Après avoir salué l’assistance, M. Mbengue a<br />
affirmé que la <strong>capitalisation</strong>, moment important pour les projets <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, va<br />
permettre au projet <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s leçons pour consoli<strong>de</strong>r les acquis. Il<br />
s’agit aussi, selon lui, <strong>de</strong> capitaliser sur les acquis <strong>de</strong>s autres projets et surtout <strong>de</strong><br />
répliquer les expériences lorsque cela peut se faire. Il a enfin évoqué la prochaine<br />
réunion <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> à Accra, au Ghana, où « il faudra partager l’expérience<br />
<strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>. » En conclusion, a-t-il dit, cette semaine « sera l’occasion <strong>de</strong> bien se<br />
préparer pour la rencontre d’Accra ». Il a terminé en remerciant la disponibilité <strong>du</strong><br />
facilitateur tout en insistant que cette session n’est qu’une première phase en<br />
attendant la <strong>de</strong>uxième.<br />
M. Thiendou Niang, facilitateur, a fait une brève présentation <strong>du</strong> Cabinet Afrique<br />
Communication qu’il dirige avant <strong>de</strong> rappeler le but <strong>de</strong> l’<strong>atelier</strong>. Il a ensuite
<strong>de</strong>mandé aux participants <strong>de</strong> se présenter et <strong>de</strong> formuler leurs attentes pour cette<br />
session <strong>de</strong> formation.<br />
TABLEAU 1 : LISTE DES BESOINS EXPRIMES<br />
Nom Attentes<br />
Hawa Bousso Ndiaye, Documentaliste<br />
4 documents mis en forme sur les quatre<br />
thèmes retenus<br />
Ibrahima Sory Diallo, Chargé <strong>de</strong>s appuis<br />
financiers<br />
Etre mieux outillé pour rendre les<br />
documents lisibles, afin qu’il y ait une<br />
traçabilité<br />
Mamadou Ndour, Assistant au responsable<br />
<strong>de</strong> suivi-évaluation<br />
Amath Ly, Responsable local antenne centre<br />
Ousseynou Ndiaye, Responsable Antenne<br />
Sud-est<br />
Sira Fofana, Bénéficiaire <strong>du</strong> Promer<br />
Ndèye Fatoumata Sall, Responsable suiviévaluation<br />
Ahmed Hady Seydi, <strong>PROMER</strong>/SAFIR<br />
Moustapha Cissé, Responsable <strong>de</strong>s<br />
opérations techniques<br />
Hyacinthe Mbengue, Directeur <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong><br />
Connaître le processus <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Maîtrise <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Maîtrise <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Changement dans les pratiques<br />
Etre outillée pour rédiger un document <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong><br />
Avoir un meilleur aperçu <strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong>.<br />
Etre outillé pour pouvoir capitaliser les<br />
expériences. Formation la plus participative<br />
possible avec <strong>de</strong>s cas pratiques bien<br />
i<strong>de</strong>ntifiés. Qu’on puisse avoir les<br />
documents finalisés<br />
Que les séminaristes maîtrisent les<br />
techniques <strong>de</strong> rédaction, pour qu’il y ait<br />
plus <strong>de</strong> lisibilité dans ce que le <strong>PROMER</strong><br />
est en train <strong>de</strong> faire. Qu’il y ait quelque<br />
chose sur les processus (étapes).<br />
Actuellement, ces processus ne sont pas<br />
suffisamment maîtrisés<br />
Résumant ces attentes, M. Niang les a classées en trois catégories :<br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> 4 documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>, mis en forme et diffusables<br />
maîtrise <strong>du</strong> processus <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
maîtrise <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Lors <strong>de</strong> la préparation <strong>de</strong> l’<strong>atelier</strong>, un travail préliminaire a été réalisé sur trois <strong>de</strong>s<br />
thèmes retenus pour être capitalisés, a affirmé M. Niang ; il reste le travail<br />
préliminaire sur le dialogue politique. Le facilitateur affirme que la formation se<br />
veut une formation pratique, une formation-action pour avoir <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its.<br />
L’<strong>atelier</strong> s’est ensuite poursuivi avec la définition <strong>de</strong>s enjeux <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong><br />
d’expérience. Elle vise à pro<strong>du</strong>ire <strong>de</strong> la connaissance pour améliorer les pratiques<br />
et les théories <strong>de</strong> développement, tirer les leçons pour améliorer la con<strong>du</strong>ite <strong>de</strong>s<br />
activités ou la conception <strong>de</strong> nouveaux projets, inspirer d’autres acteurs <strong>de</strong><br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
5
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
6<br />
développement et <strong>de</strong> nouvelles politiques publiques, conforter les partenaires et<br />
faciliter la mobilisation <strong>de</strong> ressources.<br />
Dans les définitions proposées par les participants, ceux-ci ont noté que la<br />
<strong>capitalisation</strong> est un « processus participatif dans la mémorisation <strong>du</strong> savoir afin <strong>de</strong><br />
mieux partager avec les autres ». D’autres mots et expressions sont revenus dans la<br />
perception <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> par les participants : innovation, organisation,<br />
transmission à <strong>de</strong>s cibles bien i<strong>de</strong>ntifiées, partage, diffusion,<br />
conservation/mémorisation, traçabilité pour partager, processus <strong>de</strong> participation,<br />
synthèse.<br />
On peut aussi définir la <strong>capitalisation</strong> comme « un processus (participatif)<br />
d’i<strong>de</strong>ntification, <strong>de</strong> collecte, <strong>de</strong> tri, d’organisation, d’analyse et <strong>de</strong> validation <strong>de</strong><br />
l’information relative à une initiative donnée, en vue <strong>de</strong> la partager avec d’autres<br />
acteurs en utilisant <strong>de</strong>s supports adaptés ». Elle met l’accent sur les bonnes<br />
pratiques et est dépositaire d’un certain nombre d’enjeux (enjeux <strong>de</strong> mémoire, <strong>de</strong><br />
patrimoine et <strong>de</strong> développement ; enjeux <strong>de</strong> communication et <strong>de</strong> plaidoyer ;<br />
enjeux <strong>de</strong> notoriété et <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> ressources).<br />
Les objectifs <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> ont ensuite été explicités. Ceux-ci intègrent une<br />
dimension « tirer les enseignements » et une dimension « passage à l’échelle »<br />
Pour capitaliser une expérience, il faut cependant avoir une connaissance <strong>de</strong>s<br />
éléments <strong>de</strong> processus qu’il faut consoli<strong>de</strong>r ensuite. Comprendre le concept <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong>, c’est savoir comment i<strong>de</strong>ntifier un thème, comment élaborer un plan<br />
<strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et comment gérer une dynamique <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>. Il s’agit là<br />
d’un travail d’équipe où l’ensemble <strong>de</strong>s acteurs doivent être mobilisés. Cela<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> aussi la maîtrise <strong>de</strong>s sources d’information. La <strong>capitalisation</strong>, c’est<br />
également décrire l’expérience, en remplissant la fiche <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription, puis analyser<br />
l’expérience, c’est-à-dire partir <strong>de</strong> la leçon et examiner quels sont les arguments qui<br />
sous-ten<strong>de</strong>nt cette leçon. Il faut lire l’expérience à travers <strong>de</strong>s indicateurs,<br />
construire son argumentaire… Ensuite, il faut raconter (écrire) l’expérience en<br />
suivant les règles d’écriture, avant <strong>de</strong> la diffuser grâce à un dispositif <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s<br />
savoirs.<br />
Au total, le travail <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> suppose un regard très critique en interne.<br />
4 groupes ont ensuite été formés pour la poursuite <strong>du</strong> travail :<br />
Groupe sur la caution solidaire Ahmed Hady Seydi, Boubacar, Diallo<br />
Groupe Boutique <strong>de</strong>s microentrepreneurs<br />
ruraux<br />
Groupe sur les services <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s entreprises<br />
Groupe sur le dialogue politique et le<br />
processus<br />
Hawa Sow Bousso Ndiaye, Sylla, Hamat<br />
Ly<br />
Fatoumata Sané Guissé, Ousseynou<br />
NDiaye, Hawa Traore<br />
Moustapha Cissé, Mamadou Ndour,<br />
Hyacinthe Mbengue<br />
Il est décidé que chaque groupe examine le travail d’un autre groupe. Le groupe sur<br />
le Dialogue politique et Processus va faire la critique <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> groupe sur la<br />
caution solidaire et vice-versa. Le groupe sur les boutiques <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs<br />
ruraux va faire la critique <strong>du</strong> travail <strong>du</strong> groupe sur les services <strong>de</strong> développement<br />
aux entreprises et vice-versa.
Cycle <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience. La <strong>capitalisation</strong> d’expérience est un<br />
processus en 7 étapes :<br />
Etape 1 : Evaluation participative <strong>de</strong> l’expérience et besoins <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong><br />
Etape 2 : I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
Etape 3 : Planification <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
Etape 4 : Collecte <strong>de</strong> données<br />
Etape 5 : Description et analyse <strong>de</strong> l’expérience<br />
Etape 6 : Mise en forme et contrôle <strong>de</strong> qualité<br />
Etape 7 : Diffusion, le partage <strong>de</strong>s acquis et le plaidoyer<br />
Le concept <strong>de</strong> diffusion renvoie à la fourniture, à la livraison <strong>de</strong> l’information. Le<br />
concept <strong>de</strong> partage met l’accent sur le feedback, l’échange, la compréhension<br />
commune, dans le but d’établir un consensus, <strong>de</strong> faire adhérer.<br />
L’après-midi <strong>de</strong> la session a été consacrée à la révision <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong>.<br />
Il s’agissait <strong>de</strong> corriger les plans <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> renseignés, mais aussi<br />
d’expliquer avec force détails, comment on réalise un plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>.<br />
Cela commence par la définition <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et la compréhension <strong>de</strong><br />
ses objectifs. Il faut aussi choisir le thème <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong>. Quel est son<br />
contexte ? Quels sont les objectifs <strong>de</strong> changement visés par la <strong>capitalisation</strong> ?<br />
JOUR 2 - DESCRIPTION DES EXPERIENCES<br />
L’objet <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième journée est <strong>de</strong> finaliser les plans <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> et, pour<br />
l’un <strong>de</strong>s groupes, <strong>de</strong> finaliser aussi la fiche <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription. Les 4 groupes ont<br />
planché sur leurs plans <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> : le Groupe 1 sur le cautionnement<br />
solidaire/les Risques, le Groupe 2 sur les boutiques <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux,<br />
le Groupe 3 sur le marché <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises, et le<br />
Groupe 4 sur la promotion <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales.<br />
Le facilitateur s’est appesanti sur la <strong>de</strong>scription, « carte d’i<strong>de</strong>ntité » <strong>de</strong><br />
l’expérience. Elle donne les renseignements qui distinguent l’expérience d’une<br />
autre et mettent en valeur son caractère unique : titre <strong>de</strong> l’expérience, date/<strong>du</strong>rée,<br />
zone/lieu, nature, objectifs, acteurs, approche, particularités, etc. Les objectifs <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>scription sont <strong>de</strong> caractériser l’expérience et <strong>de</strong> disposer <strong>de</strong>s informations<br />
indispensables à son analyse ultérieure. Le facilitateur a montré comment on décrit<br />
une expérience avec l’examen détaillé et l’explication <strong>de</strong> l’outil « Fiche <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scription d’une expérience ».<br />
JOUR 3 - ANALYSE DE L’EXPERIENCE<br />
Cette journée à été consacrée à l’analyse d’une expérience et à la présentation<br />
<strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> rédaction. L’analyse <strong>de</strong> l’expérience est un examen critique qui<br />
permet d’évaluer les pratiques et d’i<strong>de</strong>ntifier les éléments d’apprentissage (facteurs<br />
<strong>de</strong> succès, facteurs d’échecs, enseignements). Ses objectifs sont <strong>de</strong> rechercher dans<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
7
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
8<br />
l’expérience <strong>de</strong> nouvelles connaissances, <strong>de</strong> rechercher ce qui permet d’améliorer<br />
les pratiques et <strong>de</strong> rechercher les leçons qui peuvent inspirer d’autres acteurs.<br />
Le processus d’analyse d’expérience a été expliqué, avec les notions <strong>de</strong> critères<br />
d’analyse (3 à 5 paramètres), d’indicateurs (3 à 5 indicateurs par critère) et<br />
d’évaluation <strong>de</strong> l’expérience en termes d’aspects positifs, d’aspects négatifs et<br />
d’aspects non maîtrisés. L’analyse d’une expérience permet l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong><br />
nouvelles connaissances, d’innovations, <strong>de</strong> bonnes pratiques et <strong>de</strong> leçons.<br />
La journée a permis aux participants, dans le cadre <strong>de</strong> leurs groupes <strong>de</strong> travail, <strong>de</strong><br />
procé<strong>de</strong>r à l’analyse <strong>de</strong>s expériences retenues. Le facilitateur les a assistés dans<br />
cette tâche, en répondant aux questions qui survenaient au cours <strong>du</strong> processus.<br />
Une partie <strong>de</strong> l’après-midi a été consacrée à la présentation <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> rédaction,<br />
notamment celle <strong>de</strong> la lisibilité, avec la manière <strong>de</strong> traiter les mots, les phrases et<br />
les paragraphes pour disposer d’un texte lisible, c’est-à-dire compris sans effort<br />
particulier et mémorisé.<br />
JOUR 4 - REDACTION DES CAPITALISATIONS<br />
Cette journée a été consacrée à la rédaction <strong>de</strong>s <strong>capitalisation</strong>s après les jours<br />
précé<strong>de</strong>nts où les participants ont appris à i<strong>de</strong>ntifier une expérience, remplir leur<br />
fiche <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>, analyser l’expérience et prendre connaissance <strong>de</strong>s règles<br />
d’écriture <strong>de</strong> leurs textes. Prévue initialement pour 13 heures, cette phase s’est<br />
finalement poursuivie jusqu’à 17 heures, le temps que chaque groupe puisse<br />
terminer son travail <strong>de</strong> rédaction ou avancer profondément en ce domaine.<br />
Le facilitateur a ensuite expliqué la suite <strong>du</strong> processus :<br />
1. Remise à tous <strong>de</strong> la grille d’évaluation<br />
2. Affectation <strong>de</strong>s textes à analyser<br />
3. Critique croisée (lecture indivi<strong>du</strong>elle, réflexion <strong>de</strong> groupe, mise en commun)<br />
4. Remise d’un rapport <strong>de</strong> synthèse d’une <strong>de</strong>mi-page et <strong>de</strong> la grille renseignée.<br />
Le rapport <strong>de</strong> synthèse doit mettre l’accent sur trois éléments <strong>de</strong> la critique<br />
(structuration, lisibilité, cohérence, etc.)<br />
5. Restitution <strong>de</strong>s travaux : 15 mn pour chaque thème<br />
6. Discussion générale<br />
Le programme <strong>de</strong> la journée <strong>du</strong> len<strong>de</strong>main a été établi comme suit :<br />
8h-9h30 Critique <strong>de</strong>s textes<br />
9h30-11h Restitution et discussion<br />
11h-12h30 Correction <strong>de</strong>s textes<br />
12h30-15h Pause<br />
15h-16h Textes corrigés à attribuer à un autre groupe<br />
16h-17h Critique niveau 2, partage<br />
JOUR 5 - ANALYSE CRITIQUE, CORRECTION DE TEXTE<br />
La présentation <strong>de</strong>s évaluations notées sur les grilles d’évaluation a commencé à<br />
9h55.
Evaluation <strong>du</strong> texte sur les boutiques <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux : La<br />
plupart <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> la grille ont reçu une réponse positive. Les évaluateurs ont<br />
cependant estimé que les ratés <strong>de</strong> l’expérience ne ressortaient pas suffisamment et<br />
que l’on ne percevait pas assez l’enjeu <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> dans le texte.<br />
Evaluation <strong>du</strong> texte sur le marché <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s<br />
entreprises : Monsieur Niang a noté qu’il faut avoir <strong>de</strong>s « faits et chiffres » pour<br />
illustrer les textes (c’est-à-dire <strong>de</strong>s exemples, <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> preuve, <strong>de</strong>s<br />
témoignages, etc.). Il a aussi affirmé la nécessité d’un message central fort pour que<br />
le lecteur puisse appréhen<strong>de</strong>r « <strong>de</strong> quoi on parle ».<br />
Evaluation <strong>du</strong> texte sur le cautionnement solidaire : Les points suivants ont été<br />
notés: message central non perceptible, innovation non mise en valeur, absence <strong>de</strong><br />
chiffres pour les ressources, facteurs <strong>de</strong> succès non apparents, conclusion<br />
manquante, trop <strong>de</strong> puces dans le texte. Ainsi, le facilitateur a réaffirmé<br />
l’importance <strong>du</strong> préalable d’un plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> bien conçu.<br />
Evaluation <strong>du</strong> texte sur la promotion <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux : la<br />
rédaction <strong>du</strong> texte n’était pas terminée, l’évaluation a été reportée à plus tard.<br />
Les auteurs <strong>de</strong>s différents textes ont ensuite procédé à la correction <strong>de</strong> leurs textes,<br />
en tenant compte <strong>de</strong>s contenus <strong>de</strong>s évaluations faites par les pairs.<br />
3.2. PRODUITS DE CAPITALISATION<br />
Les quatre <strong>capitalisation</strong>s effectuées ont porté sur les thèmes suivants :<br />
1. Boutiques <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux<br />
2. Marché <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises<br />
3. Cautionnement solidaire<br />
4. Promotion <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales<br />
Capitalisation 1 : Boutique <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux : <strong>de</strong>s ratés dans la<br />
mise en œuvre d’une innovation<br />
L’approche <strong>de</strong>scendante <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement constitue un facteur <strong>de</strong> non<br />
appropriation <strong>de</strong>s outils et <strong>de</strong> contre-performance. Le cas <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong>s microentrepreneurs<br />
ruraux, à Tambacounda et à Kaolack, illustre l’échec <strong>de</strong> cette<br />
démarche. Ces boutiques, fortement soutenues par le <strong>PROMER</strong>, ont enregistré <strong>de</strong>s<br />
pertes récurrentes découlant <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong>s stocks et <strong>de</strong> l’irrégularité dans la<br />
qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its.<br />
Capitalisation 2 : Service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises : un levier <strong>de</strong><br />
performance et <strong>de</strong> compétitivité <strong>de</strong>s micro et petites entreprises<br />
Un service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> qualité garantit la performance et<br />
la compétitivité <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales (MPER). L’expérience <strong>de</strong>s<br />
marchés <strong>de</strong> services <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises <strong>du</strong> Projet <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong><br />
l’entreprenariat rural <strong>du</strong> Sénégal montre que la disponibilité <strong>de</strong> compétences<br />
avérées <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services, d’outils méthodologiques et <strong>de</strong> normes adaptés<br />
entraîne une augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité <strong>de</strong>s MPER et <strong>de</strong>s emplois. Elle<br />
améliore également la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, favorise l’accès aux marchés locaux et<br />
ouvre <strong>de</strong>s perspectives sur les marchés nationaux et régionaux.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
9
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
10<br />
Capitalisation 3 : Micro et petites entreprises rurales : quand le partage <strong>de</strong>s<br />
risques garantit un accès <strong>du</strong>rable au crédit<br />
La caution solidaire couplée au partage <strong>de</strong>s risques facilite l’accès <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs ruraux à <strong>de</strong>s services financiers adaptés et garantit la sécurité <strong>du</strong><br />
portefeuille <strong>de</strong> prêts constitué. Dans l’expérience <strong>du</strong> Service d’Appui à la Finance<br />
rurale (SAFIR) <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, près <strong>de</strong> 700 micro-entrepreneurs ruraux, <strong>de</strong><br />
Tambacounda et <strong>de</strong> Thiénaba, ont bénéficié <strong>de</strong> l’accès au financement pour plus <strong>de</strong><br />
58 millions <strong>de</strong> francs CFA. Le taux <strong>de</strong> remboursement <strong>de</strong> plus 98% montre la<br />
bonne santé <strong>du</strong> portefeuille.<br />
Capitalisation 4 : Renforcement <strong>de</strong>s capacités : un levier pour le<br />
développement <strong>de</strong> l’entreprise rurale<br />
Les micro et petites entreprises rurales les plus performantes sont celles qui<br />
bénéficient <strong>de</strong> la globalité <strong>du</strong> paquet d’appuis constitué par les formations, le<br />
financement et le suivi-accompagnement, selon une séquence bien définie. Selon<br />
l’expérience <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, la maîtrise <strong>de</strong>s compétences entrepreneuriales, associée<br />
à la satisfaction <strong>de</strong>s besoins financiers en fonds <strong>de</strong> roulement et en investissement<br />
<strong>de</strong> l’entreprise et soutenu par un conseil <strong>de</strong> proximité, permet d’inscrire l’activité<br />
<strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales dans la <strong>du</strong>rabilité.<br />
IV. EVALUATION ET PLAN D’ACTION DE SUIVI<br />
A l’évaluation finale <strong>de</strong> l’<strong>atelier</strong>, les questions suivantes ont été posées aux<br />
participants :<br />
• Quels sont les points forts ?<br />
• Quels sont les points faibles ?<br />
• Indiquer votre principale suggestion pour améliorer les sessions <strong>de</strong> formation<br />
futures.<br />
• Citer les <strong>de</strong>ux principaux enseignements tirés <strong>de</strong> la formation.<br />
• Quelle est votre principale recommandation pour une institutionnalisation <strong>de</strong><br />
la <strong>capitalisation</strong> d’expérience au sein <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> ?<br />
Points forts – Les points forts les plus cités sont la maîtrise <strong>du</strong> processus <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong> (3 fois), le travail <strong>de</strong> partage et d’échange (3 fois), la métho<strong>de</strong><br />
participative (3 fois). Viennent ensuite l’animation (2 fois) et la connaissance <strong>de</strong>s<br />
règles d’écriture (2 fois).<br />
Les points suivants apparaissent également (cités chacun une fois) : présentation <strong>du</strong><br />
processus <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>, explications précises <strong>du</strong> processus, travail sur les<br />
indicateurs et les critères, méthodologie utilisée avec les questions/réponses et le<br />
partage en plénière, plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>, <strong>de</strong>scription et analyse, évaluation par les<br />
pairs, pédagogie, neutralité et compétence <strong>de</strong>s formateurs. Un participant a aussi<br />
noté que « plus on avance, plus on y prend goût ».<br />
Points faibles – Les points faibles les plus cités sont le temps trop court <strong>de</strong> la<br />
formation (8 fois) et les conditions <strong>de</strong> travail peu favorables (6 fois). Viennent<br />
ensuite (cités chacun une fois) l’absence <strong>de</strong> document pour la préparation, la<br />
formation « in<strong>du</strong>isant beaucoup <strong>de</strong> sorties », les problèmes d’électricité, la<br />
pression. Un participant a estimé qu’il n’y avait, sur les points faibles, rien à<br />
signaler.
Principales suggestions pour améliorer les sessions <strong>de</strong> formations futures - A<br />
cette question, les <strong>de</strong>ux suggestions les plus citées sont celles <strong>de</strong> donner plus <strong>de</strong><br />
temps à la formation (4 fois), <strong>de</strong> tenir l’<strong>atelier</strong> hors <strong>de</strong>s locaux <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> (3 fois)<br />
et <strong>de</strong> permettre aux participants d’avoir une bonne connaissance <strong>du</strong> thème pour<br />
bien préparer la pro<strong>du</strong>ction (2 fois). Les autres suggestions (citées chacune une<br />
fois) sont : organiser le lieu <strong>de</strong> travail ; <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’implication <strong>du</strong> comité<br />
d’animation <strong>du</strong> processus pour la collecte, la <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la fiche pour gagner <strong>du</strong><br />
temps, toujours recourir à <strong>de</strong>s formations-actions, s’appesantir sur la rédaction.<br />
Deux principaux enseignements tirés <strong>de</strong> la formation – De nombreuses réponses<br />
ont été suggérées pour cette question. Les participants ont donné les réponses<br />
suivantes :<br />
• La <strong>capitalisation</strong> est utile pour soi-même avant <strong>de</strong> l’être sur le plan<br />
professionnel<br />
• La <strong>capitalisation</strong> est un processus qui s’acquiert avec le temps<br />
• La préparation <strong>de</strong> la rédaction grâce à la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> base<br />
précis<br />
• La cohérence <strong>de</strong>s parties à développer pour assurer un fil con<strong>du</strong>cteur<br />
• La méthodologie adoptée <strong>de</strong> mise en commun est très pratique et permet<br />
progressivement une mise à niveau<br />
• Le plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> est la clé <strong>du</strong> succès<br />
• Les phrases courtes sont les plus lisibles<br />
• Pour rédiger un document <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> satisfaisant, il faut veiller à faire<br />
au préalable un bon plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
• Il faut avoir <strong>de</strong> bonnes sources pour étayer l’argumentaire<br />
• La <strong>du</strong>rée est à augmenter (2 jours <strong>de</strong> plus)<br />
• Tenir l’<strong>atelier</strong> hors <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> pour une meilleure mobilisation <strong>de</strong>s<br />
acteurs<br />
• Processus <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> maîtrisé<br />
• Meilleure implication (bonne sensibilisation) sur le processus <strong>de</strong><br />
<strong>capitalisation</strong> et son importance<br />
• Exposé et présentation <strong>du</strong> processus <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> bien fait<br />
• Les principes pour une bonne rédaction <strong>de</strong> l’expérience<br />
• Une visibilité sur les étapes et outils pour une bonne <strong>capitalisation</strong><br />
• le cadre participatif<br />
Principales recommandations pour une institutionnalisation <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong> d’expérience au sein <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> –<br />
1) Instaurer tous les six mois une séance <strong>de</strong> formation action en <strong>capitalisation</strong> ;<br />
2) Présenter une expérience capitalisée à l’occasion <strong>de</strong> chaque réunion<br />
trimestrielle élargie ;<br />
3) Inscrire la <strong>capitalisation</strong> au PTBA afin qu’un jour soit consacré chaque<br />
trimestre à une séance <strong>de</strong> partage ;<br />
4) Mettre la réalisation d’un nombre <strong>de</strong> documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> pro<strong>du</strong>its<br />
dans les fiches <strong>de</strong> poste <strong>de</strong>s agents <strong>du</strong> projet.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
11
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
12<br />
Dans le cadre <strong>de</strong>s actions post-<strong>atelier</strong>, il a été décidé que les articles non terminés<br />
<strong>de</strong>vront être envoyés par email au facilitateur au plus tard le 16 mai 2011. Celuici<br />
aura une semaine pour les finaliser et les retourner aux auteurs.<br />
IV. CONCLUSION ET CLOTURE<br />
L’<strong>atelier</strong> a permis aux participants <strong>de</strong> maîtriser le concept, la démarche et les outils<br />
<strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> d’expérience.<br />
Il a aussi permis la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> 4 documents <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> dont <strong>de</strong>ux finalisés<br />
(boutiques <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux, cautionnement solidaire/partage <strong>de</strong>s<br />
risques) et <strong>de</strong>ux autres qui méritent d’être améliorés (marché <strong>de</strong>s services <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s entreprises et promotion <strong>de</strong>s micro et petites entreprises<br />
rurales).<br />
Prenant la parole, à la clôture <strong>de</strong> l’<strong>atelier</strong>, Mme Guissé a remercié l’ensemble <strong>de</strong>s<br />
participants pour leur implication dans les travaux, ainsi que le directeur <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong> qui a permis la tenue <strong>de</strong> cet <strong>atelier</strong>. Elle a aussi remercié le facilitateur,<br />
M. Thiendou Niang, pour avoir distillé au cours <strong>de</strong> cette formation une culture <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong> au sein <strong>de</strong>s participants qui ont compris l’importance et le sérieux <strong>de</strong><br />
cette méthodologie.<br />
Au total, les six journées <strong>de</strong> travail ont montré qu’il y avait une forte <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour<br />
l’accompagnement, l’édition, la diffusion et le partage <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> cette<br />
<strong>capitalisation</strong>. Les participants ont exprimé le besoin pour con<strong>du</strong>ire un nouveau<br />
processus d’accompagnement <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> en vue <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r les acquis et<br />
augmenter le nombre <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong>
V. ANNEXES<br />
ANNEXE 1 : CHRONOGRAMME<br />
Lundi 02 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.30-10.00 Accueil et ouverture<br />
o Mot <strong>de</strong> bienvenue<br />
o Présentation <strong>de</strong>s participants et <strong>de</strong> leurs attentes<br />
o Présentation <strong>de</strong> l’<strong>atelier</strong> et organisation <strong>du</strong> travail (rapporteurs et<br />
évaluateurs)<br />
10.00-11.00 Concept <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience : enjeux, objectifs, cibles, conditions<br />
préalables à une <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
11.00-11.15 Pause santé<br />
11.15-13.00 Rappel <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> l’expérience et <strong>de</strong>s thèmes <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> : critères,<br />
procé<strong>du</strong>res et mécanismes<br />
Planification d’une <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
Exercice d’élaboration d’un plan <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
13.30-14.30 Pause repas<br />
14.30-17.00 Sources et outils <strong>de</strong> collecte d’information : gui<strong>de</strong> d’entretien, questionnaire, récits<br />
<strong>de</strong> vie<br />
Evaluation et clôture <strong>de</strong> la journée<br />
17.00-17.15 Pause <strong>de</strong> départ<br />
Mardi 03 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.00-09.30 Ouverture <strong>de</strong> la journée<br />
09.30-11.00 Animation d’une <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
11.00-11.15 Pause santé<br />
11.15-13.30 Animation d’une <strong>capitalisation</strong> d’expérience<br />
13.30-14.30 Pause repas<br />
14.30-15.30 Description <strong>de</strong> l’expérience : présentation<br />
15.30-17.00 Description <strong>de</strong> l’expérience : application<br />
Evaluation et clôture <strong>de</strong> la journée<br />
17.00-17.15 Pause <strong>de</strong> départ<br />
Mercredi 04 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.00-09.30 Ouverture <strong>de</strong> la journée<br />
09.30-11.00 Analyse <strong>de</strong> l’expérience: présentation<br />
11.00-11.15 Pause santé<br />
11.15-12.15 Analyse <strong>de</strong> l’expérience : application<br />
12.15-13.00 Analyse <strong>de</strong> l’expérience : application<br />
13.30-14.30 Pause repas<br />
14.30-15.30 Techniques <strong>de</strong> rédaction d’un document <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> : plan et règles <strong>de</strong><br />
lisibilité : présentation<br />
15.30-17.00 Techniques <strong>de</strong> rédaction d’un document <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong> : plan et règles <strong>de</strong><br />
lisibilité : application<br />
Evaluation et clôture <strong>de</strong> la journée<br />
17.00-17.15 Pause <strong>de</strong> départ<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
13
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
14<br />
Jeudi 05 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.00-09.30 Ouverture <strong>de</strong> la journée<br />
09.30-10.30 Rédaction <strong>de</strong> textes : travail indivi<strong>du</strong>el<br />
10.30-11.00 Rédaction <strong>de</strong> textes : travail indivi<strong>du</strong>el (suite)<br />
11.00-11.15 Pause santé<br />
11.15-13.00 Rédaction <strong>de</strong> textes : travail indivi<strong>du</strong>el (suite)<br />
13.00-14.30 Pause repas<br />
14.30-15.30 Analyse critique <strong>de</strong>s textes : travail collectif<br />
15.30-17.00 Analyse critique <strong>de</strong>s textes : travail collectif (suite)<br />
Evaluation et clôture <strong>de</strong> la journée<br />
17.00-17.15 Pause <strong>de</strong> départ<br />
Vendredi 06 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.00-09.30 Ouverture <strong>de</strong> la journée<br />
09.30-11.00 Correction <strong>de</strong> textes : travail indivi<strong>du</strong>el<br />
11.00-11.15 Pause santé<br />
11.15-12.00 Correction <strong>de</strong>s textes<br />
12.00-13.00 Correction <strong>de</strong>s textes<br />
13.00-14.30 Pause repas<br />
14.30- 18.00 Stratégie <strong>de</strong> diffusion et <strong>de</strong> communication<br />
Plan <strong>de</strong> plaidoyer<br />
Evaluation et clôture officielle<br />
Samedi 07 mai 2011<br />
Horaires Activités<br />
09.00-13.00 Revue <strong>de</strong>s textes (rédacteurs et consultants)
ANNEXE 2 : FICHES DE DESCRIPTION REMPLIES<br />
CHAMP CONTENU<br />
1. TITRE DE<br />
L’EXPERIENCE<br />
Fiche <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription - Boutique <strong>de</strong>s MER<br />
La boutique <strong>de</strong>s MER : une initiative à améliorer pour permettre aux<br />
micros entreprises rurales <strong>de</strong> mieux commercialiser leurs pro<strong>du</strong>its et<br />
accroître leur visibilité.<br />
2. MESSAGE CENTRAL La boutique <strong>de</strong>s MER ? un pôle <strong>de</strong> groupage, <strong>de</strong> distribution massive et<br />
une voie toute tracée vers la labellisation et la pérennisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its<br />
<strong>de</strong>s MER.<br />
3. PAYS SENEGAL<br />
4. PROJET Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural - Phase II (<strong>PROMER</strong> 2) - la<br />
mise en place <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong>s micros entrepreneurs ruraux appuyée par le<br />
<strong>PROMER</strong> II<br />
5. PERSONNE-RESSOURCE<br />
ET FONCTION<br />
Mme Ndiaye née Hawa Sow Bousso, Responsable Centre d’information, <strong>de</strong><br />
documentation et <strong>de</strong> démonstration (CIDD), Point focal Gestion <strong>de</strong>s<br />
Savoirs,<br />
Hyacinthe Modou MBENGUE, coordonnateur <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II<br />
6. E-MAIL hawasowbousso@yahoo.fr; hawasow.bousso@promer-sn.org;<br />
mbenguehyacinthe@yahoo.fr; promer.dp@promer-sn.org<br />
7. DATE DE DEBUT ET<br />
DATE DE FIN DE<br />
L’ACTIVITE<br />
8. LOCALISATION<br />
Région, province, district,<br />
communauté où l'activité<br />
spécifique a eu lieu<br />
9. NATURE DE<br />
L’INITIATIVE<br />
- Services financiers<br />
- Services non financiers<br />
- Accès aux marchés<br />
- Accès aux technologies<br />
- Autre à préciser<br />
10. CONTEXTE<br />
Décrire les principaux facteurs <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong> l'activité. Ils<br />
peuvent être économiques,<br />
politiques, sociaux et<br />
environnementaux (par exemple<br />
les tendances migratoires, la<br />
sécheresse, etc.)<br />
Février 2004 – Juillet 2005<br />
L’expérience s’est déroulée dans les régions <strong>de</strong> Tambacounda et Kaolack<br />
L’activité a reçu les appuis techniques et financiers <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> à travers<br />
le Fonds d’appui technologique, la convention d’appui commercial,<br />
l’intermédiation financière <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> avec les SFD pour faciliter l’accès<br />
au crédit avec CMS, ACEP, UMEC.<br />
En outre, <strong>de</strong>s partenariats ont été noués avec <strong>de</strong>s services techniques <strong>de</strong><br />
l’Etat et <strong>de</strong>s structures intervenant dans la promotion <strong>de</strong> l’entreprenariat<br />
rural pour booster le développement <strong>de</strong>s activités non agricoles. On peut<br />
citer par exemple : le Lycée Technique <strong>de</strong> Kédougou, l’institut <strong>de</strong><br />
technologie alimentaire, l’institut sénégalais <strong>de</strong> normalisation, la<br />
participation aux foires, l’organisation <strong>de</strong> journées <strong>de</strong> lancement <strong>de</strong><br />
nouveaux pro<strong>du</strong>its, les visites <strong>de</strong> prospection <strong>de</strong> nouveaux marchés ; les<br />
visites d’échanges à l’intérieur <strong>du</strong> Sénégal et les voyages d’étu<strong>de</strong>s dans la<br />
sous-région ont également permis aux micro-entrepreneurs d’échanger sur<br />
les techniques <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction ou sur les stratégies commerciales <strong>de</strong><br />
promotion et/ou <strong>de</strong> vente. Ces visites et voyages d’étu<strong>de</strong>s se sont avérés être<br />
<strong>de</strong> puissants vecteurs <strong>de</strong> transfert et d’adoption <strong>de</strong> technologies surtout pour<br />
la cible non-scolarisée.<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> sa première phase (1997-2005), le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s<br />
Micros Entreprises Rurales (<strong>PROMER</strong> I) avait mis en place <strong>de</strong>s<br />
infrastructures commerciales (une à Tambacounda et une à Kaolack).<br />
L’idée d’ouvrir un espace <strong>de</strong> vente pour les MER est née <strong>de</strong> la constatation<br />
<strong>de</strong>s difficultés énormes auxquelles les Micro Entreprises Rurales (MER)<br />
appuyées par le projet rencontrent dans la commercialisation <strong>de</strong> leurs<br />
pro<strong>du</strong>its. Ces difficultés sont l’étroitesse <strong>de</strong>s marchés ruraux ; la <strong>de</strong>man<strong>de</strong><br />
rurale peu valorisante, l’accès aux marchés <strong>de</strong> valeur ; l’inexistence <strong>de</strong><br />
vitrine commerciale en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s manifestations commerciales ponctuelles<br />
(FIARA, FIDAK, Techno - foire, Foires régionales, …) ; l’absence <strong>de</strong><br />
politique <strong>de</strong> fidélisation <strong>de</strong>s clients et <strong>de</strong> présence permanente et<br />
significative sur les marchés.<br />
11. PROBLEME / QUESTION Le projet a été initié pour permettre aux MER <strong>de</strong> disposer d’une<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
15
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
16<br />
Quels problèmes l’activité ou<br />
l'intervention adressent-ils?<br />
Pourquoi le projet a été initié dans<br />
ce domaine?<br />
12. OBJECTIFS<br />
Quel était le but <strong>du</strong> travail<br />
effectué? Tout en considérant<br />
une activité spécifique, il est<br />
également utile <strong>de</strong> déterminer<br />
comment ces objectifs sont<br />
liés aux objectifs généraux <strong>du</strong><br />
projet?<br />
13. BÉNÉFICIAIRES<br />
• Brève <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la<br />
population cible<br />
• La couverture <strong>de</strong> l'activité en<br />
termes <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong><br />
personnes atteintes<br />
14. INTERVENANTS<br />
/PARTENAIRES<br />
• Tous les acteurs impliqués, y<br />
compris le groupe cible <strong>de</strong><br />
l’activité, autorités locales,<br />
gouvernement ou autres<br />
institutions, membres <strong>de</strong><br />
l'équipe <strong>du</strong> projet.<br />
infrastructure et d’un espace d’écoulement <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its à <strong>de</strong>s prix<br />
compétitifs, rapprocher l’offre rurale <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine, lutter contre la<br />
pauvreté rurale par la valorisation et l’amélioration <strong>de</strong> la qualité et <strong>de</strong> la<br />
présentation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its ruraux<br />
Le Projet a pour ambition d’accroître les revenus <strong>de</strong>s ménages, <strong>de</strong> fixer les<br />
jeunes et les femmes, ré<strong>du</strong>ire l’exo<strong>de</strong> et la pauvreté rurale, répondre à la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> croissante <strong>de</strong>s urbains par la transformation et valorisation <strong>de</strong>s<br />
pro<strong>du</strong>its agro forestiers et artisanaux ruraux.<br />
Face à la problématique <strong>du</strong> chômage <strong>de</strong>s jeunes et <strong>de</strong>s femmes, il constitue<br />
une Stratégie d’implication <strong>de</strong> ces cibles prioritaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> dans la<br />
promotion <strong>de</strong> l’entreprenariat rural.<br />
Les objectifs visés à travers cette activité sont <strong>de</strong> :<br />
- Montrer les opportunités offertes en termes <strong>de</strong> métiers ruraux en<br />
amont et en aval <strong>de</strong> l’agriculture notamment dans les filières<br />
porteuses agro alimentaires et artisanales à travers ???<br />
- Améliorer <strong>de</strong> façon significative la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> biens et<br />
services <strong>de</strong> qualité nécessaires au développement économique <strong>de</strong>s<br />
zones rurales, à travers notamment la valorisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>ctions<br />
agricoles et <strong>de</strong> cueillette<br />
- Allonger la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> travail pro<strong>du</strong>ctif annuel au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s<br />
pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travaux agricoles ;<br />
- Atténuer l’exo<strong>de</strong> rural grâce à <strong>de</strong>s opportunités <strong>de</strong> travail offertes<br />
aux jeunes et aux femmes dans leurs villages<br />
- Améliorer les revenus <strong>de</strong>s familles rurales pauvres par la création<br />
<strong>de</strong> nouveaux emplois saisonniers ou permanents rémunérateurs et<br />
<strong>du</strong>rables ;<br />
- Ré<strong>du</strong>ire le chômage <strong>de</strong>s jeunes ;<br />
- Augmenter les emplois créés et consolidés ;<br />
- Ré<strong>du</strong>ire la pauvreté rurale<br />
Micro entrepreneurs, Bénéficiaires finaux urbains <strong>de</strong> Tambacounda et<br />
Kaolack<br />
Les intervenants impliqués dans l’activité sont les suivants :<br />
- les autorités locales et administratives pour l’information, la<br />
sensibilisation, l’appui conseil ; et le soutien à l’initiative<br />
- les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) : pour faciliter<br />
l’accès au financement) ;<br />
- les services techniques <strong>de</strong> l’Etat pour assurer le suivi et<br />
l’encadrement ;<br />
- les conseillers en entreprise et prestataires <strong>de</strong> services pour le<br />
renforcement <strong>de</strong> capacités, le suivi et accompagnement ;<br />
- les organisations professionnelles : pour la défense <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong><br />
la filière, l’accès au crédit et la pérennité <strong>de</strong> l’activité ;<br />
- le <strong>PROMER</strong>2 (le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural,<br />
Phase 2) pour faciliter l’accès aux services non financiers et<br />
financiers, l’appui à l’organisation<br />
- Les MER (46 à Kaolack dont 14 groupements et 32 indivi<strong>du</strong>els, 40<br />
à Tambacounda). Indivi<strong>du</strong>els et collectifs :<br />
- Les commerciaux (ven<strong>de</strong>urs et gérants) recrutés et rémunérés par<br />
le <strong>PROMER</strong> : gestion, vente<br />
- Comité d’agrément : contrôle <strong>de</strong> qualité AG, Bureau : contrôle <strong>de</strong><br />
la gestion, bilan technique et financier<br />
- Institut <strong>de</strong> Technologie Alimentaire : renforcement <strong>de</strong> capacités et<br />
contrôle <strong>de</strong> qualité<br />
- Consommateurs : achat <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et appréciations<br />
- Institut Sénégalais <strong>de</strong> Normalisation : attribution <strong>de</strong>s autorisations<br />
FRA
15. STRATÉGIE / APPROCHE<br />
• Comment l'activité est-elle<br />
mise en œuvre? S'il vous plaît<br />
résumer les principales<br />
caractéristiques <strong>de</strong> l'activité.<br />
• Quelles sont les actions<br />
qu’implique l’expérience? Il<br />
s'agit <strong>de</strong> l'orientation<br />
spécifique ou une stratégie<br />
suivie par l'activité, comme,<br />
par exemple, une sensibilité à<br />
l'approche <strong>de</strong> genre, ou<br />
chaînes <strong>de</strong> valeur.<br />
16. RESULTATS / IMPACTS<br />
• Les résultats quantitatifs et<br />
qualitatifs par rapport aux<br />
objectifs.<br />
• Comment les activités<br />
contribuent à ré<strong>du</strong>ire la<br />
pauvreté et la vulnérabilité ?<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong> l’activité suit les étapes suivantes :<br />
- Information/sensibilisation <strong>de</strong>s cibles potentielles,<br />
- La réalisation <strong>de</strong>s émissions radiophoniques en langues locales,<br />
- La sélection <strong>de</strong>s MER et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>vant être présents dans<br />
les boutiques<br />
- L’i<strong>de</strong>ntification, l’accompagnement et l’émergence <strong>de</strong>s MER <strong>de</strong><br />
références<br />
- L’I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s bénéficiaires ;<br />
- L’organisation <strong>de</strong>s MER en GIE, la mise en place d’outils et<br />
d’organes <strong>de</strong> gestion<br />
- La mise en place d’outils méthodologiques et opérationnels très<br />
important tel que le Fonds d’appui technologique et la convention<br />
d’appui commercial. Le Fonds d’appui technologique (FAT) est<br />
<strong>de</strong>stiné à l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> nouvelles technologies <strong>de</strong>vant<br />
permettre l’amélioration <strong>de</strong>s procédés et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its dans les<br />
filières structurantes.<br />
- Et la Convention d’appui commerciale sert à appuyer les stratégies<br />
<strong>de</strong> commercialisation retenues pour les MER …. ???<br />
- L’achat d’emballage pour améliorer la présentation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its<br />
Les micro-entreprises rurales <strong>de</strong> référence utilisent <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction et <strong>de</strong> gestion relativement avancés et doivent servir <strong>de</strong> lieu <strong>de</strong><br />
démonstration et <strong>de</strong> formation pour les autres MER évoluant dans le<br />
même domaine. Ces MER <strong>de</strong> référence bénéficient <strong>de</strong> la convention<br />
d’appui commercial et <strong>du</strong> fonds d’appui technologique.<br />
Le Centre d’Information, <strong>de</strong> Documentation et <strong>de</strong> Démonstration<br />
(CIDD) est appelé à offrir <strong>de</strong>s services aux micro-entrepreneurs et aux<br />
autres acteurs au développement, mais aussi et surtout à servir <strong>de</strong> pôle<br />
<strong>de</strong> démonstration, d’exposition et <strong>de</strong> vulgarisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et<br />
technologies utilisés par les MER, ceci à travers le hall technologique.<br />
Il vise à pallier l’insuffisance d’informations techniques, économiques et<br />
commerciales <strong>de</strong>s bénéficiaires et <strong>de</strong>s agents <strong>du</strong> projet. Des axes <strong>de</strong><br />
partenariat et <strong>de</strong> collaboration avec d’autres centres <strong>de</strong> documentation<br />
sont définis et mis en œuvre. Un site Web dynamique permet <strong>de</strong><br />
visualiser les pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s MER, les lieux <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, les quantités<br />
pro<strong>du</strong>ites ainsi que les prix. Ceci contribuera à assurer une meilleure<br />
visibilité aux MER et à leurs pro<strong>du</strong>its.<br />
- Le recrutement <strong>de</strong> gérants et ven<strong>de</strong>urs,<br />
- L’i<strong>de</strong>ntification et l’aménagement <strong>de</strong> locaux <strong>de</strong>vant abriter les<br />
boutiques<br />
- L’information, sensibilisation, les journées <strong>de</strong> lancement et<br />
d’inauguration <strong>de</strong>s boutiques, les campagnes <strong>de</strong> prospection <strong>de</strong><br />
nouveaux marchés, la participation à <strong>de</strong>s activités commerciales<br />
(FIARA, forums et foires);<br />
- Etablissement d’une situation <strong>de</strong> référence et un plan d’action (à<br />
travers un diagnostic sur le terrain) par les prestataires ;<br />
- Formations techniques et en gestion ;<br />
- La tenue <strong>de</strong> rencontre régulière pour évaluer l’état d’avancement<br />
<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>s boutiques ;<br />
- Mise en relation avec les structures <strong>de</strong> financement et les<br />
organisations professionnelles ;<br />
- Le Suivi et accompagnement.<br />
Les chiffres d’affaires <strong>de</strong>s MER ont augmenté ; en effet, les chiffres<br />
d’affaires faits par la boutique <strong>de</strong> Tambacounda d’avril 2004 à avril 2005<br />
connaissent une fluctuation très importante avec une moyenne mensuelle <strong>de</strong><br />
441.560 F, un maximum <strong>de</strong> 973.800 F et un minimum <strong>de</strong> 106.625 F.<br />
Les revenus <strong>de</strong>s MER ont été multipliés par 2 à 3 fois<br />
L’expérience a contribué à assurer une meilleure visibilité <strong>du</strong> projet<br />
Elle a permis à renforcer d’améliorer la capacité, la présentation et la<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
17
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
18<br />
• Quelle est l’opinion <strong>de</strong>s<br />
bénéficiaires sur l’activité ?<br />
17. COÛTS ET RESSOURCES<br />
UTILISÉES<br />
• Précisez le budget total.<br />
Quelle ressource a été<br />
cruciale?<br />
• Budget<br />
• Expertise externe<br />
18. DIFFICULTES<br />
RENCONTREES<br />
Quels ont été les défis majeurs <strong>de</strong><br />
cette activité et comment ont-ils<br />
été surmontés?<br />
19. FACTEURS DE SUCCES<br />
DE L’INITIATIVE<br />
qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s MER<br />
Création et consolidation d’emplois<br />
12 399 544 par boutique : investissements, emballages, étiquettes et <strong>de</strong><br />
charges <strong>de</strong> fonctionnement<br />
Participation <strong>de</strong>s bénéficiaires : 10 000 par membre pour l’adhésion<br />
Coûts <strong>de</strong> transport <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its pris en charge par <strong>PROMER</strong><br />
Salaires <strong>du</strong> personnel : <strong>de</strong>ux personnes par boutique (75 000 FCFA /gérant<br />
et 50 000 /ven<strong>de</strong>ur) :<br />
Temps <strong>de</strong> travail <strong>de</strong> l’équipe <strong>PROMER</strong><br />
Les difficultés majeures rencontrées par l’activité sont liées aux aspects<br />
suivants :<br />
- Approvisionnement insuffisant et irrégulier en pro<strong>du</strong>its lié à<br />
l’éloignement <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction<br />
- Faiblesse <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> roulement <strong>de</strong>s MER, au taux <strong>de</strong> rotation <strong>du</strong><br />
stock<br />
- Eloignement <strong>de</strong>s MER<br />
- Chute <strong>du</strong> CA : Le CA minimum 106.625 F a été obtenu en avril<br />
2005 mois <strong>du</strong>rant lequel à la rupture <strong>de</strong>s stocks <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its<br />
secondaires s’est ajoutée celle <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its phares ou d’appel.<br />
- La faiblesse <strong>de</strong> la marge commerciale comparée aux activités<br />
similaires ;<br />
- Coûts élevés <strong>de</strong>s charges fixes et variables ;<br />
- Positionnement <strong>de</strong> la boutique dans la catégorie détail avec ses<br />
conséquences : lour<strong>de</strong>ur dans le suivi, faible marge, chiffres<br />
d’affaires faibles, etc.<br />
- Fonctionnement insatisfaisant <strong>de</strong>s organes ;<br />
- L’absence d’appropriation <strong>de</strong> la boutique par les membres<br />
- Le <strong>PROMER</strong> s’est substitué aux MER<br />
- Analyse contextuelle insuffisante<br />
- La mise en place tardive <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> pérennisation tel que le<br />
fonds d’appui technique et la convention d’appui commerciale<br />
- Les difficultés <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> la convention d’appui<br />
commerciale<br />
• La mise en place <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux boutiques a contribué à mieux valoriser<br />
les potentialités naturelles <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> rural, rapprocher l’offre rurale<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine Elle a également permis d’appuyer les<br />
MER dans la conquête et la fidélisation d’une clientèle <strong>de</strong> valeur,<br />
ainsi qu’une meilleure valorisation <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its sur les<br />
marchés ;<br />
• De faciliter la pénétration commerciale par la prise en<br />
charge commune <strong>de</strong> la promotion ;<br />
• D’assurer une plus gran<strong>de</strong> maîtrise <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> valeur mais<br />
exigeants ??? (distribution mo<strong>de</strong>rne organisée, marchés <strong>de</strong><br />
collectivités, hôtellerie et tourisme, certains marchés<br />
contractuels).<br />
• Gérer la marque commerciale commune qui correspond à<br />
l’enseigne <strong>de</strong> la boutique ;<br />
• Servir <strong>de</strong> vitrine commerciale, d’espace <strong>de</strong> promotion, <strong>de</strong><br />
valorisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s MER et <strong>de</strong> négociation <strong>de</strong> contrats<br />
commerciaux ;<br />
• Contribuer à la pérennisation <strong>de</strong>s MER en leur favorisant l’accès<br />
aux marchés urbains <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> consommation et aux circuits <strong>de</strong><br />
distribution commerciale ;<br />
Les boutiques se sont dotés d’organes et d’outils liés aux aspects<br />
organisationnels et <strong>de</strong> gestion notamment l’Assemblée générale ; le
20. MESSAGE CLE / LEÇONS<br />
• Quel est (sont) la leçon clé (s)<br />
tirée(s) <strong>de</strong> cette pratique?<br />
• Qu'est-ce qui rend l’activité à<br />
être considérée comme une<br />
bonne pratique /<br />
potentiellement une bonne<br />
pratique?<br />
• Que feriez-vous<br />
différemment?<br />
21. NOTES<br />
COMPLÉMENTAIRES<br />
Mentionner toute information que<br />
vous jugerez pertinente qui n'est<br />
pas couverte dans l'un <strong>de</strong>s champs<br />
ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
22. DOCUMENTS<br />
Noter tous les documents qui<br />
prouvent votre approche ou <strong>de</strong>s<br />
échantillons <strong>de</strong> matériaux utilisés<br />
dans votre application que vous<br />
êtes disposés à partager avec<br />
d'autres projets?<br />
comité <strong>de</strong> gestion, le comité d’agrément, l’élaboration d’un manuel<br />
<strong>de</strong> procé<strong>du</strong>res (fiches <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> stocks, livres journal <strong>de</strong> vente,<br />
fiche <strong>de</strong> compte <strong>de</strong> MER, le tableau récapitulatif <strong>de</strong>s vente <strong>de</strong> la<br />
semaine, la fiche <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la caisse d’avance, le livret CMS)<br />
Le contrôle <strong>de</strong> gestion est assuré par les différents responsables <strong>du</strong><br />
projet (régional, commercial). Quant au contrôle <strong>de</strong> qualité, il est<br />
surtout effectué par le responsable technique.<br />
Sur le plan technique et commercial, le <strong>de</strong>sign <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> a permis<br />
l’internalisation <strong>de</strong> ressources humaines qualifiées et expérimentées qui ont<br />
pu mettre en œuvre un ensemble <strong>de</strong> stratégies techniques et commerciales<br />
ayant permis aux MER d’améliorer la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et <strong>de</strong>s biens et<br />
d’accé<strong>de</strong>r dans certains cas à <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> valeur.<br />
Le Fonds d’Appui Technologique (FAT) et la Convention d’Appui<br />
commerciale (CAC) ont été d’un grand apport dans la mise en œuvre <strong>de</strong>s<br />
plans <strong>de</strong> développement surtout pour les MER <strong>de</strong> référence et les boutiques<br />
<strong>de</strong>s MER.<br />
En vue d’une réplicabilité <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong>s MER et <strong>de</strong> leur réussite le<br />
<strong>PROMER</strong> et/ou les projets <strong>de</strong> développement gagneraient à revoir certains<br />
aspects :<br />
• Assurer une meilleure implication (responsabilisation, participation<br />
effective) <strong>de</strong>s MER dans les choix commerciaux <strong>de</strong> leurs<br />
entreprises et les actions y afférentes ;<br />
• Mener <strong>de</strong>s efforts considérables au niveau <strong>de</strong> la compression <strong>de</strong>s<br />
charges fixes ;<br />
• Augmenter les recettes mensuelles par la mise en œuvre <strong>du</strong> plan <strong>de</strong><br />
communication externe et <strong>de</strong> la prospection <strong>de</strong> nouveaux marchés ;<br />
• Finaliser le dossier <strong>de</strong>s autorisations FRA ;<br />
• Assouplir les procé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> mobilisation <strong>de</strong> la CAC<br />
• Alléger les lour<strong>de</strong>urs dans la gestion communautaire <strong>de</strong>s boutiques<br />
• <strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> pré évaluation <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I<br />
• <strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> l’évaluation <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I<br />
• <strong>Rapport</strong> d’Achèvement final <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I<br />
• <strong>Rapport</strong> d’Achèvement <strong>du</strong> Responsable Commercial <strong>de</strong> Kaolack<br />
• <strong>Rapport</strong> d’achèvement <strong>du</strong> Responsable Commercial <strong>de</strong><br />
Tambacounda<br />
• <strong>Rapport</strong> Annuel 2004 <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong> Kaolack<br />
• <strong>Rapport</strong> annuel 2004 <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong> Tambacounda<br />
• Vidéo sur le lancement <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong> Kaolack<br />
• Stratégie <strong>de</strong> commercialisation et <strong>de</strong> pérennisation <strong>de</strong>s MER<br />
• Banque d’images <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
19
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
20<br />
Fiche <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription - Partage <strong>de</strong>s risques/caution<br />
CHAMP CONTENU<br />
23. TITRE DE<br />
L’EXPERIENCE<br />
24. PAYS SENEGAL<br />
Le Groupe <strong>de</strong> caution (Partage <strong>de</strong>s risques) : un outil <strong>de</strong> facilitation <strong>de</strong><br />
l’accès au crédit<br />
25. PROJET Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural – Phase II (<strong>PROMER</strong> 2)<br />
26. PERSONNE-<br />
RESSOURCE ET<br />
FONCTION<br />
27. E-MAIL ameth_hady@hotmail.com,<br />
28. DATE DE DEBUT ET<br />
DATE DE FIN DE<br />
L’ACTIVITE<br />
29. LOCALISATION<br />
Région, province, district,<br />
communauté où l'activité<br />
spécifique a eu lieu<br />
30. NATURE DE<br />
L’INITIATIVE<br />
- Services financiers<br />
- Services non financiers<br />
- Accès aux marchés<br />
- Accès aux technologies<br />
- Autre à préciser<br />
31. CONTEXTE<br />
Décrire les principaux facteurs<br />
<strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l'activité.<br />
Ils peuvent être économiques,<br />
politiques, sociaux et<br />
environnementaux (par exemple<br />
les tendances migratoires, la<br />
sécheresse, etc.)<br />
Ameth Hady SEYDI : Responsable National <strong>du</strong> Service d’Appui à la Finance<br />
Rurale, 33.939.81.34, 77.583.35.48,<br />
Mois <strong>de</strong> Mars 2010 (Convention Boulangers/ UIMCEC)<br />
Mois <strong>de</strong> Novembre 2010 (Convention FFTAT/ URMECS)<br />
Durée <strong>de</strong>s conventions : Trois (03) ans<br />
Convention Union Départementale <strong>de</strong>s Femmes transformatrices <strong>de</strong> céréales<br />
locales/ Caurie Microfinance<br />
Union <strong>de</strong>s femmes transformatrices <strong>de</strong> néré <strong>de</strong> Kabendou dans la région <strong>de</strong><br />
Kolda/Caurie Microfinance<br />
Région <strong>de</strong> Tambacounda (Sénégal)<br />
Région <strong>de</strong> Thiès Communauté Rurale <strong>de</strong> Thiénaba (Sénégal)<br />
(Convention Boulangers/ UIMCEC)<br />
(Convention FFTAT/ URMECS)<br />
Durée <strong>de</strong>s conventions : Trois (03) ans<br />
GIE MAREWE <strong>de</strong> Kabendou dans la région <strong>de</strong> Kolda 4, 5 millions<br />
Le financement <strong>de</strong> l’investissement et la prise en charge <strong>de</strong>s besoins en fonds<br />
<strong>de</strong> roulement <strong>de</strong>s micros entrepreneurs sont au cœur <strong>de</strong>s préoccupations <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong> II. Ces micros entrepreneurs qui sont pour la plupart faibles sur le<br />
plan institutionnel et financier, accè<strong>de</strong>nt difficilement aux services proposés<br />
sur le marché financier.<br />
Les Institutions financières susceptibles <strong>de</strong> leur fournir ces services financiers<br />
s’appuient principalement sur trois (03) critères :<br />
La solvabilité qui implique une analyse <strong>de</strong> leur situation<br />
financière caractérisée par<br />
une absence quasi-totale <strong>de</strong> fonds propres;<br />
La capacité d’autofinancement qui suppose une rentabilité <strong>de</strong><br />
leurs activités;<br />
La notion <strong>de</strong> garantie exclusivement basée sur <strong>de</strong>s<br />
considérations conventionnelles,<br />
Par exemple, le nantissement et gage <strong>de</strong>s biens meubles,<br />
hypothèque <strong>de</strong>s immeubles<br />
Etc.<br />
Autant <strong>de</strong> critères qui constituent <strong>de</strong>s facteurs limitant lors <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s<br />
requêtes <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s MPER et qui excluent les micros entrepreneurs
32. PROBLEME /<br />
QUESTION<br />
Quels problèmes l’activité ou<br />
l'intervention adressent-ils?<br />
Pourquoi le projet a été initié<br />
dans ce domaine?<br />
33. OBJECTIFS<br />
Quel était le but <strong>du</strong> travail<br />
effectué? Tout en<br />
considérant une activité<br />
spécifique, il est également<br />
utile <strong>de</strong> déterminer comment<br />
ces objectifs sont liés aux<br />
objectifs généraux <strong>du</strong><br />
projet?<br />
34. BÉNÉFICIAIRES<br />
• Brève <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la<br />
population cible<br />
• La couverture <strong>de</strong> l'activité<br />
en termes <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong><br />
personnes atteintes<br />
35. INTERVENANTS<br />
/PARTENAIRES<br />
• Tous les acteurs impliqués,<br />
ruraux <strong>du</strong> marché financier Traditionnel.<br />
C’est dans ce cadre qu’un partenariat MPER /SFD a été établi avec la<br />
signature d’une convention.<br />
Ce partenariat s’appuie sur la constitution d’un groupe homogène<br />
d’entrepreneurs, partageant les mêmes préoccupations qui noue un partenariat<br />
avec une structure financière, en l’occurrence un Système Financier<br />
Décentralisé (<strong>de</strong> préférence partenaire <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II).<br />
Ce partenariat qui définit très tôt ses objectifs, doit être matérialisé par une<br />
convention signée par les <strong>de</strong>ux parties.<br />
Le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> ce partenariat reste la confiance mutuelle qui est instaurée<br />
selon les dispositions prévues dans la convention. Cette confiance qui se<br />
substitue à la garantie .<br />
Le manque <strong>de</strong> biens réels à offrir comme garantie, les coûts <strong>de</strong> transaction et<br />
les risques très élevés ont toujours été les facteurs principaux qui expliquent<br />
l'exclusion <strong>de</strong>s pauvres <strong>du</strong> marché financier. Les intermédiaires financiers ont<br />
toujours trouvé l'offre <strong>de</strong> services aux démunis incompatible avec leur<br />
exigence <strong>de</strong> viabilité financière.<br />
Se basant sur le principe <strong>de</strong> la solidarité et <strong>de</strong> l'ai<strong>de</strong> réciproque entre ceux qui<br />
l'utilisent, le cautionnement solidaire est un mécanisme qui rapproche les<br />
institutions financières <strong>de</strong> leurs clients. Il (le cautionnement solidaire) ré<strong>du</strong>it<br />
les coûts <strong>de</strong> transaction et le risque que la fourniture <strong>de</strong> services financiers<br />
implique pour les institutions financières.<br />
Les caractéristiques principales <strong>du</strong> cautionnement solidaire sont:<br />
L'existence d'un groupe homogène et organisé,<br />
La connaissance personnelle réciproque <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong> groupe,<br />
La reconnaissance réciproque <strong>du</strong> professionnalisme <strong>de</strong>s membres <strong>du</strong><br />
groupe,<br />
La responsabilité réciproque pour la <strong>de</strong>tte <strong>de</strong> chaque membre <strong>du</strong><br />
groupe,<br />
L'obligation morale et la pression sociale exercée par les membres <strong>du</strong><br />
groupe vis-à-vis <strong>de</strong> tout membre bénéficiant d'un prêt.<br />
Le Fonds <strong>de</strong> garantie ; couverture et partage <strong>du</strong> risque<br />
L’activité a été initiée pour permettre aux couches <strong>de</strong>s populations démunies<br />
d'avoir accès aux services financiers.<br />
Le <strong>PROMER</strong>2 par le biais <strong>de</strong> sa composante Service d’Appui à la Finance<br />
Rurale (SAFIR) dont l’objectif est <strong>de</strong> permettre un accès <strong>du</strong>rable à <strong>de</strong>s<br />
services financiers adaptés pour les MPER, a opté pour une démarche qui<br />
s’inscrit dans la pérennité. Il s’agit <strong>de</strong> travailler à la réalisation <strong>de</strong>s relations<br />
<strong>du</strong>rables (qui survivraient au projet) entre les MPER et les SFD. Des relations<br />
déterminées par un partenariat « gagnant-gagnant » dans lequel toutes les<br />
<strong>de</strong>ux parties trouvent leur compte.<br />
Femmes et <strong>de</strong>s jeunes hommes et femmes évoluant dans <strong>de</strong> organisations<br />
professionnelles <strong>de</strong>s régions <strong>de</strong> Tambacounda (OP <strong>de</strong>s boulangers <strong>de</strong><br />
Tambacounda) et organisation <strong>de</strong>s femmes transformatrices <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> cajou<br />
<strong>de</strong> Thiénaba dans la région <strong>de</strong> Thiès (Sénégal)<br />
Les différents Acteurs <strong>de</strong> la pratique et principes <strong>de</strong> base.<br />
• Acteur A : Le Projet qui met en place une ligne <strong>de</strong> crédit et un fonds<br />
<strong>de</strong> garantie <strong>de</strong>stiné à couvrir une partie <strong>de</strong>s créances abandonnées<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
21
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
22<br />
y compris le groupe cible <strong>de</strong><br />
l’activité, autorités locales,<br />
gouvernement ou autres<br />
institutions, membres <strong>de</strong><br />
l'équipe <strong>du</strong> projet.<br />
36. STRATÉGIE /<br />
APPROCHE<br />
• Comment l'activité est-elle<br />
mise en œuvre? S'il vous<br />
plaît résumer les principales<br />
caractéristiques <strong>de</strong> l'activité.<br />
• Quelles sont les actions<br />
qu’implique l’expérience?<br />
Il s'agit <strong>de</strong> l'orientation<br />
spécifique ou une stratégie<br />
suivie par l'activité, comme,<br />
par exemple, une sensibilité<br />
à l'approche <strong>de</strong> genre, ou<br />
chaînes <strong>de</strong> valeur.<br />
37. RESULTATS / IMPACTS<br />
• Les résultats quantitatifs et<br />
qualitatifs par rapport aux<br />
objectifs.<br />
• Comment les activités<br />
contribuent à ré<strong>du</strong>ire la<br />
pauvreté et la vulnérabilité ?<br />
• Quelle est l’opinion <strong>de</strong>s<br />
bénéficiaires sur l’activité ?<br />
(plus <strong>de</strong> 12 mois <strong>de</strong> retard),<br />
• Acteur B : Un Système Financier Décentralisé partenaire <strong>du</strong> projet<br />
avec bonifications <strong>de</strong>s taux appliqués sur les prêts et dérogations sur<br />
les conditions d’accès;<br />
• Acteur C : Le Groupe avec son fonds <strong>de</strong> garantie (mobilisé par les<br />
membres) <strong>de</strong>stiné à couvrir les crédits en retard <strong>de</strong> 03 à 12 mois.<br />
La pratique <strong>du</strong> Groupe <strong>de</strong> caution a comme principes <strong>de</strong> base :<br />
• L’organisation <strong>de</strong>s membres en entité homogène, partageant les<br />
mêmes préoccupations professionnelles et développant une confiance<br />
mutuelle,<br />
• L’ouverture d’un compte collectif au nom <strong>du</strong> groupe et <strong>de</strong> comptes<br />
indivi<strong>du</strong>els pour chaque membre au niveau <strong>du</strong> SFD,<br />
• La Mobilisation d’un fonds <strong>de</strong> garantie (variable) bloqué dans le<br />
compte collectif constitué par les apports indivi<strong>du</strong>els (en<br />
pourcentage) <strong>de</strong>s membres sur la base <strong>de</strong> leurs besoins financiers,<br />
• La Signature d’un protocole d’accord <strong>de</strong> financement « Groupe /<br />
SFD » qui entre dans le cadre <strong>de</strong> la convention « refinancement »<br />
liant le <strong>PROMER</strong> II avec ledit SFD,<br />
• Cautionnement solidaire entre les membres et participation aux<br />
risques.<br />
III/ Mise en œuvre :<br />
3.1/ Conditions d’accès aux financements <strong>de</strong>s membres.<br />
• Etre bénéficiaire <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II ou <strong>de</strong>s autres projets FIDA, et<br />
adhérer au groupe selon les conditions définies ci-<strong>de</strong>ssus,<br />
• Présenter une requête <strong>de</strong> financement élaborée à partir <strong>de</strong>s besoins<br />
justifiés et inscrits dans un plan d’affaire/ plan <strong>de</strong> développement,<br />
• Etre agréé avec délivrance d’un accréditif délivré par le groupe. Cet<br />
accréditif aura valeur d’une caution solidaire <strong>du</strong> groupe (caution<br />
morale surtout),<br />
• Mobiliser une épargne nantie (montant nanti calculé à partir <strong>du</strong><br />
pourcentage <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong>s prêts en retard) à bloquer dans le<br />
fonds <strong>de</strong> garantie <strong>du</strong> groupe.<br />
3.2/ Mise en place et gestion <strong>du</strong> financement.<br />
Après accord <strong>du</strong> Comité <strong>de</strong> crédit :<br />
• Informer le groupe <strong>du</strong> Procès verbal <strong>du</strong> Comité <strong>de</strong> crédit pour les<br />
besoins <strong>du</strong> suivi (bonne utilisation <strong>du</strong> prêt, non détournement d’objet<br />
etc.),<br />
• Signature <strong>du</strong> contrat indivi<strong>du</strong>el <strong>de</strong> prêt par le bénéficiaire qui<br />
s’acquitte <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong> prêt,<br />
• Virement <strong>du</strong> prêt dans le compte <strong>du</strong> bénéficiaire,<br />
• Mobilisation <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> garantie selon les dispositions prévues dans<br />
le protocole d’accord en cas d’impayés (retard entre 03 et 12 mois)<br />
Quelques résultats : quatre (04) groupes <strong>de</strong> caution mis en place, dans les<br />
régions <strong>de</strong> Tambacounda avec l’OP <strong>de</strong>s boulangers, ruraux, à Thiénaba<br />
(Thiès) avec les femmes transformatrices <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> cajou ; l’union <strong>de</strong>s<br />
femmes transformatrice <strong>de</strong> néré <strong>de</strong> Kabendou et les femmes transformatrices<br />
<strong>de</strong> céréales <strong>de</strong> Vélingara. Garantie d’accès <strong>de</strong> 350 femmes transformatrices<br />
<strong>de</strong>s noix d’anacar<strong>de</strong> et <strong>de</strong> 50 boulangers traditionnels aux financements fonds<br />
roulement pendant au moins (03) trois ans.<br />
La pratique présente <strong>de</strong>s avantages, notamment :<br />
• Participation <strong>de</strong>s différents acteurs au risque encouru dans le<br />
financement <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> caution<br />
• Inscription <strong>de</strong>s relations MPER/ SFD dans la confiance mutuelle et la<br />
<strong>du</strong>rabilité.
38. COÛTS ET<br />
RESSOURCES<br />
UTILISÉES<br />
• Précisez le budget total.<br />
Quelle ressource a été<br />
cruciale?<br />
• Budget<br />
• Expertise externe<br />
39. DIFFICULTES<br />
RENCONTREES<br />
Quels ont été les défis majeurs<br />
<strong>de</strong> cette activité et comment ontils<br />
été surmontés?<br />
40. FACTEURS DE SUCCES<br />
DE L’INITIATIVE<br />
41. MESSAGE CLE /<br />
LEÇONS<br />
• Quel est (sont) la leçon clé<br />
(s) tirée(s) <strong>de</strong> cette pratique?<br />
• Qu'est-ce qui rend l’activité<br />
à être considérée comme une<br />
bonne pratique /<br />
potentiellement une bonne<br />
pratique?<br />
• Que feriez-vous<br />
différemment?<br />
42. NOTES<br />
COMPLÉMENTAIRES<br />
Mentionner toute information<br />
que vous jugerez pertinente qui<br />
n'est pas couverte dans l'un <strong>de</strong>s<br />
champs ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
43. DOCUMENTS<br />
Noter tous les documents qui<br />
prouvent votre approche ou <strong>de</strong>s<br />
échantillons <strong>de</strong> matériaux<br />
utilisés dans votre application<br />
que vous êtes disposés à<br />
partager avec d'autres projets?<br />
• Existence d’un premier niveau <strong>de</strong> contrôle. Ce qui épargne au SFD<br />
une partie <strong>du</strong> travail liée à l’instruction <strong>du</strong> dossier.<br />
La sensibilisation <strong>de</strong>s membres sur la pratique a été la première difficulté<br />
rencontrée. Le point d’apprentissage difficile à assimiler a été la<br />
responsabilisation indivi<strong>du</strong>elle. La problématique relative à l’agrément <strong>du</strong><br />
dossier <strong>de</strong> financement s’est posée. En effet, le bureau doit faire montre<br />
d’impartialité et <strong>de</strong> certaines capacités à évaluer la pertinence <strong>de</strong> la requête.<br />
Enfin, le problème <strong>de</strong> la gestion <strong>du</strong> partenariat par le groupe s’est posé.<br />
Deux innovations<br />
• Participation <strong>de</strong>s différents acteurs au risque. C'est-à-dire ; le<br />
<strong>PROMER</strong> II, le SFD et les membres <strong>du</strong> Groupe qui sont<br />
indivi<strong>du</strong>ellement responsables et participent à la constitution <strong>de</strong> la<br />
garantie.<br />
• Agrément par le groupe <strong>du</strong> dossier <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> crédit<br />
Les enseignements tirés ; (i) la qualité <strong>du</strong> portefeuille (taux <strong>de</strong><br />
remboursement 100%), (ii) Le sentiment d’appartenance, la responsabilisation<br />
indivi<strong>du</strong>elle <strong>de</strong>s bénéficiaires et (iii) la confiance entre les Systèmes<br />
Financiers Décentralisés et les Groupes signataires.<br />
Piste d’amélioration : Participation <strong>de</strong>s collectivités locales à la prise <strong>de</strong><br />
risque en mobilisant un fonds <strong>de</strong> garantie.<br />
La réussite et la repro<strong>du</strong>ctibilité <strong>de</strong> la pratique reposent sur la sensibilisation<br />
<strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s groupes et le renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s différents<br />
acteurs dans la gestion <strong>du</strong> partenariat (gestion <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> garantie et suivi <strong>de</strong>s<br />
financements).<br />
Cette pratique sera éten<strong>du</strong>e dans la zone d’intervention <strong>de</strong>s projets FIDA<br />
(PAFA). Les Organisations Professionnelles sont visées en priorité. A terme,<br />
les différents groupes bien constitués <strong>de</strong>vraient évoluer vers <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong><br />
cautionnement animées par les cadres <strong>de</strong> concertation inter filières.<br />
• Service d’Appui à la Finance Rurale <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II « SAFIR »,<br />
• Association <strong>de</strong>s Boulangers Traditionnels <strong>de</strong> la Région <strong>de</strong><br />
Tambacounda Prési<strong>de</strong>nt: Boubacar KEITA n° tel : 773241143.<br />
• La Fédération <strong>de</strong>s Femmes Transformatrices <strong>de</strong> l’Anacar<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Thiénaba Prési<strong>de</strong>nte Louty SOW Thiénaba : tel : 774075235,<br />
• Union <strong>de</strong>s Institutions Mutualistes Communautaires d’Epargne et <strong>de</strong><br />
Crédit « UIMCEC »<br />
Union Rurale <strong>de</strong>s Mutuelles d’Epargne et <strong>de</strong> Crédit <strong>du</strong> Sénégal « URMECS »<br />
Conventions <strong>de</strong> partenariat MPER /OP, OP/SF<br />
<strong>Rapport</strong>s <strong>de</strong> Pré évaluation <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II<br />
Etu<strong>de</strong> sur l’offre et la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s services Financiers dans la zone<br />
d’intervention <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
23
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
24<br />
CHAMP CONTENU<br />
Fiche <strong>de</strong> <strong>de</strong>scription- Marché <strong>de</strong>s SDE<br />
1. TITRE DE L’EXPERIENCE Le marché <strong>de</strong> SDE en milieu rural : les limites d’une approche nouvelle dans les<br />
projets FIDA : cas <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2<br />
2. PAYS Sénégal<br />
3. PROJET Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural Phase II (<strong>PROMER</strong> II)<br />
4. PERSONNE-RESSOURCE ET<br />
FONCTION<br />
Mme Fatoumata SANE GUISSE, RSE<br />
5. E-MAIL promerdp@promer-sn.org fatoumata.sane@promer-sn.org<br />
6. DATE DE DEBUT ET DATE DE FIN<br />
DE L’ACTIVITE<br />
7. LOCALISATION<br />
Région, province, district, communauté où<br />
l'activité spécifique a eu lieu<br />
8. NATURE DE L’INITIATIVE<br />
- Services financiers<br />
- Services non financiers<br />
- Accès aux marchés<br />
- Accès aux technologies<br />
- Autre à préciser<br />
9. CONTEXTE<br />
Décrire les principaux facteurs <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong> l'activité. Ils peuvent être<br />
économiques, politiques, sociaux et<br />
environnementaux (par exemple les<br />
tendances migratoires, la sécheresse, etc.)<br />
10. PROBLEME / QUESTION<br />
Quels problèmes l’activité ou l'intervention<br />
adressent-ils? Pourquoi le projet a été initié<br />
dans ce domaine?<br />
11. OBJECTIFS<br />
Quel était le but <strong>du</strong> travail effectué?<br />
Tout en considérant une activité<br />
spécifique, il est également utile <strong>de</strong><br />
déterminer comment ces objectifs sont<br />
liés aux objectifs généraux <strong>du</strong> projet?<br />
12. BÉNÉFICIAIRES<br />
• Brève <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la population cible<br />
• La couverture <strong>de</strong> l'activité en termes <strong>de</strong><br />
nombre <strong>de</strong> personnes atteintes<br />
13. INTERVENANTS /PARTENAIRES<br />
• Tous les acteurs impliqués, y compris le<br />
groupe cible <strong>de</strong> l’activité, autorités<br />
locales, gouvernement ou autres<br />
institutions, membres <strong>de</strong> l'équipe <strong>du</strong><br />
projet.<br />
14. STRATÉGIE / APPROCHE<br />
• Comment l'activité est-elle mise en<br />
œuvre? S'il vous plaît résumer les<br />
principales caractéristiques <strong>de</strong> l'activité.<br />
• Quelles sont les actions qu’implique<br />
l’expérience? Il s'agit <strong>de</strong> l'orientation<br />
spécifique ou une stratégie suivie par<br />
l'activité, comme, par exemple, une<br />
sensibilité à l'approche <strong>de</strong> genre, ou<br />
chaînes <strong>de</strong> valeur.<br />
Avril 2006 – Septembre 2013<br />
Régions <strong>de</strong> Kolda, Fatick, Kaolack, Thiès, Kaffrine, Tambacounda et Kédougou<br />
L’activité repose sur le renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> service<br />
financiers et non financiers agréés par le <strong>PROMER</strong> 2. Ainsi donc le partenariat<br />
<strong>PROMER</strong>2/BIT a permis <strong>de</strong> booster le service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises par<br />
le renforcement <strong>de</strong>s capacités grâce aux outils GERME et PACTE pour assurer un<br />
bon suivi accompagnement aux MPER et OP appuyés par le <strong>PROMER</strong> 2<br />
Le principe d’intervention <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>-II est basé sur le « faire-faire » avec pour<br />
mission <strong>de</strong> développer un marché pérenne et <strong>du</strong>rable <strong>de</strong> services d’appuis non<br />
financiers et financiers. Sa démarche consiste ainsi à renforcer les capacités <strong>de</strong>s<br />
prestataires <strong>de</strong> services afin <strong>de</strong> développer l'offre <strong>de</strong> services d'appui financiers et<br />
non financiers aux MPER et à organiser la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> pour qu’elles puissent y accé<strong>de</strong>r.<br />
L’accompagnement technique <strong>de</strong>s PIE, MPER et OP qui va <strong>du</strong> diagnostic <strong>de</strong><br />
l’activité au suivi en passant par la formation et l’appui-conseil est réalisé par <strong>de</strong>s<br />
PSNF, qui <strong>de</strong>vront être i<strong>de</strong>ntifiés, sélectionnés et renforcés par le projet. Une<br />
sélection fine permettra <strong>de</strong> choisir <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> proximité, endogènes et<br />
suffisamment outillés pour offrir <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> qualité, accessibles et pérennes.<br />
Le rôle <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>-II n’est pas <strong>de</strong> fournir directement <strong>de</strong>s services aux entreprises<br />
et OP Bénéficiaires, mais plutôt <strong>de</strong> faciliter l'émergence et la rencontre <strong>de</strong> l'offre et<br />
<strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> services, au travers d’interventions temporaires permettant<br />
d'améliorer le fonctionnement <strong>de</strong>s marchés existants.<br />
- L’activité a pour objet :<br />
- le développement d’un service <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong>s entreprises en milieu<br />
rural<br />
- Appui au développement <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong>s MPER<br />
- Renforcement <strong>de</strong>s OP<br />
- Il permet d’assurer la pérennisation <strong>du</strong> SDE pour que la relève puisse être<br />
assurée à la Fin <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2<br />
- 71 Prestataires <strong>de</strong> services ont été i<strong>de</strong>ntifiés et renforcés dont 42 opérationnels<br />
- 639 MPER opérationnelles<br />
- 36 OP fonctionnelles<br />
BIT, PSNF, <strong>PROMER</strong>, MPER, PIE, OP, SFD, Collectivités locales.<br />
- I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s PSNF à l’ai<strong>de</strong> d’une fiche d’i<strong>de</strong>ntification<br />
- Présélection <strong>de</strong>s PSNF : par Avis à Manifestation d’Intérêt (AMI), Formulaires<br />
<strong>de</strong> candidature, Grille <strong>de</strong> présélection, Commission Technique<br />
- Sélection <strong>de</strong>s PSNF : à travers un Comité <strong>de</strong> sélection et d’une grille <strong>de</strong><br />
sélection, avec l’appui <strong>du</strong> BIT, <strong>de</strong>s Maître formateurs GERME et PACTE<br />
- Les PSNF seront ensuite formés en GERME et PACTE par le BIT afin <strong>de</strong><br />
pouvoir accompagner les PIE et MPER par le bais <strong>de</strong> formations et <strong>de</strong> suivi en<br />
Germe niveau 1, Germe classique et TRIE/CREE. Les PSNF formés en<br />
GERME seront aussi coachés par les maitres-formateurs <strong>du</strong> BIT jusqu’à la<br />
certification.<br />
- Les PSNF seront aussi formés en technique <strong>de</strong> diagnostic afin <strong>de</strong> pouvoir
15. RESULTATS / IMPACTS<br />
• Les résultats quantitatifs et qualitatifs<br />
par rapport aux objectifs.<br />
• Comment les activités contribuent à<br />
ré<strong>du</strong>ire la pauvreté et la vulnérabilité ?<br />
• Quelle est l’opinion <strong>de</strong>s bénéficiaires sur<br />
l’activité ?<br />
16. COÛTS ET RESSOURCES<br />
UTILISÉES<br />
• Précisez le budget total. Quelle<br />
ressource a été cruciale?<br />
• Budget<br />
• Expertise externe<br />
17. DIFFICULTES RENCONTREES<br />
Quels ont été les défis majeurs <strong>de</strong> cette<br />
activité et comment ont-ils été surmontés?<br />
18. FACTEURS DE SUCCES DE<br />
L’INITIATIVE<br />
con<strong>du</strong>ire efficacement les diagnostics d’entreprises, étapes clé <strong>du</strong> dispositif<br />
d’accompagnement <strong>de</strong>s MPER<br />
- Certains PSNF seront renforcés dans <strong>de</strong>s domaines spécifiques comme le Genre,<br />
le marketing, le contrôle <strong>de</strong> qualité et la gestion <strong>de</strong>s approvisionnements. Les<br />
formations seront con<strong>du</strong>ites par <strong>de</strong>s consultants et <strong>de</strong>vront permettre aux PSNF<br />
d’apporter <strong>de</strong>s appuis conseils spécifiques aux MPER.<br />
- Des <strong>atelier</strong>s <strong>de</strong> mise à niveau seront organisés pour les PSNF afin <strong>de</strong> les<br />
informer et sensibiliser sur les filières, l’environnement <strong>de</strong>s MPER et le<br />
<strong>PROMER</strong>-II<br />
- Les PSNF non encore formalisés seront sensibilisés et accompagnés vers <strong>de</strong>s<br />
structures spécialisées dans ce domaine comme les chambres <strong>de</strong> commerce,<br />
d’in<strong>du</strong>strie et d’agriculture, les centres <strong>de</strong> gestion agréés, les services <strong>de</strong>s impôts<br />
et domaines, les banques,…etc. La formalisation <strong>de</strong>vrait les ai<strong>de</strong>r à exercer leur<br />
métier dans la légalité et la transparence et <strong>de</strong> pouvoir postuler à <strong>de</strong>s marchés<br />
publics.<br />
Le développement d’un SDE a permis le développement <strong>de</strong><br />
Les capacités <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> service sont renforcées<br />
Le SDE a permis <strong>de</strong> gagner d’autres marchés hors <strong>PROMER</strong><br />
Les montants encaissés par les prestataires <strong>de</strong>s marchés <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> est 2<br />
Les montants encaissés par les prestataires hors <strong>PROMER</strong><br />
BIT<br />
Difficulté pour les MPER à payer le service <strong>de</strong> conseil <strong>de</strong> sorte que va se poser le<br />
problème <strong>de</strong> la pérennisation<br />
Démarrage tardif <strong>du</strong> suivi accompagnement dont 33% <strong>de</strong>vaient être pris en charge<br />
par les MPER<br />
Prémices <strong>de</strong> Développement d’un Service <strong>de</strong> Développement d’entreprises en milieu<br />
rural<br />
19. MESSAGE CLE / LEÇONS Disponibilité d’une offre <strong>de</strong> service <strong>du</strong>rable capable <strong>de</strong> satisfaire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> dans la<br />
• Quel est (sont) la leçon clé (s) tirée(s) <strong>de</strong> zone d’intervention <strong>du</strong> projet<br />
cette pratique?<br />
• Qu'est-ce qui rend l’activité à être<br />
considérée comme une bonne pratique /<br />
potentiellement une bonne pratique?<br />
• Que feriez-vous différemment?<br />
20. NOTES COMPLÉMENTAIRES<br />
Mentionner toute information que vous<br />
jugerez pertinente qui n'est pas couverte dans<br />
l'un <strong>de</strong>s champs ci-<strong>de</strong>ssus.<br />
21. DOCUMENTS<br />
Noter tous les documents qui prouvent votre<br />
approche ou <strong>de</strong>s échantillons <strong>de</strong> matériaux<br />
utilisés dans votre application que vous êtes<br />
disposés à partager avec d'autres projets?<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> pré évaluation <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2 ; Convention <strong>PROMER</strong> 2/BIT, rapports<br />
<strong>de</strong> formation GERME et PACTE, <strong>Rapport</strong> techniques et financiers <strong>du</strong> BIT, rapport<br />
SRC (Séminaire <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> capacités)<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> missions <strong>de</strong> suivi et <strong>de</strong> supervision <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2, <strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> la revue à<br />
mi parcours <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> 2<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
25
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
26<br />
ANNEXE 3 : LISTE DES PARTICIPANTS<br />
Noms Structure Email Téléphone<br />
Ousseynou Ndiaye Antenne Sud-est osendiaye@yahoo.fr 70 206 6449<br />
Hawa Sow Bousso CIDD <strong>PROMER</strong> hawabousso@yahoo.fr 77 538 3896<br />
Hamat Ly RLA <strong>PROMER</strong> hamatly@yahoo.fr 77 545 15 34<br />
Mamadou Ndour UGP <strong>PROMER</strong> madoundour@yahoo.fr 77 578 2870<br />
Moustapha Cissé UGP PRMER cissecom@yahoo.fr 77 552 3460<br />
Ameth Hady Seydi <strong>PROMER</strong> SAFI Ameth_hady@hotmail.com 77 583 3548<br />
Boubacar Keita OP traditionnelles<br />
Boulangers Tamba<br />
Ibrahima Sory Diallo SAFIR <strong>PROMER</strong><br />
Tamba<br />
77 324 1143<br />
Sori02ibrahima@yahoo.fr 77 363 8411<br />
70 103 1733<br />
Hawa Diarra Prestataire Masagne58@yahoo.fr 77.649.1415<br />
Fatoumata Sané RSE <strong>PROMER</strong> Fabiatou2008@yahoo.fr 77 640 1633<br />
Sira Fofana MPER Goudiry 77 516 5699
ANNEXE 4 : GRILLE D’EVALUATION DES TEXTES<br />
Titre <strong>de</strong> la <strong>capitalisation</strong> :<br />
Nom <strong>de</strong>s auteurs/contributeurs :<br />
Equipe d’évaluation :<br />
Evaluation générale : Le message central (leçon, innovation, bonne pratique) est-il<br />
explicite ?<br />
Critères<br />
d’évaluation<br />
1 – Intro<strong>du</strong>ction<br />
• Est-ce que l’enjeu et le problème sont<br />
bien exposés ?<br />
• Est-ce que le sujet est bien décliné ?<br />
• Est-ce que l’objectif <strong>de</strong> la<br />
<strong>capitalisation</strong> est bien indiqué?<br />
• Est-ce que le plan <strong>du</strong> texte est bien<br />
annoncé ?<br />
• Autres observations<br />
2. Description<br />
• Est-ce que les objectifs <strong>de</strong><br />
l’expérience sont bien présentés ?<br />
• Est-ce que les principaux acteurs et<br />
leurs rôles sont bien exposés ?<br />
• Est-ce que les stratégies, les<br />
approches et les métho<strong>de</strong>s<br />
d’intervention sont abordées ?<br />
• Est-ce que les ressources mobilisées<br />
sont précisées ?<br />
• Est-ce que les collaborations et<br />
partenariats sont traités ?<br />
• Autres aspects<br />
3. Analyse <strong>de</strong> l’expérience<br />
• L’expérience est-elle analysée <strong>du</strong><br />
point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> ses effets (ré<strong>du</strong>ction<br />
<strong>de</strong>s inégalités : inégalités <strong>de</strong><br />
conditions <strong>de</strong> vie, <strong>de</strong> niveau <strong>de</strong> vie,<br />
<strong>de</strong> pouvoir) ?<br />
• Les facteurs déterminants <strong>de</strong> succès<br />
sont-ils analysés<br />
• Les difficultés rencontrées sont-elles<br />
analysées ?<br />
• Les implications pour le<br />
développement sont-elles précisées ?<br />
• Autres aspects<br />
Constats<br />
et observations<br />
Commentaires et<br />
recommandations<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
27
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
28<br />
4 - Conclusion et perspective<br />
• Les principaux points développés<br />
sont-ils rappelés ?<br />
• Les perspectives sont-elles<br />
annoncées ?<br />
5. Lisibilité<br />
• La présentation est-elle claire ?<br />
• L’écriture <strong>du</strong> texte est-elle simple et<br />
accessible ?<br />
• Les connecteurs logiques sont-ils<br />
bien utilisés ?<br />
• Les sigles, acronymes et abréviations<br />
utilisés sont-ils tous ?<br />
• Les illustrations et tableaux sont-ils<br />
pertinents et adaptés au texte ?<br />
• Les références bibliographiques sontelles<br />
correctement appelées/citées<br />
dans le texte ?
ANNEXE 5 : DE LA FICHE AU A LA REDACTION<br />
Pour rédiger …<br />
LE TITRE<br />
L’INTRODUCTION (2 PAGES)<br />
• Pourquoi ce problème ?<br />
• De quoi s’agit-il ?<br />
• Quels seront les points traités ?<br />
LE CORPS DU TEXTE (6 A 8 PAGES)<br />
• Description <strong>de</strong> l’expérience<br />
• Analyse <strong>de</strong> l’expérience<br />
CONCLUSION (1 A 2 PAGES)<br />
Mixe<br />
• <strong>de</strong>s aspects récapitulatifs (rappel<br />
<strong>de</strong>s principaux enseignements)<br />
• et <strong>de</strong>s aspects prospectifs (mise en<br />
perspective)<br />
Prendre les informations dans les parties<br />
suivantes <strong>de</strong> la grille <strong>de</strong> <strong>capitalisation</strong><br />
Titre <strong>de</strong> l’initiative<br />
Mots-clés<br />
NB : Le titre <strong>de</strong> la grille n’est qu’un titre <strong>de</strong><br />
travail. Le titre définitif est choisi après avoir<br />
rédigé le texte.<br />
Nature <strong>de</strong> l’initiative<br />
Zone, lieu<br />
Date, <strong>du</strong>rée<br />
Contexte/problématique<br />
PARTIE « DESCRIPTION »<br />
Objectifs<br />
Principaux acteurs et leurs rôles<br />
Stratégies, approches<br />
Ressources mobilisées<br />
PARTIE « ANALYSE »<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s effets<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong>s impacts<br />
Facteurs déterminants <strong>de</strong> succès<br />
Difficultés rencontrées<br />
Rappel <strong>de</strong>s principaux points développés<br />
Principales leçons, conditions pour passage à<br />
l’échelle<br />
Perspectives<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
29
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
30<br />
ANNEXE 6 : 4 TEXTES DE CAPITALISATION<br />
TEXTE 1 : BOUTIQUES DES MICRO-ENTREPRENEURS RURAUX<br />
Des ratés dans la mise en œuvre d’une innovation<br />
L’approche <strong>de</strong>scendante <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement constitue un facteur <strong>de</strong> non<br />
appropriation <strong>de</strong>s outils et <strong>de</strong> contre-performance. Le cas <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong>s microentrepreneurs<br />
ruraux, à Tambacounda et à Kaolack, illustre l’échec <strong>de</strong> cette<br />
démarche. Ces boutiques, fortement soutenues par le <strong>PROMER</strong>, ont enregistré <strong>de</strong>s<br />
pertes récurrentes découlant <strong>de</strong> la rupture <strong>de</strong>s stocks et <strong>de</strong> l’irrégularité dans la<br />
qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its.<br />
L’idée d’ouvrir un espace <strong>de</strong> vente pour les micro-entreprises rurales (MER) est née <strong>de</strong>s<br />
difficultés <strong>de</strong> commercialisation <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its, malgré l’appui <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, le Projet<br />
<strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro-Entreprises Rurales basé à Tambacounda, dans le sud-est <strong>du</strong><br />
Sénégal. Le maigre pouvoir d’achat <strong>de</strong>s populations rurales, leur faible niveau <strong>de</strong><br />
consommation, la difficulté <strong>de</strong> placer leurs pro<strong>du</strong>its dans les circuits <strong>de</strong> distribution<br />
mo<strong>de</strong>rnes (boutiques, magasins, épiceries…) ne favorisent pas, en effet, la promotion <strong>de</strong>s<br />
micro-entreprises rurales. Il faut ajouter à cela le manque <strong>de</strong> vitrines commerciales, en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s manifestations ponctuelles que sont la FIARA (Foire Internationale <strong>de</strong>s<br />
Ressources Agricoles et animales), la FIDAK (Foire Internationale <strong>de</strong> Dakar) et les foires<br />
régionales, mais aussi l’absence <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales dans les<br />
marchés urbains.<br />
Pour mieux exploiter les opportunités commerciales, les micro-entreprises rurales ont<br />
besoin d’assistance. C’est elle qui leur permet d’i<strong>de</strong>ntifier les opportunités plus<br />
efficacement, en partant <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong>s différents marchés et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Les MER<br />
peuvent ainsi adapter leur offre à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> en mettant en place <strong>de</strong>s circuits <strong>de</strong><br />
distribution innovants.<br />
C’est dans ce cadre que la première phase <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> (le <strong>PROMER</strong> 1, 1997-2005), a mis<br />
en place <strong>de</strong>ux boutiques au profit <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs ruraux : celle <strong>de</strong> Tambacounda,<br />
<strong>de</strong>stinée aux micro-entreprises rurales <strong>de</strong> Tambacounda et <strong>de</strong> Kolda ; et celle <strong>de</strong> Kaolack,<br />
pour les MER <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> Fatick.<br />
La conception et la mise en œuvre <strong>de</strong> cette expérience, qui s’est étalée sur dix-huit mois, <strong>de</strong><br />
février 2004 à juillet 2005, ont souffert <strong>de</strong> beaucoup d’insuffisances, principalement <strong>du</strong>es à<br />
une approche erronée qui partait <strong>du</strong> sommet à la base. Cela a sans doute favorisé la non<br />
appropriation <strong>de</strong> cette initiative par les micro-entrepreneurs ruraux. D’où <strong>de</strong>s contreperformances<br />
regrettables, certes, mais réelles.<br />
Ce document revient sur cette expérience. Expliquant d’abord ce que sont les boutiques <strong>de</strong>s<br />
MER, il analyse ensuite les raisons <strong>de</strong> leur échec en mettant l’accent sur les aspects liés à<br />
la non rentabilité, à l’insatisfaction <strong>de</strong> la clientèle et au déficit d’appropriation. Des<br />
solutions et recommandations sont enfin proposées pour permettre à l’avenir une meilleure<br />
réplicabilité <strong>de</strong> ce genre d’initiative.<br />
Le rôle prépondérant <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong><br />
Avec les boutiques <strong>de</strong>s MER, l’objectif est d’offrir aux micro-entrepreneurs ruraux la<br />
possibilité <strong>de</strong> disposer d’un espace <strong>de</strong> vente et d’écoulement <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its à <strong>de</strong>s prix<br />
compétitifs. Les boutiques visaient également à satisfaire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> urbaine en pro<strong>du</strong>its<br />
d’origine rurale valorisés grâce à une meilleure présentation et à l’amélioration <strong>de</strong> leur<br />
qualité globale. Un autre objectif était <strong>de</strong> profiter <strong>de</strong>s opportunités dans les métiers ruraux<br />
en amont et en aval <strong>de</strong> l’agriculture singulièrement dans les filières porteuses <strong>de</strong> l’artisanat.<br />
Tout cela, en augmentant leurs chiffres d’affaires, <strong>de</strong>vait améliorer les revenus <strong>de</strong>s micro-
entrepreneurs, mais aussi permettre <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> nouveaux emplois rémunérateurs et<br />
<strong>du</strong>rables, saisonniers ou permanents,<br />
De nombreux acteurs ont participé à la mise en œuvre <strong>de</strong>s boutiques. La sensibilisation et<br />
l’information ont été faites par les autorités locales et administratives qui ont aussi appuyé,<br />
conseillé et soutenu l’initiative. L’accès au financement a été facilité par les systèmes<br />
financiers décentralisés, principalement l’Alliance pour le Crédit et l’Epargne Populaire<br />
(ACEP), le Crédit Mutuel <strong>du</strong> Sénégal (CMS) et l’Union <strong>de</strong>s Mutuelles d’Epargne et <strong>de</strong><br />
Crédit (UMEC). Les services techniques <strong>de</strong> l’Etat ont assuré le suivi et l’encadrement à<br />
travers le Service Régional <strong>du</strong> Commerce et les Centres d’Expansion Rurale. Quant aux<br />
micro-entreprises rurales, elles étaient 78 à participer à l’initiative : 43 <strong>de</strong> Tambacounda et<br />
46 <strong>de</strong> Kaolack dont 14 groupements et 14 entreprises indivi<strong>du</strong>elles. Il ne faut pas oublier,<br />
parmi les acteurs, l’ITA (Institut <strong>de</strong> technologie alimentaire), dont le rôle était <strong>de</strong> renforcer<br />
les capacités <strong>de</strong>s bénéficiaires et d’assurer le contrôle <strong>de</strong> qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, les ven<strong>de</strong>urs<br />
et gérants recrutés et rémunérés par le <strong>PROMER</strong>, et enfin les clients, acheteurs <strong>de</strong>s<br />
pro<strong>du</strong>its, qui ont répon<strong>du</strong> à l’enquête <strong>de</strong> satisfaction et donné leur feedback sur les articles<br />
commercialisés.<br />
Le <strong>PROMER</strong> a joué un rôle prépondérant pour l’accès <strong>de</strong>s micro-entreprises aux services<br />
financiers et aux services non financiers. C’est avec lui qu’ont été mis en œuvre l’appui au<br />
recrutement <strong>du</strong> ven<strong>de</strong>ur et <strong>du</strong> gérant, la mise en place <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> gestion, la réalisation<br />
<strong>de</strong>s plaquettes <strong>de</strong> présentation <strong>de</strong>s boutiques et la confection d’étiquettes pour les pro<strong>du</strong>its.<br />
Le <strong>PROMER</strong> a également élaboré <strong>de</strong>s politiques commerciales, mis à la disposition <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs ruraux <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong>s manuels <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>res, assuré le suivi<br />
régulier <strong>de</strong>s recettes et informé le public <strong>de</strong> l’existence <strong>de</strong>s boutiques en postant<br />
l’information dans son site web.<br />
Sélection <strong>de</strong>s entreprises<br />
De la formulation au suivi-accompagnement, en passant par l’information-sensibilisation,<br />
la formalisation et la mise en œuvre, cinq étapes ont jalonné le processus..<br />
Il a fallu, dans le cadre <strong>de</strong> la formulation, diagnostiquer les problèmes. De ce diagnostic<br />
est née l’idée <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong>s boutiques avant que les agents <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong><br />
n’élaborent les dossiers techniques <strong>de</strong> l’initiative. L’information-sensibilisation <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs ruraux a été ensuite assurée par les conseillers en entreprise <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>,<br />
relayés par les autorités administratives et locales. Au sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> la formalisation, <strong>de</strong>ux<br />
assemblées générales ont été organisées, suivies <strong>de</strong> la création <strong>de</strong>s groupements d’intérêt<br />
économique (GIE). Les étapes suivantes ont consisté en la mise en place <strong>de</strong>s comités <strong>de</strong><br />
gestion, la libération <strong>de</strong>s droits d’adhésion et la signature <strong>de</strong>s protocoles d’accord entre le<br />
<strong>PROMER</strong> et les prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s GIE.<br />
La mise en œuvre, c’est avant tout la location <strong>de</strong>s boutiques, la réalisation <strong>de</strong>s<br />
aménagements, la mise en place <strong>de</strong>s équipements et emballages, l’élaboration <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong><br />
gestion (fiches <strong>de</strong> stocks, cahiers recettes-dépenses, manuel <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res) et le<br />
recrutement <strong>de</strong>s gérants et ven<strong>de</strong>urs, Elle a aussi concerné la sélection <strong>de</strong>s microentreprises<br />
rurales et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its à mettre en vente, l’installation <strong>de</strong>s panneaux et<br />
enseignes <strong>de</strong> signalisation, l’ouverture <strong>de</strong>s boutiques, et les journées <strong>de</strong> lancement par les<br />
autorités. Les recherches <strong>de</strong> marchés, les formations techniques et en gestion, la tenue <strong>de</strong><br />
rencontres régulières pour évaluer la mise en relation avec les systèmes financiers<br />
décentralisés et les chambres consulaires, la création d’un site web pour faciliter la<br />
commercialisation en ligne constituent aussi <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> mise en œuvre.<br />
Lors <strong>de</strong> la phase <strong>de</strong> suivi-accompagnement, les responsables techniques et commerciaux<br />
ont surveillé les recettes, assuré le contrôle <strong>de</strong> la gestion et <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, mené<br />
<strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> prospection <strong>de</strong> marchés et donné leur appui pour l’élaboration <strong>de</strong>s<br />
rapports.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
31
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
32<br />
L’appui technique et financier <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> s’est manifesté à travers le Fonds d’Appui<br />
Technologique (FAT) et la Convention d’Appui Commercial (CAC). 23,7 millions <strong>de</strong><br />
francs CFA ont été investis par le <strong>PROMER</strong>, entre autres dans les emballages, les<br />
étiquettes et les charges <strong>de</strong> fonctionnement. Les micro-entrepreneurs ruraux ont participé à<br />
cet effort en cotisant chacun 10.000 francs, soit un total <strong>de</strong> 890 000 francs.<br />
Déficit d’appropriation<br />
Malgré les résultats encourageants enregistrés, confirmés par <strong>de</strong>s chiffres d’affaires élevés<br />
(15, millions <strong>de</strong> francs, soit 52% <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> référence qui s’élève à 7,5 millions <strong>de</strong><br />
francs), malgré l’augmentation <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales qui s’élevait à<br />
12,5 millions <strong>de</strong> francs sur la pério<strong>de</strong>, les boutiques ont connu <strong>de</strong> sérieuses limites qui ont,<br />
finalement, con<strong>du</strong>it à leur arrêt. Pour comprendre cet échec, il faut l’analyser en prenant en<br />
compte les aspects <strong>de</strong> rentabilité, <strong>de</strong> fidélisation <strong>de</strong> la clientèle et d’appropriation par les<br />
MER.<br />
Si l’on prend les trois critères que sont le chiffre d’affaires, le bénéfice net et la valeur<br />
ajoutée, on se rend compte que la rentabilité était difficile à atteindre. En effet, avec une<br />
moyenne <strong>de</strong> 300.000 francs par mois, les charges <strong>de</strong>meuraient très élevées. Elles ont été<br />
subventionnées par le <strong>PROMER</strong>, <strong>de</strong> même que les pertes récurrentes comblées à hauteur<br />
<strong>de</strong> 7 millions <strong>de</strong> francs par mois, <strong>de</strong> février 2004 à juillet 2005). Les marges commerciales,<br />
top faibles, ne permettaient pas la couverture <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> fonctionnement <strong>de</strong>s boutiques.<br />
En conséquence, les membres n’ont pas pu prendre en charge progressivement, comme<br />
prévu, les coûts <strong>de</strong> fonctionnement.<br />
La fidélisation <strong>de</strong> la clientèle était indispensable à la réussite <strong>de</strong> l’initiative. Elle s’apprécie<br />
sous les angles <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> satisfaction, <strong>du</strong> niveau <strong>de</strong> portefeuille client et <strong>du</strong> taux <strong>de</strong> réachat.<br />
Bien que les besoins <strong>de</strong>s clients aient été bien i<strong>de</strong>ntifiés au départ,<br />
l’approvisionnement insuffisant et irrégulier en pro<strong>du</strong>its, <strong>du</strong> fait <strong>de</strong> l’éloignement <strong>de</strong>s zones<br />
<strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, a entraîné à la longue <strong>de</strong> fréquentes ruptures <strong>de</strong> stock, et finalement une<br />
désaffection croissante <strong>de</strong> la clientèle. A cela, il faudrait ajouter la difficulté <strong>de</strong> maintenir la<br />
qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its. En dépit <strong>de</strong> tous les efforts consentis, notamment en matière <strong>de</strong><br />
présentation (emballage, conditionnement, étiquettes), les pro<strong>du</strong>its n’ont pas réussi à<br />
maintenir un taux <strong>de</strong> rotation <strong>du</strong> stock suffisant.<br />
Enfin, l’absence d’appropriation <strong>de</strong>s boutiques par les membres a été le principal maillon<br />
faible <strong>de</strong> l’expérience. Le fait que le <strong>PROMER</strong> se soit bien souvent substitué aux<br />
bénéficiaires sur <strong>de</strong> nombreux aspects cités plus haut a fini par occasionner le désintérêt <strong>de</strong><br />
ces <strong>de</strong>rniers dans la gestion, mais aussi la passivité <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong>s organes <strong>de</strong> gestion qui<br />
ont commencé à mal fonctionner. Ce qui tra<strong>du</strong>it leur faible niveau d’implication et<br />
d’appropriation <strong>de</strong>s boutiques. Malgré la tenue <strong>de</strong>s réunions d’évaluation, con<strong>du</strong>ites par les<br />
prési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong>s GIE, le niveau <strong>de</strong> responsabilisation escompté n’a pas été atteint. Par<br />
ailleurs le démarrage tardif <strong>de</strong>s boutiques, à un an <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la première phase <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong>, n’a pas permis une bonne maturation <strong>de</strong> l’expérience ni une bonne mise en<br />
œuvre <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> sortie.<br />
Primauté <strong>de</strong> la fonction commerciale<br />
Le <strong>PROMER</strong>, dans sa première phase, a joué un rôle prépondérant et précurseur dans la<br />
promotion et le développement <strong>de</strong> la micro-entreprise non agricole en milieu rural. Il a<br />
ainsi contribué <strong>de</strong> façon significative à la lutte contre la pauvreté et l’exo<strong>de</strong> rural grâce à<br />
<strong>de</strong>s opportunités d’emplois <strong>du</strong>rables et <strong>de</strong> richesses offertes aux ruraux, singulièrement les<br />
femmes et les jeunes. Cette phase pilote a permis au <strong>PROMER</strong> <strong>de</strong> concevoir et d’adapter<br />
<strong>de</strong>s outils méthodologiques d’appui à la micro-entreprise rurale, dont les boutiques.<br />
Malheureusement, le démarrage tardif et l’approche <strong>de</strong>s outils n’ont pas permis aux<br />
bénéficiaires <strong>de</strong> s’en approprier
Les actions menées et les résultats enregistrés par l’appui commercial dans cette phase<br />
auront cependant permis <strong>de</strong> mesurer à quel point le volet commercial est important dans la<br />
bataille <strong>du</strong> développement <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales. Mais l’appui commercial ne doit<br />
pas se limiter uniquement à trouver <strong>de</strong>s marchés à <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales<br />
disséminées à <strong>de</strong>s centaines <strong>de</strong> kilomètres <strong>de</strong> ces marchés. Il s’agit aussi <strong>de</strong> fidéliser ces<br />
marchés par un approvisionnement régulier et une qualité constante dans les pro<strong>du</strong>its. Cela<br />
passe nécessairement par une pleine implication <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales.<br />
Force est <strong>de</strong> reconnaître cependant que les boutiques <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales, malgré<br />
leur échec, ont constitué un outil clé <strong>de</strong> visibilité commerciale et un élément fondamental<br />
dans le processus <strong>de</strong> pérennisation <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales. Elles ont permis à nombre<br />
ré<strong>du</strong>it d’entre elles, aussi minime soit-il, d’augmenter leur capacité <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, d’élargir<br />
leur marché et <strong>de</strong> s’ouvrir au marché <strong>de</strong>s valeurs.<br />
En vue d’une réplicabilité <strong>de</strong>s boutiques <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales et <strong>de</strong> leur réussite, la<br />
<strong>de</strong>uxième phase <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> ou les projets <strong>de</strong> développement gagneraient revoir à<br />
certains aspects <strong>de</strong> la conception et <strong>de</strong> la mise en œuvre.<br />
Au vu <strong>de</strong> tous les écueils évoqués, beaucoup tenteraient <strong>de</strong> reléguer les boutiques aux<br />
oubliettes. Cette crainte <strong>de</strong> l’échec in<strong>du</strong>irait l’inaction face à un choix inévitable dicté par<br />
le marché et les besoins <strong>de</strong>s MPER<br />
Au contraire, si les problèmes i<strong>de</strong>ntifiés sont résolus, ces boutiques pourraient constituer<br />
une bouée <strong>de</strong> sauvetage permettant <strong>de</strong> pérenniser les entreprises rurales. Pour ce faire, il<br />
faudrait, d’une part, assurer une meilleure implication <strong>de</strong>s micro-entreprises rurales, dans<br />
les choix commerciaux <strong>de</strong> leurs entreprises et les actions y afférentes (responsabilisation,<br />
participation effective) ; et, d’autre part, mener le combat <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et <strong>de</strong> la<br />
régularité dans l’approvisionnement. Il faudrait par ailleurs relever les défis <strong>de</strong> la maitrise<br />
<strong>de</strong>s couts, <strong>de</strong> l’augmentation <strong>de</strong>s recettes mensuelles par la mise en œuvre d’un plan <strong>de</strong><br />
communication et <strong>de</strong> la prospection <strong>de</strong> nouveaux marchés. En outre, il serait nécessaire<br />
d’alléger les lour<strong>de</strong>urs dans la gestion communautaire <strong>de</strong>s boutiques, d’assurer un temps <strong>de</strong><br />
maturation convenable et un retrait progressif planifié avec les acteurs.<br />
Une première piste à prospecter pourrait porter sur les possibilités <strong>de</strong> permettre aux<br />
boutiques <strong>de</strong> commercialiser <strong>de</strong>s intrants qu’utilisent les micro-entreprises rurales (farine,<br />
mil, quincaillerie et ferraille pour les MER <strong>de</strong> forge, intrants <strong>de</strong> teinture, etc.) et liés à leurs<br />
activités directes <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, dans le but d’améliorer et <strong>de</strong> diversifier les marges<br />
bénéficiaires.<br />
Une secon<strong>de</strong> piste pourrait porter sur la possibilité d’appuyer un micro-entrepreneur<br />
indivi<strong>du</strong>el, volontaire, qui prendrait l’essentiel <strong>de</strong>s risques pour mettre en place sa<br />
boutique. Ce <strong>de</strong>rnier a l’avantage <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r en temps réel, <strong>de</strong> négocier les prix et <strong>de</strong><br />
sanctionner la mauvaise qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its.<br />
En définitive, l’accent doit être mis sur la fonction commerciale (avec l’implantation <strong>de</strong>s<br />
infrastructures commerciales), seul poste <strong>de</strong> profit pour les micro-entreprises rurales. Il<br />
faudrait nécessairement mettre en cohérence tous les outils dans le cadre d’une stratégie<br />
claire appuyée par <strong>de</strong>s moyens conséquents. Toutes ces actions viseront dès le départ à<br />
consoli<strong>de</strong>r et à renforcer les acquis dans une approche dégressive.<br />
Il s’agit d’amener les micro-entreprises rurales à prendre en charge <strong>de</strong> façon progressive<br />
tout le processus commercial : recherche <strong>de</strong> marché, négociation commerciale, gestion <strong>de</strong><br />
la clientèle, réactivité et pro-activité, calcul <strong>de</strong>s coûts, marges et bénéfices, etc.<br />
SUGGESTIONS<br />
Encadré : MER (origine, objectif et définition)<br />
Dans le texte : Témoignage (d’un entrepeneur et/ou d’un client)<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
33
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
34<br />
Dans le texte : quels types <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its sont dans les boutiques (donner <strong>de</strong>s exemples)<br />
Encadré sur la liste <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its ven<strong>du</strong>s dans les boutiques<br />
Les pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s boutiques<br />
Tambacounda : céréales, fruits et légumes, fonio, beurre <strong>de</strong> karité,, huile <strong>de</strong> palme, nététou,<br />
miel, aman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cajou, meubles en raphia et en rônier, houes sine, charrues, charrettes,<br />
semoirs<br />
Kaolack : céréales, fruits et légumes, nététou, miel, aman<strong>de</strong>s <strong>de</strong> cajou, houes sine,<br />
charrues, charrettes, semoirs, pâte d’arachi<strong>de</strong>, toufa, yeet, yokhos, pagne, crevettes,<br />
poisson séché et fumé<br />
SOURCES<br />
• FIDA, <strong>PROMER</strong> I,. <strong>Rapport</strong> <strong>de</strong> pré-évaluation, volume II : documents <strong>de</strong> travail.<br />
<strong>Rapport</strong> No. 1769-SN. - Avril 2005.<br />
• FIDA, <strong>PROMER</strong> I.- <strong>Rapport</strong> d’évaluation d’intermédiaire, décembre 2004.-<br />
<strong>Rapport</strong> n° 1565 -SN<br />
• <strong>PROMER</strong> I.- <strong>Rapport</strong> d’Achèvement final <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I.- Mai 2005 .- 65 p.<br />
• LY, Hamat.-<strong>Rapport</strong> d’Achèvement <strong>du</strong> Responsable Commercial <strong>de</strong> Kaolack.-<br />
Septembre 2004.- 10 p.<br />
• SOUARE, Amadou.- <strong>Rapport</strong> d’achèvement <strong>du</strong> Responsable Commercial <strong>de</strong><br />
Tambacounda.- Décembre 2004 – 14 p.<br />
• <strong>PROMER</strong> I .- <strong>Rapport</strong> Annuel 2004 <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong> Kaolack<br />
• LY, Hamat.- Situation général <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong>s MER <strong>de</strong> février 2004 à août<br />
2005 : principaux enseignements tirés-Août 2005.- 1Op.<br />
• <strong>PROMER</strong>.I- <strong>Rapport</strong> annuel 2004 <strong>de</strong> la boutique <strong>de</strong> Tambacounda.- Avril 2005 .-<br />
32 p.<br />
• <strong>PROMER</strong> I.- Stratégie <strong>de</strong> commercialisation et <strong>de</strong> pérennisation <strong>de</strong>s MER.-<br />
Février 2005.- 15 p.<br />
• <strong>PROMER</strong> I.- Banque d’images <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I.- 2004 à 2005
TEXTE 2 : SERVICE DE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES<br />
Levier <strong>de</strong> performance et <strong>de</strong> compétitivité <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales<br />
Un service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> qualité garantit la performance et la<br />
compétitivité <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales (MPER). L’expérience <strong>de</strong>s<br />
marchés <strong>de</strong> services <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises <strong>du</strong> Projet <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong><br />
l’entreprenariat rural <strong>du</strong> Sénégal montre que la disponibilité <strong>de</strong> compétences avérées<br />
<strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services, d’outils méthodologiques et <strong>de</strong> normes adaptés entraîne<br />
une augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité <strong>de</strong>s MPER et <strong>de</strong>s emplois. Elle améliore<br />
également la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, favorise l’accès aux marchés locaux et ouvre <strong>de</strong>s<br />
perspectives sur les marchés nationaux et régionaux.<br />
Avant la mise en œuvre <strong>de</strong> la première phase <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> (Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s<br />
micro-entreprises rurales), il n’existait aucun service dédié au développement <strong>de</strong>s<br />
entreprises au Sénégal. Le <strong>PROMER</strong> 1 (1994-2005) est donc le projet pilote <strong>de</strong> promotion<br />
<strong>de</strong>s micro-entreprises rurales au Sénégal.<br />
Dans sa première phase, le <strong>PROMER</strong> avait un pool <strong>de</strong> 24 conseillers en entreprises<br />
internes répartis dans autant <strong>de</strong> zones d’animation économique <strong>de</strong> proximité (ZAEP). Ils<br />
étaient chargés <strong>de</strong> la sensibilisation et <strong>de</strong> l’animation sur les opportunités, <strong>de</strong>s ouvertures<br />
<strong>de</strong> comptes courants et d’épargne, <strong>de</strong> l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s porteurs d’initiatives, <strong>de</strong> l’appui<br />
<strong>de</strong>s PIE dans l’élaboration <strong>de</strong> leur dossier <strong>de</strong> projet et <strong>du</strong> suivi-accompagnement. La<br />
sélection <strong>de</strong> ces conseillers se faisait sur la base d’un appel à candidatures et d’un entretien.<br />
Cette fonction a été externalisée lors <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième phase <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> (<strong>de</strong>puis 2005).<br />
Le <strong>PROMER</strong> est convaincu qu’un service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises <strong>de</strong> qualité est<br />
un gage <strong>de</strong> performance et <strong>de</strong> compétitivité <strong>de</strong>s micro et petites entreprises rurales<br />
(MPER). Le principe <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s appuis <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> est basé sur le « fairefaire<br />
». Il a pour mission <strong>de</strong> développer un marché pérenne et <strong>du</strong>rable <strong>de</strong> services d’appuis<br />
non financiers et financiers. La démarche consiste à i<strong>de</strong>ntifier, sélectionner et renforcer les<br />
prestataires locaux (formation en gestion, diagnostic…) afin qu’ils puissent offrir <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> qualité, accessibles aux MPER. Cette offre <strong>de</strong> service <strong>de</strong> qualité et <strong>du</strong>rable s’est<br />
tra<strong>du</strong>ite par l’amélioration <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité et <strong>de</strong> la compétitivité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s micro<br />
et petites entreprises rurales.<br />
Il s’agit <strong>de</strong> montrer ici que le <strong>PROMER</strong> II a appuyé et accompagné la mise en place d’une<br />
offre adaptée au service <strong>du</strong> développement <strong>de</strong> la micro et petite entreprise rurale afin <strong>de</strong><br />
tirer les enseignements nécessaires en vue d’une éventuelle réplicabilité. Pour assurer la<br />
<strong>du</strong>rabilité <strong>de</strong> cette offre, un travail <strong>de</strong> sensibilisation est à effectuer auprès <strong>de</strong>s micro et<br />
petites entreprises rurales pour rendre la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> plus solvable. Ce travail sera analysé par<br />
rapport à l’offre <strong>de</strong> qualité, l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s MPER, la compétitivité et<br />
la <strong>du</strong>rabilité.<br />
Offre <strong>de</strong> qualité<br />
Le développement <strong>de</strong> la micro-entreprise en milieu rural se présente comme une<br />
formidable opportunité pour contribuer à la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la pauvreté dans les campagnes<br />
sénégalaises. En effet, le développement d’entreprises rurales peut favoriser l’émergence<br />
<strong>de</strong> services <strong>de</strong> proximité et la facilitation <strong>de</strong> l’accès aux intrants. La première phase a<br />
permis <strong>de</strong> concevoir et d’adapter <strong>de</strong>s outils méthodologiques d’appui à la MER<br />
essentiellement axés sur la communication et l’animation, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> porteurs<br />
d’initiatives économiques, le pré-diagnostic, le diagnostic, le suivi et l’appui conseil.<br />
Pour la secon<strong>de</strong> phase, il s’agit <strong>de</strong> consoli<strong>de</strong>r les acquis <strong>de</strong> l’expérience pilote mais cette<br />
fois ci en mettant en œuvre la stratégie <strong>du</strong> « faire faire ». Cette approche a suscité<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
35
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
36<br />
l’émergence et le renforcement <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> services aux MPER par l’organisation <strong>de</strong><br />
l’offre (service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises) et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable dans un<br />
souci <strong>de</strong> pérennisation.<br />
Ainsi, il a été mis en place <strong>de</strong>s prestataires dont le processus <strong>de</strong> sélection est basé sur <strong>de</strong>s<br />
critères objectifs.<br />
Le Prestataire d’appui non-financier est Consultant professionnel indépendant ou<br />
groupe <strong>de</strong> consultants (Bureau d’étu<strong>de</strong>, cabinet, associations, structures <strong>de</strong> formation..)<br />
spécialisé dans la fourniture <strong>de</strong> service <strong>de</strong> conseils d’entreprises (information, diagnostic,<br />
accompagnement, suivi,...) ; formation (technique, gestion, alphabétisation) ; d’appuis<br />
spécifiques (innovation commerciale, promotion commerciale, innovation technique et<br />
technologique, ..)<br />
La stratégie adoptée pour mettre en place l’Offre est l’I<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s PSNF à l’ai<strong>de</strong><br />
d’une fiche contenant les informations comme : Profil <strong>du</strong> prestataire (Cabinet / Institution<br />
<strong>de</strong> formation spécialisée / Consultant Indépendant, raison sociale, adresse, contacts, forme<br />
juridique, numéro registre <strong>de</strong> commerce, Ressources humaines, Ressources physiques,<br />
expériences, Références. La Présélection <strong>de</strong>s PSNF par une Commission Technique à<br />
l’ai<strong>de</strong> d’une Grille, la Sélection <strong>de</strong>s PSNF par un comité composé <strong>du</strong> BIT et <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong> à l’ai<strong>de</strong> d’un gui<strong>de</strong>. Les critères <strong>de</strong> sélections sont basés sur le niveau é<strong>du</strong>cation<br />
minimum, expériences en gestion/création d'entreprise, compréhension <strong>de</strong>s étapes <strong>de</strong><br />
création et <strong>de</strong> gestion d'entreprise, activités <strong>de</strong> formation réalisées, motivation et<br />
disponibilité, capacité <strong>de</strong> prise d'initiatives.<br />
Formation <strong>de</strong>s Formateurs, elle est dispensée les maitres-formateurs <strong>du</strong> BIT pour<br />
pouvoir accompagner les PIE et MPER par le bais <strong>de</strong> formations en Germe niveau 1,<br />
Germe classique et TRIE/CREE et suivi. Ils ensuite coachés par jusqu’à la certification.<br />
Les PSNF sont aussi formés en technique <strong>de</strong> diagnostic afin <strong>de</strong> pouvoir con<strong>du</strong>ire<br />
efficacement les diagnostics d’entreprises, étapes clé <strong>du</strong> dispositif d’accompagnement <strong>de</strong>s<br />
MPER<br />
Certains PSNF sont renforcés dans <strong>de</strong>s domaines spécifiques comme le Genre, le<br />
marketing, le contrôle <strong>de</strong> qualité et la gestion <strong>de</strong>s approvisionnements. Les formations sont<br />
con<strong>du</strong>ites par les maitres formateurs <strong>du</strong> BIT (Germe, Pacte).<br />
Des <strong>atelier</strong>s <strong>de</strong> mise à niveau sont organisés pour les PSNF afin <strong>de</strong> les informer et<br />
sensibiliser sur les filières, l’environnement <strong>de</strong>s MPER et le <strong>PROMER</strong> II<br />
Les PSNF non encore formalisés sont sensibilisés et accompagnés vers <strong>de</strong>s structures<br />
spécialisées dans ce domaine comme les chambres <strong>de</strong> commerce, d’in<strong>du</strong>strie et<br />
d’agriculture, les centres <strong>de</strong> gestion agréés, les services <strong>de</strong>s impôts et domaines, les<br />
banques,…etc. La formalisation <strong>de</strong>vrait les ai<strong>de</strong>r à exercer leur métier dans la légalité et la<br />
transparence et <strong>de</strong> pouvoir postuler à <strong>de</strong>s marchés publics. Les prestataires sont ensuite<br />
suivis et renforcés annuellement par <strong>de</strong>s maîtres formateurs dans une approche qualité
Le BIT partenaire méthodologique <strong>PROMER</strong>2 a été le maître d’œuvre dans la sélection <strong>de</strong><br />
prestataires <strong>de</strong> qualité<br />
GERME, TRIE, CREE<br />
Pour améliorer <strong>de</strong> manière <strong>du</strong>rable les performances <strong>de</strong>s MPER par la formation <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs potentiels et ceux en activité. Les outils utilisés sont simples, pratiques et<br />
adaptés à la réalité et selon une démarche participative. Il s’y ajoute un outil<br />
complémentaire basé sur le jeu d’entreprise. Dans le cadre <strong>de</strong> l’adaptation <strong>de</strong>s outils aux<br />
cibles <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II, le Germe niveau 1 a été initié. Ces mo<strong>du</strong>les s’adressent aux cibles<br />
faiblement alphabétisées qui exercent <strong>de</strong>s micros activités <strong>de</strong> type AGR et souhaitent<br />
migrer vers la dynamique d’entreprise.<br />
PACTE :Partenariat pour <strong>de</strong>s Actions Concertées par <strong>de</strong>s Transferts et <strong>de</strong>s Echanges un<br />
programme <strong>de</strong> formation <strong>de</strong>stiné à renforcer les capacités <strong>de</strong>s organisations<br />
professionnelles à mieux assumer leurs rôles et responsabilités en tant que plateformes <strong>de</strong><br />
services pour les micro et petites entreprises en milieu rural. Il constitue un outil <strong>de</strong><br />
référence pour le Ministère <strong>de</strong> l’Agriculture et <strong>du</strong> Développement Rural, <strong>du</strong> Fonds<br />
International <strong>de</strong> Développement Agricole et <strong>du</strong> Bureau Sous Régional <strong>de</strong> l’OIT pour le<br />
Sahel à Dakar, qui s’efforcent d’apporter un appui dans le domaine <strong>de</strong> la formation en vue<br />
doter les organisations professionnelles d’outils et <strong>de</strong>s documents pour réaliser <strong>de</strong>s actions<br />
<strong>de</strong> formation au profit <strong>de</strong> leurs membres. PACTE est aujourd’hui développé dans plus <strong>de</strong><br />
pays dans neuf pays <strong>de</strong> la<br />
Approche méthodologique PACTE<br />
La Méthodologie PACTE repose sur une approche triangulaire en trois phases : Apprendre<br />
à mieux nous connaître ; Réfléchir ensemble sur les solutions à nos problèmes ; Agir pour<br />
progresser ensemble.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
37
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
38<br />
Cette approche triangulaire qui doit être fondamentalement participative pour créer une<br />
dynamique collective doit être maîtrisée par les formateurs conseillers PACTE et les outils<br />
doivent en tenir compte. La formation sera basée sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> et se et repose sur un<br />
package <strong>de</strong> Mo<strong>du</strong>les :<br />
Le Diagnostic<br />
La mission <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong>s MPER consiste à faire une évaluation objective <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques et fonctions <strong>de</strong>s entreprises. Elle aboutira à un plan d’action opérationnel<br />
et réaliste. En effet, l’objectif est <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à une analyse approfondie <strong>de</strong> l’entreprise à<br />
travers une analyse <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s fonctions <strong>de</strong> l’entreprise (approvisionnement,<br />
pro<strong>du</strong>ction, gestion <strong>de</strong>s ressources humaines, financement, commercialisation) et aussi <strong>de</strong><br />
l’environnement (marché, concurrence). D’une manière participative les obstacles et les<br />
pistes <strong>de</strong> solutions doivent i<strong>de</strong>ntifiées et analysées.<br />
Le suivi-accompagnement<br />
Vise à terme, la responsabilisation <strong>du</strong> MPER et son autonomie à con<strong>du</strong>ire les activités avec<br />
une intervention minimum <strong>de</strong> l'extérieur sur tous les plans. Il est amené à se sentir<br />
responsable <strong>de</strong>s réussites et <strong>de</strong>s échecs, ce qui l'incite à se former, pour progresser dans les<br />
résultats. L'autonomie <strong>de</strong> la MPER se rapporte aussi au financement <strong>de</strong>s activités. Si au<br />
départ, un soutien financier ou matériel est nécessaire pour faire décoller les activités, le<br />
suivi con<strong>du</strong>it la MPER à valoriser le soutien par l'accroissement <strong>de</strong>s bénéfices afin qu'il<br />
arrive à réinvestir dans les activités<br />
Evaluation <strong>de</strong> prestataires par un maitre formateur <strong>du</strong> BIT dans une approche qualité
Acteurs<br />
Le Bureau International <strong>du</strong> Travail (BIT), dans le cadre d’une convention <strong>de</strong><br />
partenariat, a apporté entre 2006 et Septembre 2010, un appui méthodologique dans<br />
l’application <strong>de</strong>s normes GERME pour l’acquisition d’un marché potentiellement<br />
rémunérateur au profit <strong>de</strong>s prestataires.<br />
<strong>PROMER</strong> II<br />
Il a pour mission <strong>de</strong> développer un marché pérenne et <strong>du</strong>rable <strong>de</strong> services d’appuis non<br />
financiers et financiers. La démarche consiste à i<strong>de</strong>ntifier, sélectionner et renforcer<br />
(formation en gestion, diagnostic……) les prestataires locaux afin qu’ils puissent offrir <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> qualité, accessibles aux MPER.<br />
Prestataires <strong>de</strong> service<br />
L’accompagnement technique <strong>de</strong>s Porteurs d’Initiatives Economiques (PIE) et <strong>de</strong>s MPER<br />
qui va <strong>du</strong> diagnostic <strong>de</strong> l’activité au suivi en passant par la formation et l’appui-conseil, est<br />
réalisé par <strong>de</strong>s Prestataires <strong>de</strong> Services Non Financiers (PSNF). L’objectif à la fin <strong>du</strong> projet<br />
est d’appuyer 70 à 80 prestataires <strong>de</strong> services qui doivent à leur tour accompagner 1300<br />
Micros et Petites Entreprises Rurales (MPER). Ces prestataires sont localisés dans 6<br />
régions, 12 Zones <strong>de</strong> concentration et 33 communautés rurales.<br />
MPER<br />
Elles constituent la cible principale. Ce sont les réceptacles <strong>de</strong> tous les appuis émanant <strong>de</strong>s<br />
autres acteurs.<br />
Organisation Professionnelles<br />
C’est un regroupement <strong>de</strong> personnes ou <strong>de</strong> micros entreprises rurales s’activant dans une<br />
même filière ou activité.<br />
Entre 2006 et 2010, le projet a engagé un montant <strong>de</strong> 395 446 228 F CFA pour le<br />
renforcement <strong>de</strong> capacités <strong>de</strong> 71 PSNF dont 42 Opérationnels. Pendant la même pério<strong>de</strong>,<br />
ces prestataires ont appuyé 1001 MPER à travers 313 contrats <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services<br />
pour un montant total <strong>de</strong> 274 809 320 F CFA. Les effets directs <strong>de</strong> ces appuis sur les<br />
PSNF sont : les gains <strong>de</strong>s prestataires se sont améliorés (le CA est passé <strong>de</strong> 25 187 303 F<br />
CFA en 2006 à 414 940 323 F CFA en 2010),<br />
AMELIORATION DE LA PERFORMANCE DES MPER<br />
L’une <strong>de</strong>s missions principales <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>2 est l’appui à l'émergence et au<br />
renforcement <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong> services non - financiers aux MPER par l’organisation <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et <strong>de</strong> l’offre et le développement <strong>du</strong>rable d'un marché <strong>de</strong> services d'appui adaptés<br />
aux MPER. [MPER : est une entreprise rurale qui emploie au maximum 20 personnes et a<br />
un chiffre d'affaires n'excédant pas 25 millions FCFA, pour les prestations <strong>de</strong> services et<br />
50 millions FCFA, pour les opérations <strong>de</strong> livraisons <strong>de</strong> biens. Ces entreprises<br />
correspon<strong>de</strong>nt à la catégorie <strong>de</strong>s petites entreprises telles qu'elles sont définies par la<br />
Charte <strong>de</strong>s PME <strong>du</strong> Sénégal. Si lors <strong>de</strong> l’établissement <strong>de</strong> la situation <strong>de</strong> référence<br />
préalable à l’appui <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II, la MPE existait et était en activité, alors elle sera<br />
comptabilisée comme MER consolidée au contraire s’il s’agissait d’une idée <strong>de</strong> projet,<br />
d’une initiative économique qui avec les appuis <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> est <strong>de</strong>venue une entreprise,<br />
alors elle sera comptabilisée comme MPE créée.]<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong> cette recommandation tirée <strong>de</strong>s enseignements <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>1, est<br />
basé sur le faire –faire. La démarche consiste à faire une sélection fine <strong>de</strong> prestataires<br />
locaux qui sont suffisamment outillés pour offrir <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> qualité, accessibles et<br />
pérennes aux Micro et petites Entreprises Rurales MPER.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
39
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
40<br />
En effet, l’approche qualité qui sous-tend cette démarche novatrice explique en partie les<br />
performances enregistrées par les MPER appuyés par le <strong>PROMER</strong> 2. Elles se tra<strong>du</strong>isent<br />
par une augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité et <strong>du</strong> chiffre d’affaire <strong>de</strong>s MPER.<br />
L’augmentation <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong>s MPER<br />
La disponibilité d’une offre <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> proximité a eu un effet in<strong>du</strong>it dans<br />
l’augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité <strong>de</strong>s MPER d’une part. D’abord le nombre d’emplois<br />
créés par les MPER a sensiblement augmenté il est passé d’une moyenne <strong>de</strong> 2 en 2006 à 5<br />
en 2010. Cette dimension en termes <strong>de</strong> nombre d’emplois créés et très importante pour<br />
mesurer la contribution <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>2 dans la lutte contre pauvreté en milieu rural. Car la<br />
raison d’être <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>2 est d’actionner sur <strong>de</strong>s leviers essentiellement économiques,<br />
avec l’objectif <strong>de</strong> dynamiser une croissance <strong>du</strong>rable et créatrice d’emplois en milieu rural.<br />
Ensuite le niveau d’équipement <strong>de</strong>s entreprises a beaucoup évolué. Cette évolution se<br />
tra<strong>du</strong>it aussi bien en qualité qu’en quantité sur les pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s MPER. Ce souci <strong>de</strong><br />
s’équiper et <strong>de</strong> se structurer est une nécessité pour les MPER afin <strong>de</strong> satisfaire une<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> en nette progression. La présence <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services non financiers<br />
facilite aux MPER la disponibilité d’informations utiles sur les technologies et les<br />
techniques appropriées afin d’accroitre leur pro<strong>du</strong>ctivité et la compétitive. D’autre part,<br />
cette augmentation <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ctivité se reflète par une augmentation <strong>de</strong>s chiffres d’affaire<br />
<strong>de</strong>s MPER. Par exemple le chiffre d’affaire <strong>de</strong>s 30% <strong>de</strong>s MPER a augmenté <strong>de</strong> 63% selon<br />
le rapport <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> sur l’impact <strong>de</strong>s appuis <strong>de</strong>s prestataires sur le développement <strong>de</strong>s<br />
MPER en 2010.<br />
Malgré les innovations et les avantages apportés par cette approche qui favorise<br />
l’émergence d’une offre <strong>de</strong> service <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> proximité entrainant l’augmentation <strong>de</strong><br />
la performance <strong>de</strong>s MPER, elle recèle quelques difficultés d’ordre économique et social.<br />
L’analyse <strong>de</strong>s aspects négatifs <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la performance <strong>de</strong> l’offre <strong>de</strong> service<br />
non financier <strong>de</strong> qualité et <strong>du</strong>rable a fait apparaitre <strong>de</strong>ux problématiques.<br />
D’abord, l’analphabétisme : constitue un facteur bloquant pour une appropriation correcte<br />
<strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> gestion. Autrement dit, les formations dispensées par les prestataires sont<br />
difficilement assimilées par certaines MPER à cause <strong>de</strong> leur niveau d’analphabétisme, et ce<br />
malgré tous les efforts consentis dans ce sens par le <strong>PROMER</strong> 2 avec le germe niveau 1.<br />
[Germe niveau 1 est un outil <strong>de</strong> gestion adapté aux cibles <strong>du</strong> Promer 2 faiblement<br />
alphabétisées]. Il reste établi que l’analphabétisme constitue un obstacle majeur aux projets<br />
et programmes <strong>de</strong> développement et particulièrement le <strong>PROMER</strong> 2 qui a pour mission<br />
d’ai<strong>de</strong>r les ruraux pauvres à sortir <strong>de</strong> la pauvreté dans un domaine aussi complexe qu’est<br />
l’entreprenariat rural.<br />
Ensuite, l’autre contrainte qui peut être considérée comme une limite <strong>de</strong> cette approche est<br />
relative aux difficultés pour les MPER à mobiliser <strong>de</strong>s fonds d’investissement. A ce<br />
niveau, malgré l’existence <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> crédit et <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> garantie, la majeure partie<br />
<strong>de</strong>s SFD rechignent a financé <strong>de</strong>s crédits d’investissement aux MPER. Cette situation est<br />
d’autant plus inquiétante pour les MPER qui ne sont pas accompagnés par les projets <strong>de</strong><br />
développement. Ce comportement s’explique <strong>du</strong> fait que les MPER sont confrontés à <strong>de</strong>s<br />
problèmes pour mobiliser une garantie en vue <strong>de</strong> prétendre à <strong>de</strong>s montants importants<br />
<strong>de</strong>stinés à l’investissement <strong>de</strong> leurs entreprises. Or, le crédit d’investissement est essentiel<br />
pour le développement <strong>de</strong> l’entreprenariat en milieu rural, car une entreprise ne se<br />
développe pas uniquement avec <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> roulement.<br />
Les effets en direction <strong>de</strong>s MPER peuvent se lire à travers un accès amélioré à<br />
l’information Technique Economique et Commerciale, une amélioration <strong>de</strong> la performance<br />
(chiffre d’affaire a évolué <strong>de</strong> 63%), un développement <strong>de</strong> la culture entrepreneuriale et un<br />
accès plus facile au financement (371 Dossiers, pour un montant <strong>de</strong> 294 457 172 F CFA).
Formation <strong>de</strong> qualité = pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> qualité<br />
COMPETITIVITE<br />
La compétitivité <strong>de</strong>s MPER correspond ici à la capacité <strong>de</strong>s MPER à satisfaire aussi bien<br />
en qualité qu’en quantité au marché local et national. Cet acquis est le résultat <strong>de</strong> la<br />
conjugaison <strong>de</strong> plusieurs facteurs combinés dont essentiel l’appui conseil et<br />
accompagnement qu’elles bénéficient auprès <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> service non-financiers.<br />
En effet avant l’avènement <strong>du</strong> Promer II Les MPER rurales n’exploitent toutes les<br />
opportunités <strong>de</strong> marché. Cette situation était liée pour une plus gran<strong>de</strong> partie <strong>du</strong> fait <strong>du</strong><br />
niveau d’équipement <strong>de</strong>s MPER très artisanal incapable <strong>de</strong> satisfaire la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au niveau<br />
local. Le Promer II à travers sa stratégie d’appui basé sur le triptyque formation,<br />
financement et suivi a su renverser la tendance en favorisant la création et/ou la<br />
consolidation <strong>de</strong> véritables MPER capables <strong>de</strong> respecter les normes en matière <strong>de</strong> qualité<br />
et d’hygiène.<br />
Cette nouvelle donne a poussé le Promer II à s’attaché <strong>de</strong>s service <strong>de</strong> spécialiste en<br />
commercialisation et en marketing pour mieux i<strong>de</strong>ntifier toutes les opportunités en partant<br />
d’une analyse <strong>de</strong>s différents marchés et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> afin d’ai<strong>de</strong>r les PMER à<br />
commercialiser leur offre (pro<strong>du</strong>it, service) mais également à mettre en place les circuits <strong>de</strong><br />
distribution pour atteindre ces marchés .<br />
Accès aux marchés (proximité et autres régions)<br />
Si les marchés ruraux paraissent moins porteurs <strong>du</strong> fait d’un pouvoir d’achat plus bas qu’en<br />
milieu urbain et d’un niveau <strong>de</strong> consommation (biens et services) globalement plus faibles,<br />
ils ne doivent cependant pas être négligés. On peut distinguer <strong>de</strong> manière très schématique<br />
<strong>de</strong>ux cas <strong>de</strong> figure :<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
41
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
42<br />
Marchés ruraux <strong>de</strong> proximité: boulangerie, matériels agricoles et agroalimentaires, services<br />
pour les MPER (approvisionnement en intrants, commercialisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its);<br />
Marchés ruraux plus éloignés: pro<strong>du</strong>its spécifiques d’une région consommés sur<br />
l’ensemble <strong>du</strong> territoire (exemple poisson fumé <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction en bor<strong>du</strong>re <strong>de</strong><br />
MPER vers l’intérieur <strong>du</strong> pays, pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> la Casamance tels que l’huile <strong>de</strong> palme, le<br />
nététou).<br />
Ces marchés sont les plus accessibles dans un premier temps aux MPER. Ils leur<br />
permettent <strong>de</strong> tester leurs offres <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its et leurs capacités commerciales, et <strong>de</strong> les<br />
améliorer progressivement, en mettant en valeur leurs avantages comparatifs par rapport à<br />
<strong>de</strong>s MPE urbaines qui ne disposent pas aussi facilement <strong>de</strong> la matière première et <strong>du</strong><br />
savoir-faire.<br />
Des marchés urbains en croissance<br />
Le secteur <strong>de</strong>s MPER, notamment dans l’agroalimentaire apparaît bien actuellement<br />
comme le secteur capable d’alimenter les citadins en pro<strong>du</strong>its locaux <strong>de</strong> qualité, à un prix<br />
accessible à une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> la population urbaine (surtout villes secondaires et<br />
Dakar). Il s’agit soit <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> substitution aux pro<strong>du</strong>its importés (confitures, sirops,<br />
fromages, etc.) soit <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its spécifiques au marché sénégalais (jus <strong>de</strong> bissap et <strong>de</strong><br />
tamarin, pro<strong>du</strong>its roulés, couscous, arraw, farine infantile à base <strong>de</strong> mil, poissons séchés,<br />
pro<strong>du</strong>its laitiers frais, etc.). Les entreprises rurales sont en passe <strong>de</strong> gagner le défi <strong>de</strong><br />
l’adaptation <strong>de</strong> leur offre <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its aux exigences <strong>de</strong>s marchés en terme <strong>de</strong> présentation<br />
<strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its (emballage), <strong>de</strong> conservation (afin <strong>de</strong> pouvoir transporter les pro<strong>du</strong>its sur <strong>de</strong><br />
longues distances et les stocker dans les circuits <strong>de</strong> distribution), <strong>de</strong> quantité (en<br />
envisageant soit l’accroissement <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction, soit la mise en commun <strong>de</strong> leur offre) et<br />
en terme <strong>de</strong> qualité (tant sanitaire qu’organoleptique) et mettre en place les circuits <strong>de</strong><br />
distribution (en s’insérant notamment dans les réseaux existants en ville).<br />
Aussi L’artisanat utilitaire (lit, panier, meubles, menuiserie métallique) peut également<br />
trouver <strong>de</strong>s débouchés au niveau <strong>de</strong>s marchés urbains, mais la concurrence est parfois forte<br />
avec <strong>de</strong>s unités artisanales installées en ville, bénéficiant d’équipements et ayant accès à<br />
l’électricité (encore limité en milieu rural). Les MPER ont un avantage comparatif pour les<br />
pro<strong>du</strong>its dont la matière première est rurale (rônier) ou qui nécessitent un savoir-faire<br />
spécifique (teinture naturelle). Pour atteindre ces marchés, les MPER n’ont pas toujours les<br />
informations nécessaires sur la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s consommateurs et sur les circuits <strong>de</strong><br />
distribution et la force <strong>de</strong> vente nécessaire. Des MPER <strong>de</strong> commercialisation pourraient<br />
faciliter la connexion entre les unités <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction rurales et les marchés <strong>de</strong><br />
consommation en vendant directement les pro<strong>du</strong>its en milieu urbain ou dans les circuits <strong>de</strong><br />
distribution existants.<br />
Toutefois, ces acquis obtenus grâce à l’intervention <strong>du</strong> Promer II, <strong>de</strong>meurent très fragiles à<br />
cause <strong>de</strong> l’environnement économique marqué par une concurrence redoutable et très<br />
évolutif.<br />
DURABILITE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE<br />
La <strong>du</strong>rabilité <strong>de</strong> l’offre et <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> se mesure à travers la participation <strong>de</strong>s MPER aux<br />
couts <strong>de</strong>s prestations et l’accès au marché par les prestataires.<br />
L’état <strong>de</strong>s lieux montre une faible participation <strong>de</strong>s MPER aux couts <strong>de</strong>s prestations. Avant<br />
la revue à mi parcours, le projet n’avait réalisé aucune activité <strong>de</strong> suivi accompagnement<br />
parce que les MPER <strong>de</strong>vaient participer au cout à hauteur <strong>de</strong> 33% la 1 ère année, 66% la 2 ème<br />
année et 100% la troisième année. C’est quand la mission <strong>du</strong> FIDA a ren<strong>du</strong> gratuit le suivi<br />
accompagnement pour la 1 ère que l’activité a pu démarrer. En tout état <strong>de</strong> cause, le<br />
paiement <strong>du</strong> service surtout pour la 1ère fois est inhérent à la qualité <strong>de</strong>s prestations<br />
fournies et donc à la capacité <strong>du</strong> prestataire à développer l’activité <strong>de</strong> l’entreprise. Les
MPER interrogées disent qu’ils n’hésiteraient pas à payer le service si elles y voient leur<br />
intérêt. Une MPER comme Sira Fofana elle dit qu’elle est prête à payer le service parce<br />
que cela lui permet <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>r le contact avec le <strong>PROMER</strong> et une meilleure prise en charge<br />
<strong>de</strong>s ces préoccupations en terme <strong>de</strong> besoins en formations, d’emballage à travers le<br />
prestataire qui l’accompagne. Quelqu’un comme Wassa Senghor <strong>de</strong> Dassilamé Socé qui<br />
s’active dans la transformation <strong>de</strong> noix <strong>de</strong> cajou dit qu’il est prêt à payer le service pourvu<br />
que l’expertise lui permet <strong>de</strong> développer son activité. Boubacar Keita, MPER boulanger<br />
<strong>de</strong> Tambacounda, dit qu’il est prêt à mettre la main à la poche pour payer le service même<br />
après la fin <strong>du</strong> projet car « le suivi accompagnement permet à la MPER d’appliquer les<br />
règles <strong>de</strong> comptabilité et les normes d’hygiène et <strong>de</strong> qualité ». Pour rendre le service<br />
pérenne il faut Renforcer les compétences techniques et institutionnelles <strong>de</strong>s prestataires et<br />
Stimuler le marché par <strong>de</strong>s subventions temporaires. A ce niveau le <strong>PROMER</strong> II, sur<br />
recommandation <strong>de</strong> la revue à mi parcours a considéré ses prestataires comme <strong>de</strong>s MPER,<br />
donc ces <strong>de</strong>rniers peuvent bénéficier <strong>de</strong> financement pour l’équipement.<br />
Le chiffre d’affaire global <strong>de</strong>s 71 prestataires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II a évolué <strong>de</strong> 25 187 303 F<br />
CFA en 2006 à 414 940 223 F CFA en 2010.<br />
CONCLUSION<br />
Durabilité <strong>de</strong> l’offre face à une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> solvable<br />
La disponibilité d’une offre <strong>de</strong> Service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises en milieu rural <strong>de</strong><br />
qualité peut garantir l’émergence et la viabilité <strong>de</strong>s micros et petites entreprises créées ou<br />
consolidées. Toutefois, pour assurer la pérennité <strong>de</strong> ce service, il faut à tout moment<br />
adapter les mo<strong>du</strong>les <strong>de</strong> formation au contexte et aux cibles. Ceci est d’autant plus<br />
important dans un contexte <strong>de</strong> développement rural où la plus part <strong>de</strong>s cibles sont<br />
analphabètes d’où la pertinence et la nécessité <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong>s réalités socioculturelles<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
43
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
44<br />
<strong>de</strong>s populations bénéficiaires. L’expérience qu’on pourrait tirer <strong>de</strong> l’émergence d’un<br />
marché <strong>de</strong> service <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s entreprises en milieu rural à l’instar <strong>de</strong> celle <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong>2 est le fait d’avoir <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services non financiers capables d’adapter<br />
les outils et les métho<strong>de</strong>s classiques d’accompagnement et d’appui aux réalités et<br />
préoccupations <strong>de</strong>s MPER.<br />
Les prestataires doivent sans cesse renforcer leurs compétences et chercher à diversifier<br />
leur marché marqué par une concurrence redoutable pour répondre efficacement aux<br />
besoins actuels et nouveaux <strong>de</strong>s entreprises.<br />
Le Germe niveau 1 constitue une innovation certe salutaire dans la prise en compte <strong>de</strong>s<br />
cibles analphabètes dans une approche inclusive.<br />
Cependant, il gagnerait en efficacité à être tra<strong>du</strong>it en langues locales pour<br />
l’accompagnement <strong>de</strong>s cibles analphabètes.
TEXTE 3 : MICRO ET PETITES ENTREPRISES RURALES<br />
Quand le partage <strong>de</strong>s risques garantit un accès <strong>du</strong>rable au crédit<br />
La caution solidaire couplée au partage <strong>de</strong>s risques facilite l’accès <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs ruraux à <strong>de</strong>s services financiers adaptés et garantit la sécurité <strong>du</strong><br />
portefeuille <strong>de</strong> prêts constitué. Dans l’expérience <strong>du</strong> Service d’Appui à la Finance<br />
rurale (SAFIR) <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, près <strong>de</strong> 700 micro-entrepreneurs ruraux, <strong>de</strong><br />
Tambacounda et <strong>de</strong> Thiénaba, ont bénéficié <strong>de</strong> l’accès au financement pour plus <strong>de</strong><br />
58 millions <strong>de</strong> francs CFA. Le taux <strong>de</strong> remboursement, <strong>de</strong> plus 98%, montre la bonne<br />
santé <strong>du</strong> portefeuille.<br />
La structure financière <strong>de</strong>s micros et petites entreprises rurales (MPER) bénéficiaires <strong>du</strong><br />
Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural phase 2 « <strong>PROMER</strong> II » se caractérise par<br />
une faiblesse <strong>de</strong> leur patrimoine (biens meubles, immeubles, etc….). Ceci rend<br />
problématique la prise en charge effective <strong>de</strong> leurs besoins en investissement et en fonds <strong>de</strong><br />
roulement, <strong>de</strong>ux leviers indispensables à leur développement. En effet, les difficultés que<br />
ces entreprises ont à présenter <strong>de</strong>s garanties matérielles font que leur fourniture en services<br />
financiers comporte <strong>de</strong>s risques élevés selon les Institutions Financières.<br />
Cette situation a incité la composante Service d’Appui à la Finance Rurale « SAFIR » <strong>du</strong><br />
<strong>PROMER</strong> II à initier <strong>de</strong>s stratégies qui visent la résolution globale <strong>du</strong> problème. Il s’agit<br />
entre autres ; <strong>de</strong> favoriser une relation <strong>du</strong>rable fondée sur un partenariat entre <strong>de</strong>ux parties<br />
qui s’articule autour <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong> confiance.<br />
Nous rappelons que pour permettre l’accès <strong>de</strong>s MPER au financement, le SAFIR s’appuie<br />
sur cinq (05) Systèmes Financiers Décentralisés « SFD » partenaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II,<br />
bénéficiant <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong> la Banque Ouest Africaine <strong>de</strong> Développement<br />
« BOAD » d’un montant d’un milliard (1.000.000.000) <strong>de</strong> F CFA. Ces SFD qui sont;<br />
l’UIMCEC, l’URMECS, la CAURIE-MF, le CPS/ ASACASE et la MEC Dimbalante<br />
constituent en outres, les domiciles financiers les mieux indiqués pour ces micros et petites<br />
entreprises.<br />
Dés lors, le partenariat « SFD/MPER » qui sous tend l’implication <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II,<br />
s’appuie sur une vision commune par laquelle chaque partie milite pour un accès sécurisé<br />
et <strong>du</strong>rable au financement grâce à un partage concerté <strong>de</strong>s risques financiers. Cette<br />
démarche pose comme postulat, l’organisation <strong>de</strong>s MPER en groupes homogènes et<br />
solidaires, représentant <strong>de</strong>s interlocuteurs crédibles <strong>de</strong>s SFD.<br />
Le partenariat tripartite « Groupes <strong>de</strong> MPER/SFD/<strong>PROMER</strong> II » qui en découle pose les<br />
jalons <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques guidé par la responsabilité que chacun <strong>de</strong>s trois assume dans<br />
une perspective <strong>de</strong> sécurisation <strong>de</strong>s prêts. Dans ses principes <strong>de</strong> base et ses modalités <strong>de</strong><br />
fonctionnement, ce partenariat révèle <strong>de</strong>s innovations. En effet, les termes <strong>de</strong> la<br />
participation <strong>de</strong> chaque partie (<strong>PROMER</strong> II, SFD ou Groupe <strong>de</strong> MPER) au risque global et<br />
la responsabilité indivi<strong>du</strong>elle <strong>de</strong>s MPER à la sécurisation <strong>de</strong>s prêts en sont la parfaite<br />
illustration.<br />
En d’autres termes, la notion <strong>de</strong> « caution solidaire » couplée au « partage <strong>de</strong>s risques » tel<br />
que circonscrit dans les différentes conventions (SFD/<strong>PROMER</strong> II et Groupe <strong>de</strong> Caution<br />
<strong>de</strong>s MPER /SFD) marque une véritable avancée dans le financement <strong>de</strong>s MPER.<br />
L’objectif visé est <strong>de</strong> faciliter « l’Accès <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux à <strong>de</strong>s services<br />
financiers adaptés » et <strong>de</strong> garantir « la sécurité <strong>du</strong> portefeuille <strong>de</strong> prêts constitué ».<br />
A ce jour, le SAFIR a favorisé la signature et la mise en œuvre <strong>de</strong>s conventions (03 en<br />
cours et 03 en finalisation) qui ont permis à une masse critique <strong>de</strong> MPER (700) d’accé<strong>de</strong>r<br />
au financement <strong>de</strong> leurs activités.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
45
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
46<br />
Dans ce document, nous allons procé<strong>de</strong>r à une <strong>de</strong>scription <strong>de</strong> la stratégie <strong>du</strong> « partage <strong>de</strong>s<br />
risques, et analyser en quoi il représente un outil <strong>de</strong> facilitation <strong>de</strong> l’accès au crédit ».<br />
Nous ferons ensuite une économie <strong>de</strong>s conventions mises en œuvre en mettant le focus sur<br />
le cas <strong>de</strong>s boulangers <strong>de</strong> la Région <strong>de</strong> Tambacounda. Enfin, nous terminerons avec <strong>de</strong>s<br />
points d’apprentissage sous formes d’analyse <strong>de</strong>s points positifs retenus et les limites<br />
révélées lors <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong>s ces conventions.<br />
STRATEGIE DU PARTAGE DES RISQUES :<br />
Le partage <strong>de</strong>s risques est une stratégie globale dans laquelle chaque acteur tient un rôle<br />
bien déterminé. La réussite <strong>de</strong> sa mise en œuvre dépend <strong>de</strong> la définition <strong>de</strong> certains<br />
préalables qui en constituent les principes <strong>de</strong> base.<br />
Dans le cas <strong>de</strong>s conventions jusqu’ici mises en œuvre, nous avons <strong>de</strong>s partenariats animés<br />
par trois (03) principaux acteurs qui sont : le <strong>PROMER</strong> II, le SFD partenaire <strong>du</strong> SAFIR et<br />
le groupe <strong>de</strong> caution.<br />
Le <strong>PROMER</strong> II qui avec son dispositif d’intervention constitué <strong>de</strong> ses composantes, ses<br />
Prestataires <strong>de</strong> Services Non Financiers et ses partenaires techniques et financiers, met à la<br />
disposition <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong>s appuis pour un renforcement <strong>de</strong> leurs capacités. Dans le<br />
cadre <strong>de</strong> la stratégie <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques, le <strong>PROMER</strong> II met en place un fonds <strong>de</strong><br />
garantie chargé <strong>de</strong> couvrir 50 à 75% <strong>de</strong>s créances irrécouvrables (prêts à plus <strong>de</strong> 12 mois<br />
<strong>de</strong> retard <strong>de</strong> remboursement) issue <strong>du</strong> portefeuille constitué grâce à la ligne <strong>de</strong> crédit<br />
« BOAD ».<br />
Le SFD partenaire <strong>du</strong> projet bénéficie d’un appui financier grâce à la ligne <strong>de</strong> crédit. Il<br />
est le domicile financier <strong>du</strong> groupe <strong>de</strong> caution avec lequel il signe une convention <strong>de</strong><br />
partenariat. Il a pour rôle d’instruire les dossiers <strong>de</strong> financement, d’accor<strong>de</strong>r les prêts aux<br />
bénéficiaires, <strong>de</strong> les suivre et <strong>de</strong> gérer les fonds logés dans ses comptes. Pour l’instant,<br />
seuls l’UIMCEC et l’URMECS sont concernés. Dans le cadre <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques, le<br />
SFD partenaire <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II accor<strong>de</strong> au groupe <strong>de</strong> cautions <strong>de</strong>s dérogations concernant<br />
certaines dispositions qui constituent <strong>de</strong> réels blocages d’accès au prêt. Ce sont par<br />
exemple ; le délai d’attente obligatoire, le taux d’intérêt, la prise <strong>de</strong> garantie etc…<br />
Le Groupe <strong>de</strong> caution regroupe <strong>de</strong>s MPER bénéficiaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II. Ils sont clients<br />
<strong>de</strong>s SFD partenaires <strong>du</strong> projet. Le groupe dont les conditions <strong>de</strong> mise en place sont définies<br />
ci-après apporte sa caution solidaire à la MPER débitrice. Il est représenté par un bureau<br />
qui est signataire <strong>de</strong> la convention avec le SFD. C’est le bureau qui agréé les requêtes <strong>de</strong><br />
financement émises par les MPER et appuie les SFD dans le recouvrement <strong>de</strong>s prêts en<br />
retard.<br />
Le Groupe <strong>de</strong> caution établit une charte d’adhésion aux MPER, définit <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong><br />
cautionnement solidaire et mobilise un fonds <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong>stiné à couvrir une partie <strong>de</strong>s<br />
créances malsaines <strong>du</strong> portefeuille (le niveau <strong>de</strong> couverture sera défini dans la convention<br />
qui lie le groupe au SFD).<br />
Principes <strong>de</strong> base <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques<br />
Le groupe <strong>de</strong> caution est fondé sur le cautionnement solidaire qui a, un peu partout dans le<br />
mon<strong>de</strong>, permis aux couches <strong>de</strong>s populations démunies d'avoir accès aux services<br />
financiers. Le manque <strong>de</strong> biens réels à offrir comme garantie, les coûts <strong>de</strong> transaction<br />
liés à la mise en place <strong>du</strong> financement et les risques très élevés <strong>de</strong>s prêts ont toujours été<br />
les facteurs principaux qui expliquent l'exclusion <strong>de</strong>s pauvres <strong>du</strong> marché financier.<br />
Les Institutions Financières ont toujours trouvé l'offre <strong>de</strong> services aux démunis<br />
incompatible avec leur exigence <strong>de</strong> viabilité. Se basant sur le principe <strong>de</strong> la solidarité et <strong>de</strong><br />
l'ai<strong>de</strong> réciproque, le cautionnement solidaire a rapproché les institutions financières et leurs<br />
clients. Il a été une alternative à l’absence <strong>de</strong> biens réels à constituer en garantie pour
sécuriser les financements. C’est en quelque sorte, le moyen trouvé par les Institutions <strong>de</strong><br />
Micro Finance pour instaurer la confiance entre elles et leurs clientèles pauvres.<br />
Le Cautionnement solidaire ce caractérise par l’existence d’un groupe homogène et<br />
organisé. Au sein <strong>de</strong> ce groupe, la connaissance personnelle et réciproque <strong>de</strong>s membres est<br />
un élément central. Dans le cadre <strong>du</strong> cautionnement solidaire, les <strong>de</strong>ttes contractées relève<br />
<strong>de</strong> la responsabilité morale <strong>du</strong> groupe qui exerce une pression sociale sur tout membre<br />
bénéficiant d’un prêt.<br />
Le Fonds <strong>de</strong> garantie ; moyen <strong>de</strong> partage <strong>du</strong> risque<br />
Pour être efficace le cautionnement solidaire implique la possibilité <strong>de</strong> pénalités<br />
financières en cas <strong>de</strong> défaillance telle que le non remboursement <strong>de</strong>s prêts. C’est pourquoi,<br />
un fonds <strong>de</strong> garantie a été mis en place Ce fonds <strong>de</strong> garantie constitué par les membres est<br />
<strong>de</strong>stiné à couvrir une partie <strong>de</strong>s créances malsaines. C’est le moyen <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques<br />
détenu par le groupe <strong>de</strong> caution.<br />
Les fonds <strong>de</strong> garantie sont souvent considérés comme <strong>de</strong>s réserves d’argent<br />
démobilisatrices. Les cas <strong>de</strong> dilapidation <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> garantie sont monnaie<br />
courante. Mais il est admis que leur bon fonctionnement nécessite qu’ils s’inscrivent dans<br />
le cadre d’une convention qui indique une gestion cohérente, transparente et collégiale.<br />
Le fonds <strong>de</strong> garantie constitué en compte à terme sera mobilisé selon <strong>de</strong>s modalités<br />
définies dans la convention qui défini en outres, le taux d’intérêt, les types <strong>de</strong> crédits qui y<br />
seront adossés.<br />
Des conventions mises en œuvre : Cas <strong>de</strong> l’Organisation <strong>de</strong>s Boulangers Traditionnels<br />
<strong>de</strong> Tambacounda.<br />
La stratégie <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques initiée par le groupe <strong>de</strong> caution constitué par les<br />
membres <strong>de</strong> l’Organisation Professionnelle <strong>de</strong>s boulangers traditionnels <strong>de</strong> la Région <strong>de</strong><br />
Tambacounda a été une réponse à la crise qui les opposait à l’UIMCEC. En effet, les<br />
relations entre l’Institution et les membres <strong>de</strong> l’OP se sont fortement détériorées suite au<br />
mauvais dénouement <strong>du</strong> financement collectif mis en place en août 2007. Les sept millions<br />
(7.000.000) <strong>de</strong> francs CFA octroyés à 42 MPER boulangers n’ont été remboursés qu’après<br />
avoir été basculés en créances abandonnées (soit plus <strong>de</strong> 12 mois <strong>de</strong> retard).<br />
Après régularisation <strong>de</strong> la situation, le SAFIR a invité les différentes parties (OP, SFD et<br />
Antenne Sud Est <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II) à réfléchir sur les causes <strong>de</strong> cette déconvenue.<br />
Globalement, les défaillances étaient imputables à un vaste détournement d’objet <strong>du</strong> prêt et<br />
à un suivi inapproprié <strong>de</strong>s débiteurs. Il fallait rapi<strong>de</strong>ment remédier à cette situation afin <strong>de</strong><br />
permettre aux MPER d’accé<strong>de</strong>r au financement pour mener à bien leurs activités.<br />
Mais le SFD n’était plus dans les dispositions <strong>de</strong> recon<strong>du</strong>ire le financement dans les<br />
mêmes termes <strong>du</strong> dossier précé<strong>de</strong>nt. Le SAFIR dont l’objectif est <strong>de</strong> faciliter l’accès<br />
<strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s MPER aux services financiers proposa le partage <strong>de</strong>s risques entre l’Institution<br />
et l’OP avec une implication <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II via le fonds <strong>de</strong> garantie <strong>de</strong> la ligne <strong>de</strong> crédit.<br />
Cette démarche marquait une rupture avec ce qui se passé<br />
La participation <strong>de</strong> l’OP au risque encouru par les financements à venir supposait<br />
l’organisation <strong>de</strong> ses membres en groupe <strong>de</strong> caution. Les financements se feraient donc<br />
dans le cadre d’une convention signée entre le SFD et le groupe <strong>de</strong> caution. Cette<br />
convention définissait les dispositions spécifiques <strong>de</strong> mise en place et <strong>de</strong> gestion <strong>du</strong> prêt.<br />
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong>s conditions liées à la notion <strong>de</strong> cautionnement solidaire qui le fon<strong>de</strong>, la<br />
constitution <strong>du</strong> groupe <strong>de</strong> caution <strong>de</strong>s boulangers <strong>de</strong> la Région <strong>de</strong> Tambacounda a respecté<br />
les dispositions bien précises. En effet, le groupe a procédé à l’ouverture d’un compte<br />
collectif au niveau <strong>de</strong> l’UIMCEC et à exhorté les MPER membres à en faire autant. Un<br />
fonds <strong>de</strong> garantie y a été logé avec la participation <strong>de</strong> chaque MPER.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
47
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
48<br />
La mobilisation <strong>du</strong> fonds <strong>de</strong> garantie qui répond aux dispositions définies dans la<br />
convention signée par les <strong>de</strong>ux parties se fera selon le niveau d’engagement <strong>de</strong>s MPER. Le<br />
groupe apporte sa caution morale aux débiteurs. La convention « Groupe <strong>de</strong> caution /<br />
SFD » qui intègre la convention « refinancement/ Fonds <strong>de</strong> garantie» liant le <strong>PROMER</strong> II<br />
avec ledit SFD,<br />
Conditions d’accès aux financements <strong>de</strong>s membres.<br />
Pour avoir accès au crédit, les MPER doivent auparavant être partenaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II<br />
et être membres <strong>du</strong> SFD. Ils doivent en outres bénéficier <strong>de</strong>s appuis préalables (pré<br />
diagnostic et diagnostic) et adhérer au groupe selon les conditions définies. Leurs requêtes<br />
<strong>de</strong> financement doivent être validés et les besoins financiers justifiés.<br />
La validation <strong>de</strong> la requête <strong>de</strong> financement par le bureau <strong>du</strong> groupe matérialisée par un<br />
accréditif représente une étape très importante. Et ceci constitue une innovation car étant le<br />
premier niveau <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la pertinence <strong>de</strong> la requête effectué. C’est aussi, les premiers<br />
jalons d’une participation à la sécurisation <strong>du</strong> crédit et <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques. La validation<br />
<strong>de</strong> la requête par le bureau équivaut donc à la caution que le groupe apporte à la MPER<br />
membre conformément aux modalités <strong>de</strong> cautionnement solidaire.<br />
Mise en place et gestion <strong>du</strong> financement.<br />
Après l’accord <strong>du</strong> dossier <strong>de</strong> prêt par le Comité <strong>de</strong> crédit <strong>du</strong> SFD, la MPER informée, se<br />
rend au guichet <strong>du</strong> SFD, signe un contrat <strong>de</strong> prêt indivi<strong>du</strong>el et s’acquitte <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong><br />
dossier. Le prêt sera viré dans le compte pour assurer la traçabilité <strong>de</strong>s fonds et la<br />
responsabilisation indivi<strong>du</strong>elle <strong>de</strong> la MPER. Celle-ci est entièrement responsable <strong>de</strong>s<br />
remboursements et ne bénéficiera <strong>de</strong> la caution qu’en cas <strong>de</strong> défaillance <strong>de</strong> remboursement<br />
avérée. Le fonds <strong>de</strong> garantie sera alors mobilisé selon les dispositions prévues dans la<br />
convention (couverture d’une partie <strong>de</strong>s prêts en retard entre 03 et 12 mois).<br />
La stratégie qui consiste à faciliter l’accès aux crédits <strong>de</strong>s MPER par le biais <strong>de</strong> leurs<br />
groupes <strong>de</strong> caution gagne <strong>de</strong> plus en plus en pertinence compte tenu <strong>de</strong>s résultats<br />
enregistrés. A ce sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>du</strong> programme « Accès aux services financiers »,<br />
<strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II, trois (03) conventions signées entre <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> caution et <strong>de</strong>s SFD<br />
partenaires <strong>du</strong> projet (01 à Tambacounda, 01 à Kaolack et 01 à Thiénaba).<br />
Pour le cas <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Tambacounda, le financement <strong>de</strong>s boulangers traditionnel est<br />
<strong>de</strong>venu une réalité. Le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’OP Boubacar Keîta se félicite <strong>du</strong> dénouement<br />
globalement heureux <strong>du</strong> premier cycle <strong>de</strong> financement pour une enveloppe globale <strong>de</strong> prés<br />
<strong>de</strong> huit millions (8.000.000) F CFA. La satisfaction <strong>du</strong> groupe rési<strong>de</strong> surtout dans la<br />
possibilité qui lui est offerte <strong>de</strong> négocier directement l’accès <strong>de</strong>s membres aux services<br />
financiers.<br />
Trois (03) autres conventions sont en cours <strong>de</strong> finalisation (02 à Thiénaba et 01 à<br />
Tambacounda). Ceci tra<strong>du</strong>it un engouement certain <strong>de</strong>s MPER bénéficiaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong><br />
II mais aussi l’adhésion <strong>de</strong>s Systèmes Financiers Décentralisés à la démarche.<br />
Grâce à la démarche, près <strong>de</strong> six cent quatre vingt treize personnes (693) ont vu leur accès<br />
au financement facilité. Le montant <strong>de</strong> l’enveloppe qui leur a été octroyé est égal à<br />
cinquante huit millions <strong>de</strong>ux cent mille francs (58.200.000 FCFA). L’intérêt <strong>de</strong> la<br />
démarche rési<strong>de</strong> aussi dans le fait que les populations les plus vulnérables peuvent accé<strong>de</strong>r<br />
au financement. Par exemple, 93% <strong>de</strong>s MPER constitués en groupe <strong>de</strong> caution et<br />
bénéficiaires <strong>de</strong>s prêts sont <strong>de</strong>s femmes.
Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> ce chiffre, c’est la qualité <strong>du</strong> portefeuille qui constitue un motif <strong>de</strong> satisfaction<br />
négligeable. Globalement, le taux <strong>de</strong> remboursement affiché est <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 98% pour un<br />
taux <strong>de</strong> portefeuille à risque à plus <strong>de</strong> 90 jours quasi nul.<br />
Du point <strong>de</strong> vue <strong>de</strong> l’organisation <strong>du</strong> groupe, la participation <strong>de</strong>s différents acteurs au<br />
risque encouru lors <strong>de</strong> la mise en place <strong>de</strong>s prêts milite en faveur <strong>de</strong> l’instauration <strong>de</strong> la<br />
confiance. La responsabilisation indivi<strong>du</strong>elle <strong>de</strong>s MPER débiteurs qui consentent à<br />
participer au risque favorise la <strong>du</strong>rabilité <strong>du</strong> dispositif et la sécurisation <strong>de</strong>s financements.<br />
Toutefois, la mise en œuvre <strong>de</strong> la stratégie <strong>du</strong> partage <strong>de</strong>s risques par le trio <strong>PROMER</strong> II/<br />
SFD/ Groupes <strong>de</strong> caution, présente <strong>de</strong>s points d’apprentissage. En effet, il se pose la<br />
problématique <strong>du</strong> manque d’implication <strong>de</strong> la majorité <strong>de</strong>s membres à la vie <strong>du</strong> groupe. A<br />
cela s’ajoute les difficultés liées à la bonne circulation <strong>de</strong> l’information. Enfin, les relations<br />
SFD/ Groupes <strong>de</strong> caution s’inscrivent dans un environnement <strong>de</strong> différence <strong>de</strong> niveau <strong>de</strong><br />
capacités techniques. C’est-à-dire que la gestion <strong>du</strong> partenariat n’est pas réalisée avec un<br />
même niveau d’appréciation.<br />
CONCLUSION<br />
Le partage <strong>de</strong> risques comme outil <strong>de</strong> facilitation <strong>de</strong> l’accès au crédit <strong>de</strong>s MPER<br />
bénéficiaires <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> II est une démarche qu’il s’avère nécessaire <strong>de</strong> <strong>du</strong>pliquer sur les<br />
zones d’intervention <strong>de</strong>s projets FIDA. Mais pour sa réussite, il importe <strong>de</strong> le développer à<br />
partir <strong>de</strong>s groupes <strong>de</strong> caution. Sous cet angle, ce sont <strong>de</strong> réelles perspectives qui s’offrent<br />
aux Organisations Professionnelles qui sont naturellement <strong>de</strong>s groupes homogènes et<br />
organisés.<br />
L’approche est d’autant plus crédible qu’au-<strong>de</strong>là l’accès aux financements, c’est <strong>de</strong> la<br />
sécurisation <strong>de</strong>s fonds dont il est question. C’est là l’enjeu qui est perçu <strong>du</strong> côté <strong>de</strong>s SFD<br />
qui voient par ce procédé le moyen <strong>de</strong> servir une clientèle à priori délaissée. En plus, la<br />
concertation dans la définition <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> partage <strong>de</strong>s risques et <strong>de</strong> validation <strong>de</strong>s<br />
requêtes <strong>de</strong>s MPER s’avèrent être <strong>de</strong> véritables innovations dans la prise en charge <strong>de</strong> leurs<br />
besoins en services financiers.<br />
Enfin, les groupes <strong>de</strong> caution calés aux OP sont <strong>de</strong> véritables étapes dans l’établissement<br />
<strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> cautionnement qui seront animées par <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> concertation inter<br />
filières. Un axe qu’il importe d’explorer pour un financement efficace et adapté <strong>de</strong>s<br />
filières.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
49
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
50<br />
TEXTE 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES<br />
Un levier pour le développement <strong>de</strong> l’entreprise rurale<br />
Les micro et petites entrprises rurales les plus performantes sont celles qui<br />
bénéficient <strong>de</strong> la globalité <strong>du</strong> paquet d’appuis constitué par les formations, le<br />
financement et le suivi-accompagnement. et selon une séquence bien définie. Selon<br />
l’expérience <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, la maîtrise <strong>de</strong>s compétences entreprenariales, associée à la<br />
satisfaction <strong>de</strong>s besoins financiers en fonds <strong>de</strong> roulement et en investissement <strong>de</strong><br />
l’Entreprise et soutenu par un conseil <strong>de</strong> proximité, permet d’inscrire l’activité <strong>de</strong>s<br />
micro et petites entreprises rurales dans la <strong>du</strong>rabilité.<br />
Partie : Intro<strong>du</strong>ction<br />
Au Sénégal, le secteur <strong>de</strong> la micro-entreprise en milieu rural qui représente pourtant un<br />
pôle <strong>de</strong> développement à fort potentiel, n’avait pas été suffisamment pris en charge par<br />
l’Etat avant l’avènement <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> en 1997. En effet, Il y a eu un déficit d’appui c est<br />
quoi ? à ce secteur qui s’est tra<strong>du</strong>it, entre autre, par une offre rurale <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its finis et <strong>de</strong><br />
services d’appui à l’agriculture peu compétitive. Et pourtant, l’expérience <strong>de</strong> certains pays<br />
tels que l’In<strong>de</strong>, le Ghana et le Burkina Faso, montre que le développement <strong>de</strong> la microentreprise<br />
en milieu rural constitue une formidable opportunité d’éradication <strong>de</strong> la<br />
pauvreté. L’émergence et le développement <strong>de</strong> très petites entreprises rurales performantes<br />
ai<strong>de</strong>nt à la satisfaction, à <strong>de</strong>s prix compétitifs, <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong> l’agriculture en matériels<br />
agricoles <strong>de</strong> base et petits outillages, intrants divers et services <strong>de</strong> proximité. De telles<br />
entreprises permettent également <strong>de</strong> valoriser par la transformation les pro<strong>du</strong>ctions<br />
agricoles ou <strong>de</strong> cueillette pour les besoins <strong>de</strong>s marchés ruraux et urbains, voire <strong>de</strong>s niches<br />
<strong>de</strong> marchés internationaux.<br />
C’est dans ce contexte que le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro-Entreprises<br />
Rurales (<strong>PROMER</strong> I) a vu le jour avec l’appui financier <strong>du</strong> Fonds International pour le<br />
Développement Agricole (FIDA). L’avènement a été marqué est intervenu dans un<br />
contexte <strong>de</strong> par la dévaluation <strong>du</strong> franc CFA, la libéralisation <strong>de</strong> l’économie nationale et la<br />
promotion <strong>de</strong> l’initiative privée. Aussi, l’intervention <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> <strong>de</strong>vait aboutir à<br />
l’émergence d’un secteur pro<strong>du</strong>ctif formel, diversifié et dynamique en milieu rural par la<br />
création et la consolidation <strong>de</strong> 1231 micro-entreprises rurales disséminées dans les quatre<br />
régions où ? d’intervention <strong>du</strong> projet.<br />
Les objectifs quantitatifs en termes <strong>de</strong> création et consolidation <strong>de</strong>s MER et d’emplois ont<br />
été largement atteints. Le Projet a permis l’émergence d’un tissu <strong>de</strong> micro entrepreneurs<br />
ruraux, certes encore embryonnaires et fragiles, mais dynamiques et <strong>de</strong> plus en plus<br />
imprégnés <strong>de</strong> la culture et <strong>de</strong> la pratique d’entreprise dans toute la zone d’intervention <strong>du</strong><br />
projet qui couvre les régions <strong>de</strong> Tambacounda, Kolda, Fatick et Kaolack, soit plus <strong>de</strong> 52 %<br />
<strong>du</strong> pays.<br />
L’évaluation intermédiaire <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> I clôturée en 2005 avait recommandé la mise en<br />
œuvre d’une secon<strong>de</strong> phase eu égard d’abord à la pertinence <strong>de</strong> l’objectif général, ensuite<br />
au caractère pilote <strong>du</strong> projet et aux impacts positifs relevés, enfin à la nécessité <strong>de</strong> mettre<br />
en place un service pérenne d’accompagnement <strong>de</strong>s MPER et <strong>de</strong>s outils financiers<br />
inclusifs.<br />
L’approche <strong>de</strong> développement généralement axée sur <strong>de</strong>s appuis isolés <strong>de</strong> formation ou <strong>de</strong><br />
financement sans un suivi systématique <strong>de</strong>s bénéficiaires fut donc abandonnée<br />
pourquoi ?au cours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième phase <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, démarré en 2006 et qui couvre en<br />
plus les régions <strong>de</strong> Matam, Diourbel, Louga et Thiès.<br />
Le <strong>PROMER</strong> phase 2 a par conséquent axé son intervention sur une stratégie <strong>de</strong> mise en<br />
œuvre bâtie sur trois leviers principaux : le renforcement <strong>de</strong>s capacités techniques, le<br />
financement et l’appui conseil aux MPER. L’expérience a montré que les MPER les plus
performantes étaient celles qui ont bénéficié <strong>de</strong> ces appuis dans leur globalité et suivant<br />
une chronologie séquence ?xxx bien définie. En effet, la maîtrise <strong>du</strong> métier par<br />
l’entrepreneur, associée à la satisfaction <strong>de</strong>s besoins financiers en Fonds <strong>de</strong> roulement et en<br />
investissement <strong>de</strong> l’Entreprise, soutenu par un conseil <strong>de</strong> proximité permet d’inscrire<br />
l’activité dans la <strong>du</strong>rabilité.<br />
Ce texte décrit le contexte <strong>de</strong> mise en place et la stratégie d’intervention <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong><br />
articulés autour <strong>de</strong> la formation, <strong>du</strong> financement et <strong>du</strong> suivi-accompagnement. Les forces<br />
les faiblesses <strong>de</strong> chaque levier sont ensuite analysées avant la présentation <strong>de</strong>s<br />
recommandations qui mettent l’accent sur le partenariat public/privé local.<br />
Création d’entreprises en milieu rural<br />
Les activités économiques en milieu rural sont généralement dominées par la pro<strong>du</strong>ction<br />
agricole qui <strong>de</strong>meure la principale source <strong>de</strong> revenus <strong>de</strong>s populations. Les effets combinés<br />
<strong>de</strong> la raréfaction <strong>de</strong>s pluies <strong>du</strong>e à une longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> sécheresse et la pauvreté <strong>de</strong>s sols<br />
ont largement contribué à une paupérisation. Malgré la disponibilité <strong>de</strong>s ressources<br />
naturelles, la saisonnalité et la raréfaction <strong>de</strong>s pluies ne permettaient l’occupation <strong>de</strong>s<br />
populations que <strong>du</strong>rant 4 à 5 mois sur l’année. L’effet immédiat a été l’exo<strong>de</strong> massif <strong>de</strong>s<br />
jeunes désœuvrés vers les centres urbains. Par ailleurs, Les politiques d’appui <strong>de</strong> l’Etat au<br />
secteur rural étaient jusqu’alors orientées sur la pro<strong>du</strong>ction agricole, les activités extra<br />
agricoles étant reléguées au second Plan<br />
La mission <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> reflète la politique <strong>de</strong> libéralisation <strong>de</strong> l’Etat <strong>du</strong> Sénégal qui<br />
s’appuie sur <strong>de</strong>ux piliers : le désengagement <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction et le soutien à<br />
l’initiative privée. C’est ainsi qu’au lieu d’intervenir dans une logique <strong>de</strong> « crédit projet »,<br />
le <strong>PROMER</strong> s’inscrit plutôt dans la dynamique <strong>de</strong> bancarisation <strong>de</strong>s acteurs économiques à<br />
faible revenu par le biais <strong>du</strong> système mutualiste.<br />
Le coût <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> phase 1 est <strong>de</strong> 06 milliards <strong>de</strong> FCFA sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 08 ans<br />
(1997-2005) et celui <strong>de</strong> la phase 2 <strong>de</strong> prés <strong>de</strong> 10 milliards <strong>de</strong> FCFA sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 07<br />
ans (2006-2013).<br />
L’objectif global <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, Phase 2 est <strong>de</strong> « contribuer à la ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la pauvreté en<br />
milieu rural par la création et/ou la consolidation <strong>de</strong> MPER générant <strong>de</strong>s emplois pérennes<br />
et entraînant une augmentation et une diversification <strong>du</strong> revenu <strong>de</strong>s ménages dans une<br />
perspective d’équité hommes-femmes.<br />
Il s’agit plus précisément <strong>de</strong> favoriser l’émergence d’entreprises en milieu rural pérennes,<br />
créatrices d’emplois <strong>du</strong>rables pour les jeunes sans emploi et déscolarisées les femmes qui<br />
avaient difficilement accès à la terre.<br />
La stratégie d’intervention <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>, s'inscrit d’abord dans une approche <strong>de</strong><br />
développement local visant à dynamiser les économies locales en se fondant sur la<br />
valorisation <strong>de</strong>s potentiels spécifiques à chacune <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> concentration (), ainsi que<br />
sur les complémentarités entre les secteurs d’intervention. Ensuite, elle s’oriente vers le<br />
marché <strong>de</strong>s services d’appui pérennes aux MPER en appuyant le renforcement <strong>de</strong> l'offre <strong>de</strong><br />
services d'appui financiers et non financiers aux MPER. Enfin elle se tourne vers la<br />
conquête <strong>de</strong> marchés porteurs pour les MPER en jouant un rôle important dans<br />
l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et l'i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong>s marchés adaptés à leurs<br />
pro<strong>du</strong>ctions.<br />
Cette stratégie est bâtie autour <strong>de</strong> trois piliers qui sous-ten<strong>de</strong>nt la démarche opérationnelle.<br />
En première ligne, le volet renforcement <strong>de</strong> capacités qui prend en charge tous les appuis<br />
<strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> envers les bénéficiaires en termes <strong>de</strong> formation technique, formation en<br />
gestion, Alphabétisation ou visite d’échanges ainsi que les appuis commerciaux. La<br />
facilitation <strong>de</strong> l’accès au financement constitue le second pilier. Elle comprend, outre le<br />
crédit, la sensibilisation à l’adhésion aux Structures <strong>de</strong> financement et à l’épargne. Pour<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
51
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
52<br />
accompagner tout le processus d’appuis et assurer un conseil <strong>de</strong> proximité adapté et sur<br />
mesure, le projet engage les services <strong>de</strong> prestataires ou <strong>de</strong> conseillers en entreprise chargés<br />
<strong>du</strong> suivi et <strong>de</strong> la mise en œuvre cohérente et correcte <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> développement ou <strong>de</strong><br />
formation<br />
Les bénéficiaires sont essentiellement les populations rurales pauvres dans la zone<br />
d’intervention <strong>du</strong> projet, les jeunes au chômage, déscolarisés, les femmes ou les<br />
associations <strong>de</strong> femmes et <strong>de</strong> jeunes (Préciser le ciblage)<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong> la démarche <strong>du</strong> projet requiert la mobilisation et la participation <strong>de</strong><br />
partenaires stratégiques, institutionnels et techniques. Sur le plan stratégique, le projet a<br />
aussi collaboré avec <strong>de</strong>s institutions spécialisées comme le BIT (Bureau international <strong>du</strong><br />
Travail) et l’Unité régionale <strong>de</strong> Micro finance <strong>du</strong> Fonds d’équipements <strong>de</strong>s nations Unies<br />
(URM-FENU). Ces collaborations ont facilité la mise en œuvre <strong>du</strong> projet surtout avec le<br />
BIT pour les mo<strong>du</strong>les GERME, la formation et le coaching <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services<br />
non-financiers et la formation <strong>de</strong>s organisations Professionnelles (OP). La<br />
collaboration entre le FIDA, l’Etat <strong>du</strong> Sénégal et le BIT à travers le <strong>PROMER</strong>-II a permis<br />
d’adapter la méthodologie <strong>de</strong> formation GERME dans le contexte rural. L’outil pro<strong>du</strong>it se<br />
nomme ainsi « Germe rural » .Il est aussi une réponse appropriée à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> MPER<br />
faiblement alphabétisés.<br />
Au niveau institutionnel et technique, le projet a bénéficié <strong>de</strong> l’appui <strong>de</strong>s Directions<br />
techniques impliquées dans la promotion <strong>de</strong> l’entreprenariat et <strong>de</strong> la promotion <strong>de</strong> l’emploi<br />
en général et <strong>du</strong> sous secteur <strong>de</strong> l’artisanat en particulier. A ce niveau, les structures clés<br />
ayant signées <strong>de</strong>s conventions avec le <strong>PROMER</strong> sont la Direction <strong>de</strong> l’Entreprenariat<br />
Féminin (DEF), la Direction <strong>de</strong> l’Artisanat (DA), la Direction <strong>de</strong>s petites et Moyennes<br />
Entreprises (DPME), l’Agence Nationale <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong> l’Emploi <strong>de</strong>s Jeunes (ANEJ),<br />
l’Agence pour la Promotion et le Développement <strong>de</strong> l’Artisanat (APDA), l’Union nationale<br />
<strong>de</strong>s Chambres <strong>de</strong> Commerce, d’In<strong>du</strong>strie et d’Agriculture (UNCCIA), l’Union nationale<br />
<strong>de</strong>s Chambres <strong>de</strong> Métiers (UNCM). Ces différents partenariats ont permis au projet<br />
d’affiner sa stratégie d’intervention, <strong>de</strong> mutualiser les couts et d’assurer une continuité.<br />
Artie trop longue option d encadré pour valoriser les infos<br />
(encadré sur les principaux résultats)<br />
La mise en œuvre <strong>de</strong>s activités a permis la création <strong>de</strong> 240 entreprises et la consolidation<br />
<strong>de</strong> 665 par le biais <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> capacités, <strong>de</strong> financement et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> proximité.<br />
13OO micro entrepreneurs ruraux formés<br />
Un <strong>de</strong>s 7 mo<strong>du</strong>les <strong>du</strong> Germe rural
Les renforcements <strong>de</strong> capacités ont concerné prés <strong>de</strong> 1300 personnes. Les formations<br />
techniques axées pour l’essentiel sur les secteurs <strong>de</strong> l’agro-alimentaire, <strong>de</strong> la construction<br />
métallique et mécanique, <strong>du</strong> textile/habillement et <strong>de</strong> l’hygiène et <strong>de</strong> la qualité ont touché<br />
prés <strong>de</strong> 700 entrepreneurs. Les formations en gestion dont plus <strong>de</strong> 90% sont réalisées avec<br />
les mo<strong>du</strong>les GERME (Gérez Mieux votre Entreprise) vulgarisés par le Bureau<br />
International <strong>du</strong> Travail (BIT) ont concerné prés <strong>de</strong> 550 entrepreneurs. Aussi, afin <strong>de</strong><br />
permettre aux bénéficiaires <strong>du</strong> projet <strong>de</strong> savoir lire, écrire et calculer pour mieux gérer<br />
leurs activités entrepreneuriales, 48 classes d’alphabétisation ont été ouvertes avec une<br />
moyenne <strong>de</strong> 15 auditeurs/auditrices par classe. L’apprentissage <strong>de</strong> ces langues aussi bien<br />
locales (wolof, pular er sérère) qu’étrangère (le français) est essentiel pour la mise en<br />
œuvre <strong>de</strong>s programmes <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> capacités en gestion. Les voyages d’étu<strong>de</strong>s<br />
hors <strong>du</strong> Sénégal ont concerné 75 entrepreneurs tandis que 145 entrepreneurs ont participé à<br />
<strong>de</strong>s visites d’échanges à l’intérieur <strong>du</strong> pays. Ces <strong>de</strong>ux activités sont très efficaces car<br />
facilitant les échanges d’expérience entre pairs<br />
La facilitation <strong>de</strong> l’accès au financement a permis d’injecter sous forme <strong>de</strong> crédit prés <strong>de</strong><br />
620 millions <strong>de</strong> FCA au profit <strong>de</strong> 850 entrepreneurs. Si pour la première phase, l’essentiel<br />
<strong>de</strong>s crédits était <strong>de</strong>s crédits court-terme pour <strong>de</strong>s fonds <strong>de</strong> roulement, la tendance s’est<br />
inversée lors <strong>de</strong> la phase 2 <strong>du</strong> projet avec une nette domination <strong>de</strong>s crédits<br />
d’investissements. L’information et la sensibilisation a facilité l’ouverture <strong>de</strong> 700 comptes<br />
auprès <strong>de</strong>s SFD et une mobilisation d’épargne moyenne <strong>de</strong> 5 millions par mois.<br />
Le suivi-accompagnement a concerné les 1465 MPER appuyées par le projet. Lors <strong>de</strong> la<br />
première phase, il était mené par <strong>de</strong>s Conseillers en Entreprises qui faisaient partie <strong>du</strong><br />
personnel <strong>du</strong> projet. La <strong>de</strong>uxième phase a intro<strong>du</strong>it une nouvelle dimension en<br />
externalisant cette fonction <strong>de</strong> conseil dans le souci d’un développement d’un marché <strong>de</strong>s<br />
Services <strong>de</strong> développement d’Entreprises (SDE)<br />
Déplacer les morceaux <strong>de</strong> texte ci-<strong>de</strong>ssus dans la partie stratégie<br />
Le processus d’appui comprend cinq phases à exécuter <strong>de</strong> facon sequentielle et<br />
ordonnée diagramme ?:<br />
1. Information Sensibilisation<br />
2. I<strong>de</strong>ntification/Sélection <strong>de</strong>s groupes cible<br />
3. Diagnostic<br />
4. Mise en ouvre <strong>de</strong>s appuis<br />
5. Suivi-accompagnement/Transfert/ Désengagement/Pérennisation<br />
Sur la base d’une information reçue sur les opportunités <strong>du</strong> projet, la cible i<strong>de</strong>ntifiée et<br />
intéressée dépose une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’appui. Un diagnostic ou une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> faisabilité est<br />
réalisée en vue d’apprécier les besoins d’appui qui sont répertoriés dans un document<br />
appelé «Plan <strong>de</strong> développement et plan <strong>de</strong> formation» ou «Plan d’affaires». Le suivi et<br />
l’accompagnement <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>du</strong> plan <strong>de</strong> développement ou <strong>du</strong> plan d’affaires<br />
sont assurés par <strong>de</strong>s prestataires sur la base d’un programme qui s’étend sur une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong><br />
trois ans.<br />
Les plans sont articulés essentiellement autour <strong>de</strong> formations techniques et en gestion, <strong>de</strong><br />
financement et d’autres appuis divers (Commercial, alphabétisation, visites d’échanges,<br />
etc.).<br />
L’efficacité <strong>de</strong>s appuis dépend en gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> l’exécution coordonnée <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s actions prévues sous le contrôle et le suivi <strong>de</strong>s prestataires généralistes.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
53
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
54<br />
Cette expérience exige une implication totale et à toutes les étapes <strong>du</strong> processus <strong>de</strong><br />
l’entrepreneur doté d’un esprit entrepreneurial avéré et qui, au préalable, a exprimé le<br />
besoin d’appui.<br />
Les secteurs éligibles sont les activités légales ??présentant une rentabilité avérée ??(même<br />
différée) et/ou permettant un accroissement significatif <strong>de</strong>s revenus, et sans impact négatif<br />
ou à impact très faible sur l’environnement. La pro<strong>du</strong>ction agricole n’est pas éligible, à<br />
l’opposé <strong>de</strong>s activités en amont et en aval <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction liées à l’approvisionnement, à la<br />
commercialisation et à la transformation <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its agricoles. La capacité financière à<br />
contribuer au coût <strong>de</strong>s actions d’appui-conseil et <strong>de</strong> formation ne représente pas un critère<br />
d’éligibilité pour la première phase d’appui-conseil généraliste. Pour les autres phases<br />
(appui-conseil spécifique, suivi-accompagnement, et accès aux innovations technologiques<br />
et commerciales), une contribution est <strong>de</strong>mandée à tous les bénéficiaires<br />
Les renforcements <strong>de</strong> capacités techniques, un important outil pour la conquête <strong>de</strong><br />
marchés porteurs !<br />
Les séminaires <strong>de</strong> renfoncement <strong>de</strong> capacités et les voyages ou visites interentreprises sont<br />
<strong>de</strong>s moments forts dans la phase <strong>de</strong> création ou <strong>de</strong> consolidation <strong>de</strong>s entreprises. Ils<br />
permettent aux entrepreneurs <strong>de</strong> bien maîtriser les procédés techniques <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction, et<br />
d’être bien initiés sur les outils et techniques <strong>de</strong> gestion.<br />
Les formations techniques permettent <strong>de</strong> mieux planifier et rationaliser sur le plan<br />
technique les pro<strong>du</strong>ctions et les ventes. Ensuite, elles facilitent le respect <strong>de</strong>s normes<br />
réglementaires qui intègrent l’innocuité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its et leurs caractéristiques<br />
nutritionnelles. Enfin, elle assure la satisfaction intrinsèque et la confiance en soi <strong>de</strong><br />
l’Entrepreneur. Ainsi, nous pouvons noter que les renforcements <strong>de</strong> capacités techniques<br />
garantissent une meilleure conformité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its aux normes sanitaires et organoleptique<br />
et ré<strong>du</strong>isent les facteurs <strong>de</strong> non qualité qui in<strong>du</strong>isant <strong>de</strong>s pertes pour l’Entreprise<br />
Les formations en gestion donnent aux entrepreneurs <strong>de</strong>s compétences pour une bonne<br />
maîtrise <strong>de</strong>s métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> calculs <strong>de</strong>s coûts. Elles permettent <strong>de</strong> bien renseigner les<br />
documents <strong>de</strong> gestion (planification financière, comptabilité, gestion <strong>de</strong>s stocks, etc). les<br />
outils <strong>de</strong> gestion et ainsi d’assurer une traçabilité financière <strong>de</strong>s opérations. L’impact <strong>de</strong><br />
ces appuis se ressent comment – intégrer <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> compétitivité ? dans la<br />
compétitivité <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s entrepreneurs pour une meilleure connaissance donc fixation<br />
<strong>de</strong>s prix <strong>de</strong> revient et <strong>de</strong> vente prenant en compte l’ensemble <strong>de</strong>s charges et <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its,<br />
élément clé <strong>du</strong> marketing.<br />
Le fort taux d’analphabétisme <strong>de</strong>s MPER (micro et petits entrepreneurs ruraux) ciblés, ont<br />
amené le projet et le BIT à concevoir le mo<strong>du</strong>le « GERME niveau 1 » ou « GERME<br />
rural ». Il n’en <strong>de</strong>meure pas moins que le coût <strong>de</strong> la formation GERME est une contrainte<br />
importante par rapport à la <strong>du</strong>rabilité <strong>du</strong> dispositif d’appui aux MPER. Il s’élève en effet à<br />
125 000 FCFA par MPER plus les frais d’organisation, soit 200 000 FCFA par MPER.<br />
De la même manière que les formations techniques et en gestion, l’alphabétisation et les<br />
voyages d’étu<strong>de</strong>s ou visites d’échanges constituent aussi <strong>de</strong>s axes <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong><br />
capacités techniques. Pour l’alphabétisation, les apports pour l’entrepreneur sont la<br />
maitrise <strong>de</strong> l’écriture, <strong>de</strong> la lecture et <strong>du</strong> calcul in<strong>du</strong>isant la capacité à suivre les<br />
programmes <strong>de</strong> formation (technique et gestion) et à utiliser les outils <strong>de</strong> gestion. Quant<br />
aux voyages ou visites d’échanges, son intérêt principal rési<strong>de</strong> dans le mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
transmission <strong>de</strong>s savoirs qui se réalise entre pairs, facilitant ainsi les échanges, la<br />
mémorisation, la <strong>capitalisation</strong> et le, transfert <strong>de</strong> techniques et technologies.
La facilitation <strong>de</strong> l’accès au financement, un moyen efficace pour augmenter la capacité<br />
pro<strong>du</strong>ctive <strong>de</strong>s entreprises !<br />
Le renforcement <strong>de</strong>s capacités financières <strong>de</strong>s entrepreneurs se réalise généralement par le<br />
biais d’obtention <strong>de</strong> crédit auprès <strong>de</strong>s Structures <strong>de</strong> Financement. Pour cela, les premières<br />
actions menées par le <strong>PROMER</strong>-II sont la sensibilisation à l’adhésion aux SFD et à la<br />
culture <strong>de</strong> l’épargne.<br />
Cette « é<strong>du</strong>cation financière » est importante pour l’entrepreneur. Elle permet d’abord la<br />
mise en relation SFD/MPER à travers l’ouverture <strong>de</strong> comptes, la facilitation <strong>de</strong>s<br />
transactions financières futures et offre l’opportunité <strong>de</strong> crédit. Ensuite, elle permet <strong>de</strong><br />
sécuriser les fonds <strong>de</strong>s MPER et d’offrir la possibilité d’autofinancement par le biais <strong>de</strong><br />
l’épargne.<br />
Le crédit offre quant à lui la possibilité d’achat <strong>de</strong> matières d’œuvre et d’équipements.<br />
Partie trop faible par rapport à la formation<br />
Le suivi-accompagnement, un outil pour la promotion <strong>de</strong> la culture d’entreprise <strong>de</strong>s<br />
conseils pour le développement <strong>de</strong> l’entreprise<br />
Les MPER, appuyés par le <strong>PROMER</strong>, ont besoin d’un suivi plus ou moins rapproché et<br />
dégressif pour mettre en œuvre les nouvelles acquisitions <strong>de</strong> savoirs et savoir-faire. Ce<br />
suivi permet également aux MPER d’accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s informations techniques, économiques<br />
et commerciales et <strong>de</strong> bénéficier d’un accompagnement pour une mise en œuvre correcte,<br />
efficace et efficiente <strong>de</strong> leurs plans <strong>de</strong> développement ou plans d’affaires. Ainsi, le contact<br />
régulier entre le promoteur et un prestataire à travers <strong>de</strong>s visites régulières et <strong>de</strong>s échanges<br />
permet <strong>de</strong> créer et <strong>de</strong> renforcer les liens, et d’instaurer à terme une culture <strong>de</strong> conseil.<br />
La mission <strong>du</strong> prestataire consiste à assurer le suivi-accompagnement <strong>de</strong>s MPER appuyées<br />
par <strong>de</strong>s visites régulières sur site. Il s’agira, à partir <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> développements et <strong>de</strong>s<br />
plans d’affaires, d’appuyer, d’accompagner et <strong>de</strong> conseiller l’entrepreneur à atteindre ses<br />
objectifs <strong>de</strong> croissance, <strong>de</strong> suivre et d’évaluer les progrès et performances réalisés et <strong>de</strong><br />
réajuster au besoin les plans <strong>de</strong> développements.<br />
Le prestataire veille aussi au renseignement <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> gestion nécessaire à la mesure <strong>de</strong><br />
performance et à la prise <strong>de</strong> décisions. Il sensibilise et accompagne l’entrepreneur pour la<br />
tenue au moins d’un cahier/fiche/journal <strong>de</strong> recettes/dépenses.<br />
Il faut préciser que l’objectif <strong>du</strong> suivi-accompagnement est <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à un audit<br />
approfondi <strong>de</strong> l’entreprise à travers une analyse <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s fonctions marketing,<br />
gestion <strong>de</strong>s stocks, approvisionnement, calcul <strong>de</strong>s coûts, comptabilité, planification<br />
financière et personnel et pro<strong>du</strong>ctivité. Pour cela, Le prestataire adopte une démarche<br />
participative et i<strong>de</strong>ntifie les contraintes <strong>de</strong> l’entrepreneur afin <strong>de</strong> proposer <strong>de</strong>s solutions<br />
concrètes d’améliorations.<br />
Le suivi-accompagnement vise, à terme, la responsabilisation <strong>du</strong> MPER et son autonomie à<br />
con<strong>du</strong>ire les activités avec une intervention minimum <strong>de</strong> l'extérieur sur tous les plans. Ce<br />
<strong>de</strong>rnier est amené à se sentir responsable <strong>de</strong>s réussites et <strong>de</strong>s échecs, ce qui l'incite à se<br />
former pour progresser dans les résultats. L'autonomie <strong>du</strong> MPER se rapporte aussi à l’auto-<br />
financement <strong>de</strong> ses activités. Si au départ, un soutien financier ou matériel est nécessaire<br />
pour faire décoller les activités, le suivi con<strong>du</strong>it le MPER à valoriser le soutien par<br />
l'accroissement <strong>de</strong>s bénéfices et le réinvestissement dans les activités<br />
Toutes les MPER appuyées et disposant <strong>de</strong> plans <strong>de</strong> développements, seront incitées à<br />
nouer un partenariat avec un prestataire <strong>de</strong> leur choix pour créer une culture <strong>de</strong> conseil,<br />
afin <strong>de</strong> l’accompagner dans la mise en œuvre et le suivi <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> développement et <strong>de</strong>s<br />
acquis <strong>de</strong>s formations reçues.<br />
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
55
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
56<br />
Le suivi-accompagnement est prévu sur 03 années. Le financement <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> suiviaccompagnement<br />
est pris en charge à 100% par le <strong>PROMER</strong> phase II pour la première<br />
année. Il diminuera les années suivantes selon les entreprises et le chiffre d’affaires<br />
expliciter.<br />
Le rythme <strong>du</strong> suivi-accompagnement est dégressif avec <strong>de</strong>s visites évaluées à un effort<br />
d’une <strong>de</strong>mi-journée <strong>de</strong> travail.<br />
Le suivi-accompagnement permet ainsi d’apprécier les indicateurs <strong>de</strong> performances <strong>de</strong>s<br />
MPER, <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong>s nouveaux besoins d’appui <strong>de</strong>s MPER, <strong>de</strong> mettre à disposition <strong>de</strong><br />
la MPER <strong>de</strong>s informations techniques, économiques et commerciales, d’accé<strong>de</strong>r au<br />
conseil pour l’amélioration continue <strong>de</strong> la pro<strong>du</strong>ction.<br />
PROMOTION DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE LOCAL,,,<br />
Le <strong>PROMER</strong> a joué un rôle prépondérant et précurseur dans la promotion et le<br />
développement <strong>de</strong> la micro entreprise en milieu rural. Il a ainsi contribué <strong>de</strong> façon<br />
significative à la lutte contre la pauvreté et l’exo<strong>de</strong> rural grâce à <strong>de</strong>s opportunités d’emplois<br />
<strong>du</strong>rables et <strong>de</strong> richesses offertes aux ruraux, principalement les femmes et les jeunes. Cette<br />
phase pilote a permis au <strong>PROMER</strong> <strong>de</strong> concevoir et d’adapter <strong>de</strong>s outils méthodologiques<br />
d’appui à la micro entreprise rurale axés essentiellement sur la communication et<br />
l’animation, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> porteurs d’initiatives économiques, le pré diagnostic et le<br />
diagnostic, le suivi et l’appui conseil.<br />
Sur le plan technique et commercial, le <strong>de</strong>sign <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong> a permis l’internalisation <strong>de</strong><br />
ressources humaines qualifiées et expérimentées qui ont pu mettre en œuvre un ensemble<br />
<strong>de</strong> stratégies techniques et commerciales ayant permis aux MER d’améliorer la qualité <strong>de</strong>s<br />
pro<strong>du</strong>its et <strong>de</strong>s biens et d’accé<strong>de</strong>r à <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> valeur. Les fonds d’Appui à<br />
l’innovation et à la technologique c’est quoi ??ont été d’un grand apport dans la mise en<br />
œuvre <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> développement surtout pour les MER <strong>de</strong> référence. Le renforcement<br />
<strong>de</strong>s capacités techniques et managériales à travers <strong>de</strong>s formations ciblées et adaptées et<br />
l’appui conseil <strong>de</strong> proximité par le biais <strong>de</strong> conseillers en entreprise ou <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong><br />
services non-financiers ont été d’un grand concours aux performances enregistrées dans la<br />
stratégie d’accompagnement initiée par le <strong>PROMER</strong> en direction <strong>de</strong>s MER. Cependant,<br />
<strong>de</strong>s limites ou contraintes ont pu être notées <strong>du</strong>rant la mise en œuvre <strong>du</strong> <strong>PROMER</strong>.<br />
L’éten<strong>du</strong>e <strong>de</strong> la zone d’intervention lors <strong>de</strong> la première phase n’a pas permis <strong>de</strong> concentrer<br />
les appuis dans un rayon tel que l’impact sur le plan <strong>de</strong> l’économie local puisse être visible<br />
et palpable. Le nombre moyen <strong>de</strong> MER par Communautés Rurales étant <strong>de</strong> 10, les<br />
retombées sociales et économiques sont difficilement appréciables par les collectivités,<br />
même si au niveau <strong>de</strong>s micro-entrepreneurs <strong>de</strong>s résultats très positifs sont enregistrés. Ceci<br />
diminue au plan macro économique les actions menées par le projet et ne favorise pas la<br />
prise en compte <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong> ce groupe par les pouvoirs locaux dans leurs plans <strong>de</strong><br />
développement.<br />
Le partenariat privé local ???a été bien développé par le <strong>PROMER</strong> qui a sollicité dans une<br />
large mesure les compétences locales. Néanmoins, <strong>de</strong>s insuffisances sont notées dans<br />
l’organisation et le renforcement <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> cette offre <strong>de</strong> services qui pourrait à la<br />
fin <strong>du</strong> projet assurer une continuité et une pérennisation d’un soli<strong>de</strong> service d’appui non<br />
financier à la micro entreprise rurale. Enfin, le projet n’a pas su développer un partenariat<br />
spécifique avec les écoles <strong>de</strong> formation professionnelle (surtout celles locales) pour<br />
i<strong>de</strong>ntifier les apprenants originaires <strong>de</strong>s villages et les inciter à y retourner après la fin <strong>de</strong><br />
leur formation. Mais une telle stratégie aurait probablement requis une « ai<strong>de</strong> à<br />
l’installation ».
FORMATION-ACTION A LA CAPITALISATION D’EXPERIENCE DU <strong>PROMER</strong> II<br />
57