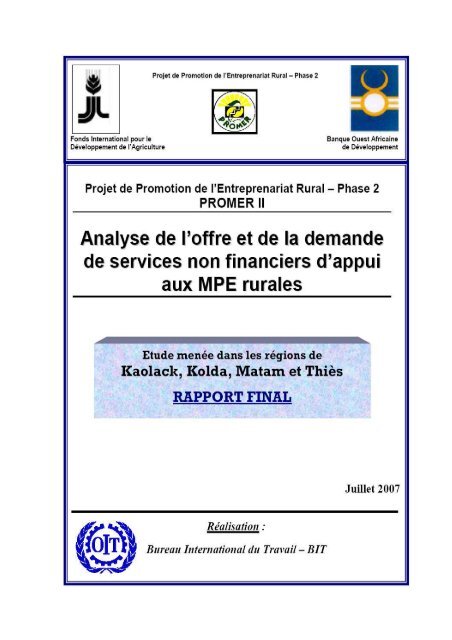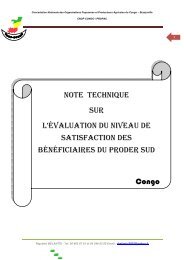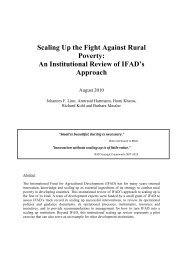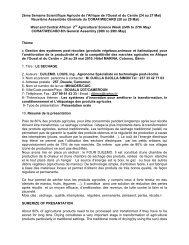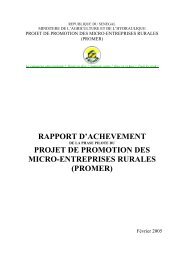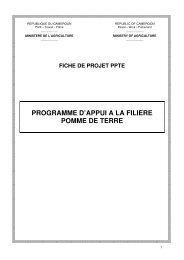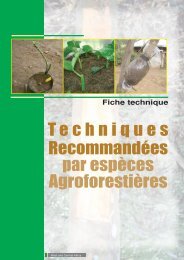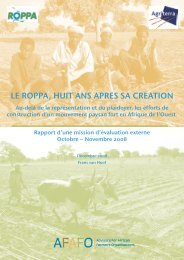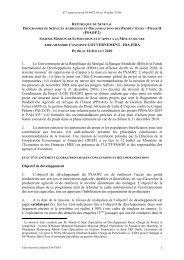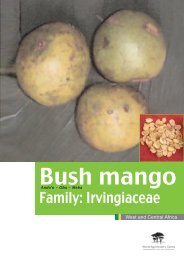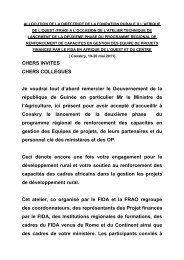Etude_offre & demande SNF_Rapport final - Groupe thématique de ...
Etude_offre & demande SNF_Rapport final - Groupe thématique de ...
Etude_offre & demande SNF_Rapport final - Groupe thématique de ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Résumé Exécutif<br />
Pour mieux orienter les actions <strong>de</strong> PROMER dans la phase II et atteindre les objectifs<br />
assignés, le FIDA a initié une étu<strong>de</strong> sur l’<strong>offre</strong> et la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers<br />
d’appui à l’entrepreneuriat rural. L’étu<strong>de</strong> doit permettre d’i<strong>de</strong>ntifier les besoins d’appui <strong>de</strong>s<br />
MPER ainsi que <strong>de</strong>s prestataires pour un développement <strong>de</strong> la micro entreprise rurale.<br />
L’étu<strong>de</strong> concerne quatre régions (Kolda, Kaolack, Thiès et Matam) pour ce qui est <strong>de</strong> la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>, tandis que pour l’<strong>offre</strong>, en plus <strong>de</strong>s quatre régions, la région <strong>de</strong> Dakar qui<br />
comprend l’écrasante majorité <strong>de</strong>s prestataires a était concernée. L’étu<strong>de</strong> a vu la<br />
mobilisation par le BIT d’un expert International jouant le rôle <strong>de</strong> coordination, un expert<br />
BDS chargé <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>, un expert BDS chargé <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, un statisticien économètre et<br />
un logisticien. 14 enquêteurs et 5 superviseurs ont assuré la collecte <strong>de</strong>s données sur le<br />
terrain et 7 opérateurs <strong>de</strong> saisie ont été mobilisés.<br />
Les étapes suivantes ont marqué la mise en œuvre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> sur le terrain. Après la revue<br />
documentaire, une analyse quantitative auprès <strong>de</strong> 200 MPER sur 19 services a permis <strong>de</strong><br />
mieux cerner les besoins d’appuis <strong>de</strong>s MPER. Au niveau <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, le recensement <strong>de</strong>s<br />
prestataires a conduit à l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> plusieurs types <strong>de</strong> prestataires avec <strong>de</strong>s<br />
caractéristiques différentes. Le diagnostic par type et par région a permis l’analyse<br />
approfondie <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> en vue d’une proposition <strong>de</strong> programme d’appui pour les prestataires.<br />
L’analyse croisée <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> et <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> a conduit à l’i<strong>de</strong>ntification du gap qui existe et<br />
<strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> structuration <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> pour l’absorber. Les focus group ont été l’occasion<br />
d’approfondir les informations <strong>de</strong> l’analyse quantitative <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> et <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong><br />
formulation par les acteurs <strong>de</strong> recommandations dans le cadre <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>uxième phase <strong>de</strong> PROMER. Afin <strong>de</strong> voir les synergies possibles avec les autres projets et<br />
<strong>de</strong> mieux cerner les formes d’appui qui existent dans les différentes régions, les<br />
responsables <strong>de</strong> ces projets ont été rencontrés individuellement ou dans le cadre <strong>de</strong>s focus<br />
group.<br />
Les résultats suivants ont été obtenus dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> eu égard aux<br />
problématiques soulevées dans les termes <strong>de</strong> référence.<br />
La caractérisation <strong>de</strong>s MPER :<br />
Les MPER enquêtées sont <strong>de</strong>s micro entreprises par leur chiffre d’affaires et petites<br />
entreprises par leur taille ; ce qui nécessite une prise en compte spécifique <strong>de</strong> la MPER dans<br />
le Charte <strong>de</strong>s PME ; elles sont dirigées par un nombre presque égal d’hommes et <strong>de</strong><br />
femmes.<br />
Le tiers seulement <strong>de</strong>s MPER est immatriculé et un employé sur trois est salarié. Cette<br />
faiblesse dans la formalisation et dans la rétribution <strong>de</strong> la main d’œuvre réduit l’impact<br />
économique et social <strong>de</strong>s MPER en particulier celui <strong>de</strong>s GPF où le nombre moyen<br />
d’employés salariés n’est que <strong>de</strong> 18,5% par MPER.<br />
On note un assez bon niveau d’instruction dans l’ensemble mais une situation critique dans<br />
la région <strong>de</strong> Thiès où près <strong>de</strong>s 2/3 <strong>de</strong>s entrepreneurs ne sont pas instruits et où 60,4% <strong>de</strong>s<br />
MPER sont dirigées par <strong>de</strong>s personnes âgées <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ans.<br />
P a g e | 2
Quels sont les facteurs explicatifs <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>s et comportements <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux<br />
face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services d’appuis non financiers ?<br />
L’étu<strong>de</strong> a permis <strong>de</strong> comprendre l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong><br />
services d’appui non financiers. L’attitu<strong>de</strong> a été analysée sur plusieurs angles : la nature du<br />
prestataire, l’âge et le genre du prestataire, le lieu <strong>de</strong> fourniture du service, le type <strong>de</strong><br />
service fourni. Pour toutes ces modalités, les attitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux changent.<br />
Par exemple pour le lieu <strong>de</strong> fourniture du service, 59,3% <strong>de</strong>s MPER souhaiteraient que la<br />
prestation se fasse en groupe et dans un centre habilité pour ce genre d’activité. Ce lieu qui<br />
est d’ailleurs celui habituel s’explique par le fait que le principe d’apprentissage ou <strong>de</strong><br />
conseil est développé en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> toute influence. Parallèlement, seulement 14, 8% <strong>de</strong>s<br />
MPER souhaitent que ce soit chez elles contre 25,9% qui souhaiteraient que ce soit chez le<br />
prestataire. Au niveau <strong>de</strong>s filières/activités coiffure, laiterie et boulangerie, les MPER ne<br />
souhaiteraient pas que la fourniture du service soit chez elles. En effet, la structure et le<br />
cadre <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> ces activités ne sont souvent pas adéquats pour un bon<br />
déroulement <strong>de</strong> la prestation. Par contre, pour la filière métal mécanique et l’élevage, le<br />
choix <strong>de</strong> la prestation à domicile se comprend par le caractère <strong>de</strong> production liée à la<br />
prestation. Généralement, les produits <strong>de</strong> la prestation sont mieux domesticables si la<br />
prestation se fait sur place.<br />
Quels sont les déterminants <strong>de</strong> la fidélisation (renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>) ?<br />
Le recours au service pour la première fois s’explique essentiellement par quatre situations :<br />
le besoin <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’activité, la réussite d’autres utilisateurs, c'est-à-dire l’effet<br />
d’imitation, la stratégie marketing du prestataire et la gratuité du service. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette<br />
première utilisation, le renouvellement est fonction <strong>de</strong> la nature du prestataire (entretien <strong>de</strong>s<br />
relations sociales avec les MPER pour 65% <strong>de</strong>s MER), <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> la prestation (le<br />
prestataire est jugé bon par les MPER), <strong>de</strong> la proximité du prestataire (recours récurrent), du<br />
coût <strong>de</strong> la prestation, <strong>de</strong> la durée...<br />
Qu’est ce qui détermine le passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente au recours effectif aux services<br />
d’appuis non financiers ?<br />
Le passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente à un recours effectif est déterminé par plusieurs facteurs<br />
et ce, selon le service. Pour certains services, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires <strong>de</strong><br />
l’entreprise, la reconnaissance juridique <strong>de</strong> la MPER… déterminent le plus le recours<br />
effectif. Il s’agit <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> comptabilité, <strong>de</strong> planification financière, <strong>de</strong> services<br />
juridiques…La présence <strong>de</strong> ces facteurs est un indicateur <strong>de</strong> taille pour inciter la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>,<br />
donc le recours effectif. La connaissance <strong>de</strong>s services par les MER, la maîtrise du besoin, la<br />
connaissance du prestataire entraîne aussi un recours effectif aux services d’appui non<br />
financiers. C’est pourquoi, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la qualité du service, il convient <strong>de</strong> mettre en œuvre<br />
une batterie d’activités pour mieux informer et sensibiliser les MPER dans l’optique d’un<br />
passage <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente à celle active. En d’autres termes, les entrepreneurs ruraux<br />
doivent être suffisamment appuyés en amont pour les amener à mieux cerner leurs besoins<br />
et les traduire en <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> d’appui.<br />
P a g e | 3
La présentation <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>s selon un regroupement par filières et par taille<br />
d’entreprise/activité <strong>de</strong> manière à constituer une population plus ou moins homogène ;<br />
La problématique <strong>de</strong>s filières au niveau du Sénégal n’a pas encore trouvé une solution<br />
définitive. La seule subdivision qui existe au niveau <strong>de</strong>s métiers est l’arrêté sur les 120<br />
corps <strong>de</strong> métiers répartis dans artisanat d’art, <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> service. La tentative <strong>de</strong><br />
regroupement <strong>de</strong>s corps <strong>de</strong> métiers permet <strong>de</strong> voir que l’utilisation <strong>de</strong>s services est<br />
fortement liée aux filières. Plus les activités sont proches (<strong>de</strong> la même corporation <strong>de</strong><br />
métiers), plus le comportement d’achat se ressemble. Cette situation appelle une certaine<br />
démarche filière ou par corporation dans le cadre <strong>de</strong> l’intervention <strong>de</strong> PROMER II pour<br />
aboutir à une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> structurée pour une solution efficace.<br />
Les forces et faiblesses <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services, ainsi que les opportunités, menaces et<br />
limites au développement et à l’expansion <strong>de</strong> ces structures ;<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers requiert une <strong>de</strong>scription approfondie <strong>de</strong>s<br />
prestataires <strong>de</strong> ces services.<br />
La prestation <strong>de</strong> services non financiers est un marché dominé par <strong>de</strong>s entreprises privées,<br />
consultants indépendants ou bureaux d’étu<strong>de</strong>. Près <strong>de</strong> 95% <strong>de</strong>s prestataires recensés sont<br />
<strong>de</strong>s entreprises privées. Les prestataires publics sont très faiblement présents dans les quatre<br />
régions <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>. Plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s prestataires recensés sont <strong>de</strong>s consultants<br />
indépendants alors qu’un peu plus du quart est constitué <strong>de</strong> bureaux d’étu<strong>de</strong>s. La région <strong>de</strong><br />
Thiès se distingue par une forte proportion <strong>de</strong> bureaux d’étu<strong>de</strong>s.<br />
Les prestataires <strong>de</strong> services ne comptent en moyenne que 2,5 employés. Ce chiffre révèle le<br />
faible développement <strong>de</strong> ces entreprises et explique la forte présence <strong>de</strong>s consultants<br />
indépendants. 44% <strong>de</strong>s prestataires recensés disposent <strong>de</strong> registre <strong>de</strong> commerce, mais<br />
seulement 27% d’entre eux ont un NINEA. Cette situation révèle le paradoxe <strong>de</strong> la faible<br />
formalisation <strong>de</strong> prestataires ayant pour mission <strong>de</strong> favoriser le développement d’un tissu<br />
formel <strong>de</strong> MPE rurales.<br />
Les régions <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> Kolda, anciennes zones d’intervention du PROMER I<br />
connaissent une forte proportion <strong>de</strong> prestataires n’ayant pas le baccalauréat.<br />
La forte présence <strong>de</strong> prestataires peu diplômés dans certaines zones pourrait s’expliquer par<br />
le souci <strong>de</strong> faire émerger <strong>de</strong>s professionnels locaux notamment dans les domaines<br />
techniques. En effet, plusieurs <strong>de</strong> ces prestataires interviennent dans la formation<br />
technique ; il s’agit souvent d’artisans ou <strong>de</strong> transformateurs <strong>de</strong> produits ayant capitalisé<br />
une expertise technique avérée dans leur domaine<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> qui n’ont pas <strong>de</strong> « prestation la plus chère » évaluée à moins<br />
<strong>de</strong> 50.000 F CFA, les prestations sont quasiment les mêmes d’un type <strong>de</strong> prestataire à un<br />
autre. Leur coût varie entre 50.000 FCFA et 200.000 FCFA.<br />
Les bureaux d’étu<strong>de</strong>, équipés, formalisés, avec un personnel qualifié sont majoritairement<br />
localisés dans la région <strong>de</strong> Thiès, tandis que les consultants indépendants sont faiblement<br />
équipés et ne sont souvent pas formalisés.<br />
56% <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong>s disposent aussi bien d’un registre <strong>de</strong> commerce que d’un<br />
NINEA. De plus, près <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> recensés dans l’étu<strong>de</strong> sont localisés<br />
dans la région <strong>de</strong> Thiès. Les bureaux d’étu<strong>de</strong>s sont assez bien équipés : plus <strong>de</strong> 9 bureaux<br />
P a g e | 4
d’étu<strong>de</strong> sur 10 disposent <strong>de</strong> matériel informatique et/ou <strong>de</strong> matériel audiovisuel et près <strong>de</strong>s<br />
2/3 ont un véhicule. Enfin, dans environ près <strong>de</strong> 85% <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> le niveau<br />
d’instruction le plus élevé est au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> Bac+4.<br />
Les développements dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> montrent que l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> service non<br />
financiers d’appui aux MPER existe mais doit être améliorée pour répondre efficacement à<br />
la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux dans une optique <strong>de</strong> pérennisation. Pour y arriver et eu<br />
égard aux caractéristiques <strong>de</strong> la MPER, il convient <strong>de</strong> prendre en compte un certains<br />
nombre d’éléments :<br />
• S’appuyer sur <strong>de</strong>s critères qui prennent en compte la problématique du<br />
développement rural par l’entrepreneuriat dans le cadre <strong>de</strong> la sélection <strong>de</strong>s<br />
bénéficiaires<br />
• Insister sur la dynamique organisationnelle dans l’accompagnement <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs individuels<br />
• Renforcement <strong>de</strong>s compétences techniques et institutionnelles <strong>de</strong>s prestataires<br />
• Stimulation du marché par <strong>de</strong>s subventions temporaires<br />
• Suivi du développement du marché<br />
• Prise en compte du suivi accompagnement dans l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> prestation<br />
• Partenariat et synergie entre PROMER II et les autres structures d’appui<br />
• Proposer une révision <strong>de</strong> la charte <strong>de</strong>s PME<br />
• Appréhension globale du système et <strong>de</strong>s acteurs<br />
P a g e | 5
SOMMAIRE<br />
RESUME EXECUTIF.............................................................................................................2<br />
Liste <strong>de</strong>s tableaux................................................................................................................................... 7<br />
Liste <strong>de</strong>s figures ..................................................................................................................................... 7<br />
I. CADRE DE L’ETUDE ........................................................................................................9<br />
1.1. Problématique du développement <strong>de</strong>s MPE ................................................................................ 9<br />
1.2. Objectifs et cibles du PROMER.................................................................................................. 11<br />
II. METHODOLOGIE DE L’ETUDE.................................................................................13<br />
2.1. Rappel <strong>de</strong>s objectifs et résultats attendus <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> ................................................................. 13<br />
2.2. L’enquête auprès <strong>de</strong>s MPE Rurales............................................................................................ 13<br />
2.2.1. Echantillonnage ..................................................................................................................................... 13<br />
2.2.2. Outils <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données ................................................................................................................ 14<br />
2.2.3. Formation et collecte <strong>de</strong>s données......................................................................................................... 16<br />
2.2.4. Traitement <strong>de</strong>s données ......................................................................................................................... 16<br />
2.3. Recensement et Diagnostic <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services............................................................ 16<br />
III. RESULTATS ET DIAGNOSTIC..................................................................................18<br />
3.1. Données statistiques sur les MPER et les prestataires .............................................................. 18<br />
3.1.1. Les Micro et Petites Entreprises Rurales ............................................................................................... 18<br />
3.1.2. Les Prestataires <strong>de</strong> services ................................................................................................................... 24<br />
27 ........................................................................................................................................................... 28<br />
3.2. Analyse <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> ................................................................................................................. 29<br />
3.2.1. Présentation synoptique <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>................................................................................................. 29<br />
3.2.2. La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services......................................................................................................................... 29<br />
3.2.3. Non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services ...................................................................................................................... 30<br />
3.2.4. Utilisation <strong>de</strong> services............................................................................................................................ 31<br />
3.3. Analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> .......................................................................................................................... 46<br />
3.3.1. L’environnement <strong>de</strong> la fourniture <strong>de</strong> services dans les 4 zones............................................................. 46<br />
3.3.2 Caractéristiques <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services d’appui non financiers ........................................................... 51<br />
3.4. Analyse croisée et Cartographie du marché............................................................................... 55<br />
3.4.1. Estimation du marché potentiel <strong>de</strong> services non financiers ................................................................... 55<br />
3.4.5. La formulation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> telle que voulue par les prestataires ...................................................... 61<br />
3.4.6. Cartographie du marché <strong>de</strong>s services non financiers............................................................................. 62<br />
IV. RECOMMANDATIONS................................................................................................64<br />
V. ANNEXES..........................................................................................................................69<br />
P a g e | 6
Liste <strong>de</strong>s tableaux<br />
Tableau 1 : Les strates <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> sondage....................................................................... 14<br />
Tableau 2 : Services étudiés ............................................................................................... 15<br />
Tableau 3 : Couverture <strong>de</strong> l’échantillon................................................................................ 18<br />
Tableau 4 : Typologie et filières <strong>de</strong>s MPE Rurales enquêtées.............................................. 22<br />
Tableau 5 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs enquêtés...................................................... 23<br />
Tableau 6 : Eléments du recensement <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services ...................................... 25<br />
Tableau 7 : Attitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers .... 29<br />
Tableau 8 : Caractéristiques <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs prêts à contribuer financièrement. ................ 33<br />
Tableau 9 : Deman<strong>de</strong>urs « actifs » <strong>de</strong> services par filière .................................................... 35<br />
Tableau 10 : Caractéristiques <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs sans volonté <strong>de</strong> contribuer financièrement . 36<br />
Tableau 11 : Deman<strong>de</strong>urs « passifs » <strong>de</strong> services par filière ................................................ 37<br />
Tableau 12 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs ne <strong>de</strong>mandant pas <strong>de</strong> service.................... 38<br />
Tableau 13 : Non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs <strong>de</strong> services par filière........................................................... 39<br />
Tableau 14 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs utilisant les services ................................. 40<br />
Tableau 15 : Raisons du recours au service pour la première fois........................................ 41<br />
Tableau 16 : Fréquence <strong>de</strong> paiement pour le service............................................................ 42<br />
Tableau 17 : Modalités opérationnelles d’utilisation du service .......................................... 43<br />
Tableau 18 : Analyse <strong>de</strong>s déterminants du passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente au recours<br />
effectif au service.................................................................................................................. 44<br />
Tableau 19 : Catégorisation <strong>de</strong>s services étudiés.................................................................. 51<br />
Tableau 20 : Services habituellement réalisés ...................................................................... 52<br />
Tableau 21 : Tarifs <strong>de</strong>s services étudiés ............................................................................... 54<br />
Tableau 22 : Raisons <strong>de</strong> la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>s services.......................................................... 59<br />
Tableau 23 : Lieu <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> la prestation et type <strong>de</strong> prestation utilisé....................... 60<br />
Liste <strong>de</strong>s figures<br />
Figure 1 : Répartition <strong>de</strong>s appuis reçus par les MPER selon la région d’implantation ........ 20<br />
Figure 2 : Répartition <strong>de</strong>s MPER enquêtées par région et par statut <strong>de</strong> l’entreprise ............ 21<br />
Figure 3 : Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux enquêtés par région, .................................. 24<br />
Figure 4 : Répartition <strong>de</strong>s prestataires par région et selon le niveau le plus élevé dans la<br />
structure................................................................................................................................. 26<br />
Figure 5 : Niveau <strong>de</strong> formalisation <strong>de</strong>s prestataires étudiés ................................................. 52<br />
Figure 6 : Solvabilité du marché <strong>de</strong>s services d’appui non financiers.................................. 57<br />
Figure 7 : Schéma <strong>de</strong>s obstacles à l’adéquation <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> SDE ................ 58<br />
Figure 8 : Schéma <strong>de</strong> la cartographie du marché.................................................................. 63<br />
P a g e | 7
Liste <strong>de</strong>s Sigle et Abréviations<br />
ADEPME Agence <strong>de</strong> Développement et d’Encadrement <strong>de</strong>s PME et <strong>de</strong> l’Artisanat<br />
AGR Activités Génératrices Revenus<br />
ANCAR Agence Nationale pour le Conseil Agricole et Rural<br />
APDA Agence <strong>de</strong> Promotion et Développement <strong>de</strong> l’Artisanat<br />
BIT Bureau International du Travail (Organisation Internationale du Travail)<br />
BOAD Banque Ouest Africaine <strong>de</strong> Développement<br />
CCIA Chambre <strong>de</strong> Commerce, d’Industrie et d’Agriculture<br />
CCIAD Chambre <strong>de</strong> Commerce, d’Industrie et d’Agriculture <strong>de</strong> Dakar<br />
CREE Créer Votre Entreprise (programme formation <strong>de</strong> l'OIT)<br />
GERME Gérer Mieux son Entreprise (programme formation <strong>de</strong> l'OIT)<br />
GIE <strong>Groupe</strong>ment d’Intérêt Economique<br />
GPF <strong>Groupe</strong>ment <strong>de</strong> Promotion Féminine<br />
GRET <strong>Groupe</strong> <strong>de</strong> Recherche et d’Echanges Technologiques (ONG française)<br />
IMF Institut <strong>de</strong> Micro-Finance<br />
ITA Institut <strong>de</strong> Technologie Alimentaire<br />
MER Micro Entreprise Rurale<br />
MPE Micro et Petite Entreprise<br />
MPER Micro et Petite Entreprise Rurale<br />
MPME Micro, Petite et Moyenne Entreprise<br />
NINEA Nombre d’I<strong>de</strong>ntification National <strong>de</strong>s Entreprises et Associations<br />
NTIC Nouvelles Technologies <strong>de</strong> l’Informatique et Communication<br />
ONFP Office National <strong>de</strong> la Formation Professionnelle<br />
ONG Organisations Non Gouvernementales<br />
ONUDI Organisation <strong>de</strong>s Nations Unis pour le Développement Industriel<br />
PAOA Projet d’Appui aux Organisations Agroalimentaires<br />
PAPES Programme d’Appui aux Petites Entreprises au Sénégal<br />
PDER Projet <strong>de</strong> Développement <strong>de</strong> l’Entreprenariat Régional<br />
PER Petite Entreprise Rurale<br />
PIE Porteurs d’Initiative Economique<br />
PME Petite et Moyenne Entreprise<br />
PMI Petite et Moyenne Industrie<br />
PNB Produit National Brut<br />
PNUD Programme <strong>de</strong>s Nations Unies pour le Développement<br />
PPEA Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Exportations Agricoles<br />
PPES Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Exportations au Sénégal<br />
PPPMER Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Petites et Micro Entreprises Rurales<br />
PRODAM Projet pour le Développement Agricole <strong>de</strong> Matam<br />
PROMER Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro Entreprises Rurales<br />
PSAOP Programme <strong>de</strong>s Services Agricoles et <strong>de</strong>s Organisations <strong>de</strong> Producteurs<br />
SDE Services pour le Développement <strong>de</strong>s Entreprises<br />
TPE Très Petite Entreprise<br />
TRI Trouver Votre Idée d’Entreprise (formation <strong>de</strong> l'OIT)<br />
UGP Unité <strong>de</strong> Gestion du Projet<br />
USAID US Agency for International Development<br />
P a g e | 8
I. Cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
1.1. Problématique du développement <strong>de</strong>s MPE<br />
Le gouvernement du Sénégal a décidé <strong>de</strong> faire <strong>de</strong> la dynamique <strong>de</strong> croissance, observée<br />
<strong>de</strong>puis la dévaluation du franc CFA en 1994, une opportunité pour créer les conditions<br />
d’une transformation en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong> l’appareil <strong>de</strong> production et <strong>de</strong> diversification <strong>de</strong>s<br />
sources <strong>de</strong> la croissance économique. Ce défi, formulé dans la nouvelle stratégie <strong>de</strong><br />
croissance accélérée, doit permettre au Sénégal <strong>de</strong> réduire <strong>de</strong> moitié la prévalence <strong>de</strong> la<br />
pauvreté sur la pério<strong>de</strong> 2006-2015. La stratégie <strong>de</strong> croissance accélérée s’appuie sur trois<br />
axes : le renforcement du partenariat entre l’Etat et le secteur privé, l’amélioration <strong>de</strong><br />
l’environnement <strong>de</strong>s affaires et le développement <strong>de</strong>s MPE.<br />
La stratégie <strong>de</strong> croissance accélérée, comme celle <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la pauvreté définie avec<br />
les partenaires au développement, est pertinente dans le contexte du mon<strong>de</strong> rural dont la<br />
promotion par <strong>de</strong>s organismes publics d’encadrement et d’assistance <strong>de</strong>s producteurs a<br />
montré ses limites après plusieurs décennies. En effet, malgré les efforts <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnisation,<br />
la productivité agricole est restée faible et sans effet d’entraînement sur les autres activités<br />
économiques et sur le niveau <strong>de</strong> vie <strong>de</strong>s populations rurales frappées encore, à plus <strong>de</strong> 80%,<br />
par la pauvreté. Refusant l’enfermement dans un pessimisme social, le Gouvernement du<br />
Sénégal a opté pour la stimulation <strong>de</strong> la croissance par l’appui aux initiatives <strong>de</strong>s<br />
populations rurales <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s micro et petites entreprises en vue d’assurer leur propre<br />
promotion économique et sociale. Cependant les micro et petites entreprises créées par les<br />
ruraux ne sont pas répertoriées; elles émergent et opèrent <strong>de</strong> façon isolée, sans soutien<br />
significatif <strong>de</strong> leur environnement.<br />
Différentes étu<strong>de</strong>s ont déjà montré que le secteur privé sénégalais est composé d’une<br />
mosaïque d’entreprises où cohabitent : un secteur mo<strong>de</strong>rne structuré et un secteur <strong>de</strong><br />
l’économie populaire, principalement urbain, communément appelé secteur informel.<br />
L’importance <strong>de</strong>s micro et petites entreprises dans le tissu économique est notamment<br />
soulignée par le diagnostic réalisé en 2000 1 sur le secteur mo<strong>de</strong>rne sénégalais qui comptait<br />
alors 1290 entreprises ainsi réparties :<br />
Les entreprises <strong>de</strong> 0 à 2 employés<br />
représentent 40% ;<br />
Les entreprises <strong>de</strong> 3 à 50 employés<br />
représentent 54% ;<br />
Les entreprises qui ont un effectif<br />
supérieur à 50 employés représentent à<br />
peine 6%.<br />
90,0%<br />
80,0%<br />
70,0%<br />
60,0%<br />
50,0%<br />
40,0%<br />
30,0%<br />
20,0%<br />
10,0%<br />
0,0%<br />
1 P. Paris (GRET) ; A. Ndour (REMIX) ; T. Sylla (SYNAPSE)<br />
Nombre d'unités<br />
Emploi<br />
Valeur ajoutée<br />
0 à 2 3 à 50 > 50<br />
Taille <strong>de</strong>s entreprises par nb. d'em plois<br />
P a g e | 9
Toutefois, pour avoir une vue globale <strong>de</strong> la réalité du tissu économique national, il faut<br />
ajouter aux entreprises <strong>de</strong> 0 à 50 employés une multitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> micro et petites entreprises<br />
évoluant dans le secteur informel ; car le secteur mo<strong>de</strong>rne (1290 entreprises) ne représente<br />
que 3% <strong>de</strong>s 39.907 entreprises immatriculées, en 2000, au Centre National d’I<strong>de</strong>ntification<br />
<strong>de</strong>s Entreprises et <strong>de</strong>s Associations. Les micro et petites entreprises constituent donc la base<br />
du secteur privé mais <strong>de</strong>meurent informelles.<br />
La plupart <strong>de</strong>s MPE rurales se trouve dans le secteur informel et on ne dispose pas <strong>de</strong><br />
données sur leur nombre, ni sur leur contribution économique. D’ailleurs, avant<br />
l’avènement du PROMER, les micro et petites entreprises rurales étaient négligées dans<br />
l’élaboration <strong>de</strong>s politiques économiques, alors que leur développement aurait pu satisfaire,<br />
à <strong>de</strong>s prix compétitifs, les besoins <strong>de</strong> l’agriculture en matériels et petits outillages, en<br />
intrants et en services <strong>de</strong> proximité. Elles auraient pu également valoriser la production<br />
agricole en la transformant sous <strong>de</strong>s formes variées pour satisfaire les besoins <strong>de</strong>s ruraux,<br />
ceux <strong>de</strong>s agglomérations urbaines voire <strong>de</strong> certains créneaux d’exportation.<br />
C’est donc cette opportunité, jusque là négligée, que les autorités sénégalaises ont<br />
<strong>de</strong>mandée au FIDA d’i<strong>de</strong>ntifier (1994) puis d’évaluer (1995). La phase 1 du PROMER est<br />
l’aboutissement <strong>de</strong> ce processus. L’intervention du PROMER I a porté sur l’émergence en<br />
milieu rural d’un tissu formel et diversifié <strong>de</strong> MPE par la création et la consolidation <strong>de</strong><br />
micro entreprises rurales dans les régions <strong>de</strong> Tambacounda, <strong>de</strong> Kolda, <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong><br />
Fatick. Le but ultime du PROMER I était d’enclencher une dynamique autoentretenue et<br />
irréversible <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> micro entreprises rurales par la pleine mobilisation <strong>de</strong>s<br />
ressources humaines, physiques et financières locales.<br />
Cette première phase du PROMER a permis d’atteindre largement les objectifs quantitatifs<br />
en termes <strong>de</strong> création, <strong>de</strong> consolidation <strong>de</strong> MPER et d’emplois. Elle a aussi permis <strong>de</strong><br />
concevoir et d’adapter <strong>de</strong>s outils méthodologiques d’appui à la MPE rurale axés<br />
essentiellement sur la communication et l’animation, l’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> porteurs<br />
d’initiatives économiques, le pré diagnostic et le diagnostic, la formation, l’appui conseil et<br />
le suivi.<br />
Certains enseignements, tirés <strong>de</strong> cette phase pilote d’appui à l’entreprenariat rural non<br />
agricole, ont guidé la préparation du PROMER II, à savoir:<br />
La MPER non agricole est un levier stratégique important dans la lutte contre la<br />
pauvreté, car elle constitue un support logistique <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> production<br />
agricole ;<br />
L’alphabétisation fonctionnelle est un préalable indispensable aux appuis<br />
techniques, financiers et non financiers, car 60% à 70% <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong> zones<br />
d’intervention du Projet ne sont alphabétisées dans aucune langue;<br />
La pérennisation <strong>de</strong>s MPER implique leur accès à <strong>de</strong>s services d’appui <strong>de</strong><br />
proximité, fournis par <strong>de</strong>s prestataires locaux dont il faut, au besoin, renforcer les<br />
capacités;<br />
L’approche formation /financement /appui-conseil est pertinente mais elle doit être<br />
adaptée aux besoins <strong>de</strong>s MPER en fonction <strong>de</strong> la localisation, du secteur d’activité,<br />
<strong>de</strong> l’âge, du genre, etc…<br />
Les appuis doivent être concentrés dans <strong>de</strong>s aires géographiques propices à<br />
l’éclosion d’entrepreneurs par l’existence <strong>de</strong> MPER en activité, <strong>de</strong> marchés<br />
P a g e | 10
potentiels et d’institutions socioéconomiques, <strong>de</strong> manière à amplifier l’impact du<br />
Projet sur l’économie locale tout en minimisant les coûts unitaires d’intervention ;<br />
L’émergence <strong>de</strong> groupements d’affaires et d’organisations professionnelles facilite<br />
l’accès <strong>de</strong>s membres à <strong>de</strong>s « services groupés » <strong>de</strong> financement, <strong>de</strong> formation et <strong>de</strong><br />
conseil ;<br />
La prise en compte par les collectivités locales (conseils régionaux et ruraux) <strong>de</strong><br />
l’entreprenariat rural dans le développement local est une contribution<br />
déterminante du PROMER au renforcement <strong>de</strong> la décentralisation dans ses zones<br />
d’intervention.<br />
1.2. Objectifs et cibles du PROMER<br />
Le mon<strong>de</strong> rural sénégalais se caractérise par une pauvreté inégalement répartie et <strong>de</strong>s<br />
valeurs culturelles fondées sur le respect <strong>de</strong>s traditions ancestrales, la primauté du groupe<br />
sur l’individu et la division du travail en fonction du genre.<br />
La pauvreté en milieu rural se caractérise non seulement par l’insuffisance <strong>de</strong>s revenus <strong>de</strong>s<br />
ménages, mais encore par le faible accès aux services sociaux <strong>de</strong> base comme l’eau potable,<br />
l’école, la santé et les routes. La carte <strong>de</strong>s indices d’accès aux services sociaux <strong>de</strong> base<br />
(annexe 1), montre que la pauvreté est localisée plus fortement dans les zones rurales du<br />
Centre, du Sud et du Nord Est qui recouvrent les aires d’intervention du PROMER II sur<br />
lesquelles porte la présente étu<strong>de</strong>. Les micro et petites entreprises rurales subissent par<br />
conséquent <strong>de</strong>s contraintes handicapantes liées à l’analphabétisme, l’absence <strong>de</strong> capitaux,<br />
l’inadéquation <strong>de</strong>s compétences techniques, le manque d’infrastructures et le défaut<br />
d’information.<br />
Face à cet environnement, le PROMER II a fixé trois objectifs stratégiques :<br />
1. la consolidation et/ou création <strong>de</strong> micro et petites entreprises génératrices d’emplois<br />
durables dans les zones <strong>de</strong> concentration du Projet, bénéficiant d’accès à <strong>de</strong>s<br />
services d’appui financiers et non financiers adaptés, durables et décentralisés, dans<br />
une perspective d’équité homme femme. La zone <strong>de</strong> concentration est une zone<br />
socioéconomique présentant <strong>de</strong>s opportunités intéressantes, i<strong>de</strong>ntifiées ou non, en<br />
termes <strong>de</strong> créneaux potentiels et <strong>de</strong> filières regroupant <strong>de</strong>s MPER intervenant au<br />
sein <strong>de</strong> la même chaîne <strong>de</strong> valeur, <strong>de</strong> l’acquisition <strong>de</strong> la matière première à la vente<br />
du produit fini. La zone <strong>de</strong> concentration présente les atouts suivants : la possibilité<br />
<strong>de</strong> valoriser <strong>de</strong>s ressources locales, la présence <strong>de</strong> micro et petites entreprises déjà<br />
en activité, l’existence d'une forte <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> locale et <strong>de</strong> marchés accessibles aux<br />
niveaux local, régional ou national, la présence d’institutions à caractère<br />
socioéconomique, ou <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> développement.<br />
2. la structuration et la professionnalisation du secteur <strong>de</strong> l’entreprenariat rural suivant<br />
les créneaux et filières développés dans les zones <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> façon à<br />
favoriser une meilleure performance <strong>de</strong>s micro et petites entreprises, leur intégration<br />
dans <strong>de</strong>s organisations professionnelles, une meilleure prise en compte <strong>de</strong> leurs<br />
contraintes, et leur participation effective aux cadres <strong>de</strong> concertation et au dialogue<br />
avec les autres acteurs aux niveaux local, régional et national. Le rôle <strong>de</strong>s<br />
organisations professionnelles est <strong>de</strong> donner aux membres une légitimité et une<br />
représentativité sociales pour la défense <strong>de</strong> leurs intérêts et le renforcement <strong>de</strong> leur<br />
capacité <strong>de</strong> proposition dans l’élaboration <strong>de</strong>s politiques <strong>de</strong> développement les<br />
concernant.<br />
P a g e | 11
3. l’amélioration <strong>de</strong> l’environnement politique, législatif et institutionnel facilitant la<br />
création et le développement <strong>de</strong>s MPE rurales. Il est en effet crucial que les MPER<br />
puissent participer, à travers leurs organisations professionnelles, leurs représentants<br />
mandatés, au dialogue croissant entre pouvoirs publics et secteur privé, qui <strong>de</strong>vrait<br />
déboucher sur d’importantes réformes <strong>de</strong> l’environnement <strong>de</strong>s affaires et du<br />
dispositif national d’appui. Ainsi le Programme National <strong>de</strong> Développement Local<br />
(PNDL) a-t-il été mis en place par le Gouvernement pour améliorer le niveau<br />
d’équipement <strong>de</strong>s collectivités locales et renforcer les opportunités économiques en<br />
faveur <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux.<br />
Ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs opérationnels chiffrés:<br />
1. Appui à environ 3.000 entrepreneurs et porteurs individuels ou collectifs<br />
d’initiatives désirant consoli<strong>de</strong>r une entreprise existante, créer une MPE rurale ou une<br />
activité génératrice <strong>de</strong> revenus, en amont ou en aval <strong>de</strong> la production agricole.<br />
2. Cet objectif d’appui à 3.000 micro et petites entreprises se décompose ainsi :<br />
a) 2.000 micro entreprises et porteurs d’initiatives ou d’activités génératrice <strong>de</strong><br />
revenu (dont 400 sont issus du PROMER I et 1600 sont <strong>de</strong>s nouveaux) ;<br />
b) 1.000 petites entreprises (dont 200 sont issues du PROMER I et 800 sont <strong>de</strong><br />
nouvelles entreprises) ;<br />
c) 60% sont <strong>de</strong>s projets individuels et 40% <strong>de</strong>s projets collectifs ;<br />
d) 50% <strong>de</strong>s entrepreneurs ciblés sont <strong>de</strong>s femmes ;<br />
Alphabétisation <strong>de</strong> 1.560 personnes car 60% à 70% <strong>de</strong>s populations <strong>de</strong> zones d’intervention<br />
du Projet ne sont alphabétisées dans aucune langue. Cet objectif qui représente 52% <strong>de</strong>s<br />
3000 MPER ciblées.<br />
3. Renforcement <strong>de</strong> capacités d’environ 160 prestataires <strong>de</strong> services non financiers dans<br />
les huit régions du Projet<br />
Les objectifs chiffrés du PROMER II ciblent <strong>de</strong>s micros entreprises classées en fonction <strong>de</strong><br />
leur taille et <strong>de</strong>s caractéristiques <strong>de</strong> leur activité: activités génératrices <strong>de</strong> revenus (AGR)<br />
ou « activités <strong>de</strong> subsistance », porteurs (individuels) d’initiatives économiques (PIE)<br />
étroitement liés aux AGR, micro entreprises rurales (MER) et petites entreprises rurales<br />
(PER). La définition <strong>de</strong>s MER et les PER est empruntée à la Charte <strong>de</strong>s PME validée par<br />
l’État et le secteur privé en décembre 2003.<br />
Les micros entreprises rurales (MER) se caractérisent par un chiffre d’affaires inférieur à 15<br />
millions <strong>de</strong> FCFA et un effectif <strong>de</strong> 1 à 10 emplois permanents ou saisonniers.<br />
Les petites entreprises rurales (PER) ont un chiffre d’affaires plus élevé (entre 15 et 25<br />
millions <strong>de</strong> FCFA pour les prestations <strong>de</strong> services ; entre 15 et 50 millions FCFA pour les<br />
opérations <strong>de</strong> livraisons <strong>de</strong> biens) et un effectif <strong>de</strong> 10 à 20 emplois permanents ou<br />
saisonniers.<br />
L’atteinte <strong>de</strong> ces objectifs nécessitant une bonne maîtrise la situation <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> et <strong>de</strong> la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers en milieu rural, les responsables du PROMER ont<br />
commandé la présente étu<strong>de</strong>.<br />
P a g e | 12
II. Méthodologie <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
L’analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> et <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers d’appui aux MPE rurales a<br />
été réalisée au cours <strong>de</strong>s mois <strong>de</strong> juin et juillet 2007. La méthodologie adoptée a nécessité<br />
l’utilisation d’outils tant quantitatifs que qualitatifs. Une enquête auprès <strong>de</strong>s MPE rurales<br />
ainsi qu’une série <strong>de</strong> focus groups avec les acteurs du marché <strong>de</strong>s régions cibles ont permis<br />
<strong>de</strong> cerner la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers.<br />
2.1. Rappel <strong>de</strong>s objectifs et résultats attendus <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
L’étu<strong>de</strong> a porté sur l’analyse approfondie du marché <strong>de</strong>s services non financiers, aussi bien<br />
du côté <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> que <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, sur la base <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> la collecte <strong>de</strong> données<br />
quantitatives et qualitatives.<br />
Du côté <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>, il s’agissait <strong>de</strong> déterminer (i) les facteurs explicatifs <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>s<br />
et comportements <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services, (ii) le processus et les<br />
déterminants <strong>de</strong> la fidélisation (renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>), (iii) les facteurs<br />
déterminant le passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente au recours effectif aux services d’appuis non<br />
financiers.<br />
Du côté <strong>de</strong>s prestataires, il s’agissait <strong>de</strong> déterminer (i) les problèmes-clés <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, (ii) les<br />
opportunités pour la conception <strong>de</strong> nouveaux services, les stratégies marketing. Ce volet<br />
incluait une évaluation <strong>de</strong>s forces et faiblesses <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services, ainsi que les<br />
opportunités et menaces au développement <strong>de</strong> ces structures.<br />
Il s’agissait enfin <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’analyse croisée <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> en vue <strong>de</strong><br />
comprendre le comportement spécifique <strong>de</strong>s MPER, les obstacles structurels au<br />
développement du marché <strong>de</strong>s services non financiers et <strong>de</strong> formuler <strong>de</strong>s<br />
recommandations.<br />
2.2. L’enquête auprès <strong>de</strong>s MPE Rurales<br />
2.2.1. Echantillonnage<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, les Termes <strong>de</strong> référence fixaient déjà la taille <strong>de</strong> l’échantillon<br />
<strong>de</strong>s MPER à 200 pour les quatre régions. Le travail <strong>de</strong> l’échantillonnage a donc porté sur le<br />
mécanisme aléatoire <strong>de</strong> sélection <strong>de</strong>s unités à observer (méthodologie), la constitution <strong>de</strong> la<br />
liste <strong>de</strong>s unités susceptibles <strong>de</strong> figurer dans l’échantillon (base <strong>de</strong> sondage) et la sélection<br />
<strong>de</strong>s unités à observer (tirage <strong>de</strong> l’échantillon).<br />
a) Méthodologie<br />
L’échantillonnage a été réalisé suivant la métho<strong>de</strong> dite <strong>de</strong> stratification. Pour chaque région,<br />
les MPE rurales ont été constituées en trois strates suivantes : hommes, femmes et<br />
groupements. Dans les <strong>de</strong>ux régions d’intervention du PROMER 1 (Kaolack et Kolda) la<br />
P a g e | 13
stratification a intégré un critère supplémentaire qui est l’appartenance <strong>de</strong> la MPER au<br />
portefeuille <strong>de</strong>s entreprises appuyées par le PROMER 1. Il a été opté pour un sondage<br />
représentatif ; ce qui signifie que la structure <strong>de</strong>s strates constituées (hommes, femmes,<br />
groupements) est la même dans l’échantillon que dans la population mère. Cette <strong>de</strong>rnière<br />
option a donc permis <strong>de</strong> traiter les résultats <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> en considérant un plan simple, c’està-dire<br />
comme un recensement.<br />
b) Base <strong>de</strong> sondage et Tirage <strong>de</strong> l’échantillon<br />
b1. Base <strong>de</strong> sondage<br />
La base <strong>de</strong> sondage a été constituée en utilisant <strong>de</strong>ux sources principales <strong>de</strong> données : la<br />
base <strong>de</strong> données du PROMER 1 et les <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>s d’appui formulées par <strong>de</strong>s entrepreneurs<br />
ruraux aspirant à l’appui du PROMER. Pour cela, trois strates ont été constituées : les<br />
entreprises individuelles d’hommes, entreprises individuelles <strong>de</strong> femmes et les entreprises<br />
collectives (groupements). A la suite <strong>de</strong>s différents traitements ayant conduit à la mise à<br />
jour <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> sondage, il a été procédé à la répartition <strong>de</strong> l’échantillon entre les strates<br />
par région. Cette répartition s’est faite <strong>de</strong> façon à avoir un sondage représentatif, c’est-àdire<br />
que la répartition <strong>de</strong>s hommes, <strong>de</strong>s femmes et <strong>de</strong>s groupements dans la populationmère<br />
(base <strong>de</strong> sondage) correspond à celle obtenue dans l’échantillon. Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous<br />
donne la taille <strong>de</strong>s strates pour les quatre régions d’étu<strong>de</strong> :<br />
b2. Tirage <strong>de</strong> l’échantillon<br />
Hommes Femmes <strong>Groupe</strong>ments<br />
KAOLACK 27 18 5<br />
KOLDA 18 4 28<br />
MATAM 19 6 25<br />
THIES 18 10 20<br />
TOTAL 82 38 78<br />
Tableau 1 : Les strates <strong>de</strong> la base <strong>de</strong> sondage<br />
Il a été procédé à un tirage aléatoire <strong>de</strong>s unités d’observation. Dans chaque strate, le tirage<br />
<strong>de</strong>s unités est réalisé <strong>de</strong> façon aléatoire à probabilité égale ; toutes les unités <strong>de</strong> la base <strong>de</strong><br />
sondage avaient donc les mêmes chances d’apparaître dans l’échantillon. Le tirage a été<br />
réalisé <strong>de</strong> façon automatique en utilisant le logiciel SPSS. Ce mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> tirage utilise une<br />
table <strong>de</strong> nombres au hasard prédéfinie dans le logiciel. Il n’utilise donc pas un pas <strong>de</strong><br />
sondage car celui-ci est employé dans le cas d’un tirage systématique utilisé en l’absence <strong>de</strong><br />
table <strong>de</strong> nombres au hasard.<br />
2.2.2. Outils <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données<br />
Les supports utilisés pour la collecte <strong>de</strong>s données <strong>de</strong> l’enquête comprenaient le<br />
questionnaire auprès <strong>de</strong>s MPER et le Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’enquêteur.<br />
P a g e | 14
a) Le Questionnaire MPER<br />
Le questionnaire MPER (annexe 2) a été conçu <strong>de</strong> manière à analyser la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> 19<br />
services retenus pour l’étu<strong>de</strong>. Après une<br />
section d’i<strong>de</strong>ntification <strong>de</strong> la MPER (zone<br />
d’implantation, activité, effectifs, chiffres<br />
d’affaires, investissements, statut juridique,<br />
etc…), le questionnaire analyse ensuite la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s 19 services retenus. La<br />
phase d’analyse comprend trois étapes :<br />
l’analyse du besoin, l’expression <strong>de</strong> la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l’entrepreneur face à l’<strong>offre</strong>.<br />
L’analyse du besoin est menée par l’enquêteur<br />
en posant une série <strong>de</strong> questions portant sur la<br />
réalité et les expériences <strong>de</strong> la MPER. Cette<br />
analyse, menée sous la forme d’un entretien,<br />
s’appuie sur une démarche empruntée à la<br />
méthodologie d’ABF <strong>de</strong> GERME. Pour chaque<br />
service étudié, trois questions intégrées dans le<br />
questionnaire <strong>de</strong>vraient servir <strong>de</strong> fil conducteur<br />
à cette analyse.<br />
A la suite <strong>de</strong> l’analyse du besoin, l’enquêteur <strong>de</strong>vrait se prononcer sur la nature du besoin. Il<br />
s’agirait d’indiquer, à la lumière <strong>de</strong> la réalité <strong>de</strong> la MPER, si le besoin pour ce service était :<br />
Satisfait, Manifeste, Latent ou Inexistant. Puis, l’entrepreneur était invité à s’exprimer<br />
clairement sur son intérêt à recourir au service. Dans ce cas, l’expression <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
était enregistrée sous trois formes possibles : souhaite recourir au service, utilise le service<br />
et ne souhaite pas recourir au service. Selon le cas, l’entrepreneur était classé soit dans le<br />
groupe <strong>de</strong>s Deman<strong>de</strong>urs (lorsqu’il souhaite recourir au service), soit dans le groupe <strong>de</strong>s<br />
Utilisateurs (lorsque l’entrepreneur utilise déjà le service) ou dans le groupe <strong>de</strong>s Non<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs (lorsqu’il ne souhaite pas recourir au service).<br />
En fonction <strong>de</strong> l’expression <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> faite par l’entrepreneur, l’enquêteur <strong>de</strong>vrait<br />
ensuite poser <strong>de</strong>s questions afin <strong>de</strong> mieux comprendre les facteurs explicatifs <strong>de</strong> son attitu<strong>de</strong><br />
face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> service. Par exemple, lorsque l’entrepreneur est un <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>ur <strong>de</strong> service, il<br />
lui est <strong>de</strong>mandé s’il est prêt à contribuer financièrement pour le service ou par quel type <strong>de</strong><br />
prestataire souhaite t-il que ce service soit fourni. De même, lorsque l’entrepreneur utilise<br />
déjà le service, l’investigation <strong>de</strong>vrait permettre <strong>de</strong> savoir si l’entrepreneur paie pour le<br />
service, s’il a déjà changé <strong>de</strong> prestataire et quels sont les déterminants <strong>de</strong> sa fidélisation.<br />
b) Le Manuel <strong>de</strong> l’enquêteur<br />
Tableau 2 : Services étudiés<br />
Alphabétisation fonctionnelle<br />
Approvisionnement<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts<br />
Comptabilité<br />
Création d'entreprise<br />
Entreprise et famille<br />
Esprit d'entreprise<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE<br />
Foires et manifestations commerciales<br />
Formation technique<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines<br />
Marketing<br />
NTIC<br />
Passation <strong>de</strong> marches<br />
Planification financière<br />
Recherche d'idée d'entreprise<br />
Services juridiques<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires<br />
Le Manuel <strong>de</strong> l’enquêteur (annexe 3) est un gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> terrain conçu pour les enquêteurs. Il<br />
contient la définition <strong>de</strong>s termes utilisés dans le questionnaire et donne une explication<br />
claire <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s 19 services étudiés. Le Manuel contient aussi le protocole d’enquête<br />
qui est un ensemble <strong>de</strong> recommandations pratiques à l’attention <strong>de</strong> l’enquêteur.<br />
P a g e | 15
2.2.3. Formation et collecte <strong>de</strong>s données<br />
Après la validation <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données, les agents <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données ont<br />
été formés à l’administration <strong>de</strong> ces outils. Tous les agents <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données ont été<br />
formés à Thiès au cours d’une formation <strong>de</strong> trois jours, incluant une journée <strong>de</strong> pré-test et<br />
<strong>de</strong> programmation <strong>de</strong>s enquêtes.<br />
La formation a été articulée autour <strong>de</strong> cinq points essentiels :<br />
- Présentation du contexte général du PROMER et <strong>de</strong> la justification <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong><br />
- Introduction au marché <strong>de</strong>s services non financiers d’appui aux MPE<br />
- la compréhension et la maîtrise du contenu <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données<br />
- le mo<strong>de</strong> d’administration <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong>s données et la prise en compte <strong>de</strong>s<br />
réalités locales<br />
- le test <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> collecte<br />
Le processus <strong>de</strong> collecte <strong>de</strong> données a eu lieu du 11 au 14 juin dans l’ensemble <strong>de</strong>s quatre<br />
régions. Dans chaque région, un superviseur d’enquêteur avait la responsabilité <strong>de</strong><br />
coordonner les travaux <strong>de</strong> terrain. Le superviseur procédait également à la revue <strong>de</strong>s<br />
questionnaires (contrôle <strong>de</strong> cohérence et d’exhaustivité).<br />
2.2.4. Traitement <strong>de</strong>s données<br />
Les données collectées ont été saisies à la suite <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> terrain. La saisie <strong>de</strong>s<br />
données a été organisée à Thiès afin d’apporter un meilleur soutien aux opérateurs <strong>de</strong> saisie.<br />
Les données recueillies ont été apurées au cours d’une session <strong>de</strong> nettoyage <strong>de</strong> fichiers.<br />
Après la mise en fichier, les principaux traitements et analyses <strong>de</strong> données <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> ont été<br />
réalisés au moyen du logiciel SPSS.<br />
2.3. Recensement et Diagnostic <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services<br />
2.3.1 Recherche et rassemblement <strong>de</strong> bases <strong>de</strong> données <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services<br />
d’appui au développement <strong>de</strong>s micros et petites entreprises.<br />
Plusieurs structures ont été mises à contribution pour une consultation <strong>de</strong> leurs différentes<br />
bases <strong>de</strong> données <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises. Ainsi, les bases<br />
<strong>de</strong> données <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> cinq structures ont-elles été exploitées à savoir : PROMER1,<br />
ADEPME-GTZ, PAPES-PADELU, GRET-InfoConseil, FFP.<br />
2.3.2. Recensement <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services non financiers au niveau <strong>de</strong>s quatre<br />
zones <strong>de</strong> PROMERII.<br />
Ce recensement s’est effectué sur la base <strong>de</strong>s sections I et II du questionnaire d’enquête<br />
prestataires (annexe 4). Ces pages recueillent pour chaque prestataire : <strong>de</strong>s informations <strong>de</strong><br />
base, le niveau <strong>de</strong> qualification et d’expérience, les ressources physiques et logistiques <strong>de</strong><br />
travail, le package <strong>de</strong> services offert ainsi que les conditions et modalités <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong><br />
chaque service. Ces <strong>de</strong>ux premières pages serviront donc à renseigner la base <strong>de</strong> données<br />
globale <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services i<strong>de</strong>ntifiés dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>.<br />
2.3.3. Diagnostic approfondi <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services au niveau <strong>de</strong>s quatre<br />
zones <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> et à Dakar.<br />
P a g e | 16
Un tri a été effectué sur l’ensemble <strong>de</strong>s prestataires i<strong>de</strong>ntifiés par le recensement en vue<br />
d’en choisir un échantillon représentatif <strong>de</strong> l’ensemble. Les critères suivants ont guidés ce<br />
choix: un nombre minimum compris entre 5 et 10 prestataires par région, le statut du<br />
prestataire (public, privé, etc.), la nature <strong>de</strong> la structure (consultant individuel, bureau<br />
d’étu<strong>de</strong>s, etc.), le niveau <strong>de</strong> formalisation, et le niveau d’étu<strong>de</strong> et d’expérience <strong>de</strong> métier. Ce<br />
travail d’approfondissement et <strong>de</strong> diagnostic <strong>de</strong>s prestataires a permis <strong>de</strong> comprendre les<br />
approches <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong>s services d’une localité à une autre, les conditions <strong>de</strong> fourniture<br />
<strong>de</strong>s services, la motivation et l’engagement <strong>de</strong>s prestataires, etc., pour servir <strong>de</strong> base à<br />
l’analyse qualitative <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services d’appui non financiers au niveau <strong>de</strong>s zones<br />
étudiées.<br />
2.3.4. Animation <strong>de</strong> focus groups.<br />
Les séances <strong>de</strong> focus group rassemblaient pour chaque localité un nombre <strong>de</strong> 20 à 25<br />
acteurs <strong>de</strong> la zone, composé proportionnellement <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong> services d’appui non<br />
financiers, <strong>de</strong> MPER, <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong> structures d’appui dont un représentant <strong>de</strong><br />
PROMER II (le Chargé du Suivi du Prestataire <strong>de</strong> la zone) <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s<br />
organisations professionnelles, <strong>de</strong>s chambres consulaires et l’animateur. Les focus groups<br />
ont permis <strong>de</strong> créer un cadre <strong>de</strong> discussion entre les différents acteurs du marché <strong>de</strong> services<br />
aux entreprises. Il y a eu un partage d’expériences propre à chaque localité. Une matrices<br />
FFOM réalisée en séance avec la contribution <strong>de</strong>s participants a permis <strong>de</strong> comprendre les<br />
points soulevés selon qu’on se situe du côté <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> ou <strong>de</strong> l’encadrement.<br />
P a g e | 17
III. Résultats et Diagnostic<br />
Le traitement et l’analyse <strong>de</strong>s données recueillies <strong>de</strong>s trois principales sources <strong>de</strong> données<br />
utilisées dans l’étu<strong>de</strong> ont permis l’analyse <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non<br />
financiers. Après une présentation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers, son analyse<br />
apporte <strong>de</strong>s réponses sur l’attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s MPER face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers, les<br />
déterminants <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services et les facteurs <strong>de</strong> renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>.<br />
Quant à l’analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>, elle est présentée sous <strong>de</strong>ux aspects : l’analyse quantitative et<br />
l’analyse qualitative. Puis conformément aux termes <strong>de</strong> référence <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, une analyse<br />
croisée <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services est présentée en fin <strong>de</strong> chapitre.<br />
3.1. Données statistiques sur les MPER et les prestataires<br />
3.1.1. Les Micro et Petites Entreprises Rurales<br />
L’enquête quantitative menée auprès <strong>de</strong>s MPE rurales dans les quatre régions <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong> a<br />
permis <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong>s données décrivant les entrepreneurs ruraux ainsi que leur entreprise.<br />
a) Couverture <strong>de</strong> l’échantillon <strong>de</strong> l’enquête quantitative<br />
La validité <strong>de</strong>s analyses dépend du niveau <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong> l’échantillon <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>. Le<br />
tableau ci-après donne la couverture <strong>de</strong> l’échantillon dans chacune <strong>de</strong>s quatre régions<br />
d’étu<strong>de</strong>.<br />
Tableau 3 : Couverture <strong>de</strong> l’échantillon<br />
Répartition MPER sélectionnées et enquêtées par région.<br />
Régions<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès<br />
Toutes les<br />
régions<br />
Enquêtes MPER<br />
MPER sélectionnées 50 50 50 50 200<br />
MPER enquêtées 50 50 50 48 198<br />
Taux <strong>de</strong> couverture (%) 100,0 100,0 100,0 96,0 99,0<br />
Au cours <strong>de</strong> l’enquête quantitative, la quasi-totalité <strong>de</strong>s MPE rurales <strong>de</strong> l’échantillon a été<br />
effectivement enquêtée. Le taux <strong>de</strong> couverture est <strong>de</strong>100% pour trois <strong>de</strong>s quatre régions.<br />
Pour la région <strong>de</strong> Thiès, 2 <strong>de</strong>s 50 MPER prévues n’ont pas été enquêtées ; ce qui amène le<br />
taux <strong>de</strong> couverture globale à 99%. Un tel niveau <strong>de</strong> couverture <strong>de</strong> l’échantillon est très<br />
satisfaisant.<br />
b) Caractéristiques <strong>de</strong>s MPE rurales<br />
Les caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs influencent la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et/ou l’utilisation d’un<br />
service non financier. Le tableau suivant présente les MPE rurales enquêtées en fonction <strong>de</strong><br />
P a g e | 18
caractéristiques telles que la taille <strong>de</strong> l’entreprise, le chiffre d’affaires, les appuis reçus,<br />
etc...<br />
Tableau 3 : Caractéristiques <strong>de</strong>s MPE Rurales enquêtées.<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales selon la région et le type d’entreprise, le type d’appui reçu, les ressources<br />
humaines, l’immatriculation <strong>de</strong> l’entreprise et le Chiffres d’affaires. Sauf indication explicite, les chiffres<br />
sont donnés en %.<br />
Régions<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès<br />
Les 4<br />
régions<br />
Typologie 2<br />
Porteur d’initiative 2,0 10,0 26,0 12,8 12,7<br />
AGR 14,0 38,0 22,0 27,7 25,4<br />
Micro-Entreprise 82,0 52,0 50,0 59,6 60,9<br />
Très Petite Entreprise 2,0 0,0 2,0 0,0 1,0<br />
Bénéficiaire d’appui<br />
PROMER 1 58,0 54,0 0,0 0,0 35,4<br />
Autre acteur 24,0 6,0 40,0 41,7 27,8<br />
Sans appui 18,0 40,0 60,0 58,3 43,9<br />
Ressources Humaines <strong>de</strong> la<br />
MPER<br />
Effectifs moyens (en nombre) 8,2 13,7 17,2 23,2 15,5<br />
% <strong>de</strong> femmes par MPER 41,1 45,6 48,2 61,2 48,9<br />
% <strong>de</strong> salariés par MPER 13,5 26,3 34,3 51,4 31,2<br />
% d’employés à plein temps 74,2 76,7 73,0 73,3 74,3<br />
Immatriculation et Statut <strong>de</strong> la<br />
MPER<br />
MPER immatriculées 12,0 46,0 46,0 25,0 32,3<br />
Chiffres d’affaires et<br />
Investissements (en F CFA)<br />
CA mensuel 180.019 130.632 246.555 145.076 170.952<br />
Investissements réalisés 587.372 294.898 468.677 630.889 499.483<br />
Par rapport aux types d’entreprises enquêtées, il ressort que les MPE sont les plus<br />
nombreuses <strong>de</strong> l’échantillon (60,9%), avec un pic <strong>de</strong> 82% à Kaolack. Les AGR suivent<br />
avec 25,4% ; les TPE sont faibles dans l’échantillon avec seulement 1%. Les porteurs<br />
d’initiatives par contre représentent 12,7% <strong>de</strong> l’échantillon avec seulement 2% à Kaolack.<br />
Ainsi, une extrapolation permet-elle <strong>de</strong> conclure que 86% <strong>de</strong> la cible est composée <strong>de</strong><br />
Micro entreprises et d’AGR<br />
Le tiers <strong>de</strong>s MPER rencontrées ont déjà collaboré avec le PROMER au cours <strong>de</strong> sa<br />
première phase ; elles sont localisées dans les régions <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> Kolda et<br />
représentent respectivement 58% et 54% <strong>de</strong>s MPER enquêtées dans ces régions.<br />
A côté <strong>de</strong>s MPER partenaires du PROMER I, on note un important groupe <strong>de</strong> MPER<br />
(43,9%) qui n’ont jamais reçu un quelconque appui. Cette proportion <strong>de</strong> MPER sans appui<br />
approche les 2/3 dans les <strong>de</strong>ux nouvelles régions.<br />
Appuis divers et variés accordés dans les régions d’intervention <strong>de</strong> PROMER I<br />
2 La typologie est celle employée par le PROMER. Par contre, une AGR est définie comme une entreprise<br />
dont le CA annuel n’excè<strong>de</strong> pas 500.000 F CFA, l’effectif n’est pas pris en compte dans la classification <strong>de</strong>s<br />
MER et <strong>de</strong>s TPER<br />
P a g e | 19
Les appuis, provenant du PROMER I ou d‘autres intervenants, accordés aux MPER<br />
enquêtées, sont divers et variés.<br />
Figure 1 : Répartition <strong>de</strong>s appuis reçus par les MPER selon la région d’implantation<br />
Ils vont <strong>de</strong> la<br />
formation<br />
technique<br />
Thiès<br />
aux visites<br />
d’échanges<br />
en passant<br />
Matam<br />
par l’appui<br />
commercial<br />
et l’appui au<br />
Kolda<br />
financement. Kaolack<br />
Les régions<br />
<strong>de</strong> Kaolack et<br />
0 20 40 60 80<br />
<strong>de</strong> Kolda,<br />
régions<br />
d’interventio<br />
Formation technique<br />
Appui commercial<br />
Formation en gestion<br />
Visite d'échanges<br />
Financement<br />
n <strong>de</strong><br />
PROMER I, sont celles où les MPER ont reçu le plus grand nombre d’appuis. Cela pourrait<br />
s’expliquer par le fait que les types d’appui analysés correspon<strong>de</strong>nt aux actions entreprises<br />
par le PROMER I au bénéfice <strong>de</strong>s MPER partenaires. Globalement la formation (en<br />
particulier la formation technique) est la première forme d’appui consenti au bénéfice <strong>de</strong><br />
ces MPER.<br />
Le tiers seulement <strong>de</strong>s MPER est immatriculé et seul un employé sur trois est salarié<br />
Pour contribuer significativement à la structuration et la dynamisation <strong>de</strong> l’économie locale<br />
dans un contexte marqué par la décentralisation, la MPER doit entre autres s’acquitter <strong>de</strong><br />
ses obligations légales. L’immatriculation <strong>de</strong>s entreprises est donc une exigence majeure en<br />
vue notamment <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong>s appuis d’un projet étatique. Cependant, seul le tiers <strong>de</strong>s<br />
MPER enquêtées affirment être immatriculées. Dans chacune <strong>de</strong>s quatre régions, moins <strong>de</strong><br />
la moitié <strong>de</strong>s MPER sont immatriculées. Ce défi <strong>de</strong> la formalisation est plus grand dans la<br />
région <strong>de</strong> Kaolack, ancienne région du PROMER I où seulement 12% <strong>de</strong>s MPER sont<br />
immatriculées.<br />
L’étu<strong>de</strong> révèle également une particularité <strong>de</strong> l’entreprenariat rural : les employés <strong>de</strong>s<br />
MPER ne vivent pas tous <strong>de</strong>s produits <strong>de</strong> l’entreprise. En effet, seulement 31,2% <strong>de</strong>s<br />
employés <strong>de</strong>s MPER sont salariés, alors que la part <strong>de</strong>s employés à plein temps est bien<br />
plus importante (3 employés sur 4). Cette faiblesse dans la rétribution <strong>de</strong> la main d’œuvre<br />
réduit l’impact économique et social <strong>de</strong>s MPER en particulier celui <strong>de</strong>s GPF où le nombre<br />
moyen d’employés salariés n’est que <strong>de</strong> 18,5% par MPER.<br />
Les MPER enquêtées sont <strong>de</strong>s micro entreprises par leur chiffre d’affaires et petites<br />
entreprises par leur taille<br />
Le chiffre d’affaires mensuel moyen par MPER est d’environ 170.000 F CFA ; soit<br />
2.050.000 F CFA par an. ¾ <strong>de</strong>s MPER enquêtées ont un chiffre d’affaires annuel inférieur<br />
P a g e | 20
à 2.400.000 F CFA, alors que l’objectif chiffré <strong>de</strong> 3000 MPER à appuyer doit comprendre<br />
1000 PE dont 800 nouvelles. Par ailleurs, l’effectif moyen d’une MPER est <strong>de</strong> 15 employés<br />
avec une moyenne <strong>de</strong> 8 employés dans la région <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> 23 employés dans la<br />
région <strong>de</strong> Thiès.<br />
Ces données soulignent la particularité <strong>de</strong> la MPER qui n’est pas appréhendée par les<br />
définitions en vigueur. En effet, selon la typologie du PROMER (dérivée <strong>de</strong> la charte <strong>de</strong>s<br />
PME), les MPER étudiées sont à la fois <strong>de</strong>s micros entreprises (MER) par leur chiffre<br />
d’affaires, qui n’excè<strong>de</strong> pas les 15.000.000 F CFA et <strong>de</strong>s petites entreprises (PE), par leur<br />
effectif qui est compris entre 10 et 20 employés. Cette particularité <strong>de</strong> la MPER mérite une<br />
conceptualisation et une définition spécifiques.<br />
Une Typologie possible<br />
Figure 2 : Répartition <strong>de</strong>s MPER enquêtées par région et par statut <strong>de</strong> l’entreprise<br />
Le graphique cicontre<br />
donne la<br />
répartition <strong>de</strong>s<br />
MPER selon le<br />
statut <strong>de</strong><br />
l’entreprise.<br />
Il apparaît une forte<br />
présence <strong>de</strong>s MPER<br />
individuelles dans<br />
les quatre régions.<br />
Thiès<br />
Matam<br />
Kolda<br />
Kaolack<br />
La région <strong>de</strong><br />
Kaolack se<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100%<br />
distingue par<br />
environ 9<br />
MPER individuelle Association GIE GPF<br />
entreprises sur 10<br />
qui sont <strong>de</strong>s MPER individuelles. La forme collective <strong>de</strong>s MPER est plus fréquente dans les<br />
trois autres régions. On y trouve <strong>de</strong>s GIE, <strong>de</strong>s GPF et, dans une moindre mesure, <strong>de</strong>s<br />
associations. Les GIE, groupements d’intérêt économique, réunissent <strong>de</strong>s hommes et/ou <strong>de</strong>s<br />
femmes dans une activité économique. Les GPF par contre sont essentiellement composées<br />
<strong>de</strong> femmes qui mènent diverses activités incluant <strong>de</strong>s AGR et <strong>de</strong>s activités permettant <strong>de</strong><br />
valoriser la position sociale <strong>de</strong> la femme. Enfin, les associations sont <strong>de</strong>s groupements <strong>de</strong><br />
personnes ayant une double fonction (sociale et économique), avec une prédominance du<br />
caractère social.<br />
P a g e | 21
La typologie retenue<br />
Tableau 4 : Typologie et filières <strong>de</strong>s MPE Rurales enquêtées<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales selon la typologie employée par le PROMER, la filière et le genre du<br />
chef d’entreprise. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Typologie PROMER<br />
Ensemble<br />
PIE AGR MER TPER<br />
Filière<br />
Bâtiment 0,0 0,0 75,0 25,0 100,0<br />
Bois 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0<br />
Boulangerie 13,3 13,3 66,7 6,7 100,0<br />
Cajou 50,0 0,0 50,0 0,0 100,0<br />
Coiffure 18,2 18,2 63,6 0,0 100,0<br />
Commerce 9,1 27,3 63,6 0,0 100,0<br />
Elevage 17,9 25,6 56,4 0,0 100,0<br />
Laiterie 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0<br />
Métal mécanique 0,0 15,8 84,2 0,0 100,0<br />
Prestation <strong>de</strong> services 31,3 18,8 43,8 6,3 100,0<br />
Savonnerie 9,1 63,6 27,3 0,0 100,0<br />
Textile 9,5 38,1 52,4 0,0 100,0<br />
Transformation 9,4 25,0 65,6 0,0 100,0<br />
Transport 25,0 0,0 75,0 0,0 100,0<br />
Toutes les filières 13,1 24,1 61,3 1,6 100,0<br />
Genre du Chef d’entreprise<br />
Homme 9,4 20,8 67,9 1,9 100,0<br />
Femme 17,6 28,2 52,9 1,2 100,0<br />
Il a été difficile <strong>de</strong> faire un classement définitif par filière, d’une part à cause <strong>de</strong><br />
l’exhaustivité <strong>de</strong>s filières cibles potentielles <strong>de</strong> PROMER et d’autre part, parce que<br />
certaines filières ont plus une dimension d’activité. Il a donc été procédé à un regroupement<br />
<strong>de</strong> tous ceux qui se ressemblent. Par exemple, dans « prestation <strong>de</strong> services », on retrouvera<br />
les activités telles que télé centre, photographie, audiovisuel…Dans « transformation », on<br />
inclura la transformation <strong>de</strong> fruits et légumes, <strong>de</strong> certains produits agricoles et parfois même<br />
<strong>de</strong> cueillette. La présence d’activité <strong>de</strong> commerce dans l’échantillon montre l’existence <strong>de</strong><br />
MPER enquêtées qui ne sont pas cibles <strong>de</strong> PROMER. Les résultats qui suivent doivent<br />
permettre <strong>de</strong> voir la pertinence ou non d’appuyer une telle activité.<br />
Ces hypothèses étant, on note que parmi les porteurs d’initiative, il n’y a pas d’idée<br />
d’entreprise sur le bâtiment, le bois, le métal mécanique, la transformation <strong>de</strong> lait. Ces<br />
activités ou filières <strong>de</strong>mandant une certaine capacité technique, les porteurs d’idées ne s’y<br />
orientent pas facilement. C’est dans le bâtiment et la boulangerie qu’on trouve<br />
essentiellement les Très Petites Entreprises. L’élément <strong>de</strong> classification étant le chiffre<br />
d’affaire, cette situation se comprend aisément puisque les intervenants dans ce domaine<br />
gèrent <strong>de</strong>s réalisations énormes. Les Micro entreprises sont surtout présentes dans les<br />
activités /filières suivante : le bois, le métal mécanique, la boulangerie la transformation <strong>de</strong><br />
lait et le transport. La savonnerie regroupe le taux d’AGR le plus important avec presque<br />
67% <strong>de</strong>s AGR<br />
Le pourcentage <strong>de</strong>s chefs d’entreprise femme est plus élevé au niveau <strong>de</strong>s PIE et <strong>de</strong>s AGR ;<br />
il est plus faible pour les MER et les TPER. Ceci signifie que les chiffres d’affaires<br />
(postulat <strong>de</strong> départ) les plus élevés sont perceptibles au niveau <strong>de</strong>s entreprises dirigées par<br />
les hommes. Cette tendance progressive vers une catégorisation est à prendre en compte<br />
dans la réponse à apporter aux différents groupes.<br />
P a g e | 22
c) Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux<br />
L’entrepreneur est la personne qui, dans la MPER, prend les principales décisions <strong>de</strong><br />
gestion. La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>, l’utilisation ou la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers sont <strong>de</strong>s<br />
décisions prises par l’entrepreneur. Il importe donc d’analyser les caractéristiques telles le<br />
genre, l’âge et le niveau d’instruction <strong>de</strong>s entrepreneurs. Le tableau ci-<strong>de</strong>ssous décrit les<br />
entrepreneurs enquêtés en fonction <strong>de</strong> ces caractéristiques et selon la région d’implantation.<br />
Tableau 5 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs enquêtés.<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux selon la région et le genre, l’âge et le niveau d’instruction. Sauf<br />
indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Régions<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès<br />
Les 4<br />
régions<br />
Genre du chef d’entreprise<br />
Hommes 56,0 60,0 66,0 41,7 56,1<br />
Femmes 44,0 40,0 34,0 58,3 43,9<br />
Age du Chef d’entreprise<br />
Moins <strong>de</strong> 30 ans 26,0 12,0 10,0 4,2 13,1<br />
Entre 30 et 40 ans 34,0 38,0 26,0 8,3 26,8<br />
Entre 40 et 50 ans 30,0 40,0 28,0 27,1 31,3<br />
Plus <strong>de</strong> 50 ans 10,0 10,0 36,0 60,4 28,8<br />
Niveau d’instruction<br />
Aucune 40,0 54,0 66,0 62,5 55,6<br />
Primaire 34,0 24,0 24,0 14,6 24,2<br />
Secondaire 26,0 20,0 8,0 18,8 18,2<br />
Supérieur 0,0 2,0 2,0 4,2 2,0<br />
Quasi-égalité du nombre d’hommes et <strong>de</strong> femmes entrepreneurs<br />
Dans l’échantillon <strong>de</strong>s MPER étudiées, 56,1% <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux sont <strong>de</strong>s hommes et<br />
43,9% <strong>de</strong>s femmes. Cette statistique qui décrit la situation dans les quatre régions, montre<br />
une quasi-égalité d’hommes et <strong>de</strong> femmes. Cependant on note une majorité (58%) <strong>de</strong><br />
femmes responsables <strong>de</strong> MPER dans la région <strong>de</strong> Thiès.<br />
Un assez bon niveau d’instruction dans l’ensemble mais une situation critique dans la<br />
région <strong>de</strong> Thiès<br />
55,6% <strong>de</strong>s entrepreneurs enquêtés n’ont aucune instruction. Cependant à la lumière <strong>de</strong>s<br />
réalités du mon<strong>de</strong> rural, cette indication est favorable pour le PROMER II, car elle signifie<br />
que plus <strong>de</strong> 44% <strong>de</strong>s MPER sont dirigées par <strong>de</strong>s personnes ayant au moins une instruction<br />
<strong>de</strong> niveau primaire. Ce groupe d’entrepreneurs scolarisés est, potentiellement, un bon<br />
réceptacle <strong>de</strong> transfert <strong>de</strong> diverses compétences notamment en matière <strong>de</strong> services non<br />
financiers (tels que les produits GERME).<br />
P a g e | 23
Figure 3 : Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux enquêtés par région,<br />
Toutefois, la situation globale<br />
cache <strong>de</strong>s disparités régionales.<br />
Dans les régions <strong>de</strong> Thiès et <strong>de</strong><br />
Matam, ce sont près <strong>de</strong> 2/3 <strong>de</strong>s<br />
entrepreneurs qui ne sont pas<br />
instruits ; ce qui ne reflète pas<br />
la priorité à accor<strong>de</strong>r aux<br />
entrepreneurs disposant d’un<br />
certain niveau d’instruction,<br />
conformément à la rationalité<br />
du PROMER II. Dans la<br />
région <strong>de</strong> Thiès, cette situation<br />
s’ajoute à une forte présence <strong>de</strong><br />
personnes âgées parmi les<br />
entrepreneurs enquêtées :<br />
60,4% <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong> Thiès sont<br />
dirigées par <strong>de</strong>s personnes<br />
âgées <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ans.<br />
Comme l’illustre le graphique<br />
ci-contre, la moyenne d’âge <strong>de</strong>s<br />
personnes n’ayant aucune<br />
instruction ou qui ont un niveau<br />
primaire dans la région <strong>de</strong> Thiès<br />
est supérieure à 50 ans. Il difficile <strong>de</strong> parvenir à un changement <strong>de</strong> comportement<br />
significatif lorsque la cible promue est constituée par <strong>de</strong>s personnes <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 50 ans,<br />
particulièrement dans le mon<strong>de</strong> rural. L’objectif du PROMER II <strong>de</strong> faire émerger <strong>de</strong>s<br />
agents <strong>de</strong> changement (1000 PE, dont 800 nouvelles) sera difficilement atteint dans ces<br />
conditions. Une attention particulière <strong>de</strong>vra donc être apportée à la sélection <strong>de</strong>s MPER<br />
partenaires du PROMER II dans les nouvelles régions. Il faudra veiller à respecter la<br />
procédure <strong>de</strong> sélection en insistant notamment sur l’analyse <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> d’appui par le<br />
comité <strong>de</strong> sélection, l’évaluation <strong>de</strong> la viabilité du projet présenté ainsi que <strong>de</strong>s capacités et<br />
<strong>de</strong> la motivation <strong>de</strong> l’entrepreneur, <strong>de</strong> manière à faire émerger les 1000 PE qui auront, pour<br />
les autres MPER, un rôle <strong>de</strong> modèles à imiter.<br />
3.1.2. Les Prestataires <strong>de</strong> services<br />
a) Description uni et bidimensionnelle<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers requiert une <strong>de</strong>scription approfondie <strong>de</strong>s<br />
prestataires <strong>de</strong> ces services. Dans le cadre <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>, un recensement <strong>de</strong> prestataires <strong>de</strong><br />
services a permis d’i<strong>de</strong>ntifier 122 prestataires <strong>de</strong> services répartis <strong>de</strong> façon relativement<br />
égale dans les quatre régions. Le tableau <strong>de</strong> la page suivante souligne cette répartition (34 à<br />
Thiès, 31 à Kolda, 30 à Kaolack, et 27 à Matam) et sa catégorisation.<br />
P a g e | 24
Tableau 6 : Eléments du recensement <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services<br />
Répartition <strong>de</strong>s Prestataires recensés par région. Sauf mention explicite, les données sont présentées en<br />
fréquences absolues.<br />
Régions<br />
Toutes les<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès régions<br />
Nombre <strong>de</strong> Prestataires recensés 30 31 27 34 122<br />
Statut du prestataire<br />
Privé 28 29 26 32 115<br />
Public 2 2 1 2 7<br />
Type <strong>de</strong> prestataire<br />
Bureau d'étu<strong>de</strong> 8 3 6 15 32<br />
Chambre consulaire 2 1 0 3 6<br />
Consultant indépendant 16 19 19 10 64<br />
Coopérative <strong>de</strong> services 0 1 0 0 1<br />
ONG 2 4 1 4 11<br />
OP 1 1 0 0 2<br />
Service étatique 1 2 1 2 6<br />
Formalisation du prestataire<br />
Avec Registre <strong>de</strong> commerce 12 23 6 12 53<br />
Avec NINEA 5 8 2 18 33<br />
% <strong>de</strong> prestataires disposant <strong>de</strong> :<br />
Matériel informatique 56,7% 35,5% 63,0% 79,4% 59,0%<br />
Véhicule 30,0% 25,8% 40,7% 58,8% 39,3%<br />
Matériel audiovisuel 6,7% 6,5% 22,2% 17,6% 13,1%<br />
Effectifs par prestataire<br />
Nombre d’employés 2,2 3,0 1,9 3,0 2,5<br />
La prestation <strong>de</strong> services non financiers est un marché dominé par <strong>de</strong>s entreprises privées,<br />
consultants indépendants ou bureaux d’étu<strong>de</strong><br />
Près <strong>de</strong> 95% <strong>de</strong>s prestataires recensés sont <strong>de</strong>s entreprises privées. Les prestataires publics<br />
sont très faiblement présents dans les quatre régions <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>. Plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s<br />
prestataires recensés sont <strong>de</strong>s consultants indépendants alors qu’un peu plus du quart est<br />
constitué <strong>de</strong> bureaux d’étu<strong>de</strong>s. La région <strong>de</strong> Thiès se distingue par une forte proportion <strong>de</strong><br />
bureaux d’étu<strong>de</strong>s.<br />
Les prestataires <strong>de</strong> services sont <strong>de</strong>s micro entreprises moyennement équipées et peu<br />
formalisées<br />
Les prestataires <strong>de</strong> services ne comptent en moyenne que 2,5 employés. Ce chiffre révèle le<br />
faible développement <strong>de</strong> ces entreprises et explique la forte présence <strong>de</strong>s consultants<br />
indépendants. 44% <strong>de</strong>s prestataires recensés disposent <strong>de</strong> registre <strong>de</strong> commerce, mais<br />
seulement 27% d’entre eux ont un NINEA. Cette situation révèle le paradoxe <strong>de</strong> la faible<br />
formalisation d’entreprises ayant pour mission <strong>de</strong> favoriser le développement d’un tissu<br />
formel <strong>de</strong> MPE rurales.<br />
Existence <strong>de</strong> prestataires peu diplômés dans l’ancienne zone du PROMER I<br />
Les régions <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> Kolda, anciennes zones d’intervention du PROMER I<br />
connaissent une forte proportion <strong>de</strong> prestataires n’ayant pas le baccalauréat comme l’illustre<br />
le graphique ci-<strong>de</strong>ssous.<br />
P a g e | 25
Figure 4 : Répartition <strong>de</strong>s prestataires par région et selon le niveau le plus élevé dans la structure<br />
100%<br />
80%<br />
60%<br />
40%<br />
20%<br />
0%<br />
La forte présence <strong>de</strong> prestataires peu diplômés dans certaines zones pourrait s’expliquer par<br />
le souci <strong>de</strong> faire émerger <strong>de</strong>s professionnels locaux notamment dans les domaines<br />
techniques. En effet, plusieurs <strong>de</strong> ces prestataires interviennent dans la formation<br />
technique ; il s’agit souvent d’artisans ou <strong>de</strong> transformateurs <strong>de</strong> produits ayant capitalisé<br />
une expertise technique avérée dans leur domaine.<br />
b) Analyse multidimensionnelle<br />
KAOLACK KOLDA MATAM THIES<br />
Sans Bac Bac Bac+1 Bac+2 Bac+3 Bac+4 Bac+5 Bac+6<br />
Afin d’aller au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la <strong>de</strong>scription unidimensionnelle <strong>de</strong>s prestataires, il convient <strong>de</strong><br />
considérer une approche multidimensionnelle. Une série <strong>de</strong> photographies <strong>de</strong>s modalités<br />
caractérisant les prestataires <strong>de</strong> services permet ainsi d’explorer au mieux les données. La<br />
métho<strong>de</strong> utilisée à cet effet est l’Analyse <strong>de</strong>s Correspondances Multiples (ACM) dont une<br />
brève <strong>de</strong>scription est présentée ci-après.<br />
Le principe <strong>de</strong> l’Analyse <strong>de</strong>s Correspondances Multiples est présenté dans l’encadré ci<strong>de</strong>ssous<br />
et les résultats sont illustrés dans le graphique factoriel <strong>de</strong> la page suivante. Le<br />
lecteur peut ne pas lire les éléments présentés en encadré, mais gar<strong>de</strong>r à l’esprit, dans<br />
l’interprétation <strong>de</strong>s graphiques, que plus <strong>de</strong>ux caractères sont proches, plus on les retrouve<br />
auprès <strong>de</strong>s mêmes individus (les prestataires <strong>de</strong> services).<br />
Dans une Analyse <strong>de</strong>s Correspondances Multiples (ACM), on a une population décrite par un<br />
ensemble <strong>de</strong> caractères, chaque caractère étant composé d'un nombre <strong>de</strong> modalités. Dans notre<br />
cas, on considère l'ensemble <strong>de</strong>s prestataires décrits par les variables qualitatives telles que la<br />
région ou le nombre d’employés. L'un <strong>de</strong>s résultats <strong>de</strong> l'ACM est la projection <strong>de</strong>s modalités sur <strong>de</strong>s<br />
plans factoriels. Sur ces plans, une modalité j va se positionner au barycentre <strong>de</strong>s modalités<br />
pondérées par leur co-occurrence avec la modalité j. Notons que la co-occurrence entre <strong>de</strong>ux<br />
modalités j et j' est le nombre d'individus possédant ces <strong>de</strong>ux caractères en même temps. C'est<br />
ainsi que sur ces plans, plus proches seront <strong>de</strong>ux modalités (géographiquement parlant), plus le<br />
nombre d'individus qui possè<strong>de</strong>nt ces <strong>de</strong>ux modalités en même temps sera grand. Par exemple, si<br />
la modalité Plus <strong>de</strong> 5 employés <strong>de</strong> la variable Nombre d’employés est très proche <strong>de</strong> la modalité<br />
ONG <strong>de</strong> la variable type <strong>de</strong> prestataire, on dira que nombreuses sont les ONG prestataires <strong>de</strong><br />
services dont l’effectif total représente plus <strong>de</strong> 5 employés. Seulement, dans l'interprétation nous<br />
<strong>de</strong>vons faire attention aux modalités centrales (proches <strong>de</strong> l'intersection <strong>de</strong>s axes) qui donnent le<br />
profil moyen. En effet pour un caractère donné, chaque modalité sera au barycentre <strong>de</strong>s individus<br />
qui la possè<strong>de</strong>nt.<br />
P a g e | 26
En reliant les modalités <strong>de</strong>s variables naturellement ordonnées comme le niveau d’instruction<br />
le plus élevé dans la structure et le nombre d’employés par cabinet, on note une évolution<br />
graduelle <strong>de</strong> la droite vers la gauche le long <strong>de</strong> l’axe 1 du plan factoriel. Le graphique met<br />
donc en opposition, à gauche, les grands prestataires (ONG, bureaux d’étu<strong>de</strong> et chambres<br />
consulaires) et, à droite, les petits prestataires (consultants indépendants). Cette analyse<br />
multidimensionnelle révèle les points suivants :<br />
Le coût <strong>de</strong> la « prestation la plus chère » ne varie pas d’un type <strong>de</strong> prestataire à un autre<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> qui n’ont pas <strong>de</strong> « prestation la plus chère » évaluée à moins<br />
<strong>de</strong> 50.000 F CFA, les prestations sont quasiment les mêmes d’un type <strong>de</strong> prestataire à un<br />
autre. Leur coût varie <strong>de</strong> 50.000 FCFA à 200.000 FCFA.<br />
Les bureaux d’étu<strong>de</strong>, équipés, formalisés, avec un personnel qualifié sont majoritairement<br />
localisés dans la région <strong>de</strong> Thiès<br />
Seuls 12% <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> n’ont ni registre <strong>de</strong> commerce, ni NINEA. En revanche, 56%<br />
<strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong>s disposent aussi bien d’un registre <strong>de</strong> commerce que d’un NINEA. De<br />
plus, près <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> recensés dans l’étu<strong>de</strong> sont localisés dans la région<br />
<strong>de</strong> Thiès. Les bureaux d’étu<strong>de</strong>s sont assez bien équipés : plus <strong>de</strong> 9 bureaux d’étu<strong>de</strong> sur 10<br />
disposent <strong>de</strong> matériel informatique et/ou <strong>de</strong> matériel audiovisuel et près <strong>de</strong>s 2/3 ont un<br />
véhicule. Enfin, dans environ près <strong>de</strong> 85% <strong>de</strong>s bureaux d’étu<strong>de</strong> le niveau d’instruction le plus<br />
élevé est au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> Bac+4.<br />
Seuls et faiblement équipés, les consultants indépendants ne sont pas formalisés<br />
60,9% <strong>de</strong>s consultants indépendants n’ont ni matériel informatique, ni matériel audiovisuel.<br />
Seuls 17% d’entre eux ont une voiture comme moyen <strong>de</strong> transport. Par ailleurs 7 consultants<br />
indépendants sur 10 n’ont ni registre <strong>de</strong> commerce, ni NINEA. Cela montre la faible capacité<br />
institutionnelle et la précarité <strong>de</strong> ce type <strong>de</strong> prestataire.<br />
c) Typologie <strong>de</strong>s prestataires<br />
Le graphique factoriel précé<strong>de</strong>nt fait apparaître six classes permettant d’affiner la<br />
caractérisation <strong>de</strong>s prestataires. En effet son interprétation permet <strong>de</strong> caractériser six classes<br />
<strong>de</strong> prestataires homogènes. Il s’agit <strong>de</strong> :<br />
27<br />
o Classe 1 : Consultants indépendants <strong>de</strong> Kolda, sans Bac ni équipement<br />
o Classe 2 : Prestataires <strong>de</strong> Kaolack sans Bac avec <strong>de</strong>s coûts <strong>de</strong> prestation faibles<br />
o Classe 3 : Consultants indépendants non formalisés, principalement à Matam<br />
o Classe 4 : Prestataires publics, services étatiques, avec plus <strong>de</strong> 5 employés<br />
o Classe 5 : ONG, avec plus <strong>de</strong> 5 employés qualifiés, dotés <strong>de</strong> moyens roulants<br />
o Classe 6 : Bureaux d’étu<strong>de</strong>s 2 à 4 employés qualifiés, formalisés, avec <strong>de</strong>s<br />
moyens informatiques et roulants
3.2. Analyse <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
3.2.1. Présentation synoptique <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
Tableau 7 : Attitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux selon l’attitu<strong>de</strong> (<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> active, <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> passive, non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>,<br />
utilisation) face à l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> service. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Deman<strong>de</strong>urs<br />
prêts à<br />
contribuer<br />
Deman<strong>de</strong>urs<br />
pas prêts à<br />
contribuer<br />
Non<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs<br />
Utilisateurs Total<br />
Alphabétisation fonctionnelle 51,5 15,1 28,8 4,5 100<br />
Approvisionnement 53,1 26,0 16,3 4,6 100<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts 60,1 26,6 11,1 2,0 100<br />
Comptabilité 69,2 18,2 8,6 4,0 100<br />
Création d'entreprise 61,6 21,7 12,1 4,5 100<br />
Entreprise et famille 64,4 24,8 8,6 2,0 100<br />
Esprit d'entreprise 48,0 23,2 10,1 18,7 100<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 58,6 27,2 13,6 0,5 100<br />
Foires et manifestations<br />
commerciales 49,5 23,2 19,7 7,6 100<br />
Formation technique 53,5 15,7 8,1 22,7 100<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 57,0 25,7 15,6 1,5 100<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources<br />
humaines 51,3 26,9 18,3 3,5 100<br />
Marketing 61,1 24,2 8,6 6,0 100<br />
NTIC 51,0 13,6 35,3 0,0 100<br />
Passation <strong>de</strong> marches 60,4 23,8 15,7 0,0 100<br />
Planification financière 60,6 24,7 10,6 4,0 100<br />
Recherche d'idée d'entreprise 59,6 23,7 12,6 4,0 100<br />
Services juridiques 60,1 29,3 10,1 0,5 100<br />
Visites d'échanges/voyages<br />
d'affaires 50,5 24,7 18,2 6,6 100<br />
3.2.2. La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services<br />
La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est très élevée pour tous les services<br />
La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> dépasse 70% pour l’ensemble <strong>de</strong>s services sauf les NTIC, la formation<br />
technique, l’alphabétisation fonctionnelle, les foires et manifestations commerciales. Si pour<br />
la formation technique le taux relativement faible s’explique par un taux élevé d’utilisateurs,<br />
pour les autres services, il s’explique par un important taux <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs.<br />
L’alphabétisation étant lié au niveau d’instruction du chef d’entreprise, sa <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est surtout<br />
perceptible chez les non scolarisés. Les NTIC sont considérées comme un service non<br />
prioritaire par la plupart <strong>de</strong>s MPER, d’où sa faible <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Pour les foires et manifestations<br />
commerciales, les MPER sont souvent confrontées à <strong>de</strong>s contraintes <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> volume<br />
<strong>de</strong> production; ce qui explique la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> moins importante <strong>de</strong> service.<br />
P a g e | 29
La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services a été<br />
par ailleurs analysée sous<br />
l’angle du paiement. Les<br />
services sont par conséquent<br />
classés en <strong>de</strong>ux groupes : les<br />
services pour lesquels la plupart<br />
<strong>de</strong>s entrepreneurs sont prêts à<br />
contribuer et les services pour<br />
lesquels, ils ne souhaitent aucun<br />
paiement malgré la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>.<br />
Au total pour chaque service,<br />
plus <strong>de</strong> 75% <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs<br />
sont prêts à contribuer. Mais<br />
cette volonté <strong>de</strong> contribuer varie<br />
d’une région à une autre.<br />
Pour certains services, la<br />
volonté <strong>de</strong> contribuer est assez<br />
élevée. Il s’agit <strong>de</strong>s NTIC, <strong>de</strong> la<br />
formation technique et <strong>de</strong><br />
l’alphabétisation fonctionnelle.<br />
Cela signifie que ceux qui<br />
s’intéressent à ces services sont<br />
suffisamment motivés pour payer ou contribuer <strong>de</strong> manière significative. L’alphabétisation est<br />
mieux considérée lorsqu’elle est <strong>de</strong>mandée que lorsqu’elle est un objectif <strong>de</strong>s facilitateurs. La<br />
formation technique est abordée par l’analyse <strong>de</strong>s besoins sous l’angle <strong>de</strong> l’amélioration <strong>de</strong> la<br />
qualité, <strong>de</strong> la mise au point <strong>de</strong> nouveaux produits, <strong>de</strong> la diversification <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong>. Ainsi<br />
perçue, elle est fortement <strong>de</strong>mandée et les MPER sont motivées à contribuer pour y accé<strong>de</strong>r.<br />
Les services <strong>de</strong> gestion sont fortement <strong>de</strong>mandés, à plus <strong>de</strong> 80% pour chaque service et avec<br />
<strong>de</strong>s engagements <strong>de</strong> contribution significative. Cette forte <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> s’explique par une bonne<br />
connaissance <strong>de</strong> ces services, mais aussi par leur impact sur l’amélioration <strong>de</strong>s aptitu<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
l’entrepreneur et <strong>de</strong>s performances <strong>de</strong> sa structure.<br />
3.2.3. Non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services<br />
Il existe <strong>de</strong>s MPER qui ne souhaitant pas recourir à certains services, même si le besoin<br />
existe.<br />
Le tableau 6 présente le comportement <strong>de</strong>s MPER face aux services et montre l’existence <strong>de</strong><br />
services pour lesquels, le recours n’est pas souhaité. Les échanges dans un tel cas ont porté<br />
sur les raisons <strong>de</strong> la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services. Ainsi, trois situations sont observées :<br />
Situation 1 : la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est très élevée<br />
1) C’est le cas <strong>de</strong>s NTIC et <strong>de</strong> l’alphabétisation fonctionnelle. Selon les résultats <strong>de</strong>s<br />
focus groups, les services qui ne sont pas <strong>de</strong>mandés malgré le besoin, le sont parce<br />
que 1) l’<strong>offre</strong> n’existe pas ; 2) le service n’est pas connu ; 3) il est jugé inaccessible ;<br />
4) il n’est pas une priorité pour l’entreprise. Ces éventualités sont applicable aux NTIC<br />
compte tenu du faible niveau <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s MPER. Par contre elles ne<br />
s’appliquent pas aisément à l’alphabétisation fonctionnelle. En effet le traitement <strong>de</strong>s<br />
données quantitatives montre une étroite relation entre le niveau <strong>de</strong> scolarisation et la<br />
P a g e | 30
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> du service<br />
alphabétisation. Ainsi,<br />
seuls les non scolarisés<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>nt en priorités<br />
ce service.<br />
Situation 2 : la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est<br />
élevée<br />
Les taux sont compris entre 15<br />
et 20 % et concernent<br />
l’approvisionnement, la gestion<br />
<strong>de</strong>s stocks, les visites<br />
d’échanges et voyages<br />
d’affaires, les foires et<br />
manifestations commerciales, la<br />
gestion <strong>de</strong>s ressources<br />
humaines, la passation <strong>de</strong><br />
marchés. Certaines MPER sont<br />
réticentes vis-à-vis <strong>de</strong> ces<br />
services pour <strong>de</strong>s raisons<br />
différentes selon le service :<br />
− L’approvisionnement et <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s stocks ne sont pas <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>mandés<br />
parce qu’ils ne règlent pas le problème d’accès à la matière première <strong>de</strong>s MPER.<br />
− Le service <strong>de</strong> gestion ressources humaines n’est <strong>de</strong>mandé que par <strong>de</strong>s entrepreneurs<br />
qui emploient plus <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux personnes. Il s’agit donc d’un service qui est <strong>de</strong>mandé<br />
qu’en fonction <strong>de</strong> la taille <strong>de</strong> l’entreprise.<br />
Par rapport aux autres services, la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> pourrait s’expliquer par le faible niveau <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s MPER. En effet pour la plus part <strong>de</strong> ces services il y a <strong>de</strong>s préalables : il<br />
faut par exemple une formation technique préalable et une production <strong>de</strong> qualité avant <strong>de</strong><br />
participer à une manifestation commerciale.<br />
Situation 3 : les services avec un faible taux <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
Ce sont les services qui sont fortement <strong>de</strong>mandés à cause <strong>de</strong> leurs effets positifs immédiats<br />
sur l’activité <strong>de</strong> la MPER. La non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> concerne alors le renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> :<br />
si le service acquis a produit <strong>de</strong>s effets positifs immédiats, le renouvellement <strong>de</strong> sa <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
est possible ; dans le cas contraire, <strong>de</strong>s réticences au renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
apparaîtront.<br />
3.2.4. Utilisation <strong>de</strong> services<br />
La formation technique, l’esprit d’entreprise, les voyages d’affaires, les foires, manifestations<br />
commerciales et le marketing sont les services les plus utilisés<br />
L’utilisation <strong>de</strong> services traduits la mise en œuvre effective, par les MPER, <strong>de</strong> compétences<br />
acquises. Elle révèle donc l’aptitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s entrepreneurs à adopter <strong>de</strong> nouveaux comportements<br />
par l’application <strong>de</strong>s connaissances et pratiques issues prestations <strong>de</strong> services <strong>de</strong> formation et<br />
P a g e | 31
<strong>de</strong> conseil. L’analyse globale <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s services étudiés sera approfondie dans la<br />
catégorisation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> par région.<br />
Au niveau <strong>de</strong> l’utilisation, les taux les plus élevés sont observés pour l’esprit d’entreprise, la<br />
formation technique, les voyages d’affaires, les foires, manifestations commerciales et le<br />
marketing. Ces services constituent l’essentiel <strong>de</strong>s appuis non financiers du PROMER I. La<br />
contribution financière est acceptée pour ces services, ce qui augure une acceptation <strong>de</strong><br />
l’approche SDE, même si le niveau <strong>de</strong> contribution annoncée est faible.<br />
Les Services juridiques, la fiscalité <strong>de</strong>s MPE, les NTIC et la passation <strong>de</strong> marchés ne sont pas,<br />
pour le moment, utilisés par les MPER <strong>de</strong> l’échantillon ou le sont très faiblement. En effet,<br />
soit ces services ne sont pas considérés comme prioritaires, soit peu <strong>de</strong> prestataires les <strong>offre</strong>nt.<br />
Cependant, comme les échanges dans les focus groups ont révélé un intérêt porté à ces<br />
services, il est important d’appuyer leur développement.<br />
Parmi les services <strong>de</strong> gestion, le marketing est le plus utilisé. Ce service se présente dès lors<br />
comme un service maîtrisé par les prestataires. En effet malgré une gamme <strong>de</strong> services<br />
souvent étroite, la plus part <strong>de</strong>s prestataires disposent <strong>de</strong> modules <strong>de</strong> marketing qu’il<br />
proposent avec une approche claire.<br />
L’utilisation du calcul <strong>de</strong>s coûts est la plus faible parmi les services <strong>de</strong> gestion. La plupart <strong>de</strong>s<br />
MPER sont dans l’artisanat <strong>de</strong> production ou <strong>de</strong> service et ont été pendant longtemps<br />
appuyées selon une logique <strong>de</strong> définition du prix <strong>de</strong> revient qui ne prend pas en compte la<br />
dimension coût direct, coût indirect, coût par article. Cette lacune issue <strong>de</strong>s structures<br />
d’encadrement perdure et explique la faible utilisation du calcul <strong>de</strong>s coûts.<br />
P a g e | 32
3.2.5. Catégorisation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> par région<br />
Deman<strong>de</strong> avec contribution<br />
Elle a été analysée d’abord en fonction <strong>de</strong>s services puis en fonction <strong>de</strong>s filières et <strong>de</strong>s<br />
services :<br />
Analyse en fonction <strong>de</strong>s services<br />
Tableau 8 : Caractéristiques <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs prêts à contribuer financièrement.<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux par région et la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> « active » du service. Sauf indication explicite, les<br />
chiffres sont donnés en %.<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès Ensemble<br />
Alphabétisation fonctionnelle 30,0 68,0 68,0 39,6 51,5<br />
Approvisionnement 40,0 65,3 81,6 25,0 53,1<br />
Calcul <strong>de</strong>s coûts 48,0 64,0 92,0 35,4 60,1<br />
Comptabilité 44,0 80,0 92,0 60,4 69,2<br />
Création d'entreprise 46,0 64,0 84,0 52,1 61,6<br />
Entreprise et famille 58,0 67,3 90,0 41,7 64,5<br />
Esprit d'entreprise 22,0 40,0 96,0 33,3 48,0<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 48,0 64,0 94,0 27,1 58,6<br />
Foires et manifestations<br />
commerciales 38,0 50,0 92,0 16,7 49,5<br />
Formation technique 34,0 42,0 88,0 50,0 53,5<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 44,0 66,0 90,0 27,1 57,1<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines 40,0 65,3 82,0 16,7 51,3<br />
Marketing 54,0 66,0 84,0 39,6 61,1<br />
NTIC 52,0 62,0 58,0 31,3 51,0<br />
Passation <strong>de</strong> marches 52,0 68,0 94,0 25,5 60,4<br />
Planification financière 48,0 64,0 84,0 45,8 60,6<br />
Recherche d'idée d'entreprise 46,0 66,0 82,0 43,8 59,6<br />
Services juridiques 48,0 66,0 94,0 31,3 60,1<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires 38,0 52,0 96,0 14,6 50,5<br />
La <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est ici analysée sous l’angle <strong>de</strong> la volonté <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs à contribuer<br />
financièrement. La logique SDE et l’objectif <strong>de</strong> pérennisation du marché exigent une<br />
participation croissante <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs aux coûts <strong>de</strong>s prestations. Cette volonté <strong>de</strong> contribuer<br />
est examinée par région en fonction <strong>de</strong>s 19 services étudiés. Les données quantitatives<br />
précisent le niveau <strong>de</strong> contribution dans les quatre régions <strong>de</strong> l’étu<strong>de</strong>.<br />
L’analyse du tableau montre les tendances globales et les spécificités régionales qui ont été<br />
confirmées par les résultats <strong>de</strong>s focus Groups.<br />
La première lecture montre une volonté <strong>de</strong> contribuer plus élevée dans les régions <strong>de</strong> Matam<br />
et <strong>de</strong> Kolda. Il est difficile <strong>de</strong> l’expliquer par l’intervention du PROMER I puisque Matam<br />
n’était pas couvert par la première phase du PROMER. Cette observation pousse donc à une<br />
analyse plus approfondie. L’analyse montre que le comportement d’achat diffère d’une<br />
région à l’autre selon le service. Par exemple, pour le service « esprit d’entreprise » <strong>de</strong>mandé<br />
dans toutes les régions, beaucoup <strong>de</strong> MPER <strong>de</strong> Matam sont prêtes à contribuer alors qu’à<br />
Kolda et Kaolack, la volonté <strong>de</strong> contribuer est faible. Cette situation pourrait s’expliquer par<br />
une absence <strong>de</strong> contribution lors <strong>de</strong>s interventions antérieures <strong>de</strong> PROMER I.<br />
P a g e | 33
Au niveau <strong>de</strong> la région <strong>de</strong> Kaolack, les services pour lesquels les <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs sont le plus<br />
engagés à contribuer financièrement sont le marketing et le service « Entreprise et famille ».<br />
Dans cette région, les entreprises individuelles et les jeunes chefs d’entreprise sont les plus<br />
nombreux. Le comportement observé peut donc s’expliquer par la pression sociale qui pousse<br />
le jeune entrepreneur à régler au plus vite ce problème et par le fait que les structures<br />
d’appui ont davantage appuyé le marketing parmi les services <strong>de</strong> gestion. Ainsi le marketing<br />
est-il le service le plus connu et ses effets positifs observés chez certains entrepreneurs <strong>de</strong><br />
Kaolack poussent d’autres à le solliciter et à s’engager à payer. En effet les résultats <strong>de</strong>s<br />
Focus groups à Kaolack ont montré une forte liaison entre la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et la réussite <strong>de</strong>s<br />
premiers <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs qui apparaissent ainsi comme <strong>de</strong>s modèles à imiter : « A Kaolack et à<br />
Fatick on observe d’abord ; et lorsqu’on constate <strong>de</strong> la réussite, on suit ».<br />
Dans la région <strong>de</strong> Kolda, la comptabilité et l’alphabétisation fonctionnelle sont les services où<br />
plus <strong>de</strong>s 2/3 <strong>de</strong>s MPER sont prêtes à contribuer. La région <strong>de</strong> Kolda se caractérise par<br />
l’existence à la fois <strong>de</strong> micro entrepreneurs opérant <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> subsistance et <strong>de</strong> micro<br />
entrepreneurs avec <strong>de</strong>s chiffres d’affaires plus élevés. Les premiers ont très tôt compris que<br />
l’entrepreneur rural a besoin, pour se développer, <strong>de</strong> savoir lire et écrire dans une langue ;<br />
d’où leur motivation <strong>de</strong> contribuer à l’acquisition du service d’alphabétisation fonctionnelle.<br />
Les MPER avec <strong>de</strong>s chiffres d’affaires plus élevés sont par contre intéressées par la<br />
comptabilité pour diminuer le recours aux prestataires pour l’établissement d’états financiers<br />
simplifiés, bilan et compte d’exploitation.<br />
La région <strong>de</strong> Matam, comme nous l’avons dit plus haut, est la région où les micro<br />
entrepreneurs ruraux sont le plus motivés à contribuer financièrement. Pour tous les services<br />
le pourcentage <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs prêts à contribuer atteint 80%. Le pic est constaté au niveau<br />
<strong>de</strong>s visites d’échanges et <strong>de</strong>s voyages d’affaires, même si le lien direct entre la volonté <strong>de</strong><br />
recourir à ce service et l’amélioration les performances <strong>de</strong> l’entreprise mérite d’être analysé.<br />
Au niveau <strong>de</strong> Thiès, on enregistre le plus faible taux <strong>de</strong> volonté <strong>de</strong> contribuer pour acquérir<br />
les services. Cette situation s’explique par la multiplicité <strong>de</strong>s intervenants, notamment <strong>de</strong>s<br />
structures d’appui, avec <strong>de</strong>s démarches d’assistance. La forte représentation <strong>de</strong> groupements<br />
<strong>de</strong> femmes dans l’échantillon pourrait aussi expliquer le faible nombre <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs prêts à<br />
contribuer car la participation à une formation ou à un appui conseil revêt souvent un<br />
caractère <strong>de</strong> représentation chez les groupements <strong>de</strong> femmes.<br />
P a g e | 34
Analyse en fonction <strong>de</strong>s filières et <strong>de</strong>s services<br />
Tableau 9 : Deman<strong>de</strong>urs « actifs » <strong>de</strong> services par filière<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales <strong>de</strong>mandant les services et prêtes à contribuer par filière. Sauf indication explicite, les<br />
chiffres sont donnés en %.<br />
Approvisionne<br />
ment<br />
Comptabilité<br />
Foires<br />
Services<br />
Filière<br />
Bâtiment 100,0 100,0 75,0 75,0 100,0 100,0 75,0 100,0 100,0<br />
Bois 50,0 75,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0 75,0 75,0<br />
Boulangerie 53,3 66,7 60,0 60,0 46,7 40,0 60,0 66,7 73,3<br />
Cajou 100,0 100,0 100,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Coiffure 18,2 45,5 27,3 27,3 54,5 27,3 27,3 45,5 36,4<br />
Commerce 18,2 63,6 27,3 45,5 36,4 27,3 36,4 36,4 45,5<br />
Elevage 61,0 85,7 57,1 54,8 66,7 71,4 64,3 64,3 66,7<br />
Laiterie 100,0 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Métal mécanique 35,0 40,0 25,0 40,0 35,0 20,0 15,0 30,0 45,0<br />
Prestation <strong>de</strong> services 56,3 81,3 62,5 75,0 75,0 75,0 50,0 75,0 75,0<br />
Savonnerie 100,0 100,0 75,0 66,7 58,3 66,7 100,0 100,0 100,0<br />
Textile 52,4 61,9 52,4 42,9 33,3 33,3 42,9 66,7 57,1<br />
Transformation 45,5 52,9 32,4 35,3 50,0 26,5 50,0 50,0 35,3<br />
Transport 75,0 100,0 75,0 75,0 50,0 75,0 25,0 75,0 75,0<br />
Visite<br />
d’échanges<br />
Formation<br />
technique<br />
Esprit<br />
d’entreprise<br />
Alphabétisation<br />
fonctionnelle<br />
Le tableau ci-<strong>de</strong>ssus montre une variation significative dans la volonté <strong>de</strong> contribuer selon les<br />
filières. Les filières pour lesquelles les entrepreneurs ont une réelle volonté <strong>de</strong> contribuer<br />
sont : le bâtiment, la filière cajou, la filière lait et la savonnerie. Par contre pour certaines<br />
filières/activités (coiffure, commerce, métal mécanique, transformation) la contribution est<br />
faible. Les premières sont essentiellement au niveau <strong>de</strong>s TPER et <strong>de</strong>s MER et les seconds sont<br />
au niveau <strong>de</strong>s AGR sauf pour le métal mécanique. Ces résultats traduisent un comportement<br />
d’achat en fonction <strong>de</strong>s filières et du type <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>ur (PIE, AGR, MER, TPER)<br />
Dans le cadre <strong>de</strong>s interventions, il est important <strong>de</strong> considérer cette situation qui traduit le<br />
comportement d’un groupe donné face à la nature <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Cette situation permet <strong>de</strong><br />
comprendre que les appuis doivent être définis en fonction <strong>de</strong>s groupes <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs.<br />
Marketing<br />
Services<br />
juridiques<br />
P a g e | 35
Deman<strong>de</strong> sans contribution<br />
En fonction <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s régions<br />
Tableau 10 : Caractéristiques <strong>de</strong>s <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs sans volonté <strong>de</strong> contribuer financièrement<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux par région et la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> « passive » du service. Sauf indication explicite, les<br />
chiffres sont donnés en %.<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès Ensemble<br />
Alphabétisation fonctionnelle 24,0 8,0 29,2 15,2<br />
Approvisionnement 24,0 20,4 2,0 58,3 26,0<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts 20,0 28,0 2,0 58,3 26,8<br />
Comptabilité 24,0 14,0 2,0 33,3 18,2<br />
Création d'entreprise 22,0 30,0 35,4 21,7<br />
Entreprise et famille 28,0 24,5 47,9 24,9<br />
Esprit d'entreprise 14,0 20,0 2,0 58,3 23,2<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 22,0 32,0 2,0 54,2 27,3<br />
Foires et manifestations<br />
commerciales 10,0 18,0 2,0 7,6<br />
Formation technique 18,0 8,0 37,5 15,7<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 24,0 22,0 2,0 56,3 25,8<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines 22,0 26,5 2,0 58,3 26,9<br />
Marketing 22,0 24,0 2,0 50,0 24,2<br />
NTIC 26,0 8,0 2,0 18,8 13,6<br />
Passation <strong>de</strong> marches 30,0 28,0 2,0 36,2 23,9<br />
Planification financière 26,0 28,0 2,0 43,8 24,7<br />
Recherche d'idée d'entreprise 22,0 28,0 2,0 43,8 23,7<br />
Services juridiques 34,0 32,0 2,0 50,0 29,3<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires 22,0 24,0 2,0 52,1 24,7<br />
Le tableau ci-<strong>de</strong>ssus fournit <strong>de</strong>s informations sur les services pour lesquels les MPER ne<br />
souhaitent pas contribuer. Il en ressort qu’à Matam lorsque certains services sont <strong>de</strong>mandés,<br />
la non contribution est nulle. Cette information est intéressante pour les prestataires <strong>de</strong> ces<br />
services ; elle implique une analyse préalable <strong>de</strong>s besoins avant toute <strong>offre</strong> <strong>de</strong> services.<br />
A Kolda, pour certains services (Alphabétisation fonctionnelle, formation technique, NTIC)<br />
le taux <strong>de</strong> non contribution est relativement faible. La stratégie <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> ces<br />
services doit par conséquent mettre l’accent sur la qualité <strong>de</strong> la prestation en sachant que la<br />
contribution est presque garantie.<br />
A Kaolack et à Thiès, la volonté <strong>de</strong> ne pas contribuer est perceptible au niveau <strong>de</strong> l’ensemble<br />
<strong>de</strong>s services (non contribution supérieure ou égal à 10%). Les services avec moins <strong>de</strong> non<br />
contribution sont les foires et manifestations commerciales pour Kaolack et les NTIC pour<br />
Thiès.<br />
P a g e | 36
En fonction <strong>de</strong>s filières et <strong>de</strong>s services<br />
Tableau 11 : Deman<strong>de</strong>urs « passifs » <strong>de</strong> services par filière<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales <strong>de</strong>mandant les services mais ne désirant pas contribuer par filière. Sauf indication<br />
explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Approvisionne<br />
ment<br />
Comptabilité<br />
Foires<br />
Services<br />
Filière<br />
Bâtiment 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Bois 25,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0<br />
Boulangerie 20,0 20,0 20,0 13,3 13,3 13,3 13,3 20,0 20,0<br />
Cajou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Coiffure 54,5 27,3 45,5 45,5 9,1 36,4 27,3 36,4 54,5<br />
Commerce 63,6 36,4 27,3 36,4 36,4 54,5 36,4 45,5 36,4<br />
Elevage 29,3 11,9 31,0 31,0 21,4 23,8 7,1 23,8 28,6<br />
Laiterie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Métal mécanique 30,0 15,0 35,0 30,0 5,0 25,0 15,0 25,0 50,0<br />
Prestation <strong>de</strong> services 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 0,0 12,5 12,5<br />
Savonnerie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Textile 23,8 19,0 23,8 28,6 9,5 28,6 23,8 28,6 38,1<br />
Transformation 30,3 38,2 29,4 32,4 29,4 32,4 26,5 38,2 35,3<br />
Transport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0<br />
Visite<br />
d’échanges<br />
Formation<br />
technique<br />
Esprit<br />
d’entreprise<br />
Alphabétisation<br />
fonctionnelle<br />
A l’instar <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> active, le tableau ci-<strong>de</strong>ssus montre le comportement <strong>de</strong>s MPER dans<br />
les différentes filières/activités face à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
Marketing<br />
Services<br />
juridiques<br />
P a g e | 37
Non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services<br />
En fonction <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s régions<br />
Tableau 12 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs ne <strong>de</strong>mandant pas <strong>de</strong> service<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux qui ne <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>nt pas un service selon la région d’implantation <strong>de</strong> la MPER.<br />
Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès Ensemble<br />
Alphabétisation fonctionnelle 42,0 24,0 20,0 29,2 28,8<br />
Approvisionnement 36,0 14,3 2,0 12,5 16,3<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts 30,0 8,0 2,0 4,2 11,1<br />
Comptabilité 24,0 4,0 2,0 4,2 8,6<br />
Création d'entreprise 30,0 6,0 2,0 10,4 12,1<br />
Entreprise et famille 14,0 8,2 2,0 10,4 8,6<br />
Esprit d'entreprise 24,0 6,0 2,0 8,3 10,1<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 28,0 4,0 4,0 18,8 13,6<br />
Foires et manifestations<br />
commerciales 28,0 8,0 4,0 39,6 19,7<br />
Formation technique 8,0 6,0 6,0 12,5 8,1<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 30,0 12,0 6,0 14,6 15,7<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines 38,0 8,2 2,0 25,0 18,3<br />
Marketing 14,0 8,0 2,0 10,4 8,6<br />
NTIC 22,0 30,0 40,0 50,0 35,4<br />
Passation <strong>de</strong> marches 18,0 4,0 4,0 38,3 15,7<br />
Planification financière 22,0 8,0 2,0 10,4 10,6<br />
Recherche d'idée d'entreprise 30,0 6,0 4,0 10,4 12,6<br />
Services juridiques 18,0 2,0 4,0 16,7 10,1<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires 32,0 6,0 2,0 33,3 18,2<br />
La non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> d’un service s’explique par le souhait <strong>de</strong> l’entrepreneur <strong>de</strong> ne pas recourir<br />
au dit service.<br />
A Kaolack, l’alphabétisation fonctionnelle, les ressources humaines, l’approvisionnement, les<br />
visites d’échanges et voyages d’affaires ont le taux <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> le plus élevé. Si la<br />
plupart <strong>de</strong>s entrepreneurs ne <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>nt pas l’alphabétisation fonctionnelle, c’est certainement<br />
parce que le taux d’analphabètes dans l’échantillon est faible et les entrepreneurs jeunes. Pour<br />
les ressources humaines, le taux élevé <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> s’explique par le caractère souvent<br />
individuel <strong>de</strong>s MPER. Enfin, l’approvisionnement est en relation avec le sta<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
développement l’activité qui, souvent, ne justifie pas le recours à ce service.<br />
A Kolda, ce sont les NTIC et l’alphabétisation fonctionnelle qui ont le taux le plus élevé <strong>de</strong><br />
non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Les NTIC ne sont pas jugées prioritaires pour les MPER <strong>de</strong> Kolda. Le taux<br />
élevé <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> pour l’alphabétisation fonctionnelle s’explique par le taux élevé <strong>de</strong><br />
scolarisation (primaire et secondaire) <strong>de</strong>s chefs d’entreprise ainsi que par les actions du<br />
PROMER I.<br />
A Matam, les services avec les taux les plus élevés <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> sont les NTIC et<br />
l’alphabétisation fonctionnelle. Matam n’a pas bénéficié <strong>de</strong> la première phase du PROMER,<br />
mais certains projets tels que le PRODAM ont y ont mené beaucoup d’activités<br />
d’alphabétisation.<br />
P a g e | 38
Enfin à Thiès, certains services comme les NTIC, l’alphabétisation fonctionnelle, la passation<br />
<strong>de</strong> marchés, les foires et manifestations commerciales, les visites d’échanges et voyages<br />
d’affaires ont les taux les élevés <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Cela s’explique par le faible niveau <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong> Thiès qui ne rend pas prioritaires ces services.<br />
En fonction <strong>de</strong>s filières et <strong>de</strong>s services<br />
Tableau 13 : Non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs <strong>de</strong> services par filière<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales ne <strong>de</strong>mandant pas les services par filière. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés<br />
en %.<br />
Approvisionne<br />
ment<br />
Comptabilité<br />
Foires<br />
Services<br />
Filière<br />
Bâtiment 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0<br />
Bois 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0<br />
Boulangerie 13,3 6,7 6,7 6,7 0,0 6,7 26,7 6,7 6,7<br />
Cajou 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Coiffure 27,3 18,2 27,3 27,3 18,2 36,4 36,4 9,1 9,1<br />
Commerce 0,0 0,0 27,3 18,2 9,1 0,0 27,3 0,0 18,2<br />
Elevage 2,4 2,4 11,9 14,3 2,4 2,4 21,4 4,8 4,8<br />
Laiterie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Métal mécanique 35,0 25,0 35,0 20,0 10,0 20,0 70,0 25,0 5,0<br />
Prestation <strong>de</strong> services 25,0 6,3 37,5 18,8 18,8 12,5 37,5 12,5 12,5<br />
Savonnerie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Textile 23,8 19,0 9,5 23,8 14,3 9,5 28,6 4,8 4,8<br />
Transformation 24,2 5,9 29,4 26,5 2,9 11,8 17,6 8,8 26,5<br />
Transport 25,0 0,0 25,0 25,0 50,0 25,0 75,0 25,0 0,0<br />
Visite<br />
d’échanges<br />
Formation<br />
technique<br />
Esprit<br />
d’entreprise<br />
Alphabétisation<br />
fonctionnelle<br />
Certains services ne sont pas <strong>de</strong>mandés par les MPER <strong>de</strong>s différentes filières/activités. La non<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> est très élevée en alphabétisation fonctionnelle pour la filière métal mécanique et le<br />
transport. La filière métal mécanique étant assez représentée au niveau micro entreprise, le<br />
taux élevé d’utilisation <strong>de</strong> l’alphabétisation permet <strong>de</strong> comprendre le taux élevé <strong>de</strong> non<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>ur. En effet lorsque l’utilisation est perceptible et la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> faible, la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
peut se comprendre par le fait que les MPER qui restent ont un niveau élevé au point où elles<br />
n’ont pas besoin <strong>de</strong> recourir au service pour accroître les performances <strong>de</strong> leur entreprise.<br />
Au niveau <strong>de</strong> la formation technique, le taux <strong>de</strong> non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> élevé au niveau du transport se<br />
comprend par le fait que ce service n’est pas prioritaire dans le cadre <strong>de</strong> cette filière. Ces<br />
informations seront confirmées dans l’analyse <strong>de</strong>s modalités pratiques <strong>de</strong> recours au service<br />
qui doivent être fonction du besoin <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong> l’entreprise, du plan marketing du<br />
prestataire, <strong>de</strong> l’effet d’imitation et parfois <strong>de</strong> la gratuité du service<br />
Utilisation <strong>de</strong>s services<br />
Dans cette section, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’utilisation du service selon la région, les modalités<br />
opérationnelles sont analysées ainsi que les déterminants du passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente<br />
<strong>de</strong> service au recours effectif pour les quelques services qui ont été utilisés par les MPER.<br />
Marketing<br />
Services<br />
juridiques<br />
P a g e | 39
Tableau 14 : Caractéristiques <strong>de</strong>s entrepreneurs utilisant les services<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux qui utilisent un service selon la région d’implantation <strong>de</strong> la MPER.<br />
Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Kaolack Kolda Matam Thiès Ensemble<br />
Alphabétisation fonctionnelle 4,0 0,0 12,0 2,1 4,5<br />
Approvisionnement 0,0 0,0 14,3 4,2 4,6<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts 2,0 0,0 4,0 2,1 2,0<br />
Comptabilité 8,0 2,0 4,0 2,1 4,0<br />
Création d'entreprise 2,0 0,0 14,0 2,1 4,5<br />
Entreprise et famille 0,0 0,0 8,0 0,0 2,0<br />
Esprit d'entreprise 40,0 34,0 0,0 0,0 18,7<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 2,0 0,0 0,0 0,0 0,5<br />
Foires et manifestations<br />
0,0<br />
commerciales 10,0 18,0 2,0<br />
Formation technique 40,0 44,0 6,0 0,0 22,7<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 2,0 0,0 2,0 2,1 1,5<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines 0,0 0,0 14,0 0,0 3,6<br />
Marketing 10,0 2,0 12,0 0,0 6,1<br />
NTIC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Passation <strong>de</strong> marches 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Planification financière 4,0 0,0 12,0 0,0 4,0<br />
Recherche d'idée d'entreprise 2,0 0,0 12,0 2,1 4,0<br />
Services juridiques 0,0 0,0 0,0 2,1 0,5<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires 8,0 18,0 0,0 0,0 6,6<br />
L’analyse du tableau, ci-<strong>de</strong>ssus, complète l’analyse globale <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong> services et<br />
permet <strong>de</strong> voir que, sauf pour la formation technique et l’esprit d’entreprise, l’utilisation <strong>de</strong><br />
services est faible dans les anciennes zones du PROMER I, Kaolack et Kolda. Il permet<br />
d’observer, un comportement différent entre les MPER appuyées par PROMER I et celles<br />
non appuyées par PROMER I. La première différence se situe au niveau <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong><br />
certains services. Les services tels que la formation technique, les foires et manifestations<br />
commerciales, l’esprit d’entreprise, les visites d’échanges et voyages d’affaires, sont plus<br />
fortement utilisés par les entrepreneurs <strong>de</strong> Kolda et <strong>de</strong> Kaolack ; alors que leur niveau<br />
d’utilisation dans les <strong>de</strong>ux nouvelles régions est négligeable. La situation <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong><br />
services à Kaolack et à Kolda pourrait s’expliquer par l’insuffisance du suivi <strong>de</strong>s prestations<br />
dans les anciennes zones du PROMER I. En effet c’est à travers le suivi que le prestataire<br />
apporte à la MPER l’assistance nécessaire à la mise en œuvre <strong>de</strong>s connaissances et pratiques<br />
acquises.<br />
On note à Matam un taux moyen <strong>de</strong> 8% dans les services utilisés, avec <strong>de</strong>s pics pour<br />
l’approvisionnement (14,3%), la gestion <strong>de</strong>s ressources humaines (14%), la création<br />
d’entreprise (14%). Cette situation pourrait s’expliquer par le fait que les appuis reçus à<br />
Matam ne datent pas <strong>de</strong> longtemps et que par conséquent le taux <strong>de</strong> mise en œuvre est élevé.<br />
Dans les autres régions, la faiblesse du suivi expliquerait les faibles taux d’utilisation <strong>de</strong>s<br />
services, comme en atteste les faibles taux d’utilisation <strong>de</strong> l’alphabétisation à Kaolack et à<br />
Kolda, les régions d’intervention du PROMER I.<br />
Trois dimensions ont été analysées dans l’acquisition d’un service. Ces dimensions que nous<br />
avons appelées ici modalités opérationnelles d’acquisition <strong>de</strong>s services sont : les raisons du<br />
recours au service pour la première fois, la fréquence <strong>de</strong> paiement pour le service et les<br />
7,6<br />
P a g e | 40
modalités d’utilisation du service. Il faut cependant souligner que l’analyse ne concerne que<br />
les filières/activités où il y a eu utilisation d’un ou <strong>de</strong> plusieurs services au moins une fois.<br />
Tableau 15 : Raisons du recours au service pour la première fois<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales utilisant les services étudiés selon la filière et la raison du recours au<br />
service. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Besoin <strong>de</strong><br />
développe<br />
ment <strong>de</strong><br />
l'entreprise<br />
Raison du recours au service pour la première fois<br />
Réussite<br />
d'autres<br />
utilisateurs<br />
<strong>de</strong> ce<br />
service<br />
Le<br />
prestataire<br />
est venu me<br />
présenter<br />
son produit<br />
Gratuité du<br />
service<br />
Autre<br />
Filière<br />
Boulangerie 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Coiffure 75,0 0,0 0,0 25,0 0,0<br />
Commerce 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Elevage 85,2 0,0 11,1 3,7 0,0<br />
Laiterie 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Métal mécanique 81,3 6,3 0,0 6,3 6,3<br />
Prestation <strong>de</strong> services 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Textile 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0<br />
Transformation 90,0 10,0 0,0 0,0 0,0<br />
Transport 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Toutes les filières 88,8 3,4 3,4 3,4 1,1<br />
L’analyse <strong>de</strong>s raisons d’utilisation <strong>de</strong>s services a été faite à travers les résultats <strong>de</strong>s données<br />
quantitatives et qualitatives <strong>de</strong>s focus group. Le recours au service pour la première fois<br />
s’explique essentiellement par quatre situations selon les données quantitatives. Pour 88,8%<br />
<strong>de</strong>s MPER enquêtées, le recours à un service s’explique par le besoin <strong>de</strong> développement <strong>de</strong><br />
l’entreprise. A ce niveau, à part les textiles (0%), la coiffure (75%), la métal mécanique<br />
(82,3%), l’élevage (85%) et la transformation (90%), toutes les MPER <strong>de</strong>s autres filières<br />
estiment que ce qui les pousse à acheter un service pour la première fois est l’objectif <strong>de</strong><br />
développement <strong>de</strong> l’entreprise. La <strong>de</strong>uxième raison avancée est la réussite <strong>de</strong> d’autres<br />
utilisateurs, c'est-à-dire l’effet d’imitation pour la filière textile. Cette raison est avancée pour<br />
toutes les MPER <strong>de</strong> cette filière. Cela se comprend si l’on voit la composition <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong><br />
cette filière qui évolue essentiellement dans la couture confection. Par rapport à la stratégie<br />
marketing du prestataire, seulement 3,4% <strong>de</strong>s MPER l’ont donnée comme raison du premier<br />
recours notamment dans la filière Elevage. Ceci qui augure que le plan marketing <strong>de</strong>s<br />
prestataires n’est pas souvent adapté au besoin <strong>de</strong>s MPER. Enfin, les MPER <strong>de</strong> la filière métal<br />
mécanique, <strong>de</strong> l’élevage et <strong>de</strong> la coiffure soutiennent qu’ils ont utilisé le service pour la<br />
première fois parce que c’était gratuit. Ce qui confirme la faible volonté <strong>de</strong> contribuer <strong>de</strong>s<br />
MPER <strong>de</strong> ces filières, généralement appuyées par certaines structures <strong>de</strong> l’Etat en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong><br />
toute logique <strong>de</strong> marché notamment les chambres <strong>de</strong> métiers.<br />
P a g e | 41
Tableau 16 : Fréquence <strong>de</strong> paiement pour le service<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales utilisant les services étudiés selon la filière et la fréquence <strong>de</strong> paiement<br />
pour le service. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Fréquence <strong>de</strong> paiement pour le service<br />
Chaque fois Souvent Quelques<br />
fois<br />
Ne paie<br />
jamais<br />
Total<br />
Filière<br />
Boulangerie 11,1 0,0 0,0 88,9 100,0<br />
Coiffure 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0<br />
Commerce 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0<br />
Elevage 0,0 0,0 7,1 92,9 100,0<br />
Laiterie 0,0 50,0 0,0 50,0 100,0<br />
Métal mécanique 6,3 0,0 0,0 93,8 100,0<br />
Prestation <strong>de</strong> services 10,0 0,0 30,0 60,0 100,0<br />
Textile 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0<br />
Transformation 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0<br />
Transport 3,4 1,1 6,9 88,5 100,0<br />
Toutes les filières 3,4 1,1 6,9 88,5 100,0<br />
La fréquence <strong>de</strong> paiement est analysée aussi dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong> selon les modalités<br />
suivantes : chaque fois (lorsque chaque utilisation a fait l’objet <strong>de</strong> paiement), souvent (quand<br />
il y a plus <strong>de</strong> fois <strong>de</strong> paiement que <strong>de</strong> non paiement), quelques fois (si le nombre <strong>de</strong> fois <strong>de</strong><br />
non paiement est largement supérieur au nombre <strong>de</strong> fois <strong>de</strong> paiement) ne paie jamais lorsque<br />
aucun paiement n’a été effectué). Il ressort que 88,5% <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong> toutes les filières ne<br />
paient jamais et ce, principalement dans les filières transformation, <strong>de</strong> métal mécanique, <strong>de</strong><br />
coiffure, <strong>de</strong> commerce et d’élevage. L’analyse <strong>de</strong> ces résultats en rapport avec le tableau<br />
précédant montre que lorsque le service est utilisé pour les besoins <strong>de</strong> développement <strong>de</strong><br />
l’entreprise, l’entrepreneur paie toujours ou souvent tandis que si le service est utilisé pour sa<br />
gratuité, l’entrepreneur ne paie jamais. La fréquence <strong>de</strong> paiement au niveau <strong>de</strong> la filière lait et<br />
au niveau <strong>de</strong> la boulangerie est plus élevée relativement aux autres filières/activités.<br />
P a g e | 42
Tableau 17 : Modalités opérationnelles d’utilisation du service<br />
Montant<br />
moyen<br />
payé à la<br />
<strong>de</strong>rnière<br />
utilisation<br />
(en F CFA)<br />
Modalités opérationnelles d’utilisation <strong>de</strong> services<br />
Nombre<br />
d’utilisation<br />
au cours<br />
<strong>de</strong>s 12<br />
<strong>de</strong>rniers<br />
mois<br />
Années<br />
écoulées<br />
<strong>de</strong>puis la<br />
première<br />
utilisation<br />
Années<br />
écoulées<br />
<strong>de</strong>puis la<br />
<strong>de</strong>rnière<br />
utilisation<br />
Durée<br />
moyenne<br />
d’utilisation<br />
du service<br />
(en années)<br />
Filière<br />
Boulangerie 500,0 20,0 3,5 1,5 2,0<br />
Coiffure 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0<br />
Elevage 6.000,0 2,0 3,0 1,0 2,0<br />
Laiterie 0,0 2,5 3,0 0,0 3,0<br />
Métal mécanique 2.500,0 4,0 3,8 2,0 1,8<br />
Prestation <strong>de</strong> services 26.250,0 0,0 3,5 1,8 1,8<br />
Transformation 0,0 5,0 4,7 2,3 2,3<br />
Toutes les filières 12.200,0 4,2 3,4 1,5 1,9<br />
Les différentes modalités opérationnelles d’utilisation <strong>de</strong>s services concernent :<br />
Le montant moyen payé à la <strong>de</strong>rnière utilisation : exprimé en FCFA, ce montant traduit le<br />
niveau <strong>de</strong> contribution <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong> chaque filière, le montant le plus élevé étant <strong>de</strong> 26 250<br />
FCFA pour la filière prestation <strong>de</strong> services.<br />
Le nombre d’utilisation au cours <strong>de</strong>s 12 <strong>de</strong>rniers mois : il donne le nombre <strong>de</strong> fois que les<br />
MPER <strong>de</strong> la filière ont utilisé le service pendant les 12 <strong>de</strong>rniers mois.<br />
Les années écoulées <strong>de</strong>puis la première utilisation : cette modalité renseigne sur la durée<br />
d’utilisation du service au niveau <strong>de</strong> la filière.<br />
Les années écoulées <strong>de</strong>puis la <strong>de</strong>rnière utilisation : elle renseigne sur la pério<strong>de</strong> écoulée sans<br />
utilisation du service.<br />
La durée moyenne d’utilisation du service : elle renseigne sur le nombre <strong>de</strong> fois que le service<br />
est utilisé par année.<br />
Les résultats montrent que les MPER <strong>de</strong> toutes les filières ont utilisé les services plus <strong>de</strong><br />
quatre fois la <strong>de</strong>rnière année. Cette fréquence cache certaines disparités au niveau <strong>de</strong>s<br />
filières/activités. Les MPER <strong>de</strong> la filière Boulangerie ont utilisé <strong>de</strong>s services plus <strong>de</strong> 20 fois<br />
les 12 <strong>de</strong>rniers mois contre zéro utilisation pour celles <strong>de</strong> la filière prestation <strong>de</strong> services.<br />
Le début d’utilisation <strong>de</strong>s services pour tous les services remonte à plus <strong>de</strong> 3 ans, ce qui<br />
signifie qu’en moyenne, les services sont utilisés <strong>de</strong>puis plus <strong>de</strong> 3 ans sauf la coiffure où les<br />
services ont été utilisé il y a seulement un an.<br />
Ces résultats aussi pertinents qu’ils soient ne doivent pas cacher une certaine limite par<br />
rapport aux services. En effet, une certaine agrégation a été faite compte tenu du faible niveau<br />
d’utilisation <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong>s résultats insignifiants pour certains services pris<br />
individuellement.<br />
P a g e | 43
Tableau 18 : Analyse <strong>de</strong>s déterminants du passage d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente au recours effectif au service<br />
Présentation <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong>s variables sur le recours aux services. Les effets positifs sont représentés avec le symbole (+),<br />
les effets négatifs sont représentés par le symbole (-) et les effets nuls sont symbolisés par (*). L’importance <strong>de</strong> l’effet est<br />
matérialisée par le nombre <strong>de</strong> symboles présentés.<br />
Approvisionne<br />
ment<br />
Comptabilité<br />
Foires<br />
Visite<br />
d’échanges<br />
Services<br />
Formation<br />
technique<br />
Esprit<br />
d’entreprise<br />
Variables<br />
Age du Chef d'entreprise * * * * * - * *<br />
Effectif total <strong>de</strong> l'entreprise ++ +++ * * * * * *<br />
Nombre <strong>de</strong> salariés * ++ * * * * * *<br />
Employés à plein temps ++ ++ * * * * * *<br />
CA mensuel ++ ++ * * * * * +<br />
Investissements réalisés * * * * * * * *<br />
Proportion <strong>de</strong>s femmes * - * * * * * --<br />
% <strong>de</strong>s salariés * * * - * - * *<br />
% <strong>de</strong>s employés à plein<br />
++ * -- * * * + *<br />
temps<br />
Femme Chef d’entreprise * - * * * * * --<br />
Appui PROMER * * ++++ ++++ ++++ ++++ * *<br />
Autre Appui * * -- - - - * *<br />
Chef sans instruction * * * * * * * *<br />
Chef niveau primaire * * * * * * * *<br />
Chef niveau secondaire * * * * * * * *<br />
MPER immatriculée + * * + * * * +++<br />
Le questionnaire MPER prenait en compte l’aspect analyse <strong>de</strong>s besoins compte tenu <strong>de</strong> la<br />
spécificité <strong>de</strong> la cible. En effet, le faible niveau <strong>de</strong>s MPER rendait difficile un traitement<br />
direct <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> sans passer par l’analyse du besoin. Ainsi pour chaque service, l’analyse<br />
du besoin permet quatre éventualités. Le besoin existe, il est manifeste (reconnu par la<br />
MPER), latent (existe mais non i<strong>de</strong>ntifié par la MPER) ou inexistant. Le tableau suivant<br />
montre les facteurs déterminant le passage d’un besoin latent à un recours effectif au service<br />
non financier. Pour un certain nombre <strong>de</strong> services, plusieurs variables (facteurs) qui ont une<br />
influence sur le service sont observées. Lorsque l’influence est positive, le signe (+) est<br />
utilisé, le signe (-) quand il est négatif et (*) lorsqu’il est nul et ce, pour un certain nombre <strong>de</strong><br />
services non financiers.<br />
Pour le service approvisionnement, le passage est favorisé par l’effectif <strong>de</strong> l’entreprise, le<br />
nombre d’employés à temps plein, le chiffre d’affaire mensuel et l’immatriculation <strong>de</strong><br />
l’entreprise. Par rapport à ce service, lorsque ces facteurs sont présents, le recours effectif est<br />
facilité en d’autres termes, ces facteurs permettent aisément le passage du besoin latent au<br />
recours effectif au service non financier. Les autres facteurs ont une influence nulle.<br />
Pour recourir à la comptabilité, ce sont les facteurs tels que l’effectif, le nombre d’employés à<br />
temps plein, le chiffre d’affaire, le nombre <strong>de</strong> salariés qui l’influent positivement. Par contre,<br />
la proportion <strong>de</strong> femmes influe négativement <strong>de</strong> même que lorsque le chef d’entreprise est<br />
une femme. Il est donc plus aisé <strong>de</strong> passer d’une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> latente à un recours effectif lorsque<br />
le chef d’unité est un homme et lorsque la proportion <strong>de</strong> femmes est faible dans l’unité.<br />
Marketing<br />
Planification<br />
financière<br />
P a g e | 44
Par rapport aux services foires, visites d’échanges, formation technique et esprit d’entreprise,<br />
le facteur appui PROMER a une influence positive sur le recours au service. Ces services qui<br />
sont usuels dans PROMER I sont passés d’une situation <strong>de</strong> latence à un recours effectif à<br />
travers les appuis <strong>de</strong> PROMER. C’est ce qui justifie la forte corrélation entre le passage du<br />
besoin latent au recours effectif et l’appui PROMER. La question est <strong>de</strong> savoir, comment la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> a été stimulée à travers l’intervention <strong>de</strong> PROMER I , c'est-à-dire si il y a eu une<br />
définition préalable <strong>de</strong>s services et une stimulation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> ces services ou<br />
l’i<strong>de</strong>ntification du besoin d’abord et la fourniture <strong>de</strong> services après.<br />
Pour l’esprit d’entreprise, l’âge du chef d’entreprise a une influence négative sur le recours<br />
effectif au service. En effet la sensibilisation à l’esprit d’entreprise est mieux consommée par<br />
les jeunes et lorsque le besoin est latent, le recours effectif est plus aisé quand l’entrepreneur<br />
est jeune que quand il est vieux.<br />
Au niveau <strong>de</strong> la planification financière, l’immatriculation <strong>de</strong> l’entreprise a une influence<br />
significative sur le recours effectif au service. Comme la comptabilité, lorsque l’entreprise est<br />
reconnue, il <strong>de</strong>vient aisé <strong>de</strong> recourir au service <strong>de</strong> planification financière. Par contre,<br />
l’influence est négative avec la proportion <strong>de</strong> femmes et le chef d’entreprise femme. Ces<br />
services exigent une certaine organisation et un certain un certain niveau qui n’est pas<br />
toujours le cas lorsque la proportion <strong>de</strong> femmes est élevée.<br />
Les exemples graphiques ci-<strong>de</strong>ssous permettent d’illustrer ce qui est dit plus haut à travers la<br />
comptabilité et la planification financière.<br />
1. Comptabilité<br />
P a g e | 45
2. Planification financière<br />
3.3. Analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong><br />
3.3.1. L’environnement <strong>de</strong> la fourniture <strong>de</strong> services dans les 4 zones<br />
3.3.1.1. Région <strong>de</strong> Thiès<br />
• Caractéristiques <strong>de</strong> la zone<br />
Thiès est une région carrefour qui se trouve à 70 km <strong>de</strong> Dakar avec une bonne accessibilité<br />
aux infrastructures <strong>de</strong> base et avec <strong>de</strong> fortes potentialités en matière <strong>de</strong> ressources naturelles<br />
notamment dans la zone maraîchère <strong>de</strong>s Niayes.<br />
Thiès est un croisement <strong>de</strong>s différents mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> communication, surtout dans le domaine <strong>de</strong>s<br />
services avec le développement <strong>de</strong> l’Internet matérialisé par la présence <strong>de</strong>s cyber et <strong>de</strong>s télé<br />
centres. D’ailleurs, le premier centre informatique communautaire du Sénégal a été installé à<br />
Thiès dans la localité <strong>de</strong> Ngoundiane.<br />
C’est aussi un grand pôle intellectuel et culturel, avec la présence <strong>de</strong>s écoles <strong>de</strong> formation <strong>de</strong><br />
renoms comme la Polytechnique, le CNEPS, et l’université <strong>de</strong> Banbéye. La Région abrite<br />
aussi la Manufacture <strong>de</strong>s Arts décoratifs un monument mondialement connu dans la<br />
production <strong>de</strong> tapisseries.<br />
P a g e | 46
L’artisanat y est fortement développé avec un grand village artisanal ou il est possible <strong>de</strong><br />
visiter les ateliers <strong>de</strong>s tisserands, <strong>de</strong>s menuisiers, <strong>de</strong>s sculpteurs sur bois etc. et le grand pôle<br />
<strong>de</strong>s métiers du cuir (Cordonnerie et maroquinerie) à Ngaye Mékhé.<br />
C’est aussi une région touristique avec la petite côte et sa station balnéaire <strong>de</strong> Saly portudal.<br />
Toutes ces caractéristiques sont favorables au développement <strong>de</strong> la micro et petite entreprise.<br />
Le PROMER II est présent dans 2 zones <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> la région avec 10 communautés<br />
rurales : Touba Toul, Thiénaba, Fandéne, Keur Moussa, Noto, Fissel, Ndiaganiao, Sesséne,<br />
Sandiara, et Nguéniéne.<br />
• L’activité <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises<br />
A Thiès, on trouve une palette <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services aux petites entreprises avec <strong>de</strong>s<br />
activités <strong>de</strong> formation (modules GERME, CREE, TRI, alphabétisation fonctionnelle) et <strong>de</strong><br />
l’appui conseil avec notamment : l’élaboration <strong>de</strong> plan d’affaires, l’intermédiation financière,<br />
l’appui commercial, notamment pour les petites activités <strong>de</strong> transformations <strong>de</strong> fruits et<br />
légumes <strong>de</strong>s groupements <strong>de</strong> femmes situés dans la zone <strong>de</strong>s Niayes, le conseil en marketing<br />
avec <strong>de</strong>s supports <strong>de</strong> communication, la sérigraphie, l’organisation et la gestion, etc.<br />
Les prestataires travaillent avec les MPER, les GIE, les <strong>Groupe</strong>ment <strong>de</strong> femmes directement<br />
et/ou par l’intermédiaire <strong>de</strong>s structures d’encadrement et d’appui telles que les ONG<br />
(ex.TOSTAN), l’ ONFP, le PNIR, la CTB (Coopération Technique Belge), le CTA (Centre<br />
Technique Agricole) <strong>de</strong>s pays bas, Green Sénégal, La FENAS, la Chambre <strong>de</strong> métiers,<br />
l’ANCAR, le POGV et Caritas Sénégal.<br />
De façon générale, les prestataires rencontrés affirment avoir noté une bonne évolution dans<br />
la prise en compte <strong>de</strong> l’importance et <strong>de</strong> l’intérêt <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> services <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s<br />
micros et petites entreprises <strong>de</strong> la localité.<br />
Aussi, pensent- ils que la durée <strong>de</strong>s prestations du type formation est trop courte et ne permet<br />
pas un bon transfert et assimilation <strong>de</strong>s connaissances <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s entrepreneurs. Ces durées<br />
sont le plus souvent fixées par les structures intermédiaires qui le plus souvent mettent en<br />
relief l’atteinte <strong>de</strong> leurs objectifs chiffrés <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong> formés et d’encadrés.<br />
Les coût <strong>de</strong>s prestations sont jugés relativement faibles avec un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> fixation allant <strong>de</strong><br />
l’application d’un coût forfaitaire (concernent plus <strong>de</strong> 50 % <strong>de</strong>s prestataires rencontrés), à <strong>de</strong>s<br />
taux fixés par les intermédiaires.<br />
Les structures d’appui qui sont présentes, interviennent dans l’accès au financement en<br />
partenariat avec <strong>de</strong>s fonds d’appui comme le FNPJ (fond national <strong>de</strong> promotion <strong>de</strong> la<br />
jeunesse) le FONDEF (fond <strong>de</strong> l’entreprenariat féminin) et la BOAD (banque ouest africaine<br />
<strong>de</strong> développement) ; mais elles interviennent aussi dans l’appui technique. On peut en citer :<br />
le POGV (projet pour l’organisation <strong>de</strong> la gestion villageoise) qui, en collaboration avec le<br />
fond international <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> l’agriculture (FIDA) et la BOAD, intervient dans le<br />
diagnostic participatif, la planification participative (plan <strong>de</strong> développement villageois), dans<br />
le suivi évaluation et dans la mise en œuvre <strong>de</strong>s plans <strong>de</strong> développement local (renforcement<br />
<strong>de</strong> capacité, appui au développement agricole et économique). Ce projet est aussi en<br />
partenariat avec Green Sénégal, Caritas, et l’ANCAR, et même la RTS (radio télévision<br />
sénégalaise) pour le volet communication. C’est là un bon exemple <strong>de</strong> synergie entre <strong>de</strong>s<br />
structures d’appui.<br />
P a g e | 47
3.3.1.2. Région <strong>de</strong> Matam<br />
• Caractéristiques <strong>de</strong> la zone<br />
Onzième région du Sénégal, Matam est la première localité érigée en région avec l’avènement<br />
du régime libéral.<br />
Situé à un peu plus <strong>de</strong> 700 km <strong>de</strong> Dakar, Matam regorge d’importantes potentialités <strong>de</strong><br />
développement économique avec <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> production agro-sylvo-pastorale et<br />
d’aquaculture. Aussi bénéficie-t- elle <strong>de</strong> 200 Km <strong>de</strong>s rives du fleuve Sénégal qui servent à la<br />
riziculture. D’ailleurs les initiatives <strong>de</strong>s femmes <strong>de</strong> la localité sont fortement marquées par la<br />
production et la commercialisation du riz <strong>de</strong> la valée. Ces regroupements <strong>de</strong> femmes<br />
développent aussi <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> micro finance avec <strong>de</strong>s mutuelles <strong>de</strong> crédit <strong>de</strong> proximité.<br />
Ces micros et petites entreprises rurales bénéficient <strong>de</strong> l’appui <strong>de</strong> plusieurs structures comme<br />
la SAED, le PRODAM (un projet du FIDA), l’ANCAR, l’ARD, etc. C’est une zone où la<br />
prestation <strong>de</strong> services non financiers se développe surtout dans les domaines du renforcement<br />
<strong>de</strong> capacités techniques <strong>de</strong>s entrepreneurs avec les Chambres consulaires et les CRETEF.<br />
Dans cette localité, PROMER II est actuellement présent au niveau <strong>de</strong> six communautés<br />
rurales (CR) regroupées en une seule zone <strong>de</strong> concentration. Ces CR sont : Dabia, Oréfondé,<br />
Agnam Civol, Ogo, Nabadji Civol, Bokidiawé. Toutefois il faut noter qu’il y a dans la région<br />
<strong>de</strong>s localités qui concentrent beaucoup <strong>de</strong> MPER comme Guidjilogne.<br />
• L’activité <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises<br />
La prestation <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises est une activité qui se développe <strong>de</strong><br />
plus en plus à Matam avec la forte présence <strong>de</strong> structures d’appui qui intègrent le « faire<br />
faire » dans leur approche <strong>de</strong> travail. On peut en citer : l’ARD, l’ANCAR, la SAED, le<br />
CRETEF, la CM, le PDER, etc.<br />
Les services généralement fournis sont la formation avec : l’alphabétisation fonctionnelle, la<br />
gestion comptable avec le module GERME, etc., l’appui conseil avec l’élaboration <strong>de</strong> plan<br />
d’affaires et <strong>de</strong> document <strong>de</strong> projet <strong>de</strong> création d’entreprise et les services juridiques ou <strong>de</strong><br />
formalisation <strong>de</strong>s MPER.<br />
Les difficultés auxquelles les prestataires <strong>de</strong> cette zone sont directement confrontés sont le<br />
plus souvent liées à l’insuffisance <strong>de</strong>s moyens matériels <strong>de</strong> fonctionnement surtout en<br />
Informatique, le manque <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> compétences techniques d’intervention et <strong>de</strong><br />
diversification <strong>de</strong>s services offerts. Par ailleurs les interventions <strong>de</strong> consultants venant <strong>de</strong><br />
Dakar, réduisent beaucoup les opportunités <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> Matam.<br />
A cela s’ajoute l’absence <strong>de</strong> visibilité <strong>de</strong>s prestataires, notée par les structures d’appui (le<br />
représentant <strong>de</strong> la SAED a été agréablement surpris <strong>de</strong> trouver autant <strong>de</strong> prestataires résidant<br />
dans la zone lors du focus group). Le manque d’agressivité commerciale et <strong>de</strong> communication<br />
<strong>de</strong>s prestataires serait la cause principale <strong>de</strong> cette situation.<br />
La crainte principale <strong>de</strong>s prestataires est la sous activité que pourrait causer la fin <strong>de</strong><br />
l’intervention <strong>de</strong> certains projets comme le PRODAM. La solution, qui ressort <strong>de</strong>s échanges<br />
avec les acteurs sur ce sujet, est la définition d’une stratégie d’intervention commune <strong>de</strong>s<br />
structures d’appui intégrant un retrait progressif, et une autonomisation <strong>de</strong>s MPER avec une<br />
vision <strong>de</strong> long terme.<br />
P a g e | 48
3.3.1.3. Région <strong>de</strong> Kaolack<br />
• Caractéristiques <strong>de</strong> la zone<br />
Située à 192 km <strong>de</strong> Dakar, Kaolack est une zone carrefour qui se trouve en plein bassin<br />
arachidier, proche <strong>de</strong> la Gambie.<br />
Kaolack abrite une bonne partie <strong>de</strong> la population du Sénégal avec une main d’œuvre locale<br />
assez importante.<br />
Les activités dominantes <strong>de</strong> la zone sont la production agricole, la production <strong>de</strong> sel iodé, et<br />
les petits commerces.<br />
En <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> ses grands marchés, Kaolack abrite plusieurs marchés hebdomadaires et <strong>de</strong>s<br />
loumas (petits marchés <strong>de</strong> villages), mais les produits <strong>de</strong> la localité sont fortement<br />
concurrencés par les produits qui venant <strong>de</strong> la Gambie.<br />
L’artisanat y est très présent avec une prédominance <strong>de</strong> la menuiserie métallique et une<br />
bonne représentativité en terme <strong>de</strong> main d’œuvre au niveau national.<br />
Les entrepreneurs <strong>de</strong> cette zone ne souffrent d’une professionnalisation insuffisante et d’un<br />
manque <strong>de</strong> représentation faîtière pour la prise en charge <strong>de</strong> leurs intérêts .<br />
PROMER y est présent dans 2 zones <strong>de</strong> concentrations avec 16 CR : Thiomby, Birkelane,<br />
Ngathie Naoudé, Latmingué, Keur Socé, Keur Baka, Mabo, Thiaré, Paoskoto, Keur Madiabel,<br />
Taîba Niasséne, Médina Sabakh, Kayemor, Porokhane, Wack Ngouna, Ngahéne.<br />
L’appui du Projet aux MPER <strong>de</strong>s 16 CR représente une gran<strong>de</strong> opportunité <strong>de</strong> travail pour les<br />
prestataires <strong>de</strong> cette localité.<br />
• L’activité <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises<br />
A Kaolack, la prestation <strong>de</strong> services d’appui est fortement marqué par la présence <strong>de</strong> bureau<br />
d’étu<strong>de</strong>s offrant une palette <strong>de</strong> services assez vaste et diversifiée du type formation et appui<br />
conseil. Les consultants indépendants y sont aussi bien présents avec une <strong>offre</strong> dominée par la<br />
formation technique.<br />
Ces prestataires ont un niveau d’étu<strong>de</strong> assez satisfaisant et disposent <strong>de</strong> moyens logistiques.<br />
Ils sont aussi assez proches <strong>de</strong>s MPER et ont une bonne maîtrise <strong>de</strong>s réalités locales du fait<br />
<strong>de</strong>s activés <strong>de</strong> la première phase <strong>de</strong> PROMER.<br />
Dans cette zone les prestataires dénoncent un manque <strong>de</strong> transparence et un favoritisme dans<br />
l’octroi <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> services par les structures d’appui.<br />
Les structures d’appui et les MPER font remarqués à leur tour un manque <strong>de</strong> visibilité <strong>de</strong>s<br />
prestataires et dénoncent aussi une faiblesse du suivi opéré par ces <strong>de</strong>rniers dans l’exécution<br />
<strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> formation technique. La cause principale en serait la durée d’intervention<br />
relativement courte <strong>de</strong>s prestations.<br />
A Kaolack, il y a moins <strong>de</strong> structures d’appui par rapport aux trois autres régions étudiées.<br />
On y trouve principalement <strong>de</strong>s institutions publiques comme le CRETEF, la CM, la<br />
Chambre <strong>de</strong> commerce, l’ANCAR, l’ARD, et quelques ONG, etc.<br />
P a g e | 49
3.3.1.4. Région <strong>de</strong> Kolda<br />
• Caractéristiques <strong>de</strong> la zone<br />
Kolda est l’une <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> la première phase du PROMER. Elle se trouve à 670 km <strong>de</strong><br />
Dakar, dans la partie sud du Sénégal. C’est une zone sylvopastorale avec une nappe<br />
phréatique peu profon<strong>de</strong>, une bonne fertilité <strong>de</strong>s sols, une disponibilité <strong>de</strong> produits forestiers<br />
et un important cheptel.<br />
C’est aussi une localité très riche avec <strong>de</strong>s produits fruitiers très propices au développement<br />
<strong>de</strong>s activités <strong>de</strong> transformation <strong>de</strong> fruits et légumes.<br />
L’artisanat y est bien développé avec une main d’œuvre assez importante constituée par la<br />
population jeune (plus 60% <strong>de</strong> la population totale).<br />
L’activité commerciale y dispose <strong>de</strong> nombreux marchés permanents et hebdomadaires.<br />
La pauvreté dans la région a frappe plus <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong> la population, avec un taux élevé <strong>de</strong><br />
prévalence <strong>de</strong> maladies surtout le VIH SIDA qui touche plus <strong>de</strong> 3% <strong>de</strong> la population.<br />
Kolda est un milieu rural enclavée du fait <strong>de</strong> sa position frontalière avec la Gambie et d’un<br />
mauvais état <strong>de</strong>s routes.<br />
La salinité <strong>de</strong>s rizières et la raréfaction <strong>de</strong>s ressources halieutiques expliquent leur très faible<br />
exploitation.<br />
PROMER y est actuellement présent dans 13 CR regroupées dans <strong>de</strong>ux zones <strong>de</strong><br />
concentration. Ces CR sont : Némataba, Kandia, Saré Coly Salé, Dabo, Mampatim,<br />
Kounkané, Bagadadji, Linkéring, Coumbacara, Sinthiang Coundara, Médina Gounass,<br />
Bonconto, Salikégné<br />
• L’activité <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services d’appui aux petites entreprises<br />
La fourniture <strong>de</strong> prestation <strong>de</strong> services aux entreprises est dominée par la formation technique<br />
pour une maîtrise <strong>de</strong>s techniques et procédés <strong>de</strong> fabrication <strong>de</strong>s produits grâce à l’émergence<br />
<strong>de</strong> bureaux d’étu<strong>de</strong>s.<br />
Les prestataires y sont assez bien représentés et dispose d’une assez bonne expérience du fait<br />
<strong>de</strong>s interventions dans la première phase du PROMER ; leur <strong>offre</strong> assez diversifiée s’appuie<br />
sur <strong>de</strong>s compétences techniques et une bonne connaissance <strong>de</strong>s différentes localités <strong>de</strong> la<br />
zone.<br />
L’une <strong>de</strong>s principales faiblesses <strong>de</strong> ces prestataires est le manque <strong>de</strong> moyens logistiques<br />
d’intervention : matériels techniques appropriés pour la formation technique, moyens<br />
informatiques. Ces prestataires déplorent aussi la concurrence <strong>de</strong>s consultants <strong>de</strong>s autres<br />
zones.<br />
Les structures d’encadrement et d’appui au développement <strong>de</strong>s micros et petites entreprises<br />
sont assez bien représentées à Kolda ; on note la présence <strong>de</strong> presque tous les démembrements<br />
<strong>de</strong>s institutions publiques (ANCAR, ARD, CRFP, CM, CCI, etc.,) ainsi que d’ ONG et <strong>de</strong><br />
projets <strong>de</strong> développement tels que SAHEL 3000, et le Forum pour le développent durable.<br />
P a g e | 50
3.3.2 Caractéristiques <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services d’appui non financiers<br />
3.3.2.1 Le package <strong>de</strong> services non financiers<br />
• Catégorisation <strong>de</strong>s services étudiés<br />
Les services étudiés sont au nombre <strong>de</strong> 19 allant d’un appui technique direct à un conseil et<br />
orientation <strong>de</strong>s entreprises sur <strong>de</strong>s aspects stratégiques. Ces services peuvent être différenciés<br />
en trois catégories :<br />
- les services « basiques » c’est-à-dire ceux qui s’adressent directement à un besoin vital<br />
ou primaire et satisfaisant aux exigences minimales <strong>de</strong> l’activité <strong>de</strong> l’entrepreneur. Ils<br />
peuvent concerner les aspects réglementaires et formalités juridiques <strong>de</strong>s entreprises,<br />
la fluidité <strong>de</strong>s informations financières <strong>de</strong> l’entreprise, et l’organisation minimale <strong>de</strong>s<br />
entreprises,<br />
- les services secondaires s’adressant à un besoin <strong>de</strong> compétitivité <strong>de</strong> l’entrepreneur,<br />
c’est-à-dire les appuis <strong>de</strong>stinés à renforcer l’entreprise sur le plan technique et <strong>de</strong> la<br />
production, sur le plan <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> l’entreprise et <strong>de</strong>s procédures administratives et<br />
financières, <strong>de</strong> la commercialisation, etc.<br />
- les services à haute valeur ajoutée s’adressant à un besoin <strong>de</strong> croissance, <strong>de</strong><br />
développement et d’expansion <strong>de</strong> l’entreprise.<br />
Le tableau suivant classe les 19 services que nous avons étudiés suivants leur catégorie.<br />
Services étudiés<br />
Alphabétisation<br />
Catégories<br />
Appui technique direct<br />
Services « basiques »<br />
Services juridiques (formalisation <strong>de</strong><br />
l’entreprise)<br />
Comptabilité (Entrée/Sortie)<br />
Formation en gestion<br />
Formation technique<br />
Marketing<br />
Internet<br />
Transport et distribution<br />
Conseil en finance et fiscalité<br />
Montage <strong>de</strong> plan d’affaires<br />
Conseil sur le processus <strong>de</strong> production<br />
Montage <strong>de</strong> dossier <strong>de</strong> crédit<br />
Assistance en informatique<br />
Recrutements d’employés<br />
Foires et expositions<br />
Services « secondaires »<br />
Voyages d’affaires<br />
Recherches développement/<strong>Etu<strong>de</strong></strong>s <strong>de</strong> projets<br />
Services à « haute valeur ajoutée »<br />
Design<br />
produit<br />
et recherche/développement <strong>de</strong><br />
Tableau 19 : Catégorisation <strong>de</strong>s services étudiés<br />
Cette catégorisation <strong>de</strong>s services d’appui étudiés laisse déjà apparaître la dominance <strong>de</strong>s<br />
services dits secondaires. Plus <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong>s prestataires que nous avons étudiés se situent au<br />
niveau <strong>de</strong> cette catégorie <strong>de</strong> prestation. C’est donc dire que le recours aux prestations chez les<br />
P a g e | 51
MPER se justifie plus pour la satisfaction d’un besoin <strong>de</strong> maintien et <strong>de</strong> compétitivité <strong>de</strong><br />
l’entreprise. Les services « basiques » en constituent prés <strong>de</strong> 30%, alors que les services « à<br />
haute valeur ajoutée » y représentent moins <strong>de</strong> 20%.<br />
Une autre forme <strong>de</strong> typologie pourrait consister à catégoriser les prestations en :<br />
- Services du type formation, regroupant toutes les prestations <strong>de</strong> nature à renforcer la<br />
capacité technique, et les<br />
- Services du type appui-conseil, englobant l’ensemble <strong>de</strong>s prestations <strong>de</strong> nature à<br />
secon<strong>de</strong>r l’intervention directe <strong>de</strong>s MPER.<br />
• Services habituellement réalisés<br />
Comme le montre ce tableau, en<br />
<strong>de</strong>hors <strong>de</strong> l’alphabétisation<br />
fonctionnelle, et la formation<br />
technique, les prestation fournies<br />
sont dominées par celles<br />
comprises dans les modules<br />
GERME, TRI et CREE.<br />
Suivant la catégorisation faite plus<br />
haut, il convient <strong>de</strong> noter que ces<br />
prestations concernent les services<br />
« basiques » et les « services<br />
secondaires » qui constituent<br />
l’essentiel <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>s<br />
MPER <strong>de</strong>s zones étudiées.<br />
27%<br />
3.3.2.2 Structuration professionnelle <strong>de</strong>s prestataires<br />
Formalisation <strong>de</strong>s prestataires NINEA<br />
73%<br />
Services Fréquence<br />
ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 39<br />
ANIMATION SENSIBILISATION 13<br />
APPUI/ CONSEIL EN COMPTABILITE 11<br />
DEVELOPPEMENT LOCAL 15<br />
DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE 10<br />
ELABORATION PROJET/<br />
PLANIFICATION 17<br />
ETUDES /ENQUETES 19<br />
FORMATION EN Gestion A F 17<br />
FORMATION ESPRIT D'ENTREPRISE<br />
MSF 10<br />
FORMATION TECHNIQUE 35<br />
GESTION ADMINISTRATIVE ET<br />
FINANCIERE 10<br />
GESTION DES PME 12<br />
NTIC 10<br />
NON<br />
OUI<br />
Tableau 20 : Services habituellement réalisés<br />
Formalisation prestataire RC<br />
Figure 5 : Niveau <strong>de</strong> formalisation <strong>de</strong>s prestataires étudiés<br />
Ces <strong>de</strong>ux illustrations traduisent le niveau <strong>de</strong> formalisation trop bas <strong>de</strong>s prestataires. Moins <strong>de</strong><br />
30% possè<strong>de</strong>nt le NINEA et l’écrasante majorité <strong>de</strong> ce groupe est constituée par les bureaux<br />
d’étu<strong>de</strong>. La plupart <strong>de</strong>s consultants indépendants limite volontairement leur formalisation à<br />
43%<br />
57%<br />
NON<br />
OUI<br />
P a g e | 52
l’inscription au registre <strong>de</strong> commerce craignant les impositions découlant <strong>de</strong> l’inscription au<br />
NINEA.<br />
Il faut noter aussi que parmi les 57% non formalisés se trouvent <strong>de</strong>s institutions publiques<br />
comme les chambres consulaires, et autres formes <strong>de</strong> structures qui ne sont pas régis par ce<br />
type <strong>de</strong> formalisation.<br />
Sur le plan <strong>de</strong>s ressources physiques, les prestataires ne sont pas bien équipés en matériel<br />
informatique (plus <strong>de</strong> 40% n’en dispose pas) et en moyens <strong>de</strong> déplacement qui sont<br />
indispensables dans <strong>de</strong>s régions comme Kolda et Matam.<br />
Plus <strong>de</strong> la moitié <strong>de</strong>s prestataires rencontrés ont reçu au moins un renforcements <strong>de</strong> capacité<br />
dans leur domaine <strong>de</strong> spécialisation. De plus prés <strong>de</strong> 75% d’entre eux sont prêts à investir<br />
dans l’acquisition <strong>de</strong> nouveaux outils <strong>de</strong> travail.<br />
3.3.2.3. Motivation, expérience et engagement <strong>de</strong>s prestataires<br />
Plus <strong>de</strong> 60% <strong>de</strong>s prestataires rencontrés consacrent plus <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> leur quotidien à la<br />
prestation <strong>de</strong> service. De même 98% <strong>de</strong>s prestataires rencontrés font <strong>de</strong> leur prestation une<br />
activité professionnelle à développer sur le long terme.<br />
Ces prestataires sont aussi très engagés dans la dynamique d’accompagner le PROMER II<br />
pour la réalisation <strong>de</strong>s appuis nécessaires pour l’atteinte <strong>de</strong> l’objectif <strong>de</strong> développement <strong>de</strong>s<br />
MPER.<br />
La quasi-totalité <strong>de</strong>s prestataires rencontrés ont au moins réalisé <strong>de</strong>ux prestations <strong>de</strong> services<br />
avec <strong>de</strong>s MPER <strong>de</strong> leur localité, et plus <strong>de</strong> 70% d’entre eux ont déjà cinq (5) MPERs qu’ils<br />
considèrent comme <strong>de</strong>s partenaires au regard <strong>de</strong>s prestations qu’ils leur ont réalisées et <strong>de</strong>s<br />
relations qu’ils entretiennent.<br />
Ces prestataires sont <strong>de</strong>s consultants <strong>de</strong> proximité, disponibles, à l’écoute, et faisant du « sur<br />
mesure » pour leur client et investissant sur une relation à long terme. On les considère<br />
comme <strong>de</strong>s mé<strong>de</strong>cins <strong>de</strong> famille ou du village, plutôt que comme <strong>de</strong>s experts spécialistes.<br />
3.3.2.4. Marketing <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services<br />
Pour prés d’un tiers <strong>de</strong>s cas étudiés, les prestataires atten<strong>de</strong>nt passivement que les clients<br />
viennent vers eux, préférant compter sur leur réputation et les recommandations données par<br />
<strong>de</strong>s tiers pour se faire connaître. Un autre tiers pratique la prospection directe.<br />
Les réseaux personnels <strong>de</strong>s prestataires et les organisations professionnelles ne procurent <strong>de</strong>s<br />
clients que dans moins <strong>de</strong> 15% <strong>de</strong>s cas.<br />
Les prestataires sont néanmoins conscients <strong>de</strong> leur manque d’agressivité en matière <strong>de</strong><br />
démarchage commercial puisque l’écrasante majorité ont une assez mauvaise opinion <strong>de</strong> leur<br />
politique <strong>de</strong> promotion qu’ils considèrent moyenne ou faible. Les prestataires font leur<br />
publicité surtout en direction <strong>de</strong>s structures d’appui susceptibles <strong>de</strong> les mandater pour appuyer<br />
les entreprises.<br />
Compte tenu <strong>de</strong>s réticences <strong>de</strong>s MPER, <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> communication entre elles , <strong>de</strong> la<br />
préférence qu’ont les prestataires <strong>de</strong> services à compter sur leur renommée (98% <strong>de</strong>s cas) et<br />
<strong>de</strong> leur proximité <strong>de</strong>s MPER, l’approche marketing qui conviendrait le mieux serait <strong>de</strong>s<br />
P a g e | 53
campagnes <strong>de</strong> sensibilisation auprès <strong>de</strong>s MPER, surtout au niveau <strong>de</strong>s organisations<br />
professionnelles, mais aussi une bonne i<strong>de</strong>ntification par les structures d’appui.<br />
De façon générale les prestataires considèrent que le marché est en expansion compte tenu <strong>de</strong>s<br />
évolutions notées ces cinq (5) <strong>de</strong>rnières années, et pensent pouvoir améliorer leur <strong>offre</strong> <strong>de</strong><br />
services aux entreprises grâce à un renforcement <strong>de</strong> compétence dans plusieurs domaines.<br />
3.3.2.5. Tarifs <strong>de</strong> prestations sur <strong>de</strong>s types <strong>de</strong> service réalisés<br />
Services Eventail <strong>de</strong> prix Moyenne Durée en j<br />
ALPHABETISATION FONCTIONNELLE 60 000 90 000 75 000 24<br />
ANIMATION SENSIBILISATION 10 000 10 000 10 000 12<br />
APPUI/ CONSEIL 50 000 100 000 75 000 10<br />
DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 75 000 75 000 75 000 3<br />
DIAGNOSTIC D'ENTREPRISE 150 000 150 000 150 000 5<br />
ELABORATION PROJET/<br />
PLANIFICATION 75 000 150 000 112 500 10<br />
ETUDES /ENQUETES 30 000 50 000 40 000 30<br />
FORMATION EN GAF 30 000 120 000 75 000 5<br />
FORMATION ESPRIT D'ENTREPRISE<br />
MSF 60 000 120 000 80 000 10<br />
FORMATION TECHNIQUE 10 000 10 000 10 000 10<br />
GESTION ADMINISTRATIVE ET<br />
FINANCIERE 35 000 40 000 37 500 5<br />
GESTION DES PME 40 000 40 000 40 000 5<br />
MARKETING 40 000 80 000 60 000 1<br />
PASSATION DE MARCHES 60 000 70 000 65 000 3<br />
SUIVI EVALUATION 200 000 200 000 200 000 5<br />
Tableau 21 : Tarifs <strong>de</strong>s services étudiés<br />
Le taux d’honoraire moyen pour les prestations est très élastique variant <strong>de</strong> 10 000 à 65000<br />
francs CFA pour les services les plus courants à 80 000 à 200 000 francs CFA pour les<br />
services <strong>de</strong> type stratégique comme le montage <strong>de</strong> dossiers <strong>de</strong> projets et le suivi évaluation.<br />
Les durées <strong>de</strong> ces prestations évaluées en nombre <strong>de</strong> jour montre que la réalisation <strong>de</strong>s<br />
services <strong>de</strong> formation et d’étu<strong>de</strong>s (ex. Alphabétisation fonctionnelle, et <strong>Etu<strong>de</strong></strong>s) dure beaucoup<br />
plus que les autres types <strong>de</strong> services.<br />
Aussi convient- il <strong>de</strong> noter qu’il n’y pas <strong>de</strong> corrélation entre la durée <strong>de</strong> réalisation du service<br />
et le montant <strong>de</strong>s honoraires payés aux prestataires. Une prestation <strong>de</strong> services <strong>de</strong> suivi<br />
évaluation <strong>de</strong> projets d’une durée <strong>de</strong> 5 jours paye mieux qu’une alphabétisation fonctionnelle<br />
réalisée sur 24 jours.<br />
Il faut noter aussi que ces prestations sont le plus souvent subventionnées en totalité ou en<br />
partie par <strong>de</strong>s « facilitateurs » (structures d’appui et d’encadrement) qui vali<strong>de</strong>nt avec les<br />
micros entreprises la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services, i<strong>de</strong>ntifient le prestataire approprié, et comman<strong>de</strong> la<br />
fourniture du service.<br />
P a g e | 54
3.4. Analyse croisée et Cartographie du marché<br />
Trois acteurs principaux animent le marché <strong>de</strong>s services non financiers étudiés dans le cadre<br />
<strong>de</strong> ce travail. Les <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs <strong>de</strong> SDE constitués par les MPER, les prestataires <strong>de</strong> SDE<br />
privés ou publics et les facilitateurs comme le PROMER II. Les analyses précé<strong>de</strong>ntes ont<br />
montré les caractéristiques <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services. Il convient dans cette<br />
partie <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à l’analyse croisée <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> en vue d’évaluer le marché<br />
potentiel <strong>de</strong>s services non financiers, sa solvabilité, ainsi que les attentes réciproques <strong>de</strong>s<br />
acteurs en vue <strong>de</strong> favoriser l’adéquation entre la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et l’<strong>offre</strong>. L’élaboration du schéma<br />
<strong>de</strong> la cartographie du marché permettra <strong>de</strong> mieux comprendre les interrelations entre ces<br />
acteurs, ainsi que les axes d’intervention <strong>de</strong>s facilitateurs pour stimuler le marché et favoriser<br />
sa pérennisation.<br />
3.4.1. Estimation du marché potentiel <strong>de</strong> services non financiers<br />
a°) Des hypothèses conservatrices basées sur les gammes <strong>de</strong> produits Germe, sur les<br />
normes d’utilisation <strong>de</strong> ces produits et sur les objectifs chiffrés du PROMER II<br />
55% <strong>de</strong>s 19 services étudiés sont contenus dans les gammes d’outils TRI, CREE et GERME<br />
développés et vulgarisés par le BIT. Le BIT a, dans ce cadre, défini, pour l’utilisation <strong>de</strong><br />
chaque outil, <strong>de</strong>s standards en ce qui concerne le nombre <strong>de</strong> jours et la taille <strong>de</strong>s groupes<br />
bénéficiaires, avec une pondération tenant compte <strong>de</strong> la spécificité <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux.<br />
L’objectif chiffré du PROMER II d’appuyer <strong>de</strong> 3000 MPER et 160 prestataires, sur une durée<br />
<strong>de</strong> sept (7) ans engendre un modèle économique qu’il convient d’analyser sous l’angle <strong>de</strong> son<br />
impact sur le développement du marché <strong>de</strong>s services non financiers, notamment sur la<br />
viabilité économique <strong>de</strong> l’activités <strong>de</strong>s prestataires.<br />
Le tableau ci-après en présente le détail <strong>de</strong>s hypothèses retenues :<br />
Nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> prestations pour 55% <strong>de</strong>s services d’appui par groupe <strong>de</strong> 15 MPER<br />
Rubriques Outils/services Nbre <strong>de</strong> jours Années TOTAUX<br />
Formation <strong>de</strong> base<br />
TRI 3 + 2 = 5<br />
1<br />
Suivi An 1<br />
CREE 26 + 40 = 66<br />
141<br />
GERME 30 + 40 = 70<br />
Suivi An2-An7 GERME 40 6 240<br />
TOTAUX 381 jours<br />
Objectif<br />
PROMER2<br />
3 000<br />
Nombre <strong>de</strong> groupe <strong>de</strong> 15 MPER<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
MPER /groupe<br />
15<br />
Nombre<br />
<strong>de</strong><br />
groupes<br />
200<br />
groupes<br />
P a g e | 55
) Evaluation, en nombre <strong>de</strong> jours, <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> globale <strong>de</strong> services non financiers<br />
Deman<strong>de</strong> globale <strong>de</strong> prestation<br />
c) Implications financières pour les prestataires<br />
Deux hypothèses sont retenues sur le nombre <strong>de</strong> prestataires et leurs honoraires<br />
Rubriques<br />
Hypothèse 1 : basée sur la<br />
Convention<br />
BIT/PROMER II<br />
Hypothèse 2 : basée sur<br />
les objectifs chiffrés du<br />
PROMER II<br />
Rubriques<br />
Nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong><br />
prestation<br />
(200 X 381 jours)<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
prestataires<br />
45<br />
160<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
groupes<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
jour par an<br />
242<br />
(10 886 : 45)<br />
68<br />
(10886 : 60)<br />
Nombre <strong>de</strong><br />
jours/groupe<br />
200 381<br />
76 200 jours sur 7 ans<br />
Prix moyens<br />
par jour<br />
(FCFA)<br />
30. 000<br />
75. 000<br />
50. 000<br />
Sur 1 an<br />
10 886 jours<br />
CA moyen par<br />
Prestataire/an<br />
(FCFA)<br />
7 260 000<br />
18. 150. 000<br />
3. 400. 000<br />
L’analyse <strong>de</strong> ces résultas conduit à trois conclusions essentielles:<br />
- les résultats sont basés sur une estimation conservatrice (55%) <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> potentielle <strong>de</strong><br />
services ; le prestataire a donc la possibilité <strong>de</strong> réaliser d’autres activités pour<br />
augmenter ses revenus.<br />
- Un prestataire <strong>de</strong> service peut faire un chiffre d’affaires annuel minimum <strong>de</strong><br />
3 400 000 francs CFA (cf. hypothèse 2, coût honoraire moyen) correspondant à un<br />
salaire moyen mensuel <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 280 000 francs CFA. L’appui du PROMERII<br />
contribuera donc, <strong>de</strong> façon significative, au développement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong><br />
<strong>de</strong> services non financiers.<br />
- Le regroupement <strong>de</strong>s MPER (15 bénéficiaires) peut favoriser une participation<br />
significative <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers aux charges liées à la prestation grâce à une mutualisation<br />
<strong>de</strong> l’accès aux services (ex. 5000 francs par MPER par appui).<br />
P a g e | 56
3.4.2. Solvabilité du marché <strong>de</strong>s services non financiers<br />
95 95 %<br />
5 %<br />
Des subventions temporaires sont nécessaires<br />
Prestataires Prestataires <strong>de</strong> <strong>de</strong> services<br />
services<br />
Prestataires Prestataires Prestataires privés<br />
privés<br />
Prestataires<br />
Prestataires Prestataires ppublics<br />
p<br />
ublics<br />
Relations<br />
Relations<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong> marché<br />
marché<br />
Services Services <strong>de</strong>mandés <strong>de</strong>mandés par par les les MPERs<br />
MPERs<br />
1/5<br />
1/5<br />
Non Non subventionnés<br />
subventionnés<br />
3/5<br />
3/5<br />
Subventionnés<br />
Subventionnés<br />
1/5<br />
1/5<br />
Gratuit ratuit<br />
Figure 6 : Solvabilité du marché <strong>de</strong>s services d’appui non financiers<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssus illustre la prise en charge financière <strong>de</strong>s services basée sur la<br />
configuration du marché. En effet il ressort <strong>de</strong>s focus group que les prestataires privés qui<br />
représentent 95% <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> interviennent sur prés <strong>de</strong>s 4/5 <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services, mais ne<br />
réalisent effectivement que 3/5 <strong>de</strong> cette <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> ; car, d’une part les MPER n’arrivent pas à<br />
supporter la totalité du coût <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>mandés et d’autre part les structures d’appui ne<br />
subventionnent pas la totalité <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>mandés à cause <strong>de</strong> leurs objectifs et/ou <strong>de</strong><br />
l’insuffisance <strong>de</strong> leurs moyens financiers. Les prestataires publics prennent en charge le<br />
cinquième <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> (avec l’intégralité <strong>de</strong>s charges) et l’exécutent sans faire intervenir<br />
les prestataires privés. Ces services sont le plus souvent ceux du type « basiques » et dans une<br />
moindre mesure ceux « à haute valeur ajoutée ». C’est le cas <strong>de</strong>s Agences <strong>de</strong> l’Etat et <strong>de</strong>s<br />
Centres <strong>de</strong> formation technique spécialisée.<br />
Il est par conséquent important <strong>de</strong> noter qu’environ le cinquième <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>s MPER<br />
ne trouve pas une prise en charge financière, ni directement par les MPER, ni par les<br />
structures d’appui. L’objectif <strong>de</strong> développement et <strong>de</strong> pérennisation du marché <strong>de</strong> services<br />
non financiers <strong>de</strong>vra impérativement en tenir compte. Une stimulation du marché par <strong>de</strong>s<br />
subventions temporaires <strong>de</strong>stinées à compléter la contribution financière <strong>de</strong>s MPER sera par<br />
conséquent nécessaire.<br />
P a g e | 57
3.4.3. Adéquation <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong><br />
L’analyse qualitative <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services non financiers, dans les focus<br />
groups a révélé un déficit d’information aussi bien au niveau <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> que <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Au<br />
niveau <strong>de</strong>s prestataires cela se traduit par une tendance à proposer une palette standard <strong>de</strong><br />
services, qui ne répond à aucune expression <strong>de</strong> besoin <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s MPER visées. Quant aux<br />
MPER, le manque d’information sur l’<strong>offre</strong> les empêche <strong>de</strong> comparer la qualité <strong>de</strong>s<br />
prestataires et <strong>de</strong> les mettre ainsi en concurrence. Le manque d’adéquation entre l’<strong>offre</strong> et la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers, que résume le schéma ci-<strong>de</strong>ssous, constitue une <strong>de</strong>s<br />
contraintes majeures au développement du marché <strong>de</strong>s SDE.<br />
DEMANDE<br />
DEMANDE<br />
Manque<br />
d’information<br />
Faible valeur<br />
accordée<br />
aux services<br />
Déficit<br />
<strong>de</strong> promotion<br />
Adaptation<br />
et qualité<br />
insuffisantes<br />
Faible solvabilité Distorsion <strong>de</strong>s<br />
prix<br />
Figure 7 : Schéma <strong>de</strong>s obstacles à l’adéquation <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> SDE<br />
OFFRE<br />
OFFRE<br />
Ces observations nous amènent à examiner, d’une part, les attentes <strong>de</strong>s MPER par rapport à la<br />
fourniture du service par les prestataires et, d’autre part, celles <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers par rapport à la<br />
formulation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> service <strong>de</strong>s MPER en vue <strong>de</strong> concevoir les améliorations à<br />
apporter au fonctionnement du marché.<br />
P a g e | 58
3.4.4. La fourniture du service telle que souhaitée par les entrepreneurs<br />
La tarification n’est pas l’élément déterminant<br />
Tableau 22 : Raisons <strong>de</strong> la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong>s services<br />
Répartition <strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>urs <strong>de</strong> services selon les raisons <strong>de</strong> non utilisation. Sauf<br />
indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Offre<br />
disponible<br />
non<br />
Fourniture<br />
non<br />
convenable<br />
Service trop Service n'est<br />
cher pas gratuit convenable<br />
Alphabétisation fonctionnelle 1,8 0,0 26,3 38,6<br />
Approvisionnement 3,1 6,3 50,0 37,5<br />
Calcul <strong>de</strong>s couts 0,0 4,5 63,6 27,3<br />
Comptabilité 11,8 5,9 58,8 17,6<br />
Création d'entreprise 0,0 4,2 50,0 29,2<br />
Entreprise et famille 0,0 11,8 29,4 58,8<br />
Esprit d'entreprise 0,0 13,3 50,0 33,3<br />
Fiscalité <strong>de</strong>s MPE 7,4 11,1 33,3 55,6<br />
Foires et manifestations commerciales 20,0 12,5 27,5 60,0<br />
Formation technique 0,0 0,0 35,0 40,0<br />
Gestion <strong>de</strong> stocks 9,7 9,7 29,0 48,4<br />
Gestion <strong>de</strong>s ressources humaines 8,3 11,1 33,3 50,0<br />
Marketing 5,9 11,8 29,4 41,2<br />
NTIC 8,6 4,3 15,7 80,0<br />
Passation <strong>de</strong> marches 9,7 6,5 29,0 74,2<br />
Planification financière 19,0 4,8 38,1 42,9<br />
Recherche d'idée d'entreprise 4,0 4,0 56,0 28,0<br />
Services juridiques 0,0 10,0 25,0 65,0<br />
Visites d'échanges/voyages d'affaires 10,8 10,8 40,5 48,6<br />
L’analyse <strong>de</strong>s résultats du tableau, ci-<strong>de</strong>ssus, montre que l’élément significatif dans la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> du service n’est pas la tarification. Cela ne signifie pas que la MPER n’est pas<br />
sensible au prix quand elle doit recourir au service, puisque la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> a été analysée plus<br />
haut en termes <strong>de</strong> contribution. Ce comportement s’explique davantage par l’assurance que<br />
<strong>de</strong>s facilitateurs ai<strong>de</strong>ront à acquérir le service. Autrement dit lorsque le micro entrepreneur est<br />
appuyé dans l’acquisition d’un service, le prix ne <strong>de</strong>vient pas pour lui le facteur le plus<br />
important. Les variables déterminantes <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services sont la nature <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> et<br />
la qualité <strong>de</strong> la prestation. Pour la l’ensemble <strong>de</strong>s services, la non <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> s’explique, à plus<br />
<strong>de</strong> 70%, par le fait que l’<strong>offre</strong> disponible n’est pas convenable (besoin <strong>de</strong> l’entreprise), ou par<br />
le fait que la fourniture du service n’est pas convenable (qualité <strong>de</strong> la prestation).<br />
Il résulte <strong>de</strong> cette analyse que pour toute fourniture <strong>de</strong> service, le besoin <strong>de</strong> la MPER doit être<br />
prioritaire pour assurer une <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> active du service. Une fois le besoin i<strong>de</strong>ntifié, il convient<br />
d’assurer une prestation <strong>de</strong> qualité puisque les informations issues <strong>de</strong> la prestation ont une<br />
influence sur le renouvellement <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> ou sur la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>s d’autres services.<br />
L’adéquation <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> a été appréciée aussi, par les MPER, sous l’angle <strong>de</strong> la<br />
localisation géographique <strong>de</strong>s prestataires et du lieu <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong>s prestations.<br />
P a g e | 59
a) Localisation du prestataire<br />
Pour tous les services, les micros entrepreneurs ruraux préfèrent un prestataire local. La<br />
proximité du prestataire est jugée comme un élément important dans la fourniture d’un<br />
service <strong>de</strong> qualité et dans une perspective <strong>de</strong> durabilité. En effet, les actions post formation <strong>de</strong><br />
suivi nécessitent plusieurs contacts entre le prestataire et le micro entrepreneur rural. Pendant<br />
ces actions, la prise en charge du prestataire prend une gran<strong>de</strong> partie du budget. Cette prise en<br />
charge varie selon que le prestataire est au niveau local, régional ou en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la région.<br />
b) Le lieu <strong>de</strong> la prestation et le type <strong>de</strong> prestation<br />
Tableau 23 : Lieu <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> la prestation et type <strong>de</strong> prestation utilisé<br />
Répartition <strong>de</strong>s MPE Rurales utilisant les services étudiés selon la filière et le lieu <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> la<br />
prestation. Sauf indication explicite, les chiffres sont donnés en %.<br />
Lieu <strong>de</strong> fourniture <strong>de</strong> la prestation Type <strong>de</strong> prestation<br />
Dans Chez le En groupe Appui - Formation<br />
l’entreprise prestataire<br />
Conseil<br />
Filière<br />
Boulangerie 11,1 77,8 11,1 100,0 0,0<br />
Coiffure 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0<br />
Elevage 44,4 0,0 55,6 100,0 0,0<br />
Laiterie 0,0 50,0 50,0 100,0 0,0<br />
Métal mécanique 18,8 12,5 68,8 31,3 68,8<br />
Prestation <strong>de</strong> services 0,0 42,9 57,1 0,0 100,0<br />
Textile 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0<br />
Transformation 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0<br />
Toutes les filières 14,8 25,9 59,3 44,4 55,6<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, une <strong>de</strong>s problématiques au niveau <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> était <strong>de</strong> voir où<br />
les MPER souhaitent que la prestation se fasse. Ainsi, dans le cadre du questionnaire, trois<br />
éventualités étaient envisagées : dans l’entreprise, chez le prestataire, et en groupe, pas chez<br />
les <strong>de</strong>ux. Il ressort <strong>de</strong> ce tableau que près <strong>de</strong> 60% <strong>de</strong>s MPER souhaiteraient que la prestation<br />
se fasse en groupe, chez aucun <strong>de</strong>s acteurs directs (prestataires et MPER). Parallèlement,<br />
seulement 14, 8% souhaitent que ce soit chez elles contre 25,9% qui souhaitent que ce soit<br />
chez le prestataire. Au niveau <strong>de</strong>s filières/activités coiffure, laiterie, boulangerie, la plupart<br />
<strong>de</strong>s MPER ne souhaitent pas que la fourniture du service soit chez elles. En effet, la<br />
structuration <strong>de</strong> ces activités et le cadre dans lequel elle sont misent en œuvre ne permettent<br />
aucune adéquation pour le bon déroulement <strong>de</strong> la prestation. Par contre, pour la métal<br />
mécanique, l’élevage, le choix <strong>de</strong> la prestation à domicile se comprend par le caractère <strong>de</strong><br />
production liée à la prestation. Généralement, les produits <strong>de</strong> la prestation sont mieux<br />
maîtrisés si la prestation se fait sur place. Enfin pour la boulangerie, la fourniture <strong>de</strong> la<br />
prestation est souvent chez le prestataire et pas en groupe, ce qui s’explique par une<br />
possibilité <strong>de</strong> réponse individuelle comme dans le cadre <strong>de</strong> l’appui conseil.<br />
La <strong>de</strong>uxième situation est le type <strong>de</strong> prestation. En effet dans la fourniture <strong>de</strong> services non<br />
financiers, <strong>de</strong>ux types sont les plus utilisés : la formation <strong>de</strong> base et l’appui conseil. Dans le<br />
cadre <strong>de</strong> cette étu<strong>de</strong>, trois situations ont été explorées. La première situation est constituée par<br />
<strong>de</strong>s filières où la formation est le mo<strong>de</strong> opérationnel d’intervention. Il s’agit <strong>de</strong>s filières<br />
prestation <strong>de</strong> services et textile. La <strong>de</strong>uxième situation est constituée <strong>de</strong> filières où le type <strong>de</strong><br />
P a g e | 60
prestation utilisé est l’appui conseil. Il s’agit <strong>de</strong> la boulangerie, <strong>de</strong> l’élevage et <strong>de</strong> la laiterie.<br />
La troisième situation est celle où la prestation a été à la fois l’appui conseil et la formation.<br />
Il ressort <strong>de</strong> cette analyse que lorsque la réponse à apporter est ponctuelle, la prestation<br />
souhaitée est la formation. Lorsque l’appui sollicité est dynamique, l’appui conseil a été le<br />
type souhaité. Toutefois, une combinaison <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux appuis est aussi perceptible surtout<br />
lorsque la formation <strong>de</strong> base est accompagnée d’un suivi qui a toujours pris la forme d’un<br />
appui conseil. Dans tous les cas, l’appui conseil est une réponse obligatoire car les formations<br />
doivent être considérées comme un dispositif qui prend en compte l’analyse du besoin, la<br />
formation <strong>de</strong> base et le suivi accompagnement, même si certains prestataires se sont<br />
spécialisés dans l’appui conseil uniquement.<br />
3.4.5. La formulation <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> telle que voulue par les prestataires<br />
Les focus groups ont révélé aux prestataires que le prix n’est pas la variable déterminante <strong>de</strong><br />
la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services non financiers par les MPER. Cependant, pour adapter leur <strong>offre</strong> et<br />
leurs prestations aux besoins <strong>de</strong> leurs clients, les prestataires ont indiqué les critères que les<br />
MPER doivent respecter en vue d’une formulation pertinente <strong>de</strong> leur <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services.<br />
a) L’esprit d’entreprise<br />
Les entrepreneurs ruraux doivent cultiver l’esprit d’entreprise en s’investissant dans la<br />
croissance et le développement <strong>de</strong> leurs activités. Ils doivent pour cela sortir <strong>de</strong> leur<br />
isolement en intégrant <strong>de</strong>s organisation professionnelles en vue d’échanger <strong>de</strong>s expériences<br />
pour mieux appréhen<strong>de</strong>r les besoins <strong>de</strong> leur entreprise.<br />
b) La reconnaissance <strong>de</strong> la valeur économique du service<br />
Cultiver l’esprit d’entreprise doit conduire l’entrepreneur à considérer la valeur ajoutée <strong>de</strong>s<br />
services offerts par les prestataires, leur impact sur le renforcement <strong>de</strong> ses capacités et sur le<br />
développement <strong>de</strong> son entreprise. Il doit en conséquence accepter <strong>de</strong> payer les services à<br />
leur juste prix ou contribuer significativement lorsqu’ils sont subventionnés par les structures<br />
d’appui.<br />
c) L’alphabétisation fonctionnelle préalable<br />
Pour profiter au mieux <strong>de</strong>s services <strong>de</strong>s prestataires, l’alphabétisation fonctionnelle préalable<br />
<strong>de</strong>s entrepreneurs ruraux est indispensable, car elle améliore l’efficacité <strong>de</strong> la<br />
communication ; elle renforce le processus d’apprentissage, la mise en œuvre et l’évaluation<br />
<strong>de</strong>s appuis fournis par les prestataires <strong>de</strong> services.<br />
d) La participation active à l’i<strong>de</strong>ntification et à la formulation du besoin<br />
Les entrepreneurs doivent s’impliquer dans l’i<strong>de</strong>ntification et la formulation <strong>de</strong> leurs besoins<br />
au lieu <strong>de</strong> s’en remettre aux agents <strong>de</strong>s structures d’appui ; ils doivent exiger <strong>de</strong> participer aux<br />
discussions entre les prestataires et les structures d’appui pour définir les programmes<br />
d’activités et les services à fournir.<br />
P a g e | 61
e) La matérialisation <strong>de</strong>s relations par un contrat écrit<br />
L’alphabétisation fonctionnelle et l’implication dans l’i<strong>de</strong>ntification du besoin <strong>de</strong>vront se<br />
traduire par la rédaction d’un contrat liant l’entrepreneur à son fournisseur <strong>de</strong> service. La<br />
rédaction <strong>de</strong> contrats renforce le sentiment <strong>de</strong> responsabilité <strong>de</strong>s parties.<br />
f) L’évaluation critique <strong>de</strong>s prestations assorties <strong>de</strong> suggestions et <strong>de</strong> recommandations au<br />
prestataire<br />
Les activités du prestataire concernent d’avantage les MPER que les structures d’appui.<br />
L’entrepreneur doit par conséquent, après chaque service consommé, procé<strong>de</strong>r à l’évaluation<br />
critique <strong>de</strong> la prestation reçue ; cette évaluation <strong>de</strong>vra être assortie <strong>de</strong> suggestions et <strong>de</strong><br />
recommandations <strong>de</strong>stinées à améliorer le suivi ainsi que les prestations futures.<br />
3.4.6. Cartographie du marché <strong>de</strong>s services non financiers<br />
Milieu favorable, modèles et sponsors constituent la combinaison systémique sur laquelle<br />
les structures d’appui, comme le PROMER, doivent agir pour favoriser le développement,<br />
dans les zones rurales, <strong>de</strong> services aux micros entreprises tirés par la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. Il ressort <strong>de</strong><br />
l’étu<strong>de</strong> que l’approche efficace consiste à impliquer simultanément les organisations<br />
professionnelles d’entrepreneurs ruraux, les prestataires <strong>de</strong> services et les structures d’appui.<br />
Le schéma ci-<strong>de</strong>ssous présente les différents acteurs du marché <strong>de</strong>s services non financiers à<br />
savoir les MPE rurales, les prestataires <strong>de</strong> services, les structures d’appui aux MPE rurales et<br />
décrit les inter- relations existant entre eux et qui ont été analysées dans l’étu<strong>de</strong>.<br />
P a g e | 62
S<br />
u<br />
i<br />
v<br />
i<br />
d<br />
u<br />
M<br />
a<br />
r<br />
c<br />
h<br />
é<br />
STRUCTURES<br />
D’APPUI<br />
(Synergie)<br />
PROMER<br />
&<br />
Autres structures<br />
d’appui<br />
PRESTATAIRES<br />
MPER<br />
Deman<strong>de</strong> & Offre <strong>de</strong> SDE<br />
(Transactions)<br />
Stimulation du marché<br />
(Subventions temporaires)<br />
Figure 8 : Schéma <strong>de</strong> la cartographie du marché<br />
STRUCTURATION<br />
- Bases <strong>de</strong> Données<br />
- Diffusion info/marché<br />
- Professionnalisation<br />
- Coopération<br />
ORGANISATIONS<br />
PROFESSIONELLES<br />
- Bases <strong>de</strong> Données<br />
- Diffusion info/Prestataires<br />
- Renforcement <strong>de</strong> capacités<br />
- Dialogue<br />
P<br />
é<br />
r<br />
e<br />
n<br />
n<br />
i<br />
s<br />
a<br />
t<br />
i<br />
o<br />
n<br />
P a g e | 63
IV. Recommandations<br />
Pour réaliser sa mission et ses objectifs, le PROMER II <strong>de</strong>vra opérer une segmentation<br />
stratégique <strong>de</strong>s MPER et veiller à inclure dans sa cible <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> changements capables<br />
<strong>de</strong> produire <strong>de</strong>s biens et <strong>de</strong>s services, <strong>de</strong> créer <strong>de</strong>s emplois et <strong>de</strong> générer <strong>de</strong>s revenus pour<br />
acheter les produits. L’approche efficace <strong>de</strong> pérennisation consiste à ai<strong>de</strong>r les micro<br />
entrepreneurs ruraux à sortir <strong>de</strong> leur isolement en impliquant simultanément les organisations<br />
professionnelles <strong>de</strong> MPER, les prestataires <strong>de</strong> services et les structures d’appui dans une<br />
dynamique <strong>de</strong> développement <strong>de</strong> services financiers et non financiers tirés par la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong>. La<br />
mise en œuvre efficace <strong>de</strong> cette stratégie globale, qui bénéficie <strong>de</strong> l’appui méthodologique du<br />
BIT, doit se matérialiser par la combinaison <strong>de</strong> plusieurs stratégies spécifiques <strong>de</strong> support<br />
que nous présentons ci <strong>de</strong>ssous.<br />
a) Sélection <strong>de</strong>s MPER<br />
Les MPER étudiées sont à la fois <strong>de</strong>s micros entreprises par leur chiffre d’affaires, qui est<br />
inférieur à 15.000.000 F CFA et <strong>de</strong>s petites entreprises par leur effectif, qui est compris<br />
entre 10 et 20 employés. Leur mo<strong>de</strong>ste chiffre d’affaires (2.050.000 FCFA) et leur faible<br />
pourcentage <strong>de</strong> salariés (31,2%) limitent considérablement leur impact réel sur l’économie<br />
locale. Par ailleurs le bon niveau général d’instruction <strong>de</strong> leurs dirigeants cache <strong>de</strong>s disparités<br />
régionales. Il résulte <strong>de</strong> ce constat que pour atteindre l’objectif <strong>de</strong> faire émerger 1000 PE,<br />
dont 800 nouvelles, une attention particulière <strong>de</strong>vra être apportée à la sélection <strong>de</strong>s MPER<br />
dans les nouvelles régions. Il faudra notamment veiller à respecter la procédure <strong>de</strong> sélection<br />
en insistant notamment sur l’analyse <strong>de</strong> la viabilité <strong>de</strong>s projets présentés, sur les capacités et<br />
sur la motivation <strong>de</strong>s promoteurs <strong>de</strong> manière à sélectionner <strong>de</strong> véritables agents <strong>de</strong><br />
changement. Cette sélection vise une catégorisation <strong>de</strong>s entrepreneurs à appuyer en trois<br />
groupes :<br />
- les MPER conscientes <strong>de</strong> la valeur ajoutée <strong>de</strong>s prestations sur le développement <strong>de</strong><br />
leur activité et ayant la capacité financière <strong>de</strong> contribuer à la couverture <strong>de</strong>s charges<br />
liée à la prestation. Cette première classe pourra au bout <strong>de</strong> cinq (5) années<br />
d’encadrement par le PROMER II <strong>de</strong>venir autonome et commencer à entretenir <strong>de</strong>s<br />
transactions directes avec les prestataires, sans assistance financière.<br />
- les MPER conscientes <strong>de</strong> la valeur ajoutée <strong>de</strong>s prestations qu’elles reçoivent, mais qui<br />
ne peuvent participer à la couverture <strong>de</strong>s charges qu’en mutualisant <strong>de</strong>s ressources<br />
avec un groupe <strong>de</strong> MPER présentant les mêmes caractéristiques. Cette catégorie<br />
pourra <strong>de</strong> façon progressive rejoindre le premier groupe grâce au développement <strong>de</strong><br />
leurs activités.<br />
- les MPER qui sont sensibilisées sur la nécessité <strong>de</strong> recevoir <strong>de</strong>s prestations, mais qui<br />
ne sont disposées à les recevoir que sous une forme gratuite. Ces <strong>de</strong>rnières ne<br />
pourront pas, <strong>de</strong> façon réaliste, constituer <strong>de</strong>s agents <strong>de</strong> développement du marché<br />
<strong>de</strong>s services non financiers.<br />
P a g e | 64
) Sélection <strong>de</strong>s porteurs d’initiative<br />
Les résultats <strong>de</strong> l’enquête ont montré que les petites entreprises (PE) sont faiblement<br />
représentées dans la base <strong>de</strong> sondage. Ce constat démontre que dans la première phase du<br />
PROMER, les entreprises appuyées sont pour la plupart <strong>de</strong>s micro entreprises ou tout<br />
simplement <strong>de</strong>s AGR. Pour cette raison et compte tenu <strong>de</strong>s objectifs en termes <strong>de</strong> nombre <strong>de</strong><br />
Petites Entreprises à appuyer, le PROMER II <strong>de</strong>vra retenir un certain nombre <strong>de</strong> critères pour<br />
la sélection <strong>de</strong>s porteurs d’initiatives. Les entrepreneurs potentiels à sélectionner dans les<br />
anciennes régions et dans les nouvelles <strong>de</strong>vront avoir au moins le niveau d’instruction du<br />
CM2. Toutefois, PROMER II <strong>de</strong>vra continuer d’apporter son appui aux micros entrepreneurs<br />
ruraux non alphabétisés qui représentent la majorité <strong>de</strong> la population dans ses zones<br />
d’intervention. Cet appui mettra particulièrement l’accent sur l’alphabétisation, la formation<br />
technique, l’esprit d’entreprise comme révélé par l’enquête<br />
c) Faire une intervention ciblée pour les MPER non alphabétisés<br />
Le portefeuille <strong>de</strong> PROMER présente un nombre important d’entrepreneurs non alphabétisés.<br />
Ces entrepreneurs doivent être prises en compte dans le dispositif global d’appui.<br />
Parallèlement, très peu d’instruments notamment en gestion existent pour répondre à la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> cette cible. C’est pour cette raison qu’il est proposé GERME niveau 1 pour les<br />
entrepreneurs en activité et qui sont faiblement alphabétisés à non alphabétisés. En outre, il<br />
serait important <strong>de</strong> mettre en œuvre le plus rapi<strong>de</strong>ment le programme d’alphabétisation en<br />
rapport avec les structures <strong>de</strong> formation dans ce domaine.<br />
.<br />
d) Structuration professionnelle et appui au développement <strong>de</strong>s MPER<br />
Les organisations professionnelles d’entrepreneurs doivent renforcer leurs regroupements en<br />
réseaux pour améliorer leur capacité <strong>de</strong> proposition et <strong>de</strong> réponse à la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> croissante <strong>de</strong>s<br />
populations. Les organisations professionnelles doivent fournir aux MPER les informations<br />
sur les prestataires et les inciter à s’impliquer activement dans la formulation <strong>de</strong> leurs besoins<br />
et dans l’évaluation <strong>de</strong>s prestations reçues. Elles doivent enfin, par le développement <strong>de</strong><br />
l’esprit d’entreprise <strong>de</strong> leurs membres, favoriser la réconciliation entre les valeurs <strong>de</strong> la<br />
société traditionnelle africaine et celles <strong>de</strong> l’entreprise mo<strong>de</strong>rne.<br />
e) Sélection <strong>de</strong> 45 prestataires <strong>de</strong> proximité<br />
La proximité du prestataire est jugée, par les entrepreneurs ruraux comme un élément<br />
déterminant dans la fourniture d’un service <strong>de</strong> qualité car elle facilite la relation <strong>de</strong> confiance<br />
et l’assistance dans la mise en œuvre <strong>de</strong>s compétences acquises. Le Projet pourra former les<br />
160 prestataires prévus mais il <strong>de</strong>vra cependant limiter à 45 le nombre <strong>de</strong> prestataires<br />
partenaires car l’évaluation du potentiel du marché a démontré que c’est à ce niveau que<br />
l’activité <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>rniers est économiquement viable.<br />
f) Choix <strong>de</strong> prestataires sans distorsion sur le marché<br />
Parmi les prestataires, certains sont <strong>de</strong>s ONG souvent spécialisés et qui sont prêts à ajuster<br />
leur prix en fonction <strong>de</strong> la situation (prix élevé lorsqu’un facilitateur appuie, prix faible voire<br />
nul en l’absence <strong>de</strong> structures d’appui). Ces prestataires sont intéressants mais leur<br />
participation à <strong>de</strong>s appels d’<strong>offre</strong>s peut créer <strong>de</strong>s distorsions du marché. Il faudrait donc<br />
comprendre ces prestataires comme <strong>de</strong>s partenaires techniques et déci<strong>de</strong>r à priori <strong>de</strong>s marchés<br />
P a g e | 65
sur lesquels ils peuvent apporter leur expertise technique. Ils pourraient être utilisés pour <strong>de</strong>s<br />
actions <strong>de</strong> sensibilisation ou comme <strong>de</strong>s points focaux plutôt que <strong>de</strong> comme <strong>de</strong>s compétiteurs<br />
sur les marchés <strong>de</strong> diagnostic, <strong>de</strong> formations et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s MPER.<br />
g) Renforcement <strong>de</strong>s compétences techniques et institutionnelles <strong>de</strong>s prestataires<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> a montré la faible capacité institutionnelle <strong>de</strong>s prestataires, leur diagnostic<br />
limité <strong>de</strong>s besoins <strong>de</strong>s MPER et leur manque d’agressivité commerciale. Par ailleurs la<br />
typologie <strong>de</strong>s prestataires a révélé l’existence <strong>de</strong> six classes ou types <strong>de</strong> prestataires comme la<br />
classe 1, caractérisée par les prestataires indépendants, <strong>de</strong> Kolda sans équipement et sans<br />
reconnaissance juridique. Le Projet <strong>de</strong>vra déterminer les appuis aux prestataires en fonction<br />
leur spécificité. L’objectif est <strong>de</strong> définir une stratégie cohérente <strong>de</strong> prise en charge effective<br />
<strong>de</strong>s problèmes <strong>de</strong>s prestataires en vue d’obtenir l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong><br />
service.<br />
• Formation technique<br />
- Initier <strong>de</strong>s sessions <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong> capacité <strong>de</strong>s prestataires en méthodologie<br />
d’intervention, en diagnostic d’entreprise, en marketing <strong>de</strong> leurs prestation et dans<br />
tout autre domaine technique jugé déterminant par les prestataires.<br />
• Renforcement <strong>de</strong>s capacités institutionnelles <strong>de</strong>s prestataires<br />
- Etablir, dans chaque région, <strong>de</strong>s bases <strong>de</strong> données <strong>de</strong> prestataires avec leur<br />
spécialisation et leurs moyens en vue <strong>de</strong> faciliter l’élaboration <strong>de</strong> short lists lors <strong>de</strong>s<br />
appels d’<strong>offre</strong>s.<br />
- Aménager <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong> travail équipées <strong>de</strong> matériels informatiques avec connexion<br />
Internet pour pallier au manque d’outils <strong>de</strong> travail <strong>de</strong>s prestataires. Ce cadre <strong>de</strong> travail<br />
peut favoriser les échanges entre les prestataires, favoriser la constitution <strong>de</strong> réseaux<br />
et déboucher à terme sur la mise en place d’un cadre <strong>de</strong> concertation <strong>de</strong>s prestataires.<br />
Le projet SITEC (services d’information économique et commercial) du PROMER II<br />
pourrait abriter une telle initiative qui serait sous la responsabilité directe du Chef <strong>de</strong><br />
la composante prestataire.<br />
h) Stimulation du marché par <strong>de</strong>s subventions temporaires<br />
L’analyse <strong>de</strong> la configuration du marché a mis en exergue qu’il reste un cinquième <strong>de</strong> la<br />
<strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services sans prise en charge financière, ni par les MPER, ni par les structures<br />
d’appui. Une stimulation du marché par <strong>de</strong>s subventions temporaires <strong>de</strong>stinées à compléter la<br />
contribution financière <strong>de</strong>s MPER s’avère par conséquent nécessaire. Cette préoccupation a<br />
été exprimée dans les focus groups par les micros entrepreneurs qui recomman<strong>de</strong>nt une<br />
autonomisation graduelle (« un sevrage progressif ») par rapport au soutien <strong>de</strong>s structures<br />
d’appui, en fonction du développement <strong>de</strong> leur capacité financière.<br />
i) Suivi du développement du marché<br />
La stimulation du marché par <strong>de</strong>s subventions temporaires ne garantie son développement et<br />
sa pérennité qui dépen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong>s entrepreneurs à modifier leur comportement par<br />
P a g e | 66
la mise en œuvre effective <strong>de</strong>s compétences acquises et par la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> nouveaux services.<br />
L’analyse <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s services par région a permis <strong>de</strong> constater qu’elle est faible dans<br />
les anciennes zones du PROMER I. Les taux d’utilisation <strong>de</strong> services observés dans les<br />
régions <strong>de</strong> Kaolack et <strong>de</strong> Kolda démontrent donc la faible performance <strong>de</strong>s activités <strong>de</strong><br />
suivi pour accompagner la MPER dans la mise en œuvre effectives <strong>de</strong>s compétences<br />
transmises par les prestataires. Le système <strong>de</strong> suivi évaluation du PROMER II et par<br />
conséquent, l’activité <strong>de</strong>s chargés <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s prestataires (CSP), <strong>de</strong>vront, dans les nouvelles<br />
zones, inclure, à côté <strong>de</strong>s critères <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong>s activités budgétisées, <strong>de</strong>s indicateurs <strong>de</strong> mesure<br />
<strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong>s services et <strong>de</strong> <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> nouveaux services en vue d’évaluer le<br />
développement du marché à travers les changements qualitatifs <strong>de</strong> comportement chez les<br />
entrepreneurs ruraux.<br />
j) Prise en compte du suivi accompagnement dans l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> prestation<br />
Pour la plupart <strong>de</strong>s facilitateurs, le suivi, lorsqu’il est pris en compte, est le fait d’un autre<br />
prestataire. Cette situation est démotivante à la fois pour le prestataire et pour la MPER. En<br />
effet, le micro entrepreneur se trouve en face <strong>de</strong> plusieurs interlocuteurs avec parfois <strong>de</strong>s<br />
démarches différentes ; ce qui ne facilite pas la mise en œuvre <strong>de</strong>s connaissances acquises.<br />
C’est pourquoi, le PROMER, pour mieux responsabiliser les prestataires dans le processus<br />
d’appui aux MPER doit exiger une <strong>offre</strong> <strong>de</strong> prestation incluant le suivi ; ce qui permettra par<br />
ailleurs d’assurer la viabilité économique <strong>de</strong> son activité.<br />
k) Partenariat et synergie entre PROMER II et les autres structures d’appui<br />
Le PROMER II cohabite avec plusieurs structures d’appui dans ses différentes zones<br />
d’intervention. Les missions <strong>de</strong> ces structures d’appui <strong>de</strong> type public ou privé présentent<br />
parfois <strong>de</strong>s similitu<strong>de</strong>s avec le PROMER II et souvent leurs bénéficiaires cibles et leurs<br />
bailleurs <strong>de</strong> fonds sont les mêmes (ex. PRODAM). Il convient donc d’étudier les<br />
partenariats et les synergies à développer par un partage <strong>de</strong> l’information, <strong>de</strong>s expériences<br />
et <strong>de</strong>s bonnes pratiques avérées.<br />
Cette dynamique pourra à terme déboucher sur <strong>de</strong>s interventions concertées, planifiées et<br />
mises en œuvre en tenant compte <strong>de</strong>s missions, <strong>de</strong>s priorités et <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> chaque<br />
structure.<br />
Des conventions et <strong>de</strong>s protocoles <strong>de</strong> partenariats à court ou moyen terme pourront,<br />
dans ce cadre, être conclus entre le PROMER II et d’autres structures d’appui dans les<br />
nouvelles zones.<br />
l) Proposer une révision <strong>de</strong> la charte <strong>de</strong>s PME<br />
Le diagnostic réalisé par l’étu<strong>de</strong> a révélé que les entreprises rurales étudiées ne rentrent pas<br />
dans la typologie établie par la charte <strong>de</strong>s PME, car elles sont <strong>de</strong>s micros entreprises par leur<br />
chiffre d’affaires et <strong>de</strong> petites entreprises par leur taille. Il a aussi révélé l’émergence d’un<br />
type <strong>de</strong> strctures dénommées AGR, non prises en compte par la charte. La difficulté qui<br />
résulte <strong>de</strong> cette situation a amené les responsables du PROMER I à i<strong>de</strong>ntifier la Très Petite<br />
entreprise (TPE), comme une catégorie intermédiaire, entre la Micro et la Petite entreprise.<br />
Seulement, cette solution n’est pas une réponse satisfaisante à la problématique <strong>de</strong><br />
classification <strong>de</strong>s MPER dont la <strong>final</strong>ité est <strong>de</strong> favoriser l’élaboration <strong>de</strong> politiques ciblées<br />
adaptées à leurs besoins spécifiques <strong>de</strong> croissance et <strong>de</strong> développement. Il faudrait donc<br />
P a g e | 67
souhaitable <strong>de</strong> proposer un amen<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> la charte <strong>de</strong>s PME qui tienne compte <strong>de</strong> la<br />
spécificité <strong>de</strong>s MPER.<br />
m) Appréhension globale du système et <strong>de</strong>s acteurs<br />
L’environnement d’appui aux initiatives <strong>de</strong> développement au niveau <strong>de</strong>s micros, petites<br />
et moyennes structures présentent divers acteurs :<br />
- Les « bénéficiaires » auxquels les appuis sont <strong>de</strong>stinés<br />
- les prestataires <strong>de</strong> services d’appui non financiers<br />
- les facilitateurs <strong>de</strong> l’appui appelés structure d’appui<br />
- les fournisseurs <strong>de</strong> services financiers communément appelé les IMF (institutions <strong>de</strong><br />
micro finance)<br />
Les responsables du PROMER II ont choisi <strong>de</strong> mener <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s différentes pour<br />
examiner en profon<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>s problèmes spécifiques comme la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> et l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong><br />
services non financiers, les besoins en informations <strong>de</strong>s MPER, l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services<br />
financier, le choix <strong>de</strong>s zones <strong>de</strong> concentration du Projet. Cependant la dynamique<br />
constituée par ces acteurs doit être appréhendée sous l’angle du développement du marché<br />
<strong>de</strong>s services (financiers et non financiers) d’appui aux entreprises et traitée à travers une<br />
étu<strong>de</strong> qui analyse en profon<strong>de</strong>ur les défaillances existantes et définit un mo<strong>de</strong><br />
d’intervention simultané sur les aspects <strong>de</strong> la <strong><strong>de</strong>man<strong>de</strong></strong> <strong>de</strong> services, <strong>de</strong> l’<strong>offre</strong> <strong>de</strong> services<br />
et <strong>de</strong> la facilitation en vue <strong>de</strong> poser les bases d’un développement durable du marché <strong>de</strong>s<br />
SDE.<br />
P a g e | 68
V. Annexes<br />
Annexe 1 : Carte <strong>de</strong>s indices d’accès aux services sociaux <strong>de</strong> base<br />
Annexe 2 : Questionnaire MPE rurale<br />
Annexe 3 : Manuel <strong>de</strong> l’enquêteur<br />
Annexe 4 : Gui<strong>de</strong> d’entretien - Prestataires<br />
Annexe 5 : Gui<strong>de</strong> d’animation <strong>de</strong>s Focus groups<br />
Annexe 6 : Base <strong>de</strong> données <strong>de</strong>s prestataires en version électronique (disponible sur CD)<br />
P a g e | 69