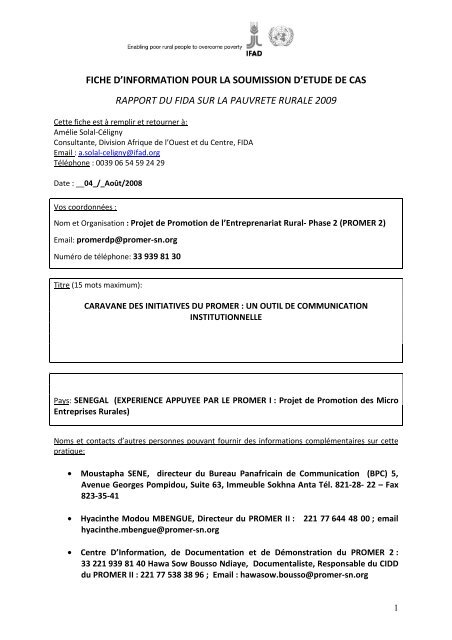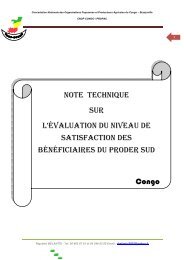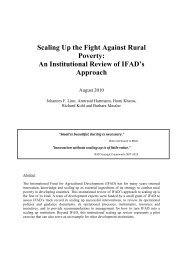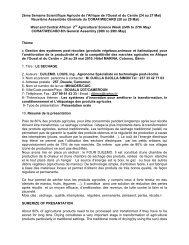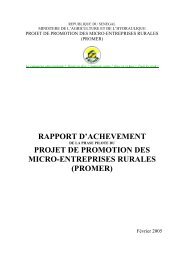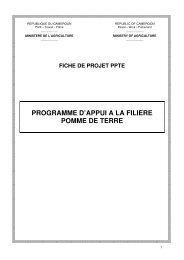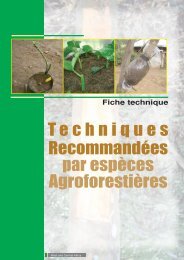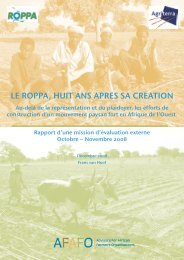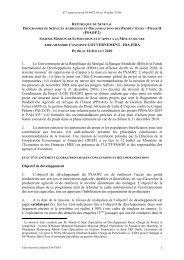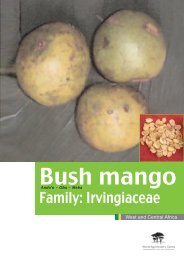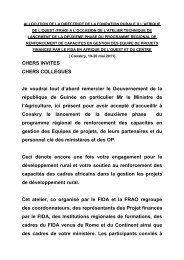Etude de cas FIDA sur la Caravane des Initiatives du ... - FIDAfrique
Etude de cas FIDA sur la Caravane des Initiatives du ... - FIDAfrique
Etude de cas FIDA sur la Caravane des Initiatives du ... - FIDAfrique
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FICHE D’INFORMATION POUR LA SOUMISSION D’ETUDE DE CAS<br />
RAPPORT DU <strong>FIDA</strong> SUR LA PAUVRETE RURALE 2009<br />
Cette fiche est à remplir et retourner à:<br />
Amélie So<strong>la</strong>l-Céligny<br />
Consultante, Division Afrique <strong>de</strong> l’Ouest et <strong>du</strong> Centre, <strong>FIDA</strong><br />
Email : a.so<strong>la</strong>l-celigny@ifad.org<br />
Téléphone : 0039 06 54 59 24 29<br />
Date : __04_/_Août/2008<br />
Vos coordonnées :<br />
Nom et Organisation : Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural- Phase 2 (PROMER 2)<br />
Email: promerdp@promer-sn.org<br />
Numéro <strong>de</strong> téléphone: 33 939 81 30<br />
Titre (15 mots maximum):<br />
CARAVANE DES INITIATIVES DU PROMER : UN OUTIL DE COMMUNICATION<br />
INSTITUTIONNELLE<br />
Pays: SENEGAL (EXPERIENCE APPUYEE PAR LE PROMER I : Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro<br />
Entreprises Rurales)<br />
Noms et contacts d’autres personnes pouvant fournir <strong>de</strong>s informations complémentaires <strong>sur</strong> cette<br />
pratique:<br />
• Moustapha SENE, directeur <strong>du</strong> Bureau Panafricain <strong>de</strong> Communication (BPC) 5,<br />
Avenue Georges Pompidou, Suite 63, Immeuble Sokhna Anta Tél. 821-28- 22 – Fax<br />
823-35-41<br />
• Hyacinthe Modou MBENGUE, Directeur <strong>du</strong> PROMER II : 221 77 644 48 00 ; email<br />
hyacinthe.mbengue@promer-sn.org<br />
• Centre D’Information, <strong>de</strong> Documentation et <strong>de</strong> Démonstration <strong>du</strong> PROMER 2 :<br />
33 221 939 81 40 Hawa Sow Bousso Ndiaye, Documentaliste, Responsable <strong>du</strong> CIDD<br />
<strong>du</strong> PROMER II : 221 77 538 38 96 ; Email : hawasow.bousso@promer-sn.org<br />
1
• Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural, Phase II (PROMER II) : 221 33 939 81<br />
30 ; fax : 221 33 981 12 32 Email promerdp@promer-sn.org<br />
Avez-vous <strong>de</strong> <strong>la</strong> documentation ? (photos, rapports, articles, histoires indivi<strong>du</strong>elles)<br />
Merci d’écrire ci-<strong>de</strong>ssous <strong>la</strong> liste <strong>de</strong>s documents et <strong>de</strong> les joindre à <strong>la</strong> fiche ou bien <strong>de</strong> les envoyer par<br />
email à : a.so<strong>la</strong>l-celigny@ifad.org.<br />
Documents disponibles : Rapport <strong>de</strong> <strong>la</strong> caravane <strong>de</strong>s initiatives, éditions 2003 ; Echos <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
caravane <strong>de</strong>s <strong>Initiatives</strong> ; film <strong>sur</strong> <strong>la</strong> caravane <strong>de</strong>s <strong>Initiatives</strong> ; album photos <strong>Caravane</strong> ;<br />
Diplômes <strong>de</strong> Micro entrepreneurs Pionniers<br />
Description <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone agro-écologique ou a été développée cette pratique (irriguée, bonne<br />
pluviométrie, faible pluviométrie…)<br />
L’expérience porte principalement <strong>sur</strong> <strong>de</strong>ux régions administratives que sont<br />
Tambacounda et Kolda. Ces <strong>de</strong>ux régions font partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone pionnière <strong>du</strong> PROMER<br />
(intervention <strong>de</strong> <strong>la</strong> première phase).<br />
La région <strong>de</strong> Tambacounda, dont le chef – lieu est <strong>la</strong> ville <strong>de</strong> Tambacounda, se situe entre<br />
12°20 et 15°10 <strong>de</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> Nord et 11°20 et 14°50 <strong>de</strong> longitu<strong>de</strong> Ouest. La région <strong>de</strong><br />
Tambacounda se situe entre les isohyètes 500 et 1500 mm, ce qui <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce parmi les<br />
régions les plus pluvieuses <strong>du</strong> pays. La pluviométrie se caractérise par une gran<strong>de</strong><br />
variabilité annuelle et mensuelle. Les mois d’Août et Septembre sont les plus pluvieux. La<br />
saison hivernale <strong>du</strong>re 4 à 5 mois et son instal<strong>la</strong>tion s’effectue d’une manière échelonnée<br />
<strong>du</strong> Sud au Nord. La quantité d’eau et le nombre <strong>de</strong> jours <strong>de</strong> pluie sont croissants <strong>du</strong> Nord<br />
au Sud.<br />
Le potentiel <strong>de</strong> <strong>la</strong> région en eau <strong>de</strong> <strong>sur</strong>face est estimé à 30 milliards <strong>de</strong> m3 par an. Ce<br />
potentiel provient essentiellement d’un réseau hydrographique assez <strong>de</strong>nse qui s’articule<br />
autour <strong>du</strong> fleuve Sénégal, <strong>de</strong> <strong>la</strong> Falémé et <strong>du</strong> fleuve Gambie.<br />
La région <strong>de</strong> Kolda est vaste <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 21.011 km², soit 10,68 % <strong>du</strong> territoire national. Elle<br />
est située au Sud <strong>du</strong> pays, entre 12°20 et 13°40 <strong>de</strong> <strong>la</strong>titu<strong>de</strong> nord, et 13° et 16° <strong>de</strong> longitu<strong>de</strong><br />
ouest. Cette situation marque une position excentrée <strong>de</strong> <strong>la</strong> région par rapport aux grands<br />
centres <strong>du</strong> pays, notamment Dakar, <strong>la</strong> capitale <strong>de</strong> Sénégal.<br />
Le réseau hydrographique, assez <strong>de</strong>nse, est essentiellement composé <strong>de</strong> <strong>la</strong> Casamance et<br />
<strong>de</strong> ses affluents, <strong>du</strong> complexe Kayanga-Anambé et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux affluents <strong>du</strong> fleuve Gambie, à<br />
savoir le Sofaniama et le Koulountou. L'Anambé, cours d'eau temporaire, arrose <strong>la</strong> zone <strong>de</strong><br />
Kounkané dans le département <strong>de</strong> Vélingara.<br />
La région dispose d’importantes ressources végétales estimées à 490.000 hectares <strong>de</strong><br />
forêts c<strong>la</strong>ssées répartis en 26 massifs, soit un taux <strong>de</strong> c<strong>la</strong>ssement <strong>de</strong> 24%. On note que près<br />
<strong>de</strong> 50.000 hectares <strong>du</strong> Parc national <strong>de</strong> Niokolokoba se trouvent dans <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Kolda.<br />
Qui a initié/inventé cette pratique?<br />
Préciser s’il s’agit d’une organisation (<strong>de</strong> pro<strong>du</strong>cteurs, ONG, gouvernement) ou <strong>de</strong> personnes<br />
L’expérience a été initiée par le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong> l’Entreprenariat Rural (PROMER)<br />
dans sa première phase. Et un protocole a été signé avec le Bureau Panafricain <strong>de</strong><br />
Communication (BPC).<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> l’accomplissement <strong>de</strong> sa mission <strong>de</strong> lutte contre <strong>la</strong> pauvreté par l’appui et<br />
l’émergence <strong>de</strong> micro-entreprises rurales, le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro entreprises<br />
2
Rurales (PROMER) a décidé d’organiser une manifestation itinérante appelée : <strong>la</strong> caravane<br />
<strong>de</strong>s initiatives <strong>du</strong> PROMER. Elle a sillonné les régions <strong>de</strong> Tambacounda et <strong>de</strong> Kolda pour <strong>la</strong><br />
première fois dans l’histoire <strong>de</strong> l’entreprenariat rural et féminin.<br />
Les régions <strong>de</strong> Tambacounda et Kolda ont été retenues zones pionnières <strong>du</strong> projet<br />
(démarrage <strong>du</strong> projet dans ces <strong>de</strong>ux régions en 1997) et en 2000 extension dans les régions<br />
<strong>de</strong> Kao<strong>la</strong>ck et Fatick ) retenue pour l’expérimentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> caravane.<br />
A qui / quels types d’agents profite cette pratique? (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, sans terres,<br />
indigènes, jeunes…<br />
Décrivez <strong>la</strong> pratique en détails :<br />
Le Projet <strong>de</strong> Promotion <strong>de</strong>s Micro -Entreprises Rurales (PROMER), accompagné <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong><br />
ses micro entrepreneurs pionniers a organisé une manifestation itinérante dénommée<br />
<strong>Caravane</strong> <strong>de</strong>s initiatives. L’objectif visé est <strong>de</strong> :<br />
• Susciter l’émergence d’idées <strong>de</strong> projets dans les filières à fort potentiel <strong>de</strong> création<br />
d’emploi et <strong>de</strong> valeur ajoutée en montrant l’exemple <strong>de</strong> micro entrepreneurs<br />
appuyés par le PROMER ;<br />
• Permettre aux popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> mieux comprendre l’offre d’appuis <strong>du</strong> PROMER et <strong>de</strong><br />
ses partenaires.<br />
Sillonnant les grands centres ruraux et les marchés hebdomadaires <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> envergure.<br />
Elle a visité huit localités <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Tambacounda (Koumpentoum ; Kidira, Missirah,<br />
Tamba avec <strong>de</strong>s escales <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux heures à Koussanar et à Goudiry) et <strong>de</strong> <strong>la</strong> Région <strong>de</strong> Kolda<br />
(Manda douane ; Dabo, Pata et Kolda avec comme escales Vélingara et Kounkané.)<br />
Le PROMER a convié <strong>de</strong>s partenaires intervenant dans le développement local avec <strong>de</strong>s<br />
espaces d’exposition et <strong>de</strong> discussion pour créer une certaine synergie entre les différents<br />
acteurs <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> rural et une certaine complémentarité <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong>s uns et <strong>de</strong>s autres<br />
pour un développement local <strong>du</strong>rable (CRETEF, PROGEDE, ITA, LVI Eaux Vives, Projet Sida<br />
III, Centre Ados, Développement Communautaire etc.<br />
Beaucoup d’outils d’information et <strong>de</strong> communication ont été déclinés :<br />
• L’exposition en termes <strong>de</strong> vil<strong>la</strong>ge avec <strong>de</strong>s stands aménagés avec <strong>de</strong>s affiches<br />
numériques qui illustrent l’ensemble <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong> valorisation <strong>de</strong>s ressources<br />
offertes dans les principales filières ;<br />
• Des pro<strong>du</strong>its et technologies, fruit <strong>du</strong> génie <strong>de</strong>s micros -entrepreneurs ruraux ;<br />
• Des ateliers sectoriels qui ont permis aux bénéficiaires, partenaires, autorités<br />
administratives <strong>de</strong> discuter à chaque escale d’un thème qui constitue un Centre<br />
d’Intérêt et <strong>de</strong> Préoccupation : (Koumpentoum : « Entrepreneuriat Rural et accès<br />
au crédit » ; Kidira : « Participation <strong>de</strong>s émigrés au financement <strong>du</strong><br />
développement local » ; Missirah : «<strong>la</strong> valorisation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its locaux et<br />
protection <strong>de</strong> l’environnement» ; Tambacounda : «Synergie <strong>de</strong>s acteurs et<br />
financement <strong>du</strong> développement local» ; Manda Douane : «Insertion et intégration<br />
<strong>de</strong>s jeunes en zones défavorisées (rurales et frontalières) <strong>de</strong> <strong>la</strong> région <strong>de</strong> Kolda pour<br />
<strong>la</strong> promotion <strong>de</strong> l’artisanat rural »; Diaobé : «les Unités semi- in<strong>du</strong>strielles <strong>de</strong><br />
pro<strong>du</strong>ction <strong>la</strong>itière : forces, faiblesses et recommandations »; Pata : «<br />
Développement et renforcement <strong>de</strong>s moyens et <strong>du</strong> partenariat technologique pour<br />
<strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s biens d’équipement »; Kolda : « <strong>la</strong> pénétration <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its<br />
agricoles et forestiers <strong>de</strong>s MER en milieu urbain : Quelles alternatives» ?<br />
• Les récits d’itinéraires <strong>de</strong>s pionniers <strong>de</strong> <strong>la</strong> micro entreprise rurale,<br />
3
• La démonstration <strong>de</strong>s technologies, les séances <strong>de</strong> dégustation <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its<br />
locaux ;<br />
• La projection <strong>de</strong> films <strong>sur</strong> les MST/SIDA et les muti<strong>la</strong>tions sexuelles et génitales;<br />
• La diffusion <strong>de</strong> l’information par <strong>la</strong> distribution <strong>de</strong> documents <strong>sur</strong> le PROMER :<br />
brochures, dépliants, tee-shirts, <strong>cas</strong>quettes, calendriers etc.<br />
La caravane a permis <strong>la</strong> découverte <strong>du</strong> PROMER, ses activités, les différents appuis<br />
technico-commerciaux, les MER, les processus <strong>de</strong> création et <strong>de</strong> consolidation d’une MER<br />
<strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> projet à l’aboutissement <strong>du</strong> projet. Un échange fructueux s’est opéré entre<br />
les MER exposants et les popu<strong>la</strong>tions visiteuses.<br />
La caravane s’est poursuivi à avec l’accompagnement <strong>du</strong> vil<strong>la</strong>ge <strong>de</strong> <strong>la</strong> caravane <strong>de</strong>s<br />
initiatives à <strong>la</strong> FIARA 2003<br />
4
Ouverture <strong>de</strong> <strong>la</strong> caravane à Koumpentoum par le Directeur <strong>de</strong><br />
Cabinet <strong>du</strong> Ministre <strong>de</strong> l’Agriculture, stands, séance <strong>de</strong> dégustation<br />
5
Vue d’ensemble <strong>de</strong>s stands<br />
6
Expliquez dans quel contexte et pourquoi cette pratique a été mise en p<strong>la</strong>ce :<br />
Après quatre années d’animation économique, le PROMER avait enregistré <strong>de</strong>s résultats<br />
que l’on s’accordait à juger satisfaisants : 962 MER créées ou consolidées, 2154 emplois<br />
créés ou consolidés et 624 dossiers <strong>de</strong> projets financés pour un montant global <strong>de</strong><br />
135 283 905 francs CFA à <strong>la</strong> date <strong>du</strong> 31 décembre 2001. Ces résultats <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt à être<br />
consolidés d’autant plus que 87% <strong>de</strong>s activités menées jusqu’en fin 2000 par les micro<br />
entrepreneurs ruraux concernaient le commerce et l’embouche, c'est-à-dire <strong>de</strong>s activités à<br />
faible valeur ajoutée et très peu créatrices d’emplois. C’est pourquoi à partir <strong>de</strong> l’année<br />
2001 et suite à son évaluation annuelle externe et à <strong>la</strong> revue à mi parcours, le PROMER a<br />
amorcé un virage stratégique visant à favoriser et consoli<strong>de</strong>r les activités relevant <strong>de</strong>s<br />
filières structurantes. Ainsi donc <strong>de</strong>ux situations se sont présentées au niveau <strong>de</strong>s<br />
acteurs appuyés par le PROMER.<br />
• <strong>la</strong> plupart <strong>de</strong>s micro entrepreneurs qui s’activaient dans le petit commerce et<br />
l’embouche ( c'est-à-dire <strong>la</strong> gran<strong>de</strong> majorité <strong>de</strong>s MER) ont été désorientés par le<br />
recentrage et les appuis <strong>du</strong> PROMER <strong>sur</strong> les activités à caractère structurant : ils ne<br />
savent ou ne peuvent valoriser les ressources locales qu’à travers leur vente à l’état<br />
brut à cause <strong>du</strong> manque <strong>de</strong> technicité, soit à l’insuffisance <strong>de</strong> moyens financiers ou<br />
tout simplement par défaut d’imagination. Malgré les sensibilisations, les<br />
animations ciblées <strong>sur</strong> le potentiel que constituent les ressources locales et les<br />
visites personnalisées, ils arrivent difficilement à trouver <strong>la</strong> bonne initiative ou les<br />
voies et moyens pour <strong>la</strong> tra<strong>du</strong>ire en activité économique viable<br />
• Dans les filières à caractère structurant, c'est-à-dire susceptibles <strong>de</strong> promouvoir un<br />
développement intégré et <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s zones considérées, les micros entrepreneurs<br />
éprouvent également <strong>de</strong>s difficultés à améliorer leurs pro<strong>du</strong>its, leurs process ainsi<br />
que leurs outils <strong>de</strong> gestion, mais aussi à as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> visibilité <strong>de</strong> leurs pro<strong>du</strong>its <strong>sur</strong> les<br />
marchés. Or ce <strong>de</strong>rnier aspect revêt une importance toute particulière. En effet, les<br />
MER <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction ne peuvent se développer <strong>du</strong>rablement si elles ne conquièrent<br />
<strong>de</strong>s parts importantes <strong>du</strong> marchés et /ou si elles i<strong>de</strong>ntifient et fidélisent <strong>de</strong>s<br />
marchés captifs porteurs. Ceci est possible à partir d’une pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> qualité bien<br />
sûr, mais également et <strong>sur</strong>tout par une meilleure connaissance et acceptation <strong>de</strong>s<br />
pro<strong>du</strong>its par les consommateurs, ceux urbains plus particulièrement qui ont leurs<br />
exigences spécifiques en termes <strong>de</strong> qualité et <strong>de</strong> conditionnement<br />
Le PROMER a démarré ses activités en 1997 d’abord dans les régions <strong>de</strong> Tambacounda et<br />
<strong>de</strong> Kolda, puis en 2000 il a éten<strong>du</strong> son intervention dans les régions <strong>de</strong> Kao<strong>la</strong>ck et Fatick. Il<br />
est connu par ses bénéficiaires mais pas <strong>du</strong> grand public, c’est <strong>de</strong> là qu’est née l’idée<br />
d’organiser une caravane itinérante <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its, process et technologies pour informer<br />
l’opinion <strong>de</strong>s réalisations <strong>du</strong> Projet mais aussi et <strong>sur</strong>tout <strong>de</strong> susciter <strong>de</strong>s initiatives et idées<br />
<strong>de</strong> projets en s’appuyant <strong>sur</strong> l’exemple <strong>de</strong>s 12 micro entrepreneurs pionniers dans<br />
l’entreprenariat rural.<br />
Le PROMER a invité tous les acteurs <strong>du</strong> développement local à participer à <strong>la</strong><br />
manifestation. Les partenaires sont entre autres : le PROGEDE ; l’ITA ; le CRETEF, le<br />
Développement Communautaire.<br />
7
Visite guidée <strong>de</strong>s autorités dans les stands <strong>du</strong> PROMER : Pro<strong>du</strong>its<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> poterie<br />
8
Pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> <strong>la</strong> filière Métal Mécanique<br />
10
Exposition <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong>s MER<br />
11
Visiteurs : fourniture d’information <strong>sur</strong> le projet<br />
Expliquez en quoi <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion va-t-elle bénéficier <strong>de</strong> cette pratique ? Qu’est-ce qui va changer en<br />
particulier ? Donner si possible <strong>de</strong>s exemples indivi<strong>du</strong>els pour montrer comment cette pratique a pu<br />
améliorer les conditions <strong>de</strong> vie <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion.<br />
La popu<strong>la</strong>tion rurale <strong>de</strong>s régions d’intervention <strong>du</strong> PROMER ont fortement bénéficié <strong>de</strong><br />
cette expérience.<br />
La caravane a enregistré <strong>la</strong> participation d’un public venu nombreux. C’est ainsi qu’elle a<br />
drainé <strong>de</strong>s foules immenses plus <strong>de</strong> 5000 visiteurs dont une bonne partie <strong>de</strong> femmes et <strong>de</strong><br />
jeunes porteurs d’initiatives économiques.<br />
Elle a permis <strong>de</strong> recueillir <strong>de</strong> nouvelles initiatives à travers <strong>de</strong>s porteurs d’initiatives,<br />
émerveillés par l’exemple <strong>de</strong>s MER pionniers et leur réussite ; et a démontré l’ambition<br />
économique <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions rurales au regard <strong>de</strong> l’importance et <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>s idées<br />
<strong>de</strong> projets.<br />
12
Stand <strong>de</strong> <strong>la</strong> forge : charrettes, décortiqueurs<br />
13
Stand ITA Partenaire <strong>du</strong> PROMER dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
transformation <strong>de</strong>s fruits et légumes<br />
Vue d’ensemble <strong>de</strong>s Autorités<br />
14
Cette pratique a-t-elle déjà été répliquée dans un autre contexte, ou par d’autres personnes?<br />
Si oui, expliquez quels ont été les facteurs qui ont permis le succès <strong>de</strong> cette réplication (ce qui a fait<br />
que cette pratique a pu être répliquée).<br />
L’expérience a été initiée dans <strong>la</strong> première zone pionnière <strong>du</strong> projet. Le ministère <strong>de</strong><br />
l’entreprenariat féminin et <strong>de</strong>s petites et moyennes entreprise <strong>du</strong> Sénégal s’est inspirée <strong>de</strong><br />
cette caravane et l’a répliquée dans toutes les régions <strong>du</strong> pays et il l’a dénommée <strong>la</strong><br />
caravane <strong>de</strong>s PME qui s’organise chaque année.<br />
Quelles sont à votre avis les leçons à tirer <strong>de</strong> cette pratique, en particulier pour <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong><br />
projets <strong>de</strong> développements et l’é<strong>la</strong>boration <strong>de</strong> politiques ?<br />
Ce genre <strong>de</strong> pratique permet d’accroître <strong>la</strong> visibilité institutionnelle, technique,<br />
économique <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement (fourniture d’informations pertinentes, <strong>de</strong><br />
qualité, recueil <strong>de</strong>s préoccupations <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions rencontrées, écoute attentive <strong>de</strong>s<br />
cibles et <strong>de</strong>s PIE potentiels, réponses aux préoccupations, incitation à <strong>de</strong> nouveaux<br />
bénéficiaires à se manifester, l’as<strong>sur</strong>ance d’une bonne couverture médiatique <strong>de</strong>s<br />
activités et réalisations <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> développement. Entrepreneurs.<br />
Cette manifestation itinérante mérite d’être <strong>du</strong>pliquée dans le cadre <strong>du</strong> PROMER II qui a<br />
une approche différente <strong>du</strong> PROMER I, stratégie, méthodologie, « approche faire faire,<br />
appuis et accompagnement à partager avec les acteurs, les partenaires dans les zones<br />
d’intervention <strong>du</strong> projet.<br />
15
CHOIX DES CHAPITRES ET IDENTIFICATION DES OBSTACLES<br />
Cochez le ou les chapitres correspondant à votre étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>cas</strong> :<br />
x<br />
x<br />
x<br />
Chapitre 2 : Ressources naturelles<br />
Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres s'as<strong>sur</strong>ent-elles d'un accès aux ressources<br />
naturelles pro<strong>du</strong>ctives et les gèrent-elles <strong>de</strong> manière <strong>du</strong>rable, ou comment pourraient-elles<br />
le faire?<br />
Chapitre 3 : Services agricoles<br />
Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres ont-elles accès aux services agricoles et en tirentelles<br />
parti, ou comment pourraient-elles le faire?<br />
Chapitre 4 : Marchés rémunérateurs et équitables<br />
Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres ont-elles accès à <strong>de</strong>s marchés rémunérateurs et<br />
équitables et en tirent-elles parti, ou comment pourraient-elles le faire?<br />
Chapitre 5: Emplois et entreprises non agricoles<br />
Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres ont-elles accès aux possibilités d'emploi et <strong>de</strong><br />
création d'entreprises non agricoles et en tirent-elles parti, ou comment pourraient-elles le<br />
faire?<br />
Chapitre 6 : Gouvernance et politiques<br />
Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres ont-elles accès aux processus <strong>de</strong> gouvernance et<br />
développent-elles <strong>la</strong> capacité d'y participer, ou comment pourraient-elles le faire?<br />
Pour le ou les chapitre(s) que vous avez sélectionné(s), i<strong>de</strong>ntifiez les défis correspondant à<br />
votre étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>cas</strong>, puis pour chaque défi cochez-le ou les obstacle(s) que <strong>la</strong> pratique<br />
décrite a permis – ou permettra - <strong>de</strong> <strong>sur</strong>monter : (entourez <strong>la</strong> lettre correspondante)<br />
N.B : ne remplir que les pages correspondant aux chapitres que vous avez sélectionnés ci<strong>de</strong>ssus.<br />
Chapitre 2<br />
Défi 1 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – obtiennent-ils ou conservent-ils un<br />
accès suffisant aux ressources naturelles pro<strong>du</strong>ctives (terre, eau, forêts, pêcheries, ressources<br />
génétiques) pour améliorer leurs moyens <strong>de</strong> subsistance, ou comment pourraient-ils le faire, malgré<br />
divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. pénurie croissante <strong>de</strong> ressources (en termes aussi bien qualitatifs que quantitatifs), aggravée<br />
par <strong>de</strong>s phénomènes tels que <strong>la</strong> croissance démographique, le changement climatique et <strong>la</strong><br />
désertification<br />
b. faiblesse <strong>de</strong>s institutions, l'insuffisance <strong>de</strong>s infrastructures et l'absence <strong>de</strong> services publics<br />
c. effondrement <strong>de</strong>s formes traditionnelles <strong>de</strong> gouvernance <strong>de</strong>s ressources naturelles<br />
d. caractère ambigu <strong>de</strong>s droits et les inégalités<br />
e. discrimination à l'encontre <strong>de</strong> groupes spécifiques (femmes, peuples autochtones, par<br />
exemple)<br />
f. incapacité <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres <strong>de</strong> participer à <strong>la</strong> gouvernance et à<br />
l'autodétermination<br />
g. absence d'informations et <strong>de</strong> connaissances <strong>sur</strong> les politiques, les droits, les lois et les<br />
réglementations au niveau national<br />
16
h. concurrence accrue avec <strong>de</strong>s intérêts plus puissants, <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> valeur croissante <strong>de</strong>s<br />
ressources, résultant <strong>du</strong> changement climatique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'agro-énergie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse<br />
<strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> base, etc.<br />
i. conflits d'intérêts chroniques entre différents groupes <strong>de</strong> popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres<br />
Défi 2 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – accroissent-ils leur sécurité d'accès aux<br />
ressources naturelles pro<strong>du</strong>ctives, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi<br />
lesquels on peut citer:<br />
a. caractère évolutif et multiplicité <strong>de</strong>s systèmes <strong>de</strong> gouvernance <strong>de</strong>s ressources naturelles à<br />
tous les niveaux<br />
b. pénurie accrue <strong>de</strong> ressources<br />
c. multiplicité/ chevauchement <strong>de</strong>s utilisations/utilisateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> même ressource naturelle,<br />
spécialement en ce qui concerne les ressources à accès ouvert – eau, forêts et pêcheries<br />
d. concurrence accrue avec <strong>de</strong>s intérêts plus puissants <strong>du</strong>e à <strong>la</strong> valeur croissante <strong>de</strong>s<br />
ressources, résultant <strong>du</strong> changement climatique, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d'agro-énergie, <strong>de</strong> <strong>la</strong> hausse<br />
<strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its <strong>de</strong> base, etc.<br />
e. manque <strong>de</strong> mécanismes garantissant le respect <strong>de</strong>s droits d'accès<br />
f. conflits<br />
Défi 3 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – développent-ils leur capacité <strong>de</strong> gestion<br />
<strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s ressources naturelles, et notamment d'amélioration qualitative <strong>de</strong>s ressources, pour<br />
renforcer leurs moyens <strong>de</strong> subsistance, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles<br />
parmi lesquels on peut citer:<br />
a. manque d'accès aux formes complémentaires <strong>de</strong> capital (é<strong>du</strong>cation, santé, capital financier,<br />
infrastructure, technologie, capital social et politique)<br />
b. manque d'accès à <strong>de</strong>s services agricoles adaptés<br />
c. manque d'accès à <strong>la</strong> technologie pertinente<br />
d. insécurité <strong>du</strong> régime foncier<br />
e. détérioration <strong>de</strong>s ressources naturelles, spécialement les ressources communes/libres<br />
d'accès (pêcheries, forêts, ressources phylogénétiques/biodiversité, etc.)<br />
f. changements dans <strong>la</strong> base <strong>de</strong> ressources et menaces persistantes et émergentes pour <strong>la</strong><br />
<strong>du</strong>rabilité (par exemple le changement climatique et <strong>la</strong> dégradation <strong>de</strong>s ressources, <strong>la</strong><br />
croissance démographique, l'intensification <strong>de</strong> l'agriculture, <strong>la</strong> déforestation, l'épuisement<br />
<strong>de</strong>s ressources halieutiques et le rétrécissement <strong>de</strong> <strong>la</strong> base phylogénétique)<br />
g. compromis entre l'augmentation <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ctivité et <strong>la</strong> capacité d'adaptation aux variations<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>du</strong>ction<br />
h. compromis entre l'amélioration <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> subsistance, <strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté<br />
rurale, <strong>la</strong> gestion <strong>du</strong>rable <strong>de</strong>s ressources et <strong>la</strong> réalisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> sécurité alimentaire<br />
Défi 4 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – tirent-ils parti, dans différents contextes<br />
agro-écologiques, <strong>de</strong> l'évolution <strong>de</strong>s marchés, et notamment <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong> services<br />
environnementaux, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on<br />
peut citer:<br />
a. inégalité <strong>de</strong>s conditions d'intégration aux marchés agricoles, tant pour les intrants que pour<br />
les pro<strong>du</strong>its, et faiblesse <strong>du</strong> pouvoir d'achat<br />
b. manque <strong>de</strong> connaissances et d'informations <strong>sur</strong> le marché<br />
c. manque d'accès au financement<br />
d. divergences entre les discours <strong>sur</strong> l'environnement et <strong>sur</strong> le développement (accords et<br />
conventions internationaux re<strong>la</strong>tifs aux ressources naturelles)<br />
e. complexité <strong>de</strong> <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s fournisseurs <strong>de</strong> services environnementaux<br />
17
f. coûts d'opportunité concernant <strong>la</strong> sécurité alimentaire, le moment et le volume <strong>de</strong> <strong>la</strong> maind’œuvre<br />
requise, <strong>la</strong> taille et le moment <strong>de</strong>s investissements<br />
g. complexité <strong>de</strong> <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong>s ressources naturelles appliquée aux ressources<br />
communes/libres d'accès<br />
h. absence d'attribution équitable <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> propriété intellectuelle<br />
Chapitre 3<br />
Défi 1 : Comment les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres ont-elles accès à <strong>de</strong>s services agricoles abordables<br />
et <strong>du</strong>rables, ou comment pourraient-elles le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on peut<br />
citer:<br />
a. retrait <strong>de</strong>s services <strong>de</strong> l'État et <strong>de</strong>s services publics, en particulier dans les zones rurales<br />
vulnérables<br />
b. diminution <strong>de</strong> l'appui accordé à l'agriculture par les États et les donateurs<br />
c. priorité accordée aux clients les plus riches, en particulier pour ce qui concerne les services<br />
financiers et les services privés<br />
d. manque <strong>de</strong> moyens <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et hommes – pour se payer ces services<br />
e. manque d'information <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et hommes – à propos <strong>de</strong>s services<br />
existants<br />
f. absence <strong>de</strong> soutien externe à long terme<br />
g. certains types <strong>de</strong> services sont disponibles, mais sans les services complémentaires.<br />
Défi 2 : Comment les services agricoles efficaces sont-ils adaptés aux besoins <strong>de</strong>s ruraux pauvres –<br />
femmes et hommes – ou comment pourraient-ils l'être, malgré divers obstacles parmi lesquels on<br />
peut citer:<br />
a. les ruraux pauvres – femmes et hommes – ne sont pas associés à <strong>la</strong> définition <strong>de</strong>s besoins, et<br />
n'en ont pas <strong>la</strong> capacité<br />
b. les ruraux pauvres – femmes et hommes – ne sont pas associés à <strong>la</strong> conception, à <strong>la</strong><br />
prestation et à l'évaluation <strong>de</strong>s services<br />
c. diversité <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et hommes – et <strong>de</strong>s contextes dans lesquels ils vivent<br />
d. absence d'une approche prenant en compte <strong>la</strong> spécificité <strong>de</strong> chaque sexe dans <strong>la</strong> conception<br />
et <strong>la</strong> prestation <strong>de</strong>s services<br />
e. les agents <strong>de</strong>s services ne sont pas capables <strong>de</strong> prendre en compte les savoirs <strong>de</strong>s<br />
popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres<br />
f. les prestataires <strong>de</strong> services ne sont pas tenus <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s comptes aux ruraux pauvres –<br />
femmes et hommes<br />
Défi 3 : Comment <strong>de</strong>s services souples, favorables à l'innovation et adaptés aux problèmes<br />
émergents sont-ils encouragés, ou comment pourraient-ils l'être, malgré divers obstacles parmi<br />
lesquels on peut citer:<br />
a. approche "solution unique"<br />
b. absence <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong>s savoirs traditionnels<br />
c. ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s budgets <strong>de</strong>s systèmes nationaux <strong>de</strong> recherche agricole<br />
18
d. absence <strong>de</strong> recherche et d'innovation adaptées au contexte <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et<br />
hommes<br />
e. absence d'informations concernant l'évolution <strong>du</strong> contexte<br />
f. manque <strong>de</strong> capacités et d'adaptabilité <strong>de</strong>s agents et <strong>de</strong>s prestataires <strong>de</strong> services<br />
Chapitre 4<br />
Défi 1 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – ont-ils accès à <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s intrants<br />
adéquats et abordables, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels<br />
on peut citer:<br />
a. moyens financiers limités <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et hommes<br />
b. manque <strong>de</strong> compétitivité ou <strong>de</strong> transparence <strong>de</strong>s marchés <strong>de</strong>s intrants<br />
c. les marchés <strong>de</strong>s intrants ne prennent pas en compte les besoins <strong>de</strong>s petits pro<strong>du</strong>cteurs<br />
Défi 2 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – participent-ils dans <strong>de</strong> meilleures<br />
conditions aux chaînes <strong>de</strong> commercialisation agricole, ou comment pourraient-ils le faire, malgré<br />
divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. coûts <strong>de</strong> transaction plus élevés pour les petits que pour les gros pro<strong>du</strong>cteurs<br />
b. accès limité ou non as<strong>sur</strong>é aux moyens <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction (ressources naturelles, finance,<br />
équipement, savoirs et technologie, par exemple) nécessaires à <strong>la</strong> compétitivité<br />
c. intégration verticale <strong>sur</strong> les marchés agricoles, qui entrave <strong>la</strong> participation <strong>de</strong>s ruraux<br />
pauvres<br />
d. absence d'informations fiables et permanentes concernant les débouchés <strong>sur</strong> les marchés<br />
e. inefficiences structurelles <strong>de</strong>s marchés agricoles<br />
f. caractère limité <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d'action collective <strong>de</strong>s petits pro<strong>du</strong>cteurs et <strong>de</strong> leurs<br />
organisations<br />
g. insuffisance <strong>de</strong>s infrastructures publiques et <strong>de</strong>s instal<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> marché<br />
Défi 3 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – entrent-ils dans <strong>de</strong> nouvelles chaînes <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong> valeur, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on peut<br />
citer:<br />
a. absence <strong>de</strong>s moyens et <strong>de</strong>s services nécessaires pour as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> compétitivité dans les<br />
chaînes <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valeur<br />
b. accès limité <strong>de</strong>s petits pro<strong>du</strong>cteurs aux informations <strong>sur</strong> les possibilités offertes par les<br />
nouvelles chaînes <strong>de</strong> valeur<br />
c. absence d'intermédiaires <strong>de</strong> marché adéquats pour permettre aux pauvres d'avoir accès aux<br />
chaînes <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> valeur<br />
d. caractère inadéquat <strong>du</strong> cadre d'action <strong>de</strong>s pouvoirs publics et <strong>du</strong> cadre institutionnel, qui ne<br />
sont pas favorables aux petits pro<strong>du</strong>cteurs<br />
e. capacité limitée <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s risques pour s’engager dans <strong>de</strong> nouvelles activités<br />
f. médiocrité <strong>de</strong>s infrastructures publiques<br />
19
Défi 4 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – accroissent-ils ou protègent-ils leur<br />
pouvoir d'achat <strong>sur</strong> les marchés <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its agricoles et alimentaires, ou comment pourraient-ils le<br />
faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. effets <strong>sur</strong> <strong>la</strong> consommation <strong>de</strong> l'augmentation <strong>de</strong>s prix <strong>de</strong>s pro<strong>du</strong>its alimentaires, qui<br />
dépassent les avantages obtenus par les petits pro<strong>du</strong>cteurs pauvres<br />
b. les politiques et les programmes publics ne suffisent pas à protéger les ruraux pauvres en<br />
tant que consommateurs<br />
c. prédominance, <strong>sur</strong> les marchés agricoles, <strong>de</strong>s chaînes <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction et <strong>de</strong> distribution non<br />
compétitives<br />
Chapitre 5<br />
Défi 1 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – trouvent-ils <strong>de</strong>s possibilités d'activités<br />
non agricoles rentables <strong>sur</strong> les marchés locaux, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers<br />
obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. stagnation <strong>de</strong> l'économie locale<br />
b. contexte peu attrayant pour les investissements privés<br />
c. faiblesse <strong>de</strong>s liaisons avec les zones urbaines et les économies urbaines<br />
d. insuffisance <strong>de</strong>s infrastructures<br />
Défi 2 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – développent-ils <strong>de</strong>s activités et <strong>de</strong>s<br />
petites entreprises non agricoles viables, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles<br />
parmi lesquels on peut citer:<br />
a. faiblesse <strong>de</strong> l'accès aux actifs pro<strong>du</strong>ctifs et financiers nécessaires<br />
b. faiblesse <strong>de</strong> l'accès à <strong>de</strong>s services ruraux adéquats et abordables<br />
c. insuffisance <strong>du</strong> capital humain et <strong>de</strong> <strong>la</strong> formation pour entrer en concurrence dans les<br />
activités non agricoles<br />
d. insuffisance <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> locale <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>its et <strong>de</strong> services non agricoles<br />
e. absence <strong>de</strong> protection sociale contre les pertes d'actifs<br />
Défi 3 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – exploitent-ils au mieux les possibilités<br />
d'emploi liées à l'urbanisation et à <strong>la</strong> migration, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers<br />
obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. faibles compétences <strong>de</strong> <strong>la</strong> main-d'œuvre locale et faible valeur <strong>de</strong> marché<br />
b. insuffisance <strong>de</strong> l'accès à l'information re<strong>la</strong>tive aux possibilités existantes dans les zones<br />
urbaines ou les zones <strong>de</strong> migration<br />
c. discrimination et manque <strong>de</strong> transparence <strong>de</strong>s marchés <strong>du</strong> travail dans les zones urbaines ou<br />
les zones <strong>de</strong> migration<br />
d. l'urbanisation et les migrations ne sont pas appuyées par <strong>de</strong>s politiques favorables<br />
Défi 4 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – tirent-ils parti <strong>de</strong>s possibilités <strong>de</strong><br />
revenus non agricoles liées au changement climatique, ou comment pourraient-ils le faire, malgré<br />
divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. développement insuffisant <strong>de</strong>s marchés concernant les services environnementaux et les<br />
échanges <strong>de</strong> droits d’émission <strong>de</strong> carbone<br />
b. les ruraux pauvres – femmes et hommes – ne disposent pas d'informations <strong>sur</strong> les nouvelles<br />
possibilités<br />
20
c. manque <strong>de</strong> moyens permettant <strong>de</strong> tirer parti <strong>de</strong>s nouvelles possibilités<br />
d. les nouvelles possibilités ont attiré d'importants investisseurs privés, ce qui présente un<br />
danger pour <strong>la</strong> sécurité d'accès et d'utilisation par les popu<strong>la</strong>tions rurales pauvres <strong>de</strong>s<br />
ressources naturelles clés (terre, forêts, eau, par exemple).<br />
Chapitre 6<br />
Défi 1 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – composent-ils une stratégie d'action<br />
favorable aux pauvres cohérente et convaincante, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers<br />
obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. les pauvres – femmes et hommes – ne sont pas encouragés à participer aux processus<br />
politiques, et n'en ont pas le temps<br />
b. gran<strong>de</strong> diversité <strong>de</strong>s intérêts (ou <strong>de</strong>s conflits) entre les ruraux pauvres – femmes et hommes<br />
c. les pauvres sont mal informés <strong>de</strong>s processus politiques pertinents<br />
d. caractère limité <strong>de</strong> l'organisation et <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d'action collective <strong>de</strong>s ruraux pauvres<br />
e. compréhension insuffisante <strong>de</strong>s possibilités d'action susceptibles <strong>de</strong> répondre au mieux aux<br />
besoins <strong>de</strong>s ruraux pauvres - femmes et hommes<br />
f. caractère non représentatif <strong>de</strong>s organisations <strong>de</strong>s ruraux pauvres - femmes et hommes<br />
Défi 2 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – ont-ils accès aux processus politiques<br />
formels et informels dans les arènes pertinentes, ou comment pourraient-ils le faire, malgré divers<br />
obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. complexité et chevauchement <strong>de</strong>s espaces et <strong>de</strong>s arènes politiques, sans c<strong>la</strong>ire délimitation<br />
b. instabilité ou absence <strong>de</strong> transparence <strong>de</strong>s processus politiques<br />
c. les processus <strong>de</strong>s Documents <strong>de</strong> stratégie pour <strong>la</strong> ré<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> <strong>la</strong> pauvreté omettent souvent<br />
<strong>de</strong> prendre en compte les pauvres – femmes et hommes<br />
d. difficultés rencontrées dans <strong>la</strong> détermination <strong>de</strong>s processus politiques présentant <strong>la</strong> plus<br />
gran<strong>de</strong> pertinence pour les pauvres – femmes et hommes<br />
e. les arènes et espaces politiques formels n'ont pas un caractère global<br />
f. absence <strong>de</strong> mécanismes institutionnels efficaces pour l'accès aux processus politiques<br />
formels<br />
g. caractère limité <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d'action collective <strong>de</strong>s ruraux pauvres dans les processus<br />
politiques informels<br />
h. faiblesse <strong>de</strong> l'engagement politique en faveur <strong>de</strong> <strong>la</strong> participation démocratique ou <strong>de</strong>s<br />
réformes favorables aux pauvres<br />
Défi 3 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – exercent-ils une influence <strong>sur</strong> les<br />
processus politiques formels et informels pertinents pour le développement rural, ou comment<br />
pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. caractère limité <strong>de</strong> <strong>la</strong> capacité d'action collective <strong>de</strong>s ruraux pauvres – femmes et hommes<br />
b. les responsables <strong>de</strong>s politiques et les institutions formelles <strong>de</strong> gouvernance ne sont pas<br />
suffisamment tenus <strong>de</strong> rendre <strong>de</strong>s comptes<br />
c. conflits d'intérêt avec <strong>de</strong>s groupes sociaux plus influents<br />
21
d. processus politiques façonnés par un petit groupe <strong>de</strong> parties prenantes<br />
Défi 4 : Comment les ruraux pauvres – femmes et hommes – s'as<strong>sur</strong>ent-ils que les décisions <strong>de</strong>s<br />
pouvoirs publics favorables aux pauvres sont mises en œuvre et ont un impact positif, ou comment<br />
pourraient-ils le faire, malgré divers obstacles parmi lesquels on peut citer:<br />
a. capacité limitée <strong>de</strong>s institutions administratives<br />
b. fragilité <strong>de</strong> l'État ou situation <strong>de</strong> conflit/post-conflit<br />
c. les processus <strong>de</strong> S&E <strong>de</strong>s décisions <strong>de</strong>s pouvoirs publics se déroulent uniquement <strong>de</strong> façon<br />
<strong>de</strong>scendante<br />
d. les ruraux pauvres – femmes et hommes – n'ont aucune influence <strong>sur</strong> l'allocation <strong>de</strong>s<br />
ressources publiques<br />
22