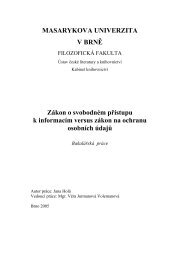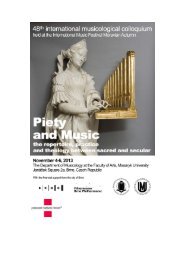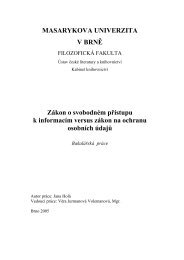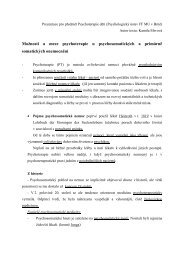quelques exemples des latinismes en français
quelques exemples des latinismes en français
quelques exemples des latinismes en français
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CHANGEMENTS DE SENS CONCERNANT LES MOTS D’EMPRUNT …<br />
33<br />
1265, 1275 JdM dans le s<strong>en</strong>s philosophique du latin convertibilitas qui<br />
désignai<strong>en</strong>t, au Moy<strong>en</strong> Age la « capacité de passer librem<strong>en</strong>t d’une ess<strong>en</strong>ce à<br />
l’autre » et avec le déclin de la philosophie médiévale il est sortie d’usage et n´a<br />
été repris qu’<strong>en</strong> 1845 dans son s<strong>en</strong>s moderne, financier.). Il est important de<br />
noter que la majorité <strong>des</strong> <strong>exemples</strong> étudiés suit cette évolution converg<strong>en</strong>te par<br />
rapport aux s<strong>en</strong>s latins.<br />
Toutefois, il existe <strong>des</strong> <strong>latinismes</strong> dont le s<strong>en</strong>s <strong>en</strong> <strong>français</strong> n’a pas évolué<br />
depuis leur première occurr<strong>en</strong>ce et qui ont gardé la signification restreinte avec<br />
laquelle ils ont été empruntés. A titre d’exemple nous pouvons citer :<br />
Pot<strong>en</strong>ce – employé uniquem<strong>en</strong>t dans une de nombreuses significations du<br />
latin pot<strong>en</strong>tia – « béquille, pièce d’appui ».<br />
Impot<strong>en</strong>ce (impot<strong>en</strong>t) – uniquem<strong>en</strong>t dans le s<strong>en</strong>s de la première occurr<strong>en</strong>ce<br />
(JdM) « état de celui qui est impot<strong>en</strong>t: qui, par un vice de nature ou par accid<strong>en</strong>t<br />
ne peut se mouvoir, ou ne se meut qu’avec une extrême difficulté » (le s<strong>en</strong>s latin<br />
est beaucoup plus riche).<br />
On peut expliquer ce figem<strong>en</strong>t par la concurr<strong>en</strong>ce de puissance, pouvoir,<br />
impuissance qui ont couvert les autres significations du latin pot<strong>en</strong>tia,<br />
impot<strong>en</strong>tia.<br />
Nous avons vu que la plupart <strong>des</strong> <strong>latinismes</strong> qui étai<strong>en</strong>t polysémiques <strong>en</strong> latin<br />
ont subi <strong>en</strong> <strong>français</strong> <strong>des</strong> modifications de s<strong>en</strong>s converg<strong>en</strong>tes par rapport au latin.<br />
Cep<strong>en</strong>dant nous devons constater que certains d’<strong>en</strong>tre eux ont perdu au cours <strong>des</strong><br />
siècles <strong>des</strong> significations qu’ils avai<strong>en</strong>t empruntées ou calquées au latin:<br />
Université a perdu son s<strong>en</strong>s de « généralité <strong>en</strong>globant tous les cas particuliers »<br />
et n’a gardé que celui de « corps <strong>des</strong> maîtres de l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t public <strong>des</strong> divers<br />
degrés » et le s<strong>en</strong>s métonymique.<br />
Nation a perdu son s<strong>en</strong>s de « naissance, nativité ». Discrétion a perdu le s<strong>en</strong>s<br />
de « différ<strong>en</strong>ce », corollaire son s<strong>en</strong>s primitif de « supplém<strong>en</strong>t ». On peut<br />
expliquer ce phénomène d’abord par l’utilisation <strong>des</strong> synonymes concurr<strong>en</strong>ts<br />
universalité, naissance mais aussi par le déclin du rôle et de l’utilisation du latin<br />
par rapport au Moy<strong>en</strong> Age : le contact étroit dans lequel étai<strong>en</strong>t le <strong>français</strong> et le<br />
latin p<strong>en</strong>dant le Moy<strong>en</strong> Age s’était perdu.<br />
b) Évolution diverg<strong>en</strong>te<br />
On remarque une autre t<strong>en</strong>dance importante concernant l’évolution de s<strong>en</strong>s de<br />
la majorité <strong>des</strong> <strong>exemples</strong> étudiés ; l´évolution indép<strong>en</strong>dante de leur „modèle“<br />
latin: le latinisme reçoit ainsi <strong>des</strong> significations qui n’existai<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> latin.<br />
Il s’agit d’un côté <strong>des</strong> changem<strong>en</strong>ts qu’on pourrait qualifier d’autonomes,<br />
nous <strong>en</strong>t<strong>en</strong>dons par là une évolution de s<strong>en</strong>s analogue à l’évolution de s<strong>en</strong>s <strong>des</strong><br />
autres mots autochtones, indép<strong>en</strong>dante <strong>des</strong> autres langues.<br />
A titre d’exemple nous pouvons citer :<br />
Constellation – JdM 1275 « position respective <strong>des</strong> astres », 1538 par<br />
métonymie « groupe d’étoiles formant une figure », 1845 par métaphore –<br />
« groupe d’objet brillants, de personnes remarquables » – s<strong>en</strong>s que le latin ne<br />
connaît pas. Le premier changem<strong>en</strong>t est motivé par le fait que le <strong>français</strong> n’a<br />
jamais emprunté au latin l’expression sidus, la deuxième modification par