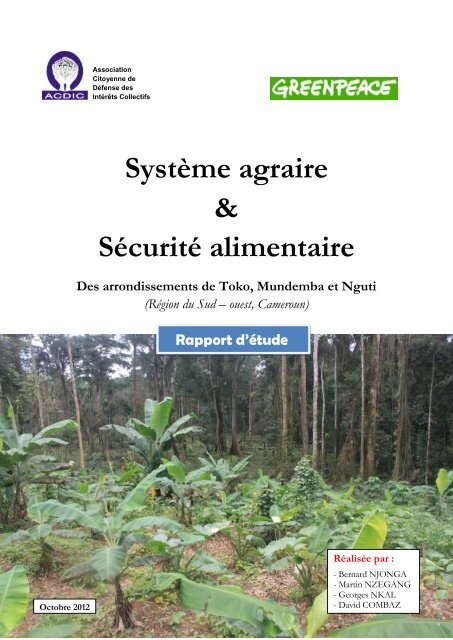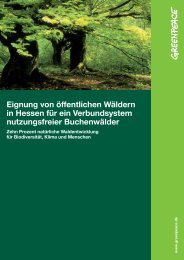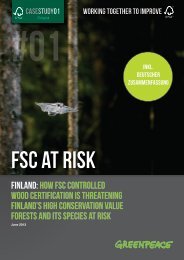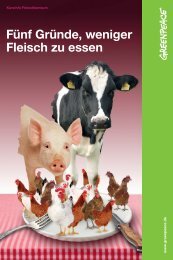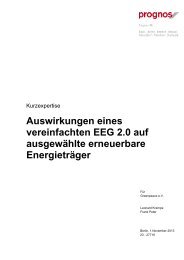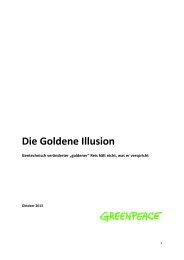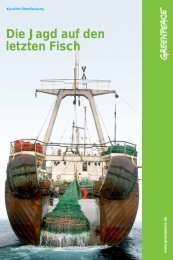Système agraire & Sécurité alimentaire Des ... - Greenpeace
Système agraire & Sécurité alimentaire Des ... - Greenpeace
Système agraire & Sécurité alimentaire Des ... - Greenpeace
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RAPPORT D’ETUDE<br />
Association<br />
Citoyenne de<br />
Défense des<br />
Intérêts Collectifs<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong><br />
&<br />
<strong>Sécurité</strong> <strong>alimentaire</strong><br />
<strong>Des</strong> arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti<br />
(Région du Sud – ouest, Cameroun)<br />
Rapport d’étude<br />
Réalisée par :<br />
- Bernard NJONGA<br />
- Martin NZEGANG<br />
- Georges NKAL<br />
- David COMBAZ 1<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
Octobre 2012
RAPPORT D’ETUDE<br />
Table des matières<br />
Table des matières ............................................................................................................................................... 2<br />
Sigles ........................................................................................................................................................................ 5<br />
Introduction ........................................................................................................................................................... 7<br />
PARTIE I : Contexte global de l’étude .......................................................................................... 10<br />
CHAPITRE 1 : Milieu naturel ............................................................................................................................ 11<br />
Géomorphologie et climat.............................................................................................................11<br />
Faune et flore.....................................................................................................................................12<br />
Quelques repères historiques ....................................................................................................... 13<br />
Successions coloniales et républicaines ...............................................................................................13<br />
Influences sur la gestion des terres......................................................................................................13<br />
Litiges historiques………………………………………………………………………14<br />
Sentiments d’aujourd’hui....................................................................................................................16<br />
Organisation actuelle du territoire ............................................................................................. 17<br />
Démographie et urbanisation...................................................................................................17<br />
Économie................................................................................................................................17<br />
Infrastructures de communication.............................................................................................19<br />
CHAPITRE 2 : Paysage agricole et sécurité <strong>alimentaire</strong> ........................................................................... 21<br />
Histoire <strong>agraire</strong> de la région......................................................................................................... 21<br />
<strong>Des</strong> sociétés nomades et acéphales.............................................................................................21<br />
Le développement des cultures de rente à l’époque coloniale........................................................21<br />
La formalisation de l’accès au foncier .......................................................................................22<br />
L’encadrement étatique de l’indépendance à la libéralisation......................................................23<br />
L’agriculture face à la libéralisation.........................................................................................24<br />
CHAPITRE 3 : Paysage agricole..................................................................................................................... 26<br />
Arrondissement de Nguti..............................................................................................................26<br />
Dans le Ndian...................................................................................................................................27<br />
Typologie des espaces cultivés .................................................................................................... 27<br />
Agroforêts cacaoyères.....................................................................................................................27<br />
Matériel végétal et pépinières....................................................................................................23<br />
Prospection et choix du terrain.................................................................................................24<br />
Défrichement...........................................................................................................................24<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
2
RAPPORT D’ETUDE<br />
Plantation et conduite de la jeune cacaoyère............................................................................25<br />
Conduite de la cacaoyère adulte..............................................................................................24<br />
CHAPITRE 4 : Palmeraie à huile en culture pure........................................................................30<br />
Matériel végétal et pépinières.....................................................................................................30<br />
Prospection et choix du terrain...................................................................................................30<br />
Préparation du terrain........................................................................................................................30<br />
Plantation et conduite de la jeune palmeraie..........................................................................31<br />
Conduite de la palmeraie adulte.................................................................................................31<br />
Les concessions agro industrielles.............................................................................................32<br />
Champs vivriers sur jachère.........................................................................................................32<br />
Champs de manioc en culture pure..........................................................................................36<br />
Champs vivriers en association...................................................................................................33<br />
Bananier plantains .................................................................................................................39<br />
Champs de bas-fond.......................................................................................................................34<br />
Jardin de case....................................................................................................................................34<br />
Arbres fruitiers..................................................................................................................................35<br />
Production des fruits......................................................................................................................35<br />
Gestion de la main-d’oeuvre.......................................................................................................40<br />
Niveau familial.........................................................................................................................40<br />
Organisation du travail en équipe...............................................................................................40<br />
La main d’œuvre salariée............................................................................................................40<br />
Economie des ménages ................................................................................................................. 41<br />
Sources de revenus...................................................................................................................40<br />
Les postes de dépenses clés........................................................................................................40<br />
Les défis de l’agriculture familiale ............................................................................................. 40<br />
Disponibilité foncière...............................................................................................................40<br />
Organisation des filières...........................................................................................................40<br />
L’absence d’encadrement agricole..............................................................................................48<br />
Le manque de financement.......................................................................................................49<br />
Approvisionnement en protéines animales ..............................................................................49<br />
Élevage....................................................................................................................................49<br />
Pêche.......................................................................................................................................50<br />
Chasse.....................................................................................................................................50<br />
<strong>Sécurité</strong> et souveraineté <strong>alimentaire</strong>...........................................................................................50<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
3
RAPPORT D’ETUDE<br />
Le vivrier dans le paysage agricole............................................................................................51<br />
Disponibilité sur les marchés locaux .......................................................................................53<br />
Accessibilité pour les ménages...................................................................................................53<br />
CHAPITRE 5 : Conséquences prévisibles du projet SGSOC.......................................................56<br />
Rappel des éléments clés du projet ............................................................................................ 56<br />
Conséquences sur la sécurité <strong>alimentaire</strong> ................................................................................ 57<br />
Disponibilité des terres et capacités de production .............................................................. 58<br />
Capacité de transport et de commercialisation ...................................................................... 62<br />
Impact sur le revenu des ménages ............................................................................................. 63<br />
Un point sur la biodiversité .......................................................................................................... 63<br />
ENCART : Quelques observations sur le système <strong>agraire</strong> de la région ..................................... I-VI<br />
PARTIE II : Recommandations ..................................................................................................... 67<br />
CHAPITRE 1 : Pour la sécurité <strong>alimentaire</strong> ……………………………………………….……...68<br />
Présentation d’un pôle de promotion de culture vivrière (PPCV)……………………68<br />
Définition ........................................................................................................................................... 68<br />
Point d’ancrage de l’initiative ...................................................................................................... 69<br />
Objectif de l’initiative ..................................................................................................................... 69<br />
<strong>Des</strong>cription de l’initiative avec les hypothèses de travail et les résultats possibles ..... 69<br />
Hypothèse 1............................................................................................................................69<br />
Hypothèse 2............................................................................................................................69<br />
Hypothèse 3............................................................................................................................69<br />
CHAPITRE 2 : Pour la biodiversité agricole ................................................................................ 70<br />
Deux approches complémentaires ............................................................................................. 71<br />
Grandir sans grossir ........................................................................................................................ 71<br />
Ce qu’on peut faire .......................................................................................................................... 72<br />
Au-delà de la rationalité économique ........................................................................................ 73<br />
PARTIE III : Les insolites du système <strong>agraire</strong> ............................................................................... 75<br />
Références .................................................................................................................................... 78<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
4
RAPPORT D’ETUDE<br />
Sigles utilisés<br />
ACDIC : Association citoyenne de défense des intérêts collectifs<br />
CDC : Cameroon Development Corporation<br />
CED : Centre pour l’Environnement et le Développement<br />
CIFOR : Centre for international Forestry Research<br />
DFID : Department for international development<br />
FAO : Food and agriculture organization<br />
GEX : Groupement des Exportateurs du Cacao-Café<br />
GIZ : Getsellschaft für Internationale zusammenarbeit<br />
MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement rural<br />
MINFOF : Ministère de Forêts et de la Faune<br />
NPMB : National Produce Marketing Board<br />
ONCPB : Office National de Commercialisation des Produits de Base<br />
PA3C : Projet d’assainissement interne de la commercialisation du cacao et du café<br />
Pamol : appellation courante de Plantations Pamol du Cameroun Limited (PPCL)<br />
PSCC : Projet Semencier Cacao Café<br />
RSPO : Table Ronde pour la Production Durable d’Huile de Palme<br />
SEMRY : Société d’expansion et de modernisation de la riziculture de Yagoua<br />
SGSOC : Sithe Global Sustainable Oils Cameroon<br />
SODECAO : Société de développement du cacao<br />
SODECOTON : Société de développement du coton<br />
SOWEFCU : South-West Farmers Cooperative Union<br />
VTC : Village Traditional Councils»<br />
WCMB : West Cameroon Marketing Board<br />
ZAPI : Zone d’action prioritaire intégrée<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
5
RAPPORT D’ETUDE<br />
INTRODUCTION<br />
Les émeutes de la faim, consécutives à une hausse brutale des cours des produits importés<br />
dont le riz, qui ont secoué la plus part des pays africains au mois de février 2008 n’ont pas qu’été<br />
négatives.<br />
Elles ont au moins eu le mérite d’aviser ces Etats sur les dangers de leur dépendance<br />
<strong>alimentaire</strong> et sur les risques qu’ils courent à négliger leurs tissus de production agricole, malgré<br />
que ces Etats aient reconnu la faiblesse des investissements dans ce secteur au point de décider en<br />
2005, alors réunis à Maputo au Mozambique, que chaque pays y consacre 10% de son budget<br />
annuel (Union Africaine, 2005).<br />
Apeuré par ces troubles qui ont surpris plus d’un, chaque Etat y est allé de ses ambitions et<br />
stratégies pour booster sa production afin de parer à toute éventuelle récidive. Au Mali par<br />
exemple, le gouvernement a mis des gros moyens pour accompagner les paysans dans la<br />
production du riz, avec des résultats forts élogieux. 1,3 millions de tonnes récoltés en 2010 contre<br />
700 000 tonnes deux ans plus tôt (Naudé, 2010).<br />
Le Cameroun, quant à lui semble avoir opté pour cette solution à hauts risques 1 de la cession<br />
de ses terres agricoles aux étrangers (Hoyle & Levang, 2012, Hydromine, n.d.), dans l’espoir qu’ils<br />
investissent et accroissent la production locale. Une situation qui frise la sous-traitance de sa<br />
souveraineté <strong>alimentaire</strong> et de l’aménagement de son territoire, sans aucune garantie que la<br />
production de ces investisseurs viendrait alimenter les marchés locaux.<br />
C’est dans cette mouvance que la société américaine Sithe Global Sustainable Oils Cameroon<br />
(SGSOC) a obtenu du gouvernement camerounais en septembre 2009, la signature d’une<br />
convention l’autorisant à mettre en valeur une exploitation de palmier à huile sur environ 70 000<br />
ha dans la région du Sud-ouest.<br />
Alors que SGSOC prenait des dispositions agronomiques telles la création de germoirs et<br />
pépinières pour une mise en valeur effective de cette « gigantesque » exploitation, voilà que des<br />
voix portées par <strong>Greenpeace</strong> sur le plan international et le CED (Centre pour l’Environnement et<br />
le Développement) sur le plan national, se sont élevées pour dénoncer non seulement les travers<br />
de la convention, mais aussi et surtout les méfaits de cette exploitation sur l’environnement et sur<br />
la vie des populations locales (Guiffo & Schwartz, 2012).<br />
1 En particulier : mise en péril de la sécurité et de la souveraineté <strong>alimentaire</strong> (production en fonction du marché) ; fortes<br />
fluctuation des prix ; consolidation de l’agrobusiness (consolidation de grandes entreprises agricole à salariés) ; destruction<br />
massive des agricultures familiales avec destruction irréversible des savoirs faire paysans, des modes de vie, de la diversité<br />
culturelle et de la biodiversité agricole ; conflits sociaux ; exclusions et d’accroissement des inégalités ; conflits de générations.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
7
RAPPORT D’ETUDE<br />
D’après <strong>Greenpeace</strong>, les investisseurs doivent agir de façon beaucoup plus responsable en<br />
définissant et en promouvant des stratégies alternatives de développement qui visent à protéger<br />
des ressources naturelles et à renforcer les moyens de subsistance des populations locales .<br />
Une lecture des choses peu partagée par le projet d’Herakles Farms, qui pousse <strong>Greenpeace</strong> à<br />
qualifier le projet SGSOC de mauvais projet au mauvais endroit, qu’il faut arrêter avant qu’il ne<br />
soit trop tard (<strong>Greenpeace</strong> International, 2012).<br />
Une campagne dans ce sens saurait-elle réussir sans alternatives crédibles aux « appâts » qui<br />
ont poussé tant les pouvoirs publiques qu’une partie des populations à adhérer à un tel projet ?<br />
<strong>Greenpeace</strong> s’en interroge et il est en cela rejoint par l’ACDIC (Association Citoyenne de<br />
Défense des Intérêts Collectifs) pour qui la vulnérabilité accrue des populations à toute insécurité<br />
dont l’insécurité <strong>alimentaire</strong> est déterminante dans leurs stratégies d’adaptation ou d’amélioration<br />
de leurs conditions de vie.<br />
C’est dans l’optique de formuler ces alternatives que cette étude a été initiée avec pour objectif<br />
global de déterminer comment l’exploitation agricole familiale peut aider à préserver et entretenir<br />
la biodiversité tout en assurant des moyens d’existence aux populations. Plus spécifiquement<br />
l’étude devait permettre<br />
1. d’identifier les influences des systèmes <strong>agraire</strong>s sur la biodiversité et la sécurité <strong>alimentaire</strong><br />
pouvant être associées aux différents modes de production agricoles dans la région de<br />
Korup, en mettant l’accent sur l’agro foresterie.<br />
2. d’identifier les facteurs socioéconomiques qui influencent les pratiques paysannes.<br />
3. d’identifier les influences macroéconomiques (nationales et internationales), ainsi que des<br />
politiques agricoles et environnementales etc.) qui impactent sur les facteurs ci-dessus<br />
relevés.<br />
La méthodologique dans le cadre de cette étude a été essentiellement basée sur les séjours<br />
dans le milieu, les entretiens avec les différents acteurs et particulièrement avec les producteurs,<br />
les observations dans les champs et l’interprétation des données bibliographiques. L’étude se<br />
déroulant en saison des pluies, les données et informations sur les pratiques de saison sèche sont<br />
celles issues des entretiens avec les acteurs et des données bibliographiques.<br />
Pour des questions de temps et d’enclavement de certains villages en cette saison pluvieuse, les<br />
observations ont été focalisées sur les trois arrondissements impliqués dans le projet SGSOC que<br />
sont : Toko, Nguti et Mundemba.<br />
L’étude a été réalisée par une équipe de quatre personnes :<br />
1- Bernard Njonga, ingénieur agronome et président de l’ACDIC<br />
2- Martin Nzegang, journaliste, ACDIC<br />
3- Georges Nkal, ingénieur agro économiste, consultant,<br />
4- David Combaz, <strong>Greenpeace</strong> - France<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
8
RAPPORT D’ETUDE<br />
Ce rapport d’étude comporte trois parties. Une qui porte sur le système <strong>agraire</strong> dans la zone et<br />
sa capacité à assurer la sécurité et la souveraineté <strong>alimentaire</strong>. La deuxième qui porte sur la gestion<br />
de la mosaïque forêt/agriculture dans la région. La troisième propose des orientations<br />
stratégiques et des recommandations concrètes pour améliorer ces deux paramètres.<br />
Nous espérons que ce rapport pourra contribuer à concilier toutes les parties prenantes autour<br />
d’un compromis qui prend en compte les nécessités d’amélioration des conditions de vie des<br />
populations et celles de la protection de l’environnement.<br />
Que toutes les agricultrices et tous les agriculteurs, tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce<br />
travail trouvent ici l’expression de nos plus vifs remerciements.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
9
RAPPORT D’ETUDE<br />
PARTIE I :<br />
CONTEXTE GLOBAL DE L’ETUDE<br />
Ce rapport décrit l’articulation entre les enjeux de biodiversité et de sécurité<br />
<strong>alimentaire</strong> confrontés à l’expansion de la culture mono spécifique industrielle d’huile de<br />
palme, dans un territoire déterminé. L’étude dont il est issu se concentre par conséquent<br />
spécifiquement sur les territoires immédiatement touchés par le projet de plantation de la<br />
société Herakles Farms, c’est-à-dire les arrondissements de Mundemba, Toko et Nguti<br />
dans les départements du Ndian et du Koupé-Manengoumba, dans la région du Sudouest<br />
du Cameroun.<br />
La compréhension des enjeux de biodiversité et de sécurité <strong>alimentaire</strong> dans cette région ne<br />
saurait se faire sans une analyse de ce qu’est ce territoire. Un territoire n’est pas seulement un<br />
paysage, ni une frontière. Un territoire est une construction, une appropriation et une<br />
transformation d’un milieu physique par les populations qui s’y sont succédé. Cette première<br />
partie de contextualisation vise à présenter ce territoire, à travers sa géographie physique, son<br />
histoire et son organisation actuelle.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
10
RAPPORT D’ETUDE<br />
Chapitre I : Milieu naturel<br />
I. Géomorphologie et climat<br />
La région du Sud-ouest s’étend le long de la frontière nigériane, au Nord-Ouest de la partie Sud du Cameroun.<br />
Elle est bordée au Nord et à l’Est par la région du Nord-ouest, et au Sud-ouest par la région du Littoral. D’un<br />
point de vue bioclimatique, elle fait partie de la zone forestière à pluviométrie monomodale. Le climat est de type<br />
équatorial à deux saisons : une longue saison des pluies de mars à novembre, et une courte saison sèche de novembre<br />
à mars. Le réseau hydrographique y est très développé. Les principaux cours d’eau sont le Ndian, la Manyu et la<br />
Meme qui ont donné leurs noms à 3 des 6 départements de la région. En plus de ces principaux cours d’eau la<br />
région est traversée de part en part de nombreuses rivières et dispose d’un large accès à la mer. L’embouchure du<br />
Rio-del-Rey et la péninsule de Bakassi, à la frontière, sont couvertes de mangroves.<br />
Le relief de la région est très varié, constitué de plaines et de plateaux. La région est dominée<br />
au Sud par le Mont Cameroun (4095 m). Les hautes terres comprennent notamment les Rumpi<br />
Hills dans la partie centrale et. Les retombées des Monts Koupe et Manengoumba à l’Est<br />
constituent la limite méridionale de la dorsale camerounaise. Les basses terres occupent, comme<br />
les plateaux, des espaces hétérogènes. Trois éléments se distinguent : la plaine littorale qui s’étend<br />
du bassin de Tiko au Rio-del-Rey, le Bassin du Ndian et la Cuvette de Mamfé.<br />
Les arrondissements de Mundemba, Toko et Nguti sont situés principalement dans ces basses<br />
terres : Mundemba couvre une partie du bassin du Ndian, Nguti constitue le Sud de la cuvette de<br />
Mamfé, Tandis que Toko relie les deux en chevauchant les flancs de Rumpi Hills. On peut<br />
globalement diviser le Sud-ouest en 6 unités géographiques:<br />
La zone volcanique à basse altitude : qui comprend le Sud et l’Est du Mont Cameroun et<br />
le département de Kupe Manengoumba avec une altitude variant entre 0 et 600 m pour<br />
une pluviométrie de 3000 à 4500 mm. Les terres y sont relativement fertiles.<br />
Le corridor de Kumba, dans le département de la Meme, d’une altitude moyenne de 100 à<br />
400 m pour une pluviométrie modérée de 2200 à 2500 mm. Cette zone, située le long de<br />
l’axe Kumba-Mamfé est assez densément peuplée malgré la présence de sols assez<br />
pauvres.<br />
Les savanes hautes (Bangem), à la limite de la région du Nord-Ouest, sont élevées de 400<br />
à 2500 m pour une pluviométrie de 2200 mm. Les sols sur cendres volcaniques y sont très<br />
riches, comme à Tombel.<br />
La cuvette de Mamfé, qui comprend au Sud l’arrondissement de Nguti, est assez basse<br />
avec une altitude ne dépassant pas les 300 m pour une pluviométrie assez forte de 3200<br />
mm. Les sols y sont généralement granitiques ou basaltiques, assez argileux, assez fertiles.<br />
Du fait du relief et du manque d’infrastructures, cette zone est très enclavée.<br />
La zone sablonneuse (Ekondo Titi, Mundemba) fait la transition entre la plaine littorale et<br />
le Bassin du Ndian elle est basse (300 m maximum) et assez arrosée ( 1800 à 3000 mm)<br />
mais les sols y sont souvent pauvres.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
11
RAPPORT D’ETUDE<br />
Les forêts montagneuses (Toko, Mundemba, Monts Bakossi) couvrent notamment les<br />
Rumpi Hills et leur piémont. Le relief y est très vallonné, d’une altitude de 400 à 1400 m<br />
pour une forte pluviométrie de 2800 à 3800 mm. Les sols y sont généralement riches,<br />
basaltiques et argileux, mais les pentes peuvent constituer un facteur limitant. Les densités<br />
de population y sont assez faibles.<br />
II.<br />
Faune et flore<br />
La région du Sud-ouest est en partie recouverte par le massif des forêts côtières du Golfe de Guinée, qui traverse<br />
la frontière nigériane et s’étend sur le delta de la Cross-River. Il constitue donc l’extrémité Nord-ouest du Bassin<br />
du Congo. L’extrême biodiversité végétale et animale de cette zone a été décrite par de nombreuses études, qui ont<br />
mis en évidence un taux d’endémisme extrêmement élevé. De fait, la zone de Korup est considérée comme le site de<br />
basse altitude abritant la plus grande diversité d’Afrique pour presque tous les taxons. Elle est donc d’une<br />
importance primordiale pour la conservation de nombreux primates, oiseaux, papillons, chauve-souris, reptiles, etc.<br />
(Malleson, 2000, Oates & al., 2004, Tchigio, 2007, Haman Bako & al., 2011).<br />
Plus spécifiquement, la zone d’étude est couverte d’une mosaïque agricole et forestière. Les<br />
espaces boisés sont couverts à l’état naturel de forêt pluviale de basse altitude sempervirente à<br />
large feuilles, dominée par les des arbres appartenant à la famille des Césalpiniacée, et dans une<br />
moindre mesure de forêts piémontaises et submontagnardes. Les espaces les mieux préservés<br />
(classifiés par <strong>Greenpeace</strong> et le World Resource Institute comme « paysages de forêts intactes »)<br />
se trouvent dans les parcs nationaux de Korup, ainsi que dans les réserves des Rumpi Hills et de<br />
Banyang Mbo, ainsi que dans les zones situées entre Korup et les Rumpi Hills (une zone habitée,<br />
comprise sur le site convoité par SGSOC) (Thies & al., 2011). Ces zones sont considérées comme<br />
indispensables à la préservation d’espèces très menacées au niveau mondial, en particulier chez les<br />
primates comme le drill (Mandrillus leucophaeus), le colobe rouge de Preuss (Procolobus preussi), le<br />
gorille des montagnes (Gorrilla beringei beringei), le chimpanzé (Pan troglodytes), etc. Enfin, l’ensemble<br />
de la zone est traversé par un réseau hydrographique dense qui trouve sa source dans les Rumpi<br />
Hills pour alimenter les mangroves du Rio-del-Rey, protégés par la convention de Ramsar pour<br />
leur importance dans la conservation d’oiseaux migratoires, et alimentant un des derniers riches<br />
stocks de poissons de la côte atlantique africaine (Tchigio, 2007, ProPSFE, 2010, Haman Bako &<br />
al., 2011).<br />
Ces caractéristiques exceptionnelles ont conduit l’ONG Conservation International (CI) à<br />
classer toute la zone dans le hot spot de biodiversité des « Forêts Guinéennes d’Afrique de<br />
l’Ouest », qui est « l’un des plus fragmentés de la planète », avec à peine 15% de sa surface<br />
originelle encore en état. Les principales menaces identifiées par CI sont l’expansion de<br />
l’agriculture industrielle, l’exploitation forestière, l’exploitation minière et une pression de chasse<br />
excessive (Conservation International, n.d.). Comme on le verra, la zone de l’étude correspond<br />
très précisément à cette description.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
12
RAPPORT D’ETUDE<br />
III.<br />
Quelques repères historiques<br />
Comprendre les enjeux associés à ces territoires ne peut se faire sans une certaine mise en perspective. Cette<br />
première partie a donc vocation à présenter la zone d’étude dans son contexte, celui d’une région riche mais délaissée<br />
et victime récurrente d’injustice historique.<br />
1. SUCCESSIONS COLONIALES ET REPUBLICAINES<br />
Le Sud-ouest est l’une des 10 régions administratives du Cameroun, mais surtout l’une des<br />
deux régions anglophones du pays. Cette caractéristique s’explique par l’histoire : suite à la défaite<br />
allemande, la colonie du Kamerun fut partagée par le traité de Versailles en 1919 entre Français et<br />
Anglais. Le Sud-ouest et le Nord-ouest furent ainsi attribués à la couronne Britannique, jusqu’en<br />
1954, date à laquelle les deux provinces intégrèrent le Nigéria voisin. Au lendemain de<br />
l’indépendance et après la réunification le 1 er octobre 1961, cette partie du pays forme l’un des<br />
deux États fédérés du Cameroun. Elle porte le nom officiel de West Cameroon.<br />
En 1972, un référendum aboutit à la suppression du système fédéral pour laisser place à la<br />
République unie du Cameroun. Les anglophones virent en cela une trahison de l’esprit de la<br />
conférence de Foumban en 1961 qui avait abouti à la naissance de la république fédérale.<br />
En 1984, l’Assemblée nationale la suppression de la mention République Unie et le<br />
Cameroun s’appelle tout simplement « République du Cameroun », nom que portait à<br />
l’indépendance le Cameroun précédemment sous tutelle de la France. Une fois de plus les<br />
anglophones voient en cette initiative une manœuvre pour les assimiler. Tous ces événements<br />
successifs ont fini par créer en ces Camerounais un sentiment d’exclusion qui s’exprime de<br />
plusieurs façons, et principalement dans un mouvement à tendance sécessionniste, le Southern<br />
Cameroon national Council (SCNC).<br />
Malgré la célébration de la réunification et le fait que le Cameroun se réclame du bilinguisme,<br />
des différences fortes subsistent, et les populations anglophones ont souvent eu à se plaindre<br />
d’une forme de discrimination au niveau de l’État central.<br />
2. INFLUENCES SUR LA GESTION DES TERRES<br />
Du point de vue de la gestion du foncier, la transition entre l’administration héritée de l’empire<br />
britannique et celle d’inspiration française ne s’est pas faite sans heurts.<br />
L’administration coloniale britannique reposait en effet sur une gouvernance indirecte du<br />
territoire, en collaborant avec les « native authorities », selon l’expression consacrée. Dans le cas<br />
des sociétés acéphales peuplant les forêts du Sud-ouest, cette gouvernance indirecte avait donné<br />
lieu à quelques ajustements, notamment la mise en place de chefferies organisées autour de<br />
« Village Traditional Councils » (VTC). Entre autres attributions, les VTC jouaient un rôle important<br />
dans la gestion foncière et faisaient appliquer les règles de transmission traditionnellement<br />
admises.<br />
Après l’indépendance et la réunification, le droit en usage dans la partie francophone, hérité de<br />
l’administration coloniale française qui privilégiait un gouvernement direct à l’« indirect rule»<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
13
RAPPORT D’ETUDE<br />
britannique, s’est étendu au Sud-Ouest. Les ordonnances de 1974 relatives au droit foncier et au<br />
domaine de l’État établirent une présomption de domanialité sur les terres laissés « vacantes et<br />
sans maîtres » : en l’absence de titre foncier ou de preuve antérieure au 5 août 1974 établissant<br />
qu’une parcelle donnée était mise en valeur dans les 10 années précédentes, ladite parcelle est<br />
considérée propriété privée de l’État. Il se dit même que la notion de la propriété de l’Etat sur les<br />
terres pourrait être utilisée pour un passage en force si SG SOC avait des difficultés à accéder aux<br />
73000 ha que lui a cédés l’Etat camerounais.<br />
Par ailleurs, la législation camerounaise stipule que toute personne sollicitant exploiter un<br />
arbre, doit suivre une procédure bien définie telle que prescrite dans la loi n° 09-01 du<br />
20/01/1994 (et ses décrets d’application) portant régime des forets de la faune et de la pêche<br />
(United Republic of Cameroon, 1974a, United Republic of Cameroon, 1974b, Malleson, 2000)<br />
Aujourd’hui, les populations locales ne bénéficient donc que de l’usufruit de la terre, sous la<br />
gestion des autorités traditionnelles. L’obtention d’un titre foncier dans ce contexte implique un<br />
long ou coûteux (ou les deux) processus bureaucratique. Malgré une certaine augmentation du<br />
nombre de titres fonciers couvrant les surfaces les plus importantes, principalement le long des<br />
axes principaux, la plupart des populations de la zone n’ont actuellement pas de moyen légal de<br />
sécuriser leur « propriété ».<br />
Au « quotidien », cette situation ne pose pas trop de problèmes. Comme on le verra, la<br />
complexité des systèmes de transmission traditionnels peut être source de conflits, mais l’autorité<br />
des VTC est généralement suffisante pour régler ces litiges. Lorsqu’un grand projet vient menacer<br />
l’intégrité des terres utilisées par les populations locales, en revanche, l’absence de propriété<br />
privée stricto sensu ouvre la porte à de nombreuses dérives. Or le Sud-ouest, en général et les<br />
arrondissements de Toko, Nguti et Mundemba en particulier ont vu beaucoup de ces projets<br />
s’implanter sur son territoire…<br />
3. LITIGES HISTORIQUES…<br />
Sur le plan des ressources naturelles le Sud-ouest a les terres les plus fertiles (terres volcaniques<br />
autour du mont Cameroun), un sous-sol riche en pétrole, les côtes poissonneuses. Cette région<br />
est celle qui a cédé, contre son gré, les plus grandes étendues de terres agricoles aux sociétés agro<br />
industrielles (CDC, Delmonte, Pamol, CTE).<br />
Les premières accaparations de terres et les premiers déplacements de populations dus à des<br />
étrangers dans la zone d’étude datent des premiers instants de la colonisation allemande. Dès<br />
1986, soit deux ans après le traité de Douala officialisant l’annexion du Cameroun à la couronne<br />
allemande, les populations de la zone forestière de Korup furent déplacées le long des routes<br />
pour faciliter le travail de l’administration coloniale. Les terres « vacantes » furent prises par la<br />
couronne allemande et l’exploitation des ressources forestières (en particulier de l’ébène) fut<br />
organisée à grande échelle.<br />
Dès la fin du XIXème siècle, de grandes plantations – principalement de banane – sont mises<br />
en place, d’abord au pied du Mont Cameroun, puis au début du XXème siècle autour de la ville<br />
de Ndian aujourd’hui disparue, sur le site actuel de la PAMOL à Mundemba. Beaucoup<br />
d’indigènes de la région furent déplacés, soit pour « libérer l’espace », soit pour alimenter le travail<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
14
RAPPORT D’ETUDE<br />
forcé dans la bananeraie. De nombreux conflits eurent lieu au sujet de ces déplacements, en<br />
particulier les « guerres d’Ikoi », du nom du village dans lesquelles la rébellion a éclaté, au Nord<br />
des Rumpi Hills.<br />
A ces terres déjà prises, l’occupation anglaise ajouta la mise en réserve de nouveaux espaces,<br />
en particulier la Réserve Forestière de Korup, la plus grande et la première, créée en 1937. Bien<br />
que la gestion de ces réserves soit conférée aux « native authorities » et que les droits de collecte,<br />
de chasse et de culture soient garantis à l’intérieur des enclaves ménagées autour des villages<br />
inclus dedans, des conflits liés à l’usage des terres continuèrent de se perpétuer.<br />
Les décennies suivantes furent marquées par une période de relative croissance économique,<br />
principalement basée sur l’exploitation forestière, la culture du café et du cacao et l’extension des<br />
plantations comme la PAMOL. La prise de poids de la ville de Mundemba et surtout de Kumba<br />
suscitèrent un exode rural assez important en direction de ces nouveaux centres urbains, et la<br />
création d’élites locales assez capitalisées.<br />
La structuration des filières du cacao et du café par l’État, via l’Office National de<br />
Commercialisation des Produits de Base (ONCPB hier, et aujourd’hui ONCC mais pas avec les<br />
mêmes fonctions), seul exportateur autorisé garantissant des prix d’achat à un réseau de<br />
coopératives chargées de la collecte des récoltes et de l’encadrement des producteurs, fut très<br />
efficace jusqu’aux années 1985. La campagne 1985/86 vit cependant les prix du cacao et du café<br />
s’effondrer. La caisse de stabilisation de l’ONCPB, mal gérée, ne permit plus de payer les<br />
producteurs. Les coopératives distribuèrent des bons d’achat à échanger ultérieurement contre de<br />
l’argent, mais ne purent jamais payer dans la plupart des cas. Cette situation provoqua dans le<br />
Sud-ouest un ressentiment et une méfiance forte envers ce système de coopérative, qui dure<br />
encore aujourd’hui.<br />
C’est à ce moment que la création du Parc National de Korup par l’élargissement de la réserve<br />
préexistante vint renforcer la pression sur les terres en ôtant tout droit aux populations sur une<br />
surface d’environ 130 000 ha. La philosophie conversationniste de l’époque considérait comme<br />
indésirable la présence de villages enclavés, et tenta de provoquer la réinstallation de ces derniers<br />
hors des limites du parc.<br />
Le Korup Project, de 1989 à 2006, associant les ministères successifs en charge des forêts, du<br />
tourisme, de la faune etc., des ONG d’environnement comme le WWF et la WCS et des bailleurs<br />
comme le DFID et la GTZ-KfW (aujourd’hui GIZ), reposait sur l’idée qu’il fallait développer les<br />
espaces adjacents au park pour inciter les populations à s’en détourner. Le contexte de crise,<br />
l’ajustement structurel, la dévaluation du Franc CFA rendirent la tâche particulièrement difficile.<br />
La construction des routes indispensables au désenclavement de la zone, en particulier, prit<br />
énormément de temps, et le développement agricole fut très difficile à mettre en œuvre.<br />
La relocalisation des villages inclus dans le parc ne fut jamais effective et donna lieu à plusieurs<br />
conflits plus ou moins graves. Les structures villageoises « traditionnelles » furent imparfaitement<br />
associées à l’ensemble du processus. Le tout se déroulant dans un contexte d’exode urbain<br />
accroissant la pression sur les terres. La création du Sanctuaire de Banyang-Mbo et du parc des<br />
Monts Bakossi venant s’ajouter à Korup et aux Rumpi Hills, les conversationnistes furent<br />
identifiés comme les premiers « land grabbers » ( les accapareurs des terres ) pendant cette période,<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
15
RAPPORT D’ETUDE<br />
quoique des conflits liés à la destruction des arbres « économiques » (localement economics trees)<br />
par les exploitants forestiers dans l’arrondissement de Nguti ait permis de « diluer » un peu ce<br />
ressentiment et donner aux écologistes une opportunité de se placer en défenseurs des droits des<br />
populations.<br />
4. SENTIMENTS D’AUJOURD’HUI<br />
L’histoire des régions anglophones du Cameroun est donc une succession de luttes pour<br />
l’autonomie : contre la colonisation allemande, contre la tutelle britannique, contre<br />
l’ « assimilation » par la partie francophone. Au lendemain de l’entrée du Cameroun dans le<br />
multipartisme et la démocratie l’une des premières revendications des populations du Sud-ouest<br />
est la rétrocession des terres occupées par la CDC, les informations sur les recettes pétrolières et<br />
les investissements locaux issus de ces recettes. Ces questions sont toujours restées depuis en<br />
suspens, et aujourd’hui encore, les populations du Sud-ouest, particulièrement celles qui sont<br />
originaires naturels, ou assimilés (les autres Camerounais venus d’autres régions avant<br />
l’indépendance se considèrent comme du Sud-ouest) ont un sentiment d’exclusion qui s’exprime<br />
de diverses manières, particulièrement le 1er octobre, jour de la réunification.<br />
Et de fait, il faut reconnaître que les « sacrifices »consentis par les populations ont été peu<br />
rétribués : les impacts de ces investissements sont peu visibles dans tous les domaines de la vie<br />
des populations : infrastructures de communication (la route Buea- Kumba qui vient d’être<br />
bitumée est l’initiative de l’Union Européenne et non de ces agro industries) ; infrastructures<br />
sociales (hôpitaux, écoles)… Le sentiment général est que l’État, considérant la force de<br />
l’opposition dans la région, a délibérément choisi de la laisser à elle-même. Vrai ou faux, c’est un<br />
sentiment généralement exprimé<br />
Par rapport au projet Héraklès, ce sentiment s’exprime de trois façons :<br />
La première - répandue chez une partie de l’élite et une partie des paysans, considère<br />
que les écologistes, comme tous les autres acteurs ayant voulu s’intéresser à la zone ont<br />
failli dans leur ambition d’apporter le développement. Ceux qui partagent ce sentiment<br />
sont donc ouverts à l’intervention d’un opérateur économique privé fortement capitalisé<br />
pouvant réaliser des investissements supposés utiles pour l’ensemble de la population.<br />
La deuxième, portée par d’autres élites et l’autre partie des cultivateurs qui ont finalement<br />
réussi à s’adapter, soit en profitant de la reprise des cours du cacao, soit en investissant<br />
dans le vivrier. Ceux-ci considèrent que trop de terres leurs ont déjà été prises et ne sont<br />
pas prêts à en céder davantage, surtout si cela implique la destruction des ressources<br />
forestières sur lesquelles une grande partie de leurs modes de vie reposent, en particulier<br />
les PFNL et la viande de brousse.<br />
La troisième, ce sont les ONGs qui ne voient le projet que sous l’angle de la disparition<br />
des espèces végétales et fauniques.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
16
RAPPORT D’ETUDE<br />
IV.<br />
Organisation actuelle du territoire<br />
1. DONNEES DEMOGRAPHIQUE<br />
La population de la région du Sud ouest du Cameroun est de 1.641.151 habitants (chiffre<br />
actualisé sur la base d’un taux de croissance annuelle de 2 ,9 % constaté par le recensement de<br />
2005). Cette population représente 7,5 % de la population total du Cameroun. Notre zone<br />
d’étude est peuplée de près de 61.000 habitants dont 47 503 ruraux et environ 34.000 actifs.<br />
Tableau 1 : Principaux indicateurs démographiques des arrondissements de Nguti,<br />
Mundemba et Toko ; Année de référence : 2012<br />
N° Arrondissement Population totale Population rurale Population active<br />
1 Nguti 33857 28.171 18.824<br />
2 Mundemba 17.938 11.409 9973<br />
3 Toko 8773 7923 4877<br />
Total 60.568 47.503 33.674<br />
Comme on peut le lire sur le tableau ci-dessus, la plus grande majorité de la population<br />
est rurale, avoisinant les 80% du total de la population des trois arrondissements de Nguti<br />
(83%), Mundemba (63 %) et Toko (91 %).<br />
S’agissant des densités il manque des statistiques précises, cependant on remarque à<br />
l’observation que la population est plus concentrée autour des agglomérations principales que<br />
sont les villes de Mundemba, Nguti et Manyemen, tandis que la population de<br />
l’arrondissement de Toko est très fortement dispersée dans de nombreux petits villages situés<br />
entre le Parc National de Korup et la réserve des Rumpi Hills.<br />
Dans l’ensemble la proportion entre hommes est assez équilibrée. Selon les statistiques du<br />
recensement général de la population de 2005 actualisées, les hommes sont relativement plus<br />
nombreux que les femmes à Nguti et Toko, tandis que celles-ci sont plus nombreuses à<br />
Mundemba. Il faut cependant relever que la différence est de quelques dizaines de personnes.<br />
Tableau 2 : Répartition de la population rurale par sexe<br />
Arrondissement Hommes Femmes TOTAL<br />
Nguti 14.099 14.072 28 171<br />
Toko 3963 3960 7923<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
17
RAPPORT D’ETUDE<br />
Mundemba 5011 5498 10509<br />
TOTAL 24073 23530 47.503<br />
2. ÉCONOMIE<br />
L’économie de la région du Sud-ouest est axée autour de trois productions principales :<br />
L’exploitation pétrolière offshore, de Limbé à Bakassi, qui produit la plupart du pétrole<br />
camerounais.<br />
L’agriculture industrielle (palmier à huile, hévéa, banane douce, thé), qui couvre<br />
globalement l’ensemble de la plaine littorale, de Douala à Kumba en passant par Limbé et<br />
Buéa (CDC, Delmonte, CTE), ainsi que les terres entourant Ekondo-Titi et Mundemba<br />
(PAMOL).<br />
La cacaoculture. Le Sud-ouest et assure à lui seul plus de 70% de la production nationale.<br />
Le gros de la production se concentre au pied du mont Cameroun et dans le corridor de<br />
Kumba, ainsi que dans une moindre mesure dans la cuvette de Mamfé et sur l’axe<br />
Kumba-Ekondo-Titi. La plaque tournante du commerce des fèves se situe à Kumba.<br />
Les autres productions d’importance plus modeste d’un point de vue macroéconomique sont<br />
principalement localisées dans les « marges » occidentales et septentrionales de la région. Il s’agit<br />
principalement de l’exploitation forestière, l’agriculture vivrière, les produits forestiers non<br />
ligneux et la viande de brousse. Une activité assez importante est également liée au trafic de<br />
marchandises avec le Nigéria voisin.<br />
La zone spécifiquement couverte par cette étude n’est pas la plus dynamique du territoire, loin<br />
s’en faut. L’arrondissement de Mundemba est principalement dominé par la production d’huile<br />
de palme, soit de manière industrielle par la société PAMOL, soit de manière artisanale.<br />
Beaucoup de particuliers – souvent des cadres de la PAMOL – possèdent leur propre plantation<br />
et font presser leurs régimes soit par la société elle-même, soit de manière artisanale.<br />
Le cacao est surtout présent dans l’arrondissement de Nguti, et dans une moindre mesure vers<br />
Toko. La production y est relativement élevée, malgré des rendements modestes. La cacaoculture<br />
se fait dans des systèmes agroforestiers qui ont en outre l’avantage de fournir beaucoup de<br />
produits forestiers non ligneux et un peu de vivrier.<br />
La production vivrière a pris une forte importance autour de Toko, pour alimenter le marché<br />
de Mundemba.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
18
RAPPORT D’ETUDE<br />
L’exploitation forestière concerne principalement le bassin de Mamfé ou de larges Unités<br />
Forestières d’Aménagement et quelques ventes de coupes sont attribuées. L’un des principaux<br />
opérateurs de la région est la société certifiée CAFECO, dont la scierie est implantée à Nguti et<br />
emploie 158 personnes – principalement des francophones. Comme on l’a vu, l’exploitation<br />
forestière a suscité des conflits dans la région, mais est aussi reconnue comme un facteur de<br />
désenclavement par les populations villageoises. La stratégie consistant à proposer une vente de<br />
coupe pour attirer un exploitant qui va ouvrir et entretenir des pistes correctes a été observée au<br />
moins deux fois, à Ntale et Ayong.<br />
Toute la zone d’étude est fortement dépendante de la viande de brousse pour son<br />
approvisionnement en protéines animales, et le commerce qui en résulte est florissant. Le<br />
principal marché est situé à Manyemen dans l’arrondissement de Nguti. Mundemba brasse<br />
également des quantités importantes de gibier.<br />
3. INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION<br />
La région de notre étude est parmi les plus enclavées du pays. De l’entrée principale (Kumba) vers les sites il n’y<br />
a que deux voies en piteux état. L’axe Nord passe par Konye – Nguti – Mamfe. La saison des pluies (mars –<br />
novembre) est la plus difficile pour la circulation. En dehors de quelques tronçons bitumés mais jamais entretenus,<br />
le reste de cet axe est une succession de bourbiers infranchissables même à certains véhicules équipés du système<br />
4x4. Le voyage dure de longues heures. Pour aller de Kumba à Nguti (95 km) il faut mettre entre 8 et 10 heures<br />
de route.<br />
L’axe Nord-ouest (Kumba – Mundemba et jusqu’à Toko) est similaire au premier à la seule<br />
différence que sur le premier, tous les ponts sont bien construits. La durée du voyage est<br />
pratiquement la même sur une distance de 115 km. En plus des bourbiers que l’on rencontre tous<br />
les 200 mètres, ou même moins, cette route passe par des collines, compliquant davantage le<br />
mouvement des véhicules.<br />
Les axes ainsi présentés sont les principaux, les voies d’accès à la région. Que dire de l’accès<br />
aux villages, aux zones de production de cacao, des cultures vivrières, du palmier à huile et autres<br />
produits forestiers non ligneux, aux sites touristiques ? Leur état est indescriptible. Pour aller de<br />
Nguti à Ntale (28 km) vous devez braver les bourbiers tous les 100 mètres en moyenne et<br />
affronter les terribles collines sur les deux rives de Nluha (9 km de Ntale) Le voyage peut durer<br />
jusqu'à 2 heures. Certains villages sont inaccessibles, notamment en saison sèche.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
19
RAPPORT D’ETUDE<br />
La route Fabé- Lipenja dans le département du Ndiang<br />
La route Nguti – Ntale dans le département du Koupé Manengouba<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
20
RAPPORT D’ETUDE<br />
Chapitre 2 : Paysage agricole et sécurité<br />
<strong>alimentaire</strong><br />
I. Histoire <strong>agraire</strong> de la région<br />
Le paysage agricole du Sud-ouest tel qu’on le connaît actuellement est un construit historique,<br />
élaboré au fil des apports et contraintes coloniaux puis étatiques. Cette partie vise à présenter<br />
comment des sociétés nomades pratiquant une petite agriculture de subsistance par abattis-brûlis<br />
ont évolué pour devenir aujourd’hui les principaux fournisseurs du Cameroun en cultures de<br />
rente.<br />
II. <strong>Des</strong> sociétés nomades et acéphales<br />
Le plus grand groupe ethnique du Sud-ouest est le groupe des Oroko, surtout présent dans le<br />
Ndian et la Meme. Il comprend plusieurs tribus, dont les plus importantes dans les<br />
arrondissements de Mundemba et Toko sont les Ngolo, les Batanga et les Bima. Leurs premiers<br />
contacts commerciaux avec les Européens datent du XVème siècle. Leur structuration sociale<br />
était principalement acéphale, et consistait principalement en relations de clientèle organisées<br />
autour des « big men », et en réseaux de parenté masculine et féminine. L’autorité était incarnée<br />
dans Ekpè ou Nyangpè, la « juju society » la plus puissante, qui gérait les conflits, percevait<br />
l’impôt et contrôlait les routes commerciales. Dans le Koupé-Manengoumba, d’autres groupes<br />
ethniques fonctionnaient à peu près sur le même modèle. Dans l’arrondissement de Nguti, il<br />
s’agit principalement des Bassossi et des Balong, ces derniers étant considérés comme nouveaux<br />
venus.<br />
Le mode de vie de ces populations était principalement basé sur la chasse et la cueillette, tandis<br />
qu’une agriculture sur brûlis de faible importance basée sur le macabo, le plantain et le manioc<br />
permettait de compléter le régime <strong>alimentaire</strong>. Au nombre des ressources forestières les plus<br />
importantes, il convient de citer le palmier à huile, le palmier raphia, la mangue sauvage, le safou,<br />
le njansang, la cola, la bitter cola, la monkey cola, le country onion, le njaber, etc. (Malleson, 2000,<br />
Mathey & Pascaud, 2010).<br />
III. Le développement des cultures de rente à l’époque<br />
coloniale<br />
L’influence coloniale au Cameroun est surtout marquée par la présence des Allemands et des<br />
Anglais. De 1884 au début du XXème siècle, les Allemands créent des grandes exploitations de<br />
produits agricoles d’exportation : cacao, café, banane, hévéa, palmier à huile. La plupart de ces<br />
exploitations étaient situées au flanc du Mont Cameroun, dans la région du Sud-ouest. Pour<br />
l’évacuation des produits, les colons ont entrepris la construction des routes, des ports en eau, le<br />
chemin de fer. La première diffusion du cacao semble s’être faite de manière informelle, les<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
21
RAPPORT D’ETUDE<br />
villageois forcés de travailler dans les grandes plantations du Mont Cameroun rapportant<br />
illégalement des fèves pour les semer au village (Mathey & Pascaud, 2010).<br />
À partir de 1919, le Cameroun occidental bénéficie d’une gestion plus souple sous protectorat<br />
anglais. Les populations villageoises sont libres de cultiver le cacao, tandis que la<br />
commercialisation est soumise au monopole du West African Cocoa Control Board. La gestion<br />
des grandes plantations allemandes est confiée à la Cameroon Development Corporation (CDC).<br />
Bien que le travail forcé n’y soit plus pratiqué, les conditions de vie des ouvriers y sont<br />
épouvantables.<br />
La diffusion du cacaoyer, couplée aux incitations successives à la sédentarisation et à la<br />
structuration des autorités indigènes par les anglais provoque un changement important dans<br />
l’organisation des sociétés, qui s’établissent en villages permanents. Ekpè et les autres « juju<br />
societies » perdent de leur importance(Malleson, 2000). En l’absence de titre foncier, les<br />
populations ne bénéficient que de l’usufruit des terres qui sont attribuées selon l’arbitrage du<br />
conseil traditionnel. Les règles mises en place à cette époque sont une adaptation des règles<br />
traditionnelles de transmission. Elles sont encore en vigueur aujourd’hui.<br />
IV. La formalisation de l’accès au foncier<br />
Les différentes populations de la zone différentient traditionnellement les espaces appartenant<br />
au village, et ceux qui regroupent les champs et la forêt ( le bush), avec une distinction<br />
supplémentaire pour les forêts denses et reculées (black bush) qui sont considérées comme<br />
l’antithèse du développement, et sont parfois associées au domaine des esprits et des<br />
manifestations surnaturelles(Malleson, 2000).<br />
Chaque village est entouré par sa « propre » forêt, qui vient rejoindre celle des villages voisins,<br />
ne laissant ainsi aucun espace libre. Les frontières sont marquées par des éléments variés du<br />
paysage (sentiers, rivières…), et éventuellement par des bornes de signalisation. Chaque habitant<br />
du village a le droit légitime de chasser et de collecter les PFNL dans « sa » forêt. Les<br />
ressortissants d’autres villages doivent obtenir l’aval du conseil traditionnel. Cette autorisation est<br />
également requise pour les villageois souhaitant prélever du bois d’œuvre, quelle que soit leur<br />
origine. L’autorisation est généralement accordée en échange d’un « cadeau » de nature variable<br />
(argent, bière, vin de palme, part de la récolte, etc.). <strong>Des</strong> accords permanents sont parfois<br />
négociés entre villages (Malleson, 2000).<br />
Au niveau individuel, l’obtention de droits exclusifs permanents sur un champ cultivé – et sur<br />
les arbres qui s’y trouvent – peut se faire par transaction (avec l’aval du conseil traditionnel), par<br />
héritage, ou par le défrichement d’aires vierges. <strong>Des</strong> droits exclusifs sont également attribués sur<br />
les arbres nouvellement plantés. Les hommes et les femmes peuvent indistinctement hériter des<br />
terres, mais dans les faits, il existe une division entre les cultures de rente, plutôt gérés par les<br />
hommes, et les cultures vivrières, principalement cultivées par les femmes (qui sont également<br />
responsable de la cueillette et de la transformation des PFNL). Ces modes de transmission<br />
impliquent, pour un individu donné une certaine dispersion du foncier. D’autre part, cela<br />
explique également un éloignement croissant des nouvelles surfaces mises en culture, avec les<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
22
RAPPORT D’ETUDE<br />
contraintes que cela représente en termes de transport et une vulnérabilité accrue aux dégâts<br />
engendrés par les animaux sauvages (Malleson, 2000).<br />
Les terres sont habituellement démarquées par des éléments du paysage ou par des haies vives<br />
d’aloka (cas des Bassossis, observé à Ofrikpabi). Les litiges fonciers sont néanmoins relativement<br />
fréquents. Lorsqu’ils ne peuvent pas être réglés à l’amiable, le conseil traditionnel est saisi. Si cela<br />
ne suffit pas, le juju local peut intervenir, puis il est fait recours au sous-préfet et enfin au tribunal<br />
dans les cas les plus graves.<br />
L’acquisition de terres est ouverte aux allogènes, selon diverses modalités. Il est possible<br />
d’acheter purement et simplement les droits, voire de se faire attribuer gratuitement une terre.<br />
D’autres systèmes existent, tels le « two party », une forme de métayage ou le « open and chop » qui<br />
consiste à donner à une personne la possibilité de ré-ouvrir une terre abandonnée pour le compte<br />
d’autrui tout en profitant de la vente des produits pour une durée donnée. Selon les cas, cet<br />
arrangement peut évoluer en two party.<br />
Ces systèmes dépendent toutefois d’un paramètre principal : la disponibilité du<br />
foncier.<br />
V. L’encadrement étatique de l’indépendance à la<br />
libéralisation<br />
De l’indépendance à la libéralisation c’est la phase de développement appelée « Stabilisation ». Au cours de<br />
cette période, l’état crée des Sociétés de Développement intégré ou sectoriel du type : ZAPI, SODECAO,<br />
SEMRY, SODECOTON, etc. Toutes ces sociétés ont consisté à mettre en œuvre la politique étatique de<br />
développement agricole pour les secteurs concernés.<br />
En ce qui concerne le cacao et le café, la commercialisation était en 1961 à la charge du West<br />
Cameroon Marketing Board (WCMB), qui devint après la réunification de 1972 le Produce<br />
Marketing Board de 1974 à 1978, date à laquelle il est intégré à l’Office National de<br />
Commercialisation des Produits de Base (ONCPB) sous le nom de National Produce Marketing<br />
Board (NPMB). Outre la commercialisation et la stabilisation des prix, le NPMB gère la collecte<br />
et assure les contrôles de qualité à travers un réseau de coopératives qui sera regroupé en 1979<br />
sous l’autorité de la South-West Farmers Cooperative Union (SOWEFCU) basée à Kumba. À<br />
partir des années 1970, ces coopératives obtiendront le monopole de la collecte du cacao et du<br />
café, sauf dans l’arrondissement de Konye où des acheteurs indépendants subsistent (Mathey &<br />
Pascaud, 2010).<br />
Le NPMB encourage nettement la production et la qualité du cacao et répand l’usage de fours<br />
de séchage, devenus nécessaires au regard de l’importance que prend le cacao. Les coopératives,<br />
appuyées par l’Institut de Recherche Agronomique pour le Développement (IRAD), fournissent<br />
également aux cacaoculteurs les moyens de lutter chimiquement contre les principaux ravageurs<br />
qui pullulent dans cette région humide, en particulier la pourriture brune des cabosses, les<br />
capsides et les mirides. Cette politique porte ces fruits, et le Sud-ouest rattrape son retard pour<br />
devenir le principal producteur de cacao du Cameroun (Mathey & Pascaud, 2010).<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
23
RAPPORT D’ETUDE<br />
Dans le paysage, cela se traduit par une surreprésentation des cacaoyères par rapport aux<br />
autres cultures telles le bananier, le palmier (sauf dans l’arrondissement de Mundemba) et<br />
l’ensemble des cultures vivrières.<br />
VI. L’agriculture face à la libéralisation<br />
Autours des années quatre-vingt, le Cameroun fait face à plusieurs crises financières et socioéconomiques,<br />
ce qui entraîne le démantèlement de l’organisation des filières agricoles dont celles<br />
du cacao/café en particulier. Il s’en suit la mise en place des réformes dans le cadre du plan<br />
d’ajustement structurel exigé par le FMI.<br />
En ce qui concerne la filière cacao, le coup le plus brutal a lieu au moment de la campagne<br />
1988 : la chute des cours est extraordinaire (les prix tombent de 425 à 50 FCFA). La caisse de<br />
stabilisation de l’ONCPB, qui avait jusque-là profité d’une différence positive entre les prix<br />
internationaux et les prix d’achats payés aux producteurs, se trouve dans une situation<br />
catastrophique. Les fonds amassés au fil des ans pour faire face à une situation de crise ont été<br />
dépensés, et les coopératives sont incapables de payer les producteurs (Malleson, 2000, Mathey &<br />
Pascaud, 2010).<br />
L’ONCPB est fermé en 1990 et la filière est libéralisée sous le contrôle de deux organes : le<br />
Conseil Interprofessionnel du Cacao et du Café (CICC) représente les intérêts des différents<br />
opérateurs des filières, tandis que l’Office National du Cacao et du Café (ONCC) est chargé par<br />
l’État de la mise en œuvre de sa politique, en particulier en ce qui concerne le respect des<br />
standards pour la connercialisation. La collecte et l’exportation sont désormais assurées dans le<br />
Sud-ouest par des Licensed Buying Agents, en concurrence. La pratique du coxage (achat illégal<br />
par des opérateurs clandestins) se répand. Le cacao revient au plus rapide, capable d’aller le<br />
chercher dans les zones de production et de payer comptant, même à un prix inférieur. Les<br />
phytosanitaires deviennent rares, et font l’objet d’un trafic parallèle auquel se livrent tant les LBA<br />
que les agents de l’État chargés de l’encadrement de la production (Mvondo Awono & al., 2009,<br />
Coulter & Etoa Abena, 2010).<br />
Au village, la crise cacaoyère touche durement les producteurs. Le cacao est délaissé, et les<br />
agriculteurs se tournent vers les cultures vivrières pour leur revenu monétaire. Les PFNL jouent<br />
également dans une certaine mesure le rôle de filet de sécurité. La crise, et la dévaluation du Franc<br />
CFA et la mise en retraite de nombreux fonctionnaires du fait de l’ajustement structurel<br />
provoquent un exode urbain qui booste la demande dans les villages. Dans la zone d’étude, ce<br />
phénomène a particulièrement été observé dans l’arrondissement de Toko, qui alimente<br />
notamment Mundemba (Bikié & al., 2000, Malleson, 2000, Tieguhong & Ndoye, 2006, Mathey &<br />
Pascaud, 2010).<br />
La dernière décennie a été marquée par une reprise à la hausse des cours du cacao, qui rend de<br />
nouveau cette spéculation rentable. En conséquence, de nombreux agriculteurs ont fait le choix<br />
de régénérer leurs cacaoyères. Ce phénomène est particulièrement visible dans l’arrondissement<br />
de Nguti, où certains villages se déclarent aujourd’hui « 100% cocoa farmers ». Les faiblesses de<br />
la filière continuent cependant d’handicaper fortement le développement de la production et le<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
24
RAPPORT D’ETUDE<br />
maintien d’une qualité mise en danger par la vétusté des équipements et l’absence d’incitation<br />
financière de la part des LBAs.<br />
L’arrondissement de Toko est remarquable par le fait que la stratégie de développement du<br />
« vivrier de rente » s’y est très fortement maintenue. Comme on le verra, ceci s’explique par le fait<br />
que le cacao est très difficile à développer dans cette zone, notamment du fait des difficultés de<br />
transport et de l’éloignement par rapport à Kumba dus au mauvais état de la route. C’est<br />
justement cet isolement et le fait que les terres de l’arrondissement de Mundemba sont peu<br />
fertiles et peu disponibles (à cause du palmier, et des aires protégées) qui booste la demande en<br />
vivrier produit localement.<br />
A Lipenja I (arrondissement de Toko), les produits forestiers non ligneux font partie des aliments de<br />
base et constituent une source de revenus monétaire : ce sac de boushe mango coûte 40.000 Frs cfa<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
25
RAPPORT D’ETUDE<br />
Chapitre 3 : Paysage agricole<br />
I. Arrondissement de Nguti<br />
Les zones cultivées se concentrent autour des routes et pistes qui traversent la région, et à<br />
proximité des villages. L’axe principal Kumba – Nguti – Mamfé est ainsi quasi intégralement<br />
bordé soit de champs vivriers mixtes associant le manioc, le plantain, la banane, le macabo,<br />
l’igname et le taro ainsi que divers légumes, soit de palmeraies ou d’agro forêts cacaoyères à<br />
différents stades de maturité.<br />
Les alentours immédiats des villages, ainsi que les espaces jouxtant les maisons, sont<br />
généralement occupés par des jardins de case dans lesquels on trouve communément quelques<br />
plantains et bananiers, quelques arbres fruitiers (principalement des orangers, avocatiers, papayers<br />
et manguiers), quelques palmiers à huile. Il est également possible d’y rencontrer des plants de<br />
maïs, d’ananas, des arachides, etc.<br />
Un jardin de case à NGUTI<br />
Ce même schéma se rencontre également dans les villages plus reculés, sur les pistes<br />
secondaires, avec une prédominance assez marquée des cacaoyères et une importance<br />
relativement moindre des cultures vivrières (cas de Ntale et d’Ayong, notamment).<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
26
RAPPORT D’ETUDE<br />
II. Dans le Ndian<br />
Les plupart des parcelles cultivées se rencontrent le long des grands axes routiers, et à<br />
proximité des villages. Pour y accéder, certains planteurs font recours aux motos ou aux véhicules<br />
taxi pour parcourir des dizaines de kilomètres Les cultures les plus rencontrées dans les sites cidessus<br />
sont : les champs vivriers mixtes associant le manioc, le plantain, la banane, le macabo, et<br />
le taro ainsi que divers légumes on y rencontre également des palmeraies ou d’agro forêts<br />
cacaoyères. À différents stades de maturité.<br />
Les alentours immédiats des villages ainsi que les espaces jouxtant les maisons sont<br />
généralement occupées par des jardins de case dans lesquels on trouve communément quelques<br />
plantains et bananiers, quelques arbres fruitiers (principalement des orangers, papayers et<br />
manguiers), ainsi que des tiges isolées de palmiers à huile. Il est également possible d’y rencontrer<br />
des plants de maïs, d’ananas, des arachides, etc.<br />
À l’intérieur de la forêt, plus ou moins éloigné des axes routiers, se rencontrent plusieurs<br />
cacaoyères et des palmeraies passablement bien entretenues.<br />
III. Typologie des espaces cultivés<br />
De façon globale le site de notre étude est un théâtre où se déroulent de nombreux enjeux<br />
autour des terres. Zones protégées, concessions agroindustrielles, exploitations familiales.<br />
IV. Agro forêts cacaoyères<br />
La culture du cacao est la spéculation la plus exploitée et la plus adoptée par les producteurs<br />
indépendants de l’arrondissement de Nguti, pour des raisons économiques, tandis qu’elle vient en<br />
second après le vivrier dans le reste du Koupe-Manengoumba. Dans l’arrondissement de<br />
Mundemba, elle est clairement secondaire par rapport au palmier à huile, tandis qu’autour de<br />
Toko, elle se maintient à un niveau relativement faible par rapport au vivrier.<br />
Le cacao est généralement cultivé par les hommes et est ainsi considérée comme « culture<br />
masculine ». En de rares cas, certaines femmes (veuves, héritières, ou initiatrice d’origine) sont<br />
propriétaires de quelques plantations. Dans toutes ces plantations on assiste à une forte<br />
expansion, généralisée sur l’association cultures vivrières, fruitières et PFNL (femmes).<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
27
RAPPORT D’ETUDE<br />
1. Matériel végétal et pépinières<br />
Dans les deux départements, certains<br />
cacaoculteurs utilisent comme<br />
matériel végétal de base pour la<br />
création de leur nouvelle plantation,<br />
des cabosses « soigneusement<br />
sélectionnées » de visu, dans les<br />
parcelles existantes, sur la base de leur<br />
productivité, leur aspect extérieur,<br />
leur grosseur, leur état sanitaire. Pour<br />
ces planteurs, ils aimeraient utiliser<br />
les cabosses de cacao sélectionnées<br />
issues des champs semenciers du<br />
Projet Semencier Cacao Café (PSCC)<br />
du MINADER. La difficulté à<br />
accéder à ces variétés améliorées<br />
les pousse à adopter les pratiques<br />
de sélections sus évoquées.<br />
Chaque planteur met en place une<br />
pépinière qui est installée selon<br />
chacun à un endroit qui lui<br />
permettra de mieux l’entretenir<br />
(arrosage, désherbage, traitements<br />
phyto…) : derrières les habitations,<br />
près du site de la future<br />
plantation….Il est conseillé de<br />
choisir un site pouvant remplir les<br />
conditions suivantes : près du<br />
point d’approvisionnement en eau<br />
d’arrosage, sécurisant, à une<br />
distance permettant un transport<br />
facile des plants pour plantation. Les planteurs éprouvent également des difficultés à<br />
s’approvisionner en sachets polyéthylène standards, qu’ils remplacent par toute sorte d’expédients<br />
: emballages de cigarettes, sachets plastique de dimensions différentes (sachets de biscuits, de<br />
bonbon…), demi-bouteilles plastiques d’eau minérale, etc.<br />
2. Prospection et choix du terrain<br />
Le terrain choisi pour la mise en place d’une cacaoyère varie selon plusieurs paramètres, à<br />
commencer par la qualité du sol qui est généralement choisi sur les terres rouge sombre riches en<br />
argile. La présence de petites pierres est également considérée comme un indicateur positif. Les<br />
sols gravillonnaires rouges pauvres en matière organique sont évités ainsi que les sols sablonneux<br />
qui sont plus fréquemment utilisés pour le palmier à huile (Malleson, 2000).<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
28
RAPPORT D’ETUDE<br />
Les efforts et les coûts escomptés varient en fonction de la distance par rapport au village. Par<br />
ailleurs, l’éloignement augmente les risques de dommages provoqués par les animaux sauvages<br />
(rongeurs, singes, sangliers, éléphants, etc.).<br />
En dépit de cette rationalité, les personnes interviewées indiquent un éloignement croissant<br />
des cacaoyères, qui s’explique par la pression foncière que suscite le regain d’intérêt des<br />
producteurs pour cette filière suite à la reprise de cours, en augmentation constante depuis 1994.<br />
Par ailleurs, la complexité des tenures foncières traditionnelles peut pousser les producteurs à<br />
sécuriser son investissement en recherchant un champ « vierge ». Enfin les anciennes cacaoyères<br />
proches des villages peuvent être délaissées du fait de la charge importante en pourriture brune<br />
(Phytophthora megacarya) et des attaques des capsides ou mirrides (Sahlbegella singularis et Distantiella<br />
theobromea) que l’on y trouve.<br />
Ces plantations abandonnées peuvent être attribués aux allogènes en provenance d’autres<br />
départements ou du Nord-Ouest : le propriétaire la cède à un travailleur afin de la remettre en<br />
bonne condition de production. En contrepartie, le travailleur l’exploite à son profit pendant une<br />
durée arrêtée de commun accord avec le propriétaire du champ. Ce type d’arrangement est appelé<br />
dans la zone « open and chop » en traduction « réhabilite et mange ». Au terme d’un tel arrangement,<br />
le processus peut évoluer vers une forme de métayage (two party).<br />
3. Défrichement<br />
Cette opération constitue l’un des volets les plus importants et les plus pénibles dans les<br />
travaux de création et évolution des champs à partir de la forêt. C’est au cours de cette phase que<br />
les coûts des travaux sont généralement les plus élevés, ce qui explique le recours fréquent aux<br />
groupes de travail et à la main d’œuvre salariée.<br />
Les travaux sont généralement menés pendant la saison sèche, en décembre et en janvier. La<br />
première étape consiste à éclaircir le sous-bois à la machette afin de ne laisser que les grands<br />
arbres en place. Les débris ne sont généralement pas brûlés mais pourrissent sur place. La<br />
seconde étape, qui intervient immédiatement après est l’abattage des arbres indésirables, c.-à-d.<br />
qui produisent une ombre trop intense, ou qui peuvent héberger des ravageurs. Au cours du<br />
défrichement, les producteurs sont assez vigilants pour éviter d’abattre les arbres considérés<br />
comme utiles, notamment ceux qui fournissent des produits forestiers non ligneux (njansang, bush<br />
mango, bitter cola, monkey cola, bush pepper…), du bois d’œuvre et du bois de service. La location d’un<br />
tronçonneur et d’une tronçonneuse sont nécessaires pour cette opération et représente une<br />
charge importante.<br />
4. Plantation et conduite de la jeune cacaoyère<br />
La plantation à proprement parler intervient entre février et mai : les jeunes plants de<br />
cacaoyers sont transportés depuis la pépinière et plantés à intervalles plus ou moins réguliers, tous<br />
les 3 à 4 mètres. Les espaces interstitiels sont occupés par des plants de plantains et bananier, taro<br />
et macabo, manioc et plus rarement maïs lorsque l’ombrage est particulièrement faible. Ces<br />
cultures associées permettent d’une part de rentabiliser la phase improductive de la cacaoyère en<br />
fournissant des apports vivriers qui seront ensuite consommés par la famille ou commercialisés,<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
29
RAPPORT D’ETUDE<br />
et d’autre part de fournir une ombre suffisante aux jeunes cacaoyers pendant qu’ils sont encore<br />
vulnérables.<br />
Les travaux de désherbage et de nettoyage se poursuivent de manière assez intensive au cours<br />
de trois premières années de la cacaoyère. Plusieurs abattages successifs peuvent se succéder, au<br />
fur et à mesure que les plants de cacao sont suffisamment vigoureux pour supporter un<br />
ensoleillement plus important (ce qui a également pour effet d’augmenter l’activité<br />
photosynthétique et donc la productivité). Ces réglages interviennent en particulier au début de la<br />
saison des pluies (pour compenser la baisse de luminosité et éviter le maintien d’une humidité<br />
excessive propice au développement de maladies dans le sous-étage). Lorsqu’il n’est pas possible<br />
de faire appel à un tronçonneur, les arbres peuvent être tués par cerclage ou en brûlant leur<br />
base(Malleson, 2000). Le même processus se poursuit au cours des campagnes suivantes. Avec le<br />
temps, la superficie de la cacaoyère s’agrandit au détriment du vivrier. Il est possible de trouver<br />
dans la zone, des cacaoyères associées exclusivement au palmier et au plantain, avec du vivrier les<br />
première années, (parcelle de démonstration d’un GIC à Manyemen). Une telle parcelle se<br />
caractérise par un excès d’ombrage pour le cacao, avec risque d’attaque importante de la<br />
pourriture brune sur cacaoyer.<br />
Les producteurs transportent leurs<br />
plans de cacaoyers aux champs les<br />
racines nues, ce qui est préjudiciable à<br />
leur croissance.<br />
5. Conduite de la cacaoyère adulte<br />
Après 4 à 5 ans, la cacaoyère est considérée comme adulte, avec des rendements pouvant<br />
théoriquement varier entre 500 Kg et 1000 Kg/Ha. Les travaux à mener sur une cacaoyère adulte<br />
sont de trois types : entretien, traitement phytosanitaires et récolte-écabossage, auxquels il<br />
convient d’ajouter la gestion de l’ombrage et des produits forestiers non ligneux. Aucun usage<br />
d’engrais n’a été mentionné par les personnes rencontrées.<br />
L’entretien consiste principalement en des opérations de désherbage et de débroussaillage à la<br />
machette pour maintenir une bonne aération du sous-étage. Les cacaoyers eux-mêmes peuvent<br />
être taillés pour supprimer les gourmands, généralement en saison sèche (Mathey & Pascaud,<br />
2010). Idéalement les cacaoyers devraient également être « toilettés » en supprimant de manière<br />
systématique toutes les cabosses attaquées par la pourriture ainsi que les rameaux porteurs de<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
30
RAPPORT D’ETUDE<br />
capsides avant de les détruire hors du champ(Njonga, 2010). Ces pratiques n’ont cependant<br />
jamais été observées sur le terrain.<br />
Les traitements phytosanitaires s’échelonnent normalement en quatre passages d’avril à<br />
décembre et permettent normalement de lutter contre les insectes et les maladies fongiques par<br />
l’emploi alternatif de fongicides de contact à haute teneur en cuivre métal et de fongicides<br />
systémiques pour la pourriture brune, et d’insecticides (Njonga, 2010). Concrètement, seuls les<br />
insecticides sont appliqués entre janvier et mars à l’aide d’un pulvérisateur à dos, avec une grande<br />
précision pour ne pas atteindre les fleurs (ce qui nuirait à la pollinisation). Les traitements<br />
antifongiques sur les cabosses commencent en saison humide au mois d’avril (Mathey & Pascaud,<br />
2010). Sur le terrain, le respect de ces itinéraires est très variable et dépend principalement des<br />
capacités financières des agriculteurs. De manière générale, les agriculteurs se plaignent de la<br />
cherté des intrants, qui leurs sont généralement fournis à crédit par les acheteurs de cacao qui se<br />
remboursent avec un intérêt souvent exorbitant (100% est le chiffre le plus souvent cité) au<br />
moment de l’achat de la production. Chaque agriculteur effectue les traitements seul.<br />
La récolte se fait par section du pédoncule des cabosses à l’aide de machettes, parfois munies<br />
de manches allongés. Les travaux se font en groupe et s’échelonnent de juin à décembre, chaque<br />
parcelle est visitée quatre fois en moyenne (Mathey & Pascaud, 2010). Les cabosses sont<br />
transportées dans des hottes en rotin jusqu’à l’aire d’écabossage (généralement une clairière dans<br />
la plantation) et empilées en tas. L’écabossage se fait en deux temps : les cabosses sont fendues à<br />
la machette, généralement par les hommes, puis les fèves en sont détachées par les femmes et les<br />
enfants et disposées sur des feuilles de bananier, avant d’être rapportées le soir sur le lieu de<br />
fermentation et de séchage dans les mêmes hottes en osier (encore un travail de femme). Le fait<br />
de fendre les cabosses à la machette peut endommager les fèves et fait courir un risque à la<br />
qualité du cacao (Njonga, com. pers.). Un homme peut écabosser en moyenne 1500<br />
cabosses /jour (Njonga,2001). Les techniques de fermentation adoptées sont de plusieurs<br />
ordres : en tas, en sacs, dans des caisses de dimensions très variables, sous bâches. La durée de<br />
fermentation varie de 3 à 6 jours en fonction du volume de la production en champ, de la<br />
disponibilité des séchoirs, de la fréquence de passage de l’acheteur du cacao marchand.<br />
La gestion de l’ombrage est une préoccupation permanente des cacaoculteurs dans la mesure<br />
où elle a une influence directe sur la production de cacao. En premier lieu, elle conditionne le<br />
risque de pertes dus aux ravageurs dans un contexte où l’accès aux moyens de lutte chimique est<br />
limité et coûteux. Une ombre excessive augmente le taux d’humidité dans le sous-étage et favorise<br />
la prolifération de la pourriture brune (black pod disease). À l’inverse un ombrage insuffisant<br />
favorise la multiplication des mirides (Disantiella theobromae) et capsides (Sahlbegella singularis). En<br />
second lieu, elle joue un rôle dans l’équilibre entre les recettes générées par la production de<br />
cacao (qui tend à augmenter avec une réduction de l’ombrage au stade adulte) et celles qui<br />
proviennent de la cueillette des produits forestiers non ligneux (Tscharntke & al., 2011). Enfin, le<br />
degré de fermeture de la canopée conditionne la prolifération des adventices et de plantes «<br />
nuisibles » : une lumière excessive favorise le développement des herbacées et entraîne des<br />
travaux de désherbage supplémentaires, tandis qu’une ombre trop intense favorise les fougères<br />
(sur sols acides) et la prolifération de mousses gênant le développement des inflorescences sur le<br />
tronc des cacaoyers.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
31
RAPPORT D’ETUDE<br />
Sur le terrain, la stratégie la plus répandue semble être de minimiser les risques phytosanitaires,<br />
sans chercher à maximiser le rendement à l’hectare. Ainsi, les arbres identifiés comme<br />
« dangereux » pour le cacao sont enlevés, mais systématiquement remplacés par un nouveau<br />
plant, généralement un arbre forestier à haute valeur (bush mango, njansang, safou ou bois d’œuvre)<br />
ou par un fruitier (manguier, oranger ou avocatier). Plusieurs agriculteurs ont ainsi déclaré<br />
entretenir de petites pépinières d’arbres forestiers chez eux pour cet usage.<br />
Un autre rôle des arbres forestiers est d’assurer la fourniture et le recyclage des éléments<br />
nutritifs dans la cacaoyère à travers les processus de captation racinaire et de décomposition des<br />
feuilles tombées (Clough & al., 2009, Tscharntke & al., 2011). Les agriculteurs interrogés n’ont<br />
jamais expliqué le maintien de la fertilité de leurs sols en l’absence d’engrais de cette manière mais<br />
manifestent systématiquement le souci de « nourrir » la terre en y laissant pourrir tous les déchets<br />
organiques issus de leur exploitation…auxquels se mêlent souvent les sachets de produits<br />
phytosanitaires et de whisky !<br />
1<br />
Les produits forestiers non ligneux sont<br />
traditionnellement une « affaire de femmes » dans la<br />
mesure où ce sont principalement elles qui prennent<br />
en charge leur cueillette, leur transformation et leur<br />
commercialisation (Malleson, 2000). Dans les<br />
cacaoyères cependant, l’homme et la femme<br />
participent également ramassage des produits. Dans<br />
les parcelles à forte densité de ces PFNL,<br />
l’exploitation devient une source importante de<br />
revenu familial, surtout pour les produits tels que :<br />
njangsang, cola sauvages diverses, bush mango…<br />
2 3<br />
Trois stades d’évolution d’une cacaoyère :<br />
1- Défrichement et abattage<br />
2- Deux mois après, cacao associé aux cultures vivrières<br />
3- Huit mois après<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
32
RAPPORT D’ETUDE<br />
V. Calendrier agricole<br />
Mois<br />
Novembre à Février<br />
Février à Mars<br />
Avril à mi Juin<br />
Avril et Octobre<br />
Mai à Octobre<br />
Mars à Juin<br />
Décembre à Octobre<br />
Août à mi Décembre<br />
Décembre à Février<br />
Activités agricoles<br />
Préparation de terrain (défrichage sous-bois, andain âge, défrichage) fin<br />
production des plants en pépinière<br />
Piquetage et trouai son<br />
Plantation (mise en champ)<br />
Fertilisation si vraiment nécessaire (mais généralement pas conseillé)<br />
Entretien de la plantation (défrichages, tailles diverses….)<br />
Période de floraison (attention à toute mauvaise action pouvant détruire les<br />
fleurs)<br />
Traitement phytosanitaire (lutte anti capside et contre pourriture brune)<br />
Récolte<br />
Conditionnement<br />
Chapitre IV : Palmeraie à huile en culture<br />
pure<br />
I. Matériel végétal et pépinières<br />
Il est conseillé aux producteurs d’utiliser des graines pré germées (variété Tenera) issues des<br />
stations de production spécialisées (IRAD de la Dibamba), Laboratoires de la PAMOL, ou des<br />
multiplicateurs agrées).C’est à partir de ce matériel sélectionné qu’ils doivent mettre en route le<br />
processus de production des plants en pépinières selon les étapes suivantes :<br />
- Création d’une pré-pépinière qui permet à la plante d’atteindre un niveau végétatif assez<br />
solide afin d’affronter l’agressivité des conditions environnementales notamment les<br />
fortes températures.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
33
RAPPORT D’ETUDE<br />
- Mise en place de la pépinière proprement dite, 4 mois après le séjour des plants en pré<br />
pépinière. Après huit mois environs de séjour en pépinière, le plant est prêt à mettre en<br />
champ.<br />
Mode de transport des plants en champs (racines nues)<br />
Ces conditions sont toutefois rarement<br />
observées chez les planteurs indépendants : leurs<br />
semences proviennent rarement de la PAMOL<br />
(sauf dans l’arrondissement de Mundemba) mais<br />
sont plutôt, ramassées sous les palmeraies<br />
villageoises existantes (Sources : Paysans, 2012). Il<br />
est rare de trouver ici des pépinières en place. La<br />
phase de pré pépinière n’est pas connue.<br />
Cependant, à une très faible proportion, on a pu<br />
visiter quelques pépinières d’élites locales ou<br />
d’anciens employés des agro industries (CDC,<br />
PAMOL) dont les conseils techniques appropriés<br />
sont pris en compte. (Sources : Paysans 2012).<br />
II. Prospection et choix du<br />
terrain<br />
Jeunes plants protégés contre les rongeurs<br />
Dans l’idée de mettre en place une palmeraie, le<br />
paysan a déjà en tête une série de sites parmi<br />
lesquelles la parcelle en projet sera développée.<br />
Ceci dépend généralement des critères suivants :<br />
disponibilité en terre, coût de la main d’œuvre<br />
(travaux d’ouverture de plantation), alors on<br />
préfère les anciennes jachères. Les paysans évitent<br />
les terrains inondés ou trop accidentés. Le palmier<br />
tolère bien les sols sableux et acides, considérés<br />
comme limitant pour les autres cultures, s’il<br />
bénéficie de traitements de fertilisation appropriés.<br />
III. Préparation du terrain<br />
La parcelle est totalement défrichée, et tous les arbres sont abattus. Elle est ensuite nettoyée,<br />
les plus gros débris sont disposés en andains, et les déchets sont brûlés. Les palmiers sont<br />
disposés en quinconce avec des écartements de 9m pour d’obtenir une densité de plantation de<br />
143 plants/ha. Ces recommandations sont inégalement respectées. Par exemple, dans<br />
l’arrondissement de Mundemba (Village Fabe), après défrichement du sous-bois, un planteur n’a<br />
pas procédé à l’abattage des grands arbres ni au nettoyage de la parcelle, mais a laissé le terrain<br />
comme en prévision à la plantation cacaoyère (présence d’ombrage à près de 70 %). De manière<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
34
RAPPORT D’ETUDE<br />
générale toutefois, l’arrondissement de Mundemba présente des palmeraies mieux gérées, sans<br />
doute du fait de l’exemple de la PAMOL.<br />
Plantation et conduite de la jeune palmeraie<br />
La jeune palmeraie est souvent associée à des<br />
cultures vivrières comme : plantain, patate douce,<br />
macabo, taro, végétaux et légumes divers. Une<br />
fois toutes ces cultures dégagées (après récolte), le<br />
palmier reste seul maître de la parcelle. Pour<br />
protéger les jeunes plants (nouvellement mis en<br />
terre) contre les rongeurs en forêt, en lieu et place<br />
du grillage généralement utilisé dans les<br />
plantations industrielles, certains planteurs<br />
utilisent, dans l’arrondissement de Nguti des<br />
objets tels : seaux en plastiques découpés, boîtes<br />
de conserve cylindriques, feuilles de tôles… voire<br />
des morceaux de troncs d’arbres (village Fabe à<br />
Mundemba). Beaucoup de ces manquements techniques observés chez les paysans des deux<br />
départements s’expliquent par un manque d’encadrement technique de la part des personnels du<br />
MINADER.<br />
IV. Conduite de la palmeraie adulte<br />
Dans les normes, une plantation de palmier à huile est considérée comme adulte dès la 5 ème<br />
année de la mise en champ des plants. C’est à cette phase que débute la vraie production avec<br />
l’apparition des tonnages de régimes allant à plus de 3 tonnes/ha. La conduite de la plantation<br />
consiste alors : au désherbage régulier avec rabattage des mauvaises herbes, coupe des feuilles<br />
sèches et dès la 6 ème année ne laisser que deux feuilles sous un régime et toutes les autres audessus.<br />
Le reste de feuilles en dessous sont supprimées, veiller à toute anomalie sur les feuilles<br />
afin d’y procéder aux traitements divers, si possible, procéder à la fertilisation (Source : Bernard<br />
NJONGA, 2010). En pratique les paysans des deux départements ne suivent pas à la lettre toutes<br />
les opérations ci-dessus mentionnées, sauf pour des rares cas chez certains élites surtout dans le<br />
département du Ndian (Source : Paysans 2012).<br />
À cette phase de la plantation, le palmier souffre d’un certain nombre de maladies fongiques<br />
fréquentes sur les feuilles (Fusarium oxysporum elaeidis, anneau rouge, causant pourrissement<br />
des régimes (dû à une Nématode), la pourriture sèche du cœur ; ou des ennemis tels : les<br />
chenilles défoliatrices, Gros vers blancs des galeries des feuilles. (Source : Bernard NJONGA,<br />
2010). Les méthodes de luttes existent pour tous ces fléaux mais sont presque jamais pratiquées<br />
par les quelques producteurs des deux départements. (Source : Paysans 2012).<br />
La production en palmeraie s’étale de la 3 ème à 30 ème année. Le régime mûrit du bas vers le<br />
haut et de l’intérieur vers l’extérieur. Le régime est complètement mûr lorsque 3 à5 noix se sont<br />
détachées et sont tombées au sol. (Source : Bernard NJONGA, 2010). Au niveau paysan c’est<br />
lorsque la quasi-totalité du régime est tout rouge et qu’une grande quantité des fruits soit tombée<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
35
RAPPORT D’ETUDE<br />
au pied de la tige. (Source : Paysans 2012). Pour la récolte, on prévoit plusieurs tours de cueillettes<br />
par mois en cas de grosse production.<br />
V. Calendrier agricole<br />
VI.<br />
Mois<br />
Janvier à Décembre (Année 0)<br />
Novembre à Février<br />
Février à Mars<br />
Avril à Juin (Année 1)<br />
Mai à Octobre<br />
Dès Année 3<br />
Dès Année 5<br />
Activités agricoles<br />
Production des plants en pépinières.<br />
Préparation de terrain (défrichage du sous-bois, abattage, andain âge)<br />
Trouai son<br />
Plantation<br />
Entretien de la plantation (défrichages, tailles diverses…)<br />
Premières récoltes /Transformation<br />
Début premières grosses récoltes /Transformation.<br />
VII. Les concessions agro industrielles<br />
La région abrite la palmeraie de la société PAMOL. Celle-ci couvre environ 4000 hectares dans<br />
le Ndian et est pointée du doigt par les populations de la ville de Mundemba comme principal<br />
responsable de la rareté des terres agricoles (cultures vivrières) autour du périmètre urbain et<br />
cause principale de la rareté et de la cherté des denrées <strong>alimentaire</strong>s.<br />
VIII. Champs vivriers sur jachère<br />
Ces champs sont établis sur des parcelles acquises de la même manière que décrit<br />
précédemment, mais sont généralement localisés au plus près de villages Le principe de l ;a<br />
jachère est simple : il consiste à mettre en culture un espace après abattis-brûlis puis à le laisser à<br />
l’abandon lorsque la fertilité décroît afin de laisser le couvert spontané se reconstituer. En général,<br />
plus les terres sont disponibles plus longue est la durée des jachères.<br />
1. CHAMP DE MANIOC EN CULTURE PURE<br />
Le manioc s’adapte sur une très grande variété de terres même à faible fertilité. Ceci a été constaté<br />
dans le Ndian et le Koupé- Manengoumba. Les parcelles sont complètement défrichées lors du<br />
début des premières pluies. Le manioc est planté sous forme de boutures prélevées sur des tiges<br />
vigoureuses, sur de petites buttes.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
36
RAPPORT D’ETUDE<br />
Pour l’entretien, les opérations suivantes sont généralement effectuées : remplacements des plants<br />
manquants au fur et à mesure, lutter contre les mauvaises herbes enlever les pousses faibles et<br />
conserver les plus vigoureuses, butter sur une hauteur de 10 cm, 5 à 6 semaines après plantation.<br />
La récolte débute 12 mois après plantation. Les paysans semblent respecter cet itinéraire en<br />
dehors de l’usage des fertilisants et des pesticides, car, dans les deux départements, le manioc<br />
demeure l’une de leur principale source de revenus et d’alimentation. La pratique de la<br />
monoculture du manioc est toutefois rare dans la région. Les rendements standards en champ<br />
varient entre 20 et 30T/ha. (Sources : Bernard NJONGA, 2001 ; Paysans, 2012.)<br />
IX. Champs vivriers en associations<br />
La préparation du terrain se fait comme pour les cultures précédentes. Toute une gamme de<br />
cultures est progressivement introduite dans la parcelle, dont les plus fréquentes sont : maïs,<br />
macabo, taro, gombo, igname, plantain, manioc, végétaux et légumes divers. La parcelle sera ainsi<br />
conduite jusqu’en période de mise en jachère. En général, les assolements possibles en zone de<br />
forêt sont : arachide-maïs-courge-manioc-jachère ; Maïs-arachide-plantain, banane, macabo,<br />
ananas, légumes, diverses-manioc-jachère. Récolte des légumes 3 à4 semaines après plantation, ou<br />
60 à 80 jours pour d’autres variétés. Ananas = 18 à 24 mois. Durée d’occupation des terres par les<br />
légumes = 3 mois à 3,5 mois. Les vivriers occupent une place très importante dans les activités<br />
des producteurs des arrondissements de Tombel et Bangem, ainsi que dans le département du<br />
Ndian<br />
Généralement dans les départements du Koupé-Manengoumba et du Ndian, la production des<br />
cultures vivrières se fait en deux campagnes pour certaines cultures. Pour celles non mentionnées<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
37
RAPPORT D’ETUDE<br />
ici, elles respectent le cycle traditionnel comme pour la plupart des vivriers (plantes à tubercules,<br />
plantains…). Le calendrier agricole respecte cette réalité.<br />
2. BANANIER PLANTAINS<br />
Ici la même parcelle peut être exploitée pour une durée variant entre 10 et 17 ans, durée du<br />
temps de jachère entre 0 et 2 ans, nombre moyen d’autres plants associés dans la parcelle : 4 à 6<br />
parmi lesquelles : maïs, manioc, macabo/taro, ignames, arachide, egusi, cacao et café<br />
La préparation du terrain consiste à procéder aux opérations suivantes : défrichement,<br />
abattage progressif des arbres jusqu’à leur élimination totale sur la parcelle, tronçonnage (pour les<br />
grandes plantations d’élites…), mise en andains des débris, piquetage et trouaison. En culture<br />
pure les écartements sont généralement de 3m x 2 m pour une densité de 1550 plants/ha. En<br />
cultures associées on applique un écartement moyen de 4 m x 4 m pour une densité de 525<br />
plants/ha. La taille des trous de plantation varient entre 40 cm x 40 cm x 40 cm et 50 cm x 50<br />
cm x 50 cm selon la grosseur de la base du rejet à planter.<br />
Le matériel végétal généralement utilisé est le rejet baïonnette et les variétés de plantain<br />
cultivées sont les suivantes : FRENCH, FAUX CORNES, VRAIES CORNES. La préparation<br />
du matériel à planter consiste à rejeter les bulbes de mauvaise qualité (attaque des charançons,<br />
nématodes…), couper toutes les racines au ras du bulbe. Le pralinage des bulbes n’est<br />
généralement pas appliqué ici.<br />
En début de la saison des pluies commence les semis. En dehors du tassement du sol autour<br />
du rejet après sa mise en terre, aucune autre pratique particulière n’est appliquée à ce stade des<br />
travaux. Les entretiens et soins divers ici consistent essentiellement à mener les opérations<br />
suivantes : lutte contre les mauvaises herbes, œilletonnage (enlever tous les rejets en excès<br />
considérés comme parasites), toilettage ou enlèvement des vieilles feuilles sèches, pratiquer le<br />
tuteurage dès la formation du régime. À la différence des plantations agro-industrielles, aucun<br />
traitement pesticide ou fertilisant particulier n’est appliqué par les paysans.<br />
Les premières récoltes débutent 10 à 12 mois après plantation. 3 à 4 mois après apparition de<br />
la fleur, la récolte des régimes est effective. La récolte se fait en continu pendant 4 à 5 cycles ; la<br />
plantation doit donc être renouvelée tous les 4 ou 5 ans. Les rendements moyens en milieu<br />
paysan sont de 8 à 15 T/ha.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
38
RAPPORT D’ETUDE<br />
X. Calendrier agricole<br />
Mois<br />
Janvier à Février<br />
Fin Février à Mars<br />
Fin avril à Juin et de<br />
Fin Août à Octobre<br />
Mi Octobre à Mi Mars<br />
Activités agricoles<br />
Préparation de terrain (défrichage, labour, formation de billons ou de<br />
buttes)<br />
Semis<br />
Entretien de la plantation (sarclage, buttage des plants)<br />
Récolte<br />
XI. Champs de bas-fond<br />
Dans le Koupe-Manengoumba et le Ndian, les champs de bas-fonds sont assez rares surtout<br />
en milieu rural. Cette pratique culturale est plus fréquente dans les zones urbaines (Bangem,<br />
Tombel, Nguti…) et le long des grands axes routiers et agglomérations où les conditions de<br />
terrain s’y prêtent. Les cultures les plus rencontrées sont : les légumes et végétaux divers, le<br />
macabo, le taro, et le maïs. L’itinéraire technique de production est quasiment la même partout.<br />
Sur l’axe Nguti – Ntale : deux parcelles ont été visitées : une parcelle de manioc, et une de<br />
cultures vivrières diverses. L’itinéraire technique est le même, suivant les témoignages des<br />
producteurs concernés.<br />
Les sont choisies en bordure de cours d’eau, faible pente, sol argilo-sableux, sans arbres<br />
d’ombrage, couvert d’une végétation d’herbes et d’arbustes de très courte taille. Elles sont<br />
défrichées à la machette, puis manuellement pour nettoyer la parcelle, pas de brûlis (ou à des très<br />
rares cas). <strong>Des</strong>souchage des arbustes si nécessaire. Mise en place des billons, des mottes ou des<br />
buttes dans lesquels sont enfouies (si possible) les herbes mortes et décomposées.<br />
Immédiatement on procède au semis des cultures souhaitées, telles : maïs, manioc, légumes<br />
diverses, macabo, taro…Les principaux entretiens consistent à l’enlèvement manuel des<br />
adventices une à deux fois en moyenne par campagne.<br />
Suivant le cycle de production de chaque culture, la récolte est organisée : 3 à 4 semaines après<br />
semis pour les légumes, 10 à 12 mois pour les feuilles de manioc et 18 à 24 mois pour les<br />
tubercules… Et parfois, au fur et à mesure que l’on libère l’espace lors des récoltes, on peut y<br />
introduire une autre culture ou la même dans le même site, question d’empêcher le<br />
développement des adventices.<br />
La pratique de la jachère est rare pour ce type de production, car l’approvisionnement en eau<br />
est quasi permanent et, pour le planteur, les sols en général sont de bonne qualité. Quand il faut<br />
la pratiquer, elle est de très courte durée : 1 à 2 mois.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
39
RAPPORT D’ETUDE<br />
XII. Jardins de case<br />
Partout, dans le Koupe-Manengoumba et le Ndian, autour des habitations, dans les cours des<br />
villages, le long des pistes entre deux quartiers au niveau urbain ou rural, il se développe de façon<br />
spontanée des plantations de cultures vivrières et fruitières. Il s’agit généralement des associations<br />
suivantes : gombo – fruitiers – ndolè – canne à sucre – maïs – manioc – courge – banane –<br />
plantain.<br />
Jardins de case à Toko<br />
Jardins de case à Fabe<br />
Ces jardins occupent des superficies de quelques dizaines de m² et sont mal entretenue : la<br />
plantation est très dense, les cultures sont en permanence envahies par les mauvaises herbes. La<br />
production est par conséquent faible dans la majorité ces cas. Par ailleurs ce sont ces types de<br />
plantations qui motivent les populations à mieux gérer leurs élevages afin d’éviter les problèmes<br />
causés par les bêtes domestiques en divagation.<br />
XIII. Arbres fruitiers<br />
On rencontre partout, dans les deux départements les essences fruitières suivantes : agrumes<br />
(orangers, citronniers, pamplemoussiers, mandariniers), les avocatiers, les papayers, manguiers,<br />
safoutiers…<br />
Ces arbres ne sont pas plantés dans des parcelles sous forme de plantation uniforme. En<br />
d’autres termes, il est très rare de trouver dans les deux départements des plantations de fruitiers<br />
sous forme de vergers classiques. Les arbres sont plantés de façon clairsemée ; on rencontre de<br />
façon isolée, un ou deux arbres dans les cours autour des habitations, le long des axes routiers,<br />
dans les cacaoyères, les parcelles de vivriers… Malgré leur bonne production apparente (surtout<br />
pour les agrumes, les papayers et les avocatiers), cette activité est négligée par les producteurs de<br />
la zone. Ceci se remarque par le mauvais état sanitaire des citrus qui malgré leur bonne<br />
production, connaissent les attaques importantes de cercosporiose. Les producteurs semblent<br />
impuissants face à ce fléau. Curieusement, le marché des fruits semble florissant dans les<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
40
RAPPORT D’ETUDE<br />
départements avoisinants le Ndian et le Koupe-Manengoumba (Meme, Moungo…). Ainsi la<br />
culture des fruitiers dispose d’un très grand potentiel qu’il faut capitaliser dans ces localités.<br />
Quelques vergers ont été identifiées mais demeurent encore très minoritaires dans la zone .Il<br />
s’agit de quelques tiges parsemées généralement en association avec d’autres cultures comme : le<br />
cacaoyer, le palmier à huile, certains vivriers soit en forêt ou autour des habitations.<br />
XIV. Production des fruits et superficies pour la région du<br />
Sud-ouest et le département du Ndian<br />
1. GESTION DE LA MAIN D’ŒUVRE<br />
Les besoins en main-d’œuvre, que l’on soit en cacaoculture, palmier à huile ou cultures<br />
vivrières, sont énormes et les paysans mettent en place pratiquement les mêmes stratégies pour y<br />
apporter des solutions. Pour y arriver différents types de négociations sont menés entre le<br />
propriétaire de la plantation et les différents travailleurs. Diverses techniques et méthodes sont<br />
ainsi mises en place pour fournir de la main d’œuvre à son exploitation. On peut ainsi retenir ce<br />
qui suit :<br />
2. NIVEAU FAMILIAL<br />
Les femmes jouent un rôle très important dans la cacaoculture, notamment dans le transport des<br />
fèves fraîches vers les bacs de fermentation ou les séchoirs.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
41
RAPPORT D’ETUDE<br />
Au niveau rural la répartition des travaux se fait généralement comme suit : l’homme est chargé<br />
de toutes les principales activités liées à la production des cultures de rente (cacao, café,<br />
palmier …) et la femme s’occupe des cultures vivrières. La femme intervient dans les travaux des<br />
cultures de rente lors du désherbage, récolte, séchage, transport. L’homme à son tour assiste la<br />
femme dans les travaux du vivrier pour les travaux de préparation de terrain surtout. Les jeunes<br />
enfants participent également aux travaux champêtres au côté des parents hommes : transports<br />
divers, récoltes et préparation des produits à commercialiser (transformation…). (Sources :<br />
Paysans : 2012).<br />
3. ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE<br />
L’ecabossage se fait généralement en groupe de travail ou par les membres de la famille.<br />
Quelques producteurs s’organisent en GIC, GIE, Coopératives, groupes de travail (njangui)<br />
ou autres groupes de moindre importance afin de mieux développer leurs activités agricoles en<br />
milieux rural. Les membres d’un groupe sont parfois du même sexe, d’une même ethnie. Le<br />
travail en équipe est principalement utilisé pour les activités suivantes : ouverture d’une forêt,<br />
désherbage, préparation de terrain, récolte de cacao.<br />
Ces groupes d’entraide peuvent être formés pour les activités de pépinières (cacaoculture en<br />
général) ou les activités de productions diverses chez les femmes ou les jeunes. Ces groupes<br />
peuvent correspondre avec des systèmes de tontines existants. Une personne peut appartenir à<br />
près de quatre groupes. Il est très facile de former de tels groupes, mais leur durée de vie peut être<br />
courte, parfois le même groupe se renouvelle chaque année avec de nouveaux membres. Un<br />
groupe de travail peut effectuer d’autres travaux chez des non-membres contre payement dont le<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
42
RAPPORT D’ETUDE<br />
taux est plus élevé que s’il s’agissait du travail d’un membre dudit groupe. Sources : Paysans :<br />
2012).<br />
Les seules activités ne donnant jamais lieu à une organisation du travail en groupe sont<br />
l’épandage des phytosanitaires et la commercialisation, en particulier pour le cacao.<br />
4. LA MAIN-D’ŒUVRE SALARIEE<br />
Pour les travaux les plus pénibles (préparation de terrain…), les propriétaires des champs<br />
recrutent de la main d’œuvre parmi les jeunes, les non propriétaires des champs, les allogènes<br />
(Nigérians, Camerounais originaires des Régions de l’Ouest et Nord –ouest surtout)<br />
nouvellement établis à la recherche des capitaux. Un individu peut gagner un contrat de travail et<br />
y utiliser son groupe de travail, ou un autre ami ou frère pour lui venir en aide. (Sources :<br />
Paysans : 2012).<br />
Pour le palmier à huile particulièrement, certaines opérations nécessitent une main d’œuvre<br />
techniquement plus qualifiée et plus expérimentée. On peut citer : taille, récolte, transformation.<br />
Dans le département du Koupé-Manengoumba (surtout arrondissements de Bangem et Nguti),<br />
les besoins en main d’œuvre pour cette culture n’est par une priorité en soi, la culture elle-même<br />
n’étant pas leur principale préoccupation. Pour la plantation par exemple le paysan transporte<br />
chaque matin, selon son gré quelques plants (5 à 10 plants dans les petits sachets) sur son vélo, sa<br />
moto ou sur la tête pour la tâche de la journée. Dans le Ndian, les besoins en main d’œuvres ont<br />
une importance plus accrue surtout dans les parcelles de certaines élites locales ou pour certains<br />
GIC et associations dans les arrondissements d’Ekondo-Titi et Mundemba. (Sources : Paysans<br />
2012).<br />
Dans le palmier à huile, la main d’œuvre salariée est généralement sollicitée dans les exploitations<br />
des élites locales, soit de façon permanente ou alors pours des tâches ponctuelles. Cette main<br />
d’œuvre se recrutent parmi les jeunes, les allogènes (Nigérians, Camerounais originaires des<br />
Régions de l’Ouest et Nord –ouest surtout). Un petit producteur individuel peut faire appel à la<br />
main d’œuvre salariée pour des tâches urgentes et importantes (grande récolte, entretien…). Un<br />
individu peut gagner un contrat de travail et y utiliser son groupe de travail, ou un autre ami ou<br />
frère pour lui venir en aide. (Sources : Paysans : 2012).<br />
Quant aux cultures vivrières les tâches pour lesquelles les besoins en main d’œuvre salariée sont<br />
les suivantes : vivriers sur jachère : préparation de terrain, entretiens ; manioc en culture pure :<br />
préparation de terrain ; vivriers en association : préparation de terrain, bananier plantain :<br />
préparation de terrain, semis, champs des bas-fonds : préparation de terrain, jardin de case : assez<br />
rare, fruitiers : préparation de terrain pour les cas de culture pure de grande superficie.<br />
Alternativement au salariat, une forme de métayage peut être mise en place lorsqu’un producteur<br />
ne peut plus cultiver à lui seul son champ. Il s’agit du « twoparty system », surtout utilisé pour la<br />
cacaoculture. Il consiste à faire travailler sa plantation par un ou plusieurs travailleurs au cours<br />
d’une année. Au moment de la vente du produit annuel, le(s) travailleur(s) et le propriétaire<br />
s’asseyent pour le partage du revenu, après déduction des charges diverses. Cette pratique se fait<br />
surtout pour la cacaoculture. (Sources : Paysans : 2012).<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
43
RAPPORT D’ETUDE<br />
XV. Économie des ménages<br />
1. SOURCES DE REVENUS<br />
Les communautés des départements du Kupe Manengoumba et du Ndian sont essentiellement<br />
rurales puisque plus de deux habitants sur trois (69,2%) y résident en zone rurale et agricole et<br />
71% des personnes actives occupées travaillent dans le secteur primaire.<br />
Suite aux entretiens avec les populations dans l’arrondissement de Nguti, une sorte de<br />
classification des sources de revenu a été faite suivant la proportion que chaque source représente<br />
dans le revenu global annuel des populations. Les pourcentages donnés ici le sont à titre indicatif,<br />
et peuvent varier fortement.<br />
1) Sources de revenus d’une femme dans un foyer<br />
a) Cultures vivrières : 35% des revenus<br />
b) Vin distillé : 5 % des revenus<br />
c) Produits de cueillette et de ramassage : 30% des revenus<br />
d) Cacao : 25 %<br />
e) Autres : 5%.<br />
NB : Pour une veuve, femme héritière d’une cacaoyère et non mariée : Cultures vivrières :<br />
20% des revenus, Vin distillé : 0 % des revenus, Produits de cueillette et de ramassage :<br />
15% des revenus, Cacao : 60 %, Autres : 5%.<br />
2) Sources de revenus d’un homme<br />
a) Culture de cacao : 65 % des revenus.<br />
b) Culture du café robusta : 15%<br />
c) Cultures vivrières : 15 %<br />
d) Gibier et vin de palme 1%<br />
e) Autres : 4%.<br />
2. LES POSTES DE DEPENSES CLES<br />
La gestion des revenus dans certains foyers est parfois source de conflits entre les deux<br />
partenaires. Mais de façon générale, on arrive toujours à trouver un terrain d’entente.<br />
1) Consommation : Elle représente 80 % du montant des revenus. Les principales dépenses à<br />
supporter sont les suivantes : éducation, la santé, amélioration de l’habitat, cérémonies traditionnelles,<br />
nouveaux investissements pour les travaux de plantation de la campagne suivante, alimentation (bière,<br />
viande de bœuf, poissons provenant de la pêche industrielle ou semi industrielle, autres<br />
produits <strong>alimentaire</strong>s non produits dans leurs localité), habillement, divers…<br />
2) Épargne : 20 % du montant des revenus<br />
a) Tontine/caisses des réunions familiales : 98% de l’argent épargné.<br />
b) Caisse d’épargne 2% de l’argent épargné<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
44
RAPPORT D’ETUDE<br />
XVI. Les défis de l’agriculture familiale<br />
1. L’AMELIORATION DES RENDEMENTS<br />
Les espaces consacrés aux cultures vivrières sont faibles et les rendements y sont de très loin<br />
inférieurs à la moyenne. Et pourtant, une amélioration de ceux-ci accroitrait substantiellement les<br />
revenus des paysans.<br />
2. L’AMELIORATION DES TECHNIQUES DE<br />
TRANSFORMATION ET DE CONSERVATION<br />
Enclavés qu’ils sont les excédents qu’on ne sait présenter sur les marchés auraient pu être<br />
transformés et conservés afin de réduire les pertes post récolte qui sont importantes dans la région.<br />
3. L’AMELIORATION DE LA COMMERCIALISATION<br />
Pour produire, il faut d’abord vendre. Dit-on. Sans marché comment les paysans auraient-ils cette<br />
envie de produire plus ? Il n’en est pas différent du cacao pour lequel le paysans subissent la loi des<br />
coxeurs.<br />
4. DISPONIBILITÉ FONCIÈRE<br />
Il n’existe pas d’agro-industrie du caco comme nous l’avons déjà souligné. Cependant la faible productivité<br />
des cacaoyers existants poussent les paysans à accroître leurs exploitations pour gagner davantage de<br />
l’argent. De plus les paysans soutiennent que faute d’emplois dans les grandes villes, les jeunes restent au<br />
village ou rentrent des villes et se lancent dans la production cacaoyère, le palmier à huile et les cultures<br />
vivrières.<br />
Ces différents facteurs font que les terres agricoles soient très sollicitées. La raison fondamentale que les<br />
paysans avancent à Meangwe I par exemple pour ne pas vouloir céder leurs terres à SGSOC est que leurs<br />
enfants et les générations futures pourront faire face au problème de terres si les parents aujourd’hui ne<br />
leur en gardaient pas. Ce discours est tenu un peu partout. À Ayong on pense que, même en cédant des<br />
terres, des dispositions seront prises pour qu’il y en ait suffisamment pour les autres et pour les<br />
générations futures. Certains rapportent le discours selon lequel en cas de difficulté SGSOC pourrait<br />
rétrocéder des terres aux paysans. Ce discours est certainement diffusé par SGSOC lui-même.<br />
Le défi de l’autosuffisance <strong>alimentaire</strong> accroit également la pression sur les terres. En l’absence d’un<br />
encadrement efficace pour une productivité plus accrue des exploitations les paysans doivent recourir à la<br />
jachère et ainsi consommer de plus en plus de terres agricoles et monter la pression sur l’environnement.<br />
Cacao<br />
5. ORGANISATION DES FILIÈRES<br />
La filière cacao est très imparfaitement structurée, complètement dominée par le rôle des acheteurs<br />
intermédiaires. Les paysans se débrouillent tant bien que mal pour la création de leurs exploitations,<br />
l’entretien de celles-ci, l’approvisionnement en intrants agricoles, la gestion des récoltes, leur<br />
transformation et leur commercialisation.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
45
RAPPORT D’ETUDE<br />
La commercialisation implique plusieurs acteurs : des opérateurs chargés d’acheter le cacao soit au village<br />
ou au niveau bord champ. Parfois, cet opérateur local qui est le représentant du grand acheteur basé au<br />
niveau de Kumba, dispose dans un village d’un magasin de stockage du produit.. Pour s’attirer les faveurs<br />
de plusieurs producteurs, donc la possibilité d’obtenir un grand tonnage, l’acheteur local leur accorde des<br />
facilités telles : crédit de production sous forme de pesticides + argent en espèce, aides diverses comme<br />
facilités de transport au cours des deuils…<br />
Au niveau des grandes villes sont basés les acheteurs plus nantis et qui sont soit des intermédiaires entre<br />
l’acheteur local (niveau village) et l’exportateur, soit directement exportateur. C’est l’intermédiaire qui,<br />
dans la plupart des cas préfinance l’activité de l’acheteur village.<br />
La représentation au niveau de l’interprofession (CICC) est également déséquilibrée en faveur des<br />
acheteurs-exportateurs, représentés par leur syndicat, le Groupement des Exportateurs du Cacao-<br />
Café (GEX). C’est l’exportateur qui traite avec l’opérateur extérieur. La représentation des producteurs au<br />
sein du CICC est plus difficile, puisqu’elle passe par l’intermédiaire d’unions de GIC et de coopératives. Le<br />
peu de structuration officielle des producteurs de la zone d’étude ne leur permet pas une représentation<br />
efficace.<br />
Finalement la chaîne de valeur est entièrement contrôlée par les acheteurs, qui achètent le cacao en vrac,<br />
sans rémunérer la qualité, et fixent les prix de manière à faire peser sur les producteurs l’intégralité des<br />
coûts de transport.<br />
Filière huile de palme<br />
La création de l’exploitation est soumise aux mêmes contraintes que pour le cacao et les cultures vivrières.<br />
Deux filières de transformation et de commercialisation coexistent. La filière industrielle, qui rassemble les<br />
régimes mûrs dans les surfaces qu’elle contrôle soit parce qu’elle en est propriétaire, soit par association<br />
avec les producteurs, produit avec de bons rendements une huile raffinée destinée prioritairement au<br />
marché national. La filière artisanale s’approvisionne auprès de producteurs indépendants et produit l’huile<br />
rouge, brute, dans de petites unités de transformation, avec des rendements faibles. Cette huile rouge est<br />
destinée au marché local et national. Elle est généralement privilégiée par les consommateurs locaux,<br />
puisqu’elle est l’une des ingrédients essentiels de l’eru, un des mets les plus consommés comme<br />
accompagnement du wata fufu (met local à base de manioc).<br />
Filière cultures vivrières<br />
Les cultures vivrières les plus produites sont le manioc, plantain, banane douce, macabo, maïs. Les autres<br />
produits vivriers rencontrés sur place viennent d’ailleurs dans le pays, ou sont simplement importés :<br />
patate, pomme de terre, haricot, riz, oignon…<br />
Malgré que la mission d’encadrement de l’agriculture vivrière soit une des missions régaliennes du<br />
ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MINADER) on ne sent pas ses services dans la<br />
région, auprès des producteurs vivriers. Il existe certes sur le terrain, des associations et des GIC des<br />
producteurs et/ou vendeurs de maïs, plantain ou de macabo et leurs sous-produits, mais cela est encore<br />
très marginal, et peut-être proportionnel au volume de production et leur place dans l’économie locale<br />
encore faible.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
46
RAPPORT D’ETUDE<br />
Produits forestiers non ligneux<br />
La plupart des PFNL, avant utilisation ou commercialisation, passent par la phase de transformation.<br />
Dans les Départements du Koupé- Manengoumba et du Ndian, on en rencontre un très grand nombre :<br />
les deux principaux sont le bush mango ou andok (Irvingia gabonensis) dont la transformation consiste à la<br />
décortiquer pour en retirer l’amande qu’il faut sécher avant de la consommer (ou commercialiser). Son<br />
commerce peut être extrêmement lucratif du fait d’une forte demande du côté nigérian de la frontière. Les<br />
acheteurs traversent fréquemment le parc de Korup pour s’en procurer dans les villages des<br />
arrondissements de Toko et Mundemba. Un sac de marché de bush mango peut rapporter jusqu’à 40 000<br />
FCFA. Deux arbres peuvent rapporter plus de 4 sacs par an.<br />
Le njañsang (Ricinodendron heudelotii) qui subit le même procédé, et suit les mêmes filières de<br />
commercialisation, est également très rentable. L’okok ou eru (Gnetum africanum) est un légume-feuilles très<br />
consommé et à usages multiples, il peut être séché et transformé en poudre pour une plus longue durée<br />
de conservation.<br />
En plus de ces produits on trouve le safou, le monkey cola, bush peper, bush onion, bitter cola… Tous Ces<br />
produits sont largement consommés et commercialisés sur les marchés locaux en particulier, souvent par<br />
des femmes qui s’approvisionnent dans les villages.<br />
Un couple de producteurs de Manyemen tenant des produits forestiers dans les bras.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
47
RAPPORT D’ETUDE<br />
Table 1 : Quelques données chiffrées dans le Sud-ouest : production/ramassage des PFNL et autres, en<br />
tonnes<br />
Année<br />
Ndian<br />
2010 Huile de Moabi (0,130 T) ; Oignon sauvage (13 T) ; Njangsan (2 T) ; Bitter cola (3 T)<br />
2011 Huile de Moabi (2 T) ; Oignon sauvage (20 T) ; Njangsan (27 T)<br />
Source : Rapport d’activités 2011 DD Minader Ndian.<br />
En principe, les Ministère de Forêts et de la Faune (MINFOF), ministère de l’Agriculture et du<br />
développement rural (Un Projet de promotion de la culture du eru en exécution au MINADER), ont la<br />
charge de l’encadrement de ces produits à la fois pour leur durabilité et leur développement.<br />
On peut y associer des structures para étatiques ou des partenaires au développement du Cameroun qui<br />
font dans la promotion des PFNL au Cameroun : FAO (Food and agriculture organisation), CIFOR<br />
(Centre for international Forestry Research).<br />
Plus spécifiquement, dans les villages de la zone tampon du parc national de Korup, la GIZ et le<br />
MINFOF travaillent à améliorer la production et la gestion des PFNL dans le cadre de leur Programme de<br />
Gestion Durable des Ressources Naturelles. Les résultats sont encore modestes.<br />
Malgré l’importance économique et <strong>alimentaire</strong> des PFNL, leurs producteurs sont encore inorganisés,<br />
comme dans la filière vivrière.<br />
6. L’ABSENCE D’ENCADREMENT AGRICOLE<br />
Officiellement on peut citer deux principaux Ministères : Agriculture et Développement Rural (volet<br />
production), Commerce (Commercialisation) et leurs structures rattachées. Et pourtant, malgré sa place de<br />
premier producteur de cacao du Cameroun avec un record de 75 % du total de production nationale, le<br />
Sud-ouest ne dispose pas de structures d’encadrement des cacaoculteurs et d’entretien des pistes de<br />
collecte comme la Société de développement du cacao (SODECAO) très présente dans les régions du<br />
Centre, du Sud et de l’Est du pays qui fournissent les 25% restants. Les postes agricoles sont généralement<br />
abandonnés.<br />
L’approvisionnement en intrants agricoles (produits phytosanitaires et autres sacs pour le<br />
conditionnement du cacao) est un véritable goulot d’étranglement pour les cacaoculteurs. Les producteurs<br />
doivent prendre à crédit et à des prix exorbitants (du simple au double) les pesticides et fongicides chez les<br />
acheteurs avec promesse ferme de vendre leur production à ces derniers. Quant aux sacs de<br />
conditionnement la rareté des sacs de jute pousse les paysans à utiliser des sacs de récupération inadaptés<br />
(sacs de riz importé étanches) dont la conséquence est l’infection de moisissure des fèves après quelques<br />
jours dans ces sacs.<br />
Les paysans désireux de créer leur champ de palmier à huile doivent prélever les noix dans les vieilles<br />
plantations pour mettre en pépinière et obtenir les plants.<br />
Pour ce qui des cultures vivrières les semences sont prélevées sur les précédentes récoltes, ce qui affecte<br />
sérieusement les rendements. Par ailleurs l’absence des structures d’encadrement laisse aux paysans la seule<br />
possibilité de garder les systèmes traditionnels de production.<br />
Quant aux techniques de conservation, on est encore aux méthodes anciennes, même pour les produits<br />
forestiers non ligneux difficiles à conserver mais pourtant à valeur marchande très élevée.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
48
RAPPORT D’ETUDE<br />
7. LE MANQUE DE FINANCEMENT<br />
Le financement de l’agriculture, après l’échec des banques agricoles étatiques, est un autre grand défi à<br />
relever dans la zone. L’unique établissement de la micro finance existant à Mundemba est fermée depuis<br />
quelque mois pour cause de faillite. De son existence ses services étaient plus destinés aux fonctionnaires<br />
et commerçants qu’aux agriculteurs. Les producteurs doivent recourir aux expédients pour leurs activités :<br />
tontines traditionnelles, usure, vente par anticipation de la production, crédit des intrants, non traitement<br />
des cacaoyers, sous-dosage des traitements…<br />
La commercialisation, au nom de la libéralisation, souffre d’un laisser-aller qui pénalise les paysans<br />
généralement en position de faiblesse, notamment face à des pressions sociales telle la rentrée scolaire des<br />
enfants ou des cas de maladie. Ces événements rendent très fragiles les producteurs dans un contexte qui<br />
ne dispose d’aucun système financier fiable pouvant éviter à ces derniers de tomber dans le piège des<br />
acheteurs véreux et autres usuriers. Malgré l’existence du Projet d’assainissement interne de la<br />
commercialisation du cacao et du café (PA3C), de création étatique, les producteurs subissent sans<br />
ménagement la dictature des acheteurs et de leurs bras armés connus communément sous l’appellation<br />
coxeurs.<br />
De même faute de structures bancaires moderne pour la sécurisation des recettes de vente des produits<br />
agricoles, les paysans doivent soit les risquer dans des tontines traditionnelles, soit les garder à la maison<br />
avec tous les risques de vols que cela peut comporter ou simplement dépenser dans des futilités et galérer<br />
peu de temps après la campagne cacaoyère<br />
Ceci peut parfois pousser certains à des solutions rapides pour traverser la période de disette : chasse,<br />
travail salarié dans des exploitations agricole. A Lipenja certains paysans sont cacaoculteurs une partie de<br />
leur temps et gardien à la pépinière de Herakles Farms locale.<br />
XVII. Approvisionnement en protéines animales<br />
1. ÉLEVAGE<br />
Il s’effectue à deux niveaux : moderne et traditionnel<br />
Niveau moderne<br />
Il existe généralement en milieu urbain, une multitude de fermes d’élevage des volailles, des porcs, lapins<br />
et de plus en plus des aulacodes. On note également le développement de l’élevage des bovins en zones<br />
urbaines (Bangem, Tombel, Ekondo-Titi) généralement par des éleveurs nomades venant de la partie<br />
septentrionale du pays et des régions de l’Ouest et du Nord-Ouest. Dans la zone d’étude, rien de<br />
semblable n’a été constaté. Un poulailler existe à Nguti, géré par un GIC de femmes, mais semble être<br />
d’une faible capacité, et plus ou moins en perdition.<br />
Niveau traditionnel<br />
Il s’agit d’un élevage de cueillette, moins important en termes de nombre de têtes. Sans structures<br />
spécialement construites pour l’habitation des animaux. On y trouve des bêtes telles : volailles (races<br />
locales), chèvres, moutons, porcs (race locales surtout)… Ici l’élevage se fait suivant certaines règles<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
49
RAPPORT D’ETUDE<br />
traditionnelles à respecter. Les bêtes sont rarement nourries et soignées de façon suivie comme pour<br />
l’élevage moderne. Dans tous les villages de la zone, des dispositions sont prises (mise en enclos, attache<br />
au bout d’une corde au point de pâture…) afin d’éviter les conflits qui peuvent survenir en cas de dégâts<br />
causés par les bêtes sur les cultures des jardins de case et autres. En moyenne, chaque famille peut<br />
disposer de 3 à 5 bêtes. Le marché d’écoulement des bêtes est très peu développé.<br />
Les produits d’élevage interviennent d’une façon particulière dans la gestion des revenus des familles.<br />
En effet, on vend le produit de l’élevage en cas de nécessité financière très importante et très urgente. Les<br />
produits de l’élevage traditionnel sont généralement utilisés lors des cérémonies telles : mariage, deuil,<br />
naissance, baptême,… ou donnés en cadeaux à des visiteurs de marque (autorités administratives ou<br />
politiques… Ces produits sont rarement consommés par les paysans eux-mêmes qui préfèrent les<br />
protéines provenant de la ville (poisson importés, viande de bœuf…).<br />
2. PÊCHE<br />
C’est surtout en saison sèche que cette activité est importante. Elle est pratiquée dans les cours d’eaux<br />
et rivières dont le niveau abaissé dans le cas des zones rurales, et dans certains lacs en zones urbaine.<br />
Espèces généralement les plus capturées : silures, carpes, tilapia …<br />
Pêche à la ligne : Pas très développée. Surtout pratiquée par les jeunes.<br />
Pêche nocturne (au filet): Quasi inexistante en zone rurale. Cependant, dans la péninsule de Bakassi<br />
(Ndian) se pratique cette technique de pêche par les allogènes (Nigérians) qui s’y connaissent mieux<br />
que les Camerounais. Les produits de pêche sont surtout les poissons de mer comme : mâchoirons,<br />
grandes carpes, brochues, morues, bars, morues, disques…<br />
Pêche au poison : Pratiquée dans le passé et actuellement formellement interdite même par les<br />
communautés locales elles-mêmes.<br />
Pêche au barrage : Pratiquée par les femmes et les jeunes filles. Elle constitue la principale source<br />
d’approvisionnement en poissons surtout en zone rurale.<br />
La pêche en elle-même pratiquée par les nationaux, n’est pas très développée dans les deux<br />
départements. En réalité, une filière pêche assez structurée n’existe pas.<br />
3. CHASSE<br />
De fait, la viande de brousse constitue la première source d’approvisionnement en protéines animales<br />
dans toute la zone d’étude. La chasse se pratique principalement en saison des pluies : à cette période, les<br />
animaux sont plus mobiles, à la recherche de nourriture. Le braconnage dans les aires protégées n’est pas<br />
rare. Les principaux marchés commerciaux de viande de brousse se situent à Manyemen (Nguti) et<br />
Mundemba.<br />
Les deux techniques de capture principales sont la chasse au fusil, pour le gros gibier, et le piégeage<br />
pour les petits mammifères (porc-épic, sanglier, hérissons, pangolins…) C’est par cette technique que l’on<br />
obtient 90% du gibier de la zone.<br />
4. SÉCURITÉ ET SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE<br />
Le niveau de souveraineté <strong>alimentaire</strong> d’une région donnée représente sa capacité à assurer elle-même<br />
son alimentation. La notion de sécurité <strong>alimentaire</strong> renvoie à la disponibilité et l’accessibilité des produits<br />
<strong>alimentaire</strong>s pour la population. Les facteurs à prendre en compte pour caractériser ces deux notions sont<br />
donc légèrement différents. La souveraineté <strong>alimentaire</strong> dépend principalement du rapport entre<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
50
RAPPORT D’ETUDE<br />
production et consommation <strong>alimentaire</strong> dans une zone donnée, tandis que la sécurité <strong>alimentaire</strong> dépend<br />
des volumes mis à disposition de la population de cette zone et de sa capacité à acquérir ces volumes.<br />
Cette partie se propose d’explorer ces deux aspects dans les arrondissements de Nguti, Toko et<br />
Mundemba de la région du Sud-ouest Cameroun, et de les mettre en perspective, compte tenu des<br />
dynamiques démographiques et foncières observées et prévisibles. Trois aspects y sont successivement<br />
abordés : la production, la disponibilité sur les marchés locaux, et l’accessibilité pour les ménages.<br />
5. LE VIVRIER DANS LE PAYSAGE AGRICOLE<br />
Une analyse quantitative de l’espace alloué aux cultures vivrières permet de donner une indication de<br />
l’offre en produits <strong>alimentaire</strong>s au niveau d’une région donnée. Le graphique ci-dessous (Figure 1) donne<br />
une estimation de la répartition des terres, par spéculations.<br />
Figure 1 : Répartition des terres agricoles par principales spéculations dans les arrondissements de<br />
Mundemba, Toko et Nguti (MINADER, 2011)<br />
Au regard de l’inexistence de l’encadrement de l’activité agricole dans les arrondissements<br />
concernés, ces données sont à prendre avec une certaine prudence. Certaines informations<br />
représentées ci-dessus correspondent néanmoins à nos observations de terrain. Il s’agit, en<br />
particulier de :<br />
La surreprésentation de la culture du palmier à huile dans l’arrondissement de<br />
Mundemba.<br />
L’importance de la cacaoculture dans l’arrondissement de Nguti, et, dans une moindre<br />
mesure, dans l’arrondissement de Toko.<br />
Une production vivrière d’importance secondaire, centrée sur le manioc et le plantain,<br />
globalement faible.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
51
RAPPORT D’ETUDE<br />
Le second graphique ci-dessous (Figure 2) est basé sur les mêmes – mauvaises – données. Il<br />
permet cependant de donner une idée de ce que représentent les productions précitées en termes<br />
de rations journalières.<br />
Figure 2 : Quantités produites exprimées en rations journalières dans les arrondissements de Mundemba,<br />
Toko et Nguti (MINADER, 2011)<br />
Comme on le constate, la ration minimale en manioc observée dans la zone se trouve à<br />
Mundemba, ce qui reflète probablement d’une part la population importante concentrée dans ce<br />
chef-lieu de département, et d’autre part l’effet de la compétition du palmier à huile sur les terres.<br />
Si l’on consent une certaine valeur indicative à ces données, cependant, on peut faire les<br />
observations suivantes :<br />
Le manioc domine complètement la production vivrière et semble disponible en quantité<br />
suffisante dans tous les arrondissements étudiés.<br />
Le déficit est flagrant pour toutes les autres productions, à l’exception du plantain dans<br />
l’arrondissement de Nguti.<br />
L’arrondissement de Mundemba est le plus déficitaire.<br />
Les lacunes observées à Mundemba sont les plus préoccupantes. On peut les expliquer de<br />
plusieurs manières. Premièrement, par le fait que le les surfaces cultivées sont principalement<br />
attribuées à la culture du palmier à huile, qui occupe 12% de la surface totale de l’arrondissement,<br />
et deuxièmement par le fait que les sols y sont notoirement moins fertiles qu’à Toko et Nguti, ce<br />
qui se traduit notamment par des rendements plus faibles – exception faite du palmier à huile qui<br />
bénéficie de l’expérience et des apports de la PAMOL.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
52
RAPPORT D’ETUDE<br />
6. DISPONIBILITE SUR LES MARCHES LOCAUX<br />
La disponibilité du vivrier dans les marchés locaux dépend de deux paramètres : premièrement<br />
il s’agit des volumes des denrées <strong>alimentaire</strong>s mis à disposition dans la région étudiée, et<br />
deuxièmement des prix demandés pour ces mêmes denrées.<br />
La collecte des données est excessivement difficile pour le premier paramètre, du fait du<br />
manque de suivi des flux commerciaux par les services de l’État. Les dernières informations<br />
disponibles datent d’un recensement de 1993 effectué par le MINAGRI. Il était possible de<br />
dénombrer 25 marchés de vivriers hebdomadaires dans le Koupé-Manengoumba contre 17 dans<br />
le Ndian. Ces données donnaient une vision plutôt optimiste de la situation. 20 ans plus tard, il<br />
est seulement possible de constater que :<br />
Dans l’arrondissement de Nguti, les principaux marchés sont situés à Manyemen et Nguti,<br />
ce dernier étant en assez piteux état. Beaucoup de villages relativement importants ne<br />
possèdent pas de structures pour accueillir un « vrai »marché, ce qui pousse les habitants à<br />
se déplacer pour accéder aux denrées les moins disponibles (cas de la viande, notamment)<br />
et pour vendre leurs excédents de production vivrière. L’autre option, très largement<br />
pratiquée, consiste à vendre la production en bord de route.<br />
Le marché de Mundemba est plus important que celui de Nguti ou de Manyemen, et une<br />
structure permanente abrite le « grand marché » du samedi, qui draine notamment la<br />
production des villages de l’arrière-pays.<br />
Les prix demandés pour la plupart des produits de base sont nettement plus élevés en<br />
moyenne sur le marché de Mundemba que sur celui de Nguti. Tous ces prix sont comparables<br />
voire supérieurs à ceux pratiqués dans les grandes agglomérations que sont Douala et Yaoundé.<br />
Cette situation n’est pas surprenante au regard des données de production analysées plus haut,<br />
qui montrent un déficit d’offre plus important au niveau de Mundemba. Ce mécanisme est<br />
exacerbé par la difficulté des transports en saison des pluies, qui entraîne un surcoût directement<br />
répercuté sur les prix.<br />
7. ACCESSIBILITÉ POUR LES MÉNAGES<br />
Comme on l’a vu, la situation en termes de sécurité <strong>alimentaire</strong> n’est pas critique : les ménages<br />
ont généralement la possibilité de produire une quantité suffisante pour assurer leur survie, bien<br />
que Mundemba soit plus vulnérable de ce point de vue.<br />
Cette observation doit cependant être relativisée au regard du manque de diversité dans la<br />
production. S’il est vrai qu’un certain nombre de données n’ont pas été collectées, la<br />
surreprésentation du manioc est manifeste. Cette situation répond à une habitude de<br />
consommation effective, ainsi qu’aux opportunités de transformation (et donc de création de<br />
valeur ajoutée) que le manioc offre, mais entraîne un déficit net en termes de souveraineté<br />
<strong>alimentaire</strong> pour d’autres cultures également très consommées, comme le riz (mais dans ce cas, le<br />
problème est national), le maïs, le haricot etc. Ces productions sont donc achetées au prix fort sur<br />
les marchés. Dans le cas des villages reculés, la question de l’accessibilité devient donc réellement<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
53
RAPPORT D’ETUDE<br />
N°<br />
problématique, puisque elle implique un déplacement sur de longues distances à un prix prohibitif<br />
pour accéder à ces denrées.<br />
Un certain nombre de production d’importance n’ont toutefois pas pu être quantifiées ici, et<br />
représentent pourtant un part importante du régime des populations du Sud-ouest. Il s’agit en<br />
particulier de l’okok ou eru, un légume spontané ou sub-spontané dans les sous-bois et les<br />
cacaoyères, consommé en grandes quantités – en particulier dans le Ndian.<br />
Tableau comparatif des prix de quelques produits de base à<br />
Nguti, Mundemba, Kumba et Yaoundé<br />
NOM DU<br />
PRODUIT<br />
UNITE DE<br />
MESURE<br />
PRIX EN CFA<br />
NGUTI MUNDEMBA KUMBA YAOUNDE<br />
1 MACABO Tas 1000 1000 1000 500<br />
2 BANANE Tas 100 500 100 100<br />
3 PLANTAIN Tas 400 500 200 500<br />
4 GOMBO Tas 100 500 100 100<br />
5 TAPIOCA Verre 50 50 75 75<br />
6 TOMATE Tas 200 200 150 100<br />
7 PATATE DOUCE Tas 400 500 200 200<br />
8 CONCOMBRE Verre 300 400 300 400<br />
9 HARICOT Verre 125 150 125 150<br />
10 ARRACHIDE Verre 100 150 100 75<br />
11 HUILE DE PALME Litres 800 700 750 800<br />
12 RIZ Verre 100 100 100 75<br />
13 ŒUF FRAIS 1 100 100 75 75<br />
14 SEL Paquet 50 100 50 50<br />
15 HUILE RAFINEE Litres 1400 1300 1300 1250<br />
16 PIMENT Tas 100 100 100 100<br />
17 CAROTTE Tas 200 200 200 100<br />
18 ORANGE Tas 100 100 100 200<br />
20 OIGNON Fruit 150 100 150 50<br />
21 DJANSANG Verre 400 700 300 400<br />
22 MANIOC Tas 400 1000 400 300<br />
NB : Le tableau comparatif ci-dessus montre à quel point la vie est chère à Nguti et à Mundemba<br />
comparativement à Kumba et Yaoundé. Pour certains produits de base, le cas de Mundemba est<br />
franchement inquiétant. Que le manioc, le plantain, la patate douce qui sont les compléments les plus<br />
usuels à toutes les sauces et dans toutes les régions camerounaises coûtent autant chers dans ces localités,<br />
il y a de quoi s’inquiéter pour la sécurité <strong>alimentaire</strong> dans ces régions.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
54
RAPPORT D’ETUDE<br />
Pour conclure, il est possible de considérer que l’état de sécurité et de souveraineté <strong>alimentaire</strong> de<br />
la zone, sans être réellement préoccupant, est anormalement fragile pour une zone rurale<br />
productive.<br />
De manière générale, trois paramètres semblent déterminants pour expliquer cette situation :<br />
1. Une pression excessive des cultures de rentes et des espaces protégés sur les terres, et<br />
particulièrement dans l’arrondissement de Mundemba ou la disponibilité du foncier est<br />
devenue réellement problématique<br />
2. Un manque flagrant dans l’encadrement des filières et l’appui aux producteurs, qui se<br />
traduit par une absence totale de politique agricole planifiée dans la région, une<br />
insuffisance dramatique dans les équipements et l’accès aux intrants nécessaires à une<br />
hausse de la productivité dans les exploitations familiales<br />
3. Un état lamentable des infrastructures de transport, en particulier en saison des pluies, qui<br />
entraîne des surcoûts incompatibles avec l’organisation d’un commerce efficace, en<br />
particulier pour les villages éloignés des axes principaux en direction de Kumba.<br />
Le manioc est l’une des principales cultures vivrières de Lipenja I, un Gic de femmes le transforme en gari<br />
La dépendance<br />
<strong>alimentaire</strong> dans le<br />
Ndian est assez<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du forte, Sud-Ouest, ces patates Cameroun) par<br />
exemple viennent de<br />
l’Ouest du pays.<br />
55
RAPPORT D’ETUDE<br />
Chapitre V : Conséquences prévisibles du<br />
projet SGSOC<br />
A la lumière des chapitres précédents, il est possible de se faire une idée plus précise de<br />
ce que pourrait apporter ou enlever l’implantation d’une palmeraie agro-industrielle de<br />
grande envergure dans la zone d’étude. Un certain nombre des données qui seront<br />
présentées dans cette partie sont confirmées en ce qu’elles proviennent des documents<br />
contraignants produits par SGSOC elle-même.<br />
D’autres proviennent en revanche de discours et de promesses formulées par les<br />
dirigeants de l’entreprise, ou encore des attentes exprimées par les populations. En<br />
conséquence, une extrême prudence doit être employée dans la manipulation de ces<br />
déclarations d’intentions.<br />
I. Rappel des éléments clés du projet<br />
Basiquement, la société SGSOC a reçu en 2009, par une convention de statut juridique flou,<br />
l’intégralité des droits d’usus et de fructus sur une surface estimée à plus de 70 000 ha pour 99<br />
ans. Plus de 60 000 ha sont voués à être cultivés en palmeraie industrielle. L’usage du reste des<br />
terres est encore indéterminé. Outre la création des unités de transformation nécessaires au<br />
traitement des régimes de palmier à huile et des pépinières, il est possible que ces espaces servent<br />
à mettre en place un projet carbone.<br />
Légalement, ces terres n’ont pas encore acquis le statut de concession stricto sensu, ce qui signifie<br />
que le droit des populations sur place est encore flou. Aucun engagement contraignent n’existe<br />
encore quand à l’usage des terres qui sera fait par la société si elle obtient cette concession,<br />
puisqu’elle s’est retirée du processus de certification RSPO et n’adhère à aucun autre. Il convient<br />
de rappeler également que la signature d’un contrat de concession équivaut à considérer<br />
l’intégralité de la surface concernée comme relevant du domaine de l’État, et donc nier le<br />
moindre droit foncier aux communautés locales. Leur marge de négociation est donc très faible,<br />
voire inexistante, et les réalisations dont elles bénéficieraient dépendrait exclusivement de la<br />
bonne volonté de la compagnie. Pour l’instant, cette dernière a multiplié les promesses de sorte à<br />
jouer sur le sentiment de frustration généré par l’abandon des populations et l’attente toujours<br />
insatisfaite du « développement » : construction de routes, électrification, infrastructures de santé,<br />
soutien à l’éducation, accès à l’eau potable.<br />
En ce qui concerne le développement agricole, rien n’existe de manière formelle mais des<br />
déclarations d’intention ont été faites, stipulant que les terres des villageois seraient réparties entre<br />
eux-mêmes et la compagnie de manière participative, et que l’agriculture vivrière serait soutenue.<br />
Les premiers signaux envoyés par SGSOC ne vont cependant pas dans ce sens, et suscitent par<br />
endroit des protestations sous forme de réclamations officielles, de manifestations, d’actions en<br />
justice, etc. Il est indéniable que le projet aura de fortes conséquences sur le territoire. En se<br />
basant sur les expériences précédentes. Il est possible d’anticiper un certain nombre de celles-ci<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
56
RAPPORT D’ETUDE<br />
II.<br />
Conséquences sur la sécurité <strong>alimentaire</strong>s<br />
L’évaluation des conséquences du projet de plantation d’Herakles Farms peut se faire en<br />
considérant les points suivants :<br />
1. Impact sur la disponibilité des terres et sur les capacités de production<br />
2. Impact sur les possibilités de transport et de commercialisation<br />
3. Impact sur le revenu des ménages<br />
III.<br />
Disponibilité des terres et capacités de production<br />
La carte suivante présente l’emprise du projet SGSOC dans le zonage actuel. Il saute aux yeux<br />
que la portion de terre qui est vouée à être plantée occupe la majorité de l’espace laissé par les<br />
aires protégées. Plus spécifiquement, la concession prendrait la quasi-totalité du bassin de<br />
production cacaoyère de Ntale, Mungo Ndor, Bombe Konye et New Konye, ainsi que de l’autre<br />
côté de l’axe Kumba-Nguti, celui d’Ayong et Sikam.<br />
La région de production vivrière de Toko serait également touchée, ainsi que les rares espaces de<br />
l’Est de l’arrondissement de Mundemba qui sont encore disponibles pour la production vivrière.<br />
Le scénario le plus probable conduirait donc à la disparition pure et simple d’importantes<br />
capacités de production, et à l’aggravation dramatique du niveau d’insécurité <strong>alimentaire</strong> déjà<br />
observable à Mundemba. L’un des indicateurs les plus concrets de ce qui pourrait advenir nous<br />
vient, dans l’environnement immédiat du cadre de notre étude, de la palmeraie de la Pamol, et<br />
dans un environnement plus lointain des exploitations de la CDC, de Delmonte et Camroon Tea<br />
Estate (CTE). L’un des derniers aspects à prendre en compte est l’augmentation probable de la<br />
demande. L’expérience montre que dans les plantations agro-industrielles, le taux d’indigènes<br />
employés est plutôt faible, ce sont surtout des allogènes qui sont recrutés. Il résulterait d’un tel<br />
scénario une augmentation nette de la population.<br />
On accuse ces agro industries d’être à l’origine de la rareté des terres agricoles, de la pénurie des<br />
denrées <strong>alimentaire</strong>s dans un système de culture qui ne tolère pas la cohabitation (pas de cultures<br />
mixtes). Couvrant des milliers d’hectares en continue, ces plantations laissent rarement des<br />
espaces pour une agriculture vivrière de grande échelle. Les zones limitrophes sont soit des<br />
marécages, soit les flancs des montagnes moins fertiles du fait de l’érosion dans une région des<br />
grandes pluviométries et difficilement accessibles. Les terres restantes, mêmes propices à la<br />
production vivrière, sont coupées de leurs débouchés pour cause de mauvaises routes ou<br />
d’interdiction de circuler dans les exploitations industrielles qui les séparent des marchés.<br />
Dans l’arrondissement de Nguti, les conséquences seraient probablement moins visibles, du fait<br />
de la préservation des villages situés le long de la route principale, mais au moins 4 villages<br />
constituant le plus gros bassin cacaoyer de l’arrondissement seraient condamnés. En ce qui<br />
concerne l’approvisionnement en protéines, la présence d’une agro-industrie, non seulement<br />
fragiliserait les possibilités de chasse, mais pousserait les populations à entrer clandestinement<br />
dans les réserves forestières où elles détruiraient la faune.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
57
RAPPORT D’ETUDE<br />
Il en est de même des produits forestiers non ligneux. Non seulement ils sont une importante<br />
source de revenu monétaire, notamment chez les femmes, mais également sont les aliments de<br />
base des populations : l’okok (eru) le djansang, le buh mango, le buh peper, le buh onion, …<br />
entrent dans les plats quotidiens. La destruction des arbres qui les produisent conduit fatalement<br />
à porter atteinte aux habitudes <strong>alimentaire</strong>s, voire la sécurité <strong>alimentaire</strong>.<br />
L’huile de palme brute (CPO) est la plus utilisée dans la cuisine locale. En dehors des plantations<br />
d’importance moyenne, les paysans essaient tant bien que mal d’avoir quelques pieds pour la<br />
production de l’huile de palme destinée à la consommation familiale. Il est incontestable que la<br />
pénurie de cette huile soit l’un des premiers coups durs à ces populations qui n’y auront plus<br />
accès, ou y accèderont à prix d’or et surtout n’auront plus de place pour produire eux-mêmes.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
58
5°15'0"N<br />
4°45'0"N<br />
5°0'0"N<br />
5°15'0"N<br />
5°0'0"N<br />
4°45'0"N<br />
RAPPORT D’ETUDE<br />
9°0'0"E<br />
9°15'0"E<br />
9°30'0"E<br />
NGUTI<br />
NTALE<br />
AYONG<br />
MANYEMEN<br />
FABE<br />
KONYE<br />
Legend<br />
Railway<br />
9°0'0"E<br />
National road<br />
Provincial road<br />
Department road<br />
Public road<br />
Primary logging road<br />
Secondary logging road<br />
Abandonned logging road<br />
Forest road<br />
Plantation<br />
SGSOC project<br />
Forest planning<br />
National Park<br />
Wildlife Reserve<br />
Reserve<br />
Forest Reserve<br />
Council Forest<br />
9°15'0"E<br />
Community Forest<br />
Timber auction area<br />
Forest Management Unit<br />
Forest projects<br />
Community Forest<br />
Council Forest<br />
9°30'0"E<br />
Forest Management Unit<br />
Population<br />
0 - 100<br />
100 - 500<br />
500 - 1000<br />
1000 - 5000<br />
5000 - 25000<br />
µ<br />
1:500,000<br />
Km<br />
0 3 6 12 18 24<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
59
RAPPORT D’ETUDE<br />
IV.<br />
Capacité de transport et de commercialisation<br />
Il est indéniable que la conduite d’une plantation agro-industrielle de palmier à huile nécessite<br />
la mise en place et l’entretien d’un réseau de pistes de collecte des régimes pour acheminer ceuxci<br />
vers les points de transformation. Le transport de l’huile raffinée nécessite également des<br />
routes suffisamment solides pour permettre le passage des camions-citernes. L’exemple de la<br />
PAMOL n’est toutefois pas rassurant sur ce point : les routes reliant leurs sites de production<br />
d’Ekondo-Titi et de Mundemba à Kumba sont dans un état lamentable, et l’aménagement du<br />
territoire est une prérogative régalienne. Même si la compagnie est de bonne volonté, il n’est pas<br />
sûr qu’elle dispose des autorisations nécessaires.<br />
Par ailleurs, la liberté de circulation n’est pas garantie sur des routes privées. L’exemple de la<br />
CDC bloquant les voies sortant de sa concession pour éviter que les planteurs d’hévéa qui y sont<br />
inclus ne partent vendre leur caoutchouc ailleurs n’est pas rassurant.<br />
Il serait toutefois abusif d’imaginer SGSOC laissant volontairement la population de la région<br />
mourir de faim. Ne serait-ce que pour fournir les moyens de survie à ses travailleurs, il est<br />
probable qu’elle contribuera à augmenter les flux de nourriture sur les routes irriguant la zone<br />
d’étude.<br />
V. Impact sur le revenu des ménages<br />
Cette question est difficile à traiter de manière formelle. Il est cependant possible de relever<br />
quelques évidences :<br />
Étant donné la forte prévalence des actifs agricoles dans la zone, il est plus que probable que<br />
le projet détruira un grand nombre d’exploitations, tant vivrières que cacaoyères. On peut prévoir<br />
un basculement d’une activité paysanne fondée sur l’entreprenariat vers un véritable prolétariat<br />
agricole. La comparaison des revenus individuels générés par ces deux activités est instructive.<br />
Rappelons que l’économie cacaoyère constitue la base de l’économie du Sud-ouest. Elle est la<br />
source de revenu monétaire la plus importante C’est, dans certains cas, le premier pourvoyeur<br />
d’emplois directs dans les villages, et de nombreux autres emplois indirects en aval. Elle occupe<br />
les paysans pratiquement six mois sur douze de l’année, de juin à novembre.<br />
En se basant sur les premières simulations réalisées au cours de cette étude, et sur la littérature<br />
existante, on peut estimer que la cacao culture et la culture du palmier à huile sont relativement<br />
similaires en termes de revenus nets pour un agriculteur indépendant (entre 200 000 et 300<br />
000FCA par hectare et par an), auxquels il faut ajouter au moins 100 000 FCFA de PFNL par<br />
hectare et par an dans le cas de la cacao culture. Avec un rendement modeste de 400 Kg/ha et un<br />
prix faible de 900 FCFA/Kg, 2 ha d’agro forêt cacaoyère sont donc suffisants pour rivaliser avec<br />
les 420 000 FCFA payés annuellement aux ouvriers agricoles dans les grandes plantations agroindustrielles<br />
(le salaire annuel de l’ouvrier agricole à la PAMOL est estimé à 420.000 F CFA l’ an<br />
soit 35.000 F CFA le mois).<br />
Étant donné que la surface moyenne des cacaoyères actuelles est estimée à 4ha dans la région,<br />
on peut prévoir une chute drastique du revenu pour l’ensemble des cacaoculteurs touchés. Les<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
60
RAPPORT D’ETUDE<br />
expériences des agro industries existantes (tout proche la PAMOL) et au loin la CDC, et la CTE<br />
sont sources d’inspiration pour mesurer les risques de paupérisation des villages, de reconversion<br />
des jeunes en « esclaves agricoles » sans avenir.<br />
VI.<br />
Un point sur la biodiversité<br />
Les possibilités d’introduire la biodiversité dans les exploitations de palmier à huile sont<br />
encore en étude (Turner & al., 2008). Bien que la culture du palmier à huile soit plus complexe<br />
sur le plan de l’écosystème que les autres monocultures, des études en Asie du Sud Est ont<br />
montré que les exploitations du palmier à huile étaient un habitat très médiocre pour les oiseaux<br />
et les papillons, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans la dissémination naturelle des<br />
semences et la pollinisation.<br />
Bien que l’on puisse soutenir que le palmier à huile soit originaire du Golfe de Guinée, et que<br />
par conséquent il peut plus tolérer d’autres espèces au Cameroun qu’en Indonésie, il n’en<br />
demeure pas moins que de vastes exploitations du palmier à huile constituent un obstacle naturel<br />
au développement des espèces et de leur expansion.<br />
Les modes de production en vigueur actuellement sur le site convoité peuvent être répartis en<br />
deux catégories : la pratique de la jachère courte utilisée surtout dans les espaces réservés aux<br />
cultures vivrières, lesquelles cultures sont destinées à la consommation familiale ou vendues sur<br />
le marché local.<br />
Il y a en deuxième position le système de jachère longue utilisée dans la cacaoculture et la<br />
caféiculture associées aux arbres d’ombrages à valeur économique produisant des fruits, ou utiles<br />
comme bois d’œuvre ou de chauffe, voire vendus en cas de nécessité (Malleson, 2000).<br />
Comparé à la monoculture, ce système agro forestier du cacao peut avoir un grand potentiel<br />
de conservation de la biodiversité en zone agricole. Une bonne gestion des arbres d’ombrage<br />
peut offrir un espace vital à bien d’espèces forestières (Perfecto & Vandermeer, 2008, Jose,<br />
2009, Tscharntke & al., 2011). Bien que les espèces observées soient moins variées que ce que<br />
l’on observe dans les forêts primaires et secondaires(Bobo & al., 2006a, Bobo & al., 2006b, Oke<br />
& Odebiyi, 2007) l’agroforêt cacaoyère et caféière peut tout aussi bien abriter plusieurs<br />
pollinisateurs et disséminateurs naturels de semences tels les insectes, les oiseaux, les criquets, les<br />
rongeurs etc. et être ainsi plus propice au développement des espèces que lorsqu’on est en<br />
monoculture agro industrielle . Cette observation a poussé <strong>Greenpeace</strong> à creuser davantage dans<br />
les systèmes agro forestiers comme alternative au développement de l’industrie du palmier à huile<br />
Les agro forêts peuvent offrir d’autres opportunités écologiques telles la séquestration du<br />
carbone, la conservation de la fertilité des sols.<br />
L’on ne doit pas oublier que la cacaoculture a été à l’origine de la déforestation(Ruf, 2007).<br />
Bien que l’ombrage soit utile dans la cacaoyère, l’exposition des plants en maturité au soleil<br />
accélère la maturation précoce du cacaoyer et limite la pourriture brune.<br />
Au bout de 25 ans le sol s’appauvrit et les paysans doivent créer de nouvelles exploitations<br />
(Clough & al., 2009, Tscharntke & al., 2011). Dans notre zone d’étude nous signalons cependant<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
61
RAPPORT D’ETUDE<br />
que cette pratique n’est pas très répandue, les paysans trouvant d’autres sources de revenus dans<br />
les produits forestiers non ligneux.<br />
De ce que nous avons appris sur le terrain, l’occupation des terres est motivée par plusieurs<br />
facteurs. Le premier facteur est économique : le prix du cacao est en hausse depuis quelques<br />
années, faisant de la cacaoculture une activité rentable.<br />
Cependant les conditions dans lesquelles se vend le cacao ne permettent pas aux producteurs<br />
d’engranger d’énormes bénéfices. Ce qui les pousse à augmenter les quantités pour augmenter<br />
leurs revenus.<br />
Le deuxième facteur d’occupation des terres est la complexité de règles traditionnelles de<br />
gestion du foncier. La propriété des plantations de cacao abandonnées est souvent controversée.<br />
Le moyen le plus simple d’éviter des conflits consiste à aller ailleurs créer une autre exploitation.<br />
Enfin, on cite la pression démographique suite à la venue des travailleurs saisonniers d’autres<br />
régions du pays (Nord ouest) qui s’installent comme exploitants agricoles en occupant de<br />
nouvelles terres. Mais c’est une question qui mérite encore des enquêtes plus approfondies pour<br />
leur véracité et l’impact supposé sur le foncier.<br />
Le dernier point important pour la protection de l’environnement est l’utilisation des produits<br />
chimiques. Mais nous ne sommes pas en mesure de démonter l’impact réel de ces produits<br />
chimiques sur l’homme et son environnement.<br />
Le Sud-ouest du Cameroun dispose de l’une des plus riches biodiversités du monde.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
62
RAPPORT D’ETUDE<br />
Quelques observations sur le <strong>Système</strong><br />
<strong>agraire</strong> de la région<br />
L’observation attentive du milieu socio économique des arrondissements de Nguti, Mundemba et Toko, fait<br />
ressortir les constats que nous résumons ici en 27 points.<br />
I. Forte dépendance <strong>alimentaire</strong><br />
1. Quand on visite les « grands marchés » de la région - chef lieux des arrondissements s’entend,<br />
on est frappé de constater le peu de diversité et de quantité des produits offerts à la<br />
consommation. Cela témoigne incontestablement de la faiblesse des activités liées à la<br />
production et à la consommation des produits vivriers. Toute chose qui contraste<br />
énormément avec la luxuriance de la végétation et la clémence du climat ambiant<br />
2. Sur les mêmes marchés et dans les échoppes de la place, on est tout aussi frappé par la<br />
diversité et l’abondance des produits pour la plus part importés du Nigéria voisin. Toute<br />
chose qui témoigne de la précarité et de la dépendance <strong>alimentaire</strong> dans la région<br />
3. A défaut de dépendre du voisin nigérian, c’est de Kumba que proviennent certains produits<br />
de consommation courante. Dans l’arrondissement de Nguti par exemple, il n’y qu’une petite<br />
ferme avicole de création récente et qui a cessé ses activités à notre passage, aucun jardin<br />
maraicher alors que les bas fonds et l’eau ne font pas défaut.<br />
4. Ce phénomène <strong>alimentaire</strong> est aussi perceptible dans les quelques restaurants et autres<br />
gargotes de la place. L’alimentation proposée est très peu variée.<br />
II. Gestion des espaces<br />
1. La composante la plus caractéristique de la structuration de l’espace- et la plus<br />
immédiatement perceptible dans les villages est celle formées par les cases d’habitation qui<br />
sont soit groupées soit construites le long des routes - sans aucun ordonnancement.<br />
2. Sont aussi perceptibles les vergers de cacao qui partent pour la plus part juste des limites des<br />
constructions comme si celles-ci avaient mordu dans la plantation pour s’établir. Ces vergers<br />
sont tous polyvalents. On y trouve en mélange toute sorte d’arbres formant des étages de<br />
végétation différents. C’est à peu près le même décor lorsqu’on se trouve dans<br />
l’arrondissement de Mundemba où prédomine le palmier à huile. A Toko par contre on note<br />
une prédominance des cultures vivrières.<br />
3. La polyvalence du verger est intéressante à trois points de vue particuliers : Sur le plan<br />
<strong>alimentaire</strong>, elle permet la variation de l’alimentation. Sur le plan économique, la diversité des<br />
récoltes permet d’avoir constamment une source de revenu. Sur le plan écologique la<br />
diversité des espèces et leur disposition favorisent la fertilité, l’humidité du sol et la<br />
conservation des espèces. Mais lorsqu’on est à Mundemba on en en situation de monoculture<br />
du palmier à huile, non seulement dans le cas de l’agro industrie (Pamol) mais aussi dans<br />
les palmeraies moyenne des élites.<br />
Les vergers monoculturaux, s’ils ont l’avantage de produire de grandes quantité d’une même<br />
espèce <strong>Système</strong> commercialisable, <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> sont faciles des arrondissements à contrôler du de point Toko, Mundemba de vue sanitaire et Nguti (Région et du du point Sud-Ouest, de Cameroun) vue des<br />
pratiques agricoles, ils présentent le désavantage de ne pas prendre en compte l’alimentation<br />
familiale, d’avoir une production saisonnière et exclusivement orienté à un but commerciale.<br />
C’est ce qui peut justifier le prix élevé des denrées <strong>alimentaire</strong>s à Mundemba où domine le<br />
I<br />
63
RAPPORT D’ETUDE<br />
4. Les vergers monoculturaux, s’ils ont l’avantage de produire de grandes quantité d’une même<br />
espèce commercialisable, sont faciles à contrôler du point de vue sanitaire et du point de vue<br />
des pratiques agricoles, ils présentent le désavantage de ne pas prendre en compte l’alimentation<br />
familiale, d’avoir une production saisonnière et exclusivement orienté à un but commerciale.<br />
C’est ce qui peut justifier le prix élevé des denrées <strong>alimentaire</strong>s à Mundemba où domine le<br />
palmier à huile.<br />
5. A quelques exceptions près, on trouve des petits jardins de case pour ceux qui ont un peu<br />
d’espace. La principale contrainte de ces jardins est leur protection contre la divagation des<br />
animaux. Il arrive que certains paysans protègent leur jardin d’une haie en bambou de chine ou<br />
en planche.<br />
6. L’agriculture maraichère et condimentaire ne sont pas très développées. Nombreux sont les<br />
produits entrant dans les préparations culinaires qui poussent spontanément dans les forêts et<br />
font l’objet de ramassage et cueillette : L’exemple de l’Okok, le djanssan, le tétrapleura, la<br />
mangue sauvage, le piment de singe … etc. Il faut noter que la cueillette n’est pas une activité<br />
liée au hasard. Les paysans connaissent les lieux où trouver telle ou telle espèce. Il est fréquent<br />
que les villageois préservent certaines plantes de cueillette lors de la mise en feu ou de<br />
l’abattage.<br />
7. Les légumes subspontanés ne font pas nécessairement l’objet d’un semis. Ils sont plus ou moins<br />
abondants et leur cueillette dépend du hasard.<br />
III. L’agriculture dans la région souffre de plusieurs facteurs<br />
limitant<br />
Moyens et méthodes de travail traditionnels. L’usage encore généralisé des outils<br />
traditionnels (houe, machette, hache et hutte) limite considérablement les capacités de production<br />
et rend le travail agricole trop pénible.<br />
Division irrationnelle du travail entre les hommes et les femmes. Si on note une forte<br />
complicité entre hommes et femmes en période d’intenses travaux cacaoyères (récolte,<br />
écabossage, fermentation, transport et séchage) (transport, pressage d’huile pour le palmier à<br />
huile), l’essentielle de la charge de travail familial repose sur la femme (productions vivrières,<br />
cuisine, ménage, entretien et éducation des enfants).<br />
Faibles rendements agricoles. Plusieurs facteurs justifient ces faibles rendements : Diverses<br />
défaillances dans les itinéraires techniques de production ; mauvaise gestion des ressources,<br />
caprices climatiques, techniques de fertilisation ignorées, mauvaise sélection et conservation des<br />
semences, jachères de courte durée<br />
Prédominance des cultures de rente. La culture de rente ; le cacao et le palmier à huile<br />
suivant les cas est privilégié. On leurs consacre le gros des facteurs de production (main d’œuvre,<br />
temps de travail, intrants agricoles, bonnes terres...)<br />
Encadrement technique défaillant. Les structures d’encadrement agricoles sont peu visibles<br />
en milieu rural quoi qu’ayant des bureaux dans les chefs lieux d’arrondissements. Les producteurs<br />
sont pour ainsi dire abandonnés à eux-mêmes, face aux difficultés de production, de<br />
la commercialisation, en passant par la transformation et autre conservation.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
Cette défaillance de l’Etat se fait aussi sentir dans : - La politique foncière (mise en place d’une<br />
législation sécurisante pour les producteurs) ; - La politique d’approvisionnement (l’existence et<br />
64 II
RAPPORT D’ETUDE<br />
Cette défaillance de l’Etat se fait aussi sentir dans : - La politique foncière (mise en place<br />
d’une législation sécurisante pour les producteurs) ; - La politique d’approvisionnement<br />
(l’existence et le bon fonctionnement d’un marché d’approvisionnement pour l’agriculture) ; -<br />
Le financement agricole (en harmonisant les politique de crédit et de subvention) ; - Une<br />
politique de commercialisation.<br />
IV. Technique de multiplication de plantes peu évolués<br />
Si pour les cacaoyères on procède à l’établissement de pépinière, il n’en est pas de même<br />
des autres arbres fruitiers dont les plants spontanés font l’objet de ramassages dans les jardins<br />
de cases ou dans les champs. De plus, la pratique du repiquage à racine nues n’est pas de<br />
nature à faciliter la multiplication.<br />
Pour le palmier à huile certains producteurs doivent recourir aux noix ramassées dans les<br />
champs du voisin ou sous un vieux palmier et mettre en pépinière.<br />
Les tentatives de domestication d’espèces exploitées en milieux spontanés, d’amélioration<br />
variétales, de greffage et de bouturages, de nouvelles méthodes de conservation, et tailles…<br />
sont peu nombreuses.<br />
V. Culture du Cacao<br />
1. A tous les niveaux, de la pépinière à la commercialisation en passant par le séchage, la<br />
production cacaoyère souffre de plusieurs manquements techniques, structurels et<br />
organisationnels.<br />
2. Aucune introduction de nouvelles variétés n’a été faite dans la région depuis belle lurette.<br />
Aussi, les producteurs continuent de prélever les fèves à ensemencer de leur récolte.<br />
3. Les pépinières qui sont généralement établies autour des cases d’habitation, ne respectent pas<br />
les standards techniques minimums. De plus la pratique de transplantation à racines nues<br />
n’est pas de nature à favoriser le plein épanouissement des plantes.<br />
4. Les traitements phytosanitaires sont approximatifs en termes de timing, de dosage et de<br />
technique d’utilisation des produits… pour ceux qui le font. A défaut de la faire, les<br />
producteurs sont peu enclins aux méthodes de lutte biologique.<br />
5. Le traitement du cacao marchand par les producteurs est à ce point médiocre que la notion<br />
de grade n’existe pas dans certains villages. Tout cacao est acheté, confondu au grade III- le<br />
plus bas de l’échelle.<br />
VI. Difficulté d’approvisionnement en bien de production<br />
Les paysans de disposent pas en quantité, en qualité, à prix favorable et en temps voulu ce<br />
dont ils auraient besoin pour l’amélioration de leurs productions. Il n’existe aucun magasin de<br />
vente d’intrants agricoles au niveau des chefs lieux d’arrondissement. Et que dire des villages,<br />
enclavés pour la plus part.<br />
26. Difficulté d’écoulement.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
Le problème d’écoulement concerne deux catégories de produits et à des degrés différents : les<br />
produits de rente en l’occurrence le cacao, et dans une moindre mesure l’huile de palme, les<br />
III<br />
65
RAPPORT D’ETUDE<br />
VII. Difficulté d’écoulement<br />
Le problème d’écoulement concerne deux catégories de produits et à des degrés différents : les<br />
produits de rente en l’occurrence le cacao, et dans une moindre mesure l’huile de palme, les<br />
produits vivriers et forestiers non ligneux. Alors que pour le cacao, les producteurs sont à la<br />
merci des acheteurs pour ce qui concerne tant le prix que l’enlèvement, les produits non ligneux<br />
souffrent d’un manque d’incitation du fait de la rareté des preneurs. Mais on a observé que la<br />
commercialisation des produits forestiers non ligneux dans l’arrondissement de Toko était<br />
florissante. Les acheteurs viennent du Nigeria voisin ou d’autres régions du Cameroun<br />
VIII. L’inorganisation<br />
L’absence d’organisation paysannes genre groupes ou coopératives(15) reconnus être des outils<br />
de développement, constitue un facteur freinant au développement des villages. Le groupe<br />
permet de produire des biens de consommation, d’accéder à des services (commercialisation,<br />
stockage en commun approvisionnement en intrants, les conseils à la production...etc.),<br />
d’acquérir et de gérer des biens collectifs, La gestion du foncier ou de l’environnement, la<br />
représentation des producteurs, etc.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
66 IV
RAPPORT D’ETUDE<br />
PARTIE II :<br />
RECOMMANDATIONS<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
67
RAPPORT D’ETUDE<br />
I. Pour la sécurité/Souveraineté<br />
<strong>alimentaire</strong><br />
Les conclusions essentielles que l’on peut tirer de l’étude du système <strong>agraire</strong> et sur<br />
lesquelles se fondent nos recommandations sont les suivantes :<br />
Les producteurs de la région ne bénéficient presque d’aucun encadrement technique -<br />
qu’il soit étatique ou associatif. Isolés qu’ils le sont pour des raisons infrastructurelles,<br />
structurelles voire socioéconomiques, leurs moyens et méthodes de travail restent<br />
traditionnelles. L’agriculture vivrière avec des rendements très faibles et des pertes post<br />
récolte excessivement élevées, est essentiellement destinée à la subsistance.<br />
Les producteurs sont peu organisés. Il n’existe pas de coopératives vivrières, de GIC<br />
(groupe d’initiative commune), ou très peu et pas efficaces, ou autres groupes d’entraide<br />
à l’exception de quelques rares coopératives cacaoyères. Isolés qu’ils le sont, les paysans<br />
ne bénéficient d’aucun effet de groupe tant en services (formation, commercialisation,<br />
ravitaillement en intrants...) qu’en défense des intérêts (représentation, négociation…).<br />
Plusieurs villages sont difficiles d’accès en saison des pluies (juillet, aout, septembre et<br />
octobre). Dans ces périodes, les populations se ravitaillent peu en produits de première<br />
nécessité et évacuent difficilement leurs productions vers les marchés. Lesquels marchés<br />
sont nettement peu fournis en qualité et quantité de vivres.<br />
Autant de facteurs qui se conjuguent pour réduire le pouvoir d’achat des paysans et<br />
conséquemment réduire leur accessibilité à la nourriture dont la disponibilité insuffisante<br />
renchérit le coût.<br />
Création des PPCV<br />
Par PPCV on entend : Pôle de Promotion des Cultures Vivrières dont le principal objet serait<br />
d’améliorer la disponibilité et l’accessibilité de la nourriture aux populations. Toute chose qui<br />
passe par : - Le soutien à la production des vivres ; - L’amélioration et la diversification des<br />
sources de revenus des paysans ; - Le soutien à la structuration/organisation des producteurs.<br />
I. Définition d’un PPCV<br />
Un PPCV est une Structure dotée de moyens matériels, humains et financiers d’appui à la<br />
production et à la gestion des récoltes paysans (magasin d’intrants et d’outillage agricole, caisse<br />
d’épargne et de crédit, aire de séchage, magasin de stockage, de conservation ou de<br />
conditionnement, commercialisation… ). Il est situé dans l’environnement immédiat des<br />
producteurs. Dans son principe de fonctionnement, le PPCV rapproche des producteurs tout ce<br />
dont ils ont besoin pour améliorer la production et la productivité de leurs exploitations, la<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
68
RAPPORT D’ETUDE<br />
gestion efficiente de leurs récoltes. Il les rapproche les uns des autres pour se connaître et<br />
échanger. Il leur permet de mutualiser leurs efforts, de faire d’économies d’échelle par leur<br />
nombre et de réduire les risques.<br />
Toutes les fonctions assurées par les animateurs le sont avec la participation des producteurs. Ce<br />
qui leur permet de s’approprier ces fonctions en vue de leur transformation en coopératives.<br />
(Coopérative d’intrants, coopérative d’épargne et crédit, coopérative de commercialisation voire<br />
de stockage ou de gestion des récoltes.). Toute chose qui garantit la durabilité de l’action. Et qui<br />
fait dire qu’un PPCV naît avec le gène qui la tuera.<br />
II.<br />
Hypothèses justifiant les PPCV<br />
Hypothèse 1<br />
A. De la gestion des récoltes :<br />
- Plus éloigné est le marché (charges et risques de commercialisation élevés) ;<br />
- Plus enclavé est le village (difficultés d’évacuation des produits) ;<br />
- Plus petits est l’habitat (moins de place pour la conservation) ;<br />
- Plus faibles sont les connaissances du producteur en matière de conservation et<br />
transformation (manque de formation et d’échange) ;<br />
- Plus petite est la récolte (faible intérêt des acheteurs) ;<br />
- Plus faibles sont les connaissances du producteur sur les marchés et les opportunités (manque<br />
de formation et d’échange) …….<br />
Plus vulnérables sont les paysans à l’insécurité <strong>alimentaire</strong><br />
B. De la gestion de l’exploitation :<br />
- Plus éloigné et enclavé est le champ (difficultés à sortir les produits) ;<br />
- Plus conservatrices sont les techniques de production (faibles production et productivité) ;<br />
- Moins le producteur est équipé (moyen de transport et infrastructures diverses...) ;<br />
- Moins le producteur produit de manière durable et raisonnée ;<br />
- Moins les producteurs maitrisent les techniques de production en sauvegarde de la biodiversité ;<br />
- Plus les producteurs sont abandonnés à eux-mêmes ;<br />
Plus vulnérables sont les paysans à l’insécurité <strong>alimentaire</strong><br />
C. De la gestion organisationnelle des producteurs :<br />
- Plus solitaire est le producteur (difficultés à mutualiser les efforts et les services) ;<br />
- Plus les producteurs sont inorganisés (structures de services et de défense des intérêts<br />
inexistantes) ;<br />
- Plus les producteurs sont inconscients de l’importance des pertes post récoltes ;<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
69
RAPPORT D’ETUDE<br />
Plus vulnérables sont les paysans à l’insécurité <strong>alimentaire</strong><br />
Toute situation caractéristique des petits exploitants agricoles communément appelés :<br />
Exploitants familiaux.<br />
Hypothèse 2<br />
Aborder le problème de vulnérabilité des paysans à l’insécurité <strong>alimentaire</strong> de manière durable<br />
dans l’optique d’améliorer les conditions de vie, d’alimentation et les revenus des petits<br />
producteurs ne saurait se faire sans prise en compte des facteurs aggravants liés à la gestion des<br />
récoltes, la gestion de l’exploitation et la gestion organisationnelle des producteurs.<br />
Hypothèse 3<br />
La baisse continue de la productivité des petites exploitations entraine l’amenuisement des<br />
excédents commercialisables ou conservables. Toute chose qui aggrave la pauvreté des paysans et<br />
confirme de ce que l’amélioration de la vulnérabilité des paysans à l’insécurité <strong>alimentaire</strong><br />
commence à la production.<br />
III. Point d’ancrage du PPCV<br />
Le PPCV s’intègre dans une dynamique de production locale et ouvre un espace qui permet<br />
l’introduction de techniques de production améliorées prenant en compte la protection de<br />
l’environnement et la gestion durable des ressources.<br />
L’amélioration de la productivité aboutit à l’augmentation de la production. Par ailleurs les<br />
infrastructures de stockage et de conservation réduisent considérablement les pertes post récolte<br />
et améliore la commercialisation des produits. Toutes choses qui permettent aux producteurs non<br />
seulement d’accroitre leurs revenus mais aussi, d’avoir suffisamment à manger.<br />
Le marketing des produits agricoles issus du PPCV, la mise en relation avec les opérateurs<br />
économiques tant pour l’achat des produits par ces derniers que pour l’approvisionnement du<br />
PPCV en intrants et autres services participent de la connexion avec le marché national, sous<br />
régional et international.<br />
IV. Objectif du PPCV<br />
Accompagner les petits producteurs dans :<br />
La gestion des récoltes (Faciliter la collecte, le regroupement, le traitement, la<br />
conservation, la transformation, le conditionnement, le stockage des produits) ;<br />
La production (Amélioration de la productivité, des outils, des techniques et systèmes de<br />
production...etc.) ;<br />
La commercialisation (recherche des débouchés/marchés, conditionnement des produits,<br />
négociation/gestion des relations commerciales…etc.) ;<br />
L’organisation/structuration (mutation des PPCV vers les coopératives : Epargnes et<br />
crédits ; d’utilisation du matériel agricole, de commercialisation, de production…etc.)<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
70
RAPPORT D’ETUDE<br />
V. Implantation des PPCV<br />
Deux PPCV seront crées :<br />
- Un Pole de promotion des Cultures vivrières à Mundemba pour les arrondissements de<br />
Mundemba et de Toko. Ce pole aura pour autre vocation : La promotion des palmeraies<br />
villageoises dans l’arrondissement de Mundemba<br />
- Un PPCV à Nguti qui aura pour autre vocation la promotion de la cacaoculture.<br />
VI. Coût estimatif d’installation et de fonctionnement d’un<br />
PPCV sur trois années en zone cacaoyère (FCFA)<br />
1. INVESTISSEMENT (aire de séchage, construction des magasins, bâtiment, serre,<br />
etc.) = 44 000 000 FCFA<br />
2. EQUIPEMENT (mobilier de bureau, groupe électrogène, appareils photos, etc.)<br />
= 60 000 000 FCFA<br />
3. PERSONNEL (Cadres, secrétaires, techniciens d’agriculture, etc.)<br />
= 96 120 000 FCFA<br />
4. FONCTIONNEMENT (activités et charges diverses, etc.) = 61 200 000 FCFA<br />
261 420 000 FCFA sur 03 ans, environ<br />
400 000 euros.<br />
II.<br />
Pour la biodiversité agricole<br />
I. Deux approches complémentaires<br />
Deux approches peuvent coexister pour la protection de l’environnement dans ce contexte:<br />
le premier est de mettre face à face le système agro forestier et l’écosystème naturel. De ce point<br />
de vue, les objectifs environnementaux seront de produire plus sur une petite surface en même<br />
temps qu’on tolèrerait la pollution, l’érosion, la perte de fertilité... dans des proportions<br />
acceptables. La seconde approche est de considérer les systèmes <strong>agraire</strong>s comme écosystème,<br />
offrant des services et essayant de maximiser la diversité et la fonctionnalité des services. En deux<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
71
RAPPORT D’ETUDE<br />
mots cela veut dire une agriculture multifonctionnelle. Dans le contexte camerounais certaines<br />
spéculations sont plus adaptées que d’autres à ces deux approches ci-dessus décrites.<br />
La cacaoculture et la caféiculture ont joué, et continuent de jouer un rôle important dans la<br />
dynamique de la transformation du paysage de la forêts tropicale et du paysage <strong>agraire</strong> (Ruf,<br />
2007, Mpoumou, 2010, Tscharntke & al., 2011). Ces cultures de rente peuvent cependant être<br />
pratiquées dans des systèmes agro forestiers multifonctionnels, par exemple sous les hauts arbres<br />
fournissant de l’ombrage au cacaoyer et au caféier et d’autres arbres à valeur économique tels les<br />
arbres fruitiers, bois d’œuvre et autres. Au cours des 15 dernières années ce système de culture a<br />
suscité un intérêt croissant pour son présumé possibilité de fournir, de préserver et d’offrir<br />
d’autres services aux éco systèmes telles la séquestration du carbone, la conservation de la<br />
biodiversité, l’enrichissement du sol, la préservation de la qualité de l’air et de l’eau. (Jose, 2009)<br />
D’autre part, les cultures vivrières annuelles et les monocultures tel le palmier à huile, ne sont<br />
pas écologiquement durables, soit en termes de consommation d’espace ou d’entretien de<br />
l’écosystème à l’exemple de la conservation du carbone. Par exemple, le brûlis pour la production<br />
vivrière peut causer des dommages considérables sur l’éco système lorsqu’il manque de terres face<br />
à la pression démographique, tandis que les grandes plantations du palmier à huile peuvent<br />
constituer un obstacle contre la propagation des gênes dans les espaces forestiers.<br />
II.<br />
Grandir sans grossir<br />
Les actions en faveur de l’environnent ne peuvent être privilégiées au détriment de l’Homme.<br />
Les peuples ont leur rationalité et s’adaptent à leur environnement. Dans certains cas les aspects<br />
économiques dominent sur les questions environnementales, ceci a été étudié et théorisé au fil<br />
des années.<br />
La question fondamentale est de savoir comment les bonnes pratiques environnementales<br />
peuvent être bénéfiques aux peuples, et culturellement adaptées car l’économie n’est pas la seule<br />
rationalité qui détermine leur décisions.<br />
Un regard sur la chaîne de valeur du cacao est révélateur. Sur le marché international, le<br />
kilogramme de cacao grade I est vendu à environ 1400 F CFA FOB en août 2012. Pendant ce<br />
temps les producteurs du Sud-ouest Cameroun vendaient le même kg à peine à 900 F CFA aux<br />
acheteurs locaux, sans différenciation de grades. Sur les 9OO F CFA, le producteur doit prélever<br />
de l’argent pour payer les crédits d’intrants agricoles contractés quelques mois plus tôt à des taux<br />
d’intérêts exorbitants (les paysans parlent de 100%).<br />
Dans ces conditions, rien n’incite le producteur mettre un accent sur la qualité du cacao<br />
produit et ils se contentent d’agrandir leurs exploitations. Mais c’est une stratégie qui rapporte<br />
peu. De plus la récolte du cacao est faite en saison des pluies dans l’une des zones les plus<br />
pluvieuses du monde. Le séchage des fèves du cacao se fait par le feu à travers des fours. La<br />
plupart de ces fours sont en piteux état et le cacao prend de la fumée. En plus, n’ayant pas de<br />
magasins de stockage, les paysans ne résistent pas face à la pression des acheteurs, car ne pouvant<br />
garder le cacao plus longtemps dès lors qu’il manque de magasins.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
72
RAPPORT D’ETUDE<br />
La chaîne de valeur est largement en faveur des acheteurs, et les producteurs n’ont aucun<br />
moyen pour les contourner. Et dès lors que la qualité du cacao est mauvaise, tout acteur perd de<br />
l’argent. Heureusement que l’agro forêt cacaoyère comporte des arbres à valeur économique<br />
( economic tree dans le jargon local), qui fournissent les produits forestiers non ligneux à valeur<br />
marchande indéniable au point de donner par moment plus d’argent que le cacao.<br />
Le tableau ci-dessous donne un exemple des actions qui peuvent faire augmenter le niveau de<br />
production et de recettes aux producteurs tout en réduisant leurs dépenses, sans les obliger à<br />
agrandir leurs exploitations ou épuiser l’environnement. Il peut tout aussi profiter à<br />
l’environnement dès lors que l’utilisation des produits chimique sera réduite.<br />
Dans le deuxième tableau des mesures nécessaires sont classées en deux catégories : appui<br />
technique et investissement. Tandis que l’appui technique vise les producteurs isolément pris et<br />
s’oriente vers l’amélioration des pratiques culturales et post récoltes, des lourds investissements<br />
pourront être bénéfiques à l’ensemble des producteurs simultanément. Ces investissements<br />
communautaires concernent essentiellement la commercialisation, et de manière spécifique le<br />
stockage, la conservation, la logistique, etc. De petits investissements pour la fermentation et<br />
autres équipements de séchage, le matériel végétal, peuvent être fournis aux producteurs<br />
individuellement.<br />
Table 2 : Cheminement pour l‘accroissement de la production du cacao et la<br />
commercialisation dans le Sud ouest du Cameroun (A T A : appui technique)<br />
Qu’est ce qui est possible? Comment? De quelle manière ? Pourquoi?<br />
Augmentation de la qualité Sélection des cabosses,<br />
Bonne fermentation<br />
Bonne pratiques de Séchage<br />
Appui technique<br />
Investissement + AT.<br />
Investissement + A T<br />
Augmentation du<br />
prix<br />
Augmentation de la qualité Matériel végétal performante<br />
Bonne gestion des maladies<br />
Investissement<br />
Appui technique<br />
Augmentation du<br />
volume<br />
Réduction des dépenses<br />
(produits phyto)<br />
Lutte intégrée Appui technique Augmentation de la<br />
marge<br />
Jouer sur la concurrence Stockage et conservation Investissement Augmentation du<br />
prix<br />
Eviter les coxeurx Export par eux-mêmes Investissement Augmentation de la<br />
marge bénéficiaire<br />
Gagner un surplus Certification Investissement + AT. Augmentation du<br />
prix<br />
Valeur ajoutée Transformation locale Investissement + AT Augmentation du<br />
prix<br />
II. Ce qu’on peut faire<br />
Dans la plupart des projets de développement, les ONG sont à la fois responsables de<br />
l’investissement et de l’assistance technique. Par le passé on demandait la contribution<br />
personnelle des paysans. De plus en plus les établissements de la micro finance s’investissent dans<br />
ces projets en apportant leur appui techniques aux producteurs dans la gestion de leurs revenus<br />
afin de payer leurs dettes. Lorsqu’un projet s’oriente vers la commercialisation, des<br />
cofinancements sont possibles par des subventions ou des crédits aux coopératives ou aux<br />
associations des producteurs.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
73
RAPPORT D’ETUDE<br />
Pour aux actions concrètes, nos propositions seront de répartir l’assistance technique, la<br />
commercialisation et la gestion entre des acteurs différents mais de manière coordonnée.<br />
- Une ONG local qui fournirait gratuitement aux paysans des outils subventionnés tels les<br />
séchoirs, les bacs de fermentation, le matériel végétal …afin de booster la production et<br />
améliorer la qualité du cacao ;<br />
- Un entrepreneur social qui a suffisamment des moyens pour construire des magasins de<br />
stockage, et fournit la logistique pour la commercialisation. Son rôle sera de s’assurer de<br />
la durabilité économique du processus ;<br />
- Un autre acteur serait une ONG travaillant directement sur le terrain et qui s’appuierait<br />
sur les méthodes traditionnelles pour accompagner les producteurs. Cette ONG les<br />
aiderait à faire le diagnostic des problèmes et proposer des solutions adéquates, les<br />
aiderait ensuite à monter des projets financés sur les fonds propres des paysans ou pour<br />
demander des appuis extérieurs.<br />
III.<br />
Au-delà de la rationalité économique<br />
On pourra nous critiquer de ce que nos propositions ci-dessus se sont surtout focalisées sur<br />
les aspects économiques et qu’elles tendent à marginaliser ou à minimiser les aspects<br />
environnementaux, particulièrement ceux relatifs à l’utilisation des terres (expansion des<br />
exploitations agricoles). Lorsqu’on gagne assez d’argent sur un petit espace, on a assez de<br />
moyens pour acquérir d’autres terres et les mettre en valeur. A vrai dire, même avec les<br />
meilleures pratiques environnementales on ne peut pas satisfaire à la fois ses intérêts et<br />
l’aspiration des singes à vivre dans une forêt intacte.<br />
Sur le terrain il est possible de trouver des alternatives à ces défis. Le système traditionnel de<br />
gestion foncière par exemple, peut provoquer des incertitudes de propriété sur les vielles<br />
cacaoyères abandonnées qui ont besoin de régénération. Pour éviter des conflits entres membres<br />
de la communauté, certains paysans préfèrent aller chercher de nouvelles terres plus loin pour<br />
mettre en valeur. Les paysan disent eux- mêmes que ce n’est pas la bonne solution au problème<br />
du fait que l’éloignement de ces nouvelles exploitations augmente les charges tant à la création<br />
qu’à l’entretien et l’exploitation. Les aider à trouver des solutions à ces problèmes serait une<br />
direction à suivre.<br />
Il n’y a pas de « bons primitifs ». Tout peuple aspire à la modernité. Ils ne sont pas naïfs et<br />
savent où se trouvent leurs intérêts, et certains ont une vision à plus long terme que les<br />
compagnies qui cherchent des profits immédiats. Si les initiatives sont prises dans cette logique<br />
des peuples alors la sensibilisation sur les questions environnementales peut trouver de<br />
nombreuse oreilles attentives et des supporters.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
74
RAPPORT D’ETUDE<br />
PARTIE III :<br />
LES INSOLITES DU SYSTEME<br />
AGRAIRE<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
75
RAPPORT D’ETUDE<br />
Les insolites du système <strong>agraire</strong> dans les arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti<br />
Les sachets vides de whisky recyclés à la pépinière. Qui aurait imaginé un tel service pour ce tord boyau<br />
Pour aller de Nguti à Ntale (24 km), il faut payer 2.500 Fcfa<br />
et voyager dans ces conditions<br />
Dire que cette route devait être construite depuis 2010.<br />
Ah quand la corruption nous tiens !<br />
Fermentation du cacao ! Les pires méthodes pour une qualité médiocre<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
76
RAPPORT D’ETUDE<br />
Les insolites du système <strong>agraire</strong> dans les arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (suite)<br />
Protéger son palmier à tout prix et de la pire des manières<br />
Séchage ou grillage du cacao! Rien de mieux pour<br />
un cacao de médiocre qualité<br />
Homme et femmes rentrant du champ. Elles<br />
portent, ils trinquent<br />
Une palmeraie sous couvert végétale, Incroyable!<br />
A Thalés, la banque du village était<br />
fermée lors de notre passage<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
77
RAPPORT D’ETUDE<br />
Références<br />
Bikié H., Ndoye O. & Sunderlin W. D., 2000. L'impact De La Crise Économique Sur Les<br />
<strong>Système</strong>s Agricoles Et Le Changement Du Couvert Forestier Dans La Zone Forestière Humide Du Cameroun.<br />
Bogor, Center for International Forestry Research.<br />
Bobo K. S., Waltert M., Fermont H., Njokagbor J. & Mühlenberg M., 2006a. From<br />
Forests to Farmlands: Butterfly Diversity and Habitat Associations Along a Gradient of Forest<br />
Conversion in Southwestern Cameroon. Journal of Insect Conservation, 10, 29-42.<br />
Bobo K. S., Waltert M., Sainge N. M., Njokagbor J., Fermont H. & Mühlenberg M.,<br />
2006b. From Forests to Farmlands: Species Richness Patterns of Trees and Understory Plants<br />
Along a Gradient of Forest Conversion in Southwestern Cameroon. Biodiversity and Conservation,<br />
15, 4097-4117.<br />
Clough Y., Faust H. & Tscharntke T., 2009. Cacao Boom and Bust: Sustainability of<br />
Agroforests and Opportunities for Biodiversity Conservation. Conservation Letters, 2, 197-205.<br />
Conservation International, n.d. Guinean Forests of West Africa - Human Impacts [en ligne].<br />
Disponible sur Internet,<br />
[http://www.conservation.org/where/priority_areas/hotspots/africa/Guinean-Forests-of-West-<br />
Africa/Pages/impacts.aspx], [consulté le 12/07/2012].<br />
Coulter J. & Etoa Abena P., 2010. Study of Value Chain Finance for Coffee and Cocoa in Cameroon.<br />
Geneva, United Nations Conference on Trade and Development. 61 p.<br />
<strong>Greenpeace</strong> International, 2012. La Dernière Frontière De L'huile De Palme. Comment<br />
L'expansion <strong>Des</strong> Plantations Industrielles Menace Les Forêts Tropicales En Afrique. Amsterdam,<br />
Grennpeace International. 28 p.<br />
Guiffo S. & Schwartz B., 2012. Le Treizième Travail D'herakles? Étude Sur La Concession Foncière<br />
De Sgsoc Dans Le Sud-Ouest Du Cameroun. Yaoundé, Centre pour l'Environnement et le<br />
Développement.<br />
Haman Bako S., Guede Gbozao D., Feliciano L. L., Eboko T., Allo Allo A., Songwe<br />
D., Chuyong D., Anye Ndeh D., Chi N. F. & Bamu E., 2011. Environmental and Social Impact<br />
Assessment Report Prepared for Sg Sustainable Oils Cameroon. Yaoundé, H&B Consulting. 320 p.<br />
Hoyle D. & Levang P., 2012. Le Développement Du Palmier À Huile Au Cameroun. Bogor,<br />
Centre for International Forestry Research. 16 p.<br />
Hydromine, n.d. Cameroon Projects [en ligne]. Disponible sur Internet,<br />
[http://www.hydromine.net/projects-cameroon.htm], [consulté le 11/10/2012].<br />
Jose S., 2009. Agroforestry for Ecosystem Services and Environmental Benefits: An<br />
Overview. Agroforestry Systems (76), 1-10.<br />
Koh L. P., 2008. Can Oil Palm Plantations Be Made More Hospitable for Forest Butterflies<br />
and Birds? Journal of Applied Ecology, 45, 1002-1009.<br />
Koh L. P. & Wilcove D. S., 2008. Is Oil Palm Agriculture Really <strong>Des</strong>troying Tropical<br />
Biodversity? Conservation Letters, XX, 1-5.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
78
RAPPORT D’ETUDE<br />
Le Monde Diplomatique, 2008. Emeutes De La Faim [en ligne]. Disponible sur Internet,<br />
[http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2008-04-14-Emeutes-de-la-faim], [consulté le<br />
11/10/2012].<br />
Malleson R. C., 2000. Forest Livelihoods in Southwest Province, Cameroon: An Evaluation of the Korup<br />
Experience. Ph.D., University College London, London, 310 p.<br />
Mathey E. & Pascaud C., 2010. Comment Améliorer La Compétitivité <strong>Des</strong> Exploitations Agricoles<br />
Face À L'avancée Du Front Pionnier - Mise En Oeuvre Du Diagnostic Agraire Dans L'arrondissement De<br />
Konye (Cameroun), Montpellier SupAgro, Montpellier, 164 p.<br />
MINADER, 2011. Annual Report of Activities, 2010 Financial Year. Mundemba, Ministry of<br />
Agriculture and Rural Development - Regional Delegation for South West.<br />
Mpoumou M., 2010. Fronts Pionniers Et Structuration De L'espace Dans Le Cameroun<br />
Méridional: De Nouveaux Territoires En Mutation Rapide. Les Cahiers d'Outre-Mer, 249, 73-91.<br />
Mvondo Awono J.-P., Assoumou Ebo E., Wassouni A. & Ambassa Mve J., 2009.<br />
Evaluation Intégrée <strong>Des</strong> Politiques Liées Au Commerce Et Les Implications En Termes De Diversité Biologique<br />
Dans Le Secteur Agricole En République Du Cameroun. Le Secteur Cacao. Genève, United Nations<br />
Environment Programme. 127 p.<br />
Naudé P.-F., 2009. Le Plan Riz Soufflé Par La Spéculation. Jeune Afrique (Paris).<br />
Njonga B., 2010. Recueil De Fiches Techniques Pour L'entepreneur Rural. Vol. 1. La Voix du<br />
Paysan, Yaoundé.<br />
Oates J. F., Bergle R. A. & Linder J. M., 2004. Africa's Gulf of Guinea Forests: Biodiversity<br />
Patterns and Conservation Priorities. Washington DC, Conservation International. 95 p.<br />
Oke D. O. & Odebiyi K. A., 2007. Traditional Cocoa-Based Agroforestry and Forest<br />
Species Conservation in Ondo State, Nigeria. Agriculture, Ecosystems and Environment, 122, 305-311.<br />
Perfecto I. & Vandermeer J., 2008. Biodiversity Conservation in Tropical Agroecosystems,<br />
a New Conservation Paradigm. Annals of the New York Academy of Sciences (1134), 173-200.<br />
ProPSFE, 2010. Geobiep Web Atlas - Base D'information Et D'evaluation Permanente [en ligne].<br />
Programme d'Appui au Programme Sectoriel Forêt-Environnement. Disponible sur Internet,<br />
[www.data.cameroun-foret.com/geobiep/atlas.php], [consulté le 13/07/2012].<br />
Ruf F., 2007. The Cocoa Sector. Expansion, or Green and Double Green Revolutions. London,<br />
Overseas Development Institute. 3 p.<br />
Tchigio I., 2007. Opportunities for Community-Based Wildlife Management: A Case Study from the<br />
Korup Region, Cameroon. Cuvillier Verlag, Göttingen, 190 p.<br />
Thies C., Rosoman G., Cotter J. & Frignet J., 2011. Les Paysages De Forêts Intactes - Pourquoi<br />
Il Est Essentiel De Préserver Ces Forêts De Toute Exploitation Industrielle. Etude De Cas: Le Bassin Du<br />
Congo. Amsterdam, <strong>Greenpeace</strong> International. 16 p.<br />
Tieguhong J. C. & Ndoye O., 2006. Transforming Subsistence Products to Propellers of<br />
Sustainable Rural Development: Non-Timber Forest Products (Ntfps) Production and Trade in<br />
Cameroon. In: Africa - Escaping the Primary Commodities Dilemma. African Development<br />
Perspectives Yearbook. Lit Verlag, Berlin, Germany, pp. 107-138.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
79
RAPPORT D’ETUDE<br />
Tscharntke T., Clough Y., Bhagwat S. A., Buchori D., Faust H., Hertel D., Hölscher<br />
D., Juhrbandt J., Kessler M., Perfecto I., Scherber C., Schroth G., Veldkamp E. & Wanger<br />
T. C., 2011. Multifunctional Shade-Tree Management in Tropical Agroforestry Landscpaes - a<br />
Review. Journal of Applied Ecology.<br />
Turner E. C., Snaddon J. L., Fayle T. M. & Foster W. A., 2008. Oil Palm Research in<br />
Context: Identifying Th Need for Biodiversity Assessment. PLoS ONE, 3 (2).<br />
Union Africaine, 2003. Protocole À La Charte Africaine <strong>Des</strong> Droits De L’homme Et <strong>Des</strong> Peuples<br />
Relatif Aux Droits <strong>Des</strong> Femmes. Maputo.<br />
<strong>Système</strong> <strong>agraire</strong> et sécurité <strong>alimentaire</strong> des arrondissements de Toko, Mundemba et Nguti (Région du Sud-Ouest, Cameroun)<br />
80