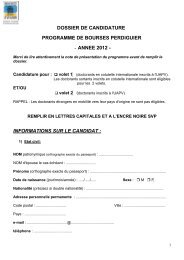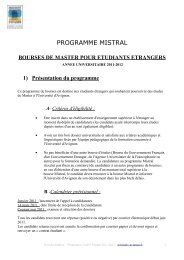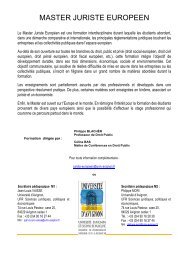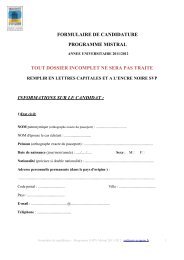Réunion du 23 mars 2012 avec Yoann BOGET - Université d ...
Réunion du 23 mars 2012 avec Yoann BOGET - Université d ...
Réunion du 23 mars 2012 avec Yoann BOGET - Université d ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Séminaire ouvert <strong>du</strong> PIMS<br />
<strong>23</strong> <strong>mars</strong> <strong>2012</strong><br />
9h-12h<br />
<strong>Yoann</strong> Boget<br />
Présentation de sa recherche doctorale sur la figure <strong>du</strong> travailleur pauvre assisté<br />
en France et en Allemagne<br />
Présents :<br />
• Conférencier invité : <strong>Yoann</strong> Boget, ATER, doctorant à l'EHESS sous la direction de Serge<br />
Paugam<br />
• Acteurs dirigeants dans le secteur de l'insertion :<br />
• Yvan Ferrier, DGA <strong>du</strong> pôle solidarités au CG <strong>du</strong> Gard<br />
• Isabelle Potel, sous-directrice à la CAF <strong>du</strong> Vaucluse<br />
• Frédéric Rostaing, Directeur de l'UT Grand Avignon au CG de Vaucluse<br />
• Membres <strong>du</strong> groupe PIMS :<br />
• Jean-Robert Alcaras, Maître de Conférences en Science Economique<br />
• Christèle Marchand, Ingénieur de Recherche en Science Politique<br />
• Guillaume Marrel, Maître de Conférences en Science Politique<br />
• Magali Nonjon, Maître de Conférences en Science Politique<br />
– Delphine Costa, Directrice <strong>du</strong> LBNC : Accueil et message de bienvenue<br />
– Magali Nonjon : Intro<strong>du</strong>ction et présentation <strong>du</strong> séminaire et des travaux <strong>du</strong> PIMS<br />
1 - Intervention de <strong>Yoann</strong> Boget :<br />
– remerciements<br />
– son approche est complémentaire des travaux <strong>du</strong> PIMS : la managérialisation <strong>du</strong> social est la<br />
boite noire de sa recherche : entre approche législative et politique (top) et le point de vue<br />
des allocataires (bottom).<br />
– Plan de la présentation :<br />
1. objet<br />
2. construction théorique et méthodologique<br />
3. résultats issus <strong>du</strong> terrain en France et Allemagne<br />
1) Objet de recherche<br />
Point de départ :<br />
– théories des Etats-providence :<br />
– Selon Espig Andersen , les Etats providence de type bismarckien sont « gelés »,<br />
1 Sur 6
incapables de se réformer réforme (car les cotisations ouvrent des droits qu'il est donc<br />
difficile de supprimer ou de remettre en cause)<br />
– Mais dans les faits, on assiste à une réforme en douceur de ces Etats, grâce à un<br />
processus de <strong>du</strong>alisation des systèmes bismarckiens<br />
– théorie critique (Bourdieu et Foucault) : les PS néolibérales inculquent aux citoyens des<br />
habitus qui les transforment en « entrepreneurs d'eux-mêmes » et les transforment donc en<br />
sujets autonomes et flexibles : ce seraient donc les politiques néolibérales qui créeraient les<br />
indivi<strong>du</strong>s néolibéraux... Assiste-t-on à un même processus de ce type en France et en<br />
Allemagne ? C'est plus complexe que cela, surtout quand on observe le point de vue et le<br />
vécu des allocataires eux-mêmes. Or, ces théories critiques postulent ce lien, mais il y a peu<br />
de validation empirique sur le vécu des allocataires .<br />
La recherche de YB vise donc à travailler sur les travailleurs pauvres assistés : être au travail tout en<br />
étant pris dans des régulations étatiques => quelles sont leurs expériences subjectives effectives ?<br />
2) Construction théorique et méthodologique<br />
Retour sur les évolutions des systèmes Français et Allemands :<br />
– Ils ne sont pas aussi identiques qu'on le dit souvent ! Et ils pro<strong>du</strong>isent aujourd'hui 2 figures<br />
différentes <strong>du</strong> travailleur pauvre...<br />
– Pourtant, la construction historique des 2 systèmes est similaire : protection assurentielles<br />
bismarckiennes + protection supplémentaires pour les exclus de l'assuranciel depuis les<br />
dernières décennies.<br />
– 1990 : EP similaire (chômage et pauvreté)<br />
– assurance chômage pour l'essentiel<br />
– protection d'assistance sociale (RMI, RSA...)<br />
– dispositions spécifiques type ASS ou aide au chômeur en Allemagne : dernier échelon<br />
destiné à l'extrême pauvreté, une assistance qui complète l'assurance.<br />
– Depuis les années 1990, de plsu en plus de chômeurs vont aller vers ces dispositifs<br />
complémentaires : il s'agit donc d'un transfert de publics contraints de recourir aux<br />
dispositifs assistantiels : forte augmentation :<br />
– plus d'un million d'allocataires <strong>du</strong> RMI, encore plus pour le RSA<br />
– ce public n'était pas prévu par ces modèles sociaux<br />
– cela crée donc une crise de légitimité de ces programmes<br />
– et un retournement dans la conception des politiques sociales (UE, OCEDE, workfare,<br />
contrepartie, activation...)<br />
– les EP bismarkien appliquent ces dispositifs et considérent de plus en plus les aides et<br />
assistances comme des instruments désincitatifs au travail ou des entraves au retour à<br />
l'emploi…<br />
– D'où un glissement des politiques sociales de lutte contre la pauvreté vers des politiques<br />
de l'emploi et de retour à l'emploi.<br />
– Dans ce cadre, on a donc assisté à 2 réformes :<br />
– RSA en France<br />
– Hartz IV en Allemagne : fusion de l'assistance et de l'aide sociale dans un seul<br />
dispositif<br />
Pour cette recherche, YB va utiliser le concept de « gouvernementalité » (Foucault) en le<br />
2 Sur 6
croisant <strong>avec</strong> celui de rationalité des formes de gouvernement (Weber) : les instruments des<br />
politiques sociales sont des instruments de con<strong>du</strong>ite des con<strong>du</strong>ites.<br />
– une gouvernementalité de valeur : identiques en France et Allemagne (même volonté de<br />
créer des incitations au retour des assistés sur le marché <strong>du</strong> travail<br />
– une gouvernementalité instrumentale de moyens : là, on constate des différences entre les 2<br />
pays, notamment dans le dosage entre méthodes d'incitation financière (plutôt en France) et<br />
disciplinaire (plutôt en Allemagne).<br />
3 niveaux d'observation :<br />
• catégories semblables de définition des allocataires en référence à l'emploi : disparition<br />
des références à la pauvreté<br />
• transformation des institutions de prise en charge : Pôle emploi en France, Agences de<br />
l'emploi en Allemagne<br />
• instauration de technique d'incitation à l'emploi : financières (France), obligations,<br />
contractuelles, sanctions (Allemagne).<br />
La différence essentielle entre les 2 pays tient dans le poids relatif de ces différentes techniques :<br />
– d'incitation (homoeconomicus) = plus fortes en France<br />
– disciplinaires (obligation, contrôle, sanction) = plus fortes en Allemagne<br />
Différence sur les montants d'allocation : All>Fr<br />
Différence sur les niveaux de cumuls<br />
Modalité Fr : libérale, peu interventionniste et peu de suivi<br />
Modalité plus paternaliste en All : + généreux mais plus stricte<br />
=> 2 figures de l'allocataire<br />
– Fr : RSA chapeau, salarié + allocation<br />
– All : exerce des activités qui lui sont réservées (≠ emplois) « 1 euro job » : en plus de<br />
l'allocation, 1,25 euros de l'heure travaillée en moyenne, emplois n'ouvrant pas droit à<br />
l'assurance.<br />
Méthode de la recherche : enquête par entretiens qualitatifs :<br />
– 50 en Fr : Belfort (été 2010)<br />
– 40 en All : Iena à la frontière E/W (hiver 2009)<br />
3) Principaux résultats issus <strong>du</strong> terrain en France et Allemagne<br />
Convergences et divergences, points communs et différences entre les vécus subjectifs des<br />
travailleurs pauvres en France et en Allemagne : beaucoup de différences, peu de similitudes .<br />
Convergences :<br />
– valorisation extrême de leur activité (même activité stigmatisée) : activité préférée à<br />
l'inactivité<br />
– le W comme valeur morale réaffirmée : il faut travailler, par de retrait volontaire « ne pas se<br />
laisser aller... »<br />
3 Sur 6
Divergences :<br />
Rapport aux institutions :<br />
– All : place très importante pour les allocataires (conflictuelle ou non), car l'institution<br />
est essentielle comme distributrice des emplois<br />
– Fr : au contraire, les allocataires sont moins en contact direct <strong>avec</strong> les institutions : ils<br />
éprouvent souvent un détachement // à Pôle emploi « qui ne sert à rien », même si<br />
leur relation aux services sociaux départementaux est souvent jugée plus utile et<br />
meilleure.<br />
Statut // emploi :<br />
– All : la majorité des allocataires ne se considèrent pas « en emploi », ils déprécient le<br />
travail qu'ils réalisent : ils se savent sur un marché <strong>du</strong> travail secondaire : activité ≠<br />
travail.<br />
– Fr : au contraire, il y a une survalorisation <strong>du</strong> statut de l'emploi qu'ils occupent,<br />
même s'il est précaire : c'est important de travailler, pour eux...<br />
Statut d'allocataire :<br />
– All : ils se considèrent encore comme « pauvres », malgré l'emploi qu'ils occupent :<br />
ils n'ont pas l'impression de sortir <strong>du</strong> dispositif <strong>avec</strong> ces activités<br />
– Fr : l'aide est perçue comme une simple allocation complémentaire au revenu : ils ne<br />
perçoivent donc pas le poids <strong>du</strong> statut, se sentent moins stigmatisés ; ils perçoivent le<br />
RSA comme une aide comme une autre (APL, autres allocations de la CAF).<br />
Perception de l'activité :<br />
– All : c'est l'activité qui est vécue comme très importante, structurante, permettant une<br />
socialisation primaire<br />
– Fr : c'est le statut qui compte surtout. On met plus en avant l'importance de<br />
l'acquisition d'un statut : « à travers le travail, j'existe » (une forme de logique de<br />
l'honneur, qui tient surtout compte <strong>du</strong> regard des autres sur soi-même).<br />
Efficacité de la mesure :<br />
– Fr : jugée d'autant plus efficace qu'on est peu inséré au marché de l'emploi. Moins on<br />
est inséré, et plus on juge la mesure efficace ! Mieux on est inséré, plus on juge le<br />
RSA comme ayant des effets limités.<br />
– All : les plus éloignés de l'emploi sont aussi les plus satisfaits, mais pour des raisons<br />
≠ .<br />
Au final : grande différence dans le sentiment d'autonomie :<br />
– Fr : on se sent responsable de son insertion sur le marché <strong>du</strong> W : « si je me bouge, je<br />
vais y arriver ».<br />
– All : on est + fataliste : « de toute façon, il n'y a pas de travail ».<br />
Pour conclure :<br />
En France, on peut dégager 3 types d'allocataires <strong>du</strong> RSA :<br />
– ceux qui se vivent comme demandeurs d'emploi perpétuels : petites activités précaires<br />
4 Sur 6
variables depuis longtemps => contrats aidés et insertion. On les retrouve le plus souvent<br />
sur des contrats aidés et des structures de l'IAE.<br />
– les travailleurs pauvres : insérés dans le travail, stables, mais aux revenus trop faibles<br />
(smic, temps partiel...), ils ne s'en sortent pas (ou <strong>du</strong> moins, ils ont ce sentiment).<br />
– en transition : jeunes en reprise de formation (RSA activité) ; ruptures professionnelles,<br />
en reconversion... relativement mieux formés que les autres, mais se vivent en situation<br />
temporaire.<br />
Efficacité <strong>du</strong> RSA comme incitation à la reprise d'activité ?<br />
– Non ! Le RSA ne peut pas être un instrument d'incitation au travail.<br />
– 3 raisons<br />
– le travail est plus qu'un revenu : socialisation, structuration de sens, de statut<br />
social... : ce sont là les raisons profondes et essentielles de la recherche d'emploi. Les<br />
incitations financières sont donc secondaires...<br />
– Le système d'incitation financière est totalement méconnu et incompris par les<br />
allocataires : beaucoup méconnaissent le mécanisme, ceux qui le connaissent ne le<br />
comprennent pas : connaissance pratique, d'expérience = incertitude, insécurité<br />
– Ce système est trop complexe (CAF et CG agissent sur ce dispositif, prime pour<br />
l'emploi, règles <strong>du</strong> cumul) = sentiment que le RSA les déstabilise, augmente leur<br />
précarité = amplifie les variations de revenu : calculé sur base trimestrielle : les actifs<br />
saisonniers sont en décalage... = stratégie : ne pas bouger, éviter les creux = peu<br />
incitatif.<br />
Questions / commentaires :<br />
YF : dans les CG, on a l'impression qu'il y a un fort taux de non recours. Une bonne partie <strong>du</strong> public<br />
ciblé ne vient pas réclamer ses droits au RSA. La complexité <strong>du</strong> dispositif pourrait être la clé de ce<br />
mystère...<br />
FR : le RSA n'a pas trouvé son public : vous ne touchez que ceux qui sont dedans et pas ceux qui<br />
son dehors.<br />
IP : confirme ce constat. Un croisement entre fichier CAF et ceux <strong>du</strong> fisc (84) avait con<strong>du</strong>it à une<br />
estimation de 31000 bénéficiaires potentiels : or, enregistrement de 18000 seulement actuellement,<br />
<strong>avec</strong> en outre un fort turn over de la population. Où sont les 13000 personnes qui pourraient<br />
prétendre au RSA mais qui ne le font pas ? Cela concerne surtout le RSA socle et le RSA activité<br />
(beaucoup moins le RSA chapeau). Ceci est confirmé par des études de la DREES, sachant que cela<br />
change un peu sur le RSA socle (mais pas sur le RSA activité).<br />
YF : au CG30, on est face aux mêmes proportions.<br />
Il faut regarder le marche <strong>du</strong> travail.<br />
Voir statistiques de la Drees au niveau national : augmentation <strong>du</strong> RSA socle (parce que le marché<br />
de l'emploi est au point mort), mais la part prévue entre RSA socle et RSA activité dérive.<br />
Cf étude de chercheurs de Dauphine : échec relatif <strong>du</strong> RSA, en effet.<br />
On aurait même <strong>du</strong> non-recours sur le RSA socle : un certain nombre d'allocataires refusent la<br />
dimension disciplinaire (flicage).<br />
FR : l'All annonce <strong>du</strong> disciplinaire mais ne le mobilise pas, la Fr, c'est l'inverse. Quelle est la<br />
proportion de la mobilisation de l'arsenal ?<br />
5 Sur 6
• All : Rapport social très négatif à ce type de PP d'activation : Hartz = infamie<br />
• Fr : maintien d'une figure plus positive = Vauquier<br />
Fr : le système d'EP est un mélange de beveridgien et bismarckien : articulation entre protection<br />
sociale, assurance sociale et aide sociale sur la norme <strong>du</strong> CDI.<br />
Echec des PP de l'EP dont on rend responsables les indivi<strong>du</strong>s<br />
Système d'aide sociale All : contrôlé par l'Etat mis en oeuvre par la commune/<br />
Fr : complexité de la décentralisation : l'Etat oriente moins les con<strong>du</strong>ites par les textes que par les<br />
finances : responsabiliser financièrement les CT (2004).<br />
Gouvernance par les finances !<br />
Réponses (YB) :<br />
– oui des trajectoires de systèmes divergentes<br />
– mais dans les 1990 : crise conjoncturelle<br />
– non-recours : 2ème boite noire de mon travail. Mon hypothèse : ce sont les travailleurs<br />
pauvres = pas d'habitude au recours : qui ne se vivent pas comme ayant-droits potentiels.<br />
YF : sur le non-recours aux droits = la complexité bureaucratique est au service de la contrainte<br />
budgétaire !!!<br />
Dimension politique : L. Wauquiez a défen<strong>du</strong> récemment une vision proche des « 1 euro job » à<br />
l'allemande... Mais dans notre système (décentralisé) au final, c’est l'élu qui prend la sanction =><br />
risque politique. D'où l'absence relative de sanctions.<br />
On ne délègue pas au travailleur social car il est trop proche : on monte des systèmes de contrôle...<br />
Jusqu'où va-ton dans la poche de pauvreté (8M en Fr) ?<br />
Interrogation des responsables : modalités techniques, question éthique et choix politiques<br />
YB : sur la complexité qui freinerait le recours... : à la CAF démarche anonymes et simples, mais<br />
plus intrusives dans les centres d'action sociaux<br />
Sur l'organisation : gestion éclatée <strong>du</strong> RSA<br />
– CAF = finance<br />
– Pôle emploi = censé gérer le suivi d'1/3 des bénéficiaires<br />
– Suivi social et pilotage par les CG<br />
A Belfort : peu de contact<br />
IP : le RSA activité est le moins complexe, le moins contrôlé, le plus facilement instruit et pourtant,<br />
on ne fait pas le plein : il y a malgré cela <strong>du</strong> non-recours.<br />
YB : trop de lien à l'aide sociale . Question de la stigmatisation<br />
FR : sur l'arsenal disciplinaire, pas de statistiques... Discussion sur la dimension <strong>du</strong> contrôle :<br />
finalement très fort et croissant en France : effet de structure éclatée en France ?<br />
IP : à la CAF, on progresse dans la montée en puissance des dispositifs de contrôle des droits des<br />
usagers. On met en œuvre <strong>du</strong> datamining et <strong>du</strong> scoring pour mieux gérer ce type de contrôle.<br />
Présence forte des instruments (notamment numériques) dans cette perspective...<br />
6 Sur 6