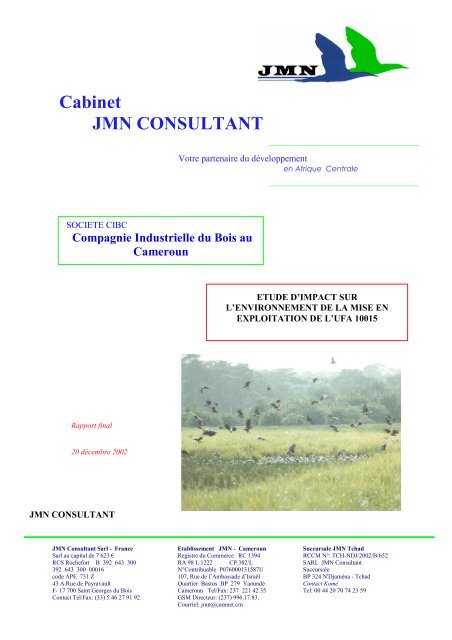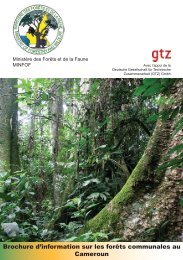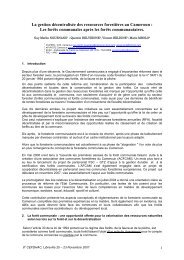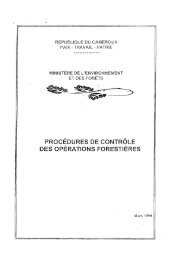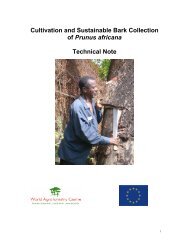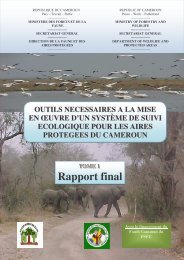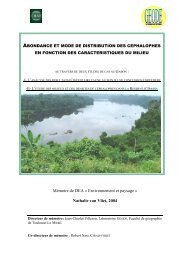Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...
Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...
Cabinet JMN CONSULTANT - Impact monitoring of Forest ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Cabinet</strong><br />
<strong>JMN</strong> <strong>CONSULTANT</strong><br />
Votre partenaire du développement<br />
en Afrique Centrale<br />
SOCIETE CIBC<br />
Compagnie Industrielle du Bois au<br />
Cameroun<br />
ETUDE D’IMPACT SUR<br />
L’ENVIRONNEMENT DE LA MISE EN<br />
EXPLOITATION DE L’UFA 10015<br />
Rapport final<br />
20 décembre 2002<br />
<strong>JMN</strong> <strong>CONSULTANT</strong><br />
<strong>JMN</strong> Consultant Sarl - France<br />
Sarl au capital de 7 623 €<br />
RCS Rochefort B 392 643 300<br />
392 643 300 00016<br />
code APE 731 Z<br />
43 A Rue de Puyravault<br />
F- 17 700 Saint Georges du Bois<br />
Contact Tel/Fax: (33) 5 46 27 91 92<br />
Etablissement <strong>JMN</strong> - Cameroun<br />
Registre du Commerce RC 1394<br />
RA 98 L 1222 CP 382/L<br />
N°Contribuable P076000131587U<br />
107, Rue de l’Ambassade d’Israël<br />
Quartier Bastos BP 279 Yaoundé<br />
Cameroun Tel/Fax: 237 221 42 35<br />
GSM Directeur: (237) 996.17.83.<br />
Courriel: jmn@camnet.cm<br />
Succursale <strong>JMN</strong> Tchad<br />
RCCM N°: TCH-NDJ/2002/B/652<br />
SARL <strong>JMN</strong> Consultant<br />
Succursale<br />
BP 324 N'Djaména - Tchad<br />
Contact Komé<br />
Tel: 00 44 20 70 74 23 59
1 PREAMBULE<br />
L’étude d’impact environnemental commandée par la société CIBC s’inscrit dans le cadre des<br />
obligations du cahier des charges des sociétés d’exploitation forestière, imposées par la Loi<br />
forestière camerounaise, et applicables à toutes les concessions attribuées sous appel d’<strong>of</strong>fre<br />
situées à proximité d’une aire protégée majeure.<br />
A ce titre, il n’est plus possible pour l’exploitant de venir prélever en forêt le bois dont il a<br />
besoin pour approvisionner son marché puis de laisser ensuite la forêt se reconstituer sans se<br />
préoccuper des effets que cette exploitation aura pu avoir sur l’environnement.<br />
Il s’agit au contraire d’évaluer dès avant le lancement des travaux routiers et des travaux de<br />
coupe, ce que ces investissements auront comme conséquence sur la forêt elle même, sur la<br />
faune, sur la flore mais aussi, et peut être surtout, sur les populations riveraines qui vivent<br />
habituellement de cette forêt.<br />
Le cabinet <strong>JMN</strong> Consultant a été sollicité par la société CIBC afin de réaliser l’étude d’impact<br />
environnementale de l’UFA 10015.<br />
Dans ce cas précis, la proximité de l’UFA avec la réserve de BOUMBA-BEK/NKI, impose<br />
donc de réaliser une étude d’impact environnementale, afin de prendre les dispositions pour<br />
ne pas mettre en danger cet espace naturel jusqu’alors préservé.<br />
Spécialisé à la fois sur les questions de développement rural, de développement agricole et<br />
d’environnement, le cabinet <strong>JMN</strong> propose dans ce document une approche globale, basée sur<br />
l’analyse des effets prévisibles de l’exploitation, de la construction des infrastructures<br />
routières, d’installation d’un bac sur la Boumba, de l’augmentation des trafics de véhicules et<br />
de personnes, de l’augmentation des populations résidentes en zone forestière, et de<br />
l’ouverture de ce fait de nouveaux marchés locaux, notamment en viandes .<br />
L’EIE est donc conçue à la fois comme une analyse des impacts sur les ressources naturelles<br />
en tant que tel, mais aussi comme une analyse des impacts sur les populations autochtones et<br />
allogènes, devant prévoir de manière dynamique quelles seront les évolutions de<br />
comportements qui seront induites par le changement provoqué par l’exploitation forestière.<br />
De manière concrète, l’EIE a pour objet, au delà de l’analyse des effets, de proposer des<br />
actions visant à atténuer les impacts négatifs sur la faune et la flore d’une part, et sur le mode<br />
de vie des populations d’autre part.<br />
En réalité, l’EIE devient l’occasion de proposer un véritable programme d’interventions<br />
visant à transformer ce qui apparaît de prime abord comme un danger potentiel pour le milieu,<br />
en une dynamique positive de développement intégrant les moyens mis en œuvre par le pilote<br />
industriel, et permettant une évolution harmonieuse conciliant à la fois les impératifs de<br />
conservation avec les nécessités économiques et les besoins légitimes des populations<br />
riveraines autochtones et allogènes.<br />
La société CIBC, attributaire de l’UFA 10015, ne saurait concevoir son installation pour une<br />
courte durée et pratiquer une exploitation minière comme cela se pratiquait encore<br />
communément il y a peu au Cameroun.<br />
Avec l’application de la Loi forestière, il s’agit au contraire de s’installer dans la durée, de<br />
mettre en place un plan d’aménagement, de veiller à prendre en compte l’ensemble des<br />
facteurs inhérents au milieu naturel et au milieu humain, afin de faire en sorte que<br />
l’exploitation forestière devienne un générateur de richesses pour les hommes, certes, mais<br />
sans que cela se fasse au détriment de la faune et de la flore, particulièrement fragile,<br />
notamment dans cette région.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 2
1.1 REMERCIEMENTS<br />
L’équipe de consultant remercie l’ensemble du personnel du groupe VICWOOD THANRY et<br />
de ses filiales pour le soutien qui leur a été apporté, tant par la direction générale, la cellule<br />
aménagement et les responsables du site.<br />
Les consultants remercient tout particulièrement à ce propos le chef de site de Lokomo et ses<br />
collaborateurs pour l’appui constant qu’ils ont bien voulu leur accorder pour la réalisation de<br />
cette étude sur le terrain et pour l’accueil qui leur a été fait dans les locaux de l’usine.<br />
Les consultants remercient également chaleureusement les responsables de l’UTO Sud-Est, de<br />
la Délégation Départementale du MINEF, du WWF et de la GTZ Pr<strong>of</strong>ornat pour le temps et<br />
l’énergie qu’ils ont bien voulu leur consacrer tant à Yokadouma que sur le terrain et pour les<br />
informations qui leur ont été fournies.<br />
Enfin, les consultants sont particulièrement reconnaissants aux autorités administratives,<br />
électives et traditionnelles, mais aussi aux populations locales, du temps et de la patience<br />
qu’ils ont bien voulu leur accorder pour que cette étude reflète les points de vue des<br />
différentes parties prenantes dans le projet d’exploitation de l’UFA 10015.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 3
2 SOMMAIRE<br />
1 PREAMBULE 2<br />
1.1 REMERCIEMENTS 3<br />
2 SOMMAIRE 4<br />
LISTE DES FIGURES 8<br />
LISTE DES PHOTOS 8<br />
3 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 9<br />
4 MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS - SYNTHESE 10<br />
5 MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT - SYNTHESE 16<br />
6 INTRODUCTION 19<br />
6.1 L’OBJECTIF DE L’EIE 19<br />
6.2 RESUME DE LA METHODOLOGIE 20<br />
6.2.1 L’APPROCHE DE TRAVAIL 20<br />
6.2.2 LA CONSULTATION DU PUBLIC 21<br />
6.2.3 L’ANALYSE DES DONNEES 21<br />
6.3 LES DIFFICULTES RENCONTREES 21<br />
7 CONTEXTE DE L’ETUDE 22<br />
7.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOMORPHOLOGIQUE 22<br />
7.1.1 LOCALISATION DE L’UFA 10015 22<br />
7.1.2 CLIMATOLOGIE 23<br />
7.1.2.1 Pluviométrie 23<br />
7.1.2.2 Température 23<br />
7.1.2.3 Humidité relative 23<br />
7.1.3 TOPOGRAPHIE 24<br />
7.1.4 HYDROGRAPHIE 25<br />
7.1.5 GEOLOGIE 26<br />
7.1.6 PEDOLOGIE 27<br />
7.1.7 LE RESEAU ROUTIER 28<br />
7.2 LE MILIEU BIOLOGIQUE 29<br />
7.2.1 LA FLORE 29<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 4
7.2.1.1 La forêt semi-décidue à Sterculiaceae et Ulmaceae 29<br />
7.2.1.2 La forêt semi-décidue à Sterculiaceae et Ulmaceae avec éléments de la forêt du Dja 30<br />
7.2.2 LA FAUNE 31<br />
7.2.2.1 La faune mammalienne 32<br />
7.2.2.2 L’avifaune 33<br />
7.3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 33<br />
7.3.1 DEMOGRAPHIE ET REPARTITION 33<br />
7.3.2 LES ETABLISSEMENTS HUMAINS ET L’HABITAT 34<br />
7.3.2.1 Les établissements humains 34<br />
7.3.2.2 L’habitat 36<br />
7.3.2.3 Origines et peuplement 37<br />
7.3.2.4 Structure et organisation sociale 38<br />
7.3.2.5 Religions et croyances. 39<br />
7.3.3 INSTITUTIONS ET PARTIES PRENANTES DANS LA ZONE D’ETUDE 39<br />
7.3.3.1 L’administration publique 39<br />
7.3.3.2 L’Unité Technique Opérationnelle du Sud Est 39<br />
7.3.3.3 L’Association pour l’Autopromotion des Peuples de l’Est Cameroun (AAPEC). 41<br />
7.3.4 LES INFRASTRUCTURES SOCIO-ECONOMIQUES 42<br />
7.3.4.1 L’éducation 42<br />
7.3.4.2 La santé 42<br />
7.3.4.3 La communication 44<br />
7.3.5 L’ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 44<br />
7.3.5.1 Les activités agricoles 44<br />
7.3.5.2 La chasse 45<br />
7.3.5.3 L'exploitation des ressources naturelles secondaires : importance de l’UFA 10015 pour les populations<br />
50<br />
7.3.6 COMMERCE ET TRANSPORTS 52<br />
7.3.7 LES ORGANISATIONS ET LES STRUCTURES COMMUNAUTAIRES 53<br />
7.3.7.1 Les COVAREF 53<br />
7.3.7.2 Les problèmes identifiés au sein des COVAREF 54<br />
7.3.7.3 Les associations villageoises 54<br />
8 CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL 56<br />
8.1 CADRE LEGISLATIF 56<br />
8.2 LES CONVENTIONS INTERNATIONALES ET REGIONALES 57<br />
8.3 LEGISLATION ET REGLEMENTATION NATIONALE 57<br />
8.4 LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES ET REGLEMENTAIRES LOCALES 58<br />
8.5 LES DIRECTIVES DES BAILLEURS DE FONDS INTERNATIONAUX EN MATIERE D’EIE 59<br />
8.6 LA GESTION COUTUMIERE DE L’ESPACE : PROPRIETE TRADITIONNELLE ET DROIT MODERNE 59<br />
9 PRESENTATION SUCCINCTE DE L’ENTREPRISE CIBC 62<br />
9.1 LE PERSONNEL 62<br />
9.2 LES EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS 62<br />
9.3 LE SITE DE LOKOMO 63<br />
9.4 L’EDUCATION. 64<br />
9.5 LA SANTE 64<br />
9.6 L’ECONOMIE 65<br />
9.7 LE LOGEMENT 65<br />
9.8 L’ALIMENTATION DES FAMILLES 65<br />
9.9 LES BESOINS EN ENERGIE : L’ELECTRICITE ET L’EAU. 66<br />
9.10 LE TRANSPORT 66<br />
10 PRESENTATION DU PROJET 67<br />
10.1 OBJECTIFS DU PROJET 67<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 5
10.2 SITUATION ACTUELLE 67<br />
10.3 LES ACTIVITES A MENER DANS LE CADRE DU PROJET 68<br />
10.3.1 LES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 68<br />
10.3.2 LA CONSTRUCTION DE CAMPS D’OUVRIERS 71<br />
10.3.3 L’AMENAGEMENT DES PARCS A BOIS 71<br />
10.3.4 LA CONSTRUCTION DU BAC SUR LA BOUMBA (PARTIE NORD A L’EMBOUCHURE DE LA BEK) 71<br />
10.3.5 LES AUTRES ACTIVITES DU PROJET 72<br />
11 PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE ET POINTS DE VU DES ACTEURS 75<br />
11.1 CHEF DE POSTE DE SALAPOUMBE 75<br />
11.2 MAIRE DE SALAPOUMBE 75<br />
11.3 ANTENNE DE WWF/MAMBELE 75<br />
11.4 MAIRE DE MOLOUNDOU 76<br />
11.5 CHEF DE POSTE WWF DE NDONGO 76<br />
11.6 GUIDE DE CHASSE DE LA ZONE D’INTERET CYNEGETIQUE N°31 76<br />
11.7 REPRESENTANT DE LA ZONE D’INTERET CYNEGETIQUE N°38 (ZIC38) 77<br />
11.8 ANTENNE WWF/POSTE FORESTIERS ET CHASSE DU MINEF DE NGATTO 77<br />
11.9 RESPONSABLES UTO SUD-EST 77<br />
12 LES EFFETS ET IMPACTS POSSIBLES DU PROJET 78<br />
12.1 IMPACTS DU PROJET AU PLAN ECONOMIQUE 78<br />
12.1.1 IMPACTS ECONOMIQUES POSITIFS 78<br />
12.1.2 IMPACTS ECONOMIQUES NEGATIFS 79<br />
12.2 IMPACTS DU PROJET DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT 79<br />
12.2.1 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX POSITIFS 79<br />
12.2.2 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX NEGATIFS 80<br />
12.2.2.1 <strong>Impact</strong>s potentiels de la réhabilitation de la piste Koumela- Boumba et de l’ouverture des routes et<br />
pistes à l’intérieur de l’UFA 80<br />
12.2.2.2 <strong>Impact</strong>s potentiels de la construction et de l'utilisation d'un Bac au niveau de l'embouchure de<br />
Boumba-Bek pour accéder à l'UFA 10015 81<br />
12.2.2.3 <strong>Impact</strong>s potentiels de l’installation des infrastructures : les campements mobiles 82<br />
12.2.2.4 <strong>Impact</strong>s potentiels des travaux d’inventaire 82<br />
12.2.2.5 <strong>Impact</strong>s potentiels des activités d’abattage et de débardage 82<br />
12.2.2.6 <strong>Impact</strong>s potentiels de l’utilisation des produits de préservation des bois sur l’environnement forestier<br />
83<br />
12.3 IMPACTS DU PROJET DANS LE DOMAINE ESTHETIQUE ET CULTUREL 85<br />
12.3.1 IMPACTS CULTURELS POSITIFS 85<br />
12.3.2 IMPACTS NEGATIFS DANS LES DOMAINES ESTHETIQUE ET CULTUREL 85<br />
12.4 IMPACTS DU PROJET DANS LE DOMAINE DES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS 86<br />
12.4.1 IMPACTS POSITIFS DU PROJET DANS LE DOMAINE DES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS 86<br />
12.4.2 IMPACTS NEGATIFS DU PROJET DANS LE DOMAINE DES SERVICES PUBLICS ESSENTIELS 86<br />
12.5 IMPACTS DU PROJET SUR LE PLAN SOCIAL 86<br />
12.5.1 IMPACTS POSITIFS 86<br />
12.5.2 IMPACTS NEGATIFS 87<br />
13 EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET 89<br />
13.1 LES DOMAINES DE REFERENCE 89<br />
13.2 LES ECHELLES D’EVALUATION DES INDICATEURS D’IMPACTS 89<br />
13.3 L’EVALUATION ABSOLUE DES IMPACTS 90<br />
13.4 L’EVALUATION DES IMPACTS SELON LES COMMUNAUTES 91<br />
13.5 EVALUATION DES IMPACTS NEGATIFS DU PROJET 92<br />
14 LES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS 97<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 6
14.1 LES MESURES REGLEMENTAIRES ET INSTITUTIONNELLES 97<br />
14.2 LES MESURES RELATIVES AUX RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTES 98<br />
14.3 LES MESURES D’ORDRE TECHNIQUE 98<br />
14.3.1 LES ZONES D’EMPRUNTS ET ZONES DE STOCKAGE DES DEBLAIS 98<br />
14.3.2 LA VEGETALISATION DES TALUS 99<br />
14.3.3 MESURES A PRENDRE DANS LES INSTALLATIONS DE CHANTIER (CAMP, PARCS) 99<br />
14.4 LES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS LIES A LA BIODIVERSITE. 100<br />
14.4.1 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS DUS A L’INSTALLATION DES INFRASTRUCTURES<br />
(CAMPEMENTS MOBILES ET ATELIERS) 100<br />
14.4.2 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS DUS AUX TRAVAUX D’INVENTAIRES. 100<br />
14.4.3 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS DUS A LA REHABILITATION ET A L’OUVERTURE DES<br />
PISTES 101<br />
14.4.3.1 Planification du réseau routier 101<br />
14.4.3.2 Spécifications techniques 101<br />
14.4.3.3 Construction des routes 101<br />
14.4.3.4 Utilisation et entretien 102<br />
14.4.3.5 Fermeture des routes 102<br />
14.4.4 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS DUS AUX ACTIVITES D’ABATTAGE ET DE DEBARDAGE.<br />
102<br />
14.4.4.1 Planification de la récolte 102<br />
14.4.4.2 Marquage des arbres 103<br />
14.4.4.3 Abattage et extraction 103<br />
14.4.4.4 Opérations post-exploitation 103<br />
14.4.4.5 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus à l’utilisation des produits de préservation des bois.<br />
103<br />
14.5 MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS LIES A LA FAUNE 104<br />
14.5.1 MESURES D’ATTENUATIONS D’ORDRE GENERAL 104<br />
14.5.2 LES MESURES SECURITAIRES 105<br />
14.5.3 MESURES DE RESTRICTION DE LA PRESSION SUR LA FAUNE SAUVAGE COMME SOURCE DE PROTEINES 106<br />
14.6 MESURES D’ATTENUATIONS POUR UNE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES 108<br />
14.7 SYNTHESE DES MESURES D’ATTENUATION A METTRE EN ŒUVRE EN MATIERE DE BIODIVERSITE 108<br />
15 PLAN DE SUIVI ET DE CONTROLE/PLANIFICATION 112<br />
16 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 113<br />
17 ANNEXES 114<br />
17.1 DECRET FIXANT LES MODALITES DE REALISATION DES ETUDES D’IMPACTS SUR<br />
L'ENVIRONNEMENT (EIE) 115<br />
17.2 LA LEGISLATION SUR LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALES 123<br />
17.3 CONCORDANCE ENTRE LES IMPACTS ET LES MESURES D’ATTENUATION DE L’EIE 10015 125<br />
17.4 TERMES DE REFERENCES 128<br />
17.5 LISTE DES EXPERTS AYANT PARTICIPE A L’ETUDE 135<br />
17.6 CALENDRIER DE LA MISSION 136<br />
17.7 QUESTIONNAIRE COMPLEMENTAIRE A L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET DE MISE EN<br />
EXPLOITATION DE L’UFA N° 10.15 138<br />
17.8 TRAME D’ENQUETE POUR L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL PREALABLE A LA<br />
MISE EN EXPLOITATION DE L’UFA 10015 PAR LA SOCIETE CIBC 145<br />
17.9 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES POPULATIONS DES VILLAGES<br />
ADJALA, TEMBE. 149<br />
17.10 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DU PUBLIC DES POPULATIONS<br />
BAKA DU CAMPEMENT BOTTOLO (PK 22 SUR LA PISTE KOUMELA-EMBOUCHURE BOUMBA ET BEK). 151<br />
17.11 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION PUBLIC DES POPULATIONS BAKA<br />
DE KOUMELA ET SALAPOUMBÉ 152<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 7
17.12 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES POPULATIONS DU VILLAGE<br />
KOUMELA ET SES ENVIRONS. 153<br />
17.13 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES POPULATIONS DES VILLAGES<br />
NDONGO, LEKE, MINDOUROU . 155<br />
PROFIL DU RESPONSABLE DU VOLET SOCIO-ECONOMIQUE BASE A LOKOMO 157<br />
17.14 CARTE DES ZIC DE L’UTO SUD EST 158<br />
17.15 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE RESTITUTION DES ETUDES D’IMPACT<br />
ENVIRONNEMENTAL DES UFA 10 015, 10 011 ET 10 007. 159<br />
17.16 DISCOURS DU SOUS PREFET DE MOLOUNDOU 161<br />
17.17 ORDRE DU JOUR DE LA REUNION DE RESTITUTION DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES UFA 10<br />
015, 10 011 ET 10 007. 161<br />
17.18 MOT DU REPRESENTANT DU GROUPE THANRY 162<br />
17.19 LISTES DES PARTICIPANTS A LA REUNION DE RESTITUTION AVEC LES POPULATIONS LOCALES ET<br />
REPRESENTANTS DES ADMINISTRATIONS A SALAPOUMBE. 163<br />
Liste des figures<br />
Figure 1 : Localisation de l’UFA 10 015…………………………………………………….22<br />
Figure 2 :Histogramme de précipitation de la zone d’étude…………………………………23<br />
Figure 3 :Unités morphologiques de l’UFA 10 015 (paysages)……………………………..24<br />
Figure 4 : Réseau hydrographique de l’UFA…………………………………………………25<br />
Figure 5 : Géologie de l’UFA…………………………………………………………..…….26<br />
Figure 6 : Pédologie de l’UFA ……………………………………………………………….27<br />
Figure 7 :Réseau routier et piste d’évacuation des grumes…………………………………..28<br />
Figure 8 : Quelques sites critiques identifiés au sein de l’UFA 10 015………………………31<br />
Figure 9 : Quelques traces d’activité de mammifères………………………………………..32<br />
Figure 10 : Zone d’usage traditionnel de chasse, de pêche et de cueillette………………….50<br />
Figure 11 : Carte du réseau routier de l’UTO Sud Est……………………………………….70<br />
Liste des photos<br />
Photo 1 : Vue du couvert végétal…………………………………………………………………….30<br />
Photo 2 : Chimpanzé………………………………………………………………………………..…32<br />
Photo 3 : Camp de braconnier en pleine forêt…………………………………………………..…35<br />
Photo 4 : Opération de délogement de braconniers en forêt…………………………………….36<br />
Photo 5 : Case traditionnelle pygmée (moungoulou)………………………………………..……37<br />
Photo 6 : Case rectangulaire pygmée………………………………………………………….……38<br />
Photo 7 : Céphalophe pris au piège et abandonné…………………………………………….….46<br />
Photo 8 : Gorille braconné et dépécé…………………………………………………………….…47<br />
Photo 9 : Braconnier à la recherche de clients au carrefour Mambélé……………………..….48<br />
Photo 10 : Réunion avec les populations et autorités…………………………………………..…61<br />
Photo 11 : Vue de l’unité de sciage de l’usine de transformation……………………………….63<br />
Photo 12 : Bac sur la Boumba (axe Moloundou-Ndongo)……………………………………..…67<br />
Photo 13 : Arbres tombés sur la piste Koumela –embouchure…………………………………..68<br />
Photo 13 : Embouchure de la Boumba et Bek……………………………………………………...72<br />
Photo 14 : Parc à grumes de l’usine………………………………………………………………...74<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 8
3 LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS<br />
AAPPEC<br />
AAC<br />
ACPC<br />
BBK<br />
CIBC<br />
COVAREF<br />
DDEF<br />
DF<br />
DFAP<br />
DPEF<br />
EIE<br />
FCFA<br />
GEF<br />
GNT<br />
GTZ<br />
Allemande<br />
MINAGRI<br />
MINAT<br />
MINEF<br />
MINEFI<br />
MINIPAT<br />
ONADEF<br />
PROFORNAT<br />
SEBC<br />
SEBAC<br />
SEFAC<br />
Legno)<br />
SIBAF<br />
SIG<br />
SPE<br />
UFA<br />
UTO<br />
WCS<br />
WWF<br />
ZIC<br />
ZICGC<br />
Association pour l'Auto-Promotion des Populations de l'Est Cameroun<br />
Assiette Annuelle de coupe<br />
Association des Chasseurs Pr<strong>of</strong>essionnels du Cameroun<br />
Boumba-Bek<br />
Compagnie Industrielle des Bois du Cameroun<br />
Comite de Valorisation des Ressources Fauniques<br />
Délégation Départementale de l'Environnement et des Forêts<br />
Direction de Forêts/MINEF<br />
Direction de la Faune et des Aires Protégées/MINEF<br />
Délégation Provinciale de l'Environnement et des Forêts<br />
Etude d'<strong>Impact</strong>s sur l'Environnement<br />
Franc CFA<br />
Global Environmental Facility/ Fonds pour l'Environnement Mondial FEM<br />
Groupe National de Travail sur la Gestion durable des forêts et la certification<br />
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit / Coopération Technique<br />
Ministère de l'Agriculture (Cameroun)<br />
Ministère de l'Administration Territoriale (Cameroun)<br />
Ministère de l'Environnement et des Forêts (Cameroun)<br />
Ministère d'Etat chargé de l'Economie et des Finances (Cameroun)<br />
Ministère de l'Investissement Public et de l'Aménagement du Territoire (Cameroun)<br />
Office National de Développement des Forêts (Cameroun)<br />
Projet de Conservation des Forêts Naturelles au Sud-Est Cameroun/GTZ<br />
Société d’Exploitation des Bois du Cameroun (Groupe VICWOOD THANRY)<br />
Société d’Exploitation des Bois d’Afrique Centrale (Groupe SEFAC/Vasto Legno)<br />
Société d’Exploitation <strong>Forest</strong>ière et Agricole du Cameroun (Groupe SEFAC/Vasto<br />
Société Industrielle des Bois Africains (Groupe Bolloré)<br />
Système d'Information Géographie<br />
Secrétariat Permanent à l'Environnement/MINEF<br />
Unité <strong>Forest</strong>ière d'Aménagement<br />
Unité Technique Opérationnelle<br />
Wildlife Conservation Society (USA)<br />
World Wide Fund for nature/Fonds Mondial pour la Nature<br />
Zone d'Intérêts Cynégétiques<br />
Zone d'Intérêts Cynégétiques à Gestion Communautaire<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 9
4 MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS - SYNTHESE<br />
Mesures d’atténuation Indicateur de réalisation Acteurs concernés<br />
par la mise en<br />
œuvre<br />
1. Gestion des implantations<br />
1.1. Implantation d’un campement Un campement pour l’hébergement du personnel est CIBC<br />
pour l’hébergement du personnel construit à Koumela<br />
Echéance de mise en<br />
œuvre<br />
Estimation de<br />
coûts<br />
Avant exploitation de 5.000.000 Fcfa<br />
l'assiette de coupe N°1<br />
1.2. Gestion de la taille du chantier Le chantier est de taille limitée CIBC Exploitation AAC 0<br />
1.3. Gestion de l’atelier et des L’atelier est bien géré et les règles élémentaires de gestion CIBC Exploitation AAC 0<br />
services d’entretien mécanique et des<br />
campements mobiles<br />
de déchets solides et des eaux usées sont bien respectées.<br />
1.4. Assurer le ravitaillement des Le personnel est approvisionné par la CIBC sur les camps<br />
personnels installés sur le campement Une cuisine de la CIBC est fonctionnelle sur le camp<br />
2. Planification du réseau routier et gestion de l’exploitation<br />
2.1. Planification du réseau routier 1. Le réseau routier est planifié lors de l’élaboration de<br />
l’aménagement forestier et sa densité est réduite ainsi<br />
que son coût de construction<br />
2. Les routes sont implantées de manière à minimiser les<br />
mouvements de matériaux et à faciliter le drainage,<br />
autant que possible en crête<br />
3. les sites critiques (salines, baïs, couloirs de migration)<br />
de biodiversité sont évités.<br />
4. l’ouverture des pistes tient compte de la piste<br />
actuellement utilisée par le guide de chasse dans la<br />
partie Est de l’UFA.<br />
5. Les zones tampons autour des cours d’eau sont<br />
identifiées et protégées<br />
6. les zones marécageuses et les zones à haut risque<br />
d’érosion sont évitées.<br />
2.2.Inventaires préalables à<br />
l’exploitation<br />
1. L’équipe d’inventaire est limitée et la sécurité du<br />
personnel est garantie<br />
2. les activités de chasse ou de piégeage sont interdites à<br />
l’équipe d’inventaire et une logistique permettant leur<br />
CIBC Exploitation AAC N.D.<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
et<br />
Entreprise<br />
agréée aux<br />
Préalable à l’exploitation<br />
de l’ AAC<br />
Préalable à l’exploitation<br />
de chaque AAC<br />
0<br />
0<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 10
2.3. Formation aux techniques<br />
d’exploitation à faible impact<br />
2.4. Gestion de la chronologie des<br />
opérations d’exploitation forestière<br />
2.5. Marquage spécifique de certains<br />
sujets (essences fruitières,<br />
médicinales ou sacrées)<br />
2.6. Identification des sites et arbres<br />
sacrés<br />
approvisionnement en nourriture est assurée.<br />
3. le marquage à la machette des essences non exploitables<br />
immédiatement est interdit et une méthode de marquage<br />
non destructeur est conçue<br />
4. les largeurs des layons d’inventaires sont réduites au<br />
minimum<br />
5. les inventaires d’exploitation sont réalisés dans de<br />
bonnes conditions<br />
Les cadres et agents spécialisés de l’entreprise ont reçu<br />
une formation spécifique<br />
inventaires<br />
Sous-traitant<br />
(Bureau d’étude<br />
spécialisé)<br />
Durant l’exploitation de l’<br />
AAC - Recyclages<br />
La chronologie des opérations est bien gérée CIBC Exploitation AAC 0<br />
Les essences fruitières et médicinales sont marqués à la<br />
peinture avec la participation des communautés<br />
villageoises pour éviter leur destruction<br />
Les sites sacrés sont repérés, et identifiés sur le terrain<br />
avec la participation des communautés et marqués à la<br />
peinture pour pouvoir les éviter.<br />
CIBC et<br />
communautés<br />
concernées<br />
CIBC et<br />
communautés<br />
concernées<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe N°1<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe N°1<br />
3. Protection du sol et de la qualité des eaux : Gestion des produits chimiques et autres substances polluantes<br />
3.1. Limiter l’utilisation des produits de<br />
préservation du bois<br />
Le temps de séjour des grumes en forêt et l’utilisation des CIBC<br />
produits de préservation sont limités par de bonnes pratiques<br />
Exploitation AAC 0<br />
d’exploitation et une bonne organisation des chantiers<br />
3.2. Précaution dans l’emploi des Toutes les précautions sont prises quant à l’usage des<br />
produits de traitement des grumes produits chimiques<br />
3.3. Gestion des substances Toutes les précautions sont prises quant à l’usage, à la<br />
polluantes<br />
destruction ou au recyclage des produits polluants<br />
4. Lutte antibraconnage : Gestion de l’évacuation des bois et du transport<br />
4.1. Barrières et contrôles à<br />
l’entrée du bac et à la sortie sur<br />
l’axe central à Koumela<br />
Une guérite avec barrières est installée et fonctionnelle toute<br />
l’année à Koumela pour le contrôle du transport des gibiers et<br />
autres produits illicites.<br />
Le bac est équipé d’une radio permettant de communiquer<br />
avec le check point de Salapoumbé le site de transformation à<br />
Lokomo et les autres postes forestiers de la zone.<br />
CIBC<br />
CIBC Exploitation AAC 0<br />
CIBC Exploitation AAC 0<br />
Collaboration UTO SE<br />
Permanent<br />
Appui temporaire<br />
5.000.000 Fcfa<br />
+ subventions à<br />
rechercher<br />
Peinture<br />
Peinture<br />
2.000.000 Fcfa<br />
infrastructures et<br />
radio<br />
+ Salaires des<br />
gardes<br />
4.2. Visites de contrôle et Des opérations ‘coup de poing’ sont organisées pour UTO SE, CIBC, Guide de Appui temporaire Frais de route +<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 11
descentes sur le terrain pour<br />
déloger les campements de<br />
braconniers ;<br />
4.3. Intégration des règles et<br />
sanctions concernant la faune aux<br />
transporteurs et aux soustraitants<br />
;<br />
4.4. Intensifier les campagnes de<br />
sensibilisation et d’information<br />
sur le braconnage<br />
4.5. Contrôler l’accès à la piste<br />
Koumela -Embouchure et à la<br />
concession<br />
4.6.Bloquer l’accès à la<br />
concession après exploitation<br />
4.7.Faciliter le contrôle par les<br />
autorités compétentes<br />
4.8. Interdiction de transport des<br />
personnes extérieures à<br />
l’entreprise<br />
déguerpir les campements et villages de braconniers le<br />
long des axes, autour et à l’intérieur de l’UFA<br />
Les contrats de transport stipulent clairement<br />
l’obligation de respecter les règles interdisant le<br />
transport de gibier, des armes et des chasseurs<br />
Des campagnes de sensibilisations sont organisées dans<br />
l’entreprise et les villages environnants pour expliquer<br />
les effets du braconnage, le rôle des employés et<br />
villageois dans la lutte contre le braconnage, leur<br />
collaboration avec les équipes de l’UTO et les<br />
COVAREF<br />
Les posters produits par le MINEF sur les espèces<br />
protégées sont distribués dans les villages riverains et<br />
aux employés.<br />
L’accès à la piste Koumela-Embouchure et à la<br />
concession est limité aux seuls véhicules de la CIBC ou<br />
ceux ayant une autorisation de la CIBC<br />
Une concertation est faite entre le guide de chasse et<br />
l’exploitant forestier pour bloquer les accès à la<br />
concession par des barrières en terre après l’exploitation<br />
Les autorités ont un accès facilité à la concession pour les<br />
contrôles<br />
Véhicules de l’entreprise ne transportant pas de gens de<br />
l’extérieur<br />
chasse ZIC 38 et forces de<br />
maintien de l’ordre<br />
Membres ZICGC 9 & 10<br />
CIBC/WWF Exploitation AAC 0<br />
WWF,GTZ,<br />
UTO<br />
CIBC, WWF Exploitation AAC 0<br />
CIBC et Guide de chasse<br />
ZIC 38<br />
Fin de<br />
l’exploitation de<br />
l’ AAC<br />
carburant<br />
2.000.000 Fcfa<br />
par an<br />
A charge de<br />
l’UTO et des<br />
projets d’appui<br />
Engins et<br />
carburants pour<br />
monter des<br />
barrières en terre<br />
CIBC, UTO En permanence Frais de route<br />
CIBC Règle permanente 0<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 12
5. Emploi de la main d’œuvre locale<br />
5.1. Employer les jeunes des villages<br />
riverains de l’UFA dans l’entreprise<br />
Des jeunes des villages riverains sont employés à<br />
l’exploitation suivant les besoins de la CIBC<br />
CIBC Exploitation AAC 0<br />
5.2. Faciliter la formation des jeunes<br />
des villages en les utilisant comme<br />
aide des agents qualifiés allochtones ;<br />
Les jeunes employés non-qualifiés des villages riverains<br />
sont utilisés comme aides et apprentis auprès des<br />
personnels qualifiés allochtones<br />
CIBC Exploitation AAC 0<br />
6. Approvisionnement des ouvriers en produits alimentaires<br />
6.1.Assurer l’approvisionnement des Un magasin bien alimenté avec des produits de première<br />
employés de la CIBC en produits de nécessité est créé sur le site de Lokomo pour éviter la pression<br />
première nécessité à prix compétitif. sur la faune autour des campements. Une convention est<br />
établie entre la CIBC et le principal commerçant installé à<br />
Lokomo pour une distribution à prix coûtant de Yokadouma<br />
des produits de première nécessité aux employés de<br />
6.2. Approvisionner régulièrement<br />
les employés en protéines<br />
alternatives à la viande de brousse ;<br />
6.3. Subventionner les protéines<br />
alternatives à destination des ouvriers ;<br />
6.4. Etudier la possibilité de stimuler<br />
la mise en place d’une unité de<br />
production de petit élevage sur le site<br />
de Lokomo<br />
6.5. Approvisionnement des ouvriers<br />
en légume et viande frais<br />
7. Réglementation de la chasse et de l’usage de la faune<br />
7.1. Veiller à une application effective<br />
de la loi forestière et des règlements<br />
intérieurs concernant l’usage de la<br />
faune ;<br />
l’entreprise.<br />
Un accord est passé avec le boucher du site de Lokomo<br />
pour la gestion de la boucherie et l’approvisionnement en<br />
viande des cuisines des camps<br />
La CIBC assure le transport du bœuf ou du poisson de<br />
Yokadouma à Lokomo et Koumela et le kilogramme de<br />
viande ou de poisson est vendu au prix de Yokadouma<br />
L’étude est réalisée et l’élevage est développé et fonctionnel à<br />
Lokomo<br />
Un projet d’intensification de l’agriculture et du petit<br />
élevage sur des parcelles délimitées hors de l’UFA est<br />
défini et mis en œuvre afin d’assurer un<br />
approvisionnement régulier en légumes et viandes frais ;<br />
Les textes des règlements et de la loi sont appliqués avec<br />
rigueur<br />
CIBC +<br />
Opérateur privé<br />
sous-traitants<br />
Exploitation AAC N°1 La CIBC<br />
subventionne<br />
partiellement le<br />
transport depuis<br />
Yokadouma<br />
CIBC Exploitation AAC N°1 idem<br />
CIBC Exploitation AAC N°1 Carburant + suivi<br />
SEBC, CIBC<br />
CIBC, <strong>JMN</strong>,<br />
AAPEC<br />
Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
CIBC, UTO SE Permanent 0<br />
10 000 000fcfa<br />
investissement<br />
10 000 000Fcfa<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 13
7.2. Interdiction des transporter tout<br />
engin de chasse par les ouvriers<br />
7.3. Interdiction d’utiliser l’atelier<br />
pour fabriquer ou réparer les armes<br />
7.4.Interdiction de transport des produits<br />
de chasse et de toute personne étrangère<br />
à l’entreprise<br />
7.5. Inscription des règles et sanctions<br />
prévues dans le règlement intérieur de<br />
l’entreprise<br />
7.6. Interdiction de transport d’armes,<br />
de munitions ou de câbles ou de tout<br />
outil destiné à la chasse.<br />
7.7. Exiger des employés de<br />
l’entreprise une collaboration étroite<br />
avec les agents du MINEF<br />
7.8.Produire des moyens<br />
d’identification pour toutes les<br />
équipes de la CIBC travaillant en<br />
forêt<br />
7.9. Instituer un comité de lutte<br />
contre le braconnage au sein de<br />
l’entreprise.<br />
7.10. Elaborer une convention de<br />
collaboration entre les différentes<br />
parties<br />
7.11. Appuyer les actions des comités<br />
de vigilance des ZICGC 9 & 10<br />
7.12. Patrouiller régulièrement dans<br />
la zone de l’UFA<br />
Les armes sont interdites sur le chantier<br />
L’atelier n’est pas utilisé pour la réparation ou la fabrication<br />
des armes<br />
Les règlements intérieurs des entreprises de transport<br />
sont stricts et appliqués avec rigueur<br />
Les règlements intérieurs sont complétés pour intégrer<br />
les interdits et les sanctions<br />
Les règles interdisant le transport des outils destinés à la<br />
chasse sont appliquées avec rigueur<br />
Les employés de l’entreprise rendent fidèlement compte<br />
de tout acte de braconnage constaté dans la zone de<br />
l’UFA<br />
Toutes les équipes de la CIBC travaillant en forêt sont<br />
identifiables par un moyen d’identification<br />
Le comité de lutte antibraconnage est institué et<br />
opérationnel<br />
La convention de collaboration est signée<br />
CIBC Appui<br />
UTO SE,<br />
gendarmerie<br />
Exploitation AAC 0<br />
CIBC, SEBC, Exploitation AAC 0<br />
Appui UTO SE,<br />
gendarmerie<br />
CIBC Exploitation AAC 0<br />
CIBC Permanent 0<br />
CIBC, SEBC,<br />
Appui UTO SE,<br />
gendarmerie<br />
Permanent 0<br />
CIBC En permanence 0<br />
CIBC Avant l’exploitation de l’<br />
AAC N°1<br />
CIBC<br />
CIBC, Guide de<br />
chasse, UTO,<br />
Responsables<br />
ZICGC 9 & 10.<br />
Avant exploitation AAC<br />
N°1<br />
Avant exploitation AAC<br />
N°1<br />
Frais de<br />
fonctionnement<br />
2 MFcfa<br />
0<br />
Les comités de vigilance sont appuyés dans leurs actions Guide de chasse En permanence Par le guide<br />
Une équipe permanente est recrutée et formée pour<br />
assurer la patrouille<br />
Guide de chasse<br />
de la ZIC 38 et<br />
CIBC et UTO<br />
En permanence<br />
10 000 000Fcfa<br />
par an<br />
7.13. Suivi-évaluation de la lutte Des réunions de suivi-évaluation sont organisées UTO, CIBC, Périodiquement 500.000 Fcfa par<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 14
antibraconnage Guide de chasse an<br />
8. Protection des sites critiques identifiés et à identifier au sein de l’UFA<br />
8.1. Limiter l’exploitation autour des<br />
sites critiques identifiés<br />
Exploitation<br />
AAC<br />
0<br />
8.2. Participer à la survie à moyen/long<br />
terme des marécages à Rynchospora<br />
corymbosa<br />
8.3.Poursuivre l’identification des sites<br />
critiques notamment des couloirs de<br />
migration des mammifères<br />
8.4. Inventorier le potentiel faunique de<br />
la ZIC 38<br />
La zone intégrant les complexes de baïs de<br />
Kopandako et Sokolibombo ainsi que le couloir<br />
de migration (au sud de l’UFA) sont mis en<br />
réserve .<br />
La perturbation des mouvement des mammifères<br />
est limitée.<br />
Aucune intervention n’est faite dans les baïs qui<br />
pourrait perturber l’évolution naturelle de ces<br />
éco-systèmes fragiles<br />
Les autres sites critiques et la continuité des<br />
couloirs de migration notamment au niveau du<br />
parc de Boumba-Bek et Nki sont identifiés et mis<br />
en réserve<br />
Un inventaire des ressources fauniques est<br />
conduit et le potentiel de la ZIC 38 est connu<br />
9. Gestion des zones d’emprunts et autres zones décapées<br />
9.1. Gestion des zones d’emprunt Les zones d’emprunt sont remodelées, recouvertes<br />
de la terre arable et revégétalisées<br />
9.2. Gestion des zones de stockage ou de<br />
traitement des grumes<br />
Les zones de stockage ou de traitement de grumes<br />
sont revégétalisées<br />
9.3. Gestion des talus de déblais Les talus de déblais sont revégétalisés en espèces<br />
herbacées présentes dans la région, de façon générale<br />
(Paspalum spp, Pennisetum sp, Androposdon citratus).<br />
CIBC, Guide de chasse ZIC<br />
38, membres de la ZICGC<br />
N°10<br />
CIBC<br />
Collaboration WWF, CIBC,<br />
Guide de chasse ZIC 38<br />
WWF - ZIC 38<br />
Collaboration CIBC<br />
Sous-traitant<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
Exploitation<br />
AAC<br />
Exploitation<br />
AAC<br />
Dès la fin du<br />
chantier<br />
Dès la fin de<br />
l’exploitation de<br />
l’ AAC<br />
Dès la fin du<br />
chantier<br />
0<br />
Carburant et appui<br />
logistique<br />
Non déterminé<br />
ND<br />
Travaux d’engins<br />
5 000 000 Fcfa<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 15
5 MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT - SYNTHESE<br />
Mesures d’accompagnement Indicateurs de réalisation Acteurs concernés par<br />
la mise en œuvre<br />
1. Gestion de la transformation<br />
1.1. Etudier et mettre en œuvre un système de Une étude est réalisée et les CIBC<br />
récupération des bois abandonnés en forêts<br />
conclusions déposées<br />
UTO<br />
1.2. Etudier la faisabilité d’une deuxième transformation Une étude est réalisée et les<br />
sur le site de Lokomo (séchage, rabotage, etc.)<br />
conclusions déposées<br />
1.3. Etudier la faisabilité d’approvisionner les petites Une étude est réalisée et les<br />
industries locales à partir des bois usinés de seconde conclusions déposées<br />
qualité<br />
1.4. Etudier la possibilité de diversifier les marchés de De nouveaux marchés sont créés.<br />
bois, travailler d’autres essences et de nouvelles sections<br />
permettant une amélioration des rendements d’usinage Le rendement bois/grume est<br />
amélioré<br />
1.5. Etudier la possibilité de créer une usine de déroulage Une étude est réalisée et les<br />
à l’échelle de l’ensemble des UFA du Groupe, voire du conclusions déposées<br />
département de la Boumba et Ngoko pour la valorisation<br />
des essences secondaires<br />
2. Gestion des redevances forestières<br />
2.1. Mettre en place le comité 10015 Le comité 10015 est fonctionnel UTO (DD–GTZ-WWF)<br />
CIBC - ZIC 38 – Chefs<br />
Commune – Ss-Préfect.<br />
2.2. Elaborer et mettre en œuvre un projet de<br />
construction d’internats dans les centres préscolaires de<br />
la zone<br />
2.3. Recommandation de donner une priorité dans des<br />
investissements productifs d’une partie des redevances<br />
forestières pour augmenter les capacités et la qualité des<br />
hébergements du personnel enseignant dans la zone.<br />
Des internats sont construits et le<br />
taux de scolarisation des enfants de<br />
la zone notamment les pygmées est<br />
amélioré.<br />
Le personnel enseignant est<br />
stabilisé et l’éducation des enfants<br />
est améliorée.<br />
Echéance de mise en<br />
œuvre<br />
Avant la fin de la<br />
convention provisoire pour<br />
l’étude et en permanence<br />
pour la mise en oeuvre<br />
CIBC Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
CIBC Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
CIBC<br />
En permanence<br />
Services commerciaux<br />
du groupe VICWOOD<br />
THANRY<br />
CIBC Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
Comité 10015<br />
Mission catholique<br />
AAPEC (Collaborateur)<br />
A la mise en<br />
exploitation de la 1 ère<br />
assiette de coupe<br />
Dans les meilleurs<br />
délais avec l’appui de<br />
la CIBC<br />
Comité 10015 Pendant l’exploitation 0<br />
MINEDUC (Service<br />
compétent)<br />
Coût estimé<br />
supplémentaire<br />
ND<br />
ND<br />
ND<br />
ND<br />
1.000.000 Fcfa<br />
par an<br />
10 000 000fcfa<br />
par an<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 16
2.4. Elaborer un manuel sur les procédures de<br />
soumission et d’accès aux fonds ainsi que sur les<br />
modalités de gestion des sommes obtenues rappelons le<br />
essentiellement dans le cadre de projets d’intérêt<br />
communautaires ;<br />
2.5. Elaboration d’un projet quinquennal d’utilisation<br />
des fonds de la RFA et planification d’un programme<br />
de réalisation annuel ;<br />
2.6. Définition de la part réservée au fonctionnement et<br />
de la part réservée à la réalisation des projets par les<br />
différentes communautés villageoises, qu’il s’agisse<br />
d’infrastructures communautaires ou de projets de<br />
développement rural ;<br />
2.7. Elaborer un projet d’identification des populations<br />
Bakas<br />
3. Appui au développement rural<br />
3.1. Elaboration des procédures de soumission et de<br />
sélection des micro projets de développement rural ;<br />
3.2. Elaboration et mise en œuvre d’un projet de<br />
vulgarisation du petit élevage<br />
3.3.Proposer l’élaboration d’un contrat de<br />
développement local mettant en relation les besoins de<br />
développement et les besoins de surveillance ou de<br />
contrôle ;<br />
Un manuel est réalisé et disponible<br />
pour les responsables locaux<br />
La planification budgétaire a été<br />
réalisée par le comité 10015<br />
Le budget détaillé de l’utilisation<br />
des fonds gérés par le comité est<br />
finalisé et adopté.<br />
Un projet d’identification des<br />
populations Baka est élaboré et en<br />
moyenne 500 cartes d’identité sont<br />
établies chaque année.<br />
Les procédures de soumission et de<br />
sélection des micro-projets sont<br />
adoptées et vulgarisées<br />
Le projet de vulgarisation du petit<br />
élevage est élaboré et mise en<br />
œuvre.<br />
Le comité et les partenaires ont<br />
élaboré un programme de<br />
développement local et des<br />
conventions de réalisation sont<br />
signées<br />
Comité 10015,<br />
ONG à identifier<br />
Appui technique CIBC<br />
Comité 10015<br />
Comité 10015<br />
Villages concernés<br />
AAPEC (Collaborateur)<br />
Comité 10015,<br />
Chefs traditionnels,<br />
AAPEC (Collaborateur)<br />
Coordinateur CIBC<br />
Comité 10015, Comités<br />
de développement des<br />
villages<br />
GTZ<br />
Comité 10015<br />
GTZ,<br />
MINAGRI/MINEPIA ,<br />
AAPEC(Collaborateur)<br />
CIBC,<br />
Comité 10015,<br />
AAPEC(Collaborateur)<br />
Avant la fin de la<br />
convention provisoire<br />
A réaliser avant la fin<br />
de l’exercice fiscal<br />
A réaliser avant la fin<br />
de l’exercice fiscal<br />
Dès la deuxième année<br />
de convention<br />
A réaliser avant la fin<br />
de l’exercice fiscal<br />
Année 2 de la<br />
convention prov.<br />
ND<br />
0<br />
0<br />
ND +<br />
subventions<br />
GTZ<br />
ND<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 17
4. Gérer la proximité du Parc National de Boumba-Bek et Nki<br />
4.1. Renforcer en permanence les moyens du poste Un véhicule WWF est mis à<br />
forestier de Salapoumbé<br />
disposition du poste forestier pour<br />
ratisser dans les axes de pénétration<br />
au Parc de Boumba-Bek à partir des<br />
4.2. Appuyer les opérations de ratissage du poste<br />
forestier de Ngato notamment au niveau des axes de<br />
pénétration au parc de Boumba-Bek à partir du village<br />
Gribé<br />
4.3. Renforcer le contrôle sur l’axe Moloundou-Ndongo<br />
pour stopper le flux de braconnage qui opère<br />
actuellement dans la zone sud de l’UFA<br />
4.4. Contrôle des véhicules pour vérifier l’application<br />
des mesures concernant les règlements adoptés ;<br />
4.5. Contrôles inopinés dans la concession forestière<br />
pour évaluer l’application des mesures concernant les<br />
règlements adoptés ;<br />
villages Mikel et Golla 120<br />
Des opérations de ratissage sont<br />
régulièrement pratiquées<br />
Les contrôles sont renforcés sur<br />
l’axe Moloudou-Ndongo<br />
Les contrôles des véhicules sont<br />
effectifs et rigoureux<br />
Les contrôles sont régulièrement<br />
effectués et rigoureux<br />
5. Amélioration des conditions de vie<br />
5.1. Extension et aménagement du camp de Lokomo Le camp de base de Lokomo est<br />
agrandi et amélioré<br />
5.2. Entretien de la route Moloundou<br />
Ndongo<br />
6 – Coordination et suivi des mesures<br />
6.1. Mise en place d’un responsable de la<br />
coordination et du suivi du plan d’atténuation, des<br />
actions environnementales et des relations avec les<br />
populations et les partenaires locaux<br />
La route Moloundou-Ndongo est régulièrement<br />
repr<strong>of</strong>ilée<br />
Un responsable coordonnateur est<br />
recruté, installé à Lokomo, véhiculé et<br />
fonctionnel.<br />
Il est responsable sur le site de Lokomo<br />
et sur les UFA 10015, 10.007 et 10.011.<br />
WWF SE En permanence Fourniture de<br />
carburant par la<br />
CIBC<br />
WWF SE,<br />
Antenne Ngato<br />
Poste forestier de<br />
Moloundou,<br />
Antenne WWF de Ndongo<br />
Postes forestiers de<br />
Moloundou et Salapoumbé,<br />
Antenne WWF de Ndongo<br />
gendarmerie de Moloundou<br />
Poste forestier de<br />
Moloundou, Antenne WWF<br />
Ndongo, Moloundou<br />
En permanence<br />
En permanence<br />
Dès la mise en<br />
exploitation de l’<br />
AAC annuelle<br />
Dès la mise en<br />
exploitation de l’<br />
AAC annuelle<br />
CIBC En permanence ND<br />
CIBC<br />
Commune rurale<br />
Moloundou<br />
Tous les ans en partenariat<br />
avec la commune qui doit<br />
participer aux charges<br />
carburant<br />
0<br />
0<br />
Engins<br />
Carburant<br />
MO<br />
CIBC En permanence Salaire<br />
Véhicule<br />
Fonctionnement<br />
Informatique<br />
Communication<br />
Le plan de suivi de mise en œuvre des mesures d’atténuation devra présenter dans les détails le plan annuel des différentes opérations.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 18
6 INTRODUCTION<br />
La CIBC, filiale du Groupe VICWOOD THANRY, envisage d’aménager l’unité forestière<br />
10015 conformément à sa convention provisoire N°0137/CPE/MINEF/CAB du 15 Février<br />
2001. Cette UFA est située dans la province de l’Est, département de la Boumba et Ngoko,<br />
arrondissement de Moloudou.<br />
Le présent rapport porte sur l’Etude d’<strong>Impact</strong> Environnemental (EIE) du projet d’exploitation<br />
de l’Unité forestière d’Aménagement (UFA) N° 10015. La loi cadre sur l’Environnement<br />
prescrit notamment que toute UFA située à proximité d’une aire protégée doit être soumise à<br />
une étude d’impact sur l’environnement préalable à sa mise en exploitation. Dans le cas de la<br />
présente étude, l’UFA N° 10015 est contiguë au parc de Boumba-Bek avec lequel elle partage<br />
une frontière de plus de 60 km matérialisée par le fleuve Bek dès son embouchure sur la<br />
Boumba.<br />
6.1 L’objectif de l’EIE<br />
La présente étude a pour objectif d’analyser les impacts et de formuler les recommandations<br />
afin de prévenir les risques environnementaux et socio-économiques liés à :<br />
• la réhabilitation et l’utilisation de la voie d’accès dans l’UFA par le Nord (route<br />
Koumela-Boumba) ;<br />
• la construction et l’exploitation d’un bac pour l’accès à l’UFA par la traversée de la<br />
rivière Boumba, au nord de l’UFA ;<br />
• l’aménagement des routes forestières et pistes de débardage ;<br />
• l’installation d’un campement d’ouvriers et l’aménagement des parcs à bois.<br />
• la coupe et le transport de bois de l’UFA à l’usine de Lokomo.<br />
Ces cinq composantes constituent ce qui sera appelé projet dans le présent rapport.<br />
De façon spécifique, l’étude d’impact environnemental vise à :<br />
• identifier les activités et impacts liés à la production forestière, l’évacuation des<br />
grumes vers la scierie de Lokomo SEBC, et l’installation d’un camp d’ouvriers fixe et<br />
des camps mobiles ;<br />
• évaluer les impacts socio-économiques et culturels des activités d’exploitation,<br />
• proposer des mesures d’atténuation de ces impacts dont la recommandation sur<br />
l’implantation du camp ;<br />
• proposer des modalités pratiques pour promouvoir des sources de protéines<br />
alternatives à la viande de brousse ;<br />
• établir des mesures de protection des couloirs de migration des animaux et les autres<br />
sites importants en matière de biodiversité ;<br />
• proposer des mesures visant à favoriser un aménagement intégré de l’UFA, de la ZIC<br />
N° 38 et des ZICGC N° 9 et N° 10 ;<br />
• proposer des mesures compensatoires pour le désenclavement des populations<br />
riveraines à la partie Sud de l’UFA après l’ouverture de la route d’accès à l’UFA par<br />
le Nord.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 19
6.2 Résumé de la méthodologie<br />
6.2.1 L’approche de travail<br />
L’équipe de consultants a suivi un schéma d’activité en plusieurs phases successives :<br />
1 ère phase : cette phase s’est déroulée en deux temps à savoir :<br />
• Réunion préliminaire de présentation et d’explication de l’approche<br />
méthodologique au commanditaires de l’étude à Douala . Cette réunion a permis<br />
aussi de mieux réviser le chronogramme ;<br />
• Recherches documentaires ;<br />
2 ème phase : Mission sur le terrain<br />
• Réunion de lancement de l’étude avec les membres de l’UTO Sud Est à<br />
Yokadouma et recherche d’informations et de documents spécifiques;<br />
• Prise de contact avec les autorités administratives et techniques et autres<br />
intervenants dans la zone de l’UFA 10015, identification des villages<br />
périphériques et planification des réunions;<br />
• Tournées de terrain et organisation des réunions de consultation en compagnie<br />
des autorités administratives de la zone et du chef de section environnement de<br />
la DDEF de Yokadouma : Ndongo, Adjala, Moloudou, Mambélé, Kouméla,<br />
Salapoumbé et Lokomo.<br />
Les sources d’information consultées se regroupent ainsi en quatre grands groupes, à savoir :<br />
• les sources bibliographiques consultées à Yaoundé et sur le terrain auprès des<br />
diverses structures actives dans le domaine de l’Environnement notamment à<br />
l’UTO Sud-Est ;<br />
• les sources orales sondées par les interviews des responsables des services<br />
publics centraux basés à Yaoundé et locaux basés à Yokadouma, Moloundou et<br />
Salapoumbé, les responsables des ONG, des ZIC et ZICGC, les responsables<br />
des sociétés forestières dont la SEBC, et la SIBAF ;<br />
• les sources à base d’enquêtes menées auprès des communautés par la voie des<br />
questionnaires et des réunions de consultation ;<br />
• l’observation directe par des visites de reconnaissance dans les villages et sur les<br />
routes d’accès à l’UFA et dans les installations destinées à réceptionner le bois<br />
de l’UFA 10015.<br />
La méthodologie utilisée était basée essentiellement sur deux approches : des rencontres<br />
individuelles et collectives d’une part, des séances de consultation (animation participative)<br />
d’autre part. Parallèlement, l’analyse documentaire a permis de s’imprégner progressivement<br />
des différents travaux réalisés dans le passé récent et moins récent sur la zone. Enfin, la<br />
recherche d’informations socio-économiques, environnementales et de biodiversité a permis<br />
de compléter la documentation fournie au départ de la mission.<br />
La composition pluridisciplinaire de l’équipe de consultants a été un facteur enrichissant des<br />
différents travaux parce que permettant une analyse croisée des aspects socio-économiques,<br />
environnementaux et de biodiversité. Une grille d’entretien servait de fil conducteur aux<br />
consultants pour animer les diverses rencontres et traiter des questions pertinentes.<br />
L’approche générale des consultants s’est voulue au plus près des différents acteurs concernés<br />
par la problématique afin de permettre une analyse au mieux de leurs aspirations et intérêts.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 20
6.2.2 La consultation du public<br />
La population concernée de près ou de loin par l’exploitation de l’UFA 10015 a été consultée<br />
par trois méthodes complémentaires dont les réunions publiques de consultation, l’enquête par<br />
questionnaire et l’interview des leaders.<br />
Les réunions publiques<br />
Au total 5 réunions ont été organisées dont 2 avec les Baka (Salapoumbé, Botolo) et 3 avec<br />
les Bantous (Ndongo, Adjala, Koumela). Ces réunions ont regroupé environ 200 participants<br />
dont près de 30 % de Baka et moins de 20 % de femmes (voir listes des participants en<br />
annexe). Les réunions ont été organisées et animées par l’approche participative et elles ont<br />
abouti presque toutes à un consensus et un échange fructueux de préoccupations et<br />
d’informations.<br />
Les enquêtes<br />
Au total, 161 paysans choisis au hasard ont été interrogés individuellement sur la base d’un<br />
questionnaire structuré de 30 questions fermées à 139 réponses possibles. Les questionnaires<br />
étaient administrés par 4 enquêteurs sélectionnés et formés au préalable sur comment et<br />
pourquoi mener l’enquête et comment dépouiller les réponses données. Les questionnaires ont<br />
été administrés jusque dans les villages où les réunions n’ont pas pu avoir lieu mais qui ont de<br />
près ou de loin des relations d’activités avec l’UFA concernée.<br />
L’échantillonnage<br />
L’échantillon de population consultée, soit environ 360 personnes sur un effectif total de<br />
population estimée à 21 000 personnes, donne un taux de sondage de l’ordre de 1,7 % de<br />
l’ensemble de la population, équivalent à 4,8 % de la population adulte.<br />
Les villages sélectionnés sont ceux dans lesquels les activités des populations ont une relation<br />
avec l’UFA, soit tous les 7 villages de l’axe Moloundou-Ndongo, les villages de Yenga,<br />
Mambélé, Koumela et le campement Baka de Botolo. L’indicateur utilisé pour savoir si les<br />
populations ont des activités dans l’UFA était l’existence des pistes d’accès.<br />
6.2.3 L’analyse des données<br />
La présentation du milieu a été faite selon une approche descriptive simple et une approche<br />
par analyse systémique.<br />
Les impacts ont été identifiés par les méthodes matricielles à base des listes de contrôle de<br />
LEOPOLD, BATELLE et SCHAENAM. Ces analyses objectives par rapport à<br />
l’identification des impacts ont été complétées par le point de vue exprimé par les paysans<br />
lors des réunions, des interviews ou dans les questionnaires.<br />
Les impacts ont été évalués sur la base des méthodes ad hoc et les méthodes ordinales de<br />
HOLMES. Ces analyses ont été complétées par la superposition des cartes thématiques.<br />
Les mesures d’atténuation ont été inspirées des entretiens avec les acteurs, des normes<br />
d’intervention en milieu forestier et des directives de l’Union Européenne et du Ministère des<br />
Travaux Publics en matière de travaux routiers.<br />
6.3 Les difficultés rencontrées<br />
Parmi les difficultés qui ont émaillé le déroulement de ce travail, on peut citer entre autres :<br />
• l’étendue de la zone d’étude : les distances très grandes entre les différents villages<br />
concernés (plus de 150 km parfois) avec une densité de population réellement très<br />
faible se répartissant le long des routes principales d’où des « villages » très étendus,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 21
• le mauvais état des routes (saison de pluies) n’était pas toujours favorable pour nos<br />
déplacements, ajouté aux obstacles (troncs d’arbres) qui obstruaient la circulation sur<br />
certaines pistes de pénétration;<br />
• l’agressivité de certains paysans qui a rendu certaines réunions et séances d’enquête<br />
particulièrement houleuses et émaillées d’invectives,<br />
• le manque de statistiques fiables dans les services publics,<br />
• la coïncidence des travaux de terrain avec la période de congé annuel de plusieurs<br />
responsables techniques ou administratifs de la zone.<br />
7 CONTEXTE DE L’ETUDE<br />
7.1 Contexte géographique et géomorphologique<br />
7.1.1 Localisation de l’UFA 10015<br />
1) Figure 1 : Localisation de l’UFA 10015<br />
Source : UTO Sud-Est<br />
L’UFA 10015 est située dans la province de l’Est, département de la Boumba et Ngoko,<br />
arrondissement de Moloudou. Géographiquement, cette entité est située entre 1°58 et 2°30 de<br />
latitude Nord et 14°50 et 15°15 de longitude Est. A l’échelle régionale, cette UFA se situe<br />
dans la zone de l’UTO Sud-Est et couvre une superficie de 130 272 hectares. Elle est limitée :<br />
• au nord et à l’ouest par le parc national de Boumba-Bek et Nki ;<br />
• au sud par une zone agr<strong>of</strong>orestière ;<br />
• à l’est par rivière Boumba et la forêt communale de Moloundou.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 22
7.1.2 Climatologie<br />
7.1.2.1 Pluviométrie<br />
L’UFA 10015 est sous l’influence d’un climat de type sub-équatorial à tendance équatoriale, à<br />
quatre saisons: la grande saison des pluies s'étend de septembre à novembre, alors que la<br />
petite saison dure de mars à juin. La grande saison sèche ensoleillée dure de décembre à<br />
février et la petite saison sèche nuageuse va de juillet à août. Les précipitations varient d'une<br />
année à l'autre, donnant ainsi une moyenne annuelle de 1.600 mm (± 100 mm).<br />
Les données de pluviométrie enregistrées sur Moloundou (380m d’altitude) sur 36 ans nous<br />
ont permis de construire l’histogramme des précipitations.<br />
2) Figure 2 : Histogramme de précipitations<br />
Histogramme de précipitation<br />
Hauteurs d'eau (mm)<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
J F M A M J Jt At S O N D<br />
Mois<br />
Source : Données météorologiques de Moloundou<br />
7.1.2.2 Température<br />
La température moyenne annuelle se situe autour de 24°C. Toutefois, dans le cadre de cette<br />
moyenne, les précipitations tendent à s’accroître de l’Est vers l’Ouest. A l’inverse, les<br />
températures moyennes mensuelles varient entre 23°C et 26°C et la température moyenne<br />
annuelle passe d’Est en Ouest, de 25°C à 24°C.<br />
7.1.2.3 Humidité relative<br />
L'humidité relative de l'air varie de 60 % en moyenne minimale journalière à 90 % en<br />
moyenne maximale journalière, avec des moyennes annuelles de l’ordre de 79 % à 85 % selon<br />
l’importance des brouillards, l’exposition aux vents dominants (quart SW/NW) et aux vents<br />
saisonniers (quart S/E), et les flux aérologiques et thermiques générés par les couloirs des<br />
fleuves Sangha et Ngoko.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 23
7.1.3 Topographie<br />
3) Figure 3 : Unités morphologiques de l’UFA (paysages)<br />
Source : ONFI , analyse de photo satellite<br />
Sur le plan géomorphologique, quatre sous unités se distinguent au sein de l’UFA 10015:<br />
• La moitié Sud-Ouest caractérisée par les collines à fortes pentes présentant une<br />
multitude de microbourrelets resserrés, avec bas fonds très encaissés. Cette bande<br />
occupe quasiment le tiers de l’UFA. Le relief y culmine autour de 600 m d’altitude.<br />
• La partie Nord-Est caractérisée par des pentes moyennes en bordure de la rivière<br />
Boumba et dont l’altitude varie de 400 m (au niveau de l’embouchure) à 480<br />
mètres.<br />
• Une bande médiane, zone de transition entre les parties nord-Est et Sud-Ouest<br />
présentant des collines à sommets aplatis.<br />
• Des vallées fluviales dans les extrémités Sud et Est en bordure de la rivière<br />
Boumba.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 24
7.1.4 Hydrographie<br />
4) Figure 4 : Réseau hydrographique<br />
Source : Atlas du Cameroun<br />
Le réseau hydrographique sur l’ensemble de l’UFA est assez dense. Cette entité est drainée<br />
par deux grands bassins versants dont celui du Dja dans sa moitié Sud Ouest et celui de la<br />
Boumba dans sa moitié Nord et Est.<br />
Le bassin versant de la Boumba est représenté ici par la rivière Bek (Lobéké en langue Baka),<br />
principal collecteur des ruisseaux dans la partie Nord Est de l’UFA. Cette rivière matérialise<br />
la limite naturelle entre le parc de Boumba-Bek et l’UFA.<br />
Le bassin versant du Dja est représenté par les rivières Bélé , Baka et Adjala qui prennent<br />
naissance au sein de l’UFA, traversent la zone agr<strong>of</strong>orestière du Sud (axe Moloundou-<br />
Ndongo) avant de rejoindre le Dja sur la frontière avec le Congo.<br />
La rivière Boumba 1<br />
Le régime hydrologique est un régime équatorial de transition. La rivière Boumba qui a une<br />
très grande influence dans la zone a un parcours beaucoup plus direct et un pr<strong>of</strong>il en long plus<br />
régulier. La végétation aquatique qui longe ses bordures sur de grandes distances ainsi que la<br />
présence de nombreux rapides le long de son cours constituent de véritables entraves à sa<br />
navigation, possible cependant au niveau de l’embouchure sur une longueur de 10 à 15 km.<br />
Les variations de débit sont dans l’ensemble calquées sur les différentes saisons de l’année.<br />
Les deux pointes de crues (petite et grande saison de pluie) sont toutefois différentes et les<br />
étiages inégaux. En saison de pluie 2 , les hauteurs quotidiennes de précipitations sont<br />
1 Pendant cette étude, il ne nous a pas été possible d’obtenir des données hydrologiques assez précises sur cette<br />
rivière.<br />
2 Période pendant laquelle l’étude à été conduite.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 25
suffisamment importantes pour augmenter nettement les débits journaliers. On assiste à des<br />
débordements du lit normal sur plus de 150 m (au niveau de l’embouchure). En Juillet et<br />
Août, avec le début de la petite saison sèche, le niveau des eaux reste tout de même supérieur<br />
à celui de l’étiage de saison sèche.<br />
7.1.5 Géologie<br />
5) Figure 5 : Géologie de l’UFA<br />
Source : Atlas du Cameroun<br />
La zone de l’UFA est composée de formations précambriennes de la série du Dja inférieur.<br />
Les formations géologiques présentes dans la zone d’étude sont:<br />
1. Les schistes et les grès quartzites du Bek. Ces formations peu ou pas métamorphiques<br />
ont été observées sur l’axe Moloundou-Yokadouma, sur la rivière Bek et sur le Dja<br />
inférieur. On regroupe dans cette classe :<br />
• des grès quartzites ocres passant à des quartzites plus francs gris bleu avec par<br />
endroit du faciès tufogène ;<br />
• Des bancs de schistes très argileux, jaune ocre à rouge saumon intercalés dans<br />
les grès quartzites de la rivière Bek. Plus à l’ouest (dans les bordures de la<br />
rivière Boumba), les schistes prédominent avec un faciès sériciteux plus<br />
métamorphique.<br />
2. Des intrusions doléritiques importantes orientées Sud-ouest – Nord-est (voir carte<br />
géologique de l’UFA) traversant l’UFA dans sa partie Nord Ouest et le parc de<br />
Boumba-Bek et Nki dans sa partie Est et qui confèrent un caractère particulier à toute<br />
la région. Ces intrusions se présentent sous des aspects très variés allant du Gabbro<br />
doléritique à la dolérite franche avec des faciès schisteux dans les bas fonds.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 26
3. Un complexe tillitique dans la partie sud de l’UFA où on retrouve :<br />
• des schistes brun foncé à noir à clivage ardoisier ;<br />
• des schistes argileux, détritiques, parfois légèrement conglomératiques à<br />
inclusion des quartz, feldspath.<br />
• des calcschistes, des talcschistes de couleur brun foncé ou gris bleu avec de<br />
nodules et filonnets de calcite.<br />
Toutes ces formations sont recouvertes en bas relief par des alluvions d'âge quaternaire. Il faut<br />
noter d’autre part que la géologie de la zone présente des sites potentiels pouvant servir de<br />
zone d’emprunt de matériaux latéritiques nécessaires pour la réhabilitation de la route<br />
existante et l’aménagement de nouveaux tronçons. Des bancs d’emprunt existants sont<br />
localisés le long de la piste à réhabiliter.<br />
7.1.6 Pédologie<br />
6) Figure 6 : Pédologie de l’UFA<br />
Source : Atlas du Cameroun<br />
Une mosaïque de sols ferrallitiques se superpose à ces formations géologiques. Dans un ordre<br />
de fertilité croissante, il s'agit des sols rouges à rouges vifs, les bas-fonds sous-forêt, les<br />
marécages. Les salines herbeuses et les bordures inondables des cours d'eau telles que la<br />
Boumba sont occupés par des sols hydromorphes (à gley, tourbeux ou alluviaux).<br />
Dans la zone de l’UFA, on peut distinguer deux types de sols :<br />
• Les sols ferralitiques rouges dérivés de roches métamorphiques qui représentent<br />
l’essentiel des sols de la zone. Ces sols sont caractérisés par un pourcentage d’argile<br />
variant entre 10 et 50% alors que les limons ne dépassent pas 8%, les sables (fins et<br />
grossiers) représentent la fraction la plus élevée de la terre fine (40-80%). Ces sols<br />
présentent une certaine uniformité dans la disposition des horizons, proche de celle<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 27
des sols ferralitiques jaunes. Leur structure, moins compacte, paraît néanmoins plus<br />
stable. Les teneurs en matière organique sont voisines de 2% en surface, les teneurs en<br />
azote total sont faibles (0.07% à 0.1%). Le rapport C/N est compris entre 10 et 14, les<br />
teneurs en humus entre 0.1 et 0.4.<br />
Le pH est compris entre 5 et 6. Les teneurs en bases échangeables sont faibles (1 à 3<br />
méq/100g), mais les réserves minérales sont un peu plus élevées (10 à 15 méq/100g de<br />
calcium, 0.5 à 5 de magnésium, .0.4 à 1.5 de potassium. Le phosphore total varie de 0.5 à 2%.<br />
• Les sols ferralitiques rouges dérivés de roches basaltiques avec des teneurs en<br />
dolérites par endroits et dont la localisation est calquée sur les bandes doléritiques Sud<br />
ouest- Nord Est susmentionnés 3 .<br />
Ces sols férralitiques rouges encore appelés ultisols sont des sols acides très pr<strong>of</strong>onds et bien<br />
drainés, qui constituent un excellent support et donc sont peu sensibles à l’érosion.<br />
7.1.7 Le réseau routier<br />
7) Figure7 :Réseau routier montrant la piste d’évacuation du bois de l’UFA 10015.<br />
Source : <strong>JMN</strong> Consultant<br />
Le réseau routier dans la région est constitué d’un axe principal (Yokadouma-Moloundou)<br />
auquel se connectent des axes secondaires. Ces axes secondaires sont pour la plupart des<br />
pistes créées par les sociétés forestières. Ces pistes forestières considérées comme privées<br />
sont pour la majorité carrossables en toute saison en raison de leur perpétuel repr<strong>of</strong>ilage.<br />
3 Voir Pédologie de la zone<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 28
Un réseau de pistes piétonnes ou pistes vicinales utilisées par les villageois dans leurs<br />
activités quotidiennes se relient à ces différents axes. Ces pistes lorsqu’elles ne sont pas<br />
créées par des villageois sont dans certains cas des anciennes pistes forestières abandonnées<br />
après l’exploitation.<br />
Dans la zone de l’UFA 10015, il existe une bretelle de pénétration sur l’axe Moloudou-<br />
Ndongo niveau du village Légwé. Cette piste est actuellement utilisée par la société Boumba<br />
Safaris amodiataire de la ZIC N°38, superposée à l’UFA. Une autre voie d’accès est<br />
l’ancienne piste administrative Koumela- embouchure Boumba-Bek dont la réhabilitation fait<br />
partie du présent projet.<br />
Justification de la réhabilitation de la route Koumela- embouchure Boumba-Bek<br />
L’UFA 10015 constitue aujourd’hui une nouvelle source d’approvisionnement du Groupe<br />
VICWOOD THANRY. Pour des raisons économiques et pour pérenniser les activités de<br />
transformation au niveau du site de Lokomo, il est nécessaire que les productions issues de<br />
cette zone soient évacuées par le chemin le plus court vers Lokomo.<br />
L’autre solution qui consisterait à sortir de l’UFA par le Sud à partir de l’assiette de coupe<br />
N°1 (attribuée à l’extrême Nord Est) verrait non seulement la distance multipliée par 4 voire<br />
5, mais aussi entraînerait, en raison des distances de roulage plus grandes, les risques de<br />
braconnage et de pollution malgré les mesures d’atténuation qui pourraient être prises.<br />
Ainsi, la non réhabilitation de cette ancienne piste et l’interdiction de rouler les productions<br />
qui y est attachée provoqueraient non seulement une perte économique majeure pour<br />
l’entreprise, mais également une augmentation des impacts négatifs liés au transport à partir<br />
de l’assiette 1.<br />
Tracé de la route.<br />
La route Koumela-embouchure existe déjà. C’est une ancienne piste forestière ouverte il y a<br />
environ 30 ans par la SIBAF dans le cadre de ses anciennes licences d’exploitation. En raison<br />
du fait que celle-ci est de nos jours très peu pratiquée par les véhicules, son utilisation<br />
nécessite une réhabilitation préalable. Cette réhabilitation se fera à l’aide des engins de<br />
travaux publics appartenant au Groupe VICWOOD THANRY, sachant que la présente étude<br />
fera ressortir les impacts liés à la modification envisagée du tracé.<br />
7.2 Le milieu biologique<br />
7.2.1 La flore<br />
La végétation typique dans la zone de l’UFA 10015 est celle d’une forêt guinéo-congolaise<br />
sempervirente de basse altitude. D’après les travaux de M. LETOUZEY, les formations<br />
végétales appartiennent à deux types forestiers :<br />
• la forêt semi-décidue ;<br />
• un type de forêt intermédiaire entre la forêt semi-décidue et la forêt sempervirente du<br />
Dja<br />
7.2.1.1 La forêt semi-décidue à Sterculiaceae et Ulmaceae<br />
Elle est caractérisée par la dominance des grands arbres appartenant soit aux Sterculiaceae,<br />
soit aux Ulmaceae. Cette forêt gagne du terrain sur la forêt sempervirente du Dja à la faveur<br />
des défriches.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 29
La physionomie de cette forêt semi-décidue est différente de celle de la forêt sempervirente<br />
par l’abondance de grands arbres au fût rectiligne et par la caducité prolongée du feuillage de<br />
la plupart d’entre eux. D’autres caractéristiques entrent en ligne de compte, telles la moindre<br />
abondance d’épiphytes et les variations floristiques du sous étage.<br />
Floristiquement cette forêt est caractérisée par les :<br />
• Sterculiaceae dont les principales sont Mansonia altissima, Nesogordonia<br />
papaverifera, Triplochiton scleroxylon, Sterculia spp, Cola spp. ;<br />
• Ulmaceae qui sont essentiellement représentées par les espèces du genre Celtis<br />
dont les plus fréquentes sont : Celtis mildbraedii, Celtis adolfi-friderici, Celtis<br />
zenkeri.<br />
D’autres espèces prennent aussi une place importante au sein de cette forêt : Piptadeniastrum<br />
africanum et Terminalia superba, espèces colonisatrices et dynamiques de cette forêt qui se<br />
rencontrent très loin (à moindre fréquence) en forêt sempervirente.<br />
Enfin, sont à citer deux espèces formant la richesse de cette forêt : Entandrophragma<br />
cylindricum et Pericopsis elata.<br />
i. Photo : Une vue aérienne du couvert végétal (PhotoErith Ngatchou)<br />
7.2.1.2 La forêt semi-décidue à Sterculiaceae et Ulmaceae avec éléments de la forêt<br />
du Dja<br />
Il s’agit d’un type de transition, nettement semi-décidu tout en présentant de nombreuses<br />
espèces de forêts sempervirente (Alstonia boonei, Cylicodiscus gabonensis, Pentalethra<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 30
macrophylla, Scorodophloeus zenkeri, ainsi de de nombreuses Irvingiaceae : Klainedoxa<br />
gabonensis, Irvingia excelsa, Irvingia gabonensis, Irvingia grandifolia)<br />
Le rapport d’une étude sur la végétation des baïs/savanes dans le parc de Boumba-Bek menée<br />
par Paul NOUPA confirme la présence d’au moins deux baïs à l’extrême nord de l’UFA. Ces<br />
baïs selon BOBO (2002) sont tous dominés par Rynchospora corymbosa souvent associé à<br />
Vernonia conferta, Acacia penneta et aux fougères. Quelques ligneux notamment le Fraké et<br />
le Baya ont été observés dans certains baïs en voie de disparition.<br />
L’ensemble des baïs jusqu’à lors identifiés couvrent une superficie de 36,10 ha soit 20,6 ha<br />
pour le complexe de Kopandako et 15,5 ha pour le complexe de Sokolibombo.<br />
De par ce qui est techniquement exploitable sur le terrain et en usine, c’est un mélange de<br />
bois rouges/bois blancs peut garantir un volume commercialisable de l’ordre de 10 ± 5 m 3 /ha.<br />
7.2.2 La faune<br />
8) Figure 8 : Quelques sites critiques identifiés<br />
Source : Etude BOBO et carte <strong>JMN</strong> Consultant<br />
L’UFA 10015 abrite une faune assez riche et diversifiée, ce qui justifie entre autre la mise en<br />
affermage de cette aire à un guide de chasse pr<strong>of</strong>essionnel. Cette richesse très accentuée dans<br />
sa partie Nord Ouest est largement tributaire non seulement de sa proximité du futur parc de<br />
Boumba-Bek et Nki, mais aussi des difficultés d’accès à cette zone même si on relève<br />
quelques activités de chasse de subsistance dans sa limite Sud et Est (en bordure de la rivière<br />
Boumba).<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 31
ii.<br />
Photo chimpanzé (photo Erith Ngatchou)<br />
7.2.2.1 La faune mammalienne<br />
9) Figure 9 : Quelques traces d’activités des mammifères<br />
Source : Etude BOBO et carte <strong>JMN</strong> Consultant<br />
Les complexes de Kopandako et Sokolibombo situés dans la partie du sud de l'UFA<br />
renferment pratiquement toutes les espèces de cette UFA avec des densités assez élevées.<br />
Un couloir de migration pour éléphants et buffles a été mis en évidence, allant de Bakodo et<br />
orienté selon un axe Nord-Nord-Ouest - Sud-Sud-Est, passant par Kopandako, puis vers<br />
l'ouest par Sokolibombo et par le baïs situé à 2°11,03'N, 14°49,47'E.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 32
Ainsi de manière globale, on peut citer à titre d'exemple, comme grands mammifères recensés<br />
dans cette UFA: les éléphants, les gorilles, les buffles, les chimpanzés, les cobes, les<br />
panthères, les bongos, les sitatunga, etc.<br />
7.2.2.2 L’avifaune<br />
Ce site est particulièrement riche en Lépidoptères. Quatre vingt seize espèces de papillons<br />
appartenant à dix sept familles ont été recensées. Une étude comparative de la richesse des<br />
Lépidoptères obtenus dans différentes zones de l’UFA indique une plus grande diversité dans<br />
la zone de Kopandako et sur l’axe Ndongo-Kopandako.<br />
Deux espèces observées sont globalement menacées et portent respectivement le statut UICN<br />
(2000) de «Presque Menacée» (le canard de Hartiaub Pteronetta hartiaubji) et de<br />
«Vulnérable» (la fauvette du Dja Bradypterus grandis). Deux autres espèces recensées ont une<br />
distribution restreinte sur le plan mondial, en l'occurrence l'hirondelle de forêt Hirundo<br />
fuliginosa et la Fauvette du Dja Bradypterus Grandis.<br />
7.3 Contexte socio-économique<br />
7.3.1 Démographie et Répartition<br />
La province de l’Est est la plus grande en superficie (109002 Km² soit 22,9% du territoire<br />
camerounais) et la moins peuplée (692 183 habitants soit 4,5% de la population totale<br />
camerounaise). La densité est de l’ordre de 6,35 hab/km² (MINPAT – Projet PNUD-OPS,<br />
1997).<br />
Le département de la Boumba et Ngoko et l’arrondissement de Moloudou qui abritent la zone<br />
de l’UFA 10015 n’en sont pas épargnés. Les estimations faites sur la base du recensement<br />
démographique 4 de 1987 en ce qui concerne la situation démographique actuelle font ressortir<br />
la même caractéristique.<br />
a) Tableau 1:Données Démographiques.<br />
Unités<br />
Superficie (en Populations Taux de Population en Densité<br />
administratives km²)<br />
(1987)<br />
croissance (%) 2002<br />
hab/km²<br />
Moloundou* 12467 23122 3,8 57322 4,6<br />
Total Département 30 329 79925 3,8 139844 4,6<br />
*L’arrondissement de Moloundou englobe le district de Salapoumbé récemment créé (1995). La population de la<br />
commune de Salapoumbé, estimée à la date de création à 2000, avoisinerait les 2771 d’après nos calculs.<br />
Source : RGPH 1987.<br />
Au regard de ces sources d’informations, l’arrondissement de Moloundou aurait enregistré<br />
une forte croissance démographique (3,8% par an entre 1987 et 2002, contre 2,9% pour la<br />
Province de l’Est et 2,8% au niveau national), croissance liée au boom de l’exploitation<br />
forestière entre 1990 et 1999. La population serait passée de 23122 habitants en 1987 à<br />
environ 57322 habitants en 2002 5 . Ce boom démographique s’explique par la présence dans la<br />
zone des entreprises forestières qui sont à l’origine des migrations de travail, l’arrivée de<br />
commerçants et autres chercheurs d’emplois. Des cas d’exode urbain sont également<br />
4 Au moment de la rédaction de ce rapport, les résultats d’enquête ECAM 2001 n’étaient pas encore disponibles.<br />
5 Estimations faites à partir du taux de croissance et des chiffres du recensement de 1987.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 33
enregistrés. La crise qu’a connu le Cameroun ces dernières années et le chômage qu’elle a<br />
engendré ont notamment favorisé cette situation.<br />
Les densités de population dans la zone (3,6 habitants au km² pour l’arrondissement de<br />
Moloundou) sont les plus faibles du pays. Ce faible taux de peuplement est visible sur le<br />
terrain par l’aspect clairsemé de l’occupation humaine 6 .<br />
Dans la zone d’étude, on dénombre une vingtaine de villages et hameaux. L’effectif de la<br />
population habitant les axes qui ceinturent l’UFA (de Koumela au nord-est à Ndongo au sud-<br />
Est en passant par Moloundou) peut être estimé à 21 080 habitants 7 .<br />
b) Tableau 2 : Population par village et répartition par groupe<br />
Localité Hommes % Femmes % Total<br />
Salapoumbé 1390 50,2 1381 49,8 2771<br />
Makoka 1 335 50,3 331 49,7 666<br />
Makoka 2 209 21,1 781 78,9 990<br />
Mambélé 471 48,1 509 51,9 980<br />
Mangobé1 709 49,4 727 50,6 1436<br />
Mangobé2 260 48,6 275 51,4 535<br />
Mbateka 967 52,1 888 47,9 1855<br />
Mbangoye 53 38,4 85 61,6 138<br />
Nguilili 492 51,0 473 49,0 965<br />
Yenga 1182 48,6 1248 51,4 2430<br />
Banana 310 48,4 330 51,6 640<br />
Bela 233 42,4 317 57,6 550<br />
Adjala 355 48,0 384 52,0 739<br />
Légwé 194 53,6 168 46,4 362<br />
Mindourou 143 49,8 144 50,2 287<br />
Ndongo 293 55,1 239 44,9 532<br />
Tembé 138 59,7 93 40,3 231<br />
Mikel 1196 48,4 1273 51,6 2469<br />
Koumela 851 48,6 899 51,4 1750<br />
Dioula 393 52,1 361 47,9 754<br />
Total 10174 10906 21080<br />
Sources : Estimations faites à partir du recensement de 1987et des données de la mairie de Salapoumbé.<br />
7.3.2 Les établissements humains et l’habitat<br />
7.3.2.1 Les établissements humains<br />
Plusieurs types d’établissements humains se distinguent dans la zone : les villes, les villages<br />
les hameaux et les campements et les sites industriels.<br />
Les villes, villages, campements<br />
Les villes ici sont représentées par les chefs-lieu d’arrondissement et de district dont<br />
Moloundou et Salapoumbé. Entre les deux localités s’égrènent le long de l’axe principal<br />
6 En dehors de quelques campements pygmées existant dans la forêt, les installations humaines sont<br />
essentiellement concentrées le long de l’axe principal.<br />
7 Résultats d’enquêtes.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 34
(Yokadouma–Moloundou) un certain nombre de villages, hameaux et campements de tailles<br />
variables. Cette occupation humaine connaît une extension en aval de la Ngoko, vers Ndongo<br />
à partir de Moloundou . De fortes concentrations humaines sont observées au niveau des<br />
raccordements qui mènent dans les sites industriels, notamment à Momboué Carrefour vers<br />
Lokomo SEBC, à Koumela Carrefour vers Libongo SEFAC, à Mambélé, piste forestière<br />
PK27 vers Kika SIBAF ou vers Socambo , à Nguilili, piste forestière PK14 vers Kika ou vers<br />
PK27.<br />
En marge des villes sus-citées, il existe des cités frontalières telles que Ouesso et Ngwalla<br />
située sur l’autre rive de la rivère Ngoko, (à quelques kilomètres de Moloundou dans<br />
l’extrême septentrion de la République du Congo). La proximité de ces cités et l’importance<br />
des flux humains du coté du Cameroun expliquent le brassage des populations au niveau de<br />
la ville de Moloundou et des villages environnants.<br />
D’autres types d’établissements humains sont les campements des braconniers. Ce type<br />
d’installation est généralement retiré des axes fréquentés et sert d’abris et de lieux de semiconditionnement<br />
(boucanage) des gibiers braconnés.<br />
iii. Camp de braconniers en pleine forêt (Photo Ge<strong>of</strong>froy De Gentile sur la ZIC 31/UFA 10.064)<br />
Par définition, ce sont des installations précaires et itinérantes qui sont abandonnées ou<br />
détruites en fonction de la dynamique de la faune dans le milieu ou de la lutte antibraconnage.<br />
iv.<br />
Opération de destruction d’un camp de braconniers par la brigade pygmée de Lonia (Photo<br />
G.de Gentile sur la ZIC 31/UFA 10.064)<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 35
Les sites industriels<br />
Les sites industriels qui abritent les installations de transformation (scieries) et les bases vies<br />
induisent la création, dans leur entourage, des cités cosmopolites. Ces sites constituent des<br />
pôles de développement économique en plein cœur de forêt. Les habitants de telles cités sont<br />
un mélange d’autochtones et d’allogènes nationaux (qui pour certains arrivent avec leurs<br />
familles) ou expatriés.<br />
7.3.2.2 L’habitat<br />
Avec la sédentarisation imposée par l’administration coloniale, l’habitat dans la région est<br />
caractérisée par un agencement de villages, hameaux et campements alignés le long de l’axe<br />
central. Dans les villages et campements permanents, les habitations en poto-poto et les<br />
cases à cloisons végétales (rectangulaires; igloos végétales « moungoulou ») se côtoient (les<br />
pygmées adoptent de plus en plus l'habitat rectangulaire des Bantous).<br />
Toutefois, en périphérie des chantiers forestiers, les habitations construites à partir de débités<br />
ou de rebut de scieries recouvertes soit en pailles, soit en tôles, dominent largement. Les<br />
constructions en dur appartiennent pour l'essentiel à l'Administration ou aux privés (sociétés<br />
forestières, quelques planteurs, commerçants, retraités).<br />
Les huttes et les cases façonnées à l’aide d’écorces d’arbres, branches et feuilles sont<br />
essentiellement la propriété des pygmées.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 36
v. Case traditionnelles pygmée « Moungoulou »<br />
Source : photo Erith Ngatchou<br />
7.3.2.3 Origines et peuplement<br />
Le peuplement de la zone d’étude est assez cosmopolite. Plusieurs ethnies y sont représentées.<br />
Les autochtones sont constitués par les Bantous et les Pygmées Baka. Les premiers sont<br />
sédentaires, alors que les Pygmées pratiquent encore le semi-nomadisme, allant des villages à<br />
la forêt en fonction des saisons et des collectes à y opérer. Les peuples Bantous et Pygmées<br />
vivent généralement ensemble dans les mêmes villages, même si les Baka se singularisent<br />
parfois en créant de petits campements distincts, mais plus ou moins greffés à des villages<br />
bantous. Les Pygmées se retrouvent pratiquement dans toutes les installations humaines.<br />
Relativement à la répartition ethnique de la population, les Baka représentent environ 60 %<br />
des autochtones dans la zone d’étude (axe Salapoumbé -Moloundou- Ndongo). Parmi les<br />
Bantous, on retrouve les Bakwélé (Essel) dans la zone de Moloundou et précisément sur l’axe<br />
Moloundou-Ndongo, les Bangando dans le secteur allant de Salapoumbé à<br />
Moloundou. Quelques allogènes nationaux tels que les Kounabembé, Mbimou , Kako et<br />
Mvong- Mvong venant du septentrion du département y sont également recensés.<br />
Ces allogènes viennent de toutes les régions du Cameroun et travaillent, soit dans les<br />
administrations, soit dans les sociétés forestières ou les safaris, soit dans des commerces ou<br />
sont tout simplement à la quête de travail.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 37
vi.<br />
Cases rectangulaires pygmée en écorces (Photo Erith Ngatchou)<br />
Source : photo Erith Ngatchou<br />
Sur les sites industriels, les allogènes sont généralement représentés par des cadres africains<br />
ou expatriés, des employés spécialisés, qui dans certains cas s’installent avec leurs familles.<br />
On trouve aussi des ressortissants des pays étrangers ouest africains (Mauritaniens, Maliens,<br />
Sénégalais, Nigérians) qui pratiquent plus le commerce, et quelque fois la pêche (Nigérians et<br />
surtout des Sénégalais installés en bordure des rivières Dja et Ngoko).<br />
D’autres étrangers à l’instar des Congolais et Centrafricains sont également recensés dans la<br />
zone de Moloundou, mais ceux ci font essentiellement des incursions journalières ou<br />
périodiques pour des raisons de trafic minier (Centrafricains), de braconnage/chasse<br />
commerciale ou tout simplement pour des raisons de ravitaillements en produits vivriers et<br />
d’autres denrées.<br />
Dans l’ensemble, l’émigration est assez faible du fait de la faiblesse des ambitions des<br />
populations et des possibilités d’emploi qu’<strong>of</strong>frent les sociétés forestières et quelques fois les<br />
sociétés de safaris. Les modes de vie restent en majorité ceux du monde rural, mais de<br />
nouveaux besoins (emplois, alimentation) génèrent de plus en plus la délinquance, la<br />
prostitution et l’alcoolisme 8 .<br />
7.3.2.4 Structure et organisation sociale<br />
L’organisation sociale est celle des peuples de la forêt, de type acéphale ou segmentaire. Les<br />
villages sont constitués de familles appartenant à un ou plusieurs lignages, qui fonctionnent de<br />
manière autonome. Le patriarcat est l’organe informel de régulation et de gestion de la<br />
8 L’alcoolisme est un des fléaux qui participent aujourd’hui à miner les peuples Bakas.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 38
société. Chaque clan a à sa tête un chef bantou choisi par l’administration. La chefferie est<br />
une réalité récente introduite par la colonisation et le chef de ce fait n’exerce pas une réelle<br />
autorité sur les populations. Il représente plus le lien entre les populations et l’Administration<br />
dont il constitue le pilier de base.<br />
Chez les Baka, la structure sociale est encore plus restreinte car le plus souvent limitée à la<br />
famille. Le semi-nomadisme accentue encore la liberté chez ces peuples de la forêt, liberté<br />
dont les Bantous sont extrêmement jaloux.<br />
L’organisation segmentaire n’est pas favorable aux regroupements, d’où la jeunesse, la<br />
fragilité et le manque d’expérience des associations dans le milieu (cas des COVAREF).<br />
L’instauration du versement de 10% des recettes forestières en faveur des populations a<br />
également été à l’origine de la création de quelques comités de développement même si la<br />
quasi totalité ne sont pas légalisés, encore moins fonctionnels. Ces comités qui n’existent en<br />
réalité que de nom éprouvent de véritables difficultés à exprimer leurs besoins ou à identifier<br />
des projets communautaires viables dans l’optique d’une valorisation des retombées.<br />
Comme on peut le constater, les initiatives de regroupement sont toujours venues de<br />
l’extérieur et non des populations elles-mêmes, et sont liées à l’espoir d’un financement ou du<br />
partage de la manne forestière.<br />
7.3.2.5 Religions et croyances.<br />
Sur le plan religieux, cette zone est fortement influencée par les congrégations américaines<br />
venant du coté du Congo et du Centrafrique. Néanmoins, on recense quelques chrétiens<br />
catholiques et protestants ainsi que des musulmans.<br />
7.3.3 Institutions et parties prenantes dans la zone d’étude<br />
7.3.3.1 L’administration publique<br />
La zone de l’UFA 10015 relève administrativement de l’arrondissement de Moloundou, mais<br />
un certains nombre de villages proche de cette UFA notamment Koumela et Salapoumbé<br />
appartiennent au district de Salapoumbé.<br />
L’arrondissement de Moloundou abrite un certain nombre de services publiques dont la souspréfecture,<br />
la brigade de gendarmerie, le commissariat de sécurité publique, l’inspection de<br />
l’éducation primaire et maternelle, le district de santé, la DAA 9 , le poste forestier et de chasse,<br />
les services de l’économie et des finances (l’inspection des douanes), les services d’émiimmigration.<br />
Le district de Salapoumbé dispose des services tels la Mairie, la brigade de gendarmerie,<br />
l’inspection de l’éducation primaire et maternelle, le poste forestier et de chasse, la<br />
perception.<br />
7.3.3.2 L’Unité Technique Opérationnelle du Sud Est<br />
L’ UTO est une structure créée en vue de favoriser la cohésion des interventions des différents<br />
services classiques du Ministère de l’Environnement et des Forêts et celles des projets de<br />
conservation et de gestion durable de la biodiversité opérant dans la région du sud-est<br />
Cameroun. L’UTO Sud-Est renforce la coordination et la capacité d’intervention des<br />
structures locales du MINEF à travers l’assistance technique des organismes internationaux<br />
notamment WWF et GTZ.<br />
9 Délégation d’Arrondissement d’Agriculture<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 39
Conformément aux dispositions légales de l’arrêté N° 055/PM du 06 Août 1999, l’UTO Sudest<br />
chargé de :<br />
• Superviser la création des parcs nationaux de Lobéké, Boumba-Bek et Nki ;<br />
• Assurer la gestion desdits parcs nationaux ;<br />
• Développer les processus de gestion durable des ressources forestières et fauniques dans<br />
la zone d’utilisation multiple (zone tampon) ;<br />
• Promouvoir la participation des communautés locales à la gestion de la biodiversité ;<br />
• Coordonner les actions de police forestière et de chasse ;<br />
• Elaborer des plans d'aménagements dans le cadre d'un aménagement intégré global de sa<br />
zone de compétence au Sud-Est Cameroun.<br />
• Promouvoir les activités d’écotourisme.<br />
Sur le plan administratif, l'UTO Sud-Est est placée sous l'autorité d'un Conservateur, ayant<br />
également la fonction de Délégué Départemental de l'Environnement et des Forêts de Boumba<br />
et Ngoko. Le Conservateur de l’UTO, ayant rang et prérogative de Délégué Départemental,<br />
dépend administrativement du Délégué Provincial du MINEF (Bertoua).<br />
La planification, le suivi et l'évaluation des activités sont assurés par un Comité de Gestion<br />
composé du Délégué Provincial de l'Environnement et des Forêts de l'Est, du Conservateur de<br />
l'UTO Sud-Est, du Délégué Départemental de l'Environnement et des Forêts du Haut-Nyong,<br />
des Responsables des Projets de Conservation (WWF, GTZ), avec possibilités d’ouvrir le<br />
Comité à des personnes externes.<br />
Un « Comité de Pilotage » (constitué du Conservateur de l’UTO et des conseillers techniques)<br />
est chargé de la coordination et de la gestion des activités ainsi qu’un « Comité local de suivi<br />
des sites » présidé par le Gouverneur de la Province de l’Est et composé des représentants de<br />
toutes les parties prenantes (MINEF, exploitants forestiers, agro-industriels, populations<br />
locales et riveraines, …).<br />
L’UTO a pour attribution de coordonner les actions/activités des agents MINEF en matière de<br />
contrôle forestier et faunique. En tant que service extérieur de renforcement du MINEF, et<br />
compte tenu de ses attributions de coordination et non d’exécution, l’UTO est une structure<br />
intermédiaire et complémentaire entre la Délégation Provinciale de l’Environnement et des<br />
Forêts de l’Est, les Délégations Départementales de l’Environnement et des Forêts de<br />
Boumba & Ngoko et du Haut-Nyong, et toutes les autres parties prenantes.<br />
Les vocations premières de l’UTO administrative sont :<br />
• de s’assurer de la bonne exécution et cohésion des programmes développés par toute<br />
structure exécutive au sein de son secteur (implication et accroissement des<br />
compétences des services extérieurs du MINEF, intégration concertée et mise en<br />
cohésion des activités/actions de toutes les parties prenantes impliquées);<br />
• de capitaliser et de pérenniser en toute cohérence les acquis des projets de l’assistance<br />
technique WWF/GTZ, des exploitants forestiers, des opérateurs de tourisme Safari,<br />
des parcs Nationaux et des communautés locales.<br />
Les activités du WWF concernent :<br />
• les inventaires biologiques<br />
• l’appui à la création et la gestion des aires protégées<br />
• la promotion et la gestion durable des zones périphériques avec la participation de tous<br />
les acteurs<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 40
• la recherche des solutions pour limiter les effets négatifs de l’exploitation forestière sur<br />
la recherche des ressources naturelles.<br />
Les actions de la GTZ concernent :<br />
• l’amélioration de la participation active de tous les acteurs au processus d’actualisation<br />
du zonage ;<br />
• la vulgarisation de la politique et la loi forestière auprès des acteurs, surtout la<br />
population ;<br />
• la sensibilisation de la population sur les méfaits de la sur-exploitation des ressources<br />
forestières et fauniques ;<br />
• la recherche et la promotion des sources de protéines alternatives ainsi que des activités<br />
génératrices de revenus en vue de détourner les populations du braconnage ;<br />
• l’amélioration de la prise en compte des intérêts des communautés riveraines dans<br />
l’aménagement des aires protégées, des UFA et des ZIC.<br />
7.3.3.3 L’Association pour l’Autopromotion des Peuples de l’Est Cameroun (AAPEC).<br />
C’est une association catholique inter diocésaine, fondée à l’initiative de Mgr Van Negen, qui<br />
oeuvre pour le développement participatif des populations marginalisées.<br />
Le but de cette association, à sa création, était d’aider les missionnaires à s’occuper des<br />
peuples pygmées. Au fil du temps, cette association s’est ouverte aux peuples Bantous.<br />
L’aire de couverture de cette association est subdivisée en neuf zones dont : Moloundou,<br />
Salapoumbé, Madjoué, Ngato, Nguilili, Midourou, Djoum, Abong bang, Lomié.<br />
Les actions d’encadrement des populations regroupent plusieurs volets parmi lesquels la<br />
santé, l’éducation de base, l’agriculture, le genre et développement, la justice et paix. Un<br />
cadre restreint appelé « mission vision », de création récente est constitué de quelques<br />
membres des différentes zones.<br />
Les actions développées dans le volet santé sont généralement préventives à l’instar des<br />
campagnes de vaccinations dans les villages et campements, de l’hygiène et assainissement. Il<br />
est à noter que les consultations et soins apportés aux malades sont payés au franc<br />
symbolique. Toutefois, la nouvelle politique mise en place par les sœurs catholiques vise à<br />
amener les populations, en l’occurrence les Bakas, à contribuer à leurs soins de santé en dépit<br />
du fait que cela se heurte à beaucoup de réticences.<br />
Dans le volet agriculture, l’amélioration des techniques culturales et la promotion du petit<br />
élevage constituent le principal cheval de bataille. Pour ce qui est du volet genre et<br />
développement, les actions visent à favoriser le mouvement associatif 10 , à promouvoir l’esprit<br />
d’entreprise chez la femme, la mise en place des systèmes de tontines qui constituent une<br />
forme d’épargne.<br />
Sur le plan de l’éducation, l’AAPEC a construit onze (11) centres d’éducation de base. La<br />
méthode pédagogique pratiquée dans ces centres est la méthode « ORA » qui signifie :<br />
Observer, Réfléchir, Agir. Les élèves à la sortie de ces centres doivent être capables de lire,<br />
écrire et compter avant d’accéder à l’éducation primaire.<br />
Pour l’année scolaire 2001-2002, les effectifs s’élevaient à 704 inscrits en début d’année.<br />
Néanmoins, les taux de déperdition sont assez importants en raison de la culture nomade des<br />
pygmées (migrations des parents en période de sécheresse) et à l’abnégation des enfants qui<br />
ne permettent pas toujours d’obtenir de bons résultats. 11 Certaines difficultés également<br />
10 A l’instar de l’association « Alliance » constituée de 25 femmes Baka de Salapoumbé<br />
11 Remarques de la Sœur Généviève AUBRY, une des responsables de l’AAPEC.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 41
encontrées résident dans l’absence d’une volonté réelle des parents d’instruire leur<br />
progéniture. Ceci est non seulement vrai chez les Baka, 12 mais aussi chez les bantous.<br />
7.3.4 Les infrastructures socio-économiques<br />
7.3.4.1 L’éducation<br />
La province de l’Est est celle qui présente les taux de scolarisation les plus bas du pays. Cette<br />
situation est non seulement due au fait que cette province est aussi très sous peuplée, mais<br />
aussi à cause du manque d’infrastructures même si on peut remarquer le manque de volonté<br />
de la part des géniteurs 13 , pour qui l’éducation des enfants ne constitue pas toujours une<br />
priorité. Ceci est vrai pour le département de la Boumba et Ngoko et l’est encore plus pour<br />
l’arrondissement de Moloundou et le district de Salapoumbé.<br />
Les données contenues dans le tableau ci-dessous donnent une idée de la situation<br />
éducationnelle de la zone.<br />
c) Tableau 3 : Scolarisation<br />
Unité<br />
Cycle maternel et primaire Cycle secondaire Déperditions<br />
administrative Garçons Filles TOTAL G F T 6 ème Terminale %<br />
Moloundou 1.370 1.205 2.575 399 356 755 62 9 85,5<br />
Salapoumbé 1.085 1.035 2.120 52 36 88 / / /<br />
TOTAL 2455 2245 4695<br />
Source : Inspections de l’éducation primaire et maternelle de Moloundou et Salapoumbé<br />
Les effectifs des cycles primaire et maternel sont ceux de l’année 2001/2002. Nous n’avons pas pu rassembler<br />
les statistiques pour l’année scolaire en cours en raison du fait que les responsables dans ces circonscriptions<br />
étaient nouvellement mutés. Au moment de nos investigations sur le terrain, le CES de Salapoumbé qui a ouvert<br />
ses portes cette année (2002-2003) comptait 88 élèves inscrits dont 52 garçons et 36 filles.<br />
En dehors des établissements publiques construits par l’état ou quelques entreprises<br />
forestières, des centres préscolaires ont également été créés par l’AAPEC 14 ; il s’agit des<br />
Centres d’Education de Base, disséminés pour dans la majorité des villages de la zone et qui<br />
s’adressent en priorité aux Pygmées, mais qui dans la pratique accueillent tous les autres<br />
villageois désireux d’y accéder.<br />
Les faibles taux de scolarisation permettent d’expliquer l’importance du taux<br />
d’analphabétisme dans la zone.<br />
7.3.4.2 La santé<br />
La zone d’étude est couverte par le district de santé de Moloundou qui englobe<br />
l’arrondissement de Moloundou et le district de Salapoumbé. On recense à ce titre l’hôpital de<br />
district de Moloundou et les deux centres de santé intégrés de Moloundou et de Salapoumbé.<br />
Il faut noter qu’en plus de ces centres de santé, on retrouve sur les sites industriels des<br />
structures construites par les sociétés forestières dans le cadre de la médecine du travail : tel<br />
est le cas de l’infirmerie de Lokomo qui est dans la pratique une unité de consultation et de<br />
12 Certains Bakas perçoivent des revenus mensuels de F CFA 80000 dans les safaris. Au 27 septembre 2002, le<br />
nombre inscrit dans les onze centres étaient d’environ 200 enfants (Baka et bantous ).<br />
13 En majorité des Bakas.<br />
14 Association pour l’Autopromotion des populations de l’Est Cameroun. ONG catholique interdiocésain pour un<br />
développement participatif des populations marginalisées.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 42
soins de santé primaire pour les employés de l’entreprise et leurs familles légitimes. On<br />
recense également dans ce type de structure l’hôpital de Libongo dans le district de<br />
Salapoumbé, le dispensaire de Kika, l’infirmerie de la SEBAC.<br />
En dehors des hôpitaux de District et de l’hôpital catholique de Salapoumbé qui peuvent<br />
réaliser des examens, les autres formations sanitaires ne disposent que de matériels<br />
sommaires.<br />
Les problèmes majeurs qu’éprouvent les responsables des services de santé dans la zone sont<br />
dans l’ordre, l’absence ou l’insuffisance des équipements techniques, l’insuffisance<br />
quantitative et qualitative du personnel, l’insuffisance des structures de distribution de<br />
médicaments, la vétusté des bâtiments. En dehors des « <strong>of</strong>ficines » présentes sur les sites<br />
industriels, nous en avons recensé dans la zone une seule appartenant à un particulier dans la<br />
ville de Moloundou. Les médicaments, lorsqu’ils ne sont pas trouvés dans ces endroits, sont<br />
achetés à Yokadouma, à 150 kilomètres de Lokomo.<br />
Les maladies courantes dans la zone sont le paludisme, les infections cutanées, les infections<br />
respiratoires chez les ouvriers (inhalation des fines particules de bois), les infections<br />
parasitaires, les maladies de la peau telles que la teigne (très fréquentes chez les Baka), les<br />
accidents de travail, les MST/SIDA. L’alcoolisme demeure aussi un problème majeur tant au<br />
niveau des sites forestiers que des villages.<br />
Les faibles revenus des populations ne leur permettent pas toujours de participer à l‘effort de<br />
santé. La majorité de la population, surtout les pygmées, continuent de ce fait à recourir à la<br />
pharmacopée traditionnelle, d’où l’importance des plantes médicinales pour les populations.<br />
Le tableau 4 présente les infrastructures scolaires et sanitaires présentes dans la zone.<br />
d) Tableau 4 : Infrastructures scolaires et sanitaires présentes dans la zone<br />
Villages<br />
Lokomo site<br />
Momboué<br />
Salapoumbé<br />
Koumela<br />
Mambélé<br />
Mbandjani<br />
Yenga<br />
Dioula<br />
Mbateka<br />
Infrastructures scolaires et de santé<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 infirmerie de travail<br />
1 centre préscolaire pour les Bakas (AAPEC)<br />
1 école pilote à cycle complet<br />
1 école publique<br />
1 CES 15 (de 6 ème en 5 ème ) avec 4 salles de classe<br />
1 Hôpital catholique AAPEC<br />
1 centre de santé à Mikel déjà fonctionnel<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 école publique à cycle complet<br />
2 écoles publiques à cycle complet<br />
1 centre préscolaire pour les Bakas (AAPEC)<br />
1 école familiale agricole<br />
1 centre de santé catholique à Yenga<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 centre préscolaire pour les Bakas (AAPEC)<br />
15 Le CES de Salapoumbé est a été construite avec les fonds issus des redevances forestières.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 43
Nguilili<br />
Mbangoye<br />
Banana<br />
Makoka<br />
Moloundou<br />
Mindourou<br />
Adjala<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 centre de santé non encore fonctionnel<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 centre préscolaire pour les Bakas (AAPEC)<br />
1 centre préscolaire pour les Bakas (AAPEC)<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 lycée d’enseignement général<br />
1 hôpital de district équipé et fonctionnel<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 école publique à cycle complet<br />
1 centre de santé non encore fonctionel<br />
7.3.4.3 La communication<br />
D’un point de vue communicationnel, en dehors des sites industriels, en général bien nantis en<br />
moyens de communications (radios et quelques fois téléphone satellite), la population de la<br />
zone est totalement coupée du reste du pays. Au niveau du département, la seule ville<br />
connectée au réseau de téléphonie par fil est Yokadouma. Le département n’est pas couvert<br />
par le réseau de téléphonie cellulaire.<br />
D’un point de vue informationnel, il n’y a pas de réseau de diffusion de la presse. Près de la<br />
moitié des habitants de la zone comprennent le français. Les radios internationales (RFI ou<br />
Africa N°1) sont plus faciles à capter que les radios nationales. A Moloundou par exemple, en<br />
dehors des émissions des chaînes congolaises et gabonaises, il est possible grâce à la radio<br />
FM locale de suivre la rediffusion du journal parlé de 13 heures enregistré à partir de 14<br />
heure.<br />
7.3.5 L’environnement économique<br />
7.3.5.1 Les activités agricoles<br />
L’agriculture vivrière demeure la principale activité des populations de la zone. C’est une<br />
agriculture de subsistance, itinérante sur brûlis et dont les produits sont prioritairement<br />
destinés à l’autoconsommation.<br />
Néanmoins, dans un cadre de commercialisation, la banane plantain, bien que considérée<br />
comme culture vivrière, représente un produit de rente à part entière de par les revenus<br />
qu’elle procure au niveau des populations. Les autres produits cultivés sont le manioc,<br />
l’arachide, le maïs, le macabo, et quelque peu l’igname.<br />
Les plantations sur brûlis se font en 2 cycles lors des saisons sèches (décembre-mars et juinaoût).<br />
Les plantations de subsistance (maïs, manioc) et les parcelles de banane plantain de<br />
tailles variables 16 sont installées là où les sols le permettent (bords de cacaoyères, bosquets de<br />
jardins de case, bas-fonds non inondables, replats de pentes en bordure de routes forestières).<br />
En terme de productions, les récoltes s'opèrent au sein de plantations issues des 3 derniers<br />
cycles. Cette organisation dans l’espace et dans le temps des activités de production permet<br />
de combler les besoins pendant les périodes de soudure.<br />
Le maïs produit sert aussi à la fabrication du whisky local (golo-golo) très consommé par les<br />
populations. La vente de ce whisky local représente une des sources de revenus chez certaines<br />
femmes de la zone. Ces revenus sont certes variables, mais d’une moyenne de 3000 F.CFA<br />
par semaine, donc 12.000.CFA par mois. Outre son importance économique, cette activité a<br />
16 Les possibilités de commercialisation des produits vivriers dimensionnent les plantations<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 44
un impact plutôt négatif sur la dynamique sociale et économique villageoise, notamment chez<br />
les pygmées Baka qui en consomment à longueur de journée.<br />
Sur l’axe Yokadouma –Moloundou, précisément dans la moitié Sud, les plantations vivrières,<br />
de superficies moyennes estimées à moins de 0,45 ha/femme/an, sont principalement<br />
orientées vers des productions de subsistance à surplus commercialisable vers Moloundou et<br />
Kika. L’installation massive des parcelles de bananeraies dans cette zone montre l’existence<br />
d’une demande accrue de produits agricoles, notamment au niveau des grands centres de<br />
consommation de la région que sont Yokadouma, Ouesso et Pokola pour le Congo<br />
Brazzaville et certains sites d’implantation de sociétés forestières.<br />
Ces nouvelles opportunités de commercialisation croissante et plus régulière amènent les<br />
populations à vouloir étendre leurs zones agricoles au sein même de l'UFA, plus<br />
particulièrement le long des pistes forestières.<br />
La principale culture de rente pratiquée dans la zone est le cacao. Le revenu moyen tiré de<br />
l’agriculture varie d’un paysan à l’autre. Dans le village Yenga par exemple, les chiffres<br />
avancés peuvent atteindre 132.500 F.CFA par an pour les cultures vivrières, et 1.000.000<br />
F.CFA pour le cacao .<br />
Les zones de fortes concentration des exploitations cacaoyères sont Yenga, Nguilili, Banana<br />
et les villages de l’axe Moloundou-Ndongo.<br />
Le principal atout de la cacaoculture tient à la meilleure tenue des cours actuels sur le marché<br />
international. On note un regain d’entretien des cacaoyères même si cela demeure confronté<br />
au problème du coût élevé des intrants. Les exploitations autrefois abandonnées après la chute<br />
drastique des cours sont réaménagées et dans certains cas étendues. On assiste aussi à la mise<br />
en place de nouveaux vergers de cacaoyers, mais les traitements phytosanitaires demeurent<br />
négligeables. La cacaoculture, en tant que culture de rente, demeure la principale source de<br />
revenus agricoles de quelques villageois Bantous.<br />
Néanmoins, on rencontre sur l’axe Moloundou-Ndongo et dans le campement Bottolo 17<br />
quelques Pygmées qui sont propriétaires de cacaoyères. L'entretien des cacaoyères est dévolue<br />
aux femmes bantous et surtout aux pygmées, souvent payés en nature, ce qui leur permet juste<br />
leur subsistance.<br />
L’écoulement de la production cacaoyère demeure un réel problème. Les négociants,<br />
conscients de l’ignorance des Bakas sur les cours du produit sur le marché international et<br />
des difficultés qu’ils éprouvent quant à l’écoulement de leur produit (transport…), se<br />
bousculent pour acquérir à faible prix et le plus souvent au moyen de troc le cacao de ces<br />
populations marginalisées. Le sac de cacao est souvent vendu à 5000 F CFA seulement ou<br />
même échangé contre quelques kilogramme de riz et des paquets de cigarettes.<br />
7.3.5.2 La chasse<br />
La chasse villageoise : plus qu’une activité de subsistance dans la zone<br />
La chasse villageoise dite de subsistance est destinée à l’alimentation avec vente du surplus de<br />
gibier. Pour des raisons vitales de besoins monétaires, la chasse représente pour certains<br />
villageois la principale activité génératrice de revenus (en moyenne 50.000 Fcfa/mois).<br />
La chasse aux lignes de pièges à câbles d'acier, plus pratiquée que la chasse au fusil, permet<br />
des prises de deux à trois gibiers par jour .<br />
En raison des aspects alimentaires et monétaires vitaux, de la non-sélectivité des pièges à<br />
câbles, et du nombre de pièges par ligne (jusqu'à 200 par homme avec des levées tous les 2-3<br />
17 Campement pygmées situés sur la piste Koumela embouchure-Boumba<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 45
jours), la chasse villageoise a obligatoirement dans sa pratique, un caractère commercial. Une<br />
étude conduite dans la zone a révélé que les prises par câbles oscillent entre 0 et 5 gibiers par<br />
visite de ligne avec une moyenne de 2 à 3 gibiers par 3 jours ou par levée. Un gibier est<br />
destiné à l'autoconsommation et les deux autres sont vendus pour moitié des cas, soit frais ou<br />
soit boucanés. Les espèces généralement commercialisées sont surtout des céphalophes (bleu<br />
et rouges) et des athérures.<br />
La chasse commerciale : une activité économique à caractère destructif.<br />
La présence des Sociétés d’exploitation forestière liée à l’implantation anarchique des sites<br />
industriels est le principal facteur de surexploitation de la grande faune dans la zone. Elle<br />
favorise l’immigration de familles en quête d’emploi et l’installation permanente de celles-ci<br />
à l’intérieur des UFA. Il en résulte une rapide croissance démographique et une demande en<br />
viande qui amène à une intensification de la chasse commerciale.<br />
La chasse commerciale est devenue l’activité économique la plus rentable car le gibier est<br />
moins coûteux que les produits d’élevage et représente la principale source de protéines<br />
animales. Les tabous sur la consommation de certaines viandes semblent être ignorés par les<br />
résidents allochtones au pr<strong>of</strong>it du gain matériel.<br />
Les études sur la chasse villageoise et la chasse commerciale ont montré que la première<br />
prélève 10 fois moins de gibier que la deuxième. N'importe comment, les prélèvements en<br />
céphalophes bleus (1 espèce) et en céphalophes rouges (4 espèces) excèdent respectivement<br />
de 9 fois et de 7 fois l'optimum de prélèvement naturel possible calculé par les scientifiques.<br />
Compte tenu de son caractère instable et en raison du fait que ses produits sont prioritairement<br />
orientés vers l’autoconsommation, les besoins en protéines animales sur les sites industriels<br />
ne peuvent pas être comblés par la seule chasse villageoise. Ceci permet d’expliquer que<br />
lesdits besoins sont complétés par un réseau de chasse commerciale capable d’assurer<br />
pleinement le ravitaillement des centres industriels.<br />
Cette activité en raison de son caractère illicite est caractérisée très souvent par un fort taux<br />
d’abandon des dépouilles en forêt du soit à l’oubli, soit au manque de moyen logistique pour<br />
acheminer les dépouilles dans les réseaux de commercialisation. Ceci a forcément une<br />
incidence sur le potentiel faunique.<br />
vii. Céphalophe pris au piège et abandonné en forêt (photo Ge<strong>of</strong>froy de Gentile sur la ZIC 31)<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 46
Le braconnage constitue dans la région un des plus grands fléaux. Deux types de braconniers<br />
peuvent être distingués :<br />
• Les braconniers permanents riverains qui vivent avec les populations dans les villages,<br />
ou les campements, et qui s'arrangent à impliquer pygmées et villageois à leurs<br />
activités illégales, tout en trouvant la complicité nécessaire pour pouvoir écouler leurs<br />
gibiers auprès des revendeuses (en provenance de Yokadouma ou Bertoua) ou de<br />
transporteurs locaux.<br />
• Les braconniers temporaires occasionnels qui sont en majorité des nationaux et<br />
quelques fois des étrangers, notamment des congolais, sont également à l’origine de<br />
ce phénomène à partir de leurs pays. Ces derniers sont très actifs pendant la saison<br />
morte 18 de la chasse sportive.<br />
Les activités de braconnage sont renforcées par la saturation du potentiel d’emploi au niveau<br />
des entreprises forestières. Les chômeurs en quête d’emploi et certains déflatés, en attendant<br />
d’autres opportunités de recrutement, se résolvent à pratiquer des activités d’exploitation<br />
illégale, notamment la chasse commerciale, devenue le moyen pour faire face aux besoins<br />
monétaires sans cesse croissants.<br />
L’UTO dans le cadre de sa stratégie de lutte antibraconnage a participé à freiner<br />
momentanément l’intensité de la chasse commerciale. Des actions telles que les « opérations<br />
coups de poings 19 » pendant lesquelles le délogement et la destruction des campements des<br />
chasseurs sont effectués permettent d’expliquer quelque peu le caractère itinérant et précaire<br />
de ces « habitats occasionnels » qui s’éloignent davantage des axes fréquentés.<br />
viii. Gorille braconné et dépecé (Photo Ge<strong>of</strong>froy de Gentile sur la ZIC 31)<br />
18 Période pendant laquelle les guides de chasse pr<strong>of</strong>essionnelle sont en congé.<br />
19 Opérations visant au délogement et à l’élimination des campements de chasse commerciale à l’intérieur des<br />
ZICGC.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 47
Quelques sondages effectués dans la zone nous permettent de dire que les commanditaires du<br />
braconnage se recruteraient parmi toutes les couches de la société, et donc aussi parmi les<br />
hautes personnalités locales et même d’ailleurs, qui mettent à la disposition des chasseurs (qui<br />
bénéficient de leur bénédiction) des armes et munitions nécessaires.<br />
Les communautés villageoises et la lutte antibraconnage<br />
En dépit du fait que la chasse soit pour certains une activité principale (et donc commerciale) dans la zone, la<br />
présence de braconniers (nationaux ou étrangers) demeure très mal perçue par les populations de la zone y<br />
compris les Pygmées.<br />
Au sein des villages, le fonctionnement des organes de contrôle à l’instar des comités de vigilance (CV)<br />
institués au sein des Comités de Valorisation des Ressources Fauniques (COVAREF) et les efforts de<br />
sensibilisation et d'interventions menées dans le cadre de l’UTO contribuent déjà à baisser les impacts de la<br />
chasse commerciale.<br />
La mission essentielle des CV est de dissuader toute activité touchant de près ou de loin le braconnage,<br />
d’étouffer toutes actions visant à hypothéquer les ressources fauniques locales et apporter un appui direct aux<br />
pouvoirs publics dans la lutte anti-braconnage entreprise.<br />
Dans certaines zones (Koumela, Mbateka, Mindourou), on remarque une prise de conscience de la part des<br />
populations de la nécessité de préserver la richesse faunique de leurs zones (ZICGC) respectives et donc le<br />
besoin<br />
ix. Braconnier<br />
d’éradiquer<br />
à la<br />
le<br />
recherche<br />
braconnage.<br />
de clients<br />
Cette<br />
au<br />
ambition<br />
carrefour<br />
se<br />
Mambélé<br />
heurte au<br />
(photo<br />
crucial<br />
Erith<br />
problème<br />
Ngatchou)<br />
de manque d’esprit<br />
communautaire 1 dans la zone et parfois du manque de moyens pouvant permettre de repousser ce fléau.<br />
1.Certains trouvent toujours le moyen d’agir en complicité avec les braconniers.<br />
x. Braconnier à la recherche de clients au carrefour Mambélé (photo Erith Ngatchou)<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 48
La pêche villageoise dans la zone est essentiellement pratiquée dans les rivières qui ceinturent<br />
l’UFA 10015. Cette ceinture est constituée notamment de :<br />
• la Bek et la Boumba (au Nord et à l’est de l’UFA), dont la diversité en ressources<br />
halieutiques (poissons, crevettes, crabes, huîtres, moules, tortues) est très connue des<br />
populations (Koumela, Mambélé, Yenga, Bottolo) ;<br />
• le Dja (dans la partie sud) qui côtoie l’axe Moloundou-Ndongo où les pêcheurs Ouest<br />
africains et congolais sont rencontrés.<br />
Cette activité est pratiquée intensément en période d’étiage, période pendant laquelle les<br />
déplacements des populations en pirogue sont moins dangereux.<br />
Au niveau du site de Lokomo par exemple, c’est une activité qui est pratiquée par quelques<br />
employés (pendant leurs heures creuses) ou leurs enfants dans la rivière Modibo-Poumo. Les<br />
produits de cette activité participent de façon non négligeable au menu de ces ménages.<br />
Même si dans l’ensemble de la zone on relève l’intérêt de quelques villageois par rapport à<br />
cette activité saisonnière, de tradition appréciée et de complément alimentaire nécessaire, elle<br />
reste marginale en raison du fait que les autochtones ne sont pas traditionnellement des<br />
ethnies de pêcheurs, mais aussi parce que les minorités ethniques qui s’y adonnent (Bakwélés-<br />
Essels sur l’axe Moloundou-Ndongo), associées à quelques étrangers Ouest-africains<br />
(Sénégalais, Béninois), ont peu d’opportunités commerciales 20 .<br />
Les produits de la pêche villageoise sont essentiellement destinés à être auto-consommés.<br />
Quoi qu’il en soit, la pêche a pour les autochtones une valeur plus alimentaire que<br />
commerciale. La rivière Mbandjani passant à proximité des villages de Mambélé et de Yenga-<br />
Tengué est très riche en crevettes; l’exploitation saisonnière et la vente de cette ressource<br />
restent exclusivement réservées aux originaires de ces villages (200 Fcfa/gobelet). Il s’agit ici<br />
d’un bon exemple de compréhension et d’application traditionnelles de la nécessité de gérer<br />
une ressource naturelle de valeur alimentaire appréciée et monétairement appréciable.<br />
L'élevage villageois d'ovins/caprins, de poulets/canards reste limité, sans but commercial<br />
affiché. Cet élevage demeure davantage destiné aux besoins traditionnels d’hospitalité, de dot<br />
et autres. Toutefois, en terme d’effectifs, il existe un gradient croissant à l’approche des<br />
principaux centres de consommation tels que Lokomo où plusieurs cheptels d’ovins et caprins<br />
appartenant aux ouvriers ou aux commerçants sont recensés.<br />
En marge de cet élevage de petits ruminants, il existe actuellement, mais de façon ponctuelle,<br />
des projets d’élevage tels l’élevage de poules pondeuses avec perspectives d’élevage de<br />
poulets de chair de M. OLINGA 21 à Salapoumbé.<br />
La pisciculture n’est presque pas développée dans la zone. Cette situation s’explique par les<br />
incertitudes des revenus face à l’investissement et au travail fournis, et par une anorexie à<br />
consommer du poisson d’élevage.<br />
La satisfaction des besoins protéiques des populations dans les villages étudiés demeure<br />
essentiellement tributaire de la faune sauvage. Cette dépendance accrue se justifie par<br />
plusieurs raisons à savoir :<br />
• la consommation du gibier (caractérisé par une qualité organoleptique particulière) est<br />
fortement ancrée dans les mœurs des populations autochtones (bantous et pygmées) et<br />
de certains allogènes.<br />
20 L es seules opportunités qui existent demeurent les sites industriels tels que Lokomo et Libongo<br />
21 Monsieur OLINGA est actuellement le seul éleveur de la zone qui dispose d’une unité de production de poule<br />
pondeuse.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 49
• Une facilité à prélever du gibier, accentuée par le fait qu’en dehors du gibier<br />
commercialisé, les animaux d’élevage (petits ruminants et volailles) sont généralement<br />
utilisés pour satisfaire les besoins traditionnels ou culturels.<br />
Sur le site de Lokomo (environ 2500 âmes), la consommation de la viande d’élevage et de<br />
poissons 22 couvrirait entre 10 % et 15 % de leurs besoins protéiques.<br />
Actuellement, avec la mise en place d’une boucherie sur le site, la consommation de la viande<br />
d’élevage ou du poisson devra augmenter si l’entreprise met les moyens qui permettent de<br />
vendre les produits à prix coûtant. 23<br />
Un bon fonctionnement de cette boucherie permettra de réduire de façon significative la<br />
consommation en viandes de brousse et participer ainsi à la baisse de la pression sur la faune<br />
sauvage.<br />
7.3.5.3 L'exploitation des ressources naturelles secondaires : importance de l’UFA<br />
10015 pour les populations<br />
10) Figure 10 : Les zones d’usage traditionnel de chasse, pêche et cueillette dans l’UFA 10015<br />
Qu’il s’agisse de la nutrition, de la pharmacopée, de l’artisanat ou du commerce, l’UFA<br />
10015 a pour les populations une importance capitale de par l’utilité de ses ressources<br />
naturelles. Du point de vue alimentaire, les produits récoltés sont les fruits, les amandes, les<br />
graines oléagineuses (Irvingia spp.; Panda oleosa), les graines condimentaires (divers<br />
Aframomum dont le Ntondo cultivé et commercialisé à Yenga), les cœurs de palmes (rotins,<br />
22 Dans un rayon d’environ 40 Km, nous avons recensé un seul point de commercialisation du poisson de mer<br />
appartenant à un employé de la SEBC.<br />
23 Le prix du kilogramme de poisson ou de viande devra être équivalent si non moins cher que le prix sur la ville<br />
de Yokadouma.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 50
aphia), les tubercules sauvages (ignames, Dioscorophyllum), les feuilles (Gnetum africanum<br />
et G.buccholzianum (Koko, Nkalé)), les écorces, les champignons, les chenilles, termites, les<br />
larves de palmiers raphia ou les escargots de forêt (Achatina spp.).<br />
La cueillette se fait par ramassage des fruits tombés, par abattage ou par écorçage des arbres<br />
(exemple : ngbwö, ngouga chez les Baka). La cueillette se fait souvent en même temps que la<br />
chasse, le chasseur récoltant sur son chemin. Certains produits de la forêts rentrent dans la<br />
construction des habitations. L’approvisionnement en bois de chauffe se fait, soit dans la forêt<br />
à partir d’arbre mort et sec, soit dans les jachères.<br />
Les feuilles de Marantacées (emballage) font l'objet d'une commercialisation très régulière<br />
tout au long de l'année, alors que les champignons (Termitomyces, girolles, pleurotes, ...) très<br />
prisés, ne le sont que très épisodiquement au cours des saisons des pluies.<br />
L’exploitation des ressources forestières apporte aux Pygmées et plus particulièrement aux<br />
femmes, des revenus appréciables. Pendant la période de maturation des fruits d’amandes de<br />
péké (Irvingia gabonensis) par exemple, en pleine récolte, une femme Pygmée, aidée de ses<br />
enfants, peut vendre pour 4 à 5.000 Fcfa/jour d’amandes de péké. Ce revenu forestier direct<br />
équivaut au revenu obtenu par un Pygmée auprès d’un propriétaire Bantou après une<br />
quinzaine de jours de travaux pénibles en plantations vivrières ou cacaoyères (défrichage,<br />
entretien, récolte ; 300 Fcfa/jour).<br />
Plusieurs ménages rencontrés pendant notre étude au niveau des localités de Koumela,<br />
Mambélé, Yenga et des villages situés dans la partie Sud de l’UFA nous ont fait remarquer<br />
que l’UFA 10015 constitue une réserve importante en produits de cueillette (fruits et ignames<br />
sauvages) et en espèces médicinales.<br />
Monsieur Andou Martin, tradipraticien Baka au campement Bottolo 24 explique que le nord de<br />
l’UFA 10015 est assez riche en plantes médicinales à l’instar du ngbwô en baka ou leko en<br />
Bangando, essence dont les écorces sont largement utilisées pour soigner les maux de ventre<br />
et bien d’autres maladies. « C’est cette partie de l’UFA qui abrite nos excursions de saison<br />
sèche». Il souligne que cette forêt demeure très riche en raison des difficultés d’accès surtout<br />
en période de crue, période pendant laquelle il est difficile de franchir la rivière à l’aide d’une<br />
pirogue artisanale. Pendant cette période qui peut durer un à deux mois, les activités de pêche<br />
se développent autour de la rivière Bek, très riche en ressources halieutiques.<br />
Au niveau de la partie Sud de l’UFA, les incursions paysannes sont presque permanentes sur<br />
toute l’année. Les populations de l’axe Moloudou-Ndongo y pratiquent leurs activités de<br />
subsistance (cueillette et chasse).<br />
Sur le plan culturel, cette forêt abrite certains sites culturels où les rites traditionnels Baka de<br />
saison sèche se produisent, mais il ne nous a pas été possible d’obtenir des précisions sur la<br />
localisation de ces sites.<br />
L'artisanat, limité à la construction des habitats traditionnels, fait appel à bon nombre de<br />
matériaux végétaux (liens, tresses, cloisons, poteaux, toits). Quelques activités de vannerie au<br />
rotin recensées dans les secteurs de Salapoumbé et Yenga ont très peu d’opportunités<br />
commerciales.<br />
Pour ce qui est des autres ressources naturelles, très peu de données renseignent sur leur<br />
exploitation et il demeure difficile d’évaluer leurs impacts directs/indirects sur<br />
l'environnement socio-économique (revenus, retombées locales) et naturel (chasse<br />
commerciale, grand braconnage, envasement des marécages et cours d'eaux).<br />
24 Campement situé à 3 Km de la rivière Boumba.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 51
Enfin, hormis l'exploitation des carrières de latérites par les exploitants forestiers et les<br />
entreprises de TP pour le latéritage du réseau routier, l'exploitation saisonnière des sables par<br />
les locaux reste encore artisanale, ponctuelle, à la commande, sans grande incidence sur<br />
l'environnement.<br />
7.3.6 Commerce et Transports<br />
Le commerce demeure très peu développé dans la zone. Les principaux centres de marché<br />
permanent sont Yokadouma et dans une moindre mesure Moloundou pour les populations<br />
situées dans un rayon de 40 km (axe Moloundou-Ndongo). Par rapport au site de Lokomo, ces<br />
deux villes sont situées respectivement à 150 et 117 Kilomètres. Sur ce site, un marché<br />
périodique a lieu toutes les deux semaines notamment pendant les week-end de quinzaine et<br />
de paie. La clientèle sur ce marché est constituée, en plus des habitants du site, des villageois<br />
qui arrivent des localités environnantes (Ngolla 120, Mickel, salapoumbé, Koumela). Comme<br />
produits commercialisés sur ce marché, on peut recenser les produits alimentaires, les<br />
vêtements de seconde main, les pagnes, les chaussures, des ustensiles de cuisine, et bien<br />
d’autres produits de première nécessité.<br />
En marge de ces principaux pôles de commercialisation, il existe tout de même au niveau des<br />
villages quelques échoppes et débits de boisson qui permettent de répondre momentanément<br />
aux besoins des populations en produits manufacturés de première nécessité. Dans les villages<br />
où il existe des raccordements 25 qui mènent dans les cités forestières (Lokomo- carrefour 18,<br />
Koumela ou Banana), on observe une concentration de restaurants, buvettes-dancings,<br />
auberges. Ces commerces, fixes ou itinérants, sont en majeure partie tenus par des allogènes<br />
Camerounais (Bamiléké, Nordistes et anglophones) et quelques fois des étrangers Ouest<br />
africains.<br />
Il est important de mentionner qu’il existe dans la partie sud de la zone (Moloundou et ses<br />
environs) un réseau important de drainage des produits vivriers (à l’instar du plantain) qui<br />
alimente les centres urbains frontaliers tels que Ouesso, Pokola au Congo. Ce commerce a<br />
une incidence directe sur les cours des produits vivriers sur les marchés de l’ensemble du Sud<br />
Est.<br />
Les flux humains et matériels sont assurés par des compagnies privées de voyage, telles que<br />
Alliance Voyage qui assure des correspondances régulières entre Bertoua, Yokadouma,<br />
Moloundou ou Libongo. A coté de cette unique agence de voyage du secteur formel, on<br />
recense des transporteurs clandestins représentés par les transporteurs de grumes 26 et les<br />
transporteurs de marchandises en direction des pays voisins (Centrafrique, Congo).<br />
L’autre principal moyen de transport est l’avion petit porteur, assuré par des compagnies<br />
aériennes privées qui desservent depuis Douala ou Yaoundé les sites industriels des sociétés<br />
forestières nantis de pistes d’atterrissage (Lokomo, Libongo, CFC, Sengbot, Kika) ou<br />
viennent déposer la clientèle des sociétés de Safari ou encore les missions de suivi des<br />
programmes de conservation et de recherche.<br />
25 Ces points de raccordement sont en général des centres de repos pour les chauffeurs transporteurs de grumes.<br />
26 Les transporteurs de grumes sont les principaux vecteurs de déplacement derrière Alliance voyage. C’est<br />
d’ailleurs ces derniers qui facilitent la fluidité des braconniers dans la zone.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 52
7.3.7 Les organisations et les structures communautaires<br />
7.3.7.1 Les COVAREF<br />
Deux Comités de Valorisation des Ressources Fauniques (COVAREF), gestionnaires des<br />
ZICGC 9 et 10, tous dans l’arrondissement de Moloundou, ont été créés dans la zone grâce à<br />
l’action de l’UTO. Ils ont pour principal objectif l’amélioration du bien être des populations à<br />
travers une bonne gestion des retombées financières de l’exploitation des ressources<br />
fauniques. Ce sont les COVAREF 2 et 10 respectivement à Mbatéka et Mindourou. Le<br />
nombre de villages regroupés autour de ces COVAREF est de:<br />
- 13 villages pour le COVAREF n° 2 , allant de Mambélé à Moloundou, d’une<br />
population de 13.000 habitants environ (ZICGC N°2 et 9);<br />
- 6 villages pour le COVAREF N°10 allant de Légwé à Ndongo, d’une population<br />
d’environ 2500 habitants.<br />
Les COVAREF sont tous conçus sur le même modèle en qui concerne leur structuration :<br />
bureau directeur, Comité de Gestion, Assemblée générale. Le tableau ci-dessous donne un<br />
aperçu du bilan du COVAREF 2 27 entre 2000 et 2001.<br />
e) Tableau 5 Quelques réalisations des C OVAREF<br />
Structure<br />
Population Recettes<br />
fauniques<br />
2000 - 2001<br />
Rapport par hbt<br />
en F.CFA<br />
Réalisations<br />
COVAREF 2 13.000 3.599.000 277 Réfection toiture de l’école de Yenga<br />
Champ communautaire<br />
Aide aux étudiants<br />
Aide aux élèves Baka du CM2<br />
Appui au comité de vigilance<br />
Aide aux pisteurs pour les inventaires<br />
Autres<br />
Source : Enquêtes terrain et entretiens , COVAREF<br />
Bien que représentant environ 60% de la population totale de la zone, les populations Baka<br />
demeurent très peu impliquées dans les activités de conservation et de gestion durable. Une<br />
bonne frange, en situation précaire, présente même des signes évidents de marginalisation.<br />
Cette situation s’illustre encore mieux dans le cas des COVAREF où les Baka, lorsqu’ils sont<br />
présents, ne sont que figuratifs.<br />
L’arrêté conjoint N° 000122 MINEFI/MINAT du 29 avril 1998 fixant les modalités d’emploi<br />
des revenus provenant de l’exploitation forestière et destinés aux communautés villageoises<br />
riveraines institue les comités de gestion et les organise ainsi qu’il suit dans son article 5 :<br />
1) Composition : Président : le maire de la commune intéressée, ayant qualité de conseiller<br />
municipal ; Membres : Six (6) représentants de la communauté villageoise concernée ;<br />
Rapporteur : Le représentant local du Ministère chargé des Forêts.<br />
2) Le représentant de chaque exploitant forestier travaillant dans la zone concernée participe<br />
aux travaux du comité avec voix consultative.<br />
27 Le COVAREF 2 fait partie des COVAREF pilotes, disposant d’une structure de gestion.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 53
L’arrêté stipule que ces revenus qui proviennent de la part de la redevance forestière due aux<br />
communautés villageoises riveraines, doivent être affectés exclusivement à la réalisation des<br />
œuvres sociales en vue du développement des communautés bénéficiaires.<br />
Deux collectivités locales, Salapoumbé et Moloundou, sont ici directement intéressées dans le<br />
cadre de l’UTO, étant par cet arrêté indirectement responsables de la conservation en tant que<br />
gestionnaires locaux des ressources générées par la forêt. Mais selon l’analyse qui en est fait<br />
plus loin, ce rôle n’a pas souvent été bien tenu. La quote-part des redevances forestières<br />
annuelles qui est réservée aux communautés riveraines (10 %) arrive difficilement aux<br />
destinataires (propositions de projets rejetées, détournements directs et indirects des fonds).<br />
A cause du taux d’analphabétisme très élevé dans la région et donc de l’ignorance d’une<br />
bonne frange de la population, on assiste à une situation où les effets de la manne forestière<br />
(redevances forestières ou fauniques) ne donnent lieu qu’à des acquis très limités en terme<br />
de développement. Les gestionnaires des ressources, de par leur position ou leur niveau<br />
d’instruction, se partagent cette manne forestière sans aucun souci des couches de base,<br />
notamment des Bakas. Les populations de bases, marginalisées, sont laissées à leurs<br />
préoccupations domestiques alors que les élites savent tirer pour eux mêmes pr<strong>of</strong>it des<br />
opportunités liées à la Loi forestière.<br />
7.3.7.2 Les problèmes identifiés au sein des COVAREF<br />
Les COVAREF mis en place connaissent un certain nombre de dysfonctionnements qui sont<br />
dus à plusieurs facteurs dont :<br />
• L’insuffisance des ressources nécessaires pour la réalisation des micro-projets ou pour<br />
l’aménagement des pistes devant faciliter l’accès aux guides pr<strong>of</strong>essionnels ;<br />
• L’absence de moyens logistiques devant permettre le fonctionnement efficace des<br />
comités de vigilance (circulation à l’intérieur des ZICGC) ;<br />
• Le braconnage, qui en appauvrissant les ZICGC, décourage les guides de chasse<br />
pr<strong>of</strong>essionnels;<br />
• Les mentalités des populations moins tentées par les projets communautaires que par<br />
une répartition immédiate des retombées.<br />
• La difficulté à appréhender la notion de plan simple de gestion.<br />
• L’absence ou l’insuffisance des personnes ressources capables de conduire ces jeunes<br />
structures.<br />
7.3.7.3 Les associations villageoises<br />
De façon générale, on rencontre partout des associations, mais il s’agit surtout de<br />
regroupements à caractère social, avec des activités ayant trait à l’entraide et au secours. Les<br />
associations féminines sont les plus nombreuses, les femmes et les Baka étant plus réceptifs et<br />
plus faciles à mobiliser que les hommes Bantous.<br />
Quelques comités de développement recensés lors des réunions d’échanges dans les villages<br />
se présentent comme suit.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 54
f) Tableau : Quelques comités de développement recensés<br />
Organisation Président Village<br />
CODEAdjala: Comité de Développement de Adjala TATALA Georges Adjala<br />
CODEGEDA : Comité de Développement et de Gestion KADRY YOUGOUDA Adjala<br />
Durable de Adjala<br />
Association des Jeunes pour l’Avenir<br />
Comité de Développement de Mongobé SOUKA NANGA Mongobé<br />
CODECNDO: Comité de Développement et de<br />
Conservation de Ndongo<br />
Association des Jeunes Actifs de Koumela (AJAK)<br />
Association des Femmes Actives de Koumela (AFAK)<br />
Ndoumbé David<br />
DJANEGO Charles<br />
Ndongo<br />
CODEIL: Comité de Développement Intégré de Leke Mediba Romain Leke<br />
CODEGEM:Comité de Développement et de Gestion de<br />
l’Environnement de Mindourou<br />
Groupe d’Initiative Commune de vente de cacao<br />
Ekamba Marcel<br />
Ngbwabio Flubert<br />
Mindourou<br />
Les réalisations des comités villageois de développement visent en fait l’amélioration des<br />
conditions de vie des populations (santé, capacité de financement, habitat), mais le manque de<br />
cohésion des groupes, les faibles capacités de gestion, l’insuffisance des ressources, ajoutés<br />
au manque d’esprit associatif, ne sont pas toujours favorables à l’initiation et à la continuité<br />
des actions, d’où la faible viabilité des micro-projets entrepris.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 55
8 CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL<br />
8.1 Cadre législatif<br />
Au niveau national, le Ministère de l'Environnement et des Forêts (MINEF), après avoir<br />
défini la politique forestière, s'est attelé à rédiger des lois et règlements qui régissent la<br />
gestion des ressources forestières, fauniques et de l'environnement. Parmi ces lois et<br />
règlements, on peut citer :<br />
• La loi N° 94/01 du 20 Janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la<br />
pêche ;<br />
• Le Décret N° 95-531-PM du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime<br />
des Forêts ;<br />
• La Loi N° 96-12 du 5 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de<br />
l'Environnement ;<br />
• Le Décret n°95-678-PM du 18 décembre 1995 instituant un cadre indicatif d'utilisation<br />
des terres en zone forestière méridionale ;<br />
• Le Décret n°95-466-PM du 20 juillet 1995 fixant les modalités d'application du<br />
régime de la faune ;<br />
• Le Décret n° 037/CAB/PM du 19 avril 1994 portant classement des Unités Techniques<br />
Opérationnelles de première catégorie ;<br />
• L'Arrêté n°0511/A/MINEF du 22 avril 1994 du MINEF portant classement des Unités<br />
Techniques Opérationnelles de 3 ème catégorie.<br />
En effet, il convient de souligner que, la loi n°94/01 du 20 janvier 1994 et les textes pris pour<br />
son application fixent le régime des forêts, de la faune et de la pêche en vue d'atteindre les<br />
objectifs généraux de la politique forestière, de la faune et de la pêche dans le cadre d'une<br />
gestion intégrée assurant de façon soutenue et durable , la conservation et l'utilisation desdites<br />
ressources et des différents écosystèmes. Il en est de même, pour la loi n°96-12 du 5 août<br />
1996, qui fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement.<br />
Conformément à l'article 17 de la loi de 96, le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet<br />
d'aménagement, d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa<br />
nature ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter<br />
atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier de charges,<br />
une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur<br />
l'équilibre écologique de la zone d'implication ou de toute autre région, le cadre et la qualité<br />
de vie des populations et des incidences sur l'environnement en général. Cette loi fait<br />
référence au cahier de charge pour la simple raison que son décret d'application est encore<br />
inexistant.<br />
Ainsi, I'UFA10015 étant à la proximité du Parc National de Boumba-Bek et Nki, son<br />
exploitation se situe dans un contexte particulier, dans la mesure où les aires protégées qui<br />
sont des espaces voués à la conservation de la biodiversité ont un statut de protection spéciale.<br />
L'accès à ces zones sensibles, l'utilisation de leurs ressources et même les activités dans leurs<br />
périphéries sont soumis à une réglementation stricte, afin de prévenir tous les risques<br />
environnementaux. A cet effet, un cahier de charges spécifiques concernant la mise en<br />
exploitation de toute concession forestière riveraine d'une aire protégée ou localisée dans la<br />
zone tampon d'une aire protégée a été institué. Ce cahier de charges spécifiques institue la<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 56
éalisation d'une étude d'impact environnementale (EIE) comme préalable pour le démarrage<br />
de l'exploitation de toute UFA attenante à une aire protégée.<br />
C'est dans ce contexte, que l'EIE de l'UFA N°10015 a été commanditée par la Compagnie<br />
Industrielle des Bois du Cameroun (CIBC), vu sa proximité du futur Parc national de<br />
Boumba-Bek et Nki. L'objectif de ce projet est d'assurer la conservation de la biodiversité de<br />
cette aire protégée ainsi que ses zones environnantes à travers des recommandations concrètes<br />
pour atténuer les impacts négatifs que pourraient occasionner la mise en exploitation de cette<br />
UFA.<br />
8.2 Les conventions internationales et régionales<br />
Le Cameroun est signataire de plusieurs conventions internationales, protocoles et plans<br />
d’action relatifs à la protection de l’Environnement :<br />
• la Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel (1972) ;<br />
• la Convention sur la diversité biologique (1992) ;<br />
• la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacée<br />
d’extinction (1981) ;<br />
• la Convention d’Alger sur la conservation des ressources naturelles (1968) ;<br />
• la Convention de Bonn (1979) sur la conservation des espèces migratrices ;<br />
• la Convention de Lomé (1989) ;<br />
• le Plan d’action de Lagos ;<br />
• le Protocole de Montréal ;<br />
• la Convention sur les changements climatiques (1992) ;<br />
• la Convention de RAMSAR relative aux zones humides (1992) ;<br />
• les Conventions de Bamako et de Bâle sur les déchets toxiques et dangereux.<br />
Au niveau de la sous-région Afrique Centrale, le massif forestier du Sud-Est Cameroun obéit<br />
aux prescriptions de la déclaration de Yaoundé (1999), du plan de convergence et du plan<br />
d’action d’urgence (PAU).<br />
8.3 Législation et réglementation nationale<br />
Issu de l’ex-Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (DATE), le<br />
Ministère de l’Environnement et des Forêts fut créé en avril 1992, à l’aube de la Conférence<br />
de Rio de Janeiro pendant laquelle le Cameroun, à l’instar des autres nations s’est engagé à<br />
mettre en œuvre des mécanismes permettant une protection de l’Environnement et la<br />
promotion d’un Développement Durable. Le MINEF est par la suite organisé par décret du 26<br />
novembre 1992. Il s’est alors attelé à l’élaboration d’un Plan National de Gestion de<br />
l’Environnement (PNGE) rendu public en 1994. La loi Cadre sur l’Environnement est<br />
promulguée le 05 août 1996. Elle fixe le cadre d’organisation et des interventions en matière<br />
de gestion de l’environnement. D’autres textes sectoriels intéressant les projets routiers<br />
forestiers et fonciers vont dans plus de détails par secteur : C’est le cas entre autres :<br />
• de la loi sur les forêts du 20 janvier 94 et ses décrets d’application,<br />
• du régime foncier et domanial (4 lois et 4 décrets),<br />
• la réglementation sur l’ouverture des carrières (3 décrets, 2 lois, une ordonnance).<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 57
La loi rend obligatoire les études d’impacts sur l’Environnement des Projets d’Aménagement,<br />
d’ouvrage, d’équipements ou d’installation susceptibles d’influer sur l’équilibre harmonieux<br />
du milieu biophysique et socio-économique.<br />
Les Directives du MINTP pour la prise en compte des impacts environnementaux dans<br />
l’entretien routier prescrivent les clauses obligatoires et les mesures de limitation des impacts<br />
environnementaux des travaux d’entretien routier et complètent provisoirement les<br />
dispositions de la Loi Cadre en attendant les décrets d’application.<br />
Ces Directives prescrivent le contenu des Evaluations Environnementales, soit notamment :<br />
• la description du tracé concerné ;<br />
• un inventaire du milieu ;<br />
• une description des travaux ;<br />
• l’identification des impacts environnementaux ;<br />
• les mesures d’atténuation ;<br />
• un programme de surveillance et de suivi environnemental ;<br />
• l’évaluation des coûts unitaires correspondant aux diverses mesures d’atténuation.<br />
Les recommandations de l’Evaluation environnementale sont rendues coercitives par la<br />
législation. Leur non application peut entraîner la suspension de l’exécution des travaux par<br />
l’administration compétente.<br />
D’autres prescriptions à l’instar du recueil des Normes d’intervention en milieu forestier<br />
prescrivent les dispositions à prendre dans le cadre d’un projet d’exploitation forestière en<br />
particulier :<br />
• par rapport aux relations avec les populations locales ;<br />
• par rapport aux activités d’aménagement forestier en fonction de certaines unités<br />
territoriales ou sites à protéger ;<br />
• par rapport à la protection de la faune et des plans d’eau ;<br />
• par rapport au tracé des pistes et à l’implantation des campements et parcs à bois.<br />
8.4 Les dispositions conventionnelles et réglementaires locales<br />
Sous la houlette des services locaux du MINEF et des organismes de coopération<br />
internationale, les structures intervenant dans le domaine des ressources forestières au Sud-Est<br />
Cameroun sont assujetties à une série de textes réglementant leur action.<br />
De façon générale<br />
• Une convention de collaboration (Convention de Mambélé) a été signée le 08<br />
juin 1999 entre le MINEF, les guides de chasse, les riverains, le projet GTZ<br />
(PROFORNAT) et le programme WWF / Sud-Est Cameroun pour promouvoir<br />
une gestion participative et concertée des ressources fauniques;<br />
• Un plan stratégique de surveillance de l’exploitation des ressources fauniques<br />
dans le département de la Boumba et Ngoko, élaboré en juillet 2001, définit les<br />
stratégies locales de lutte anti-braconnage, l’organisation de la surveillance et<br />
précise les moyens matériels, humains et financiers à mettre en œuvre dans le<br />
cadre de l’exécution du plan.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 58
• Un plan de surveillance des activités d’exploitation forestière a été rendu<br />
public en mars 2002. Ce plan précise les modalités de suivi des travaux<br />
d’aménagement, de contrôle et de suivi des chantiers d’exploitation, des usines<br />
de transformation, l’évacuation des produits et la collecte des documents<br />
d’exploitation et l’analyse des données.<br />
De façon spécifique<br />
L’administration a signé avec la CIBC la convention provisoire d’exploitation N°<br />
0137/CPE/MINEF/CAB du 15 février 2001, assortie d’un cahier des charges qui garantit<br />
entre autres :<br />
• les droits d’usage des populations riveraines,<br />
• les diamètres minima d’exploitation par essence,<br />
• les normes à respecter en matière de protection de l’environnement sont précisées à<br />
l’article 12 du cahier de charge,<br />
• les modalités de participation à la réalisation d’infrastructures socio-économiques sont<br />
précisées à l’article 14.<br />
Sur cette UFA superposée à une zone de chasse, la ZIC N° 38 28 , un accord assorti d’un cahier<br />
des charges (N° 009/CDC/MINEF/DFAP/SAN du 31/01/2001) a été signé entre le MINEF et<br />
le Guide de chasse pr<strong>of</strong>essionnel de la société Boumba Safaris, amodiataire de ladite ZIC. Cet<br />
accord contraint le guide de chasse à une gestion en bon écologiste et au recrutement en<br />
priorité des riverains. D’autre part, 40 % des taxes d’affermages sont destinées à la commune<br />
de Moloundou et 10 % aux communautés riveraines.<br />
Dans la région de l’UFA et ses environs, l’arrêté du MINEF N° 1236/MINEF/DFAP/FB du<br />
20 septembre 2000 porte création des ZIC N° 38 et des ZIC GC N° 8 et N° 9.<br />
8.5 Les Directives des bailleurs de fonds internationaux en matière d’EIE<br />
Les Etudes d’<strong>Impact</strong>s doivent obéir à des directives prescrites par les bailleurs de fonds :<br />
• Les Directives de la Banque Mondiale publiées en octobres 1992 sous le N° DD4.01<br />
prescrivent les étapes à suivre et un contenu type des évaluations environnementales.<br />
• L’Union Européenne a publié en avril 1998, un recueil de propositions de clausestypes<br />
environnementales à intégrer dans les marchés de travaux routiers.<br />
• La procédure USAID d’études d’impacts publiée le 03/06/1994 définit le moment, les<br />
catégories de projet, les domaines d’application des évaluations environnementales.<br />
• La Caisse Française prescrit une étude sur l’environnement, coordonnée avec<br />
l’ensemble des études techniques et socio-économiques du projet. Elle doit<br />
s’accompagner d’une consultation des populations pour garantir leur participation et<br />
leur intégration au projet.<br />
8.6 La gestion coutumière de l’espace : propriété traditionnelle et droit moderne<br />
Dans la région, c’est l’occupation d’un espace donné qui confère à un individu le droit de<br />
propriété. L’espace est collectif à l’ensemble des membres du lignage, seules les terres mises<br />
en valeurs (habitations, plantations, arbres fruitiers, champs et jachères) appartiennent aux<br />
individus. Il en va de même pour les produits de ramassage, dont les lieux ou arbres de<br />
ramassage appartiennent à ceux qui les ont découverts les premiers. Cette propriété est<br />
28 La ZIC 38 couvre une superficie de 132197 ha. Elle chevauche l’UFA 10015 à près de 90%.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 59
transférée de manière héréditaire par les ascendants aux descendants, par héritage pour les<br />
lignages, transmission de père en fils. L’accès au foncier pour les femmes se fait seulement en<br />
cas de décès du mari s’il n’ y a pas de fils. La femme dépend du mari pour l’acquisition d’une<br />
parcelle à cultiver dont elle n’a que l’usufruit. En dehors de ces espaces individualisés, le reste<br />
du patrimoine foncier traditionnel appartient à la communauté et l’accès y est libre pour les<br />
autochtones. Cependant, il arrive que les activités conduisent les ressortissants de villages<br />
différents, à coloniser des terres à des distances assez éloignées de leurs origines. Dans ce<br />
dernier cas, les terres n’appartiennent pas aux villages, mais plutôt aux individus.<br />
L’espace que le village considère comme sien se divise entre le village (case et plantations<br />
derrière), la forêt proche du village (lieu des maîtrises foncières exclusives au village, champs<br />
et jachères, forêt non défrichée et pistes, ruisseaux, rivières), la forêt la plus éloignée soit trois<br />
à douze kilomètres. Les limites entre les villages sont les cours d’eau, les arbres naturels ou<br />
plantés.<br />
L’espace cultivé a une logique spatiale (territoriale) dominante. La forêt éloignée est le lieu<br />
des activités de collecte, chasse et pêche. Cet espace tend à devenir commun à plusieurs<br />
villages mais avec des limites de terroirs au moins connues des anciens. Dans la logique<br />
d’appropriation des ressources, (accès et contrôle), l’espace n’est qu’un support des activités,<br />
les limites correspondent aux modalités particulières d’une activité. Ce système permet des<br />
fluctuations, des interdépendances et des échanges. Les limites entre villages semblent<br />
connues des seuls vieillards et non transmises aux jeunes, ce qui pose un problème pour<br />
l’avenir, des tensions entre villages, surtout compte tenu de la vitesse d’accroissement de ces<br />
villages.<br />
L’accès se fait par prêt pour les étrangers au village (allogènes et voisins du même groupe<br />
ethnique), sur demande au chef de village qui consulte les chefs de famille.<br />
Si l’accès au foncier chez les Bantous se définit par l’occupation effective, chez les Baka au<br />
contraire, la notion de propriété foncière n’existe pas : l’espace forestier dans lequel ils ont<br />
toujours évolué appartient à tous, et chacun accède aux ressources selon ses besoins et ses<br />
capacités. C’est à ce niveau que se rejoignent les deux peuples, car même chez les Bantous, la<br />
forêt est un bien collectif : la chasse, le ramassage, la cueillette, la pêche ou toute autre<br />
activité peuvent y être pratiqués par tous. Ces activités représentent chez les Pygmées, les<br />
bases de leur vie, et chez les Bantous une part importante de leur alimentation et de leurs<br />
revenus. Même si on relève aujourd’hui une sédentarisation progressive chez les Baka, leur<br />
perception du milieu demeure.<br />
Cette perception de l’espace et de son utilisation par les peuples autochtones et surtout les<br />
Pygmées Baka s’oppose sur plusieurs aspects au droit moderne et à l’évolution des situations<br />
environnementales qui sont :<br />
• L’ordonnance de 1974 sur le régime foncier;<br />
• La loi n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la<br />
pêche, qui impose désormais des restrictions en matière de faune;<br />
• Les impératifs de la conservation qui ont induit la création ou les projets de création<br />
des parcs nationaux notamment celui de Boumba-Bek et Nki contiguë à l’UFA 10015<br />
et celle des ZIC ( ZIC N° 38 chevauchant à 90% l’UFA 10015) à l’intérieur desquels<br />
les activités de chasse sont interdites pour les populations;<br />
• La politique de l’Etat Camerounais visant l’installation des Pygmées Baka le long des<br />
voies de communication et leur intégration dans les circuits socio-économiques<br />
modernes.<br />
Tous ces facteurs et éléments font que les populations ne se retrouvent pas dans la nouvelle<br />
structuration de l’espace. Les Pygmées sont encore plus touchés, car il s’agit là d’un<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 60
ouleversement total dans l’utilisation de leur milieu. Un travail de sensibilisation est encore à<br />
faire dans l’orientation des populations dans l’utilisation des ressources naturelles ou la<br />
pratique des rites culturaux dans les zones à usages multiples.<br />
Dans l’arrondissement de Moloundou et ses environs, la propriété foncière est collective à<br />
toute la communauté sur un territoire donné. C’est ainsi que la communauté dispose des<br />
espaces d’habitation, des espaces cultivés, des jachères et des zones de chasse et de cueillette.<br />
Les populations ne sont pas très regardantes sur les limites de leur territoire ancestral, surtout<br />
en forêt, vu le caractère vaste de l’espace forestier.<br />
Au dire de l’autorité administrative, aucun titre foncier n’a déjà été délivré ou serait en cours<br />
d’établissement dans l’arrondissement de Moloundou. La propriété privée s’acquiert sur un<br />
espace par la création de plantations de cultures pérennes (cacao en l’occurrence).<br />
xi.<br />
Réunion avec les autorités locales et les représentants des populations de Adjala (photo Erith<br />
Ngatchou)<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 61
9 PRESENTATION SUCCINCTE DE L’ENTREPRISE CIBC<br />
L’exploitation de l’UFA N° 10015 a été attribuée à la CIBC (Compagnie Industrielle du Bois<br />
du Cameroun), membre du Groupe VICWOOD THANRY qui regroupe par ailleurs les<br />
sociétés SEBC, CFC, SAB, J. PRENANT, THANRY Centrafrique et THANRY Congo.<br />
Le bois exploité dans l’UFA N° 10015 sera transformé dans la scierie de la SEBC à<br />
Lokomo.<br />
9.1 Le personnel<br />
Selon le Chef de site, M. Xavier de MOMPEOU, l’entreprise emploie environ 250 personnes.<br />
L’entrée en exploitation de l’UFA N° 10015 va générer 15 à 20 nouveaux postes de travail<br />
permanents. Le personnel est organisé en 8 équipes de travail en forêt dont :<br />
• 2 équipes de prospecteurs,<br />
• 1 équipe d’abattage,<br />
• 1 équipe de débardage,<br />
• 1 équipe de préparation des bois (parc en forêt),<br />
• 1 équipe de garage,<br />
• 1 équipe route,<br />
• 1 équipe de transport de bois.<br />
Au niveau de l’usine, le personnel est organisé comme suit :<br />
• 2 équipes de scierie,<br />
• 2 équipe de récupération,<br />
• 1 équipe parc à grumes,<br />
• 1 équipe parc à débiter.<br />
• 1 équipe mécanique et maintenance,<br />
• 1 équipe de structure (administrative et gardiennage),<br />
• 1 équipe menuiserie,<br />
• 1 équipe de tâcherons pour nettoyage et salubrité.<br />
Les horaires de travail sont de 6h à 16h en forêt et de 6h à 14h et de 14 heures à 22h30 en<br />
scierie, soit deux postes de 8 heures .<br />
9.2 Les équipements et installations<br />
La scierie de Lokomo SEBC est installée sur une superficie globale estimée à près de 10 ha<br />
dont l’espace usine et les bureaux, les zones de résidence pour cadres, les camps des ouvriers<br />
et agents de maîtrise. L’habitat est construit, soit en dur, soit en bois. Des réseaux de<br />
distribution d’électricité et d’eau alimentent une bonne partie des constructions. Une piste<br />
d’atterrissage en latérite longue de près de 1 500 m est aménagée juste à l’Ouest des<br />
installations de la scierie.<br />
L’usine est subdivisée en divers blocs dont les parcs à grumes, le bloc de sciage, le bloc<br />
menuiserie, le parc de bois débité, les blocs de maintenance et une unité de séchage en cours<br />
de construction.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 62
Les installations de la scierie de Lokomo ont une capacité de 7500 m 3 de grumes par mois<br />
(en travail à deux équipes) qui produisent environ 2 500 m 3 de bois débité. Le reste est<br />
constitué de déchets de scierie, de bois abandonnés pour mulotage, décolorations ou cœurs<br />
pourris.<br />
xii.<br />
Vue de l’unité de sciage de l’usine de transformation de Lokomo (Photo Erith Ngatchou)<br />
9.3 Le site de Lokomo<br />
Le village Lokomo est la localité qui abrite le site de transformation de la SEBC 29 du Groupe<br />
VICWOOD THANRY. Cette localité créée en 1984 compte aujourd’hui environ 2500 âmes.<br />
C’est une cité cosmopolite constituée en majeure partie d’allogènes, en provenance d’horizon<br />
divers et dont l’installation est étroitement liée à la présence de l’entreprise. En général, ces<br />
allogènes sont soit les employés de la société (cadres camerounais ou expatriés, agents de<br />
maîtrise, manœuvres spécialisés ou ouvriers de base), soit des jeunes en quête d’emploi, soit<br />
des commerçants (Mauritaniens, Nordistes…).<br />
Dix huit ans après l’installation, cette localité dispose d’un certain nombre d’infrastructures<br />
qui permettent dans une certaine mesure de répondre plus ou moins aux besoins de base de<br />
ses habitants.<br />
29 Société d’Exploitation des Bois du Cameroun.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 63
9.4 L’éducation.<br />
Le site de Lokomo dispose d’une école primaire publique à cycle complet. Cette école a été<br />
créée par une association de quelques employés soucieux de l’encadrement de leur<br />
progéniture. Elle a été érigée en Ecole Publique 30 en 1994 et compte aujourd’hui six (06)<br />
salles de classe dont quatre en parpaing construites par l’état camerounais et deux en bois<br />
construites par l’entreprise.<br />
L’effectif des élèves au 26 septembre 2002 était de 344 dont 187 garçons (60,17%) et 137<br />
filles (39,83%). Cet effectif est beaucoup plus concentré dans les classes inférieures (120 à la<br />
sil). Les Baka sont représentés avec 14 têtes soit 4,07% de l’effectif total inscrit 31 .<br />
L’encadrement des élèves est assuré par six (06) enseignants dont deux vacataires, deux<br />
instituteurs payés par l’état et deux maîtres communaux payés 32 par la commune de<br />
Salapoumbé.<br />
Les taux de réussite enregistrés pour l’année scolaire passée sont de 66% au concours d’entrée<br />
en classe de sixième, 92% au concours d’entrée au CETIC, et 70% au CEPE.<br />
Les problèmes rencontrés par le personnel enseignant se situent à deux niveaux :<br />
l’encadrement des plus jeunes élèves qui nécessiterait deux salles de classe de plus pour<br />
abriter le cycle maternel et le cadre de vie lié à leur propre habitat insuffisamment équipé.<br />
Les bâtiments qui font <strong>of</strong>fice de logements pour les enseignants (2 sur 6 dont le directeur)<br />
sont des anciennes salles de classe construites par l’APE.<br />
9.5 La santé<br />
Relativement aux soins de santé, une infirmerie a été construite par la société. La consultation<br />
est gratuite pour tous les habitants de la cité et l’acquisition des médicaments se fait au moyen<br />
d’une ordonnance délivrée par l’infirmier. Le traitement gratuit est réservé aux employés et à<br />
leurs familles légitimes. Les habitants du site non employés ou n’ayant aucune relation<br />
(conjoint ou fils) avec ces derniers ne bénéficient pas du traitement. Par conséquent, après<br />
consultation, ceux qui disposent des moyens s’orientent vers « le pharmacien du gazon 33 »<br />
pour leur besoin en médicaments. Il demeure évident que les habitants du site, qui ne sont ni<br />
employés de l’entreprise, ni commerçants, et qui n’exercent presque pas d’activité génératrice<br />
de revenus éprouvent de sérieuses difficultés pour financer leurs traitements. Ce phénomène a<br />
une forte incidence sur la propagation des maladies contagieuses en l’occurrence les MST.<br />
Même si les employés et leurs relations directes bénéficient des traitements, leur immunité<br />
n’est pas toujours assurée en raison de leur cohabitation avec les autres citadins non<br />
employés.<br />
Sur le plan de la logistique, l’infirmerie dispose d’une salle équipée de 03 lits qui servent en<br />
pratique de lieu de repos pour quelques malades. Les cas graves de maladie sont évacués soit<br />
à l’hôpital catholique des sœurs de Salapoumbé soit à l’hôpital de district de Moloundou.<br />
Les maladies couramment rencontrées sur le site sont le paludisme, les maladies respiratoires<br />
chez les ouvriers, les accidents de travail et les MST/SIDA.<br />
30 Ecole Publique de Lokomo SEBC<br />
31 L’inscription s’élève à F CFA 1000 dont 500 pour le carnet de correspondance et 500 pour l’APE. Le nombre<br />
d’inscrit selon le directeur d’école augmente dès la fin du mois de septembre avec la paie.<br />
32 Au moment de notre étude, ces deux maîtres accusaient deux mois d’arriérés de salaire.<br />
33 Le pharmacien du gazon est installé depuis six mois et réalise une chiffre d’affaire moyen mensuel de F CFA<br />
500000.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 64
9.6 L’économie<br />
L’économie de la localité de Lokomo est tenue par quelques commerçants et employés<br />
propriétaires des échoppes (au total 4) et débits de boisson, des bar dancing 34 associés dans<br />
certains cas aux auberges. D’autres activités génératrices de revenus telles que les machines à<br />
écraser (moulin à manioc ou maïs), le petit commerce de manioc en cossette ou de vente de<br />
whisky local 35 (golo-golo) occupent les femmes.<br />
Ce tableau de l’économie quotidienne est complétée par le marché périodique qui se tient<br />
pendant les week-end de quinzaine et de paie. Les acteurs commerçants viennent<br />
généralement des villes de Yokadouma et Moloundou. Les produits vendus par les<br />
commerçants extérieurs sont généralement les produits alimentaires, les vêtements de seconde<br />
main, les pagnes, les chaussures, des ustensiles de cuisine, et bien d’autres produits de<br />
première nécessité.<br />
Même si sur ce marché périodique on retrouve quelques produits qui correspondent aux<br />
besoins des habitants du site, il n’en demeure pas moins vrai que les expéditions organisées<br />
sur Yokadouma pour le ravitaillement pendant ces périodes restent une nécessité absolue. Ces<br />
expéditions pour des raisons évidentes, s’expliquent par le fait que les prix pratiqués sur<br />
Lokomo sont trop élevés pour l’employé moyen. Ce déplacement se justifie également<br />
pendant la rentrée scolaire en raison du fait que les besoins des parents en fournitures pour<br />
leur progéniture ne peuvent pas être comblés.<br />
Pour favoriser l’installation des commerçants sur le site, la politique incitative mise en place<br />
par l’entreprise consiste à terrasser l’emplacement et à fournir du bois de construction.<br />
9.7 Le logement<br />
Pour loger les employés, l’entreprise dispose d’un total de 100 appartements (dont 9<br />
logements pour agents de maîtrise et 68 appartements de 3 pièces) pour un effectif actuel de<br />
245 employés. A cause de la saturation de ces logements, bon nombre d’employés partagent<br />
les mêmes appartements alors que d’autres essayent autant qu’il peuvent de trouver un abri<br />
chez les villageois du site. Il est évident que cette cohabitation ne se fait pas sans incidents sur<br />
le plan social.<br />
9.8 L’alimentation des familles<br />
Le menu principal dans les ménages reste le manioc consommé sous plusieurs formes.<br />
Quelques variantes telles que le plantain ou le macabo y figurent également. La part carnée de<br />
l’alimentation est essentiellement faite de la viande de brousse. La consommation de la viande<br />
bovine, du poisson ou des œufs demeure un luxe que ne peuvent s’<strong>of</strong>frir que certains agents<br />
en raison du coût très élevé au kilogramme 36 . La commercialisation de la viande bovine dans<br />
la cité est jusqu’alors faite par un commerçant nordiste qui a une connaissance des besoins en<br />
viande de la cité et des différents aléas qui peuvent entraver son approvisionnement<br />
34 Les deux bar-dancing les plus fréquentés (Mathias et Sokowater) de la cité réalisent des chiffres d’affaire<br />
moyens mensuels de l’ordre de FCFA 120 000 pour le premier et FCFA 800 000 pour le second.<br />
35 Une vendeuse de whisky local arrive à dégager un revenu moyen mensuel de FCFA 6000. La clientèle<br />
principale est essentiellement constituée des Baka.<br />
36 Quelques nordistes bouchers assurent l’approvisionnement du site en viande même si on relève parfois des<br />
périodes de pénurie. Deux à trois bœufs en moyenne sont abattus par mois sur Lokomo. Le kilogramme de<br />
viande coûte F CFA 1400 en moyenne et le kilogramme de poisson est de F CFA 1500. Le plateau d’œufs coûte<br />
3000 FCFA.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 65
Une tentative de solution à ce problème a été la construction d’une boucherie avec des<br />
installations en eau courante et équipée de deux congélateurs. Cette unité dont le contrat de<br />
gestion a été confié à un employé de la société éprouve pour le moment d’énormes difficultés<br />
de démarrage pour plusieurs raisons :<br />
• la faible capacité de financement du gestionnaire ;<br />
• L’amateurisme du gestionnaire dans le métier et donc le manque d’expérience pouvant<br />
permettre de lever certaines difficultés;<br />
• La gestion de la boucherie demeure une activité subsidiaire pour cet employé de<br />
l’entreprise.<br />
9.9 Les besoins en énergie : l’électricité et l’eau.<br />
Sur l’ensemble du site, en dehors des installations de la scierie et de la cité des cadres<br />
expatriés qui sont alimentées en énergie électrique, l’énergie utilisée dans les ménages est le<br />
pétrole lampant. Il en est de même pour les enseignants d’école. Au cours de notre séjour,<br />
nous avons recensé au total onze (11) groupes électrogènes dont quatre (04) appartenant aux<br />
particuliers (propriétaires d’alimentation, d’auberge ou de bar-dancing 37 ) et sept (07)<br />
appartenant à certains employés de la société.<br />
Le carburant nécessaire pour le fonctionnement de ces appareils est acheté à la pompe de la<br />
société au prix de F CFA 450 pour le gas-oil et FCFA 500 pour l’essence. On retrouve ainsi<br />
certains propriétaires de groupe électrogène qui font le commerce de l’énergie électrique<br />
auprès des voisins nécessiteux et se font régler les comptes en nature (carburant) ou en argent<br />
à la fin du mois (paie).<br />
L’alimentation en eau dans la localité est assurée grâce à une unité de pompage et de<br />
traitement construite par l’entreprise. Cette unité est complétée par un réseau d’adduction<br />
d’eau avec en série de trois (03) robinets alimentant l’ensemble du village.<br />
9.10 Le transport<br />
En dépit de la volonté des responsables du site d’assister les habitants de Lokomo en cas<br />
d’urgence, il demeure tout de même remarquable que les possibilités de déplacement restent<br />
très faibles. Il existe peu de moyen de locomotion pouvant permettre aux habitants de la cité<br />
de rejoindre l’axe principal Moloundou-Yokadouma au PK 18. Quelques véhicules de la<br />
société pouvant assurer ce service ne sont pas toujours disponibles à cause de leurs multiples<br />
sollicitations. Deux motocyclettes (Yamaha 50) appartenant à deux villageois permettent<br />
lorsque les propriétaires sont disponibles de transporter certains nécessiteux au tarif de F CFA<br />
2000 à 2500 par tête.<br />
37 Les dépenses en carburant chez les propriétaires de bar dancing peuvent atteindre les FCFA 50000 par mois.<br />
Ce chiffre équivaut à une durée de fonctionnement moyen de 5 heures de temps par jour.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 66
10 PRESENTATION DU PROJET<br />
Le projet d’exploitation de l’UFA N° 10015 est basé sur la coupe, le transport et le sciage de<br />
bois dans les 131 000 ha que couvre cette unité.<br />
10.1 Objectifs du projet<br />
L’objectif majeur reconnu pour ce projet, c’est d’assurer l’alimentation en grumes de l’usine<br />
de Lokomo pendant au moins les 25 à 30 prochaines années. Cette alimentation va permettre<br />
de continuer à satisfaire la clientèle du Groupe VICWOOD THANRY.<br />
10.2 Situation actuelle<br />
La partie sud-est de l’UFA a été exploitée autrefois par une autre entreprise forestière. Par<br />
ailleurs, la CIBC avait entrepris de vouloir exploiter une assiette de coupe en 2001, au sud de<br />
l’UFA, mais elle a du y renoncer pour des raisons de litiges concernant la réfection de la route<br />
d’accès. A ce jour, la CIBC n’a donc pas encore commencé à exploiter l’UFA 10015.<br />
Pour y accéder, l’entreprise avait procédé à la remise en état du Bac à la traversée de la<br />
Boumba près de Moloundou et une piste d’accès desservant les villages de l’axe Moloundou-<br />
Ndongo avait été aménagée.<br />
xiii.<br />
Bac sur la Boumba sur l’axe Moloundou-Ndongo entretenu par la CIBC/ SEBC<br />
L’entreprise a étudié la possibilité d’accéder à l’UFA par des voies plus courtes soit<br />
notamment à Yenga, Mbanjani ou à Mambélé, mais toutes ces alternatives qui touchent la<br />
forêt communale de Moloundou n’ont pas connu de succès du fait qu’elles n’ont pas été<br />
acceptées par les autorités municipales. Il s’est avéré que l’accès à l’UFA par Koumela est la<br />
seule alternative économique qui ne rencontre pas de gros obstacles en dehors des inquiétudes<br />
par rapport à la proximité du parc de Boumba-Bek, et du fait que les populations de l’axe<br />
Moloundou – Ndongo sont mécontents de voir les opportunités socio-économiques qu’<strong>of</strong>fre<br />
l’exploitation forestière s’éloigner de leur localité.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 67
10.3 Les activités à mener dans le cadre du projet<br />
Les activités à mener dans le cadre du projet se regroupent de la manière suivante, à savoir :<br />
• la réalisation des infrastructures routières et pistes de pénétration,<br />
• l’aménagement de camps d’ouvriers,<br />
• l’aménagement de parcs à bois,<br />
• la construction d’un bac de traversée sur la Boumba.<br />
10.3.1 Les infrastructures routières<br />
Les routes et pistes à réaliser ou réhabiliter serviront au développement des activités de coupe<br />
et évacuation du bois.<br />
La route Koumela – Boumba<br />
Le choix de cet axe vise à éviter d’empiéter sur la forêt communale traversée par les entrées<br />
partant de Mambélé, Mbandjani et Yenga, ou la ZICGC N° 8 en passant par Salapoumbé.<br />
xiv.<br />
Des arbres tombés sur la route Koumela-Boumba (Photo Erith Ngatchou)<br />
Les travaux à effectuer dans le cadre de la réhabilitation de cette ancienne piste administrative<br />
se résument en 7 points principaux, à savoir :<br />
• le dégagement des accotements pour l’ensoleillement de la plate-forme du PK<br />
0,00 (Carrefour Koumela) au PK 29,00 (rive de la Boumba), soit une bande<br />
discontinue de part et d’autre des fossés longitudinaux (29 ha),<br />
• la mise en forme de la plate forme sur 29 km,<br />
• le remblai de rechargement des points bas, soit 6 000 m 3 ,<br />
• l’exécution des couches de roulement en grave latéritique sur les côtés<br />
critiques, soit 10 000 m 3 ,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 68
• la construction de 5 ponts provisoires sur les cours d’eau situés au PK 2,900,<br />
PK 8,900, PK 11,900, PK 18,00 et PK 13,900 ;<br />
• la pose de 15 passages de buses métalliques de ∅ 800 et la construction des<br />
ouvrages de tête ;<br />
• la création des fossés et exutoires, soit 58 000 ml ;<br />
• l’exploitation de deux zones d’emprunts existantes et d’autres à prospecter et<br />
aménager éventuellement en fonction du rapprochement des points de remblai.<br />
La route Moloundou – Ndongo et le bac sur la Boumba<br />
L’option d’accéder à l’UFA par le Nord a suscité des inquiétudes notamment chez les<br />
populations de la partie Sud, qui trouvent cela préjudiciable au développement économique de<br />
leur région. Malgré le fait qu’il n’y ait toujours pas d’exploitation dans l’UFA, le Groupe<br />
VICWOOD THANRY conscient de cette situation a continué par le biais de la SEBC à<br />
supporter mensuellement une charge de F CFA 291.000 pour 6 employés chargés du<br />
gardiennage (02) et du passage (04) du bac. En marge de cela, les travaux d’entretien de la<br />
coque et de remplacement des câbles usés sont jusqu’à lors faits par la SEBC.<br />
Le maintien en bon état de l’axe routier Moloundou – Ndongo et du bac sur la Boumba fait<br />
partie intégrante du projet tels que le stipulent les termes de référence. Le travail d’entretien<br />
permanent de cette route tout au long des travaux a également été retenu comme une mesure<br />
d’atténuation en consensus avec les populations de cet axe lors des réunions de consultation<br />
de public. L’entretien incluant notamment la remise en état des points critiques, l’entretien<br />
des fossés et exutoires, la réfection des ponts défectueux et éventuellement le remblai<br />
latéritique des points de stagnation d’eau. L’entretien du bac, quant à lui, inclut le<br />
remplacement des câbles en tant que de besoin, la réparation des pannes éventuelles et le<br />
paiement du personnel. Il est à noter que pour ce dernier aspect actuellement assuré par<br />
l’entreprise, il y a lieu de suggérer qu’une entente soit négociée avec la commune rurale de<br />
Moloundou afin de partager les coûts et d’impliquer logiquement la commune, qui dispose<br />
des revenus fiscaux liés à l’exploitation forestière, dans l’entretien de ses équipements.<br />
Les routes de desserte des assiettes de coupe<br />
La construction des routes est aussi assujettie au respect des lignes de crête pour minimiser les<br />
coûts. La longueur de piste estimée pour relier l’assiette la plus au Nord à l’assiette la plus au<br />
Sud sur la limite Est est estimée à environ 120 km en intégrant la distance de traversée de la<br />
zone agr<strong>of</strong>orestière. La construction des routes de desserte devra ainsi aller progressivement<br />
de la limite Est à la limite Ouest de l’UFA. Les activités relatives à la création de ces routes<br />
incluent : la prospection, le layonnage, le défrichement au bulldozer, les terrassements,<br />
l’aménagement des fossés et de la chaussée à la niveleuse, les remblais par apport de matériau<br />
latéritique,…<br />
Les pistes de débardage<br />
Leur construction à l’intérieur des assiettes est liée à la répartition spatiale des essences à<br />
exploiter. Leur aménagement se fait par layonnage et défrichement simple au bulldozer D7<br />
généralement sans apport de latérite, sauf cas particulier.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 69
11) Carte du réseau routier et des UFA de l’UTO<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 70
10.3.2 La construction de camps d’ouvriers<br />
Elle intègre les défrichements au bulldozer, l’abattage, les terrassements, l’aménagement des<br />
sources d’eau, des fosses septiques, des points de stockage, la construction de bâtiments.<br />
L’implantation de camps d’ouvriers fait partie intégrante du projet. L’installation de camps<br />
d’ouvriers se décompose en plusieurs volets correspondant aux différents plans<br />
quinquennaux :<br />
Un camp permanent installé à Koumela.<br />
Ce camp, vivement souhaité par les habitants de Koumela, sera le point de résidence des<br />
ouvriers travaillant dans l’UFA au moins au cours du premier plan quinquennal. Le site<br />
indiqué se trouve au quartier Sepa, ancien emplacement d’un camp missionnaire où certaines<br />
infrastructures telles que les sources, les fosses et les arbres fruitiers existent encore. Il s’agira<br />
d’un campement célibataire où les ouvriers seront amenés de Lokomo le lundi et repartiront<br />
chaque vendredi soir. Les familles des ouvriers resteront en permanence à Lokomo. Un<br />
service de ravitaillement et de cuisine sera assuré par l’entreprise.<br />
Un campement mobile<br />
Ce camp pourra être installé en forêt avec des habitations mobiles où ne pourront accéder que<br />
les ouvriers sans leurs familles. Comme pour le camp de Koumela, les ouvriers n’y résideront<br />
que du lundi au vendredi en période d’activités intenses. Ce type d’habitat ne sera envisagé<br />
que lorsque la distance par rapport au village de Koumela (site d’installation du camp<br />
permanent) dépassera les 60 à 80 km, soit au cours du second plan quinquennal. Un service de<br />
ravitaillement des ouvriers et de cuisine devra alors être organisé par l’entreprise.<br />
C’est aussi au niveau de ces campements que peuvent être disposées les citernes de<br />
ravitaillement en carburants et lubrifiants.<br />
Un camp au sud de l’UFA<br />
Ce camp sera installé le long de la route de Ndongo, pour l’exploitation des blocs<br />
quinquennaux de la partie sud de l’UFA. L’entreprise assurera le ravitaillement en vivres et la<br />
cuisine pour les ouvriers qui y vivront sans leurs familles.<br />
10.3.3 L’aménagement des parcs à bois<br />
Les parcs à bois sont des espaces aménagés pour le groupage des grumes dans le but<br />
d’organiser leur évacuation, de faciliter les contrôles et marquages par les services du MINEF<br />
et éventuellement de traiter celles des essences qui nécessitent de l’être.<br />
Leur emplacement et leur superficie sont déterminés en fonction de la richesse en essences<br />
exploitées des zones de coupe. Dans le cas de zones de fortes densités en essences exploitées,<br />
un parc à bois peut être aménagé pour 15 à 20 unités de comptage. La superficie des parcs,<br />
également variable selon le volume de bois, peut varier de 1 à 1,5 ha.<br />
Une estimation grossière dans le cas de l’UFA 10015 évalue à environ 30 à 40 le nombre de<br />
parcs à bois à aménager par an sur 30 ans.<br />
10.3.4 La construction du bac sur la Boumba (partie nord à l’embouchure de la Bek)<br />
Pour la traversée de la Boumba dont la largeur au point de l’embouchure avec la Bek est<br />
estimée à plus de 150 m, et d’une pr<strong>of</strong>ondeur variable de 4 à 6 m en période de crues,<br />
l’entreprise envisage de construire un bac à moteur d’une capacité maximale de 50 t destiné<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 71
au transport des véhicules légers, des engins, des camions et des grumiers. Avec une capacité<br />
de 50 t, le bac sera en mesure de ne faire traverser qu’un seul grumier chargé à la fois.<br />
La construction du bac nécessite les étapes ci-après :<br />
• le dégagement et l’aménagement des points d’accostage et des rampes d’accès,<br />
• la construction des piles en béton,<br />
• la fixation des câbles, soit un câble aérien et un câble immergé.<br />
• La construction d’une guérite pour le gardien et d’un petit magasin pour les<br />
équipements de maintenance et la réserve de carburant.<br />
xv.<br />
Embouchure de la Boumba et de la Bek où doit être installé le bac pour l’accès nord de l’UFA<br />
10015 (photo Erith Ngatchou)<br />
10.3.5 Les autres activités du projet<br />
Les autres activités du projet concernent la coupe, le tronçonnage de bois par abattage à la<br />
scie à moteur et le groupage des grumes dans les parcs à bois à l’aide des engins de traction<br />
(bulldozer D7 et 528) ou des engins de transport direct (fourchette).<br />
Le bois groupé est alors classé par essence pour organiser les opérations de contrôle, de<br />
martelage, de traitement ou d’évacuation. Un triage est également fait à l’aide de fourchettes<br />
pour isoler les grumes défectueuses.<br />
Les bois qui présentent des risques d’attaques de charançons ou qui sont déjà mulotés sont<br />
traités au cryptogyl.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 72
Les essences exploitées<br />
Le type d’essence coupé est fonction du marché et de la clientèle et la décision de l’entreprise<br />
est conséquente à une analyse coût/avantage. Ainsi, l’entreprise n’engage que l’exploitation<br />
des essences qui sont demandées en quantité et à un prix susceptible de sécuriser une marge<br />
bénéficiaire satisfaisante par mètre cube.<br />
En septembre 2002, le groupe VICWOOD THANRY exploitait environ 9 essences dans la<br />
région de Lokomo, dans l’UFA 10.011, soit notamment :<br />
- le sapelli - le tali - l’assamela<br />
- le sipo - le kossipo - le bossé<br />
- l’ayous - l’iroko - le dibetou (bibolo)<br />
Les tableaux ci-après présentent les résultats d’inventaires d’exploitation menés dans<br />
l’assiette N° 1 de l’UFA 10015.<br />
g) Tableau : Essences exploitables dans l’assiette N° 1 de l’UFA 10015<br />
Essences principales Essences principales Essences secondaires<br />
Nom<br />
Volume<br />
(m 3 )<br />
Nom Volume (m 3 ) Nom Volume (m 3 )<br />
Acajou de Bassam 139,70 Aminge ‘’R’’ 224,16 Aiele 431,70<br />
Aassamela 1484,92 Eyong 1499,28 Frake 7349,20<br />
Ayous 30574,40 Longhi 1819,42 Ilomba 403,98<br />
54,55 Pao Rosa 242,52 Koto 295,29<br />
Bete 55,08 Lati Parallèle 2266,33<br />
Bosse clair 26,50 Mambode 794,31<br />
Bosse foncé 550,20 Mukulungu 33,10<br />
Dibetou (bibolo) 255,47 Niove 386,3<br />
Doussie blanc 15,99 Okan 2523,71<br />
Doussie rouge 47,35 Padouk 865,97<br />
Iroko 3870,10 Tali 1938,30<br />
Kossipo 3405,60<br />
Kotibe 189,97<br />
Sapelli 22118,20<br />
Sipo 3822,00<br />
Tiama 1260,00<br />
Total 67869,73 Total 3785,38<br />
3616 tiges 578 tiges 2170 tiges<br />
Source :Rrésultats de l’inventaire d’exploitation de LF VEKO<br />
La commercialisation<br />
Compte tenu de la distance entre Lokomo et le port de Douala, un certain nombre d’essences<br />
ne peuvent être exploités, faute de rentabilité. Par ailleurs, on constate que les commandes de<br />
bois sont limités dans certaines essences à un nombre limité de sections. Il en résulte des<br />
pertes assez importantes dès que les sections tombées sont inférieures à la commande en<br />
cours.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 73
Il convient donc de retravailler systématiquement avec les commerciaux du Groupe<br />
VICWOOD THANRY pour rechercher des marchés de niches aptes à absorber des petites<br />
sections et à améliorer ainsi les rendements de sciage.<br />
Récupération des coursons et branches<br />
Par ailleurs, un niveau important de pertes en bois abandonnés est courant dans les<br />
concessions. Il convient de mieux valoriser ces bois abandonnés en forêt afin d’améliorer les<br />
rendements d’exploitation.<br />
xvi.<br />
Parc à grumes de l’usine de transformation de Lokomo (Photo Erith Ngatchou)<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 74
11 PROBLEMATIQUE ENVIRONNEMENTALE ET POINTS DE VU<br />
DES ACTEURS<br />
11.1 Chef de poste de Salapoumbé<br />
Le chef de poste de Salapoumbé trouve le projet louable et souhaiterait que la CIBC trouve<br />
des mesures alternatives, car ce projet risque d'intensifier le braconnage dans la zone. Ainsi, il<br />
suggère que la CIBC puisse par exemple appuyer la lutte contre le braconnage, en fournissant<br />
du carburant et en mettant en place un économat, comme c'est le cas à l'heure actuelle à la<br />
SEFAC à Libongo .<br />
11.2 Maire de Salapoumbé<br />
Tout d'abord, l'équipe des consultants a présenté le projet à Monsieur le Maire. A la suite de<br />
cette présentation, le Maire trouve que ce projet va permettre de créer un pôle de<br />
développement économique dans la région de Salapoumbé en général et dans le village de<br />
Koumela en particulier. Il a ensuite marqué son accord de principe pour sa mise en place et a<br />
conduit l'équipe d'EIE auprès des autorités en place. Il a également fait part des doléances ciaprès<br />
:<br />
• Construction des écoles dans les villages ;<br />
• Adduction d'eau dans les villages ;<br />
• Recrutement des autochtones au poste de responsabilités lors de l'exploitation de<br />
l'UFA 10015;<br />
• Construction des ponts ;<br />
• Distribution des déchets de bois aux populations ;<br />
• Appui aux collectivités locales ;<br />
• Trouver des alternatives au problème de braconnage ;<br />
• Appui aux autorités administratives ;<br />
• Construire le campement permanent à Koumela et identifier son site d'implantation en<br />
collaboration avec les populations.<br />
11.3 Antenne de WWF/MAMBELE<br />
Le Responsable du site Mambélé n'a pas tellement critiqué la mise en place d'un tel projet. Il a<br />
plutôt attiré l'attention de l'équipe d'EIE sur les problèmes que pourrait engendrer ce projet, à<br />
savoir:<br />
• L'augmentation du braconnage ;<br />
• Le conflit entre le Guide de Chasse et l'exploitant forestier au cas où le campement<br />
des ouvriers est installé à l'intérieur de l'UFA 10015;<br />
• Le problème de sécurisation des couloirs de migration des éléphants;<br />
Après avoir fait part des problèmes que pourraient engendrer l'exploitation de l’UFA 10015, il<br />
a par la suite proposé les recommandations suivantes :<br />
• Etudier au préalable les couloirs d'Éléphants ;<br />
• Sensibiliser le personnel sur les espèces protégées, surtout en matière de chasse<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 75
illégale<br />
• Sanctionner les ouvriers en possession des produits fauniques ou surpris en train de<br />
braconner;<br />
• La CIBC devra dénoncer les sites abritant les campements de braconnier dans sa<br />
zone ;<br />
• La CIBC devrait appuyer le MINEF lors des opérations coup de poing (en moyen<br />
financier et logistique comme le fait par exemple la SIBAF) ;<br />
• Etant donné que l'UFA 10015 possède des baïs riches en ressources fauniques, la<br />
CIBC devrait associer toutes les parties prenantes lors des ouvertures de pistes de<br />
débardage.<br />
11.4 Maire de Moloundou<br />
M. le Maire de Moloundou est satisfait de la mise en exploitation de l’UFA 10015 mais<br />
insiste pour que celle-ci se fasse en passant par Moloundou et donc par le sud de l’UFA.<br />
Il souhaite que, dans tous les cas, la CIBC assure l’entretien du bac et de la route de Ndongo<br />
qui désenclave les villages au sud de l’UFA, le long de la frontière.<br />
M. le Maire considère l’exploitation de l’UFA 10015 comme une opération majeure dans sa<br />
commune et souhaite, au delà des retombées fiscales, pouvoir en tirer un pr<strong>of</strong>it maximum que<br />
ce soit terme de création d’emplois, d’entretien du bac et des pistes de désenclavement,<br />
d’entretien de la route principale de Moloundou, de retombées économiques pour la ville de<br />
Moloundou ou encore d’utilisation des services sociaux et administratifs tels l’hôpital, le<br />
dispensaire, les écoles, etc.<br />
11.5 Chef de poste WWF de NDONGO<br />
Ce chef de poste souligne qu'il connaît bien l’UFA 10015 pour avoir fait partie de l'équipe de<br />
Monsieur BOBO qui a récemment réalisé une étude dans cette unité et pour avoir également<br />
organisé plusieurs opérations de lutte contre le braconnage dans cette zone. Selon ce dernier,<br />
l'UFA 10015 possède deux grands complexes de baïs se situant au sud de l'UFA et qui sont<br />
très riches en faune et dont il faudra tenir compte lors de l'exploitation forestière. Il ajoute<br />
également que de nombreuses salines sont à proximité de ces baïs, sans oublier les couloirs de<br />
migrations des grands mammifères. Pour ce chef de poste, les mesures suivantes doivent être<br />
prises pendant l'exploitation, à savoir :<br />
• Sensibiliser les ouvriers et les populations riveraines sur les espèces protégées ;<br />
• Licencier les ouvriers qui exercent le braconnage ou qui sont surpris avec un<br />
animal abattu ;<br />
• Avoir auprès de la CIBC un spécialiste de la faune qui va non seulement<br />
sensibiliser les ouvriers sur les textes en vigueur, mais également jouer l'interface<br />
entre les deux exploitants (Guide de chasse et exploitant forestier) ;<br />
• Bien délimiter et matérialiser les zones riches en ressources fauniques dans la ZIC<br />
N°38.<br />
11.6 Guide de Chasse de la Zone d’Intérêt Cynégétique n°31<br />
Dans le cadre de la présente étude, l'équipe de consultation a jugé opportun de visiter le Guide<br />
de Chasse de la ZIC N°31 pour un partage d'expérience, car la ZIC N°31 est aussi superposée<br />
à une UFA (1'UFA 10.064). En outre, le responsable de BOUMBA SAFARI (ZIC N°38) a<br />
confié la surveillance de sa zone de chasse au responsable de la ZIC N°31 pendant son<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 76
absence en intersaison.<br />
De l'entretien avec le responsable de la ZIC N°31, il se dégage deux éléments fondamentaux à<br />
prendre en compte lors de l'exploitation de l'UFA 10015, à savoir:<br />
• Appui à la lutte contre le braconnage par la CIBC;<br />
• La CIBC devrait trouver des mesures alternatives telles que l'élevage du gibier, du<br />
poulet, des chèvres, du mouton, afin de ravitailler les ouvriers et les populations<br />
riveraines en protéines animales.<br />
11.7 Représentant de la Zone d’Intérêt Cynégétique n°38 (ZIC38)<br />
Le représentant de la ZIC N°38 trouve le projet louable. Car, selon ce dernier, la zone d'intérêt<br />
cynégétique n°38 ne possède pas encore des pistes de chasse sur l’ensemble de la zone.<br />
Ainsi, l'ouverture des pistes de débardages leur permettra également de les utiliser non<br />
seulement pour faire la chasse mais aussi pour effectuer le contrôle contre le braconnage.<br />
Toutefois, continue-t-il, l'ouverture de ces pistes devrait tenir compte des zones riches en<br />
ressources fauniques, afin de ne pas beaucoup perturber l'habitat de la faune. En outre, ce<br />
dernier suggère que le Campement des ouvriers ne soit pas construit à l'intérieur de l'UFA<br />
10015, mais plutôt à Koumela.<br />
11.8 Antenne WWF/Poste <strong>Forest</strong>iers et Chasse du MINEF de NGATTO<br />
De prime à bord, les responsables de NGATTO, ont été un peu réticent en ce qui concerne la<br />
réhabilitation de la route Koumela — Embouchure Boumba- Bek. Mais, après clarification<br />
faite par l'équipe de consultation sur cette route tel qu'ils l'ont vu sur le terrain, les deux<br />
parties sont tombées d'accord sur sa réhabilitation. Néanmoins, l'équipe de NGATTO a<br />
proposé pour une meilleure exploitation de l'UFA 10015, les mesures d'atténuation suivantes:<br />
• Partenariat entre les acteurs ;<br />
• Protection des couloirs et des clairières à l'intérieur de l'UFA 10015 ;<br />
• Collaboration entre la cellule d'Aménagement du groupe VICWOOD THANRY et<br />
l'UTO Sud-Est.<br />
11.9 Responsables UTO Sud-Est<br />
II convient de souligner que l'étude d'impact de l'UFA 10015 a été demandée de manière<br />
expresse par les responsables de l'UTO, vu sa proximité avec le futur parc national de<br />
Boumba-Bek et Nki. De plus, les responsables de l'UTO connaissent bien ce projet pour avoir<br />
participer de bout en bout à l'élaboration des termes de références. Ainsi, les responsables de<br />
l'UTO ont marqué leur accord de principe pour la réalisation de ce projet tel que prévu dans<br />
les termes de références. Toutefois, ils ont suggéré à l'équipe de consultation de bien faire<br />
ressortir les mesures d'atténuation urgentes et à long terme, car selon eux, dès l'ouverture de la<br />
route, il faudra déjà prendre des dispositions pour lutter contre le braconnage et sensibiliser<br />
les populations. De plus, poursuivent-ils, ce projet aura des impacts sur le milieu physique,<br />
biologique et humain et il faudra prendre des dispositions à court, moyen et long terme.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 77
12 LES EFFETS ET IMPACTS POSSIBLES DU PROJET<br />
12.1 <strong>Impact</strong>s du projet au plan économique<br />
12.1.1 <strong>Impact</strong>s économiques positifs<br />
Les impacts économiques positifs du projet sont multiples et on peut les énumérer selon deux<br />
périodes : la phase actuelle avant exploitation et la phase d’exploitation correspondant à la<br />
période de concession actuelle sur 30 ans.<br />
On considère qu’il n’y a pas de phase d’après exploitation ou d’après projet, dans la mesure<br />
où la mise en œuvre des mesure de gestion durable des concessions forestières permet<br />
normalement de poursuivre directement l’exploitation après la phase actuelle par un nouveau<br />
cycle de 30 ans et ceci théoriquement indéfiniment.<br />
En phase actuelle<br />
• Le projet procure des emplois sur le bac (route Moloundou – Ndongo) et en forêt<br />
pour la garde de la pirogue à moteur effectuée par 3 personnes ;<br />
• Le projet génère des recettes en matière de redevance forestière sur les taxes<br />
payées à l’hectare soit 40 % à la commune rurale de Moloundou et 10 % aux<br />
communautés riveraines.<br />
En phase d’exploitation<br />
• La création d’emplois pour la jeunesse locale :<br />
o La création d’emplois directs.<br />
La CIBC prévoit embaucher près de 30 à 40 personnes supplémentaires pour les<br />
travaux d’exploitation et de transformation du bois de l’UFA 10015. Les postes<br />
spécialisés seront occupés par des employés prélevés sur l’effectif actuel de la<br />
société. Ce nouveau recrutement qui implique des retombées sera à l’origine d’une<br />
nouvelle fluidité de l’économie dans les villages de la zone en raison de<br />
l’augmentation de la masse monétaire.<br />
o La création d’emplois indirects.<br />
L’exploitation de l’UFA 10015 suscitera la création d’emplois indirects avec<br />
l’émergence de nouvelles activités économiques dans les villages impliqués<br />
(Koumela, Salapoumbé, Ndongo, Adjala, Tembe, etc.) et leurs environs : petite<br />
restauration, petits commerces (échoppes, bar, auberges, circuits…). Ces activités<br />
occupent généralement les femmes et les plus jeunes (petite restauration et petit<br />
commerce) qui trouvent ici un moyen d’accroître leurs revenus et partant<br />
d’améliorer leur condition de vie.<br />
L’augmentation de la population sera à l’origine d’un accroissement de la<br />
demande en viandes. Cette demande, on le sait très bien, est à l’origine de la<br />
chasse lucrative pratiquée par les jeunes qui en font une source de revenus.<br />
• Accroissement des prix des vivres locaux ;<br />
• Accroissement de la production stimulée par la demande ;<br />
• Location des espaces fonciers au bénéfice des propriétaires pour installation de<br />
camp ;<br />
• Location éventuelle de résidences pour le logement des employés du projet ;<br />
• Développement du petit commerce local ;<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 78
• Facilitation des transports grâce à un flux important de véhicules dans la localité et<br />
l’entretien des routes et ponts ;<br />
• Accroissement des revenus pour la commune et les communautés par le paiement<br />
des redevances liées à l’exploitation ;<br />
• Appui éventuel aux activités de chasse légale ;<br />
• Accroissement des recettes à l’Etat.<br />
12.1.2 <strong>Impact</strong>s économiques négatifs<br />
<strong>Impact</strong>s économiques négatifs du projet en phase actuelle<br />
Depuis l’attribution de l’UFA à la CIBC, les impacts négatifs relevés dans la localité au plan<br />
économique sont négligeables compte tenu du fait que l’UFA est assez éloignée des villages<br />
et pratiquement aucune exploitation artisanale de bois d’œuvre ne parvient jusque là, à<br />
l’exception des rares cas inavoués d’exploitation d’ébène qui, malgré leur caractère illégal,<br />
procurent cependant des revenus à leurs promoteurs. Ces activités sont quasi-bloquées depuis<br />
que l’UFA est sous surveillance.<br />
<strong>Impact</strong>s économiques négatifs du projet en phase d’exploitation<br />
Les impacts économiques négatifs du projet susceptibles de survenir en phase d’exploitation<br />
sont nombreux, nous citerons entre autres :<br />
• la perturbation des activités de chasse légale et de chasse traditionnelle ;<br />
• la perturbation des activités de pêche ;<br />
• la perturbation du petit artisanat par la coupe des essences utilisées par les artisans<br />
(ayous, padouk rouge etc.).<br />
12.2 <strong>Impact</strong>s du projet dans le domaine de l’Environnement<br />
12.2.1 <strong>Impact</strong>s environnementaux positifs<br />
Ils sont scindables selon les phases d’analyses choisies.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux positifs au stade actuel<br />
Le projet au stade actuel génère quelques impacts positifs surtout liés à la surveillance de la<br />
forêt par le guide de chasse et le personnel de l’Entreprise. Ainsi la coupe illicite de bois et<br />
l’exploitation anarchique de la faune sont freinées.<br />
<strong>Impact</strong>s Environnementaux positifs en phase d’exploitation<br />
On peut en citer quelques uns parmi lesquels :<br />
• le drainage des marres d’eau à l’instar de la grande marre située au PK 2,900 de la<br />
route Koumela-boumba sur la rivière Kpokilo, qui abrite des larves de moustiques<br />
et a détruit le site de récolte de raphia ;<br />
• la canalisation des eaux de ruissellement ;<br />
• le désenclavement qui pourra faciliter l’accès des services d’hygiène (AAPEC) à<br />
des endroits jusque là inaccessibles (campement Baka de Botolo par<br />
exemple,….) ;<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 79
• le déploiement du dispositif de surveillance du parc de Boumba-Bek et de lutte<br />
anti-braconnage par l’UTO Sud-Est grâce à l’ouverture des pistes ;<br />
• la résolution des problèmes d’inondation de la chaussée sur certains cours d’eau<br />
de la route Moloundou-Ndongo ;<br />
• l’enrichissement du sol par apport de la matière organique produite par les<br />
défrichements et l’abattage.<br />
12.2.2 <strong>Impact</strong>s Environnementaux négatifs<br />
A l'heure actuelle, la surface allouée en Unité <strong>Forest</strong>ière d'aménagement (UFA) au Cameroun<br />
représente un fort pourcentage des forêts situées hors des aires protégées. Ces unités<br />
forestières d'aménagements sont très riches en biodiversité et leur exploitation entraîne dans la<br />
plupart des cas des dégâts importants sur la biodiversité.<br />
Ainsi, si nous tenons à réduire l'impact de l'exploitation forestière sur cette biodiversité, nous<br />
devons tout d'abord chercher à comprendre quelles pratiques pouvons-nous modifier pendant<br />
cette exploitation forestière.<br />
En effet, dans le cadre de l'exploitation de l'UFA 10015, objet de la présente étude, les<br />
éléments du projet de mise en exploitation de cette UFA susceptibles d'avoir des impacts<br />
négatifs sur la biodiversité sont les suivants:<br />
• La réhabilitation et l'utilisation de la route Koumela -Embouchure de Boumba-<br />
Bek(au nord de l'UFA 10015 et au sud<br />
• du futur Parc national de Boumba-Bek/Nki) ;<br />
• La construction et l'utilisation d'un Bac au niveau de l'embouchure de Boumba-<br />
Bek pour accéder à l'UFA 10015 ;<br />
• L'installation d'un campement d'ouvrier à l'intérieur de l'UFA 10015 ;<br />
• Les travaux d'inventaire d'aménagement de l'UFA 10015 ;<br />
• Les activités d'abattage, de débardage et de stockage de bois en forêt<br />
• l’utilisation de produits chimiques de préservation des bois abattus.<br />
12.2.2.1 <strong>Impact</strong>s potentiels de la réhabilitation de la piste Koumela- Boumba et de<br />
l’ouverture des routes et pistes à l’intérieur de l’UFA<br />
• Perturbation de l’habitat de la faune sauvage<br />
La piste Koumela-Embouchure Boumba-Bek, traverse une zone agr<strong>of</strong>orestière.<br />
Cette zone très riche en ressources fauniques, notamment en grands mammifères<br />
telles que le Bongo, les Eléphants, les chimpanzés, les gorilles, etc… et en<br />
produits forestiers non ligneux connaîtra avec la réhabilitation de la piste une<br />
perturbation des habitudes de migration des animaux. Les routes peuvent agir<br />
comme barrière à la dispersion et à la migration des animaux forestiers. Les<br />
animaux vivant dans la canopée et qui ne peuvent traverser de houppier à houppier<br />
sont particulièrement concernés. De plus, avec la circulation des grumiers pendant<br />
la nuit, le risque d’écrasement des animaux est élevé.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 80
• Perte directe de couvert forestier : les travaux d’aménagement au niveau des<br />
emprises et de décapage des zones d’emprunt pour le latéritage de la piste ont<br />
comme conséquence la destruction de la couverture végétale. Plus il y a de routes<br />
et plus larges sont elles, plus la couverture forestière est détruite. A l’intérieur de<br />
l’UFA, ceci peut entraîner une diminution significative de la superficie en forêt ;<br />
• Augmentation de la pression sur la faune sauvage comme source de nourriture<br />
En marge de l’exploitation proprement dite, la réhabilitation de la piste Koumela –<br />
Embouchure Boumba (difficilement accessible jusqu’à l’heure actuelle) pourra<br />
faire d’elle un axe de saignée de la faune sauvage, car elle favorisera la pénétration<br />
des braconniers non seulement dans la ZICGC 8, mais aussi dans le parc de<br />
Boumba-Bek et Nki.<br />
L’intensité de cet impact dépendra de l’importance de la demande en viandes de<br />
brousse. Plus celle-ci sera élevée, plus la chasse sera importante avec un impact<br />
fort sur la réserve de la faune sauvage. Avec l’installation du Bac, les braconniers<br />
vont ainsi trouver un moyen rapide pour accéder au Parc et une pression sera<br />
observée sur la ressource faunique et les produits forestiers non ligneux de cette<br />
aire protégée. Un accroissement des activités de braconnage pourra être à l’origine<br />
du développement d’un réseau de commercialisation du gibier dans la zone.<br />
• Pêche illégale : en raison de la richesse en ressources halieutiques des rivières de<br />
la zone et de la Boumba en particulier, il est prévisible avec la réhabilitation de la<br />
piste qu'une intensification des activités de pêche soit observée avec comme<br />
conséquence éventuelle la pollution ou la disparition de certaines espèces.<br />
• Erosion du sol : Le sol nu est plus susceptible à l’érosion que quand il est sous<br />
couvert et maintenu par les racines. L’érosion peut conduire à des pertes de<br />
production en bordure des routes par la perte des couches supérieures du sol,<br />
riches en nutriments ;<br />
• Sédimentation dans les lits de rivière : le sol érodé provenant des routes sédimente<br />
dans les lits de rivière, affectant la qualité de l’eau pour la vie aquatique animale et<br />
végétale, ainsi que la santé humaine lorsque la population utilise l’eau pour la<br />
boisson.<br />
• Dommages aux paysages. Dans une zone à valeur récréative, les routes peuvent<br />
détériorer la valeur paysagère associée à la forêt.<br />
12.2.2.2 <strong>Impact</strong>s potentiels de la construction et de l'utilisation d'un Bac au niveau<br />
de l'embouchure de Boumba-Bek pour accéder à l'UFA 10015<br />
• Destruction de la couverture végétale aux abords de Boumba-Bek<br />
Les travaux de construction du bac vont entraîner le déboisement de la couverture<br />
végétale au niveau de l'embouchure de Boumba-Bek ainsi que la destruction de la<br />
végétation aquatique et des sites de ponte des poissons.<br />
• Perturbation de l'habitat de la faune aquatique<br />
Pendant la construction et même l'utilisation du Bac, les bruits du Bac vont<br />
détruire les lieux de frayères des poissons et les éloigner de leur site de<br />
prédilection.<br />
• Augmentation du Braconnage<br />
La Boumba-Bek présente beaucoup de zones de rapides ce qui limite par<br />
conséquent l'accès aux braconniers dans la partie nord de l'UFA 10015 et la partie<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 81
sud du futur Parc National de Boumba-Bek et Nki qui, avant l'installation du bac,<br />
se protégeait naturellement. Avec l’installation du Bac, les braconniers pourraient<br />
ainsi trouver un moyen rapide d’accéder au Parc et exerceront une pression qui<br />
sera observée sur la ressource faunique et les produits forestiers non ligneux de<br />
cette aire protégée.<br />
12.2.2.3 <strong>Impact</strong>s potentiels de l’installation des infrastructures : les campements<br />
mobiles<br />
L’installation des infrastructures, de par les travaux d’aménagement préalables qu’elle<br />
impose, présente forcément des incidences négatives sur l’environnement. Parmi ces<br />
incidences, on peut citer :<br />
• Perte directe de couvert forestier, quand le campement et les ateliers sont<br />
construits ;<br />
• Erosion du sol : un sol nu sur de grandes surfaces d’un seul tenant et soumis au<br />
passage régulier des engins et véhicules est très sensible à l’érosion ;<br />
• Risque de pression sur la faune par la chasse par le personnel des campements ;<br />
• Dégradation de la qualité de l’eau (sédimentation, déchets du garage et des<br />
ateliers, huiles usagées, déchets ménagers, etc..)<br />
12.2.2.4 <strong>Impact</strong>s potentiels des travaux d’inventaire<br />
Les travaux d’inventaire consistent en l’ouverture de layons nécessaires au déplacement des<br />
équipes et au repérage des arbres et en comptage et marquage des arbres. Les principaux<br />
impacts de ces opérations sont :<br />
• La perturbation de la faune : la présence en forêt d’une dizaine à une vingtaine de<br />
personnes bivouaquant entraîne un décantonnement des animaux, voire une baisse<br />
des populations si ces personnes chassent pour se nourrir ;<br />
• Les dégâts au peuplement : ces dégâts en général minimes consistent en la<br />
destruction du sous-bois sur une largeur variable pour matérialiser les layons et au<br />
marquage des arbres à la machette pour bien s’assurer qu’ils ont été comptés ; ce<br />
marquage peut être la porte d’entrée de pathogènes si l’arbre marqué n’est pas<br />
destiné à être abattu dans un court délai.<br />
12.2.2.5 <strong>Impact</strong>s potentiels des activités d’abattage et de débardage<br />
• <strong>Impact</strong>s sur les sols. Le débusquage et le débardage entraînent une compaction du<br />
sol et une érosion. La compaction du sol, créée par le passage des engins, réduit la<br />
capacité d’absorption de l’eau des sols. L’eau coule alors en surface, en causant de<br />
l’érosion. Les racines des plantes ont une faible croissance dans les conditions<br />
anaérobiques des sols compactés, ce qui affecte la régénération et les récoltes<br />
futures.<br />
• <strong>Impact</strong>s sur l’eau : Le débardage des bois à travers les cours d’eau peut<br />
endommager le lit des cours d’eau et affecter l’écoulement. Des niveaux plus<br />
élevés d’érosion sur les pistes entraînent une sédimentation plus forte dans les<br />
cours d’eau, ce qui affecte la qualité de l’eau pour la vie aquatique.<br />
• <strong>Impact</strong>s sur le peuplement restant : les arbres abattus blessent et cassent d’autres<br />
arbres lors de leur chute. Les lianes accrochées aux arbres peuvent en entraîner<br />
d’autres dans leur chute. Les engins de débusquage et de débardage écrasent des<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 82
plantules, cassent des jeunes arbres et arrachent l’écorce des arbres adultes. Ceci<br />
affecte la capacité de la forêt à régénérer et donc les futures récoltes.<br />
• <strong>Impact</strong>s sur la faune : Les perturbations causées par l’exploitation forestière font<br />
fuir les animaux vers des zones non exploitées (Parc de Boumba-Bek et Nki,<br />
ZICGC 10 et dans une moindre mesure la forêt communale et la ZIGC 9), où ils<br />
entrent alors en compétition avec les animaux déjà présents. Leur reproduction<br />
peut également être perturbée.<br />
12.2.2.6 <strong>Impact</strong>s potentiels de l’utilisation des produits de préservation des bois sur<br />
l’environnement forestier<br />
Les produits chimiques les plus utilisés par l’exploitation forestière sont les produits de<br />
préservation des grumes des attaques d’insectes et de champignons, utilisés en aspersion sur<br />
les parcs à bois. Les effets négatifs de l’utilisation de ces produits peuvent être :<br />
• Les produits peuvent être dispersés en forêt à proximité des parcs à bois si les<br />
techniques d’épandage ne sont pas maîtrisées ;<br />
• Les animaux et plantes des cours d’eau avoisinants peuvent être affectés ;<br />
• La qualité de l’eau de boisson peut être affectée ;<br />
• Les personnes vivant à proximité des parcs et les opérateurs peuvent être affectés ;<br />
• Les produits peuvent entrer dans les chaînes alimentaires, affectant la vie sauvage,<br />
et la biodiversité.<br />
Les impacts environnementaux négatifs du projet peuvent être présentés selon les éléments<br />
environnementaux touchés et selon les phases d’analyse.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs du projet au stade actuel<br />
Au stade actuel, les impacts environnementaux négatifs se résument à la perturbation de la<br />
faune lors des activités de prospection et d’inventaires.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) du projet en phase d’exploitation<br />
Ces impacts sont présentés ci-après en fonction des éléments environnementaux touchés, soit<br />
notamment : le sol, les eaux de surface, la faune, les ressources halieutiques, la flore, l’air, la<br />
qualité acoustique, les risques naturels et anthropiques, les crises et conflits :<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) sur les eaux de surface<br />
• La perturbation de l’écoulement des eaux de surface lors de l’aménagement des<br />
routes et pistes, la construction des ponts ;<br />
• La pollution éventuelle des eaux de surface lors des opérations de vidange ou de<br />
nettoyage du matériel ;<br />
• La pollution éventuelle des eaux de surface par les produits de traitement des<br />
grumes ou lors des opérations de stockage ou de distribution des hydrocarbures ;<br />
• La pollution de l’eau par les fuites et échappements d’hydrocarbures liés au<br />
fonctionnement des bacs ;<br />
• La pollution éventuelle des eaux de surface par une mauvaise gestion des déchets<br />
de chantier et des eaux usées ;<br />
• L’obstruction éventuelle des cours et plans d’eau par la chute des arbres.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 83
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) sur la faune et les ressources<br />
halieutiques<br />
• La perturbation des animaux par les bruits persistants des engins et moteurs de<br />
véhicules en forêt,<br />
• La destruction des couloirs de migration, l’habitat des animaux et les zones de<br />
fréquentation des espèces de faune,<br />
• La perturbation par l’abattage de certains fruitiers sauvages servant à<br />
l’alimentation de certaines espèces de faune,<br />
• L’augmentation éventuelle du braconnage due à l’ouverture des voies d’accès et la<br />
présence continue des ouvriers en forêt,<br />
• L’augmentation de la pression sur les ressources halieutiques suite à l’ouverture<br />
des voies d’accès,<br />
• La perturbation de la faune aquatique par les bruits du bac et la pollution<br />
éventuelle des eaux,<br />
• La génération de risque d’intoxication de la faune par les contenants vides<br />
d’insecticides ou autres produits toxiques éventuellement utilisés par les ouvriers.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) sur la flore<br />
• La destruction de la flore par le défrichement lors de la construction des routes et<br />
pistes, des parcs et campements,<br />
• La destruction des jeunes arbres non visés lors des opérations d’abattage,<br />
• La destruction éventuelle des espèces rares et menacées de disparition lors des<br />
opérations d’abattage,<br />
• La perturbation de l’écosystème forestier par la coupe des essences recherchées<br />
par l’exploitation.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) sur l’air et la qualité acoustique<br />
• Pollution de l’air par les gaz d’échappement des engins, des véhicules divers et du<br />
bac,<br />
• Perturbation de la qualité acoustique par le bruit persistant des engins, des<br />
véhicules, du bac, des scies à moteur et de la chute des arbres,…<br />
• Pollution de l’air par les poussières en saison sèche.<br />
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) en rapport avec les risques naturels et<br />
anthropiques<br />
• La provocation éventuelle des inondations due à la perturbation des eaux de<br />
surface,<br />
• La provocation de l’érosion due au décapage de la terre végétale et des horizons<br />
pédologiques,<br />
• La création des risques d’incendies dans les installations de chantiers,<br />
• La génération des risques d’accidents liés à l’abattage des arbres, la circulation des<br />
engins et véhicules, ou le transport des grumes,<br />
• La génération des risques liés à l’agression par les animaux féroces en forêt.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 84
<strong>Impact</strong>s environnementaux négatifs (IEN) en rapport avec les crises et conflits<br />
• Les tensions sociales peuvent provenir d’une mauvaise politique de recrutement<br />
aux emplois du projet,<br />
• La cohabitation entre les employés allogènes du projet et les autochtones peut être<br />
la source de conflits,<br />
• Une mauvaise application des procédures d’expropriation peut être à l’origine des<br />
conflits,<br />
• La méconnaissance ou le non respect du cahier de charges par l’entreprise peut<br />
être à l’origine des conflits,<br />
• L’inexistence d’un mécanisme de règlement à l’amiable des différends entre<br />
l’entreprise et les communautés peut être à la base des conflits et des crises graves.<br />
12.3 <strong>Impact</strong>s du projet dans le domaine esthétique et culturel<br />
Les impacts du projet dans le domaine culturel ont été analysés en rapport avec la situation<br />
actuelle, la phase d’exploitation et la situation après exploitation.<br />
12.3.1 <strong>Impact</strong>s culturels positifs<br />
Au stade actuel<br />
Les impacts du projet dans le domaine culturel sont négligeables compte tenu du fait que le<br />
personnel d’études et de prospection qui y travaille de temps en temps est en nombre<br />
négligeable et réside souvent à la base de Lokomo.<br />
En phase d’exploitation<br />
Les impacts culturels positifs seront considérables avec notamment :<br />
- L’aménagement éventuel des aires de sport par les engins du projet,<br />
- L’animation des villages avec l’organisation probable des tournois de sport et<br />
autres activités récréatives,<br />
- L’installation probable des centres d’animation et dancing qui viendront<br />
répondre à une demande en matière de distraction.<br />
12.3.2 <strong>Impact</strong>s négatifs dans les domaines esthétique et culturel<br />
Au stade actuel<br />
Les impacts culturels négatifs sont négligeables au stade actuel du projet.<br />
En phase d’exploitation<br />
Les impacts attendus sont de plusieurs natures :<br />
- Le développement de la délinquance due à l’affluence des étrangers et des<br />
débits de boisson,<br />
- La perturbation éventuelle des comportements et des valeurs ancestrales,<br />
- La violation des interdits locaux par les employés du projet,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 85
- La modification du paysage due aux défrichements pour la construction des<br />
routes, des camps, des parcs, la recherche des carrières et zones d’emprunt ou<br />
alors le dégagement des sites pour construction,<br />
- La violation éventuelle des sites sacrés situés en forêt,<br />
- La destruction des arbres fétiches.<br />
12.4 <strong>Impact</strong>s du projet dans le domaine des services publics essentiels<br />
On notera des impacts positifs et des impacts négatifs qui se manifesteront selon les phases du<br />
projet.<br />
12.4.1 <strong>Impact</strong>s positifs du projet dans le domaine des services publics essentiels<br />
Au stade actuel<br />
Les populations bénéficient de quelques avantages en rapport avec :<br />
- le maintien en fonctionnement du bac sur la Boumba sur la route Moloundou-<br />
Ndongo,<br />
En phase d’exploitation<br />
- L’aménagement éventuel des écoles, centres de santé et points d’eau,<br />
- Les communautés pourront bénéficier éventuellement des facilités <strong>of</strong>fertes par<br />
le projet en matière d’énergie et de transports.<br />
12.4.2 <strong>Impact</strong>s négatifs du projet dans le domaine des services publics essentiels<br />
Au stade actuel<br />
Les impacts négatifs du projet dans le domaine des services publics essentiels sont<br />
négligeables au stade actuel.<br />
En phase d’exploitation<br />
- L’accroissement du trafic va créer un accroissement des risques d’accidents de<br />
la route,<br />
- L’accroissement des risques d’accident à la traversée des zones scolaires ou<br />
des marchés,<br />
- L’accroissement des risques d’accidents de chantier.<br />
12.5 <strong>Impact</strong>s du projet sur le plan social<br />
Ces impacts sont scindables selon leur caractère (positif/négatif) et selon les phases d’analyse.<br />
12.5.1 <strong>Impact</strong>s positifs<br />
• L’ouverture des routes va faciliter les interventions des autorités même dans les<br />
villages jadis enclavés à l’instar de Bottolo pour le règlement des litiges, et les<br />
opérations de routine de l’administration (recensement démographique ou fiscal,<br />
sensibilisation en matière économique, d’hygiène et salubrité etc…),<br />
• L’amélioration de l’habitat et le développement du petit artisanat peuvent se<br />
développer à base des déchets de bois fournis sur le projet.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 86
12.5.2 <strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Au stade actuel<br />
Le projet génère des impacts sociaux négatifs divers dont nous citerons notamment :<br />
• La création des tensions liées à l’aménagement d’une voie d’accès dans l’UFA par<br />
le Nord,<br />
• La création des tensions liées à des revendications voilées sur la destination des<br />
redevances forestières payées par le projet et la désignation des communautés<br />
dites riveraines,<br />
• Les revendications démesurées des communautés qui laissent planer des<br />
inquiétudes sur le développement harmonieux futur du projet<br />
En phase d’exploitation<br />
La mise en exploitation de l’UFA 10015 aura certainement des impacts à plusieurs niveaux<br />
notamment au niveau du village Koumela où le campement sera installé en raison de<br />
l’augmentation de la population. Compte tenu des caractéristiques de la population locale,<br />
cette augmentation aura des impacts qu’il est important de circonscrire afin d’en atténuer les<br />
effets indésirables.<br />
• Le risque de conflit entre les employés allogènes et les autochtones ;<br />
La cohabitation entre les employés autochtones et allogènes du projet peut être<br />
difficile et déboucher sur des conflits si la population autochtone ne se sent pas<br />
privilégiée dans la politique de recrutement notamment pour des opérations non<br />
spécialisées ;<br />
• Une flambée des prix des produits de consommation et de première nécessité à la<br />
suite d’un déséquilibre significatif causée par une <strong>of</strong>fre faible face à une demande.<br />
Bien que l’idée de la politique de recrutement de la CIBC soit de privilégier les natifs<br />
de la région, l’installation du campement entraînera à court ou à moyen terme la<br />
migration des populations en quête du travail et la forte concentration dans les<br />
campements. Ceci a pour conséquence de favoriser les conflits possibles entre les<br />
différentes ethnies et de créer une demande solvable qui perturbera les trop fragiles<br />
circuits locaux de commerce.<br />
• <strong>Impact</strong> sur la santé des populations : Propagation des maladies sexuellement<br />
transmissibles et du SIDA.<br />
Avec l’arrivée de nouvelles personnes au niveau du village d’installation du campement<br />
(Koumela), on observera avec l’importance des flux humains une multiplication du<br />
vagabondage sexuel et le propagation des maladies sexuellement transmissibles/SIDA qui en<br />
sont la conséquence immédiate ;<br />
<strong>Impact</strong> sur le droit d’usage et la cueillette.<br />
• La déforestation et la disparition des essences utiles aux populations.<br />
L’UFA 10015 est une zone primaire de cueillette et de chasse pour les populations de<br />
Koumela et ses environs et celles de la partie sud. Son exploitation pourrait entraîner la<br />
destruction voire la disparition de certaines essences utiles aux populations (plantes<br />
médicinales, essences à fruits sauvages ou à épices servant dans l’alimentation, essences<br />
utilisées dans la pharmacopée traditionnelle). Cette destruction sera préjudiciable aux<br />
populations à partir du moment où elle sera à l’origine de l’éloignement des zones de<br />
cueillette. Ce phénomène d’éloignement pourra éventuellement se ressentir par la pression sur<br />
le futur parc de Boumba-Bek, seule zone caractéristique des forêts primaires.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 87
• La violation des lieux sacrés :<br />
En raison de son caractère quasi primaire, cette forêt abrite en période de sécheresse (de<br />
décembre à février) des rites culturelles des populations, notamment les pygmées Baka.<br />
L’exploitation de cette forêt aura une perturbation sur les pratiques culturelles et ancestrales<br />
des populations Baka. Cette perturbation pourra avoir des implications sur le futur parc en<br />
raison de la migration des populations à le recherche des sites caractéristiques.<br />
Le ralentissement des activités de chasse, de cueillette et de collecte, ce qui conduit à un<br />
changement brusque de leur mode de vie.<br />
D’autres impacts sur la plan social pourront être relevés notamment :<br />
• le développement de l’alcoolisme dû à l’augmentation du flux monétaire et des débits<br />
de boisson dans les villages ;<br />
• le développement éventuel des fléaux sociaux inhabituels tels que le vol, le grand<br />
banditisme, la délinquance, etc.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 88
13 EVALUATION DES EFFETS ET IMPACTS DU PROJET<br />
13.1 Les domaines de référence<br />
Les divers impacts potentiels du projet ont été évalués sur la base des domaines de<br />
référence ci-après :<br />
• L’espace de référence<br />
L’espace de référence est représenté par les villages entourant l’UFA, et surtout ceux qui ont<br />
des liens fonctionnels avec ce massif forestier. Il s’agit notamment des 7 villages de l’axe<br />
Moloundou-Ndongo, des villages de Yenga, Mbanjani, Mambélé, Koumela et Salapoumbé<br />
(dans une moindre mesure) où des voies d’accès dans l’UFA ont été repérées.<br />
• Les horizons de référence<br />
Les horizons d’analyse ont été déterminés en deux phases : phase actuelle où le projet a déjà<br />
une existence sur le terrain et la phase d’exploitation d’une durée estimée à 30 ans.<br />
• Les états de référence<br />
Les états d’analyse regroupent l’état du site sans le projet et l’état avec le projet.<br />
• Les indicateurs de mesure d’impacts<br />
Ils concernent l’ampleur ou l’intensité, l’étendue de l’impact, la durée de l’impact et la<br />
réversibilité. Ces indicateurs ont été évalués sur la base des méthodes ad hoc et les évaluations<br />
ont été menées selon l’approche d’une analyse multicritère avec un présupposé d’équilibre<br />
pondéral des différents critères.<br />
13.2 Les échelles d’évaluation des indicateurs d’impacts<br />
Les indicateurs d’impacts ont été mesurés selon une échelle à 5 mesures. La mesure a surtout<br />
porté sur les impacts négatifs en raison du fait que c’est sur ceux-ci qu’on doit développer des<br />
mesures d’atténuation.<br />
• L’ampleur ou l’intensité<br />
Elle a été évaluée en 5 cotes désignant notamment des niveaux de manifestation des impacts<br />
notés 1, 2, 3, 4 et 5 :<br />
la cote 1 – caractérise un impact d’intensité faible et négligeable,<br />
la cote 2 – caractérise un impact d’intensité ressentie,<br />
la cote 3 – caractérise un impact d’intensité assez importante et nécessitant des<br />
mesures,<br />
la cote 4 – caractérise un impact fortement ressenti, nécessitant des mesures qui<br />
malgré tout laissent un impact résiduel,<br />
la cote 5 – caractérise un impact très fort imposant des contraintes graves.<br />
• L’étendue<br />
Ella a été évaluée en 5 cotes désignant des étendues de manifestations des impacts notées de 1<br />
à 5 :<br />
La cote 1 : caractérise un impact localisé à un espace réduit et susceptible de<br />
toucher un à quelques 10 ménages au maximum,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 89
La cote 2 : caractérise un impact notable, assez étendu et susceptible de toucher<br />
plus de 10 ménages dans l’espace de référence,<br />
La cote 3 : caractérise un impact assez étendu et susceptible de toucher entre 3 et<br />
25 % de la population de l’espace de référence,<br />
La cote 4 : caractérise un impact étendu et susceptible de toucher entre 25,1 % et<br />
49 % de la population de l’espace de référence.<br />
La cote 5 : caractérise un impact très étendu pouvant toucher 50 % et plus de la<br />
population de l’espace de référence.<br />
• La durée de l’impact<br />
La durée de l’impact a été évaluée sur une échelle à 5 paliers désignés par les cotes 1, 2, 3, 4<br />
et 5 :<br />
La cote 1 – impact de durée limitée à la période d’avant projet ou à la durée où se<br />
développe l’action qui en est la source,<br />
La cote 2 – impact de durée correspondant à des phases sporadiques dans le<br />
développement du projet (construction par exemple),<br />
La cote 3 – impact de durée assez longue couvrant la quasi totalité de la phase<br />
d’exploitation,<br />
La cote 4 – impact de durée longue couvrant la phase actuelle et toute la phase<br />
d’exploitation,<br />
La cote 5 – impact de durée très longue allant au delà de la phase d’exploitation.<br />
• La réversibilité<br />
Cet indicateur a été évalué selon une échelle à 5 niveaux cotés de 1 à 5 :<br />
La cote 1 – impact fugace et qui s’estompe quand cesse l’action source,<br />
La cote 2 – impact assez réversible sous condition de prise de mesures<br />
préventives,<br />
La cote 3 – impact persistant nécessitant la prise de mesures de jugulation, mais<br />
jugulable par celles-ci,<br />
La cote 4 – impact persistant nécessitant la prise des mesures, de réversibilité<br />
inférieure à 50 % de son intensité (moins de 50 % de son intensité<br />
est réduit par les mesures d’atténuation),<br />
La cote 5 – impact totalement irréversible et persistant au-delà de la durée du<br />
projet.<br />
13.3 L’évaluation absolue des impacts<br />
L’évaluation absolue des impacts se fait par calcul de la moyenne pondérée des divers<br />
indicateurs d’impacts. Par souci de simplification et compte tenu du fait que le temps imparti<br />
à l’étude ne pouvait pas permettre une analyse systématique permettant d’évaluer le poids de<br />
chaque indicateur, nous avons convenu que les indicateurs étaient d’importance pondérale<br />
identique et la cote d’évaluation de chaque impact était calculée par la moyenne arithmétique<br />
des cotes des différents indicateurs. Ainsi :<br />
La cote 1 à 1,9 : désigne un impact faible et négligeable<br />
La cote 2 à 3 : impact notable nécessitant des mesures d’atténuation,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 90
La cote 3,1 à 4 : impact sévère, action réalisable sous condition et selon les choix<br />
politiques,<br />
La cote 4, 1 à 5 : impact très sévère, action à éviter ou à contourner.<br />
13.4 L’évaluation des impacts selon les communautés<br />
L’évaluation des impacts par les communautés s’établit par attribution des cotes<br />
selon le pourcentage de population ayant confirmé le problème lors des enquêtes et des<br />
réunions de consultation. Elle est présentée dans le tableau récapitulatif dans la colonne<br />
« évaluation relative ».<br />
Cote 1 : 0 à 5 % des populations ont confirmé le problème, l’impact est faible et<br />
négligeable selon les communautés,<br />
Cote 2 : 5,1 % à 10 % des personnes interrogées ont confirmé le problème (impact<br />
faible mais notable, nécessitant des mesures préventives),<br />
Cote 3 : 10,1 % à 25 % des personnes interrogées ont confirmé le problème. Ceci<br />
signifie un impact fort nécessitant des mesures d’atténuation,<br />
Cote 4 : 25,1 % à 40 % des personnes interrogées ont confirmé l’impact sévère<br />
susceptible d’un impact résiduel malgré les mesures d’atténuation,<br />
Cote 5 : 40,1 % et plus des personnes interrogées ont confirmé le problème.<br />
<strong>Impact</strong> très sévère nécessitant de surseoir ou d’annuler l’action qui en est<br />
la source.<br />
xvii.<br />
Réunion avec les populations (photo Erith Ngatchou)<br />
La colonne « évaluation globale » présente la moyenne des résultats des colonnes<br />
« évaluation absolue » et « évaluation relative ».<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 91
13.5 Evaluation des impacts négatifs du projet<br />
Domai<br />
ne<br />
ECONOMIQUE<br />
ENVIRONNEMENT<br />
Pourcentage<br />
Ampleur<br />
Elément<br />
Evaluation d’individus ayant Evaluation Evaluation<br />
environnementaux <strong>Impact</strong>s négatifs<br />
ou Etendue Durée Réversibilité<br />
absolue confirmé le relative globale<br />
intensité<br />
problème<br />
Activités agricoles Destruction des cultures 3 2 2 4 2,75 62,11 5 3,88<br />
Activités de chasse Perturbation des activités de chasse 4 4 5 4 4,25 23,60 3 3,62<br />
Activités de pêche Perturbation des activités de pêche 1 3 3 1 2 30,43 4 3<br />
Artisanat Perturbation du petit artisanat 1 1 3 4 2,25 4,64 1 1,62<br />
Revenu<br />
Demande<br />
Sol<br />
Eaux de surface<br />
Perte de revenus liés au projet dès<br />
sa fin<br />
Chute de la demande en produits<br />
locaux à la fin du projet<br />
Perturbation du sol lors des<br />
terrassements<br />
Pollution des sols par les<br />
hydrocarbures et produits de<br />
traitement des grumes<br />
Perturbation des berges de la<br />
Boumba<br />
Perturbation des zones<br />
marécageuses<br />
Perturbation par l’extraction de<br />
matériaux (sable, graviers, latérite)<br />
Perturbation de l’écoulement des<br />
eaux de surface<br />
Pollution des eaux de surface par<br />
les hydrocarbures et produits de<br />
traitement des grumes<br />
4 4 5 4 4,25 - - 4,25<br />
4 4 4 3 3,75 - - -<br />
4 4 4 5 4,25 24,84 3 3,62<br />
3 3 4 4 3,5 16,10 3 3,25<br />
2 1 3 4 2,5 2,02 1 1,75<br />
3 3 3 4 3,25 22,10 3 3,12<br />
4 2 4 4 3,5 08 2 2,75<br />
4 3 5 4 4 24,84 3 3,5<br />
3 3 4 4 3,5 16,10 3 3,25<br />
Pollution des eaux de surface par<br />
les bacs<br />
2 1 3 1 1,75 2,02 1 1,37
Domaine<br />
ENVIRONNEMENT (suite)<br />
Elément<br />
environnement<br />
aux<br />
Eaux de surface<br />
Faune et<br />
ressources<br />
halieutiques<br />
Flore<br />
<strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Pollution des eaux de surface par les<br />
déchets de chantier<br />
Obstruction des cours d’eau et plans<br />
d’eau par la chute des arbres<br />
Ampleur<br />
ou<br />
intensité<br />
Etendue Durée Réversibilité<br />
Evaluation<br />
absolue<br />
Pourcentage<br />
d’individus ayant<br />
confirmé le<br />
problème<br />
Evaluation<br />
relative<br />
2 2 3 2 2,25 2,25<br />
2 2 3 3 2,5 2,5<br />
Perturbation de la faune par les bruits 5 4 3 4 4 20,49 3 3,5<br />
Destruction des couloirs de migration et<br />
des zones de fréquentation des espèces<br />
de faune<br />
Destruction des sources alimentaires de<br />
certaines espèces de faune<br />
Augmentation du braconnage dû aux<br />
pistes et au personnel du chantier<br />
Augmentation de la pression sur les<br />
ressources halieutiques<br />
Perturbation des ressources halieutiques<br />
par le bac<br />
Risques d’intoxication de la faune par<br />
une mauvaise gestion des déchets<br />
Destruction de la flore par les<br />
défrichements<br />
Destruction des jeunes arbres lors de<br />
l’abattage de gros arbres<br />
Destruction des espèces rares lors de<br />
l’abattage<br />
Perturbation de l’écosystème par<br />
l’extraction des essences exploitées<br />
3 3 3 3 3 3<br />
3 3 3 3 2,75 18,1 3 2,84<br />
4 4 5 4 4,25 75,17 5 4,62<br />
2 2 3 1 2 20,49 3 2,5<br />
1 1 3 1 1,5 - 1 1,25<br />
2 3 3 1 2,25 - 1 1,62<br />
3 3 5 4 3,75 78,26 5 4,37<br />
3 3 2 2 2,5 30,24 4 3,25<br />
3 3 2 2 2,5 30,24 4 3,25<br />
2 3 4 3 3 - - 3<br />
Evaluation<br />
globale<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 93
Domaine<br />
ENVIRONNEMENT (Suite)<br />
Elément<br />
environnementau<br />
x<br />
Risques naturels et<br />
anthropiques<br />
Air et qualité<br />
acoustique<br />
Crise et conflits<br />
Pourcentage<br />
<strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Ampleur ou<br />
Evaluation d’individus Evaluation Evaluation<br />
Etendue Durée Réversibilité<br />
intensité<br />
absolue ayant confirmé relative globale<br />
le problème<br />
Création des risques d’érosion 4 3 4 3 3,5 - - 3,5<br />
Création des risques d’incendie<br />
dans les installations de chantier<br />
2 2 2 1 1,75 - - 1,75<br />
Création des risques d’accidents de<br />
chantier<br />
Création des risques d’agression<br />
par les animaux<br />
Pollution de l’air par la gaz<br />
d’échappement<br />
Création de bruit par les engins, les<br />
véhicules et scies à moteur<br />
Pollution de l’aire par les<br />
poussières en saison sèche<br />
Tensions sociales liées aux besoins<br />
d’emplois<br />
Tensions sociales liées à la<br />
cohabitation (problèmes de<br />
femmes et autres<br />
Conflits éventuels liés aux<br />
expropriations<br />
Conflits liés à la méconnaissance<br />
du cahier de charge<br />
3 3 3 1 2,5 - - 2,5<br />
3 3 2 1 2,25 - - 2,25<br />
2 2 2 1 1,75 4,64 1 1,37<br />
3 3 4 1 2,75 26,01 4 3,37<br />
3 3 3 1 2,5 - 4 3,25<br />
3 2 2 2 2,25 - - -<br />
2 2 3 4 2,75 40,99 5 3,84<br />
3 2 4 3 3 18 3 3<br />
2 2 3 2 2,25 8,1 2 2,12<br />
Conflits liés à l’absence de<br />
mécanisme de dialogue avec<br />
l’entreprise<br />
2 2 3 1 2 - 2 2<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 94
Domaine<br />
ENVIRONNEM<br />
ENT<br />
DOMAINE ESTHETIQUE ET<br />
CULTUREL<br />
SERVICES<br />
PUBLICS<br />
ESSENTIELS<br />
Elément<br />
environnement<br />
aux<br />
Autres éléments<br />
environnementtaux<br />
Comportements<br />
Valeurs<br />
croyance<br />
Circulation<br />
transport<br />
Infrastructures<br />
Electrification<br />
Distribution<br />
d’eau potable<br />
et<br />
et<br />
Pourcentage<br />
<strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Ampleur ou<br />
Evaluation d’individus ayant Evaluation Evaluation<br />
Etendue Durée Réversibilité<br />
intensité<br />
absolue confirmé le relative globale<br />
problème<br />
Perturbation du régime hydrique 3 3 3 4 3,25 - - 3,25<br />
Colonisation par les espèces de forêts<br />
3<br />
secondaires<br />
3 5 4 3,75 - - 3,75<br />
Menace d’expansion des activités<br />
agricoles<br />
Développement de la délinquance, la<br />
perturbation des comportements et<br />
valeurs ancestrales<br />
Violation des interdits locaux par les<br />
allochtones<br />
2 2 5 3 3 - - 3<br />
2 2 3 3 2,25 18,63 3 2,62<br />
4 2 3 3 3 77,62 5 4<br />
Violation des sites sacrés 2 2 3 3 2,5 25 3 2,75<br />
Destruction des arbres sacrés et fétiches 3 2 3 3 2,75 8 2 2,37<br />
Modification de paysage 3 3 4 4 3,5 5,4 2 2,62<br />
Augmentation des risques d’accidents de<br />
circulation<br />
Insuffisance de maintenance après le<br />
projet<br />
4 3 3 3 3,25 - 3 3,12<br />
4 3 5 3 3,75 - 2 2,84<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 95
Domaine<br />
AUTRES ASPECTS SOCIAUX<br />
Elément<br />
environnement <strong>Impact</strong>s négatifs<br />
aux<br />
Création des tensions liées à l’entrée<br />
dans l’UFA par le Nord<br />
Propriété<br />
foncière<br />
Sexualité<br />
Revendications sur les<br />
communautés bénéficiaires des<br />
redevances<br />
Revendication démesurées des<br />
communautés<br />
Ampleur<br />
intensité<br />
ou<br />
Etendue Durée Réversibilité<br />
Evaluation<br />
absolue<br />
Pourcentage<br />
d’individus ayant<br />
confirmé le problème<br />
Evaluation<br />
relative<br />
4 3 2 2 2,75 - 3 2,82<br />
2 2 1 3 2 - 3 2,5<br />
3 4 4 3 3,5 40,20 5 4,25<br />
Prolifération des MST-SIDA 4 3 5 4 3,5 91,30 5 4,25<br />
Déstabilisation des ménages locaux 2 2 3 3 2,5 40,99 5 3,75<br />
Vie sociale Développement du vol, banditisme 2 2 3 3 2,5 18,66 3 2,75<br />
Evaluation<br />
globale<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 96
14 LES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS NEGATIFS<br />
Les mesures d’atténuation peuvent être de plusieurs ordres :<br />
- les mesures d’ordre réglementaire institutionnel,<br />
- les mesures d’ordre technique,<br />
- les mesures relatives aux relations avec les communautés<br />
14.1 Les mesures réglementaires et institutionnelles<br />
Pour une meilleure exploitation de l'UFA 10015, l’entreprise doit veiller à respecter la<br />
législation forestière en vigueur (Loi N° 94-01 du 20 janvier 1994 et Loi N° 96 -12 du 5 août<br />
1996) et en particulier les « Normes d’interventions en milieu forestier » (MINEF, 1998)<br />
dont les principes directeurs s'articulent autour de dix points, à savoir :<br />
• Relation avec les populations ;<br />
• Activités d'aménagement <strong>Forest</strong>ier en fonction des sites à protéger ;<br />
• Protection des rives des plans d'eau ;<br />
- respect de la largeur de lisière de 30 m en bordure des plans d’eau,<br />
- coupe de bois et abattage interdit dans les lisières,<br />
- évacuation des arbres tombés sur le plan d’eau.<br />
• Protection de la qualité de l'eau ;<br />
- aménager un pontage sur la traversée de cours d’eau,<br />
- ne pas laver ou vidanger une machine sur un plan d’eau ou à 60 m de celui-ci,<br />
- les parcs, camps doivent être aménagés à 60 m au moins de plans d’eau et toute<br />
manipulation de carburant ou lubrifiant doit être interdite en dehors de ces sites.<br />
• Protection de la faune ;<br />
- le transport de tout engin de chasse ou de pêche doit être interdit à bord des<br />
véhicules de l’entreprise,<br />
- le transport de tout produit de chasse doit être interdit à bord des véhicules de<br />
l’entreprise,<br />
- le transport de toute personne étrangère à l’entreprise, à bord des véhicules et<br />
engins doit être interdit ;<br />
- la consommation de gibier doit être interdite aux employés du projet, l’entreprise<br />
devra en conséquence assurer un service de ravitaillement lors des campements<br />
en forêt ;<br />
- les routes et pistes non désirées par les autorités locales doivent être barrées à la<br />
fin de l’exploitation d’une assiette de coupe.<br />
• Tracé, construction et amélioration des routes forestières ;<br />
• Campements et installations industrielles en forêts ;<br />
- l’aire de campement doit être située à une distance supérieure ou égale à 1000 m<br />
d’un site sensible, et à de 60 m d’un plan d’eau,<br />
- la terre végétale décapée doit être entassée loin d’un plan d’eau en vue de sa<br />
réutilisation,<br />
- respecter les règles élémentaires de gestion des déchets solides et des eaux usées.<br />
• Implantations des parcs a grumes ;<br />
• L'exploitation forestière ;<br />
• Débardage.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 97
14.2 Les mesures relatives aux relations avec les communautés<br />
La première mesure consiste lors de l’élaboration du plan d’aménagement à localiser et<br />
cartographier de manière participative avec les communautés les sites et effets à protéger<br />
soit :<br />
- les essences (fruitières ou médicinales) exploités par les populations,<br />
- les sites et arbres sacrés.<br />
L’entreprise doit avoir un mécanisme de concertation et de dialogue avec les communautés<br />
pour :<br />
- la communication par rapport aux questions de sécurité,<br />
- les diverses prestations de service et les dons éventuels (déchets de bois,…),<br />
- le règlement des différends,<br />
- l’appui éventuel de l’entreprise dans les projets d’intérêt communautaire<br />
développés à l’aide des redevances perçues,<br />
- les accords doivent être conclus avec les communautés préalablement à toute<br />
action qui touche leurs intérêts (emploi, expropriation, location, sécurité, ...),<br />
- l’entreprise pourrait avantageusement appuyer un programme de<br />
sensibilisation des communautés sur les MST/SIDA.<br />
14.3 Les mesures d’ordre technique<br />
• L’entreprise doit disposer en son sein<br />
- d’un plan de protection de l’Environnement dans ses installations (gestion des<br />
déchets solides, gestion des eaux usées, gestion des carburants et produits<br />
polluants, un plan d’alimentation en eau des installations, etc.) et de limitation<br />
de la pollution,<br />
- d’un plan de sécurité pour le personnel, la sécurité au travail, la sécurité des<br />
riverains, la santé des employés etc.,<br />
- d’un plan de remise en état des sites après exploitation (zones d’emprunt, zone<br />
de déblais, talus).<br />
• Toute action de terrassement ou de déblai doit prévoir la remise en état du site<br />
après exploitation. Ceci débute par le stockage de la terre végétale en un point où<br />
elle est facilement récupérable.<br />
• Planification du réseau routier.<br />
Le réseau routier doit être planifié et approuvé au préalable par les services compétents du<br />
MINEF. Les fortes pentes doivent être évitées pour minimiser les déblais, les plans d’eau<br />
doivent être à 60 m au moins et les zones d’emprunt suffisamment proches pour éviter les<br />
longs transports de matériau.<br />
14.3.1 Les zones d’emprunts et zones de stockage des déblais<br />
Les mesures à prendre concernent :<br />
- le remodelage du terrain pour éviter la stagnation et faciliter l’écoulement,<br />
- la remise en place de la terre végétale décapée et stockée,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 98
- le nettoyage et le tri des produits du défrichement pour permettre leur<br />
réutilisation par les populations pour les travaux en zone agro-forestière,<br />
- la revégétalisation des zones de stockage de bois et d’emprunts de matériaux.<br />
14.3.2 La végétalisation des talus<br />
Les talus de remblai seront protégés par plantation des espèces herbacées présentes dans la<br />
région, de façon générale (Paspalum spp, Pennisetum sp, Androposdon citratus). Ces travaux<br />
devront être fait avec l’apport en main d’œuvre des associations locales ou des ONG qui en<br />
ont les capacités techniques et organisationnelles.<br />
14.3.3 Mesures à prendre dans les installations de chantier (camp, parcs)<br />
Le site choisi doit être à 60 m au moins d’un plan d’eau (lac , marécage…) pour minimiser<br />
les risques de pollution et à 150 m au moins des habitations si c’est au village. Ce site doit<br />
être choisi en zone dégagée à faible défrichement.<br />
Education environnementale du personnel<br />
Un règlement mentionnant les règles de sécurité et l’interdiction de la consommation d’alcool<br />
aux heures de travail doit être élaboré et diffusé. La chasse et la consommation de gibier<br />
doivent être interdits aux employés.<br />
L’information sur la protection de la nature, de la végétation, etc…, des séances de<br />
sensibilisation sur les MST et le SIDA sont à organiser et des affiches appropriées à placer<br />
aux points de grande fréquentation.<br />
L’ensemble de ces activités peut être confié à des ONG ou des organisations techniquement<br />
aptes ou à un service spécialisé au sein de l’entreprise.<br />
Sécurité et assainissement dans les installations<br />
Les aires de bureau et logements doivent être pourvues de diverses installations :<br />
- installation sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et<br />
douches) ;<br />
- des réservoirs d’eau doivent être prévus en quantité et qualité appropriée ;<br />
- un drainage adéquat aménagé ;<br />
- daller les aires de cuisine et de réfectoire et les désinfecter régulièrement ;<br />
- aménager des bacs de collecte des déchets à vider pour décharger dans une<br />
fosse à aménager à 100 m au moins des plans d’eau. Les déchets toxiques sont<br />
à trier et à traiter à part.<br />
Entretien des équipements et matériels<br />
Les mesures ci-après doivent être prises pour l’entretien des équipements et engins :<br />
- bétonner les aires de lavage et entretien ;<br />
- prévoir un puisard de décharge des huiles et des graisses qui se situe en<br />
dépression par rapport à l’aire de lavage.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 99
Stockage des produits polluants<br />
Les mesures ci-après doivent être prises pour éviter la contamination :<br />
- bétonner les aires de stockage des hydrocarbures, les bassins de rétention et<br />
les aires de ravitaillement ;<br />
- les citernes enterrées devront l’être dans les conditions de sécurité prévues par<br />
la réglementation appropriée (matériau étanche et entouré d’un drain vers un<br />
puits de vérification des fuites) ;<br />
- les citernes hors terre doivent être placées sur une aire bétonnée étanche avec<br />
des murs d’enceinte étanches. Les produits absorbants doivent être disposés à<br />
proximité ;<br />
- les huiles usées sont à stocker dans des contenants à entreposer en lieu de<br />
sécurité avant de les destiner au recyclage.<br />
Les voies d’accès<br />
Les exutoires des pistes et routes doivent être régulièrement entretenus et les bas-cotés<br />
cantonnés pour que la bande de roulement reste sèche et stable.<br />
14.4 Les mesures d’atténuation des impacts négatifs liés à la biodiversité.<br />
14.4.1 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus à l’installation des infrastructures<br />
(campements mobiles et ateliers)<br />
- Choix du site sur un terrain plat pour éviter l’érosion des sols ;<br />
- Latéritage des zones mises à nu et qui doivent le rester pour éviter une trop forte<br />
érosion ; revégétalisation des autres zones.<br />
- Récupération des déchets et des huiles usagées du garage avec les fournisseurs de<br />
produits pétroliers ;<br />
- Assainissement du campement : création de points d’eau, récupération des eaux usées,<br />
création de latrines, etc..,<br />
- Définition et mise en œuvre de projets d’intensification de l’agriculture et des petits<br />
élevages sur des parcelles délimitées afin d’assurer un approvisionnement régulier en<br />
légumes, fruits et viandes frais ; (en dehors de l’UFA) ;<br />
- Interdiction de la chasse sur la concession, à inclure dans le règlement intérieur avec<br />
sanctions appropriées ;<br />
14.4.2 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus aux travaux d’inventaires.<br />
- Limitation du nombre de personnes dans les équipes d’inventaire au minimum, tout en<br />
garantissant la sécurité du personnel ;<br />
- Interdiction de chasse ou de piégeage aux équipes d’inventaire. Elaboration d’une<br />
logistique permettant d’assurer un approvisionnement régulier en nourriture de ces<br />
équipes.<br />
- Ouverture des layons sur une largeur minimale, surtout lorsque ces layons ne sont pas<br />
appelés à être réutilisés (layons de l’inventaire d’aménagement qui peuvent être de<br />
simples traces) ;<br />
- Eviter le marquage des arbres à la machette lorsque les arbres ne sont pas destinés à<br />
être exploités rapidement ; concevoir et mettre en œuvre un marquage non destructeur.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 100
14.4.3 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus à la réhabilitation et à l’ouverture des<br />
pistes<br />
14.4.3.1 Planification du réseau routier<br />
La planification de la desserte forestière est une étape importante dans l’élaboration d’un<br />
aménagement forestier. Une planification entraîne toujours une réduction de la densité du<br />
réseau par rapport à une construction au coup par coup. La planification réduit les coûts de<br />
construction et d’entretien et assure une meilleure localisation des routes. Les spécifications à<br />
inclure dans le plan d’aménagement forestier de l’UFA 10015 sont :<br />
- Définir une densité maximale routière à ne pas dépasser compte tenu de la ressource ;<br />
- Implanter les routes de manière à minimiser les mouvements de matériaux et à<br />
faciliter le drainage, autant que possible en crête ;<br />
- Dessiner les tracés routiers pour avoir des pentes minimales et suivre les contours du<br />
terrain autant que possible ;<br />
- Identifier et protéger des zones tampons autour des cours d’eau. Si une route doit<br />
suivre une vallée, elle doit être localisée en dehors de la zone tampon ;<br />
- Eviter les zones marécageuses et les zones à haut risque d’érosion ;<br />
- Eviter les zones riches en biodiversité reconnues lors des inventaires.<br />
14.4.3.2 Spécifications techniques<br />
Les spécifications techniques doivent minimiser les impacts négatifs et augmenter la sécurité.<br />
Tous les travailleurs concernés par la construction des routes devraient être familiarisés avec<br />
les standards de construction routière.<br />
Les spécifications techniques à inclure dans le plan d’aménagement forestier devraient<br />
intégrer les recommandations suivantes :<br />
- Définition de largeurs maximales pour les différentes catégories de routes ;<br />
- Définition d’une largeur maximale de déforestage et d’ensoleillement. Là où de<br />
grandes largeurs d’ensoleillement sont nécessaires, prévoir des ponts de canopée, à<br />
installer de préférence sur les sols les mieux drainés ;<br />
- Ne pas dépasser des pentes en long supérieures à 8% dans le sens des grumiers en<br />
charge et de 12% à vide ;<br />
- Types de passages busés à utiliser, dimensions et fréquence ;<br />
- Distance minimale de visibilité pour assurer la sécurité du trafic.<br />
14.4.3.3 Construction des routes<br />
Pendant la construction, de grandes quantités de terre sont remuées avec des engins lourds. La<br />
construction de ponts peut contraindre à travailler dans le lit de la rivière. L’érosion du sol et<br />
les dommages aux cours d’eau peuvent être importants. Pour minimiser les impacts négatifs<br />
durant la construction, les travaux doivent être menés par une équipe entraînée et sous<br />
contrôle permanent. Le plan d’aménagement devra formuler des recommandations concernant<br />
la construction des routes parmi lesquelles :<br />
- la construction doit se faire en saison sèche autant que possible pour éviter une érosion<br />
excessive. Le compactage doit être terminé avant le début des pluies et une période<br />
minimale devra être respectée avant le début d’utilisation de la route ;<br />
- Interdiction ou minimisation de l’emploi d’engins lourds dans les cours d’eau lors de<br />
la construction des ponts ;<br />
- Construction de ponts et de passages busés autant que nécessaire pour éviter les<br />
modifications permanentes d’écoulement des eaux.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 101
14.4.3.4 Utilisation et entretien<br />
Un guide d’utilisation et d’entretien du réseau routier devra être rédigé. A l’intérieur devront<br />
figurer :<br />
- la définition des droits d’accès au réseau routier ;<br />
- les mesures prises pour la sécurité des employés : Limitations de vitesse et panneaux<br />
indicateurs ;<br />
- les mesures prises pour indiquer l’utilisation de la route en cours par les grumiers, si<br />
l’accès de la route est public ;<br />
- les restrictions d’utilisation en période de pluies (barrières de pluies) ;<br />
- un protocole de surveillance et de maintenance du réseau routier, particulièrement des<br />
structures de drainage ;<br />
14.4.3.5 Fermeture des routes<br />
Les routes sont en général utilisées pendant une période déterminée et ensuite abandonnées<br />
jusqu’à la prochaine rotation. Pendant cet intervalle, l’accès devrait être contrôlé si<br />
l’ouverture de la route est nécessaire au désenclavement de villages. Si au contraire la<br />
fermeture est prévue, ce qui est généralement souhaitable, il conviendra :<br />
- D’enlever les ponts et passages busés de manière à empêcher l’utilisation de la route ;<br />
- De nettoyer les cours d’eau pour assurer un libre écoulement ;<br />
- D’installer des « water bars » pour empêcher l’eau de circuler sur la surface en créant<br />
des ornières.<br />
14.4.4 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus aux activités d’abattage et de<br />
débardage.<br />
La qualité de la planification et de l’exécution des travaux d’exploitation forestière est<br />
primordiale pour maintenir un bon état de l’écosystème forestier après la récolte. Des<br />
procédures devront être rédigées et mises en place pour garantir que les activités d’abattage et<br />
de débardage se font dans les meilleures conditions. Ces procédures devront couvrir les<br />
domaines suivants :<br />
- planification de la récolte ;<br />
- marquage des arbres ;<br />
- abattage, débusquage, débardage et transport ;<br />
- opérations post-exploitation.<br />
14.4.4.1 Planification de la récolte<br />
La planification de la récolte réduit les coûts d’exploitation et les dommages au peuplement<br />
restant.<br />
Le plan d’aménagement qui sera rédigé, ainsi que les plans de gestion localiseront les zones à<br />
exploiter et proposeront un calendrier de passage en coupe.<br />
Les inventaires d’exploitation, obligatoires de part la loi, permettront de localiser sur carte les<br />
arbres exploitables des essences commerciales.<br />
Au cours de l’inventaire d’exploitation, on identifiera et on reportera sur carte les zones<br />
devant être évitées par l’exploitation (zones tampons, fortes pentes, sols fragiles, forêts<br />
marécageuses, sites d’intérêt écologique, sites culturels).<br />
On planifiera les pistes de débardage avec les cartes de pistage préalablement à l’abattage.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 102
14.4.4.2 Marquage des arbres<br />
Les procédures qui seront rédigées devront indiquer :<br />
- les critères déterminant les arbres inventoriés au cours de l’inventaire d’exploitation<br />
qui seront effectivement abattus (essences, qualités, diamètre minimaux). Il n’est peutêtre<br />
pas nécessaire par exemple d’abattre certaines essences représentées par très peu<br />
d’arbres dans une assiette de coupe qui ne pourront pas être valorisés économiquement<br />
du fait d’un volume trop faible ;<br />
- les critères déterminant le marquage des arbres à conserver (semenciers, arbres<br />
patrimoniaux) ;<br />
- les critères déterminant la signalisation des arbres d’avenir qui risqueraient d’être<br />
endommagés au cours des travaux et que les équipes devront respecter ;<br />
- la définition des responsabilités pour le marquage des arbres ;<br />
- la formation des prospecteurs nécessaire.<br />
14.4.4.3 Abattage et extraction<br />
Les procédures à rédiger devront inclure :<br />
- Les techniques d’abattage à utiliser : constitution d’une équipe, mesures de sécurité,<br />
méthodes d’abattage directionnel, procédures de soins d’urgence ;<br />
- L’ouverture des pistes de débardage avant l’abattage ;<br />
- Les méthodes de débusquage, en particulier l’utilisation des treuils, qui réduit les<br />
dégâts au peuplement restant ;<br />
- Les techniques d’utilisation des débardeurs, et de manutention des billes sur les parcs<br />
à bois ;<br />
- Les techniques mises en œuvre pour garantir la traçabilité des bois (étiquetage des<br />
billes) permettant de s’assurer qu’aucun arbre n’est oublié en forêt ;<br />
- Les parcours de formation à mettre en œuvre.<br />
14.4.4.4 Opérations post-exploitation<br />
Après exploitation, il est nécessaire :<br />
- de s’assurer par un inventaire que l’exploitation a été faite conformément aux<br />
procédures ;<br />
- de réhabiliter les sites : décompactage des parcs à bois, construction de « waters bars »<br />
le long des pistes de débardage en pente pour éviter l’érosion ;<br />
- d’empêcher l’accès aux zones exploitées par coupure des routes d’accès ou destruction<br />
des ponts.<br />
14.4.4.5 Mesures d’atténuation des impacts négatifs dus à l’utilisation des produits<br />
de préservation des bois.<br />
Des procédures devront être rédigées et mises en application dès le démarrage des opérations<br />
d’exploitation forestière dans l’UFA 10015 afin de réduire les effets négatifs de l’utilisation<br />
des produits de préservation. Ces procédures devront inclure les recommandations suivantes :<br />
- une réflexion sur la nécessité de traitement des grumes ; certaines essences, certaines<br />
périodes de l’année ne nécessitent pas de traitement systématique. Des pratiques<br />
d’exploitation et une bonne organisation des chantiers peuvent réduire le temps de<br />
séjour des grumes en forêt et limiter l’utilisation des produits.<br />
- Une liste de produits à utiliser en fonction des objectifs recherchés. On devra s’assurer<br />
que les produits interdits par les conventions internationales ou par la législation, ainsi<br />
que ceux contenant des organochlorés, ne sont pas utilisés.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 103
- La définition des endroits où le traitement peut se faire : éviter les zones à proximité<br />
des cours d’eau ou des habitations.<br />
- Les conditions d’application des produits : matériel utilisé, dosage, conditions<br />
météorologiques, vêtements de protection.<br />
- La nomination d’une personne de l’équipe d’encadrement responsable de l’utilisation<br />
de ces produits et la restriction de l’accès à ces produits au personnel autorisé ;<br />
- La conduite à tenir en cas d’accident ou de déversement accidentel des produits dans<br />
l’environnement ;<br />
- Les conditions de stockage sécurisé des produits ;<br />
- Les conditions de destruction ou de retour au fabricant des produits non utilisés ou<br />
périmés ;<br />
- Les parcours de formation nécessaires pour les personnes manipulant ces produits.<br />
14.5 Mesures d’atténuation des impacts négatifs liés à la faune<br />
Les mesures d'atténuation visent à prendre des dispositions pour minimiser les impacts<br />
négatifs causés sur la biodiversité à la suite de la réhabilitation de la route Koumela-<br />
Embouchure Boumba-Bek, la construction du bac au niveau de l'embouchure de Boumba-<br />
Bek, les travaux d'inventaires, les ouvertures de pistes de débardage, les opérations d'abattage,<br />
la création des parcs à bois en forêt, ainsi que la construction du campement des ouvriers.<br />
L'objectif visé à travers ces mesures d'atténuation est d'assurer une gestion durable des<br />
ressources fauniques et forestières dans l'UFA 10015 et de ses zones environnantes pendant<br />
l'exploitation de ladite unité forestière d'aménagement.<br />
Ainsi dans le cadre de ce projet, deux types de mesures d'atténuations devraient être prise en<br />
compte par la CIBC et les autres acteurs concernés dans la zone avant et pendant<br />
l'exploitation de l'UFA 10015. Il s'agit des mesures d'atténuation d'ordre général relatives aux<br />
textes en vigueur et surtout à l'intervention en milieu forestier et des mesures d'atténuation liés<br />
directement à l'exploitation de I'UFA 10015 dont l'objectif est de faire des recommandations<br />
pertinentes et concrètes pour compenser les impacts négatifs causés sur les ressources<br />
fauniques et forestières.<br />
14.5.1 Mesures d’atténuations d’ordre général<br />
En plus du document normes d'intervention en milieu forestier, les responsables de la CIBC<br />
devraient également s'assurer que l'équipe qui sera chargée des opérations d'inventaire de<br />
l'UFA 10015 dispose d'une connaissance parfaite et d'une bonne maîtrise du document intitulé<br />
«Normes d'inventaire d’exploitation» (MINEF, 1995) dont l'objectif principal est de :<br />
• Faciliter le contrôle de l'exploitation par la connaissance plus précise des effectifs de<br />
coupe ;<br />
• Fournir des bases de prévision des recettes ;<br />
• Connaître le potentiel réel des bois commercialisables ;<br />
• Planifier et organiser le mouvement des bois par rapport aux divers utilisateurs ;<br />
• Planifier les activités sylvicoles ;<br />
• Ajuster le plan de gestion ;<br />
• Evaluer le potentiel à venir ;<br />
• Connaître l'emplacement des tiges à récolter.<br />
Quant à l'opérateur de la Zone d'Intérêt Cynégétique N°38, il doit respecter les clauses<br />
prescrites par son cahier de charge à savoir :<br />
• Procéder à un inventaire des ressources fauniques (par des personnes agréées dans le<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 104
domaine) de sa zone à la 1 ère et à la 4 ème année à compter de l'entrée en vigueur de<br />
son cahier de charges ;<br />
• Recruter dans le cadre de ses besoins en personnels des riverains de la zone pour<br />
l'exploitation et à la gestion de la faune (80% des effectifs du personnel doivent être<br />
recrutés dans les zones riveraines à la concession). Dans le cas présent, la priorité<br />
pourra être donnée aux Bakas qui constituent la part la plus importante de la<br />
population de Salapoumbé.<br />
• Assurer le gardiennage de la zone de chasse pendant toute l'année en collaboration<br />
avec les responsables locaux de l'administration chargée de la faune. Il a également<br />
l'obligation de former son personnel pour la protection da la faune. Son personnel de<br />
contrôle peut appréhender les braconniers en flagrant délit, à condition de les mettre<br />
avec leurs butins à la disposition du responsable le plus proche du MINEF dès leur<br />
arrestation.<br />
• Entretenir des relations saines avec les riverains.<br />
De manière spécifique, toutes ces directives ont été traduites en mesures d'atténuation<br />
concrètes afin de limiter autant que faire se peut, les impacts négatifs sur la gestion des<br />
ressources fauniques et forestières lors de l'exploitation de l'UFA 10015.<br />
14.5.2 Les mesures sécuritaires<br />
Ces mesures visent à restreindre l'accès à l'Unité <strong>Forest</strong>ière d'aménagement N°10015/ZIC38,<br />
le futur Parc National de Boumba-Bek et Nki et les ZICGC N°9 et 10. En pratique, elles<br />
consisteront à :<br />
• Installer une guérite avec barrière de contrôle de véhicules, avec cadenas à l'entrée de<br />
Koumela (au point de raccordement avec l’axe central) ;<br />
• Le poste d’opérateur du bac devra être équipé d’une radio de manière à faciliter la<br />
communication entre ce poste, le poste de contrôle de Salapoumbé et la base de<br />
Lokomo. Le passage sur le bac ne sera autorisé qu’aux personnes et véhicules<br />
autorisés par l’entreprise.<br />
• Recruter et former quatre (04) Gardes <strong>Forest</strong>iers qui seront chargés des contrôles sur<br />
la route d’accès et de la lutte anti-braconnage à l’intérieur de l’UFA. Il convient de<br />
souligner que le contrôle de l'entrée au niveau de Koumela sera assuré par un gardien<br />
de nuit de la société CIBC et le contrôle à l'intérieur de l'UFA se fera en collaboration<br />
avec les Ecogardes de la ZIC N°38. Une convention de partenariat peut être élaborée<br />
et mise en œuvre entre le responsable de la ZIC 38 et la CIBC afin de sous-traiter les<br />
opérations de lutte ani-braconnage et de gardiennage aux postes d’entrée de l’UFA.<br />
• Mettre à la disposition des gardes forestiers, deux motos pour faciliter leurs<br />
déplacements pendant les opérations «coup de poing» et les patrouilles à l'intérieur de<br />
l'UFA et les zones périphériques.<br />
• Etablir des moyens d’identification pour les employés de la CIBC pour les identifier<br />
lors du contrôle au niveau de la barrière de Koumela et à l'entrée du Bac.<br />
• Limiter l'accès sur la route Koumela-Embouchure Boumba-Bek aux seuls véhicules de<br />
la CIBC ou à ceux autorisés par la CIBC.<br />
• Enregistrer tous les véhicules entrant et sortant en indiquant l'heure d'entrée et de<br />
sortie de l'UFA.<br />
• Renforcer les capacités d'intervention des Comités de Valorisation des ressources<br />
fauniques(COVAREF)<br />
• Refermer toutes les pistes forestières secondaires après exploitation de chaque assiette<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 105
de coupe,<br />
D’autres mesures à prendre visent à mettre en place au niveau de l'UFA 10015 et ses<br />
zones environnantes une réglementation stricte et un dispositif de contrôle efficace. II<br />
s'agit de :<br />
• Interdire le transport de toute personne étrangère à la société, du gibier, des armes à<br />
feu ou de tout autre outil pouvant servir au braconnage dans les véhicules de la CIBC ;<br />
Il est clairement établi que l’intense trafic de grumes ou bois sciés contribue à<br />
l’acheminement de quantités importantes de produits de chasse par les camionsgrumier<br />
vers les agglomérations importantes.<br />
L’ouverture de nouvelles zones est souvent l’opportunité d’abattre facilement des<br />
population animales peu préparées à cette confrontation. Cette situation donne lieu à<br />
une chasse commerciale plus ou moins importante par des chasseurs allochtones mais<br />
aussi par les ouvriers. Il convient de réduire cette activité qui ne concerne en rien<br />
l’exploitation forestière pour laquelle ces personnels ont été embauchés.<br />
• Le Personnel de la CIBC doit informer les responsables de l'UTO des activités de<br />
chasse commerciale, de braconnage et de trafic illicite des produits animaux (ivoire,<br />
peaux etc.) se déroulant au sein de l'UFA, à l'exception des opérations menées par<br />
l'opérateur de safaris de la ZIC N°38 dans le cadre de ses activités normales.<br />
• Organiser des opérations de contrôle systématique au sein, à l'entrée et à la sortie de<br />
l'UFA, le long du fleuve Boumba-Bek ainsi que le long des axes routiers et pistes<br />
forestières.<br />
• Organiser chaque trimestre les opérations coup de poing en collaboration avec tous les<br />
acteurs concernés, appuyées par la force de maintien de l'ordre et les autorités<br />
administratives afin de traquer les braconniers et de détruire leurs campements.<br />
• Soutenir la mise en place d’une brigade mobile sous la tutelle de l’UTO ou soustraitée<br />
à un opérateur privé spécialisé en matière de lutte anti-braconnage.<br />
• Inspecter systématiquement tous les véhicules entrant ou sortant de l’UFA ;<br />
• Assurer un contrôle régulier dans le futur Parc National de Boumba-Bek et Nki<br />
pendant les heures d'ouverture de la barrière du BAC.<br />
• Organiser la chasse de subsistance au niveau des villages ;<br />
• La CIBC doit élaborer un règlement intérieur interdisant la chasse, le transport et le<br />
commerce de la viande de brousse. Les exploitations forestières sont souvent mises à<br />
l’index pour leur rôle dans l’ouverture des massifs forestiers mais plus encore pour la<br />
quasi mise à disposition de leurs infrastructures pour le transport des animaux abattus<br />
au plus pr<strong>of</strong>ond des zones d’exploitation. Il convient de stopper ces pratiques qui<br />
apportent peu à l’entreprise si ce n’est une très mauvaise réputation.<br />
14.5.3 Mesures de restriction de la pression sur la faune sauvage comme source de protéines<br />
L’installation du Campement des ouvriers à Koumela<br />
Afin d'éviter toute tentative de chasse illicite au sein de l’UFA et du parc national de Boumba-<br />
Bek, le campement des ouvriers devra être installer à Koumela. Ceci permettra non seulement<br />
de limiter l'intensification du braconnage à l'intérieur de l'UFA 10015 et ses zones<br />
périphériques, mais va également favoriser l'émergence du commerce à Koumela et partant la<br />
création d'un pôle de développement avec des effets positifs sur l'agriculture, la santé,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 106
l'école,..., bref l'amélioration du cadre et du niveau de vie de la population de Salapoumbé en<br />
général et de Koumela en particulier et de ses environs.<br />
Développer des sources de protéines alternatives<br />
Afin de réduire la pression sur la faune sauvage due à une demande sans cesse croissante en<br />
viande notamment au niveau de Koumela, la CIBC devra promouvoir le développement des<br />
sources de protéines alternatives. De façon concrète, il s’agit de :<br />
• Promouvoir dans la région le développement des initiatives locales de création<br />
d'élevage d'animaux domestiques (poulets, moutons, chèvres etc.) ainsi que la mise en<br />
place des micro-projets pilotes du genre pisciculture, du petit élevage notamment de<br />
volailles.<br />
• Assurer l’approvisionnement en animaux vivants ou en viandes d’élevage pour<br />
l’approvisionnement de la boucherie de Lokomo et des cuisines des camps à un prix<br />
compétitif.<br />
Elaborer et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et<br />
d'éducation des populations sur le problème de la sur-exploitation de la<br />
faune<br />
• Rédiger et diffuser chez les différents acteurs un recueil de bonnes pratiques de<br />
gestion de la faune dans les Unités <strong>Forest</strong>ières d'aménagements<br />
• Intensifier les réunions de sensibilisation sur la bonne gestion des ressources fauniques<br />
dans les villages en langue locale comme le font à l'heure actuelle les animateurs de la<br />
GTZ, ainsi que dans les chantiers auprès des ouvriers par la cellule aménagement du<br />
groupe VICWOOD THANRY.<br />
Elaborer et mettre en œuvre un protocole de collaboration entre les<br />
responsables de la CIBC, l'UTO, la Forêt Communale (FC), la ZIC N°38,<br />
la ZICGC N°9 et 10 sur la gestion durable de la faune dans l'UFA 10015 et<br />
ses zones périphériques<br />
Ce protocole de collaboration devra surtout se focaliser sur les mesures restrictives, les<br />
engagements des parties prenantes et les sanctions disciplinaires.<br />
Les différentes parties prenantes pourront également à travers ce protocole de collaboration,<br />
élaborer un projet d'aménagement intégré des ressources biologiques du complexe Aire<br />
protégée, UFA10015/ZIC38, FC (forêt communale) et ZICGC 9 et 10 et négocier d'autres<br />
sources de financements auprès des bailleurs de fonds.<br />
Ouvrir les pistes de débardage en prenant soin d’éviter les sites critiques riches en<br />
ressources fauniques tels que les salines, les baïs, les couloirs des grands mammifères.<br />
D'ores et déjà, les figures 8 et 9 indiquent certains sites à prendre en compte lors de<br />
l'ouverture de ces pistes de débardage.<br />
En effet, pour mieux planifier ce réseau de piste de débardage, le Guide de chasse de la ZIC38<br />
devra au préalable procéder à un inventaire faunique de toute sa zone. Cet inventaire<br />
permettra aussi d'identifier les sites fragiles tels que les zones de forte concentration des<br />
animaux, les baïs, les salines, les couloirs des grands mammifères qu'il faudra prendre en<br />
compte lors de l'établissement du réseau de piste de débardage et d'abattage.<br />
La CIBC doit mettre en place une logistique permettant d'assurer un<br />
approvisionnement régulier en nourriture des équipes d'inventaire, afin d'éviter le<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 107
aconnage par les ouvriers.<br />
Favoriser le recrutement de la main d'œuvre locale lors de l'exploitation de I'UFA<br />
10015 . La priorité devra être accordée à l'ethnie Baka qui présente des signes de<br />
marginalisation dans la zone.<br />
Appuyer la patrouille mixte de la Tri-Nationale du Dja-Minkébé-Odzala, étant donné<br />
que I'UFA10015 est périphérique à ce complexe Tri-national.<br />
14.6 Mesures d’atténuations pour une gestion durable des ressources forestières<br />
1) Elaborer et mettre en œuvre le plan d'aménagement de I'UFA 10015. Ce Plan<br />
d'aménagement doit intégrer la problématique de gestion de la faune dans les unités<br />
forestières d'aménagement.<br />
2) Limiter le nombre de personnes dans les équipes d'inventaire au minimum, tout en<br />
garantissant la sécurité de ces personnes.<br />
Pour le layonnage, l'équipe peut être composée de 8 à 12 personnes , suivant le rendement<br />
attendu. Pour le comptage, l'équipe doit être composée de 6 prospecteurs, un Boussolier, un<br />
pointeur, un responsable de Croquis de l'unité de comptage et d'un porteur d'eau, nourriture et<br />
trousse de premiers soins. Quant à l'équipe d'intendance, elle sera composée d'un cuisinier,<br />
d’un aide cuisinier et d'un chauffeur.<br />
3) Ouvrir des layons sur une largueur minimale (l,5 à 2m de largueur peuvent être tolérés)<br />
4) Eviter le marquage des arbres à la machette, surtout lorsque les arbres ne sont pas destinés<br />
à être exploités rapidement<br />
5) Eviter lors de l'ouverture des pistes de débardage, les zones sensibles telles que les baïs, les<br />
salines et les couloirs des éléphants identifiées par le Guide de Chasse de la ZIC38 (voir<br />
figures 3 et 4 pour les zones déjà identifiées)<br />
6) Détruire aussitôt les campements ayant servi aux fins d'inventaire<br />
7) Restaurer après les travaux, la végétation perturbée par le reboisement avec des espèces<br />
indigènes<br />
8) Récolter seulement les arbres marqués lors de l'inventaire d'exploitation, à l'exception des<br />
portes graines identifiés<br />
9) L'abattage doit être effectué par un abatteur qualifié qui applique la technique appropriée<br />
afin de minimiser les pertes. Cet abattage, lorsque cela est possible, doit être directionnel de<br />
manière à protéger les beaux sujets en régénération et à occasionner le moins de bris possible<br />
d'arbres voisins. De plus, l'arbre abattu doit être placé dans la direction de la piste de<br />
débardage en vue de minimiser les dégâts au moment du débardage.<br />
14.7 Synthèse des mesures d’atténuation à mettre en œuvre en matière de biodiversité<br />
Le Tableau 12, résume les différentes mesures proposées pour atténuer les impacts négatifs<br />
de l'exploitation de I'UFA 10015 sur la biodiversité. Ce tableau ressort également les<br />
indicateurs ainsi que les acteurs concernés pour sa mise en œuvre. Il convient de souligner<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 108
que les coût liés aux différentes actions seront arrêtés en collaboration avec les responsables<br />
de la CIBC.<br />
12) Mise en œuvre des mesures d'atténuations des impacts négatifs<br />
Mesures d'atténuations Indicateurs de réalisation Acteurs<br />
concernés<br />
pour la mise<br />
en œuvre<br />
1. restreindre l'accès à I'UFA 10015, la<br />
ZIC38, le futur Parc de Boumba-Bek et<br />
Nki et les Z1CGC9 et 10<br />
- Installer deux barrière de contrôle et<br />
construire une guérite par barrière<br />
- Equiper les guérites par un système<br />
radiophonique<br />
- Recruter et former les gardes forestiers<br />
affectés à la surveillance<br />
- Acquérir les motos pour les gardes<br />
forestiers<br />
Fabriquer les moyens d’identification<br />
pour les employés de la CIBC<br />
L'entrée de Koumela et de<br />
l'embouchure Boumba-Bek<br />
possède chacune une barrière et<br />
une guérite, avec cadenas<br />
Une radio est achetée et mise à la<br />
disposition de la guérite de<br />
l'embouchure Boumba-Bek<br />
quatre gardes forestiers sont<br />
recrutés, formés et employés par<br />
la CIBC pour la surveillance le<br />
long de la route, à l’entrée du bac<br />
td l’ f<br />
Deux motos sont achetées et<br />
mises à la disposition des gardes<br />
forestiers pour la lutte contre le<br />
braconnage<br />
Chaque employé de la CIBC est<br />
identifiable<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
Période de mise en<br />
oeuvre<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe №1<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe N°1<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe №1<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe №1<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe №1<br />
- Enregistrer les véhicules entrant et<br />
sortant<br />
Un registre d'enregistrement<br />
existe au niveau du Bac et les<br />
entrées et sorties des véhicules y<br />
sont consignées<br />
- Renforcer la capacité des COVAREF Les responsables des ZICGC 9 et<br />
10 sont formés à la gestion de<br />
ressources fauniques<br />
- Refermer toutes les pistes forestières<br />
après exploitation<br />
Rapport de lutte contre le<br />
braconnage indiquant que les<br />
pistes sont fermées<br />
CIBC (agents<br />
de<br />
surveillance)<br />
CIBC, ZIC38<br />
et UTO<br />
CÏBC<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Pendant l'exploitation<br />
del'UFA l0.015<br />
Juste après<br />
l'exploitation de chaque<br />
assiette de coupe<br />
2. Mettre en place dans l'UFA 10015 et<br />
ses zones périphériques, une<br />
réglementation stricte et un dispositif de<br />
contrôle efficace<br />
- Interdire le transport de braconnier, de<br />
la viande de brousse, des armes et câbles<br />
par les grumiers<br />
Rapport de lutte contre le<br />
braconnage indiquant que les<br />
camions de la CIBC ne<br />
transportent par les braconniers<br />
et leurs matériels de chasse<br />
CIBC UTO<br />
ZIC38<br />
Avant et pendant<br />
l'exploitation de<br />
I'UFA10015<br />
- Informer l'UTO des activités de<br />
braconnage dans le chantier<br />
Rapport de lutte contre le<br />
braconnage<br />
CIBC<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFAl0.015<br />
- Organiser les opérations de contrôle au<br />
sein de l'UFA et à travers les pistes<br />
forestières et le long du fleuve<br />
Au moins un contrôle est<br />
effectué chaque semaine<br />
UTO et<br />
ZIC38<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 109
- Organiser les opérations coup de poing Tous les trois mois, une<br />
opération coup de poing est<br />
organisée et le rapport disponible<br />
à l'UTO<br />
- Mettre en place une brigade mobile Une brigade de contrôle est mise<br />
en place et fonctionnelle<br />
- Assurer le contrôle régulier du futur<br />
Parc national de Boumba-Bek et Nki<br />
Rapport de contrôle dans le parc<br />
est disponible à l'UTO<br />
- Organiser la chasse de subsistance Un arrêté organisant la chasse<br />
traditionnelle est disponible<br />
- Elaborer un règlement intérieur à<br />
l'attention des ouvriers<br />
3. Promouvoir l’utilisation des sources<br />
alternatives de protéines<br />
- Encourager des initiatives nouvelles et<br />
des micro-projets pilotes<br />
4. Elaborer et mettre en œuvre des<br />
programmes de sensibilisation et<br />
d'éducation<br />
Un règlement intérieur est<br />
élaboré et appliqué par la CIBC<br />
Un micro-projet pilote de<br />
pisciculture existe à Lokomo et<br />
Koumela. Des élevages de<br />
moutons, chèvres, poulets<br />
existent dans la localité de<br />
Koumela et lokomo<br />
CIBC<br />
UTO<br />
ZIC38<br />
ZICGC9 et<br />
10<br />
UTO<br />
UTO<br />
UTO<br />
CIBC<br />
CIBC et<br />
Populations<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Avant, pendant et après<br />
l'exploitation de l'UFA<br />
10015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
- Rédiger et diffuser des recueils à<br />
diffuser<br />
Des recueils sont élaborés et<br />
diffusés par l’UTO<br />
CIBC/UTO<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Organiser des réunions de sensibilisation Rapport de réunion<br />
5. Construire le campement des ouvriers<br />
à KOUMELA<br />
Campement construit à Koumela<br />
et fonctionnel<br />
CIBC<br />
UTO<br />
ZIC38<br />
CIBC<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Avant exploitation de<br />
l'assiette de coupe №1<br />
6. Elaborer et mettre en œuvre un<br />
protocole de collaboration<br />
7. Approvisionner en nourriture les<br />
équipes d'inventaire<br />
8. Favoriser le recrutement de la main<br />
d'œuvre locale<br />
Protocole de collaboration<br />
élaboré et fonctionnel<br />
Les équipes d'inventaire sont<br />
régulièrement ravitaillées et<br />
s'abstiennent de braconnage<br />
Au moins dix Baka sont recrutés<br />
selon les besoins pour des taches<br />
bien précises<br />
UTO<br />
CIBC<br />
ZIC 38<br />
Commune<br />
CIBC<br />
CIBC/UTO<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
Pendant l'inventaire de<br />
l'UFA N°10015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de l'UFA l0.015<br />
9. Appuyer la patrouille Tri-Nationale Rapport de patrouille indiquant<br />
la participation de la CIBC<br />
10. Elaborer et mettre en œuvre le plan<br />
déménagement de I'UFA10015<br />
11. Limiter au minimum le nombre de<br />
personne dans l'équipe d'inventaire<br />
Plan d'aménagement élaboré et<br />
mis en œuvre, en prenant en<br />
compte l'aspect faune<br />
Normes d'inventaire respectées<br />
pendant l'inventaire<br />
Trinationale<br />
Et CIBC<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
Avant l'expiration de la<br />
convention provisoire<br />
Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 110
12. Ouvrir les layons sur une largueur<br />
minimale<br />
Norme d'inventaire respectées<br />
pendant l'ouverture des layons<br />
CIBC<br />
Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
13. Eviter le marquage des arbres à la<br />
machette<br />
14. Eviter lors des ouvertures des pistes<br />
de débardages les salines, les baïs et les<br />
couloirs des éléphants<br />
15. Détruire les campements ayant servi<br />
aux inventaires<br />
18. Restaurer après les travaux<br />
d'exploitation, la végétation perturbée<br />
Normes d'inventaire respectées<br />
pendant l'inventaire<br />
Rapport d'équipe d'ouverture des<br />
piste de débardage<br />
CIBC<br />
CIBC<br />
ZIC38/UTO<br />
Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
Rapport de lutte contre le<br />
braconnage<br />
CIBC Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
Rapport de contrôle de l'UTO CIBC Après l'exploitation de<br />
I'UFA 10015<br />
19. Planifier les pistes de débardage et<br />
d'abattage<br />
Cartes de piste de débardage<br />
disponible<br />
CIBC<br />
Avant l'exploitation de<br />
I'UFA 10015<br />
20. Récolter seulement les arbres<br />
marqués<br />
21. Appliquer la technique d'abattage à<br />
faible impact<br />
Rapport de contrôle de l'UTO CIBC Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
Rapport de contrôle de l'UTO CIBC Pendant l'exploitation<br />
de I'UFA 10015<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 111
15 PLAN DE SUIVI ET DE CONTROLE/PLANIFICATION<br />
Ce chapitre présente la procédure de vérification de la mise en œuvre des mesures<br />
d’atténuation proposées dans la présente étude.<br />
Dans le souci de concrétiser les contributions des parties prenantes et d'assurer une meilleure<br />
mise en œuvre des différentes mesures d'atténuation, une plate forme de concertation et de<br />
suivi sera mise en place et dénommée « Comité 10015 ». A l'intérieur de cette plate forme, les<br />
parties prenantes doivent s'engager de manière formelle pour la préservation de la biodiversité<br />
en cherchant à tirer le juste revenu de leur zone d'exploitation, sans toutefois mettre en périr<br />
les ressources biologiques disponibles et la pérennité des retombées financières et fiscales afin<br />
de ne pas compromettre l'avenir de la génération future et d'assurer une gestion durable à long<br />
terme de ces ressources.<br />
Cette plate forme, dont le principal rôle sera de suivre la réalisation des actions proposées et<br />
de régler les conflits pouvant subvenir entre les acteurs concernés, regroupera tous les acteurs<br />
institutionnels autour de I'UFA 10015. Il s'agit de:<br />
• L'Unité Technique Opérationnelle du Sud-Est (MINEF, WWF, GTZ)<br />
• Les Comités de Valorisation des Ressources Fauniques (COVAREF) des ZIC GC 9 et<br />
SIC GC 10<br />
• La Commune de Moloundou (FC), pour la forêt communale<br />
• La Zone d'Intérêt Cynégétique N°38 (ZIC38)<br />
• La Compagnie Industrielle des Bois du Cameroun (CIBC)<br />
• Le sous-préfet de Moloundou, coordonnateur de tous les services étatiques de la zone.<br />
Pour une meilleure coordination, la plate forme pourra se réunir tous les six mois sur<br />
convocation de l'Unité Technique Opérationnelle. Toutefois, des séances extraordinaires de<br />
travail peuvent être convoquées sur proposition de l'UTO ou de la CIBC.<br />
Des accords de collaboration entre les acteurs institutionnels pour mieux gérer les ressources<br />
biologiques et les modalités de fonctionnement de la plate forme doivent être élaborés.<br />
Les fonctions de membre de la plate forme sont gratuites ; toutefois les frais de<br />
fonctionnement des réunions seront pris en charge par la CIBC.<br />
Les autres détails relatifs au bon fonctionnement de la plate forme seront définis par les<br />
différents acteurs lors de leurs assises.<br />
Un coordonnateur CIBC basé à Lokomo et chargé des actions environnementales et des<br />
relations avec les populations et les partenaires.<br />
Pour assurer la mise en œuvre du programme d’atténuation des impacts de l’exploitation de<br />
l’UFA 10015 (et des UFA 10.011 et 10.007 également), la CIBC (en coûts partagés avec la<br />
SAB et la SEBC) devra recruter un cadre (cf. pr<strong>of</strong>il de poste en annexe) qui sera chargé de<br />
l’interface entre le groupe industriel et les partenaires locaux institutionnels et les populations.<br />
Il sera plus particulièrement chargé d’assurer la mise en œuvre des mesures d’atténuation des<br />
impacts et des mesures d’accompagnement. En outre, il assurera l’animation du comité UFA<br />
10015, instance de concertation destinée à régler régulièrement les problèmes venant à se<br />
poser et liés à l’exploitation.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 112
16 REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES<br />
1. A procedure for evaluating environmental impact - LEOPOLD D,L., CLARKE, F.E,<br />
HANSHAW B.B et J.R.BALSLEY, 1971.<br />
2. Check list <strong>of</strong> impact categories for land development projects – SCHAENAM, 1976.<br />
3. Collart N.J. et Stuart S.N., 1985. Threatened birds <strong>of</strong> africa and related islands.<br />
4. Convention de collaboration pour le gestion de la faune sauvage (Convention de<br />
Mambélé) - Délég. départementale MINEF, YOKADOUMA, Guides de chasses de<br />
l’Arrondissement de Moloundou et populations de la zone de Lobéké, 1999.<br />
5. Davenport T., 1998. The Butterflies <strong>of</strong> Lobeke reserve. Report WWF-CPO.<br />
6. Directives clauses types à incluse dans les marchés des travaux d’entretien routiers<br />
pour atténuer les impacts sur l’environnement - MINIP, 1997 .<br />
7. Ekobo A., 1995. Conservation <strong>of</strong> the Africain forest elephant in the Lobeke, southeast<br />
Cameroon. PH.D Thesis, University <strong>of</strong> Kent, 151pp.<br />
8. J.M. Noiraud et J. Tentchou, 2001. Etude de d’impact sur l’Environnement de la<br />
mise exploitation de l’UFA n°10037.<br />
9. JR François, 2001. Etude environnementale stratégique pour la planification et<br />
l’aménagement de l’exploitation forestière dans l’UTO Sud Est. Composante portant<br />
sur les activités de chasse sportive. Rapport de mission.<br />
10. Letouzey R, 1985. Notice de la carte phytogéographique du Cameroun au 1:500.000.<br />
Institut de la cartographie internationale de la végétation, Toulouse, France.<br />
11. Méthode d’évaluation environnementale lignes et postes - HYDRO-QUEBEC, 1992<br />
12. Normes d’intervention en milieu forestier – MINEF, 1998.<br />
13. NZOOH DONGMO et al., 2002. Evaluation des Potentialités fauniques des Zones<br />
d’Intérêt Cynégétique à Gestion Communautaire N° 1,2,3, 8 et 9 au Sud-Est<br />
Cameroun.<br />
14. Philippe Hecketsweiller, 1999. Etude environnementale stratégique UTO.<br />
15. Plan stratégique de surveillance de l’exploitation des ressources fauniques dans le<br />
département de la Boumba & Ngoko. Délégation MINEF YOKADOUMA et Projet<br />
WWF – Jengi, , 2001.<br />
16. Procédure de contrôle des opérations forestières – TECSULT, 1998<br />
17. Propositions de clauses types à intégrer dans les marchés de travaux routiers- UNION<br />
EUROPEENE, 1998<br />
18. Strmomayer K.A.K and Ekobo A.,1991. Biological survey <strong>of</strong> Southeas Hern<br />
Cameroon.<br />
19. Technique de communication avec le public.- BISHOP, 1973<br />
20. Tutin and Fernandez, 1984. Nation wide census <strong>of</strong> gorilla and chimpanzee<br />
21. Vivien, 1991. Faune du Cameroun. Guide des mammifères et des poissons Ed;<br />
GICAM/ncd.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 113
17 ANNEXES<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 114
17.1 DECRET FIXANT LES MODALITES DE REALISATION DES ETUDES<br />
D’IMPACTS SUR L'ENVIRONNEMENT (EIE)<br />
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,<br />
Vu la Constitution ;<br />
Vu la Loi n° 96/12 du 05 Août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de<br />
l'environnement,<br />
Vu le Décret n° 94/259 du 31 Mai 1994 portant création 'de la Commission Nationale<br />
Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable ;<br />
Vu le Décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement ;<br />
Vu le Décret n° 98/345 du 21 Décembre 1998 portant organisation du Ministère<br />
Environnement et Forêts ,<br />
DECRETE<br />
DES DISPOSITIONS GENERALES<br />
Article 1er : Le présent Décret pris en application de l'article 17 de la loi n° 96/12 du 05 Août<br />
1996 portant loi-cadre relatif à la gestion de l'environnement, fixe les modalités de réalisation<br />
des études d'impacts sur l'environnement, dénomée ci-après « étude d'impacts».<br />
Article 2 : Pour l'application du présent Décret, les définitions suivantes sont admises<br />
• Environnement : l'ensemble des éléments naturels et artificiels et des équilibres bio<br />
géochimiques auxquels ils participent, ainsi que l'ensemble des facteurs économiques, sociaux<br />
et culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu, des<br />
organismes vivants et des activités humaines ,<br />
• Administration compétente, l'Administration chargée de l'environnement,<br />
• Autorité compétente : l'Autorité habilitée à délivrer le certificat de conformité<br />
environnementale, soit le Ministre charge de l'Environnement,<br />
• Etude d'<strong>Impact</strong>s : Document présentant les résultats d'une étude réalisée selon les<br />
prescriptions d'un cahier de charges approuvé par l'administration compétente , permettant<br />
d'évaluer les incidences directes et indirectes d'un projet sur l'équilibre écologique de la zone<br />
d'implantation, ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des populations et les<br />
incidences sur l'environnement en général,<br />
• Projet : Toute activité de mise en valeur, d'utilisation ou d'aménagement du territoire, toute<br />
installation ou tout ouvrage, industriel, agricole ou commercial et susceptible d'avoir unie<br />
incidence sui l’environnement ;<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 115
• Audit environnemental : Outil de gestion comportant une évaluation systématique,<br />
documentée, périodique et objective du fonctionnement d'une entreprise, de son système de<br />
management et des procédés destinés à assurer la protection de l'environnement et qui vise à<br />
* Faciliter le contrôle opérationnel des pratiques susceptibles d'avoir une incidence sur<br />
l'environnement,<br />
* Evaluer la conformité avec les politiques environnementales de l'entreprise<br />
• Promoteur : Toute personne physique ou morale auteur d'une demande d'autorisation<br />
concernant un projet privé ou l’autorité publique initiatrice d'un projet _ __<br />
• Unité : Toute installation ou tout ouvrage industriel, agricole ou commercial dont l'activité<br />
peut être génératrice de pollution ou porter atteinte à l'environnement<br />
Chapitre I: DISPOSITIONS COMMUNES<br />
Article 3 :<br />
1. Il est institué deux catégories d'étude d'impacts<br />
2. l'évaluation sommaire d'impacts dénommée ci-après évaluation sommaire<br />
3. l'étude d'impacts détaillée dénommée ci-après étude détaillée<br />
Article 4 : Pour l'application de l'article 19(1) de la loi n° 96/12 du 05 Août 1996,<br />
sont assujettis à la procédure d'étude détaillée, les projets visés dans les domaines énumérés à<br />
l'annexe 1 du présent décret<br />
sont assujettis à la procédure d'évaluation sommaire, les projets visés dans les domaines<br />
énumérés à l'annexe 2 du présent décret<br />
Article 5 : Tout projet entrepris avant la date de signature du présent décret n'est pas soumis à<br />
une étude d'impacts<br />
II peut toutefois faire l'objet d'un audit environnemental décidé par l'administration en<br />
charge de l'environnement<br />
Article 6 : Les frais relatifs à une étude d'impacts sont entièrement à la charge du promoteur<br />
Chapitre II: DE LA PROCEDURE D'ETUDE D'IMPACTS<br />
Article 7 :<br />
1 Pour réaliser l'étude d'impacts d'un projet, le promoteur dépose auprès de l'administration<br />
chargée de l'environnement un dossier de demande d'autorisation de son projet comprenant<br />
une demande, comportant la raison sociale, l'adresse, le capital social, le secteur d'activité, le<br />
nombre d'emploies, pour les personnes morales, les noms et prénoms, l'adresse pour les<br />
personnes physiques, un mémoire descriptif et justificatif du projet mettant l'accent sur les<br />
incidences possibles du projet sur l'environnement<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 116
2 Le dépôt du dossier donne lieu à la délivrance d'un récépissé sur lequel est indiqué<br />
obligatoirement la date et le numéro du dossier<br />
3 Après réception du dossier de demande d'autorisation, l'administration chargée de<br />
l'environnement dispose de 45 jours pour dire au promoteur si son projet est assujetti ou<br />
non à une étude d'impacts ou à une évaluation sommaire visées à l'article 3 ci-dessus<br />
4 L'administration chargée de l'environnement fournie au promoteur les termes de référence<br />
de l'étude d'impacts à réaliser<br />
5 Sur la base de ces termes de référence, le promoteur prépare le cahier des charges de l'étude<br />
d'impacts et le soumet pour approbation à l'administration compétente<br />
Article 8 : Le promoteur d'un projet est libre de faire appel à un consultant ou /et bureau<br />
d'études de son choix pour réaliser l'étude d'impacts de son projet. Cependant, la priorité<br />
accordée aux compétences nationales<br />
Pour être habilité à réaliser une étude d'impacts, le consultant ou bureau d'études doit être<br />
agréé par l'administration compétente, à la date de soumission de l'étude<br />
CHAPITRE III: DE LA RECEVABILITE DE L'ETUDE D'IMPACTS<br />
Artide-9 : Il est crée au sein de l'administration compétente un comité ad hoc chargé de<br />
l'examen de l'étude d'impacts ou de l'évaluation sommaire.<br />
Ses membres sont désignés pour chaque étude d'impacts ou évaluation sommaire par un texte<br />
particulier de l'autorité compétente, sur proposition de l'administration compétente<br />
Le comité est préside par le responsable de l'administration compétente et son secrétariat est<br />
assuré par la structure de l'administration compétente en charge de la normalisation<br />
environnementale<br />
Article 10 Le promoteur remet à l'autorité compétente, avec accusée de réception son étude<br />
d'impacts en 5 exemplaires s'il s'agit d'une évaluation sommaire et en 10 exemplaires s'il s'agit<br />
d'une étude détaillée<br />
Des réception de l'étude d'impacts, l'autorité compétente transmets quatre exemplaires pour<br />
examen et avis à l'administration compétente s'il s'agit d'une évaluation sommaire et 9<br />
exemplaires dans le cas de l'étude détaillée<br />
Article 11 : S'il s'agit d'une Evaluation sommaire, dès réception de l'étude d'impacts,<br />
l'administration compétente descend sur le terrain pour fin de vérification qualitative et<br />
quantitative des informations qui y sont contenues et pour recueillir les avis des populations<br />
concernées<br />
l'administration compétente établit un rapport d'évaluation accompagné de son avis motivé, ce<br />
rapport est transmis au comité interministériel sur l'environnement pour approbation<br />
Article 12 : S'il s'agit d'une étude détaillée, à sa réception, l'administration compétente<br />
examine l'étude afin de juger sa recevabilité A cet effet, elle peut en cas de besoin, effectuer<br />
des visites de contre-expertise sur le terrain<br />
Elle dispose d'un délai de 30 jours pour transmettre l'étude accompagnée de son avis motivé<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 117
au Comité Interministériel pour l'Environnement (CIE) aux fins de l'examiner<br />
Article 13 : Le Comité Interministériel dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur la<br />
recevabilité de l'étude.<br />
En cas de refus, l'autorité compétente le notifie au promoteur en indiquant les motifs du refus<br />
ou le cas échéant, les observations et corrections à apporter à l'étude pour la rendre recevable<br />
Passé le délai de 30 jours et en cas du silence de l'autorité compétente, l'étude détaillée est<br />
réputée recevable<br />
A la réception des observations et corrections prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le promoteur<br />
confectionne le rapport définitif et le dépose en 15 exemplaires contre accusé de réception<br />
auprès de l'administration compétente qui dispose, à compter de la date de dépôt, d'un délai<br />
de 30 jours pour émettre son avis sur l'étude détaillée faute de quoi celle-ci est considérée<br />
comme recevable<br />
Article 14 : Aussitôt que l'administration compétente reçoit <strong>of</strong>ficiellement la version<br />
définitive du rapport d'étude détaillée, elle prépare l'avis de recevabilité dont l'objectif est de<br />
fournir à l'autorité compétente l'éclairage nécessaire qui lui montre la pertinence pour laquelle<br />
il faut rendre publique l'étude détaillée<br />
L'avis de recevabilité est motivée par un rapport d'analyse environnementale qui vise à<br />
contrôler la recevabilité administrative et technique et à établir la conformité de l'étude<br />
détaillé avec les normes scientifiques et juridiques en vigueur ainsi que la compatibilité avec<br />
l'environnement<br />
Article 15 : Des réception de l'avis de recevabilité de l'administration compétente, l'autorité<br />
compétente rend publique l'étude détaillée par voie de presse, radio, télévision et autres Des<br />
exemplaires du rapport sont déposés dans des salles appropriées de la zone du projet et dans<br />
les principales villes du pays pour consultation publique pendant une période de 45 jours a<br />
compter de la date d'ouverture des salles<br />
Les modalités d'acquisition de la salle, sa date d'ouverture, son approvisionnement en<br />
documents et sa gestion sont fixés par un texte particulier du Ministère de l'Environnement et<br />
des Forêts Les frais de consultation publique sont à la charge du promoteur<br />
Toutes les remarques et les mémoires du public sont consignées dans des cahiers ou registres<br />
ouverts à cet effet dans les salles de consultation publique<br />
Article 1 6: Au terme des consultations publiques, une notification des résultats est faite au<br />
promoteur soit pour confirmer la recevabilité de l'étude, soit pour l'informer de la nécessité<br />
d'une audience publique<br />
CHAPITRE IV: DE L'AUDIENCE PUBLIQUE<br />
Article 17: Une audience publique relative à une étude détaillée peut être ordonnée par<br />
l'autorité compétente.<br />
Article 18: Toutefois, une demande d'audience publique relative à une étude détaillée peut<br />
être adressée a l'autorité compétente par toute personne physique ou morale, sur la base des<br />
remarques ou mémoires pertinents qu'elle aura fournis<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 118
Pour le faire, elle dépose auprès de l'administration compétente une demande d'audience<br />
publique qui doit comporter obligatoirement l'avis motivé à sa requête<br />
En cas de refus de l'autorité compétente, le pétitionnaire peut saisir la Commission Nationale<br />
Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable (CNCEDD) qui statue en<br />
dernier ressort<br />
Article 19 : L'audience publique comprend deux parties :<br />
1. pendant la 1ère consacrée à l'information, les requérants sont invités à exposer les motifs<br />
de leur demande d'audience et le promoteur à mieux présenter l'étude détaillée de son<br />
projet<br />
2. la 2e partie qui a lieu au moins 30 jours après la fin de la 1ère, est consacrée a l'audition<br />
des mémoires des requérants et du promoteur du projet<br />
Article 20 : La composition de la commission chargée de l'audience publique est fixée par un<br />
texte particulier de l'autorité compétente. Toutefois, elle devra comprendre obligatoirement,<br />
un représentant de chacune des autres administrations concernées par le projet, deux<br />
représentants des ONGs, deux des syndicats et deux de la société civile<br />
La commission dispose de 4 mois pour réaliser l'ensemble de son mandat Son apport est remis<br />
à l'autorité compétente qui doit le rendre public dans les 60 jours qui suivent<br />
Article 21 : Les projets relevant de la .sécurité ou de la défense nationale ne sont pas soumis a<br />
la procédure d’audience publique ci-dessus<br />
CHAPITRE V: DU CONTENU DE L'ETUDE D’IMPACTS<br />
Article 22 : Le contenu d'une évaluation sommaire comprend .<br />
• la description sommaire de l'environnement du site et de la région ;<br />
• l'étude bibliographique ;<br />
• le rapport de la descente sur le terrain.<br />
Elle doit faire l'inventaire et la description des impacts du projet sur les différentes<br />
composantes de l'environnement et, indiquer les différentes mesures d'atténuation qui ont été<br />
envisagées.<br />
Article 23 : L'Etude détaillée comporte les éléments suivants :<br />
a) la description de l'état initial du lieu et de la région d'implantation du projet ;<br />
b) la description du projet et les raison de son choix parmi les autres solutions possibles ,<br />
c) la présentation de l'environnement du projet et les raisons du choix du site ;<br />
d) l'identification et l'évaluation des effets possibles de la mise en œuvre sur l'environnement<br />
naturel et humain du projet,<br />
e) l'indication des mesures prévues pour éviter, réduire ou éliminer les effets dommageables<br />
du projet sur l'environnement ;<br />
f) l'étude socio-économique du projet avec procès verbal des réunions tenues avec les<br />
populations concernées par le projet, les ONG, les syndicats, les leaders d'opinions et autres<br />
groupes organisés ,<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 119
g) le programme de sensibilisation et d'information des populations concernées accompagné<br />
des procès verbaux des réunions correspondantes ,<br />
h) le résumé en langage simple des informations spécifiques requises aux alinéas ci-dessus.<br />
Article 24 : La réalisation de l'étude d'impacts doit être faite avec la participation des<br />
populations concernées.<br />
A cet effet, le programme qui comporte les dates des réunions, un mémoire descriptif et<br />
explicatif du projet et des objectifs des concertations doit parvenir avec décharge ou accusé<br />
de réception 30 jours avant la tenue à l'administration compétente et aux responsables des<br />
populations concernées.<br />
L'écho doit en être largement fait par voie de presse, radio, télé et autres médias. Chaque<br />
réunion est sanctionnée par un procès verbal dont copie sera intégrée au rapport de l'étude<br />
CHAPITRE VI: DE L'EVALUATION DE L'ETUDE D'IMPACTS<br />
Article 25 : Afin de garantir la sauvegarde de l'environnement, de la santé et des intérêts des<br />
populations concernées par un projet, l'évaluation de l'étude d'impacts d'un projet doit être<br />
transparente et participative. A cet effet elle tient compte de:<br />
• la consultation des populations pendant l'étude préliminaire ;<br />
• l'approbation du cahier de charges par l'administration compétente ,<br />
• l'évaluation de sa recevabilité par l'administration compétente<br />
• l'avis du comité interministériel sur l'environnement et le cas échéant de celle de la<br />
commission nationa1e consultative sur l'environnement et le développement<br />
durable ;<br />
• la publication et l'ouverture à la consultation publique;<br />
• l'audience publique sur le projet le cas échéant ;<br />
• le cas échéant, du dernier recours à la CNCEDD, instance suprême nationale en<br />
matière de l'environnement.<br />
CHAPITRE VII: DE L’APPROBATION DE L’ETUDE<br />
Article 26: Lorsqu'il s'agit d'une évaluation sommaire,<br />
le comité interministériel sur l'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour<br />
approuver ou rejeter le rapport .Passé ce délai, le rapport d'évaluation est considéré comme<br />
approuvé.<br />
L'administration chargée de l'environnement est tenue dans un délai de 60 jours, d'émettre par<br />
voie de presse, de radio, d'audiovisuel et autres son avis motivé sur l'évaluation sommaire et<br />
ce après celui du Comité Interministériel pour l'Environnement (CIE). Passé ce délai<br />
l'évaluation sommaire est considérée comme acceptée et le promoteur peut commencer ses<br />
travaux.<br />
Article 27 : L'approbation de l'étude d'impacts de tout projet donne lieu à une décision<br />
motivée de l'autorité compétente, après avis à une du CNCEDD.<br />
Une décision favorable donne droit à la délivrance d'un certificat de conformité à<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 120
l'environnement.<br />
Une décision conditionnelle indique au promoteur les mesures qu'il doit prendre en vu de se<br />
conformer et d'obtenir le certificat de conformité.<br />
Une décision défavorable entraîne le refus pur et simple de la mise en œuvre du projet.<br />
Article 28 : Tout promoteur qui s'estime lèse par la décision du Ministre chargée de<br />
l'Environnement peut recourir en dernier ressort à la CNCEDD<br />
Article 29 : Tout promoteur de projet assujetti à la procédure de l'étude d'impacts doit au<br />
préalable obtenir un certificat de conformité à l'environnement de son projet délivré par<br />
l'autorité compétente avant le démarrage de sa mise en œuvre.<br />
CHAPITRE VIII: DE LA SURVEILLANCE ET DU SUIVI ENVIRONNEMENTAL<br />
DU PROJET<br />
Article 30 : Le promoteur d'un projet est le responsable de la surveillance et du suivi<br />
environnemental de son projet, conformément aux prescriptions du certificat de conformité à<br />
l'environnement<br />
A cet effet, il est tenu de soumettre à l'approbation de l'administration compétente un plan de<br />
gestion environnementale de son projet.<br />
Un rapport de suivi environnemental suivant un modèle fourni par l'administration<br />
compétente doit être envoyé à ladite administration selon une fréquence spécifié dans le plan<br />
de gestion environnementale et au moins une fois l'an dans tous les cas,<br />
Durant la mise en œuvre du projet, le promoteur doit tenir à jour un registre des substances<br />
émises dans l'environnement (polluante ou non) et dont l'origine provient d'une activité du<br />
projet, ainsi que des prélèvements effectués sur les ressources naturelles et sur<br />
l'environnement.<br />
Article 31 : L'administration compétente est responsable du contrôle des programmes de<br />
surveillance et du suivi environnemental du promoteur du projet.<br />
Pendant les périodes de suivi environnemental, des mesures peuvent être adoptées d'accord<br />
parties pour se conformer le mieux possible aux recommandations du rapport d'étude<br />
d'impacts<br />
CHAPITRE IX: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES<br />
Article 32 : En attendant la signature du décret organisant le Comité interministériel sur<br />
l’environnement, prévu par l'article 10 de la loi n° 96/12 du 05 Août 1996, la Commission<br />
Nationale Consultative pour l'Environnement et le Développement Durable (CNCEDD) agit<br />
en ses lieu et place dans la procédure d'étude d'impacts<br />
Article 33 : Les unités en cours d'exploitation ou /et de fonctionnement disposent d'une délai<br />
de 6 mois à compter de la date de signature du présent décret pour soumettre à l'approbation<br />
de 1 'administration chargée de l'environnement leur plan de gestion environnementale<br />
Article 34 : Le présent décret s'applique à l'ensemble du projet et non à une fraction du projet<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 121
Article 35 : Les contrevenants au présent décret s'exposent aux sanctions prévues par la<br />
législation en vigueur en matière de l'environnement et du développement durable<br />
A cet effet la procédure d'urgence pour suspendre les travaux en cas d'infraction est<br />
celle du décret n° 98/031 du 9 Mais 1998 portant organisation des plans d'urgences et de<br />
secours en cas de catastrophes ou de risques majeurs<br />
Article 36 : Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires antérieures contraires au<br />
présent décret<br />
Article 37 : Le Ministre de l'Environnement et des Forêts est chargé de l'application du<br />
présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au<br />
Journal Officiel en Français et en Anglais.<br />
Fait à Yaoundé, le___________<br />
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,<br />
Peter MAFANI MUSONGE<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 122
17.2 LA LEGISLATION SUR LES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTALES<br />
CHAPITRE II<br />
DES ETUDES D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL<br />
ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement<br />
ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des incidences des activités qui y sont<br />
exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à l'environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du<br />
cahier des charges, une étude d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur<br />
l'équilibre écologique de la zone d'implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des<br />
populations et des incidences sur l'environnement en général.<br />
Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense ou de la sécurité<br />
nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité nationale assure la publicité de l'étude<br />
d'impact dans des conditions compatibles avec les secrets de la défense ou de la sécurité nationale.<br />
telle procédure est prévue.<br />
(2) L'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une<br />
(3) L'étude d'impact est à la charge du promoteur.<br />
d'application de la présente loi.<br />
(4) Les modalités d'application des dispositions du présent article sont fixées par un décret<br />
ARTICLE 18.- Toute étude d'impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges est nulle et de nul<br />
effet.<br />
ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d'opérations dont la réalisation est soumise à une étude<br />
d'impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l'étude d'impact est rendue publique sont fixées par un décret<br />
d'application de la présente loi.<br />
(2) L'étude d'impact doit comporter obligatoirement les indications suivantes :<br />
• l'analyse de l'état initial du site et de son environnement ; les raisons du choix du site ;<br />
• l'évaluation des conséquences prévisibles de la mise en œuvre du projet sur le site et son<br />
environnement naturel et humain ;<br />
• l'énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d'ouvrage pour supprimer, réduire et, si<br />
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et l'estimation des<br />
dépenses correspondantes ;<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 123
• la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la<br />
protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.<br />
ARTICLE 20.- (1) Toute étude d'impact donne lieu à une décision motivée de l'Administration compétente,<br />
après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la présente loi, sous peine de nullité absolue de cette<br />
décision.<br />
La décision de l'Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter<br />
de la date de notification de l'étude d'impact. Passé ce délai, et en cas de silence de l'Administration, le<br />
promoteur peut démarrer ses activités.<br />
(2) Lorsque l'étude d'impact a été méconnue ou la procédure d'étude d'impact non respectée<br />
en tout ou en partie, l'Administration compétente ou, en cas de besoin, l'Administration chargée de<br />
l'environnement requiert la mise en œuvre des procédures d'urgence appropriées permettant de suspendre<br />
l'exécution des travaux envisagés ou déjà entamés. Ces procédures d'urgence sont engagées sans préjudice des<br />
sanctions pénales prévues par la présente loi.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 124
17.3 Concordance entre les impacts et les mesures d’atténuation de l’EIE 10015<br />
Domain<br />
e<br />
ECONOMIQUE<br />
Elément<br />
environnementaux<br />
<strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Activités agricoles Destruction des cultures 3,57<br />
Activités de chasse Perturbation des activités de chasse 3,62<br />
Activités de pêche Perturbation des activités de pêche 3<br />
Artisanat Perturbation du petit artisanat 1,62<br />
Revenu<br />
Demande<br />
Perte de revenus liés au projet dès<br />
sa fin<br />
Chute de la demande en produits<br />
locaux à la fin du projet<br />
Evaluatio<br />
n globale<br />
Mesures d’atténuation<br />
- Evaluation des dégâts avant les travaux<br />
- Indemnisation des propriétaires<br />
(respect des procédures d’expropriation)<br />
Concertation de l’entreprise avec les<br />
chasseurs sur le mode de gestion de<br />
l’espace<br />
Concertation pêcheurs-entreprise sur les<br />
appuis à apporter aux activités de pêche<br />
4,25 - Promotion de l’entreprenariat local<br />
- -<br />
Perturbation du sol lors des<br />
terrassements<br />
3,62<br />
Pollution des sols par les<br />
hydrocarbures et produits de<br />
traitement des grumes<br />
3,25<br />
Stockage des hydrocarbures et polluant<br />
sur couche de sable ou aire bétonnée<br />
Perturbation des berges de la<br />
Boumba<br />
1,75<br />
Perturbation des zones<br />
marécageuses<br />
3,12<br />
- Respect des écoulements naturels<br />
- Respect des plans d’eau<br />
Sol<br />
Faune et ressources<br />
halieutique<br />
Perturbation par l’extraction de<br />
matériaux (sable, graviers, latérite)<br />
2,75<br />
- Remise en état des zones d’emprunts à<br />
l’issue des travaux<br />
- Ravitaillement sur les zones d’emprunt<br />
relativement proche et au matériaux de<br />
nature similaire au point des travaux<br />
Perturbation de l’écoulement des<br />
eaux de surface<br />
3,5<br />
Bon dimensionnement et positionnement<br />
adéquat des ouvrages<br />
Pollution des eaux de surface par<br />
les hydrocarbures et produits de<br />
traitement des grumes<br />
3,25<br />
Respect des normes de l’Union<br />
Européenne en matière de stockage et<br />
distribution des polluants et<br />
hydrocarbures<br />
Pollution des eaux de surface par<br />
les bacs<br />
1,37<br />
Pollution des eaux de surface par<br />
les déchets de chantier<br />
2,25<br />
Mise sur pied d’un plan de gestion des<br />
déchets de chantier<br />
ENVIRONNEMENT<br />
Eaux de surface<br />
Faune et ressources<br />
halieutiques<br />
Obstruction des cours d’eau et<br />
plans d’eau par la chute des arbres<br />
Perturbation de la faune par les<br />
bruits<br />
2,5<br />
3,5<br />
- Eviter la chute d’arbre sur les plans<br />
d’eau<br />
- Dégager les arbres tombées sur les<br />
plans d’eau<br />
- Eviter les travaux de nuit en forêt<br />
- Ne pas utiliser les engins produisant un<br />
son de plus 70dB à 50 m<br />
- Planifier les travaux de la Boumba vers<br />
le parc<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 125
ENVIRONNEMENT<br />
Faune et ressources<br />
halieutiques<br />
Flore<br />
Risques naturels et<br />
anthropiques<br />
Air et qualité<br />
acoustique<br />
Crise et conflits<br />
Destruction des couloirs de<br />
migration et des zones de<br />
fréquentation des espèces de faune<br />
Destruction des sources<br />
alimentaires de certaines espèces<br />
de faune<br />
Augmentation du braconnage dû<br />
aux pistes et au personnel du<br />
chantier<br />
Augmentation de la pression sur<br />
les ressources des halieutiques<br />
Perturbation des ressources<br />
halieutiques par le bac<br />
Risques d’intoxication de la faune<br />
par une mauvaise gestion des<br />
déchets<br />
Destruction de la flore par les<br />
défrichements<br />
Destruction des jeunes arbres lors<br />
de l’abattage de gros arbres<br />
Destruction des espèces rares lors<br />
de l’abattage<br />
Perturbation de l’écosystème par<br />
l’extraction des essences exploitées<br />
3<br />
2,84<br />
4,62<br />
2,5<br />
1,25<br />
1,62<br />
4,37<br />
3,25<br />
3,25<br />
Création des risques d’érosion 3,5<br />
Création des risques d’incendie<br />
dans les installation de chantier<br />
Création des risques d’accidents de<br />
chantier<br />
Création des risques d’agression<br />
par les animaux<br />
Pollution de l’aire par la gaz<br />
d’échappement<br />
Création de bruit par les engins, les<br />
véhicules et scies à moteur<br />
Pollution de l’aire par les<br />
poussières en saison sèche<br />
Tensions sociales liées aux besoins<br />
d’emplois<br />
Tensions sociales liées à la<br />
cohabitation (problèmes de<br />
femmes et autres<br />
Conflits éventuels liés aux<br />
exploitations<br />
3<br />
1,75 -<br />
2,5<br />
2,25 -<br />
1,37 -<br />
3,37<br />
- Respecter une bande de sécurité de 50<br />
m de part et d’autre des couloirs de<br />
migration<br />
Respecter les fruitiers sauvages. Pour<br />
ceux qui sont exploitables respecte le<br />
diamètre d’exploitabilité<br />
- Interdire le transport d’engin ou<br />
produit de pêche dans les véhicule de<br />
l’entreprise<br />
- Interdire la consommation de gibier<br />
- Mettre sur pied un économat<br />
disposant des sources de protéines<br />
animales<br />
- Abattre seulement les arbres marqués<br />
lors de l’inventaire<br />
- Pratiquer l’abattage directement<br />
- Protéger les jeunes arbustes et les<br />
espèces non destinées à l’exploitation<br />
- Identifier et protéger les espèces<br />
menacées<br />
Revégétaliser les talus et les zones<br />
d’emprunts après exploitation<br />
- Mise sur pied d’une réglementation<br />
concernant la sécurité à l’abattage, à la<br />
circulation<br />
- Eviter les travaux de nuit<br />
- Ne faire ronfler les engins que si<br />
nécessaire<br />
3,25 Arroser de temps en temps la chaussée<br />
-<br />
3,84 Sensibiliser le personnel<br />
3<br />
Respecter les procédures en matière<br />
d’expropriation<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 126
Domaine<br />
ENVIRONNEMENT<br />
ESTHETIQUE ET<br />
DOMAINE<br />
CULTUREL<br />
SERVICES<br />
PUBLICS<br />
ESSENTIELS<br />
AUTRES ASPECTS SOCIAUX<br />
Elément<br />
environnementau<br />
x<br />
Crise et conflits<br />
Autres éléments<br />
environnementaux<br />
Comportements<br />
Valeurs et croyance<br />
Circulation<br />
transport<br />
Infrastructures<br />
Electrification<br />
et<br />
Distribution d’eau<br />
potable<br />
Propriété foncière<br />
Sexualité<br />
Vie sociale<br />
<strong>Impact</strong>s négatifs<br />
Conflits liés à la méconnaissance<br />
du cahier de charge<br />
Conflits liés à l’absence de<br />
mécanisme de dialogue avec<br />
l’entreprise<br />
Evaluation<br />
globale<br />
Perturbation du régime hydrique 3,25 -<br />
Colonisation par les espèces de<br />
3,75 -<br />
forêts secondaires<br />
Menace d’expansion des activités<br />
agricoles<br />
Développement de la<br />
délinquance, la perturbation des<br />
comportements et valeurs<br />
ancestrales<br />
Violation des interdits locaux par<br />
les allochtones<br />
Mesures d’atténuation<br />
2,12 Contrôle des services MINEF<br />
2<br />
- -<br />
2,62<br />
Violation des sites sacrés 2,75<br />
Destruction des arbres sacrés et<br />
fétiches<br />
Mettre sur pied un mécanisme de<br />
concertation et de dialogue entre les<br />
communautés et l’entreprise par la voie<br />
des représentant de la communauté et<br />
un service des relations publiques dans<br />
l’entreprise<br />
4 Recruter en priorité les autochtones<br />
2,37<br />
Modification de paysage 2,62<br />
Augmentation des risques<br />
d’accidents de circulation<br />
Insuffisance de maintenance<br />
après le projet<br />
Création des tensions liées à<br />
l’entrée dans l’UFA par le Nord<br />
Revendications sur les<br />
communautés bénéficiaires des<br />
redevances<br />
Revendication démesures des<br />
communautés<br />
3,12<br />
2,84<br />
2,82<br />
2,5<br />
4,25<br />
Prolifération des MST-SIDA 4,25<br />
Déstabilisation des ménages<br />
locaux<br />
Développement du vol,<br />
banditisme<br />
3,75<br />
2,75<br />
Consulter régulièrement les<br />
communautés pour la protection des<br />
sites et arbres sacrés<br />
Faciliter la repousse de la végétation<br />
dans les sites décapés<br />
Emprunter la route SIBAF à la sortie<br />
de Koumela pour minimiser les risques<br />
Encourager une dynamique<br />
communautaire d’entretien routier<br />
Entretien simultané de la route<br />
Mouloundou Ndongo pendant toute la<br />
durée du projet<br />
Informer les communautés sur ls notion<br />
de riverain<br />
Organiser les campagnes de<br />
sensibilisation sur les MST/SIDa<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 127
17.4 Termes de Références<br />
Etude d'<strong>Impact</strong> sur l'Environnement<br />
UFA 10015<br />
CIBC - UTO Sud Est<br />
Douala – Yokadouma<br />
2 Août 2002<br />
1. Introduction<br />
Selon la loi cadre sur l'environnement, toute Unité forestière d'aménagement (UFA) située à<br />
proximité d'une aire protégée doit être soumise à une étude d'impact sur l'environnement<br />
(EIE) préalablement à sa mise en exploitation. Suite aux recommandations de l'Unité<br />
Technique Opérationnelle (UTO) du Sud Est et dans le souci de respecter la réglementation<br />
en vigueur au Cameroun, la Compagnie Industrielle des Bois du Cameroun (CÎBC),<br />
attributaire de FIJFA 10015 limitrophe du Parc National de Boumba-Bek, s'engage à réaliser<br />
une telle étude.<br />
Le présent document présente les termes de références de cette étude qui seront soumis pour<br />
approbation au Ministère de l'Environnement et des Forêts,<br />
II est articulé comme suit :<br />
- présentation du contexte de l'EIE<br />
- les objectifs de l’EIE<br />
- la structure de l'EIE<br />
- les modalités pratiques de déroulement de l'EIE<br />
- les documents attendus à la fin de l'EIE.<br />
2. Contextes<br />
2.1 Contexte géographique<br />
L’UFA 10015, d'une superficie de 130272 ha, est située dans l’arrondissement de Moloundou,<br />
département de Boumba-et-Ngoko, province de l'Est. Cette concession est limitée au nordouest<br />
par les Parcs Nationaux de Boumba-Bek et Nki, à l’est par la rivière Boumba et au sud<br />
par une zone agr<strong>of</strong>orestière destinée aux villages localisés le long de la rivière Ngoko où les<br />
populations riveraines les plus proches pratiquent leurs activités traditionnelles. D'autres<br />
populations habitant certains villages situés sur l'axe routier reliant Yokadouma à Moloundou<br />
peuvent également dans une moindre mesure être considérées comme riverains de cette forêt.<br />
Des études récentes ont révélé que cette forêt présente une biodiversité très riche, notamment<br />
une faune sauvage abondante et variée, ainsi que de nombreux sites critiques pour la faune. Il<br />
y a lieu de signaler que cette UFA se superpose à une zone d'intérêt cynégétique, la ZIC N°<br />
38. Elle est aussi attenante dans sa partie sud, à une zone d'intérêt cynégétique a gestion<br />
communautaire (ZICGC N° 10), et dans sa partie est, limitrophe de la forêt communale de<br />
Moloundou sur laquelle se superpose la ZICGC N° 9.<br />
2.2 Contexte institutionnel<br />
2.2.1 Cadre législatif et réglementaire<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 128
La loi N° 96/12 du 05 août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement fixe<br />
le cadre juridique général de gestion de l'environnement au Cameroun. Elle prévoit en son<br />
article 17 que; «le promoteur ou le maître d'ouvrage de tout projet d' aménagement, d'ouvrage,<br />
d'équipement ou d'installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature ou des<br />
incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à<br />
l'environnement, est tenu de réaliser selon les prescriptions du cahier des charges, une étude<br />
d'impact permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur l'équilibre<br />
écologique de la zone d' implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité de vie des<br />
populations et incidences sur l'environnement en général ».<br />
De plus, la proximité de l'UFA 10015 aux Parcs Nationaux de Boumba-Bek et Nki situe son<br />
exploitation dans un contexte particulier, dans la mesure où les aires protégées qui sont des<br />
espaces voués à la conservation de la biodiversité ont un statut de protection spéciale. L'accès<br />
à ces zones sensibles, l'utilisation de leurs ressources et même les activités dans leurs<br />
périphéries sont soumis à une réglementation stricte, afin de prévenir tous les risques<br />
environnementaux. A cet effet, un cahier des charges spécifiques concernant la mise en<br />
exploitation de toute concession forestière riveraine d'une aire protégée ou localisée dans la<br />
zone tampon d'une aire protégée a été institué. Ce cahier de charges spécifiques institue la<br />
réalisation d'une étude d'impact environnementale comme préalable pour le démarrage de<br />
l'exploitation de toute UFA attenante à une aire protégée.<br />
2.2.2- Les acteurs institutionnels<br />
Le Ministère de l'Environnement et des Forêts auquel incombe la responsabilité d'élaborer et<br />
de mettre en œuvre les politiques nationales en matière de gestion des forêts et de<br />
l'environnement est représenté sur le plan régional par la Délégation Provinciale de l'Est. Au<br />
niveau local, il existe une Délégation départementale pour la Boumba et Ngoko qui est<br />
renforcée par 10 Postes <strong>Forest</strong>iers et de Chasse.<br />
Par ailleurs, l'UFA 10015 se trouve dans le territoire de compétence de l'Unité Technique<br />
Opérationnelle dénommée UTO/Sud-Est, structure créée par un arrêté du Premier Ministre en<br />
1999, en application des dispositions des textes organiques du MINEF, dans la perspective de<br />
favoriser un aménagement intégré des ressources forestières et fauniques. L'UTO/Sud-Est<br />
renforce la coordination et ta capacité d'intervention des structures locales du MTNEF à<br />
travers l'assistance technique des organismes internationaux, notamment WWF et GTZ. Les<br />
principales missions de l'UTO/Sud-Est se présentent comme suit :<br />
- Superviser la création des parcs nationaux de Lohéké, Boumba-Bck et Nki ;<br />
- Assurer la gestion desdits parcs nationaux ;<br />
- Développer le processus de gestion durable des ressources forestières et<br />
fauniques dans la zone d'utilisation multiple (zone tampon) ;<br />
- Promouvoir la participation des communautés locales à la gestion de la<br />
biodiversité Coordonner les actions de police forestière et de chasse.<br />
Les activités du WWF sont focalisées sur :<br />
- les inventaires biologiques ;<br />
- l'appui à la création et la gestion des aires protégées la promotion de la gestion<br />
durable des zones périphériques avec la participation de tous les acteurs ;<br />
- la recherche des solutions pour limiter les effets négatifs de l'exploitation<br />
forestière sur les ressources naturelles ;<br />
Les actions de la GTZ concernent :<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 129
- l'amélioration de la participation active de tous les acteurs au processus<br />
d'actualisation du zonage ;<br />
- la vulgarisation de la politique et la loi forestière auprès des acteurs, surtout la<br />
population ;<br />
- la sensibilisation de la population sur les méfaits de la sur-exploitation des<br />
ressources forestières et fauniques ;<br />
- la recherche et la promotion des sources de protéines alternatives, ainsi que des<br />
activités génératrices de revenus, en vue de détourner les populations du<br />
braconnage l'amélioration de la prise en compte des intérêts des communautés<br />
riveraines dans l'aménagement des aires protégées, des UFA et des Z1C.<br />
En plus des organismes partenaires de l'UTO/Sud-Est ci-dessus mentionnés, il convient de<br />
souligner que d'autres acteurs institutionnels importants sont à considérer dans la zone<br />
d'étude, notamment :<br />
- la société Boumba Safaris qui est amodiataire de la Z1C N^ 38 les Comités de<br />
Valorisation des Ressources Fauniques (COVARRF) en charge des ZICGC<br />
N°9 et N° 10 ;<br />
- la Sous-Préfecture et la Commune Rurale de Moloundou qui ont pour rôles<br />
d'assurer la coordination générale de tous les services et d'encadrer les<br />
populations.<br />
2.3 Contexte socio-économique<br />
L’UFA 10015 a été octroyée à la CIBC par la convention provisoire d'exploitation<br />
N°137CPC/MINEF/CAB du 15 février 2001. L'aménagement et l'exploitation de cette forêt<br />
de production sont principalement orienté vers l’approvisionnement en grumes de l'usine de<br />
transformation de Lokomo, localité située à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de ce<br />
massif forestier. La mise en exploitation de cette UFA implique:<br />
- la réhabilitation d'une voie d’accès reliant la route Yokadouma-Moloundou au<br />
nord de l’UFA ;<br />
- la mise en place d'un bac pour assurer ta traversée de la Boumba ;<br />
- l'implantation d'un campement temporaire à proximité ou à l'intérieur du<br />
massif pour tes employés du chantier ;<br />
- l'ouverture des pistes forestières, des pistes de débardage et des parcs à bois au<br />
sein de l'UFA, dans le cadre du processus d'extraction des grumes.<br />
Pour accéder à l'UFA, la C1BC retient le tracé le plus économique soit la réhabilitation d'une<br />
ancienne route forestière actuellement considérée comme une route administrative. Celle-ci<br />
est située dans la zone agro-forestière et présente l'avantage de réduire au minimum la<br />
distance entre la zone d'exploitation et l'usine. Toutefois l'ouverture de cette route suscite<br />
quelques inquiétudes dans la mesure où elle peut également faciliter l'accès des braconniers<br />
dans le Parc National de Boumba-Bek, mais aura l'avantage de désenclaver les populations de<br />
villages le long de cette route. Ce choix aura forcement une incidence sur les populations<br />
riveraines de la partie sud de l'UFA qui craignent tout comme les autorités administrative que<br />
l'axe routier Moloundou-Ndongo ne soit pas suffisamment entretenu et portera préjudice au<br />
développement économique de leur région.<br />
L'installation d'un campement d'ouvriers forestiers risque d'engendrer le développement d'une<br />
agglomération susceptible d'exercer une pression sur la faune sauvage en général et sur le<br />
Parc National de Boumba-Bek en particulier. Afin de pallier à celte éventualité, le campement<br />
des ouvriers sera temporaire, il sera composé de «maisons mobiles » déplacées sur le site<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 130
seulement durant la période des travaux en forêt. Il ne sera accessible qu'aux ouvriers sans<br />
leur famille. Les ouvriers seront déposés au campement le lundi matin et ramenés à Lokomo<br />
le vendredi soir.<br />
Par ailleurs l'ouverture des pistes forestières, des pistes de débardage et des parcs à bois peut<br />
malencontreusement provoquer des dégâts sur la biodiversité en général et les sites critiques<br />
pour la faune en particulier, notamment les couloirs de migration des grands mammifères, les<br />
salines et les refuges saisonniers.<br />
3 Objectifs de l’étude.<br />
L’étude a pour objectif d'analyser et de formuler des recommandations relatives aux risques<br />
environnementaux et socio-économiques liés à :<br />
- L'exploitation forestière de l'UFA 10 015 ;<br />
- La réhabilitation et utilisation de la voie d'accès par le nord de l'UFA La<br />
construction et l'utilisation d'un bac pour la traversée de ta rivière Boumba au<br />
nord de l’UFA ;<br />
- L'installation d'un campement d'ouvriers à proximité de FUFA et des Parcs<br />
Nationaux de Boumba-Bek et Nki.<br />
Ces quatre composantes sont rassemblées ci-dessous sous le terme de «projet», qui doit être<br />
soumis à une étude d'impact environnemental respectant les normes nationales d'application.<br />
L'étude recommandera les options jugées les plus avantageuses ainsi que des mesures<br />
d'atténuation appropriées.<br />
Les objectifs spécifiques de cette EIE sont :<br />
- Identifier les activités liées à la production forestière, à l'évacuation des<br />
produits forestiers vers Lokomo ou à l'implantation d'un campement<br />
temporaire pour le personnel et analyser leurs impacts sur le Parc National de<br />
Roumba-Bek et sa périphérie ;<br />
- Evaluer les impacts socio-économiques et culturels ,des activités d'exploitation<br />
de l’UFA 10015 ;<br />
- Proposer des mesures d'atténuation desdits impacts ;<br />
- Faire des recommandations par rapport à la localisation du campement, afin<br />
de prévenir des pressions éventuelles sur le Parc National de Boumba-Bek ;<br />
- Proposer des modalités pratiques pour promouvoir des sources de protéines<br />
alternatives au gibier pour éviter que la forte demande en viande créée par<br />
l'implantation du campement ne contribue à intensifier le braconnage ;<br />
- Etablir des procédures de suivi et de contrôle du transport de bois au niveau de<br />
la route d'accès à l’UFA et dans les pistes forestières pour éviter<br />
l’intensification du braconnage ;<br />
- Etablir des mesures de protection des couloirs de migration des animaux et les<br />
autres sites importants en matière de biodiversité ;<br />
- Proposer des mesures visant à favoriser un aménagement intégré de l’UFA, de<br />
la ZIC N° 38 et des ZICGC N° 9 et N° 10 ;<br />
- Proposer des mesures compensatoires pour le désenclavement des populations<br />
riveraines de la partie sud de l’UFA après l'ouverture de la route d'accès dans<br />
la partie nord.<br />
4 Termes de références<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 131
Sont présentées ici les différentes étapes du travail à réaliser et le contenu du rapport final de<br />
l'étude d'impact38<br />
4.1 Les étapes requises de l’étude d’impact environnemental<br />
1) Description du projet proposé<br />
Cette première tâche consiste à fournir une description des éléments de base du projet :<br />
localisation et taille, objectifs affichés, état actuel de réalisation, moyens disponibles,<br />
institutions engagées, programme d'intervention, durée de vie ..,<br />
2) Description de l’environnement du projet<br />
L’objectif est de rassembler les données qui caractérisent l'environnement avant l'éventuelle<br />
réalisation du projet. Ces informations serviront également de base à l'identification puis à<br />
l'évaluation des différents impact du projet.<br />
• Environnement Juridique et administratif:<br />
Il est surtout question de faire l’état des lieux des différents textes nationaux et internationaux<br />
régulant l'exécution du projet et leurs implications sur la mise en œuvre du projet.<br />
• Environnement physique et biologique :<br />
Sur la base des résultats disponibles des études réalisées dans la zone, faire une revue des<br />
données géologiques, topographiques, pédologiques, climatologiques, hydrologiques et du<br />
potentiel biologique (faune et flore).<br />
• Environnement économique ;<br />
Pour les populations riveraines, une synthèse devra être faite sur le niveau et les sources de<br />
revenus, les indicateurs de bien-être, l'utilisation du milieu naturel, les principales activités<br />
commerciales, les flux des échange, les possibilités d'accès au marché,...<br />
Pour les acteurs locaux du secteur privé, le point doit être fait sur le chiffre d'affaires, les<br />
emplois crées, les retombées économiques locales, le niveau de production, les impôts et<br />
taxes, le tourisme, la pollution autour des sites industriels.<br />
• Environnement socio-culturel :<br />
Les composantes socioculturelles devront de leur côté faire ressortir les considérations<br />
générales du genre : démographie, distribution ethnique, nombre et localisation des<br />
implantations humaines, nature des activités villageoises, modes coutumiers d'appropriation<br />
de l'espace, savoirs traditionnels, sites culturels, organisations sociales, éducation, santé,...<br />
3) Désignation des alternatives<br />
Suite à l'analyse de l'environnement globale, définir s'il y a lieu les différentes alternatives<br />
envisageables pour atteindre les objectifs du projet.<br />
4) Détermination des impacts des différentes possibilités de mise en œuvre du projet<br />
Deux étapes sont à suivre :<br />
- Parmi toutes les informations récoltées, identifier les impacts significatifs<br />
qu'aurait le projet sur son environnement. Ce choix des impacts principaux doit<br />
être justifié avec soin.<br />
- Pour chacune des alternatives, évaluer les impacts (environnementaux,<br />
économiques et sociaux), si possible en termes quantitatifs, de la mise en<br />
œuvre du projet sur son environnement. Cette analyse doit distinguer<br />
clairement les impacts positifs et négatifs, les impacts directs et indirects, ceux<br />
38 Document de référence : Décret fixant les modalités de réalisation des études l’impact sur l'environnement<br />
(EIE) en préparation . norme EIE Banque Mondiale ; norme EIE Union Européen ne .<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 132
à court terme et à long terme, ceux sur site et hors-site, ainsi que les impacts<br />
irréversibles,<br />
5) Elaboration d'un plan d'atténuation des impacts négatifs<br />
Le plan d'atténuation devra recommander des mesures effectives pour prévenir ou réduire les<br />
effets dommageables directs (installation des infrastructures) et indirects sur les aspects<br />
environnementaux et sociaux. Les résultats attendus de telles mesures et leurs coûts de mise<br />
en place (notamment les coûts de formation) doivent être évalués.<br />
6) Conception d’un plan de suivi<br />
L'étude devra présenter un plan détaillé pour contrôler Inexécution du projet tel que décrit<br />
dans l'étude d'impact et la mise en application des mesures d'atténuation. Il est bon d'y<br />
préciser le coût financier et les autres apports (formation, renforcement institutionnel,...)<br />
nécessaires pour un tel suivi.<br />
7) Contenu du rapport de l'étude d’impact environnemental<br />
Le rapport de TEIE doit être organisé de. la façon suivante :<br />
- Résumé analytique : il s'agit d'un exposé succinct des principales conclusions<br />
de l'étude d’impact et des mesures recommandées. Ce résumé, qui sera<br />
largement diffusé. doit être rédigé, en français et en anglais, dans un langage<br />
non-technique afin d’être compris du plus grand nombre.<br />
- Description du projet : elle s'inscrit dans une perspective géographique,<br />
écologique, économique, technique, sociale et temporelle.<br />
- Etat du contexte juridique et administratif, dans lequel l'étude d’impact est<br />
réalisée et<br />
dans lequel le projet sera fait.<br />
- Données de base: elles précisent toutes les informations utilisées pour ta<br />
description de l’environnement du projet ainsi que pour l'évaluation d'impact<br />
environnementale. Les documents utilisés ainsi que les entretiens réalisés<br />
doivent être rapportés en appendice.<br />
- Analyse des alternatives. Pour chacune des alternatives, les caractéristiques<br />
ainsi que les principaux impacts positifs et négatifs doivent être présentés.<br />
- Evaluation d'impacts: cette partie identifie et estime de manière si possible<br />
quantifiée les impacts positifs et négatifs susceptibles de résulter du projet<br />
- Plan d'atténuation; ce plan consiste à définir les mesures à prendre pour<br />
éliminer ou réduire les effets néfastes sur l’environnement. Le plan doit<br />
comporter des mesures compensatrices si les mesures d'atténuation ne sont pas<br />
envisageables ou suffisantes<br />
- Plan de suivi : ce plan doit définir le type de contrôle à mettre en place, qui en<br />
aura la charge, son coût ainsi que tes mesures d'accompagnement nécessaires.<br />
- Appendices, comprenant entre autres , la liste des experts ayant participé à<br />
l'étude d'impacts, les comptes-rendus des séances de consultation publique, la<br />
liste des documents sources, les données utilisées.<br />
8 Modalités pratiques<br />
8.l Participation des acteurs concernés<br />
Toute étude de qualité d'impact sur l'environnement se doit d'associer les acteurs concernés à<br />
l'élaboration et la mise en oeuvre du projet. On distingue généralement deux groupes d'acteurs<br />
devant prendre part aux procédures d'information et de consultation :<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 133
- les groupes directement affectés par le projet : le promoteur et les agents<br />
économiques du secteur privé, populations locales (autorités <strong>of</strong>ficielles et<br />
traditionnelles), représentants élus, autres acteurs institutionnels locaux ;<br />
- les autres groupes intéressés, telles que l'administration compétente, les ONG<br />
nationales ou internationales, les personnes de la société civile (experts,<br />
chercheurs,..-) ayant une connaissance particulière du projet.<br />
8.2 Plan de travail<br />
Les étapes importantes de la mission principale seront : la préparation, la concertation avec le<br />
promoteur, membres de l'UTO du Sud-Est, autres acteurs institutionnels et les populations<br />
concernées, l'étude de terrain et la rédaction du-rapport.<br />
Les étapes de la mission se présentent comme suit :<br />
- Réunions de concertation entre le promoteur et les partenaires de l'UTO/Sud-<br />
Est en vue de préparer les termes de référence (TDR) ;<br />
- Présentation des TDR au SPE ;<br />
- Collecte des informations bibliographiques ;<br />
- Collecte des données sur le terrain ;<br />
- Organisation des réunions de concertation dans les villages avec la<br />
participation des autorités administratives, municipales et traditionnelles ;<br />
- Rédaction du rapport ;<br />
- Restitution du rapport au niveau de l’UTO, avec la participation du<br />
promoteur ;<br />
- Présentation du rapport au niveau du SPE, avec la participation du promoteur,<br />
8.3 Période de réalisation de l'étude<br />
L'étude devra commencer au plus tard deux semaines après la réception d'un avis favorable à<br />
la réalisation de l’étude. La durée totale de l'étude ne devra pas excéder 8 (huit) semaines.<br />
8.4 Composition de l’équipe<br />
L'étude sera réalisée par un bureau compétent en étude d'impact environnemental ayant une<br />
expérience reconnue dans la réalisation de travaux similaires au Cameroun ou dans la région.<br />
Il est nécessaire que ce bureau d'études ait une très bonne connaissance des textes régissant<br />
les études d'impact au Cameroun.<br />
Du à la spécificité de cette UFA située a proximité d'un parc national, juxtaposition d'une Z1C<br />
et deux ZICGC et sa richesse en espèces fauniques, un accent particulier devra être mis sur<br />
l'aménagement et la protection de la faune.<br />
L’équipe de recherche se composera au minimum de :<br />
Un environnementaliste avec des compétence en génie civil<br />
Un aménagiste forestier<br />
Un écologiste<br />
un socio- économiste.<br />
A cette équipe seront associés une personne ressource représentant le promoteur, et le chef<br />
Section Départemental de l'Environnement et Vulgarisation de Boumba-et-Ngoko, pour les<br />
besoins de suivi.<br />
Un soutien technique et scientifique de l'UTO du Sud-Est pourra être apporté au cabinet<br />
chargé de l'étude.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 134
17.5 Liste des experts ayant participé à l’étude<br />
N° d’ordre Nom de l’expert Fonction au sein de l’équipe<br />
1 Jean Marie NOIRAUD Ingénieur Agro-économiste Senior<br />
2 Laurent TELLIER Ingénieur Aménagiste forestier, ONFI<br />
3 KPWANG ABESSOLO François Ingénieur environnementaliste<br />
4 DJOGO TOUMOUK SALA Ingénieur écologiste<br />
5 NGATCHOU Erith Ingénieur Agro-socio-économiste Junior<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 135
17.6 Calendrier de la mission<br />
Date Heures Activités Personnes rencontrées Responsabilités<br />
Revue documentaire<br />
06/09/2002 13H00 Départ Yaoundé Lokomo<br />
07/09/2002<br />
17H30<br />
19H00<br />
9H30<br />
14H30<br />
Arrivée à Lokomo<br />
Séance de debriefing avec les<br />
responsables du groupe<br />
VICWOOD THANRY<br />
Séance de travail avec les<br />
responsables du groupe<br />
VICWOOD THANRY<br />
Revue documentaire et<br />
structuration du travail par<br />
l’équipe de consultants<br />
08/09/2002 Rencontre avec le chef de<br />
poste forestier de Salapoumbé<br />
Descente sur la piste à<br />
réhabiliter jusqu’à la<br />
traversée de la Boumba<br />
09/09/2002 Prise de contact avec les<br />
autorités de Moloudou<br />
10/09/2002<br />
11/09/2002 7H00<br />
15H00<br />
Entretien avec le Chef de site<br />
WWF de Kombo<br />
Séance de travail avec le chef<br />
de site de Lokomo<br />
Séance de travail avec<br />
l’assistant technique WWF et<br />
le chef de poste forestier de<br />
Ngato<br />
12/09/02 Séance de travail avec les<br />
responsables UTO Sud Est<br />
de Yokadouma<br />
13/09/02 Revue documentaire à l’UTO<br />
SE Yokadouma<br />
14/09/02<br />
15/09/02 Séance de travail à la GTZ<br />
Yokadouma<br />
16/09/02<br />
17/09/02 11H00 Réunion avec les populations<br />
de Ndongo, Léké et<br />
14H30<br />
Mindourou<br />
Réunion avec les populations<br />
des villages Adjala, Tembé et<br />
Légwé<br />
18/09/02<br />
19/09/02 Réunion avec les populations<br />
du village Koumela<br />
20/09/02 9H25 Réunion avec les populations<br />
baka du campement Bottolo<br />
JOANES<br />
Xavier De Maupéou<br />
NKOULOU Gervais<br />
JOANES<br />
Xavier De Maupéou<br />
NYETAM SEGBE<br />
Marcel<br />
EKORO Laurent<br />
IPANDO<br />
FOUDA Expédit<br />
Xavier de Maupéou<br />
BENE BENE Lambert<br />
MONGO NKATH<br />
Emmanuel<br />
NDO NKOUMOU J.C.<br />
WAGNE<br />
TCHAPGNOUO Jules<br />
ZANG MVOUA Parfait<br />
NGNIADO WOUALA<br />
Alphonse<br />
Léonard USONGO<br />
Jean Paul GWET<br />
Mathias HEINZE<br />
Liste des participants<br />
disponible sur demande<br />
Liste des participants<br />
disponible sur demande<br />
Liste des participants<br />
disponible sur demande<br />
Liste des participants<br />
disponible sur demande<br />
Aménagiste Groupe<br />
VICWOOD THANRY<br />
Sous-Préfet de Moloudou<br />
Maire de Moloudou<br />
Adjoint Maire de Moloudou<br />
Parc assistant Lobéké<br />
Chef de site<br />
Assistant technique WWF<br />
Chef de poste forestier de<br />
NGATO<br />
DDEF/BN- Conservateur<br />
UTO SE<br />
Chef Section Forêt DDEF/BN<br />
Chef Section Environnement<br />
DDEF/BN<br />
<strong>Forest</strong> <strong>of</strong>ficer<br />
Coordinateur WWF SE<br />
GTZ SE<br />
Conseiller Technique Projet<br />
UTO SE<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 136
21/09/02<br />
22/09/02<br />
6H30<br />
Descente à l’intérieur de<br />
l’UFA 10015<br />
22/09/02 14H20 Séance de travail avec<br />
quelques membres du<br />
COVAREF 2<br />
26/09/02 Séance de restitution à<br />
Yokadouma<br />
27/09/02 Séance de travail en équipe<br />
Entretien avec un responsable<br />
de l’AAPEC<br />
28/09/02 Descente sur la 10-011<br />
Entretien quelques employés<br />
et habitants du site<br />
29/09/02 Descente sur la Boumba<br />
Entretien avec le président du<br />
COVAREF 1<br />
30/09/02 Rencontre avec le président<br />
du COVAREF 2 (ZICGC<br />
2&9)<br />
Entretien avec le logisticien<br />
de la ZIC 38<br />
8/10/02<br />
09/10/02<br />
Entretien avec le Chef de<br />
District de Salapoumbé<br />
Entretien avec le Maire de<br />
Salapoumbé<br />
Monsieur MBOMBI<br />
Janvier<br />
Monsieur KOULBOUT<br />
David<br />
Porte parole Guide de chasse<br />
ZIC N°38<br />
Parc Assistant WWF<br />
Mambélé<br />
Monsieur EKAZA Pierre Président ZICGC N° 10<br />
Monsieur NIAMI<br />
NGOGO François<br />
Monsieur ADJINA Ernest<br />
DJENDA Eloi<br />
Sœur Geneviève AUBRY<br />
NYAMSI<br />
KOUM JACQUES<br />
IKONG DAVID<br />
Aubertin<br />
Etienne MOKENDA<br />
MOKOMPEA<br />
NIAMI NGOGO<br />
François<br />
BOMBI Janvier<br />
NKOUMBA OBAM<br />
Pierre<br />
MOSSADIKOU Norbert<br />
Président COVAREF 2<br />
(ZICGC 2 &9)<br />
Multiplicateur Baka GTZ<br />
Membre Chef d’unité<br />
financière COVAREF 2<br />
Chef chantier forêt SEBC<br />
Délégué du personnel<br />
Conseiller de la Commune<br />
rurale de Salapoumbé.<br />
Président du COVAREF 2<br />
(ZICGC 2&9)<br />
Logisticien Boumba Safaris<br />
Chef de District de<br />
Salapoumbé<br />
Maire de Salapoumbé<br />
Autres personnes rencontrées :<br />
MBOH DANDJOUMA - Chef de Section Faune & Aires Protégées, DDEF Boumba & Ngoko (MINEF)<br />
MOKOAKILI DOH Jean-Pierre – Chef de Village de Mambélé<br />
OLINGA MOUAZOK Anne – Multiplicatrice GTZ à Mambélé<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 137
17.7 Questionnaire complémentaire à l’évaluation environnementale du projet de mise<br />
en exploitation de l’UFA N° 10.15<br />
Le présent questionnaire vise à compléter les informations relatives à la préparation du<br />
projet de mise en exploitation de l’UFA N° 10.15 et à requérir le point de vue des<br />
communautés sur le projet, ses effets et impacts positifs ou négatifs. Le questionnaire sera<br />
administré à des individus relevant des communautés et les vues seront analysées pour<br />
constituer les opinions indicatives d’ensemble.<br />
Nom (facultatif) …………………………………………………………………………..<br />
Village ………………….. Arrondissement ………….……… District …………………<br />
Ethnie ……………………………………………………………………………………..<br />
(Encercler le code de votre réponse)<br />
N° Questions Réponses Code Passage<br />
1 Sexe Masculin 1<br />
Féminin 2<br />
Moins de 25 ans 3<br />
2 Tranche d’âge 25 à 45 ans 4<br />
45 ans et plus 5<br />
Chrétien 6<br />
Musulman 7<br />
3 Activités religieuses<br />
Animiste 8<br />
Autres (préciser)<br />
9<br />
-<br />
-<br />
-<br />
4 Activités sociales Association (GIC), Coop, Syndicat 10<br />
Autorité traditionnelle 11<br />
Autres (préciser)<br />
12<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Agriculture 13<br />
Elevage 14<br />
5 Activités économiques Chasse 15<br />
et de subsistance Pêche 16<br />
Petit commerce 17<br />
Autres (préciser)<br />
18<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 138
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Quelles sont les<br />
routes qui passent<br />
Les énumérez<br />
-<br />
19<br />
6 près de chez vous<br />
(moins de 20 km) et<br />
-<br />
-<br />
qui peuvent vous<br />
-<br />
servir ?<br />
Très bon 20<br />
7 Comment jugez-vous Bon (praticable en toute saison) 21<br />
leur état aujourd‘hui ? Mauvais (praticable en saison sèche 22<br />
seulement)<br />
Très mauvais (accès difficile en toute 23<br />
saison<br />
Depuis 1 à 2 ans 24<br />
8 Depuis combien de Depuis 2 à 5 ans 25<br />
temps dure cet état ? Depuis plus de 5 ans 26<br />
9 Avez-vous entendu<br />
27<br />
Oui<br />
parler du projet<br />
d’exploitation<br />
forestière de la CIBC<br />
Non<br />
28 Question 23<br />
La radio et les journaux 29<br />
Le Préfet / le Sous Préfet ou une autre<br />
autorité<br />
30<br />
10 Qui vous en a parlé ? J’ai seulement vu les gens arriver et<br />
nous parler<br />
31<br />
Autres (préciser)<br />
32<br />
-<br />
-<br />
-<br />
L’Etat 33<br />
Les bailleurs de fonds 34<br />
11 Qui a initié le projet ? Les populations 35<br />
Je ne sais pas 36<br />
Les forestiers 37<br />
Autres (préciser) 38<br />
L’Union Européenne 41<br />
La Banque Mondiale 42<br />
Je ne sais pas 43<br />
L’Agence Française de Développement 44<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 139
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Par rubrique, cochez les 2 problèmes que vous pensez être très importants aujourd’hui dans les<br />
villages avant les travaux du projet<br />
12 Au plan économique<br />
13 Au plan social<br />
14 Au plan<br />
environnemental<br />
Les prix de nos produits sont bas 45<br />
L’argent est très rare 46<br />
Les déplacements sont très difficiles 47<br />
Nous produisons peu de choses à vendre 48<br />
Beaucoup de jeunes sont en chômage 49<br />
Nous produisons beaucoup de choses 50<br />
mais pas de débouchés (les marchés sont<br />
loin)<br />
Nous n’avons pas assez de moyens pour 51<br />
produire les choses à vendre<br />
Aucun problème 52<br />
Autres (préciser)<br />
53<br />
-<br />
-<br />
-<br />
L’école est éloignée 54<br />
L’école est sous-équipée 55<br />
Le dispensaire est très loin 56<br />
Nous avons une très mauvaise eau à 57<br />
boire<br />
Il y a la sorcellerie au village 58<br />
Il y a le vol, le banditisme au village 59<br />
Il y a la prostitution au village 60<br />
Nous n’arrivons pas souvent à évacuer 61<br />
nos malades<br />
Aucun problème 62<br />
Autres (préciser)<br />
63<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Le gibier et le poisson sont rares 64<br />
Les terres ne sont plus fertiles 65<br />
Les forêts finissent 66<br />
Il y a trop de moustiques 67<br />
Il y a beaucoup de maladies liées à l’eau 68<br />
Il y a les inondations 69<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 140
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Cochez les 2 effets positifs que vous pensez être les plus importants et que l’exploitation<br />
forestière va amener<br />
Nous allons vendre plus facilement nos 70<br />
produits<br />
Les déplacements seront plus faciles 71<br />
15 Au plan économique<br />
Nous allons produire plus facilement en 72<br />
élevage ou en agriculture<br />
Les acheteurs viendront sur place pour 73<br />
notre gibier<br />
Avec la route les usines peuvent se créer 74<br />
et nos enfants vont trouver du travail<br />
Autres (préciser)<br />
75<br />
-<br />
-<br />
-<br />
L’éducation de nos enfants sera facilitée 76<br />
Nous pourrons résoudre facilement les 77<br />
problèmes de santé<br />
Les conflits seront facilement portés aux 78<br />
autorités<br />
16 Au plan social<br />
La sorcellerie et l’alcoolisme vont 79<br />
baisser<br />
On pourra construire facilement nos 80<br />
maisons<br />
Nous aurons plus de contacts avec les 81<br />
villes<br />
Autres (préciser)<br />
82<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Il y aura des boîtes et des bars non loin 83<br />
du village<br />
17 Au plan culturel Autres (préciser)<br />
84<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les organismes de développement 85<br />
viendront<br />
La forêt sera mieux exploitée 86<br />
18 Au plan On viendra nous former à la protection<br />
environnemental de l’environnement<br />
87<br />
Les contrôleurs des eaux et forêts 88<br />
viendront plus facilement<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 141
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Cochez les 2 effets négatifs que vous pensez être les plus importants et que l’exploitation<br />
forestière va causer (2 effets par rubrique)<br />
Les prix vont grimper 89<br />
Les vendeurs éloignés viendront nous 90<br />
concurrencer<br />
19 Au plan économique<br />
Les produits des pays voisins vont nous 91<br />
envahir<br />
Les prix de nos produits vont baisser 92<br />
On va tuer notre petit commerce local 93<br />
Autres (préciser)<br />
94<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20 Au plan social Les MST et le SIDA vont arriver avec 95<br />
les étrangers<br />
Il y aura les bandits et les voleurs des 96<br />
villes dans les villages<br />
Il y aura les risques d’accidents 97<br />
La délinquance et l’alcoolisme vont 98<br />
augmenter<br />
Les mauvaises habitudes de la ville vont<br />
arriver ici<br />
99<br />
Les bandits de la ville arriveront ici 100<br />
21 Au plan Le braconnage sera intensifié 101<br />
environnemental Les bruits de voiture seront très gênants 102<br />
Les forestiers vont dévaster nos forêts 103<br />
22 Avez-vous des solutions à proposer pour chacun des problèmes relevés pendant la phase de<br />
construction de la route ou après la fin des travaux ?<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 142
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Quels avantages attendez-vous de ce projet pendant la phase de construction ?<br />
23<br />
Au plan économique<br />
24 Au plan social<br />
25 Au plan culturel<br />
26 Au plan<br />
environnemental<br />
Les fils du village auront le travail 104<br />
Les employés du projet vont acheter nos 105<br />
produits<br />
Les engins du projet vont nous aider 106<br />
pour les petits travaux de terrassement<br />
Autres (préciser)<br />
107<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Nous aurons beaucoup d’ambiance au 108<br />
village<br />
Les voitures du projet vont beaucoup 109<br />
nous aider pour le déplacement<br />
Les biens et équipements de l’entreprise 110<br />
vont nous aider en matière d’habitat, de<br />
santé ou d’éducation<br />
Autres (préciser)<br />
111<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Le projet va nous aider à réaliser les 112<br />
terrains de sport<br />
Nous organiserons souvent des tournois 113<br />
avec les employés du projet<br />
Autres (préciser)<br />
114<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Ils vont drainer les marres d’eaux 115<br />
Les eaux d’écoulement seront canalisées 116<br />
Nous allons vendre beaucoup de viande 117<br />
Autres (préciser)<br />
118<br />
-<br />
-<br />
-<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 143
N° Questions Réponses Code Passage<br />
Quels problèmes prévoyez-vous pouvoir rencontrer pendant la phase de construction ?<br />
Les prix des vivres vont grimper au 119<br />
village parce que les employés du projet<br />
ont beaucoup d’argent<br />
Les prix du savon et du pétrole risquent 120<br />
27 Au plan économique de grimper<br />
Ils vont détruire nos champs 121<br />
Aucun 122<br />
Autres<br />
123<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Ils peuvent détruire les tombes de nos 124<br />
parents et nos forêts sacrées<br />
Les employés du projet vont aimer nos 125<br />
femmes et nos filles<br />
28 Au plan social<br />
Les employés du projet risquent 126<br />
d’amener les maladies (MST, SIDA)<br />
L’alcoolisme va augmenter ici au village 127<br />
La présence des employés du projet 128<br />
pourra provoquer des conflits<br />
On va détruire nos maisons 129<br />
Aucun problème 130<br />
Autres (préciser)<br />
131<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Les étrangers vont violer nos interdits 132<br />
Aucun problème 133<br />
29 Au plan culturel Autres (préciser)<br />
-<br />
-<br />
134<br />
30 Au plan<br />
environnemental<br />
On va détruire beaucoup de forêts 134<br />
Les engins feront trop de bruits qui nous 136<br />
dérangent<br />
Nos travaux vont provoquer des 137<br />
inondations et créer des bourbiers<br />
Aucun problème 138<br />
Autres (préciser)<br />
139<br />
-<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 144
17.8 TRAME D’ENQUETE POUR L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL<br />
PREALABLE A LA MISE EN EXPLOITATION DE L’UFA 10015 PAR LA<br />
SOCIETE CIBC<br />
Localité :____________________ Distance localité - ville proche ________km<br />
Localisation par rapport à l’UFA 10015 ________________________________________<br />
Accessibilité : _______________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________<br />
1. Populations ________ Habitants Répartition par sexe : M_______ F_______<br />
Nombre de familles présentes dans le village __________<br />
2. Infrastructures présentes dans le village.<br />
Ecole(s) Centre de santé Lieu(x )de culte Marché Puits<br />
Autres (à préciser)______________________________________________________<br />
Dans le cas où il existerait une école, préciser le nombre d’enseignant(________), l’effectif<br />
des élèves (______) et la répartition par sexes ( Garçons_______ ; Filles_______).<br />
3. Existe –t- dans la localité un (des) point(s) d’eau potable ou de l’électricité ?<br />
Oui<br />
Non<br />
Si oui, quelles sont les sources de financement qui ont aidé à réaliser ces œuvres ?<br />
(Cocher dans la case correspondante)<br />
La communauté villageoise<br />
Une société forestière<br />
La commune rurale de _____________<br />
Autre (à préciser)_________________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________<br />
4. Ethnies majoritaires dans la localité (Numéroter les cases par ordre d’importance).<br />
(a) Pygmées (c) Konabembé (e) Mbimou<br />
(b) Bantou<br />
(d) Essel<br />
Autres ethnies (à préciser)________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
5. Existe –t- il dans le village des conflits inter- ethniques, et autres conflits<br />
sociaux?<br />
Pour quelles raisons ?<br />
_______________________________________________________<br />
6. Existe –t- il des zones litigieuses dans le village ?<br />
1- Oui<br />
2- Non<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 145
Si oui, pour quelle(s) cause(s) et où sont-elles situées? _________________________<br />
___________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________.<br />
7. Existe -t - il dans la localité des activités d’élevage ou de pisciculture?<br />
Si oui, quelles sont les espèces élevées ?<br />
1. Volaille<br />
2. Ovins<br />
3. Caprins<br />
Autre (à préciser)_________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
8. Quelles sont les principales sources de revenus dans le village ? (Numéroter les cases<br />
par ordre d’importance).<br />
La commercialisation des produits de chasse<br />
La commercialisation des produits de pêche<br />
La commercialisation des produits vivriers<br />
La commercialisation des produits cueillette<br />
Les redevances forestières<br />
Autres (à préciser)______________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________<br />
9. Quels sont les problèmes rencontrés dans la scolarisation des jeunes de la localité ?<br />
Manque de structures (salle de classe et équipements y afférents)<br />
L’éducation des enfants ne représente pas une priorité pour les parents<br />
Manque du personnel enseignant<br />
Autres (à préciser )_____________________________________________________<br />
____________________________________________________________<br />
___________<br />
10. Quels sont les principaux problèmes rencontrés par les populations dans leurs besoins<br />
en soins de santé ? (Numéroter les cases par ordre d’importance)<br />
Manque de centre de santé<br />
Les structures existent, mais le personnel soignant manque.<br />
Les structures existent, mais les équipements manquent.<br />
Le centre de santé manque de médicaments nécessaires pour les soins.<br />
Autres (à préciser)_________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
11. Prévalence des maladies dans la localité:<br />
Paludisme<br />
MST/SIDA<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 146
Autres maladies présentes dans la localité_______________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
12. Existe –t – il des structures associatives dans le village ? (Cocher dans la case<br />
correspondante)<br />
Oui<br />
Non<br />
Si oui, pour quelle(s) cause(s)?<br />
Champs communautaires<br />
Comité de développement<br />
Gestion de la forêt communautaire<br />
Valorisation des ressources fauniques (COVAREF)<br />
Autre (à préciser)______________________________________________________<br />
_______________________________________________________________________<br />
13. Existe –t – il dans le village des zones de chasse qui sont sous-traitées aux<br />
pr<strong>of</strong>essionnels de safaris ?<br />
Oui<br />
Non<br />
Si oui, comment sont gérées les ressources provenant de cette activité? _______<br />
_____________________________________________________________________<br />
14. Quelles seraient les attentes ou les sollicitations des populations d’une entreprise ou<br />
société d’exploitation forestière qui exploiterait à proximité du village? (Numéroter<br />
les cases correspondantes par ordre de priorité).<br />
Sur le plan infrastructurel<br />
Construire un puits pour l’approvisionnement en eau des populations<br />
Electrification<br />
Construire une case de santé<br />
Fournir des lits pour le centre de santé<br />
Aider les invalides<br />
Construire et équiper une salle de classe<br />
Payer l’(es) enseignant(s) de l’école<br />
Construire un lieu de culte<br />
Construire une case communautaire<br />
Payer la scolarité des enfants du village<br />
Employer nos enfants dans la société<br />
Acheter les intrants et matériels agricoles<br />
Installer l’unité de transformation dans le village<br />
Aménager la route d’accès dans le village<br />
Autre (à préciser)__________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 147
Sur le plan de la sauvegarde des valeurs socioculturelles<br />
(Numéroter les cases correspondantes par ordre de priorité).<br />
Respecter nos zones de cueillette et de chasse<br />
Respecter les limites d’exploitations<br />
Eviter d’abattre nos espèces médicinales<br />
Respecter nos sites culturels<br />
Autre (à préciser)__________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________<br />
15 – Questions ouvertes<br />
Vos préoccupations<br />
Vos attentes<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 148
17.9 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES<br />
POPULATIONS DES VILLAGES ADJALA, TEMBE.<br />
L’an deux mille deux et le seize du mois de septembre s’est tenue à la chefferie de Adjala dès 14Heures la<br />
réunion de consultation des populations des villages de Adjala, Tembé Rivière dans le cadre de l’étude d’impact<br />
environnemental préalable à la mise en exploitation de l’UFA 10015 attribuée à la société CIBC du groupe<br />
VICWOOD THANRY.<br />
Cette réunion qui s’est déroulée en présence du Sous-préfet de l’arrondissement de Moloundou avait pour but de<br />
mieux s’imprégner, par les échanges avec les populations , des inquiétudes , des attentes des suggestions en<br />
rapport avec la reprise des travaux d’exploitation par la société CIBC de l’UFA n° 10 015 où la première<br />
assiette a déjà été attribuée.<br />
L’ordre du jour de cette séance s’articulait autour des points suivants :<br />
1. Présentation de l’équipe des consultants et des autres participants<br />
2. Présentation de l’objet de la réunion par le chef de mission<br />
3. Echanges avec les populations<br />
Présentation de l’équipe des consultants.<br />
En sa qualité de responsable d’arrondissement, Monsieur EKORO Laurent, Sous-préfet de Moloundou a d’abord<br />
pris la parole pour remercier les populations des différents villages et hameaux qui n’ont ménagé aucun effort<br />
pour honorer de leur présence cette réunion de consultation organisée par le <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant chargé de<br />
l’étude. Ensuite, la parole est revenue au Chef de Section Environnement de la Boumba et Ngoko Monsieur<br />
ZANG Parfait, représentant de la Délégation Départementale de l’Environnement de la Boumba et Ngoko qui a<br />
présenté le cadre d’insertion de cette étude par rapport à la législation en vigueur en matière d’exploitation des<br />
ressources forestières.<br />
Présentation de l’objet de la réunion<br />
Monsieur KPWANG ABESSOLO Environnementaliste de l’équipe, a pris la parole pour<br />
définir le contexte et l’objet de la mission en réitérant qu’il est question de recueillir les points<br />
de vues des populations sur la question de la reprise des activités d’exploitation dans l’UFA<br />
10015 en accédant par le nord.<br />
Les échanges avec les populations<br />
Après échange des civilités des différents intervenants, le porte-parole des villages représentés, Monsieur<br />
SOUKA NANGA a intervenu pour traduire en langue locale la problématique de ladite réunion de consultation.<br />
Cette phase a été suivi par des réactions de la part des populations notamment le chef de canton, Monsieur<br />
NGONGA Jacques qui a bien voulu recevoir des illustrations sur une carte la localisation de la nouvelle<br />
traversée qui est envisagée par la CIBC pour accéder dans l’UFA. Ensuite, le porte-parole a souligné en<br />
traduisant quelques réactions des villageois que quelques doléances avaient été exprimées lors d’une tenue de<br />
réunion de palabre. Mais, quelques participants ayant contribué à la rédaction du procès verbal de cette tenue de<br />
palabre ont mentionné que ce dernier n’avait pas été signé par le représentant du groupe VICWOOD THANRY.<br />
Parmi ces doléances, on peut citer :<br />
1. la construction d’un pont en matériaux définitifs sur la Boumba ;<br />
2. la construction des écoles dans les villages qui en étaient jusqu’à lors dépourvus ;<br />
3. la construction des points d’eau (forages) ;<br />
4. la construction des cases de santé dans les villages ;<br />
5. la construction des cases pour les chefs de villages ;<br />
6. le recrutement de la main d’œuvre locale(permettant la résorption du chômage) ;<br />
7. l’ouverture de la route Moloundou-Ndongo ;<br />
8. le terrassement des aires de jeux pour les jeunes du village ;<br />
9. la fourniture des planches pour l’amélioration de l’habitat ;<br />
10. l’installation du campement d’ouvriers sur l’axe Moloundou-Ndongo.<br />
Réagissant à ces propos Monsieur le sous-préfet a rappelé aux populations qu’il ne faut pas solliciter de la<br />
société (groupe VICWOOD THANRY ) ce qu’elle ne peut jamais faire. Il a par exemple rappelé que les grands<br />
ouvrages comme le pont sur la Boumba relèvent de la compétence de l’état, il a poursuivi son commentaire en<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 149
appelant que les 10% de la redevance forestière versés aux populations ou bien les ressources générées par le<br />
COVAREF peuvent bien servir à initier des actions telles que la construction des puits et forages, des écoles et<br />
centres de santé ainsi que bien d’autres réalisations.<br />
Monsieur KPWANG Abessolo a pris la parole pour expliquer aux participants quelles sont les principales<br />
raisons qui orientent l’accès dans l’UFA par le Nord .<br />
Monsieur Zang Parfait a complété en précisant que la même forêt qui part de Ndongo aboutit à Koumela et que<br />
les calculs des coûts et avantages obligeront la société à commencer à partir de la première assiette de coupe qui<br />
a été attribuée dans la partie Nord.<br />
A l’issue de cet échange particulièrement houleux, de temps en temps interrompu par des invectives et<br />
injonctions des participants , le consensus a semblé se dégager sur la nécessité pour la société de garantir<br />
l’entretien de la route, du bac et des petits ouvrages même pendant la période d’exploitation des assiettes de<br />
coupe situées vers le Nord de l’UFA.<br />
Monsieur le Sous-préfet et les membres de la mission ont tenu à préciser qu’ils ne représentent pas le groupe<br />
VICWOOD THANRY, mais les termes de cet échange seront transmis fidèlement aux autorités du MINEF et<br />
au groupe VICWOOD THANRY qui ont la prérogative d’en donner une suite ou de relancer les débats.<br />
La deuxième phase de l’entretien a porté sur les compléments d’information par rapport aux relations entre les<br />
communautés et l’équipe de la ZIC n° 38 qui est superposée à l’UFA<br />
10015 , les diverses organisations paysannes actives dans les villages représentés, et les éventuelles<br />
conséquences que l’exploitation de l’UFA concernée peut avoir sur le milieu social :<br />
Quant à l’amodiataire de la ZIC 38 ,les populations ont souligné qu’il coopère peu avec les populations et ainsi,<br />
elles n’ont aucune idée de sa démarche dans la forêt, la quelle permettrait d’éviter les interférences entre les<br />
zones de tir dans la ZIC et les aires de cueillette des populations.<br />
Les participants ont également formulé des reproches vis-à vis du Guide de chasse notamment sur le fait qu’il ne<br />
s’arrête pas dans les vilLages et ne collabore pas avec le COVAREF de la zone.<br />
Les associations et organisations paysannes présentes.<br />
Sur le plan associatif, quelques structures existent mais ne sont pas légalisées. Quelques participants ont<br />
mentionné le manque d’esprit associatif dans la localité ainsi que l’inactivité des membres lorsqu’ils adhèrent.<br />
Organisation Président Village<br />
CODEAdjala: Comité de Développement de Adjala TATALA Georges Adjala<br />
CODEGEDA : Comité de Développement et de Gestion KADRY YOUGOUDA Adjala<br />
Durable de Adjala<br />
Association des Jeunes pour l’Avenir<br />
Comité de Développement de Mongobé SOUKA NANGA Mongobé<br />
Les activités culturelles<br />
Les activités des populations dans cette partie sud de l’UFA se résument à l’agriculture,la chasse de subsistance<br />
la cueillette et la pêche.<br />
Pour la préservation de quelques sites et essences présentes dans l’UFA, les populations ont recommandé que les<br />
fils du village soient présents lors des expéditions de prospection ou d’abattage pour signaler les endroits<br />
interdits et les essences à prréserver.<br />
Après le jeu de questions- réponses animé par Mr KPWANG Abessolo , Monsieur le<br />
Sous-préfet a clôturé la consultation à 16H 30, et un pot d’amitié a été <strong>of</strong>fert par les populations.<br />
LE RAPPORTEUR<br />
LE PRESIDENT DE SEANCE<br />
Les Consultants<br />
1. KWANG ABESSOLO, Environnementaliste<br />
2. NGATCHOU Erith, Agro-socio-économiste<br />
Pièces jointes : Listes des participants<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 150
17.10 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DU PUBLIC DES<br />
POPULATIONS BAKA DU CAMPEMENT BOTTOLO (PK 22 sur la piste<br />
KOUMELA-embouchure Boumba et Bek).<br />
L’an deux mille deux et le dix neuf du mois de septembre de consultation des populations Baka du campement<br />
Bottolo dans le cadre de l’étude d’impact environnemental préalable à la mise en exploitation de l’UFA 10015<br />
attribuée à la société s’est tenue à Bottolo (à 6 Km de l’assiette N°1 de l’UFA 10015) à 9 Heures la réunion<br />
CIBC du groupe VICWOOD THANRY.<br />
Ouvrant la séance, Monsieur ZANG Parfait, chef de section départementale de l’environnement de la Boumba<br />
et Ngoko a remercié l’assistance d’avoir accepté d’honorer de leur présence à la réunion de consultation<br />
organisée par le <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant.<br />
Après échange des civilités, Monsieur Kpwang Abessolo a explicité l’objet de la réunion. Il a été question de<br />
présenter de façon détaillée aux populations Baka les différents axes d’un tel projet aux participants à savoir les<br />
informer du futur projet d’exploitation de l’UFA 10015, projet qui verra la réhabilitation de la piste passant<br />
devant le campement de Bottolo afin que celles-ci expriment leurs attentes, leurs inquiétudes ou leurs<br />
suggestions.<br />
Ces différentes interventions ont été suivies par les réactions de certains participants dont le chef de campement<br />
qui a bien voulu rappeler la période de création du campement ainsi que le fondateur (M. Ambassa, décédé) dont<br />
l’épouse Madame MOLEMO, était présente. C’est un campement qui abrite aujourd’hui 60 habitants, installé<br />
depuis plus de vingt ans avant l’exploitation de la SOTREF.<br />
Les principales activités pratiquées ici sont la cacaoculture,, la chasse de subsistance, la pêche, le ramassage et la<br />
cueillette des fruits et ignames sauvages particulièrement au sein de l’UFA 10015, la production du bananier<br />
plantain (ce campement a été pendant longtemps pourvoyeur des villages Koumela et Salapoumbé en Bananier<br />
plantain)<br />
Au sein du campement, deux anciens travailleurs des sociétés forestières ont été recensés dont le chef du<br />
campement comme abatteur et un boussolier. Un tradipraticien identifié explique que ces principaux produits de<br />
traitement(écorces, racines d’arbres) se retrouvent dans l’UFA 10015. C’est ce site qui abrite les expéditions de<br />
saisons sèches pendant lesquelles les activités de pêches se pratiquent dans la rivière Bek, les marécages situés<br />
dans l’UFA<br />
Relativement au projet d’exploitation forestière, quelques inquiétudes ont été exprimées par les populations du<br />
campement dont :<br />
1. le risque de destruction des parcelles cacaoyères et vivrières à proximité de la piste à réhabiliter ;<br />
2. la destruction de leurs cases et éventuellement leur déguerpissement.<br />
Les inquiétudes des participants ont également concerné la protection de certaines essences médicinales<br />
notamment le « ngbwo » en baka et « leko » en bangando, utilisée aussi lors des incantations en forêt. Toutefois,<br />
ces populations soulignent que cette essence n’est pas généralement exploitée par les forestiers.<br />
Par rapport aux doléances formulées, elles concernent :<br />
o le recrutement de quelques fils du campement ;<br />
o la fourniture des planches pour l’amélioration de l’habitat ;<br />
o la fourniture du petit outillage agricole (machettes, limes, houes, tridents….) ;<br />
o le terrassement des aires de construction des cases d’habitation ;<br />
o l’aménagement du point d’eau situé en face du campement.<br />
Au terme de cet échange qui a duré deux heures, l’équipe de consultants a de nouveau remercié l’assistance<br />
d’avoir disposé de leur temps en dépit de leurs multiples préoccupations.<br />
LE RAPPORTEUR<br />
LE PRESIDENT DE SEANCE<br />
Parfait ZANG<br />
Chef section Environnement/DDEF<br />
Les Consultants<br />
KPWANG ABESSOLO, Environnementaliste<br />
NGATCHOU Erith, Agro-socio-économiste<br />
Boumba et Ngoko<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 151
17.11 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION PUBLIC DES<br />
POPULATIONS BAKA DE KOUMELA ET SALAPOUMBÉ<br />
L’an deux mille deux et le quinze du mois de septembre s’est tenue à Salapoumbé dès 11Heures la réunion de<br />
consultation des élites Baka de Koumela et Salapoumbé dans le cadre de l’étude d’impact environnemental<br />
préalable à la mise en exploitation de l’UFA 10015 attribuée à la société CIBC du groupe VICWOOD<br />
THANRY.<br />
Ouvrant les travaux en présence du chef de village de Salapoumbé, Madame Olinga , traductrice et<br />
multiplicatrice GTZ chargée de la sensibilisation des communautés Baka a remercié l’assistance d’avoir accepté<br />
d’honorer de leur présence à la réunion de consultation organisée par le <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant.<br />
Après cette brève introduction, la parole est revenue à Monsieur Kpwang Abessolo qui a explicité l’objet de la<br />
réunion et de la réhabilitation d’une piste d’accès reliant le village Koumela à la Boumba. Il a été question de<br />
présenter de façon détaillée aux populations Baka les différents axes d’un tel projet aux participants à savoir les<br />
informer du futur projet d’exploitation de l’UFA 10015 afin que celles-ci expriment leurs attentes, leurs<br />
inquiétudes ou leurs suggestions.<br />
En sa qualité de chef de section départementale de l’environnement de la Boumba et Ngoko, Monsieur Zang<br />
Parfait a tenu à apporter davantage de lumière sur les impacts qu’un tel projet peut avoir sur l’environnement<br />
notamment celui des pygmées concernés au premier chef.<br />
Ces différentes interventions ont été suivies par les réactions de certains participants les plus éveillés notamment<br />
un ancien ouvrier de la SEBC qui a bien voulu partager son expérience avec l’équipe des consultants.<br />
Cet ancien ouvrier aide conducteur raconte que pendant deux ans, il a été temporaire, avec un salaire mensuel de<br />
18000 francs CFA. La journée de travail commençait à 5 heures du matin et se terminait à 15 heures. Parmi les<br />
participants, il en avait qui étaient des aides-abatteurs, des « boussoliers » (les plus nombreux) et des défricheurs.<br />
Après un bout de temps dit-il, la majorité a démissionné et nous sommes restés quatre seulement. « nous<br />
travaillions sans contrat avec tous les risques et sans aucune assurance. Nous pensons que les conditions des<br />
travailleurs Baka doivent être améliorées ».<br />
Relativement au projet d’exploitation forestière, les participants ont exprimé quelques doléances à savoir :<br />
3. le recrutement des jeunes baka et l’amélioration de leurs conditions de travail ;<br />
4. la fourniture des planches pour l’amélioration de leur habitat ;<br />
5. l’octroi du petit matériel agricole (machette, daba, lime, …).<br />
Les inquiétudes des participants étaient particulièrement axées sur la protection de certaines essences<br />
médicinales et à fruits sauvages (produits de cueillette). Ils argumentent que la Boumba étant jusqu’à lors un<br />
obstacle, l’installation d’un bac permettant sa traversée pourra provoquer une pression et éventuellement la<br />
disparition de certaines ressources dans ce qui est considéré aujourd’hui comme un réservoir.<br />
Sur le plan social, quelques difficultés qui émaillent la vie des Baka ont été relevées dont :<br />
o leur instabilité perpétuelle qui influent négativement sur la scolarisation des enfants.<br />
o La désobéissance des enfants qui ne connaissent pas de brimades<br />
o Les conflits inter-claniques<br />
o Leur marginalisation par les bantous<br />
o Les taches faiblement rémunérées (200 à 300 francs CFA/jour)<br />
o Les faibles prix d’achat de leurs produits de vente ou de cueillette.<br />
Réagissant à toutes ces interventions, les membres de la mission ont chacun pris la parole pour expliquer<br />
l’importance de la scolarisation des enfants Baka qui seront des interlocuteurs valables aptes à défendre leurs<br />
droits. Les consultants ont également sensibilisé sur l’importance d’un mouvement associatif pouvant<br />
développer des initiatives communes et mûrir des réflexions qui contribueront à trouver des solutions aux<br />
problèmes baka.<br />
Après le jeu de questions- réponses animé par Monsieur KPWANG ABESSOLO et Monsieur NGATCHOU,<br />
cette séance de consultation a pris fin à 12 heures 30 avec le mot de remerciement formulé par les participants à<br />
l’endroit des consultants pour le don qui a été <strong>of</strong>fert.<br />
LE RAPPORTEUR<br />
LE PRESIDENT DE SEANCE M.Parfait ZANG<br />
Les Consultants<br />
Chef section Environnement/DDEF Boumba et Ngoko<br />
KPWANG ABESSOLO, Environnementaliste<br />
NGATCHOU Erith, Agro-socio-économiste<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 152
17.12 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES<br />
POPULATIONS DU VILLAGE KOUMELA ET SES ENVIRONS.<br />
L’an deux mille deux et le dix huit du mois de septembre s’est tenue à Koumela de 9 Heures à 12 heures la<br />
réunion de consultation des populations du village Koumela et ses environs dans le cadre de l’étude d’impact<br />
environnemental préalable à la mise en exploitation de l’UFA 10015 attribuée à la société CIBC du groupe<br />
VICWOOD THANRY.<br />
Ouvrant la séance, le chef section de l’environnement de la Boumba et Ngoko Monsieur ZANG Parfait a<br />
remercié l’assistance d’avoir accepter d’honorer de leur présence à la réunion de consultation organisée par le<br />
<strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant.<br />
En sa qualité de rapporteur, il a bien voulu souligner le fait que cette réunion devait être présidée par le chef de<br />
district de Salapoumbé qui pour d’autres raisons indépendantes de sa volonté n’a pas pu honorer. Cette brève<br />
introduction s’est poursuivie par la présentation de l’ordre du jour articulé autour de trois points à savoir :<br />
1. La présentation des différents participants ;<br />
2. La présentation de l’objet de la rencontre<br />
3. Les échanges avec la population<br />
1. La présentation des participants<br />
Cette présentation des participants était individuelle suivie de l’inscription sur une fiche de présence (voir<br />
annexe du document).<br />
2. L’objet de la réunion<br />
Monsieur Kpwang Abessolo, Environnementaliste a explicité l’objet de la réunion en présentant le projet<br />
d’exploitation de l’UFA 10015 par la CIBC, lequel projet verra la réhabilitation de la piste reliant le village<br />
Koumela à l’embouchure (Boumba et Bek), l’installation d’un bac à la traversée de la rivière Boumba qui<br />
permettra d’acheminer le bois vers la scierie de Lokomo et l’installation d’un campement d’ouvriers qui<br />
travailleront sur l’exploitation.<br />
3. Les échanges avec la population<br />
La présentation de l’objet de la réunion a suscité un certain nombre de réactions de la part des participants qui<br />
ont bien voulu exprimer leurs inquiétudes, leurs suggestions et leurs attentes relativement à un tel projet.<br />
La première réaction a été celle de Monsieur Nanga Didier, GFA à Mambélé qui a bien voulu savoir si la<br />
consultation en cours implique que le village Koumela est considéré comme riverain (ce qui suppose des<br />
retombées en redevances forestières),<br />
Pour apporter des éclaircissements à cette question, le chef section de l’environnement s’adressant à l’assistance<br />
a posé la question de savoir si les autorités du village avaient été conviées à la réunion d’information tenue par<br />
le préfet à Moloudou et relative à l’exploitation de cette UFA ? Après un silence observé, il a poursuivi en leur<br />
demandant de bien vouloir se référer auprès des autorités compétentes pour de plus amples informations sur le<br />
partage de ces redevances de l’UFA 10015 qui même si elle est entièrement située dans l’arrondissement de<br />
Moloudou abrite tout de même un certain nombre d’activités des populations de Koumela et ses environs.<br />
La deuxième préoccupation des participants a porté sur le recrutement de la main d’œuvre locale. Brossant un<br />
tableau des entreprises forestières de la zone, l’intervenant a souligné le fait que ces entreprises ont toujours<br />
importé la main d’œuvre pour répondre à leur besoin. Pour ce qui est de l’exploitation de l’UFA 10015, se<br />
référant au nombre de jeunes du village disposant plus ou moins d’une expérience relative à l’exploitation<br />
forestière, il a émis le vœux de voir l’importation de la main d’œuvre se limiter et que un certain nombre de<br />
recrutements soient faits sur place.<br />
Pour rassurer davantage l’assistance, les membres de l’équipe ont tour à tour expliqué aux participants qu’il y a<br />
davantage un souci permanent dans de tels projets d’impliquer les populations locales. Pour illustrer ce propos,<br />
l’exemple a été pris pour le WWF qui sur 26 Garde <strong>Forest</strong>iers d’Appui actuellement en poste dans la Boumba et<br />
Ngoko, 2 sont ressortissants du village Koumela (Voir fiche de présence).<br />
Un certain nombre de doléances préparée à l’avance par les populations ont été exprimées à savoir :<br />
o Le village Koumela doit bénéficier des retombées des redevances forestières relatives à l’exploitation<br />
de l’UFA 10015 ;<br />
o Le terrassement des sites de construction pour les nécessiteux et le nettoyage (au grader) de la bande de<br />
forêt en arrière des cases d’habitation, autour des écoles, églises et de la chefferie afin d’assurer un<br />
certain éclaircissement dans le village Koumela et ses hameaux (de Tigadji à la rivière Lopondji).<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 153
o La mise à disposition des populations des déchets de bois pouvant être utilisés pour l’amélioration de<br />
l’habitat ; un comité du village sera mis en place pour contrôler l’utilisation effective de ce bois.<br />
Comme condition préalable à l’acquisition de ce bois, chaque nécessiteux devra présenter trois à quatre<br />
sachets de pointes qui serviront dans la construction de la case.<br />
o Le recrutement des jeunes du village afin de résorber le chômage ;<br />
o La construction d’une case de santé pour le village ;<br />
o L’achat d’un équipement sportif pour l’équipe de football du village<br />
o<br />
La construction du campement des ouvriers au cœur du village précisément sur l’ancien site des<br />
missionnaires situé à 200m du village, ce qui permettra d’écouler facilement les produits sans<br />
parcourir de longues distances.<br />
o L’organisation d’une fête solennelle au moment de l’installation du campement dans le village afin<br />
lancer un climat de parfaite collaboration.<br />
Relativement à cette liste de doléances, les membres de l’équipe en compagnie du Chef section environnement<br />
ont tenu à rappeler à l’assistance que toute sollicitation en marge des redevances forestières normalement versées<br />
par l’entreprise aux communes (lesquelles redevances peuvent permettre de réaliser d’importants projets<br />
communautaires) peut trouver des solutions favorables s’il existe une parfaite collaboration entre l’entreprise et<br />
les villageois.<br />
D’autres préoccupations des participants ont été axées sur la protection de la faune et la peur de voir leur zone<br />
d’usage (notamment la cueillette) détruites. Au sujet de la faune, les populations ont souligné que la<br />
réhabilitation de la piste favorisera l’accès facile des braconniers qui parfois sont aidés par les employés de la<br />
société. Les mesures proposées par les populations pour limiter atténuer tout impact sur la faune<br />
visent l’installation des barrières de contrôle à l’entrée de la piste (à partir de l’axe principal) et au niveau du bac<br />
de traversée sur la Boumba afin de maîtriser le mouvement des braconniers potentiels dans leur ZICGC (zone<br />
d’intérêt cynégétique à gestion communautaire N°8 du COVAREF 1). Ces barrières devront être contrôlées si<br />
non co-contrôlées avec quelques membres du comité de vigilance recrutés sur place.<br />
Quant à la préservation des zones de cueillette, l’exploitation devra éviter la destruction des zones riches en<br />
essences à fruits comestibles ou des espèces médicinales.<br />
Pour clôturer, les populations ont émis le vœux de voir que les doléances formulées puissent être consignées<br />
dans un protocole d’accord et que les mesures à prendre tiennent compte des Baka qui disposent des zones de<br />
cueillette et des sites culturelles à la traversée de la Boumba. Au sujet du protocole d’accord, l’équipe de<br />
consultation a bien voulu souligner que l’établissement d’un tel document peut se faire entre l’entreprise et les<br />
populations si cela s’avère nécessaire.<br />
Pour ce qui est de la structuration interne du village, quelles structures associatives identifiées se présentent<br />
comme suit :<br />
Organisation<br />
Association des Jeunes Actifs de Koumela (AJAK)<br />
Association des Femmes Actives de Koumela (AFAK)<br />
Président<br />
DJANEGO Charles<br />
Après le jeu de questions- réponses animé par l’équipe de consultants, le président de séance a remercié les<br />
participants pour leur disponibilité et leur esprit de coopération.<br />
LE RAPPORTEUR<br />
Les Consultants<br />
LE PRESIDENT DE SEANCE<br />
Parfait ZANG<br />
CSE/ Boumba et Ngoko<br />
KWANG ABESSOLO, Environnementaliste<br />
NGATCHOU Erith, Agro-socio-économiste<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 154
17.13 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE CONSULTATION DES<br />
POPULATIONS DES VILLAGES NDONGO, LEKE, MINDOUROU .<br />
L'an deux mille deux et le seize du mois de septembre s'est tenue à la chefferie de Ndongo dès 11 Heures la<br />
réunion de consultation des populations des villages de Ndongo, Leke et Mindourou dans le cadre de l'étude<br />
d'impact environnemental préalable à la mise en exploitation de l'UFA 10015 attribuée à la société CIBC du<br />
groupe VICWOOD THANRY<br />
Cette réunion qui s'est déroulée en présence du Sous-préfet de l'arrondissement de Moloundou avait pour but de<br />
mieux s'imprégner, par les échanges avec les populations, des inquiétudes, des attentes des suggestions en<br />
rapport avec la reprise des travaux d'exploitation par la société CIBC de l'UFA n° 10 015 où la première assiette<br />
a déjà été attribuée. L'ordre du jour de cette séance s'articulait autour des points suivants .<br />
1. Présentation de l'équipe des consultants et des autres participants<br />
2. Présentation de l'objet de la réunion par le chef de mission<br />
3. Echanges avec les populations<br />
1. Présentation de l’équipe des consultants.<br />
En sa qualité de responsable d'arrondissement. Monsieur EK.ORO Laurent, Sous-préfet de Moloundou a d'abord<br />
pris la parole pour remercier les populations des différents villages et hameaux qui n'ont ménagé aucun effort<br />
pour honorer de leur présence cette réunion de consultation organisée par le <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant chargé de<br />
l'étude. Après présentation des civilités, la parole est revenue au Chef de Section Environnement Monsieur<br />
ZANG Parfait, représentant de la Délégation Départementale de l'Environnement de la Boumba et Ngoko qui a<br />
présenté le cadre d'insertion de cette étude par rapport à la législation en vigueur en matière d'exploitation des<br />
ressources forestières.<br />
2. Présentation de l’objet de la réunion<br />
Monsieur KPWANG ABESSOLO, Environnementaliste de l'équipe, a pris la parole pour définir le contexte et<br />
l'objet de la mission en réitérant qu'il est question de recueillir les points de vues des populations sur la question<br />
de la reprise des activités d'exploitation dans l'UFA 10015 en accédant par le nord.<br />
3. Les échanges avec les populations<br />
Après échange des civilités des différents intervenants, le porte-parole des villages représentés Monsieur<br />
Massouom Jean a intervenu en rappelant que la société SEBC du groupe VICWOOD THANRY avait d'abord<br />
commencé l'exploitation de cette UFA par le coté Sud. Avant le début de cette exploitation a-t-il rappelé, il a été<br />
organisé avec les populations de l'axe Moloundou- Ndongo, une tenue de palabre avec le responsable<br />
administratif et financier du groupe VICWOOD THANRY. Après cette brève évocation, une liste de doléances<br />
exprimées à l'époque par les populations a été présentée à savoir :<br />
1. la construction d'un pont en matériaux définitifs sur la Boumba ;<br />
2. la construction des écoles dans les villages qui en étaient jusqu'à lors dépourvus ;<br />
3. la construction des points d'eau (forages) ;<br />
4. la construction des cases de santé dans les villages ;<br />
5. la construction des cases pour les chefs de villages ,<br />
6. le recrutement de la main d'œuvre locale(pennettanl la résorption du chômage) ;<br />
7. l'ouverture de la route Moloundou-Ndongo ;<br />
8 le terrassement des aires dejeu pour les jeunes du village ;<br />
9. la fourniture des planches pour l’amélioration de l'habitat<br />
10. l'installation du campement d'ouvriers sur l'axe Moloirndou-Ndongo<br />
Le porte-parole a ensuite souligné que de toutes ces doléances qui ont été exprimées par les populations, seule<br />
l'ouverture de l'axe Moloundou-Ndongo a été prise en compte par l’entreprise II a aussi exprimé ta grande<br />
inquiétude qu'ont les populations d'apprendre qu'on va couper le bois derrière leurs cases en passant par Yenga<br />
ou Koumela.<br />
Réagissant à ces propos, Monsieur le sous-préfet a rappelé aux populations qu'il ne faut pas solliciter de la<br />
société (groupe VICWOOD THANRY ) ce qu'elle ne peut jamais faire. Il a par exemple rappelé que les grands<br />
ouvrages comme le pont sur la Boumba relèvent de la compétence de l'état, il a poursuivi son commentaire en<br />
rappelant que les 10% de la redevance forestière versés aux populations ou bien les ressources générées par le<br />
COVAREF peuvent bien servir à initier des actions telles que la construction des puits et forages, des écoles et<br />
centres de santé ainsi que bien d'autres réalisations<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 155
Monsieur KPWANG Abessolo a pris la parole pour expliquer le comment et le pourquoi il faut une entrée dans<br />
l'UFA par le Nord .<br />
Monsieur Zang Parfait a complété en précisant que la même forêt qui part de Ndongo aboutit à Koumela et que<br />
les calculs des coûts et avantages obligeront la société à commencer à partir de la première assiette de coupe qui<br />
a été attribuée dans la partie Nord.<br />
Une discussion s'en est suivie avec l'intervention du président du COVAREF, du chef du village de Leke , des<br />
jeunes du village et de tous les membres de la mission, A l'issue de ce débat, le consensus a semblé se dégager<br />
sur la nécessité pour la société de garantir l'entretien de la route, du bac et des petits ouvrages même pendant la<br />
période d'exploitation des assiettes de coupe situées vers le Nord de FUFA. Que les fils du village soient recrutés<br />
prioritairement quand la société viendra travailler dans la région, et qu'on n'observe plus la situation où on a vu<br />
un seul ressortissant des villages de Ndongo, Mindourou et Leke être recruté sur la centaine d'ouvriers que<br />
comptait la société dans la région.<br />
Monsieur le Sous-préfet et les membres de la mission ont tenu à préciser qu'ils ne représentent pas le groupe<br />
VICWOOD THANRY, mais les termes de cet échange seront transmis fidèlement aux autorités du MINEF et au<br />
groupe VICWOOD THANRY qui ont la prérogative d'en donner une suite ou de relancer les débats.<br />
La deuxième phase de l'entretien a porté sur les compléments d'information par rapport aux relations entre les<br />
communautés et l'équipe de la ZIC n° 38 qui est superposée à l’UFA10015, les diverses organisations paysannes<br />
actives dans les villages représentés, et les éventuelles conséquences que l'exploitation de l’UFA concernée peut<br />
avoir sur le milieu social :<br />
Par rapport au Guide de chasse Amodiataire de la ZIC 38, les populations ont relevé qu’il ne semble pas tenir<br />
compte des doléances des populations qui lui ont été exprimées à savoir :<br />
- de recruter les jeunes de la localité ;<br />
- d'informer les populations après chaque batîue pour qu'elles puissent bénéficier de la chair ;<br />
- informer les populations pendant les entrées en forêts<br />
Les participants ont aussi formulé des reproches vis-à vis du Guide de chasse notamment sur le fait qu'il ne<br />
s’arrête pas dans les villages et ne collabore pas avec le COVAREF de la zone.<br />
Les associations et organisations paysannes présentes.<br />
Le tableau ci-dessous présente quelques associations et comités qui ont été identifiés lors de la réunion mais ces<br />
structures demeurent non légalisées.<br />
Organisation Président Village<br />
CODECNDO: Comité de Développement et de Conserva Lion de Ndoumbé David Ndongo<br />
Ndongo<br />
CODE1L. Comité de Développement Intégré de Leke1 Mediba Romain Leke<br />
CODEGEM. Comité de Développement et de Gestion de<br />
l'Environnement de Mindourou<br />
Groupe d'Initiative Commune de vente de cacao<br />
Ekamba Marcel<br />
Ngbwabio Flubert<br />
Mindourou<br />
Les activités culturelles<br />
Les activités des populations dans cette partie sud de l'UFA se résument à l’agriculture, la chasse de subsistance<br />
la cueillette et la pêche. Le braconnage selon les participants est perpétré par des congolais qui traversent la<br />
frontière pour chasser les éléphants et d'autres grands mammifères,<br />
Dans l'UFA particulièrement du côté Ouest et le long du fleuve Dja, les doyens ont signalé que les ingrédients<br />
utiilisés pour la danse des grelots, le site du rite nguii (où se trouveraient une femme et un homme nus laissés par<br />
tes ancêtres) se trouvent dans cette forêt. Les produits utilisés pour le dio , et le Kene Kene , stimulant sexuel très<br />
recherché se prépare à base d’un arbre présent dans cette forêt.<br />
Pour la préservation de ces sites et essences les populations ont recommandé que les fils du village soient<br />
présents lors des expéditions de prospection ou d'abattage pour signaler ces endroits.<br />
Après le jeu de questions- réponses animé par Mr KPWANG Abessolo , Monsieur le Sous-préfet a clôturé la<br />
consultation à 13H 30 et un pot d’amitié a été <strong>of</strong>fert par les populations.<br />
LE RAPPORTEUR<br />
LE PRESIDENT DE SEANCE<br />
Les Consultants<br />
KPWANG ABESSOLO, Environnementaliste.<br />
NGATCHOU Erith, Agrosocio-économiste.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 156
Pr<strong>of</strong>il du responsable du volet socio-économique basé à Lokomo<br />
* Pr<strong>of</strong>il et qualifications<br />
- un spécialiste du développement socio-économique ayant une bonne<br />
connaissance de l’exploitation forestière et des questions de gestion de<br />
l’environnement,<br />
- niveau Ingénieur Agronome avec de préférence une spécialisation sur les<br />
questions d’environnement,<br />
- expérience du travail avec les communautés de base de la zone forestière<br />
pendant au moins 5 ans.<br />
* Lieu de travail<br />
Région de Lokomo – Moloundou – Ndongo avec résidence à Lokomo SEBC.<br />
* Tâches et responsabilités au sein de l’entreprise<br />
Rattaché à la cellule aménagement du groupe VICWOOD THANRY, il aura pour tâches de :<br />
- conseiller le chef de site en matière d’environnement et relations publiques,<br />
- gérer les relations entre l’entreprise (le groupe) et les communautés riveraines<br />
en rapport avec la protection de leurs droits dans le cadre de l’exploitation des<br />
UFA 10015, 10011 et 10007,<br />
- Organiser et suivre la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts<br />
environnementaux, telles que recommandées par l’EIE,<br />
- Etre l’interlocuteur du MINEF et de l’UTO Sud-Est au sein de l’entreprise en<br />
matière de suivi et d’exécution du plan de gestion de l’environnement,<br />
- Participer localement aux travaux de préparation des plans d’aménagement des<br />
UFA.<br />
* Collaborateurs<br />
Le responsable environnement peut négocier et conclure des ententes avec les ONG locales,<br />
régionales ou nationales, les associations et organisations compétentes, les consultants<br />
éventuels, pour la mise en œuvre de certaines mesures d’atténuation édictés par l’EIE.<br />
* Budget<br />
Il aura pour ce faire à gérer le budget alloué annuellement pour chaque rubrique par le Groupe<br />
VICWOOD THANRY (CIBC, SEBC, SAB) pour régler dans la zones les problèmes relevant<br />
de son ressort. Son budget sera soumis à l’approbation de la direction générale et les dépenses<br />
seront contrôlées par la cellule aménagement en collaboration avec le chef de site de Lokomo.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 157
17.14 Carte des ZIC de l’UTO Sud Est<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 158
17.15 PROCES VERBAL DE LA REUNION DE RESTITUTION DES ETUDES<br />
D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES UFA 10 015, 10 011 et 10 007.<br />
L’an deux mil deux et le douze du mois de Décembre s’est tenue à 12H 30 à l’école pilote de Salapoumbé la<br />
réunion de restitution des études d’impact environnemental des UFA 10 015, 10 011 et 10 007. L’ordre du jour<br />
de la réunion portait sur cinq points à savoir :<br />
1. Mot introductif du Délégué Départemental de l’Environnement et Foret<br />
2. Mot d’ouverture du Sous-préfet de l’arrondissement de Moloundou<br />
3. Mot du représentant du Groupe Thanry<br />
4. Présentation des résultats par le représentant du <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant<br />
5. Echanges<br />
Divers<br />
Introduisant la réunion en sa qualité de modérateur, le Chef section environnement représentant le Délégué<br />
Départemental de l’Environnement et des Forêts de la Boumba et Ngoko/Conservateur de l’UTO-Sud Est a tenu<br />
à remercier les participants qui n’ont ménagé aucun effort pour honorer de leur présence cette réunion de<br />
présentation des résultats des études d’impact des UFA sus citées.<br />
Ensuite, le Sous préfet de Moloundou en tant que président de séance a bien voulu inscrire cette réunion dans le<br />
cadre d’un exercice d’échange participatif, édifiant et constructif qui devra permettre de mettre les jalons d’une<br />
collaboration franche entre les différentes parties.<br />
Intervenant comme représentant du Groupe Thanry, Monsieur Jean Pierre FINES, Aménagiste, a rappelé l’objet<br />
de l’étude à savoir identifier et analyser les éventuels impacts, positifs ou négatifs environnementaux,<br />
économiques et sociaux de l’activité forestière et par la même occasion formuler des mesures d’atténuation ou de<br />
correction des impacts négatifs. Il s’est appesanti sur le fait que le Groupe Thanry s’est résolument engagé dans<br />
un processus d’aménagement durable de ses UFA tel qu’exigé par la législation forestière camerounaise. C’est<br />
dans cette optique que l’orateur a circonscrit le contexte de l’aménagement durable qui signifie non seulement<br />
que l’on exploite la forêt de telle sorte que sa capacité de production soit constante dans le temps, c’est à dire que<br />
le volume de bois extrait de la forêt aujourd’hui se sera régénéré naturellement au bout de la période de rotation<br />
ou mise au repos de la parcelle annuellement exploitée mais aussi que l’on tienne compte des besoins des<br />
populations locales et qu’elles soient pleinement impliquées dans le processus d’aménagement des forêts.<br />
Après l’exposé des principaux résultats des études par le représentant du <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant, le modérateur<br />
de la séance a ouvert le débat aux différents participants notamment les Délégués villageois, les autorités<br />
électives, traditionnelles et administratives.<br />
Les principales réactions enregistrées dans un premier temps ont concerné les mesures compensatoires proposées<br />
pour l’axe Moloundou-Ndongo et pour lequel les populations voulaient savoir concrètement comment le Groupe<br />
Thanry pense résoudre le problème. Réagissant à cette question, Monsieur Francis JOANES a répondu qu’une<br />
mission de prospection sera programmée pour identifier les principaux points critiques de l’axe afin de déployer<br />
le matériel nécessaire pour les travaux de repr<strong>of</strong>ilage.<br />
D’autres interventions ont été orientées sur l’effectivité de l’utilisation de la main d’œuvre locale dans les<br />
travaux d’exploitation, car d’après les constats, la main d’œuvre utilisée par l’entreprise est essentiellement<br />
allochtone. Pour répondre à cette question, il a été clarifié que les recrutements devront se faire sur la base des<br />
besoins de l’entreprise. Toutefois, compte tenu de la qualification requise dans certains postes notamment les<br />
postes spécialisés, les locaux pourront être utilisés comme aides et appentis des employés allochtones qualifiés.<br />
Des remarques de la part des participants ont été faites sur la nécessité d’identifier les projets pouvant aider à<br />
l’amélioration des conditions de vie et des revenus des populations telles que proposées par l’étude.<br />
Relativement à la proposition de recrutement d’un cadre chargé d’assurer l’interface entre l’entreprise et les<br />
populations, ces dernières ont noté qu’effectivement il y a une perspective d’amélioration du partenariat entre<br />
elles et l’exploitant.<br />
Certaines préoccupations saillantes des populations étaient également axées sur le fait que jusqu’à lors, il n’y a<br />
pas de transparence dans la gestion des redevances forestières. Ceci justifie d’ailleurs le fait que les doléances<br />
relatives à la réalisation des infrastructures socio-économiques (écoles, centres de santé, électrification, …)<br />
continuent d’être exprimées auprès des responsables de l’entreprise.<br />
Relativement à cette question, les autorités administratives (Sous-préfet de Moloundou et Chef de District de<br />
Salapoumbé) ont intervenu tour à tour pour relever que ces doléances doivent normalement être réalisées avec<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 159
les fonds générés par les taxes régulièrement payées par l’exploitant. Ils ont toutefois noté qu’ils ont pris<br />
conscience de la situation et ont rassuré les populations du suivi rigoureux de la gestion rationnelle et effective<br />
de ces fonds. Le modérateur a poursuivi en ajoutant que la réalisation de certaines doléances peut être négociée<br />
dans le cadre d’une parfaite collaboration entre l’industriel et les populations.<br />
Après le jeu de questions réponses à l’issu duquel les principales préoccupations des populations ont connu des<br />
éclaircissements, le président de séance a une fois de plus remercié les différents participants notamment pour<br />
l’atmosphère détendue des échanges et a déclaré close la séance de restitution des études d’impact<br />
environnemental des UFA 10 015, 10 011 et 10 007.<br />
Pièces jointes :<br />
1. Discours du Sous préfet de Moloundou<br />
2. Mot du représentant du Groupe Thanry<br />
3. Liste des participants<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 160
17.16 Discours du sous préfet de Moloundou<br />
Discours d’ouverture prononcé par le Sous préfet de Moloundou<br />
Monsieur le Chef de district de Salapoumbé,<br />
Messieurs les Maires des communes de Moloundou et Salapoumbé,<br />
Monsieur le DDEF/Conservateur de l’UTO-SE,<br />
Monsieur les Délégués villageois,<br />
Responsables du Groupe Thanry,<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
J’ai le réel plaisir de présider ce jour, la réunion de restitution des résultats des études d’impact environnemental<br />
sur les UFA 10 015, 10 011 et 10 007 attribuées respectivement à la CIBC, la SAB et la SEBC.<br />
Je tiens à vous remercier d’avoir honorer de votre présence à cette séance de travail en dépit de vos multiples<br />
sollicitations.<br />
Messieurs les Maires des communes de Moloundou et Salapoumbé,<br />
Monsieur les Délégués villageois,<br />
Le gouvernement camerounais soucieux de la gestion durable de nos forêts, de l’amélioration des conditions de<br />
vies des populations, situe les populations au cœur du processus participatif d’aménagement de leur<br />
environnement.<br />
Ces efforts ne peuvent être palpables que par la volonté des différents partenaires à savoir les entreprises et les<br />
populations que vous êtes.<br />
Je saisis cette occasion pour féliciter le Groupe Thanry pour les efforts consentis tant sur le plan matériel,<br />
financier et humain pour l’accomplissement de ce processus.<br />
Mesdames, Messieurs,<br />
Cette rencontre devra permettre d’aborder en pr<strong>of</strong>ondeur en excluant toute forme de passion dans le seul souci de<br />
proposer des solutions pertinentes à l’amélioration des résultats qui seront présentés dans quelques instants.<br />
Il ne sert à rien, de se concerter, si la réflexion ne doit pas aboutir à des actions concrètes. Si nous voulons<br />
envisager l’avenir avec optimisme, nous devons dès à présent, suggérer des pistes d’action pour le futur. Je vous<br />
invite, dans le cadre de cet échange à travailler dans le calme et la sérénité.<br />
Les populations de l’arrondissement de Moloundou sont à votre écoute. Elles nous regardent et attendent des<br />
résultats édifiants et constructifs des échanges de ce jour.<br />
Vous avez la volonté, les moyens et les capacités pour produire les résultats attendus de cette réunion de<br />
restitution, pour le bien être de nos populations et le développement de notre arrondissement.<br />
C’est sur cette note d’espoir, que je déclare ouvert les travaux de cette réunion de présentation des résultats<br />
préliminaires des études d’impact environnemental des UFA sus-citées.<br />
Vive l’arrondissement de Moloundou,<br />
Vive le Cameroun,<br />
Je vous remercie.<br />
17.17 Ordre du jour de la réunion de restitution des études d’impact environnemental<br />
des UFA 10 015, 10 011 et 10 007.<br />
1. Mot introductif du Délégué Départemental de l’Environnement et Foret<br />
2. Mot d’ouverture du Sous-préfet de l’arrondissement de Moloundou<br />
3. Mot du représentant du groupe Thanry<br />
4. Présentation des résultats par le représentant du <strong>Cabinet</strong> <strong>JMN</strong> Consultant<br />
5. Echanges<br />
6. Divers<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 161
17.18 Mot du représentant du groupe Thanry<br />
M le sous préfet de Moloundou<br />
M le Chef de District de Salapoumbé<br />
Ms les maires de Moloundou et Salapoumbé<br />
M le DD Environnement et des Forêts/Conservateur de l’UTO SE<br />
Ms les représentants villageois<br />
Mesdames et Messieurs,<br />
La CIBC, la SAB et la SEBC respectivement attributaires des UFA 10015, 10-011 et 10-007 qui font partie du<br />
groupe Thanry vous souhaitent la bienvenu à cette réunion.<br />
Le groupe Thanry s’est résolument engagé dans un processus d’aménagement durable de ses UFA tel qu’exigé<br />
par la législation forestière camerounaise. L’aménagement durable signifie non seulement que l’on exploite la<br />
forêt de telle sorte que sa capacité de production soit constante dans le temps, c’est à dire que le volume de bois<br />
extrait de la forêt aujourd’hui se se sera régénéré naturellement au bout de la période de rotation ou mise au<br />
repos de la parcelle annuellement exploitée mais aussi que l’on tienne compte des besoins des populations<br />
locales et qu’elles soient pleinement impliquées dans le processus d’aménagement des forêts.<br />
Pour bien réussir, l’aménagement des forêts doit se faire en partenariat, les trois principaux partenaires étant :<br />
l’exploitant forestier, l’état camerounais par l’entremise principalement du MINEF et aussi les populations<br />
locales qui vivent à proximité des UFA.<br />
Les UFA 10015 et 10 011 ont la particularité d’être situées à proximité d’aires protégées soit les parcs nationaux<br />
Bouba Bek et Lobéké. La législation actuelle demande qu’une étude d’impact environnemental soit réalisée<br />
préalablement à la mise en exploitation de telles UFA. L’étude d’impact doit identifier et analyser les éventuels<br />
impacts, positifs ou négatifs environnementaux, économiques et sociaux de l’activité forestière et par la même<br />
occasion formuler des mesures d’atténuation ou de correction des impacts négatifs. Le groupe Thanry a retenu<br />
pour la réalisation de ces études le consultant <strong>JMN</strong> basé à Yaoundé possédant une forte expérience dans ce<br />
domaine. Après être venu dans la zone pour voir de visu la situation et surtout consulté les principaux<br />
intervenants concernés, les principaux résultats de ces études vous sont présentés aujourd’hui.<br />
La mise en exécution des mesures d’atténuation se fera a travers des plans d’actions annuels et seront reprises<br />
dans les plans d’aménagement requis pour chacune des UFA.<br />
Nous vous remercions sincèrement d’avoir bien voulu vous déplacer afin d’assister à cette réunion et nous<br />
comptons sur votre pleine participation pour en arriver à valider d’une manière consensuelle ces études<br />
d’impacts sur l’environnement.<br />
Je vous remercie.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 162
17.19 Listes des participants à la réunion de restitution avec les populations locales et<br />
représentants des administrations à Salapoumbé.<br />
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 163
<strong>JMN</strong> Consultant Etude d’impact environnemental de l’UFA 10015 - CIBC 164