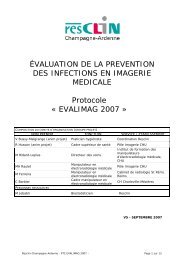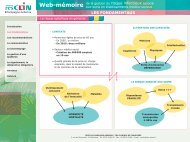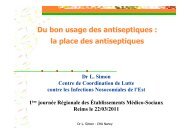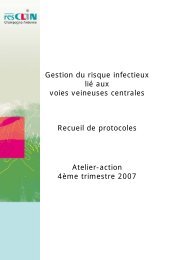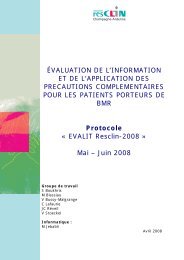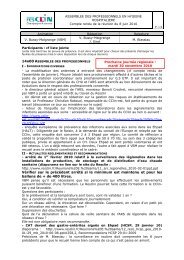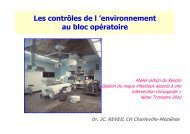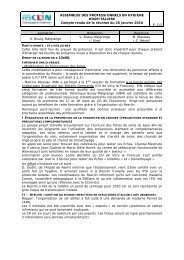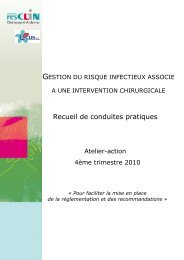Gestion du risque infectieux lié aux voies veineuses centrales ...
Gestion du risque infectieux lié aux voies veineuses centrales ...
Gestion du risque infectieux lié aux voies veineuses centrales ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong><br />
<strong>lié</strong> <strong>aux</strong><br />
<strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Recueil de protocoles<br />
Atelier-action<br />
4ème trimestre 2007
SOMMAIRE<br />
Page<br />
Contributeurs 3<br />
Relecteurs 3<br />
Intro<strong>du</strong>ction 4<br />
Objectif 4<br />
Références utiles accessibles sur l’Internet ® 4<br />
<strong>Gestion</strong> d’une voie veineuse centrale : processus<br />
PCS<br />
Logigramme décisionnel <strong>du</strong> choix <strong>du</strong> type de voie veineuse centrale<br />
PTC I<br />
Pose d’un cathéter central externalisé ou d’une chambre à cathéter<br />
implantable : phase pré-interventionnelle<br />
PTC II<br />
Pose d’un cathéter central externalisé ou d’une chambre à cathéter<br />
implantable : phase post-interventionnelle immédiate<br />
PTC III<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable : surveillance, manipulation,<br />
utilisation<br />
PTC IV<br />
Manipulation ou changement des tubulures : recommandations<br />
PTC V<br />
Prélèvements sanguins sur une voie veineuse centrale<br />
PTC VI<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable : ablation de l’aiguille<br />
PTC VII<br />
LISTE DES ABREVIATIONS<br />
AES : accident d’exposition au sang<br />
CCI : chambre à cathéter implantable<br />
DASRI : déchets d’activités de soins à <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong><br />
Giga/l = 1000/mm 3<br />
PCS : processus<br />
PTC : protocole<br />
SHA : solution hydroalcoolique<br />
TCA : temps de céphaline activée<br />
TQ : temps de Quick<br />
VVC : voie veineuse centrale<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007 Page 2
CONTRIBUTEURS<br />
NOM PRENOM FONCTION ETABLISSEMENT/VILLE<br />
Brandt Marie Thérèse Cadre de santé - Clud CHU - Reims<br />
Bussy-Malgrange<br />
Véronique<br />
Praticien en hygiène coordinateur Resclin - Reims<br />
Demarly Corinne<br />
Infirmière en hygiène et<br />
oncologie médicale a<strong>du</strong>ltes<br />
Institut J. Godinot – Reims<br />
Devie Isabelle<br />
Praticien responsable<br />
Qualité Hygiène <strong>Gestion</strong> des <strong>risque</strong>s<br />
Institut J.-Godinot -Reims<br />
Curé Hervé Oncologue, Directeur Institut J.-Godinot - Reims<br />
Dubois Pierre-Yves Anesthésiste-réanimateur Institut J.-Godinot - Reims<br />
Ferry Régine Onco-hématologue a<strong>du</strong>ltes CH – Charleville Mézières<br />
Guyot Eliane<br />
Anesthésiste-réanimateur<br />
Chirurgie pédiatrique<br />
CHU – Reims<br />
Khaznadji Sylvette Cadre de santé Hématologie a<strong>du</strong>ltes CHU – Reims<br />
Labrousse Marc Chirurgien ORL CHU - Reims<br />
Lefort Lydie<br />
Cadre de santé<br />
Onco-hématologie pédiatrique<br />
CHU – Reims<br />
Libbrecht Eric Infectiologue CH – Troyes<br />
Mérol Jean Claude Chirurgien ORL CHU - Reims<br />
Poiret Marielle Infirmière en réanimation CH - Charleville<br />
Quinquenel M. Claude Pneumologue CH –Châlons en Champagne<br />
Raclot Isabelle Cadre de santé en hygiène CClin-Est – Nancy<br />
Réveil Jean-Claude<br />
Médecin en hygiène Responsable<br />
Qualité Hygiène <strong>Gestion</strong> des <strong>risque</strong>s<br />
CH – Charleville-Mézières<br />
Simonnet Christelle<br />
Infirmière<br />
Onco-hématologie pédiatrique<br />
CHU – Reims<br />
Wynckel Alain Néphrologue CHU - Reims<br />
RELECTEURS<br />
Membres <strong>du</strong> comité de réflexion <strong>du</strong> Resclin<br />
Carlier Monique DRDass Châlons en Champagne<br />
Ciobanu Eugen Clinique François 1 er Saint-Dizier<br />
Eloy Clarence CH Troyes<br />
Gerde<strong>aux</strong> Michèle Clinique Saint-André Reims<br />
Professionnels de l’antenne régionale Resclin-Champagne-Ardenne<br />
Blassiau<br />
Martine<br />
Bussy-Malgrange Véronique<br />
Réveil<br />
Jean Claude<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007 Page 3
INTRODUCTION<br />
Le cathétérisme veineux central est une technique essentielle dans la con<strong>du</strong>ite des<br />
traitements de longue <strong>du</strong>rée, répétitifs, ou utilisant des molécules agressives pour le<br />
réseau veineux. La réanimation, l’urgence, la <strong>du</strong>rée atten<strong>du</strong>e <strong>du</strong> cathétérisme et l’état <strong>du</strong><br />
réseau veineux périphérique <strong>du</strong> patient interviennent dans la décision de poser ou non<br />
une voie veineuse centrale (VVC).<br />
Les cathéters veineux centr<strong>aux</strong> peuvent être externalisés (cathéter long) ou implantés<br />
(chambre à cathéter implantable). Le choix <strong>du</strong> type de voie veineuse centrale et <strong>du</strong> site<br />
d'insertion dépend des indications, des contre-indications relatives et <strong>du</strong> <strong>risque</strong> de<br />
complications. Certains facteurs <strong>lié</strong>s au patient peuvent faire suspecter une insertion<br />
difficile. La <strong>du</strong>rée d’utilisation, le type de substance à administrer, l’âge <strong>du</strong> patient, la<br />
qualité de vie atten<strong>du</strong>e ou les besoins <strong>du</strong> patient interviennent également.<br />
Les complications infectieuses sont les plus fréquentes et représentent un problème<br />
médical significatif pouvant con<strong>du</strong>ire à l’ablation <strong>du</strong> matériel en place.<br />
La densité d’incidence des bactériémies nosocomiales (BN) à porte d’entrée VVC est de<br />
0,054/1000 journées d’hospitalisation (BN-CClin Est 2006). Les micro-organismes les<br />
plus fréquemment en cause dans les BN à porte d’entrée VVC appartiennent au genre<br />
Staphylocccus. La porte d’entrée VVC représente 17,6% des BN à S. aureus et 49,6%<br />
des BN à S. à coagulase négative. L’origine cutanée probable de ces microorganismes<br />
conforte la notion que certaines de ces BN sont accessibles à la prévention et sont, pour<br />
une certaine part, évitables.<br />
Des mesures de prévention adéquates doivent donc être mises en place.<br />
Le partage des expériences en présence d’experts professionnels de la région est l’une<br />
des clefs de la réussite des mo<strong>du</strong>les de l’atelier-action « gestion des <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong><br />
<strong>centrales</strong> » mis en place dans le cadre des trav<strong>aux</strong> <strong>du</strong> Resclin-Champagne-Ardenne. Il a<br />
permis d’enrichir les débats autour des problèmes de terrain rencontrés par les<br />
professionnels.<br />
OBJECTIF<br />
Dans le cadre de la mutualisation des expériences, en présence de professionnels réputés<br />
experts de la région, permettre à chaque participant de structurer ou d’actualiser les<br />
protocoles de gestion des <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong> dans son établissement afin de les<br />
soumettre pour validation et approbation <strong>aux</strong> instances.<br />
REFERENCES UTILES ACCESSIBLES SUR L’INTERNET®<br />
Accessibles librement :<br />
David C. McGee, M.D., and Michael K. Gould, M.D. Preventing Complications of Central<br />
Venous Catheterization. NEJM, 2003;348:12;1123-33.<br />
http://content.nejm.org/cgi/content/full/348/12/1123<br />
http://content.nejm.org/cgi/content/full/348/12/1123/DC1. Vidéo pose cathéter jugulaire<br />
CENTRAL VENOUS CATHETER: Cours de la faculté de médecine d’Ottawa (2005).<br />
http://www.med.uottawa.ca/medweb/cvc/Indications/e_indications.htm<br />
L’Audit Clinique et l’Audit Clinique Ciblé. Haute autorité de santé<br />
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_431335<br />
Audit Clinique Ciblé chambre implantable : Rapports 2004-2005<br />
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_467073<br />
Non accessibles librement<br />
Alan S. Graham, M.D., Caroline Ozment, M.D., Ken Tegtmeyer, M.D., Susanna Lai, M.P.H.,<br />
and Dana A.V. Braner, M.D. Central Venous Catheterization. NEJM 2007;356:e21(Vidéo in<br />
clinical medicine). http://content.nejm.org/cgi/content/short/356/21/<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007 Page 4
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
12-2007 <strong>Gestion</strong> d’une voie veineuse centrale : processus<br />
PCS<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
Importance<br />
<strong>du</strong> <strong>risque</strong><br />
<strong>infectieux</strong><br />
X<br />
X<br />
Indication de la pose<br />
Choix <strong>du</strong> type de VVC<br />
Diagnostic<br />
Contre-indications<br />
<strong>Gestion</strong> des achats<br />
et des stocks<br />
XX<br />
Choix <strong>du</strong> site de pose<br />
Accord concerté <strong>du</strong> patient<br />
Prescription médicale<br />
Logigramme<br />
décisionnel<br />
X<br />
Programmation<br />
T<br />
R<br />
A<br />
XXX<br />
Préparation <strong>du</strong> patient<br />
C<br />
A<br />
XXX<br />
Pose<br />
B<br />
I<br />
L<br />
XX<br />
Surveillance immédiate<br />
post-intervention<br />
I<br />
T<br />
XXX<br />
Surveillance,<br />
manipulation, utilisation<br />
de la VVC<br />
Chambre à cathéter implantable :<br />
-pose aiguille<br />
-ablation aiguille<br />
E<br />
XXX<br />
XX<br />
Manipulation,<br />
changement des<br />
tubulures<br />
Ablation<br />
Prescription médicale<br />
Information/préparation <strong>du</strong> patient<br />
Organisation<br />
Intervention<br />
VVC : voie veineuse centrale<br />
Importance <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> : X = modéré, XX = important, XXX = très important<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PCS
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
12-2007 Logigramme décisionnel <strong>du</strong> choix <strong>du</strong> type de VVC<br />
PTC I<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
Contre-indications à la VVC (exceptionnelles) :<br />
- certains états septiques (sauf urgence vitale)<br />
- troubles non corrigés de l'hémostase<br />
- thrombose veineuse*<br />
- compression cave supérieure*<br />
- sclérose post-radique*<br />
- métastases cutanées*<br />
- infection locale*<br />
- brûlure, dermatose*<br />
- ...<br />
* rechercher le site veineux le plus adapté<br />
Oui<br />
Indication VVC<br />
Accord concerté <strong>du</strong> patient<br />
Traitement<br />
> 15 jours<br />
Non<br />
Traitement<br />
> 3 mois<br />
Oui<br />
Non<br />
CCI :<br />
accord<br />
patient<br />
Oui<br />
Non<br />
Chambre à cathéter<br />
implantable<br />
Cathéter central<br />
externalisé tunnelisé<br />
Cathéter central<br />
externalisé simple<br />
VVC = voie veineuse centrale<br />
CCI = chambre à cathéter implantable<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC I
12-2007<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
Pose d’un cathéter central externalisé ou d’une<br />
chambre à cathéter implantable :<br />
Phase pré-interventionnelle<br />
PTC II<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
1. Information, préparation (psychologique) <strong>du</strong> patient :<br />
En hospitalisation : infirmier(e). En consultation : médecin, chirurgien, infirmier(e)<br />
Après annonce de la maladie et des traitements nécessaires par le médecin :<br />
- information <strong>du</strong> patient sur :<br />
o les buts recherchés<br />
o le type et le déroulement de l’intervention<br />
o le matériel<br />
- proposition de visualisation <strong>du</strong> matériel et d’un DVD précisant les princip<strong>aux</strong> points<br />
- remise d’un document d’information<br />
- é<strong>du</strong>cation <strong>du</strong> patient sur les précautions d’hygiène à respecter (hygiène corporelle et<br />
vestimentaire, pansement clos, protection des tubulures)<br />
2. Si chambre à cathéter implantable : choix de l’emplacement et de la taille<br />
En hospitalisation ou en consultation : médecin, chirurgien<br />
Le choix est notamment fonction :<br />
- de l’anatomie <strong>du</strong> patient, de sa corpulence, de son âge<br />
- des impératifs médic<strong>aux</strong><br />
- des besoins <strong>du</strong> patient : habitudes de vie, de loisirs<br />
- <strong>du</strong> vécu de la maladie<br />
- des impératifs professionnels<br />
3. Information <strong>du</strong> patient concernant l’organisation de la pose :<br />
En hospitalisation : infirmier(e) ; en consultation : médecin ou chirurgien<br />
- bilan complémentaire préalable<br />
- jour et heure de l’intervention<br />
- lieu et <strong>du</strong>rée d’hospitalisation<br />
- préparation à la pose (cutanée, douleur)<br />
4. Bilan complémentaire (au plus tard la veille) :<br />
Prescription : médecin, chirurgien ; mise en œuvre : infirmier(e)<br />
- en cas de pathologie thoracique : cliché pulmonaire récent (cf protocole médical adapté)<br />
- systématiquement : TQ, TCA < 24h00 si anormal : cf médecin<br />
- si besoin, en cas de pathologie ou de thérapeutique susceptible de modifier<br />
l’hémogramme :<br />
o NFS < 24h00<br />
si anormal : cf médecin<br />
si N plaquettes < 80 giga/l* : cf médecin<br />
*Afssaps, juin 2003 : recommandations de bonnes pratiques ; transfusion de plaquettes<br />
en cas de geste effractif : transfuser si N plaquettes < 50 giga/l<br />
- préparer le bon pour la radiographie post-interventionnelle<br />
- si report de la pose : prévenir le patient et le bloc opératoire<br />
5. Préparation préinterventionnelle :<br />
Infirmier(e), aide-soignant(e), <strong>aux</strong>iliaire de puériculture<br />
- au plus tard la veille : interrogatoire, recherche d’allergies<br />
- la veille et le matin : préparation cutanée<br />
- le matin :<br />
o prévention douleur<br />
o jeûne en fonction <strong>du</strong> type d’anesthésie :<br />
- anesthésie générale : se reporter <strong>aux</strong> protocoles habituels<br />
- anesthésie locale : petit déjeuner léger autorisé<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC II
12-2007<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
Pose d’un cathéter central externalisé ou d’une<br />
chambre à cathéter implantable<br />
Phase post-interventionnelle immédiate<br />
Surveillance au retour de la salle d’intervention<br />
Chambre à cathéter implantable ou cathéter tunnelisé : programmation de<br />
l’ablation des fils<br />
QUI : infirmiers<br />
QUAND : après la pose, au retour de la salle d’intervention<br />
PTC III<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
Quoi<br />
Vérifications :<br />
- Contrôle radiologique effectué et lu<br />
- Contrôle de perméabilité effectué<br />
par le chirurgien<br />
- Livret de surveillance et carte<br />
spécifique présents dans le dossier<br />
Surveillance d’une extravasation<br />
Surveillance d’un saignement<br />
Réfection <strong>du</strong> pansement<br />
Bilan des constantes<br />
Evaluation de la douleur<br />
Livret de surveillance et carte<br />
spécifique<br />
Transmissions écrites<br />
Programmation de l’ablation des fils<br />
Comment<br />
Sur fiche de suivi.<br />
Si non effectué : les faire réaliser<br />
Selon protocole <strong>du</strong> service<br />
Ou selon ANAES 2000 « évaluation de la qualité de<br />
l’utilisation et de la surveillance des chambres à<br />
cathéter implantables » p 23<br />
Si début de saignement : délimiter pour surveiller<br />
l’évolution au minimum toutes les heures.<br />
En cas de saignement continu, prévenir le médecin<br />
référent<br />
Si nécessaire, se reporter protocole IV :<br />
« surveillance, manipulation, utilisation »<br />
Changement immédiat de tout pansement souillé ou<br />
non hermétiquement fixé<br />
Pouls, tension artérielle, température (rythme) :<br />
- selon le protocole <strong>du</strong> service<br />
ou<br />
- selon prescription spécifique<br />
Selon protocole <strong>du</strong> service<br />
Noter la valeur correspondant à l’échelle utilisée sur la<br />
fiche de suivi :<br />
- échelle visuelle analogique : EVA<br />
- échelle verbale simple : EVS<br />
- échelle numérique : EN<br />
Accompagner leur remise au patient des explications<br />
utiles et vérifier la bonne compréhension <strong>du</strong> patient.<br />
Compléter la fiche de suivi<br />
Sur la fiche de suivi<br />
Dans le dossier de soins<br />
Délai :<br />
- selon prescription (cf compte ren<strong>du</strong> intervention)<br />
- sinon : J10-J12<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC III
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable :<br />
12-2007 Surveillance, manipulation, utilisation<br />
QUI : infirmiers, manipulateurs en électroradiologie médicale<br />
PTC IV<br />
Page<br />
1 sur 3<br />
PRECAUTIONS<br />
Surveillance à la recherche de complications éventuelles (infection, thrombose,<br />
dysfonctionnement et déplacement de la chambre, extravasation,…) :<br />
- signes loc<strong>aux</strong> ou génér<strong>aux</strong> d’infection<br />
- diffusion autour de la chambre implantable<br />
- hématome<br />
- désunion de la cicatrice<br />
- qualité <strong>du</strong> reflux sanguin, de la résistance à l’injection et <strong>du</strong> débit<br />
- œdème local, rougeur, douleur<br />
En cas de complication : en référer au médecin<br />
Si extravasation, se référer au protocole <strong>du</strong> service ou à ANAES 2000 « évaluation de la<br />
qualité de l’utilisation et de la surveillance des chambres à cathéter implantables » p 23<br />
Choix de l’aiguille :<br />
- biseau tangentiel (tableau des dispositifs mis à disposition par la pharmacie)<br />
- aiguille sécurisée : prévention AES<br />
- perfusion : pointe de Hüber coudée (+ prolongateur) ou de type gripper®<br />
- injection unique, prélèvements (uniquement si l’accès en veine périphérique est<br />
impossible) : pointe de Hüber droite<br />
- longueur selon épaisseur <strong>du</strong> septum et corpulence <strong>du</strong> patient (de 15 à 35 mm)<br />
- diamètre selon pro<strong>du</strong>its à administrer : de 19 G (sang) à 22 G (perfusions simples à<br />
faible débit). Le diamètre de 23 G est disponible pour la pédiatrie<br />
Ponction :<br />
- l’endroit de la ponction dans le septum doit varier à chaque nouvelle pose d’aiguille<br />
- avant toute piqûre, prévoir si besoin l’application d’un anesthésique local (patch), sur<br />
prescription médicale<br />
Rinçage :<br />
- rincer avec NaCl à 0,9% entre 2 pro<strong>du</strong>its et à la fin <strong>du</strong> traitement<br />
- Il est inutile d’hépariner<br />
Manipulation des tubulures :<br />
- selon les recommandations (protocole PTC V)<br />
- le robinet <strong>du</strong> prolongateur est placé dans un dispositif de protection. En l’absence de<br />
consensus, il ne peut être recommandé d’imprégner le dispositif d’antiseptique toutes les 8<br />
heures. Toutefois, si cette pratique est retenue, sa traçabilité est indispensable.<br />
- les rampes sont tenues à distance des sources de contamination (literie, plaie, stomie,…) :<br />
o accrocher les rampes nues à un support spécifique (porte-rampe)<br />
o remarque : la solution <strong>du</strong> porte-rampe est préférée en raison de la difficulté d’obtenir<br />
l’imprégnation antiseptique correcte et continue d’un protège-rampe (renouvelé en même<br />
temps que les tubulures) par ajout d’antiseptique toutes les 08h00 et en raison <strong>du</strong> <strong>risque</strong><br />
de fuites non détectées<br />
Pansement :<br />
- changement immédiat de tout pansement souillé ou non hermétiquement fixé<br />
- immédiatement après la pose de la CCI :<br />
o absence de perfusion immédiate : pansement stérile non transparent ; ôté à 48h00<br />
o perfusion immédiate : pansement stérile transparent mis en place au moment de la<br />
mise en route de la perfusion<br />
- à distance de la pose de la CCI :<br />
o perfusion continue : changement <strong>du</strong> pansement en même temps que l’aiguille<br />
o après retrait définitif de l’aiguille : pansement stérile à laisser en place 24 heures<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC IV
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable :<br />
12-2007 Surveillance, manipulation, utilisation<br />
PTC IV<br />
Page<br />
2 sur 3<br />
MATERIEL SUR UN CHARIOT PROPRE ET DESINFECTE : :<br />
Matériel nécessaire pour le pansement<br />
simple ou pour la pose d’une aiguille<br />
Masque patient et soignant<br />
1 flacon de SHA<br />
1 monodose de savon antiseptique et<br />
d’antiseptique de la même gamme<br />
1 monodose de NaCl à 0,9% injectable<br />
1 gant médical en vinyl non stérile non<br />
poudré (et un 2 ème gant si pansement<br />
souillé)<br />
1 paire de gants d’intervention stériles<br />
non poudrés<br />
10 compresses stériles<br />
1 sac à DASRI<br />
Matériel nécessaire pour la pose de l’aiguille<br />
1 charlotte et une surblouse si patient<br />
neutropénique<br />
2 champs stériles<br />
1 aiguille de Hüber coudée (perfusion, injections<br />
multiples) ou droite (injection unique, prélèvement)<br />
et 1 prolongateur avec robinet<br />
OU 1 aiguille de type gripper® et un robinet<br />
1 seringue de 10 ml*<br />
20 ml de NaCl à 0,9% injectable*<br />
1 protège-robinet<br />
1 paquet de bandelettes adhésives stériles<br />
1 pansement stérile transparent<br />
Si perfusion :<br />
o 1 tubulure, 1 rampe, le traitement<br />
o 1 porte-rampe<br />
Absence de perfusion immédiate :<br />
o 2 ème seringue de 10 ml*<br />
o 20 ml de NaCl à 0,9% injectable*<br />
o 1 bouchon stérile<br />
*Remarques :<br />
- il peut-être avantageux en terme de rapport bénéfice-<strong>risque</strong> d’utiliser des seringues<br />
préremplies<br />
- pour la qualité <strong>du</strong> rinçage, adapter la quantité de NaCl à la longueur <strong>du</strong> dispositif ; un<br />
prolongateur de 50 cm pourra nécessiter plus de 20 ml de NaCl<br />
TECHNIQUE<br />
1) Préparation des intervenants<br />
Le patient<br />
- installation en décubitus dorsal<br />
- masque (ou tête tournée <strong>du</strong> côté opposé si le<br />
patient ne peut pas supporter le masque)<br />
Le soignant<br />
- masque<br />
- charlotte et surblouse pour la pose de<br />
l’aiguille<br />
- friction des mains avec SHA<br />
2) Préparation cutanée et ouverture <strong>du</strong> matériel :<br />
- si pansement souillé, enfiler un gant non stérile<br />
- retirer le pansement en place et, le cas échéant, retirer le gant<br />
- désinfecter les mains par friction SHA (ou lavage simple au savon doux)<br />
- repérer soigneusement les bords de la chambre par palpation<br />
- enfiler un gant non stérile<br />
- ouvrir les paquets de compresses, les imbiber d’antiseptique<br />
- réaliser les 4 premiers temps de la préparation cutanée, laisser sécher<br />
- retirer le gant<br />
- désinfecter les mains par friction SHA (ou lavage hygiénique avec un savon antiseptique)<br />
- mettre le champ stérile sur le chariot<br />
- déposer le matériel stérile sur le champ, ouvrir les gants stériles<br />
3)<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC IV
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable :<br />
12-2007 Surveillance, manipulation, utilisation<br />
PTC IV<br />
Page<br />
3 sur 3<br />
Mise en place de l’aiguille et branchement de la perfusion si besoin :<br />
- enfiler les gants stériles<br />
- pratiquer la 2ème application cutanée d’antiseptique (5ème temps), laisser sécher<br />
complètement<br />
- placer le champ stérile sur le patient<br />
- monter aiguille et prolongateur ou Gripper® et seringue remplie de 10 ml de NaCl à 0,9%<br />
injectable<br />
- purger les 2 <strong>voies</strong>, fermer les <strong>voies</strong>, laisser la seringue connectée<br />
- maintenir fermement le boîtier entre 3 doigts et enfoncer l’aiguille en piquant<br />
perpendiculairement à la chambre jusqu’à ce qu’elle touche le fond.<br />
o le cas échéant, au moment de piquer, demander au patient de bloquer sa respiration<br />
en inspiration<br />
o si aiguille de Hüber coudée :<br />
• appuyer avec l’index au niveau de la courbure<br />
• placer une compresse stérile p<strong>lié</strong>e sous la courbure<br />
- ouvrir le robinet<br />
- aspirer avec la seringue jusqu’à ce que le sang reflue légèrement.<br />
o si pas de reflux, ce qui peut être fréquent, vérifier la perméabilité en injectant le<br />
contenu de la seringue. Si cette injection est indolore et ne provoque pas de<br />
gonflement, l’utilisation de la CCI est possible<br />
- fixer l’aiguille par des bandelettes adhésives stériles (point de ponction apparent)<br />
- poursuivre le traitement :<br />
o en cas de perfusion : brancher la perfusion<br />
o en l’absence de perfusion : réaliser une pression positive avec la 2ème<br />
seringue et mettre un bouchon<br />
- placer le pansement<br />
- faire une boucle de sécurité avec la ligne de perfusion et la coller sur le torse ou<br />
l’abdomen (si CCI posée en veine fémorale) ; ne pas coller sur le pansement<br />
- protéger le robinet avec le dispositif de protection. En l’absence de consensus, il ne peut<br />
être recommandé d’imprégner le dispositif de protection d’antiseptique toutes les 8<br />
heures. Toutefois, si cette pratique est retenue, sa traçabilité est indispensable<br />
4) Fin <strong>du</strong> soin :<br />
- retirer le champ stérile<br />
- retirer les gants<br />
- réinstaller le patient<br />
- éliminer les déchets<br />
- désinfecter les mains par friction SHA (ou lavage simple)<br />
- transcrire sur le dossier de soins infirmiers les observations<br />
- traçabilité <strong>du</strong> soin : diagramme de soin, livret de suivi <strong>du</strong> patient<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC IV
12-2007<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
Manipulation ou changement des tubulures :<br />
recommandations<br />
PTC V<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
QUI : infirmière<br />
EDUCATION DU PATIENT<br />
Précautions d’hygiène à respecter :<br />
- hygiène corporelle et vestimentaire<br />
- si pansement : doit être maintenu clos<br />
- protection des tubulures des sources de contamination<br />
MATERIEL SUR CHARIOT PROPRE ET DESINFECTE :<br />
- masque patient et soignant<br />
- charlotte et surblouse à usage unique si patient neutropénique<br />
- antiseptique<br />
- compresses stériles<br />
- SHA<br />
Si nécessaire :<br />
- tubulures et annexes : connecteurs, obturateurs, rampe<br />
- protège robinet<br />
1) Préparation des intervenants :<br />
Le patient<br />
- installation<br />
- masque (ou tête tournée <strong>du</strong> côté opposé si le<br />
patient ne peut pas supporter le masque)<br />
Le soignant<br />
- masque<br />
- charlotte et surblouse si patient<br />
neutropénique<br />
- friction des mains avec SHA<br />
2) Recommandations :<br />
- désinfecter les embouts et les robinets et les manipuler avec une compresse stérile<br />
imprégnée d’antiseptique<br />
- mettre en place un nouveau bouchon stérile chaque fois que l’accès ou le robinet est<br />
ouvert<br />
- tenir les rampes à distance de toute source de contamination (literie, plaie, stomie,…) :<br />
o accrocher les rampes nues à un support spécifique (porte-rampe)<br />
o remarque : la solution <strong>du</strong> porte-rampe est préférée en raison de la difficulté d’obtenir<br />
l’imprégnation antiseptique correcte et continue d’un protège-rampe (renouvelé en même<br />
temps que les tubulures) par ajout d’antiseptique toutes les 08h00<br />
- si des connecteurs de sécurité sont utilisés : les désinfecter avant tout accès au système<br />
- si un obturateur est utilisé : mettre en place un nouvel obturateur stérile après chaque<br />
nouvel accès au cathéter<br />
- pour la qualité <strong>du</strong> rinçage, adapter la quantité de NaCl à la longueur <strong>du</strong> dispositif ; un<br />
prolongateur de 50 cm pourra nécessiter plus de 20 ml de NaCl<br />
- remplacer les tubulures après chaque administration de pro<strong>du</strong>it sanguin labile (1poche, 1<br />
tubulure)<br />
- remplacer les tubulures dans les 24 heures suivant l’administration d’émulsions lipidiques<br />
- changement <strong>du</strong> dispositif de perfusion (tubulures et annexes) :<br />
o toutes les 96 heures<br />
o à chaque changement d’aiguille de la chambre implantable<br />
3) Fin <strong>du</strong> soin :<br />
- réinstaller le patient<br />
- éliminer les déchets<br />
- friction des mains avec SHA ou lavage simple<br />
- traçabilité <strong>du</strong> soin : diagramme de soin, livret de suivi <strong>du</strong> patient<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC V
12-2007<br />
QUI : infirmière<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
Prélèvements sanguins sur <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong><br />
<strong>centrales</strong><br />
QUAND : uniquement si l’accès en veine périphérique est impossible<br />
Précaution : si traitement en cours, <strong>risque</strong> de perturbation des résultats biologiques<br />
EFFECTUER UNE PURGE SELON LES INDICATIONS CI-DESSOUS<br />
MATERIEL SUR CHARIOT PROPRE ET DESINFECTE :<br />
- masque patient et soignant<br />
- charlotte et surblouse à usage unique<br />
si patient neutropénique<br />
- 2 gants médic<strong>aux</strong> en vinyl non stériles<br />
non poudrés<br />
- antiseptique<br />
- compresses stériles<br />
- 1 corps de vacutainer à usage unique<br />
- 1 adaptateur<br />
- 20 ml NaCl à 0,9% injectable*<br />
- seringue de 20 ml<br />
PTC VI<br />
Page<br />
1 sur 1<br />
ou seringues<br />
préremplies<br />
- tubes secs pour purger la tubulure :<br />
o patient perfusé : 3 tubes de 7 ml<br />
o patient non perfusé : 1 tube de 5 ml<br />
- tubes nécessaires au prélèvement<br />
- 1 bouchon stérile<br />
- 1 collecteur à objets coupants-tranchants<br />
*Qualité <strong>du</strong> rinçage : Adapter la quantité de NaCl à la longueur <strong>du</strong> dispositif (1 prolongateur<br />
de 50 cm pourra nécessiter plus de 20 ml de NaCl)<br />
1) Préparation des intervenants :<br />
Le patient<br />
- installation<br />
- masque (ou tête tournée <strong>du</strong> côté opposé si le<br />
patient ne peut pas supporter le masque)<br />
Le soignant<br />
- masque<br />
- charlotte et surblouse si patient<br />
neutropénique<br />
- friction des mains avec SHA<br />
2) Réalisation <strong>du</strong> prélèvement :<br />
- préparer le matériel sur le chariot<br />
- enfiler les gants non stériles (prévention des AES)<br />
- connecter l’adaptateur sur le corps de vacutainer<br />
- entourer le robinet d’une compresse stérile imprégnée d’antiseptique<br />
- enlever le bouchon <strong>du</strong> robinet et le jeter<br />
- connecter le corps de vacutainer muni de l’adaptateur au robinet<br />
- fermer le robinet côté perfusion<br />
- purger :<br />
o absence de perfusion en cours : prélever 1 tube sec de 5 ml de sang et le jeter<br />
o perfusion en cours : prélever 3 tubes secs de 7 ml de sang et les jeter<br />
- prélever les tubes d’examen<br />
- rouvrir la ligne de perfusion<br />
- désadapter le corps de vacutainer et le jeter<br />
- rincer par 3 à 5 pressions successives (au moins 20 ml) de NaCl à 0,9% injectable à<br />
l’aide d’une seringue ou à l’aide de la perfusion<br />
- rouvrir le robinet dans le sens de la perfusion<br />
- remettre un bouchon stérile neuf<br />
- étiqueter les tubes au lit <strong>du</strong> patient<br />
3) Fin <strong>du</strong> soin :<br />
- retirer les gants<br />
- réinstaller le patient<br />
- éliminer les déchets<br />
- friction des mains avec SHA ou lavage simple<br />
- traçabilité <strong>du</strong> soin : diagramme de soin, livret de suivi <strong>du</strong> patient<br />
Remarque : Si chambre à cathéter implantable (CCI) non perfusée :<br />
Eviter de prélever par la CCI. Si prélèvement obligatoire par la CCI<br />
- placer une aiguille de Hüber et un prolongateur ou un Gripper®<br />
- après le prélèvement, rincer la CCI avec NaCl à 0,9% injectable<br />
- retirer l’aiguille ou le Gripper® en maintenant la pression positive (cf protocole VII)<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC VI
12-2007<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable :<br />
Ablation de l’aiguille<br />
PTC VII<br />
Page<br />
1 sur 2<br />
QUI : infirmier(e)<br />
QUAND :<br />
- A la fin de toute perfusion ou injection unique non répétée quotidiennement<br />
- A la fin d’une cure de traitement<br />
- Si perfusion continue ou si perfusion quotidienne unique :<br />
En dehors <strong>du</strong> Sida : tous les 6 jours<br />
Sida : tous les 3 jours si perfusion continue<br />
MATERIEL SUR UN CHARIOT PROPRE ET DESINFECTE<br />
Masques patient et soignant<br />
1 charlotte et une surblouse<br />
3 gants médic<strong>aux</strong> en vinyl non stériles non poudrés<br />
Compresses stériles<br />
1 flacon de SHA<br />
1 monodose de savon antiseptique et d’antiseptique de la même gamme<br />
1 seringue de 20 ml<br />
ou seringue préremplie<br />
20 ml de NaCl à 0,9% injectable<br />
1 pansement standard stérile<br />
1 sac à DASRI<br />
1 conteneur à objets piquants-tranchants adapté à la taille des objets à éliminer<br />
Si aiguille non sécurisée : 1 système de protection anti-rebond (prévention AES) à usage<br />
multiple préalablement désinfecté ou à usage unique<br />
TECHNIQUE<br />
1) Préparation des intervenants<br />
Le patient<br />
- patient en décubitus dorsal<br />
- masque (ou tête tournée <strong>du</strong> côté opposé si le<br />
patient ne peut pas supporter le masque)<br />
Le soignant<br />
- masque, charlotte et surblouse<br />
- friction des mains avec SHA<br />
2) Réalisation <strong>du</strong> soin :<br />
- Si pansement souillé, enfiler un gant non stérile<br />
- retirer le pansement en place, et, le cas échéant, retirer le gant<br />
- désinfecter les mains par friction SHA (ou lavage simple au savon doux)<br />
- ouvrir les paquets de compresses, les imbiber d’antiseptique<br />
- désinfecter les mains par friction SHA (ou par lavage hygiénique au savon antiseptique)<br />
- enfiler des gants non stériles (prévention des AES)<br />
- désadapter les lignes de perfusions<br />
- désinfecter la valve bidirectionnelle avec une compresse imbibée d’antiseptique<br />
- adapter la seringue remplie de NaCl à 0,9% injectable en manipulant avec une<br />
compresse imbibée d’antiseptique<br />
- rincer par pressions successives (20 ml au moins)<br />
- fermer le robinet en pression positive<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC VII
12-2007<br />
Atelier-Action « gestion d’une voie veineuse centrale »<br />
<strong>Gestion</strong> d’une chambre à cathéter implantable :<br />
Ablation de l’aiguille<br />
PTC VII<br />
Page<br />
2 sur 2<br />
- retrait de l’aiguille :<br />
o aiguille non sécurisée :<br />
retirer l’aiguille en positionnant le système de protection anti-rebond au dessus de<br />
la chambre et en le maintenant fermement pendant le retrait de l’aiguille (fig cidessous)<br />
éliminer l’aiguille dans le conteneur à objets piquants-tranchants<br />
o aiguille sécurisée :<br />
suivre les instructions <strong>du</strong> fabricant<br />
- comprimer pendant 2 minutes avec une compresse imbibée d’antiseptique, pour éviter<br />
la survenue d’un hématome en regard <strong>du</strong> septum<br />
- recouvrir le site d’un pansement stérile à laisser en place 24 heures<br />
3) Fin <strong>du</strong> soin :<br />
- réinstaller le patient<br />
- retirer les gants<br />
- éliminer les déchets<br />
- désinfecter les mains avec SHA (ou lavage simple)<br />
- compléter la traçabilité <strong>du</strong> soin : diagramme de soin, livret de suivi <strong>du</strong> patient<br />
Utilisation <strong>du</strong> système de protection antirebond<br />
<strong>Gestion</strong> <strong>du</strong> <strong>risque</strong> <strong>infectieux</strong> <strong>lié</strong> <strong>aux</strong> <strong>voies</strong> <strong>veineuses</strong> <strong>centrales</strong><br />
Atelier-Action Resclin-Champagne-Ardenne – 4 ème trimestre 2007<br />
PTC VII