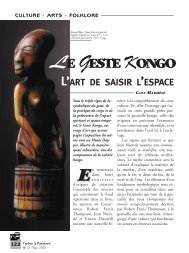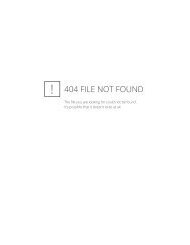LATITUDES N°4 - Association des Revues Plurielles
LATITUDES N°4 - Association des Revues Plurielles
LATITUDES N°4 - Association des Revues Plurielles
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CRÓNICAS/CHRONIQUES<br />
La perception en France<br />
de l’Estado Novo de Salazar<br />
La France <strong>des</strong> années 30 est<br />
confrontée à “une crise de<br />
civilisation”. Cherchant un<br />
peu partout <strong>des</strong> solutions, sa presse<br />
se penche sur les systèmes politiques<br />
existant à l’étranger. Elle rend<br />
ainsi compte <strong>des</strong> résultats du fascisme<br />
et du nazisme, mais également<br />
d’autres régimes autoritaires<br />
ou dictatoriaux qui se mettent en<br />
place en Europe.<br />
C’est dans ce contexte que <strong>des</strong><br />
périodiques de droite et d’extrême<br />
droite et <strong>des</strong> intellectuels s’intéressent<br />
aux résultats économiques et<br />
politiques obtenus par le Président<br />
du Conseil Portugais: António de<br />
Oliveira Salazar.<br />
Perçu comme l’incarnation du<br />
renouveau portugais, celui-ci<br />
devient pour certains un modèle<br />
de vertu et de conscience du bien<br />
commun et son régime, l’Estado<br />
Novo, l’archétype du régime chrétien.<br />
Les “séi<strong>des</strong>” du salazarisme en<br />
viennent même à réclamer, pour la<br />
France, un homme aussi providentiel<br />
qu’Antonio de Oliveira Salazar.<br />
Ainsi fut élaborée, dans la France<br />
de l’entre-deux-guerres, une image<br />
simplifiée, voire mystificatrice, de<br />
la situation socio-économique et<br />
politique du Portugal. Nous garderons<br />
à l’esprit le rôle politique de<br />
l’élaboration d’un tel mythe pour<br />
ces laudateurs à la recherche d’un<br />
modèle d’action.<br />
Cette perception, en trois temps,<br />
est inséparable de l’image de<br />
Salazar en France.<br />
Emmanuel Hurault*<br />
plus, elle l’assimile le plus souvent<br />
à l’Espagne. Ainsi, l’hebdomadaire<br />
Je suis partout insère-t-il dans la<br />
page consacrée à ce dernier pays,<br />
les articles concernant la Lusitanie.<br />
Il ne fait aucune distinction entre<br />
ces deux pays de la Péninsule<br />
Ibérique et présente même le Portugal<br />
comme province de l’Espagne.<br />
Un changement radical s’opère<br />
en 1931, lorsque le 9 mai, la rédaction<br />
s’excuse de la façon suivante :<br />
« Que nos lecteurs du Portugal<br />
veuillent bien ne pas se formaliser<br />
si, pour <strong>des</strong> nécessités de mises en<br />
pages, les informations de leur pays<br />
passent généralement dans la page<br />
sous le titre “Espagne”. Ce n’est pas<br />
plus par une annexion ou une<br />
confusion que ne l’est de placer sur<br />
la même feuille, dans les albums de<br />
géographie, les deux républiques<br />
qui se partagent la péninsule ibé-<br />
1930-1933 : La découverte et la<br />
création du mythe<br />
Avant 1930, le Portugal n’est pas<br />
considéré comme un pays digne<br />
d’un grand intérêt. La presse n’en<br />
parle que lors <strong>des</strong> révolutions ou<br />
<strong>des</strong> renversements politiques. De<br />
Couverture La Revue Universelle, 15 juin 1937<br />
30 <strong>LATITUDES</strong> n° 4 - décembre 98
ique. La réalité physique, l’association<br />
<strong>des</strong> idées conduisent à ce<br />
voisinage, à cette juxtaposition qui<br />
ne peuvent amener à méconnaître<br />
la profonde originalité historique,<br />
linguistique et politique au Portugal<br />
(...) La République lusitatienne se<br />
trouvait ainsi assimilée à la Catalogne<br />
ou à la Galice...» 1 .<br />
Désormais, les articles concernant<br />
la Lusitanie sont bien identifiés<br />
et paraissent à la rubrique<br />
“Portugal” ou “Monde Ibérique”. Le<br />
Portugal est alors reconnu, par cet<br />
hebdomadaire, dans sa spécificité<br />
nationale, comme une entité à part<br />
entière.<br />
Cet exemple marque le début<br />
du changement d’attitude de la<br />
presse française extrémiste à l’égard<br />
de la Lusitanie. En effet, à partir de<br />
là, les articles sur le Portugal<br />
deviennent plus nombreux et plus<br />
conséquents.<br />
En novembre 1931, Le Figaro<br />
Artistique Illustré publie un numéro<br />
spécial sur le Portugal. A notre<br />
connaissance aucun périodique<br />
n’avait jusqu’alors consacré une<br />
telle importance au pays de<br />
Camoëns. Cette parution nous<br />
semble marquer les prémices de la<br />
création du “mythe” autour du nouveau<br />
Portugal et d’António de<br />
Oliveira Salazar.<br />
1934-1936 : Le mythe en action<br />
Si l’année 1934 compte à elle<br />
seule, autant d’articles que la période<br />
1930 à 1933 réunies, l’année<br />
1935 est encore plus marquante<br />
quant à leur nombre et aux déplacements<br />
de journalistes et d’intellectuels<br />
français. Durant cette période,<br />
la plupart <strong>des</strong> articles, sur le<br />
Portugal, se trouvent soit en première<br />
page, soit à une place spécifique<br />
à l’intérieur du journal.<br />
A la quasi unanimité, ils présentent<br />
Salazar comme le paradigme<br />
du chef de gouvernement menant<br />
son pays vers l’ordre et la stabilité<br />
économique.<br />
Dorénavant, les journalistes<br />
aiment à faire la comparaison entre<br />
ce qui s’est passé en Lusitanie sous<br />
la République et ce que le pays est<br />
devenu depuis 1926. La place pré-<br />
Couverture Le Front Latin, juin 1936<br />
pondérante du Portugal dans l’histoire<br />
de l’Humanité lors <strong>des</strong> gran<strong>des</strong><br />
découvertes est également rappelée<br />
régulièrement aux lecteurs.<br />
Les reportages sur le Portugal et<br />
son “Chef”, du fait <strong>des</strong> voyages de<br />
leurs auteurs, sont plus nombreux<br />
mais toujours aussi peu approfondis<br />
sur la réalité de la situation. Ces<br />
“visites organisées” se déroulent<br />
presque toujours de la même façon :<br />
une promenade accompagnée à travers<br />
la Lusitanie pittoresque, une<br />
visite de la Capitale et pour finir une<br />
rencontre avec le dictateur.<br />
Bien que ces porte-plumes<br />
reconnaissent l’indigence de la<br />
population locale, ils assurent que<br />
les gens n’y sont pas malheureux.<br />
Selon eux, comparativement à celle<br />
d’autres pays, la situation y est bien<br />
meilleure notamment grâce au climat<br />
2 et à une certaine quiétude<br />
d’esprit.<br />
Ces articles nous ont fortement<br />
frappés par le contraste existant<br />
entre le caractère lucide <strong>des</strong> faits<br />
observés et l’aspect mièvre, voire<br />
poétique de leur <strong>des</strong>cription et<br />
interprétation.<br />
Par exemple, une scène de la<br />
vie de paysans miséreux est magnifiée<br />
en une ode du retour à la nature,<br />
en une connivence de l’homme<br />
et de la terre. N’est-ce pas ce procédé<br />
que nous retrouvons plus ou<br />
moins sous Vichy ?<br />
En dehors <strong>des</strong> journalistes, nous<br />
pouvons signaler également le<br />
voyage, du 9 au 18 mars 1935, d’une<br />
trentaine de députés de la Chambre<br />
et du Sénat sous la houlette d’Henri<br />
Torrés 3 . Ce périple a d’ailleurs été<br />
relaté par le Diario de Noticias du<br />
15 mars 1935.<br />
De même, notons celui en juin<br />
1935, à l’invitation du gouvernement<br />
portugais, d’intellectuels français<br />
et francophones, tels : Jules<br />
Romains 4 , Georges Duhamel, Albert<br />
Thibaudet, Jacques Maritain 5 ,<br />
Maurice Maeterlinck, Gonzague de<br />
Reynold...<br />
Entre 1934 et 1936, onze ouvrages,<br />
consacrés au Portugal et à Salazar,<br />
furent publiés. Conjointement, bon<br />
nombre de conférences, sur Salazar<br />
et son régime, sont données dans<br />
certaines villes de France.<br />
Les principaux intervenants portugais<br />
: António Ferro, responsable<br />
du Secrétariat à la Propagande<br />
Nationale (S.P.N.) ; Emydgio da<br />
Silva, Vice-Gouverneur de la Banque<br />
du Portugal ou encore José Augusto<br />
de Magalhano, Consul du Portugal<br />
à Marseille... Parmi les français,<br />
mentionnons : Henri Massis 6 , Paul<br />
de Laget, Alexandre Gauthier...<br />
A Paris, le “Centre Rive-Gauche”<br />
organise <strong>des</strong> conférences sur le Dr<br />
Salazar. A noter principalement<br />
celle du 15 mars 1936 relatée par<br />
Robert Brasillach dans L’Action<br />
Française du 16 mars 1936.<br />
A Marseille, ce genre de manifestation<br />
est organisée à la fois par<br />
le “Cercle Jacques Bainville” et le<br />
Consulat du Portugal.<br />
1937-1940 : Le mythe pérennisé<br />
et standardisé<br />
Pour cette période, l’intérêt pour<br />
l’Estado Novo et Salazar demeure<br />
mais évolue en fonction de la situation<br />
européenne particulièrement<br />
mouvementée.<br />
Nous observons que la parution<br />
d’ouvrages se maintient. A ce jour,<br />
<strong>LATITUDES</strong><br />
n° 4 - décembre 98<br />
31
Cartoon de João Abel Manta<br />
nous en avons comptabilisé quinze.<br />
La majorité sont publiés par <strong>des</strong><br />
maisons d’édition qui peuvent être<br />
qualifiées de secondaires, sous la<br />
bienveillance, voire avec l’aide, <strong>des</strong><br />
services de la propagande portugais.<br />
Les articles élogieux sur l’Estado<br />
Novo et la nouvelle conjoncture<br />
économique portugaise continuent<br />
de paraître. Cependant, nous observons<br />
une évolution dans la teneur<br />
de certains écrits.<br />
Après l’élaboration d’un modèle<br />
avec pour but d’en faire le moteur<br />
de l’action politique et économique,<br />
suit un phénomène d’appropriation<br />
de l’idéologie salazariste, principalement<br />
par <strong>des</strong> intellectuels et journalistes<br />
de l’Action Française, tels :<br />
Charles Maurras, Henri Massis,<br />
Jacques Delebecque ou Thierry<br />
Maulnier...<br />
Ainsi, Henri Massis fait-il un rapprochement<br />
de la pensée de Salazar<br />
et celle de Charles Maurras, mais<br />
aussi d’autres théoriciens français :<br />
“Mais ces idées, dira-t-on, ce sont<br />
celles qu’à propagées la doctrine de<br />
Charles Maurras : il y a là tout<br />
Maistre, tout La Tour du Pin, tout<br />
Fustel (...) Oui, ces idées ce sont les<br />
nôtres, je veux dire celles dont nous<br />
sommes les serviteurs; mais les voici<br />
appliquées, réalisées par un homme<br />
qui gouverne, incarnées dans une<br />
expérience actuelle, inscrites dans<br />
une histoire vivante” 7 .<br />
Le “modèle portugais” 8 devient<br />
alors, non seulement un exemple<br />
d’action que les penseurs français<br />
ont déjà théorisés sans jamais pouvoir<br />
l’appliquer, mais aussi la preuve,<br />
pour ces Maurrassiens, que<br />
leurs idées sont et doivent être<br />
mises en œuvre. C’est alors que le<br />
mythe devenu réalité s’impose par<br />
la même comme un argument politique<br />
pour convaincre la population<br />
française de l’urgence d’un<br />
changement de gouvernement en<br />
France.<br />
Argument politique d’autant<br />
plus fort que la crise institutionnelle<br />
sévit dans l’hexagone et que ce<br />
modèle devient finalement, sous<br />
leurs plumes, typiquement français.<br />
Illustrons ce “glissement” par un<br />
extrait de l’article de Thierry<br />
Maulnier dans La Revue Universelle :<br />
“Hitler, c’est peut-être la masse allemande,<br />
Salazar, c’est l’homme seulement<br />
(...) L’œuvre de Salazar,<br />
moins grandiose peut-être, moins<br />
spectaculaire que certaines autres,<br />
a le mérite de n’avoir jamais perdu<br />
de vue les grands principes directeurs.<br />
Ces principes sont français”<br />
et d’ajouter qu’ “en imitant Salazar<br />
dans le soin qu’il a eu de préserver<br />
les grands principes directeurs,<br />
nous ne ferons que nous imiter<br />
nous-mêmes” 9 .<br />
Au travers de tels propos, nous<br />
pouvons comprendre comment l’influence<br />
du salazarisme s’est répandue,<br />
en France, dans les milieux<br />
conservateurs et nationalistes : le<br />
salazarisme ne représente-t-il pas<br />
tout ce qu’ils désirent ardemment<br />
et réclament à cor et à cri ?<br />
Les extrémistes de droite française,<br />
notamment ceux de l’Action<br />
Française, n’attendaient et ne désiraient<br />
qu’une chose : l’instauration<br />
d’un régime autoritaire qui viendrait<br />
remettre de l’ordre et redonner<br />
l’espoir, l’exemple du Portugal<br />
leur servant d’“étendard”, de modèle<br />
à imiter.<br />
L’instauration du régime de<br />
Vichy, la “divine surprise” selon<br />
Charles Maurras peut être considérée<br />
comme la mise en forme de tout<br />
ce qu’avait écrit les “séi<strong>des</strong>” du salazarisme.<br />
Ainsi la “maison France” réorganisée,<br />
par le régime de Vichy, n’a<br />
donc plus rien à envier à l’Estado<br />
Novo portugais.<br />
Nous terminerons sur une question<br />
: pouvons-nous pousser l’audace<br />
jusqu’à considérer que Pétain<br />
s’est efforcé d’incarner un Salazar à<br />
la Française ? Pétain lui-même<br />
semble nous donner raison en<br />
avouant : “Puisque j’ai les idées de<br />
Salazar et la tunique de Carmona,<br />
je ne vois pas pourquoi je me dédoublerai.”<br />
10 ●<br />
1 Je suis partout, 9 mai 1931.<br />
2 La presse aime rappeler la phrase du<br />
dictateur polonais Pilsudski : “Bienheureux<br />
pays, ce Portugal dont la<br />
Sibérie est à Madère”.<br />
3 Archives du Ministère <strong>des</strong> Affaires<br />
Etrangères français, Série Europe<br />
1918-1940, Sous-Série Portugal,<br />
Volumes 90/91.<br />
4 Jules Romain raconte ainsi son voyage<br />
: “Le Maeterlinck dont je me souviens<br />
(...) était comme moi un <strong>des</strong><br />
hôtes du Portugal, en juin 1935. Le<br />
gouvernement portugais avait invité<br />
une douzaine d’écrivains européens<br />
à visiter le pays, sans autre obligation<br />
que celle, toute morale, d’assister<br />
à <strong>des</strong> réunions qu’on organisait en<br />
leur honneur. Au nombre <strong>des</strong> invités<br />
figuraient Duhamel, Mauriac, Unamuno,<br />
etc.” - Jules Romains, Amitiés et rencontres,<br />
Paris, Flammarion, 1970.<br />
5 Jacques Maritain a écrit, en juillet<br />
1937, au dictateur portugais :<br />
“J’admire votre sagesse politique et la<br />
façon dont vous avez adapté les principes<br />
aux conditions particulières et<br />
au tempérament de votre pays.<br />
L’œuvre réalisée témoigne d’ailleurs<br />
par elle-même, et d’une façon fort<br />
impressionnante au moment où la<br />
Russie et l’Allemagne laissent voir à<br />
quelles faillites peut conduire une<br />
exaltation purement communautaire,<br />
capable de tenir la violence la plus<br />
outrée pour la manifestation d’un<br />
droit plus élevé” - Archives nationales -<br />
Torre do Tombo - AOS/CP - 168 ; Pasta<br />
4.4.12/12 ; Folhas 485 à 495.<br />
6 Comme celle faite à Béthune en<br />
décembre 1938 et intitulée : “Le Président<br />
Salazar - Réformateur du Portugal”.<br />
7 Henri Massis, Je suis partout, 8 avril<br />
1938.<br />
8 Titre d’un article de Charles Maurras,<br />
L’Action Française, 6 mars 1939.<br />
9 Thierry Maulnier, La Revue Universelle,<br />
janvier-mars 1937.<br />
10 Cité par Marc Ferro, Pétain, Fayard,<br />
Coll “Pluriel”, p. 137.<br />
32 <strong>LATITUDES</strong> n° 4 - décembre 98