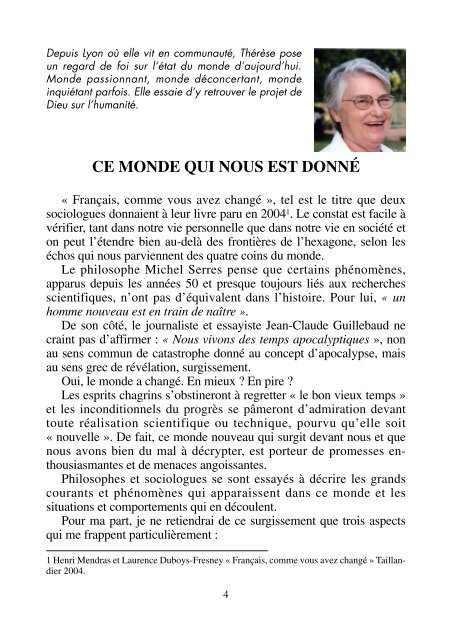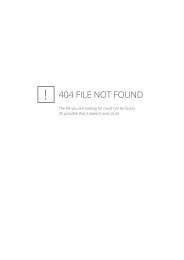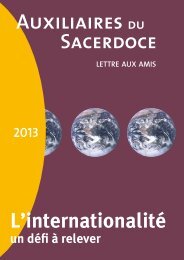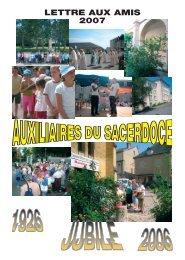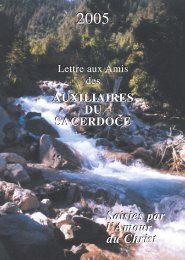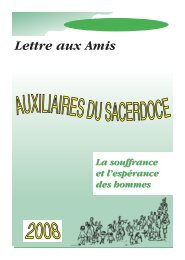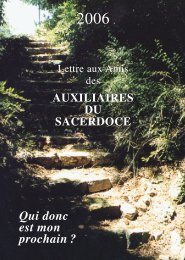ce monde qui nous est donné - Le site des auxiliaires du Sacerdoce
ce monde qui nous est donné - Le site des auxiliaires du Sacerdoce
ce monde qui nous est donné - Le site des auxiliaires du Sacerdoce
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Depuis Lyon où elle vit en communauté, Thérèse pose<br />
un reg ard d e foi sur l’état d u mond e d ’aujourd ’hui.<br />
M ond e passionnant, mond e d écon<strong>ce</strong>rtant, mond e<br />
inq uiétant parfois. E lle essaie d ’y retrouver le projet d e<br />
Dieu sur l’humanité.<br />
CE MONDE QUI NOUS EST DONNÉ<br />
« F ra n ç a is , c o m m e v o u s a v e z c h a n g é » , te l e s t le titre q u e d e u x<br />
s o c io lo g u e s d o n n a ie n t à le u r liv re p a ru e n 2 0 0 4 1 . L e c o n s ta t e s t fa c ile à<br />
v é rifie r, ta n t d a n s n o tre v ie p e rs o n n e lle q u e d a n s n o tre v ie e n s o c ié té e t<br />
o n p e u t l’é te n d re b ie n a u -d e là d e s fro n tiè re s d e l’h e x a g o n e , s e lo n le s<br />
é c h o s q u i n o u s p a rv ie n n e n t d e s q u a tre c o in s d u m o n d e .<br />
L e p h ilo s o p h e M ic h e l S e rre s p e n s e q u e c e rta in s p h é n o m è n e s ,<br />
a p p a ru s d e p u is le s a n n é e s 5 0 e t p re s q u e to u jo u rs lié s a u x re c h e rc h e s<br />
s c ie n tifiq u e s , n ’o n t p a s d ’é q u iv a le n t d a n s l’h is to ire . P o u r lu i, « un<br />
h o m m e no uv e a u e s t e n tr a in d e na ître » .<br />
D e s o n c ô té , le jo u rn a lis te e t e s s a y is te J e a n -C la u d e G u ille b a u d n e<br />
c ra in t p a s d ’a ffirm e r : « N o us v iv o ns d e s te m p s a p o c a ly p tiq ue s » , n o n<br />
a u s e n s c o m m u n d e c a ta s tro p h e d o n n é a u c o n c e p t d ’a p o c a ly p s e , m a is<br />
a u s e n s g re c d e ré v é la tio n , s u rg is s e m e n t.<br />
O u i, le m o n d e a c h a n g é . E n m ie u x ? E n p ire ?<br />
L e s e s p rits c h a g rin s s ’o b s tin e ro n t à re g re tte r « le b o n v ie u x te m p s »<br />
e t le s in c o n d itio n n e ls d u p ro g rè s s e p â m e ro n t d ’a d m ira tio n d e v a n t<br />
to u te ré a lis a tio n s c ie n tifiq u e o u te c h n iq u e , p o u rv u q u ’e lle s o it<br />
« n o u v e lle » . D e fa it, c e m o n d e n o u v e a u q u i s u rg it d e v a n t n o u s e t q u e<br />
n o u s a v o n s b ie n d u m a l à d é c ry p te r, e s t p o rte u r d e p ro m e s s e s e n -<br />
th o u s ia s m a n te s e t d e m e n a c e s a n g o is s a n te s .<br />
P h ilo s o p h e s e t s o c io lo g u e s s e s o n t e s s a y é s à d é c rire le s g ra n d s<br />
c o u ra n ts e t p h é n o m è n e s q u i a p p a ra is s e n t d a n s c e m o n d e e t le s<br />
s itu a tio n s e t c o m p o rte m e n ts q u i e n d é c o u le n t.<br />
P o u r m a p a rt, je n e re tie n d ra i d e c e s u rg is s e m e n t q u e tro is a s p e c ts<br />
q u i m e fra p p e n t p a rtic u liè re m e n t :<br />
1 H e n ri M e n d ra s e t L a u re n c e D u b o y s -F re s n e y « F ra n ç a is , c o m m e v o u s a v e z c h a n g é » T a illa n -<br />
d ie r 2 0 0 4.<br />
4
–l’interdépendan<strong>ce</strong> entre les hommes et les communautés <strong>qui</strong> fait<br />
de notre <strong>monde</strong> un village à l’échelle planétaire ;<br />
–le saut énorme réalisé <strong>ce</strong>s dernières années dans le champ<br />
d’activités <strong>des</strong> scien<strong>ce</strong>s et de la technique ;<br />
–enfin, au moins pour notre <strong>monde</strong> occidental, une société <strong>qui</strong> a<br />
per<strong>du</strong> ses repères religieux dans le domaine public.<br />
<strong>Le</strong>s facteurs de l’interdépendan<strong>ce</strong> sont multiples : globalisation de<br />
l’économie et de la finan<strong>ce</strong>, mobilité <strong>des</strong> populations provoquée par les<br />
né<strong>ce</strong>ssités professionnelles ou, pire, par le besoin d’échapper à la famine<br />
ou à la guerre, surtout développement <strong>des</strong> transports et instantanéité de la<br />
communication. A insi, <strong>ce</strong>rtains voient dans la cybernétique un sixième<br />
continent.<br />
Tout <strong>ce</strong>la ouvre un immense espa<strong>ce</strong> à l’échange, au dialogue, au<br />
brassage <strong>des</strong> cultures, et en mê me temps une possibilité de choix<br />
multiples <strong>qui</strong>, paradoxalement, génère un progrès de l’indivi<strong>du</strong>alisme.<br />
Q ue dire aussi de <strong>ce</strong>ux que l’âge, la maladie ou la précarité tiennent<br />
à l’écart de <strong>ce</strong>s réseaux ? A l’heure de la plus grande communication,<br />
la solitude r<strong>est</strong>e présente.<br />
<strong>Le</strong> scientifique A lbert Jacquard compare l’interdépendan<strong>ce</strong> de tous<br />
les hommes à <strong>ce</strong> <strong>qui</strong> se passe entre les molécules <strong>qui</strong> s’assemblent pour<br />
former les <strong>ce</strong>llules ou aux <strong>ce</strong>llules <strong>qui</strong> s’assemblent pour former les<br />
organes, avec <strong>ce</strong>tte différen<strong>ce</strong> que les humains peuvent décider de la<br />
forme de leur interdépendan<strong>ce</strong> alors que les <strong>ce</strong>llules, les organes,<br />
agissent les uns sur les autres selon les lois de la nature.<br />
<strong>Le</strong>s humains peuvent se regarder avec indifféren<strong>ce</strong> ; ils ne sont alors<br />
qu’un agglomérat d’humains. Ils peuvent se regarder avec crainte, <strong>ce</strong><br />
<strong>qui</strong> engendre <strong>des</strong> pro<strong>ce</strong>ssus d’opposition, d’agression, de défense. Ils<br />
peuvent enfin voir en l’autre une sour<strong>ce</strong> leur apportant les moyens de<br />
la construction d’eux-mê mes, de l’accès à <strong>des</strong> possibilités nouvelles.<br />
Et le scientifique d’en arriver à <strong>ce</strong>tte conclusion désarmante de<br />
simplicité : « L’indiffé ren<strong>ce</strong> comme l’ag ressivité ne peuvent g é né rer<br />
que <strong>des</strong> catastrophes. L’ouverture confiante peut ê tre b é né fique ;<br />
pourquoi hé <strong>site</strong>r ? 2 »<br />
On ne peut que rendre hommage à <strong>ce</strong>s hommes et à <strong>ce</strong>s femmes,<br />
responsables politiques ou personnes influentes, <strong>qui</strong>, malgré <strong>des</strong><br />
obstacles persistants, tentent, à for<strong>ce</strong> de dialogues et de négociations,<br />
de mettre fin à <strong>des</strong> conflits <strong>qui</strong> <strong>du</strong>rent depuis <strong>des</strong> dizaines d’années.<br />
2 A lbert Jacquard « Dieu ? » Stock /B ayard 2003<br />
5
<strong>Le</strong>s avancées de la scien<strong>ce</strong> et de la technique sont devenues en<br />
elles-mêmes et à cause de <strong>ce</strong>tte interdépendan<strong>ce</strong> entre les hommes, un<br />
immense espoir et une in<strong>qui</strong>étante mena<strong>ce</strong>.<br />
Dans le domaine <strong>des</strong> « scien<strong>ce</strong>s <strong>du</strong> vivant », les progrès de la<br />
recherche permettent de guérir <strong>ce</strong>rtaines maladies, de retarder au moins<br />
leur issue fatale, de soulager la souffran<strong>ce</strong>. En même temps, les manipulations<br />
génétiques <strong>nous</strong> font craindre <strong>des</strong> perspectives effrayantes<br />
pour l’espè<strong>ce</strong> humaine.<br />
<strong>Le</strong>s réalisations techniques ouvrent <strong>des</strong> connaissan<strong>ce</strong>s jusqu’ici<br />
insoupçonnées, améliorent les conditions de vie, ré<strong>du</strong>isent la pénibilité<br />
<strong>du</strong> travail.<br />
Pourtant, <strong>ce</strong>rtains abus pro<strong>du</strong>isent <strong>des</strong> nuisan<strong>ce</strong>s <strong>qui</strong> dégradent notre<br />
planète. La sophistication <strong>des</strong> armements rendrait terrifiants de<br />
possibles conflits internationaux.<br />
Accaparés que <strong>nous</strong> sommes par l’urgen<strong>ce</strong>, <strong>nous</strong> avons besoin de<br />
<strong>ce</strong>s « indicateurs », tels le philosophe Edgar Morin <strong>qui</strong> plaide pour « la<br />
conscien<strong>ce</strong> d’une communauté de d<strong>est</strong>in », ou d’autres comme Y ann<br />
Arthus-Bertrand ou Jean-Marie Pelt pour « une écologie responsable ».<br />
Il faut reconnaître que, grâ<strong>ce</strong> à <strong>ce</strong>tte sensibilisation, <strong>des</strong> avancées se<br />
font jour, trop timi<strong>des</strong> sans doute, tant elles exigeraient la modération<br />
de notre soif de confort et de consommation.<br />
Dans <strong>ce</strong> <strong>monde</strong>, dans la société occidentale, plus précisément dans<br />
notre société française, quelle pla<strong>ce</strong> pour Dieu ? Quel rapport de<br />
l’homme <strong>du</strong> vingt et unième siècle à Dieu ?<br />
Je ne vais pas développer ici le constat bien connu de la situation<br />
sociologique de l’É glise de Fran<strong>ce</strong> (<strong>ce</strong>lle <strong>qui</strong> m’<strong>est</strong> la plus proche) :<br />
baisse de la pratique religieuse, raréfaction et vieillissement <strong>des</strong><br />
prêtres, pénurie <strong>des</strong> vocations sa<strong>ce</strong>rdotales et religieuses, ignoran<strong>ce</strong> <strong>des</strong><br />
symboles chrétiens ; no tre so ciété laïcisée ne no us parle plus de<br />
Dieu.<br />
N otons au passage que les valeurs démocratiques dont <strong>nous</strong> <strong>nous</strong><br />
réclamons au nom de la déclaration de 19 48 <strong>des</strong> droits de l’homme et<br />
<strong>du</strong> citoyen, ne sont pas sans devoir une bonne part de leur inspiration à<br />
la tradition judéo-chrétienne. R econnaître <strong>ce</strong>la n’<strong>est</strong> pas récuser<br />
l’héritage <strong>des</strong> Lumières.<br />
L’indivi<strong>du</strong>alisme <strong>qui</strong> caractérise notre société se manif<strong>est</strong>e en<br />
particulier par un besoin d’exprimer son identité à travers <strong>des</strong><br />
comportements privés et <strong>des</strong> choix culturels. Or, la religion appartient<br />
aujourd’hui au domaine privé, comme une manière parmi d’autres de<br />
6
donner <strong>du</strong> sens à l’existen<strong>ce</strong> personnelle et au vivre ensemble. C’<strong>est</strong><br />
pourquoi les deman<strong>des</strong> à l’Église se font surtout lors <strong>des</strong> grands événements<br />
de la vie : naissan<strong>ce</strong>, mariage, décès.<br />
On remarque aujourd’hui une importante fréquentation <strong>des</strong> divers<br />
lieux d’accueil de l’Église, manif<strong>est</strong>ant un besoin de convivialité et une<br />
recherche de sens. Notre époque connaît les grands rassemblements où<br />
se vivent la joie de la fête, l’enthousiasme de croire ensemble.<br />
Alors, les chrétiens, une minorité ? Sans doute.<br />
Avec son regard d’homme « redevenu chrétien », Jean-Claude<br />
Guillebaud écrit : « L’É glise réelle, <strong>ce</strong>lle que je redécouvrais, faisait<br />
plutô t songer à <strong>ce</strong>s communautés <strong>des</strong> premiers siè cles, solidaires et<br />
joyeuses, mais tenues à l’écart par le pouvoir romain. 3 »<br />
Monseigneur Dagens, dans sa « Méditation sur l’Église », qualifie<br />
<strong>ce</strong>lle-ci d’« Église en acte de naissan<strong>ce</strong> » et les chrétiens d’« adeptes de<br />
la V oie » comme aux premiers siècles de l’Église.<br />
Notre Église affaiblie et appauvrie, <strong>est</strong> aussi, dans l’humilité et la<br />
discrétion, en profond renouvellement. Et <strong>nous</strong> pouvons réentendre,<br />
dans le contexte d’aujourd’hui, le cri <strong>du</strong> prophète Z acharie : « S ilen<strong>ce</strong>,<br />
D ieu se réveille en sa demeure. » (Z a, 2, 17)<br />
Ce rapide regard, d’où émergent quelques crêtes, <strong>nous</strong> laisse<br />
entrevoir un immense chantier où chacun peut trouver sa pla<strong>ce</strong>.<br />
Invités à servir le projet de Dieu de rassembler l’humanité, <strong>nous</strong><br />
pouvons « choisir la forme de notre appartenan<strong>ce</strong> » en <strong>nous</strong> inv<strong>est</strong>issant<br />
dans les relations. <strong>Le</strong>s associations en particulier, <strong>nous</strong> proposent<br />
mille manières de créer <strong>du</strong> lien social, d’échanger nos richesses avec<br />
l’autre différent par la culture ou la religion, d’apporter notre humble<br />
voix à la promotion de la justi<strong>ce</strong> ou à la poursuite de la paix.<br />
Pour tout <strong>ce</strong>la, auquel tout homme <strong>est</strong> appelé, notre vie religieuse en<br />
communauté <strong>est</strong> un précieux laboratoire.<br />
Afin de participer à la protection de la planète et à la juste<br />
répartition de ses richesses, <strong>nous</strong> sommes invitées à la sobriété de vie,<br />
à <strong>des</strong> g<strong>est</strong>es simples d’attention dans le quotidien <strong>qui</strong> tra<strong>du</strong>isent<br />
concrètement notre solidarité et notre refus <strong>du</strong> gaspillage. La pauvreté<br />
3 Jean-Claude Guillebaud « Comment je suis redevenu chrétien » Albin Michel 2007<br />
7
à laquelle <strong>nous</strong> <strong>nous</strong> sommes engagées ne trouve-t-elle pas là un<br />
nouveau visage ?<br />
Enfin, notre lien d’Auxiliaires <strong>du</strong> Sa<strong>ce</strong>rdo<strong>ce</strong> à l’Église <strong>nous</strong> mobilise<br />
pour servir le <strong>monde</strong> tel qu’il <strong>est</strong> aujourd’hui.<br />
« L’Église n’a pas son <strong>ce</strong>ntre en elle-même, mais à l’ex térieur<br />
d’elle-même », rappelait ré<strong>ce</strong>mment le Cardinal Barbarin à <strong>des</strong><br />
chrétiens engagés dans la mission.<br />
Nous avons maintes occasions d’accompagner <strong>des</strong> frères et sœ urs,<br />
souvent « passants » dans l’Église, de côtoyer dans le respect <strong>ce</strong>ux <strong>qui</strong><br />
appartiennent à d’autres cultures ou religions et de collaborer avec eux<br />
dans la cité.<br />
Mais, plus que de notre faire, il me semble que <strong>ce</strong> <strong>monde</strong> a besoin<br />
de notre espéran<strong>ce</strong>, de notre conviction que « Dieu <strong>est</strong> à l’œ uvre en <strong>ce</strong>t<br />
â ge » et de notre disponibilité à en témoigner.<br />
Cela <strong>nous</strong> sera donné si <strong>nous</strong> allons à la sour<strong>ce</strong>, si <strong>nous</strong> mettons nos<br />
vies sous la Parole, afin d’apprendre de l’Évangile <strong>du</strong> Christ le projet<br />
de Dieu sur les hommes.<br />
Oui, <strong>ce</strong> temps d’aujourd’hui <strong>est</strong> le beau temps que Dieu <strong>nous</strong> donne<br />
à vivre, le temps de notre foi. Sachons <strong>nous</strong> en réjouir.<br />
Thérèse LABRIET<br />
8