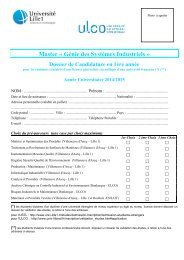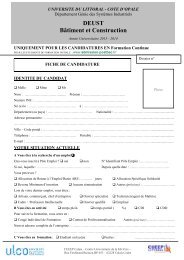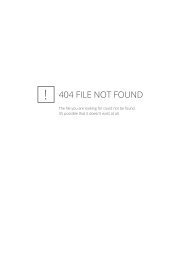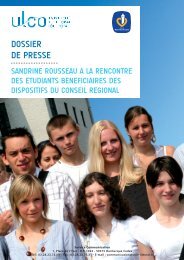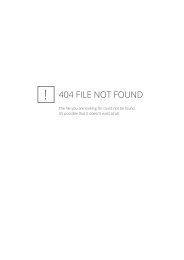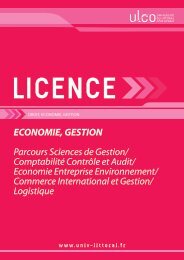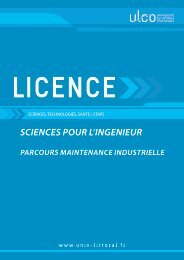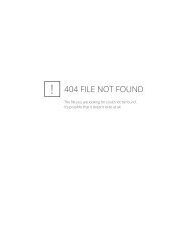ANALYSE SYSTEMIQUE DE LA COMMUNICATION PREVENTIVE ...
ANALYSE SYSTEMIQUE DE LA COMMUNICATION PREVENTIVE ...
ANALYSE SYSTEMIQUE DE LA COMMUNICATION PREVENTIVE ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>ANALYSE</strong> <strong>SYSTEMIQUE</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>COMMUNICATION</strong> <strong>PREVENTIVE</strong> SUR LES<br />
RISQUES EN STATION <strong>DE</strong> SPORTS D’HIVER<br />
Atelier souhaité : éducation pour la santé, économie, loisirs, territoire et A.P.S.<br />
Soulé Bastien – Centre de Recherche sur les A.P.S. – Université de Caen<br />
02 31 56 72 68 soule@staps.unicaen.fr<br />
Reynier Véronique – Laboratoire E.R.O.S. – Université de Grenoble 1<br />
04 76 63 50 93 veronique.reynier@ujf-grenoble.fr<br />
Corneloup Jean – Institut de Géographie Alpine – Université de Grenoble 1<br />
07 73 78 26 76 j.corneloup@libertysurf.fr<br />
Le nombre élevé d’accidents se produisant chaque année en station de sports d’hiver, ainsi<br />
que le constat de l’efficience réduite de l’information préventive déployée par les<br />
gestionnaires de ces sites touristiques, posent un certain nombre de problèmes en terme de<br />
santé publique. Afin de fournir des éléments explicatifs du faible impact de cette<br />
communication préventive, sa genèse et son impact sont analysés dans une perspective<br />
systémique. Les principaux résultats révèlent d’une part que les démarches préventives ne<br />
prennent pas suffisamment en compte le rapport entretenu par les pratiquants avec la<br />
dialectique risque-sécurité. Et d’autre part que les processus décisionnels relatifs à la<br />
prévention des risques en station sont empreints d’intérêts particularistes venant parfois se<br />
substituer à l’objectif de sensibilisation du public.<br />
Mots-clés : stations de sports d’hiver – risques – information préventive<br />
Type de communication souhaitée : communication orale (atelier D)<br />
Support technique nécessaire : vidéo-projection (Powerpoint P.C.)
<strong>ANALYSE</strong> <strong>SYSTEMIQUE</strong> <strong>DE</strong> <strong>LA</strong> <strong>COMMUNICATION</strong> <strong>PREVENTIVE</strong> SUR LES<br />
RISQUES EN STATION <strong>DE</strong> SPORTS D’HIVER<br />
Soulé Bastien – Centre de Recherche sur les A.P.S. – Université de Caen<br />
02 31 56 72 68 soule@staps.unicaen.fr<br />
Reynier Véronique – Laboratoire E.R.O.S. – Université de Grenoble 1<br />
04 76 63 50 93 veronique.reynier@ujf-grenoble.fr<br />
Corneloup Jean – Institut de Géographie Alpine – Université de Grenoble 1<br />
07 73 78 26 76 j.corneloup@libertysurf.fr<br />
Introduction<br />
Le nombre élevé d’accidents se produisant chaque hiver en station de sports d’hiver (Laporte,<br />
1999; Soulé, 2002), leur impact traumatique conséquent (Binet, Laporte et Constans, 1998;<br />
Johnson, Ettlinger et Shealy, 1997) et le coût social induit (Francillon, 1997) ne vont pas sans<br />
poser de problèmes en terme de santé publique. Par la force des choses, ces sites touristiques<br />
constituent donc des systèmes gestionnaires de risques qui déploient des efforts destinés à<br />
minimiser l’occurrence et/ou l’impact des accidents.<br />
A l’instar de ce qui se passe sur la route, ces systèmes présentent une spécificité : sur les<br />
domaines skiables, les gestions individuelle et collective des risques sont interdépendantes. Il<br />
y a co-régulation des dangers de la part des pratiquants et des professionnels locaux. Une<br />
partie importante de l’action de ces derniers consiste en une information préventive censée<br />
avoir une incidence sur les comportements des clients. Cependant, les opérations actuellement<br />
menées aboutissent à des résultats mitigés. Une des rares enquêtes à grande échelle réalisée<br />
auprès des pratiquants atteste de l’efficience réduite des campagnes de prévention (Poizat,<br />
2001). Ce travail entend fournir des éléments explicatifs de cet état de fait, en centrant<br />
l’analyse sur deux aspects : les pratiques préventives des acteurs chargés de la sécurité en<br />
station de sports d’hiver ; les rapports entretenus par les usagers des domaines skiables au<br />
danger et à la sécurité.<br />
Méthode<br />
C’est à partir d’analyses documentaires et d’entretiens semi-directifs auprès d’un échantillon<br />
représentatif (sur le plan fonctionnel et non statistique) des différents acteurs partie prenante<br />
de la régulation des dangers inhérents aux sports d’hiver que les pratiques préventives ont été<br />
analysées. Le travail s’est centré sur la mise en évidence :<br />
- du contenu des messages préventifs adressés aux clients des stations<br />
- du cadre formel concernant la gestion des risques sur les domaine skiables (obligations<br />
légales, prérogatives officielles des différents acteurs)<br />
- des discours institutionnels mis en avant<br />
- des principes présidant réellement à la genèse des messages délivrés<br />
Les rapports entretenus par les pratiquants vis-à-vis du danger et de la sécurité ont été révélés
par l’intermédiaire d’enquêtes réalisées sous forme de questionnaires et d’entretiens non<br />
directifs. Celles-ci ont permis d’appréhender :<br />
Résultats<br />
- les opinions des pratiquants relatives à la sécurité (Soulé, Corneloup et Guelle, 1999)<br />
- leurs représentations sociales du danger en station de sports d’hiver (Reynier et Soulé,<br />
2002)<br />
En ce qui concerne les pratiques préventives, les efforts déployés par les acteurs de la sécurité<br />
en station sont conséquents. Mais il convient de souligner que la plupart de ces professionnels<br />
ont conscience du faible impact des campagnes menées et de la signalisation des dangers<br />
effectuée (en termes de notoriété et d’impact sur les comportements des clients). Leur faible<br />
connaissance des publics cibles de la communication préventive (méconnaissance culturelle et<br />
en besoins d’informations) doit également être évoquée. Sur le plan de l’organisation chargée<br />
d’assurer la sécurité des clients, la comparaison des priorités prophylactiques affichées<br />
(prévention, éradication des risques a priori…) et des pratiques concrètes des acteurs fait<br />
apparaître des déviations d’objectif : certains intérêts particularistes viennent se substituer à<br />
l’objectif de sensibilisation du public.<br />
Les enquêtes auprès du public ont permis d’affiner sa connaissance. Les usagers des domaines<br />
skiables expriment un sentiment d’insécurité plus ou moins prononcé, ainsi que des opinions<br />
sur les mesures éventuellement à même d’optimiser la sécurité. Par ailleurs, l’analyse des<br />
représentations sociales du risque en station met en lumière la coexistence de rapports<br />
diversifiés au danger, qu’il s’agisse des manières d’expliquer l’occurrence d’accidents ou de<br />
la place accordée au risque lors de la pratique.<br />
Discussion<br />
Essentiellement basées sur l’expertise des responsables sécurité, les démarches préventives<br />
observées semblent sous-tendues par une conception béhavioriste des pratiquants, au<br />
détriment de la prise en compte du système d’interprétation mis en place par ces derniers face<br />
au danger.<br />
Le glissement téléologique présenté dans les résultats de l’analyse organisationnelle renforce<br />
les difficultés de mise en place d’une communication préventive de qualité. Il voit son origine<br />
dans les logiques d’action des spécialistes de la sécurité, lesquelles constituent le cadre réel de<br />
leur intervention, au-delà de leurs prérogatives formelles. Deux logiques d’action sont<br />
particulièrement prégnantes lorsqu’il est question d’information préventive délivrée aux<br />
pratiquants: la logique commerciale et la logique juridico-normative, qui seront présentées en<br />
détail.<br />
Ainsi, même si les modèles de communication mis en œuvre peuvent être l’objet de critiques<br />
(qualité des supports et pertinence des messages formulés), leur efficacité toute relative peut<br />
donc être envisagée comme étant également une conséquence de stratégies particularistes<br />
s’étant partiellement substituées à la visée d’intérêt général mise en avant. En effet, en<br />
l’absence de contre-pouvoir, les processus décisionnels actuellement en vigueur concernant la<br />
prévention des risques en station sont largement empreints d’intérêts sectoriels et locaux.
Enfin, les représentations sociales et le positionnement des pratiquants par rapport au risque<br />
constituent aussi un facteur explicatif de la faible efficience des actions de sensibilisation du<br />
public. En effet, généralement envisagé de manière restrictive comme une atteinte potentielle<br />
à l’intégrité corporelle, le risque peut être activement recherché dans le but d’atteindre des<br />
bénéfices d’ordre quelconque (liés à l’interaction sociale, aux sensations fortes, etc.). Dès lors,<br />
les messages informatifs actuels, qui partent du postulat que le risque minimum est recherché,<br />
ne peuvent prétendre toucher l’ensemble des usagers des domaines skiables.<br />
Références<br />
Binet M.H., Laporte J.D. et Constans D. (1998) Epidémiologie des accidents de sports d’hiver<br />
en 1998, Colloque médico-technique de Grenoble, Grenoble.<br />
Johnson R.J., Ettlinger C.F. et Shealy J.E. (1997) Skier injury trends: 1972 to 1994, in<br />
Johnson R.J., Mote C.D. et Ekeland A. (eds), Skiing trauma and safety (11 th volume),<br />
American society for testing and material edits, Philadelphia, 37-48.<br />
Laporte J.D. (1999) Accidentologie du ski. Etude descriptive, Cahiers du C.S.S.M., 11, 31-37.<br />
Poizat D. (2000) Hors-piste: comportements, connaissances et perceptions des pratiquants,<br />
Neige et Avalanches, 89, 2-8.<br />
Soulé B. (2002) Difficultés et enjeux de la quantification des accidents dans les stations de<br />
sports d’hiver, Revue Risques, 52 (sous presse).<br />
Soulé B. (2001) La sécurité des pratiquants des sports d’hiver: analyse, gestion et<br />
acceptabilité sociale des risques dans les stations de ski alpin, thèse de doctorat non publiée,<br />
Paris XI.<br />
Soulé B., Guelle C. et Corneloup J. (1999) Le marketing de la sécurité et des pratiques à<br />
risque dans les stations de ski, in Le marketing du loisir et du tourisme sportif, Actes du 5 ème<br />
séminaire de Marketing du Sport de Dijon, Dijon, 123-145.<br />
Reynier V. et Soulé B. (2002) Les représentations sociales des risques en station de sports<br />
d’hiver, Communication orale lors du 1 er congrès de la Société de Sociologie du Sport de<br />
Langue Françase, 28-30 octobre, Toulouse.