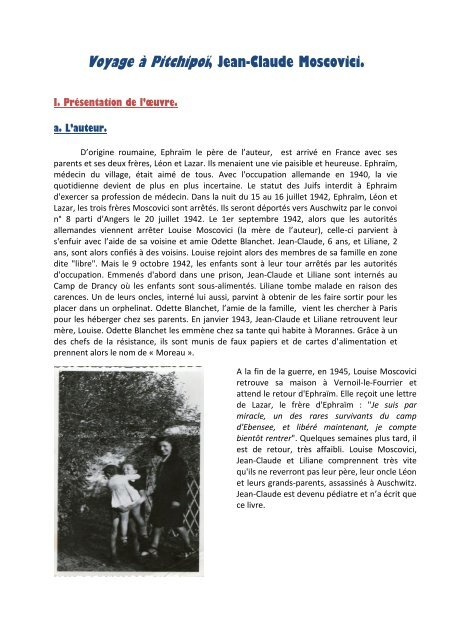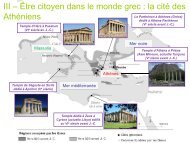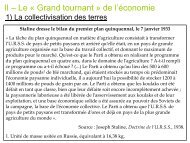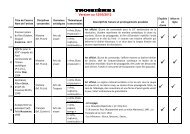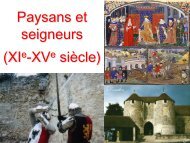Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.
Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.
Voyage à Pitchipoï, Jean-Claude Moscovici.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong>, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Moscovici</strong>.<br />
I. Présentation de l’œuvre.<br />
a. L’auteur.<br />
D’origine roumaine, Ephraïm le père de l’auteur, est arrivé en France avec ses<br />
parents et ses deux frères, Léon et Lazar. Ils menaient une vie paisible et heureuse. Ephraïm,<br />
médecin du village, était aimé de tous. Avec l'occupation allemande en 1940, la vie<br />
quotidienne devient de plus en plus incertaine. Le statut des Juifs interdit <strong>à</strong> Ephraim<br />
d'exercer sa profession de médecin. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 1942, Ephraïm, Léon et<br />
Lazar, les trois frères <strong>Moscovici</strong> sont arrêtés. Ils seront déportés vers Auschwitz par le convoi<br />
n° 8 parti d'Angers le 20 juillet 1942. Le 1er septembre 1942, alors que les autorités<br />
allemandes viennent arrêter Louise <strong>Moscovici</strong> (la mère de l’auteur), celle-ci parvient <strong>à</strong><br />
s'enfuir avec l’aide de sa voisine et amie Odette Blanchet. <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong>, 6 ans, et Liliane, 2<br />
ans, sont alors confiés <strong>à</strong> des voisins. Louise rejoint alors des membres de sa famille en zone<br />
dite "libre". Mais le 9 octobre 1942, les enfants sont <strong>à</strong> leur tour arrêtés par les autorités<br />
d'occupation. Emmenés d'abord dans une prison, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane sont internés au<br />
Camp de Drancy où les enfants sont sous-alimentés. Liliane tombe malade en raison des<br />
carences. Un de leurs oncles, interné lui aussi, parvint <strong>à</strong> obtenir de les faire sortir pour les<br />
placer dans un orphelinat. Odette Blanchet, l’amie de la famille, vient les chercher <strong>à</strong> Paris<br />
pour les héberger chez ses parents. En janvier 1943, <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane retrouvent leur<br />
mère, Louise. Odette Blanchet les emmène chez sa tante qui habite <strong>à</strong> Morannes. Grâce <strong>à</strong> un<br />
des chefs de la résistance, ils sont munis de faux papiers et de cartes d'alimentation et<br />
prennent alors le nom de « Moreau ».<br />
A la fin de la guerre, en 1945, Louise <strong>Moscovici</strong><br />
retrouve sa maison <strong>à</strong> Vernoil-le-Fourrier et<br />
attend le retour d'Ephraïm. Elle reçoit une lettre<br />
de Lazar, le frère d'Ephraïm : "Je suis par<br />
miracle, un des rares survivants du camp<br />
d'Ebensee, et libéré maintenant, je compte<br />
bientôt rentrer". Quelques semaines plus tard, il<br />
est de retour, très affaibli. Louise <strong>Moscovici</strong>,<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> et Liliane comprennent très vite<br />
qu'ils ne reverront pas leur père, leur oncle Léon<br />
et leurs grands-parents, assassinés <strong>à</strong> Auschwitz.<br />
<strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> est devenu pédiatre et n’a écrit que<br />
ce livre.
. Le livre.<br />
<strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong>, écrit en 1995 est une autobiographie, plus précisément un<br />
témoignage. L’auteur, d’origine juive, y retrace le destin tragique de sa famille pendant la<br />
seconde guerre mondiale.<br />
Quatrième de couverture :<br />
« <strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong> raconte la tragédie d'une famille juive, en France,<br />
pendant la guerre.<br />
En 1942, l'auteur de ce livre avait six ans. Sa famille fut arrêtée, par des<br />
gendarmes allemands et français, et déportée.<br />
Le narrateur et sa petite soeur furent d'abord confiés <strong>à</strong> des voisins jusqu'<strong>à</strong> ce<br />
que le maire du village fasse appliquer la décision du capitaine SS,<br />
Commandeur de la région et responsable des mesures de répression<br />
antisémite : « L'accueil d'enfants juifs dans des familles françaises est<br />
indésirable et ne sera autorisé en aucun cas. » Les deux enfants furent alors<br />
enfermés dans une prison, puis transférés au camp de Drancy, où la petite<br />
fille tomba malade par malnutrition.<br />
Sortis miraculeusement du camp, ils retrouvèrent quelques mois plus tard leur<br />
mère qui avait réussi <strong>à</strong> s'échapper lors de son arrestation et n'avait pas été<br />
reprise, malgré les portes qui s'étaient souvent fermées lorsqu'elle avait<br />
demandé de l'aide.<br />
Après des mois de vie clandestine, <strong>à</strong> la Libération, ils revinrent dans leur<br />
maison vide et abandonnée.<br />
Ils ne devaient jamais revoir leur père.
II. L’analyse en détail de l’œuvre.<br />
a. Les informations contenues dans la première de couverture.<br />
Le titre > <strong>Voyage</strong> <strong>à</strong> <strong>Pitchipoï</strong> : nom<br />
qu’utilisaient les juifs de France pour<br />
désigner le lieu de destination<br />
inconnu, mystérieux et menaçant des<br />
convois de dépotés. Le mot serait<br />
apparu <strong>à</strong> Drancy parmi les enfants<br />
qui y étaient retenus. Il signifierait le<br />
« pays de nulle part ».<br />
l’auteur est également le personnage<br />
de ce livre. Il y retrace des faits réels<br />
et son histoire. Il s’agit donc d’une<br />
autobiographie.<br />
La photo représente l’auteur et sa<br />
petite sœur <strong>à</strong> leur sortie du camp de<br />
Drancy. Leurs corps amaigris, leurs<br />
cheveux rasés et le regard dans le<br />
vague de la petite attirent le regard<br />
du lecteur qui peut déj<strong>à</strong> deviner le<br />
calvaire enduré par ces deux enfants<br />
lors de leur déportation.
. Partir d’évènements objectifs pour aller vers le témoignage personnel.<br />
Incipit du roman :<br />
« Le 20 juillet 1992, <strong>à</strong> la demande d’un ancien déporté, eut lieu en France, dans<br />
une ville de 150000 habitants, la commémoration du départ d’un train <strong>à</strong> destination du<br />
camp d’extermination d’Auschwitz. Unique convoi parti de province, le convoi N°8 en<br />
date du 20 juillet 1942 était constitué de 824 juifs, dont 430 femmes, parqués avant leur<br />
départ dans le grand séminaire alors réquisitionné, et qui servit en 1942 et 1943 de<br />
prison-antichambre des camps. De ce convoi, 14 rescapés survivaient en 1945.<br />
Cinquante ans plus tard, l’évêque de la ville, le préfet et le maire, hauts<br />
responsables de la cité, avouaient chacun leur honte d’avoir jusqu’<strong>à</strong> ce jour ignoré ces<br />
évènements… »<br />
On remarque d’emblée la profusion des chiffres, des données<br />
géographiques, d’informations objectives (surlignés en jaune dans le<br />
texte). Il s’agit de l’incipit d’un roman autobiographique et pourtant<br />
l’auteur utilise un point de vue externe et se positionne comme un<br />
témoin, un observateur des faits.<br />
L’implication de l’auteur est imperceptible, hormis la présence des points<br />
de suspension en bas de page.<br />
Dates Lieux Personnes circonstances
- 20 juillet 1942<br />
Province<br />
824 juifs<br />
Déportation de ces<br />
824 juifs vers le camp<br />
d’extermination<br />
d’Auschwitz.<br />
- De 1942 <strong>à</strong> 1943<br />
Grand séminaire<br />
réquisitionné.<br />
824 juifs déportés<br />
par le convoi N°8<br />
Parqués des ce<br />
séminaire qui était<br />
l’anti-chambre des<br />
camps.<br />
- 1945<br />
France<br />
14 rescapés de ce<br />
convoi N°8.<br />
On apprend <strong>à</strong> la fin<br />
de la guerre que<br />
seuls 14 personnes<br />
sur les 824 de ce<br />
convoi ont survécu <strong>à</strong><br />
la déportation.<br />
- 20 Juillet 1992<br />
Province<br />
« hauts responsables<br />
de la cité »<br />
Ces personnes<br />
« avouent leur honte<br />
d’avoir jusqu’<strong>à</strong> ce<br />
jour ignoré ces<br />
évènements… »<br />
Dans cette première page, JC. <strong>Moscovici</strong> synthétise de façon objective<br />
cinquante ans d’Histoire. Il le fait car cette partie de l’Histoire de France est<br />
intimement liée <strong>à</strong> son histoire personnelle. Le dernier paragraphe perd en<br />
objectivité (points de suspension, critique implicite <strong>à</strong> l’encontre des « hauts<br />
responsables de la cité » qui se souviennent en 1992 mais qui n’étaient pas<br />
venus en aide <strong>à</strong> la famille en 1942) et introduit la suite du récit.
c. La restitution d’un souvenir traumatisant.<br />
Dans cet extrait, l’auteur se souvient de la nuit où des soldats allemands se<br />
sont introduits au domicile familiale. C’est durant cette nuit que leur mère sera<br />
contrainte de prendre la fuite et que les enfants seront confiés <strong>à</strong> des voisins,<br />
puis déportés <strong>à</strong> Drancy.<br />
« C’était la nuit du 1 er au 2 septembre. Ma sœur venant d’avoir deux ans, les directives<br />
officielles mettant ma mère <strong>à</strong> l’abri d’une éventuelle arrestation ne la concernaient plus<br />
depuis trois jours.<br />
Nous dormions chacun dans notre lit, près de celui où ma mère dormait d’un<br />
sommeil entrecoupé de cauchemars. Des voix bruyantes et inconnues soudain la<br />
réveillèrent. En un instant elle comprit que, pour nous aussi, l’heure du départ et peut-être<br />
de la séparation était arrivée. A très petits pas, ma grand-mère monta les escaliers pour<br />
annoncer la présence des Allemands venus nous arrêter, et instinctivement conseilla <strong>à</strong> ma<br />
mère de nous cacher. Puis, elle redescendit doucement, sans faire de bruit, pour rejoindre<br />
mon grand-père et mon oncle qui préparaient leurs bagages sur les injonctions des soldats<br />
allemands.<br />
Ma sœur dormait d’une respiration calme et régulière. La réveiller, c’était la faire<br />
pleurer et attirer l’attention sur nous trois. Alors très vite, et le plus silencieusement possible<br />
pour ne pas faire craquer le parquet, ma mère sortit du lit et s’empressa de rabattre les<br />
couvertures sur le sien et le mien comme si personne n’y avait dormi, et m’entraîna dans le<br />
grenier qui était au même étage.
On se jeta sous un vieux tapis, serrés l’un contre l’autre. J’avais l’impression<br />
d’entendre des camions dont le moteur tournait sans cesse près de nous. Comme le camion<br />
qui avait emmené mon père et mes oncles. Mais il n’y avait pas de camion, et quand je<br />
demandais <strong>à</strong> ma mère si elle les entendait, elle me répondit que ce n’était que mon cœur<br />
qui battait très fort. Et puis il y a eut des bruits de pas dans l’escalier, de plus en plus<br />
sonores, des pas qui se rapprochaient et une conversation de plus en plus nette que je ne<br />
comprenais pas, avec des intonations dures qui me terrorisaient.<br />
La porte s’ouvrit brutalement et ils entrèrent dans ce petit grenier où l’on pouvait <strong>à</strong><br />
peine tenir debout. A travers du tapis je voyais les faisceaux des lampes qui balayaient la<br />
charpente et le sol, qui passaient sur nous et qui recommençaient.<br />
Ils parlaient très fort et donnaient des coups de botte dans tout ce qui était <strong>à</strong> leur<br />
portée. Ils étaient tout près de nous. Je ne respirais plus. Je croyais mourir. Puis ils<br />
repartirent en retraversant la chambre où ma chambre dormait calmement.<br />
On restait serrés l’un contre l’autre, bougeant <strong>à</strong> peine, <strong>à</strong> l’écoute du moindre bruit,<br />
attendant un signe de leur départ. J’entendais toujours les camions… et puis souvent <strong>à</strong><br />
nouveau ces voix et ces pas qui martelaient les escaliers, et <strong>à</strong> nouveau leur présence, les<br />
faisceaux de lumière qui fouillaient les moindres recoins et les violents coups de bottes qui<br />
faisaient vibrer le plancher, les coups de bottes dans tout…jusqu’<strong>à</strong> ce qu’ils me touchent et<br />
que je crie.<br />
Alors nous sommes sortis de notre cache. Ma mère a réveillé ma sœur, l’a prise dans<br />
ses bras, et nous sommes descendus tous les trois, les allemands derrière nous.<br />
Dans un français <strong>à</strong> peine compréhensible, ils signifièrent que ma sœur et moi allions<br />
être confiés <strong>à</strong> des voisins dont la maison était juste en face <strong>à</strong> la nôtre.<br />
Ma grand-mère prépara une valise où elle mit quelques-uns de nos vêtements, puis<br />
notre voisine, qui était aussi une amie de mes parents, fut prévenue et vint nous chercher.<br />
Nous nous sommes embrassés, et nous sommes partis avec elle dans l’obscurité, en nous<br />
tenant la main. »<br />
Cette nuit a particulièrement frappé l’auteur car elle correspond <strong>à</strong><br />
l’explosion de la cellule familiale ainsi qu’au début de la déportation des<br />
enfants. Il se souvient donc des années après très précisément de la<br />
date : « c’était dans la nuit du 1 er au deux septembre ».<br />
L’auteur<br />
Sa petite<br />
soeur<br />
Leur mère<br />
Lieu où ils se<br />
trouvent.<br />
« m’entraîna<br />
dans le grenier »<br />
« Nous<br />
dormions<br />
chacun<br />
notre lit »<br />
dans<br />
« m’entraîna<br />
dans<br />
grenier »<br />
le<br />
Ce qu’ils font.<br />
« On se jeta sous<br />
un vieux tapis,<br />
serrés l’un<br />
contre l’autre »<br />
« Ma sœur<br />
dormait d’une<br />
respiration<br />
calme et<br />
régulière »<br />
« ma mère<br />
sortit du lit et<br />
s’empressa de<br />
rabattre les<br />
couvertures
Sentiment qui<br />
les caractérise.<br />
« Je ne respirais<br />
plus. Je croyais<br />
mourir »<br />
sur le sien et le<br />
mien comme si<br />
personne n’y<br />
avait dormi, et<br />
m’entraîna<br />
dans le grenier<br />
qui était au<br />
même étage »<br />
« calme » « s’empressa »<br />
Le petit garçon perçoit la présence des soldats allemands dans la<br />
maison par le bruit qu’ils font : « des bruits de bottes », « ils parlaient<br />
très fort », par la lumière de leurs torches : « les faisceaux de lumière<br />
qui fouillaient les moindres recoins », la violence de leurs gestes : « la<br />
porte s’ouvrit brutalement », « les violents coups de bottes qui faisaient<br />
vibrer le plancher ».<br />
Il s’agit ici du récit d’une expérience traumatisante. L’auteur tente de<br />
retranscrire la peur qu’il a ressentit enfant en restant le plus fidèle<br />
possible aux sensations éprouvées. Le petit garçon ne perçoit les<br />
allemand que par des sensations (ouïe, toucher, vue) et associe cette<br />
nuit <strong>à</strong> d’autres moment inquiétants (le départ de son père et de ses<br />
oncles).
d. La description symbolique des lieux.<br />
Voici deux extraits du livre. Tout d’abord, au début du récit la<br />
description méliorative de la maison avant la déportation d’un grand nombre<br />
des membres de la famille. Puis, la description de ce même lieu au moment<br />
du retour, après la guerre.<br />
EXTRAIT 1 :
EXTRAIT N°2 :
La description inaugurale (du début) et finale de la maison familiale<br />
permettent <strong>à</strong> l’auteur de traduire les changements d’ambiance et de<br />
sentiments dans le récit. L’avant guerre est représenté par une<br />
description méliorative de la maison et des activités du petit garçon,<br />
tandis que le retour est représenté au moyen d‘une description<br />
péjorative de ce même lieu, faisant comprendre au lecteur que le temps<br />
de l’insouciance est <strong>à</strong> jamais révolu.
e. La description d’un univers cauchemardesque.<br />
L’utilisation répétitive du pronom « on « au début de l’extrait, montre<br />
que dans un premier temps l’auteur s’attache davantage <strong>à</strong> restituer des<br />
faits vécut par la totalité des enfants <strong>à</strong> Drancy.
Par la force des choses, le petit garçon se montre extrêmement mature<br />
et tente de supplanter les adultes auprès de sa petite sœur dans un<br />
univers cauchemardesque: « Je faisais tout ce que je pouvais pour<br />
remplacer mes parents auprès de ma petite sœur. »<br />
A la fin de cet extrait, les enfants évoquent ce lieu étrange et menaçant :<br />
« <strong>Pitchipoï</strong> » une impression de mystère s’en dégage, celle d’un lieu<br />
indéfinissable. L’utilisation du champ lexical de l’inconnu par l’auteur<br />
permet d’en accentuer l’effet : « un endroit », « lieu mystérieux »,<br />
« certains », « personne ne semblait avoir de nouvelles », « angoisse de<br />
l’inconnu ».<br />
Le quotidien<br />
Boire et se nourrir<br />
Réalité <strong>à</strong> Drancy<br />
« On mangeait surtout de la soupe aux choux avec du<br />
pain, qui était apportée dans de grandes bassines, et que<br />
nous essayions de boire dans de vieilles boîtes de<br />
conserve récupérées. »<br />
Dormir<br />
Se laver et aller aux<br />
toilettes<br />
L’odeur<br />
« La nuit, dans la lueur bleutée d’une unique veilleuse,<br />
couchés <strong>à</strong> même le sol, sur de la paille qui provenait de<br />
vieux matelas souillés et éventrés, on se serrait l’un<br />
contre l’autre pour se réchauffer. On était souvent<br />
réveillés par des cris d’enfants terrorisés sous l’emprise<br />
de cauchemars, comme l’était aussi ma sœur. »<br />
« Il y avait une planche sur toute la longueur avec plein<br />
de trous dedans, sur lesquels on s’asseyait, et tout le<br />
monde se voyait. »<br />
« Pour se laver, un seul robinet sur un évier en forme<br />
d’auge ouvrait plusieurs orifices d’où l’eau sortait <strong>à</strong> petits<br />
jets, éclaboussait le sol en permanence mouillé. »<br />
« Il y avait sur le palier un sceau hygiénique qui souvent<br />
débordait et répandait une odeur nauséabonde… »<br />
S’occuper la journée<br />
« Pendant la journée, on restait dans la cour… »
III. D’Autres témoignages.<br />
a. Primo Levi, Si c’est un homme.<br />
Poème liminaire du roman autobiographique de P. Lévi<br />
Vous qui vivez en toute quiétude<br />
Bien au chaud dans vos maisons,<br />
Vous qui trouvez le soir en rentrant<br />
La table mise et des visages amis,<br />
Considérez si c'est un homme<br />
Que celui qui peine dans la boue,<br />
Qui ne connaît pas de repos,<br />
Qui se bat pour un quignon de pain,<br />
Qui meurt pour un oui ou pour un non.<br />
Considérez si c'est une femme<br />
Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux<br />
Et jusqu'<strong>à</strong> la force de se souvenir,<br />
Comme une grenouille en hiver.<br />
N'oubliez pas que cela fut,<br />
Non, ne l'oubliez pas :<br />
Gravez ces paroles dans votre cœur,<br />
Pensez-y chez vous, dans la rue,<br />
En vous couchant, en vous levant ;<br />
Répétez-les <strong>à</strong> vos enfants,<br />
Ou que votre maison s'écroule,<br />
Que la maladie vous accable,<br />
Que vos enfants se détournent de vous.<br />
1947, Primo Levi<br />
La description du camp :<br />
Le camp <br />
"Nous avons une idée de la topographie du Lager; c'est un carré d'environ six cents mètres<br />
de côté, clôturé par deux rangs de barbelés, dont le plus proche de nous est parcouru par un<br />
courant <strong>à</strong> haute tension. Le camp se compose de soixante baraques en bois, qu'ici on appelle<br />
blocks, dont une dizaine sont en construction; <strong>à</strong> quoi s'ajoutent le corps des cuisines, qui est<br />
en maçonnerie, une ferme expérimentale tenue par un groupe de Häftlinge privilégiés, et les<br />
baraques des douches et des latrines, une tous les six ou huit Blocks. Certains Blocks, en<br />
outre, sont affectés <strong>à</strong> des usages particuliers. D'abord l'infirmerie et le dispensaire,<br />
constitués par huit baraques situées <strong>à</strong> l'extrémité est du camp;(...) Le centre du Lager est<br />
occupé par l'immense place de l'Appel. C'est l<strong>à</strong> qu'a lieu le rassemblement, le matin pour<br />
former les équipes de travail, le soir pour nous compter. En face de la place de l'Appel se<br />
trouve une pelouse soigneusement tondue, où l'on dresse la potence en cas de besoin."
. Les dessins de David Olère.<br />
David Olère est un peintre et sculpteur juif polonais, naturalisé français<br />
en 1937. Détenu au camp d'Auschwitz-Birkenau de 1943 <strong>à</strong> 1945, après<br />
la guerre, il ne cesse de témoigner de son expérience concentrationnaire<br />
par le dessin et la peinture.
c. Le mémorial de la Shoa.<br />
Les élèves peuvent alors évoquer leur visite de ce lieu. Ils ont pu retrouver le<br />
nom du père et des oncles de <strong>Jean</strong>-<strong>Claude</strong> <strong>Moscovici</strong> sur le mur du mémorial<br />
dédié aux victimes de la Shoa.<br />
http://www.memorialdelashoah.org/index.php/fr/rechercher-une-personne-victimeresistant-juste