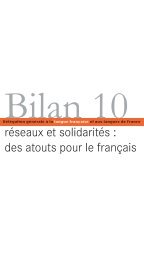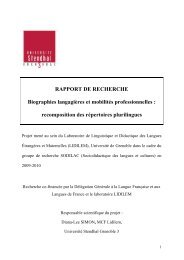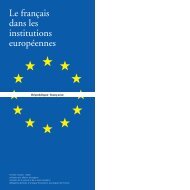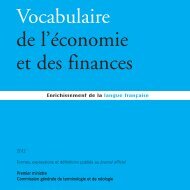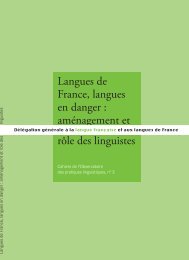L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2<br />
L’arméni<strong>en</strong> occid<strong>en</strong>tal, destin<br />
d’une <strong>la</strong>ngue de diaspora<br />
Anaïd DONABEDIAN,<br />
Inalco<br />
constitue un<br />
rameau isolé au sein<br />
L’arméni<strong>en</strong><br />
de <strong>la</strong> famille des <strong>la</strong>ngues<br />
indo-europé<strong>en</strong>nes. À<br />
partir du Moy<strong>en</strong> Âge, l’arméni<strong>en</strong><br />
c<strong>la</strong>ssique cède progressivem<strong>en</strong>t<br />
<strong>la</strong> p<strong>la</strong>ce <strong>à</strong> deux branches<br />
qui ont donné naissance,<br />
au XIX e siècle <strong>à</strong> deux variétés<br />
normées : l’arméni<strong>en</strong> occid<strong>en</strong>tal<br />
<strong>et</strong> l’arméni<strong>en</strong> ori<strong>en</strong>tal<br />
(voir l’article p. 3).<br />
L’Arménie étant située <strong>à</strong> <strong>la</strong><br />
frontière des grands empires<br />
qui ont successivem<strong>en</strong>t<br />
dominé <strong>la</strong> région, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
arméni<strong>en</strong>ne s’est trouvée <strong>en</strong><br />
contact avec de nombreuses<br />
<strong>la</strong>ngues de groupes différ<strong>en</strong>ts<br />
qui ont influ<strong>en</strong>cé son développem<strong>en</strong>t<br />
<strong>à</strong> divers stades de son<br />
histoire. Au stade anci<strong>en</strong>, on<br />
note des analogies de structures<br />
avec le grec, <strong>et</strong> de nombreux<br />
emprunts lexicaux <strong>à</strong><br />
l’irani<strong>en</strong>, mais aussi des traces<br />
du substrat ourarté<strong>en</strong>, qui<br />
n’est pas rattaché <strong>à</strong> <strong>la</strong> famille<br />
indo-europé<strong>en</strong>ne. Plus tard,<br />
le bilinguisme prolongé des<br />
Arméni<strong>en</strong>s avec le turc a infléchi<br />
le développem<strong>en</strong>t morphosyntaxique<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
<strong>et</strong> apporté de nombreux<br />
emprunts <strong>en</strong>core très vivants<br />
dans les dialectes. Malgré<br />
tout, <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue moderne a<br />
gardé une grande proximité<br />
avec <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue c<strong>la</strong>ssique,<br />
notamm<strong>en</strong>t au p<strong>la</strong>n phonologique<br />
<strong>et</strong> lexical, ainsi que pour<br />
<strong>la</strong> morphologie du verbe. Le<br />
lexique <strong>et</strong> les modes de formation<br />
lexicale sont égalem<strong>en</strong>t<br />
restés stables malgré <strong>la</strong><br />
concurr<strong>en</strong>ce des emprunts.<br />
Au V e siècle, l’arméni<strong>en</strong> a été<br />
doté d’un alphab<strong>et</strong> original,<br />
dont <strong>la</strong> création est attribuée<br />
<strong>à</strong> l’ecclésiastique Mesrob<br />
Machtots. C<strong>et</strong> alphab<strong>et</strong>, destiné<br />
<strong>à</strong> <strong>la</strong> traduction de <strong>la</strong> Bible,<br />
a immédiatem<strong>en</strong>t donné lieu <strong>à</strong><br />
une littérature c<strong>la</strong>ssique florissante.<br />
Les premières œuvres<br />
du V e siècle sont ess<strong>en</strong>tiellem<strong>en</strong>t<br />
historiographiques ;<br />
elles sont rapidem<strong>en</strong>t suivies<br />
d’œuvres théologiques <strong>et</strong><br />
de très nombreuses traductions<br />
du grec (Pères de<br />
l’Église, histori<strong>en</strong>s, théologi<strong>en</strong>s,<br />
philosophes), puis<br />
d’œuvres poétiques (hymnes,<br />
fables…), juridiques, sci<strong>en</strong>tifiques<br />
(grammaires, géographie,<br />
puis, au temps des invasions<br />
arabes, des traités<br />
médicaux <strong>et</strong> vétérinaires).<br />
Une <strong>la</strong>ngue moderne se rapprochant<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue parlée<br />
apparait pour <strong>la</strong> première fois<br />
dans les textes au XIII e siècle<br />
quand, fuyant les invasions<br />
mongoles, les Arméni<strong>en</strong>s quitt<strong>en</strong>t<br />
le p<strong>la</strong>teau arméni<strong>en</strong> <strong>et</strong> sa<br />
capitale Ani pour fonder un<br />
nouveau royaume <strong>en</strong> Cilicie.<br />
Alors que sous <strong>la</strong> dynastie<br />
précéd<strong>en</strong>te des Bagratides,<br />
on utilisait le grec ou l’aramé<strong>en</strong><br />
comme <strong>la</strong>ngue de chancellerie<br />
<strong>et</strong> l’arméni<strong>en</strong> c<strong>la</strong>ssique<br />
pour les usages religieux<br />
ou littéraires, le nouveau<br />
Royaume choisit pour <strong>la</strong> première<br />
fois de rédiger ses textes<br />
officiels, <strong>et</strong> notamm<strong>en</strong>t<br />
juridiques, dans une <strong>la</strong>ngue<br />
qui se veut compréh<strong>en</strong>sible<br />
par tous ; l’arméni<strong>en</strong> c<strong>la</strong>ssique<br />
reste toutefois <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
littéraire noble jusqu’au milieu<br />
du XIX e siècle, même si <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
moderne <strong>en</strong> gestation<br />
transparait dans différ<strong>en</strong>ts<br />
textes.<br />
Le XIX e siècle est celui de <strong>la</strong><br />
modernité pour les<br />
Arméni<strong>en</strong>s : une riche littérature<br />
se développe avec un<br />
courant romantique, puis <strong>la</strong><br />
naissance d’une prose<br />
réaliste, <strong>et</strong> une int<strong>en</strong>se activité<br />
de traduction d’œuvres<br />
occid<strong>en</strong>tales, <strong>en</strong> même temps<br />
qu’un travail de normalisation<br />
de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue moderne, qui<br />
devi<strong>en</strong>t <strong>la</strong>ngue littéraire. Puis<br />
<strong>à</strong> <strong>la</strong> charnière du XX e siècle, <strong>la</strong><br />
prise de consci<strong>en</strong>ce de <strong>la</strong><br />
richesse dialectale conduit <strong>à</strong><br />
un nouvel <strong>en</strong>richissem<strong>en</strong>t de<br />
<strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue moderne, notamm<strong>en</strong>t<br />
grâce <strong>à</strong> <strong>la</strong> découverte<br />
par les <strong>et</strong>hnographes de l’épopée<br />
orale de David de<br />
Sassoun, qui a fait l’obj<strong>et</strong>, <strong>en</strong><br />
1939 d’une édition intégrant<br />
l’<strong>en</strong>semble des récits<br />
recueillis dans diverses<br />
variantes dialectales. Après <strong>la</strong><br />
constitution de <strong>la</strong> grande<br />
diaspora consécutive au<br />
génocide de 1915, <strong>la</strong> culture<br />
arméni<strong>en</strong>ne occid<strong>en</strong>tale se<br />
développe hors de son territoire,<br />
que ce soit au Moy<strong>en</strong>-<br />
Ori<strong>en</strong>t ou ailleurs, considéré<br />
<strong>en</strong>core aujourd’hui comme le<br />
conservatoire de l’arméni<strong>en</strong><br />
occid<strong>en</strong>tal. En <strong>France</strong>, un courant<br />
littéraire important apparait<br />
<strong>à</strong> Paris <strong>en</strong>tre les deux<br />
guerres mondiales (voir l’article<br />
p. 4-5). Aujourd’hui, on<br />
compte <strong>en</strong> <strong>France</strong> deux<br />
grands poètes arméni<strong>en</strong>s :<br />
Krikor Beledian <strong>et</strong> Zou<strong>la</strong>l<br />
Kazandjian. Un quotidi<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>ngue arméni<strong>en</strong>ne, Haratch<br />
(audi<strong>en</strong>ce : <strong>en</strong>viron 10 000<br />
lecteurs, y compris hors de<br />
<strong>France</strong>), parait <strong>à</strong> Paris depuis<br />
plus de soixante-dix ans ; sont<br />
publiés égalem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>France</strong><br />
plusieurs journaux bilingues <strong>à</strong><br />
dominante arméni<strong>en</strong>ne<br />
(Gamk, quotidi<strong>en</strong>) ou <strong>française</strong><br />
(<strong>France</strong>-Arménie, m<strong>en</strong>suel<br />
; Achkar, hebdomadaire).<br />
L’arméni<strong>en</strong> occid<strong>en</strong>tal est<br />
désormais parlé uniquem<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> diaspora, ce qui a des<br />
conséqu<strong>en</strong>ces sur son développem<strong>en</strong>t<br />
sociolinguistique :<br />
les locuteurs font un usage le<br />
plus souv<strong>en</strong>t restreint des<br />
registres stylistiques, soit par<br />
manque de compét<strong>en</strong>ce, soit<br />
au contraire par purisme.<br />
Ajouté au bilinguisme massif,<br />
le phénomène des néo-locuteurs,<br />
qui n’est pas <strong>en</strong>core<br />
dominant, mais pourrait le<br />
dev<strong>en</strong>ir, conduit <strong>à</strong> l’émerg<strong>en</strong>ce<br />
de nouvelles ramifications<br />
dialectales fondées sur<br />
le type de bilinguisme auquel<br />
sont confrontés les locuteurs<br />
de l’arméni<strong>en</strong> occid<strong>en</strong>tal : <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>ngue évolue <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> différemm<strong>en</strong>t<br />
dans les foyers<br />
anglophones, francophones,<br />
hispanophones, par le biais<br />
notamm<strong>en</strong>t de calques des<br />
<strong>la</strong>ngues de contact (comme<br />
« troisième âge » v<strong>en</strong>u du français).<br />
Mais certains dialectes<br />
arméni<strong>en</strong>s subsist<strong>en</strong>t <strong>en</strong>core<br />
dans certaines régions,<br />
notamm<strong>en</strong>t au Moy<strong>en</strong>-Ori<strong>en</strong>t,<br />
<strong>et</strong> <strong>en</strong>richiss<strong>en</strong>t <strong>la</strong> vitalité de<br />
l’arméni<strong>en</strong> occid<strong>en</strong>tal. Dans<br />
toute <strong>la</strong> diaspora, <strong>et</strong> notamm<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong> <strong>France</strong>, un r<strong>en</strong>ouveau<br />
linguistique se manifeste <strong>à</strong><br />
partir des années 1970,<br />
lorsque <strong>la</strong> troisième génération,<br />
parfaitem<strong>en</strong>t intégrée,<br />
cherche <strong>à</strong> se réapproprier sa<br />
<strong>la</strong>ngue d’origine. L’essor<br />
réc<strong>en</strong>t des écoles bilingues<br />
franco-arméni<strong>en</strong>nes est le<br />
signe de <strong>la</strong> poursuite de ce<br />
mouvem<strong>en</strong>t.