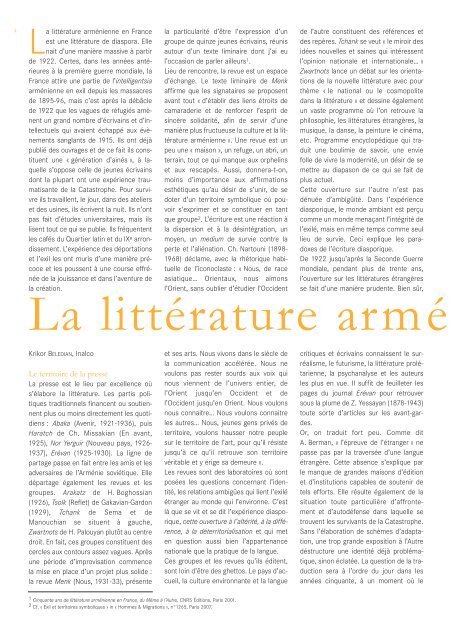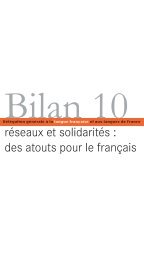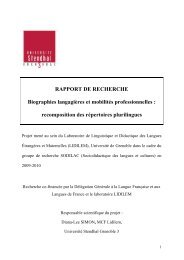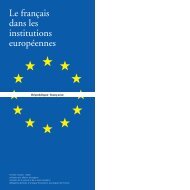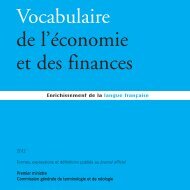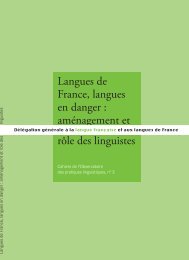L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
L'arménien en France - Délégation générale à la langue française et ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
4<br />
La littérature arméni<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> <strong>France</strong> <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité d’être l’expression d’un de l’autre constitu<strong>en</strong>t des référ<strong>en</strong>ces <strong>et</strong><br />
est une littérature de diaspora. Elle groupe de quinze jeunes écrivains, réunis des repères. Tchank se veut « le miroir des<br />
nait d’une manière massive <strong>à</strong> partir autour d’un texte liminaire dont j’ai eu idées nouvelles <strong>et</strong> saines qui intéress<strong>en</strong>t<br />
de 1922. Certes, dans les années antérieures<br />
<strong>à</strong> <strong>la</strong> première guerre mondiale, <strong>la</strong><br />
<strong>France</strong> attire une partie de l’intellig<strong>en</strong>tsia<br />
arméni<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> exil depuis les massacres<br />
de 1895-96, mais c’est après <strong>la</strong> débâcle<br />
de 1922 que les vagues de réfugiés amèn<strong>en</strong>t<br />
un grand nombre d’écrivains <strong>et</strong> d’intellectuels<br />
qui avai<strong>en</strong>t échappé aux évènem<strong>en</strong>ts<br />
sang<strong>la</strong>nts de 1915. Ils ont déj<strong>à</strong><br />
publié des ouvrages <strong>et</strong> de ce fait ils constitu<strong>en</strong>t<br />
une « génération d’ainés », <strong>à</strong> <strong>la</strong>quelle<br />
s’oppose celle de jeunes écrivains<br />
dont <strong>la</strong> plupart ont une expéri<strong>en</strong>ce traumatisante<br />
de <strong>la</strong> Catastrophe. Pour survivre<br />
ils travaill<strong>en</strong>t, le jour, dans des ateliers<br />
<strong>et</strong> des usines, ils écriv<strong>en</strong>t <strong>la</strong> nuit. Ils n’ont<br />
pas fait d’études universitaires, mais ils<br />
lis<strong>en</strong>t tout ce qui se publie. Ils fréqu<strong>en</strong>t<strong>en</strong>t<br />
les cafés du Quartier <strong>la</strong>tin <strong>et</strong> du IX e arrondissem<strong>en</strong>t.<br />
L’expéri<strong>en</strong>ce des déportations<br />
<strong>et</strong> l’exil les ont muris d’une manière précoce<br />
<strong>et</strong> les pouss<strong>en</strong>t <strong>à</strong> une course effrénée<br />
de <strong>la</strong> jouissance <strong>et</strong> dans l’av<strong>en</strong>ture de<br />
l’occasion de parler ailleurs 1 .<br />
Lieu de r<strong>en</strong>contre, <strong>la</strong> revue est un espace<br />
d’échange. Le texte liminaire de M<strong>en</strong>k<br />
affirme que les signataires se propos<strong>en</strong>t<br />
avant tout « d’établir des li<strong>en</strong>s étroits de<br />
camaraderie <strong>et</strong> de r<strong>en</strong>forcer l’esprit de<br />
sincère solidarité, afin de servir d’une<br />
manière plus fructueuse <strong>la</strong> culture <strong>et</strong> <strong>la</strong> littérature<br />
arméni<strong>en</strong>ne ». Une revue est un<br />
peu une « maison », un refuge, un abri, un<br />
terrain, tout ce qui manque aux orphelins<br />
<strong>et</strong> aux rescapés. Aussi, donnera-t-on,<br />
moins d’importance aux affirmations<br />
esthétiques qu’au désir de s’unir, de se<br />
doter d’un territoire symbolique où pouvoir<br />
s’exprimer <strong>et</strong> se constituer <strong>en</strong> tant<br />
que groupe 2 . L’écriture est une réaction <strong>à</strong><br />
<strong>la</strong> dispersion <strong>et</strong> <strong>à</strong> <strong>la</strong> désintégration, un<br />
moy<strong>en</strong>, un medium de survie contre <strong>la</strong><br />
perte <strong>et</strong> l’aliénation. Ch. Nartouni (1898-<br />
1968) déc<strong>la</strong>me, avec <strong>la</strong> rhétorique habituelle<br />
de l’iconoc<strong>la</strong>ste : « Nous, de race<br />
asiatique… Ori<strong>en</strong>taux, nous aimons<br />
l’opinion nationale <strong>et</strong> internationale… »<br />
Zwartnots <strong>la</strong>nce un débat sur les ori<strong>en</strong>tations<br />
de <strong>la</strong> nouvelle littérature avec pour<br />
thème « le national ou le cosmopolite<br />
dans <strong>la</strong> littérature » <strong>et</strong> dessine égalem<strong>en</strong>t<br />
un vaste programme où l’on r<strong>et</strong>rouve <strong>la</strong><br />
philosophie, les littératures étrangères, <strong>la</strong><br />
musique, <strong>la</strong> danse, <strong>la</strong> peinture le cinéma,<br />
<strong>et</strong>c. Programme <strong>en</strong>cyclopédique qui traduit<br />
une boulimie de savoir, une <strong>en</strong>vie<br />
folle de vivre <strong>la</strong> modernité, un désir de se<br />
m<strong>et</strong>tre au diapason de ce qui se fait de<br />
plus actuel.<br />
C<strong>et</strong>te ouverture sur l’autre n’est pas<br />
dénuée d’ambigüité. Dans l’expéri<strong>en</strong>ce<br />
diasporique, le monde ambiant est perçu<br />
comme un monde m<strong>en</strong>açant l’intégrité de<br />
l’exilé, mais <strong>en</strong> même temps comme seul<br />
lieu de survie. Ceci explique les paradoxes<br />
de l’écriture diasporique.<br />
De 1922 jusqu’après <strong>la</strong> Seconde Guerre<br />
mondiale, p<strong>en</strong>dant plus de tr<strong>en</strong>te ans,<br />
l’ouverture sur les littératures étrangères<br />
<strong>la</strong> création.<br />
l’Ori<strong>en</strong>t, sans oublier d’étudier l’Occid<strong>en</strong>t se fait d’une manière prud<strong>en</strong>te. Bi<strong>en</strong> sûr,<br />
La littérature armé<br />
Krikor BELEDIAN, Inalco<br />
Le territoire de <strong>la</strong> presse<br />
La presse est le lieu par excell<strong>en</strong>ce où<br />
s’é<strong>la</strong>bore <strong>la</strong> littérature. Les partis politiques<br />
traditionnels financ<strong>en</strong>t ou souti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t<br />
plus ou moins directem<strong>en</strong>t les quotidi<strong>en</strong>s<br />
: Abaka (Av<strong>en</strong>ir, 1921-1936), puis<br />
Haratch de Ch. Missakian (En avant,<br />
1925), Nor Yerguir (Nouveau pays, 1926-<br />
1937), Erévan (1925-1930). La ligne de<br />
partage passe <strong>en</strong> fait <strong>en</strong>tre les amis <strong>et</strong> les<br />
adversaires de l’Arménie soviétique. Elle<br />
départage égalem<strong>en</strong>t les revues <strong>et</strong> les<br />
groupes. Arakatz de H. Boghossian<br />
(1926), Tsolk (Refl<strong>et</strong>) de Gakavian-Gardon<br />
(1929), Tchank de Sema <strong>et</strong> de<br />
Manouchian se situ<strong>en</strong>t <strong>à</strong> gauche,<br />
Zwartnots de H. Palouyan plutôt au c<strong>en</strong>tre<br />
droit. En fait, ces groupes constitu<strong>en</strong>t des<br />
cercles aux contours assez vagues. Après<br />
une période d’improvisation comm<strong>en</strong>ce<br />
<strong>la</strong> mise <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ce d’un proj<strong>et</strong> plus solide :<br />
<strong>la</strong> revue M<strong>en</strong>k (Nous, 1931-33), prés<strong>en</strong>te<br />
<strong>et</strong> ses arts. Nous vivons dans le siècle de<br />
<strong>la</strong> communication accélérée. Nous ne<br />
voulons pas rester sourds aux voix qui<br />
nous vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t de l’univers <strong>en</strong>tier, de<br />
l’Ori<strong>en</strong>t jusqu’<strong>en</strong> Occid<strong>en</strong>t <strong>et</strong> de<br />
l’Occid<strong>en</strong>t jusqu’<strong>en</strong> Ori<strong>en</strong>t. Nous voulons<br />
nous connaitre… Nous voulons connaitre<br />
les autres… Nous, jeunes g<strong>en</strong>s privés de<br />
territoire, voulons hausser notre peuple<br />
sur le territoire de l’art, pour qu’il résiste<br />
jusqu’<strong>à</strong> ce qu’il r<strong>et</strong>rouve son territoire<br />
véritable <strong>et</strong> y érige sa demeure ».<br />
Les revues sont des <strong>la</strong>boratoires où sont<br />
posées les questions concernant l’id<strong>en</strong>tité,<br />
les re<strong>la</strong>tions ambigües qui li<strong>en</strong>t l’exilé<br />
étranger au monde qui l’<strong>en</strong>vironne. C’est<br />
l<strong>à</strong> que se vit <strong>et</strong> se dit l’expéri<strong>en</strong>ce diasporique,<br />
c<strong>et</strong>te ouverture <strong>à</strong> l’altérité, <strong>à</strong> <strong>la</strong> différ<strong>en</strong>ce,<br />
<strong>à</strong> <strong>la</strong> déterritorialisation <strong>et</strong> qui m<strong>et</strong><br />
<strong>en</strong> question aussi bi<strong>en</strong> l’appart<strong>en</strong>ance<br />
nationale que <strong>la</strong> pratique de <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue.<br />
Ces groupes <strong>et</strong> les revues qu’ils édit<strong>en</strong>t,<br />
sont loin d’être des gh<strong>et</strong>tos. Le pays d’accueil,<br />
<strong>la</strong> culture <strong>en</strong>vironnante <strong>et</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue<br />
critiques <strong>et</strong> écrivains connaiss<strong>en</strong>t le surréalisme,<br />
le futurisme, <strong>la</strong> littérature prolétari<strong>en</strong>ne,<br />
<strong>la</strong> psychanalyse <strong>et</strong> les auteurs<br />
les plus <strong>en</strong> vue. Il suffit de feuill<strong>et</strong>er les<br />
pages du journal Erévan pour r<strong>et</strong>rouver<br />
sous <strong>la</strong> plume de Z. Yessayan (1878-1943)<br />
toute sorte d’articles sur les avant-gardes.<br />
Or, on traduit fort peu. Comme dit<br />
A. Berman, « l’épreuve de l’étranger » ne<br />
passe pas par <strong>la</strong> traversée d’une <strong>la</strong>ngue<br />
étrangère. C<strong>et</strong>te abs<strong>en</strong>ce s’explique par<br />
le manque de grandes maisons d’édition<br />
<strong>et</strong> d’institutions capables de sout<strong>en</strong>ir de<br />
tels efforts. Elle résulte égalem<strong>en</strong>t de <strong>la</strong><br />
situation toute particulière d’affrontem<strong>en</strong>t<br />
<strong>et</strong> d’autodéf<strong>en</strong>se dans <strong>la</strong>quelle se<br />
trouv<strong>en</strong>t les survivants de <strong>la</strong> Catastrophe.<br />
Sans l’é<strong>la</strong>boration de schèmes d’adaptation,<br />
une trop grande exposition <strong>à</strong> l’Autre<br />
déstructure une id<strong>en</strong>tité déj<strong>à</strong> problématique,<br />
sinon éc<strong>la</strong>tée. La question de <strong>la</strong> traduction<br />
sera <strong>à</strong> l’ordre du jour dans les<br />
années cinquante, <strong>à</strong> un mom<strong>en</strong>t où le<br />
1 Cinquante ans de littérature arméni<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> <strong>France</strong>, du Même <strong>à</strong> l’Autre, CNRS Éditions, Paris 2001.<br />
2 Cf. « Exil <strong>et</strong> territoires symboliques » in « Hommes & Migrations », n°1265, Paris 2007.