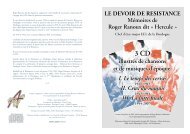Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VALENTINE HENRIETTE <strong>PRAX</strong> (BÔNE 1897 - PARIS 1981) 1<br />
Ataviquement méditerranéenne, elle naquit de parents français, son père d’origine catalane, propriétaire forestier et viceconsul<br />
d’Espagne et du Portugal à Bône et poète à ses heures, et sa mère, de lignage sicilien en passant par Marseille. Elle<br />
grandit en Afrique du Nord, étudie durant deux ans à l'École des Beaux-Arts d'Alger avant de s’installer à Paris en 1919, à<br />
peine majeure, sans doute inspirée par un jeune artiste Russe émigré. Elle emménage dans une pauvre et glaciale «cage de<br />
verre» servant d’atelier, rue Rousselet où elle fait connaissance d'un de ses voisins : Ossip Zadkine, connu de Montparnasse,<br />
âgé de 29 ans. Protégé du Prince amateur et mécène Paul Rodocanacchi, ce sculpteur fougueux d'origine russe métissé<br />
d’écossais par sa mère, à l’«allure curieuse» dira-t-elle et très drôle, était déjà célèbre non seulement en France mais aussi à<br />
Londres, Berlin, Amsterdam… Elle partage avec lui idées et idéal artistique, nourris d’une vaste et profonde culture, l’esprit<br />
toujours en recherche, initiant ainsi une indéfectible relation à laquelle pour sa part, elle n’apportera jamais d’infidélité. Autour<br />
de Montparnasse, elle est avec lui immédiatement introduite dans ce monde cosmopolite d'artistes novateurs, où elle trouve<br />
bientôt sa place. Entre la Rotonde et le Dôme, la Grande Chaumière et la Ruche, les manifestes des Salons des Indépendants,<br />
d’Automne et des Tuileries, l’École de Paris en sa bouillante aventure dans ces Années folles, rassemble les plus prometteurs<br />
et pour certains déjà, les plus grands talents. Inspirés par les grands aînés qu’ils fréquentent également tel Rodin, les<br />
Zadkine rencontrent un vertigineux aréopage concentrant génie et créativité, avec parmi eux et sans rigoureuse chronologie,<br />
André Lhote, Fernand Léger, les jeunes Russes émigrés dont Marie Vassilieff, Chagall, Soudbinine, Archipenko, Ivanov…,<br />
Brancusi, Lipchitz, Survage et Delaunay, Zarate, Dietrich, Matisse ou Man Ray, Marie Laurencin et la baronne d’Oettingen<br />
alias Angibout, la pianiste Margit Varo, le compositeur Erik Satie, le groupe des Six (les compositeurs Georges Auric, Louis<br />
Durey, Darius Milhaud, Arthur Honegger, Germaine Taillefer et Francis Poulenc dont le nom s’attachera plus tard à Rocamadour),<br />
Scriabine, Stravinski, Thompson, Isadora Duncan, Diaghilev et Lifar … et tant d’autres tels le collectionneur Barnes, l’architecte<br />
Adrien Blomme, le critique Georges Duthuit, les poètes Cendrars et Max Jacob, Robert Desnos, Jean Cocteau, Paul<br />
Eluard, André Breton et Tristan Tzara, Joseph Émile-Rignault, Jean Lurçat, Pierre Betz, René Huyghes plus tard … <strong>Valentine</strong><br />
évoque encore, en sa seule deuxième visite à la Rotonde… «Soutine 2 , Modigliani, René Durey, Léopold Lévy, Henry Ramey,<br />
Ehrenbourg, Zborowsky, Foujita…». De nombreuses rencontres majeures jalonnèrent ainsi toute la vie du couple, comme un<br />
peu plus tard encore par exemple, au Dôme, avec celle d’Henry Miller… 3 «C’est alors que je découvris la Peinture : les cubistes,<br />
les fauves, Picasso, Braque, Ensor, Van Dongen, Dufresne…» plus tard encore Bourdelle, Cézanne, … Vollard,<br />
Rouault, et tant d’autres : l’énumération ne s’en peut être exhaustive sans énumérer pratiquement tout ce que l’art et l’histoire<br />
moderne aura compté…<br />
Dès 1919, la jeune femme publie un poème dans les Lettres parisiennes. Zadkine s’était exclamé : «Voilà, vous êtes poète !<br />
Laissez dessins et peintures. Écrivez… Mais je vous avertis, vous crèverez de faim.» 4 . Elle présente sa première exposition<br />
personnelle à Paris, Galerie Mouninou rue Marboeuf. Elle fréquente l’Académie de la Grande Chaumière lorsqu’elle peut en<br />
payer les leçons en se privant de manger, expose à la galerie La Licorne.<br />
Tout va très vite pour elle dès son arrivée : le 14 août 1920 elle épouse Zadkine à Bruniquel au cœur de ce Quercy «grandiose<br />
et sévère, sauvage et intact» qui accompagnera désormais leur vie. Avec pour seuls invités les parents de <strong>Valentine</strong> et<br />
pour témoins Foujita et Fernande Barrey sa compagne. Les jeune époux sont si pauvres que les alliances leurs sont prêtées<br />
et que la chambre nuptiale est à tous vents. En 1921, ils y achèteront une maison délabrée, mais à la belle porte Renaissance…<br />
Au cours des années suivantes, <strong>Valentine</strong> Prax est l'une des rares femmes peintres à s'imposer sur la scène artistique. Elle<br />
expose aux côtés de Charles Dufresne, son compatriote et mentor d’Afrique du Nord, qui la soutînt dans sa pauvreté parisienne.<br />
Elle accrochera ses toiles aussi, auprès de Picasso…<br />
1 Notes à partir du site de la Ville de Paris et complétées.<br />
2 Rappelons une fois de plus les liens entre le Lot et cette grande époque de l’art moderne, tandis qu’Émile Joseph-Rignault acquit le petit château de Saint-<br />
Cirq-Lapopie, devenu Musée départemental Rignault, propriété du Département, fut l’un des découvreurs et mécènes de Chaïm Soutine, dont les toiles qu’il<br />
lui acheta se trouvent au Musée Calvet d’Avignon.<br />
3 <strong>Valentine</strong> Prax, Avec Zadkine – Souvenirs de notre vie, La Bibliothèque des Arts, 1973, p. 44.<br />
4 Ibid., p. 19<br />
1
En 1924 elle expose à la Galerie Berthe Weill, présentant des peintures paysannes et des fixés sous verre très prisés, de<br />
technique rare et délicate qu’elle maîtrisait à merveille. En 1926, elle passe un contrat avec la Galerie Barbazanges tandis que<br />
Zadkine déménage à Paris de l’atelier de la rue Rousselot trop exigu, au <strong>10</strong>0 de la rue d’Assas.<br />
Pendant les années 30, elle participe aux heures glorieuses de Montparnasse, expose à Londres, Chicago, Philadelphie,<br />
Bruxelles…<br />
En 1936, la célèbre Galerie Jeanne-Bucher la présente, seule femme, dans le cadre de l’Exposition du Collectionneur Henri<br />
Laugier, auprès de peintures de Georges Braque, Raoul Dufy, Fernand Léger, Jean Lurçat, Louis Marcoussis, Joan Miro, Pablo<br />
Picasso, Utrillo, Tchelitchevn, de statues de Henri Laurens et de tapisseries de Lurçat et Rouault.<br />
Participant à l'Exposition universelle de 1937, elle réalise une grande verrière pour le Musée d'Art Moderne de Paris sur le<br />
thème de l’Aviation, qui lui vaudra une médaille d’or.<br />
La rencontre d’amour avec la terre du Lot remonte à 1934, lors d’un premier voyage dans le département. Zadkine et sa<br />
femme, alors financièrement plus à l’aise, achètent le Manoir des Arques, au cœur de ce petit village préservé dont cette élection<br />
garantira le renouveau dans la seconde moitié du XXe siècle. Il fut le lieu de création de nombreuses sculptures inspirées<br />
du cœur de ses forêts dont nombre de vieux arbres se réincarnèrent en géants animés. Zadkine aménage dans la vieille demeure,<br />
quatre ateliers partagés par le ménage. Le couple est resté sans enfant, creusant cette douleur d’une Maternité impossible<br />
exprimée secrètement par <strong>Valentine</strong>...<br />
En 1939 elle travaille dans la retraite lotoise sur des cartons de tapisserie pendant que Zadkine finit de tailler son grand Christ<br />
en bois. Jean Lurçat l’avait encouragée : «Votre projet m’avait beaucoup plu et, je dois ajouter, donné confiance dans les possibilités<br />
des peintres à s’adapter vite aux conditions et exigences techniques de la tapisserie». Trop coûteuse, la réalisation à<br />
Aubusson ne pourra se faire…<br />
En septembre 1940, «V., comme l’écrit Zadkine dans ses Carnets Intimes, veut absolument retourner à Paris, ce Paris devenu<br />
presque mystérieux tant il est séparé de nous, de tout le monde, de toute la terre par un rideau de fer. Elle est très émue et<br />
maternelle, et parle de sa disparition, de tout ce qu’il faut faire. Elle est comme sur un radeau qui attend la vague pour être enlevée…<br />
Je vois encore son profil charmant et ses cheveux que le vent brosse sauvagement… ».<br />
En juin 1941, émigre à New York Zadkine dont les origines juives prenaient une place intime, éprouvant dans sa chair devant<br />
les menaces hitlériennes cette inquiétude, inconnue jusqu’alors, plongeant en lui ses aiguilles… sous l’emprise d’une pieuvre<br />
au mal honteux, affreux, empoisonnant peu à peu tout [son] être 5 . <strong>Valentine</strong> demeurera seule dans le refuge de la zone libre<br />
durant les heures tragiques de la Guerre. Elle entendait ainsi courageusement, en demeurant en terre de France, préserver<br />
leurs biens et surtout les œuvres tant à Paris qu’aux Arques où s’écouleront durement les heures sombres et solitaires. Gaulliste<br />
et anglophile, elle fut inquiétée pour être l’épouse d’un juif. Elle dût «déterrer des papiers de baptême d’aryenne» pour<br />
échapper aux persécutions nazies et de certains requins … ainsi que les désigna son époux à son retour, l’obligeant à se réfugier<br />
chez une amie, ne pouvant même préserver toutes les œuvres dont Zadkine en retrouvera jetées dehors. Cette période si<br />
douloureuse de repli lotois fut toutefois, à cause de cela et, tout en même temps grâce à ces souffrances dont elle sût noblement<br />
faire résilience, parmi les plus fécondes de sa vie de créatrice.<br />
En 1944, elle eut à croire au décès annoncé de Zadkine à New York : «Durant dix jours, je vécu dans le désespoir le plus noir.<br />
Ainsi finissait cette attente douloureuse qui m’avait soutenue pendant quatre ans… J’appris que la nouvelle… était fausse, inventée<br />
pour me tuer à distance par une personne mal intentionnée…» 6 Toutefois en 1945, conscient ou non de ce sinistre canular,<br />
Zadkine télégraphie : «Suis malade, malheureux, sans argent. Acceptes-tu que je revienne »… Revenant tous deux<br />
aux Arques, Zadkine écrira «<strong>Valentine</strong> était auprès de moi ; plus rien d’autre ne comptait. J’étais heureux…» 7 Toutefois, la reprise<br />
d’une vie si bouleversée ne fut ni simple ni si lumineuse. Rien ne sera plus jamais comme avant, observe Nancy Huston.<br />
Les années 1960 consacrent le Peintre <strong>Valentine</strong> Prax avec en 1963 son importante exposition à la Galerie Katia Granoff présentant<br />
cinquante trois tableaux 8 . Passant par l’expression de sa colère et de sa vengeance, particulièrement blessée par<br />
l’aventure de «l’américaine mal intentionnée», elle sublimera sa révolte, témoignant ainsi de sa noblesse d’âme et revenant à<br />
l’essentiel de sa Vie intérieure (1955) en faisant appel à des puissances mystérieuses des femmes (N. H.).<br />
À la mort de Zadkine en 1967 et sur la volonté expresse du défunt, elle travaille à la création d'un musée parisien dans la maison<br />
où a vécu et travaillé l'artiste de 1928 à 1967, constitué d'un fonds d'environ trois cents œuvres de son époux. Celui-ci<br />
dans son testament, souhaitait pour établir la mémoire de sa vie, donner priorité à sa maison des Arques qui abritait encore<br />
ses ateliers qu’il fréquentait durant les étés ainsi que quelques semaines en hiver : celle-ci fut vendue un peu plus tard à un<br />
particulier. Peut-être, encore blessée par les années douloureuses de son repli pendant la guerre, autant que par souci de<br />
5 D’après Zadkine, in Sylvain Lecombre, Ossip Zadkine - L’œuvre sculpté, Paris, 1994, p. 214.<br />
6 Gaston Louis-Marchal, Ossip Zadkine – La sculpture … toute une vie, éd. du Rouergue, 1992, p.<strong>10</strong>9<br />
7 Zadkine, in Le Maillet et le Ciseau, souvenirs de ma vie, Albin Michel, 1968<br />
8 Cf. Sylvain Lecombre, Catalogue Couvent des Cordelier, pp 11-17…<br />
2
donner à l’Œuvre de Zadkine le renom d’une adresse parisienne, sa veuve favorisa la Ville de Paris en effectuant une donation<br />
en 1978, officialisant le legs en 1980.<br />
<strong>Valentine</strong> meurt le 15 avril 1981 à Paris, ayant souffert d’une douloureuse maladie des reins. Elle lègue l'ensemble de ses<br />
biens au musée, réservant cependant «des documents inestimables» 9 à Gaston-Louis Marchal, ami quercynois des Zadkine.<br />
Elle repose désormais dans le cimetière Montparnasse, y rejoignant symboliquement l’éponyme empyrée des Artistes.<br />
Le 19 avril 1982 est inauguré le Musée Zadkine de Paris qui possède également des œuvres de <strong>Valentine</strong>, dont un fonds important<br />
existe notamment tant en musées publics comme ceux de Paris au Musée national d’art moderne – Georges Pompidou,<br />
de Grenoble, Bordeaux, Céré ou pour l’étranger, Amsterdam…, qu’en collections privées, telle la Galerie Quintessens<br />
d’Utrecht. De nombreuses œuvres, tant pour les huiles que pour les gouaches ou ses admirables dessins, furent détruites soit<br />
par l’artiste elle-même, soit par fait de vandalisme de guerre notamment. Son héritage aussi bien intellectuel et poétique que<br />
pictural, demeure certainement encore à approfondir, avec des redécouvertes toujours possibles, afin de lui rendre sa place<br />
méritée dans l’histoire de l’art du XX e siècle.<br />
« N’empêche que ce mystère de la «beauté» et celui de ce cheminement personnel qui m’amena à admirer les choses<br />
qui m’étaient, ou m’auraient été, repoussantes dans ma jeunesse, je ne les ai pas vraiment éclaircis.<br />
Je veux aujourd’hui appeler «beauté» l’objet, la forme, la couleur, le son<br />
qui satisfait en nous un désir de voir et regarder encore ou d’entendre davantage,<br />
de posséder le moyen d’exalter en nous le meilleur de nous-mêmes,<br />
ce qui donne la satisfaction d’éprouver le besoin d’un amour,<br />
ce qui – somme toute –- provoque en nous du bonheur. »<br />
<strong>Valentine</strong> Prax, Avec Zadkine…, op. cit., p. 75<br />
© Isabelle Rooryck<br />
Conservateur en chef départemental des Musées du Lot<br />
9 Gaston Louis-Marchal, op. cit., p. 7<br />
3
À propos de <strong>Valentine</strong> Prax<br />
«Deux précédents jouèrent et continuent à jouer durant la vie de <strong>Valentine</strong> Prax.<br />
Ces deux précédents sont d’un ordre atavique, de particulière préhistoire : un repli antique très sensible, d’une<br />
part, né des origines catalanes et siciliennes d’ancêtres allés en Algérie et marié, par la suite et, d’autre part, à un<br />
repli français.<br />
Les débuts parisiens du peintre <strong>Valentine</strong> Prax furent durs, comme pour nous tous. Par nature, la jeune<br />
femme savait regarder ; et ses visites aux musées lui ont vite appris ce qu’il faut d’abord faire de soi et pour soi<br />
avant de vouloir œuvrer par le dessin ou la couleur :<br />
- créer en soi un nouvel être ;<br />
- non seulement trouver en soi le narrateur et l’accentuer mais aussi, en soi, renouveler le langage de l’objet peint<br />
ainsi que les nouveaux moyens de peindre l’objet ;<br />
- armer les yeux de moyens nouveaux de voir et libérer l’objet de sa gaine compliquée et descriptive ; en finir avec<br />
la description habile et photographique, accentuer la poésie des objets tantôt éclatants, tantôt sourds pour l’âme<br />
en veilleuse qui éclaire les objets du dedans et y décèle l’intéressante chose cachée ;<br />
- chercher en soi la résonance des mondes multiples qui déploient leur éventail d’un film souvent timide dans l’espoir<br />
que vienne l’œil perspicace ; choisir ce qui se marie le mieux avec son âme et qui fait de soi un Monde Enchanté…<br />
C’est là un programme pour exécuter lequel il ne faut perdre ni ses penchants, ni son angle de vision, ni cette<br />
forêt de choses qu’on aime toute sa vie.<br />
<strong>Valentine</strong> Prax eut tôt un penchant pour les rues de villages pauvres, pour les intérieurs de maisons paysannes.<br />
Elle affectionnait des rues solitaires aux fenêtres aveugles. Aussi leur fit-elle chanter, à sa façon, leurs<br />
mélancolie et solitude. Son œuvre, jusqu’à la guerre de 1939-45, fut animée par cette poétisation de ce que la vie<br />
ébranlante et hâtive de cette époque abandonnait dans les villages du sud-ouest français.<br />
Les persécutions, les affres de la guerre, la solitude aussi ont fait éclore une autre série de grandes toiles pour<br />
lesquelles <strong>Valentine</strong> Prax a exprimé son horreur de la destruction et de l’impuissance de l’être humain devant le<br />
fléau dévastateur ou vis-à-vis de la brute ricanante qui fait mourir le poète et le soleil.<br />
Après la guerre, elle est revenue au paysage qu’elle peupla de personnages et d’animaux, et aux naturesmortes<br />
pour construire lesquelles insista sur la composition de formes convergeant vers un centre lumineux. Dans<br />
cette peinture d’après-guerre, souvent des personnages avec instruments de musique regardent sur l’espace ouvert,<br />
médusés plus par un silence que par une sorte de suspense devant lequel le spectateur est laissé seul avec<br />
lui-même, comme s’il écoutait et se retrouvait soudain, les yeux plongés dans l’ouverture d’une grande et merveilleuse<br />
fenêtre.<br />
Dans les tout derniers tableaux, le sujet peint se dédouble, personnage et bête, homme ou femme et oiseaux<br />
qui n’existent pas…, les têtes se détachant sur des villes féeriques qui éclosent au lointain dans la mer. On est attiré<br />
par ces tableaux aux floraisons dans les vagues marines et le regard ne peut qu’accepter l’invitation à s’en aller<br />
là-bas, où tout est léger et imprécis.<br />
Le retour vers le paysage perdu, fantastique et toujours marin, rouvre la page atavique sur laquelle tout est<br />
écrit et coloré, des aubes et azurs du grand Jadis où tout est indiqué, sagement, de ce qui doit être pour toujours.»<br />
Ossip Zadkine<br />
Les Arques, août 1965<br />
4