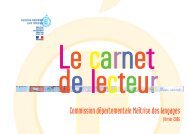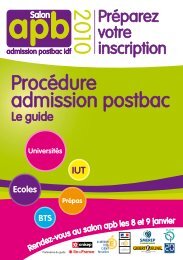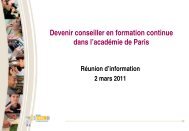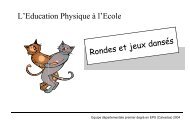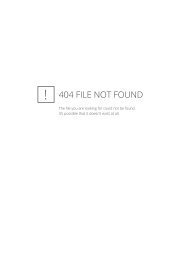que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse
que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse
que faire des stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le Français aujourd’hui n° 149, La <strong>littérature</strong> de <strong>jeunesse</strong> : repères, enjeux et prati<strong>que</strong>s<br />
ches re<strong>la</strong>tivement récentes 3 pour tenter finalement d’envisager <strong>des</strong><br />
parcours de lecture susceptibles de favoriser les rencontres, l’appréciation,<br />
<strong>la</strong> maitrise progressive de ces stéréotypies aux différents niveaux de <strong>la</strong> sco<strong>la</strong>rité.<br />
Les criti<strong>que</strong>s traditionnelles<br />
Les bonnes raisons <strong>que</strong> l’on peut avoir de criti<strong>que</strong>r les <strong>stéréotypes</strong> ont été<br />
<strong>la</strong>rgement énoncées aussi bien dans les sciences sociales, qu’en <strong>littérature</strong><br />
ou en analyse du discours. En tant <strong>que</strong> représentations toutes faites et<br />
figées, en tant <strong>que</strong> schèmes préexistants, <strong>à</strong> l’aide <strong>des</strong><strong>que</strong>ls chacun filtre <strong>la</strong><br />
réalité ambiante, les <strong>stéréotypes</strong> peuvent présenter un caractère nocif,<br />
déplorable et déploré quand ils nuisent aux individus pour les disqualifier<br />
sans aucune base objective. En ce qui concerne l’enseignement du français,<br />
les discours sur les <strong>stéréotypes</strong> peuvent être développés de trois points de<br />
vue qui renvoient <strong>à</strong> l’histoire <strong>des</strong> formes littéraires, <strong>à</strong> <strong>la</strong> position <strong>des</strong> auteurs<br />
et enfin <strong>à</strong> <strong>la</strong> formation du lecteur. En <strong>littérature</strong>, <strong>la</strong> criti<strong>que</strong> s’est intéressée<br />
aux dimensions esthéti<strong>que</strong>s mais aussi sociales <strong>des</strong> <strong>stéréotypes</strong>. Le stéréotype<br />
se niche dans une formule banale, une figure, un discours, une vision<br />
exprimant ou résumant une opinion toute faite qui réduit les particu<strong>la</strong>rités.<br />
Il surdétermine un schéma littéraire ou <strong>la</strong> mise en scène d’une situation.<br />
On l’associe fré<strong>que</strong>mment au cliché dans un renvoi <strong>à</strong> <strong>des</strong> représentations<br />
condensées, schématisées, <strong>à</strong> <strong>des</strong> lieux communs, <strong>des</strong> idées reçues pour<br />
présenter, décrire, analyser <strong>à</strong> l’aide de formes répétitives, attendues, sans<br />
originalité, quasi pétrifiées. De l<strong>à</strong>, l’illégitimité et <strong>la</strong> condamnation<br />
fré<strong>que</strong>nte de toute <strong>littérature</strong> qui repose sur ce procédé. La posture de<br />
l’écrivain <strong>à</strong> l’égard du stéréotype est d’ailleurs une revendication et un trait<br />
de distinction. Par réflexe esthéti<strong>que</strong> ou individualiste l’écrivain cherche<br />
autre chose <strong>que</strong> <strong>la</strong> doxa ou l’expression banale. La <strong>littérature</strong> de masse et <strong>la</strong><br />
para<strong>littérature</strong> ont été dépréciées par <strong>la</strong> criti<strong>que</strong> et marginalisées au motif<br />
<strong>que</strong> ce type de production use et abuse du procédé pour f<strong>la</strong>tter un lecteur<br />
prisonnier par ailleurs de <strong>que</strong>l<strong>que</strong>s formes simples. La <strong>littérature</strong> de<br />
<strong>jeunesse</strong> a souvent été c<strong>la</strong>ssée dans cette para<strong>littérature</strong> pour <strong>des</strong> raisons du<br />
même ordre. S’adressant <strong>à</strong> de jeunes enfants qu’il convient d’édu<strong>que</strong>r,<br />
nombre d’auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs ont longtemps stipulé <strong>que</strong><br />
les textes qu’on leur <strong>des</strong>tine ne doivent pas rechercher <strong>la</strong> subtilité de l’effet<br />
littéraire ou esthéti<strong>que</strong> mais l’efficacité pédagogi<strong>que</strong> et commerciale.<br />
Georges Chaulet, créateur de Fantomette, confiait <strong>que</strong> dans un roman<br />
pour <strong>la</strong> <strong>jeunesse</strong>, « D’abord et avant tout, il faut qu’il y ait <strong>des</strong> bons et <strong>des</strong><br />
méchants ». De l<strong>à</strong>, un assez <strong>la</strong>rge recours aux <strong>stéréotypes</strong> et clichés pour<br />
raconter <strong>des</strong> histoires et faciliter leur appropriation <strong>à</strong> partir de principes<br />
fort simples et de techni<strong>que</strong>s rodées. Dans les cas les plus célèbres, il apparait<br />
<strong>que</strong> c’est précisément, <strong>la</strong> simplicité <strong>des</strong> comparaisons et <strong>des</strong> représen-<br />
3. Ruth Amossy, Les Idées reçues : sémiologie du stéréotype, Paris, Nathan, 1991, coll. « Le<br />
Texte <strong>à</strong> l’œuvre » ; Jean-Louis Dufays, Stéréotype et lecture. Essai sur <strong>la</strong> réception littéraire,<br />
Liège, Mardaga, 1994, coll. « Philosophie et <strong>la</strong>ngage » ; Ruth Amossy & Anne Herschberg-<br />
Pierrot, Stéréotypes et clichés, Paris, Nathan « Université », 1997.<br />
46