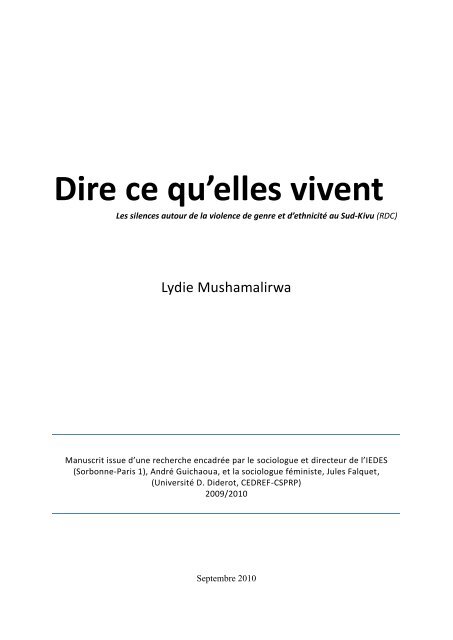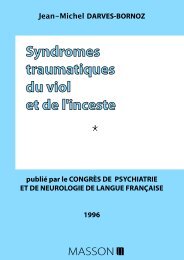Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Dire</strong> <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong><br />
Les silen<strong>ce</strong>s autour de la violen<strong>ce</strong> de genre et d’ethnicité au Sud-Kivu (RDC)<br />
Lydie Mushamalirwa<br />
Manuscrit issue d’une recherche encadrée par le sociologue et directeur de l’IEDES<br />
(Sorbonne-Paris 1), André Guichaoua, et la sociologue féministe, Jules Falquet,<br />
(Université D. Diderot, CEDREF-CSPRP)<br />
2009/2010<br />
Septembre 2010
2<br />
Remerciements<br />
A Jules Falquet, Nicole Khouri, Anne Lenaëlou et André Guichaoua pour leur soutien, leurs<br />
encouragements, leurs conseils qui n’ont fait qu’enrichir et stimuler <strong>ce</strong> travail.<br />
A tous les membres de ma famille de sang et de cœur qui ont participé de près ou de loin à<br />
l’élaboration de <strong>ce</strong> projet et, tout spécialement, à Alika, dada yangu., Nkana,et Davina.<br />
A tous les yeux qui, de Gyf-sur-Yvette à Noumea en passant par nos plus proches<br />
départements comme le 78 et le 92, ont relus avec passion et attention <strong>ce</strong>rtains passages de<br />
<strong>ce</strong> manuscrit.<br />
A toutes les organisations locales et internationales qui ont ouvert leurs portes à ma<br />
recherche.<br />
A toutes les voix qui, de gré ou de for<strong>ce</strong> 1 , se sont élevées ou se sont tues.<br />
Remarque : Dans le souci de protéger mes interlocutri<strong>ce</strong>s, leurs prénoms sont fictifs, et seules<br />
les majuscules de leur nom de famille et de leur village sont indiquées.<br />
1 Formulation inspirée de l’ouvrage de Jules Falquet : De gré ou de for<strong>ce</strong>, les femmes dans la mondialisation.
3<br />
Table des matières<br />
Remerciements ................................................................................................................... 2<br />
1. De la « victime » au victimisme. ................................................................................... 9<br />
1.1 19 ème siècle et avant : La victime invisible. .......................................................................... 9<br />
1.2 La naissan<strong>ce</strong> d’une nouvelle figure au 19 ème siècle : la victime. ....................................... 10<br />
1.3 Travers, dangers et excès – le « victimisme ». .................................................................. 12<br />
1.4 L’émergen<strong>ce</strong> de la figure de la victime de violen<strong>ce</strong>s sexuelles en RDC ............................ 12<br />
2. Analyse des discours produits sur les victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans l’Est de<br />
la République Démocratique du Congo ........................................................................... 14<br />
2.1 Des réalités aux discours de la sphère associatives. ......................................................... 15<br />
2.2 …aux sphères médiatiques et politiques ............................................................................ 20<br />
2.3 Au-delà : Les discours produits dans la sphère scientifique .............................................. 22<br />
2.4 Caractéristiques de <strong>ce</strong>s discours: une arme de guerre « banalisée »............................... 23<br />
1. <strong>Dire</strong> une réalité silencieuse ......................................................................................... 27<br />
1.1 Un humble objectif… .......................................................................................................... 27<br />
1.2 …qui a une histoire. .......................................................................................................... 28<br />
2. Une parole de plus en plus précise et problématisée ................................................ 30<br />
2.1 Le premier mouvement de réflexion ................................................................................... 30<br />
2.2 Le deuxième mouvement de réflexion ................................................................................. 32<br />
2.3 Dernier mouvement de réflexion ........................................................................................ 35<br />
3. Les dangers épistémologiques inhérents à ma prise de parole : les silen<strong>ce</strong>s<br />
inévitables. ........................................................................................................................... 37<br />
3.1 La « victime » : Comment dire sans nommer et catégoriser ?........................................... 37<br />
3.2 L’hétérogénéité réduite au silen<strong>ce</strong> par un discours qui tend fatalement vers l’homogénéité<br />
.................................................................................................................................................. 40<br />
3.3 Le silen<strong>ce</strong> de la non-représentativité entre l’enquêteur/tri<strong>ce</strong> et les enquêtés ............... 41<br />
1. Choix géographique : De la RDC au Bushi .................................................................. 46<br />
1.1 Les déterminants familiaux et personnels de la sélection géographique et temporelle. .... 46<br />
1.2 Caractéristiques socio-culturelles ...................................................................................... 48<br />
1.3 Caractéristiques géographiques ........................................................................................ 53<br />
1.4 Caractéristiques géopolitiques ........................................................................................... 54<br />
2. Les institutions associatives et hospitalières. ................................................................ 57
4<br />
2.1 Caractéristiques générales du tissu associatif local et international de la provin<strong>ce</strong> du Sud-<br />
Kivu. ......................................................................................................................................... 57<br />
2.2. La sélection préalable de mes futures interlocutri<strong>ce</strong>s par la réalité de terrain. ............... 61<br />
2. 3 Le choix de mes structures d’enquête : la prise de contact............................................... 64<br />
2.4 L’hôpital Général de Panzi et Action d’Aide aux Vulnérables : bref historique. .............. 70<br />
3. Mes interlocutri<strong>ce</strong>s ...................................................................................................... 73<br />
3.1 Le choix de mes interlocutri<strong>ce</strong>s selon des critères qui me sont extérieurs......................... 73<br />
3.2 Les dangers de la catégorisation ....................................................................................... 75<br />
3.3 Situations et caractéristiques de mes interlocutri<strong>ce</strong>s. ........................................................ 76<br />
1. Parcours méthodologique pour accéder à leurs paroles. ............................................ 79<br />
1.1 Méthodes d’enquêtes : Du questionnaire semi-directif au récit de vie. ............................. 79<br />
1.2 Les barrières entre moi et mes interlocutri<strong>ce</strong>s. .................................................................. 82<br />
2. Intériorisation, extériorisation, résilien<strong>ce</strong> : la parole thérapeutique ...................... 84<br />
2.1 De l’impossibilité de dire ................................................................................................... 84<br />
2.2 L’intériorisation et ses effets .............................................................................................. 87<br />
2.3 <strong>Dire</strong> <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong>, revivre <strong>ce</strong> qu’elles disent : la parole thérapeutique. .................... 89<br />
2.4 Le refus de parler : la parole coercitive ? ......................................................................... 93<br />
3. le dire de l’entre-soi : la parole urbaine des déplacées ............................................... 98<br />
1. Au village : Lydia, 23 ans, récit de vie. ....................................................................... 105<br />
2. Au village : Noémie, 25 ans, récit de vie. .................................................................... 110<br />
BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................... 113
5<br />
Introduction<br />
Ce qu’elles <strong>vivent</strong> : le présent s’impose car, avant d’être combattues, les violen<strong>ce</strong>s auxquelles<br />
<strong>ce</strong>rtaines femmes du Sud-Kivu ont sur-vécues et contre lesquelles j’écris, sont vécues au<br />
présent et au quotidien. Cette contemporanéité, pourtant inhérente à mon objet d’étude et<br />
facteur de son intérêt, n’est pas sans poser d’inconfortables problèmes éthiques: au<br />
moment où je prétendais enquêter sur les formes de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> dans la vie de <strong>ce</strong>lles qui<br />
la subisse, elles étaient encore perpétrées. Au moment où je formule un discours sur <strong>ce</strong><br />
sujet, et probablement même au moment où il est lu, <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s sont encore perpétrées.<br />
Et dans les nombreux cas où on les croit appartenir au passé par<strong>ce</strong>-qu’ elles ont eu lieu dans<br />
le passé, elles sont encore à l’action dans le corps, dans le psychique et dans plusieurs<br />
dimensions de la vie de nombreuses personnes qui y ont survécu.<br />
Le présent du verbe vivre est mis en parallèle avec un mode atemporel et non personnel :<br />
l’infinitif de « dire ». Bien que ma démarche soit personnelle et qu’elle ait une histoire et<br />
donc un temps, <strong>ce</strong>tte forme infinitive m’a semblée la plus à même d’englober tout-e-s les<br />
possibles énonciateurs et énonciatri<strong>ce</strong>s, tout-e-s les possibles destinataires et destinatri<strong>ce</strong>s,<br />
dans le présent et dans le passé, de mon enquête et de mes interlocutri<strong>ce</strong>s. Cet écrit est<br />
effectivement l’histoire réflexive et problématisée d’un dialogue entre les « victimes » qui<br />
ont ac<strong>ce</strong>pté de me parler et moi, entre « elles » et les associations qui les accueillent, entre<br />
<strong>ce</strong>s associations et moi-même, et, bien sûr, entre vous et moi, ainsi qu’entre « elles » et<br />
vous. Comme pour affirmer d’un même temps l’existen<strong>ce</strong> de barrières qui entravent <strong>ce</strong><br />
dialogue, et donc souligner la part d’indicibilité de <strong>ce</strong> « dire », le titre est mis en perspective<br />
avec le sous-titre : « les silen<strong>ce</strong>s de la violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique ». Nous verrons<br />
effectivement que beaucoup de <strong>ce</strong> qui est et sera tenté d’être dit se réduit, presque<br />
fatalement, au silen<strong>ce</strong>. Cependant, le silen<strong>ce</strong> peut être assez significatif pour dire quelquechose.<br />
Nous allons donc aussi tenter d’explorer <strong>ce</strong> que disent les silen<strong>ce</strong>s de la violen<strong>ce</strong> que<br />
nous allons définir, à toutes les échelles du dialogue. Pour que je puisse en dire quelquechose,<br />
il a fallu que <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles me disent quelque-chose de <strong>ce</strong> qu’elles ont<br />
vécues et de <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong>, parfois de gré, parfois de for<strong>ce</strong>, bien qu’ inconsciente et<br />
involontaire. C’est de for<strong>ce</strong> dont il est question dans <strong>ce</strong>t essai de réflexion anthropologique<br />
et sociologique, <strong>ce</strong>lle qui impose et méprise la volonté de <strong>ce</strong>ux et <strong>ce</strong>lles à l’encontre de qui<br />
elle est exercée. Violen<strong>ce</strong> vient du latin « violentia » (1215) qui signifiait alors abus de la
6<br />
for<strong>ce</strong>. Aujourd’hui, elle renvoie à <strong>ce</strong>tte for<strong>ce</strong> brutale exercée contre quelqu’un, notamment<br />
pour le soumettre. L’imaginaire collectif, au moins occidental, sous-entend que la for<strong>ce</strong><br />
employée est systématiquement brutale, alors qu’elle peut revêtir une forme dou<strong>ce</strong> et<br />
insidieuse. Il sous-entend aussi qu’elle est né<strong>ce</strong>ssairement physique, alors qu’elle peut être<br />
psychologique ou même symbolique. 2 Au pluriel, violen<strong>ce</strong> renvoie plus précisément aux<br />
actes de violen<strong>ce</strong>s, par lesquels <strong>ce</strong>tte for<strong>ce</strong> ou <strong>ce</strong>s for<strong>ce</strong>s s’exer<strong>ce</strong>nt. Dans le titre, je choisis<br />
d’employer <strong>ce</strong> mot au singulier afin de souligner l’unité réelle et symbolique et notamment<br />
structurelle, qui bien souvent se cache derrière tous les actes de violen<strong>ce</strong> que nous<br />
évoquons, malgré la multitude des interprétations qui leur sont données. Les méthodes<br />
utilisées par les acteurs (car <strong>ce</strong> sont souvent des hommes) pour faire acte de violen<strong>ce</strong> sont<br />
diverses autant que sont les conséquen<strong>ce</strong>s sur les actri<strong>ce</strong>s (car <strong>ce</strong> sont souvent des femmes)<br />
victimes de <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s. Le tissu associatif local et international est habitué à distinguer<br />
trois types de conséquen<strong>ce</strong>s : médicales, psychologiques, sociales – Le volet « social » étant<br />
souvent séparé en deux axes d’actions: l’axe « familial et communautaire » et l’axe « socioéconomique<br />
». Les frontières entre les unes et les autres de <strong>ce</strong>s conséquen<strong>ce</strong>s sont<br />
poreuses, elles s’enchevêtrent et s’influen<strong>ce</strong>nt mutuellement. D’ailleurs beaucoup<br />
d’associations entendent privilégier une approche « holistique » de la prise en charge<br />
apportée aux « victimes ». Partant de <strong>ce</strong>tte définition même de violen<strong>ce</strong>, donc comme abus<br />
et excès dans l’exerci<strong>ce</strong> de la for<strong>ce</strong> de la part de personne(s) envers d’autre(s) personne(s),<br />
et du fait même qu’il y a des conséquen<strong>ce</strong>s préjudiciables, je choisi de nommer <strong>ce</strong>ux et<br />
surtout <strong>ce</strong>lles à l’encontre de qui sont exercés <strong>ce</strong>s actes de violen<strong>ce</strong> comme des « victimes »,<br />
sans pour autant les définir ainsi de manière intrinsèque et systématique. En effet, la victime<br />
est, notamment, une personne qui subit un préjudi<strong>ce</strong> par la faute d’une tier<strong>ce</strong> personne -<br />
même si nous verrons que <strong>ce</strong>la ne va pas sans poser de problèmes épistémologiques. C’est<br />
pour <strong>ce</strong>tte raison que nous utilisons <strong>ce</strong> nom avec précaution.<br />
Les adjectifs genrée et ethnique 3 ont été préférés à d’autres adjectifs habituellement utilisés<br />
pour qualifier la forme de violen<strong>ce</strong> qui sévit au Sud-Kivu comme l’adjectif « sexuelle », car<br />
<strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s effectivement « sexuelles » ne sont en fait que le fruit du continuum<br />
transnational des rapports sociaux de sexe, et de logiques sociales liées à l’ethnicité. Comme<br />
2 Bourdieu, Pierre (1998) La domination masculine, Paris, seuil.<br />
3 Ces adjectifs seront par la suite parfois implicites à la formulation que j’utiliserai : « la violen<strong>ce</strong> »
7<br />
Miranda Allison 4 , j’interprète l’utilisation des violen<strong>ce</strong>s sexuelles en contexte (post-)<br />
conflictuel comme la conséquen<strong>ce</strong> d’un système genré et ethnique de rapports de<br />
domination. L’ethnicité est ici comprise dans le sens que Fréderic Barth lui donne c’est-à-dire<br />
comme une catégorie dynamique et donc mouvante que les acteurs et actri<strong>ce</strong>s sociaux vont<br />
consciemment ou inconsciemment manipuler pour s’y assigner ou, au contraire, y être<br />
assignés 5 . Les théories du genre et des relations interethniques sont intéressantes pour nous<br />
aider à comprendre le phénomène. La femme peut être effectivement attaquée par<strong>ce</strong><br />
qu’elle est, par exemple, symbole de la terre nourricière, ou de l’avenir de tout un groupe<br />
d’appartenan<strong>ce</strong> ethnique. Il s’agit alors de « toucher à la capacité de reproduction et de<br />
transmission du lien de filiation de la communauté définie comme ennemie ‘ethnique’ » 6 .<br />
Cette intersection entre le genre et l’ethnicité ici matérialisée par la conjonction de<br />
coordination et n’est pas pour autant l’objet de notre recherche. En effet, <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong><br />
genrée et ethnique s’est incarnée et s’incarne au jour le jour dans la vie de nombreuses<br />
personnes, indénombrables comme nous allons le voir, à travers le monde - De l’ ex-<br />
Yougoslavie, à l’Algérie sous la guerre d’indépendan<strong>ce</strong>, ou encore au Guatemala en passant<br />
par le Rwanda de 1994, le Soudan d’aujourd’hui et bien sûr la République Démocratique du<br />
Congo (RDC). C’est la réalité de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong>, ici au Sud-Kivu, provin<strong>ce</strong> de la RDC, qui nous<br />
intéresse. :<br />
Dans quelles mesures est-il possible de dire la réalité de <strong>ce</strong> que la violen<strong>ce</strong> genrée et<br />
ethnique leur (a) fait vivre ?<br />
Le petit robert 2011 donne plusieurs définitions au terme « dire » dont seulement quelquesunes<br />
vont nous intéresser. « <strong>Dire</strong> » renvoie au « fait d’exprimer oralement, ou par écrit ».<br />
C’est notamment <strong>ce</strong> qui, dans différentes sphères de connaissan<strong>ce</strong>, a été dit par écrit et,<br />
occasionnellement, à l’oral à travers les médias audiovisuels, qui nous intéresse dans un<br />
premier chapitre. Le deuxième chapitre prolonge <strong>ce</strong>tte définition. <strong>Dire</strong> consiste alors en «<br />
faire savoir » « communiquer » voire « témoigner ». Je tenterai effectivement d’expliquer<br />
mes motivations qui s’inscrivent justement dans une simple volonté de dire au sens de faire<br />
savoir. Nous tenterons ensuite de définir et problématiser plus précisément l’angle sous<br />
4 Miranda Allison (2007) in Freedman, Jane ; Valluy, Jérôme (coords.) (2007) Persécutions des femmes.<br />
Savoirs, protections et mobilisations, Paris, Editions du Croquant.<br />
5 Barth, Frederick (1969) Les groupes ethniques et leurs frontières. L’organisation sociale des différen<strong>ce</strong>s<br />
culturelles, Bergen, Oslo, Universitetsforlaget.<br />
6 Nahoum-Grappe, V. « Le viol comme instrument de guerre et d’extermination », CNRS, URL :<br />
http://www2.cnrs.fr/presse/thema/225.html. Consulté le 26/09/09.
8<br />
lequel j’aspire à faire passer l’éventuel message. La troisième partie traite du chemin en<br />
impasse que j’ai emprunté pour faire « dire » pour faire, « communiquer, exprimer (la<br />
pensée, les sentiments, les intentions) par la parole. Le quatrième chapitre chercher à<br />
analyser <strong>ce</strong> que dit et ne dit pas la parole car dire c’est aussi « faire connaître par un signe<br />
autre que la parole ». Dans le cinquième chapitre, nous laisserons, enfin, la pla<strong>ce</strong> à une<br />
partie, né<strong>ce</strong>ssairement non représentative, du contenu de <strong>ce</strong> qu’elles ont réussi à me dire,<br />
de gré ou de for<strong>ce</strong>.
9<br />
CHAPITRE 1<br />
Préliminaires épistémologiques : Analyse<br />
de <strong>ce</strong> qui a déjà été dit<br />
1. De la « victime » au victimisme.<br />
Essayer de dire et donc aussi de penser les actes de violen<strong>ce</strong>, ici genrée et ethnique, du point<br />
de vue de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui la subissent plutôt que de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui les commettent; les<br />
dire et les penser du point de vue particulier de la souffran<strong>ce</strong> individuelle et collective, plutôt<br />
que de <strong>ce</strong>lui plus général de la société, est une tentative en accord avec notre modernité. Si<br />
de l’encre a déjà été versée, si des discours ont déjà été produits sur des « victimes » de la<br />
violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique en République Démocratique du Congo, c’est que nous sommes<br />
dans une ère favorable aux « victimes » en général. Michel Wieworka explique l’entrée dans<br />
<strong>ce</strong>tte ère par un « renversement anthropologique ». Avant de rentrer dans la stricte analyse<br />
du contenu des discours déjà produits sur mon sujet, je vais essayer, à partir de l’analyse de<br />
Michel Wievorka d’expliquer pourquoi <strong>ce</strong>tte production discursive a été possible,<br />
notamment grâ<strong>ce</strong> à l’évolution de la figure de la « victime » dans l’espa<strong>ce</strong> public 7 .<br />
1.1 19 ème siècle et avant : La victime invisible.<br />
Les discours produits autour de la violen<strong>ce</strong> ont évolué avec le temps et avec les<br />
changements de l’image et la per<strong>ce</strong>ption de la « victime » dans l’espa<strong>ce</strong> public. Avant le<br />
19 ème , la violen<strong>ce</strong> est analysée du point de vue de la société et lorsque la victime est prise en<br />
compte c’est seulement par rapport à son impact, son influen<strong>ce</strong> sur l’ordre social, la<br />
cohésion sociale, et plus largement la société. L’image renvoyée de n’importe quel malheur<br />
7 La réflexion de <strong>ce</strong>tte partie s’inspire du chapitre 3, « l’émergen<strong>ce</strong> de la victime », extrait de M. Wieworka, La<br />
violen<strong>ce</strong>.
10<br />
tel qu’il est vécu est donc différente de <strong>ce</strong>lle qu’on connait mieux. C’est en tous cas <strong>ce</strong> qu’il<br />
est possible de lire de la victime « dans les sociétés traditionnelles, et dans les phases de<br />
modernité antérieures à la nôtre ». Michel Wievorka ne prend pas l’exemple de la figure de<br />
guerre mais <strong>ce</strong>lle de la pauvreté telle qu’elle parait dans les écrits de Bronislaw Geremek :<br />
« sa souffran<strong>ce</strong> et son intégrité physique et morale, bafouée, niée, détruite ne pèsent guère.<br />
Ce qu’elle [la victime] vit du fait de la violen<strong>ce</strong>, à chaud puis ensuite, si elle survit, son<br />
traumatisme, ses difficultés existentielles sont bien moins importantes que <strong>ce</strong> qu’a signifié la<br />
violen<strong>ce</strong> du point de vue global de la communauté ».<br />
En effet, à l’époque décrite par Michel Wievorka, la pauvreté, dans <strong>ce</strong>t exemple, les guerres,<br />
dans le cas qui nous con<strong>ce</strong>rne, ou encore, autre exemple, les catastrophes naturelles<br />
n’importent qu’en fonction de leur impact sur la communauté, voire la société, que dans<br />
l’ordre qu’ils y perturbent : « On n’entend pas sa douleur, ses cris sont masqués » alors que<br />
c’est aujourd’hui tout <strong>ce</strong> qu’on entend ou qu’on essaye de faire entendre. C’est d’ailleurs <strong>ce</strong><br />
que j’essaye moi-même de faire entendre, comme l’indique le titre assez explicite de <strong>ce</strong><br />
projet. La figure compassionnelle de la victime qui souffre telle qu’on la connait et telle<br />
qu’elle se dessine à travers beaucoup des discours qui seront analysés dans la deuxième<br />
partie, n’existe donc pas avant le « renversement anthropologique » que nous allons<br />
analyser.<br />
1.2 La naissan<strong>ce</strong> d’une nouvelle figure au 19 ème siècle : la victime.<br />
C’est au 19 ème siècle qu’elle acquiert une visibilité progressive. A l’échelle internationale c’est<br />
Henri Dunant qui, avec la Croix-Rouge, participe au début de <strong>ce</strong> pro<strong>ce</strong>ssus, notamment par<br />
l’aide qu’il entend apporter aux victimes militaires, et pas encore civiles, de la guerre à<br />
Solferino (1859). A l’échelle de la vie sociale interne, déjà commen<strong>ce</strong> à se former l’image des<br />
femmes et des enfants comme victimes. Cette tendan<strong>ce</strong> se répercuterait jusque dans la<br />
culture, et tout particulièrement dans la littérature avec la pla<strong>ce</strong> laissée à des personnages<br />
comme Cosette dans les Misérables de Victor Hugo. Mais c’est dans le courant des années<br />
1960 que <strong>ce</strong> serait opéré le véritable et presque radical « renversement anthropologique »<br />
avec une émergen<strong>ce</strong> nette de la « victime » sur la scène publique. Ce renversement se<br />
manifeste notamment par un symptôme important pour notre objet d’étude. Il s’agit de<br />
l’importan<strong>ce</strong> et la pertinen<strong>ce</strong> toujours grandissantes de la perspective des victimes
11<br />
spécifiquement de guerre presque simultanée avec l’avancée du droit d’ingéren<strong>ce</strong>. Les<br />
victimes civiles sont alors plus prises en considération que les victimes militaires. Les médias<br />
électroniques jouent un rôle non négligeable dans <strong>ce</strong>tte nouvelle prise en compte dans sa<br />
propagation à plusieurs échelles (locale, nationale et bien sûr internationale). C’est par<br />
exemple <strong>ce</strong> que Médecins Sans Frontières comprend, en offrant à leur action et aux victimes<br />
qu’ils soignent une couverture médiatique retentissante. A une échelle plus interne de la<br />
société, il est possible d’observer parallèlement la constitution de <strong>ce</strong> qu’on pourrait presque<br />
appeler un mouvement social qui porte sur la scène publique des préoccupations, des<br />
revendications qui s’inscrivent dans <strong>ce</strong>tte optique, ébranlant progressivement les sociétés<br />
occidentales. En <strong>ce</strong> qui con<strong>ce</strong>rne la fa<strong>ce</strong> féminine, sans né<strong>ce</strong>ssairement être féministe, du<br />
mouvement on assiste, par exemple, à une mobilisation publique grandissante contre le<br />
viol, les violen<strong>ce</strong>s conjugales ou encore l’in<strong>ce</strong>ste, notamment à partir de 1968. Les médias<br />
jouent là aussi un rôle important. Ces contestations brouillent les frontières entre la sphère<br />
privée et publique mais débouchent sur des actions sociales concrètes, comme la création<br />
de <strong>ce</strong>ntre pour les femmes battues, ou pour les femmes victimes de viols, qui se qualifient<br />
de survivors 8 , de la même manière que des victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles au Sud-Kivu vont<br />
s’auto-désigner « survivantes » de <strong>ce</strong>s actes de violen<strong>ce</strong> plus tard. Cette action sociale<br />
débouche même sur une action plus scientifique avec la création en 1980 des Post-traumatic<br />
stress Center dont l’influen<strong>ce</strong> se fait ressentir dans la psychanalyse américaine. A un niveau<br />
plus universitaire, il est d’ailleurs possible de trouver un signe précurseur de <strong>ce</strong><br />
renversement dans la psychanalyse chez Charcot, neurologue ou chez Freud, en 1893, dans<br />
ses études sur l’hystérie, le traumatisme, et la névrose de guerre. Mais aujourd’hui <strong>ce</strong><br />
renversement s’est déjà propagé dans toutes les scien<strong>ce</strong>s sociales. La figure de la victime<br />
existe de manière suffisamment effective pour qu’une discipline lui soit consacrée : La<br />
victimologie, en 1937. L’action sociale contestataire renfor<strong>ce</strong> l’action scientifique et<br />
institutionnelle pour faire rentrer massivement les victimes dans l’espa<strong>ce</strong> public et dans<br />
diverses sphères discursives. Mais <strong>ce</strong>tte entrée n’est pas sans poser de problèmes.<br />
8 Il s’appuie sur l’exemple des Etats-Unis. Le passage du statut de « victime » à <strong>ce</strong>lui de « survivante » trouve<br />
écho jusqu’au Kivu d’aujourd’hui.
12<br />
1.3 Travers, dangers et excès – le « victimisme ».<br />
Tout d’abord à l’échelle des nations et à l’échelle de l’histoire semble s’instaurer un combat<br />
pour la reconnaissan<strong>ce</strong> du statut de victime. Si les Juifs sont les premiers à mener <strong>ce</strong> combat,<br />
d’autres, comme les arméniens ou les noirs-américains pour l’esclavage par exemple,<br />
prennent progressivement leur pla<strong>ce</strong>. Même à l’échelle de la vie sociale interne, des<br />
victimes de toutes sortes de maux se manifestent dans l’espa<strong>ce</strong> public avec des exigen<strong>ce</strong>s<br />
croissantes, notamment vis-à-vis de l’état qui, par ailleurs, failli dans, <strong>ce</strong> que l’on peut<br />
considérer comme, sa mission de satisfaire <strong>ce</strong>s exigen<strong>ce</strong>s. Mais les éventuelles réussites de<br />
la communauté étatique internationale ou nationale dans <strong>ce</strong>tte mission qu’on lui donne, à<br />
tort ou à raison, semble procurer du pouvoir aux victimes qui osent élever leur voix et se<br />
plaindre, si bien que de plus en plus de personnes et de communautés aspirent à avoir<br />
quelque-chose à revendiquer et donc à être victime. Ce contexte est favorable à la<br />
pérennisation, après son émergen<strong>ce</strong>, de la figure de la victime. Ensuite, <strong>ce</strong>tte tendan<strong>ce</strong> dans<br />
les discours à vouloir se positionner en tant que victime peut s’avérer dangereuse dans la<br />
mesure où l’individu qui se positionne ou qui est positionné en tant que victime se définit<br />
négativement. Il se définit dans l’impuissan<strong>ce</strong> plutôt que dans la puissan<strong>ce</strong> de l’action.<br />
Michel Wieworka sollicite Elisabeth Badinter 9 pour expliquer la né<strong>ce</strong>ssité de transformer les<br />
victimes en des sujets constructifs. C’est la même injonction que formule un <strong>ce</strong>rtain discours<br />
féministe visant à nous prévenir des dangers de la tendan<strong>ce</strong> discursive à la victimisation des<br />
femmes, aussi actri<strong>ce</strong>s et pas seulement victimes.<br />
1.4 L’émergen<strong>ce</strong> de la figure de la victime de violen<strong>ce</strong>s sexuelles en RDC<br />
Cet éclairage historique sur la figure de la victime nous aide à comprendre comment notre<br />
ère nous incite, et bien sûr m’incite, à répondre favorablement à l’invitation tacite de la<br />
sphère publique de la société à penser la violen<strong>ce</strong> du point de vue de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui en<br />
souffrent. Il ne nous explique pas pour autant comment <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui souffrent des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles en RDC ont pris leur pla<strong>ce</strong> dans le discours produit sur les victimes en<br />
général. Avant de nous lan<strong>ce</strong>r dans son analyse, essayons de comprendre comment la figure<br />
de la victime de violen<strong>ce</strong>s sexuelles en RDC s’est dessinée avec un retentissement relatif. Elle<br />
faisait partie de la sphère privée jusqu’à <strong>ce</strong> que la violen<strong>ce</strong> sexuelle soit utilisée massivement<br />
9 Badinter, Elisabeth, Fausse route, Paris, Ed Odile Jacob, 2003 citée dans le même chapitre 3.
13<br />
et surtout comme arme de guerre. Cette réalité est souvent silencieuse, mais, comme nous<br />
allons le voir, elle sort de son silen<strong>ce</strong> dans des circonstan<strong>ce</strong>s particulières auprès d’acteurs<br />
associatifs locaux particuliers. Ces derniers alors peuvent faire tout un travail de<br />
sensibilisation à l’échelle nationale et internationale qui va favoriser l’émergen<strong>ce</strong> de la figure<br />
très homogène de la « victime de violen<strong>ce</strong> sexuelle en RDC ». Une partie de l’histoire de<br />
l’hôpital de Panzi au sein duquel j’ai effectué la première partie de mon enquête, est à <strong>ce</strong><br />
titre intéressant. Née en 1999, la section spécialisée dans le soutien d’abord médical aux<br />
victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles n’a dépassé qu’en 2002 <strong>ce</strong>tte dimension médicale pour en<br />
prendre une militaire et politique en dénonçant les crimes commis par les militaires. Des<br />
organisations internationales comme Médecins Sans Frontières, Amnesty International ou<br />
Human Right Watch dont les observations et rapports contribuèrent à faire de leur lutte<br />
une cause reconnue par la communauté internationale, s’investissent dans la cause et <strong>ce</strong>,<br />
notamment, grâ<strong>ce</strong> au travail sans relâche de sensibilisation à la question par le Dr Denis<br />
Mukwege, gynécologue et directeur de l’hôpital. L’émergen<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>tte figure spécifique de<br />
la « victime » est donc liée à l’action sociale et contestataire que nous avons déjà évoquée.<br />
La violen<strong>ce</strong> n’est donc vraisemblablement plus envisagée par rapport à l’ordre collectif mais<br />
plutôt par rapport à l’intégrité et la souffran<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui la subissent, elle n’est<br />
plus une affaire strictement politique, mais elle est aussi et surtout une affaire<br />
individuellement et collectivement compassionnelle. C’est ainsi que, sans toujours<br />
contourner les dangers du « victimisme », une figure, voire une catégorie sociale comme<br />
nous le verrons plus tard, qui est presque invisible devient une figure incontournable de la<br />
modernité contemporaine. Elle favorise ainsi la production discursive sur les victimes en<br />
général, et <strong>ce</strong>lle plus légère sur les victimes de la violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique au Congo, et<br />
encore plus précisément au Sud-Kivu.
14<br />
2. Analyse des discours produits sur les victimes de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles dans l’Est de la République Démocratique du Congo<br />
Les cas de violen<strong>ce</strong>s basées sur le genre et l’ethnicité en contexte de conflit ou de<br />
post-conflit sont malheureusement assez nombreux pour avoir fait couler déjà un peu<br />
d’encre, mais vraisemblablement pas assez car elles n’ont pas encore <strong>ce</strong>ssées d’être<br />
perpétrées. Ce sont les discours produits sur <strong>ce</strong>lles qui sont parfois désignées entre expert-es<br />
par les victimes enfants, femmes et, plus rarement, hommes - de VVS (Viols et Violen<strong>ce</strong>s<br />
Sexuelles) qui vont ici nous intéresser. L’emploi de <strong>ce</strong> diminutif en dit long sur la<br />
systématisation et la banalisation de <strong>ce</strong>tte catégorisation et nous invite à l’interroger. La<br />
littérature à propos de <strong>ce</strong>s victimes, que nous essayerons de nommer, autant qu’il est<br />
possible, « survivantes » afin de faciliter la prise de recul vis-à-vis de <strong>ce</strong>tte nomination, est<br />
plus foisonnante que <strong>ce</strong> que je pensais, comme l’indique la bibliographie. La guerre dite<br />
« silencieuse » menée à leur encontre depuis le début de la première guerre de 1996, en<br />
temps de paix officiel et bien sûr en temps de guerre, semble donc sortir petit à petit du<br />
mutisme premier caractéristique de <strong>ce</strong> genre de phénomène de violen<strong>ce</strong>. Ce mutisme est<br />
malgré tout relatif comparé à, par exemple, <strong>ce</strong>lui complet et plus long (25 ans) au<br />
Guatemala 10 à la suite de la guerre civile à propos d’autres mais mêmes types de violen<strong>ce</strong>s.<br />
En RDC, plusieurs milieux ont créés, simultanément et tour à tour, des espa<strong>ce</strong>s dédiés à<br />
l’expression de <strong>ce</strong>s actri<strong>ce</strong>s. Ils se sont mis en pla<strong>ce</strong> avec plus ou moins de facilité et sont<br />
parfois allés jusqu’à instrumentaliser la question des violen<strong>ce</strong>s qualifiées généralement de<br />
sexuelles. Il s’agit là des milieux associatifs, des milieux politiques et médiatiques, des<br />
milieux religieux. Qui dans <strong>ce</strong>s milieux a produit des discours ? Sur qui exactement ? Quelle<br />
est la nature et quelles sont les caractéristiques de <strong>ce</strong>s discours ? Dans quels buts sont-ils<br />
produits ? Quelles en sont les répercussions sur les actri<strong>ce</strong>s que nous nous proposons<br />
d’étudier ? C’est à <strong>ce</strong>s questions que nous allons essayer de répondre tout d’abord en<br />
analysant les discours produits dans la sphère <strong>ce</strong>ntrale et primordiale qu’est la sphère<br />
associative, pour analyser ensuite la manière dont ils se propagent dans les sphères<br />
médiatique, politique et religieuse d’une part , et dans <strong>ce</strong>lle scientifique et universitaire<br />
10 Actoras de Cambio, Sobreviví, estoy aquí, y estoy viva, documentaire, 2008
15<br />
d’autre part. Nous tenterons enfin d’expliquer et analyser la tendan<strong>ce</strong> à qualifier <strong>ce</strong>s<br />
violen<strong>ce</strong>s d’ « armes de guerre » et à leur « banalisation ».<br />
2.1 Des réalités aux discours de la sphère associatives.<br />
Les réalités véhiculées dans toutes <strong>ce</strong>s sphères sont incontestables en elles-mêmes: Aux<br />
fléaux de la famine, de la pauvreté urbaine et rurale s’est ajouté le fléau de la guerre et ses<br />
conséquen<strong>ce</strong>s corollaires qui, comme toujours, s’abattent sur la population civile. Les<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles en sont un exemple. Les chiffres, les images les témoignages, véhiculés<br />
dans les sphères associatives et/ou médiatiques d’information avec leurs constantes et leurs<br />
variantes parlent d’eux-mêmes. C’est justement l’incontestabilité de <strong>ce</strong>s réalités et de<br />
l’absen<strong>ce</strong> de la formulation étatique de réponses qui justifient et légitiment l’action de la<br />
société dite civile et <strong>ce</strong>lle de la communauté internationale par le biais de « partenariats » et<br />
d’actions menées indépendamment de <strong>ce</strong> tissu associatif local. Cependant, bien<br />
qu’incontestables, <strong>ce</strong>s réalités, ou en tous cas les informations relayées sur <strong>ce</strong>s réalités n’en<br />
sont pas moins manipulées par tous <strong>ce</strong>s acteurs et actri<strong>ce</strong>s de la scène associative locale et<br />
internationale, dans la poursuite d’objectifs diverses pas toujours explicites. C’est <strong>ce</strong> que l’on<br />
peut observer, à un premier niveau, dans la simple analyse des discours produits par les<br />
acteurs associatifs locaux auprès de la communauté internationale. Les rapports des<br />
organisations internationales sont beaucoup plus visibles et plus ac<strong>ce</strong>ssibles que <strong>ce</strong>ux des<br />
associations locales. Mais, étant nées d’un travail en collaboration avec les associations<br />
locales, leur discours m’apparait représentatif de <strong>ce</strong>lui des associations locales.<br />
La sphère associative apparait comme <strong>ce</strong>ntrale dans la mesure où elle semble incarner le lien<br />
entre les actri<strong>ce</strong>s qui nous intéressent et les autres sphères. Dans <strong>ce</strong>tte sphère associative, il<br />
me semble important de dissocier les associations locales des organismes nationales et<br />
surtout internationales, même si dans les faits et dans leur action elles sont indissociables<br />
sur <strong>ce</strong> terrain. Ce sont souvent les associations locales qui font le lien entre les actri<strong>ce</strong>s en<br />
question et les organismes d’envergure internationale. Elles seules (avec les Eglises,<br />
d’ailleurs souvent organisées en structures associatives) ont les moyens d’atteindre <strong>ce</strong>s<br />
actri<strong>ce</strong>s en leur offrant des servi<strong>ce</strong>s d’ordre médical, psychosocial, socio-économique ou<br />
encore juridique. Comme nous le verrons dans le quatrième chapitre, c’est souvent la<br />
perspective de se faire soigner qui motive un éventuel dépla<strong>ce</strong>ment et une éventuelle prise
16<br />
de parole chez elles. En dehors de <strong>ce</strong>s associations, il existe quelques organes de santé<br />
nationaux qui pourraient aussi servir de relais mais, souvent payants, elles ne pouvaient se<br />
permettre d’en bénéficier 11 jusqu’en 2007, année où l’OMS prend part aux finan<strong>ce</strong>ments des<br />
soins de toutes les victimes de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> basée sur le genre dans les diverses <strong>ce</strong>ntres de<br />
santé dans les villages. Soit <strong>ce</strong>s actri<strong>ce</strong>s ont la possibilité matérielle et physique d’aller<br />
jusqu’à <strong>ce</strong>s associations, dispensaires, <strong>ce</strong>ntres de santé ou hôpitaux locaux, soit <strong>ce</strong>s derniers<br />
et dernières mettent en pla<strong>ce</strong> des cliniques mobiles leur permettant de se dépla<strong>ce</strong>r et<br />
d’atteindre quelques-unes parmi <strong>ce</strong>lles qui sont bloquées. Mais il m’apparait comme évident<br />
que malgré <strong>ce</strong>tte mobilité toutes n’ont pas accès à <strong>ce</strong>s servi<strong>ce</strong>s. On voit ainsi s’opérer une<br />
sorte de sélection des actri<strong>ce</strong>s par défaut, affaiblissant ainsi la voix, qui éventuellement<br />
monte de leur expérien<strong>ce</strong> commune, d’un manque de représentativité vis-à-vis de toutes les<br />
autres qui sera analysé dans les chapitres suivants. Les obstacles sur le chemin,<br />
occasionnellement à double-sens donc, entre les associations et les actri<strong>ce</strong>s sont nombreux<br />
et triomphent seulement occasionnellement. Malgré l’encre qui coule, la victoire pour le<br />
combat contre <strong>ce</strong>tte guerre dite « silencieuse » évoquée plus haut, n’est donc pas si<br />
évidente qu’il n’y paraissait. Lorsqu’alors un concours de circonstan<strong>ce</strong>s extérieures et/ou<br />
intérieures à nos actri<strong>ce</strong>s libère leur parole du poids du silen<strong>ce</strong>, dans la sphère associative,<br />
pour peut-être ensuite se propager dans d’autres sphères, il nous faut garder à l’esprit qu’en<br />
aucun cas elle ne représente ni ne rempla<strong>ce</strong> toutes <strong>ce</strong>lles dont d’autres circonstan<strong>ce</strong>s<br />
étouffent, voire même écrasent leur parole.<br />
Comptes rendus et rapports écrits de missions ou d’observations sont les formes privilégiées<br />
sous lesquelles s’expriment leur parole, pourtant pas toujours retranscrite surtout dans le<br />
cadre informel ou professionnel mais privé de la relation qui se crée entre le personnel des<br />
associations et les actri<strong>ce</strong>s. Parmi les quelques associations locales qui accueillent des<br />
femmes et enfants victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans le Sud-Kivu et que j’ai répertorié ici,<br />
je ne suis parvenue à avoir accès qu’à deux versions électroniques de rapports similaires<br />
dans la forme à <strong>ce</strong>ux d’organisations internationales. J’ai réussi à combler partiellement <strong>ce</strong><br />
manque sur le terrain, toutes ne m’ayant pas donnée accès à leurs données 12 .<br />
Cette<br />
difficulté d’accès aux données des associations locales qui sont pourtant les premières à être<br />
en contact avec <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui osent dire leur violen<strong>ce</strong> subie pointe un des silen<strong>ce</strong>s de la<br />
11 Moufflet, Véronique, « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la République Démocratique<br />
de Congo », Afrique contemporaine. De Boecke Université ISSN, 2008, N°227, p119-133.<br />
12 Pour la liste des associations, cf Annexes, tableau.
17<br />
violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique au Sud-Kivu : Si les associations locales ne sont pas assez<br />
formelles pour faire des compte-rendus écrits de leur action et de l’avis de leur bénéficiaires,<br />
ou si elles sont assez formelles mais qu’ elles n’ouvrent pas facilement leur porte aux acteurs<br />
extérieurs, elles mettent indirectement au silen<strong>ce</strong> la voix des personnes qui nous<br />
intéressent.<br />
Les rapports des organisations internationales sont par contre beaucoup plus visibles donc<br />
plus ac<strong>ce</strong>ssibles. Leur travail indépendant et/ou en collaboration avec les associations locales<br />
leur permet de récolter des informations et de les communiquer plus facilement avec les<br />
moyens qu’elles ont. Ces informations circulent en communication interne et en<br />
communication externe. Dans le premier cas, le but est d’informer le personnel pour mieux<br />
agir. Dans le deuxième cas, le but est double - il s’agit soit de dossiers ou documents de<br />
presse pour informer et sensibiliser le maximum de personnes par le biais de la sphère<br />
médiatique ou alors il s’agit de rapports dont les recommandations s’adressent aux organes<br />
supérieurs de décision dans le milieu politique et/ou dans le milieu juridique. Certaines<br />
d’entre elles s’inscrivent seulement dans le premier cas de figure et fournissent dossiers de<br />
presse, mais aussi rapports de missions d’observation très complets afin de sensibiliser,<br />
d’informer l’opinion public et, en corollaire seulement, inciter les acteurs des sphères<br />
politiques et juridiques à agir, vite. C’est le cas assez typique d’Amnesty international ou de<br />
Human Right Watch ; et c’est un discours que l’on peut qualifier de militant.<br />
Les organisations dont les rapports m’ont été ac<strong>ce</strong>ssibles sont les suivantes: La FIACAT<br />
(Fédération internationale de l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture,<br />
2003) ; Amnesty International (2003, 2004, 2008) ; CIAT (Communiqué International de<br />
l’Accompagnement de la Transition, 2005) CICR (Comité International de la Croix Rouge,<br />
2009) ; Commission Justi<strong>ce</strong> et Paix Hollande (2009) ; FIDH (Fédération Internationale des<br />
Droits de l’Homme, 2008), HRW (Human Right Watch, 2002, 2003, 2005, 2007) ; IRC<br />
(International Rescue Committe, 2008) ; MSF (2002, 2004, 2005) ; Observatoire International<br />
de l’usage du viol comme tactique de guerre (2003) ; RFDP (Réseau des Femmes pour la<br />
Défense des Droits et de la Paix) (2004). J’ajoute à <strong>ce</strong>la tous les communiqués, toutes les<br />
sections se rapportant aux violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans des rapports plus généraux, délivrés<br />
dans les deux cas par l’ONU et ses antennes telles, surtout, UNICEF, UNIFEM, la MONUC, le<br />
PNUD. Communiqués et déclarations interfèrent alors peut-être plus avec la sphère<br />
médiatique.
18<br />
De manière générale, les discours que <strong>ce</strong>tte sphère propose font appel au registre de la<br />
compassion et de l’émotion. Ils visent à donner une dimension humaine aux vies de<br />
personnes qu’il serait éventuellement possible de qualifier d’inhumaine. Les témoignages<br />
sont des procédés d’énonciation utilisés fréquemment. Même lorsqu’ils sont courts, ils nous<br />
informent toujours sur le prénom et l’âge même approximatif de la victime, comme pour lui<br />
restituer symboliquement son individualité et son humanité. Ils se con<strong>ce</strong>ntrent souvent sur<br />
le récit en lui-même des horreurs qu’elles ont traversées, comme pour rendre compte du<br />
degré de l’horreur à laquelle elles ont survécu. Cette dimension très subjective et<br />
émotionnelle est légèrement contrebalancée par une autre dimension un peu plus<br />
rationnelle qu’expriment les quelques chiffres et statistiques qui font souvent offi<strong>ce</strong> d’entrée<br />
en matière, la contextualisation politico-militaire et les recommandations très concrètes en<br />
fin de rapports. Il ne s’agit, par ailleurs, pas seulement de restituer à <strong>ce</strong>s vies de l’humanité<br />
mais aussi et surtout de sensibiliser, de toucher les interlocuteurs de <strong>ce</strong>s associations, pour<br />
les inciter à agir et à donner, vite. Le champ lexical de l’urgen<strong>ce</strong>, de la né<strong>ce</strong>ssité, du besoin<br />
caractérise donc aussi <strong>ce</strong>s discours ; On peut effectivement remarquer l’idée qu’il y a<br />
urgen<strong>ce</strong> de donner pour soulager ou <strong>ce</strong>lle de dénon<strong>ce</strong>r pour que des mesures soient prises<br />
afin que le mal s’arrête (c’est un discours par exemple assez typique d’Amnesty<br />
international). Parallèlement, les acteurs associatifs multiplient leurs déclarations à<br />
l’occasion d’évènements diplomatiques ou à <strong>ce</strong>lle des journées respectives de la Femme et<br />
de la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s à son encontre. Dans la même logique d’urgen<strong>ce</strong>, et aussi<br />
dans un souci probable d’efficacité dans la ré<strong>ce</strong>ption du message par leurs interlocuteurs et<br />
interlocutri<strong>ce</strong>s, les formules sont brèves, choc. On retrouve des slogans tels « stop au viol »,<br />
« halte au féminicide ». Leur message en est probablement d’autant plus percutant. Dans<br />
tous les cas évoqués de production d’un discours médiatique, les entrées en matière sont<br />
chiffrées (« 40 viols par jour dans l’est de la RDC », « 16000 nouveaux cas re<strong>ce</strong>nsés depuis<br />
2008 sur tout le pays ») et spectaculaires. Les chiffres, par ailleurs, varient d’un media à<br />
l’autre, de la même manière qu’ils varient d’une association et d’une organisation à l’autre<br />
même lorsqu’il s’agit de la même période, peut-être par<strong>ce</strong>-que, dans le fond, il est<br />
impossible de savoir avec exactitude les chiffres. L’idée semble être de rendre compte du<br />
degré peut-être inhumain atteint de la violen<strong>ce</strong> qu’elles subissent et de l’urgen<strong>ce</strong>, encore,<br />
d’agir et de donner. Ces discours sont parfois à la limite de l’exagération. Ce sont les<br />
multiples déclarations de la part de membres de la « société civile » sur Bukavu, la décrivant
19<br />
comme « la capitale du viol » véhiculées par la presse qui pourraient illustrer ici <strong>ce</strong>tte<br />
tendan<strong>ce</strong>. Le point de départ de l’information est vrai : Le viol est un phénomène social<br />
inquiétant, mais ne fait pas pour autant de Bukavu la « capitale mondiale du viol ».<br />
L’information est donc parfois clairement et volontairement exagérée.<br />
Malgré la coïnciden<strong>ce</strong> entre le début de la guerre en RDC et le fait que la même année, Le 27<br />
juin 1996, pour la première fois dans l'histoire, le Tribunal pénal international de la Haye<br />
qualifie le viol contre les femmes commis en temps de guerre de crime contre l'humanité à la<br />
suite du dossier de Foca, c’est surtout au cours des années 2000, particulièrement à partir de<br />
2002-2003, qu’on assiste au début du fleurissement de rapports de mission en tout genre de<br />
la part de <strong>ce</strong>s organisations. La multiplication de <strong>ce</strong> type de rapports et des communiquées<br />
particulièrement autour de 2008 n’est pas sans relation avec le paradoxe entre engagement<br />
signé à Goma le 23 janvier 2008 par les for<strong>ce</strong>s armées et politiques et la persistan<strong>ce</strong> des<br />
exactions militaires dans les faits. Peut-être est-<strong>ce</strong> aussi dû aux effets qui commen<strong>ce</strong>nt à se<br />
ressentir de la sensibilisation progressive de la communauté internationale à <strong>ce</strong>s questionslà.<br />
Il est important de noter que la sphère religieuse produit le même type de discours de<br />
dénonciation, particulièrement l’Eglise catholique qui possède de plus gros moyens et dont<br />
les positions idéologiques font de tout <strong>ce</strong> qui a attrait à la femme une priorité et un enjeu.<br />
Par son poids institutionnel et le rôle qu’elle joue dans la société dite civile, ses prises de<br />
positions bénéficient d’une extrême visibilité qui nous permet de comprendre les régulières<br />
représailles dont elle est l’objet aux Kivus.<br />
Ces organisations semblent monopoliser la parole des actri<strong>ce</strong>s qui nous intéresse en <strong>ce</strong> qui<br />
con<strong>ce</strong>rne la problématique des violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans la mesure où elles sont les<br />
premières interlocutri<strong>ce</strong>s de la presse en particulier. Etant donné que <strong>ce</strong>s organisations<br />
servent de relais entre les actri<strong>ce</strong>s et les médias, on retrouvera la même sélection par défaut<br />
dans la sphère médiatique d’autant plus forte et effective qu’on assiste alors à une autre<br />
sélection <strong>ce</strong>lle des organisations les plus grandes et les plus visibles (donc <strong>ce</strong>lles qui ont le<br />
plus de moyen) par le monde des médias. Le silen<strong>ce</strong> de la violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique au<br />
Sud-Kivu se manifeste ici sous trois dimensions : la sélection par défaut des bénéficiaires des<br />
associations locales, la difficulté d’accès aux données des associations locales, le discours<br />
parfois formaté que produisent les organisations internationales dont la voix est pourtant<br />
plus audible. Ces silen<strong>ce</strong>s se répercutent dans les autres sphères qui font écho à <strong>ce</strong>tte sphère
20<br />
associative. Les réalités discursives associatives et médiatiques révèlent ici la tendan<strong>ce</strong> à la<br />
surenchère émotive, à la spectacularisation, et à l’exagération de données dont la réalité est<br />
pourtant incontestable.<br />
2.2 …aux sphères médiatiques et politiques<br />
« ‘Les Grands malheurs sont monotones’ écrivait Albert Camus. Surtout, ajouterait-on<br />
volontiers aujourd’hui, lorsqu’ils se déroulent loin des caméras de CNN. Le regard se<br />
détourne plus vite des souffran<strong>ce</strong>s de l’autre quand <strong>ce</strong>lles-ci sont invisibles. Et il est plus<br />
facile alors, pour chacun, de répudier sa propre responsabilité ». 13 Le journaliste illustre <strong>ce</strong>t<br />
état de fait avec l’exemple du Kivu. C’était en 1996, au début de la guerre. Le drame qui s’y<br />
déroulait tombe, régulièrement, dans l’oubli ou dans l’indifféren<strong>ce</strong> médiatique et, plus<br />
sporadiquement, il fait les grands (si rarement) titres de nos medias. Il arrive tout de même<br />
de plus en plus souvent que les déclarations, les rapports, les communiqués et alertes<br />
produits par les organes de l’ONU et les ONGs soient relayés par la presse, au gré des<br />
intérêts de l’instant. Suite au ré<strong>ce</strong>nt constat d’échec de l’ONU dans la région, la production<br />
littéraire médiatique à <strong>ce</strong> propos s’est, par exemple, clairement multipliée. Les journées<br />
respectives de la femme et de la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s faites aux femmes incarnent aussi<br />
souvent l’occasion au tissu associatif de trouver oreille plus attentive à leur travail de<br />
dénonciation et de sensibilisation. Prenons ici pour exemple l’Éditorial publié dans<br />
l'International Herald Tribune le 6 mars 2009, écrit par le secrétaire général de l’ONU M. Ban<br />
Ki-Moon suite à la visite d’hôpitaux à Goma, ou encore les déclarations de Rama Yade alors<br />
secrétaire d’état chargée des Affaires étrangères suite à son passage en RDC fin novembre<br />
2009, cinq jours après la journée de la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s faites aux femmes. Les<br />
évènements diplomatiques comme <strong>ce</strong>ux que nous avons déjà évoqués en première partie<br />
(les résolutions de l’ONU, la signature d’accords) sont d’autres éléments qui rythment les<br />
apparitions aléatoires de la problématique dans la sphère médiatique. 2008 est d’ailleurs<br />
une année qui voit les médias s’emparer du sujet de manière plus conséquente. Le travail<br />
des associations trouve un relai auprès d’une communauté internationale sensibilisée.<br />
Beaucoup des discours de la sphère médiatique et politique s’inspirent sur les discours<br />
produits par les acteurs de <strong>ce</strong>tte sphère associative. Les acteurs politiques se servant de la<br />
13 Le Monde (05 dé<strong>ce</strong>mbre 1996) Le Kivu, du drame à l’indifféren<strong>ce</strong>.
21<br />
sphère médiatique pour véhiculer <strong>ce</strong>s discours, je choisi de rassembler les médias et le<br />
politique dans une seule sphère. Si on assiste à une production de discours relativement<br />
régulière dans la sphère associative à l’image de la régularité réelle de <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s dans la<br />
vie des actri<strong>ce</strong>s, il n’en est pas de même de la sphère m »diatique et politique. Ce n’est donc<br />
effectivement que sporadiquement que les médias s’emparent du sujet, mais toujours de la<br />
même façon. Il est possible de remarquer deux types de production de discours: D’un côté<br />
les discours brefs (articles, éditos, communiqués de presse) qui visent presque<br />
exclusivement à informer et dénon<strong>ce</strong>r et, de l’autre, les discours plus long qui visent la<br />
dénonciation et l’information mais aussi et surtout l’explication et la compréhension<br />
approfondie du phénomène ainsi que la sensibilisation et l’humanisation des personnes qui<br />
en sont victimes. Il s’agit là plutôt des reportages et des documentaires. Dans les deux cas<br />
les entrées en matière sont, aussi, chiffrées ou expriment l’indignation ou le dégout, c’est le<br />
cas de l’éditorial que nous avons évoqué plus haut. L’idée est quoi qu’il en soit de rendre<br />
compte du degré inhumain atteint de la violen<strong>ce</strong> et de l’urgen<strong>ce</strong> d’agir.<br />
De la même manière que les ONG féministes jouaient un rôle prépondérant dans la sphère<br />
associative, ici la presse, plus féminine que féministe, joue un rôle important dans <strong>ce</strong>tte<br />
sphère-là. Les magazines féminins comme, surtout, Elle Magasine ou les émissions<br />
culturelles féminines comme the Oprah Show ont fait passer l’information. La presse<br />
française est beaucoup moins présente que la presse américaine ou la presse africaine dans<br />
l’espa<strong>ce</strong> public dédié à <strong>ce</strong>s victimes. De même, il y a plus de reporters anglo-saxons qui se<br />
sont emparés de la question que des francophones. Le ton de la plupart des articles et<br />
surtout des reportages et des documentaires est émotionnel, et fait appel à la compassion.<br />
En <strong>ce</strong>la <strong>ce</strong>tte sphère rejoint la sphère associative, mais dans la sphère médiatique, l’image<br />
prend une pla<strong>ce</strong> plus importante et ajoute une <strong>ce</strong>rtaine dimension à l’émotion et la<br />
compassion suscitées. Les témoignages sont beaucoup utilisés. En <strong>ce</strong> qui con<strong>ce</strong>rne les<br />
reportages et documentaires ils vont plus en profondeur et pénètrent plus profondément<br />
l’intimité des interlocutri<strong>ce</strong>s. Ces dernières sont par ailleurs exclusivement présentées<br />
comme victimes, en accord avec la figure de la victime dont nous avons déjà analysé<br />
l’émergen<strong>ce</strong>. Le but explicite est de faire comprendre leur réalité, de la dénon<strong>ce</strong>r mais aussi<br />
et surtout, de leur restituer la parole.
22<br />
2.3 Au-delà : Les discours produits dans la sphère scientifique<br />
En <strong>ce</strong> qui con<strong>ce</strong>rne la sphère scientifique et universitaire, il me semble important de préciser<br />
qu’à propos de <strong>ce</strong>tte problématique, les viols et violen<strong>ce</strong>s sexuelles ont été beaucoup<br />
étudiées en elles-mêmes et pour elles-mêmes, ou alors du point de vue de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui<br />
ont une part de responsabilité dans la réalisation de <strong>ce</strong>tte problématique. La parole des<br />
bourreaux est donc au final plus fréquemment rentrée dans le discours de l’analyse<br />
scientifique sociologique et anthropologique que <strong>ce</strong>lle des victimes, peut-être par<strong>ce</strong> qu’elle<br />
apporte plus dans la tentative, propre à notre ère, de comprendre les mécanismes de<br />
basculement dans la violen<strong>ce</strong> de masse et dans la cruauté; peut-être aussi par<strong>ce</strong>-que « la<br />
victime (une femme, souvent), morte dans d’atro<strong>ce</strong>s souffran<strong>ce</strong>s, ne dit plus rien, par contre<br />
l’auteur (un homme, pas toujours) est encore là, gorgé de sang et d’encre » 14 en ex-<br />
Yougoslavie, nous fournissant ainsi peut-être un élément d’explication quant au fréquent<br />
délaissement de la parole des victimes au profit<br />
de <strong>ce</strong>lle du bourreau, pour <strong>ce</strong>tte<br />
problématique spécifique. Le développement de la discipline de la victimologie (déjà depuis<br />
1937) dans les scien<strong>ce</strong>s dures et dans les scien<strong>ce</strong>s humaines invite rapidement à<br />
contrebalan<strong>ce</strong>r <strong>ce</strong>tte tendan<strong>ce</strong>. Cette discipline n’est pas sans poser de problèmes d’ordre<br />
épistémologique dans la mesure où elle institutionnalise au niveau universitaire le statut de<br />
victime comme objet d’étude. Il est ici important de préciser que, quoi qu’il en soit, <strong>ce</strong>tte<br />
discipline appartient plus aux psychologues et psychanalystes qu’aux sociologues,<br />
anthropologues et philosophes. Peut-être que le renversement que nous avons évoqué n’a<br />
tout simplement pas encore touché <strong>ce</strong>t objet d’étude spécifique qu’est la violen<strong>ce</strong> genrée et<br />
ethnique au Sud-Kivu.<br />
Con<strong>ce</strong>rnant les articles universitaires ils s’inscrivent dans une logique d’approfondissement,<br />
d’amélioration de la connaissan<strong>ce</strong> sur l’objet d’étude que serait les victimes de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles dans l’Est de la RDC. La plupart des écrits que j’ai identifiés ont une perspective<br />
plus distanciée, plus rationnelle, plus critique, plus scientifique vis-à-vis de la question sur les<br />
discours déjà produits dans les sphères que nous avons déjà analysées. Con<strong>ce</strong>rnant les<br />
mémoires, finalement peu nombreux, que j’ai pu consulter à Bukavu, ils s’inscrivent dans la<br />
même logique compassionnelle que nous avons déjà décrite dans les autres sphères. Il est<br />
14<br />
Nahoum-Grappe, Dominique (1996)« l’usage politique de la cruauté », in Séminaire de Françoise Héritier, De la<br />
violen<strong>ce</strong> 1
23<br />
apparemment difficile quand une telle réalité est si proche de la dire de manière<br />
complètement détachée. 15<br />
2.4 Caractéristiques de <strong>ce</strong>s discours: une arme de guerre « banalisée ».<br />
En temps de guerre, les « violen<strong>ce</strong>s sexuelles » sont souvent décrites comme une réalité<br />
indéniable mais inévitable, voire fatale. Cette réalité a effectivement traversé les barrières<br />
du temps de l’antiquité à nos jours, et de l’espa<strong>ce</strong>. Le viol des Sabines, mythe fondateur de la<br />
Rome antique, est l’exemple souvent évoqué pour illustrer son intemporalité et expliquer<br />
des aspects du phénomène. Cette affirmation, aussi juste soit-elle, tend à faire passer <strong>ce</strong>t<br />
acte comme invariant, universel, voire banal contre lequel il est difficile d’agir.<br />
C’est après la seconde guerre mondiale qu’on assiste à une première prise en compte des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles en temps de guerre à un niveau international. Ce n’est que quarante ans<br />
après que, lors du conflit en Ex-Yougoslavie, l’on commença à parler du viol comme « arme<br />
de guerre » ou de destruction parfois qualifiée comme massive. Ce type de violen<strong>ce</strong> sexuelle<br />
s’inscrit alors dans une démarche globale stratégique, rationnelle, réfléchie et conçue<br />
globalement. Sinon, il peut s’agir d’une initiative spontanée favorisée par un contexte<br />
militaire particulier. On peut parler, dans un cas, de viols et violen<strong>ce</strong>s sexuelles comme<br />
armes, voire tactiques de guerre et, dans l’autre, de viols et violen<strong>ce</strong>s sexuelles comme<br />
conséquen<strong>ce</strong>s de la guerre. La limite entre les deux types de violen<strong>ce</strong> n’est par ailleurs pas<br />
toujours claire ; le premier cas de figure pouvant évoluer vers le deuxième de manière<br />
presque incontrôlée.<br />
Depuis l’émergen<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong> sujet dans l’ensemble de <strong>ce</strong>s sphères la tendan<strong>ce</strong> est à présenter<br />
<strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s sexuelles comme des armes de guerre. Ce qui, parfois mais pas toujours, est le<br />
cas. Tous les milieux qui produisent des discours sur le sujet et que nous venons d’analyser<br />
semblent s’accorder pour désigner et dénon<strong>ce</strong>r <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s comme armes de guerre,<br />
plutôt que comme conséquen<strong>ce</strong>s indirectes du chaos crée par la guerre, tellement qu’il nous<br />
15 Byanamungu, Muhungusa, Pascasie, Perspectives d’une prise en charge pastorale des femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles : cas de la paroisse de Walungu, mémoire de graduat option pastorale familiale, Institut Supérieur de Pastorale<br />
Familiale, 2006-2007
24<br />
parait né<strong>ce</strong>ssaire de s’arrêter un temps pour questionner <strong>ce</strong>tte nomination. Le viol comme<br />
arme de guerre apparait comme une catégorisation instrumentalisée mais dans quel but ?<br />
Les recommandations en fin de rapports montrent que l’information récoltée par les<br />
associations est délivrée dans le but fréquent de faire agir, de faire prendre des décisions<br />
aux organes de décision supérieurs que seraient les antennes de l’ONU de l’UE, et surtout les<br />
tribunaux nationaux et internationaux.<br />
La tendan<strong>ce</strong> à catégoriser <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans les armes de guerre peut trouver une<br />
esquisse d’explication dans la résolution 1870 du conseil de sécurité de l’ONU qui classe le<br />
viol et toute autre forme de violen<strong>ce</strong>s sexuelles comme des mena<strong>ce</strong>s à la sécurité<br />
internationale et donc comme possibles crimes de guerre contre l’humanité ou comme<br />
élément constitutif du crime génocidaire le 19 juin 2008. Les résolutions de 2000 (« les<br />
femmes, la paix, la sécurité ») et <strong>ce</strong>lles qui s’ensuivent ne suffisent apparemment pas à<br />
changer la réalité de terrain. Cette résolution encourage toutes les mesures possibles pour<br />
prévenir les actes de violen<strong>ce</strong> sexuelle contre des civils et aider les victimes de <strong>ce</strong>s crimes.<br />
Elle rend aussi<br />
une éventuelle sanction possible et légitime alors une éventuelle<br />
intervention du conseil et surtout donne un cadre juridique et d’action aux mouvements de<br />
lutte contre <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s dont la cause principale est d’ailleurs juridique : l’impunité. 16<br />
Véronique Moufflet offre dans son article un autre élément d’explication. Elle démontre très<br />
bien comment voir <strong>ce</strong> phénomène comme une stricte illustration des tensions géo-politiques<br />
de la région peut s’avérer dangereux en <strong>ce</strong> que <strong>ce</strong>la peut facilement être récupéré<br />
politiquement. Cette interprétation implique effectivement que chacun des bourreaux fait<br />
né<strong>ce</strong>ssairement parti d’un groupe militaire. Les associations et les médias peuvent alors<br />
dénon<strong>ce</strong>r telle ou telle mili<strong>ce</strong> au gré des intérêts politiques, chaque association locale étant<br />
reliée de près ou de loin à une mouvan<strong>ce</strong> politique, et financiers, chaque association locale<br />
dénonçant tel ou tel groupe armé selon les propriétés établies par <strong>ce</strong>ux qui détiennent les<br />
possibilités de finan<strong>ce</strong>ments. On assisterait alors à une véritable politisation plus ou moins<br />
consciente des discours produits sur <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s sexuelles qui ne seraient alors qu’un<br />
« outil de communication politique qui permet de désigner leurs adversaires comme<br />
coupables de violen<strong>ce</strong>s sexuelles à des fins de guerre et plus largement comme responsables<br />
de la désintégration du tissu sociale congolais ». Le phénomène dépasse pourtant <strong>ce</strong>s<br />
16 Pambazuka News (voix pan africaie pour la liberté et la justi<strong>ce</strong>) : Carlyn Hambuba, Le viol comme arme de<br />
guerre : L’ONU ouvre un front aux mouvements de femmes<br />
(http://www.pambazuka.org/fr/category/comment/50054 consulté le 06/02/2010)
25<br />
problématiques politiques et atteint la société dans son cœur. Les associations locales savent<br />
que la responsabilité n’est pas que politico-militaire mais aussi civil. Les cas de viols civils<br />
dépasseraient en proportion les cas de viols armés selon un dernier rapport de Médecins du<br />
se faire entendre de manière conséquente. L’idée de l’utilisation des violen<strong>ce</strong>s sexuelles<br />
comme arme (politique) de guerre est donc à manipuler avec précaution.<br />
De la même manière que l’expression « arme de guerre » accompagne souvent le discours<br />
sur les « violen<strong>ce</strong>s sexuelles », des notions telles la « banalisation » et la « systématisation »<br />
caractérise <strong>ce</strong> même discours. C’est avec l’adjectif « banal » et le nom « banalisation » que<br />
sont introduits beaucoup d’articles, comme nous le montre déjà bien par exemple le titre de<br />
quelques-uns des articles de la bibliographie (L’Express : 2008 ; Media et humanitaire). Cette<br />
« banalisation » discursive, je l’ai retrouvée dans la ville de Bukavu : à la quasi-invisibilité de<br />
<strong>ce</strong>s femmes dans la sphère discursive occidentale ou, en tous cas, à leur visibilité ponctuelle,<br />
répondait une survisibilité nominative dans <strong>ce</strong>tte ville même où, pourtant, elles m’étaient<br />
invisibles : Les chansons de sensibilisation au rythmé congolais qui s’échappaient de postes<br />
de radio, les pancartes du siège social des ONGs spécialisées dans l’action en faveur des<br />
femmes victimes de violen<strong>ce</strong> sexuelle qui fleurissaient, les affiches des différentes<br />
campagnes de sensibilisation au viol comme arme de guerre, comme <strong>ce</strong>lle de Vagina day<br />
donnaient une réalité à la problématique dans l’espa<strong>ce</strong> public urbain. Le phénomène était<br />
apparemment double : Les associations qu’il me fallait donc au moins essayer d’identifier se<br />
multipliaient autant que les victimes mais <strong>ce</strong>s dernières m’étaient invisibles. Elles perdaient<br />
leur réalité effective au profit de leur réalité économique dans la mesure où leur existen<strong>ce</strong><br />
publique débloquait des fonds dont elles n’étaient pas né<strong>ce</strong>ssairement les premières<br />
bénéficiaires, <strong>ce</strong> qui pourrait être un élément d’explication quant à la relative indifféren<strong>ce</strong><br />
générale qui semblait régner dans l’opinion publique kivutienne : Cette réalité était plutôt<br />
vue comme un business, pour reprendre le mot que j’ai si souvent entendu, que comme une<br />
souffran<strong>ce</strong> réelle et effective. Peut-être qu’il s’agissait là d’une manière inconsciente de<br />
mettre à distan<strong>ce</strong> une réalité quotidienne pourtant effective et de la rendre supportable.<br />
Je me suis rendue compte par la suite qu’à la ville, effectivement, elles sont nombreuses :<br />
Dans la « banalisation » ambiante de leur vécu, et dans le chaos et l’anonymat d’une ville<br />
surpeuplée, elles pouvaient se mettre à l’abri du regard des autres où de l’insécurité, laissés<br />
au village. Avant mon départ, nombreux étaient les aspects de mon objet d’étude que j’avais<br />
inconsciemment sous-estimés ou simplement mal estimés. Il en était ainsi de l’ampleur du
26<br />
phénomène que je voulais étudier. Tout <strong>ce</strong> que j’avais lu était en fait comme extrait de la<br />
réalité subjective et personnelle des gens. En effet, comment un évènement aussi lourd de<br />
conséquen<strong>ce</strong>s à l’échelle individuelle pouvait être décrit comme « banal » ? Il est vrai que la<br />
particularité de <strong>ce</strong> qui s’avère être un véritable phénomène social (la propagation des viols<br />
et des violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans la société) réside dans son écho à une double échelle : Un (ou<br />
plusieurs, car elles sont nombreuses à avoir été violées plusieurs fois dans la même unité<br />
temporelle mais aussi à plusieurs mois ou plusieurs années de différen<strong>ce</strong>) acte de violen<strong>ce</strong><br />
subi à un moment déterminé par un individu spécifique et unique se multiplie, se propage,<br />
s’étend sur l’échelle du temps et de l’espa<strong>ce</strong>. L’expérien<strong>ce</strong> individuelle, parfois vécue dans la<br />
plus grande solitude, devient une expérien<strong>ce</strong> collective, voire, une expérien<strong>ce</strong> de masse.<br />
C’est <strong>ce</strong>tte multiplication qui justifie la qualification de « banal ». Il me semble <strong>ce</strong>pendant<br />
que l’évident traumatisme que révèle notamment le non-dit que nous allons explorer remet<br />
en question <strong>ce</strong>tte idée de « banalisation ». A l’échelle individuelle, les actes de violen<strong>ce</strong> n’ont<br />
rien de banal. Au contraire, ils sont vécus comme quelque-chose de tellement nouveau et<br />
inédit que jamais <strong>ce</strong>lles qui les ont subis n’auraient pensé avoir à vivre <strong>ce</strong> genre d’expérien<strong>ce</strong><br />
traumatisante. Donc si le discours est banalisé, en aucun cas il est vécu de manière banale à<br />
l’échelle individuelle.<br />
Telles sont donc les lumières historiques et les grandes caractéristiques de <strong>ce</strong> qui déjà a été<br />
dit à propos de <strong>ce</strong>tte problématique et de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui lui ont survécu. C’est donc<br />
seulement à partir de <strong>ce</strong> passé discursif qu’il est éventuellement possible de dire la violen<strong>ce</strong><br />
qu’elles <strong>vivent</strong>. Analysons maintenant <strong>ce</strong> que je veux et peux en dire.
27<br />
Chapitre 2. Objectifs, caractéristiques et<br />
dangers de ma prise de parole.<br />
1. <strong>Dire</strong> une réalité silencieuse<br />
1.1 Un humble objectif…<br />
Le premier objectif qui a motivé <strong>ce</strong> projet de recherche m’est apparu comme simple, évident,<br />
né<strong>ce</strong>ssaire et indiscutable : je voulais faire savoir <strong>ce</strong> qui était méconnu, voire parfois inconnu<br />
pour <strong>ce</strong>rtains, rendre visible <strong>ce</strong> qui ne l’était vraisemblablement pas assez. Cette<br />
méconnaissan<strong>ce</strong> et <strong>ce</strong>tte invisibilité sont relatives. Je ne me rendais pas alors compte des<br />
dangers inhérents à <strong>ce</strong>t objectif :<br />
«La violen<strong>ce</strong> domestique et la violen<strong>ce</strong> contre les femmes en général affectent elles aussi<br />
bien plus que les personnes directement con<strong>ce</strong>rnées, permettant une relative économie de<br />
moyens. Il n'est pas né<strong>ce</strong>ssaire de violer ou de battre toutes les femmes tous les jours :<br />
quelques cas particulièrement horribles présentés avec éclat par la presse à scandale ou<br />
rapportés par les voisines suffisent pour que chacune s'inquiète et redoute d'enfreindre les<br />
normes <strong>ce</strong>nsées la protéger de pareil sort. L'indignation et la résistan<strong>ce</strong> existent, mais l'auto<strong>ce</strong>nsure,<br />
l'isolement, la passivité et la résignation semblent bien être les principaux effets<br />
obtenus. » 17<br />
Si j’ai conscien<strong>ce</strong> aujourd’hui des potentiels dangers de la visibilité de la violen<strong>ce</strong>, je ne me<br />
suis pas sûre que <strong>ce</strong>tte crainte, justement formulée, se réalise systématiquement. Mon<br />
raisonnement est presque inverse : Cette visibilité est la condition à l’éventuelle action de<br />
résistan<strong>ce</strong>. – Comment agir contre une réalité dont on n’a pas conscien<strong>ce</strong> ? Malgré l’existen<strong>ce</strong><br />
de discours produits à propos de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong>, il semblerait que sa réalité pour <strong>ce</strong>lles qui en<br />
sont victimes s’inscrive effectivement dans une <strong>ce</strong>rtaine pérennité. Il me semble pourtant<br />
que si aujourd’hui encore elles sont perpétrées c’est que la prise de conscien<strong>ce</strong> n’est pas<br />
17 Oropeza Dobles, citée dans Falquet Jules, « Guerre de base intensité contre les femmes? La violen<strong>ce</strong><br />
domestique comme torture, réflexions sur la violen<strong>ce</strong> comme système à partir d cas Salvadorien » (2007) in<br />
Freedman, Jane ; Valluy, Jérôme (coords.). Persécutions des femmes. Savoirs, protections et mobilisations, Paris,<br />
Editions du Croquant.
28<br />
arrivée jusqu’aux sphères ou elle le devrait. Il est alors légitime de produire un autre discours<br />
à leur propos. Celui que je propose ici s’inscrit dans l’intersti<strong>ce</strong> des sphères associative,<br />
médiatique et universitaire : mon but est à la fois de sensibiliser à <strong>ce</strong>tte réalité encore<br />
actuelle, de la rendre visible, mais aussi d’en améliorer ma compréhension afin de la clarifier,<br />
pour moi et pour <strong>ce</strong>ux qui me liront, la restitution écrite de <strong>ce</strong> que j’en ai vu, lu, entendu et<br />
compris. Il ne s’agit alors pas seulement de rendre visible une réalité particulière et<br />
particulièrement « atro<strong>ce</strong> », pour reprendre un champ lexical privilégié par les sphères<br />
médiatiques et associatives qui ont au moins le mérite de donner une visibilité même limitée<br />
à <strong>ce</strong>tte réalité. Il s’agit aussi et surtout d’en éclairer, d’en expliquer les mécanismes et les<br />
dynamiques sociales, culturelles économiques et même politiques qui sous-tendent <strong>ce</strong>tte<br />
réalité.<br />
1.2 …qui a une histoire.<br />
Cette humble tentative de donner une voix même fragile à une réalité, <strong>ce</strong>rtes de moins en<br />
moins silencieuse dans <strong>ce</strong>rtaines sphères de connaissan<strong>ce</strong>s, a une histoire que je ne peux<br />
ignorer. Mon projet universitaire s’inscrit vraisemblablement dans l’histoire du féminisme.<br />
Ce mouvement n’a pas seulement cherché à défendre les droits des femmes, ou, comme le<br />
dit Jonathan Culler cité par G.C Spivak , « la contribution des révolutions démocratiques<br />
bourgeoises à l’individualisme social et politique des femmes »18, mais aussi à donner aux<br />
« subalternes [ndlr : Ici, les femmes] une voix dans l’histoire »19. Malgré tous les dangers<br />
épistémologiques que <strong>ce</strong>la implique, beaucoup de travaux aujourd’hui dans les scien<strong>ce</strong>s<br />
sociales et politiques s’inscrivent dans <strong>ce</strong> projet. Les espa<strong>ce</strong>s de l’histoire qui ont été réduits<br />
au silen<strong>ce</strong> sont nombreux et, d’ailleurs, pas né<strong>ce</strong>ssairement féminins. Ce projet n’est donc<br />
pas exclusivement féministe. Cependant, en <strong>ce</strong> qui con<strong>ce</strong>rne la fa<strong>ce</strong> féministe du projet,<br />
lorsque l’histoire des femmes se constitue, un tournant se dessine, car la femme est alors<br />
trop souvent présentée comme une victime. Son identité dans les représentations et les<br />
discours se cristallise autour de <strong>ce</strong> statut. Mais « Est-<strong>ce</strong> que les femmes n’ont pas eue un rôle<br />
à jouer dans l’histoire ? Est-<strong>ce</strong> qu’elles ont toujours tout ac<strong>ce</strong>pté ? Ont-elles consenti ? » :<br />
Telles sont les questions qui animent <strong>ce</strong> retournement dans la manière de dire l’histoire de<br />
18 Jonathan Culler cite par Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris,<br />
éditions Amsterdam.<br />
19 Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, éditions Amsterdam, Paris, p74.
29<br />
la femme et qui peuvent expliquer les mises en garde universitaires formulées à l’égard d’un<br />
projet pourtant né d’une inoffensive (en apparen<strong>ce</strong>) volonté de dire <strong>ce</strong> que <strong>vivent</strong> des<br />
« victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans le contexte post-conflictuel du Sud-Kivu ». Cette<br />
problématique trouve son origine dans le général, dans le politique, dans l’Histoire mais je ne<br />
voulais pas me confiner dans <strong>ce</strong>tte dimension-là. Telle est la raison pour laquelle je consacre<br />
si peu de lignes à la description du contexte social et politique pourtant peu connu. Un peu à<br />
la manière d’Urvashi Butalia, <strong>ce</strong>tte éditri<strong>ce</strong>, écrivaine, essayiste, professeure indienne qui a<br />
tenté de donner une voix aux « aspects particuliers » de la Partition Inde-Pakistan plutôt qu’à<br />
son aspect général, apparemment déjà connu, je souhaite ici restituer une réalité sociale,<br />
politique, militaire, dans ses aspects particuliers « plus difficiles à découvrir »20. Au départ,<br />
c’est tout <strong>ce</strong> que je savais : Je voulais donner une voix particulière à des « victimes de<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles » dans l’est – finalement réduit au Sud-Kivu – de la République<br />
Démocratique du Congo, pour les raisons que j’ai déjà évoquées, sans véritablement savoir<br />
qui elles étaient ni si elles avaient déjà une identité discursive que je devais prendre en<br />
compte. Finalement le particulier se mêle, forcément un peu, avec le singulier, et le général,<br />
voire l’universel. A la lumière de <strong>ce</strong> travail d’analyse d’identité discursive, il fallait alors que je<br />
définisse et problématise plus clairement <strong>ce</strong> que je voulais dire de <strong>ce</strong>s femmes. Cette<br />
problématisation s’est faite en trois mouvements.<br />
20 Butalia Urvashi (2002) Les voix de la partition Inde-Pakistan, Arles, Actes Sud, p10.
30<br />
2. Une parole de plus en plus précise et problématisée<br />
2.1 Le premier mouvement de réflexion<br />
Le titre de mon projet de mémoire a évolué avec l’affinement de ma problématique. Dans<br />
un premier temps, je pensais seulement proposer la compréhension que j’avais d’une réalité<br />
alors pas très bien définie, à la lumière de témoignages et de con<strong>ce</strong>pts théoriques rendus<br />
familiers par ma première année de master en sociologie et anthropologie des migrations et<br />
des relations interethniques, tels que le genre et l’ethnicité. Je me suis d’abord interrogée<br />
sur les possibilités qui s’offraient à <strong>ce</strong>lles qui avaient survécu à <strong>ce</strong> type de violen<strong>ce</strong>s liées au<br />
conflit et aux dépla<strong>ce</strong>ments corollaires et, déjà, sur le rôle du tissu associatif local et<br />
international dans la reconstruction de leur vie. Dans <strong>ce</strong>tte région, le décalage entre les<br />
multiples signes de la présen<strong>ce</strong> d’acteurs associatifs de l’aide d’urgen<strong>ce</strong> et de développement<br />
et les signes visibles de la souffran<strong>ce</strong> palpable des habitants, liée à toute sorte de maux<br />
étonne et interroge né<strong>ce</strong>ssairement tout regard extérieur. Il semblerait d’ailleurs que <strong>ce</strong>tte<br />
provin<strong>ce</strong> - et même <strong>ce</strong> pays - appartienne à <strong>ce</strong>ux, comme la Guinée-Bissau, Haïti, le Liberia,<br />
la Sierra Leone, la Somalie, dont la dégradation infrastructurelle, économique et sociale est<br />
en lien direct ou indirect avec le contexte politico-militaire. Il semblerait même qu’elle soit en<br />
lien, direct ou indirect, avec l’aide dont ils ont bénéficiés, et pas seulement par<strong>ce</strong> qu’elle est<br />
occasionnellement détournée à des fins personnelles et politiques.21<br />
J’ai d’abord opposé, de manière un peu schématique, les acteurs locaux aux acteurs<br />
internationaux. Dans <strong>ce</strong>tte région, le phénomène est double : on assiste à une massification<br />
des actes de violen<strong>ce</strong>s et donc à une multiplication des victimes de <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s qui ne se<br />
déclarent pas né<strong>ce</strong>ssairement d’une part, et à une multiplication parallèle des associations<br />
qui s’impliquent soit dans la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s sexuelles en elles-mêmes, ou dans la<br />
prise en charge de <strong>ce</strong>ux et surtout <strong>ce</strong>lles qui en sont victimes d’autre part. Et c’est<br />
progressivement que je pris conscien<strong>ce</strong> de la complexité du lien entretenu par les<br />
associations locales avec leur « partenaires » internationaux. L’action locale que je supposais<br />
21 Sogge David, (2003) les mirages de l’aide internationale, Enjeux planète, ed. Charles<br />
Leopold Mayer.<br />
Perouse de Montclos, Marc Antoine. (2001). L’aide humanitaire, aide à la guerre ? Paris :<br />
Editions Complexe. 208 p.
31<br />
modeste mais plus adaptée et respectueuse de la volonté, des besoins, et des valeurs<br />
culturelles de la société civile, ne s’opposait pas né<strong>ce</strong>ssairement et strictement à une action<br />
internationale déconnectée des réalités locales et inadéquate. Les deux s’imbriquaient l’une<br />
dans l’autre, et s’influençaient mutuellement. Je ne pouvais donc pas prétendre explorer le<br />
tissu associatif local impliqué dans le domaine qui m’intéressait sans explorer <strong>ce</strong> rapport<br />
complexe qui le reliait à la communauté internationale, qui de fait, formatait ses actions. Il<br />
m’est ensuite apparu assez rapidement que mon sujet n’était pas assez précis et<br />
problématisé. Au cours de mes recherches, je me suis rendu compte que les associations<br />
semblaient con<strong>ce</strong>ntrer leurs actions autour de cinq volets différents : le volet psychologique,<br />
le volet spirituel (rassemblés parfois sous une même dénomination), le volet socioéconomique,<br />
le volet familial et communautaire (aussi parfois rassemblés sous une même<br />
dénomination) et le volet juridique et judiciaire. Les premières associations rencontrées sur<br />
le terrain ont confirmé l’existen<strong>ce</strong> effective de <strong>ce</strong> partage des champs d’intervention. Par<br />
exemple l’ONG CAMPS, pourtant réputée pour son action dans le domaine social et<br />
communautaire, milite en faveur d’une approche holistique de l’action. Elle propose des<br />
actions dans les domaines psychologique, socio-économique et communautaire et travaille<br />
en partenariat avec d’autres associations pour les autres domaines. Il est vrai que tous <strong>ce</strong>s<br />
champs d’intervention (ainsi que toutes les dimensions de la problématique) sont<br />
interdépendants les uns des autres et ont une influen<strong>ce</strong> plus ou moins forte sur le parcours<br />
d’une personne selon sa personnalité et les moments de sa vie. Ce partage nous aide tout de<br />
même à penser <strong>ce</strong>tte problématique et à classifier les actions. Toute l’activité de CAMPS, par<br />
exemple, est, quoi qu’il en soit, orientée en fonction des domaines d’intervention que nous<br />
avons évoqués. Le tableau des activités des associations locales œuvrant dans le domaine de<br />
la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s sexuelles et du soutien à <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux, moins visibles, qui en<br />
sont victimes, proposé en annexe a été conçu à la lumière de <strong>ce</strong> partage. Malgré <strong>ce</strong>tte<br />
interdépendan<strong>ce</strong> qui existe entre <strong>ce</strong>s différents domaines, il m’a alors semblé important de<br />
me con<strong>ce</strong>ntrer sur l’un d’entre eux. Malgré ma profonde conviction que l’aspect<br />
psychologique est primordial, j’ai pensé qu’il était plus pertinent, compte tenu mon parcours<br />
et de mes matières de rattachement que sont la sociologie et l’anthropologie, de me<br />
con<strong>ce</strong>ntrer sur l’aspect communautaire et donc familial.
32<br />
2.2 Le deuxième mouvement de réflexion<br />
Le deuxième titre de mon projet était alors le suivant : « La reconstruction du lien<br />
communautaire par et pour les femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans l’est de la<br />
République Démocratique du Congo. » Même si ma problématique a encore évolué, il me<br />
parait important d’expliciter mes interrogations ici car elles ont orienté tout mon travail de<br />
terrain et elles nourrissent les réponses que je tente d’apporter à ma problématique finale.<br />
Je suis partie de la définition du lien communautaire tel que Weber le définit 22. Ce n’est, par<br />
ailleurs, pas lui mais Tönnies qui fut le premier à formuler clairement et en termes théoriques<br />
une définition de la communauté en opposition avec la société. Pour Tönnies, la<br />
communauté renvoie à des entités sociales constituées sur la base d’un sentiment<br />
chaleureux d’un sentiment de groupe sur l’affectivité. Elle caractérise les relations entre<br />
proches : la famille, les amis, ou même les connaissan<strong>ce</strong>s. La société quant à elle renvoie aux<br />
entités sociales vues comme artificielles, rationalisées et formelles. Weber, quant à lui, ne<br />
parle pas d’entités sociales mais de relations sociales. Il évoque d’ailleurs l’idée de<br />
communalisation et de sociation et met ainsi en valeur la dynamique relationnelle de la<br />
constitution des communautés toujours par rapport aux injonctions des sociétés. Dans les<br />
scien<strong>ce</strong>s sociales d'aujourd’hui on parle plutôt de société communautaire ou sociétaire, les<br />
deux ne s’opposant pas de manière systématique. Dans le cas qui nous con<strong>ce</strong>rne, il<br />
semblerait que <strong>ce</strong>tte communauté soit visée à travers la femme. C’est dans <strong>ce</strong> sens que vont<br />
tous les discours que j’ai entendu à propos de <strong>ce</strong>tte problématique communautaire, jusqu’à<br />
<strong>ce</strong>lui lisse et officiel du vi<strong>ce</strong>-gouverrneur du Sud-Kivu, Jean Claude Kibala : A l’occasion de la<br />
première représentation des Monologues du vagin d’Eve Ensler, il formula un discours auprès<br />
des acteurs et actri<strong>ce</strong>s (moins nombreuses, toujours) associatifs présents sur les<br />
conséquen<strong>ce</strong>s des violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans la société et l’importan<strong>ce</strong> des opérations de<br />
sensibilisation telle que <strong>ce</strong>lle menée par V-day, l’association de l’auteure et sur la prévention<br />
de la destruction bien connue des communautés. Dans la définition que nous avons essayé<br />
de donner du genre, nous avons déjà approché <strong>ce</strong>tte idée de la femme comme symbole. En<br />
tant que symbole de la terre nourricière, ou de l’avenir de tout un groupe d’appartenan<strong>ce</strong><br />
ethnique, elle peut être attaquée. Son rôle, <strong>ce</strong>ntral au sein de la communauté familiale et<br />
villageoise, et donc aussi au sein de la société peut lui aussi être visé. Après toutes <strong>ce</strong>s<br />
22 Weber, Marx [1995 (1956-67)] « Les relations communautaires ethniques », in Economie et Société.<br />
L’organisation et les puissan<strong>ce</strong>s de la société dans leur rapport avec l’économie. Paris, Pocket, p. 124-144.
33<br />
lectures qui insistent sur la dimension communautaire, j’ai décidé de me con<strong>ce</strong>ntrer sur <strong>ce</strong>t<br />
aspect de la problématique. J’ai défini deux niveaux dans la communauté : <strong>ce</strong>lui de la famille<br />
et <strong>ce</strong>lui du village. Dans un premier temps, je les ai confondu, pensant que, particulièrement<br />
dans <strong>ce</strong>tte région, les voisins et voisines sont comme des membres de la famille, les parents<br />
des uns surveillants par exemple les enfants des autres comme si ils étaient les leurs. Mais<br />
au cours de mon enquête je me suis aperçue que là ou moi je mettais la structure familiale et<br />
villageoise sur le même niveau, mes interlocutri<strong>ce</strong>s dessinaient une frontière, surtout lorsque<br />
je les interrogeais sur la réaction des membres de <strong>ce</strong>s structures communautaires.<br />
Interviewer : Depuis que tu es ici [ndlr à l’hôpital Panzi], tu te sens plus proche des gens de ta<br />
famille qui sont restés là-bas chez toi ou des gens que tu as rencontrés ici à l’hôpital ?<br />
Interviewée (Sophie) : De <strong>ce</strong>ux qui sont ici. On peut dire que <strong>ce</strong>ux dont je suis proche là-bas<br />
chez nous <strong>ce</strong> sont tate et les membres de ma famille. Tous les autres ne m’aiment pas. Ils<br />
disent du mal de moi. Est-<strong>ce</strong> que je peux vraiment me sentir proche de quelqu’un qui dit du<br />
mal de moi ?<br />
En dessinant <strong>ce</strong>tte frontière entre les membres de sa famille et les « autres » du village, elle<br />
souligne un élément essentiel moteur de la différenciation : le regard moqueur de <strong>ce</strong>s autres.<br />
Sa communauté s’arrête à <strong>ce</strong>ux et <strong>ce</strong>lles qui lui renvoient une image négative et dépréciative<br />
d’elle-même. Parmi les membres de sa communauté, c'est-à-dire de <strong>ce</strong>ux dont elle se sent<br />
proche, elle sépare les membres de sa famille restés au village, des personnes rencontrées à<br />
l’hôpital de ville : le personnel et ses « semblables » qui ont vécu la même chose qu’elle. Je<br />
me suis proposée d’analyser les répercussions de tels actes sur les relations sociales et<br />
communautaires de la victime pour ensuite mieux interroger les possibilités de surmonter, et<br />
au mieux, réparer <strong>ce</strong>s préjudi<strong>ce</strong>s. Si je parle de reconstruction, c’est que je suppose que dans<br />
un premier temps il y a eu construction puis, dans un deuxième, déconstruction. En effet,<br />
c’est bien la personne sociale telle qu’elle est définie au sein de sa communauté d’origine, et<br />
son lien avec <strong>ce</strong>tte communauté d’origine - de la <strong>ce</strong>llule familiale à <strong>ce</strong>lle villageoise, voire<br />
régionale - que les auteurs de <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s visent souvent à détruire - <strong>ce</strong>la dépendant aussi<br />
beaucoup du contexte, civil ou armé par exemple, dans lequel s’inscrit l’exerci<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>s<br />
violen<strong>ce</strong>s.<br />
Parallèlement, je m’interrogeais aussi sur les dynamiques identitaires corollaires aux<br />
transformations du lien communautaire que nous avons évoquées. Avant d’explorer <strong>ce</strong>s
34<br />
dynamiques identitaires sur le terrain, je les avais explorées en termes théoriques,<br />
notamment à travers des auteurs comme Giraud, Barth ou J.L. Amselle. L’approche<br />
interactionniste de Frederick Barth dans Les groupes ethniques et leurs frontières23 par<br />
exemple m’a semblée pouvoir s’appliquer aux dynamiques identitaires que j’ai pensé dé<strong>ce</strong>ler<br />
dans les entretiens que je me proposais de mener avec les femmes qui avaient subi <strong>ce</strong> type<br />
de violen<strong>ce</strong>s. En effet, il développe dans <strong>ce</strong>t ouvrage l’idée de la construction de l’identité<br />
(ethnique dans son cas mais elle peut aussi s’appliquer à l’identité culturelle, sociale, et/ou<br />
genrée) à travers un pro<strong>ce</strong>ssus interactionnel d’hétéro-catégorisation et d’autocatégorisation,<br />
c'est-à-dire de catégorisation croisée. Il apparaît dès lors que l’identité se joue<br />
dans l’interaction et par là même se débarrasse de toute essentialité et de toute stabilité.<br />
D’un contexte interactionnel à l’autre, elle peut varier, manipulée qu’elle est par l’individu.<br />
Elle apparaît comme une construction, voire comme une stratégie. J’ai supposé qu’être<br />
victime du type de violen<strong>ce</strong>s que je me proposais d’étudier et des dépla<strong>ce</strong>ments qu’ils<br />
impliquent fragilise voire détruit le lien avec l’unique référentiel identitaire qu’était la famille<br />
puis le village. Je me suis alors demandé s'il était possible pour <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui avaient subi<br />
<strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> de reconstruire <strong>ce</strong>s liens et dans quelles conditions. Si <strong>ce</strong>tte reconstruction<br />
n’est pas possible, quels sont les nouveaux liens et les nouvelles identifications ? Vont-ils se<br />
créer seulement avec les autres qui ont été victimes de la même expérien<strong>ce</strong>? Vont-elles se<br />
cristalliser autour de <strong>ce</strong> statut de victime ou au contraire vont-elles tenter de s’en<br />
différencier? Pourquoi? Quelles en sont les motivations conscientes et/ou inconscientes ? En<br />
lisant que beaucoup des « écoutantes » ou « assistantes sociales » qui s’engagent dans les<br />
associations de soutiens aux victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles ont elles-mêmes subi <strong>ce</strong> même<br />
type de violen<strong>ce</strong>s, je me suis dit que <strong>ce</strong>s dernières seraient peut-être plus faciles d’accès et<br />
auraient plus de facilité à me parler. De plus, elles ouvraient d’autres portes de réflexions<br />
notamment sur le rôle de l’engagement associatif dans la reconstruction du lien<br />
communautaire et de l’identité, toujours en construction.<br />
Je suis partie de l’hypothèse de parcours suivant : Le fait de subir des violen<strong>ce</strong>s sexuelles<br />
rompt le lien qui unit <strong>ce</strong>lle qui les subit à sa communauté, partiellement responsable de la<br />
manière dont la « victime » se définit. Les associations éventuellement rencontrées par <strong>ce</strong>tte<br />
dernière œuvrent à reconstruire <strong>ce</strong> lien. Soit la personne con<strong>ce</strong>rnée retrouve sa pla<strong>ce</strong> au sein<br />
23 Barth Frederick (1969) Les groupes ethniques et leurs frontières. L’organisation sociale des différen<strong>ce</strong>s<br />
culturelles, Bergen, Oslo, Universitetsforlaget.
35<br />
de sa communauté, ou alors elle se crée une nouvelle pla<strong>ce</strong> auprès de personnes qui ont subi<br />
les mêmes violen<strong>ce</strong>s qu’elle. Dès lors, elle s’identifie plus par rapport à sa communauté<br />
familiale ou villageoise, mais par rapport à sa nouvelle communauté de « semblables » 24<br />
Ce sont <strong>ce</strong>s parcours que je me suis proposée d’analyser et d’interroger en ayant pleinement<br />
conscien<strong>ce</strong> qu’ils n’étaient pas exclusifs les uns des autres - au contraire c’est par exemple la<br />
rencontre avec une association qui peut par exemple permettre de reconstruire les liens avec<br />
la communauté d’origine et vi<strong>ce</strong>-versa - et qu’il peut en exister des variantes. Lorsque je me<br />
suis retrouvée sur le terrain j’ai donc rendu visite prioritairement aux associations qui<br />
prenaient en compte l’aspect communautaire. Les questions que j’ai osé poser étaient<br />
directement inspirées de <strong>ce</strong> schéma. Elles interrogeaient la vie de la personne à chacune de<br />
<strong>ce</strong>s étapes, et cherchaient à comprendre à chaque fois de qui la personne se sentait « le plus<br />
proche », à qui et comment elle s’identifiait, l’impact concret qu’avaient eu toutes <strong>ce</strong>s étapes<br />
dans sa vie. Comme nous allons le voir plus tard, il s’est révélé plus difficile que <strong>ce</strong> que je<br />
pensais de poser toutes <strong>ce</strong>s questions. C’est notamment dans <strong>ce</strong>tte difficulté que réside<br />
finalement le cœur de ma problématique.<br />
2.3 Dernier mouvement de réflexion<br />
Je regrette de ne pas m’être aperçue plus tôt de mon erreur dans la formulation de ma<br />
problématique autour de laquelle toute ma réflexion s’est construite jusqu’aux derniers<br />
entretiens. A la relecture de mes entretiens, il m’apparait clairement que dans mon travail<br />
de terrain, je suis passée à côté de mon sujet. Je suis restée enfermée dans ma grille<br />
d’entretien sans m’aper<strong>ce</strong>voir qu’au lien d’interroger le lien qu’elles entretenaient avec leur<br />
communauté villageoise ou familiale il aurait fallu interroger la possibilité même de parler de<br />
<strong>ce</strong>tte communauté ou de quoi que <strong>ce</strong> soit qui approche de près ou de loin <strong>ce</strong>tte expérien<strong>ce</strong><br />
traumatisante. J’avais pensé avoir détourné les difficultés relatives au fait de revenir sur une<br />
telle expérien<strong>ce</strong> en l’insérant dans un parcours qui ne les forçait pas à raconter <strong>ce</strong>tte<br />
expérien<strong>ce</strong>. Mais <strong>ce</strong>tte difficulté s’est tout de même imposée à moi, comme le révèlent tous<br />
mes entretiens. Je me suis donc aperçue, trop tard, que les barrières qui s’étaient dressées<br />
lors de leur tentative de me dire un aspect de <strong>ce</strong> qu’elles avaient vécue étaient en fait<br />
24 C’est ainsi que mes interlocutri<strong>ce</strong>s nomment <strong>ce</strong>lles qui ont subi les mêmes violen<strong>ce</strong>s qu’elles.
36<br />
<strong>ce</strong>ntrales dans l’approche de mon sujet. J'ai enfin pris conscien<strong>ce</strong> que l’élément-clé des<br />
réponses que je tentais de trouver à la problématique identitaire et communautaire se<br />
trouvait autour du dit et du non-dit. En effet, j’ai pu observer des différen<strong>ce</strong>s dans la mise en<br />
scène probablement inconsciente de la parole de mes interlocutri<strong>ce</strong>s en fonction du lieu où<br />
elle était proférée : En ville ou au village. Le fait de dire (de gré ou de for<strong>ce</strong>) ou de garder le<br />
silen<strong>ce</strong> (de gré ou de for<strong>ce</strong> aussi) influen<strong>ce</strong> directement les formations et les transformations<br />
des communautés autour de la femme qui a subi des actes de violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique.<br />
J’ai alors, encore trop tard, bien après mon stage de terrain, décidé d’orienter mes réflexions<br />
sur la parole (verbale, para-verbale ou encore extraverbale) et, ici, son contraire inévitable et<br />
presque fatal – le silen<strong>ce</strong>.
37<br />
3. Les dangers épistémologiques inhérents à ma prise de parole :<br />
les silen<strong>ce</strong>s inévitables.<br />
Aussi pleine de bonne volonté qu’était ma tentative de réduire au maximum l’espa<strong>ce</strong><br />
condamné à un silen<strong>ce</strong> partiel de la réalité de mes futures interlocutri<strong>ce</strong>s, elle était<br />
vraisemblablement vouée à un échec, lui aussi partiel. L’un des premiers silen<strong>ce</strong>s auxquels je<br />
pouvais me confronter résidait dans les difficultés épistémologiques à les nommer et donc<br />
les catégoriser. Comment effectivement exprimer une part même infime de la réalité d’une<br />
catégorie de personnes, si sa nomination ainsi que sa catégorisation corollaire pose<br />
problème ? Bien qu’inhérente au travail du socio-anthropologue, la manipulation discursive,<br />
même distanciée, de catégories d’acteurs et/ou d’actri<strong>ce</strong>s est problématique. La catégorie<br />
des femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans le contexte post-conflictuel de l’Est de la<br />
République Démocratique du Congo que j’entendais mettre au cœur de mon étude qui se<br />
veut socio-anthropologique n’échappe pas à <strong>ce</strong>s difficultés dont je ne soupçonnais pas même<br />
l’existen<strong>ce</strong> lorsque mon sujet prit dans ma tête ou une formulation encore très relative. Je ne<br />
pensais alors effectivement pas devoir faire fa<strong>ce</strong> à <strong>ce</strong>s difficultés que nous allons d’abord<br />
considérer dans leur dimension épistémologique mais qui en devenaient parfois aussi<br />
presque éthiques. Par ailleurs, elles se sont aussi posées parfois de manière inattendue mais<br />
très concrète lorsque je me suis confrontée à la réalité du terrain, mais je traiterai de <strong>ce</strong>t<br />
aspect du problème dans le troisième chapitre. Ce n’est en fait qu’en commençant mes<br />
recherches et en confrontant les premières esquisses encore très floues d’idées à l’opinion et<br />
à la critique toujours constructive de mes relations dans la sphère personnelle et surtout<br />
universitaire que <strong>ce</strong>tte réflexivité épistémologique que je vais essayer ici de retranscrire,<br />
s’est imposée..<br />
3.1 La « victime » : Comment dire sans nommer et catégoriser ?<br />
Nous avons plus haut défini la victime comme toute personne qui subit un préjudi<strong>ce</strong> par la<br />
faute d’une tier<strong>ce</strong> personne. Nous avons aussi vu son histoire discursive. Ce terme ne<br />
renvoie pourtant pas seulement à <strong>ce</strong>tte définition qui, par ailleurs, correspond aux cas de<br />
figure que nous avons rencontrés, mais aussi et surtout à une catégorie sociale. Dans un<br />
premier temps, je n’ai pas compris les mises en garde qui ont été formulées à l’égard de mon
38<br />
sujet et surtout de l’utilisation problématique du terme de « victime ». Je n’étais alors peutêtre<br />
pas assez familière de l’histoire du féminisme que nous avons survolée plus haut. Je ne<br />
comprenais pas comment il était possible de remettre en cause le fait qu’elles aient<br />
effectivement « subi un préjudi<strong>ce</strong> par la faute d’une tier<strong>ce</strong> personne », comme le dit la<br />
définition, sans faire basculer la « faute », et donc l’entière responsabilité sur elles. Même de<br />
manière circonstancielle et donc dans un contexte particulier, <strong>ce</strong>s femmes ont été victimes.<br />
Peut-être même que les conséquen<strong>ce</strong>s du préjudi<strong>ce</strong> subi vont au-delà de la circonstan<strong>ce</strong>, du<br />
moment, du contexte. On peut donc argumenter qu’elles n’ont pas seulement été victimes<br />
mais qu’elles sont victimes, contrairement à <strong>ce</strong> qu’elles sont souvent elles-mêmes tentées de<br />
croire. Le sentiment de culpabilité comme <strong>ce</strong>lui de honte qui lui est corrollaire font partie des<br />
conséquen<strong>ce</strong>s presque classiques de la violen<strong>ce</strong> subie. Je me suis alors demandée s’il était<br />
possible de les amener à effa<strong>ce</strong>r <strong>ce</strong> sentiment en remettant en cause leur statut de victime et<br />
donc l’implication d’une tier<strong>ce</strong> personne dans la responsabilité de <strong>ce</strong> qui leur est arrivé. De<br />
plus, souvent, l’entourage entretient <strong>ce</strong> sentiment de culpabilité en les accusant d’être<br />
responsable de maux qu’elles ont pourtant subis. Il les accuse même d’y avoir pris un plaisir<br />
qu’elles n’oseraient avouer et donc d’être « la femme des Interahamwés » par exemple. Dans<br />
<strong>ce</strong> contexte, il me semble que la reconnaissan<strong>ce</strong> de leur statut même circonstanciel de<br />
victime pourrait améliorer l’image que la violen<strong>ce</strong> subie leur renvoie d’elle-même. Cette<br />
reconnaissan<strong>ce</strong> ne prend pas seulement sens d’un point de vue psychologique et social mais<br />
aussi d’un point de vue juridique dans la mesure où elle est une arme de plus dans le combat<br />
acharné que mènent beaucoup d’associations locales contre l’impunité. Mais s’il est<br />
dangereux de remettre en cause <strong>ce</strong> statut de victime, il le serait peut-être tout autant de<br />
l’utiliser sans s’arrêter, au moins un moment, pour le mettre à distan<strong>ce</strong>. Tout d’abord, les<br />
femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles ne sont effectivement pas que des femmes victimes<br />
de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans le contexte post-conflictuel de la République Démocratique du<br />
Congo. Elles l’ont été de manière circonstancielle, même si comme nous l’avons vu, les<br />
conséquen<strong>ce</strong>s peuvent aller au-delà de la circonstan<strong>ce</strong>. En les interpellant sur le seul critère<br />
de <strong>ce</strong>tte circonstan<strong>ce</strong>, je prends le risque, à travers mon discours, de les enfermer dans un<br />
statut qui ne renvoie en faites que partiellement à elles. Il ne s’agit en effet que d’une partie<br />
plus ou moins grande et plus ou moins décisive de leur vie, de leur parcours et de leur<br />
identité. L’objet de ma recherche était justement de définir, d’évaluer l’impact d’une telle<br />
circonstan<strong>ce</strong> sur la vie, sur le parcours, et sur l’identité d’une femme. Le manque de temps et
39<br />
les problèmes liés à la traduction ne m’ont finalement pas permise d’éviter les pièges de mon<br />
enquête que j’avais pourtant préalablement balisés. Il me semble malheureusement,<br />
qu’indirectement, mon enquête a participé à une <strong>ce</strong>rtaine cristallisation du parcours de vie<br />
et de l’identité de mes interlocutri<strong>ce</strong>s autour du statut de victime et de l’expérien<strong>ce</strong> du viol<br />
qui leur ont promulgué <strong>ce</strong> statut. Encore aujourd’hui, il m’est alors difficile de différencier la<br />
part de réalité de ma problématique de <strong>ce</strong>lle que j’ai moi-même façonnée, voire créée à<br />
travers mon enquête et ma présen<strong>ce</strong> sur le terrain. Nous verrons plus tard comment <strong>ce</strong><br />
problème s’est posé en termes très concrets lors de mon approche du terrain. Je conçois<br />
aussi que l’utilisation du terme « victime » pose encore problème dans la mesure où il ne<br />
renvoie pas seulement à une personne et à son expérien<strong>ce</strong> mais aussi à toute une catégorie<br />
sociale significative dans notre société. Guillaume Gerner25 argumente d’ailleurs que dans<br />
notre société, la victime serait une figure incontournable construite socialement. Elle<br />
renverrait à une catégorie sociale vénérée et instrumentalisée à des fins autres<br />
qu’humanistes. Il est alors né<strong>ce</strong>ssaire de manipuler <strong>ce</strong>tte catégorie avec précaution et<br />
d’interroger <strong>ce</strong> qu’elle signifie socialement et pour qui. Qui définit qui comme victime ? Dans<br />
quelle sphère discursive, dans quel contexte et dans quel objectif ? C’est notamment <strong>ce</strong> que<br />
nous avons indirectement essayé de faire dans le premier chapitre. L’auteur dessine une<br />
sortie de l’impasse dans laquelle il est possible de se trouver lorsqu’on essaye de concilier la<br />
« victime » en tant que personne, et la « victime » en tant que catégorie sociale. Il<br />
différencie la sphère privée au sein de laquelle la compassion envers la victime est<br />
ac<strong>ce</strong>ptable voire né<strong>ce</strong>ssaire, de la sphère publique qui implique plus de précaution dans la<br />
manipulation discursive de la notion. De plus, comme nous l’avons vu, la critique féministe<br />
déplore avec justesse le fait que dans les discours, les femmes sont plus souvent présentées<br />
comme victimes que comme actri<strong>ce</strong>s, et on peut aussi argumenter que <strong>ce</strong>tte victimisation<br />
s’inscrit dans une stratégie politique. Dans la société dans laquelle elles évoluent, il me<br />
semble qu’elles ne sont pas encore assez déresponsabilisées de <strong>ce</strong> qui leur arrive pour que<br />
l’on puisse de manière inconséquente remettre en question <strong>ce</strong> statut de victime jusqu’à le<br />
détruire en tant que catégorie, même pour le reconstruire. Au contraire, elles continuent de<br />
prendre sur elles le fardeau implicite et multidimensionnel de la faute mais aussi de la<br />
souffran<strong>ce</strong> et de la douleur. Pour <strong>ce</strong>la je prends donc malgré tout le parti pris de les qualifier<br />
occasionnellement de victimes. Occasionnellement, par<strong>ce</strong> que nous allons aussi voir dans<br />
25 Guerner Guillaume (2006) La société des victimes, Paris, La Découverte.
40<br />
quelles mesures <strong>ce</strong>tte expérien<strong>ce</strong> en tant que victime les for<strong>ce</strong> à devenir actri<strong>ce</strong>s dans<br />
d’autres domaines plus relatifs à leur survie et à <strong>ce</strong>lle de leurs familles.<br />
3.2 L’hétérogénéité réduite au silen<strong>ce</strong> par un discours qui tend fatalement vers l’homogénéité<br />
Le problème semble résider dans l’évidente hétérogénéité des cas de violen<strong>ce</strong>s genrées et<br />
ethniques même dans <strong>ce</strong> contexte très particulier, et de l’identité des personnes qui les<br />
subissent. Dès lors qu’un discours est produit sur <strong>ce</strong> genre de réalité, la tendan<strong>ce</strong> est à leur<br />
homogénéisation. Car même si on pluralise <strong>ce</strong>tte réalité, si on insiste sur sa multiplicité, elle<br />
est perçue comme unique. Ses échos qui résonnent dans les sphères discursives de la société<br />
se multiplient mais à l’identique. Gayatri Chakravorty Spivak26 donne un fond con<strong>ce</strong>ptuel à<br />
<strong>ce</strong>tte idée à travers l’exemple de l’image de la femme chez Freud : « Comme l’a montré Sarah<br />
Kofman, la profonde ambiguïté de l’utilisation par Freud des femmes comme boucs<br />
émissaires correspond à une ‘formation réactionelle’ issue d’un désir initial et continu de<br />
donner une voix à l’hystérique pour faire d’elle le sujet de l’hystérie »27. De la même<br />
manière « se construit la monolithique ‘femme du Tiers-monde’ »28 ou « la femme du<br />
Congo », ou encore, dans le cas plus précis qui nous con<strong>ce</strong>rne, « la femme victime de<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles en temps de conflit (dans le tiers-monde voire au Kivu) ». Afin de<br />
contourner <strong>ce</strong> danger inhérent à ma démarche je réaffirme et réaffirmerai encore la diversité<br />
des voix qui sont réduites au silen<strong>ce</strong>, et que je réduis au silen<strong>ce</strong> en choisissant (par défaut,<br />
souvent) d’en élever <strong>ce</strong>rtaines plutôt que d’autres. Le discours que je produis provient de <strong>ce</strong><br />
que quelques-unes d’entre elles ont réussi à me dire (directement ou indirectement) et je ne<br />
prétends aucunement à une exhaustivité ni à une représentativité. Mon titre aurait pu être<br />
plus long et être le suivant : « <strong>Dire</strong> <strong>ce</strong> que <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles <strong>vivent</strong> ». J’ai préféré, à<br />
travers mon sous-titre, établir un parallèle entre « <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong> » et « les silen<strong>ce</strong>s » pour<br />
montrer les inévitables blancs, les inévitables silen<strong>ce</strong>s qui se cachent derrière n’importe<br />
quel « elles », même si <strong>ce</strong> n’est que <strong>ce</strong>rtaines, derrière tant de tentative de produire un<br />
discours homogénéisant prétendument immuable sur une réalité humaine, surtout <strong>ce</strong>lle-là.<br />
Si l’on veut un discours qui tend vers le particulier, on se trouve dans l’obligation de taire<br />
26 Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, éditions Amsterdam.<br />
27<br />
Kofman, Sarah (1980) l’Enigme de la femme. La femme dans les textes de Freud, Paris, Galilée.<br />
Citée dans Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, éditions<br />
Amsterdam.<br />
28 Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, éditions Amsterdam.
41<br />
d’autres voix dont l’importan<strong>ce</strong> est pourtant aussi grande. Si l’on veut un discours qui tend<br />
vers le général, on se trouve dans l’obligation de baisser le ton de la voix du particulier et de<br />
s’éloigner de sa vérité déjà fragile. Il me semble malgré tout avoir trouvé une sortie à <strong>ce</strong> qui<br />
apparait comme une impasse, tout d’abord en prenant conscien<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>t inévitable silen<strong>ce</strong><br />
de mon discours. De plus, malgré ma volonté initiale de donner une voix particulière à une<br />
réalité, il semble que <strong>ce</strong> discours s’inscrive aussi inévitablement à l’intersection de<br />
l’universel, du particulier et du singulier. Les allers-retours sans <strong>ce</strong>sse entre <strong>ce</strong>s niveaux de<br />
réflexion me permettent, peut-être, de sortir de <strong>ce</strong> dilemme entre l’hétérogénéité des<br />
réalités et l’homogénéité d’un discours.<br />
3.3 Le silen<strong>ce</strong> de la non-représentativité entre l’enquêteur/tri<strong>ce</strong> et les enquêtés<br />
La question de la représentativité ne se pose pas seulement par rapport aux enquêté-e-s et à<br />
la représentativité de l’échantillon choisi plus ou moins volontairement. Elle se pose aussi<br />
dans la relation entre <strong>ce</strong>lui ou <strong>ce</strong>lle qui enquête et les enquêté-e-s. En effet, qui parle lorsqu’<br />
on produit un discours sur des femmes qui ont subi <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique ou une<br />
autre ? Il s’agit trop rarement des femmes qui l’ont effectivement subi. Le problème est que<br />
l’objet du discours est trop rarement son sujet. L’analyse de G.C Spivak m’apparait ici comme<br />
un bon point de départ réflexif à <strong>ce</strong>tte question <strong>ce</strong>ntrale. J’avais d’ailleurs prévu d’introduire<br />
<strong>ce</strong> travail sur mais aussi né<strong>ce</strong>ssairement avec les femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles<br />
dans le contexte dit post-conflictuel de l’est de la République Démocratique du Congo par<br />
Can the subaltern speak ?. La catégorie au cœur de mon étude semble effectivement à<br />
première vue s’inscrire dans d’autres catégories mais <strong>ce</strong>tte fois-ci con<strong>ce</strong>ptuelles : <strong>ce</strong>lles de la<br />
subalternité et de la vulnérabilité. Me proposant de produire un énième discours en prise<br />
avec <strong>ce</strong>s catégories con<strong>ce</strong>ptuelles sujettes à la controverse, un retour réflexif sur la pla<strong>ce</strong> de<br />
mon discours proposé par rapport aux nombreux autres s’est imposé à moi, mais aussi sur sa<br />
légitimité ainsi que sur ses multiples zones d’ambigüités. Le travail de G.C Spivak m’est<br />
apparu comme un point de départ intéressant, pertinent, bien qu’intellectuellement exigent<br />
et difficile. La situation inconfortable dans laquelle je me trouvais et dans laquelle je me<br />
trouve encore était prévisible car typique des sphères de la recherche sociologique et/ou<br />
anthropologique dont l’objet d’étude fait partie d’un monde plus ou moins extérieur au
42<br />
chercheur ou à la chercheuse. G.C Spivak interroge la pla<strong>ce</strong> de l’enquêteur/tri<strong>ce</strong> dans la<br />
production d’un discours sur le tiers-monde et dans la sphère discursive occidentale et<br />
déplore le fait qu’elle soit si rarement interrogée. Or le sujet n’est jamais neutre : Il n’est ni<br />
vide, transparent ni silencieux. 29 J’ai hésité à rajouter « ni blanc » car justement le<br />
problème tient du fait que le sujet du discours sur le tiers-monde est, d’une part, masculin et,<br />
d’autre part, « blanc », non pas dans sa symbolique neutre mais dans sa symbolique<br />
hégémonique et dominante européenne et plus largement occidentale. L’objectif des<br />
subaltern studies par exemple est justement d’offrir des voix « subalternes » alternatives à<br />
<strong>ce</strong>tte voix blanche dominante d’abord de l’histoire coloniale indienne.<br />
Cette réflexion autour du point de vue d’un discours s’applique aussi au discours que je<br />
propose de produire : Le « je », que je préfère souvent au « nous » trop général, de mon<br />
discours n’est pas vide. Il a une histoire, une identité qui me semble prendre sa pla<strong>ce</strong> ici,<br />
avant d’aller plus loin. Il est possible de penser que <strong>ce</strong>rtaines des difficultés liées au point de<br />
vue à partir duquel je produis le discours et sur sa représentativité ont été contournées dans<br />
la mesure où mon identité et aussi mon histoire ne sont pas complètement extérieures à la<br />
catégorie sur laquelle je prétends produire un discours. Mon identité et mon histoire créent<br />
des ponts, et parfois des barrières entre elles et moi. Ces ponts et <strong>ce</strong>s barrières sont<br />
pertinents dans <strong>ce</strong>tte réflexion sur la légitimité et la représentativité de mon discours mais ils<br />
l’ont aussi été de manière plus concrète sur le terrain, comme nous le verrons dans le<br />
troisième chapitre. Mon « je » a le même sexe, la même couleur de peau, la même<br />
nationalité (d’origine seulement en <strong>ce</strong> qui me con<strong>ce</strong>rne mais actuelle en <strong>ce</strong> qui les con<strong>ce</strong>rne)<br />
et parfois la même ethnie (idem) qu’ « elles ». En apparen<strong>ce</strong>, <strong>ce</strong>rtains aspects du sujet que je<br />
suis s’enchevêtrent donc avec <strong>ce</strong>rtains aspects des femmes qui sont l’objet de mon<br />
discours.30 En apparen<strong>ce</strong> seulement par<strong>ce</strong>-que si je suis une femme et si la couleur de ma<br />
peau est noire, je ne suis pas pour autant congolaise, et encore moins bashi31, même si<br />
j’aurai pu l’être. Je ne suis pas sûre que <strong>ce</strong> conditionnel suffise à légitimer mon discours. De la<br />
29.<br />
Ibid, chapitre 3 et 4.<br />
30 Pour un exemple, fondateur dans la pensée féministe, sur l’imbrication idéologique entre les systèmes sociaux<br />
de sexe, de classe et de ra<strong>ce</strong>, voir l’ouvrage suivant :<br />
-Angela Davis (1983) Femmes , ra<strong>ce</strong>, classe, Paris, Des Femmes, pp60-88.<br />
31 Bashi renvoie au peuple de culture Shi majoritairement représenté dans les territoires alentours de la ville de<br />
Bukavu (Cf. Annnexes, carte des groupes ethniques majoritaires) Plus de la moitié de mes interlocutri<strong>ce</strong>s en font<br />
partie.
43<br />
même manière, si j’avais moi-même été une femme du Sud-Kivu victime de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong><br />
genrée et ethnique, ou si <strong>ce</strong>la avait été le cas d’un-e membre de ma famille, comme il m’a<br />
été parfois et à ma grande surprise demandée, en supposant alors que j’ai la capacité et<br />
l’envie de formuler un discours dans la sphère discursive occidentale, <strong>ce</strong> dernier serait-il plus<br />
légitime pour autant ? Il me parait important de préciser ici que la voix contestataire d’une<br />
réalité provient rarement de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui subissent quotidiennement <strong>ce</strong>tte réalité.<br />
Ils/elles n’ont d’ailleurs pas même né<strong>ce</strong>ssairement conscien<strong>ce</strong> qu’il existe une alternative à<br />
<strong>ce</strong>tte réalité subie. Ce que dit Bell Hooks du féminisme me semble pertinent ici :<br />
« A aucun moment le feminisme aux Etats-Unis n’est née de l’initiative des femmes qui sont<br />
le plus persécutées [victimized] par une oppression sexiste; par les femmes qui sont<br />
quotidiennement battues, physiquement et spirituellement: Les femmes privées du pouvoir<br />
de changer les conditions de leur vie. Elles appartiennent à une majorité silencieuse. En<br />
ac<strong>ce</strong>ptant les combats de la vie sans visiblement les interroger, sans les manifester de<br />
manière organisée et sans une rage et une colère collectives est un signe de leur persécution<br />
[victimization].»32<br />
On comprend alors que les femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s au Sud-Kivu (et ailleurs) ne peuvent<br />
probablement pas parler ni agir, en tous cas au moment où elles sont encore sous le joug de<br />
l’oppression.<br />
Par ailleurs, je crois que la légitimité de n’importe quel discours, n’importe quel point de vue<br />
sur une réalité aussi sensible que <strong>ce</strong>lle-là va au-delà de notre appartenan<strong>ce</strong> à la même<br />
communauté 33 de genre, de nation, d’ethnie ou même d’expérien<strong>ce</strong> : Elle réside plus<br />
simplement dans notre humanité commune. Cette réalité nous con<strong>ce</strong>rne donc tout-e-s. Bien<br />
qu’ici particulièrement elle peut apparaître comme lointaine pour <strong>ce</strong>rtain-e-s.<br />
Et il me<br />
semble que n’importe quel discours et point de vue participe à son échelle à la<br />
compréhension, condamnée à être partielle, de l’objet d’étude ; <strong>ce</strong> qui ne nous empêche pas<br />
de préserver une distan<strong>ce</strong> critique de sécurité vis-à-vis de tous <strong>ce</strong>s discours et de<br />
comprendre, comme nous avons essayé de faire dans le premier chapitre, pourquoi et<br />
comment ils sont produits, surtout lorsqu’ils proviennent de <strong>ce</strong>ux qui « dominent ». Il est vrai<br />
que sans mon passé familial et culturel et sans <strong>ce</strong> premier voyage personnel dans le Sud-Kivu<br />
32 Hooks Bell (2000) Black Women: Shaping the Feminist Theory, in Joy James and Tra<strong>ce</strong>y Denean Sharpley-<br />
Whiting eds, Black Feminist Reader, Oxford, Blackwell, p131.<br />
33<br />
La communauté n’est pas entendue ici dans son sens sociologique mais commun.
44<br />
en 2008, je n’aurai peut-être jamais eu accès à un pan de <strong>ce</strong>tte réalité et je n’aurai jamais<br />
cherché à y avoir accès ; il est vrai que <strong>ce</strong>s ponts de ressemblan<strong>ce</strong> qui n’ont <strong>ce</strong>ssé de se<br />
construire et de se déconstruire entre elles et moi ont servi et parfois, comme nous le<br />
verrons dans le troisième chapitre, desservi mon enquête. Il me semble malgré tout que le<br />
degré de superposition entre le sujet et l’objet importe peu, car malgré <strong>ce</strong> fil de l’humanité<br />
et donc de l’universalité qui nous unit tout-e-s : « Je » ne suis et ne serais jamais aucune<br />
d’entre « elles ». Cela implique que dans la tentative de dire une part, même infime, de <strong>ce</strong><br />
qu’elles <strong>vivent</strong>, il y aura né<strong>ce</strong>ssairement une part, que j’aurais voulu encore plus infime, de<br />
moi, de ma subjectivité, de mon interprétation. Dans mon discours, plus <strong>ce</strong>tte part grandit et<br />
plus la part de leur réalité telle qu’elles la <strong>vivent</strong> et la disent diminue. L’interprétation,<br />
pourtant incontournable, que je fais de leur parole et encore plus de leurs silen<strong>ce</strong>s filtre leur<br />
voix. Le silen<strong>ce</strong> auquel est condamné une trop grande partie de leur réalité est brisé par ma<br />
propre voix c'est-à-dire par la subjectivité de <strong>ce</strong> que je vais retranscrire. Il est donc possible<br />
de dire au sens de « faire savoir » mais avec ma voix. La leur, que je voulais faire entendre,<br />
est donc filtrée par les silen<strong>ce</strong>s de la catégorisation, de la tendan<strong>ce</strong> discursive à<br />
l’homogénéité, de la non-représentativité entre le sujet et l’objet du discours et donc de ma<br />
subjectivité.
45<br />
Chapitre 3. Choix et caractéristiques du<br />
terrain : L’inévitable filtrage de « leur »<br />
parole.<br />
Après avoir dessiné les grandes lignes du cheminement intellectuel qui m’a menée à la<br />
problématique telle que nous venons de l’énon<strong>ce</strong>r, je vais vous présenter la méthode qui<br />
m’a menée jusqu’à la réalité filtrée du terrain et des voix que je vais faire entendre dans les<br />
deux prochains chapitres. Nous tenterons aussi d’en exposer à chaque étape les<br />
caractéristiques principales afin d’aider les lectri<strong>ce</strong>s et lecteurs à comprendre et interpréter<br />
<strong>ce</strong>tte réalité. Ces cheminements ne sont pas indépendants les uns des autres, au contraire,<br />
ils se sont mutuellement façonnés pour arriver à leur forme telle qu’elle est exposée ici.<br />
L’affinement du choix de « mon » terrain s’est fait de manière progressive et, aux moments<br />
où je perdais le contrôle du déroulement de mon enquête, de manière aléatoire et<br />
hasardeuse. Si <strong>ce</strong>la n’a pas été le cas du choix géographique du terrain dont nous allons<br />
tenter de donner les caractéristiques géopolitiques et culturelles, et si le choix de institutions<br />
auprès desquelles j’ai mené mon enquête s’est fait à mi-chemin de <strong>ce</strong>s deux logiques, il me<br />
semble que le choix, par défaut, de mes interlocutri<strong>ce</strong>s était bien moins conscient et<br />
contrôlé que <strong>ce</strong> que j’aurai voulu.
46<br />
1. Choix géographique : De la RDC au Bushi<br />
Pour trouver des réponses aux questions que je me posais, même si <strong>ce</strong> n’était pas encore les<br />
bonnes, il me fallait donc affronter la réalité, inévitable et très attendue, du terrain. Si ma<br />
première sélection géographique et temporelle du terrain m’est premièrement apparue<br />
comme fortuite, je me suis vite aperçue que rien, ou si peu, n’était en fait dut au hasard<br />
dans <strong>ce</strong>tte sélection.<br />
1.1 Les déterminants familiaux et personnels de la sélection géographique et temporelle.<br />
Les personnes qui <strong>vivent</strong> <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> sexuelle et ethnique, nous l’avons vu dans<br />
l’introduction, sont nombreuses. Elles se multiplient sur <strong>ce</strong>tte double échelle du temps et de<br />
l’espa<strong>ce</strong> qui a déjà été évoquée en introduction mais aussi au niveau de <strong>ce</strong>tte intersection<br />
qu’est le Sud-Kivu d’aujourd’hui. Il me semble que la volonté de travailler sur une<br />
problématique relative au Sud-Kivu a été antérieure à la naissan<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>tte thématique<br />
spécifique. Ce sont clairement les circonstan<strong>ce</strong>s personnelles et familiales d’un voyage à<br />
Bukavu et, plus brièvement, dans deux villages du Bushi ainsi qu’à Goma qui ont, en 2008,<br />
éveillé ma conscien<strong>ce</strong> à la réalité concrète et persistante des souffran<strong>ce</strong>s d’une population<br />
civile. C’est d’ailleurs plus précisément le décalage déroutant entre le fleurissement des<br />
pancartes d’ONG, d’associations et d’organisations internationales 34 donc le signe de la<br />
présen<strong>ce</strong> d’acteurs locaux, nationaux et surtout internationaux d’une part, et la persistan<strong>ce</strong><br />
de <strong>ce</strong>tte réalité d’autre part qui m’avaient interrogée et qui avaient orienté le premier<br />
mouvement de ma réflexion déjà évoqué 35 . Ce voyage et <strong>ce</strong>tte prise de conscien<strong>ce</strong> ont<br />
ouvert les premières portes d’accès à une connaissan<strong>ce</strong>, <strong>ce</strong>rtes limitée, partielle et<br />
probablement condamnée à le rester, de la réalité historique et sociale de <strong>ce</strong>tte<br />
problématique au Sud-Kivu. Ces portes étaient malgré tout assez ouvertes pour atteindre ma<br />
34 Annexes, tableau des associations.<br />
35 Cf. chapitre 2.
47<br />
sensibilité et aiguiser ma curiosité au point d’envisager une recherche universitaire à son<br />
propos.<br />
FNUAP Bukavu estime la moyenne nationale du nombre de victimes de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> dans<br />
tout le pays à 1595 par mois au cours de l’année 2009. Elle serait à 9101 aux Kivus, et à 5010<br />
au Sud-Kivu. 36 Cette estimation est né<strong>ce</strong>ssairement en deçà de la réalité car, comme nous<br />
allons le voir, la principale difficulté dans la compréhension et l’évaluation de <strong>ce</strong> qui s’avère<br />
être un véritable phénomène social se trouve dans les silen<strong>ce</strong>s de <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui en sont<br />
victimes. Ils/elles sont indénombrables.<br />
Il m’a semblé d’un premier abord que la délimitation de mon terrain s’est faite au hasard des<br />
rencontres et des facilités pratiques. Alors que j’espérais encore que mon enquête s’étende<br />
à la totalité de la Provin<strong>ce</strong> du Kivu, j’envisageais Bukavu comme le point de départ de la<br />
partie que j’allais effectuer dans la Provin<strong>ce</strong> Sud et Goma comme <strong>ce</strong>lui de la partie que je<br />
comptais effectuer dans la Provin<strong>ce</strong> Nord. Je ne savais pas encore que trois semaines sur le<br />
terrain ne seraient même pas suffisantes pour me donner un aperçu même partiel –<br />
j’admettais quand même déjà <strong>ce</strong>tte partialité – de la réalité à laquelle elles devaient faire<br />
fa<strong>ce</strong> au Sud-Kivu. J’avais sous-estimé l’ampleur du phénomène et du travail qui m’attendait.<br />
Alors j’ai dû faire un choix.<br />
Les réalités du phénomène au Sud et au Nord du Kivu sont semblables sans être exactement<br />
les mêmes. Les deux villes m’offraient les mêmes facilités d’accès grâ<strong>ce</strong> aux contacts que j’y<br />
avais. Mon entourage familial et universitaire m’encouragea à privilégier Bukavu à cause du<br />
contexte militaire qui était plus favorable au bon déroulement de mon enquête. Ce premier<br />
choix n’avait donc rien de fortuit. Il était déterminé par des circonstan<strong>ce</strong>s géopolitiques<br />
particulières et il annonçait d’ailleurs même <strong>ce</strong> qui allait déterminer les autres choix qui<br />
allaient suivre et <strong>ce</strong> qui allait aussi réduire progressivement au silen<strong>ce</strong> les voix auxquelles je<br />
n’avais pas accès. Si la plupart des associations rencontrées agissent dans la totalité de la<br />
provin<strong>ce</strong> du Sud-Kivu, les excursions sur le « terrain » en zone rurale se sont effectuées<br />
exclusivement dans le Bushi.<br />
36 Annexes, tableaux statistiques FNUAP.
48<br />
1.2 Caractéristiques socio-culturelles<br />
C’est avec précaution que j’aborde <strong>ce</strong>tte question, en ayant pleinement conscien<strong>ce</strong> du<br />
caractère dynamique 37 et artificiel de données et de frontières qui peuvent apparaître ici<br />
comme fixes et immuables. Elles me semblent malgré tout assez « pertinentes » d’un point<br />
de vue social, même inconsciemment, pour mériter que l’on s’arrête dessus quelques<br />
instants, tout en essayant d’éviter toute dérive essentialiste. Si l’on considère les frontières<br />
ethniques telles que les acteurs et actri<strong>ce</strong>s de notre terrain les envisagent, là ou un regard<br />
extérieur non-averti peut voir une simple opposition entre un groupe ethnique relativement<br />
homogène et les migrants rwandais, tutsis et hutus, installés depuis plus ou moins<br />
longtemps, il est en fait possible de distinguer au sein même du groupe prétendument<br />
homogène les groupes répertoriés sur la carte correspondante en annexe.<br />
A chaque groupe ethnique correspond un dialecte dans lequel se font la plupart des<br />
échanges dans les zones rurales. Mais c’est en swahili, la langue usuelle, que se font les<br />
échanges « inter-ethniques ». Pour des raisons que nous allons explorer dans la deuxième<br />
section de <strong>ce</strong> chapitre, la majorité de mes interlocutri<strong>ce</strong>s appartiennent à la culture Shi. Elles<br />
maitrisent donc plus le dialecte (le mashi) que le swahili, et encore moins le français. La<br />
culture dans laquelle s’inscrivaient les autres m’étaient inconnues. Il est clair que la culture<br />
Shi est majoritaire dans mon enquête. Afin d’au moins comprendre le sens social donné à la<br />
violen<strong>ce</strong> que <strong>ce</strong>s femmes ou d’autres femmes de leur entourage ont subi, nous allons tenter<br />
de souligner quelques caractéristiques qui lui sont attribuées et/ou que ses membres s’autoattribuent.<br />
Les Bashi <strong>vivent</strong> traditionnellement de l’élevage et de la culture, et de la pêche.<br />
Nous allons voir un peu plus loin comment <strong>ce</strong>la détermine les dépla<strong>ce</strong>ments effectués dans<br />
leur milieu, exposant surtout les femmes et les jeunes filles toujours plus aux dangers des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles et les rendant plus vulnérables qu’elles ne le sont déjà. La vie sociale<br />
d’une mushikazi 38 s’organise autour de <strong>ce</strong>s trois piliers : l’école, l’église et la famille. La<br />
famille est le premier <strong>ce</strong>rcle de référen<strong>ce</strong> au sein duquel la femme ou la fille se constitue. Il y<br />
a la famille dans laquelle elle née, et <strong>ce</strong>lle au sein de laquelle elle se marie. C’est dans <strong>ce</strong><br />
<strong>ce</strong>rcle familial multiple qu’elle cherche prioritairement par exemple une aide relationnelle<br />
ou matérielle en cas de besoin. Si au cours de <strong>ce</strong> mémoire se dessine parfois une apparente<br />
confusion entre <strong>ce</strong>rcle familial, villageois et communautaire, c’est en fait que les membres<br />
37 Bart, Frederick (1969) Les groupes ethniques et leeur frontières.<br />
38 C’est le nom donné aux femmes de la culture shi
49<br />
du village peuvent avoir le même statut que la famille. Les conseils, les avertissements<br />
peuvent être prononcés par des membres de l’un ou l’autre des deux <strong>ce</strong>rcles et avoir le<br />
même pouvoir. Nous verrons plus loin que souvent il n’y a pas confusion mais opposition<br />
entre la réaction de la famille fa<strong>ce</strong> à l’épreuve de la violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique telle que<br />
nous l’avons définie et <strong>ce</strong>lle de <strong>ce</strong>ux qui sont extérieurs à la famille. L’église est un autre<br />
cadre de communalisation. 39 Le dimanche est un jour ou tout le monde se retrouve à la<br />
messe, dans les villages où la religion majoritaire est le catholicisme, ou au culte dans les<br />
villages où la religion majoritaire est le protestantisme. Les femmes se regroupent une fois<br />
par semaine dans une « communauté de base » appelée cirika en swahili et cishagala en<br />
mashi. Dans <strong>ce</strong>s réunions elles prient, chantent, échangent. Elles entretiennent aussi avec <strong>ce</strong><br />
groupe une relation d’entraide. 40 Les plus jeunes filles se regroupent hebdomadairement<br />
dans des réunions similaires pour les plus jeunes. Au sein de <strong>ce</strong> groupe elles prient,<br />
chantent, échangent mais elles peuvent aussi sortir. De plus des adultes interviennent<br />
parfois pour leur donner des conseils de vie, les éduquer à leur future vie de femmes par<br />
exemple. L’école regroupe les personnes par âge et par sexe mais ne con<strong>ce</strong>rnent pas tout le<br />
monde, le taux de scolarisation général sur toute la RDC est estimé à 52%. Ce sont<br />
notamment les paroles d’une de mes interlocutri<strong>ce</strong>s, Emmanuelle, qui ont mis la lumière sur<br />
la pertinen<strong>ce</strong> sociale de <strong>ce</strong>s <strong>ce</strong>rcles communautaires autour desquels semblent s’organiser la<br />
vie ordinaire d’une mushikazi au village, et dont je n’avais que partiellement conscien<strong>ce</strong>.<br />
« Quand nous sous sommes toutes rencontrées dans la forêt, nous avons commencé à<br />
pleurer. Nos semblables avec qui on étudiait, avec qui on allait à la messe et à la chorale,<br />
avec qui on faisait l’animation mais qu’on disait mortes. Elles étaient là. »<br />
Dans la forêt ou elle a été retenue en tant qu’esclave sexuelle, Emmanuelle retrouve des<br />
« semblables » qu’elle pensait mortes. Elle distingue trois critères d’identité commune à<br />
travers l’utilisation de <strong>ce</strong> mot « semblables » : L’école, l’église, et l’animation du village (qui<br />
semble s’entrecouper avec le critère de l’église).<br />
39 Définition (Weber) au chapitre 2.<br />
40 Par exemple, pour l’organisation du mariage d’un ou une de leurs enfants, elles peuvent compter sur l’aide des<br />
membres de leur propre cirika mais aussi <strong>ce</strong>lle des membres de la cirika de leur mère ou de leur sœur. Le <strong>ce</strong>rcle<br />
communautaire familial s’imbrique dans <strong>ce</strong> <strong>ce</strong>rcle communautaire.
50<br />
Il me parait important de mettre aussi en lumière les rôles et les représentations de la<br />
femme dans la culture Shi. Beaucoup des analyses de la problématique des violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles privilégient une vision culturaliste des causes structurelles de <strong>ce</strong>tte problématique.<br />
C’est notamment en consultant sur pla<strong>ce</strong> des mémoires de fin d’études qui traitaient de la<br />
question que je m’en suis aperçue. Une étudiante de l’Institut Supérieur de Pastorale<br />
Familiale de Bukavu fait de « la culture rétrograde des Bashis envers l’être féminin », c'est-àdire<br />
sa culture sexiste, l’hypothèse de départ à son analyse. 41 Or, aussi sexiste que puisse<br />
éventuellement être la culture traditionnelle Shi, il n’est pas possible de lui incomber<br />
l’entière responsabilité de <strong>ce</strong> fléau pour deux raisons finalement assez simples : si la violen<strong>ce</strong><br />
genrée et ethnique telle que nous l’étudions existait déjà sous d’autres formes avant la<br />
guerre de 1996, <strong>ce</strong> n’est qu’à partir de là qu’elle s’est systématisée et qu’elle a pris les<br />
multiples formes que nous lui connaissons. De plus, les actes de violen<strong>ce</strong>s ne sont pas<br />
perpétrés par des membres de <strong>ce</strong>tte société traditionnelle-là, sauf dans le cas, <strong>ce</strong>rtes de plus<br />
en plus fréquent, de viols civils. Il serait alors peut-être plus intéressant de regarder du côté<br />
des codes sociaux et culturels des agresseurs, souvent burundais ou rwandais, comme le fait<br />
les associations RFDP, RFDA et International Alert dans leur sous-chapitre sur les per<strong>ce</strong>ptions<br />
socio-culturelles des violen<strong>ce</strong>s sexuelles au Rwanda et au Burundi. Par contre, ses rôles, ses<br />
interdictions, ses obligations dans la représentation traditionnelle shi, effectivement<br />
sexiste, de la femme nous aident à comprendre les réactions de la femme qui survit à des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles et de son entourage dès lors que <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s sexuelles sont rendues<br />
publiques ; Par exemple, traditionnellement, la femme doit se taire lorsqu’un homme parle,<br />
elle doit considérer <strong>ce</strong> dernier comme son maître et responsable (une autre appellation pour<br />
mari est « Seigneur » « responsable » 42 ), elle ne doit pas transgresser de tabou au risque<br />
d’être répudiée, elle ne doit pas s’exprimer en public 43 . Nous tenterons d’analyser les<br />
implications de tels interdits et de telles obligations pour les femmes que nous avons<br />
rencontrées. Sa représentation n’échappe donc pas à des logiques qui s’inscrivent dans des<br />
rapports sociaux de sexe, évoqués en introduction. Comme le remarque donc peut-être plus<br />
41 Byanamungu, Muhungusa, Pascasie, Perspectives d’une prise en charge pastorale des femmes victimes de<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles : cas de la paroisse de Walungu, mémoire de graduat option pastorale familiale, Institut<br />
Supérieur de Pastorale Familiale, 2006-2007.<br />
42 (Seigneur) Woliha,(responsable) nakuno.<br />
43 Esther Tabu Kabwanda (1992) Emancipation de la femme : œuvre de l’évangile de Jésus-Christ essai<br />
d’exégèse de Luc 8 :43-48, mémoire de graduat en théologie, Institut Supérieur deThéologie Evangélique.
51<br />
justement une autre étudiante qui travaillait sur la même problématique sur un terrain<br />
semblable au mien, « le Sud-Kivu comme le Bushi, est une société patriarcale et hiérarchisée<br />
ou les femmes occupent encore largement un statut subordonné. Certaines pratiques<br />
traditionnelles discriminatoires, font des femmes une propriété privée ». 44 La femme<br />
mushikazi, mais bien évidemment pas seulement elle, existe effectivement socialement et<br />
coutumièrement d’abord par rapport à son père ou son représentant (le frère ainé par<br />
exemple) puis par rapport à son mari. Sa relation fa<strong>ce</strong> au masculin est une relation<br />
d’appartenan<strong>ce</strong>. Son corps entier lui appartient. Son identité sociale est donc aussi en<br />
relation avec sa virginité et à l’exclusivité sexuelle qu’elle doit à son mari. Il est intéressant<br />
de constater que dans la langue swahili usuelle telle qu’elle est parlée à Bukavu il est<br />
possible de traduire virginité par « bu fille », c'est-à-dire, ici, « le fait d’être fille ». La virginité<br />
est donc constitutive de l’identité d’une fille qui est autorisée par la culture et plus<br />
largement par la société à devenir femme que dans le cadre réglementé du mariage. Dès<br />
que la sexualité sort de <strong>ce</strong> cadre, la fille n’est plus fille mais ne peut pas être considérée<br />
comme femme pour autant. Il est alors plus facile pour nous de comprendre par exemple<br />
pourquoi Sophie, une de mes interlocutri<strong>ce</strong>s, m’a confiée que le viol qu’elle a subi n’a pas<br />
seulement détruit sa « réputation » mais aussi et surtout sa « féminité ». Ce sont les mêmes<br />
mécanismes qui barrent l’accès des femmes « à la propriété, à l’éducation, aux technologies<br />
modernes et à l’information ». 45<br />
Malgré <strong>ce</strong>s représentations plus sociétales que culturelles qui s’inscrivent clairement dans<br />
les rapports de domination de sexe, le rôle de la femme shi est <strong>ce</strong>ntral dans la sphère privée<br />
familiale et donc plus largement dans la communauté : elle se démène aux champs, au<br />
marché, sur les sentiers, aussi dangereux soient-ils, pour nourrir sa famille. Elle transmet à<br />
ses enfants la vie mais aussi la culture shi – elle est mère avant tout. D’ailleurs, on l’appelle<br />
traditionnellement rarement par son prénom mais plutôt par l’appellation « mama » suivit<br />
du nom de son premier enfant. Son identité sociale dépend donc aussi de ses fonctions<br />
reproductri<strong>ce</strong>s. 46 Ce sont probablement toutes ses fonctions qui font d’elle une cible<br />
privilégiée des mili<strong>ce</strong>s ennemies qui veulent atteindre la communauté en son cœur.<br />
44 Mulemaza, Mathilde (2003-2004) Guerres et violen<strong>ce</strong>s sexuelles au Sud-Kivu : cas des territoires de Walungu<br />
et de Kabare (1996-2004), mémoire de graduat en pédagogie, p37.<br />
45 Réseau des Femmes pour le Défense des Droits et la Paix (RFDP), 2004, « Le corps de la femme comme<br />
champ de bataille. Durant la guerre en RDC, violen<strong>ce</strong>s sexuelles contre les femmes et les filles au Sud Kivu<br />
(1996-2003) ».
52<br />
Toutes <strong>ce</strong>s caractéristiques socio-culturelles, toutes <strong>ce</strong>s représentations sociales sont moins<br />
pertinentes en ville qu’à la campagne, peut-être à cause du brassage culturel qu’une<br />
immersion urbaine dans la ville de Bukavu implique ou sous l’effet du simple éloignement<br />
des garants de la coutume. Il me paraît ici important de souligner une différen<strong>ce</strong><br />
pertinente pour la compréhension de mon sujet entre <strong>ce</strong> que j’appelle, d’une manière<br />
volontairement schématique, la « ville » et le « village ». Si chaque territoire bénéficie au<br />
moins d’un <strong>ce</strong>ntre (Walungu est par exemple le <strong>ce</strong>ntre du territoire de Walungu) et d’autres<br />
localités offrant, notamment grâ<strong>ce</strong> au travail des ONGs et de l’inspection provinciale de la<br />
santé, quelques infrastructures utiles à la survie de la population, Bukavu est la seule grande<br />
ville. Il s’agit d’ailleurs de la capitale Provinciale. Cette ville, en bordure du lac, s’étend en<br />
plateaux stratifiés de 1460 m d’altitude (au niveau du lac Kivu) à 1800 m d’altitude. En <strong>ce</strong> qui<br />
con<strong>ce</strong>rne l’habitation, il y a d’une part les grandes villas, principalement dans les zones ou<br />
habitent le personnel humanitaire et la MONUC 47 , les maisons planifiées qui ont été<br />
construites entre 1935 et 1950, et les « quartiers d’urbanisation spontanée » où les<br />
habitations sont auto-construites anarchiquement. Les troubles de la guerre ont accéléré<br />
l’exode rural des populations civiles qui fuyaient l’insécurité de leur village, et donc<br />
l’urbanisation de Bukavu. Les individus qui ont été victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles dans<br />
<strong>ce</strong>tte ville peuvent se réfugier à l’hôpital général de Panzi. On y vient de toute la provin<strong>ce</strong> et<br />
même au-delà. 48 Il est le seul à fournir des soins aussi spécialisés pour les problèmes qu’elles<br />
rencontrent. C’est là où j’ai effectué la première partie de mon enquête. Ils y trouvent aussi<br />
l’anonymat confortable de la ville. Si au village, <strong>ce</strong>s individus peuvent subir le regard des<br />
autres, à la ville il est beaucoup moins pesant par<strong>ce</strong> que leur identité et leur histoire sont<br />
moins visibles ou moins connues. Telles sont les caractéristiques socio-culturelles des deux<br />
espa<strong>ce</strong>s dans lequel j’ai effectué mon enquête : la ville et le village.<br />
47 Annexes, photographies.<br />
48 Entretien avec la psychologue de Panzi.
53<br />
1.3 Caractéristiques géographiques 49<br />
À présent, afin de mieux comprendre le contexte géopolitique déterminant pour la<br />
compréhension de mon sujet, je vais caractériser géographiquement <strong>ce</strong>t espa<strong>ce</strong> dans lequel<br />
s’est finalement déroulée mon enquête. Le Sud-Kivu est une des onze provin<strong>ce</strong>s du Congo. À<br />
l’est, <strong>ce</strong>tte provin<strong>ce</strong> partage une frontière avec le Burundi et le Rwanda, au nord avec le<br />
Nord-Kivu, à l’ouest avec la provin<strong>ce</strong> du Maniema, et au sud, elle partage un petit bout de<br />
frontière avec le Katanga. 50 Bukavu est le chef-lieu d’une provin<strong>ce</strong> actuellement divisée en<br />
huit territoires. 51 Mais les chiffres que donne l’Inspection Provinciale de la Santé à propos de<br />
notre problématique ne sont pas répartis en fonction de <strong>ce</strong>s territoires mais en fonction des<br />
zones de santé. Les données statistiques générales sur la provin<strong>ce</strong> sont données en<br />
annexe. 52 Il est possible d’écrire beaucoup sur <strong>ce</strong> qui caractérise plus précisément un milieu<br />
surtout lorsqu’il est aussi vaste, mais je choisi de mettre seulement en lumière les<br />
caractéristiques pertinentes pour la compréhension notre problématique. Le Sud-Kivu est un<br />
milieu montagneux dont l’altitude atteint un maximum de 3300 km 53 . Le climat est tropical<br />
humide et tempéré : La saison des pluies s’étend sur neuf mois (de septembre à mai). La<br />
saison sèche s’étend sur les trois autres mois (de juin à août). Les plaines, les parc nationaux,<br />
les collines qu’offrent le paysage de <strong>ce</strong>tte région sont donc dominées par les forêts. Ces<br />
dernières peuvent alors servir de refuge aux civils qui fuient l’insécurité de leur village, mais<br />
aussi et surtout de campements pour les mili<strong>ce</strong>s armées rebelles formelles ou informelles.<br />
C’est d’ailleurs là que la plupart des personnes qui ont été kidnappées pour, souvent,<br />
esclavagisme sexuel, sont retenues. Les sentiers sinueux qui épousent les courbes des<br />
collines, des plaines ou des montagnes couvertes de forêts, mais aussi de champs, de<br />
plantations de riz de bananes ou encore de manioc 54 offrent aux soldats des possibilités<br />
quasi-infinies de se cacher et surprendre leur cible. Dans les zones rurales, les femmes et les<br />
jeunes filles incarnent donc vraiment une cible facile d’accès : Lorsqu’elles ne sont pas<br />
violées ou kidnappées directement chez elles, ou à proximité, leurs dépla<strong>ce</strong>ments vers les<br />
49 Les données de <strong>ce</strong>tte section ainsi que les données de la section ‘socio-culturelles’ sont de sour<strong>ce</strong>s orales, et des<br />
chapitres introductifs des mémoires de fin d’étude, consultés à Bukavu, qui abordaient la question des violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles (Les référen<strong>ce</strong>s sont indiqués dans la partie « Thèses, mémoire de fin d’étude » de ma bibliographie)<br />
et de la monographie du Sud-Kivu effectuée en 2005 par une unité ministérielle de Kinshasa<br />
50 Annexe, cartes ‘de l’Afrique au Sud-Kivu’.<br />
51 Annexe, carte ‘les territoires du Sud-Kivu.<br />
52 Annexe, tableau des données générales.<br />
53 Bashi Murhi-Orhakube Contstantin (2006) Parlons Mashi, Paris, L’Harmattan, p18.<br />
54 Annexe, photographie du village.
54<br />
champs pour cultiver 55 ou pour aller chercher du charbon ou du bois multiplient les<br />
possibilités de subir des violen<strong>ce</strong>s sexuelles.<br />
Les richesses du sol kivutien en minerai, quant à elles, sont bien connues : or, argent, coltan,<br />
cassitérite 56 . Elles incarnent une des entrées à partir desquelles il est possible d’expliquer le<br />
contexte géopolitique de mon terrain.<br />
1.4 Caractéristiques géopolitiques 57<br />
Ce contexte (post -) conflictuel est bien sûr <strong>ce</strong>ntral dans la compréhension de mon sujet,<br />
dans la mesure où la violen<strong>ce</strong> que mes interlocutri<strong>ce</strong>s ont subies et continuent à subir s’y<br />
enracine. Je choisi malgré tout de lui accorder une pla<strong>ce</strong> que secondaire dans mon discours<br />
car mon premier objectif n’est pas d’en expliquer les causes profondes et structurelles mais<br />
plutôt d’apporter une contribution à la compréhension de ses conséquen<strong>ce</strong>s réelles et<br />
concrètes dans la vie des quelques personnes qui ont ac<strong>ce</strong>pté de répondre à mes questions.<br />
La compréhension de <strong>ce</strong>s conséquen<strong>ce</strong>s est elle-même envisagée comme un point de départ<br />
pour mieux penser les solutions concrètes, pour « réparer » les dommages qu’elles causent.<br />
Je prends donc le risque, incontournable pour l’optique de mon sujet, de faire de l’ombre<br />
aux causes profondes et essentielles du conflit en mettant en lumière ses conséquen<strong>ce</strong>s par<br />
ailleurs plus spectaculaires 58 . J’espère amenuiser les dangers inhérents à <strong>ce</strong> risque en<br />
m’arrêtant quelques instants sur <strong>ce</strong> que je pense avoir compris de <strong>ce</strong>s causes multiples et<br />
complexes.<br />
Si, géographiquement, nous avons notamment défini les Kivus par leur frontière<br />
orientale, c’est par<strong>ce</strong>-que sa situation géopolitique actuelle est déterminée par ses relations<br />
avec les pays qui la borde à l’est : le Burundi et le Rwanda. Il est possible de distinguer cinq<br />
clés thématiques pour comprendre les conflits desquels <strong>ce</strong>tte zone ne semble pas réussir à<br />
55 Réseau des Femmes pour le Défense des Droits et la Paix (RFDP), et Al Int., 2004, « Le corps de la femme<br />
comme champ de bataille. Durant la guerre en RDC, violen<strong>ce</strong>s sexuelles contre les femmes et les filles au Sud<br />
Kivu (1996-2003) ».<br />
Le chapitre 10 explique comment la fertilité diminuante des terres et la restriction de leur accès aux champs les<br />
for<strong>ce</strong> à aller toujours plus loin, et à s’exposer, malgré elles, toujours plus au danger.<br />
56 Annexes, carte des ressour<strong>ce</strong>s minières.<br />
57 Pour aller plus loin : Kalere, Jean Migabo (janvier 2002) Génocide au Congo ? Analyse des massacres des<br />
populations civiles.<br />
58 Falquet Jules, (janvier 2011) « Cinq entrées pour penser la mondialisation néolibérale dans une perspective<br />
féministe »
55<br />
se défaire. Elles ne sont évidemment pas exclusives les unes des autres, bien au contraire,<br />
elles s’éclairent mutuellement et s’imbriquent les unes aux autres.<br />
La première clé est démographique. Si les sphères médiatiques et associatives que nous<br />
connaissons ne vont rarement au-delà des évènements, <strong>ce</strong>rtes capitaux, de 1994 pour dater<br />
l’origine du conflit, les spécialistes semblent s’accorder sur la date de 1937, comme le<br />
montrent les deux articles que nous venons de référen<strong>ce</strong>r. Pour apporter une réponse a<br />
priori circonstancielle aux problèmes de surpopulation que rencontre le Rwanda,<br />
l’administration coloniale belge trouve dans les Kivus (tout d’abord le Nord) une terre<br />
d’accueil pour une immigration spontanée ou organisée, notamment par la Mission<br />
d’Immigration des Banyarwandas (MIB). Corollaire à <strong>ce</strong>tte question, la deuxième entrée est<br />
foncière. Elle serait l’origine structurelle du conflit. Avec une immigration rwandaise et<br />
burundaise mal contrôlée, les Kivus auraient été le théâtre d’une véritable « conquête<br />
foncière ». 150000 hectares auraient été accordés aux banyarwandais 59 . La troisième entrée,<br />
identitaire et ethnique, est le fruit des déséquilibres démographiques de la région et de <strong>ce</strong>s<br />
conflits territoriaux et la précarité qui s’en suit. L’intersti<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>s clés thématiques a<br />
provoqué une montée progressive des tensions et des crispations identitaires. Roland<br />
Pourtier distingue quatre niveaux de différenciations identitaires : les autochtones et les<br />
étrangers (essentiellement banyarwandais), les tutsis et les hutus, les Kivutiens et les<br />
Congolais, et un quatrième inattendu : les tutsis anglophones du Rwanda et les<br />
francophones. Bien qu’elles soient toutes interdépendantes les unes des autres, la<br />
deuxième, les hutus et les tutsis, me parait la plus pertinente pour la compréhension de mon<br />
sujet. En effet, à la vague de réfugiés du Burundi suite aux troubles civils de 1993 succède<br />
<strong>ce</strong>lle plus connue et plus massive des hutus génocidaires vers la même zone à partir de 1994.<br />
Le conflit trouve d’ailleurs déjà ses premiers balbutiements en 1959. Parmi eux se trouvent<br />
déjà les Interahamwés, <strong>ce</strong> mouvement de jeunesse qui se transforme en mili<strong>ce</strong> dès 1990 et<br />
participe déjà aux massacres de 1992 60 . Ce sont les premiers accusés de perpétrés la<br />
violen<strong>ce</strong> que nous analysons ici. En effet, les statistiques de la section d’assistan<strong>ce</strong> aux<br />
victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles nous informent que 80% des agresseurs présumés de leurs<br />
bénéficiaires sont des Interahamwés. De plus, comme nous le verrons, toutes mes<br />
interlocutri<strong>ce</strong>s affirment l’identité Interahamwé ou, au moins, banyarwandaise de leur(s)<br />
59 Guichaoua André (1989) Destins paysans et politiques agraires en Afrique <strong>ce</strong>ntrale (tome 1), L'Harmattan.<br />
60 Emmanuel Viret, Interahamwe, Encyclopédie en ligne des violen<strong>ce</strong>s de masse, [en ligne], publié le 8 mars<br />
2010, consulté le 11 septembre 2010, URL : http://www.massviolen<strong>ce</strong>.org/Interahamwe,498, ISSN 1961-9898
56<br />
agresseur(s). Cette mili<strong>ce</strong> et les autres, burundaises et rwandaises, se reconstituent dans des<br />
camps de réfugiés surpeuplés. L’année 1996 officialise le début de la première guerre dite de<br />
libération. La provin<strong>ce</strong> doit faire fa<strong>ce</strong> aux rebellions internes ou externes qui s’enchainent<br />
au rythme des allian<strong>ce</strong>s politiques et militaires qui continuent à se faire, se défaire et se<br />
refaire au gré du contexte et des intérêts géopolitiques et surtout économiques du moment.<br />
Il est même possible d’argumenter que les identités ethniques sont manipulées au gré de <strong>ce</strong>s<br />
intérêts. 61 La cinquième clé de compréhension, et pas la moindre, est économique.<br />
L’exploitation illégale antérieure au conflit contribue à l’entretenir. Ce qu’explique un article<br />
du Nord-Kivu paru dans Le Nouvel Observateur s’applique au Sud : « La carte des richesses<br />
minérales coïncide avec <strong>ce</strong>lle des bandes armées. Là où abondent or wolfram, niobium ou<br />
toute autre matière rare ou précieuse, il y a des bivouacs, des fusils, des uniformes, des<br />
exactions, des crimes. » 62 Tous les acteurs politiques, militaires et même associatifs, locaux,<br />
nationaux ou encore internationaux, semblent bénéficier plus ou moins directement de<br />
<strong>ce</strong>tte exploitation. Peut-être <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> perpétrée à l’encontre des civils <strong>ce</strong>ssera-t-elle<br />
lorsque <strong>ce</strong>s bénéfi<strong>ce</strong>s ne seront plus. Pour l’heure, malgré la signature d’accords de paix, la<br />
multiplication des missions de maintien de la paix, et donc l’entrée officielle dans une ère<br />
dite post-conflictuelle en 2008 (après y être entrée en 1998, 2003, et 2006) la paix tarde à se<br />
concrétiser dans la réalité quotidienne des habitants de <strong>ce</strong>tte région et <strong>ce</strong>, jusqu’à<br />
aujourd’hui, surtout dans les zones rurales. Au cœur de la population civile et des armées<br />
congolaises, le nombre total de morts de <strong>ce</strong>tte guerre, qui n’en finit pas, est estimé<br />
supérieur à cinq millions. Certaines analyses argumentent même en faveur de l’idée d’une<br />
tentative d’élimination du peuple congolais. 63 Les conséquen<strong>ce</strong>s évidentes et<br />
médiatiquement visibles d’un tel conflit sur la population civile ont bien sûr légitimé la<br />
communauté internationale dans l’exerci<strong>ce</strong> d’un droit d’ingéren<strong>ce</strong> humanitaire. La<br />
pérennité de <strong>ce</strong>s conséquen<strong>ce</strong>s assure, jusqu’à aujourd’hui, à cause de la présen<strong>ce</strong> et à<br />
l’action de <strong>ce</strong>tte communauté, une <strong>ce</strong>rtaine légitimité, bien qu’elle soit sporadiquement<br />
remise en cause dans l’entre-soi des acteurs et actri<strong>ce</strong>s de la société civile. Une remise en<br />
cause plus officielle en dehors de <strong>ce</strong>t entre-soi compromettrait les possibilités de<br />
61 Pour une lecture critique de la notion même d’ethnie : Amselle, Jean-Loup (1999) « Ethnies et espa<strong>ce</strong>s : pur<br />
une anthropologie topologique », in Au coeur de l’ethnie , Paris, La découverte /poche<br />
62 Le Nouvel observateur (2008) « les miniers de l’enfer ».<br />
63 Kalere, Jean Migabo (janvier 2002) Génocide au Congo ? Analyse des massacres des populations civiles.
57<br />
finan<strong>ce</strong>ment. Au cœur d’une société déjà assistée par les ONGs – l’absentéisme de l’État 64 en<br />
matière de prestations de servi<strong>ce</strong>s publics auprès de sa population, en temps de paix comme<br />
en temps de guerre, étant assez remarquable – les initiatives associatives locales et<br />
internationales se sont multipliées et la présen<strong>ce</strong> des acteurs et actri<strong>ce</strong>s de <strong>ce</strong> tissu associatif<br />
s’est pérennisée. C’est à travers <strong>ce</strong>t obstacle ou <strong>ce</strong> filtre associatif que j’ai pu avoir accès à <strong>ce</strong><br />
qu’ « elles » disent de <strong>ce</strong> qu’elles ont vécu et <strong>vivent</strong> encore.<br />
2. Les institutions associatives et hospitalières.<br />
2.1 Caractéristiques générales du tissu associatif local et international de la provin<strong>ce</strong> du Sud-<br />
Kivu.<br />
Vous trouverez en annexe la liste, malheureusement non-exhaustive, des associations<br />
œuvrant dans la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s sexuelles et/ou dans la prise en charge de <strong>ce</strong>lles et<br />
<strong>ce</strong>ux qui en sont victimes. 65 J’ai commencé <strong>ce</strong>tte enquête en étant persuadée de la réalité de<br />
l’opposition entre organisations internationales et associations locales. Le lien entre les deux<br />
est en fait plus complexe que <strong>ce</strong>lui d’une simple opposition. L’action des unes et des autres<br />
s’influen<strong>ce</strong>nt mutuellement. Je ne pouvais donc pas prétendre explorer le tissu associatif<br />
local impliqué dans le domaine qui m’intéressait sans explorer <strong>ce</strong> rapport complexe qui le<br />
reliait à la communauté internationale, qui de fait, formatait ses actions. C’est un aspect de<br />
<strong>ce</strong> rapport que je me propose d’analyser ici et, plus précisément, l’influen<strong>ce</strong> des normes<br />
con<strong>ce</strong>ptuelles et catégorielles de la communauté internationale sur l’action associative<br />
locale.<br />
« L’intériorisation et la retransmission de la doxa discursive des bailleurs par les<br />
responsables des associations locales est logique et habituelle. » 66 En allant à la rencontre de<br />
<strong>ce</strong>rtaines de <strong>ce</strong>s associations locales, j’ai pu différencier trois catégories, et <strong>ce</strong> à travers le<br />
critère différentiel du temps. En effet <strong>ce</strong>rtaines, très peu, sont nées avant la guerre d’une<br />
64 Pour une analyse critique du rôle de l’état en Afrique :<br />
Denis M. Tull (2003) “A reconfiguration of a political order: The State of the state in North Kivu”, African<br />
Affairs, 102, pp 429-446.<br />
65 Annexes, tableau des associations.<br />
66 Moufflet V., Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la République démocratique du Congo,<br />
Afrique contemporaine 2008/3, N° 227, p. 119-133.
58<br />
volonté d’agir pour le développement de leur région, ou, par exemple, le respect des droits<br />
de la femme. D’autres sont nées de la guerre des problématiques qui lui sont inhérentes :<br />
sensibilisation à la paix, activités de dénonciations des activités militaires, aide aux victimes<br />
de toutes sortes. D’autres encore, majoritaires, sont nées dans le courant des années 2000<br />
au gré des appels d’offre ici et là dans diverses domaines tels que la protection de l’enfan<strong>ce</strong>,<br />
ou la lutte contre les violen<strong>ce</strong>s sexuelles plus ré<strong>ce</strong>mment. Les plus visibles d’entre elles, et<br />
donc les plus ac<strong>ce</strong>ssibles bénéficiaient ou avaient bénéficiées d’un partenariat avec un ou<br />
plusieurs acteurs organisationnels de la coopération internationale très ré<strong>ce</strong>nt dans le cas<br />
particulier des violen<strong>ce</strong>s sexuelles : D’ECHO à l’UNICEF en passant par Caritas, Médecin Sans<br />
Frontières, ou encore Global Rights. Dans le premier cas, la seule analyse superficielle des<br />
dénominations associatives nous permet de remarquer la prédominan<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>s trois<br />
domaines con<strong>ce</strong>ptuels : le genre, les droits de l’homme, et le développement. En <strong>ce</strong> qui<br />
con<strong>ce</strong>rne le genre et la lutte pour les droits des femmes, plusieurs associations réclament le<br />
« développement intégral » de la femme, son « épanouissement », ou agissent<br />
exclusivement auprès des femmes. Con<strong>ce</strong>rnant le développement et la lutte contre la<br />
pauvreté, elles sont aussi nombreuses à expliciter dans leur dénomination <strong>ce</strong>tte priorité, je<br />
pourrais ici citer comme exemple Action pour le Développement Social née bien avant la<br />
guerre. Il apparait clairement que <strong>ce</strong>s objectifs affichés ont pu être façonnés, si <strong>ce</strong> n’est<br />
créés au moins par les habitudes sémantiques de la communauté internationale. Et si elles<br />
ne sont pas des habitudes, elles sont des exigen<strong>ce</strong>s auxquelles la communauté<br />
internationale conditionne son aide. C’est le cas, encore ré<strong>ce</strong>nt et actuel du con<strong>ce</strong>pt de «<br />
genre ». La prise en compte de la dimension genrée dans les programmes d’action facilite<br />
l’implication des bailleurs de fonds occidentaux sensibles à <strong>ce</strong>tte dimension dans tous les<br />
rapports sociaux.<br />
Les associations locales ne manipulent pas seulement les modes con<strong>ce</strong>ptuelles mais aussi les<br />
normes catégorielles qu’impose la communauté internationale. Le politique du ciblage,<br />
aussi problématique soit-elle, appartient aux mécanismes qui régissent <strong>ce</strong>s normes. Depuis<br />
les années 1990, le ciblage, et surtout sa précision grandissante est en vogue dans toutes les<br />
actions de développement de l’Amérique latine à l’Afrique. C’est exactement dans <strong>ce</strong>tte<br />
logique de ciblage à outran<strong>ce</strong> que s’inscrivent de manière plus ou moins visible les<br />
programmes d’actions de toutes les associations impliquées dans la lutte contre les<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles ou la prise en charge de ses victimes, et <strong>ce</strong>, malgré l’affichage d’objectifs
59<br />
généraux comme la lutte pour les droits de la femme, ou contre la pauvreté. C’est une<br />
tendan<strong>ce</strong> compréhensible dans la première mesure ou la spécificité des problèmes<br />
rencontrés par <strong>ce</strong>rtaines catégories de la population né<strong>ce</strong>ssite une spécification des<br />
solutions que l’on prétend leur apporter, surtout en temps de guerre, et dans la deuxième<br />
mesure ou les fonds n’étant pas illimités, l’aide ne peut qu’être restreinte et se con<strong>ce</strong>ntrer<br />
sur <strong>ce</strong>rtaines catégories selon leur type de vulnérabilité et aussi selon leur degré de<br />
vulnérabilité. En effet, au risque de limiter l’aide, ou en tous cas son efficacité, il apparaît<br />
né<strong>ce</strong>ssaire d’identifier <strong>ce</strong>s catégories sus<strong>ce</strong>ptibles de bénéficier de <strong>ce</strong>tte aide – elles sont<br />
appelées « population-cible » ou encore « groupe bénéficiaire » – et donc de choisir des<br />
critères d’identification 67 . Bien que compréhensible donc, <strong>ce</strong>tte tendan<strong>ce</strong> n’en est pas moins<br />
problématique pour des raisons que nous allons exposer.<br />
La première phase de l’identification des cibles est tout d’abord biaisée par le problème<br />
d’ac<strong>ce</strong>ssibilité de <strong>ce</strong>rtaines tranches de la population qui peuvent pourtant être les plus<br />
né<strong>ce</strong>ssiteuses. Les politiques de ciblage posent effectivement « des problèmes de seuils<br />
d’accès aux aides » 68 Dans le cas qui nous con<strong>ce</strong>rne, la démarche est particulière car il faut<br />
né<strong>ce</strong>ssairement que la personne décide d’aller se faire identifier auprès d’un organisme<br />
associatif adéquat ou alors qu’elle décide de dévoiler la vérité sur sa situation lorsqu’on un<br />
de ses organismes se dépla<strong>ce</strong> jusqu’à elle. Il est évident que dans les deux cas, une sélection<br />
s’opère par défaut, en fonction de l’ac<strong>ce</strong>ssibilité de <strong>ce</strong>s bénéficiaires potentielles. Ensuite, <strong>ce</strong><br />
pro<strong>ce</strong>ssus d’identification est né<strong>ce</strong>ssairement soumis aux effets des modes con<strong>ce</strong>ptuelles<br />
déjà analysées mais aussi des modes catégorielles. En effet, selon la sensibilité du moment,<br />
tour à tour les femmes, les enfants, d’ailleurs considérés comme les catégories les plus<br />
vulnérables, ou encore les communautés rurales, par exemple, vont être privilégiées et<br />
d’autres vont toujours être oubliées. Cela pose problème dans la mesure où <strong>ce</strong>s ciblages «<br />
tendent à fragmenter les groupes sociaux en les scindant en catégories à traitement<br />
différencié » 69 , sans envisager <strong>ce</strong>s groupes dans leur cohésion, leur interrelation, leur<br />
imbrication et leur influen<strong>ce</strong> mutuelle. Or, il est évident que, la solution à un problème<br />
caractéristique d’une <strong>ce</strong>rtaine catégorie de personnes, peut se trouver en dehors de <strong>ce</strong>tte<br />
67 Anderson, Mary B. (1994) « Le con<strong>ce</strong>pt de vulnérabilité : au-delà des groupes vulnérables » in Revue<br />
Internationale de la Croix Rouge, N°808,.<br />
68 Ceballos M., Lauthier B., “Les politiques de transfert conditionnel de revenue en Amérique latine: “ciblage<br />
large”, ou émergen<strong>ce</strong> d’un droit à l’assistan<strong>ce</strong>?” in Couffignal G. (Dir) : Amérique latine 2007 – Les surprises de<br />
la démocratie, La Documentation Française (Avril 2007).<br />
69 Ibid.
60<br />
catégorie. Par exemple, lorsque la femme est chassée par son mari après avoir été violée,<br />
c’est auprès de son mari et de son <strong>ce</strong>rcle d’influen<strong>ce</strong> qu’il faut agir durablement pour offrir à<br />
la femme la possibilité de réintégrer pleinement son foyer sans risque d’être méprisée, voire<br />
de se faire de nouveau chasser. Les évaluations qui précèdent l’action menée et <strong>ce</strong>lles qui la<br />
suivent devraient donc être menées dans toutes les couches de la population. Il m’apparaît<br />
aussi né<strong>ce</strong>ssaire de définir tout d’abord la sour<strong>ce</strong> du problème et la vulnérabilité des<br />
bénéficiaires avant de définir les solutions qu’on prétend apporter à un problème que l’on<br />
connait finalement mal, et quelles sont les circonstan<strong>ce</strong>s qui ont menées à <strong>ce</strong>tte situation de<br />
vulnérabilité extrême 70 .<br />
Cela nous mène à <strong>ce</strong> qui est selon moi le danger le plus important de <strong>ce</strong> ciblage : il apporte<br />
une réponse circonstancielle à un temps et pour une catégorie donnés, mais en aucun cas<br />
une réponse structurelle. « Les politiques ciblées ne diminuent pas durablement la<br />
vulnérabilité extrême ; elles peuvent accroître momentanément le niveau des ressour<strong>ce</strong>s<br />
dans des situations de crises, la situation alimentaire et sanitaire des pauvres, mais ne<br />
permettent pas une autonomie durable, en particulier pour <strong>ce</strong>ux qui sont exclus de l’activité<br />
productive […] Les politiques ciblées finissent par devenir un véritable « tonneau des<br />
Danaïdes », puisque non seulement elles sont couteuses (par tête), mais n’éliminent que<br />
très rarement les causes de <strong>ce</strong> qu’elles sont <strong>ce</strong>nsées combattre. » 71 C’est <strong>ce</strong> qui pourrait<br />
d’ailleurs dessiner la limite entre action humanitaire d’urgen<strong>ce</strong> et action dite de<br />
développement, qui semble s’inscrire beaucoup plus dans la durée.<br />
Fa<strong>ce</strong> au caractère aléatoire des cibles privilégiées, il est compréhensible que les associations<br />
locales chargées de faire le lien entre les finan<strong>ce</strong>ments internationaux et <strong>ce</strong>ux et <strong>ce</strong>lles qui<br />
sont <strong>ce</strong>nsés en bénéficier s’adaptent. Reprécisons que <strong>ce</strong>s structures associatives sont dans<br />
<strong>ce</strong>tte région les seuls prestataires d’aide et de servi<strong>ce</strong>, bien que relatifs et sélectifs, dans la<br />
provin<strong>ce</strong>. Si on en reste à la surfa<strong>ce</strong>, les associations locales ne semblent que s’adapter aux<br />
tendan<strong>ce</strong>s con<strong>ce</strong>ptuelles imposées par la communauté internationale. En réalité, elles<br />
s’adaptent aussi aux modes et aux tendan<strong>ce</strong>s catégorielles. L’exemple d’une association<br />
rencontrée au cours de ma recherche me parait ici intéressant. Il s’agit d’Action pour le<br />
70 Anderson, Mary B., « Le con<strong>ce</strong>pt de vulnérabilité : au-delà des groupes vulnérables » in Revue Internationale<br />
de la Croix Rouge, N°808, 1994, pp 361-362<br />
71 Ceballos M., Lauthier B., “Les politiques de transfert conditionnel de revenue en Amérique latine: “ciblage<br />
large”, ou émergen<strong>ce</strong> d’un droit à l’assistan<strong>ce</strong>?” in Couffignal G. (Dir) : Amérique latine 2007 – Les surprises de<br />
la démocratie, La Documentation Française (Avril 2007), p6.
61<br />
Développement Intégral de la Femme. Basée à Bukavu, sa dénomination ne laisse pas<br />
deviner sa catégorie-cible privilégiée. Sa représentante actuelle (il s’agissait de la première<br />
représentante femme que je rencontrais, tous les autres étaient des hommes) m’avait<br />
confiée que leur projet précédent était en fait axé sur la réinsertion des anciens enfantssoldats,<br />
mais la fin des finan<strong>ce</strong>ments sur <strong>ce</strong> projet les contraignirent à l’arrêter, sans que la<br />
réinsertion initialement prévue ait né<strong>ce</strong>ssairement aboutie. Des appels à projets con<strong>ce</strong>rnant<br />
la prise en charge et la réinsertion des victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles de la part de la<br />
communauté internationale leur ont permis d’obtenir d’autres finan<strong>ce</strong>ments qui les ont<br />
forcé à trouver un nouveau programme d’action pour une autre catégorie-cible : les<br />
« victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles ». Ils continuent à agir auprès de <strong>ce</strong>tte catégorie tant que<br />
les finan<strong>ce</strong>ments le leur permettent. Leur action est donc conditionnée et influencée par les<br />
capacités financières des bailleurs de fond, et leurs objectifs. Surtout depuis 2007, les appels<br />
à projets con<strong>ce</strong>rnant la problématique des violen<strong>ce</strong>s sexuelles se multiplient. C’est en<br />
s’adaptant à <strong>ce</strong>s capacités à <strong>ce</strong>s normes con<strong>ce</strong>ptuelles et <strong>ce</strong>s modes catégorielles qu’ils<br />
réussissent à subsister et à continuer à agir, même de manière sectionnée. Ces<br />
manipulations discursives plus ou moins conscientisées me semblent refléter la complexité<br />
du lien qu’entretiennent les structures associatives locales et les structures associatives ou<br />
interétatiques internationales dans <strong>ce</strong>tte région.<br />
2.2. La sélection préalable de mes futures interlocutri<strong>ce</strong>s par la réalité de terrain.<br />
C’est dans <strong>ce</strong> tissu associatif local et international complexe du Bushi que se trouvent les<br />
structures auprès desquelles j’ai choisi de faire mon enquête. La contemporanéité déjà<br />
évoquée de la réalité de <strong>ce</strong> double phénomène social a rendu le cadre de mon enquête,<br />
même au Sud-Kivu, instable d’un point de vue à la fois social, politique et militaire. Cette<br />
instabilité avait déjà influencé mon premier choix, et elle était sur le point d’influen<strong>ce</strong>r le<br />
prochain. En effet, elle me barrait l’accès à <strong>ce</strong>rtaines zones qui pourtant étaient l’espa<strong>ce</strong> au<br />
sein duquel se transformait en réalité concrète la problématique que j’entendais explorer.<br />
Les responsables associatifs rencontrés me rappelaient régulièrement la né<strong>ce</strong>ssité d’aller sur<br />
le terrain si je voulais vraiment comprendre la réalité de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong>. Paris-Bukavu ne<br />
suffisait donc pas à m’emmener sur le terrain.
62<br />
Il fallait encore opérer un autre voyage de Bukavu mais, <strong>ce</strong>tte fois-ci, vers les villages des<br />
zones rurales alentours. La violen<strong>ce</strong> genrée et ethnique est effectivement plus régulièrement<br />
et plus fréquemment perpétrée dans <strong>ce</strong>s zones rurales qu’à la ville 72 . Une sélection par<br />
défaut s’était déjà opérée parmi <strong>ce</strong>s personnes qui avaient subies et subissaient encore <strong>ce</strong>tte<br />
violen<strong>ce</strong> dans <strong>ce</strong>s zones rurales, condamnant ainsi au silen<strong>ce</strong> <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui ne faisaient<br />
pas parti de <strong>ce</strong>tte sélection : comment alors prétendre faire entendre la voix des femmes qui<br />
ont subi <strong>ce</strong>s actes de violen<strong>ce</strong> alors qu’une partie, indéfinie et indénombrable d’entre elles<br />
était morte de leur conséquen<strong>ce</strong> directe ou indirecte ? Comment prétendre faire entendre<br />
leurs voix alors qu’une autre partie, tout aussi indéfinie et indénombrable, est retenue<br />
encore aujourd’hui dans des bases militaires ou cachée dans les forêts dans des refuges de<br />
fortune? Leurs voix, leurs paroles et donc la réalité de l’expérien<strong>ce</strong> telles qu’elles l’ont vécue<br />
nous sont inac<strong>ce</strong>ssibles, et nous devons l’ac<strong>ce</strong>pter. De même, comment prétendre faire<br />
entendre leurs voix alors qu’une partie tout autant indéfinie et indénombrable est<br />
prisonnière de la honte, de la peur, de la culpabilité, des regrets ? Le seul pont qui semble<br />
exister entre moi et <strong>ce</strong>ux et surtout <strong>ce</strong>lles, nombreuses, qui restent est le <strong>ce</strong>rcle associatif et<br />
hospitalier leur apportant une aide plus ou moins directe. Celles qui étaient en vie, dans bien<br />
des cas poussées justement par un <strong>ce</strong>rtain instinct de survie, pouvaient, quand les<br />
circonstan<strong>ce</strong>s l’exigeaient, échapper à leur bourreaux, fuir durant des heures, des jours,<br />
voire des semaines pour atteindre une association d’aide aux victimes ou au mieux un<br />
hôpital, et, fa<strong>ce</strong> au personnel, effectivement surmonter les obstacles que nous avons cités :<br />
la honte, la peur, le sentiment de culpabilité, les regrets. Ce milieu associatif et hospitalier<br />
était la première, et peut-être la seule porte d’accès à une réalité qui peut, à première vue,<br />
paraître insaisissable et qui aurait pu le rester longtemps.<br />
Mais de par leur ac<strong>ce</strong>ssibilité limitée, <strong>ce</strong>s milieux opèrent aussi involontairement une<br />
sélection qui échappe à tout contrôle et particulièrement au mien. Elle restreint ainsi mon<br />
champ d’analyse et biaise donc la réalité que je vise pourtant à rendre compte. L’hôpital de<br />
Panzi, par exemple, est, comme nous allons bientôt le voir, le seul hôpital de la région à<br />
offrir des soins relativement adéquats et gratuits aux besoins des victimes de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles. Au sein même de leur village, les <strong>ce</strong>ntres de santé ne proposent pas beaucoup<br />
plus que des kits d’hygiène, <strong>ce</strong> qui est, sûrement, déjà quelque chose. La proportion des<br />
72 Sauf, par exemple, en 2004, où la ville-même fut le théâtre de combats sanglants. C’est <strong>ce</strong> type d’importation<br />
du conflit dans le contexte urbain qui est à l’origine de l’initiative de Venantie Bisimwa avec l’Union Sportive<br />
pour l’Autodéfense Populaire d’organiser en ville des cours d’auto-défense pour les filles.
63<br />
femmes qui auraient besoin des soins proposés par <strong>ce</strong> grand hôpital par rapport à <strong>ce</strong>lles qui<br />
effectivement se dépla<strong>ce</strong>nt pour bénéficier de <strong>ce</strong>s soins est inestimable. Une enquête<br />
effectuée entre 2004 et 2008 auprès des patientes de <strong>ce</strong>rtaines des patientes de <strong>ce</strong>t hôpital<br />
révèle qu’elles sont 12% à s’y être déplacées dans le mois suivant leur agression, et que 50%<br />
d’entre elles ont attendu plus d’un an avant de se faire examiner. Un pour<strong>ce</strong>ntage indéfini<br />
ne se dépla<strong>ce</strong>ra pas au risque fréquent d’en mourir. En plus des difficultés d’ac<strong>ce</strong>ssibilité, les<br />
dangers de la stigmatisation incarnent une barrière entre les survivant(e)s et <strong>ce</strong>s institutions.<br />
Le problème de la stigmatisation se pose dans le dernier cas de la différenciation entre les<br />
catégories d’association exposées au début de <strong>ce</strong> sous-chapitre 73 : le public-cible des<br />
activités de l’association est explicite. Dès lors qu’un(e) survivant(e) se dirige vers <strong>ce</strong>tte<br />
association, tous <strong>ce</strong>ux qui le ou la voient savent qu’il fait partie de <strong>ce</strong> public-cible. Les deux<br />
premiers types d’associations proposent souvent aussi, et parfois même exclusivement, des<br />
prestations aux « victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles ». Contrairement aux dernières dont<br />
l’activité et le public-cible sont explicite, elles ont l’avantage de garder secret les drames des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles qui poussent les victimes à aller vers eux. C’est le cas d’une des<br />
associations auprès de laquelle j’ai effectué mon enquête, Association d’Action pour les<br />
Vulnérables. Si les membres du personnel associatif sont au courant du mal dont ses<br />
bénéficiaires sont victimes, il n’en est pas de même pour les <strong>ce</strong>rcles sociaux et<br />
communautaires, que <strong>ce</strong>s bénéficiaires ne veulent pas né<strong>ce</strong>ssairement informer. Ce n’est<br />
pas le cas de l’hôpital de Panzi qui possède un servi<strong>ce</strong> spécial pour les victimes de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles. Ce servi<strong>ce</strong> est, comme nous allons le voir, complètement isolé du reste de<br />
l’hôpital. Dès lors, toute personne qui y séjourne pour une plus ou moins grande période<br />
peut être stigmatisée par son entourage. Ce type d’institutions associatives et hospitalières,<br />
nombreuses, ne favorise pas l’identification et l’éventuelle prise de parole de <strong>ce</strong>lles et, <strong>ce</strong>tte<br />
fois-ci peut-être encore plus, <strong>ce</strong>ux que la honte paralyse. En effet, un ré<strong>ce</strong>nt rapport<br />
dénon<strong>ce</strong> l’invisibilité des hommes et des garçons en tant que victimes de la violen<strong>ce</strong> genrée.<br />
Si la stigmatisation chez les femmes et les filles fait partie des grands maux corollaires aux<br />
actes de violen<strong>ce</strong>s, elle serait encore plus grande chez les hommes et les garçons. 23% des<br />
hommes interrogés (en Ituri) ont avoués avoir été victimes d’abus sexuels depuis le début du<br />
conflit. Leur pour<strong>ce</strong>ntage est bien moindre dans les institutions associatives et hospitalières,<br />
73 Chapitre 3, 2.1, p54.
64<br />
alors qu’ils seraient encore plus nombreux que <strong>ce</strong> que révèle <strong>ce</strong>tte enquête. 74 Les survivants<br />
masculins n’ont donc pas de structures qui proposent des prestations adéquates à leurs<br />
besoins, pourtant différents de <strong>ce</strong>ux des survivantes. L’exemple de la (non -) présen<strong>ce</strong><br />
masculine au sein de <strong>ce</strong>s structures démontre la sélection par défaut qu’opèrent les dangers<br />
de la stigmatisation au sein de <strong>ce</strong>s structures, et donc au sein de mon enquête. La restriction<br />
de mon champ de vision par <strong>ce</strong>tte sélection par défaut est donc bien réelle mais<br />
indépendante de ma volonté, la réalité du terrain m’interdisant quoi qu’il en soit l’accès à<br />
toutes <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui sont passé-e-s, de gré ou de for<strong>ce</strong>, au travers de <strong>ce</strong> tissu associatif<br />
et hospitalier.<br />
2. 3 Le choix de mes structures d’enquête : la prise de contact.<br />
Bukavu s’avéra être un point de départ judicieux grâ<strong>ce</strong> à son rôle administratif : toutes les<br />
associations du Sud-Kivu ont leur siège social dans <strong>ce</strong>tte ville. Le choix de <strong>ce</strong>lles que j’ai voulu<br />
rencontrer s’est fait d’abord au hasard. Avant de partir, j’ai préétabli une liste d’associations<br />
dont j’avais répertorié les coordonnées et les adresses. Celles repérées sur internet étaient<br />
bien sûr les plus visibles et donc les plus formalisées et, probablement, les moins proches de<br />
la population. Cette liste s’est modifiée sur pla<strong>ce</strong>. Certaines, qui n’existaient plus, en ont été<br />
rayées tandis que le travail effica<strong>ce</strong> et aléatoire du bouche-à-oreille en rajouta. La première<br />
phase de mon travail a consisté à leur rendre visite pour vérifier leur existen<strong>ce</strong> effective, et<br />
me rendre compte de la réalité de leur action, au moins dans leur discours. Cette première<br />
phase m’a permis de débuter une classification qui a éclairé l’offre des actions concrètement<br />
proposées. Lorsqu’un membre du personnel d’UNICEF m’a informée qu’une <strong>ce</strong>ntaine<br />
d’associations sont impliquées dans la problématique des violen<strong>ce</strong>s sexuelles, j’ai pris<br />
conscien<strong>ce</strong> qu’il me fallait encore restreindre mon champ d’investigation. La for<strong>ce</strong> du<br />
bouche-à-oreille, qui d’ailleurs dépasse les frontières du Congo, vu que la connaissan<strong>ce</strong> de<br />
<strong>ce</strong>tte structure avait atteint mes oreilles lorsque j’étais encore en Fran<strong>ce</strong>, m’a orientée vers<br />
l’hôpital de Panzi en premier lieu. C’est au sein de <strong>ce</strong>tte structure de référen<strong>ce</strong> dans le<br />
domaine que j’ai effectué ma première série d’entretiens. Quelques voix se sont malgré tout<br />
élevées pour me mettre en garde contre <strong>ce</strong>tte structure qui, par sa réputation, sa taille, son<br />
échelle d’action, me donnerait une version faussée de la réalité. Mais d’autres personnes<br />
74 Irin, “repenser les violen<strong>ce</strong>s sexuelles – analyse”, 09/08/2010, Irin news | http://www.irinnews.org |
65<br />
ont insisté sur le caractère incontournable que donne justement <strong>ce</strong>tte grande échelle<br />
d’action à l’hôpital. Le choix de l’autre structure associative que je voulais moins grande et<br />
plus locale s’est fait au gré de rencontres, grâ<strong>ce</strong> à la volonté des bénévoles de m’ouvrir leur<br />
porte, et de l’adéquation de leur action avec <strong>ce</strong> que je pensais alors être ma problématique.<br />
Je ne me rendais pas encore compte que la frontière entre échelle locale et internationale<br />
d’action n’était pas aussi claire que je le pensais.<br />
A l’entrée des espa<strong>ce</strong>s associatifs et hospitaliers dans lesquels j’ai donc décidé par défaut de<br />
limiter la première partie de mon enquête d’abord associative, d’autres barrières se sont<br />
dressées, opérant ainsi une sélection imprévue. En effet, toutes <strong>ce</strong>s structures ne m’ont pas<br />
ouverte facilement la porte à leur fonctionnement, à leurs statuts, à leurs rapports de<br />
mission, à leurs chiffres, et à <strong>ce</strong> qui m’intéressait le plus : le contact avec leurs bénéficiaires.<br />
J’avais conscien<strong>ce</strong> de la possibilité de rencontrer <strong>ce</strong>tte difficulté puisque je m’attaquais à un<br />
sujet sensible mais aussi tabou. Cependant, je me suis confrontée à <strong>ce</strong>tte multiplication<br />
visible des actions de lutte contre les violen<strong>ce</strong>s sexuelles, à toutes <strong>ce</strong>s pancartes, à tous <strong>ce</strong>s<br />
signes visibles de <strong>ce</strong>s campagnes de sensibilisation, surtout dans la ville. J’ai pensé,<br />
partiellement à tort, que le tabou était, au moins en phase d’être brisé. Il commençait<br />
effectivement à l’être à la ville mais pas au village. Au moment de mon enquête, le pro<strong>ce</strong>ssus<br />
visant à défaire le tabou était visiblement entamé. Les violen<strong>ce</strong>s sexuelles n’étaient plus,<br />
dans leurs grandes lignes, une réalité invisible. Les codes sociaux et moraux commençaient<br />
donc à autoriser la visibilité de <strong>ce</strong>tte réalité. En discutant avec les différents membres des<br />
associations, je me suis malgré tout confrontée à l’interdit tacite et inattendu d’accès à<br />
<strong>ce</strong>rtains aspects de <strong>ce</strong>tte réalité. En effet, la plupart des structures rencontrées tiennent à<br />
préserver l’anonymat de leur « bénéficiaires ». Beaucoup tiennent aussi à la confidentialité<br />
de leurs données et quelques-unes à la confidentialité de leur activité. Leur souci est parfois<br />
de protéger leurs bénéficiaires, des dangers sécuritaires d’une éventuelle exposition qui<br />
échapperait à leur contrôle et à leur volonté, ou encore des dangers de la stigmatisation. J’ai<br />
cru voir au sein de <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles le souci peut-être un peu plus égoïste de préserver<br />
un <strong>ce</strong>rtain contrôle sur leur activité, sur leur données, mais aussi sur leurs « bénéficiaires ».<br />
En collaboration avec l’UNICEF et le ministère du genre, un plan d’Action Multi-Sectorielle a<br />
été mis en pla<strong>ce</strong> pour coordonner les actions dans le domaine des violen<strong>ce</strong>s sexuelles. Au<br />
cours d’une réunion AMS à laquelle j’ai pu assister au siège local de l’UNICEF, la ministre du<br />
genre a exprimé sa colère et son indignation à l’égard des acteurs associatifs locaux réti<strong>ce</strong>nts
66<br />
à l’idée de divulguer des données chiffrées ou des témoignages car il s’agissait de « nos<br />
victimes, nos victimes, nos victimes ». Au singulier ou au pluriel, <strong>ce</strong> pronom, désignant de<br />
manière assez ambigüe une relation d’appartenan<strong>ce</strong>, est souvent sorti de la bouche des<br />
acteurs associatifs locaux ou internationaux, et la plupart du temps involontairement<br />
révélant ainsi malgré eux une relation d’appartenan<strong>ce</strong> instinctive, voire naturelle. Cette<br />
prétention ou <strong>ce</strong>tte volonté même inconsciente d’inscrire la relation qui les lie à leur «<br />
bénéficiaire » dans <strong>ce</strong> rapport d’appartenan<strong>ce</strong> me semble inévitable. Par un raccourci<br />
fâcheux, je me suis moi-même surprise plus d’une fois à vouloir désigner parmi les<br />
personnes que j’ai interrogées, <strong>ce</strong>lles dont je suis le plus proche par « mes victimes ». À<br />
combien plus fortes raisons, des personnes qui les côtoient plus fréquemment et dont le rôle<br />
est conséquent dans la préparation de la nouvelle vie de la victime en question, dans<br />
l’orientation de son destin, cèdent plus facilement à la tentation de s’approprier la vie et le<br />
destin de <strong>ce</strong>lles qu’on pense avoir « sauvées ». Cette prétention n’en est pas moins<br />
problématique car symptomatique d’une emprise qui apparaît aussi comme inévitable :<br />
Celle qui s<strong>ce</strong>lle le rapport de for<strong>ce</strong> entre, ici, <strong>ce</strong>lle qui a besoin d’aide, et <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui<br />
sont habilités à donner l’aide. Ce sont, me semble-t-il, <strong>ce</strong>s mécanismes de protection, d’une<br />
part, et de pouvoir, d’autre part, qui ont poussé les structures associatives rencontrées à<br />
faire parfois preuve de méfian<strong>ce</strong> envers moi, et à dresser une barrière entre moi et « mes »<br />
interlocutri<strong>ce</strong>s.<br />
Il me semble aussi que l’ambiguïté de mon statut vis-à-vis d’eux a participé à la fois à<br />
construire les barrières, mais aussi à les briser. En effet, barricadées derrière des immenses<br />
portails dont les entrées et sorties sont surveillées jour et nuit, les grandes structures<br />
internationales sont d’un premier abord inac<strong>ce</strong>ssible à quiconque n’a pas de contact à<br />
l’intérieur de <strong>ce</strong>s barricades, peu importe à quel grade. Il faut avoir un rendez-vous pour<br />
espérer rentrer dans leur bâtiment et, souvent, un laisser-passer. L’association au sein de<br />
laquelle j’ai fait un petit stage en parallèle m’en a fourni un. Mais pour avoir un rendez-vous,<br />
il faut d’abord réussir à contacter par téléphone ou par internet un des membres du<br />
personnel, souvent très occupé, <strong>ce</strong> qui n’est pas aussi facile qu’il n’y parait quand on connait<br />
les problèmes de communications dans <strong>ce</strong>tte ville. Une fois le rendez-vous obtenu, avec la<br />
personne en charge de la problématique qui m’intéresse, encore fallait-il que mon projet<br />
soit reçu favorablement : implicitement ou explicitement, sa crédibilité, sa légitimité, et son<br />
utilité ont constamment été questionnées, ainsi que mon identité.
67<br />
Nous avons déjà vu dans le deuxième chapitre l’ambigüité du in et du out de ma position<br />
d’enquêtri<strong>ce</strong> vis-à-vis des enquêtées. La situation dans laquelle je me trouvais fa<strong>ce</strong> à <strong>ce</strong>s<br />
grosses structures internationales est assez emblématique de <strong>ce</strong>tte ambivalen<strong>ce</strong> à laquelle<br />
j’étais assignée. Dès que j’ouvrais la bouche, confirmant <strong>ce</strong> que mon attitude malgré moi<br />
leur avait fait pressentir, j’étais française. La lettre de recommandation heureusement<br />
délivrée par André Guichaoua 75 l’a confirmé et a insufflé une crédibilité bienvenue à mon<br />
projet. Il semblerait que dans <strong>ce</strong>tte zone, tout projet universitaire sur n’importe quel sujet<br />
né<strong>ce</strong>ssite une lettre de recommandation de <strong>ce</strong> genre.<br />
Le comportement de la grande structure partenaire de l’UNICEF qu’est l’hôpital de Panzi au<br />
sein de laquelle j’ai effectué ma première série d’entretiens a été différent des autres. Peutêtre<br />
est-<strong>ce</strong> pour <strong>ce</strong>tte raison que mon choix s’est arrêté sur <strong>ce</strong>tte structure. Alors que je<br />
n’avais même pas encore de lettre de recommandation, ils ont ac<strong>ce</strong>pté que je mène une<br />
partie de mon enquête avec eux. Sa politique, critiquée, consiste à ouvrir les portes de leur<br />
hôpital aux visiteurs, surtout extérieurs à la zone, au pays, et encore plus au continent. Ils<br />
sont donc habitués à accueillir dans leur locaux journalistes, étudiants en Masters et surtout<br />
doctorants qu’ils espèrent voir participer par leur analyse à la fin de <strong>ce</strong> phénomène, et par<br />
leur visibilité au combat pour « faire savoir » les horreurs qui ont lieu dans le pays, et à la<br />
multiplication des possibilités des finan<strong>ce</strong>ments, pourtant déjà multiples. Cette politique est<br />
beaucoup décriée dans l’opinion public qui effectivement accuse <strong>ce</strong>t hôpital d’être le<br />
premier à faire des violen<strong>ce</strong>s sexuelles un business. Mais <strong>ce</strong>tte politique a eu, au moins, le<br />
mérite de faciliter mon enquête en ouvrant des portes ailleurs difficile à ouvrir. Elle l’a<br />
compliquée aussi dans la mesure où l’habitude formatait le discours des personnes que<br />
j’allais interroger au sein du personnel mais aussi de leurs « bénéficiaires ». Cet hôpital mais<br />
aussi toutes les autres structures avaient une idée préconçue de <strong>ce</strong> que mes oreilles<br />
occidentalisés avaient envie et besoin d’entendre, et de <strong>ce</strong> que mes yeux aussi occidentalisés<br />
avaient envie ou besoin de voir. Malgré tout, une fois <strong>ce</strong>tte lettre en main, elles m’ont toutes<br />
accordée le droit de regard sur des rapports de mission et, au mieux, un entretien avec le<br />
dirigeant (un homme, toujours) du servi<strong>ce</strong>, mais très court et assez froid. 76 Le contact avec<br />
les bénéficiaires n’a que très rarement été envisagé et, quoi qu’il en soit, seulement à travers<br />
leurs « partenaires locaux ».<br />
75 Annexes, lettre de recommandation.<br />
76 Ex<strong>ce</strong>ption du directeur de l’hôpital de Panzi, Dr Denis Mukwege : Il m’a, à ma grande surprise, accordé un<br />
entretien d’une heure.
68<br />
Ces derniers ont été, comme je m’y suis attendue, plus ac<strong>ce</strong>ssibles, mais aussi plus difficiles à<br />
trouver car moins formels et moins visibles, surtout lorsqu’ils n’étaient pas partenaires<br />
d’ONGs internationales. Mais, une fois trouvés, ils m’ont ouvert assez chaleureusement<br />
leurs portes, même s’il m’a parfois aussi fallu me battre pour obtenir des rendez-vous, dans<br />
des locaux plus ou moins officiels. 77 Ce que <strong>ce</strong>s acteurs associatifs per<strong>ce</strong>vaient comme une<br />
« double » identité a là aussi été un facteur décisif dans le façonnement des relations et des<br />
rapports que j’entretenais avec eux. Bien que je ne m’étais personnellement encore jamais<br />
pensée comme tel, j’étais donc dans leur regard à la fois européenne (et/ou française) et<br />
congolaise. Au gré des conversations, ils m’ont considérée comme l’une ou l’autre ou les<br />
deux à la fois de manière plus ou moins favorable. On me posait beaucoup de questions sur<br />
mon parcours. Je ne compte pas le nombre de fois où j’ai raconté mon histoire familiale. On<br />
me posait aussi beaucoup de questions sur la vie en Europe. Les deux aspects de <strong>ce</strong>tte<br />
identité ont progressivement tissé la complexité du lien qui se créait entre nous et ont<br />
façonné d’une manière inattendue le déroulement et donc les résultats de mon enquête. Il<br />
est naturellement possible de penser que la légitimité de ma présen<strong>ce</strong> sur le terrain – autant<br />
que la légitimité de mon discours, comme nous l’avons vu dans le deuxième chapitre – s’est<br />
seulement construite en fonction de mon passé familial. Il m’a effectivement épargné<br />
l’immédiate catégorisation en tant qu’étrangère. De plus il a, occasionnellement, permis à<br />
mes échanges d’échapper au formatage des discours et leur a permis de s’inscrire dans une<br />
<strong>ce</strong>rtaine ouverture. Cependant, mon identité européenne et universitaire a aussi légitimé<br />
ma présen<strong>ce</strong>, crédibilisé mon enquête et ouvert quelques portes. C’est <strong>ce</strong> que j’ai remarqué<br />
lorsque je soumettais leur personne à la lecture de la lettre de recommandation. C’est aussi<br />
<strong>ce</strong> qu’ont confirmé les propos d’un étudiant congolais à l’Université Officielle de Bukavu.<br />
Dans l’introduction de son mémoire sur le rôle des institutions hospitalières dans la<br />
réinsertion sociale des femmes violées au Sud-Kivu, il évoque ainsi une des difficultés<br />
rencontrées dans son enquête.<br />
« Nous avons eu des difficultés d’accéder aux données de l’hôpital de Panzi. En effet,<br />
l’hôpital de Panzi considère la situation des femmes violées comme un gagne-pain qu’il<br />
ne donne pas du tout accès aux informations né<strong>ce</strong>ssaires à qui que <strong>ce</strong> soit pour éviter<br />
une fuite sus<strong>ce</strong>ptible de disperser les bailleurs de fonds quant au finan<strong>ce</strong>ment des<br />
projets dans <strong>ce</strong> domaine dont il voudrait avoir le monopole. Aucun responsables de <strong>ce</strong><br />
77 Du salon de leur habitation dans les bidonvilles, au siège de la société civile
69<br />
<strong>ce</strong>ntre hospitalier de Panzi ne nous re<strong>ce</strong>vaient à tout moment que nous demandions<br />
l’audien<strong>ce</strong>, même si c’était sur rendez-vous. »<br />
Les réti<strong>ce</strong>n<strong>ce</strong>s, peut-être exagérées, de l’hôpital à ouvrir la porte d’accès à ses données<br />
sont peut-être liées au fait que <strong>ce</strong>t étudiant n’est pas un étranger. De même, la bonne<br />
volonté du même hôpital à m’ouvrir <strong>ce</strong>s mêmes portes est probablement liée au pied<br />
que j’ai à l’extérieur, en l’occurren<strong>ce</strong> en Europe. Dans mon rapport aux grandes<br />
structures internationales comme <strong>ce</strong>lle-ci et aux plus petites structures locales, la<br />
dimension européenne de mon identité a donc été un avantage mais parfois aussi un<br />
inconvénient. Les discours ont alors pu être formatés par exemple par l’espoir de<br />
finan<strong>ce</strong>ments. Cet espoir est légitime et compréhensible dans la mesure où tous les<br />
finan<strong>ce</strong>ments dans le milieu humanitaire viennent de l’Europe ou plus largement de<br />
l’Occident, des muzungu 78 , mais il filtrait, voire déformait la réalité. Cette déformation,<br />
nous le verrons dans le quatrième chapitre, dit aussi quelque chose sur <strong>ce</strong>tte réalité.<br />
Dans l’ensemble <strong>ce</strong>tte double identité a influencée, quand elle ne l’a pas directement<br />
facilitée, la prise de contact avec toutes les structures. Au moment où j’ai choisi la<br />
deuxième structure associative dans laquelle je voulais effectuer mon enquête, j’étais<br />
encore convaincue de l’opposition entre association internationale et association locale.<br />
Le hasard, peut-être, a voulu que je reste fidèle à la première association locale<br />
rencontrée qui m’a ouvert ses portes et dont l’action, dans <strong>ce</strong> domaine, ne dépassait pas<br />
les frontières du territoire de Bushi. Il s’agit d’Action d’Aide aux Vulnérables. Bien que<br />
partiellement financée par une structure internationale, son action ne m’est pas apparue<br />
trop formatée par les exigen<strong>ce</strong>s de la communauté internationale. Elle m’a laissée<br />
entrevoir des espa<strong>ce</strong>s d’informalité intéressants. Tels sont les cheminements et les<br />
mécanismes qui m’ont permis d’aboutir au choix des deux structures, l’hôpital de Panzi<br />
et AAV.<br />
78 Ce mot renvoie à toutes les personnes, noires ou blanches, qui viennent de l’occident.
70<br />
2.4 L’hôpital Général de Panzi et Action d’Aide aux Vulnérables : bref historique.<br />
L’hôpital Panzi, point de départ de mon enquête, a été fondé en 1999, fruit d’une<br />
collaboration entre l’Eglise protestante (la Huitième Communauté d’Eglises Pentecôtistes en<br />
Afrique Centrale – née grâ<strong>ce</strong> à des missionnaires suédois) de la provin<strong>ce</strong> et l’UNICEF en<br />
réponse à toutes atrocités dont a souffert la population pendant les guerres dites « de<br />
libération ». Le but premier était de créer une clinique mobile afin de surmonter les<br />
problèmes d’ac<strong>ce</strong>ssibilité aux soins médicaux d’abord pour les femmes en<strong>ce</strong>intes ou leurs<br />
enfants nouvellement nés. En 1998, l’organisation Austria offre un hôpital mobile à l’UNICEF<br />
qui en fait un <strong>ce</strong>ntre de maternité. Il ne survit pas à la guerre. Un an plus tard et notamment<br />
grâ<strong>ce</strong> à l’organisation suédoise PMU Interlife qui reprend le projet, deux anciens bâtiments<br />
sont réhabilités, des nouveaux sont construits autour pour donner lieu à un complexe<br />
médical pouvant offrir des soins en obstétrique, gynécologie, pédiatrie, chirurgie spécialisée<br />
et général, ophtalmologie, soins dentaires, et nutritionnels pour, en moyenne, 350 patients.<br />
La première opération chirurgicale est effectuée sur une patiente, violée et fusillée à<br />
l’intérieur de ses parties génitales. Elle vient du territoire de Fizi. C’est le servi<strong>ce</strong> mobile du<br />
CICR qui l’emmène jusqu’à l’hôpital. Elle est aujourd’hui infirmière dans le même hôpital.<br />
Depuis les cas de violen<strong>ce</strong>s sexuelles se sont multipliés jusqu’à représenter aujourd’hui 71%<br />
des patients 79 . C’est le seul hôpital dont une partie du personnel, et de la structure, est<br />
spécialisé sur la question. Mais <strong>ce</strong>t hôpital s’est con<strong>ce</strong>ntré, dans un premier temps, sur<br />
l’aspect médical du phénomène. C’est en 2002 qu’il obtient les finan<strong>ce</strong>ments (IRC, puis<br />
ECHO) pour un projet d’assistan<strong>ce</strong> holistique spécifique pour <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux victimes des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles. La même année, il prend une dimension militante et politique en<br />
dénonçant les crimes commis par les militaires. Des organisations internationales comme<br />
Médecins Sans Frontières, Amnesty International ou Human Right Watch dont les<br />
observations et rapports contribuent à faire de leur lutte une cause reconnue par la<br />
communauté internationale, s’investissent dans la cause. Ils développent trois volets<br />
différents qu’ils qualifient de « médical », « psychosocial et spirituel », et « socioéconomique<br />
». Le contact avec les différents acteurs de <strong>ce</strong>s différents servi<strong>ce</strong>s ne m’a pas<br />
été permis. Peut-être n’ai-je pas assez insisté. L’hôpital m’a ouvert ses portes sans<br />
79 Hôpital Panzi | www.panzihospitalbukavu.com |
71<br />
hésitations mais à l’intérieur toutes mes questions et toutes mes interrogations n’ont pas<br />
toujours eu droit de réponse. Si mes recherches préalables à l’enquête m’ont informée<br />
d’une prise en charge spirituelle consistant en <strong>ce</strong> que prêtres, pasteurs et autres hommes de<br />
Dieu collaborent avec l’hôpital pour apporter un réconfort spirituel aux patientes mais aussi<br />
et surtout pour amener les couples en rupture à travailler sur la réconciliation entre eux et le<br />
pardon envers l’agresseur, sur pla<strong>ce</strong>, je n’en ai rien vu ni rien appris. J’ai observé la<br />
dimension spirituelle à travers les cultes du matin, plus destinés au personnel qu’aux<br />
patients et à travers les allées et venues d’hommes que je supposais d’Eglise à partir de leurs<br />
tenues. Le volet socio-économique était matérialisé par la possibilité d’apprendre des savoirfaire<br />
comme la couture, ou le tissage. De plus, il est possible pour <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles,<br />
apparemment pas toutes, de bénéficier de « <strong>ce</strong>ntres de formations professionnels » et de<br />
cours d’alphabétisation à la maison Dorcas. Cette dernière permet même à leurs éventuels<br />
enfants de bénéficier d’une garderie. L’idée est, comme pour toutes les autres ONGs avec un<br />
volet socio-économique, de leur permettre de revenir dans leur village, dont les habitants<br />
sont généralement au courant de <strong>ce</strong> qui leur est arrivé, avec une <strong>ce</strong>rtaine dignité auprès des<br />
leurs et un sentiment d’utilité grâ<strong>ce</strong> aux métiers et aux techniques qu’elles ont apprises. J’ai<br />
été immergée dans le volet psychosocial à mi-temps pendant deux semaines – tout du moins<br />
dans <strong>ce</strong> qu’ils m’ont laissé entrevoir de <strong>ce</strong> volet. Après examen médical et pré-examen<br />
psychologique, peut-être pour s’assurer de la véracité des propos de la survivante, <strong>ce</strong>tte<br />
dernière est envoyée auprès de l’équipe « psychosociale » composée de deux psychologues<br />
femmes et d’un psychologue homme. Après entretien avec l’une des psychologues, une<br />
assistante sociale (ou écoutante) lui est assignée et plusieurs servi<strong>ce</strong>s d’écoute et d’échange<br />
que nous verrons plus loin, lui sont offert selon le degré de son traumatisme.<br />
Les personnes soignées dans <strong>ce</strong>t hôpital viennent de loin. Elles y restent aussi longtemps<br />
qu’elles le peuvent. Il est possible d’assimiler la section dédiée aux soins des violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles, comme un camp de déplacé-e-s : <strong>ce</strong>s dernières ne cherchent pas seulement les<br />
soins, elles fuient l’insécurité et le jugement des autres, dans leur village.<br />
Telles sont les caractéristiques générales et l’aperçu historique de la structure au sein de<br />
laquelle j’ai effectué la première partie de mon enquête.<br />
L’histoire et le fonctionnement d’AAV sont tout autres. Cette association est née en 2006 de<br />
l’initiative conjointe de citoyens congolais issus de la « diaspora » et d’autres qui sont restés<br />
sur pla<strong>ce</strong>. L’objectif de l’association est de proposer une assistan<strong>ce</strong> (médicale, éducative,
72<br />
sociale, économique) à tout type de « vulnérables » : Les veufs et veuves, les orphelins, les<br />
filles-mères, les indigents et les victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles. La responsable de<br />
l’association est, une fois n’est pas coutume, une femme. C’est progressivement que<br />
l’association a développé une <strong>ce</strong>llule spéciale d’aide aux derniers et plus fréquent aux<br />
dernières. Ils se sont aperçu que beaucoup de familles qui correspondaient à leur critère<br />
d’attribution d’aide rencontraient des problèmes liés aux violen<strong>ce</strong>s sexuelles. Ce constat les<br />
a poussés à créer un <strong>ce</strong>ntre d’hébergement et de formation (coupe-couture,<br />
essentiellement) dans le village <strong>ce</strong>ntral du territoire pour <strong>ce</strong>lles qui étaient rejetées par leur<br />
village et/ou par leur famille. Toutes les filles que j’ai rencontrées de <strong>ce</strong>tte association<br />
regrettent <strong>ce</strong> temps ou elles pouvaient vivre à l’abri du regard et des mena<strong>ce</strong>s des autres<br />
dans <strong>ce</strong> <strong>ce</strong>ntre. Actuellement l’association vise à reconstruire un <strong>ce</strong>ntre de <strong>ce</strong> type. Malgré<br />
leurs activités de sensibilisation dans les églises, auprès des chefs de village, etc., les femmes<br />
et filles « VVS » souffrent toujours de la stigmatisation, mettant parfois jusqu’à leur vie ou<br />
<strong>ce</strong>lle de l’éventuel enfant issu du viol en danger. Il m’a été difficile de comprendre le<br />
fonctionnement de <strong>ce</strong>tte association, tellement <strong>ce</strong> dernier n’est pas formel ni formalisé. Il<br />
semblerait que les survivantes qu’ils prennent partiellement en charge sont réunies deux fois<br />
par mois pour une séan<strong>ce</strong> d’écoute. Le travail effectué par l’association n’est pas que avec et<br />
pour les femmes. Elle fait un important travail de sensibilisation auprès des villageois-e-s, de<br />
leur chef coutumiers, religieux, politiques pour lutter contre les méfaits de la stigmatisation<br />
et pour faire des violen<strong>ce</strong>s sexuelles un problème public. Elle fait aussi un important travail<br />
de réinsertion communautaire. L’exemple qui m’a le plus frappée c’est <strong>ce</strong>lui d’une femme<br />
dont le mari l’avait chassée : un des rôles traditionnels du mari, est de construire la maison<br />
du foyer. N’ayant plus de maison, ni de foyer, ni de mari, l’association a réactivé les<br />
mécanismes de solidarité et de « cohésion sociale », selon les mots d’un des responsables de<br />
l’association : En sensibilisant les gens elle a réussi à récolter le matériel né<strong>ce</strong>ssaire à la<br />
construction d’une maison (bois, paille, etc.) dans laquelle <strong>ce</strong>tte femme vit à présent. Il y<br />
aurait beaucoup d’autres exemples de <strong>ce</strong> type de solidarité parmi les 300 bénéficiaires<br />
survivantes des violen<strong>ce</strong>s sexuelles de guerre.<br />
Telles sont donc les caractéristiques générales des structures auprès desquelles j’ai effectué<br />
mon enquête.
73<br />
3. Mes interlocutri<strong>ce</strong>s<br />
3.1 Le choix de mes interlocutri<strong>ce</strong>s selon des critères qui me sont extérieurs.<br />
J’ai dans un premier temps envisagé deux phases dans le déroulement de mon enquête au<br />
sein des structures choisies. La première aurait dû consister en une phase d’observation<br />
participante qui aurait dû m’intégrer à la structure et m’aider à créer des liens de confian<strong>ce</strong><br />
avec le personnel associatif et ses « bénéficiaires ». La deuxième aurait dû consister en une<br />
phase d’entretiens plus formels avec <strong>ce</strong>lles et <strong>ce</strong>ux qui, pleinement conscients de qui j’étais,<br />
auraient ac<strong>ce</strong>pté de s’entretenir avec moi. Je ne sais toujours pas pourquoi la première<br />
phase envisagée n’a pas pu se réaliser. Une enquête ne se déroule vraisemblablement<br />
jamais comme on l’imagine. Mes interlocuteurs et mes plus rares interlocutri<strong>ce</strong>s m’ont<br />
directement engagée dans <strong>ce</strong> qui aurait dû être une deuxième phase, inscrivant<br />
involontairement ma prise de contact avec mes interlocutri<strong>ce</strong>s dans une <strong>ce</strong>rtaine violen<strong>ce</strong> :<br />
<strong>ce</strong>tte prise de contact apparaît comme peu naturelle. Il a été de ma responsabilité d’adoucir<br />
au cours d’entretiens toujours trop courts le rapport de for<strong>ce</strong> installé malgré moi.<br />
Le choix en lui-même de mes interlocutri<strong>ce</strong>s s’est aussi fait malgré moi. Les circonstan<strong>ce</strong>s et<br />
les associations ont déjà opérées une sélection par défaut des personnes à qui je pouvais<br />
m’adresser, comme nous l’avons vu. Les associations ont opéré, <strong>ce</strong>tte fois-ci beaucoup plus<br />
consciemment, une autre sélection parmi <strong>ce</strong>s dernières. Malgré l’expression assez claire<br />
auprès du personnel associatif de ma volonté de parler avec <strong>ce</strong>lles qui en ont la for<strong>ce</strong> et<br />
l’envie, les femmes qui se sont présentées à moi ne l’ont pas choisi, mais ont toutes été<br />
désignées soit par <strong>ce</strong> personnel ou par les autres bénéficiaires. Au village, elles avaient<br />
toutes choisi de venir me voir pour, a priori, me parler. Nous explorerons dans le prochain<br />
chapitre les éventuels motifs de <strong>ce</strong> dépla<strong>ce</strong>ment et de <strong>ce</strong>tte volonté de me dire <strong>ce</strong> <strong>qu'elles</strong><br />
avaient vécu. Toutes n’ont pas eu l’occasion de me parler. L’association a du sélectionner,<br />
pour moi, quelques-unes d’entre elles.<br />
Une fois qu’elles étaient réunies autour de moi, le directeur de l’association s’exprima :<br />
« Ça fait dix personnes qui vont parler avec elles. Par<strong>ce</strong>-qu’ il y a beaucoup de travail, si l’on<br />
dit que chaque personne va parler pour soi, ça ne va pas tenir. Vous allez voir par exemple<br />
une maman qu’on a emmené à la forêt, mais son foyer est détruit, le mari la chasse, moi
74<br />
<strong>ce</strong>tte personne si je l’attrapais, je le mettrais même en prison. Par<strong>ce</strong>-que quand on t’a fait<br />
tout ça, il était là, il voyait. Mais, après, il te dit "pars, suis tes amis". Cette personne si on<br />
l’attrape, on va lui montrer <strong>ce</strong> que disent les enseignements, on va lui montrer comment<br />
c’est. Par<strong>ce</strong>-que si on a rien fait, on ne doit pas chasser l’autre, c’est <strong>ce</strong> que je vous dit. Donc<br />
vous devez montrer la maman qui a eu <strong>ce</strong> problème ou alors <strong>ce</strong>lle qui quand tu accouches un<br />
enfant, après ça elle devient un sujet de moquerie, en disant : "<strong>ce</strong>lui-là, il vient de la forêt" ou<br />
<strong>ce</strong>ci, et après tu te retrouves sans paix dans le village. Vous avez compris ? Ce sont <strong>ce</strong> genre<br />
de personnes qu’on recherche. Nous arrivons du côté des filles, chaque fille qui a accouché<br />
chez elle (fille-mère), ou alors on te laisse chez toi, tu as un enfant avec un homme après il te<br />
laisse comme on laisse un déchet. Vous-même vous savez déjà, <strong>ce</strong>lle-là aussi, vous la<br />
cherchez. Qu’elles causent avec maman. » (Pasteur responsable d’une section d’AVV)<br />
Il a donc demandé aux autres membres de l’association de désigner les femmes<br />
abandonnées par leur mari à la suite des violen<strong>ce</strong>s et les femmes pointées du doigt à cause<br />
d’un enfant issu du viol. Mes interlocutri<strong>ce</strong>s ont été désignées par les autres. Il s’est avéré<br />
que parmi les dix sélectionnées seulement trois d’entre elles ont effectivement été victimes<br />
de violen<strong>ce</strong>s sexuelles. Les autres sont veuves, orphelines, filles-mères. Il leur a fallu alors<br />
chercher parmi toutes <strong>ce</strong>lles qui étaient venues <strong>ce</strong>lles qui correspondaient à ma<br />
« population-cible ». Le temps m’a finalement permis que de discuter avec Lydia,<br />
Emmanuelle et la responsable associative. Cela montre soit la méconnaissan<strong>ce</strong> des situations<br />
précises des uns et des autres (comme nous l’avons vu, les actions de <strong>ce</strong>tte association<br />
s’adressent à tout type de « vulnérables »). Ou bien <strong>ce</strong>la montre la volonté finalement du<br />
personnel associatif de privilégier d’autres critères comme l’horreur des expérien<strong>ce</strong>s qu’elles<br />
ont traversé ou encore le degré de familiarité avec elles. En effet, ils ont tous<br />
vraisemblablement pensé que <strong>ce</strong>lle qui me parlerait retirerait un avantage quelconque. Au<br />
cours de ma deuxième visite au village, tout était beaucoup plus calme, organisé et il y avait<br />
moins de personnes - Tout de même une trentaine. L’association avait déjà<br />
« présélectionné » cinq femmes entre 25 et 35 ans qui avaient été ou alors étaient mariées,<br />
et qui avaient été victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles. Je leur avais seulement demandé cinq<br />
personnes qui partagent quelques caractéristiques comme l’âge ou le statut. A l’hôpital de la<br />
ville, la sélection était moins chaotique et plus simple dans la mesure où toutes les femmes<br />
présentes avaient été victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles. La psychologue qui m’a été référée les
75<br />
a appelées au fur et à mesure, ou les a consignées la veille pour le lendemain. Dans les deux<br />
cas, le choix ne leur était pas posé. Elles sont désignées par une tier<strong>ce</strong> personne et sont<br />
obligées de faire fa<strong>ce</strong> à toutes sortes de choses déjà enfouies. Cette sélection est révélatri<strong>ce</strong><br />
de l’emprise qu’exerçait le personnel associatif sur leurs « bénéficiaires ». Il me semble que<br />
le critère de sélection de <strong>ce</strong>tte psychologue a été la proximité temporelle de l’évènement qui<br />
était en train de transformer leurs vies. En effet, cinq sur six à qui j’ai parlé ont subi <strong>ce</strong>s actes<br />
de violen<strong>ce</strong> en 2009 ou en 2010. Je lui avais pourtant précisé que plus <strong>ce</strong>s actes avaient été<br />
perpétrés loin dans le temps, plus il me serait facile d’analyser les transformations du lien<br />
communautaire que je cherchais alors à analyser. Cependant, il me semble qu’elle avait déjà<br />
choisi <strong>ce</strong>s critères avant que je lui évoque les miens car elle avait déjà choisi mes<br />
interlocutri<strong>ce</strong>s avant qu’on parle de <strong>ce</strong>s « critères ».<br />
Le choix des personnes avec qui j’ai eu la chan<strong>ce</strong> d’échanger s’est donc fait malgré moi selon<br />
les critères de l’association.<br />
3.2 Les dangers de la catégorisation<br />
En écho aux réflexions sur le statut de la victime comme catégorie sociale du deuxième<br />
chapitre, il me paraît aussi important de s’arrêter quelques instants pour penser ma<br />
catégorisation, inhérente à la dimension sociologique de mon propos. Ce temps de réflexion<br />
est peut-être encore plus né<strong>ce</strong>ssaire dans mon cas dans la mesure où la catégorisation est<br />
triple, voire quadruple : je sollicite leur statut identitaire commun, discutable, de « victime »,<br />
de femme, de congolaise, et même de mushikazi, quand on pense que la grande majorité<br />
des mes interlocutri<strong>ce</strong>s font partie de la culture Shi. Ces statuts sont discutables car ils sont<br />
plus moins pertinents sociologiquement selon le contexte dans lequel la personne ainsi<br />
catégorisée évolue. Les catégories se réinventent quotidiennement d’un contexte à l’autre,<br />
d’interlocuteurs ou d’interlocutri<strong>ce</strong>s à d’autres. Les membres de la catégorie qu’on essaye de<br />
manipuler avec le plus de précautions possibles se révèlent bien plus actri<strong>ce</strong>s qu’on ne le<br />
pense dans <strong>ce</strong>tte réinvention. Cependant, comme nous l’avons vu dans l’introduction, les<br />
critères qui font d’elles une cible privilégiée de l’agresseur et donc qui fondent sa future<br />
appartenan<strong>ce</strong>, circonstancielle ou perpétuelle, à la catégorie de « victime » sont les mêmes<br />
critères qui déterminent les statuts catégoriels que je sollicite : le sexe, et l’appartenan<strong>ce</strong> à
76<br />
une communauté ethnique ou nationale. Sans pour autant les naturaliser, <strong>ce</strong>s<br />
catégorisations préexistent donc à mon enquête. Autrement je n’aurais d’ailleurs peut-être<br />
même pas eu l’idée de prendre pour objet d’étude les éventuels membres de <strong>ce</strong>s catégories.<br />
C’est <strong>ce</strong> que montre la multiplication passée et présent des discours à leur propos dans les<br />
différentes sphères que nous avons déjà analysées – surtout dans la sphère associative.<br />
Financièrement, elle ne voit peut-être pas d’intérêt à <strong>ce</strong> que <strong>ce</strong>tte catégorie ne <strong>ce</strong>sse<br />
d’exister, pour <strong>ce</strong>la n’a-t-elle peut-être pas encore résolu les problèmes liés à une catégorie<br />
qui légitime leur présen<strong>ce</strong> sur le terrain. Le danger inhérent à <strong>ce</strong>s catégorisations me semble<br />
résider dans leur renfor<strong>ce</strong>ment et leur légitimation pourtant involontaire. En effectuant une<br />
étude puis en formulant un discours en prise avec <strong>ce</strong>tte catégorie (<strong>ce</strong>lle de victime, ici<br />
corollaire aux deux autres), pourtant dans l’objectif de mieux la comprendre et de mieux<br />
répondre aux besoins qui lui sont propres, il est possible de penser que je la renfor<strong>ce</strong> et que<br />
je la légitime. Peut-être alors qu’à vouloir réformer un ordre social, involontairement et<br />
parfois inconsciemment, on participe à sa création et sa perpétuation. Alors, dans <strong>ce</strong> cas,<br />
peut-être qu’encore plus pertinent que le sexe et l’appartenan<strong>ce</strong> communautaire (et les<br />
statuts qui lui sont associés) comme critère de catégorisation, il y aurait le dénominateur<br />
commun d’une apparente réelle souffran<strong>ce</strong>, aux formes pourtant multiples. Cette<br />
souffran<strong>ce</strong>, visible ou invisible, audible ou inaudible, est le fruit d’une confrontation à une<br />
(ou plusieurs) situation(s) de violen<strong>ce</strong> effectivement mise en action dans leurs vies pour des<br />
critères liés à leur identité de genre et d’ethnicité. Ces situations peuvent alors servir une<br />
catégorisation inévitable mais plus distanciée.<br />
3.3 Situations et caractéristiques de mes interlocutri<strong>ce</strong>s 80 .<br />
Sans né<strong>ce</strong>ssairement former un « monde social », la situation peut être « sociale dans la<br />
mesure où elle engendre des contraintes et des logiques d’action qui présentent bien des<br />
points communs, où elle est perçue à travers des schèmes collectifs, où elle est<br />
éventuellement traitée par une même institution » 81 . C’est le cas de la catégorie qui nous<br />
con<strong>ce</strong>rne. Les situations de violen<strong>ce</strong>s sexuelles sont multiples mais répondent toutes à une<br />
même logique genrée. Dans le cadre d’une action de sensibilisation en collaboration avec la<br />
80 Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des personnes dont j’utilise l’entretien ici.<br />
81 Bertaux Daniel (2005) L’enquête et ses méthodes – le récit de vie, Paris, Armand Colin, p21.
77<br />
Fondation des ONG Finlandaises pour les Droits Humains (KIOS) et Global Rights,<br />
l’association locale d’Action des Chrétiens Activistes des Droits de l’Homme de Shabunda<br />
(ACADOSHA) liste les différents cas ou situations de violen<strong>ce</strong>s sexuelles et leur peine pénale<br />
associée. Il s’agit de l’attentat à la pudeur, du mariage, grossesse ou stérilisation forcé-e-s,<br />
de l’incitation de mineurs à la débauche, de la pornographie mettant en scène des enfants,<br />
de la prostitution d’enfants, du trafic et d’exploitation d’enfants à des fins sexuelles, du<br />
proxénétisme, de la prostitution forcée, de l’harcèlement sexuel, du viol individuel et<br />
collectif, de l’esclavage sexuel, de la mutilation sexuelle, ou encore de la transmission<br />
délibérée des infections sexuellement transmissibles incurables. Il est clair que <strong>ce</strong>rtaines<br />
situations s’entrecoupent tandis que d’autres se rencontrent plus rarement. Il est clair aussi<br />
que <strong>ce</strong>rtaines situations sont constantes en temps de paix et en temps de guerre tandis que<br />
d’autres se multiplient voire se systématisent en temps de guerre (Viol individuel et collectif,<br />
esclavagisme sexuel, mutilation sexuelle, grossesse forcée, transmission délibérée<br />
d’infections sexuellement transmissibles par exemple). Ces situations, dans un contexte<br />
(post -) conflictuel se différencient des autres par leur logique de destruction<br />
communautaire, comme nous l’avons déjà vu. Au cours de mes entretiens, j’ai délibérément<br />
évité le récit du viol en lui-même. A la lumière d’autres témoignages véhiculés par d’autres<br />
associations, il apparait de manière évidente que le viol en lui-même peut revêtir une variété<br />
impressionnante de formes différentes. Une enquête révèle par exemple qu’il peut être<br />
perpétré par un jusqu’à vingt agresseurs, qu’il peut impliquer que les victimes elles-mêmes,<br />
quand elles sont plusieurs prennen part au viol (en y assistant ou en étant forcée d’avoir des<br />
relations sexuelles avec les autres), qui peu impliquer l’introduction dévastatri<strong>ce</strong> d’objet (du<br />
pilon à l’arme parfois à feu) dans les parties génitales. Toutes <strong>ce</strong>s situations auxquelles sont<br />
confrontées les victimes s’inscrivent dans une logique similaire mais n’impliquent pas les<br />
mêmes conséquen<strong>ce</strong>s. Ces dernières dépendent donc du degré de violen<strong>ce</strong> de la situation en<br />
question mais aussi de la personnalité et de la for<strong>ce</strong>, aléatoire, de survie de <strong>ce</strong>lle qui la subit.<br />
Nous avons déjà vu dans le deuxième chapitre l’extrême hétérogénéité qui se cache derrière<br />
un discours sur une catégorie qui apparait, peut-être particulièrement ici, comme<br />
homogène. Parmi toutes <strong>ce</strong>lles que les circonstan<strong>ce</strong>s contextuelles puis les structures<br />
associatives ont choisies pour moi, j’ai pu m’entretenir avec 13 femmes. Elles ont entre 18 et<br />
36 ans. Certaines sont veuves, d’autres sont abandonnées de leur mari, d’autres sont<br />
célibataires e d’autres encore sont encore mariées. Les caractéristiques qui importent pour
78<br />
la compréhension de mon sujet sont le lieu (urbain ou rural) dans lequel je les ai<br />
rencontrées, et le caractère public ou privé de l’épreuve qu’elles ont traversée et du<br />
caractère privé ou public de <strong>ce</strong> qu’elles ont vécu. J’ai rencontré six d’entre elles à la ville,<br />
tandis que j’ai rencontré les sept autres, en deux fois, au village. Le nombre de tableaux en<br />
annexe montrent <strong>ce</strong>s trois étapes, et <strong>ce</strong>s deux espa<strong>ce</strong>s particuliers de rencontre dans<br />
l’enquête. Par contre, huit d’entre elles se sont fait kidnappées dans la forêt : La nature de <strong>ce</strong><br />
qu’elles ont vécu en forêt est publique dès lors qu’elles reviennent dans leur village, si elles<br />
arrivent à revenir. Une, Andrée a subi les deux types de situation. Les autres ont subi les<br />
actes de violen<strong>ce</strong> dans le cadre privé de leur maison au su, parfois de leur mari et de leurs<br />
enfants.<br />
Telles sont les caractéristiques générales des filles et femmes que j’ai rencontrées. C’est<br />
selon <strong>ce</strong> filtrage involontaire qu’il est possible de dire une partie, limitée, de la violen<strong>ce</strong><br />
genrée et ethnique qu’elles <strong>vivent</strong>.
79<br />
CHAPITRE 4 : méthodologie et analyse<br />
des entretiens<br />
1. Parcours méthodologique pour accéder à leurs paroles.<br />
1.1 Méthodes d’enquêtes : Du questionnaire semi-directif au récit de vie.<br />
Avant de rentrer dans la plus stricte analyse du contenu des entretiens, il me parait<br />
important de m’arrêter quelques instants sur la manière dont je suis arrivée aux échanges<br />
tels que je les ai retranscrits. La méthode d’enquête envisagée fit partie des méthodes<br />
d’enquêtes appliquées sur le terrain. La première sour<strong>ce</strong> de renseignements envisagée fut<br />
effectivement l’entretien individuel et à travers <strong>ce</strong> dernier, éventuellement le récit de vie,<br />
mais il se révéla incomplet et insuffisant en lui-même. L’un de mes objectifs était, nous<br />
l’avons vu, de donner une dimension individuelle à un phénomène social dit de masse. C’est<br />
ainsi que dans mon approche réflexive préalable à l’expérien<strong>ce</strong> de terrain en elle-même,<br />
l’entretien individuel d’ordre qualitatif s’imposa. Ma première sour<strong>ce</strong> de renseignements fut<br />
effectivement des entretiens individuels. J’espérais de voir <strong>ce</strong>s entretiens laisser la pla<strong>ce</strong> au<br />
récit de vie. Mais mon enquête exigeait des réponses précises en rapport à ma<br />
problématique très spécifique et surtout des réponses objectives et donc justifiables dans le<br />
cadre académique et universitaire d’un mémoire de fin d’étude. Et c’est <strong>ce</strong>tte né<strong>ce</strong>ssité qui<br />
guida la préparation des questions pour les entretiens futurs. Vingt-cinq questions semidirectives<br />
qui auraient dû apporter des réponses, et peut-être même les réponses attendues<br />
et supposées à ma problématique et mes hypothèses de départ. Elles étaient orientées en<br />
fonction du schéma du parcours identitaire et communautaire prédéfini 82 . Les premiers<br />
entretiens invalidèrent d’emblées la justesse de <strong>ce</strong> mon questionnaire. Les questions ne<br />
cadraient pas avec le cadre de compréhension et d’appréhension de mes interlocutri<strong>ce</strong>s. Les<br />
réponses apportées échappaient au format de réponse attendues tant par leur longueur que<br />
par leur contenu et leur registre. Elles prirent rapidement un caractère incontrôlable et ne<br />
82 Voir le chapitre 2.
80<br />
purent éviter <strong>ce</strong> que j’avais pourtant voulu éviter: le trop-plein d’émotion. La mission est<br />
presque impossible pour un sujet aussi passionnel. Ma stratégie méthodologique devait être<br />
réadaptée presque simultanément au moment même où elle était en marche et où elle<br />
s’invalidait d’elle-même. Mes questions furent alors plus évasives, moins précises et bien<br />
que suivant le même schéma, elles laissaient beaucoup plus de pla<strong>ce</strong> à l’expression de<br />
l’interviewée et s’adaptait à son discours, à son histoire.<br />
Dans <strong>ce</strong>tte libération forcée de l’espa<strong>ce</strong> de parole, la pla<strong>ce</strong> était faite au récit de vie. Comme<br />
le rappelle Daniel Bertaud, « il y a du récit de vie dès qu’il y a description sous forme<br />
narrative d’un fragment de l’expérien<strong>ce</strong> vécue » 83 . Et c’est <strong>ce</strong> qu’il est possible d’observer au<br />
cours des entretiens menés dont la durée a finalement variée entre 27 minutes et une heure<br />
trente. Peut-être par<strong>ce</strong>-que c’est progressivement que j’ai pris conscien<strong>ce</strong> de <strong>ce</strong>tte né<strong>ce</strong>ssité<br />
de laisser plus de pla<strong>ce</strong> de libre expression à mes interlocutri<strong>ce</strong>s, mes derniers entretiens à<br />
Panzi (Rachel, Andrée) sont <strong>ce</strong>uxqui laissent entrevoir le plus de passage narratifs.<br />
Parallèlement, la tournure incontrôlable et irrationnelle que prenaient parfois les entretiens<br />
m’interrogea quant à la validité scientifique et objective des données que <strong>ce</strong>s entretiens,<br />
bien que riches et humains, apportaient à mon mémoire. Une volonté d’objectiver me<br />
poussa à d’une part à chercher activement des données chiffrées, vérifiées et donc<br />
justifiables auprès des différents organismes qui interagissaient avec la population-cible que<br />
nous avions en commun. Cette volonté se coupla avec <strong>ce</strong>lle d’obtenir des données plus<br />
précise et me poussa à allier des questions plus précises aux questions évasives plus propi<strong>ce</strong>s<br />
au récit de vie. Cela complexifia le déroulement de l’entretien. Les structures associatives<br />
étaient malheureusement incapables de me donner <strong>ce</strong>s informations générales mais<br />
précises sur les personnes en question. Je décidai alors de compléter la méthode de<br />
l’entretien et du récit de vie par <strong>ce</strong>lle du questionnaire. J’eu l’occasion de l’appliquer au<br />
cours de ma deuxième série d’entretiens au village. Par manque de temps, comme toujours<br />
au village, mon accompagnatri<strong>ce</strong> se chargea de <strong>ce</strong>tte partie de l’enquête à partir des grilles<br />
du questionnaire que je lui donnai. Le rapport avec mes interlocutri<strong>ce</strong>s était donc double. Le<br />
questionnaire n’était pas sans poser problèmes pour autant dans la mesure où il s’assimilait<br />
à des fiches d’identifications et allait ainsi en contradiction avec la règle implicite que<br />
j’observais, à savoir <strong>ce</strong>lle du silen<strong>ce</strong> et du secret quant à l’identité des victimes et quant à<br />
l’exactitude de <strong>ce</strong> qu’elles avaient vécues.<br />
83 Bertaux Daniel (2005) L’enquête et ses méthodes, le récit de vie, Paris, Armand Colin, p14.
81<br />
Il s’avéra aussi que les informations que <strong>ce</strong>s questionnaires me divulguaient étaient <strong>ce</strong>rtes<br />
précises mais n’auraient pu augmenter en validité, en valeur et en intérêt scientifique qu’en<br />
confrontant leurs résultats avec le plus grand nombre d’autres mêmes questionnaires. 84 Ma<br />
première grille d’entretiens que j’avais établie avant d’aller au Sud-Kivu ne m’a finalement<br />
pas été très utile. Elle me donnait seulement des points de repères sur l’orientation générale<br />
à laquelle je devais donner l’entretien, autant que <strong>ce</strong>la m’était possible. J’ai au fur et à<br />
mesure essayé de laisser à mon interlocutri<strong>ce</strong> la liberté de nommer et décrire les<br />
évènements qui étaient pertinents, et à chaque étape j’ai essayé de savoir d’une part <strong>ce</strong><br />
qu’elle avait ressenti et <strong>ce</strong> qu’elle ressentait encore, et d’autre part, <strong>ce</strong> qu’elle avait pensé.<br />
Au cours de la deuxième partie de mon enquête, au village, le questionnaire tel qu’il a été<br />
établit me fournit des informations personnelles d’identification de l’interviewée : âge, nom,<br />
prénom, activité, statut ; lieu et tribu d’origine. Il m’a permis aussi d’avoir des données sur le<br />
contexte de sa vie avant et après d’un point de vue personnel, familial, économique,<br />
données un peu plus difficile à avoir pendant l’entretien surtout pour les questions<br />
économiques et personnelles de scolarisation etc. Il me permet d’avoir des données précises<br />
quant aux circonstan<strong>ce</strong>s de l’acte : qui, quand, comment, et des conséquen<strong>ce</strong>s<br />
physiques/médicales (blessure, grossesse, sida ou autre maladie sexuellement transmissible)<br />
et communautaires (réaction de l’entourage), et aussi quant à la prise en charge : par quelles<br />
structures elle est passée avant d’arriver à <strong>ce</strong>lle qui me permet d’être en contact avec elles.<br />
Comme je n’ai pas moi-même posé les questions de <strong>ce</strong> questionnaire, et que je n’ai même<br />
pas été là au moment où elles ont été posées, j’ai finalement décidé de ne pas exploiter les<br />
informations précises et objectives que procurent pourtant les réponses. Il servit donc à me<br />
rassurer quant à l’objectivité, illusoire, de ma démarche alors que le récit de vie peut lui<br />
aussi fournir des données très objectives et précises 85 au, et qui peuvent. Ce dernier offre,<br />
par ailleurs, plusieurs portes d’analyse: l’ordre dans la production du discours des<br />
évènements, les répétitions, les hésitations, les émotions, les perturbations extérieures ou<br />
intérieures. Tout <strong>ce</strong> que nous dit le langage verbal, para-verbal, extra-verbal est intéressant.<br />
Le récit de vie l’est d’autant plus dès qu’il donne lieu une production du discours libre et<br />
indépendante de l’enquêteur dans laquelle les mots, et leur ordre viennent exclusivement<br />
de l’enquêté. J’ai eu beaucoup de difficultés à analyser <strong>ce</strong>tte production discursive. Peut-<br />
84 Ibid.<br />
85 Ibid.
82<br />
être par<strong>ce</strong>-qu’ elle était constamment entravée par les barrières que passivement je<br />
construisais et par <strong>ce</strong>lles que le contexte construisait. Ce sont <strong>ce</strong>s barrières que nous allons à<br />
présent analyser.<br />
1.2 Les barrières entre moi et mes interlocutri<strong>ce</strong>s.<br />
Toutes les barrières qui se sont dressées entre mes interlocutri<strong>ce</strong>s et moi au cours de la<br />
préparation du travail de terrain n’ont pas disparues dans notre interaction pourtant plus<br />
simple.<br />
La première barrière s’est matérialisée par la présen<strong>ce</strong> d’un ou plusieurs membres du<br />
personnel associatif pendant le déroulement de tous les entretiens. Elle révélait un rapport<br />
hiérarchique ambigu entre les bénéficiaires et le personnel associatif. A l’hôpital la<br />
psychologue qui était ma référente mais aussi <strong>ce</strong>lle par qui toutes les patientes passaient dès<br />
leur arrivée insista pour faire l’interprète entre moi et les femmes, prétextant « être plus<br />
habituée » à parler avec elles que ma cousine qui aurait dû faire offi<strong>ce</strong> d’interprète. Au<br />
village, je réussis à faire en sorte que ma tante soit l’interprète, je ne voyais d’ailleurs pas<br />
comment faire autrement dans la mesure où la quasi-totalité du personnel associatif était<br />
masculin. Cependant, le membre du personnel allait et venait librement dans la salle ou je<br />
menais mes entretiens : Pour me presser à cause du temps, pour photographier l’entretien,<br />
pour m’offrir à boire, pour vérifier d’un signe de tête que tout se passait bien. Dans les deux<br />
cas ils semblaient tous vouloir contrôler ma relation avec elle, et surtout le contenu même<br />
du récit des femmes interrogées. A l’hôpital de ville, le décalage flagrant entre les paroles de<br />
mes interlocutri<strong>ce</strong>s et <strong>ce</strong>lles telles qu’elle me les avait traduites en était révélateur. Elle avait<br />
exagéré toutes les paroles qu’elles m’avaient prononcée. Je ne m’en suis rendu compte que<br />
lorsque j’ai pris le temps avec une swahiliphone de traduire mot à mot les enregistrements.<br />
J’ai beaucoup apprécié le fait qu’elle adapte mes mots à leur réalité (En swahili, le mot<br />
« psychologique » n’existe pas par exemple, mais elle a toujours trouvé des moyens pour<br />
exprimer la même idée avec « les pensées », « le cœur »). C’était par contre peu appréciable<br />
qu’elle exagère presque systématiquement les bienfaits de la structure à leur égard par<br />
exemple.
83<br />
Le problème de la langue expliquait bien sûr <strong>ce</strong>tte frontière. Si je l’avais maîtrisée, sa<br />
présen<strong>ce</strong> n’aurait pas eu lieu d’être. Je ne maitrisais pas non plus le dialecte, langue<br />
pratiquée au village. J’ai alors dut faire appel à ma tante. Il me semble que sa présen<strong>ce</strong> était<br />
un moindre mal. Ne faisant pas partie de l’association, elle n’avait aucun intérêt à exagérer<br />
les propos des unes et des autres. De plus, on remarquera que presque jamais elle ne posait<br />
des questions que je n’avais pas moi-même posée. La barrière qu’elle incarnait était donc<br />
moins visible. Au contraire, j’avais l’impression que par sa réelle appartenan<strong>ce</strong> à la culture Shi<br />
que laissait transparaître sa maîtrise de la langue et par mon appartenan<strong>ce</strong> à sa famille, elle<br />
créait un lien entre elles et moi. Il m’apparait important de préciser qu’elle est elle-même<br />
membre d’une autre association locale d’aide aux femmes vulnérables. Elle était donc<br />
habituée à mener des missions auprès de <strong>ce</strong>tte catégorie de personnes, <strong>ce</strong> qui peut être<br />
servait et desservait le bon déroulement de mon enquête. Ce problème de la langue était<br />
aussi emblématique de la question du in et du out que nous avons déjà longuement<br />
discutée. Là où mon nom de famille et mon apparen<strong>ce</strong> créaient des similarités et donc des<br />
ponts entre elles et moi, ma non-maîtrise de la langue (swahili à la ville, mashi au village) les<br />
détruisaient. Cet entre-deux de mon identité ne me semblait pas pour autant aussi pertinent<br />
qu’il avait été dans la prise de contact avec les structures associatives. En effet, dans nos<br />
échanges elles m’ont semblées beaucoup plus solliciter notre humanité commune, ma<br />
capacité à comprendre, ma capacité à écouter, ma capacité à compatir c'est-à-dire à souffrir<br />
avec elles au moment où elles me disent <strong>ce</strong>tte souffran<strong>ce</strong>, que notre éventuelle<br />
appartenan<strong>ce</strong> à une même communauté.<br />
Telles sont les conditions auxquelles et dans lesquelles elles ont pu me dire quelque-chose de<br />
<strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong> au passé et au présent.
84<br />
2. Intériorisation, extériorisation, résilien<strong>ce</strong> : la parole<br />
thérapeutique<br />
2.1 De l’impossibilité de dire<br />
L’une des raisons qu’il est possible de donner au semblant d’échec et de vanité de ma<br />
démarche qui, pourtant, me paraissait si simple et évidente, réside dans les difficultés, voire<br />
l’impossibilité de (se) dire. Dans la réalité quotidienne même de mes interlocutri<strong>ce</strong>s, leur<br />
parole est confrontée à des barrières d’ordre culturel, social ou psychologique. A combien<br />
plus forte raison <strong>ce</strong>tte parole l’a-t-elle aussi été dans la situation particulière d’échange que je<br />
leur ai, inconsciemment, imposée. L’intimité et la nouveauté des « difficultés » - pour<br />
reprendre un mot qu’elles utilisent souvent - auxquelles les violen<strong>ce</strong>s sexuelles les exposent<br />
rend problématique voire impossible l’éventuelle prise de parole de toutes <strong>ce</strong>lles qui rentrent<br />
dans les deux catégories de situation qui nous intéressent.<br />
Le degré des problèmes d’expression dépend aussi évidemment de l’identité et du<br />
fonctionnement psychique des destinataires de leur parole. Si, par exemple, leur état de<br />
santé les oblige, comme nous allons le voir, à prendre la parole devant les membres d’un<br />
personnel hospitalier, souvent masculin, et qui leur est inconnu, le degré en question sera<br />
probablement élevé. Une des différen<strong>ce</strong>s entre les deux cas de figure que nous avons<br />
rencontrées réside dans le caractère privé ou public de la violen<strong>ce</strong> subie. Dans le premier cas<br />
où elles ont été kidnappées, lorsqu’elles reviennent dans leur village, tous leurs <strong>ce</strong>rcles<br />
communautaires connaissent les grandes lignes de <strong>ce</strong> qui leur est arrivé. Dans le deuxième<br />
cas où les actes de violen<strong>ce</strong> ont été perpétrés dans le cadre privé de l’habitat, seul la famille<br />
proche, présente, le sait. Dans le premier cas, elles n’ont donc pas le choix 86 de faire savoir<br />
ou non, de rendre leur souffran<strong>ce</strong> publique ou non : elle l’est déjà. Ces villageois-e-s, plus ou<br />
moins proches, ne savent pas pour autant le détail de <strong>ce</strong> que leur voisine a vécu dans la<br />
forêt. Les autres peuvent donc savoir qu’elle a subi « des violen<strong>ce</strong>s sexuelles » mais elles ont<br />
toutefois leur liberté de dire, d’expliciter, de poser des mots sûr <strong>ce</strong> qu’elles ont subi comme<br />
violen<strong>ce</strong>s et surtout de quelles manières elles les ont vécues, <strong>ce</strong> qu’elles en ont pensé, <strong>ce</strong><br />
qu’elles en ont ressenti. Dans le deuxième cas, elles semblent encore posséder <strong>ce</strong>s deux<br />
86 La notion même de choix est bien sûr discutable dans la mesure où la caractéristique principale de l’oppression<br />
c’est l’absen<strong>ce</strong> de choix. Mais elle n’est pas au cœur de notre propos ici.
85<br />
libertés-là. Cela explique pourquoi, à ma grande surprise, il ne s’agissait que d’une première<br />
ou deuxième prise de parole vis-à-vis de <strong>ce</strong>tte violen<strong>ce</strong> subie pour les cinq dernières filles<br />
que j’ai rencontrées au village. Nous verrons un peu plus loin les circonstan<strong>ce</strong>s dans<br />
lesquelles leur choix est finalement limité, leur liberté restreinte - lorsque leur vie est en<br />
danger par exemple. Nous tenterons aussi de décliner les potentiels destinataires de leur<br />
parole lorsqu’elles brisent, de gré ou de for<strong>ce</strong>, leur silen<strong>ce</strong>. La solitude et le silen<strong>ce</strong><br />
conséquent constitue donc une, si <strong>ce</strong> n’est pas la première et parfois éternelle, des phases<br />
par lesquelles mes interlocutri<strong>ce</strong>s sont passées. Sophie, rencontrée à l’hôpital de Panzi m’a<br />
décrit ainsi sa vie lorsqu’elle était encore au village :<br />
« C’était comme si je ne pouvais pas m’assoir parmi les personnes. Je reste dans une pla<strong>ce</strong> où<br />
je suis seule. Je reste, soit dans la maison. Je reste seulement là-dedans, pour sortir dedans là<br />
j’ai honte ».<br />
Il est probable que la raison pour laquelle elle doit s’isoler soit liée au regard des autres et<br />
aux odeurs que généraient les problèmes génitaux rencontrés à la suite des actes de<br />
violen<strong>ce</strong>. Il est aussi probable que son isolement soit un mécanisme conscient ou inconscient<br />
de défense. En effet, la parole met des mots sur et donc donne vie au conflit interne. Elle<br />
permet une revivis<strong>ce</strong>n<strong>ce</strong> de l’expérien<strong>ce</strong> vécue. L’isolement protège du retour potentiel de <strong>ce</strong><br />
qui a été refoulé 87 . Mais sa solitude est réelle et l’empêche d’instaurer un véritable dialogue<br />
avec qui que <strong>ce</strong> soit. De même, Anne passait au début, juste après le viol qu’elle a subit,<br />
beaucoup de temps seule. Cultivatri<strong>ce</strong>, elle a trouvé dans les champs, et non pas à la maison<br />
comme Sophie, un refuge :<br />
« Avant, je fuyais les gens. Je fuyais les gens, j’allais dans mon champ seulement au lieu<br />
d’aller à la messe. »<br />
La messe est un des lieux de socialisation au village. Anne a donc dans un premier temps,<br />
évité toute possibilité d’échange. Pour <strong>ce</strong>lles qui n’ont pas ainsi explicité leur condamnation<br />
à l’isolement et donc au silen<strong>ce</strong>, elles me laissaient entrevoir dans <strong>ce</strong> qu’elles ne disaient pas<br />
et dans la difficulté même à dire mot, des mécanismes d’isolement similaires. Le facteur<br />
principal d’isolement volontaire ou involontaire, conscient ou inconscient et d’enfermement<br />
de la parole à l’intérieur de soi est la honte, <strong>ce</strong> sentiment de gêne ou de confusion provoqué<br />
87 Il s’agit du « retour du refoulé » selon la psychanalyse freudienne.
86<br />
par une crainte réelle ou imaginaire de perte d'honneur. Certaines analyses évoquent<br />
également la peur des représailles. Il me semble que si peur il y a, dans les cas que j’ai<br />
rencontrés c’est plutôt <strong>ce</strong>lle du regard des autres et de la perte de la « dignité », conférée par<br />
le regard d’autrui, mais qui est également réflexive, donc aussi dans leur propre regard sur<br />
elles-mêmes. C’est <strong>ce</strong>tte dignité qui les constitue en tant que femmes. Nous avons déjà vu <strong>ce</strong><br />
à quoi est lié, entre autres, l’identité d’une femme dans la culture shi : la virginité avant le<br />
mariage, la fidélité, la maternité. N’importe quel type de violen<strong>ce</strong>s sexuelles, mais peut-être<br />
encore plus particulièrement le viol, prive la femme qui le subit d’au moins une de <strong>ce</strong>s<br />
« vertus ». Je ne sais toujours pas <strong>ce</strong> qui est le plus pertinent socialement pour la femme<br />
victime de <strong>ce</strong>tte honte sociale et pas seulement des actes de violen<strong>ce</strong> subis : perdre sa<br />
dignité, son honneur dans ses propres yeux ou dans <strong>ce</strong>ux des autres ? A première vue, le<br />
regard des autres serait premier. En effet, <strong>ce</strong> sont les autres qui renvoient à mes<br />
interlocutri<strong>ce</strong>s et une image indigne d’elles-mêmes – comme nous le verrons. Cependant, la<br />
seule femme qui est parvenue à m’expliquer sa notion de la dignité et du déshonneur le<br />
rapportait à son propre regard, et l’expliquait par rapport à l’exclusivité sexuelle bafouée<br />
qu’elle doit pourtant à son mari, à qui elle est mariée depuis qu’elle a ses 13 ans. Il s’agit de<br />
Rachel, 35 ans.<br />
Peut-être qu’au-delà de la honte, leur prise de parole est bloquée par une véritable<br />
indicibilité au sein de laquelle le dire ne se négocie pas. Il apparaît clairement que la réalité<br />
de <strong>ce</strong> qu’elles ont vécu dans la « forêt » ou dans le <strong>ce</strong>rcle plus intime et privé de la maison, a<br />
dépassé les frontières de « l’inhumanité », au sens où leur expérien<strong>ce</strong> est étrangère à tout <strong>ce</strong><br />
que leur vie sur terre les a habituées. Mais même <strong>ce</strong>tte « inhumanité », elles arrivent à peine<br />
à la formuler. La difficulté est donc encore plus grande et plus radicale s’il avait s’agit de<br />
l’expliciter. Lorsque je demande à Sophie de m’expliquer ses sentiments, juste après son<br />
retour de la forêt, elle me répond :<br />
« Donc <strong>ce</strong> que je ressentais était confus. Je me demande si je suis dans le monde, si je suis<br />
chez les hommes, si je ne suis plus chez les hommes. J’étais seulement au milieu. »<br />
Beaucoup d’entre elles, Lydia par exemple, auraient préféré la mort à tout <strong>ce</strong> qu’elles<br />
enduraient dans la forêt.
87<br />
Ce qu’elles ont vécu apparaît comme trop inhumain pour franchir les limites du dicible. Si le<br />
dicible est <strong>ce</strong> qui caractérise notre humanité alors devant un acte in-humain, il est impossible<br />
d’en dire quoi que <strong>ce</strong> soit. Peut-être leur est-il possible de dire à <strong>ce</strong>lles qui ont vécu une<br />
expérien<strong>ce</strong> similaire, mais ont-elles alors vraiment besoin de mots pour se faire comprendre<br />
les unes les autres <strong>ce</strong> qu’elles ont enduré ? C’est peut-être pour <strong>ce</strong>s raisons qu’elles restent<br />
dans l’indéfini de « la forêt » par exemple. La réalité exacte de <strong>ce</strong> qui se cache derrière <strong>ce</strong><br />
mot apparait comme indicible.<br />
2.2 L’intériorisation et ses effets<br />
Ce sentiment de honte et <strong>ce</strong>tte indicibilité les for<strong>ce</strong> à intérioriser une souffran<strong>ce</strong> qu’elles<br />
auraient pourtant, peut-être, plus intérêt à extérioriser. Le silen<strong>ce</strong> auquel elles se<br />
condamnent, de con<strong>ce</strong>rt avec la société qui les entoure, est à l’origine d’une des souffran<strong>ce</strong>s<br />
qu’elles endurent, parfois même inconsciemment. Toute l’argumentation qui suit s’inspire de<br />
deux ouvrages, Etudes sur l’hystérie de Freud, et Quand dire c’est faire d’Austin, et surtout de<br />
l’article très intéressant de Marie Guillot, « Wittgenstein, Freud, Austin : voix thérapeutique<br />
et parole performative ». Mon utilisation d’écrits du père de la psychanalyse et de<br />
philosophes du langage peut surprendre dans un mémoire de socio-anthropologie. Un arrêt,<br />
même succinct, sur <strong>ce</strong> qu’ils m’ont appris sur la parole m’est apparu <strong>ce</strong>pendant né<strong>ce</strong>ssaire<br />
dès lors que la question du dit et du non-dit s’est imposée d’une manière aussi claire dans la<br />
compréhension de mon sujet. Il me paraît tout de même important de préciser que<br />
j’envisage <strong>ce</strong>t arrêt comme un premier pas pour mieux analyser ensuite les conséquen<strong>ce</strong>s<br />
sociales de leur choix ou simple capacité de dire ou de ne pas dire. Marie Guillot permet à la<br />
performativité austinienne de la parole de faire deux pas de plus. Elle démontre qu’il est<br />
possible de donner à <strong>ce</strong>tte parole le pouvoir, non seulement de faire (Austin), mais aussi de<br />
dé-faire les troubles psychologiques (Freud) et philosophiques (Wittgenstein). La parole<br />
aurait donc des vertus thérapeutiques. C’est le soin des troubles psychologiques qui va nous<br />
intéresser ici. Dans le cas qui nous con<strong>ce</strong>rne, lorsque, de gré ou de for<strong>ce</strong>, les femmes victimes<br />
de violen<strong>ce</strong>s ici sexuelles emprisonnent leur souffran<strong>ce</strong>, consciente ou inconsciente, dans le<br />
silen<strong>ce</strong>, elles peuvent s’exposer à une autre souffran<strong>ce</strong>, à un autre mal.<br />
« Le mal n’est pas l’affect en lui-même, mais la privation d’une expression adéquate, propre à<br />
rétablir la balan<strong>ce</strong> intérieure par une décharge suffisante d’énergie. Le refoulement qui
88<br />
frappe <strong>ce</strong>rtaines émotions trop violentes, impossibles à assumer, en interdit du même coup<br />
la manifestation naturelle (…) et les transforme en un fardeau psychique bientôt sour<strong>ce</strong> de<br />
troubles. Le sentiment réprimé torture d’autant plus cruellement l’esprit qu’il le fait dans<br />
l’ombre, sans risque d’être surpris et chassé. »<br />
L’intériorisation, le refoulement, le silen<strong>ce</strong>, corollaires les uns des autres ne permettent pas<br />
aux émotions de se rééquilibrer, au « conflit interne » de se résoudre. Les troubles qui s’en<br />
suivent alors peuvent s’exprimer de manière plus ou moins inattendue. Il s’agit des<br />
symptômes du syndrome post-traumatique que m’ont énumérés tous les acteurs associatifs<br />
qui s’occupaient de la prise en charge psychologique des victimes, la psychologue de l’hôpital<br />
Panzi qui m’était attitrée, en a énuméré une partie au détour d’une question. J’interrogeais<br />
Liza sur les effets « dans son corps » et « dans ses pensées », c'est-à-dire corporels et<br />
psychiques de <strong>ce</strong> qu’elle venait tout juste subir.<br />
« Au moment où tu venais des champs, après avoir subi <strong>ce</strong>t acte, quand tu es rentrée chez toi,<br />
qu’est-<strong>ce</strong> que tu ressentais ? Dans le corps par exemple, est-<strong>ce</strong> que tu as ressenti un<br />
tremblement, de la peur ou des sueurs ? Ou une faiblesse, comme si tu avais perdu<br />
connaissan<strong>ce</strong> ? Ou est-<strong>ce</strong> que ton cœur s’est affaibli, comme s’il s’arrêtait ? » (la psychologue)<br />
Les tremblements, les sueurs, les pertes de connaissan<strong>ce</strong>, les baisses de tension font donc<br />
vraisemblablement partie de <strong>ce</strong>s symptômes.<br />
De même, lorsque j’interroge Elodie sur ses sentiments et ses pensées à la suite du viol et<br />
avant la rencontre avec les gens de l’association, elle ne m’en dit rien. Par contre elle me dit<br />
<strong>ce</strong> qui s’est passé dans son corps, comme si un transfert c’était opéré de son cœur à son<br />
corps<br />
- A <strong>ce</strong> moment-là, avant de rencontrer maman Ange, comment tu te sentais ?<br />
- Beaucoup de vertiges, et la tête commençait à me faire mal, et je me grattais le<br />
Corps. »<br />
«Les vertiges » font partie des symptômes du syndrome.<br />
La même psychologue a évoqué le cas d’une patiente qui, une fois revenue de « la forêt », ne<br />
parlait plus à personne, le regard dans le vide. Il s’agissait là peut-être d’une autre pathologie
89<br />
liée au traumatisme vécu. Les seuls sons qui sortaient de sa bouche étaient des cris qui<br />
avertissaient de l’arrivée des soldats. C’est comme si elle était hantée par le souvenir du jour<br />
où les soldats sont effectivement venus la chercher.<br />
Les pensées, les sentiments, les émotions qu’on intériorise semblent donc être condamnées<br />
à s’exprimer malgré tout par des voies insoupçonnées, telles les voies corporelles. Il est donc<br />
né<strong>ce</strong>ssaire de trouver une alternative énonciatri<strong>ce</strong>, éventuellement dans la prise de parole, à<br />
<strong>ce</strong>tte intériorisation. C’est le rôle, en psychanalyse de l’entretien analytique. Cependant, il<br />
peut revêtir d’autres formes, dans d’autres cadres, plus adaptés de socialisation. Nous les<br />
verrons un peu plus loin.<br />
2.3 <strong>Dire</strong> <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong>, revivre <strong>ce</strong> qu’elles disent : la parole thérapeutique.<br />
Il apparaît comme né<strong>ce</strong>ssaire à la personne qui subit le type de traumatisme associé aux<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles d’extérioriser par la parole (ou autre chose) plutôt que d’intérioriser <strong>ce</strong><br />
qu’elle vit. La contemporanéité de la réalité de la violen<strong>ce</strong> vécue par mes interlocutri<strong>ce</strong>s, telle<br />
que nous l’avons évoquée dans l’introduction, ne réside pas seulement dans la proximité ou<br />
l’éloignement temporel de leur expérien<strong>ce</strong>. Elle réside aussi dans la performativité de leur<br />
parole. Au moment où elles essayent de dire leur réalité, elles peuvent la revivre, ipso facto.<br />
« Freud avait compris, dès les premiers balbutiements de la psychanalyse, que la disparition<br />
des pathologies psychiques reposait sur un <strong>ce</strong>rtain mode du discours : <strong>ce</strong>lui par lequel le<br />
patient, en formulant ses maux, en prenait subitement conscien<strong>ce</strong> et s’en détachait aussitôt<br />
[…]. L’acte thérapeutique repose entièrement sur un dire… » (Marie Guillot)<br />
Mais <strong>ce</strong> dire, <strong>ce</strong>tte formulation peut pas se contenter de constater, il devrait éventuellement<br />
être le véhicule d’une puissan<strong>ce</strong> émotionnelle vitale de manière à <strong>ce</strong> qu’au moment de dire,<br />
la personne éprouve pleinement l’émotion du souvenir du traumatisme ou du traumatisme,<br />
c'est-à-dire qu’elle la vive. Dans le verbe, dans la parole, se trouvent donc « le mal et [/ou] le<br />
remède » car elle doit permettre de faire vivre de nouveau <strong>ce</strong> qu’elle a probablement enfoui<br />
(refoulé), de souffrir, pour parvenir, peut-être, à guérir. Les tra<strong>ce</strong>s du couple dire et vivre se<br />
retrouvent dans beaucoup de mes entretiens notamment à travers l’alternan<strong>ce</strong> peut-être<br />
aléatoire entre le « je » et « il » ou entre le « nous » et « vous », à travers les changements<br />
aussi, peut-être, aléatoire de temps (présent contre passé par exemple). Je choisis de
90<br />
prendre l’exemple discursif de Laura. Ainsi évoque-t-elle le moment où elle s’est échappée<br />
des mains de ses ravisseurs :<br />
« Nous sommes entrés dans le village à 21h pour piller, et je me suis retrouvée d’un côté et<br />
ma copine de l’autre côté. Mieux vaut que je m’en aille. Même s’il faut que je me perde. Je<br />
veux rentrer chez moi. C’est ainsi que je me suis évadée. J’ai laissé le colis et je me suis<br />
enfuie »<br />
Tout son récit est au passé. Seulement au moment où elle exprime les pensées qui ont<br />
traversé sa tête à <strong>ce</strong> moment-clé de sa vie, elle passe au présent, comme l’indique les verbes<br />
en gras. Au moment où elle me dit <strong>ce</strong> qui s’est passé (et alors même que je ne lui ai<br />
demandé que les faits – elles sont pourtant rares à me dire plus ou autre chose que <strong>ce</strong> que je<br />
leur demande), les faits restent lointains (au moins dans le passé) mais ses pensées<br />
intérieures (ici, soulignées) surgissent dans le présent de sa parole. C’est donc la preuve<br />
qu’elle revit, en pensée, <strong>ce</strong> qu’elle a vécu. Plus précisément elle revit la volonté de vivre,<br />
l’instinct de survie qui a animée son action (l’évasion).<br />
Sophie nous relate ainsi la nuit où elle a été enlevée de chez elle :<br />
« C’était la nuit, nous dormions. C’est à <strong>ce</strong> moment que les Interahamwés sont arrivés à la<br />
maison, la nuit. Quand ils sont arrivés à la maison, j’étais chez mon oncle. Quand ils sont<br />
arrivés à la maison, ils ont surgi en pleine nuit. Et c’est comme ça qu’ils sont arrivés, ils m’ont<br />
emmenée, et ils ont emmené aussi mon oncle. Et on a couru. La femme de mon oncle est<br />
partie dans une autre direction. Et moi et mon oncle, ils nous ont pris. C’est comme ça que<br />
nous sommes partis là-bas. Ils m’ont violée [kubaka/violer], et ils m’ont laissée là-bas deux<br />
mois. Je suis rentrée avec une grossesse. C’est comme ça que j’ai accouché, l’enfant est arrivé<br />
mort. La grossesse a donc évolué au village. Je suis restée au village alors qu’ils avaient déjà<br />
pris mon oncle. Il était toujours là-bas dans la forêt. Ils lui avaient déjà coupé les jambes et<br />
les bras. Ils lui avaient coupé le sexe. Et ils lui ont percé les yeux. Et il est là-bas dans la forêt.<br />
Je suis restée chez tate 88 . Je n’ai pas su où ma maman et les autres avaient fui. Chacun avait<br />
fui dans sa direction. C’est alors qu’ils ont égorgé mon oncle. Ils l’ont attaché à un arbre. Et<br />
moi, ils m’avaient déjà violée. Et j’ai déjà leur grossesse. Ils l’ont alors égorgé. La journée. Ils<br />
l’ont égorgé, et ils l’ont laissé là-bas. »<br />
88 Grand-parent
91<br />
Bien qu’elle ait vraisemblablement l’habitude de dire <strong>ce</strong>tte histoire (elle est à l’hôpital depuis<br />
2001) aux nombreux visiteurs et visiteuses de l’hôpital, elle continue à revivre <strong>ce</strong> qu’elle dit,<br />
peut-être d’une autre manière. Au gré du récit, la mort de son oncle et <strong>ce</strong> qu’elle semble<br />
vivre comme un abandon 89 , par exemple, se disent avec la distan<strong>ce</strong> du temps (première<br />
phrase en gras) ou avec la violen<strong>ce</strong> du présent (deuxième verbe en gras).<br />
Au village, <strong>ce</strong> ravivement du présent s’est fait plus explicite au cours d’un de mes entretiens :<br />
une autre de mes interlocutri<strong>ce</strong>s m’a reprochée de lui faire revivre un mal qu’elle essayait<br />
probablement d’oublier, qu’elle avait probablement intériorisé – Elodie. Il s’agit peut-être<br />
aussi d’un mécanisme de défense : pour éviter de remettre à jour <strong>ce</strong> conflit qui la ronge,<br />
pour éviter le « retour du refoulé », elle préfère mettre <strong>ce</strong>tte distan<strong>ce</strong> avec moi.<br />
Dans <strong>ce</strong>s conditions, j’ai souvent, au cours de mon séjour, interrogé la légitimité de mon<br />
enquête : valait-elle toutes <strong>ce</strong>s souffran<strong>ce</strong>s ravivées ? Mais dans le couple dire/vivre, se<br />
trouve <strong>ce</strong> mal mais aussi, éventuellement, le remède. En effet, <strong>ce</strong>tte souffran<strong>ce</strong> revécue au<br />
présent serait comme un mal né<strong>ce</strong>ssaire à la pleine guérison de la victime, si elle est<br />
possible.<br />
« La simple expression des troubles suffit à provoquer la délivran<strong>ce</strong> : la description des<br />
symptômes et de leurs causes n’est pas comme en médecine un préalable à la guérison, elle<br />
est la méthode de guérison. Le discours (…) effectue la thérapie. Le langage soigne ses<br />
propres maux par les mots » (Marie Guillot)<br />
Plus la parole est spontanée et violente, car reflet de l’inconscient, plus elle accomplira son<br />
potentiel curatif car « la parole libératri<strong>ce</strong> est toujours radicalement créatri<strong>ce</strong>, violente et<br />
inattendue, condition indispensable de son succès puisqu’il lui faut saisir la pensée<br />
lorsqu’elle n’est pas sur ses gardes, de manière à vaincre les résistan<strong>ce</strong>s par surprise, sans<br />
qu’elles puissent anticiper l’attaque. ». C’est un mécanisme que l’on retrouve dans la tragédie<br />
grecque par exemple, avec le pouvoir cathartique (purificateur) de la parole.<br />
C’est autour de <strong>ce</strong> principe que se cristallisent tous les « volets psychologiques » des<br />
associations que j’ai pu rencontrer. L’existen<strong>ce</strong> même d’un volet psychologique reflète leur<br />
89 Elle l’aurait abandonné dans la forêt, alors qu’il était, vraisemblablement déjà mort
92<br />
lien avec un organisme international de finan<strong>ce</strong>ment ou de formation. Les séan<strong>ce</strong>s d’écoute<br />
individuelle, d’écoute collective, ou encore de counselling sont <strong>ce</strong> que <strong>ce</strong>s volets tentent<br />
d’offrir aux éventuels bénéficiaires. Ces prestations rencontrent plus ou moins de succès<br />
selon le bénéficiaire en fait. Au cours de mes entretiens, j’ai été confrontée que deux fois<br />
(avec Liza et Rachel) au glissement du mal vers le remède apparent de « dire ». Je ne peux<br />
pas dire si la parole qu’elles m’ont adressée a vraiment été thérapeutique, mais j’ai senti dans<br />
le non-dit de notre interaction que quelque chose de leur libération, intérieure et verbale, se<br />
jouait et constituait une étape peut-être décisive pour un éventuel mieux-être.<br />
Con<strong>ce</strong>rnant Rachel s’il est une chose dont on peut difficilement douter à la lecture de ses<br />
entretiens c’est de son visible besoin de parler. Pour obtenir le récit de sa vie, nous sommes<br />
finalement intervenus que très peu. Il arrivait souvent qu’elle reprenne son récit, parfois là<br />
où elle l’avait laissée, sans besoin d’être relancée. Il est possible de trouver une explication au<br />
délitement de sa parole dans l’absen<strong>ce</strong> de prestations de servi<strong>ce</strong> d’écoute depuis son arrivée.<br />
Les médecins se sont effectivement préoccupés de l’état de sa santé mais si peu de son été<br />
psychique. Le flot de sa parole, qui se cherchait encore, était impressionnant. Il est possible<br />
de l’expliquer par la recherche inconsciente de son conflit interne, comme nous l’avons vu.<br />
Cependant Veronique Nahoum-Grappe nous offre une autre éventuelle explication : Il y<br />
aurait une autre barrière discursive peut-être moins consciente que <strong>ce</strong>lles explorées plus<br />
haut : <strong>ce</strong>lle qu’elles dressent entre elles-mêmes et la souffran<strong>ce</strong> qu’elles ont vécues, peutêtre<br />
pour la rendre plus supportable. Au cours d’un entretien avec la revue « Clio »,<br />
Véronique Nahoum-Grappe évoque l’idée de « récit-écran » pour les hommes, plus<br />
nombreux qu’on ne le croit, qui ont subi des tortures sexuelles. Mais <strong>ce</strong> mécanisme est tout<br />
autant valable pour les femmes.<br />
« Ils [et elles] évitent d’en parler par<strong>ce</strong>-que la torture avilit et que le témoignage<br />
expose à nouveau <strong>ce</strong>t avilissement. Quand les gens arrivent au camp de réfugiés, il y<br />
a un moment terrible où ils n’ont pas encore construit un récit-carapa<strong>ce</strong> pour se<br />
protéger ; on peut alors recueillir le témoignage. Puis, tragiquement déstabilisés par
93<br />
<strong>ce</strong> qui leur est arrivé, ils s’inventent un récit-écran et il faut passer des heures avec<br />
eux, il faut peut-être boire ensemble, pour obtenir le vrai récit » 90 .<br />
Dans l’hôpital qui fait parfois aussi offi<strong>ce</strong> de camp pour femmes déplacées ayant été victimes<br />
de violen<strong>ce</strong>s sexuelles, les femmes ont tellement racontée leur histoire que la construction<br />
de <strong>ce</strong> « récit-écran » est inévitable. Mais sur les six interviewées, cinq venaient d’arriver dans<br />
les 6 mois qui précédaient notre rencontre le récit-écran était donc peut-être au stade de sa<br />
construction. Sophie, dont nous avons déjà analysé le récit de son enlèvement, semble<br />
m’avoir fourni un « récit-écran ». Cela ne l’a pas empêché pour autant de revivre<br />
sporadiquement quelques passages de son récit. Comme si il n’était jamais vraiment<br />
possible de mettre à une complète distan<strong>ce</strong> <strong>ce</strong> genre de souffran<strong>ce</strong>. Seulement une m’a<br />
donné l’impression de ne pas me fournir de récit-écran ou formaté par quelque système<br />
informel de don-contre-don : Rachel. Elle était là depuis une semaine, et racontait son récit<br />
pour la première ou deuxième semble-t-il car les soins médicaux avaient été prioritaires sur<br />
les soins psychologiques. Comme il est possible de remarquer dans l’entretien retranscrit en<br />
annexe, peu de questions lui sont posées, mais ses réponses sont très longues, une de ses<br />
réponses atteint deux pages. Elle semble ressentir le besoin de parler, quitte à vivre de<br />
nouveau par la parole <strong>ce</strong> qu’elle a vécu. Elle semble ne pas encore avoir mis en pla<strong>ce</strong> de<br />
mécanisme de défense. Les évènements qui sont venus perturber sa vie ont eu lieu dans les<br />
semaines précédentes.<br />
2.4 Le refus de parler : la parole coercitive ?<br />
Peut-être justement pour éviter de revivre <strong>ce</strong> qu’elles disent, au risque de se confronter aux<br />
dangers que nous avons évoqué, il arrive qu’au contraire elles refusent plus ou moins<br />
ouvertement le dialogue. La parole qu’elles me délivrent alors est clairement coercitive. Il<br />
est possible de prendre l’exemple de Violette, à l’hôpital. Son attitude (verbale) est<br />
différente de toutes ses « semblables » de l’hôpital. Il semblerait que pour se défendre des<br />
souffran<strong>ce</strong>s inhérentes à la mise en mot de <strong>ce</strong> son vécu, elle adopte la stratégie de<br />
l’évitement : Elle ne répond que par oui, non ou par des phrases simples aux questions qu’on<br />
lui pose, là où d’autres donnent un récit détaillé. Elle n’a vraisemblablement pas envie de<br />
90 Notes de la rédaction, Véronique Nahoum-Grappe, « La purification ethnique et les viols systématiques. Ex-<br />
Yogoslavie 1991-1995 », Clio, numéro 5-1997, Guerres civiles, [en ligne], mis en ligne le 01 janvier 2005.<br />
URL : http://clio.revues.org/index416.htlm . Consulté le 17 juillet 2010.
94<br />
parler, et encore moins de <strong>ce</strong> qu’elle a vécue pendant six mois à la forêt. Comme elle le dit<br />
plus loin : elle l’a « jeté derrière » elle. Peut-être pressentait-elle qu’elle allait revivre en<br />
pensée <strong>ce</strong> qu’elle allait dire, si elle choisissait de nous le dire. En effet, les rares paroles que<br />
nous avons réussi à lui faire dire sur les conditions dans lesquelles elle a vécu <strong>ce</strong>s violen<strong>ce</strong>s,<br />
elle passe du passé au présent, du discours narratif au discours direct facilement :<br />
« Ils me frappaient, vas vite, cours vite, tu veux mourir en cours de route alors qu’on n’est<br />
pas encore arrivé ? Et quand je suis arrivée, c'est là qu'ils m’ont violée… »<br />
Elle semble réentendre les paroles prononcées par ses ravisseurs, au moment où elle nous<br />
les fait entendre. On peut alors comprendre qu’au moment où on lui demande explicitement<br />
de parler <strong>ce</strong> qui est venu « abîmer sa vie » (j’avais utilisé le mot perturber), elle ne veuille<br />
pas en parler et évoque tous ses malheurs, sauf <strong>ce</strong>lui de son enlèvement. Il est alors possible<br />
de penser que son enlèvement et les violen<strong>ce</strong>s consécutives sont moins significatives pour<br />
elle que ses autres malheurs en question (la maladie de sa mère par exemple). A la lumière<br />
des réponses qu’elle donne aux autres questions, il semblerait que les deux interprétations<br />
soient possibles. Elle n’a aussi, plus simplement, pas envie de parler de <strong>ce</strong>t enlèvement :<br />
« … Là où vous vivez là-bas, les membres de ta famille disent du mal de ta maman?<br />
- oui<br />
- Donc tu n’es pas proche d'eux, toi?<br />
- non<br />
- Bon tu vivais bien avec tes parents, avec ta maman et ton papa, vous alliez au champ, vous étiez affairés. Qu'est-<strong>ce</strong> qui est<br />
venu perturber la vie avec tes parents quand tu allais au champ ? La vie que tu menais, qu'est-<strong>ce</strong> qui est venu abîmer <strong>ce</strong>tte<br />
vie?<br />
- Rien. On allait juste au champ. Si on récolte le manioc, on enlève la peau. Si on récolte les<br />
haricots, on prépare ou on met dans le sac. On vivait juste comme ça.<br />
- Oui, c'est ça, c'était une belle vie que vous meniez, et quelque-chose est arrivé, pour que la famille doive s'éparpiller comme<br />
on l’a vu, quelque-chose est arrivé, quelle nouvelle est arrivée pour que <strong>ce</strong>tte vie que vous meniez au champ, où vous alliez<br />
tranquillement chercher la nourriture, soit abîmée, pour que la vie que vous meniez soit abimée ?<br />
- Même à présent, elle est déjà abimée, par<strong>ce</strong>-que maman est devenue vieille, elle n'a même<br />
pas la for<strong>ce</strong> de cultiver. Elle a déjà laissé <strong>ce</strong>s champs.<br />
- Quelle chose a alors abîmé ta vie à toi?<br />
- Quelle chose? Mais les Interahamwés m'ont emmenée !
95<br />
- c'est <strong>ce</strong> qu'on veut que tu nous dises.<br />
- aahh [rires] Les Interahamwés m'ont emmené. J’y ai passé 6 mois là-bas. Et c'est à <strong>ce</strong><br />
moment-là que maman a eu la tension.<br />
- Maman a eu la tension, elle a fait quoi?<br />
- Elle est devenue malade / Par<strong>ce</strong>-que je suis restée toute seule et papa est mort. Et c'est pour<br />
<strong>ce</strong>la qu'elle a eu la tension. Elle seule au champ, elle ne cultive même pas.<br />
- Maintenant, le jour où les Interahamwés sont venus. C'était la nuit, c'était le jour? Qu’est-<strong>ce</strong> que tu faisais?<br />
- C'était la nuit, minuit.<br />
- Et qu'est-<strong>ce</strong> que vous faisiez?<br />
- Bah j'étais en train de dormir [rires]<br />
- Ou est-<strong>ce</strong> qu'on t’a emmenée?<br />
- Moi? Là où ils demeurent.<br />
- C'est où?<br />
- Dans la forêt<br />
- Le chemin était long, tu as pu marcher, pendant combien de temps, pendant combien de jours?<br />
- Trois jours.<br />
- La nuit et le jour vous marchiez?<br />
- oui »<br />
Elle ne semble pas vouloir me donner plus de précisions que le oui ou le non profèrent, elle<br />
ne semble pas vouloir préciser <strong>ce</strong> qui s’est passé « là où ils demeurent », « dans la forêt ».<br />
Elle reste volontairement dans le flou. C’est <strong>ce</strong> genre de réponses très brèves que j’ai<br />
retrouvé presque systématiquement au sein de l’association du village, dès lors que<br />
j’abordais la question du viol. Elles m’ont données que très peu de détails quant à la manière<br />
dont <strong>ce</strong>la s’est passé. Ce n’était vraisemblablement pas lié à l’habitude de dire ou pas. Cinq<br />
années étaient déjà passées mais il s’agissait de la première ou deuxième fois qu’elles<br />
délivraient leur témoignage. Alors pour faire écran à leur souffran<strong>ce</strong>, il me semble qu’elles<br />
l’avaient enfouies, intériorisées, si bien qu’elles ne pouvaient la dire que par un récit miné<br />
par les pleurs (Emmanuelle), des réactions corporelles que je n’avais pas prévu (Tension,<br />
palpitation pour Elodie), non-dits (absen<strong>ce</strong> de réponse) sur les faits et leur souffran<strong>ce</strong><br />
corollaire qu’elles ne voulaient pas raviver. Ce refus se manifestait aussi, comme avec<br />
Violette, par des réponses courtes à des questions qui en appelaient pourtant des longues
96<br />
Est-<strong>ce</strong> vraiment un mécanisme de défense vis-à-vis d’une souffran<strong>ce</strong> que l’on veut éloigner ?<br />
Ou alors est-<strong>ce</strong> le fruit de <strong>ce</strong>tte situation coercitive dans laquelle, pour des raisons qui<br />
m’échappaient, l’association les avait confrontées ? Ou encore, le refus de parler était-il tout<br />
simplement lié à la violen<strong>ce</strong> symbolique qu’exerçait un système occidental d’appréhension<br />
de la pensée et des sentiments par la parole complétement étranger à leur propre système<br />
culturel ? En effet, le rapport traditionnel de la femme Shi à la parole est compliqué : Elle n’a<br />
aucun droit en termes d’expression public, surtout en présen<strong>ce</strong> de son mari. De plus, elle n’a<br />
pas le droit de transgresser les tabous de la société et de la culture 91 . A combien plus forte<br />
raison conservera-t-elle à l’intérieure d’elle-même un tabou qu’elle avait pourtant ellemême<br />
involontairement transgresser ?<br />
91 Esther Tabu Kabwanda, Emancipation de la femme : œuvre de l’évangile de Jésus-Christ essai d’exégèse de<br />
Luc 8 :43-48, mémoire de graduat en théologie, Institut Supérieur deThéologie Evangélique, 1992
98<br />
3. le dire de l’entre-soi : la parole urbaine des déplacées<br />
Il est alors possible de penser que c’est sa proximité géographique avec les membres de la<br />
société qui impose <strong>ce</strong>s tabous qui influen<strong>ce</strong> de manière sociologiquement pertinente sur la<br />
possibilité et la volonté de dire ou pas. Nous avons déjà dressé l’opposition entre la parole<br />
urbaine et la parole rurale. Au village, les femmes ne disaient rien de la violen<strong>ce</strong> qu’elles<br />
avaient subi. Au mieux disaient-elles, toujours indirectement (« la forêt », toujours) qu’elles<br />
l’avaient vécue. A la ville, elles étaient libérées du poids du regard de la société par<br />
l’anonymat et la « banalisation » de leur situation 92 dans la ville ou par la présen<strong>ce</strong> de<br />
« semblables » rassemblées dans <strong>ce</strong> qui ressemblait pourtant à un village. Je me suis d’abord<br />
confrontée à l’anonymat et à la banalisation discursive, alors que j’étais à la recherche d’une<br />
réalité effective. Vraisemblablement, elle m’échappait. Je n’arrivais pas à la palper. Lorsque<br />
j’avais déjà fait le tour de quelques-unes des associations spécialisées dans l’action pour (et<br />
je pensais aussi par) <strong>ce</strong>s femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles parmi la <strong>ce</strong>ntaine existante<br />
et basée à Bukavu, je n’avais eu droit qu’à des chiffres, des rapports de mission très froids,<br />
des récits d’action, des discours visiblement formatés et très distants de directeurs (des<br />
hommes, toujours) d’associations pour les femmes pourtant qui semblaient plus préoccupés<br />
par les possibilités de finan<strong>ce</strong>ment que par l’utilité de leur action, des mots désincarnés.<br />
Seulement une fois, je me suis confrontée à une directri<strong>ce</strong> dont la préoccupation première<br />
semblait être la santé mentale des victimes que son association prenait en charge, et qui<br />
semblait vraiment être affectée par la réalité de <strong>ce</strong>s victimes. Je cru d’abord que je m’étais<br />
trompée : Le terrain n’était pas ou je pensais qu’il était c'est-à-dire dans la ville même de<br />
Bukavu. Le dépla<strong>ce</strong>ment que je venais de faire de Paris à Bukavu n’était alors pas suffisant<br />
en soi. Si je voulais me confronter à « la réalité du terrain » il fallait me dépla<strong>ce</strong>r à nouveau –<br />
au village, n’importe lequel, sauf sur le territoire d’Idjwi, seul espa<strong>ce</strong> apparemment préservé<br />
de <strong>ce</strong> phénomène car <strong>ce</strong>ntral, insulaire, et difficilement ac<strong>ce</strong>ssible. C’était là, au village, que<br />
tout s’était passé et se passait toujours. Il y avait des actions de violen<strong>ce</strong>s sexuelles à la ville<br />
mais elles étaient plutôt civiles n’étaient pas organisées. Des actes militaires de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles avaient déjà eu lieu à la ville mais de manière ponctuelle. Une autre difficulté<br />
géographique se posait alors à moi. Le village était <strong>ce</strong>rtes plus proche de Bukavu que Bukavu<br />
92 Voir chapitre 1, 1.4.
99<br />
de Paris mais peut-être encore moins ac<strong>ce</strong>ssible, notamment à cause de la sécurité et de<br />
l’état des routes qui y menaient. C’est seulement après avoir, parfois mais pas toujours,<br />
franchi 93 les barrières érigées entre moi et leur association, et donc aussi entre moi et les<br />
femmes que je voulais rencontrer qu’ils semblaient vouloir protéger, mais je n’arrive<br />
toujours pas à savoir de quoi, que <strong>ce</strong>s pancartes, <strong>ce</strong>s chansons, <strong>ce</strong>s affiches, mais aussi<br />
l’ensemble de me recherches préalables à mon séjour prirent une forme réelle et concrète<br />
bien qu’inattendue, une réalité urbaine dont je commençais à douter. La réalité du terrain<br />
n’était pas inexistante mais seulement différente de <strong>ce</strong>lle au village. Mon terrain était donc<br />
double, urbain et rural, et me révélait deux réalités effectives qui allaient se compléter. Mon<br />
enquête pouvait donc commen<strong>ce</strong>r là où j’étais, à Bukavu. C’est en tous cas là que pour la<br />
première fois les mots, les discours se concrétisaient et s’incarnaient (enfin) dans des<br />
visages, des regards souvent baissés, des corps, parfois mutilés, et bientôt des voix qui<br />
allaient presque me hanter. Je compris seulement plus tard qu’au moins à la ville, <strong>ce</strong>tte<br />
réalité ne pouvait pas être visible dans la mesure où l’anonymat que <strong>ce</strong>tte ville surpeuplée et<br />
construite anarchiquement offrait souvent était un refuge pour la plupart des villageoises<br />
qui avaient fui l’insécurité mais aussi le regard accusateur et méprisant des autres villageois.<br />
Souvent, mais pas tout le temps car j’ai rencontré une fille qui avait rencontré à la ville<br />
quelqu’un de son village qui avait alors divulgué <strong>ce</strong> qui lui était arrivé aux gens de son<br />
quartier qui lui infligent jusqu’à aujourd’hui le même regard et les mêmes paroles<br />
accusatri<strong>ce</strong>s qu’au village. Ou alors, toujours à la ville, quand elles n’étaient pas éparpillées<br />
de manière plus ou moins aléatoire à travers la ville, elles étaient au contraire regroupées<br />
dans des maisons de transit que l’on pouvait par ailleurs aussi trouver à la campagne, ou<br />
dans des unités aménagées spécialement pour elles dans les hôpitaux. Ce dénominateur<br />
commun de souffran<strong>ce</strong> que nous avons déjà évoqué n’était donc pas seulement un critère<br />
pour créer une catégorie mais aussi pour mettre ensemble, dans un même espa<strong>ce</strong>, de<br />
manière transitoire ou pérenne, les membres de <strong>ce</strong>tte catégorie. C’est lors de ma première<br />
confrontation avec la réalité effective de <strong>ce</strong>tte souffran<strong>ce</strong> que je pris conscien<strong>ce</strong> avec<br />
étonnement de <strong>ce</strong> que l’on pourrait appeler un espa<strong>ce</strong> de l’entre-soi au sein duquel semblait<br />
se mettre en scène un « dire » de l’entre-soi.<br />
93 Cf chapitre 3.
100<br />
Au cours de mes première visites de présentation à l’hôpital, j’eu l’occasion d’observer le<br />
fonctionnement de l’hôpital. D’obédien<strong>ce</strong> protestante, l’hôpital demandait à son personnel<br />
d’assister à un culte quotidien au début de leur journée de travail. S’en suivait une réunion<br />
elle aussi hebdomadaire mais privée du personnel médical d’au moins une heure. Les<br />
patients attendent à l’accueil pour présenter leur problème de santé. S’ils étaient admis, ils<br />
devaient payer les frais dans la salle d’à côté avant d’obtenir les soins qu’ils étaient venus<br />
chercher. Si une femme disait avoir été victime de violen<strong>ce</strong>s sexuelles, elle était envoyée<br />
auprès des spécialistes du volet « VVS » de l’hôpital. Si <strong>ce</strong>s derniers décrétaient qu’elle disait<br />
vrai, elle pouvait avoir accès aux soins et à la prise en charge holistique évoquée<br />
gratuitement. J’avais eu l’occasion de me promener dans les couloirs extérieurs de l’hôpital,<br />
mais je n’avais toujours aucune idée du lieu où elles étaient – étaient-elles aussi éparpillées<br />
parmi les autres patients de l’hôpital ? L’espa<strong>ce</strong> qu’un reportage que j’avais visionné avant<br />
de partir avait présenté comme la file d’attente des <strong>ce</strong>ntaines de femmes victimes de<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles était en fait la file d’attente de tous les patients et patientes qui étaient<br />
victimes d’autres maux : la maladie, la famine, les méfaits du sous-développement. Même<br />
dans l’hôpital pourtant spécialisé sur la question des violen<strong>ce</strong>s sexuelles, la réalité de mon<br />
sujet m’échappait. Elle continuait à être insaisissable. Ce n’est que lorsqu’on décida de me<br />
présenter à une psychologue rattachée au projet et qui allait être ma réferente tout le long<br />
de mon enquête dans <strong>ce</strong>t hôpital que j’approchai <strong>ce</strong>tte réalité. On m’emmena dans une<br />
partie de l’hôpital dont je ne soupçonnais pas même l’existen<strong>ce</strong>, comme, je l’imagine,<br />
beaucoup d’autre étant donné qu’aucun des reportages visionnés n’en avait fait mention.<br />
Cet aménagement avait deux ans apparemment. Un/une membre du personnel<br />
administratif me guida jusqu’à ma réferente à travers les couloirs extérieurs de l’hôpital.<br />
Nous avons dépassé <strong>ce</strong> que je croyais être la fin de l’hôpital, nous sommes allés au-delà de<br />
<strong>ce</strong> que le regard du simple visiteur pouvait voir. Nous sommes des<strong>ce</strong>ndues par un couloir qui<br />
séparait deux bâtiments, et alors que les bâtiments finissaient, on pouvait déjà aper<strong>ce</strong>voir<br />
une immense étendue qui commençait tout en bas du couloir en question. L’étendue en<br />
question était vaste, peut-être 60 m2. Elle était bordée à droite par le terrain de voisins et à<br />
gauche par des bâtiments qui abritaient les salles de consultation, des salles d’attente et des<br />
dortoirs – d’après <strong>ce</strong> que j’ai pu voir, et <strong>ce</strong> que l’on m’a dit : Je n’ai pas eu l’occasion de<br />
visiter les lieux. Sur le côté arrière, il y avait un réfectoire sous lequel les femmes mangeaient<br />
parfois ou s’affairaient avec les activités de « réinsertion socio-économique ». Deux
101<br />
<strong>ce</strong>ntaines de femmes occupaient visiblement <strong>ce</strong>t espa<strong>ce</strong>. J’appris plus tard qu’elles étaient à<br />
<strong>ce</strong> moment-là plus de 300. Je croisais des bébés et j’appris même que <strong>ce</strong>rtains d’entre eux<br />
avaient été abusés. Je croisais des adoles<strong>ce</strong>ntes qui ne me semblaient pas avoir bien plus<br />
que 13 ans parfois, et <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles étaient en<strong>ce</strong>intes. Il y avait des femmes âgées<br />
autour de la soixantaine 94 , <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles avaient clairement des difficultés à<br />
marcher et pas seulement à cause de la vieillesse. Je n’ai croisé que deux hommes qui<br />
semblaient faire partie des bénéficiaires de <strong>ce</strong>t hôpital. Il y en avait quelques autres mais<br />
seulement au sein du personnel médical. L’organisation de l’espa<strong>ce</strong> et de leur journée<br />
évoquaient en <strong>ce</strong>rtains points <strong>ce</strong>lles d’un village. Il y avait d’ailleurs deux huttes d’aspect<br />
traditionnel mais dont la taille et la fonctionnalité était différente. Tout au bout du jardin, il y<br />
avait un local qui servait de cuisine. La nourriture était cuite au charbon, comme partout<br />
ailleurs. Les femmes avaient une file d’attente presque pour tout : pour manger, pour se<br />
faire soigner, seuls les rendez-vous médicaux programmés leur épargnaient <strong>ce</strong>tte attente.<br />
Leur journée était rythmée par les repas et les rendez-vous avec les médecins et les<br />
psychologues. Dans le dernier cas les rendez-vous pouvaient être personnalisés ou<br />
collectifs : Les deux faisaient partie intégrante de la thérapie qui, par ailleurs, avait été<br />
importée par des missionnaires suédois. Elles étaient réunies deux fois par jour pour<br />
manger : Le matin, elles mangeaient un bol de bouillie aussi traditionnelle mais qui me<br />
semblait contraster avec le pain et le café que prenaient le personnel masculin et directif du<br />
projet là-haut, dans les bureaux, spatialement opposés à <strong>ce</strong> petit village, <strong>ce</strong>ux qui se<br />
trouvaient dans la partie visible de l’hôpital. Le midi, elles avaient droit au bugali aussi<br />
traditionnel et à une sau<strong>ce</strong> de légume qui variait. La première fois que je les ai vues, elles<br />
attendaient le petit déjeuner dans l’amphithéâtre <strong>ce</strong>ntral. Elles le prenaient dans <strong>ce</strong>t<br />
amphithéâtre ou sous le réfectoire. Quant aux rendez-vous médicaux et/ou psychologiques,<br />
leur fréquen<strong>ce</strong> est relative à la gravité de leur situation. Le reste de leur journée, elles<br />
s’affairent : Elles se lavent et/ou lavent leurs enfants ou <strong>ce</strong>lui des autres, elles lavent leur<br />
vêtements qu’elles font séchées sur les espa<strong>ce</strong>s verts ou les fils encore libres, elles se<br />
tressent les unes les autres (entraide villageoise intacte), dans le cadre des activités dites de<br />
réinsertion socio-économique, elles apprennent à tisser des sacs ou des objets fonctionnels
102<br />
ou d’art, à coudre, ou encore à fabriquer du savon par exemple, elles discutent, observent<br />
ou, plus passivement, attendent. C’est <strong>ce</strong> que j’observe. J’ai aussi appris que de manière plus<br />
ponctuelle, il leur arrive d’aller vendre en groupe au marché de la ville <strong>ce</strong> qu’elles ont<br />
fabriqué dans un stand qui ne cache pas leur identité. Une fois par semaine, une association<br />
vient organiser des activités collectives d’art-thérapie « pour <strong>ce</strong>lles qui ont encore la for<strong>ce</strong> ».<br />
J’ai aussi appris qu’il y avait d’autres femmes que <strong>ce</strong>lles que je pouvais observer : <strong>ce</strong>lles qui<br />
vivaient dans des habitations alentours à l’extérieur de l’hôpital, construites exclusivement<br />
pour elles avec l’aide des finan<strong>ce</strong>ments d’UNICEF ; <strong>ce</strong>lles qui étaient trop « abîmées » pour<br />
se dépla<strong>ce</strong>r. D’ailleurs parmi <strong>ce</strong>lles qui étaient visibles, peut-être un dixième se déplaçait<br />
avec difficulté pour des raisons que l’on suppose liées aux violen<strong>ce</strong>s subies. Lorsque les<br />
femmes se regroupaient dans l’amphithéâtre par exemple <strong>ce</strong>rtaines étaient seules, d’autres<br />
en groupe, et en marge de toutes <strong>ce</strong>s femmes réunies, on trouvait souvent un ou plusieurs<br />
groupes de femmes qui restent tout le temps entre elles. C’était, parait-il, à cause d’elles<br />
qu’on avait confiné et marginalisé ainsi toutes les femmes qui étaient dans <strong>ce</strong>t hôpital par<strong>ce</strong><br />
qu’elles avaient été victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles de « difficultés gynécologiques en lien<br />
direct ou indirect avec la guerre ». En effet, <strong>ce</strong>s groupes de femmes avaient subi des actes et<br />
des mutilations d’une telle violen<strong>ce</strong> que leur fistule avait été détruite. Dans l’attente peutêtre<br />
vaine qu’elle soit réparée. Alors que l’ensemble des femmes qui avaient subi des<br />
violen<strong>ce</strong>s sexuelles séjournaient encore dans les locaux officiels et visibles de l’hôpital, des<br />
patients et de visiteurs se sont plaints des odeurs. Ces plaintes de plus en plus fréquentes<br />
ont amené les membres du projet à élaborer <strong>ce</strong>t espa<strong>ce</strong> en marge de l’hôpital afin que les<br />
odeurs ne gênent personne qui soit extérieur au projet. Cet espa<strong>ce</strong> marginalisé au sein de<br />
<strong>ce</strong>t hôpital pourtant général semblait fonctionner de manière autonome. Et sa structure<br />
s’apparentait à <strong>ce</strong>lle d’un village, très petit mais surpeuplé et surtout presqu’exclusivement<br />
féminin. A priori, les liens ne pouvaient se créer qu’entre femmes ayant vécues la même<br />
expérien<strong>ce</strong> et/ou avec le personnel administratif, médical et psychosocial qu’elles étaient<br />
amenées à côtoyer quotidiennement. Il m’a semblé que <strong>ce</strong>rtaines solidarités a priori<br />
villageoises ont subsisté dans leur organisation : Elles s’entraidaient, comme nous l’avons vu,<br />
pour se tresser mutuellement, ou encore pour s’occuper de leurs enfants par exemple. Mais<br />
en allant à la rencontre de <strong>ce</strong>rtaines d’entre elles, je pu me rendre compte que la relation<br />
qui sembler les lier était plus complexe qu’il n’y paraissait.
103<br />
Il apparait quoi qu’il en soit évident que <strong>ce</strong> village était un espa<strong>ce</strong> de l’entre-soi de<br />
l’expérien<strong>ce</strong>. Dès lors, le regard de l’autre n’est plus une mena<strong>ce</strong> et la parole peut être<br />
délivrée. On comprend aussi pourquoi au village, les seuls espa<strong>ce</strong>s où la parole se délivre<br />
sont <strong>ce</strong>ux qui offrent <strong>ce</strong> type de sécurité. Anne évoque la facilité qu’ont <strong>ce</strong>rtaines femmes à<br />
lui parler de leurs problèmes, et la difficulté qu’elles ont à parler devant quelqu’un<br />
d’étranger, surtout si c’est un homme :<br />
« J’ai d’abord donné le nom de mes semblables et pour lui et pour te montrer que <strong>ce</strong> n’est<br />
pas du mensonge, on va t’amener nos « carnets » de soin. Et au même moment, chacune a<br />
amené le carnet. Et d’ailleurs c’est <strong>ce</strong> qu’on a pris, et chacune a amené son carnet de soin. Il<br />
nous a inscrites, et je lui ai montré les autres qui n’avaient pas encore eu les médicaments. Je<br />
lui ai tout montré. Ça a amené papa L. à demander à <strong>ce</strong> que chacune passe pour lui raconter<br />
ses difficultés. Certaines ont ac<strong>ce</strong>pté et d’autres ont refusé. Mais quand moi, je retourne et je<br />
vais les voir, elles n’ont pas honte avec moi et elle me raconte comment ça s’est passé. »<br />
Donc le regard et l’identité de l’autre (selon qu’il soit consideré comme autre ou au contraire<br />
« semblable ») est déterminant dans la capacité et la volonté ou non de dire la violen<strong>ce</strong><br />
subie.<br />
De plus, les femmes qui parlent insistent pour que leur anonymat soit préservé. Anne<br />
continue plus loin :<br />
« <strong>ce</strong> qui a fait que beaucoup se sont manifestées après, Quand elles ont entendues que <strong>ce</strong><br />
n’était pas des choses qu’on criait que <strong>ce</strong> sont des telles, <strong>ce</strong> sont des telles, <strong>ce</strong> sont des telles.<br />
A <strong>ce</strong> moment, deux de nos semblables étaient malades. Je leur ai dit, si vous continuez à vous<br />
cacher, vous allez être comme elles, et pourtant vous auriez pu encore trouver quelque part<br />
ou vous soigner. Ça a poussé quelques-unes à commen<strong>ce</strong>r à venir. Quand elles ont vues que<br />
<strong>ce</strong> n’était pas des choses qu’on divulguait dans le quartier. »<br />
Ici elle souligne deux nouvelles motivations à la prise de parole : la peur de la mort, et<br />
l’anonymat. On observe que du silen<strong>ce</strong> individuel de leur souffran<strong>ce</strong> on passe au silen<strong>ce</strong><br />
collectif. Dans des réunions dites de développement ou de prières, elles se réunissent en<br />
faites pour parler de leur souffran<strong>ce</strong> commune. Même la famille n’est pas au courant de
104<br />
<strong>ce</strong>la. (Récit de vie d’Anne et de Claire). Elles se sentent ainsi protéger du regard lourd de la<br />
société, de la communauté familiale ou villageoise. L’entre-soi anonyme à l’extérieur serait<br />
donc une autre condition à la faculté et à la volonté de « dire » son vécu, passé ou présent.
105<br />
Chapitre 5 : Récits de vie<br />
J’ai dans un premier temps pensé que mon mémoire se finirait sur l’analyse générale que je<br />
viens de faire des entretiens. Une sensation d’inachevé m’a alors encouragée à continuer<br />
avec <strong>ce</strong> dernier chapitre exclusivement consacré à la restitution d’un récit de vie. Il est vrai<br />
que le contenu de <strong>ce</strong>s récits se retrouve dans les entretiens. Il m’est apparu comme limité<br />
voire dangereux de seulement annexer le brut, le vif de leur parole, alors que mon premier<br />
but était justement de restituer à <strong>ce</strong>tte parole la pla<strong>ce</strong> qui lui est due. Après avoir donné une<br />
partie des outils de compréhension de <strong>ce</strong>tte parole multiple, après donc avoir balisé au long<br />
de quatre chapitres les limites aux possibilités infinies de son cadre d’interprétation, je<br />
choisis d’en restituer deux sous une forme narrativisée parmi les treize que j’ai entendu. Le<br />
choix n’est bien sûr pas lié à la représentativité de son cas. Nous savons maintenant qu’elle<br />
est vaine. Il s’agit juste des paroles qui ont été prononcées dans les contextes sociaux et<br />
interrelationnels où les barrières que nous avons analysées m’ont semblées influen<strong>ce</strong>r le<br />
moins possible l’échange. J’invite mes lecteurs et lectri<strong>ce</strong>s à bien sûr confronter la forme<br />
narrativisée et donc né<strong>ce</strong>ssairement subjectivée de <strong>ce</strong>tte parole restituée ici avec les<br />
entretiens annexés. Je les invite aussi à se plonger dans la lecture de tous les autres<br />
entretiens, maintenant que les clés sont données pour les interpréter.<br />
1. Au village : Lydia, 23 ans, récit de vie.<br />
Mon nom c’est Lydia. M…, de N…, je suis née à N…. . Ma mère a mis au monde 10<br />
enfants. Tous ont fini par mourir. Mon père, lui aussi, il est mort. Nous sommes restées à<br />
trois filles, et c’est ainsi que nous sommes à trois. Il n’y a que ma mère qui est encore là,<br />
mais elle est devenue faible. Je la vois de temps en temps mais elle est devenue faible, elle<br />
n’a plus de santé. Je viens de la voir. Par<strong>ce</strong>-que, tu vois, j’ai eu deux enfants avec <strong>ce</strong>s<br />
bahutus. Elle garde une enfant, et moi j’ai gardé l’autre là où je me suis mariée. Pour mes<br />
deux sœurs, Il y en a une dont le mari est malade, il est à l’hôpital chez les soignants. Et il y a<br />
l’autre mais peut-être qu’elle, son mari est bien portant. Je n’ai vu que l’autre. On a emporté<br />
son mari d’ici à l’hôpital, chez les soignants hier. Aujourd’hui, je suis mariée à O….
106<br />
Avant de me marier, je venais d’AAV. Et avant tout ça…j’étais encore chez moi. J’allais<br />
encore à l’école, et puis <strong>ce</strong> dimanche-là, on était à la messe. En fait, les bahutus se cachaient<br />
dans les champs de manioc, là, à l’église catholique, mais on ne savait pas qu’ils étaient là. Et<br />
quand on était là, alors qu’eux ils étaient cachés, nous sommes entrés dans la messe. Nous<br />
pensions qu’il n’y avait personne, en fait, c’est là que <strong>ce</strong>s bahutus se cachaient. Quand nous<br />
étions dans la messe, ils sont entrés, et ils ont dits qu’ils étaient des soldats, que c’est<br />
Kinshasa qui les envoyait, et pourtant c’était des Bahutus…Après, à la fin, on nous a dit de<br />
quitter la messe, de sortir, d’aller dehors. Nous sommes allés dehors. Et quand nous<br />
sommes allés dehors, c’est là qu’on m’a saisie. On triait les filles et les jeunes 95 et les jeunes 96<br />
[en mashi – emisole]. Après, quand nous sommes arrivés à P…, quand les soldats d’ici ont<br />
commencé à tirer les balles, c’est à <strong>ce</strong> moment-là que <strong>ce</strong>s jeunes se sont échappés. Par<strong>ce</strong>que<br />
comme nous on était sur les <strong>ce</strong>intures, on était attachés aux <strong>ce</strong>intures 97 , nous, ils sont<br />
partis avec nous là, dans la forêt.<br />
C’était l’année 2004. J’avais 16 ans. J’ai passé 5 mois dans la forêt. Je voyais comme si<br />
c’était la mort. Je ne pensais plus que je m’en sortirai. Je voyais comme si j’allais mourir<br />
quand j’étais là. Par<strong>ce</strong>-qu’ on était là, on vivait là, on était comme si…Quand je voyais l’autre<br />
dame, j’étais là, même si je connaissais l’autre dame, ils ne me permettaient pas de parler<br />
avec elle. Ils ne pouvaient même pas ac<strong>ce</strong>pter que je te parle. Il n’y a que, il n’y a que <strong>ce</strong>lui<br />
qui t’avait amenée seulement. Lui, il ne pouvait pas aimer que tu parles avec l’autre. Et il te<br />
frappe, mais tu ne sais même pas pourquoi il t’a frappée. On croyait qu’on allait mourir<br />
seulement. On ne savait même pas qu’on allait quitter là-bas. Déjà j’étais en<strong>ce</strong>inte de <strong>ce</strong>t<br />
enfant.<br />
Mais Dieu nous a bénis. Quand on avait déjà passé quelques jours là-bas, on a vu les<br />
soldats de chez nous qui sont partis se battre là-bas dans leur bataille. En se battant, les gens<br />
fuyaient, et nous on a fuies vers les soldats de chez nous. On est arrivé de <strong>ce</strong> côté-ci, les bras<br />
en l’air, et ils ont vu que nous étions des congolaises.<br />
D’abord je suis partie chez les prêtres, et chez le curé à K.... le curé m’a dit de voir le<br />
médecin de K.... Après je suis allée à K, ils m’ont donnée des médicaments, ils m’ont<br />
95 En français<br />
96 En mashi.<br />
97 Je suppose qu’elles étaient attachées ensemble à l’aide de <strong>ce</strong>inture, ou qu’elles étaient attachées aux <strong>ce</strong>intures<br />
même des soldats.
107<br />
examinée, ils ont dit qu’ils n’avaient pas trouvés de maladie. Je suis restée là pour qu’ils<br />
m’aident avec mes pensées. Ils me disaient que si tous mes problèmes étaient arrivés, ils<br />
auraient pu arriver à n’importe qui, qu’il ne fallait pas pleurer par<strong>ce</strong>-que c’est arrivé à toi<br />
comme ça. Quand le curé m’a demandée comment on vivait là-bas, je lui ai dit que nous ne<br />
vivions que dans des difficultés par<strong>ce</strong>-que là où on était, pour manger, c’était une grande<br />
difficulté, et quand on nous donnait à manger, après on nous battait. On nous a beaucoup<br />
malmenées. On nous prenait de for<strong>ce</strong> 98 . Je suis d’abord restée aux soins du curée. Il avait un<br />
bon cœur, selon les bons enseignements qu’il me donnait. Par<strong>ce</strong>-que s’il ne me les avait pas<br />
donnés, je serais morte à cause de mes pensées. Il disait : Par<strong>ce</strong>-que je, moi aussi, je serais<br />
mort <strong>ce</strong> jour où on t’avait emmenée. Par<strong>ce</strong>-qu’ après vous, quand on vous a emmenées<br />
comme ça, les autres qui sont restés derrières, on aurait pu nous tirer dessus, mais Dieu ne<br />
l’a pas voulu.<br />
Mais, en regardant, j’ai fini par rencontrer ma maman Ange. [ndlr : présidente de<br />
l’association AAV]. Elle m’a donnée aussi d’autres enseignements, et elle me donna aussi le<br />
peu qui a permis à l’enfant d’arriver là où il en est. J’ai beaucoup vécu grâ<strong>ce</strong> à<br />
l’enseignement de maman Ange, mais pas tant grâ<strong>ce</strong> à l’enseignement du curé par<strong>ce</strong>-qu’ à<br />
la naissan<strong>ce</strong>, il avait quitté K…, on l’a envoyé à Bukavu. J’ai vécu avec maman jusqu’à <strong>ce</strong> que<br />
j’arrive à O…, j’étais toujours à AAV.<br />
Quand j’ai quitté la forêt, Je ne savais pas quoi faire, je pensais que j’étais en<strong>ce</strong>inte et<br />
que j’allais mourir. Je ne savais pas que j’allais être sauvée. Là, je ne savais pas les projets<br />
que j’avais par<strong>ce</strong>-que je pensais qu’à un moment ou un autre. Et puis Dieu m’a aidé, j’ai<br />
quitté là-bas. Et quand j’ai quitté là, moi, je me disais que Dieu m’aide et que mon enfant<br />
grandisse, J’étais déjà en<strong>ce</strong>inte. L’enfant, je l’ai aimé dès que j’ai accouché car je ne savais<br />
pas que j’allais accoucher, je croyais que j’allais mourir. Dieu m’a aidé. Je l’ai mis au monde.<br />
J’ai ressenti que je l’aimais. Mais, on nous blessait ; Je me trouvais contente mais ma<br />
mère…Les gens du village disaient que j’avais un enfant des Interahamwés, <strong>ce</strong>t enfant me<br />
tuera, que j’enlève <strong>ce</strong>tte saleté. Et d’autres disaient qu’à un moment eux ils le tueront,<br />
par<strong>ce</strong>-que <strong>ce</strong>t enfant aura le cœur de ses papas. Je sentais, je voyais comme si je mourrais.<br />
J’aurai préféré que quelqu’un me tue. Ils sont même arrivés à me faire arriver à me faire<br />
arrêter par les soldats, ils disaient aux soldats de me mettre en prison. C’est à cause de moi<br />
98 Elle utilise le verbe ku-yanka.
108<br />
qu’on va les tuer. On m’a emprisonnée. Ma mère est venue mais…tout l’argent qu’elle avait<br />
était fini. Elle payait là où on m’avait emprisonnée. Ma maman n’était plus en forme. Les<br />
messieurs me détestaient, ils me disaient de tuer l’enfant. J’ai dit que je ne peux pas tuer<br />
l’enfant. Et quand j’ai vu qu’ils ont emmené les soldats qui m’ont attrapée et qui m’ont<br />
emprisonnée pour la 4 ème fois, je leur ai dit que, <strong>ce</strong>tte fois, je n’ai pas d’argent à vous<br />
donner. A chaque fois ils disaient qu’il faut que je sorte 50 dollars.<br />
Cette fois, lorsqu’ils sont venus pour <strong>ce</strong>tte 4 ème fois, <strong>ce</strong>tte fois, comme je n’ai pas<br />
d’argent à vous donner, je n’ai pas d’endroit où en trouver, prenez alors <strong>ce</strong>t enfant, et<br />
emmenez-moi aussi, comme ça vous saurez si vous allez me tuer par<strong>ce</strong>-que je ne sais plus<br />
quoi faire. C’est à <strong>ce</strong> moment-là qu’ils m’ont emportée, ils m’ont emmenée dans la prison,<br />
là, à K... Et quand on est arrivé à la prison à K…, on nous a emprisonnés, j’y ai dormi <strong>ce</strong> jour<br />
où on nous a emmenés. Et comme on avait déjà dormi là, c’est là qu’ils ont dit, quand c’était<br />
déjà la nuit, ils ont emmené un soldat. Ces soldats nous disaient - ils étaient à deux - on ne<br />
veut plus vous emprisonner, mais vous allez être nos femmes, et nous on leur disait que <strong>ce</strong><br />
n’est pas par<strong>ce</strong> qu’ on nous a emmenées dans la forêt, et si on nous a emmenées, ça ne veut<br />
pas dire qu’on doit maintenant devenir des putes. On va rester avec nos enfants. Comme<br />
Dieu lui-même fera, <strong>ce</strong> que l’éternel a préparé, <strong>ce</strong> n’est pas la prostitution qui nous a sortie<br />
de là. Ça nous est arrivé comme ça…A <strong>ce</strong> moment…Ils en sont arrivés que pendant la nuit,<br />
<strong>ce</strong>s soldats aussi nous ont violées 99 . C’est là que je suis tombée en<strong>ce</strong>inte pour la deuxième<br />
fois. Et quand j’ai amené <strong>ce</strong>tte deuxième grossesse, ils ont attrapé <strong>ce</strong>s soldats, on leur a fait<br />
un interrogatoire en lui demandant comment est-<strong>ce</strong> qu’ils en sont arrivé là. Le curé de K…, le<br />
deuxième qui était là qu’on venait d’attraper. Les autres ont fait de la politique : ils ont<br />
demandé à <strong>ce</strong> qu’on les livre aux autres soldats, comme ça il va partir chercher l’argent. En<br />
fait les autres voulaient que le curé le leur livre pour qu’ils le fassent fuir. Et quand le curé l’a<br />
libéré pour qu’il aille chercher l’argent, alors qu’ils avaient fait déjà ça, qu’ils nous avaient<br />
détruites. Ils ont fui, on n’a pas su par où ils sont passés. On a entendu qu’on ne sait pas où<br />
est-<strong>ce</strong> qu’ils sont allés. On est restées là, on était en<strong>ce</strong>intes, on a pas su ou est-<strong>ce</strong> qu’ils<br />
étaient allés.<br />
Quand je suis revenue de la forêt, quand ils m’ont vue, ma famille ? Ils étaient enchantés.<br />
Ma famille était dans la joie. Et quand j’ai accouché, à la maison, ils ont tous aimé l’enfant,<br />
99 Elle utilise encore le verbe kuyanka
109<br />
personne ne le regarde mal, mes deux grandes sœurs, et ma mère, toutes l’aiment. Mais, les<br />
gens du village, tous, ils disent qu’ils peuvent lui donner du poison.<br />
Le deuxième enfant, quand j’ai accouchée, ils ont dit que je suis allée voir mes maris, que je<br />
suis allée les voir dans la forêt, que c’est moi qui accouche les enfants des Interahamwés, qui<br />
vont venir les tuer dans leur village…Certains ont commencé à dire : quand les problèmes<br />
arrivent à <strong>ce</strong>tte fille, vous le voyez non, <strong>ce</strong> n’est pas elle qui les appelle, quand <strong>ce</strong> problème<br />
lui arrive, vous le voyez bien non ? C’est <strong>ce</strong> qu’ils leur ont dit. Quand j’ai eu le deuxième<br />
enfant, comme j’étais déjà blessée, et les gens m’avaient déjà, les gens disaient déjà, à cause<br />
de leur parole, j’étais déjà blessée, mais quand j’ai accouché, j’étais contente. Et j’ai vu que<br />
<strong>ce</strong> qui n’est pas dans le plan de Dieu ne peut pas me tuer. Je suis restée là, avec mon enfant.<br />
C’est là que maman Ange est arrivée. Elle a dit alors que je quitte la maison, et que j’aille<br />
chez AAV. J’ai alors quitté là-bas, et je suis partie chez AAV. J’étais très contente chez AAV.<br />
Je suis allée là-bas, on a bien vécu. En tous cas, je vivais bien là. Je n’ai vu aucun mal en<br />
Maman.<br />
Puis j’ai réussi à me marier, là à O....Il m’a rencontrée là, c’est à AAV qu’il m’a fiancée.<br />
C’est là qu’il m’a fiancée. C’est de là que je venais quand il m’a fiancée chez lui.<br />
Certains à O… savent <strong>ce</strong> qui m’est arrivée. Ces derniers temps, quand je suis partie là-bas,<br />
deux mamans m’ont dit au mariage : comment est-<strong>ce</strong> qu’il est parti chercher une femme qui<br />
vient de chez les Interahamwés? Est-<strong>ce</strong> qu’il pouvait manquer un endroit où il pouvait<br />
fian<strong>ce</strong>r une autre ? Et lui il a dit, c’est <strong>ce</strong>lle-là que j’aime. Je l’ai épousée tout en sachant que<br />
c’est de là qu’elle venait. Que là où il y avait les Interahamwés, c’est de là qu’elle vient.<br />
Chez AAV, je vivais bien. Et là bon, il n’a rien, il est pauvre. Il m’aime, mais il n’a rien.<br />
Il ne fait rien. Il n’a rien, mais le peu qu’il a je le vois. Quand il a quelque-chose, je vois qu’il<br />
ne regarde pas mal mes enfants. C’est pour <strong>ce</strong>la que je n’ai jamais vu de mal en lui,<br />
seulement la pauvreté. Mais il n’a rien. Je vois que <strong>ce</strong>t homme m’aime, mais il n’a rien. Je<br />
vois que quand on n’a pas cultivé pour qu’on nous donne quelque-chose pour manger, c’est<br />
difficile d’avoir à manger 100 . Et parfois, c’est lui qui va cultiver pour ça, et il part avec la houe,<br />
et <strong>ce</strong>lui qui lui donne quelque chose, et je mange ça quand j’arrive. La vie est difficile.<br />
100 Au village, il arrive à <strong>ce</strong>ux qui n’ont pas de champs de cultiver dans <strong>ce</strong>ux des autres en échange de quelquechose<br />
à manger.
110<br />
2. Au village : Noémie, 25 ans, récit de vie.<br />
Avant…quand j’étais encore une enfant, quand j’avais 10/12 ans, je vendais des petites<br />
bananes sur le rebord de la route. Et puis, j’allais à l’école. A la maison, avec mes frères et<br />
sœurs, on était tous bien. Sauf Papa : il n’y arrivait plus. Il avait des maux d’estomac. Un<br />
dimanche matin, c’était en 2003, le 16. Le 16 juin 2003. C’était le dimanche matin. J’avais 15<br />
ans.<br />
Je quittais le village pour me rendre à la ville. Bukavu. Ils m’ont surprise/rencontrée sur la<br />
route. Ensuite, ils sont allés dans un autre village – avec moi. Ils y ont surprises 20 de mes<br />
semblables : les miens. Elles étaient en train de prier. Ils les ont aussi prises. Alors qu’elles<br />
étaient en pleine réunion de prière. Ils nous ont toutes prises. Ils nous emmenées dans…la<br />
forêt. Là, on n’a rencontré les autres. On n’a commencé à pleurer. On nous avait dit qu’elles<br />
étaient mortes, mais elles étaient là. Mes semblables, les miennes. Celles avec qui on avait<br />
toujours étudié, prié, chanté, joué. On croyait qu’elles étaient mortes ! Nous nous sommes<br />
toutes rencontrées. Mais on ne s’est même pas échangé un regard.<br />
Quand moi, je suis arrivé là, on m’a coupée au couteau dans le bras. Seulement par<strong>ce</strong>-que<br />
j’avais dit que je n’arrivais pas à dormir. Quand on est arrivés nos soldats, <strong>ce</strong>ux de la RCD, les<br />
ont poursuivis. Ils sont venus combattre pour nous, mais ils ne nous ont pas retrouvées.<br />
Nous, on les appelait nos soldats. On criait. Alors on nous a coupées. Ils nous coupaient, ils<br />
tiraient des balles, ils mettaient le fusil sur l’épaule, puis ils tiraient des balles. Quand on est<br />
arrivées en haut de la forêt, nos soldats nous ont retrouvées. Beaucoup d’entre eux sont<br />
morts devant nos yeux <strong>ce</strong> jour-là…<br />
La nuit est arrivée. C’est la nuit qu’ils nous violaient.<br />
Je suis restée sept mois. Je pensais tout le temps à tous <strong>ce</strong>ux que j’avais laissés au village.<br />
C’est dans la forêt que j’ai eu mes premières règles. C’est là aussi que je suis tombée<br />
en<strong>ce</strong>inte.<br />
J’ai réussi à m’échapper. J’ai quitté la forêt. Je suis venue par <strong>ce</strong> chemin. Je me perdais. Je ne<br />
savais pas d’où je venais. Je ne savais pas ou j’allais. On est venue me chercher à l’église d’un<br />
autre village. Si vous aviez vu l’état dans lequel j’étais. Vous seriez en train de pleurer. Je<br />
n’étais plus une humaine. Le pasteur m’a emmenée à l’hôpital. C’est là que j’ai donné vie à<br />
<strong>ce</strong>t enfant. C’est l’enfant de Dieu, vraiment.
111<br />
Plus tard, ils sont venus jusqu’au village, <strong>ce</strong>ux qui m’avaient kidnappée. Ils sont venus me<br />
chercher. Ils sont arrivés, ils ont brûlés des maisons, tués des gens. Ils disaient qu’ils étaient<br />
venus me chercher.[Ndlr : Elle commen<strong>ce</strong> à pleurer]. Les gens du village m’ont obligée à aller<br />
à la ville, Bukavu, pour ma sécurité. On m’envoyait des lettres tous les jours. Pars d’ici, ils<br />
m’ont dit. Je suis partie à Bukavu. Aucune personne de ma famille n’y vivait. Mais j’y suis<br />
allée, seule. Les gens du quartier tourmentent mon enfant. Ils disent que c’est l’enfant de<br />
l’ennemi. Quelqu’un de mon village m’a retrouvée et leur a dit. Moi, ils disent que je suis la<br />
femme de l’ennemie. Quand ils voient mon enfant, ils le frappent. Je ne sais pas quoi faire.<br />
Je l’ai renvoyé au village. On n’arrête pas de le tourmenter. Ça me fait tellement mal au<br />
cœur [ndlr : elle se remet à pleurer]<br />
Aujourd’hui, je n’ai pas la paix au village. Je n’ai pas la paix à la ville. Je ne suis bien nulle<br />
part. Et tout se mélange. Les gens nous tourmentent. Je n’ai pas de quoi nourrir mon enfant.<br />
De quoi lui payer l’école, de quoi l’habiller. Je suis en colère. Avec les circonstan<strong>ce</strong>s dans<br />
lesquelles j’ai eu mon enfant, mais pourquoi il ne peut vivre nulle part ? Mais <strong>ce</strong>t enfant,<br />
c’est l’enfant de Dieu.<br />
Mais heureusement que sur mon chemin, j’ai rencontré maman Solange [ndlr, la présidente<br />
de l’association]. Sans elle, je serais morte.
112<br />
Conclusion<br />
Ainsi, il est possible de dire quelque-chose, même partial et partiel, de « <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong> »<br />
à condition de se positionner par rapport à <strong>ce</strong> qui a déjà été dit et, surtout, à condition<br />
d’ac<strong>ce</strong>pter de dire, de transmettre une réalité avec les nombreux silen<strong>ce</strong>s auxquels<br />
condamnent d’une part la catégorisation, la tendan<strong>ce</strong> discursive à l’homogénéité, la nonreprésentativité<br />
entre le sujet et l’objet du discours et donc ma subjectivité et, d’autre part,<br />
l’inévitable sélection, consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, des enquêté-es.<br />
Il est <strong>ce</strong>pendant seulement possible de dire <strong>ce</strong> qu’elles même peuvent en dire. La<br />
condition est alors d’ac<strong>ce</strong>pter leurs propres silen<strong>ce</strong>s, leurs propres non-dits : tout <strong>ce</strong> qui<br />
s’exprime, ou pas en dehors de la parole.<br />
Ce premier pas vers la formulation d’un discours sur « <strong>ce</strong> qu’elles <strong>vivent</strong> » me semble en<br />
appeler au moins deux autres. Etant donné les difficultés à dire leur vécu, dans la proximité<br />
géographique avec le lieu du traumatisme, peut-être serait-il plus pertinent de décaler mon<br />
regard, et de poursuivre <strong>ce</strong>tte recherche du point de vue de personnes déplacées, voire<br />
réfugiées ailleurs – au Burundi ou en Tanzanie par exemple. Etant donné <strong>ce</strong>s mêmes<br />
difficultés, peut-être serait-il pertinent d’explorer d’autres modes d’expression que la<br />
parole : la danse, les chants spirituels par exemple. Beaucoup d’entre elles ont effectivement<br />
évoqué le rôle <strong>ce</strong>ntral des prières et des chants spirituels, lors de leurs rencontres<br />
informelles, au village. Il me semble aussi important de préciser que dans un deuxième<br />
temps, il s’agira peut-être de coupler le verbe « dire » avec un autre, « agir », afin de<br />
participer de manière plus concrète à la réalisation d’un mieux-être dans leur présent.
113<br />
BIBLIOGRAPHIE<br />
Ouvrages théoriques et généraux<br />
- Badinter, Elisabeth (2003) Fausse route, Paris, Ed Odile Jacob.<br />
- Barth, Frederick (1969) Les groupes ethniques et leurs frontières. L’organisation sociale des<br />
différen<strong>ce</strong>s culturelles, Bergen, Oslo, Universitetsforlaget.<br />
- Bertaux Daniel (2005) L’enquête et ses méthodes – le récit de vie, Paris, Armand Colin.<br />
- Bashi Murhi-Orhakube Contstantin (2006) Parlons Mashi, Paris, L’Harmattan,.<br />
- Bourdieu, Pierre (1998) La domination masculine, seuil.<br />
- Dauphin, Cécile (1997) de la violen<strong>ce</strong> et des femmes, Paris : Albin Michel.<br />
- Angela Davis (1983) Femmes , ra<strong>ce</strong>, classe, Paris, Des Femmes.<br />
- Davies, H. (1994) Woman and violen<strong>ce</strong>, London: Zed books.<br />
- Freedman, Jane ; Valluy, Jérôme (coords.) (2007) Persécutions des femmes. Savoirs,<br />
protections et mobilisations, Paris, Editions du Croquant.<br />
- Guenivet, Karima (1998) violen<strong>ce</strong>s sexuelles : la nouvelle arme de guerre, Paris : Michalon.<br />
- Guerner Guillaume (2006) La société des victimes, Paris, La Découverte.<br />
- Kergoat, Danièle, « de la division sexuelle du travail », in dictionnaire du féminisme.<br />
- Perouse de Montclos, Marc Antoine. (2001). L’aide humanitaire, aide à la guerre ? Paris :<br />
Editions Complexe.<br />
- Rioux, J-Sébastien, Gagné, Julie (2005) Femmes et conflits armés. Réalités, leçons et<br />
avan<strong>ce</strong>ment des politiques, pul.<br />
- Sémelin Jacques (2005) Purifier et détruire, seuil.<br />
- Spivak, Gayatri Chakravorty (2009) Les subalternes peuvent-elles parler ?, Paris, éditions<br />
Amsterdam.<br />
- Streiff-Fenart, Jo<strong>ce</strong>lyne, Poutignat, Philippe (2008) Théories de l’ethnicité, puf.<br />
- Vigarello Georges (1998) Histoire du viol, seuil.
114<br />
- Weber, Marx [1995 (1956-67)] « Les relations communautaires ethniques », in Economie et<br />
Société. L’organisation et les puissan<strong>ce</strong>s de la société dans leur rapport avec l’économie.<br />
Paris, Pocket, p. 124-144<br />
- Wieworka, Michel (2004) La violen<strong>ce</strong>, Paris, Balland.<br />
.<br />
Articles scientifiques et universitaires<br />
- Anderson, Mary B. (1994) « Le con<strong>ce</strong>pt de vulnérabilité : au-delà des groupes vulnérables »<br />
in Revue Internationale de la Croix Rouge, N°808, pp 361-362.<br />
- Amselle, Jean-Amselle (1999) « Ethnies et espa<strong>ce</strong>s : pur une anthropologie topologique »,<br />
in Au cooeur de l’ethnie , Paris, La décuverte /poche.<br />
- Bassiouni, C., McCormick, M. (1996) « Sexual Violen<strong>ce</strong>: an invisible weapon of war in the<br />
former Yougoslavia », Chicago: De Paul University,.<br />
- Fourçans, Claire (29 avril 2008) Les violen<strong>ce</strong>s sexuelles faites aux femmes pendant les<br />
conflits armés et la Réponse des juridictions pénales internationales, Séminaire « Femmes et<br />
Conflits », Paris.<br />
- Hooks Bell (2000) Black Women: Shaping the Feminist Theory, in Joy James and Tra<strong>ce</strong>y<br />
Denean Sharpley-Whiting eds, Black Feminist Reader, Oxford, Blackwell.<br />
-Krijn Peters Paul Richards, (1998) « Why we fight: voi<strong>ce</strong>s of youth combatants in Sierra<br />
Leone », Africa 68 (2), pp. 183-210.<br />
-Marzona, Alain, Yann Braem, Les relations Armées-ONG, des relations de pouvoir ?<br />
Caractéristiques et enjeux de la coopération civilo-militaire française : le cas du Kosovo »<br />
Revue historique des armées, 243 | 2006<br />
mis en ligne le 17 novembre 2008. URL : http://rha.revues.org//index5302.html. Consulté le<br />
26 septembre 2009.<br />
-Malone, A. (1996) « Beyond Bosnia and In Kasinga: a Feminist Perspective on re<strong>ce</strong>nt<br />
developments in protecting women from sexual violen<strong>ce</strong> », Boston University International<br />
Law Journal.<br />
-Meron, Theodor (3 dé<strong>ce</strong>mbre 1992) « Le viol comme crime dans le cadre du droit<br />
international humanitaire », American Journal of International Law,.
115<br />
- Nahoum-Grappe, Dominique (1996) « l’usage politique de la cruauté », in Séminaire de<br />
Françoise Héritier, De la violen<strong>ce</strong> 1<br />
-Nahoum-Grappe, V. « Le viol comme instrument de guerre et d’extermination », CNRS,<br />
URL : http://www2.cnrs.fr/presse/thema/225.html. Consulté le 26/09/09.<br />
-Nordstrom, C, « Rape : politics and theory in war and pea<strong>ce</strong> », Australian Feminist studies<br />
11-23, 1996.<br />
- Rodriguez, Claudia (mars 2007) “Violen<strong>ce</strong>s sexuelles au Sud-Kivu” in Migration Forcée<br />
Revue. Violen<strong>ce</strong>s sexuelles : arme de guerre, impédiment à la paix, n°27, p45-48.<br />
- Tull Denis M. (2003) “A reconfiguration of a political order: The State of the state in North<br />
Kivu”, African Affairs, 102, pp 429-446.<br />
Mémoires, thèses<br />
- Byanamungu, Muhungusa, Pascasie, Perspectives d’une prise en charge pastorale des<br />
femmes victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles : cas de la paroisse de Walungu, mémoire de graduat<br />
option pastorale familiale, Institut Supérieur de Pastorale Familiale, 2006-2007.<br />
- Cauvin, La repression des violen<strong>ce</strong>s sexuelles par les tribunaux internationaux,Mémoire de<br />
DESS Droit humanitaire et Droits de l’homme. Université d’Evry Val d’Essonne.<br />
-De Vries, Janine (2005) Sexual violen<strong>ce</strong> against women in Congo, thèse.<br />
- Kabwanda Esther Tabu (1992) .Emancipation de la femme : œuvre de l’évangile de Jésus-<br />
Christ essai d’exégèse de Luc 8 :43-48, mémoire de graduat en théologie, Institut Supérieur<br />
de Théologie Evangélique.<br />
-Kavuo Muhiwa, Lydia (2008) De la problématique de la prise en charge des femmes et filles<br />
congolaises victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles, enquête en Ituri. Mémoire de graduat.<br />
- Moufflet, Véronique, (2008) « Le paradigme du viol comme arme de guerre à l’Est de la<br />
République Démocratique de Congo », Afrique contemporaine. De Boecke Université ISSN,<br />
N°227, p119-133.<br />
-Moswa Mombo, Leslie (2008), La répression des infractions se rapportant aux violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles dans le contexte de crise de la Justi<strong>ce</strong> congolaise: Cas du Viol.<br />
Etudes de cas de la RDC au reste du monde.<br />
-Allen, B (1996) Rape warfare: the hidden genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia,
116<br />
University of Minnesota press.<br />
- Butalia Urvashi (2002) Les voix de la partition Inde-Pakistan, Arles, Actes Sud.<br />
- Ceballos M., Lauthier B. (Avril 2007) “Les politiques de transfert conditionnel de revenue en<br />
Amérique latine: “ciblage large”, ou émergen<strong>ce</strong> d’un droit à l’assistan<strong>ce</strong>?” in Couffignal G.<br />
(Dir) : Amérique latine 2007 – Les surprises de la démocratie, La Documentation Française.<br />
- Guichaoua André (1989) Destins paysans et politiques agraires en Afrique <strong>ce</strong>ntrale (tome 1),<br />
L'Harmattan.<br />
-Kalere, Jean Migabo (janvier 2002) Génocide au Congo ? Analyse des massacres des<br />
populations civiles.<br />
-Lira, Elizabeth; Weinstein, Eugenia. (1990). La tortura. Con<strong>ce</strong>ptualización psicológica y<br />
pro<strong>ce</strong>so terapéutico. In MARTÍN BARÓ, Ignacio (compilateur). Psicología social de la guerra :<br />
trauma y terapia. San Salvador : UCA<br />
-Makotot-Mianzena (2003) Viol des femmes dans les conflits armés et thérapies familiales,<br />
cas du Congo Brazzaville, L’harmattan, 2003.<br />
-Mazurana, Dyan et McKay, Susan (2004) Ou sont les filles ?, ed. Droits et Démocratie.<br />
-Stiglmayer, Alexandra (1994) Mass Rape. The War against Women in Bosnia-Herzegovina,<br />
Lincoln-Londres, university of Nebraska Press.<br />
- Von Ragenfeld-Feldman (1997) The Victimization of Women: Rape and the Reporting of<br />
Rape in Bosnia-Herzegovina.<br />
Rapports d’organisations et d’associations<br />
-Amnesty International (AI). 26 October 2004, « République démocratique du Congo.<br />
Violen<strong>ce</strong>s sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates. » (AFR 62/018/2004)<br />
-Amnesty International (AI), octobre 2004, « République Démocratique du Congo : Violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles : un urgent besoin de réponses adéquates ».<br />
-Amnesty International (AI), 26 octobre 2004, « RDC; Après le viol: Témoignages recueills<br />
dans l’est du pays ».<br />
-Amnesty International (AI), 1 dé<strong>ce</strong>mbre 2004, « RDC: VIH: La séquelle la plus durable de la<br />
guerre ».<br />
-Amnesty International (AI), 16 dé<strong>ce</strong>mbre 2004, « RDC: Viols, ni loi, ni mesure ».<br />
-Amnesty International (AI), 29 septembre 2008, « République Démocratique du Congo -<br />
Recrudes<strong>ce</strong>n<strong>ce</strong> des viols et du recrutement d’enfants -soldats ».
117<br />
-Amnesty International (AI), 29 septembre 2008, « République Démocratique du Congo.<br />
Nord Kivu. Une guerre san fin pour les femmes et les enfants » (ADR 62/005/2008).<br />
-Asylum Aid, March 2002. Clare Palmer and Kathryn Ramsay. « Democratic Republic of<br />
Congo: Refugee Women and Domestic Violen<strong>ce</strong>: Country Studies ».<br />
-Centre National de Coopération au développement (CNCD), «Les violen<strong>ce</strong>s sexuelles au Sud-<br />
Kivu ». [http://www.cncd.be/spip.php?article74 consulté le 7/02/10]<br />
-Commission Justi<strong>ce</strong> et Paix Hollande, Jagoda Paukovic, 2007, « Qu’est-<strong>ce</strong> que tu as fait à ma<br />
sœur, La culture fa<strong>ce</strong> aux violen<strong>ce</strong>s faites aux femmes et filles en RD Congo, Guide de<br />
sensibilisation ».<br />
-Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 2009, « Our World – Views from the<br />
Democratic Republic of the Congo? ».<br />
-Comité International de la Croix-Rouge (CICR), 18 novembre 2009, « Violen<strong>ce</strong>s sexuelles en<br />
RDC: Une histoire de résilien<strong>ce</strong> ».<br />
-Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), avril 2008, « Crimes sexuels en<br />
République Démocratrique du Congo: Briser l’impunité ».<br />
-Human Right Watch (HRW), juin 2002, « The war within the war: Sexual violen<strong>ce</strong> Against<br />
Women and Girls in Eastern Congo ».<br />
-Human Right Watch (HRW), 06 mars 2005, « D.R Congo: Tens of Thousands Raped Few<br />
Prosecuted ».<br />
- International Rescue Committe (IRC), Janvier 2008, « Forgotten crisis: 5, 4 million dead in<br />
Congo ».<br />
-International Rescue Committe (IRC), novembre 2008, « Special Report: Rape in Congo ».<br />
-International Rescue Committe (IRC), 21 novembre 2008, « Congo Crisis: More Help is<br />
needed for Women and Girls in North Kivu as Sexual Violen<strong>ce</strong> Escalâtes »<br />
- Irin, “repenser les violen<strong>ce</strong>s sexuelles – analyse”, 09/08/2010, Irin news |<br />
http://www.irinnews.org<br />
- Médecins du Monde (MdM), 25 mars 2009, « République Démocratique du Congo : Le viol<br />
se généralise au Nord-Kivu ».<br />
- Médecin Sans Frontières (MSF), dé<strong>ce</strong>mbre 2000 – janvier 2004, « Je n’ai plus de joie de<br />
vivre ni de tranquillité d’esprit : Les conséquen<strong>ce</strong>s médicales, psychosociales et socioéconomiques<br />
de la violen<strong>ce</strong> sexuelle dans l’est de la RDC ».
118<br />
- Médecin Sans Frontières (MSF), site spécial Etat critique (www.condition-critical.org),<br />
« voi<strong>ce</strong>s from the war in Easter Congo».<br />
-Observatoire international de l’usage du viol comme tactique de guerre, 2003, Primo Levi,<br />
« les particularités de la violen<strong>ce</strong> en RDC ; la banalisation du viol et ses répercussions »,<br />
rapport annuel, pp12-13.<br />
- Oxfam International, The Harvard Humanitarian Initiative, 15 avril 2010, Now the World is<br />
without me, 15 avril 2010.<br />
-Réseau des Femmes pour le Défense des Droits et la Paix (RFDP), et Al Int., 2004, « Le corps<br />
de la femme comme champ de bataille. Durant la guerre en RDC, violen<strong>ce</strong>s sexuelles contre<br />
les femmes et les filles au Sud Kivu (1996-2003) ».<br />
Articles, communiqués dans la presse<br />
-Allafrica.com, Charles Wasso lunga (10 janvier 2008) « La violen<strong>ce</strong> sexuelle bat son plein au<br />
Nord Kivu ».<br />
-Allafrica.com (12 dé<strong>ce</strong>mbre 2009) « Congo-Kinshasa –Le nombre de violen<strong>ce</strong>s sexuelles<br />
s’est multiplié dans le Sud-Kivu ».<br />
-AFP (15 juin 2009) Viols en RDC : Kinshasa invité à « renfor<strong>ce</strong>r le statut de la femme ».<br />
- Congo Tribune | Congotribune.com | Awazi Kazele (09/09/2010) « viol au Kivu, hypocrisie<br />
de la communauté internationale »<br />
Consulté le 10 septembre 2010 http://www.congotribune.com/2010/09/viol-au-kivul%E2%80%99hypocrisie-de-la-communaute-internationale/<br />
- Courrierinternational.com (25 aout 2010) « Plus de 200 viols collectifs au Nord-Kivu »<br />
- Courrier international (extraits de Prensa libre), Carolina Escobar Sarti (mars 2010) « Pour<br />
que la honte change de camp – Guatemala.<br />
- Elle.fr Magazine, AS (27 août 2010) « Viols collectifs au Congo : l’ONU réclame une<br />
enquête » Consulté le 10 septembre 2010 | http://www.elle.fr/elle/Societe/News/Violscollectifs-au-Congo-l-ONU-reclame-une-enquete<br />
|<br />
- Elle Magazine (19 juin 2008) Interview de Rama Yade, « Le viol est une arme de guerre en<br />
RDC ».<br />
-The Canberra Times (21 dé<strong>ce</strong>mbre 2008) « Victim alert leaders to Congo rape crisis ».<br />
-Elle Magazine (1 dé<strong>ce</strong>mbre 2008) « Silen<strong>ce</strong>, on meurt ».<br />
-L’Express, Marie Simon (25 novembre 2008) « Au Nord Kivu, l’impunité favorise la
119<br />
banalisation ».<br />
- Le Figaro.fr (23 aout 2010) « RDC: 200 viols collectifs au Nord-Kivu ».<br />
-IRIN – Nouvelles et analyses humanitaires (29 janvier 2010) “RDC: Les forêts du Nord-Kivu,<br />
refuge des déplacés<br />
-Jeune Afrique (9 novembre 2003) « Le viol systématique, arme de guerre dans l’est de la<br />
RDC »,<br />
- Libération (14 novembre 2008) Le viol, tabou des femmes du Kivu ».<br />
-Libération (6 Octobre 2004) Thomas Hofnung. “Répudiées, l’ultime outrage.”<br />
-Media et Humanitaire, Pascaline Zamuda, « Sud Kivu (RD Congo) : banalisation des violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles ».<br />
- Le monde.fr (12/09/2010) « A la rencontre de femmes violées en RDC, avec Boris<br />
Cyrulnik », Porfolio sonore URL | http://www.lemonde.fr/afrique/portfolio/2010/09/10/aucongo-rdc-une-rencontre-avec-les-femmes-violees-par-boris-cyrulnik_1409349_3212.html<br />
|<br />
- Le Monde.fr (8/9/2010) « L’Onu réclame des sanctions contre les responsables de viols<br />
collectifs en RDC »<br />
Consulté le 10/09/2010 URL | http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/09/08/l-onureclame-des-sanctions-contre-les-responsables-de-viols-collectifs-en-rdc_1408160_3212.html<br />
- Le monde (25 novembre 2009) « Violen<strong>ce</strong>s sexuelles : au Congo, des maisons pour le dire »<br />
- Le Monde (25 octobre 2007) « Human Right Watch dénon<strong>ce</strong> « meuurtres, viols, et<br />
recrutements d’enfants soldats » au Nord-Kivu ».<br />
- Le Monde (23 février 2005) « Les meurtres et viols se multiplient en RDC ».<br />
- Le Monde (11 février 2005) « Kofi Annan: des membres de l’ONU coupables de violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles en RDC ».<br />
- Le Monde (05 dé<strong>ce</strong>mbre 1996) « Le Kivu, du drame à l’indifféren<strong>ce</strong> »<br />
-Radio des Nations Unies, Martial Assène, 19 mars 2009, « Nord-Kivu : les violen<strong>ce</strong>s<br />
sexuelles dénoncées par Alan Doss ».<br />
-Radio Okapi, 21 juillet 2007, « Sud Kivu : Violen<strong>ce</strong>s sexuelles contre les femmes, proportions<br />
dramatiques ».<br />
- New-York Times (novembre 2008) “Pillages, viols et massacres sont de retour”<br />
Paru dans courrier international le 07 novembre 2008 (extraits).
120<br />
- New York Times, paru dans courrier international le 18 octobre 2010, “Silen<strong>ce</strong>, on viole en<br />
masse”.<br />
- New York Times (slideshow) (06 octobre 2007) « Sexual Vioen<strong>ce</strong> in Eastern Congo ».<br />
-Le nouvel observateur (04/12/2008) « Congo Le viol comme arme de guerre »<br />
- Le nouvel observateur, 13 novembre 2008, « Congo. Une horreur qui rapporte : L’ONU est<br />
impuissante. »<br />
- L’Express, n°2993 (13 novembre 2008) « Congo. Les damnés du Kivu », p64.<br />
-Radio Okapi (26 novembre 2008) « Bukavu : Les femmes dénon<strong>ce</strong>nt l’absen<strong>ce</strong> de paix et les<br />
violen<strong>ce</strong>s faites aux femmes ».<br />
-Radio Okapi, 28 novembre 2008, « Hôpital de Panzi : le médecin directeur décoré du prix<br />
des droits de l’Homme » 2008.<br />
- Le nouvel observateur (10 janvier 2008 « Afrique, il n’y a pas que le Darfour… : Les<br />
massacres oubliés de Somalie, d’Ouganda, du Nord-Kivu », pp46-51.<br />
-Observateur Quotidien des Informations Générales en RD Congo, Freddy Longangu, (24<br />
novembre 2009), « Aides aux victimes de violen<strong>ce</strong>s sexuelles du Nord-Kivu ».<br />
-O, The Oprah Show (Février 2005) « Postcards from the Edge ».<br />
-O, The Oprah Show ( 24 janvier 2005) “Reaching Out the World: Liza Ling in the Congo”.<br />
Reportages, documentaires.<br />
-CICR, République Démocratique du Congo : la femme, un champ de bataille (2006)<br />
-CNN, Anderson Cooper (19 août 2008) “Congo sex abuse”.<br />
-CNN, (07 novembre 2008) “Congolese Women protest at EU”.<br />
-CNN (17 novembre 08) “Empowering Congo’s women”.<br />
-CNN (21 novembre 2008) “Saving Congo’s Women”.<br />
-CNN (20 novembre 2008) “Raped for a month”.<br />
-Fran<strong>ce</strong> 5, C dans l’air, (18/11/08), « Congo-Kinshasa : génocide »<br />
-MSF (20 novembre 2008)série de vidéos intitulée « Etat-critique: Les mots de la guerre dans<br />
l’Est du Congo ».<br />
-MSF vide ( 25 avril 2008) “Raped women in Kitchanga, DRC”.<br />
-US Holocaust Memorial Museum: Repples of genocide (septembre 2003) “Journey through<br />
Eastern Congo”.<br />
- Actoras de Cambio (2008) Sobreviví, estoy aquí, y estoy viva,
121<br />
-Productions indépendantes:<br />
Burdot, E. et Lanotte, M. (2008) viols sur ordonnan<strong>ce</strong>, (RTBF Production).<br />
Babila, Suzanne (2007) Le viol une arme de guerre,<br />
Bleasdale, Marcus, Rape of a Nation.<br />
Brauwers Greet, Custers Raf (2005) Bourreaux à Baraka, (25mn.)<br />
Guye, Khalil, les âmes brisées (production FNUAP, réalisation Génaration TV Dakar)<br />
Jackson, Liza, The Greatest Silen<strong>ce</strong><br />
Le Pape Marc, Genoud, Robert, Congo, la paix en Otage (MSF- production EUP)<br />
Témoignages et récits autobiographiques à travers le monde<br />
-Hatzfeld, Jean (2000) Dans le nu de la vie, Seuil,<br />
-Hatzfeld, Jean (2003) Une saison de machettes. Normandie : le Seuil.<br />
-Levi, Primo (1988) Si c’est un homme, pocket.<br />
-Levi, Primo, (1989).Les naufragés et les rescapés : quarante ans après Auschwitz, Gallimard.<br />
-Thurshen M., Twagiramariya C., (1998) What women do in wartime, gender and conflict in<br />
Africa, Zed Books.<br />
Romans, Essais<br />
-Améry, Jean (2005) Par-delà le crime et le châtiment, Arles, Actes Sud.<br />
-Sade, Justine ou les malheurs de la vertu, Flammarion.<br />
Sites internet :<br />
- http://www.genreenaction.net<br />
- Irin news | http://www.irinnews.org |<br />
- http://www.massviolen<strong>ce</strong>.org<br />
- Hôpital Panzi | www.panzihospitalbukavu.com |<br />
- http://www.viol-tactique-de-guerre.org