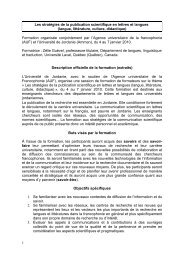Point de vue : Émile Tanawa, Directeur du Bureau Afrique de l'Ouest
Point de vue : Émile Tanawa, Directeur du Bureau Afrique de l'Ouest
Point de vue : Émile Tanawa, Directeur du Bureau Afrique de l'Ouest
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
programmes <strong>de</strong> formation : la prise en compte <strong>de</strong>s usages <strong>du</strong> français a con<strong>du</strong>it - semble-t-il - à lanotion <strong>de</strong> compétences, mais ceci ne s’est pas suffisamment tra<strong>du</strong>it sur le terrain. Si la valeur d’usage<strong>de</strong> la langue française avait été mieux considérée par les enseignants et les chercheurs, il aurait été plusaisé <strong>de</strong> développer <strong>de</strong>s partenariats non seulement avec <strong>de</strong>s non-spécialistes, mais aussi avec leséquipes travaillant dans d’autres domaines scientifiques : sciences physiques, environnement, sciences<strong>de</strong> la santé, géographie, etc. Une <strong>de</strong>s portes d’entrée pourrait être la communication, car bien souventles spécialistes ne parviennent pas à communiquer sur <strong>de</strong>s sujets spécialisés avec les non-spécialistes,faute <strong>de</strong> vocabulaire. Entre autres solutions, la réponse à ces besoins <strong>de</strong> communication pourraitmobiliser différentes équipes <strong>de</strong> domaines différents.- Favoriser l’intercompréhension <strong>de</strong>s langues dans la région : la langue française est pratiquée en<strong>Afrique</strong> <strong>de</strong> l’Ouest avec d’autres langues, comme le portugais. De plus, à la faveur <strong>de</strong> l’intégrationsocioéconomique dans la région, les populations se déplacent plus facilement d’un lieu à un autre pourleurs affaires, sans nécessairement avoir appris la langue <strong>du</strong> pays d’accueil. Il en est <strong>de</strong> même pour lesuniversitaires dans leurs échanges internationaux. Des réflexions et <strong>de</strong>s formations ont été menées surl’intercompréhension dans les contextes africains, comme outil pour le plurilinguisme. Des pistes <strong>de</strong>politique linguistique intéressantes ont été dégagées, <strong>de</strong>s outils pour la formation àl’intercompréhension, l’enseignement réciproque ou simultané <strong>de</strong>s langues ont été élaborés etexpérimentés, avec l’appui <strong>de</strong> l’AUF et <strong>de</strong> l’Union Latine. Ils mettent en avant les capacitésd’utilisation <strong>de</strong> toutes les langues dans la variété <strong>de</strong>s usages sociaux.- Assurer la professionnalisation <strong>de</strong>s filières d’étu<strong>de</strong>s françaises : Le problème <strong>de</strong> laprofessionnalisation se pose avec acuité dans les disciplines <strong>de</strong> la linguistique et <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s françaises.Dès lors, les questions suivantes peuvent être posées : quels autres métiers sauraient être accessiblesaux étudiants <strong>de</strong> ces filières ? Dans la mesure où les curriculums sont peu diversifiés, quelles actionsfaudrait-il entreprendre pour développer <strong>de</strong> nouvelles compétences professionnelles ? Par ailleurs, laprofessionnalisation est l’un <strong>de</strong>s points faibles <strong>de</strong> la mise en œuvre <strong>de</strong> la réforme Licence-Master-Doctorat (LMD) dans les universités <strong>de</strong> la région. Les spécialistes <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s françaises ne peuvent pascorriger seuls cette situation, d’où la nécessité impérieuse <strong>de</strong> développer <strong>de</strong> nouveaux partenariats pourla recherche et pour l’enseignement. Deux pistes sont régulièrement évoquées dans le cadre <strong>du</strong> LMD :* le renforcement <strong>de</strong> la professionnalisation pour les débouchés considérés comme « naturels » pources départements (formation <strong>de</strong>s enseignants <strong>de</strong> langue, formation <strong>de</strong>s tra<strong>du</strong>cteurs et <strong>de</strong>s interprètes) ;* ouverture beaucoup plus large vers d’autres débouchés qui convoquent également d’autresdisciplines (journalisme, métiers <strong>de</strong> la communication et <strong>de</strong> la culture, métiers <strong>du</strong> tourisme, métiers <strong>de</strong>l’interculturel dans les entreprises, métiers <strong>de</strong> l’in<strong>du</strong>strie <strong>de</strong>s langues, etc.).Il faudrait alors <strong>du</strong> soutien aux universités, pour qu’elles fassent le bon choix dans la prise en compte<strong>de</strong>s questions linguistiques dans la mise en œuvre <strong>du</strong> LMD.- Contribuer à répondre aux importants besoins <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ction d’autres langues vers le français : lesbesoins <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ction et d’interprétariat sont importants en <strong>Afrique</strong> <strong>de</strong> l’Ouest. Il s’agit là <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong>scréneaux pour la professionnalisation, d’où la nécessité, pour les réseaux <strong>de</strong> chercheurs, les réseauxinstitutionnels et les réseaux <strong>de</strong> départements d’étu<strong>de</strong>s françaises, <strong>de</strong> se positionner par rapport à cesbesoins professionnels. Mais la difficulté est plus gran<strong>de</strong> ici, dans la mesure où il faut prendre encompte la globalité <strong>de</strong> la politique linguistique dans les établissements car les autres langues doiventaussi être équipées.- Favoriser l’interaction entre les langues nationales et le français afin <strong>de</strong> puiser, dans la culture