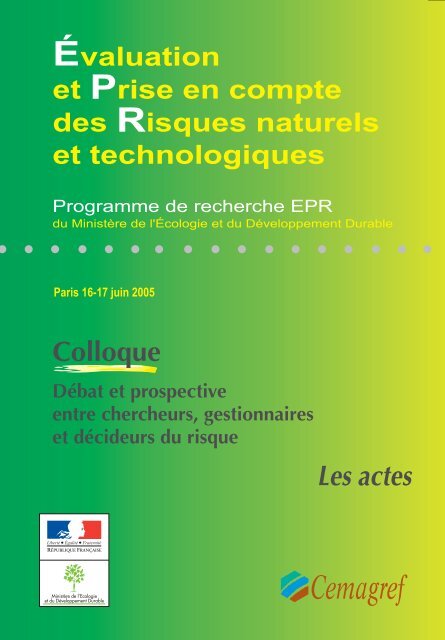Actes
Actes
Actes
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Évaluationet Prise en comptedes Risques naturelset technologiquesProgramme de recherche EPRdu Ministère de l'Écologie et du Développement DurableParis 16-17 juin 2005ColloqueDébat et prospectiveentre chercheurs, gestionnaireset décideurs du risqueLes actesLiberté Égalité FraternitéRÉPUBLIQUEFRANÇAISEMinistère de l’Ecologieet du Développement Durable
Évaluation et prise en comptedes risques naturelset technologiquesProgramme EPR<strong>Actes</strong> de Colloque16-17 juin 2005Débat et prospective entre chercheurs,gestionnaires et décideurs du risque
Responsable du programme : Sylvie Charron (MEDD/D4E/SRP)Coordinateur du programme : Jacques Joly (Cemagref)Conseil scientifiquePrésident : Claude Gilbert (CNRS)Membres : Bernard Barraqué (CNRS), Isabelle Bourdeaux (MSH-Alpes), GérardBrugnot (Cemagref), Simon Charbonneau (Université de Bordeaux 1), Suzanne deCheveigné (CNRS), Jean-Claude Deustch (ENPC), Pierre Dumolard (UniversitéJoseph Fourié Grenoble 1), Jean-louis Fabiani (EHESS), François Gillet (PôleGrenoblois d'Etudes et de Recherche pour la Prévention des Risques Naturels),Dominique Henriet (Université de la Méditerranée), Christine King (BRGM), PierreLascoumes (CNRS), Romain Laufer (Groupe HEC), Jean-Paul Maréchal(université de Rennes 2), Pierre Muller (CNRS), Marc Poumadère (ENS), PhilippeUrfalino (EHESS), Jean-Luc Wybo (ENSM)Comité d'orientationPrésident : Philippe Huet (IGE)Membres : représentants des directions du MEDD (D4E, DPPR, DE), desAgences de l'eau, des DIREN, des DDAF, des SDIS, de l'Office National desforêts, du Cemagref, de l'INERIS, de l'IPGR, des ministères chargés del'agriculture, de l'équipement, de la recherche, de l'intérieur, de la DDSC, duHCFDC, d'associations (FNE, ANCMRTM, CARNACQ, Union des industrieschimiques), de représentants de l'assurance, des Chambres de commerce etd'industrie, du Palais de la découverte, du président du conseil scientifique et ducoordinateur du programme.Ministère de l'Écologie et du Développement Durable20 avenue de Ségur75 007 ParisLa retranscription des interventions et des débats a été réalisée par Anne-PauleMettoux, docteur es sociologie. <strong>Actes</strong> du colloque «Débat et prospective entrechercheurs, gestionnaires et décideurs du risque», organisé par le ministère del'Écologie et du Développement Durable et le Cemagref - Paris, 16 et 17 juin 2005.Secrétariat éditorial : Cemagref. Préparation et suivi de l'édition : Laura Belloni etAnne-Paule Mettoux (Cemagref). Imprimé et façonné au Cemagref.Dépôt légal : 2 ème trimestre 2006. Tous droits réservés ISBN 2-85362-660-1
PréfaceL’engagement du programme Évaluation et Prise en compte des Risques naturelset technologiques (EPR), dans le cadre du ministère de l’Environnement devenuministère de l’Écologie et du Développement durable, a marqué un tournant dansles recherches engagées en ce domaine. Alors que les travaux habituellementréalisés sur les différents types de risques visent à apporter les éléments deconnaissance permettant d’armer les décisions, ceux développés dans le cadre duprogramme EPR ont plutôt visé à déterminer comment ces connaissancespouvaient être appropriées par les acteurs à divers titres concernés par les risqueset leur gestion. Les recherches effectuées au sein du programme EPR témoignentde cette inflexion qui conduit à ne pas considérer comme allant de soi lespossibilités de transfert de connaissance, et, donc, à prendre en compte lescontraintes et attentes propres aux différentes catégories d’acteurs (notammentceux qui se situent au plus près du «terrain»).Ce retour vers les acteurs et plus largement vers la société renvoie à de nouvellesapproches de la gestion des risques. Celle-ci apparaît de moins en moins releveruniquement de la compétence de décideurs et d’experts centraux à qui ilreviendrait, en toute extériorité, de définir la nature des problèmes et de concevoirla manière de les régler. Un rôle accru est reconnu aux acteurs et aux collectivitésles plus directement impliqués dans la gestion des risques. Il est donc normal que,à travers les recherches, les dimensions locales, territoriales prennent une grandeimportance et que, sur cette base, le cercle des acteurs considérés s’élargissebien au-delà des sphères habituelles de la décision et de l’expertise. Il estégalement normal que les idées de concertation, de négociation voire deconfrontation soient présentes dans nombre d’analyses. Un large chantier s’estouvert dont les chercheurs s’efforcent de rendre compte à travers différentsterrains, en identifiant les logiques en cours ainsi que les prémisses deschangements à venir.La mise en œuvre du programme EPR (1999-2005) correspond probablement àune période de transition dont on voit de multiples signes mais dont la nature n’estpas encore complètement définie. À certains égards, nous sommes aujourd’hui aumilieu du gué. Il en résulte de nombreuses incertitudes qui favorisent l’engagementde débats et controverses, à caractère très général, sur les risques, avecl’intervention d’acteurs diversifiés relevant aussi bien de la sphère institutionnelle(comme, par exemple, les acteurs du monde judiciaire) que de la sphère noninstitutionnelle(comme les multiples représentants de la société civile). Longtempsconfinés dans des espaces de gestion spécialisés, les risques à caractère collectifsont véritablement devenus des «problèmes publics», ce dont, là encore, leschercheurs s’efforcent de rendre compte en analysant les débats, leur structurationet l’évolution des argumentations, etc.La recherche sur les risques, notamment en sciences humaines et sociales, setrouve donc confrontée à deux grandes questions : l’une correspond à un
«changement de régime» dans la gestion des risques, avec d’ailleurs dessituations variables selon les risques; l’autre à une «mise en débat public» desrisques qui ouvre sur de nombreuses questions dites de société. Bien qu’assezdifférentes, ces deux questions n’ont cessé de se croiser dans les recherches duProgramme EPR, rendant parfois malaisé le travail d’analyse. Mais leur prise encharge par les chercheurs, de façon parfois simultanée, tend à montrer le rôlespécifique qu’ils ont à jouer : produire de la connaissance tout en «portant àconnaissance» les incertitudes voire les contradictions existant aujourd’hui dans ledomaine de la gestion des risques. C’est ainsi que l’effort de recherche financé surfonds publics prend tout son sens.Claude GilbertDirecteur de recherche au CNRS (UMR PACTE et MSH-Alpes)Président du conseil scientifique du programme EPR.
SommaireOuverture du colloque – Objectifs et bilan du programme EPR 9 Éric Vindimian, Ministère de l'Écologie et du Développement Durable 9 Claude Gilbert, président du conseil scientifique 11 Philippe Huet, président du comité d'orientation 15Table ronde 1 : Dire le risque ? 19 L'évaluation des dommages, une méthode d'approche des risques,au-delà des préjudices matériels et humains : Claire Arnal 21 Pertinence et faisabilité d'une politique de gestion des risquestransports de matières dangereuses dans des agglomérations àforte concentration industrielle : Philippe Blancher 25 Risques naturels, information préventive dans les Alpes Maritimes :Valérie Godfrin 31 Étude de la demande sociale de surveillance environnementale desstockages de résidus miniers d'uranium : Claire Mays 35 De 1856 à 2003, les évolutions des rapports au risque inondation dansle delta du Rhône : Bernard Picon 39 Pour un observatoire informatisé des alertes et des crisesenvironnementales : Didier Torny 53 Débat 59Table ronde 2 : Intégrer la société civile dans la gestion du risque ? 73 Contestations associatives et régulation des conflits dans lapolitique de gestion des zones inondables : Cyril Bayet 75 Victimes, associations de victimes et prévention des risques collectifs:Geneviève Decrop 79 OGM et débat public - leçons des expériences participatives :Pierre-Benoit Joly 83 Les négociations sur la prévention des risques environnementauxpeuvent-elles être conçues comme un outil de décision collectiveefficiente ? : Bertrand Munier 87 Le quidam engagé. La «catastrophe naturelle» comme expériencedémocratique : Jacques Roux, Christian Magro et Philippe Brunet 93 Débat 99Autour de la valorisation du programme EPR 109Anne-Paule Mettoux, Cemagref 109Lionel Moulin, Ministère de l'Équipement, des transports et du logement 114
Table ronde 3 – Communications et débats : Permettre l'appropriationdes outils de la gestion des risques ? 117Cartographie, évaluation économique et dispositifs administratifscomme instruments d'une appropriation et d'une gestion collective durisque de ruissellement érosif. : Daniel Delahaye et David Gaillard 119Sensibilisation des PME/TPE à la réduction de leur vulnérabilité faceau risque de crue - un parcours long et sinueux : Richard Guillande 125Quelques éléments d'analyse sur les comportements des propriétairesforestiers face aux risques naturels encourus par la forêt :Stéphane Couture 129A trop bien défendre les maisons, on peut accroître le risqued'incendie : Claude Napoleone 133Le risque inondation et la cartographie réglementaire. Analyse del'efficacité, des impacts et de l'appropriation locale de la politique deprévention : Gilles Hubert et Bernadette de Vanssay 147Le principe de précaution saisi par le juge administratif.Enjeux politiques et sociaux de la mobilisation juridique du principede précaution : Rachel Vanneuville 159Les mécanismes de gestion contestable, vecteurs de l'appropriationdu risque par certains acteurs industriels. Contribution à uneéconomie des OGM : Olivier Godard et Thierry Hommel 167Table ronde 4 : Comment faire des retours d'expérience ? 175 Quelles données pertinentes pour une évaluation globale et intégréedu risque tempête en Ile-de-France ? (Exemple du 26 décembre1999) : Martine Tabeaud 177 Méthodologie de retour d'expérience interactif – REX Interactif.Retour d'expérience sur la prise de décision et le jeu des acteurs- le cas du cyclone Lenny dans les Petites Antilles au regard dupassé : Pierre-Marie Sarant 181 Méthodologie de retour d'expérience des actions de gestion desrisques : Jean-Luc Wybo 187 Production et diffusion des connaissances suite à un désastretechnologique - mécanismes incitatifs et institutionnels :Emmanuelle Fauchart 191 Débat 195Table ronde 5 : Connaître des expériences étrangères en matière degestion des risques ? 199La protection contre les inondations en France et en Angleterre.Des mesures structurelles à la réduction des vulnérabilités :Bernard Barraqué 203Évaluation économique du risque d'inondation, comparaisonFrance / Pays-Bas : Jean-Roland Barthélémy 207
Les pluies diluviennes au Saguenay des 19 et 20 juillet 1996 -Un regard sur l'expérience québécoise : Bruno Ledoux 211 De l'usage de l'incinération - une comparaisonFrance / Danemark / Pays-Bas : Nicolas Buclet 215 Débat 219Conclusions du colloque, perspectives 227Claude Gilbert, président du conseil scientifique 227Philippe Huet, président du comité d'orientation 231Éric Vindimian, MEDD, D4E 233Thierry Trouvé, MEDD, DPPR 235Suite à des incidents d'enregistrement au cours de la table-ronde n°3, les actes ontétés rédigés, de la page 133 à la page 171, à partir des communications écritesdes intervenants et de notes prises par des participants.
Ouverture du colloqueObjectifs et bilan du programme EPRÉric Vindimian, Ministère de l'Écologie et du DéveloppementDurableJe voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette salle du ministère. Aujourd’hui,nous allons brasser beaucoup d’idées avec un objectif extrêmement important quiest celui de la recherche en appui aux politiques publiques. Cette recherche a lemême critère d’excellence que la recherche dite fondamentale. La seule différenceest qu’elle est orientée par un objectif. L’objectif, dans notre cas, est d’appuyer,d’éclairer les politiques publiques de l’écologie et du développement durable, et enl’occurrence, pour ce qui concerne le programme EPR, les politiques publiques degestion des risques.Le service de la recherche et de la prospective a financé ce programme EPR,Evaluation et Prise en compte des Risques naturels et technologiques. On se rendcompte en relisant ce titre, que cet univers que nous avons cherché à couvrir, defaçon forcément imparfaite, est extrêmement vaste. Mais, il fallait se lancer et nousl’avons fait, avec l’idée de relier recherche académique et rechercheopérationnelle, d’articuler l’expertise et la recherche. En cela, nous avons utilisénos outils classiques : un programme de recherche, gouverné selon un modebicamériste, avec un conseil scientifique et un comité d’orientation.Le conseil scientifique a été présidé par Claude Gilbert que je remercie. Le conseilscientifique a un rôle extrêmement important, celui d’évaluer tous les projets, derejeter systématiquement tout ce qui n’est pas de la «bonne science» et égalementde co-construire avec nous et avec le comité d’orientation la problématique derecherche. L’expérience nous prouve qu’à partir du moment où on veut travaillerpar objectifs, si on se contente d’interroger les opérationnels sur leur demande derecherche, les commandes exprimées conduisent à des études. Cette situation estliée au fait qu’un opérationnel a des besoins à résoudre et donc son idéeimmédiate correspond à la mise en place d’une étude. Cela ne signifie pas qu’il n’apas d’idées de recherche mais plutôt qu’il n’est pas forcément en situation de lesfaire émerger. En revanche, quand on fait travailler des scientifiques et desresponsables de politiques publiques en leur demandant de co-construire uneproblématique de recherche, le résultat se présente sous la forme de questions derecherche. Donc, le conseil scientifique a une importance significative. Il estégalement évaluateur. Évaluation à laquelle nous procédons également aposteriori, ce qui est une originalité de ce ministère.Le comité d’orientation est celui qui m’aide à prendre la décision finale definancement des projets, qui définit les orientations générales du programme, quipar symétrie co-construit avec le conseil scientifique la problématique derecherche. Il est formé des responsables des politiques publiques qui sont parties9
prenantes dans l’enjeu. Il est bien entendu interministériel puisque la recherches’applique à des politiques publiques qui ne sont pas simplement des politiques duministère de l’Écologie. Dans le domaine des risques, beaucoup de ministères sontparties prenantes et ils sont tous invités autour de la table du comité d’orientation.Philippe Huet a animé avec beaucoup de fougue, de motivation et de compétencece comité d’orientation. Je le remercie. Il faut également souligner le rôle et lacompétence du chargé de mission du Ministère de l’Écologie. A ce titre je tiens toutparticulièrement à ajouter à mes remerciements, ceux pour Sylvie Charron qui faitle travail actuellement, un travail extrêmement lourd puisque qu’elle anime en plusle Comité de Précaution et de la Prévention. Auparavant, Geneviève Baumont etAnnie Erhard-Cassegrain étaient les chargées de mission de ce programme.Pour que l’animation soit complète, nous nous appuyons sur un animateur, enl’occurrence le Cemagref qui a été extrêmement efficace et je remercie Jean-PaulNobécourt, Jacques Joly, Anne-Paule Mettoux et Laura Belloni qui nous ontapporté beaucoup pour ce programme.Donc, ce programme s’est plutôt bien passé, cependant il embrassait un champextrêmement large. Or, quand on embrasse un champ extrêmement large, on atendance à se diluer. D’où la grande diversité des travaux et effectivement, unecertaine frustration qui peut émerger. Un certain nombre de résultats sontmarquants, notamment concernant l’importance de la vulnérabilité. Quand on parlede risque, on se pose toujours la question intrinsèque de l’aléa, mais lavulnérabilité est également un sujet extrêmement important. Le programme a bienpermis de le mettre en avant. Un autre sujet essentiel a été mis en évidence : lerôle de la société civile dans la gestion des risques. Ce n’est pas seulement unproblème d’expert. Se concentrer sur la relation chercheurs-experts ne rend pascompte de l’ensemble. D’autres programmes, notamment le programme quis’appelle Concertation, Décisions et Environnement traitent de ce sujet. Pour lesrisques, c’est particulièrement important. Le retour d’expérience aussi. Leprogramme n’a pas créé cette notion mais la recherche sur le sujet a été biendéveloppée. On sait mieux maintenant qu’il faut évaluer les risques au départ, lessurveiller et ensuite faire le bilan. Il y a des méthodologies de retour d’expérience.Il ne suffit pas d’écouter les acteurs, il faut mettre en œuvre des méthodologiespour bien comprendre ce qu’ils ont fait, ce qu’ils ont dit, ce qu’ils ont voulu dire, cequ’ils n’ont pas dit et en tirer les conséquences utiles pour une meilleure évaluationdes risques et une meilleure gestion. On a également commencé à aborderl’aspect économique parce que des choix sont nécessaires, et que, pour choisir, iln’y a rien de tel que de traduire en euros. Cet aspect économique dans la gestiondu risque me paraît important. Il a été effleuré par le programme. Cette frustrationgénérale nécessitera un nouveau développement.Suite aux réunions du conseil scientifique et du comité d’orientation, et auxrelectures des résultats de recherche, trois rapports ont été proposés à lapublication : le rapport de Bernard Picon qui a travaillé sur les risques d’inondationdans le delta du Rhône, le rapport de Francis Chateauraynaud qui a un outillogiciel tout à fait intéressant pour la gestion des alertes et de l’inquiétude du publicet Rachel Vanneuville sur le principe de précaution et le rôle des acteurs du droit,de l’appropriation. Je voudrais féliciter ces chercheurs parce que si ces rapports10
ont été détectés, c’est qu’ils relevaient de la «bonne» science mais également dela science mise à disposition des acteurs des politiques publiques. Voilà pourquoinous aimerions publier ces rapports pour faire date, pour que cette information soitdisséminée et ne reste pas dans le cercle des proches de ce programme même sice cercle est déjà assez large.Ce colloque a pour objectif le dialogue. Donc, ce n’est pas une simple série deprésentations. Cinq tables rondes sont prévues avec dix animateurs, deuxanimateurs pour chaque table ronde. Je les remercie tous, car sans eux, cecolloque n’aurait pas lieu. Pour terminer, je vous remercie d’être venus et j’espèreque vous n’hésiterez pas à poser les questions iconoclastes, à apporter toute votrefougue sur ce sujet, à dire tout ce que vous avez envie de dire. Il n’y a pas depolitiquement correct même si on est dans un ministère. Nous sommes là pourfaire avancer les idées. Rien ne pourra être retenu contre vous. Faites que cettejournée soit créative. C’est de la confrontation des idées que viendra la suite dontje vous reparlerai quand je viendrai faire la conclusion de ce colloque. Je voussouhaite un très bon colloque.Claude Gilbert, Président du conseil scientifiqueLes activités au sein du Programme EPR ont été nombreuses et riches (unetrentaine de recherches, différents séminaires de suivi et de valorisation, etc.). Cecolloque va être l’occasion de procéder à un premier bilan d’ensemble. Mais,d’ores et déjà, quelques remarques préalables peuvent être faites aussi bien poursouligner la portée de ce programme que pour indiquer certaines de ses limites.Les recherches réalisées ainsi que les réflexions développées dans le cadre desmultiples séminaires ont de toute évidence permis d’aborder une variété dequestions dans différents domaines touchant à la gestion des risques. Mais, lesobjets au cœur de ce programme ont été diversement investis. Si les risques dits«naturels» ont été plutôt bien couverts, c’est moins vrai pour ce qui concerne lesrisques technologiques. Pour des raisons d’ordre scientifique, administratif,politique aussi, il apparaît toujours difficile d’engager des travaux dans ce domaine.C’est particulièrement le cas lorsque survient un accident majeur. Ainsi, et pasuniquement pour des problèmes de calendrier, n’a-t-il pas été possible de lancerune action spécifique de recherche à la suite de l’accident d’AZF. Il y a donc lieude s’interroger sur la façon dont s’organise l’agenda scientifique dans le cadre deprogrammes comme EPR, sur la façon aussi dont nous pourrions envisager desinvestigations rapides en cas d’accidents majeurs ou de catastrophes naturelles(même si, dans ce dernier cas, quelques initiatives ont pu être prises).Les approches des chercheurs sont très diverses, tout autant que les courants derecherche représentés. Il en résulte une incontestable richesse. Mais lacontrepartie est la difficulté qu’il peut y avoir à organiser des débats autour dethématiques et de problématiques relativement bien cernées. Cela retentitinévitablement sur le degré de structuration et le mode de fonctionnement de la«communauté» de chercheurs qui, à divers titres, se saisissent de la question desrisques naturels et technologiques. Curieusement, c’est plutôt autour d’autres11
isques et situations d’incertitude (sida, OGM, ESB, amiante, ondesélectromagnétiques, etc.) qu’un réseau de chercheurs s’est structuré enpartageant divers cadres d’analyse (cf. les travaux autour du GIS RisquesCollectifs et Situations de Crise, auquel était associé le ministère de l’Écologie).Lors de l’engagement du programme EPR, et cela a été rappelé par EricVindimian, le caractère finalisé des recherches avait été souligné. L’objectif étaitque les acteurs puissent, directement ou indirectement, s’approprier les résultatsdes recherches. Pour certains travaux, cet objectif a été atteint. Mais une grandepartie des recherches reste déterminée par une logique académique. Il n’est pasanormal que les chercheurs se réfèrent principalement à leur universd’appartenance, leur carrière dépendant des publications et appréciations faitespar leurs pairs. S’engager dans une recherche finalisée, souvent confondue avecl’expertise, ne va pas sans «prise de risque», professionnellement parlant. Ilconvient donc, plus que cela n’a été fait jusqu’à présent, de s’interroger sur cettesituation si nous voulons que des transferts de connaissance s’effectuent dans debonnes conditions.Par ailleurs si les recherches ont permis de réelles avancées sur un grand nombrede points, certaines questions demeurent encore insuffisamment traitées. Nousn’avons par exemple toujours pas de vision synthétique, risque par risque, desdifférents acteurs impliqués dans leur gestion (qu’ils relèvent de la recherchefondamentale, de l’expertise, des mondes de l’administration, de l’économie, dusecteur associatif, etc.). Or, les configurations d’acteurs ainsi que les typesd’interaction entre acteurs varient considérablement d’un secteur à l’autre. Lesrisques naturels, par exemple, sont pris en compte par une multiplicité d’acteurssans que l’on puisse toujours identifier un pôle structurant. Par contre, les risquestechnologiques font l’objet d’une plus forte appropriation, certains acteurs exigeantmême d’en être les «propriétaires». Mieux comprendre, au-delà des visionsformelles des organigrammes, quelles sont les grandes logiques et dynamiques ausein de chaque secteur apparaît important.Sur les aspects financiers, économiques, nous avons également peu progressé.Malgré l’importance de cette dimension, nous ne savons toujours pas compter,évaluer, mettre en rapport les coûts d’une politique de prévention et les coûtsd’une politique de réparation. Ce problème, depuis longtemps pointé, a clairementété affiché par le programme EPR, mais sans que l’on ait vraiment réussi àmobiliser les chercheurs susceptibles de le traiter. Faut-il pour cela s’adresser auxéconomistes, comme nous l’avons tenté, ou bien aux statisticiens, aux comptablespublics ? Toujours est-il que, pour le moment, nous manquons toujours dedonnées et d’analyses alors que, de toute évidence, elles seraient particulièrementprécieuses pour guider l’action publique.Un dernier point, au cœur de la réflexion sur les risques, demeure encoreproblématique. Il a trait à la notion de la vulnérabilité (telle qu’elle est notammenttraitée dans le domaine des risques naturels). Pour appréhender cette notion, noussommes toujours dépendants du cadrage des risques tel qu’il est effectué par les«sciences dures». Encore aujourd’hui, une confusion s’opère entre risque et aléa,tant la part de l’aléa semble déterminante dans la définition d’un risque. Quant à la12
vulnérabilité, elle tend à se réduire à de «l’endommagement» (aux atteintessusceptibles d’être portées aux «enjeux», pour reprendre les termes usuels). Ainsicomprise, la notion de vulnérabilité est assez restreinte. Or, aussi bien les acteursque les chercheurs savent que la vulnérabilité d’une collectivité à un aléa (ou à unensemble d’aléas) tient à la manière dont elle est organisée, dont elle fonctionne;au degré d’attention qu’elle porte aux menaces; aux ressources qu’elle dégagepour développer des connaissances, engager des actions pérennes dans cedomaine, etc. C’est tout un ensemble qui fait qu’une collectivité, une ville, unesociété est plus ou moins vulnérable à un aléa, divers types d’indicateurs pouvantêtre produits en ce sens. Dans l’état actuel, nous ne savons encore pas penser lerisque à travers la vulnérabilité. Il est ainsi peu concevable pour une partie despouvoirs publics, des experts et des scientifiques relevant des «sciences dures»qu’un risque de grande ampleur puisse résulter du croisement d’un aléa mineuravec d’importantes vulnérabilités. Vulnérabilités pouvant découler d’unecoopération insuffisante entre les acteurs impliqués dans la prévention, la gestionde crise, d’un mauvais arbitrage entre l’ensemble des impératifs devant être prisen compte, notamment au plan local, d’une articulation insuffisante entre sciencesfondamentales et appliquées pour certains risques, etc. Malgré l’engagement dequelques travaux dans ce sens, nous en sommes encore au début de la réflexionsur la vulnérabilité.Si nous avons progressé dans le cadre du programme EPR et de programmesvoisins au sein du ministère de l’Ecologie, beaucoup reste donc à faire. C’est laraison pour laquelle le conseil scientifique a préconisé une formule un peuinhabituelle pour l’organisation de ce colloque. Plutôt que d’inviter les équipes àprésenter, de manière un peu formelle, leurs résultats, nous leur avons proposé unautre dispositif. Nous avons tout d’abord assuré une large publicité aux rapports derecherche (en les mettant en ligne, en réalisant des posters). Par ailleurs, nousavons demandé aux responsables des équipes de nous indiquer en quoi leurstravaux avaient permis de répondre à quelques grandes questions que nous nousposions au début du programme et qui, aujourd’hui encore, nous semblentpertinentes.La première question se centre sur «dire le risque». Peut-on vraiment dire lerisque ? Peut-on effectivement, concrètement enregistrer l’existence d’un dangerdans un lieu, dans un espace donné ? Cette question peut surprendre par sasimplicité. Mais, dans bien des domaines, dire le risque, l’afficher ne va toujourspas de soi.La seconde question concerne l’intégration de la société civile dans la gestion desaffaires publiques et notamment la gestion des risques. Au-delà d’une certaineconvention de discours, quelle est aujourd’hui la réalité d’une telle intégration,quelle volonté y a-t-il aussi pour qu’elle survienne ? Quels acteurs sonteffectivement parties prenantes dans la gestion des risques ? Comment, dansquelles circonstances ?La troisième interrogation porte sur les outils de la gestion des risques. Certainsoutils sont conçus par des organismes scientifiques, des organismes d’expertise.Dans quelle mesure sont-ils véritablement appropriés par les acteurs à divers titres13
concernés, et avec quels effets observables dans la gestion des risques au plusprès du terrain ?Une autre question a trait au retour d’expérience. La nécessité de procéder auretour d’expérience est régulièrement affirmée. Mais que fait-on vraiment,comment et dans quelles circonstances ? Peut-on par exemple parler de «retourd’expérience» à propos de l’accident d’AZF malgré les nombreux rapports qu’il asuscités ?L’ensemble de ces questions ont été préalablement adressées aux chercheurs.Avec Philippe Huet nous avons confié à des représentants du conseil scientifiqueet du comité d’orientation, le soin d’animer conjointement les différentes tablesrondes. Les animateurs ont pris contact, à notre initiative, avec les chercheurs. Ilsse sont rencontrés, ont beaucoup échangé. Bref, une dynamique est née. Je lesremercie tous vivement de cette implication. En procédant ainsi, nous avonssouhaité que s’engage un large débat au sein des tables rondes et avec le public.L’objectif poursuivi est aussi de préparer des questionnements pour desprogrammes à venir, sachant que le relais est déjà pris par le programme RDT,Risque, Décision et Territoires.Pour conclure, je voudrais remercier l’ensemble des personnes qui ont permis laconduite de ce programme depuis 1999. Tout d’abord les membres du conseilscientifique qui en ont constitué l’épine dorsale. Ils ont été un pôle de stabilitéimportant lors de ces six années marquées par des «aléas» de toute sorte(administratif, financier). Ensuite les équipes, notamment celles de la premièrephase, qui ne se sont pas laissées décourager par un mode de gestion complexe.Je remercie également les personnes du ministère, alors de l’Environnement etmaintenant de l’Écologie. En premier lieu, Annie Erhard-Cassegrain, qui a joué unrôle tout à fait déterminant. C’est notamment sur elle qu’a reposé l’élaboration dupremier appel à propositions. En second lieu, Geneviève Baumont qui nous aaidés à naviguer dans les incertitudes. En troisième lieu, Sylvie Charron qui, endénouant de nombreux problèmes (aussi bien d’ordre scientifique, administratifque financier), a rétabli un mode de fonctionnement propice à la conclusion duprogramme. L’organisation de ce colloque lui revient d’ailleurs très largement. Jetiens également à remercier différents membres du Cemagref qui avaient encharge la gestion du Programme EPR. Jean-Paul Nobecourt et Jacques Joly, quiont su rendre à nouveau gérable ce qui ne l’était plus. Anne-Paule Mettoux qui,dans le cadre du Cemagref, a été la «cheville ouvrière» de nombreuses actions dece programme, en les portant, quelles que soient les circonstances. Nous luidevons notamment d’avoir pris en charge les séminaires de suivi des recherches,une partie de l’organisation de ce colloque, la réalisation de ses actes, etc. Enfin,je remercie Isabelle Bourdeaux du CNRS qui m’a assisté et conseillé tout au longdu programme EPR et m’a ainsi permis d’assumer, malgré diverses autrescharges, mes fonctions de président du conseil scientifique.Pour terminer, je tiens à saluer Philippe Huet, président du comité d’orientation,personnage exigeant, impatient qui attend souvent de la recherche plus que cequ’elle peut donner, surtout dans de brefs délais. Au cours des ans, il n’a jamaisoublié de rappeler la nécessité d’établir un lien fort entre la décision et la14
echerche, notamment la recherche en sciences humaines et sociales qu’il arégulièrement invitée à «prendre le risque» de l’expertise (en réalisant desexpériences très novatrices en ce sens). De même n’a-t-il jamais cessé, dans uneposture de fonctionnaire, de rappeler les exigences en matière de service public. Ila donc joué un rôle tout à fait important dans le déroulement de cette opération.Au terme de ce colloque, il reviendra au ministère de l’Écologie de précisercomment il entend poursuivre son effort de recherche dans le domaine des risquesnaturels et technologiques. Eric Vindimian s’est déjà saisi de ce dossier, ce dont jele remercie vivement. Une initiative a été prise récemment dans le cas des risquesindustriels avec la création d’une fondation de recherche qui associe industriels,collectivités locales et organismes de recherche (Fondation pour une Culture deSécurité Industrielle). Il y a là des enjeux importants. Il est essentiel de concevoirde nouveaux types de coopération pour ce qui concerne les risques industriels.Concernant les risques «naturels», il convient de réfléchir sur la place que peuventet doivent avoir les chercheurs en sciences humaines et sociales dans unprogramme comme RDT, a priori plus tourné vers les «sciences dures». Lespossibilités d’échanges interdisciplinaires mériteraient d’être encore plusexplorées. Il conviendrait de saisir l’opportunité de ce programme, etéventuellement d’autres actions, pour stabiliser un réseau de chercheurs,associant divers champs scientifiques, diverses disciplines, dans le domaine desrisques «naturels». C’est ainsi seulement que l’on pourra reformuler la questiondes risques, en situant au même niveau de complexité l’analyse des aléas et celledes vulnérabilités. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un boncolloque.Philippe Huet, Président du comité d’orientationEn préalable, pour nous aussi, cela n’a pas été facile de travailler avec leschercheurs. Je retiens la conclusion de Claude Gilbert, qui peut se traduire par : «ilfaut continuer et il y a toujours quelque chose à co-construire». C’est plus quejamais ma conviction et j’espère qu’au cours de ces deux journées, cela apparaîtrabien. Pour illustrer ces propos, le programme EPR était un programme d’aide à ladécision publique. C’était l’orientation. Voilà des extraits de l’appel à propositionsque nous avons co-rédigé. Je me souviens très bien que c’est Claude Gilbert qui afait, avec sa plume brillante, le premier jet, et on a beaucoup travaillé avec leministère, avec les différents membres du comité d’orientation pour avoir un texteconsensuel. Dans ce texte, on peut lire que le programme doit être à la charnière,voir à l’aval des programmes de recherche des grands organismes. Il s’agit pour leprogramme, non seulement d’acquérir de nouvelles connaissances, mais de lesvaloriser pour des outils quasi opérationnels : «répondre à des besoins d’acteurs,notamment de la décision publique.». On a appris en cinq / six ans à mieux seconnaître, et je remercie beaucoup les chercheurs d’avoir accepté de descendredans l’arène, de frotter leur imagination féconde aux réalités un peu immédiatesauxquelles nous avions à faire face. Pour nous, fonctionnaires d’exécution, c’estune très grande sécurité de savoir que l’on a autour de nous, une équipe à qui onpeut dire : «nous avons été sur le terrain, voilà la question, qu’est-ce que vous en15
pensez ?» La capacité du chercheur à conceptualiser les choses, à prendre durecul, à faire des comparaisons, nous aide à gagner beaucoup de temps.Finalement, quels sont les produits du programme ? Je vous rassure, on a faitbeaucoup de choses. Qu’est-ce qu’il y avait dans l’appel à propositions ? D’abord,on parle de prévention, pas de gestion de crise. On parle de prévention et de cequi vient après la crise. Deuxièmement, on parle de tous les risques, avec prioritéà ceux qui concernent le MEDD, risques naturels et technologiques. Cela veut direy compris les risques de santé, et j’ai vu qu’il y a un médecin qui s’est inscrit. Celanous intéresserait beaucoup d’avoir son point de vue. Ensuite, valorisation d'outilsquasiment opérationnels. Trois thèmes principaux avaient été proposés dansl’appel à propositions : la mesure des risques, dont l’économie, l’appropriation desrisques, c’est-à-dire des différents outils des risques par les différents acteurs etl’organisation de la décision publique.Dans le dispositif structurant le programme autour du donneur d’ordre, quel a étéle rôle du comité d'orientation ? Ce dernier est intervenu à divers niveaux, sur letexte lui-même de l’appel d’offres et sur les propositions, à la suite du conseilscientifique. C’est très important, on ne s’est jamais affranchi de la règle. LorsqueClaude Gilbert venait rapporter aux membres du comité d’orientation lespropositions des chercheurs en disant, «scientifiquement, cela ne tient pas laroute», nous n'allions pas plus loin. On disait : «tiens, le sujet est intéressant, c’estdommage que la proposition ne soit pas satisfaisante. Cela vaudrait le coup dereposer la question à d’autres». La barrière de qualité scientifique a été pour nousabsolue. Ensuite, il y avait une double évaluation par le conseil scientifique et parle comité d'orientation; on regardait ce que nous pouvions faire avec les résultatsde la recherche, comment les valoriser et donc quelle était la distance entre lerésultat et l’opérationnel ?Le comité d’orientation était composé de 25 membres dont le président du conseilscientifique, des membres des administrations, des collectivités, desprofessionnels de l’assurance, des industries chimiques et des associations. Jetiens à les remercier tous de leur assiduité : lors des réunions, on était toujours aumoins une vingtaine. Lorsqu’on demandait aux uns et aux autres de relire lesrapports et je vous garantis que les rapports scientifiques ne sont pas du «SanAntonio», ils les ont toujours lus, et ont toujours pris la peine de donner un avis. Jetiens à les en remercier.Au titre du bilan, avec le conseil scientifique, les échanges ont été pour nous trèsutiles. Même si on piaffe en disant, «mais cela, je le sais depuis très longtemps, etaprès que fait-on ?» On a souvent dit «et après». En même temps, la distance quele conseil scientifique prend vis-à-vis de certaines choses nous a aidés. Il y a eu 80réponses à l’appel à propositions. Le conseil scientifique et le comité d'orientationen ont sélectionné 30. Sur les 30, il y en a 27 qui sont arrivés au bout, et qui vontvous être présentés. C’est dire qu’à la fois, cela a suscité beaucoup d’intérêt etqu’il y a eu une sélection.Quelques mots sur le contenu des résultats : six risques naturels et quatre risquestechnologiques ont été abordés. C’est vrai que pour les risques technologiques, il ya eu moins de propositions et que les approches ont été sans doute plus distantes.16
Que peuvent nous apporter les chercheurs ? Des avancées conceptuelles, nousobliger à relire autrement, à aborder par un autre angle les problèmes quotidiens.J’estime qu’il y a au moins trois rapports qui, sur le plan conceptuel, ont aidé àrenouveler certaines approches. Ensuite, il y a six rapports qui ont l'ambition dedéboucher sur des propositions de méthodes. De type classique -comme le retourd’expérience- ou un peu moins classique pour nous, par exemple : «commentrelire l’histoire et la géographie d’un territoire affecté par une inondation au fil deschangements sociaux. Quelle est la lecture d’il y a un siècle, quelle est celle quel’on a aujourd’hui ?». Ou bien encore: «comment les petites et moyennesentreprises peuvent aborder le risque inondation ?» Mais le plus grand nombre derapports proposent plutôt des analyses, des études, des monographies qui portentsur les acteurs. Il y a par exemple un travail sur l’attitude des sylviculteurs après latempête vis-vis de l’assurance. Quelle est l’attitude de ceux qui viennent urbaniseren forêt ? Quel est leur motivation ? Quelle est l’attitude du juge administratif ? Onprend un acteur et on voit ce qu’il fait. Quelle est l’attitude d’une association devictimes, d’une association de riverains, d’une association de protection del’environnement ? Ce sont des décodages qui nous sont bien utiles. Troisexpériences étrangères nous seront présentées. Puis des analyses d’outils :«Jusqu’où peut-on aller avec un PPR ? Que veut dire l’information préventive,comment est-elle perçue ? Quelles sont les échelles de risques, comment lesconstruire, etc…» Voilà le type de résultats qui vont vous être présentés en détails.Je termine sur les enjeux du colloque vus par le comité d’orientation. Laconception en est due à l’équipe de Claude Gilbert à laquelle nous nous sommesassociés. Nous en attendons un dialogue entre les chercheurs et les différentsacteurs. La scène du risque est une conception des chercheurs. J’ai essayé declasser les 248 inscrits au colloque, par rapport à la scène du risque. Tous lesacteurs de la scène du risque sont à peu près là, sauf les tribunaux. Mais il y aparmi vous des juristes. Au centre, les chercheurs, environ 67 inscrits soit unequinzaine de labos qui ont participé ou non à la recherche. Autour, il y a l’État, sixministères parce qu’il y a aussi la Santé et les Affaires Étrangères en plus desministères classiques Intérieur, Équipement, Environnement bien sûr, Agriculture.Dix services déconcentrés (DDE, DDAF, DIREN), des élus (douze parlementairesse sont inscrits) et puis les représentants de collectivités (des Conseils généraux,des Conseils régionaux, des établissements publics de bassin). Ensuite, lesprofessionnels. Voilà qui est pour nous une très bonne surprise. Dans lesprofessionnels, plus de 15 bureaux d’études se sont inscrits, ce qui devrait donnerlieu à des débats très intéressants sur le passage de la recherche à l’expertise.Leur présence est un vrai signe encourageant. Il y a aussi dix agences publiqueset établissements publics très techniques, type Météo-France, Agence de bassin,INERIS, etc. Les professions sont présentes, ainsi que les assureurs, c’estrelativement nouveau et nous en sommes très heureux. Il y a un représentantd’une étude notariale, un représentant de l’immobilier. Tout cela va dans le bonsens; il y a aussi des sociétés industrielles de production. Il y a plus d’une dizained'associations, de toutes les catégories, environnement, riverains… J’en profitepour saluer la fidélité du CARNACQ qui a toujours été là. Il y aussi les organismes PPR: Plan de prévention des risques17
de formation. Bien sur, il y a les enseignants-chercheurs, universitaires. Il y a aussiune bonne dizaine d’écoles d’ingénieurs au côté d'une quinzaine d’universités. Engros, nous sommes ici une petite scène du risque et je pense que la pièce quenous allons jouer ensemble, sous la houlette bienveillante d’un juge absent, seratout à fait intéressante.Je termine en disant que nous sommes tout à fait convaincus que la décisionpublique, l’expertise publique, l’opérationnel se porteront d’autant mieux querégulièrement, ou même d'une manière continue, on sait prendre la distance qu’ilfaut avec les collègues dont le métier est justement de réfléchir, d’imaginer, dereprésenter, de proposer des lectures. Ce lien doit absolument se développer, sepérenniser. Avec quels moyens ? J’espère que demain après midi, au moment dela conclusion, on aura avancé là dessus.Un tout dernier mot. Le programme EPR, représente des moyens significatifs, unedurée, beaucoup de monde. Ce sera à vous de dire à la fin : «est-ce que cela aproduit une série de poussières, une pierre de taille dans le dispositif ou même unepierre angulaire dans les relations entre opérationnels et chercheurs sur lerisque?» Merci beaucoup.18
Table ronde 1 : Dire le risque ?Cette table ronde était centrée sur la question de l'énonciation durisque.Afficher les risques et prendre en compte leur réalité sur le terrain, enintégrant les contraintes, suscitent de nombreuses difficultés. Quelssont ces obstacles ? Comment les surmonter ?Co-animateurs :Gérard Brugnot, CemagrefFrançois Barthélémy, CG des MinesIntervenants :Claire Arnal, BRGMPhilippe Blancher, Asconit ConsultantsValérie Godfrin, ARMINES ENSMClaire Mays, SYMLOGBernard Picon, CNRSDidier Torny, EHESSGérard Brugnot, CemagrefJ’ouvre solennellement la première table ronde. Elle est centrée sur le thème «direle risque». Dire le risque repose sur des outils, par exemple les systèmesd’information géographiques qui reposent eux-mêmes sur des moyens au sensétymologique, médias, Internet, moyens de communication, et sur des procédures.En France, on est très riche sur les procédures, notamment dans ce domaine19
(plans de prévention des risques, naturels puis technologiques, informationpréventive, etc.). Six exemples illustrent ce souci de dire le risque, de le «porter àconnaissance». Le programme a duré sept ans, la plupart des recherches ont durédeux ou trois ans. Résumer ce type de travaux en dix minutes n’est pas possible.L’intérêt de ces exposés sera donc de préparer, d’introduire la table ronde qui vasuivre mais surtout de prolonger cette table ronde lors de débats qui pourront avoirlieu pendant cette journée dans les couloirs. Vous aurez tous une bonneconnaissance de ce que font les intervenants, même si cette connaissance estimparfaite et résumée.20
L’évaluation des dommages, une méthode d’approchedes risques, au-delà des préjudices matériels et humainsClaire ArnalBRGM117 avenue de Luminy, BP 168, 13 276 Marseille Cedex 09Tél : 04 91 17 22 93c.arnal@brgm.frCe travail porte sur la réalisation d’une échelle de dommages. L’objectif était detrouver les moyens pour exprimer quelles sont les conséquences d’un événementlié à un aléa donné. Celles-ci ne sont généralement pas exprimées autrement quesous forme d’un nombre de dommages humains, morts, blessés ou sans abri, etsous forme de coûts financiers. Disposer d’un outil qui permette de les exprimersuivant différents concepts, représentant le point de vue de différents typesd’acteurs, nous a paru essentiel.Nous nous sommes calés sur la problématique des cavités souterraines parce quec’est un aléa qui fait partie du champ de nos compétences. Mais l’outil a étédéveloppé en ayant présent à l’esprit qu’il fallait qu’il puisse se déclinerultérieurement sur d’autres types de phénomènes.Ces travaux ont été réalisés de façon pluridisciplinaire, c’est-à-dire que nous avonsassocié, d’une part, des chercheurs connaissant l’aléa et d’autre part, deschercheurs ou des spécialistes d’autres disciplines dont Deschanels consultantsqui travaille dans le domaine du risque industriel et le Laboratoire de psychologiede Metz. Nous avons également travaillé avec l’INERIS pour la partie aléa et poursa pratique des collectivités et le LAEGO qui est le laboratoire de recherche del’école des Mines de Nancy pour les outils de mesure.La recherche s’est déroulée en deux temps; d'une part nous avons réalisé uninventaire des outils existants et d'autre part, nous avons construit notreméthodologie pour fabriquer notre outil.La première phase a concerné le recensement des échelles existantes etl'élaboration d'une typologie de dommages. Cette analyse n'existait pas et elle aété réalisée pour cette étude. Synthétiquement, plusieurs types d’échelle peuventêtre distingués. Elles ont pour objet la description et l’évaluation :- des événements, type échelle de Beaufort avec une intensité du vent,- des dommages avec pour objectif d’évaluer l’intensité d’un événement(échelle de Richter),- des niveaux de dommages à un bien donné (HAZUS pour les séismes).Cependant, il n’existe pas d’échelle décrivant les dommages globaux dus à unévénement donné, hormis l’échelle développée par le MEDD qui est calée surdeux paramètres, le nombre de morts et les coûts financiers, et l’échelle de risques21
industriels qui est basée sur un certain nombre de paramètres type dommages àl’environnement, coûts, dommages humains, etc.Ainsi, aucun outil ne permet de décrire des dommages fonctionnels. Pourtant, lefait qu’une société puisse se retrouver paralysée parce que deux routes sontcoupées alors que personne n’est mort, ou parce qu’il n’y a pas d’hôpital à moinsde 50 kilomètres, constitue bien un dommage. Il n’existe rien susceptibled’exprimer quels pourraient être ou quels sont les dommages fonctionnels, ni quelssont les impacts économiques ou sociaux ou environnementaux. C’est pourquoinotre outil a pour souci d’exprimer ces dommages. Il reste cependant à le testersur de nombreux cas pour parvenir au domaine de l’opérationnalité la plus totale.Le principe est le suivant. On part d’un événement. On constate des dommagesphysiques et on suppose ou on observe que ces dommages physiques ont desconséquences qui sont fonctionnelles et qui ont des impacts économiques, sociauxou environnementaux. Je dis bien des impacts et non pas des dommages car onpeut très bien avoir, lorsqu’on a des dommages physiques un impact économiquepositif. A titre d’exemple, il est connu que si les guerres sont des événementsdésolants, elles ont souvent un impact économique positif, au moins pourcertaines.Dans la construction de notre échelle, la typologie d’un dommage, en tant quetelle, est décrite, qu’il s’agisse d’un bien ou d’une fonction. Ensuite, à l’aide decette typologie, les dommages de l’événement sont globalement décrits.La typologie des dommages aux éléments physiques concerne des dommagesaux personnes, aux biens et aux milieux. Les niveaux de dommages sont établissoit en considérant que le vital, le structurel ou l’irréversible en matièred’environnement sont atteints, soit que c’est du non vital, du non-structurel et duréversible qui sont affectés. Cette analyse est effectuée par analogie avec laméthode développée pour l’échelle de dommages HAZUS développée dans ledomaine sismique. A titre d’exemple, les dommages aux personnes ont étéclassifiés en 4 catégories qui vont d’organes vitaux non atteints et des blessuressuperficielles à des organes vitaux atteints et des troubles irréversibles.Pour l’analyse des dommages fonctionnels, trois paramètres sont pris en compte,ce qui est assez novateur. Dans l'analyse classique, seuls les critères d’intensitédu dysfonctionnement et de durée sont considérés. L’intensité dudysfonctionnement correspond à une altération plus ou moins profonde de lafonction : circulation alternée sur une route ou coupure totale (interruption totale decirculation). La durée s’exprime en jours, mois, année. Le troisième critère est celuique nous avons appelé l’importance fonctionnelle ou stratégique (ISF). Il exprimel’importance de la fonction qui peut être locale, régionale, nationale voireinternationale. Les critères d’importance stratégique ou fonctionnelle s'appuient surle nombre de personnes concernées, le périmètre géographique, lareprésentativité des usagers ou des usages et les mesures palliatives, c’est-à-direla capacité de remplacer cette fonction par une fonction d’ordre équivalent enmobilisant des moyens plus ou moins importants.22
Un exemple simple peut être donné : la coupure d’une route peut être totale durantun mois. Mais l’importance fonctionnelle de ce dommage n’est pas la même s'ils’agit d’une route menant à quelques habitations qui peuvent être atteintes par unautre moyen ou s'il s’agit de la route menant par exemple au tunnel du Mont Blanc.De la même manière, les impacts économiques sont évalués, en en considérantl’intensité (économie légèrement affectée ou totalement paralysée), la durée (jour,mois, année) et l’importance (local, régional, national…). Le travail a porté sur lescavités minières de Lorraine, au droit desquelles l’immobilier a subi une forte pertede valeur, où les permis de construire se sont trouvés limités, ce qui n’est pas sansconséquence pour le développement de la région.Sur ces principes méthodologiques, l’échelle de représentation globale desdommages a été construite : elle s’exprime selon sept paramètres, les dommageshumains, les dommages physiques, les dommages financiers, les dommagesfonctionnels et les impacts économiques, sociaux et environnementaux. Lesdommages humains sont exprimés selon l’échelle du MEDD, les dommages auxbiens et aux milieux sont exprimés physiquement (x maisons détruites, y routescoupées) et financièrement, l’estimation correspond aux coûts directs, c’est-à-direaux coûts de réparation des dommages physiques. Il n’y a pas d’estimation desdommages indirects puisque nous considérons qu’ils sont exprimés parl’évaluation de l’impact économique, social, environnemental et éventuellementpolitique des dommages fonctionnels.Le cas d'Auboué illustre notre recherche. Il concerne des affaissements miniers enLorraine au droit d’anciennes mines de fer, dans de petites villes. Sur desproblèmes de dommages physiques mais surtout des problèmes sociauxextrêmement importants, se sont greffées des conséquences économiques liéesau développement de la région. Les problèmes sociaux se sont traduits par desimpacts politiques importants puisque les politiques ont été saisis du problème etque leur intervention a eu pour conséquence la modification du Code Minier.L’aspect global de l’événement montre qu’en termes de dommages humains, lesdommages sont surtout psychologiques. Par contre, en termes de dommages auxbiens et aux milieux, environ 140 millions d’euros ont été dépensés. Cecicorrespond dans notre échelle à un dommage de niveau 3. Les dommagesfonctionnels ont été importants puisque 400 personnes sont sans logement.L'impact économique n’est pas énorme. Par contre l'impact social est de niveau 3,c’est-à-dire de niveau national.Cette échelle reste à passer au banc de l’utilisation quotidienne par des utilisateursfinaux qui sont les gestionnaires de l’événement et qui font le retour d’expériencede celui-ci. L’intérêt était de réunir un certain nombre d'acteurs autour de la table,les DDE, les DRIRE… et qu'ils nous disent où ils situent les impacts et lesdommages. Chacun s'exprime par rapport à son point de vue, c'est-à-dire ceuxpour qui l’événement est un vrai dommage social, ceux pour qui l’événement estun vrai dommage économique, etc…. Enfin, ce type d'outil reste à appliquer, caleret éventuellement développer sur d’autres types d’évènements.23
Gérard BrugnotJe souhaite attirer votre attention sur le travail très exhaustif qui a été réalisé dansle recensement des différentes échelles utilisées au niveau français etinternational.24
Pertinence et faisabilité d’une politique de gestion des risquestransports de matières dangereuses dans des agglomérationsà forte concentration industriellePhilippe BlancherAsconit consultants62 boulevard Niels Bohr, BP 2132, 69603 Villeurbanne cedexTél : 04 78 93 68 90philippe.blancher@asconit.comCette intervention présente un risque dont on parle peu, qui pose même unproblème pour le nommer, l’identifier dans l’espace public. Elle rend compte d’uneétude sur la pertinence et la faisabilité d’une politique de gestion des risquestransports de matières dangereuses (TMD) dans des agglomérations à forteconcentration industrielle. Ce travail a été mené à l’époque où je travaillais àEconomie et Humanisme; il a bénéficié de la collaboration de Bénédicte Vallet.La problématique de cette recherche reposait sur un constat. Dans le courant desannées 80, plusieurs travaux ont été menés sur l’évaluation des risques destransports de matières dangereuses. Ils ont débouché sur différentespréconisations et la création de la Mission des Transports de MatièresDangereuses en 1987. A la fin de la décennie, un rapport parlementaire (le rapportCarton) a préconisé l’élaboration de dispositifs de gestion des TMD aux niveauxdes régions, départements, agglomérations. La Mission TMD a défini les élémentset modalités de mise en œuvre de telles stratégies. Or, cette politique ne semblaitavoir été appliquée nulle part dans la continuité, si ce n’est peut-être dansl’agglomération lyonnaise. Des actions avaient été menées dans différentesagglomérations, mais elles étaient restées ponctuelles.Pour mener cette analyse, sur la façon de dire ce risque et de le traiter, je me suisappuyé plus particulièrement sur la notion de référentiel d’une politique publique,telle que développée par Jobert et Muller . Cette notion vise à dégager lespréceptes généraux et les représentations qui orientent les dynamiques desconstructions sociales d’une réalité, ici d’un risque, et qui déterminent des cadreset des pratiques socialement légitimes pour traiter de ce problème.Sont considérées, dans cette recherche, comme matières dangereusestransportées, celles désignées comme telles dans des recommandations de l'ONUqui encadrent la législation dans ce domaine. Plus de 3000 substances sontrépertoriées en 9 classes, selon la nature du danger principal. Les véhiculestransportant ces matières portent les symboles de danger reproduits dans la figureci-dessous (figure1). Les flux de TMD correspondent à des modes de transporttrès différenciés : citernes, colis, bouteilles, camions sur la route, wagons,péniches, canalisations. Les produits concernés peuvent être très spécifiques etdangereux, ou très courants comme l’essence ou le gaz de pétrole liquéfié (GPL). «L'État en action», Jobert et Muller, 198725
Figure 1 : Symboles de dangerCes camions, ces wagons se retrouvent dans le flux de la circulation. Il est parfoistrès difficile de les identifier, de les localiser. Le comptage pose des problèmes.Cette banalisation est d’autant plus forte que l’accidentologie des transportsroutiers de matières dangereuses est proportionnellement plus faible que celle descamions en général. Les TMD sont concernés par 5% du trafic de marchandisespar la route, 1,5 % des accidents corporels de poids lourds et 0,8% des accidentsde la circulation routière. Finalement, peu d’accidents se produisent, et parmi euxun nombre plus réduit encore met en jeu la matière dangereuse. Par exemple, uncamion de matière dangereuse peut se renverser ou être impliqué dans unecollision avec un autre véhicule sans qu'elle s’échappe de la citerne qui la contient;la citerne a, de fait, été conçue pour qu’il en soit ainsi dans la plupart des cas. Cecipose d’ailleurs un problème de comptage des accidents de TMD pour la MissionTMD, puisque quand les forces de l’ordre recensent ce type d’accident, elles nementionnent pas toujours le fait que le camion concerné transportait des matièresdangereuses.Le TMD correspond donc à un risque qui a une faible probabilité, mais qui toutefoispeut être majeur, dans le sens où sa réalisation cause beaucoup de morts, uneévacuation, ou une pollution très importante : 216 morts à Los Alfaques enEspagne en 1978, 240 000 personnes évacuées à Toronto au Canada en 1979, dufait de la présence d’un wagon de chlore dans un convoi accidenté en feu.En France, entre 1973 et 1997, 3 accidents ont fait plus de 10 morts : Saint-Amand-les-Eaux (59) en 1973, 15 morts; Les Eparres (38) en 1993, 10 morts, 4blessés dont 3 graves; Port-Sainte-Foy (24) en 1997, 13 morts et 43 blessés. Le26
chemin de fer a été à l’origine de pollutions et de dégâts importants, comme àChavanay en 1990 et à Saint Galmier en 2000.En France, il existe une législation sur le transport de matières dangereusesdepuis la fin du XIX e siècle. Depuis les années 50, des accords régulant lestransports internationaux de matières dangereuses en Europe, ont été élaboréssous l’égide de l’ONU, dans l’objectif, en particulier, de consolider les relations estouest.Ce cadre s’est renforcé et a été étendu au domaine des transportsintérieurs, suite à l’Acte unique européen de 1985.Quelle est la logique qui structure l’analyse et, plus encore, le traitement du risqueTMD ? Je tiens à remercier François Barthélémy, président de cet atelier, car c’estl’entretien que j’ai eu avec lui dans le cadre de cette recherche, qui m’a permis d’yvoir plus clair.A la fin des années 80, pour avancer dans le traitement du risque TMD, deuxréférentiels, correspondant à deux législations différentes et deux façons de dire lerisque, sont entrés en concurrence. La notion structurante du premier, issu del’Acte unique européen, est la libre circulation des marchandises en Europe. Donc,le référentiel est celui du marché. Le deuxième, issu de la directive européenneSeveso, est celui du risque majeur. Ces deux référentiels se traduisent par unefaçon différente, voire antagonique, de concevoir, d’interpréter et de traiter lerisque, et un rapport distinct au territoire.Le référentiel de la libre circulation implique que les marchandises, fussent-ellesdangereuses, puissent circuler avec le moins de contraintes possibles. Assurer lasécurité dans ce cadre consiste avant tout à assurer la fiabilité du transport. Laprobabilité d’un accident étant réduite au maximum, le TMD est d’une certainemanière banalisé dans les flux de marchandises. La réglementation vise às’abstraire des spécificités territoriales pour assurer la libre circulation desmarchandises. Le territoire disparaît. Ce référentiel se traduit par des prescriptionsextrêmement détaillées et complexes qui visent avant tout la fiabilité destransports; elles touchent aux vitesses, aux règles de conception des équipements,à la relation entre chargeur et transporteur... Cette orientation contribue à ladifficulté de dire le risque dans un espace donné. Même des ingénieurs de la DDE,spécialisés sur cette question, se sentent relativement incompétents quand onaborde le TMD. Pour le grand public ou les élus, la situation est pire encore. Ladimension technique et réglementaire très complexe dissuade les acteurs locauxnon directement concernés de s’intéresser à cette question.Ce référentiel est congruent avec le statut du transport dans notre économie. Lalocalisation des activités dans l’espace répond à des critères d’accès à desmarchés (marché de l’emploi, marché de la production…) et d’organisationindustrielle, puis le système de transport s’adapte et permet de s'abstraire de ladistance, tant au niveau des délais que des coûts. Il en résulte tout un ensemblede conséquences sur l’organisation du secteur des transports, les conditions detravail, etc.Le référentiel du risque majeur est tout autre. Il suppose justement que la fiabilité,qui est à la base du référentiel précédent, soit mise en défaut quoique l’on fasse,27
ou en tout cas que cette hypothèse soit envisagée. Cela amène aussi à modéliserl’accident, même de faible probabilité, et à évaluer son impact. A partir de là, leterritoire réapparaît, avec ses spécificités, sous forme d’itinéraires, plus ou moinsaccidentogènes, de virages, de tunnels…, ainsi que d’habitants et d’équipementssitués à proximité (c'est-à-dire quelques kilomètres pour les accidents les plusimportants envisageables…). Aussi pour réduire la probabilité et l'impact d’unaccident, il faut aussi s’intéresser à ce territoire, mener une approche spécifique degestion du risque sur ce territoire.Les ressorts et modalités d’une prise en compte forte sur l'agglomérationlyonnaise.L'implication très forte de la Communauté urbaine a joué un rôle important,notamment sous l’impulsion de son Président, Michel Noir. Celui-ci a positionnécette question dans le cadre d’un autre référentiel, celui de l’Eurocité, c'est-à-diredes villes tournées vers les activités à forte valeur ajoutée, à haute qualité urbaineet environnementale, villes en compétition pour attirer les entreprises high-tech etles fonctions de direction des entreprises. C’est donc, là encore, le référentiel dumarché sous une autre forme. Dans Lyon métropole à vocation européenne, villede services avec une charte d’écologie urbaine, l’industrie chimique n’avait pas saplace. D'une certaine manière, le territoire local et son histoire sont niés puisque ceréférentiel obéit à un modèle de ville uniforme et suppose un chemin dedéveloppement relativement uniforme pour toutes les villes. Dans ce cadre, agirsur le transport de matières dangereuses est apparu à Michel Noir comme unefaçon de contraindre l’industrie chimique. Au-delà de cette impulsion, il y a eu unemobilisation forte de l’adjoint à l’environnement, des administrations publiques etdes acteurs économiques dans le cadre du SPIRAL (Secrétariat Permanent pourla Prévention des Pollutions Industrielles et des Risques dans l’AgglomérationLyonnaise), avec une approche très pragmatique et concertée.Au cours des années 80, dans différentes régions françaises, des étudessystématiques d’identification et d’évaluation des risques ont été réalisées. Parexemple, le CEPN (Philippe Huet, Jean Brenot et alii) a mené des étudescomparatives d’itinéraires de contournement de Grenoble ou de Lyon, mettant enœuvre des évaluations probabilistes. Le LTMG de Caen a réalisé une cartographiedes TMD et du risque TMD sur la Seine Maritime, à la demande de la Protectioncivile; il s’agissait de mettre au point une méthode d’évaluation préalable à lapréparation des Plans de Secours Spécialisés TMD. Or, dans les années 90 surLyon, ce type d’approche n'a pas été mis en œuvre. Les démarches mises enœuvre se sont appuyées sur des savoirs vernaculaires, des savoirs d’action.Ainsi, pour la détermination des schémas de contournement et de desserteinterne, le travail a été réalisé en relation étroite avec les chauffeurs, qui ontexpliqué leurs difficultés pour aller dans tel quartier, pour emprunter tel axe, selonl’heure et les embouteillages. Pour localiser les panneaux d’interdiction, l'étude aégalement pris en compte, de façon très approfondie, le savoir pratique des forcesde l’ordre et leur expérience des difficultés pour contrôler les camions. Cetteapproche agit à la marge, en améliorant l’existant. Elle ne met pas en cause leréférentiel du marché et l’organisation de secteur; ou plutôt, elle n’introduit pas le28
éférentiel du risque majeur d’une façon forte. L’action sur les plates-formesmultimodales est aussi très intéressante. La responsable d’une sociétégestionnaire de plate-forme, qui avait participé à des discussions et négociationsau niveau européen et national, a trouvé dans le SPIRAL une façon de poser lesproblèmes de façon très pratique et concrète, qui répondait mieux à la réalitéqu’elle rencontrait.Les limites de cette action : un investissement en temps et des délais de mise enœuvre importants. Elle a montré la faiblesse des marges de manœuvre à unniveau local du fait des contraintes économiques et réglementaires, spatiales etd’aménagement, liées à la complexité des enchevêtrements des différents réseauxet équipements, ainsi que des contraintes financières. D’une certaine manière,cette action ne contribue que de façon limitée à une visibilité du risque dansl’espace public. Elle ne permet pas une représentation globale du risque, mêmepour les acteurs directement impliqués. De plus, au sein du SPIRAL, lacommission TMD est la moins ouverte à des non-techniciens. Ainsi, desassociations locales participent aux commissions de travail sur l’air ou sur l’eau,aucune à la commission TMD. Toutefois, par son action, et c’est là son intérêt, leSPIRAL a exercé une fonction de veille et de vigilance, il a fait passer des idées,clarifié des objectifs communs, permis un apprentissage collectif appuyé sur lesconnaissances du terrain.Gérard BrugnotJe vous encourage à prendre connaissance de l’intégralité du rapport. Vous avezune boîte à outils à partir de l’exemple lyonnais. S’il y a des collectivités quivoudraient se lancer dans ce type d’approche du risque, cet exemple peut aider àlancer la réflexion.29
Risques naturels, information préventive dans les AlpesMaritimesValérie GodfrinARMINES-ENSMPBP 207, 06 904 Sophia-Antipolis cedexTél : 04 93 95 74 86Valerie.godfrin@ensmp.frTrois analyses sur la procédure d’information préventive ont été menées : uneétude juridique, une analyse sociologique à travers un questionnaire auprès de lapopulation et des élus et également, une étude des médias nationaux sur unedizaine d’années. Cette présentation dresse le bilan, dans le département desAlpes Maritimes, d’entretiens qui ont été menés auprès des collectivités locales etdes services de la préfecture chargés de mettre en œuvre cette obligationd’information préventive, pour montrer la difficulté de mettre en place ce type deprocédure. Le droit peine à s’imposer et à faire vivre cette obligation.Brièvement, quelles sont ces obligations en matière de risques ? L’étude portaitexclusivement sur les risques naturels et mettait de côté les risquestechnologiques. L’étude juridique a montré que cette obligation d’information étaitassez ancienne, bien avant la loi du 22 juillet 1987, puisque la jurisprudence avaitdéjà sanctionné les autorités publiques pour absence d’information à travers lepouvoir de police générale et les pouvoirs de police spéciale. Le pouvoir de policea pour objectif de maintenir l’ordre et la sécurité publics. Le pouvoir de policegénérale incombe aux maires sur le territoire de leur commune et au préfet. Lespouvoirs de police spéciale concernent notamment la gestion de l’urbanisme etdes risques, dont les procédures des plans de prévention des risques,anciennement plans d’exposition aux risques, plans de surface submersible, plansde zone sensible aux incendies de forêt et périmètres de risque de l’article R111-3du code de l’urbanisme. La jurisprudence est assez ancienne et sanctionnesystématiquement les autorités pour absence d’information des administréslorsque le risque était connu de la part des autorités.Pourquoi une loi prévoit-elle spécifiquement cette obligation d’informationpréventive puisque la jurisprudence est assez fournie ? La loi du 22 juillet 1987marque un pas important dans la politique de prévention puisqu’elleinstitutionnalise cette obligation d’information et confère un rôle au citoyen. Eneffet, elle officialise la charge des autorités publiques en matière d’information maisen même temps, indique au citoyen qu’il doit s’informer de la présence de risques.A la suite de ce texte du 22 juillet 1987, des textes d’application ont cadré cetteobligation d’information. Des documents servent à informer la population. Auniveau départemental, le préfet doit élaborer un Dossier Départemental desRisques Majeurs, répertoriant pour toutes les communes tous les risques quiexistent, naturels et technologiques. Ensuite, pour chaque commune, un DossierCommunal Synthétique est élaboré. Il a pour objectif de recenser tous les risquesnaturels et technologiques à l’échelle d’une commune et d’indiquer les moyens deprévention qui ont été mis en œuvre. Il est transmis au maire de chaque commune31
concernée qui, à son tour, doit élaborer un dossier d’information communale surles risques majeurs, le DICRIM qui reprend en substance les informations duDossier Communal Synthétique et qui doit être enrichi des apports de la politiquelocale en matière de prévention des risques.L’étude a été réalisée entre 1999 et 2002. Entre la fin de cette étude et cecolloque, est intervenue la loi du 30 juillet 2003 dite loi Bachelot qui renforce cetteobligation d’information. Il est notamment prévu trois grandes obligations pourrenforcer les précédentes : l’apposition de repères de crue en zone inondable,l’information régulière dans les communes disposant d’un PPR ou lorsqu’un PPR aété prescrit, une information au moins une fois tous les 2 ans et surtout uneinformation lors des transactions des opérations immobilières, que ce soit desopérations de vente ou de location.Comment est mise en œuvre cette obligation d’information dans les AlpesMaritimes et quelles ont été les difficultés rencontrées ? Fin 2000, le constat étaitun retard dans la mise en œuvre de cette information préventive. Les dernièrescirculaires au moment de l’étude dataient de 1994. La procédure a été mise enœuvre approximativement vers 1996. Fin 2002, alors qu’une centaine decommunes avaient fait l’objet d’un dossier communal synthétique sur les 163 quecompte le département des Alpes Maritimes, seule une trentaine avait élaboré leurpropre dossier d’information.Pourquoi ce retard ? Une forte disparité entre les communes existe parce quesuivant leur taille, elles rencontrent des difficultés qui sont propres à leurorganisation. Bien souvent, les communes se heurtent à un problème de moyens,notamment des moyens financiers parce qu’une procédure d’informationpréventive coûte relativement chère. Il faut prendre le temps d’élaborer lesdocuments, puis de les diffuser auprès de la population. C’est aussi une questionde moyens humains. Les communes n’ont pas forcément du personnel disponibleà consacrer à cette mission. Lié à ce problème de moyens humains, apparaît unproblème de compétence car souvent, les personnes qui s’occupent de cetteprocédure d’information préventive ne sont pas véritablement formées à la gestiondes risques. Elles se retrouvent contraintes de s’accommoder de cette missionsans savoir si elles ne passent pas à côté de l’essentiel. Une questiond’organisation des services se pose également, liée à la taille des communes. Plusla commune est petite, moins elle dispose de services différents et plus il estdifficile de s’organiser et de mettre en œuvre la procédure d’information préventive.Dans une toute petite commune, le maire ne dispose pas toujours d’un secrétairegénéral en charge de ce dossier, dossier qui s’ajoute à ses obligationsquotidiennes. A l’inverse, plus la commune est grande, plus elle dispose deservices spécifiques consacrés à la gestion des risques qu’ils soient naturels outechnologiques. Par exemple, dans les grandes villes des Alpes Maritimes commeNice, Cannes, Grasse, Antibes, des services particuliers consacrés à la sécuritéurbaine et à la gestion des risques ont été créés. De plus, il n'y a pas véritablementd’homogénéité dans le traitement de l’information préventive. Les services qui sechargent de la question, sont assez disparates : service de l’environnement,service technique, service de l’urbanisme, service de la communication32
Les limites de cette obligation d’information préventivePeu d’actions spontanées sont menées dans les zones de risque. Les maires descommunes n’engagent pas la procédure d’information préventive avant de recevoirle dossier de la part de la préfecture. Assez paradoxalement, on peut se trouverdans une zone de risque sans mettre en œuvre de procédure d’information.Certains maires ont donc une attitude assez passive puisqu'ils attendent derecevoir le dossier communal synthétique pour engager la procédure. Par ailleurs,les personnes qui travaillent dans les communes sont sceptiques quant àl’efficacité des procédures parce que dans la réalité, les effets seraient faibles, lapopulation étant peu sensibilisée.Une absence de connaissance des procédures est aussi remarquée. Globalement,les entretiens montrent que les personnes en charge de la mission ont découvertcette obligation d’information lorsqu’elles ont reçu le dossier de la préfecture lesinformant qu’elles devaient élaborer un dossier d’information communale. Lemanque de compétence et de formation en matière de gestion des risques est misen évidence. Bien souvent les personnes ne comprennent pas tout l’enjeu del’information préventive et de la gestion des risques au sein d’une commune.D’ailleurs, une confusion sur la finalité des procédures est remarquée puisque laplupart des personnes pensent qu'il n'est pas nécessaire de communiquer et decréer un document particulier puisqu’un PPR sur la commune existe. Elles necomprennent pas que ces deux objets diffèrent au sein d’une même politique degestion des risques.Une autre limite se trouve dans les remaniements au sein des municipalités quiretardent considérablement le dossier, constat réalisé durant la période de l’étudeentre 1999 et 2002 où sont intervenues les élections municipales. Lorsque l’équipemunicipale change, il faut attendre plusieurs mois avant de retrouver une continuitédans la politique d’information préventive, les nouvelles équipes engageant unenouvelle réflexion avant de poursuivre le dossier, ce qui accentue le retard.Les messages délivrés à travers les procédures d’information préventive sontrelativement uniformes, sans adaptation au contexte. Des circulaires indiquentassez clairement quelles sont les obligations, et les autorités, qu’elles soientpréfectorales ou municipales, peinent à se sortir de ces textes, de ce carcan, pourfaire preuve d’imagination et élaborer des documents assez attractifs et surtout quis’adaptent au contexte de chaque cas particulier. Un message relativementuniforme ne prend pas en compte les différences de population, notamment lesdifférentes catégories socioprofessionnelles.Enfin, on a pu constater une absence d’information dans les établissementsrecevant du public, notamment dans les écoles, ainsi qu'une absence d’informationen langue étrangère, compte tenu du caractère touristique du département. Laplupart du temps, les personnes estiment que les risques naturels se situent endehors des zones et des périodes touristiques, ce qui est faux, des inondationspeuvent se produire en pleine période estivale et le risque d’incendie de forêt estbel est bien présent en été, dans le Sud de la France.33
La population est très peu sensibilisée à ce type d’information. Lorsque laprocédure a été respectée et que l’affichage a été effectué, peu de personnesconsultent les dossiers d’information. Les autorités peinent à sensibiliser lesadministrés et à faire en sorte que la population vienne s’informer. Surtout, onconstate une perte de la mémoire rapide des événements locaux. Les personnesoublient ce qui s’est passé ou ne retiennent que partiellement l'événement. Uneattitude généralisée de déresponsabilisation ressort d’ailleurs très nettement del’enquête sociologique. La population est tellement habituée à être assistée qu’ellene prend pas l’initiative de s’informer.Les motivationsQu’est-ce qui guident les autorités locales à informer ? Une certaine historicité desévénements amène les autorités communales à informer, de manièrepragmatique, très empirique, notamment pour tout ce qui concerne l’urbanisme,domaine qui touche au caractère financier de la valeur des parcelles et donc dupatrimoine.Les initiativesLes initiatives intéressantes sortent du cadre des textes d’application et descirculaires, notamment à travers l’organisation de réunions publiques mais aussid'actions de formation qui permettent de toucher particulièrement les personnes etde les sensibiliser très précisément. L’association des médias locaux constitueégalement un bon vecteur d’information. Les communes utilisent, par exemple,Nice-Matin, journal local, notamment la rubrique consacrée aux communes pourpasser des messages, avant les périodes critiques comme par exemple avant lapériode estivale pour rappeler à la population l’obligation de débroussailler ou lesévénements qui se sont déjà produits. Des historiques sont relatés. Cette presselocale est assez utilisée en complément des bulletins municipaux qui sont élaboréstous les mois ou les trimestres qui servent à faire passer tous les messages desévénements communaux et qui sont un très bon vecteur de communication,puisqu’ils permettent de toucher directement la population.La conclusion de cette étude pourrait être la suivante : trop de droit tue le droit.Trop de droit tue l’imagination des collectivités locales. Pour qu’une bonneinformation préventive puisse être effectuée, il faut qu’elle sache s’abstraire destextes qui ont été élaborés.Gérard BrugnotJe vous incite à lire le travail de Valérie Godfrin qui est un véritable mémento surles textes de jurisprudence et aussi sur les aspects d’efficacité sociale.34
Étude de la demande sociale de surveillance environnementaledes stockages de résidus miniers d’uraniumClaire MaysInstitut SYMLOGBP 125, 94 232 CachanTél : 01 47 40 09 90Claire.mays@wanadoo.frCette étude a eu lieu en 2000-2001. Elle a été réalisée en collaboration avecSylvie Charron, alors en poste à l’IRSN. Il s’agit d’une étude qualitative, presqueclinique, menée autour de l’ancienne division minière de la Crouzille, dans laLimousin. Ce territoire qui se situe à une vingtaine de kilomètres au nord deLimoges était un territoire économiquement pauvre au milieu du 20 ème siècle. Ceterritoire a eu la chance et la fierté d’être le berceau du nucléaire en Francepuisque le premier gisement français d’uranium y a été découvert en 1948.L’activité minière d’extraction et de traitement de minerais d’uranium a fonctionnépendant 40 ans. Si vous désirez connaître l’histoire de la transformation de ceterritoire et de cette activité minière, vous pouvez vous référer au livre publiél’année dernière par Philippe Brunet, du CRESAL.Aujourd’hui, les résidus du traitement du minerai d’uranium qui sont restés surplace constituent la principale manifestation de cette activité de 40 ans. Cesdéchets radioactifs, à basse activité et à vie longue sont d'une compositioncomplexe en radioéléments. Sur le territoire français, plusieurs zones d’anciennesextractions d’uranium existent. Au total, ce type de déchets concentre uneproportion très significative de la radioactivité associée à la productionélectronucléaire. Dans le Limousin et dans les zones anciennes d’extraction, cesrésidus sont stockés sur place dans des sites dits naturels et aménagés pour lesdifférents types de matières issues du traitement des minerais. Les boues issuesde l'usine et les résidus de traitement par lixiviation sont isolés sous unecouverture végétale, dans des zones à l’accès restreint et intégrés au paysage. Laprésence de ces stockages soulève des questions de régime de surveillance àlong terme.Le but de notre étude a été d’investiguer les représentations et les demandessociales autour de ces stockages. Nous nous sommes posé la question de savoircomment ces déchets sont représentés par les riverains. Quelles sont les attentesdes riverains pour leur gestion ? La phase post-minière appelle-t-elle unpositionnement fort et visible des acteurs de l’environnement ? La problématiquede «Dire le risque ? » est au cœur de nos observations.Le fait que je sois psychologue a certainement déterminé à la fois la conception etla conduite de cette étude qualitative. Nous avons rencontré 22 personnes, 12femmes et 10 hommes âgés entre 23 et 80 ans. Nous les avons rencontrées enentretien sur place. Nous avons commencé en interviewant des personnes facilesà identifier comme étant impliquées, donc des associatifs, des notables de cette35
égion. Nous avons été très vite amenées à rencontrer des riverains, des gens quiexprimaient un intérêt pour nous parler.A l’époque de nos entretiens, on trouvait sur place, dans le cadre de notre étude,les indications d’une situation humaine et sociale un peu compliquée. On a généréà travers l’étude l’impression d’une peur latente, d’un questionnement, d’unepréoccupation sourde surtout chez la population plus âgée, celle qui avait bienconnu l’activité minière. Elle avait connu et parfois participé directement à cequ’elle décrit comme la longue construction de la transparence chez l’ancienexploitant, une transparence acquise à la force de demandes transmises par lesmairies, les associations. Ces personnes âgées connaissent également l’incidencede maladies graves, de cancers, de décès précoces. Elles hésitent à les attribuerdirectement à l’activité minière, mais constater ou vivre ces maladies représenteune épreuve douloureuse. La population plus jeune nous semblait exprimer unemeilleure confiance dans la gestion des sites de stockage mais l’inquiétude pour lasanté, celle des riverains actuels, celle de la génération à venir, à l’échelle d’uneou deux générations, était partagée. Cette inquiétude cependant n'était pasexprimée franchement. Elle ne semblait pas être l’objet de revendication, à partdans les milieux associatifs, lesquels ont la satisfaction aujourd’hui de voir portercertaines questions devant le tribunal. Cette inquiétude que nous avons entendueétait comme un secret, un secret que l’on vérifiait avec moi, hors micro. C’était unsecret objet en soi de questions telles que : «ce lien entre présence de déchets etprésence de maladies graves est-il réel ?» Les personnes interviewées medemandaient : «d’autres ne vous ont-ils pas parlé de la même chose ? N’ont-ilspas peur, eux aussi ?»En testant auprès de moi, chercheur, le bien fondé de cette peur, en vérifiantqu’elle pouvait être répandue dans la communauté, les interviewés montraient quecette peur et ce questionnement faisaient l’objet d’une ignorance plurielle. Onpense comme les autres mais on n’a pas les moyens de le savoir. Donc, il n’y apeut-être pas crise, mais il s’agit d'une situation instable à gérer. Ce n’est pas unvécu facile, quand on manque de moyens pour mettre en commun unquestionnement et pour élaborer les réponses. Le silence, la peur du ridicule enposant à haute voix ces questions, la peur de la mauvaise nouvelle, les clivageséventuels entre générations dans leur appréhension du risque, la conscience qu’ilest très difficile d’obtenir des certitudes sur les effets individuels du rayonnement,tous ces éléments empêchent la mise en commun et minent peut-être l’aptitudesociale à faire face à ce risque collectif.La question secrète des riverains porte sur le risque environnemental pour la santémais la difficulté à adresser cette question, à dire ce soupçon du risque devientelle-même la base d’un autre danger collectif.Dans la communication préparée pour les <strong>Actes</strong> du colloque, nous avons soulignél’intérêt de créer des relations choisies et non pas subies entre les riverains et lesparties prenantes du stockage, la nécessité de former des partenariats. Uneinitiative est actuellement menée : la création d’un groupe d’expertise pluraliste à lademande des ministères de l’Ecologie, de l’Industrie et de la Santé dans le butd’intensifier l’effort de dialogue, de transparence et de concertation autour des36
enjeux de gestion sur place. Ce groupe pluraliste est composé d’experts étrangers,de l’IRSN, d’autres organismes compétents, experts issus du monde associatif, del’ancien exploitant COGEMA. De ce dispositif, une commission locale d’informationet de surveillance devrait émerger.On peut espérer que cette initiative instaure une dynamique nouvelle, un sentimentqu’il est possible sur place de parler de ce risque et de commencer à construireune idée partagée du risque en présence. J’aurais voulu encourager les différentespersonnes qui sont impliquées dans ces instances d’expertise ou les instancesassociées à essayer, avec force et volonté, de se rapprocher des riverains qui nesiègent pas dans ces instances. Que les riverains puissent faire part de leursobservations cumulées sur la durée, et que les riverains puissent être assurés queleurs observations alimentent le programme de travail du groupe de l’expertiseplurielle.Gérard BrugnotIl y a une préconisation dont on pourra parler lors de la table ronde qui esteffectivement celle d’un système d’information qui pourrait fonctionner entredifférentes parties prenantes. Là, il y a visiblement un problème de circulationd’information.37
De 1856 à 2003, les évolutions des rapports au risqueinondation dans le delta du RhôneBernard PiconDESMID1 rue Parmentier, 13 200 ArlesTél : 04 90 93 86 66bpicon@wanadoo.frPlutôt que d’évoquer la comparaison entre les inondations du Rhône de 1856 et de1993 et 1994 en Camargue, objet de notre rapport EPR, cet exposé a pour objetde montrer comment l’inondation en 2003 a engendré des remises en cause et denouvelles dispositions règlementaires, gestionnaires, sociales, symboliques,scientifiques, concernant les crues du fleuve en favorisant l’émergence denouvelles transversalités à tous les niveaux.L’inondation généralisée du delta du Rhône en 1856 (Document 1) a débouché surune mesure exceptionnelle : la construction des «Chaussées de GrandeCamargue» sous l’égide de l’État. Leur gestion fût confiée à «l’Association desChaussées de Grande Camargue». Cette association regroupait les propriétairesprivés du delta du Rhône. Leurs cotisations et les pouvoirs de chacun dans cetteassociation étaient proportionnels à leur surface cadastrale (statuts de 1883).Socialement, le delta étant une région de grandes propriétés agricoles, on peutdire que la protection du delta par rapport aux crues du Rhône était confiée à ceuxqui en bénéficiaient en premier lieu, les propriétaires fonciers. Le système pouvaitêtre qualifié de censitaire.Document 1 : Inondations de 1840 et 1856 : champ d'inondation du Rhône deTarascon- Beaucaire à la mer39
De surcroît, pendant les 150 ans qui ont séparé cet épisode de l’inondation de1993 et 1994, l’île de Camargue, a été désignée sur un plan plus symboliquecomme «espace naturel».- Au début du XXe siècle, les félibres l’ont construite comme une île de nature etde culture menacée par un extérieur perçu comme dangereux (les grandesopérations de mise en valeur agricole et salinière).- En 1927, les étangs centraux sont classés en réserve intégrale de nature pourrésoudre un conflit de gestion de l’eau entre agriculture et industrie salinière.- En 1970, l’image de nature déteint sur l’ensemble du delta qui est classé en«Parc Naturel Régional», avec pour fonction, dans le cadre de l’aménagementdu territoire, d’établir une «coupure verte» entre la zone industrielle de Fossur-Merà l’Est et les établissements touristiques du Languedoc-Roussillon àl’Ouest.Les inondations et les ruptures de digues d’octobre 1993 et janvier 1994(Document 2), en précipitant les eaux du Rhône dans l’île de Camargue dévoilenttrois décalages normatifs, sociaux et symboliques liés à cette situation héritée dusiècle précédent et qui peuvent être considérés comme des facteurs aggravant dela crise.Sur le plan normatif, les statuts gestionnaires de 1883 faisaient toujours force deloi et étaient complètement inapplicables dans un contexte socio-économique enmutation rapide (Document 3).Document 2 : Zones inondées lors des crues de 1993 et 199440
Document 3 :Les statuts gestionnairesde 1883 faisaienttoujours force de loi en1993 et 1994 maisétaient complètementinapplicablesLa Camargue n’était plus seulement une île agricole mais un milieu complexe faitd’intérêts agricoles, saliniers, résidentiels, touristiques et de protection de lanature. Dans ce contexte, le système censitaire privé et agricole de gestion desdigues ne fonctionnait plus depuis longtemps et leur état de délabrement, pointépar le rapport DAMBRE, en résultait.Sur le plan social, cette inondation a eu pour conséquence de noyer deslotissements habités par des populations modestes qui, mobilisées au sein d’uneassociation de sinistrés, devenue ultérieurement association des camarguais(Document 4), a d’abord dénoncé le système de gestion en réactivant une sorte desymbolique de lutte des classes puisqu’ils étaient exclus de l’entretien des diguesqui incombait principalement aux propriétaires fonciers (Document 5). Les «gros»ayant noyé les «petits», ils ont revendiqué une gestion publique des digues duRhône via un «syndicat mixte» qui était déjà la règle sur la rive gardoise du petitRhône (rive droite). Aucune brèche majeure ne s’étant déclarée sur cette rive, lagestion publique fût admise par toutes les parties prenantes comme la bonnesolution.41
Document 4 : Inondations de1993 et 1994, les sinistrés semobilisent au sein del'Association des camarguaisLe Provencelal du 12 novembre 199442
Document 5 :le Provencelal, 12janvier 1994Sur le plan symbolique, l’île de Camargue qui avait été progressivementdésignée comme «dernier milieu naturel intact» de la côte méditerranéennefrançaise menacé d’un grand nombre d’agressions humaines (Document 6),apparut soudain, dans les médias, comme un milieu humain menacé decatastrophes naturelles. Alors que l’on se protégeait d’incursions industrielles,résidentielles ou touristiques présentées comme catastrophiques, c’est un objetnaturel, l’eau du Rhône qui a déstabilisé le delta. De milieu naturel menacé derisques humains, le delta a basculé dans la représentation d’un milieu humainmenacé de risques naturels.La production symbolique d’un espace naturel avait gommé la réalité d’un polderagricole et salinier à risque. Il ne faut pas oublier que le centre du delta est à moinsun mètre cinquante au dessous du niveau de la mer et que les bourrelets alluviauxplacent le Rhône au dessus de la plaine.L’idéologie dominante nourrie de l’idée que la Nature est forcément bonne et belleet que l’homme est malfaisant, avait aussi contribué à «l’oubli» des digues duRhône et a donc constitué aussi un facteur aggravant du risque.43
Scientifiquement, enfin, de très nombreuses publications naturalistes forçaient letrait en contribuant à construire la Camargue comme «terre sauvage».Document 6 : l'oubli durisque naturel(d'après documents du ParcNaturel Régional deCamargue)La réponse gestionnaire à la double catastrophe de 1993-94 a été la constitutiond’un syndicat mixte de gestion des digues d’abord appelé SYDREMER en 1997puis SYMADREM en 1999, quand la région PACA et le conseil général desBouches-du-Rhône ont rejoint le syndicat (Document 7).44
Document 7La compétence du SYMADREM portait sur la seule protection de l’île deCamargue (rive droite du grand Rhône, rive gauche du petit Rhône et digue à lamer). Le mythe territorial restait vivace.En même temps, face à la revendication émergente d’une gestion globale desinondations du Rhône, les pouvoirs publics voulaient une étude hydrauliquecomplète, l’étude globale Rhône qui fût confiée à l’association «territoire Rhône»composée de tous les Conseils Généraux riverains du Rhône (Document 8).45
Document 8 : Étude globale Rhône - décembre 1995En décembre 2003, une nouvelle inondation du Rhône aval va mettre à mal unenouvelle fois ce dispositif de protection par rapport aux crues mais aussil’exceptionnalité camarguaise.L’inondation, comme par un fait exprès, contourne très précisément l’île deCamargue et le territoire du Parc Naturel Régional (Document 9).46
Document 9 : Vue de l'inondation de 2003Elle inonde les 6 000 habitants de la plaine du Trébon au Nord d’Arles et desmilliers d’hectares en Camargue gardoise.Les brèches, que ce soit dans le remblai SNCF de la voie ferrée Tarascon-Arles -censé faire digue- et dans la digue de la rive droite du petit Rhône, se trouvanthors du périmètre de gestion du SYMADREM, ce constat fait à nouveau voler enéclats un dispositif pourtant vieux de moins de dix ans.D’abord, s’il justifie le rôle du SYMADREM (aucune brèche ne s’est déclarée surson périmètre de compétence), par contre, il remet en cause définitivement,concernant les risques, la sanctuarisation de la seule île de Camargue qui avaitprésidé au périmètre dévolu au SYMADREM.Le delta sur le plan géomorphologique, est bien plus étendu que le territoire duParc de Camargue. Il commence au Sud d’Avignon et il s’étend à l’Ouest et à l’Estde l’île.La réponse gestionnaire a été rapide et les compétences du SYMADREM ont étéétendues jusqu’à Beaucaire au Nord et à la rive droite du petit Rhône. Il aura fallutrois catastrophes pour comprendre que le fleuve se désintéresse dessegmentations symboliques des territoires.47
Sur le plan social, le même constat a finalement émergé, et les sinistrés, pourassurer leur défense et pour devenir partie prenante de la gestion des inondations,ont créé une «confédération des riverains du Rhône», «l’association desCamarguais» n’ayant plus de sens au vu de la géographie de la dernièreinondation (Document 10).Document 10 : Source «confédération des riverains du Rhône», 2004L’ampleur des dommages aux biens et aux personnes et les difficultésadministratives, politiques, juridiques, sociales pour y répondre de façon concertéeet sur le long terme, ont d’autre part marqué les limites de l’étude globale Rhônerendue en 2003.A ce remarquable travail hydraulicien sur le fonctionnement du Rhône et sur lespoints faibles concernant la prévention, il manque tout l’immense volet de lacomplexité sociale, économique, législative, de la prévention des risques, tant surle plan de la vulnérabilité que de l’aléa.La réponse à cette dernière segmentation entre le social et le naturel a été la priseen compte globale et transversale du risque inondation sur l’ensemble du bassin àtraiter comme phénomène socio – naturel : en 2003 est nommé un préfet debassin. Avec cette juridiction découpée par la nature, on est enfin entré dansun indispensable processus de gestion non segmenté et socio-naturel.Le préfet du bassin a pour mission de mettre en place «une stratégie globale deréduction des risques d’inondation du Rhône et de ses affluents» (Document 11).48
Document 11 : Élaboration d'une stratégie globaleCette stratégie s’appuie sur un dispositif complexe : comité de pilotage, équipetechnique, équipe pluridisciplinaire, comité scientifique et les comités territoriauxde concertation auxquels les Conseils Régionaux adjoignent les «États Générauxdu Rhône» pour intégrer les préoccupations des riverains. Ce dispositif a pourobjectif de traiter de façon conjointe le Rhône amont, moyen et aval en jouant sur49
des solutions techniques qui ne passent plus seulement par les endiguementscomme ce fut le cas en Camargue après les inondations 1993-94.Réduire l’aléa et la vulnérabilité passe par la prévention, la cohésion, la solidaritéamont-aval, mais aussi la gestion de l’eau et des sédiments, les zones d’expansionde crues, etc.Pour aller jusqu’au bout de cette tentative de globalisation, il est apparu que laprise en compte du risque inondation ne pouvait pas rester isolée ni se faire audétriment des autres fonctionnalités du fleuve et de ses affluents. Toujours sousl’égide du préfet de bassin, un «plan Rhône», sur le modèle du «plan Loire» déjàexistant est en train de voir le jour en 2005 (Document 12).Ce plan Rhône associe la question des inondations avec celle de l’écologie et dela biodiversité, de la navigation, de la production énergétique, du tourisme et desloisirs etc. pour l’ensemble du bassin.Pour conclure, il semble bien qu’à propos d’un objet spécifique, les inondationsrécentes du Rhône, les réponses gestionnaires, sociales, et symboliques aientprogressivement abouti au même travail de désegmentation imposé auxscientifiques par l’irruption récente de la question environnementale et des risquesnaturels. Si les scientifiques tentent d’y répondre par le développement del’interdisciplinarité entre sciences de la nature et sciences de la société, lesgestionnaires et les acteurs sociaux ont répondu, d’inondation en inondation, parles remises en cause administratives, territoriales, juridictionnelles, techniques etsymboliques qui s’imposent dans le sens d’une plus grande transversalité; cettebrève interprétation de la période en témoigne.La Camargue, quant à elle, abandonne un peu de son statut mythique d’exceptionnaturelle et rentre dans la catégorie plus prosaïque d’exutoire du bassin du Rhôneet d’interface socio-naturelle fleuve – mer.Gérard BrugnotCe rapport a beaucoup servi après les événements de la crue du Rhône de 2003.50
Document 12 : le plan Rhône (CIAT du 12 juillet 2005)51
Pour un observatoire informatisé des alertes et des crisesenvironnementales 1Didier TornyTSV-INRA65 Bvd de Brandebourg, 94205 Ivry-sur-Seine CedexTél : 01 49 59 69 97, Fax : 01 46 70 41 13torny@ivry.inra.frCette recherche a produit non seulement un texte, un rapport, mais également deslogiciels et des corpus de texte. Une hypothèse assez optimiste de traitement desrisques et des crises consiste à énoncer qu’il suffirait de mobilisation et de moyenspour les régler et progressivement, on tendrait vers un monde qui serait de moinsen moins risqué, de moins en moins problématique. Cette hypothèse est invalidéemême si elle court toujours, au moins localement dans le temps, dans un dossierou dans un lieu, au profit d’autres hypothèses où il y a un déplacement permanentdes dangers, des risques, des alertes et des crises. Un problème se règle parcequ’on a beaucoup mobilisé et puis finalement un autre surgit, le problème sedéplace ailleurs. On se situe dans cette seconde hypothèse : que faire quand on aune multitude de signaux, de textes, d’éléments qui surgissent, que ce soit dansl'administration publique ou chez un opérateur privé, signaux qui ne sont pas del’ordre de l’inondation massive en s'imposant à tous de manière tangible, mais quimontrent qu’il y a un problème à régler.Notre proposition est de passer par l’utilisation d’outils informatiques quipermettent un certain nombre de fonctions. Par exemple, vous recevez un courrierd’une petite association qui vous parle de pollution dans une rivière ou d’un tauxde fausses couches important dans un village. Les documents ne sont pas signéspar une équipe internationale d’épidémiologistes mais par une infirmière, parexemple. Qu'advient-il de ces éléments ? Cela dépend de la personne qui lesreçoit. Parfois, ils sont gardés ou sont passés à la hiérarchie ou ne sont pasretenus. Puis, les personnes en poste changent, la mémoire disparaît. Ceséléments sont enfermés dans des dossiers. L’idée est de pouvoir exercer unemémoire relativement longue des événements passés, doublée d’une mise à jour.Cette opération permet en particulier de confronter en permanence la situationactuelle et l’ensemble des événements déjà connus. Imaginez si tous cesévénements historiques étaient effectivement à disposition de l’ensemble desacteurs. Au moment même où ils ont des décisions à prendre ou des phénomènesà maîtriser, cela changerait assez profondément les choses, au lieu de recevoiraprès coup la leçon des historiens ou des sociologues. L’un des élémentsessentiels est le partage entre l’ordre de ce qui est du lieu commun, c’est-à-dire1Nous présentons ici très brièvement les résultats d’une étude menée entre 2001 et 2003 :Chateauraynaud F., Bertrand, A., de Blic D. & Charriau, J.-P., 2003, Pour un observatoire informatisédes alertes et des crises environnementales. Une application des concepts développés lors desrecherches sur les lanceurs d'alerte, Paris, Convention CEMAGREF / GSPR-EHESS, 263 p.53
des éléments qui sont connus de tous, qui sont partagés, qui ne sont pasproblématiques et ce qui demeure des zones d’incertitude.Dans ce dispositif, qu’appelle-t-on un dossier et quelle masse cela représente-t-il ?Les dossiers se trouvent sous forme informatisée. Les corpus qui ont étéapprofondis pour cette étude portent sur le benzène et secondairement sur lacharte de l’environnement et le nucléaire. Ils représentent des masses textuelles etdes périodes temporelles assez importantes (tableau 1).Tableau 1 : Exemples de corpusCorpus Pages Textes Auteurs Périodisation Étatamiante 3572 684 148 du 23/ 9/1971 au Suivi25/ 5/2005benzène 901 228 70 du 1/ 4/1974 au Suivi12/ 4/2005charte891 169 76 du 3/ 5/2001 au Suivienvironnement1/ 3/2005gaucho 416 203 49 du 1/ 6/1991 au Suivi9/ 3/2005grippe aviaire 1853 1760 22 du 2/ 9/1997 au suivi23/ 4/2005intermittents du 1452 490 77 du 1/ 8/1987 au Suivispectacle10/ 5/2005nanotechnos 828 804 43 du 9/ 9/1991 au Suivi8/ 5/2005nucleaire 8626 1697 312 du 1/ 7/1946 au Suivi20/ 5/2005OGM 2200 1030 58 du 1/ 5/1992 au Clos21/ 5/2004prion 3007 1243 87 du 1/12/1989 au 27/ Clos2/2002La recherche 678 191 112 du 13/ 6/1997 au21/ 5/2005SuiviQue peut-on faire grâce à ce type d’outil ? Les avantages des automatismesproduisent des situations qui sont censées être impossibles pour les humains,c’est-à-dire, typiquement, vous placer au moment des faits. Par exemple, le grandreproche adressé aux juges est de projeter l'avenir dans le passé. Avec cet outil,on se place à un moment donné. Plaçons-nous le 2 mai 1986, une semaine aprèsTchernobyl. Qu’est-ce que l’explosion de Tchernobyl apporte à un dossier ? Quelssont les éléments qui demeurent à travers le temps ? Par exemple, Greenpeacesurgit dans le dossier nucléaire à partir de Tchernobyl et s’installe de manièredurable.54
Cependant, cet automatisme ne peut fonctionner qu'avec une accumulationproduite par le travail des humains. Dans la plupart des dossiers, les riverains, cespopulations qui sont autour de sites, d’endroits, sont désignés dans les textes defaçons diverses. Dans le corpus nucléaire, les riverains sont désignés une seulefois sous les «gens du coin». Donc, plus ce travail est accumulé, plus lesautomatismes fonctionnent; si on reparle des gens du coin, ils seront repéréscomme étant des riverains.Avec cet outil, la production d’un auteur particulier, par exemple Greenpeace, peutêtre surveillée et analysée. 87 textes entre 1997 et 2005 ont été produits parGreenpeace sur le dossier nucléaire. Certains éléments intéressants peuventapparaître. Ainsi, Greenpeace ne parle jamais des thyroïdes. Donc, la partiesanitaire post-Tchernobyl, en particulier les cancers de la thyroïde, n’est jamaisdiscuté par Greenpeace. Greenpeace n'évoque absolument pas le volet desconséquences sanitaires des expositions radioactives, ni le corps médical.Le mode de dénonciation, c’est-à-dire la façon dont on qualifie de manièrenégative, est également intéressant à étudier. Des termes tels que lobby nucléaire,mensonge, scandale, désinformation, propagande, nucléocrate, mépris, etc. sontcroisés avec les auteurs qui les évoquent le plus dans la littérature. Cependant, ilfaut toujours revenir au texte pour éviter les effets de citation à l’intérieur mêmedes textes. C’est une des limites des automatismes. D’autres façons de travaillerexistent : sur quoi portent les critiques des personnes ? Un langage se forme :exploitation excessive, dégazage sauvage, usage abusif, peur irrationnelle,principe inacceptable, projet inutile, qui permet d’observer la critique.L’autre élément important par rapport à ces outils est qu’à tout moment, vouspouvez non seulement observer ce qui est présent mais également ce qui estabsent. Par exemple, sur le corpus charte de l’environnement, la CommissionCoppens a produit un texte censé avoir un rôle de synthèse. Or, les OGM ne sontpas cités alors que d’autres acteurs passent leur temps à les évoquer : l’absencedevient alors significative. Non seulement, il faut évoquer ce qui est absent maiségalement ce qui est en devenir. Parce que souvent, ce qu’on attend de ce genred’outil est une capacité prospective. L’une des façons d’être attentif au devenir estde cerner dans les textes quel type d’avenir dessinent les personnes. Les termessont variés : les catastrophes annoncées, les progrès attendus, les matériaux desubstitution qui doivent apparaître, etc. Sur le dossier des nanotechnologies qui estrempli de futur, on peut voir la manière dont les auteurs vont l’engager. Autreexemple, on sait depuis 1992, qu’en 2007 beaucoup de débats sur le nucléaireauront lieu. Cette date est importante pour les acteurs, pour organiser leur actiontant du côté des opérateurs que du côté des associations.Enfin, pour conclure cette présentation trop rapide, que faut-il pour réaliser un teltype d’observatoire ? Il y a trois conditions essentielles. La première est laconstitution d’un ou plusieurs dossiers. Le fantasme de la surveillance, «vousmettez tout ce qu’il y a sur Internet et vous voyez ce qui arrive», ne fonctionne pasen pratique. Tout ce qu’il y a de plus évident et partagé émerge et le résultat estune masse informe. Il s’agit bien de constituer des dossiers avec une relativecohérence en termes d’orientation des textes, c’est-à-dire ce que disent les55
auteurs. Le deuxième élément est la nécessité d’un travail de mise à jourpermanent du corpus. Il y a toujours des nouveaux textes à rentrer, des absences,le corpus pointe toujours vers des absences. Pour les absences, soit personne n’yfait effectivement allusion, soit il faut aller chercher les textes des auteurs, desproducteurs qui évoquent le sujet, y compris par d’autres méthodes comme lesentretiens ou l’ouverture de forum internet. Enfin, il faut évidemment travailler etprévoir un budget ad hoc, principalement dédié aux moyens humains nécessaires.Gérard BrugnotL’aspect logiciel est une production en soi.François Barthélémy, CG des MinesVous avez donc entendu un certain nombre d’exposés qui sont liés à la question«dire le risque ?». Je représente une certaine catégorie d’acteurs, les utilisateursde l’administration et il faut se rendre compte que la problématique dans cedomaine a beaucoup évolué. La façon de dire le risque, il y a dix ou quinze ans etcelle d'aujourd’hui sont différentes. Une interaction entre ces réflexionsscientifiques et les pratiques existe. Les pratiques ont beaucoup évolué. Il y a dixou quinze ans, les pratiques de confidentialité dans le domaine du risque étaientconsidérables. Par exemple, vers 1992, quelques incidents sur des stockages deproduits radioactifs du côté de Saclay ont entraîné la nomination d'unecommission. Elle était chargée de faire un inventaire des stockages et déchetsradioactifs. L’idée sous-jacente était de rassurer la population rapidement. Cettecommission était composée de médecins, d’ingénieurs... Elle s’est tournée vers lesexploitants comme EDF 2 ou la Cogema. Dans le nucléaire, lorsque l’uranium estenlevé du minerai, il reste encore des éléments radioactifs sur une chaîne qui en aune douzaine. La radioactivité a été déplacée. En regardant les chiffres, avec lesquantités en cause, l'installation devait être classée nucléaire de base. Quand laCommission l'a constaté, les ministères ont été plongés dans un abîme deperplexité et ils se sont tournés vers le Conseil d’État qui a eu la sagesse de direque dans les décomptes de radioactifs, il ne fallait prendre que l’élément chef defile et pas tous les descendants. Ainsi, le bilan radioactif sur les sites a été divisépar dix et les sites sont restés dans la liste des installations classées et ne sontpas passés dans les INB (Installation Nucléaire de Base). Depuis, de gros progrèsont été réalisés. L’ANDRA 3 réalise maintenant des inventaires très complets.De même, les relations entre les préfets et les élus locaux sur la façon de prendreen compte les risques dans l’urbanisation ont changé. Il y a 10 ou 15 ans, denombreux exemples montraient comment un préfet ayant reçu de la DRIRE 4 undossier épais dans lequel toutes les zones de danger autour d’un certain nombred’usines d’une grande ville étaient répertoriées, modifiait son projet pour répondreà la demande d'un maire afin que le projet soit d’«intérêt général raisonnable».2 EDF : Electricité de France3ANDRA : Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs4DRIRE : Direction Régionale de l'Industrie, de la recherche et de l'Environnement56
Maintenant, le préfet notifie au Président de la communauté urbaine de cetteagglomération des zones de danger incomparablement plus vastes. C’est unchangement tout à fait radical.A certains égards, c’est un progrès mais cela pose aussi des questions dans lamesure où il faut expliquer ce risque pour ne pas arriver à des blocages. Descontraintes s'additionnent. Or, aujourd’hui, on ne sait pas expliquer toute une sériede contraintes et de risques qui sont de nature assez différente, que ce soit entermes de probabilité ou de nature de risque. Les uns concernent directement desrisques aux personnes, d’autres sont plus des risques sur les biens. On aégalement quelques difficultés pour expliquer ces risques au public et expliqueraux élus locaux qu’elles pourraient être les façons de les prendre en compte dansles documents du risque. Ces sujets nécessitent l'apport de la communautéscientifique pour l’analyse des risques. Il faut être conscient par exemple quel’accident qui s’est produit à Toulouse n’était pas prévu. Avant Toulouse, descentaines d’études des dangers ont été effectuées. L’accident qui s’est produit àToulouse avait deux défauts. Le premier était que l’atelier où il s’est produit n’étaitpas une installation Seveso, il était en dessous du seuil. Et deuxièmement, cetaccident ne devait pas se produire. Tous les accidents qui concernaient lesstockages de chlore, d’ammoniac, etc. avaient été étudiés mais il était interdit aunitrate d’ammonium d’exploser. Or, il l’a fait ce qui était regrettable. Donc, on estconfronté à des problèmes déstabilisateurs pour les personnes réalisant cesétudes en constatant que l’accident qui est arrivé est celui qui n'était pas prévu.Cela rejoint les questions de vigilance face à des risques émergents. On a unedifficulté à répondre à des questions que l’on ne connaît pas.57
Table ronde 1 : Dire le risque ?DébatMr Demicheli, ingénieur d’études à la DRASS Poitou CharentesJ’avais entendu dans l’exposé que vis-à-vis de la problématique de la catastrophed’AZF, on avait juste tenu compte au niveau des PPI des scénarios majorants. Lesplus délicats étaient évidemment les produits toxiques.François Barthélémy, CG MinesDans l’usine d’AZF, il y avait un certain nombre de stockages de produitsdangereux et c’est effectivement par rapport à eux que des mesures avaient étéprises, aussi bien vis-à-vis de l’urbanisme que des plans de secours. L’accident quis’est produit était tout à fait différent puisque ce n’était pas un dégagement toxiquemais une explosion, ce qui en termes d’effets est assez différent, notamment sur leplan de la cinétique. C’est un des points fondamentaux au niveau des PPI. Lesactions sur des accidents qui ont une cinétique rapide, mais pas instantanée, ousur ceux qui ont une cinétique lente, sont radicalement différentes. La sirène n’apas fonctionné à AZF parce qu’elle avait été démolie. C’est, en termes de gestiondes risques, un point essentiel.Liliane Besson, Institut des Risques MajeursJe voudrais ajouter un exemple sur le changement des mentalités, à propos desruptures de barrage. Je me souviens d’un temps où les informations fournies parEDF étaient soigneusement cachées à la préfecture et où il n’était pas question dedonner ce genre d’information à la population. Maintenant que cela a changé, cen’est pas forcément plus facile. Comment expliquer aux gens les conséquences dela rupture d’un barrage, les hauteurs d’eau, ce qu’ils devront faire, à partir dequelle sirène, etc. Bien sûr, le risque rupture de barrage est relativement faible. Iln’empêche que lorsqu’on a une démarche d’information préventive à faire, il faut lafaire correctement. J’ai rencontré en ce qui me concerne beaucoup de difficultéspour répondre à toutes ces questions.Benoît Vergriette, Agence Française de Sécurité SanitaireEnvironnementaleJ’ai été très intéressé par l’exposé de Didier Torny concernant la question del’observatoire des alertes et des crises. Dans votre exposé, vous avez beaucoupinsisté sur le caractère un peu rétrospectif de l’utilisation qui peut être faite de lacollecte de ces informations. Avez-vous connaissance de travaux identiques auniveau européen ? Par exemple, sur la question de la détection des alertesprécoces pour anticiper les réponses possibles à l’apparition de crises quipourraient se déclarer 10 ans ou 50 ans plus tard, comme les questions de la crise59
de l’amiante, des travaux ont été menés par l’Agence Européenne del’Environnement. Elle a publié il y a quelques années un travail d’analyse surl'alerte précoce et les actions tardives, en référence au principe de précaution. Estceque ce type d’instrument peut être exploité pour engager des travaux derecherche, d’expertises, voir déterminer des mesures réglementaires pouvantpermettre une action anticipée ? Aux Pays-Bas, dans le cadre du plan nationalsanté-environnement néerlandais, version 2, il était envisagé de constituer unecellule de recensement et d’observatoire d’un certain nombre de signaux dont onne sait pas très bien comment on va organiser la collecte et le traitement. Celamontre que c’est un point très fort de préoccupation.Didier Torny, INRALa notion même d’observatoire est très largement répandue dans les années 80-90 avec le triomphe de la pensée épidémiologique, avec l’idée qu’il faut recueillirtous ces éléments. On peut dire que l’INVS , c’est cela. Son rôle, définilégislativement, est bien la détection de tout événement pouvant modifier l’état desanté de la population. En pratique, cette structure existe et fonctionne avec desprofessionnels, des moyens limités, etc. Notre idée est de dire que les moyenshumains sont toujours présents mais l’avantage des dispositifs informatiques bienformés est d'avoir d’une part une grande stabilité et d’autre part, de répondre à uneforme de mémoire qui est radicalement différente, c’est-à-dire que dans un posteadministratif quelconque, quand quelqu’un part, toute une partie non seulement del’expérience mais aussi de la mémoire disparaît. Ce côté rétrospective-prospectiveest intéressant. L'amiante est un des dossiers sur lesquels nous avons travaillé, enparticulier sur les archives de la Direction Générale de la Santé. Si vous voulezvoir l’avenir, il faut du passé, sinon, vous serez dans le surgissement permanentdu présent, des éléments nouveaux surgissant tous les jours. Vous allez sauterdans une espèce de zapping permanent où finalement vous ne traiterez plus riensi ce n’est sur le plan communicationnel. Ce type de reproches est d’ailleursadressé à un certain nombre d’administrations. Donc, il faut du passé, établi demanière relativement rationnelle. Il ne s’agit pas de tout montrer. Dans le cas del’amiante, tous les signaux sont présents. En prenant les archives de la DirectionGénérale de la Santé, le problème des flocages monte peu à peu, les alertes, à telou tel endroit, la mine de Canari, le centre de recherche contre le cancer à Lyon,les immeubles à Nantes, etc. Tous ces éléments sont présents mais ils ne sontpas considérés. L’intérêt de passer à l’informatique est de redonner aux acteursdes prises pour les reconsidérer, y compris s’ils ne s’y intéressent pas, ne serait-ceque parce qu’ils constateront une forme d’accumulation, de répétition, qui sinonreste inaperçue parce qu’on passe par différentes structures, par différentespersonnes. Finalement, les éléments sont stockés et archivés et ne sont pasconsidérés comme importants. Donc, la réponse est triple : premièrement, il faut dupassé pour penser à l’avenir. Deuxièmement, il faut en permanence être capablede savoir s’il y a du nouveau et troisièmement, pour le niveau européen, il n’y apas d’équivalent au niveau du logiciel parce qu’évidemment, toutes les formes delogiciel qui sont développées sont sur la base d’informaticiens, éventuellement de INVS : Institut de veille sanitaire60
linguistes. Leur problème est uniquement le traitement automatique. Nous, c’est lecontraire. Si vous traitez automatiquement, vous allez voir qu’effectivement lesgens parlent du nucléaire et de Tchernobyl. Si vous voulez repérer les élémentsqui sont nouveaux, différents, les petites variations, il y a nécessité d’interventionpermanente des humains et donc les outils doivent être conçus en fonction.Aujourd’hui, nous sommes dans une phase qui semble souligner l’intérêt de notrerecherche. Plus que jamais, il y a des moyens d’accumulation gigantesques, desarchives de plus en plus présentes, de plus en plus disponibles et finalement, et,en même temps, il n’y a pas d’outils de traitement qui soient adaptés aux besoinset aux préoccupations.Philippe Brunet, Université d’EvryJe voudrais revenir sur cette question de la mémoire mais cela déborde sur latable ronde de cet après midi. Ce n’est pas aussi facile qu’il y paraît de répondre àcette question. Dans le travail que vous faites, il y a forcément une mémoiresélective. Lorsque vous identifiez, par exemple sur le nucléaire entre 1996 et 2005,à peu près 350 dossiers ou textes, si on fait une moyenne par an et, si elle a dusens, on arrive à un nombre limité de documents, sur une très longue période.Mais surtout, quel est le statut de ces documents ? Il y a un choix de prélever desdocuments, mais il y a surtout toutes les mémoires vives ou plus ou moins vivesqui existent et qui sont bien souvent dans les coffres-forts des particuliers. Quanddes problèmes se posent localement, comment la circulation de l’information seconstruit-elle ? Comment circule-t-elle, etc. ? Une mémoire, sur laquelle lesinstitutions publiques et les chercheurs ont du mal à avoir prise, existe. Descollectifs se créent, existent pendant quelques mois, accumulent une certainemémoire. Cette mémoire particulière, individualisée, que devient-elle ? Il fauteffectivement revenir sur le passé parce que le passé peut éclairer le présent etl’avenir mais il faut aussi faire ce travail de mise en légitimité des différentesformes de mémoire et ne pas penser à présélectionner a priori les traces écrites etverbales qui existent et qui peuvent être utiles à un moment donné dans dessituations de gestion de crise.Didier Torny, INRAJe suis d’accord avec vous. Comme vous le savez en sociologie, le grand livre surla mémoire c'est «Les cadres sociaux de la mémoire» 5 . Le nombre de documentsest beaucoup plus important et au bout d’un moment, la masse est telle que vousne saisissez plus rien. Sur le nucléaire, on doit être à l’équivalent de 18 000 pages.L’avantage de cette mémoire est de voir surgir des éléments que vous aviezoubliés. Sans arrêt, elle vous renvoie à un extérieur qui permet de remettre à jourdes éléments qui ne sont présents chez personne ou le sont de manière diffuse.Deuxième réponse, ce type de dispositif peut être vu comme un dispositif desurveillance à la limite de type policier, les RG l'utilisant, par exemple. Aucontraire, on peut le voir comme un dispositif démocratique qui met à disposition5HALBWACHS, Maurice, Les Cadres sociaux de la mémoire, Paris, Albin Michel, 1994, 367 pages RG : Services des renseignements généraux61
de toute une série d’acteurs des éléments qui sont connus et pertinents, une autreforme d’organisation de débats publics.Troisième élément, le corpus renvoie sans arrêt à ce qui n’est pas dans le corpus,c’est-à-dire que ces opérations de sélection doivent être constamment pensées ettoute propriété du corpus doit renvoyer à des questions. C’est pour cela, qu’on abesoin de personnes. Pourquoi ne parle-t-on pas de tel site nucléaire dans ledossier ? Parce que quelqu’un, quelque part, sait que l’on devrait parler de tel outel élément. Ce n’est pas présent dans le dossier donc il faut compléter. Il n’y a pasde logique de fermeture. On peut envisager ce type de dispositif dans une logiquede fermeture, fermeture démocratique, politique, en termes de qui a le droit derentrer le texte par exemple ou au contraire, en étant ouvert. Plus vous ouvrez,plus la masse est importante, plus le travail est important et plus ensuite, il y anécessité de revenir dessus. Mais l’avantage est que cette mémoire est objectivée.Elle existe dans les caves des administrations, des opérateurs, des associationsou Internet. On nous dira qu'il existe des documents sur Internet. Mais qui a lacapacité de prendre en mains ces documents, de les interpréter et de pouvoir enfaire quelque chose précisément en vue d’actions futures ?Gérard Degoutte, CemagrefDans le domaine des sciences de l’environnement, les chercheurs sont trèsattentifs à ce que le moyen de mesure ne modifie pas le milieu qui est mesuré.Quelquefois, ce n’est pas possible. Au niveau des sciences sociales, j’imagine queles problèmes sont différents puisque l’influence du milieu que l’on mesure estfavorable, voir voulue pendant les enquêtes. Mais, on peut imaginer le risque derumeur. Existe-t-il une déontologie ou un besoin de déontologie ?Didier Torny, INRAIl y a plusieurs types de recherche, de la recherche la plus académique à larecherche action où le but est de construire avec les acteurs des éléments. Lasociologie en particulier mais aussi la psychologie ont une influence décisive sur lemonde social. Toutes les sciences sociales passées sont incorporées dans lemonde social. Vous ne pouvez pas avoir un objectif de césure complète entre lemonde social et les connaissances que vous produisez, dans un double sens.D’abord, parce que la diffusion existe d’une façon ou d’une autre et d’autre part,pour un certain nombre de chercheurs, il faut que cela diffuse avec un effet sur lesacteurs.François Barthélémy, CG des MinesPhilippe Huet pourrait en parler parce que dans les rapports de retour d’expériencesur les inondations, cet aspect d’interaction sur les acteurs est fondamental.Claire Mays, Institut SYMLOGC’est toujours utile de soulever les questions de déontologie, quelles que soient lesdisciplines. On doit se préoccuper de l’impact produit par le chercheur sur les62
phénomènes et sur le milieu qu’on tente de connaître et de décrire. Cetteconscience fait partie de la formation ainsi que du cadre de travail des chercheursen sciences sociales. Elle a sous-tendu mon travail dans le Limousin. L’importantest de ne pas être seul face à ses observations. Mais en psychologie, on disposede la supervision comme dispositif d'accompagnement. Dans les sciencessociales, la pluridisciplinarité peut remplir cette fonction. Dans ce colloque, dans lemeilleur des cas, on touche à la transdisciplinarité. Dans la rencontre avec unterritoire, on essaie de mettre en place des échanges, des dialogues, uneparticipation des différents acteurs pour dire le risque : chacun aborde et définit lerisque différemment. Cela donne de la dimension à notre connaissance de laproblématique, et nous éloigne de l’imposition de notre point de vue, ce qui est unenjeu fondamental de la déontologie.François Serrand, CARNACQJe suis membre du CARNACQ, Centre National des Comités de Quartiers quiregroupe quelques 500 comités de quartier. Dans le mouvement, nous avons desexpériences diverses et à un moment donné, de 1983 à 1995, à partir d’un mandatlocal, j’ai été président de la commission de la circulation à la sécurité routière desmaires de France. J’ai essayé, mais en vain, et quelle que soit la couleur politiquedes gouvernements, de lutter contre le laxisme à l’égard des poids lourds. Quandon discute dans un cabinet ministériel, on vous dit «vous savez bien l’importancedes poids lourds qui sera de plus en plus grande.» Le problème n’est pas là. Leproblème est de faire appliquer par les poids lourds la réglementation. Dans lesdépartements, j’ai eu l’occasion de demander : «pourquoi laissez-vous passer despoids lourds dans des villages, là où il y a une interdiction absolue?» Les réponsesétaient parfois «langue de bois» mais on me disait également «vous savez, nousavons des directives.» On ne peut pas interdire le passage de poids lourds sur unesection d’autoroute sans qu’il y ait une longue procédure. Le problème estl’application. Nous avons remarqué que les accidents sont souvent provoqués parles poids lourds, notamment dans les dépassements, mais les poids lourds ne sontpas eux-mêmes reconnus comme à l'origine de l'accident. Par ailleurs, lesaccidents sont rares dans les villes et les villages mais il y a les traumatismes deshabitants. Par contre, quand il y a un accident de poids lourds dans un village,surtout si c’est du transport de matières dangereuses, c’est une grandecatastrophe. Ce problème va devenir d’autant plus important avec l’augmentationdu nombre de poids lourds.Philippe Blancher, Asconit consultantsDans ce que vous dites, il y a deux points à souligner. Le premier est en lien avecce qui a été dit précédemment sur «dire le risque». Pour certains risques commecelui que j’ai présenté, dire le risque est difficile. Mais il y a des tas de choses quisont énoncées, connues, et qui ne se traduiront pas par une action. Il y a enparticulier ce problème du statut du transport, de l’importance du transport, qui faitque tout un ensemble de réglementations déjà internes à ce système ne sont pasappliquées. Par exemple, pour le transport de matières dangereuses, lestationnement pose de nombreux problèmes. De même, des règles sont moins63
igides, par exemple dans les stations de stockage. Certains faits se comprennent,car on ne peut pas gérer le risque de la même manière, mais des effets pervers dedéplacement du risque vers le système de transport se produisent. Une étude aété réalisée pour le ministère de l’Environnement. Elle montrait comment desindustriels, pour échapper au seuil Seveso, avaient créé des stockages hors del’établissement industriel pour qu’aux deux endroits, ils soient en dessous du seuil,générant ainsi un flux de matières dangereuses.C'est également l’histoire des plates-formes multimodales. Le stockage ne doit pasdépasser 48 heures mais en fin de compte, celles-ci deviennent un lieu destockage. Les gestionnaires de plate-forme sont confrontés à des difficultéséconomiques et ayant peu de moyens de pression sur les chargeurs, tolèrent etacceptent cet état de fait. Je cite le cas d’un gestionnaire qui a intimé autransporteur de venir prendre la livraison de la marchandise au delà du délai des48 heures. Le transporteur a chargé le camion et l’a arrêté aux portes de la plateformemultimodale, à proximité d’une agglomération. A partir de là, le gestionnairea accepté plus souvent de garder le chargement sur la plate-forme.Le statut des transports est intéressant à étudier de ce point de vue. Le transportest accepté même si les règles ne sont pas respectées, c’est donc que notresociété, dans son fonctionnement, répercute sur le transport ses contradictions etses dysfonctionnements. Parce que notre système est organisé d’une façon telleque le transport doit assurer ces contradictions, assurer un fonctionnement fluidede notre société, dans des conditions extrêmement difficiles. Ainsi, au niveau dutransport, il faut «ruser» avec les règles. On accepte certaines choses du transportparce que cela fait partie d’un fonctionnement bien plus global que le transport luimême.Bernadette de Vanssay, Paris 5Je voudrai revenir sur le thème de cette table ronde, peut-on dire le risque. Il mesemble qu’au bout des cinq ou six présentations que l’on a eues, on est un peuattristé. Si on peut dire le risque, on ne voit pas très bien ni où, ni comment. MmeArnal préconise un changement de vision de la société de façon à ce que lasociété soit prise comme un fonctionnement. Mme Godfrin a montré qu’à partquelques communes avec de bonnes initiatives, dire le risque dans les petitescommunes était à peu près impossible et on est arrivé avec Mme Mays à quelquechose d'encore plus grave puisque le risque même est profondément indicible pourles personnes. On a donc eu des solutions présentées par le logiciel PROSPEROet un peu par Mr Picon avec de la «désegmentation». Est-ce que ceci estsuffisant ? Est-ce qu’en conclusion des travaux qui ont été présentés, on peut direqu’il faudrait reconsidérer ce que signifie dire le risque pour l’État, sachant quedans toutes les enquêtes que nous faisons, l’ensemble des échantillons interrogésconsidèrent, surtout en fonction de l’inondation, que c’est à l’État de dire le risque ?Peut-on reprendre cette thématique ?64
Didier Torny, INRAIl me semble qu’il y a plusieurs questions différentes. D’une part, on n’a jamaisautant dit le risque. Mais, on l’a constaté dans plusieurs exposés, même quand onle dit, ce n’est pas pour autant qu’il y a des moyens d’action qui suivent. C’est unpremier problème. Deuxième question, c’est : oui, on l’a dit. Or, le problème n’estpas le risque mais les risques. Un jour, on parle de tel dossier, le lendemain, onparle d’un autre. Le fait de l’avoir dit finalement ne change pas grand chose, avecune insatisfaction générée par ceux qui portent des alertes, des dossiers avec eux,tout au long de l’année et qui, à un moment donné, ont éventuellement une fenêtrequelqu'en soit la forme, médias, préfet… Puis cela retombe, il y a des délais et onne comprend pas pourquoi. Ce n’est pas appliqué. Donc, cette question «dire lerisque» est difficile à isoler en tant que telle. Elle peut être analytiquement séparéemais, en termes sociaux et politiques, le problème ne peut pas être isolé desdispositifs d’expertise, d’action et des politiques de manière plus générale.Valérie Godfrin, ENSMPLa réflexion que j’ai eue suite à l’étude portait sur la pertinence des procéduresd’information. Ces procédures constituent-elles la bonne solution pour informer enmatière de risques ? Il manque une étude de psychologie-sociologiecomportementale par rapport au risque. Elle permettrait de comprendre commentest réceptionné un message, comment il est vécu et ce que les gens en retirent.On a institué des procédures d’information préventive mais on ne sait pascomment le message est réceptionné. C’est ce qui manque pour rendrel’information efficace en matière du risque.Didier Torny, INRAIl y a beaucoup de travaux sur des tas de domaines et à chaque fois, on voit quece sont des choses extrêmement compliquées, que ce soit sur le domaineindividuel ou collectif. Vous prenez 20 ans de sida et 20 ans d’histoire decampagne et d’actions de prévention, c’est compliqué y compris lorsque vousrentrez dans l’intimité des gens. Dans ce cas, le risque a été dit. Il y a eu uninvestissement massif sociétal. Cette question est abordée dans de nombreusesétudes mais on a des réponses extrêmement compliquées y compris dans uncadre de visualisation massive.Claire Arnal, BRGMOn est tous ici en train de parler du risque. On est tous des spécialistes du risqueet on a tous la préoccupation du risque. Cependant, quand on discute avec lesparlementaires, qui sont absents aujourd’hui, et avec un certain nombre dereprésentants des collectivités, le risque, particulièrement le risque naturel, estpratiquement le dernier de leur souci. Aborder le risque en affirmant "il faut dire lerisque" n’est peut-être pas le bon moyen. Le bon moyen est probablement deréinsérer le risque dans une problématique d’aménagement parmi d’autresconsidérations qui sont le développement économique, la sécurité, le social…Mais, est-ce qu’il ne serait pas intéressant de dire le risque en essayant de voir65
quelles sont les préoccupations des gens auxquels on s’adresse et d’insérer plusou moins discrètement ce risque ? En France, nous ne sommes pas, en matièrede risques naturels, très exposés à des choses gravissimes.Nicolas Buclet, Université de Technologie de TroyesMa question s’adresse à Claire Arnal sur son système d’indicateurs. Par rapportaux différents types d’impact, social, économique, environnemental… vous avezune échelle du plus léger au plus dommageable. N’avez-vous pas envisagé qu’ilpuisse y avoir des impacts positifs et d’autres négatifs dans votre échelle ? Ce quedisait Bernard Picon sur le fait que si on protégeait l’environnement, cela nepouvait avoir que des bénéfices pour le social. Finalement, les liens entre lesdifférents types d’impact sont plus compliqués.Claire Arnal, BRGMVous avez tout à fait raison. J’ai parlé de types d’impact et pas de dommages cequi signifie que cela pouvait être positif et négatif. Ce que j’exprimais dans le termed’impact est l’importance du local à national et international. Il reste à réfléchir surl’expression, c’est-à-dire se borne-t-on à dire que c’est un impact d’un certainniveau ou est-ce qu’on essaie de déterminer si c’est un impact positif ou négatif.Yves Le Bars, Cemagref / Conseiller de la Commission du débat public surla gestion des déchets radioactifsPeut-on dire le risque sans dire le bénéfice ? C’est vrai que l’on est bien marquépar la logique des risques naturels dont le bénéfice de la prise de risque n’est passouvent calculé, mais il y a un bénéfice à mettre sa chaudière dans un sous-sol aulieu de la cave qui est régulièrement inondée. Cette question est débattue dans lecadre des déchets radioactifs. On ne devrait pas parler de déchets radioactifsindépendamment d’un débat global sur l’énergie. C’est une question qu’il faut seposer à chaque moment. Peut-on dire le risque sans parler des bénéfices et si onadopte une position où on ne parle que de dire le risque, n’est-on pas dans uneidéologie du risque zéro ?François Barthélémy, CG MinesIl est certain que cette question apparaît de façon parfois cachée. Ainsi, lesdéchets radioactifs de Bessines n’ont pas beaucoup augmenté en volume cesdernières années puisque l’exploitation est fermée. Par contre, la prise en comptedu risque est beaucoup plus prégnante, aujourd’hui que l’activité est arrêtée. Dutemps où il y avait plusieurs centaines de mineurs à Bessines, le risque étaitrefoulé. Dans un autre cas récent, celui de Métal Europe, du temps où l’usinefonctionnait et occupait 800 ou 1000 personnes, dire qu’elle polluait était secret.Depuis que l’usine s’est arrêtée, la pollution est devenue un problème majeur.Donc, cela montre bien la difficulté d’avoir un discours. Il faut effectivement tenircompte des avantages qu’un certain nombre d’activités procurent. Mais l’impactdans les discours est extrêmement complexe et difficile à rationaliser. Sur le plangénéral du nucléaire, c’est particulièrement difficile parce qu'on a du mal à66
expliquer qu’entre les bénéficiaires qui sont tout le monde et ceux qui ont lesinconvénients, les habitants de trois cantons, le bénéfice global compense.Claire Mays, Institut SYMLOGDans notre étude dans le Limousin, nous avons été étonnées d’apprendre et deconstater que les interviewés les plus âgés acceptent volontiers le stockage de cesdéchets et notamment celui d’uranium appauvri à Bessines. Ils justifient cetteacceptation par la conscience d’avoir bénéficié pendant 40 ans de l’activitéminière. Pourtant, parmi ces 22 personnes, un certain nombre a osé parler dutabou, du déni, de la contradiction qui paralyse la parole dans ces zones. Dans lelivre de Philippe Brunet, on a des renseignements dans ce sens. Cette balancerisque-bénéfice devient un problème moral pour les gens : «Est-ce que j’ai le droitde relever le risque lorsque j’ai été travailleur dans une industrie qui a nourri mafamille ?».Philippe Blancher, Asconit consultantDans le prolongement de cette réflexion, en ayant travaillé sur le risque majeur liéà l’urbanisation, un arbitrage se fait à un moment donné par les responsables. Cetarbitrage a besoin d’un certain voile d’ignorance. La façon dont cela fonctionnedonne l’impression que l’arbitrage ne peut pas être affiché. C’est lié en partie à lanature du risque majeur, qui balance sans arrêt entre la faible probabilité etl’ampleur du sinistre ou de l’impact, et qui fait que toute recherche d’équilibre, toutepondération est très difficile à afficher publiquement. Cet aspect dire le risque etdire son bénéfice est accompagné par un autre aspect qui est : peut-on dire lerisque sans pouvoir dire ce que l’on fait en face du risque. Sur les matièresdangereuses, ce qui empêche de dire le risque, c’est quand on ne sait pas dire enmême temps ce qu’on fait, même le début d’une action pour répondre à certainsproblèmes.Claude Gilbert, Président du conseil scientifique EPR, CNRSDire le risque, pour rebondir sur les propos de Claire Arnal, est-ce que cela peutvraiment être autre chose qu’un « affichage » ? N ’est-on pas conduit, pour gérereffectivement les risques, à quitter le risque avec la dimension exceptionnelle qu’ilintroduit, pour trouver le chemin des politiques ordinaires qui ancrent cette gestiondans l’ordinaire, qui permettent aussi de faire les nécessaires et inévitablescompromis entre différents impératifs.Un second point abordé par Valérie Godfrin et Philippe Blancher : le risque peutêtre une ressource pour les acteurs. Des accidents industriels, par exemple,survenant dans des zones fortement urbanisées peuvent fournir « l’occasion » dedestiner les terrains à d’autres activités plus en accord avec les priorités que sedonnent, un moment donné, une agglomération.Un troisième point enfin, abordé par Philippe Blancher, Bernard Picon et DidierTorny. Des problèmes sont définis en tant que risques. Mais ces définitions sontinstables. Ce ne sont pas les mêmes dangers, les mêmes territoires qui setrouvent ainsi nommés et cela renvoie à des enjeux et valeurs extrêmement67
variables. Par exemple, nous ne sommes pas du tout en face du même type derisque selon que l’on est sur un référentiel ou un autre. Lorsque Bernard Picon faitétat des problèmes en Camargue, ils sont appréhendés de manière très différenteselon qu’on les resitue par rapport à la Camargue en tant que lieu où sedéveloppent des activités économiques ou en tant que lieu dont il faut préserver lecaractère naturel. De même, et je me réfère à l’intervention de Didier Torny, ladéfinition d’un problème en tant que risque varie selon l’intervention des locuteurs,selon la manière dont se structure la scène où ils interviennent. En d’autrestermes, la manière d’approcher un risque varie selon le « cadrage » quiprédomine. On a pu le constater dans divers autres domaines (la sécurité routière,les déchets nucléaires…).Jean-Claude Soumbo, Conseil régional de MartiniqueJe me suis senti particulièrement impliqué par les propos de Claire Arnal et DidierTorny. Dire le risque nous semble être un enjeu majeur parce que l’homme est unanimal social. Pourquoi nous sommes-nous mis en société ? Parce quel’organisation sociale était une façon de réduire le risque et de pouvoir perpétuerl’espèce. C'est ce que met en valeur le travail de Philippe Blancher qui montre bienque dire le risque s’attaque de front à l’organisation de la société en tempsqu’objectif de vouloir produire directement ou uniquement du profit. Parce que lalibre circulation des marchandises rejaillit sur ce problème. Il en est de même desproblèmes posés par le traitement des déchets d’uranium. Cette vision globaledépasse même les problèmes propres à l’État, qui doit être une vision mondiale.Le travail de Claire Arnal m’a beaucoup intéressé car dans son impact, le politiqueexiste parce que cet impact politique est capable de faire évoluer les choses.Rappelons-nous la réaction par rapport à la vache folle, à l’amiante.Pour prendre un exemple, en Martinique, nous avons voulu mettre en place unepolitique globale par rapport au risque sismique et on s’est rendu compte que cettepolitique globale passait par de la formation d’ingénieurs, d’architectes, d’artisans,de chefs de chantier mais aussi par celle de la population comme l’a dit ValérieGodfrin. Il était temps de faire des réunions avec la population parce qu’à cemoment-là, les gens qui ont les informations sont susceptibles de les intégrerchacun à leur niveau, afin de mieux se préparer face au risque. Donc, il fautresituer cet enjeu majeur qui dépasse le cadre politique. Parfois en Martinique,nous avons des problèmes pour expliquer qu’appliquer une norme telle qu’elle estconçue en France pour les hôpitaux n’est pas une bonne solution car quand onprend sa dimension ilienne, l’hôpital est un outil fondamental qui doit êtrefonctionnel après le passage d’un séisme majeur. Donc, cette notion de dire lerisque, du moment où on prend en compte le risque mais aussi le lieu où se situele risque, est fondamentale; mais surtout, nous ne pouvons pas dissocier le risquede la vie, tout simplement. Avant, si le fait de se mettre en société nous permettaitde mieux vivre, de mieux perpétuer l’espèce, on se rend compte que par sonaction, l’homme crée de plus en plus des risques nouveaux qui mettent en jeul’espèce elle-même.68
Marie Gueydon, étudianteJe pose ma question à titre personnel. Elle est en relation avec le fait que le risquedépasse le cadre politique. J’aurais aimé vous parler du nucléaire car à mon avisl’État et les organismes publics ont pour mission première le bien commun et laprotection de la santé publique. Pourtant l’État a engagé son accord pour unenouvelle génération de centrale nucléaire. On connaît déjà le risque de cettetechnologie, les dangers sanitaires et environnementaux qu’il représente et quisont avérés, qui ont déjà existé et qui posent problème. On sait que l’opinionpublique est très défavorable à ce projet et aussi, qu’il serait possible, àinvestissement égal, de développer d’autres technologies qui produiraient autantd’électricité. Quand un risque est trop important et qu’il concerne le territoire et lasanté publique, il est nécessaire de prendre en considération l’opinion publique etde modifier ses comportements en fonction. Le secret national pèse sur ce thème.Dire le risque n’est pas forcément évident, ni facile mais sur un sujet d’une telleenvergure, cela me paraît important et évident de prendre en compte l’opinion dela population. Il y a une grosse contradiction. Pourquoi ne prend-on pas enconsidération d’autres possibles ?Philippe Huet, Président du comité d'orientation, IGECe n’est pas un colloque sur «l’EPR » et une commission du débat public estprécisément en place pour répondre à votre question.Marie Gueydon, étudianteLe sujet de la table ronde est de dire le risque mais une fois qu’on a dit le risque, leprend-on en considération surtout au niveau de l’État ?Didier Torny, INRASur ce point, c’est assez intéressant parce que c’est un enjeu essentiel. Il y a desdoutes qui sont très largement partagés. En tant que sociologue, je n’aiévidemment pas de position précise à adopter a priori sur cette question, cela faitpartie de la déontologie. Est-ce que le débat va être découplé des décisions ouest-ce que le débat et les décisions sont liés ? Autrement dit, sous quelle forme estintroduite une procédure démocratique ? On retrouve ce débat sur le nucléaire oupour le référendum sur l'Europe. Demande-t-on son avis au peuple ? A-t-on unedémocratie représentative ou une démocratie dans laquelle le gouvernement peutimpulser seul un certain nombre d’actions ? Donc, la réponse de la CNDP 6 est unebonne réponse mais en même temps, l’organisme lui-même et la façon dont lesdébats sont organisés font que les conditions de la démocratie ne sont pasforcément réunies, au moins aux yeux d’un certain nombre d’acteurs. EPR : European pressurized reactor (nouvelle technologie nucléaire)6CNDP : Commission Nationale du Débat Public69
André Carrière, CARNACQ / Président de l’union des quartiers de NîmesOn vient de parler de dire le risque mais une fois qu’on a dit le risque, qu’est-cequ’on peut faire pour que nos élus, nos dirigeants appliquent les décisions qui ontété prises en fonction du risque. Je prends un exemple. Mr Huet, dans votrerapport que vous avez fait après les inondations de 2003, vous avez suggéré enparticulier à Nîmes qu'il y ait une zone d’expansion des crues qui ne soit pasconstructible. Or, actuellement, le préfet s’apprête à donner l’autorisation depermis de construire sur cette zone.Philippe Huet, Président du comité d'orientation, IGELe projet, sur cette zone, c’est 500 logements dans une zone inondable. Nousavions calculé que cette affaire coûterait tôt ou tard de l'ordre de 8 millions d’€ à lacollectivité. Sur une période d'une trentaine d’années, il y a une forte chance eneffet qu'il y ait au moins une inondation. Le fond de la question est le suivant :peut-on aménager en zone inondable, sans avoir exploré les possibilités de selocaliser ailleurs ? C'est une vraie question de politique publique. Il y a des effortsassez considérables à faire, en particulier dans la région Languedoc Roussillon.C'est la même logique que pour les TMD 7 . Des affaires de ce type ne seréorientent pas en un, deux ou trois ans. Cela se réoriente par la volonté de lasociété civile, des associations, des juges, par des expertises et contre-expertisespour montrer que d’autres modèles sont possibles. Quand on a eu une politiquependant trente ans, il est difficile de se convertir rapidement.Valérie Godfrin, ENSMPC’est vrai que la plupart du temps, malheureusement, la réponse juridiqueintervient a posteriori puisque c’est une mise en cause des responsabilités après lesinistre. On essaie de savoir ce qui s’est passé. Il est vrai aussi qu’il existe descontrôles a priori, les contrôles de légalité sur les permis de construire. Dans laréalité, tous les permis de construire ne font pas l'objet d'un contrôle. Avec lamultiplication des PPR, on peut penser que la marge d’erreur concernant ladélivrance de permis de construire dans les zones de risques, va se réduire… Apartir du moment où le PPR affiche le risque, on peut penser que les contrôles surles permis de construire seront beaucoup plus rigoureux.Nicolas Camp’huis, Agence de l’eau Loire-BretagneJe dirige depuis 10 ans une équipe qui est censée rappeler le risque d’inondationle long de la Loire moyenne, sur les aléas, les enjeux et les vulnérabilités. Jepartage l’avis d’Yves Le Bars sur la façon de dire le risque; c'est ce que jeremarque au contact des collectivités territoriales. Nous avons fait 120 enquêtesde retour d’expérience sur les personnes inondées. Nous nous sommesentretenus avec 80 personnes en tête à tête pendant deux heures sur ce quereprésentait pour elles le risque inondation. 60 interviews en zone inondable, avecdes personnes qui vont être délocalisées dans les 5 ans qui viennent, portaient7TMD : Transport de Matières Dangereuses70
sur : pourquoi habitez-vous là ?, qu’est-ce qui fait que vous avez envie d’être là ?,est-ce que vous êtes conscient du risque auquel vous êtes exposé ? En cemoment, pour répondre à Valérie Godfrin, nous sommes en train de faire un retourd’expérience sur la façon dont les gens ont reçu un DICRIM 8 dans leur boîte auxlettres et l’ont utilisé. Je ne crois pas à dire le risque seul. Le risque, c’est peut-êtrele travail de l’État mais pour le citoyen, il n’a aucun intérêt à recevoir le risque.Nous participons à un projet européen avec des Néerlandais et des Allemands,«plaisir de vivre au bord du fleuve», initié par des Néerlandais qui se sont pris desclaques énormes car ils disaient le risque alors que les gens en face d’eux nevoulaient pas le dire mais voulaient vivre au bord d’un cours d’eau. Il y a vraimentune difficulté sur cette façon de dire le risque si on n'intègre pas ce qu'il y a dans latête des gens qui vivent là. Ils ont aussi des plaisirs. Si on veut être entendu desgens, il faut aussi être crédible de ce côté là, dire aussi la face de lumière. Lesrares collectivités locales qui, le long de la Loire, disent correctement le risque, ycompris réglementairement, sont des collectivités qui ont derrière, des projets dedéveloppement urbain autour d’un fleuve avec le risque, mais également avec lesautres palettes.Liliane Besson, Institut des Risques majeursParmi les différents facteurs qui nuisent à dire le risque, il y a la crainte de laresponsabilité. C’est un point important qui gêne cette transparence que nousrecherchons tous.Didier Torny, INRALes modifications de la responsabilité pénale sur le plan juridique et surtout dans latête des acteurs administratifs, parce qu’ils ne sont pas tous juristes, entraînentdeux attitudes contradictoires. Certains comportements visent effectivement ausecret, à l’absence de traces mais il y a exactement l’inverse, dire précisément lerisque par un effet d’affichage avec des notes qui peuvent descendre du cabinet,ce qui est considéré par ceux qui les reçoivent, comme une tentative d’échapper àtoute forme de responsabilité puisque le cabinet a agi et a informé l’administrationqu’il fallait agir. Evidemment après, vous imaginez toute la chaîne descendantepour arriver jusqu’au préfet et aux responsables de DRIRE.Valérie Godfrin, ENSMPCe qui ressort de l’enquête menée sur l’information préventive, c’est que biensouvent, la procédure est appliquée à la lettre, en parfaite conformité avec lestextes, ce qui laisse penser que les autorités «ouvrent un parapluie», les mettant àl’abri d’une procédure judiciaire. Mais, savoir si le message a été correctementcompris apparaît comme un souci très secondaire, le principal étant la protectionjuridique apportée par le respect de la procédure.8DICRIM : Dossier d'Information Communale sur les Risques Majeurs71
Claude Gilbert, Président du conseil scientifique, CNRSIl faut prendre très au sérieux la demande qui nous a été adressée par rapport aunucléaire. Il est quand même curieux que dans un programme sur les risquestechnologiques et naturels, nous n’ayons aucun travail sur le nucléaire. Nousdébattons sans trop de difficulté sur les risques naturels. Sur les risquesindustriels, c’est déjà plus compliqué. Sur les risques nucléaires, dans quellesconditions allons-nous débattre ? Je fais le pari que l’on va pouvoir débattre tantque nous voulons sur les déchets nucléaires, sur les grandes options, en matièrede réacteurs, etc. Quelles vont être les conditions du débat ? Est-ce que nousallons pouvoir, à coup d’expertises, de mobilisations, de juges, socialementdébattre de la même façon pour le nucléaire que nous pouvons débattre sur lesrisques naturels ? Les conditions sont complètement asymétriques.Gérard Brugnot, CemagrefNous sommes un pays qui «dit beaucoup le risque» à travers des procédures trèspratiques. Il n’est pas forcément très facile de revenir en arrière une fois qu’ons’est lancé dans cette direction. Deuxième point, nous sommes un pays où depuisla France «d’en-bas» jusqu'à la France décisionnaire, nous sommes trèsallergiques à l’économie. Il serait très intéressant d’analyser cette doubleparticularité française qui nous conduit vers une sorte de crise de nerfspermanente.72
Table ronde 2 : Intégrerla société civile dans la gestiondu risque ?Cette table ronde s'interroge sur le rôle de la société civile dans lagestion de risque.La gestion du risque implique de plus en plus toutes les partiesprenantes de la société, y compris les acteurs de la société civile.Quel est le bilan de ces expériences ? Quelles sont les pistes àsuivre ?Co-animateurs :Suzanne de Cheveigné, CNRSPaul Louis, ANCMRTMIntervenants :Cyril Bayet, Université Paris 13Geneviève Decrop, Futur AntérieurPierre-Benoit Joly, INRABertrand Munier, ENSAMJacques Roux, CNRS73
Suzanne de CheveignéLa question que nous nous posons là est celle de l’intégration de la société civiledans la question de la gestion des risques, c’est-à-dire au fond, un renoncement àune simple gestion par représentation, que ce soit une représentation politique oubien une délégation à des experts techniques. Est-ce que des gens «ordinaires»peuvent intervenir dans cette gestion des risques ? Bien entendu, les gens«ordinaires» sont partie prenante des problèmes environnementaux,technologiques que l’on peut rencontrer, en tant que victimes, en tant aussi queresponsables par des conduites qui participent à créer du risque ou en empirer lesconséquences mais également de façon plus positive, avec une participation à laréparation, au suivi des problèmes et avec des positions qui sont, de façongénérale, souvent ambivalentes. Quoi faire avec cette population qui a despositions différentes, contradictoires, qui a des exigences croissantes; je vousrappelle un fait sociologique : le niveau de la population a très fortement augmentéau cours de ces 50 dernières années. Cette population qui est beaucoup pluséduquée demande à participer de façon beaucoup plus importante à cesquestions. Cette participation peut prendre différentes formes. Cela peut être toutsimplement d’être informée ou qu’on lui rende des comptes sur la gestion de telleou telle question. Mais doit-elle participer à la gestion ? Doit-elle véritablementcogérer ? Est-ce qu’elle doit redéfinir, recadrer les problèmes ? On a différentsniveaux d’intégration de la société civile dans les problèmes. Comment faireconcrètement ? Cela veut dire en effet gérer un très grand nombre de personnes.Cette question du grand nombre est fondamentale. C’est un vrai problème. Va-t-onavoir des individus isolés, ou doit-on forcément passer par des associations ? Estceque l’un exclut l’autre ou faut-il combiner les deux ? Quels peuvent être lesdispositifs qui vont servir à aider cette participation ? Est-ce que cela va être desdébats, des négociations ? Comment faire pour mettre en œuvre ces processus,les évaluer, les améliorer ? Toute une série de questions que se sont posées lesdifférents chercheurs qui vont nous exposer leurs travaux.Nous avons demandé aux chercheurs de mettre en évidence les points forts deleur recherche mais également de répondre à ces questions. Que pensent-ils desdifficultés que rencontre cette intégration de la société civile ? Quelles résistancesapparaissent ? Quid des dispositifs et de la manière de les évaluer ? Quels rôlespeuvent jouer les collectivités locales ? Quelle influence peut avoir ladécentralisation ? Surtout nous leur demandons d’ouvrir les yeux sur l’avenir, avecquel type de recherches ?74
Contestations associatives et régulation des conflitsdans la politique de gestion des zones inondablesCyril BayetUniversité Paris 1399, avenue Jean-Baptiste Clément, 94430 VilletaneuseTél : 01.42.80.38.28cyrilbayet@hotmail.comJ’aborde la question de la société civile sous un angle précis, celui desmobilisations collectives observées contre la politique de prévention desinondations, qui est aujourd’hui celle de l’État, c'est-à-dire les PPRI, Plans dePrévention des Risques Inondation. Cette politique suscite de nombreuxphénomènes de contestation au niveau local de la part de riverains qui souvent seconstituent en association et sont souvent soutenus par leurs élus locaux. J’aicherché à analyser le déroulement de ces conflits et la manière dont ils sontappréhendés et traités par les pouvoirs publics en essayant de montrer que l’onassiste à une certaine évolution dans les outils employés par les autorités pourréguler ces situations de conflits, outils qui reconnaissent une légitimité un peuplus importante aux intérêts défendus par les riverains.Dans une première lecture, on peut considérer que les oppositions observées auniveau local ne sont pas très surprenantes dans la mesure où ces politiques desPPR comportent une forte charge de conflictualité, puisqu'elles recherchent desbénéfices diffus sur le long terme, à savoir la réduction globale de la vulnérabilitésociale et économique aux inondations, la réduction des dépensesd’indemnisations des catastrophes naturelles ou encore la préservation del’environnement via la préservation des zones inondables naturelles. Cesbénéfices concernent l’ensemble de la collectivité et ne peuvent se faire sentir qu’àlong terme. A l’inverse, cette politique est susceptible d’entraîner un certainnombre de coûts concentrés sur quelques uns, les élus des collectivités concernéset les riverains inondables. Ces coûts s’exercent à court terme. Pour les élus, desprojets d’aménagement local peuvent être remis en cause et pour les riverains, cesont des incertitudes sur le devenir de la valeur de leurs biens, sur les conditionsfutures d’indemnisation par les assurances et aussi certaines obligations detravaux, par exemple concernant la mise en sécurité de leur habitation.Ces coûts sont d’autant plus fortement ressentis par les habitants que la politiquedes PPR constitue souvent un complet changement d’orientation par rapport auxpolitiques menées jusqu’à présent au niveau local, en matière d’urbanisation deszones inondables et par rapport aux discours rassurants qui ont pu être tenus auxriverains sur l’efficacité des dispositifs existant contre les inondations. Dans cesconditions, les projets PPR sont souvent vécus et dénoncés comme des produitsfondamentalement technocratiques, imposés aux populations et aux territoiresconcernés pour des raisons propres à l’administration et sans considération desattentes effectives des habitants à l’égard des risques d’inondations. Beaucoup deprojets PPR donnent lieu à des mouvements d’opposition de la part de riverains75
qui contestent le contenu et la légitimité de cette politique et qui revendiquentparallèlement des mesures actives de lutte contre les inondations.La question qui se pose du point de vue de l’administration est de savoir commenttraiter et gérer ces oppositions. La manière dont les services de l’État gèrent cesconflits est fortement influencée par une lecture des mobilisations des riverains entermes de syndrome NIMBY, c’est-à-dire que l’administration aurait à faire à desriverains guidés par une attitude essentiellement égoïste, centrée sur la défensed’intérêts strictement privés. La remise en cause des PPR serait le fait depropriétaires avant tout préoccupés par la valeur de leurs biens et qui refuseraientd’assumer les coûts liés au fait d’habiter en zone inondable et qui à l’inversechercheraient à reporter le problème des inondations sur la collectivité, endemandant des garanties supplémentaires en matière d’indemnisation et enréclamant le financement par les pouvoirs publics de mesures de protectionsupplémentaires contre les crues. Les préoccupations des riverains seraient enmême temps irrationnelles, dans la mesure où ces riverains auraient tendance àexagérer quelque peu les conséquences négatives des PPR sur leur situationpersonnelle. Ils formuleraient des demandes de protection contre les inondationsirréalistes au regard des données et des réalités scientifiques. Cette lecture al’avantage, si on se place du côté de l’administration, d’établir une frontière netteentre l’intérêt général qui serait incarné par la politique des PPR et de l’autre lesintérêts particuliers qui seraient défendus par les riverains. De la même manière,elle établit une frontière entre les spécialistes des questions d’inondation et lesprofanes, aux attentes et aux conceptions irrationnelles. Ainsi, ces oppositions neremettraient pas en cause la légitimité des projets de PPR portés parl’administration.Ces oppositions, dans cette perspective, appellent des solutions de deux sortes :- assurer une meilleure information des populations locales sur la réalité desrisques d’inondation afin de mieux faire prendre conscience de lanécessité et de la légitimité d’une réglementation. C’est l’objet de certainesmesures qui accompagnent la politique des PPR, qu’il s’agisse des atlasdes zones inondables ou de manière plus récente, comme c’est prévu parla loi Bachelot, la pause de repères de crue par les municipalités.- amender dans les PPR les dispositions qui sont susceptibles d’êtrecontestées, de porter atteinte aux propriétaires. C’est ainsi par exempleque les dispositions obligeant normalement les riverains des zones bleues,de risque moyen, à réaliser à leurs frais certains travaux de mise ensécurité de leur habitation, ne sont quasiment jamais inscrites dans lesPPR par l’administration car considérées comme beaucoup tropconflictuelles alors même que c’est une disposition centrale dans lapolitique publique.Les modalités de traitement des conflits s’avèrent néanmoins souvent inopérantespour prévenir ou dénouer les oppositions et pour éviter des situations de blocagepolitique. C’est le cas dans une situation que j’ai étudiée plus particulièrement quiest celle de la vallée de l’Oise, où le travail effectué par les associations deriverains pour mobiliser autour de leur cause a consisté à revenir sur cette lecture76
des oppositions en termes de «nimbisme». Elles ont employé deux stratégiesprincipales. D’abord, elles se sont efforcées de rattacher leur cause à la défensedes intérêts d’un groupe social dans son ensemble, celui des riverains inondables,en soulignant en quoi la politique des PPR revenait finalement à stigmatiser et àculpabiliser les riverains installés pourtant légalement en zone inondable et à leurfaire porter, en grande partie, la responsabilité de traiter les problèmesd’inondation; par exemple en leur imposant de réaliser certains travaux deprotection alors que les services de l’État ou les collectivités locales sont laissés enpartie exemptes d’obligation. De même, la stratégie des associations a consisté àse faire les porte-parole d’enjeux territoriaux en soulignant que la politique desPPR était mal adaptée aux enjeux particuliers de la vallée de l’Oise et ensoulignant que des mesures de protection contre les crues étaient possibles etnécessaires sur ce territoire.Donc, le travail et la réussite de la mobilisation des associations de riverains ontété de brouiller la frontière entre intérêt général et intérêt particulier, entrespécialistes et profanes pour faire apparaître le conflit comme un conflit politiquequi oppose certains intérêts sociaux qui sont également légitimes. Cette situation aobligé l’administration à modifier sa stratégie de régulation de ces conflits. Si onextrapole, à partir du cas de la vallée de l’Oise, on assiste à la mise en place denouveaux outils de régulation liés à la politique des PPR qui vont dans le sensd’une reconnaissance de la légitimité des intérêts dits locaux ou particuliers. Cesoutils sont de deux sortes :- des outils de négociation, sous la forme de l’instauration de sortes decompensations, c’est-à-dire que d’un côté, l’État met en œuvre des PPR, del’autre, il négocie des contreparties avec les acteurs locaux pour compenser lescoûts de la politique des PPR. Ces contreparties s’intéressent par exemple auxintérêts privés. La loi Bachelot prévoit de financer par des aides publiques lestravaux que doivent réaliser les riverains de la zone bleue. Ces compensationss’adressent aussi aux intérêts locaux ou territoriaux. Ainsi, les PPR d’annonce descrues, de travaux de lutte contre les crues sont de plus en plus pensésconjointement dans une perspective de compensation réciproque. D’un côté, l’Étatavance dans la mise en œuvre des PPR, de l’autre les riverains et les collectivitéslocales obtiennent des améliorations dans l’annonce des crues ou la protection dezones urbanisées. Un accord de ce type a été officialisé dans la vallée de l’Oise àtravers la charte Oise-Aisne. La mise en œuvre des PPR est de plus en plusconçue comme devant s’accompagner de négociation avec les intérêts locaux etles intérêts privés. Des négociations prennent un tour de plus en plus officiel.- A côté de ces pratiques de compensation, il y a également aujourd’hui un certainintérêt qui est reconnu au débat et à la confrontation publique et pas seulement àl’information et à la pédagogie, comme moyen de réguler les conflits liés aux PPR.Cette évolution s’observe essentiellement dans les discours. Néanmoins, quelqueschangements concrets vont dans ce sens. Par exemple depuis la loi Bachelot, lesenquêtes publiques de PPR deviennent des enquêtes de type Bouchardot, quis’inscrivent dans un cadre un peu plus démocratique.77
Au total, avec la politique des PPR, on assiste à une évolution qui est commune àbeaucoup de politiques d’environnement et d’aménagement. Une conceptiondavantage territorialisée de l’intérêt général se met en œuvre. Elle est conçuecomme le résultat d’un processus localisé d’ajustements entre des intérêts sociauxdifférents et dans ce cadre, les intérêts de proximité qui sont défendus par lesriverains ne sont plus rabattus du côté de l’égoïsme et du particularisme mais sevoient reconnaître une certaine forme de légitimité.Suzanne de CheveignéNous avons donc eu là une première rencontre entre pouvoirs publics et sociétécivile.78
Victimes, associations de victimes et prévention des risquescollectifsGeneviève DecropFutur AntérieurChemin du Lavoir, 69 690 BessenayTél : 04 74 72 81 79Genevieve.decrop@wanadoo.frJe vais vous parler des associations de victimes de catastrophe, plus précisémentdes associations qui sont regroupées autour de la FENVAC, Fédération Nationaledes Victimes d’Accidents collectifs, SOS-Catastrophes et tenter de répondre à laquestion posée : qu’apportent ces associations de victimes à la gestion desrisques et qu’apporte l’étude de ces associations à la recherche dans ce champ ?Les associations de victimes sont un phénomène récent. La FENVAC s’estconstituée en 1993. Elle est née de l’association qui s’est constituée en 1988 suiteà la catastrophe de la Gare de Lyon. Ce sont donc des nouvelles venues dans lechamp du risque. Elles ont, dès leur apparition été très fortement controversées.Deux reproches majeurs leur ont été faits, le premier étant de tirer la scène durisque vers l’émotion, la passion au détriment des approches rationnelles etscientifiques plus froides. On les a soupçonnées d’être le fer de lance d’unphénomène régressif, voire archaïque, poussées à traquer des coupables pardésir de vengeance. Dans cette optique, elles se trouvaient en complet décalageavec ce que le champ du risque mettait au jour sur la scène du risque, sur sacomplexité, sur l’enchevêtrement des causes, des effets et des acteurs. On acraint que ces associations ne soient un facteur de retour en arrière. On leur aégalement reproché de déchaîner le processus de judiciarisation de la société etde susciter une réaction en contre-coup, en incitant les acteurs en charge de cesrisques à se protéger – à se focaliser sur le risque pénal, plutôt que sur les risquescollectifs.Quelles sont les conclusions de cette étude qui a duré presque 3 ans ? Cesassociations apportent quelque chose de très intéressant sur le plan de lasociologie de la mobilisation associative. Elles sont d’un type nouveau, en réalitétrès moderne. Elles font partie de ces associations, typiques de la sociétéd’individus, dont les membres se mobilisent au nom d’eux-mêmes, en refusant ladélégation. Elles sont du type «self-help». A ce titre, elles entretiennent unecertaine tension avec les associations d’aide aux victimes – une tension qui n’estpas toujours perçue de l’extérieur, d’où une certaine tendance à les confondre.L’intérêt collectif des associations de victimes ne préexiste pas à leur constitution.Certains chercheurs ont parlé à leur propos de «groupe circonstanciel». Leursmembres, en effet, n’ont aucun intérêt commun hors l’événement qui les aconstitués en victime. Le groupe circonstanciel est en fait un groupe de hasard.Toute la difficulté est de construire cet intérêt collectif, malgré les différences detous ordres (sociales, géographiques, parfois nationales, culturelles, etc) qui lesséparent, et ce alors que la circonstance qui les rassemble, la perte, le deuil, est79
ien plus propre à séparer qu’à rassembler. Le deuil incite au retrait dans l’espaceprivé, dans l’intimité et ici, il s’agit de construire un espace public. La constructionde l’objet commun appartient donc à la fois aux moyens et aux finalités del’association.Et la chose intéressante – et très contemporaine – est que cet objet commun estdans l’ordre cognitif. C’est un processus de connaissance, de dévoilement de cequi est arrivé et des chemins par lesquels il est arrivé – en s’appuyant sur lesdiverses expertises mises en jeu à la suite d’un accident collectif, dans l’ordretechnique et dans l’ordre judiciaire.Mais de ce point de vue, qu’amènent ces associations dans le champ de laprévention des risques et de la gestion des crises ?La première chose est une posture inédite. Les associations habituelles, cellesqu’on a l’habitude de voir dans les «tours de table» de la prévention sont souventdes associations de défense d’un site, des associations de protection de la nature,donc, des associations qui se défendent soit contre une atteinte à leur intérêt oucontre un risque hypothétique, d’anticipation. Les associations de victimes nemettent pas en garde contre un risque à venir puisqu’elles parlent au nom d’uneépreuve passée, d’une catastrophe survenue, d’un pire derrière et non pas d’unpire devant. Elles apportent dans le champ du débat le point de vue de l’épreuvetraversée et retravaillée. Leur légitimité n’est pas du style «j’ai souffert donc je suislégitime» mais c’est plutôt «la voie que j’ai choisie pour m’expliquer avec l’épreuvesubie, est celle de la recherche de la vérité; cette compréhension peut avoir uneutilité générale pour la collectivité, être utile dans le champ de la prévention». Letype de vigilance qui en est issu s’appuie sur un intense travail de décryptaged’une situation et de toutes les défaillances qui ont amené à la catastrophe. Cetélément est en consonance très forte avec les sociétés postmodernes qui sont dessociétés d’information, de connaissance et de travail. Et je rajouterai : un travailpartagé, collectif de construction de savoirs, sur le fondement d’une épreuvevécue.C’est ce qui explique la proximité forte entre les associations de victimes et lajustice pénale. C’est la seule forme judiciaire qui a pour objet la recherche de lavérité. Mais dans la pratique, il s’agit d’une proximité tendue, à la limite du conflit.On l’a vu ces dernières années, avec la mobilisation des associations contre la loiFauchon, du 10 juillet 2000, dont l’objectif était très clairement de soustraire lespersonnalités politiques et le haut de la hiérarchie administrative aux poursuitesaprès une catastrophe – avec ce résultat que la justice pénale était invitée à serabattre sur l’opérateur direct, c’est-à-dire de base. Les associations de victimesont vu là, non sans fondement, un phénomène régressif de réduction de laresponsabilité à celle du lampiste. Car toute leur philosophie est au contraire demettre en évidence les chaînes de responsabilités, donc de faire droit à lacomplexité moderne, justement. Cependant, la justice pénale n’est pas le seulespace d’expression et d’action de ces associations. D’abord, elles accordentaussi un certain intérêt à la justice civile, qui permet parfois aussi de poser laquestion des responsabilités.80
Et surtout, elles ne se cantonnent pas à l’arène judiciaire. En effet, leur stratégieest de dépasser le stade du procès pour s’impliquer dans le champ de laprévention, en nouant un partenariat avec ses acteurs. La plupart du temps, ils’agit de leurs adversaires d’hier, lors des procès. Là aussi, il y a quelque chose deneuf, d’inédit, qui pointe vers une certaine qualité d’espace commun de discussion,où la coopération ne fait pas l’impasse ni sur le conflit, ni sur les sentimentsnégatifs ou difficiles. Il y a là peut-être des enseignements à tirer pour la réflexionsur les nouvelles formes de démocratie, démocratie participative ou démocratietechnique.Ces différents traits ne sont sans doute pas étrangers au fort impact symbolique deces regroupements. Et là aussi, il y a originalité, car ce pouvoir symboliquecontraste fortement avec leur fragilité interne. Cela n’apparaît pas toujours auregard extérieur, car on a l’impression que la place qu’occupent les associationsdans le débat politique s'appuie sur une puissante logistique. Or, en réalité, ellessont plutôt fragiles. La structuration interne est très faible. Elles ont très peu demoyens, reposent sur le volontariat, n’ont pas de personnel permanent. Parcontraste, les associations d’aide aux victimes sont très fortement structurées,avec des moyens importants.Brièvement, quelles sont les questions sur lesquelles les associations de victimespeuvent avoir un apport important, dans le champ de la gestion des crises ? Ellesont un apport du côté de la gestion des secours et de l’accueil des victimes, dansle champ des systèmes socio-techniques, auprès des acteurs de la prévention ence sens qu’elles dérangent le discours bien huilé de la sociologie des organisationsou bien de l’ergonomie, etc. où l’on est très enfermé dans le discours du facteurhumain, de l’erreur. Ces associations réintroduisent les notions de laresponsabilité, de l’engagement de l’acteur, de la personne dans son activité, quidéplacent les termes du débat et apportent des éclairages incontournables. Ellespeuvent aussi apporter quelque chose d’utile dans la problématique de lavictimisation, en ce sens qu’elles contribuent à la délimiter, ce qui est plus quenécessaire dans la mesure où la victimisation est de ces notions extensives, quifinissent par introduire une confusion généralisée. Les associations entretiennentun débat interne sur l’opportunité de créer un statut de victime, qui mériterait d’êtrepartagé dans un espace plus large.En conclusion, on peut avancer l’idée que les associations de victimes sont plutôtune figure moderne de la société du risque. La société du risque a succédé àl’approche ancienne du danger, où on cherchait à le circonscrire par le tryptique :sécurité, prévention et force majeure. Les associations de victimes, dernièresvenues sur la scène du risque, donnent figure à la menace, sur un mode trèscontemporain, celui d’une société complexe d’individus, où les processus desavoirs et d’informations sont centraux, une société ouverte au débat et à lacontroverse, organisée autour d’un nouveau tryptique : précaution, victimes,risques majeurs.81
Suzanne de CheveignéMerci de nous montrer comment, à cause d’un événement extérieur, des gens dela société civile s’organisent. Avec Pierre-Benoît Joly, nous allons maintenantregarder comment on peut demander la participation de la société civile.82
OGM et débat public : leçons des expériences participativesPierre-Benoit JolyINRAUnité TSV- Transformations Sociales et politiques liées au Vivant65, Boulevard de Brandebourg, 94205 Ivry-sur-SeineTél : 01 49 59 69 55joly@ivry.inra.frCette présentation porte sur une recherche que nous avons réalisée avec macollègue Claire Marris. Depuis presque 10 ans, nous travaillons sur les interactionsentre experts et profanes dans les choix scientifiques et techniques. Nous avonsporté notre regard sur le dossier des OGM qui peut être résumé par un paradoxe :on observe une polarisation croissante des positions des acteurs et, en mêmetemps, les OGM ont fait l’objet de multiples débats dans différentes instancesreprésentatives (le Sénat, l’Assemblée Nationale, le Commissariat Général auPlan, le Conseil Economique et Social, etc.) et de plusieurs évaluationsparticipatives. Cette conjonction entre mise en débat et polarisation ne manquepas de surprendre. On est en effet fondé à penser que la mise en débat favorisel’intercompréhension, une clarification des points d’accord et de désaccord etpermet de progresser dans la constitution d’un monde commun.Comment expliquer que plus on débat des OGM, plus les positions des acteurs sepolarisent ? Y a-t-il des raisons de fond de penser que la mise en débat renforce leconflit ? Le caractère agnostique des relations résulte-t-il de la façon dont cesmises en débat ont été effectuées ? Ou bien encore s’agit-il d’une simplecorrélation entre deux phénomènes mais sans aucune relation de cause ? Ce typede questionnement s’inscrit dans le courant de recherche sur l’évaluationtechnologique participative, très dynamique au niveau international. Mais, lestravaux dans ce domaine sont généralement centrés sur l’étude d’un dispositif entant que tel. Quelles sont les formes d’interaction entre les experts et les profanes?Quels sont les modes de délibération, les modes d’argumentation ? Peut-onobserver des effets de cadrage, de biais, etc. se reproduisant dans cesmicrocosmes et travailler sur les procédures qu’il convient de mettre en œuvrepour améliorer ce type de dispositif ?Nous avons souhaité tirer partie de toute une série de travaux sur les OGMréalisés dans l’Unité TSV pour analyser les interactions entre ces dispositifs et ledébat public, ce qui est très original dans la littérature sur l’évaluation participative.Nous avons donc suivi l’évolution du débat public et analysé quatre expériences demise en débat des OGM en utilisant une grille commune :- la conférence de citoyens de 1998 qui est la première mise en œuvre de laprocédure danoise de conférence de consensus en France;- les États généraux de l’alimentation.- les débats des quatre «sages», une formule ad hoc inventée par legouvernement Jospin.83
- une formule que nous avons-nous-mêmes conduite à l’INRA, d’évaluationtechnologique interactive des programmes de recherche sur les vignestransgéniques qui s’inspire d’un modèle hollandais.Quels sont les enseignements tirés de cette étude ? Il nous semble nécessaire deproposer un déplacement conceptuel. Dans la plupart des initiatives étudiées, lesacteurs se réfèrent de façon explicite ou non à l’idée de débat public commefondement d’une démocratie participative. Cette référence à une agora des tempsmodernes est autant présente chez les promoteurs de ces dispositifs dialogiquesque chez leurs détracteurs. Pourtant, dans nos sociétés complexes marquées parla culture du gouvernement représentatif, l’agora correspond plus à une figuremythique qu’à un objectif réaliste. Nous proposons de considérer l’évaluationparticipative comme une arène, c’est-à-dire un espace symbolique de conflit et deconfrontation qui est régi par des règles spécifiques, des principes supérieurspermettant de régler les désaccords, des règles d’inclusion et d’exclusion, unesyntaxe,…Par exemple, le discours «profane» sera valorisé par rapport audiscours des experts, ce qui permettra de faire surgir des interactions originales etune problématisation et un cadrage originaux des choix scientifiques et techniques.La notion d’arène ouvre complètement le champ de la réflexion. Elle permet de nepas être piégé par la notion de représentation (ou de représentativité) ou celle du«bon débat» et conduit à mettre l’accent sur la nature des procédures quipermettent de prendre en compte l’ensemble des positions, de mettre à l’épreuvela fiabilité des connaissances et de s’entendre sur des principes de clôture desdiscussions. Deuxièmement, l’accent est mis sur la circulation entre ce qui sepasse dans cette arène spécifique et dans d’autres arènes, sur les phénomènesde traduction ou de transcodage qui permettent de ne pas raisonner en termesd’impact. Le rapport invite à ce déplacement.Quels sont les résultats ?On observe en premier lieu une très forte influence du contexte sur lefonctionnement de ces dispositifs. L’idée du bon dispositif «passe-partout» estdonc remise en cause. Le choix d’un dispositif spécifique doit donc être raisonnéselon le contexte : quel est le stade de développement du débat public sur laquestion traitée ? Quel est l’état de la mobilisation ? Quelle est la nature desrapports de pouvoir ? Comment les connaissances sont-elles distribuées ? Uneformule générale n'existe pas. Il est nécessaire d’adapter les dispositifs auxdifférents contextes. Cette diversité doit néanmoins renvoyer à des règlescommunes.Deuxième résultat, on observe, dans tous les cas analysés, une très grandedifficulté à traduire les conclusions de ces débats en termes d’action publique oude recherche, bien que ces conclusions soient intéressantes et originales. Cettefaiblesse tient au fait que ces expériences participatives sont organisées sans quesoit clairement défini l’engagement du commanditaire concernant l’utilisation desrésultats des débats. On est donc confronté à une difficulté réelle, celle d’articulerparticipation et représentation. La position critique de nombreux parlementaires àl’égard de la conférence de citoyens sur les OGM est une illustration de ces84
tensions. Plus près de nous, on retrouve ce même problème dans les désaccordsentre l’OPECST et la CNDP à propos du débat public sur les déchets nucléaires.Enfin, on est frappé par une résistance des commanditaires à déléguerl’organisation de ces expériences à des instances qui ne sont pas partiesprenantes. Ce défaut d’indépendance nourrit la critique de certaines associationsqui considèrent alors que les conditions du «bon débat» ne sont pas réunies etqu’il s’agit d’une manœuvre de manipulation. D’où l’idée de mettresystématiquement en œuvre, à l’instar de la CNDP, la règle du tiers organisateur(ou à défaut la règle du tiers garant).Pour en revenir à la question initiale, notre analyse conduit donc à pointer lesinsuffisances dans les conditions de mise en œuvre des procédures d’évaluationparticipative. Quelles que soient les intentions des protagonistes, l’association,variable selon les cas, d’un manque d’indépendance des dispositifs et du manqued’articulation avec la décision publique a des effets délétères. Cela nous conduit àformuler cinq propositions concernant les mises en œuvre des procéduresparticipatives :Proposition 1Les dispositifs participatifs doivent viser à rééquilibrer les rapports de force etcontribuer aux dynamiques collectives. Plusieurs mécanismes sont à cet égardnécessaires :- l’accès à l’information de l’ensemble des personnes concernées;- la possibilité, pour des groupes qui le demandent, de financer desexpertises sur le dossier.Proposition 2Les groupes constitués doivent être associés au dispositif, mais selon desmodalités qui ne conduisent pas à marginaliser les autres voies (groupesconcernés, citoyens ordinaires,…). Ces modalités sont diverses, par exemple :audition de l’ensemble des parties concernées, participation à l’élaboration desprocédures,…Proposition 3La participation doit suivre un ensemble de règles de procédures qui assurent lesconditions d’une délibération équitable : règles d’instruction, règles de délibération,règles du «tiers garant». Cela passe probablement par le renforcementd’institutions qui, comme la CNDP, ont la charge de l’organisation du débat public,qui peuvent défendre ces procédures contre les pressions extérieures et qui sontdes centres de capitalisation de l’expérience.Proposition 4Les dispositifs participatifs doivent être mieux équipés en outils de transcodage.On doit pouvoir généraliser l’obligation de prise en compte des résultats desdélibérations par la puissance organisatrice. Concernant le transcodage dans les85
systèmes techniques, il est nécessaire de développer, notamment dans le cadredes initiatives «sous-politiques» (dans les instituts de recherche, les associations,les firmes…) les instruments qui permettent les traductions entre la technique et lesocial (évaluations multicritères, méthodes de scénarios,…).Proposition 5La participation ne peut être conçue comme la mise en œuvre isolée d’opérationsd’ouverture suivies de longues périodes de fermeture. Elle suppose la mise enœuvre d’un ensemble d’opérations de concertation, co-construction ou coproduction.Il faut donc concevoir la participation comme un processus continu.Suzanne de CheveignéNous allons continuer avec la même préoccupation de voir quelles sont conditionsnécessaires, quelles sont les manières d’améliorer les possibilités de négociationautour de ces questions avec l’intervention de Bertrand Munier.86
Les négociations sur la prévention des risquesenvironnementaux peuvent-elles être conçues comme un outilde décision collective efficiente ?Bertrand MunierGRID/ENSAM30 avenue du Président Wilson, 94 230 CachanTél : 01 41 98 37 60munier@grid.ensam.estp.frEn réalité, comme vient de le dire Pierre-Benoît Joly, la participation de la sociétécivile laisse nombre d’acteurs insatisfaits. La question que nous nous sommesposée a une modalité spécifique, un peu différente des cas précédents. Elle aconsisté à se dire : «cette insatisfaction relative n'est-elle pas fondée sur lemauvais management des négociations ?» Une négociation ne se résume pas às'asseoir, discuter et essayer de s'expliquer, elle se manage. Donc, quelles sontles conditions pour faire de ces négociations un outil qui conduise à des décisionsqui soient efficientes ? Par efficientes, j’entends que ces décisions, par exemple,ne conduisent pas à donner un niveau de satisfaction donné aux différents acteursà un coût triple de celui auquel ils auraient pu aboutir par eux-mêmes. Trèssouvent, on commence par faire de très belles études, on regarde ce qu’il y a demieux pour la collectivité et on oublie de demander l’avis des acteurs locaux puison s’aperçoit que ce n’était pas admis par ces acteurs locaux, et qu’il fallaitnégocier. Alors, les négociations s’engagent sur des préoccupations qui sonttotalement orthogonales par rapport aux études réalisées et qui conduisent à dessolutions parfois discutables.La question de recherche pratique est : doit-on se résoudre, pour faire participer lasociété civile, à effectuer des choix inefficients ( optimalité de second rang) ? Jeme suis posé la question : une fois qu’on a décidé qui participe, comment gère-ton? L’esprit dans lequel nous avons réalisé cette étude n'est pas de raffiner ou decréer un outil analytique nouveau, mais plutôt d’utiliser d’une façon créative lapensée analytique en utilisant les techniques existantes simples.Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il y a trois niveaux de conflit, situés entredeux extrémités. Les extrémités sont très simples : la première est celle du débatdans lequel les oppositions d’intérêt sont apparentes et sont davantage liées à undéficit d’information qu’à une réelle opposition, par exemple la négociation surl’usage de l’eau lorsqu’il s’avère que tous les acteurs sont identifiés et prêts à unarrangement vers lequel le bon sens entraîne. C’est le niveau zéro du conflit.Le niveau 1 est le cas où il y a une opposition d’intérêts réelle (ce n’est pas undébat) mais ce niveau 1 exclut tout conflit de reconnaissance identitaire. Lescommunications entre acteurs ne sont pas bloquées. Tout le monde est ouvert àune recherche de solution mais sans savoir comment s’y prendre. Toute solutioneffraie car on se dit qu’elle va peut-être attenter aux intérêts qui sont les siens.L’objectif de résolution est d’extraire l’information des acteurs eux-mêmes (cetobjectif est d’ailleurs permanent pour les trois niveaux). Et l’extraction se fait87
toujours de façon indirecte. C’est un peu du management de la connaissance : lesgens ont des tas d’informations mais ne savent pas les formuler. Il faut doncparvenir à les extraire pour arriver à une solution acceptable dans ce premierniveau, niveau assez «soft» de conflit. Différents types de solution sont possibles.Il faut procéder à cette sorte de maïeutique moderne pour déterminer une solutionacceptable, en utilisant quelques critères. La difficulté est de conceptualiser lasolution acceptable, de sortir de tous ces problèmes du type «not in my backyard»,etc. Une réponse que nous avons proposée est un algorithme assez simple : pourchaque individu, on explicite d’abord les préférences. On relève ensuite que dansl’ensemble des solutions, certaines ont des vertus particulières sur certainscritères. On peut définir ainsi des «profils» de solution. Il se trouve qu’à partir despréférences et des ensembles de solution envisageables, on peut définir un«noyau», doté d’un certain niveau de signification. Ce concept de solutionrassemble le meilleur dans chaque profil, du point de vue de chaque individu.Chaque individu a, en effet, ses profils et ses catégories de solutions (tableau 1).Tableau 1 : niveau 1 de conflitNiveaux de Caractérisation duconflits conflit ou dudésaccordObjectif derésolutionType de solutionpossibleDifficultés àprévoir(à surmonter)Niveau 1(ex : UsagerivièreCasFavorableTypeDurance)Oppositionsd’intérêts réelles,maisreconnaissanceidentitaire etcommunicationentre acteurs, onest ouvert à larecherche d’unesolutionExtrairel’informationdes acteurseux-mêmes defaçon indirecteet proposerune solutionacceptable(= un certainconsensus)Etablir unalgorithme quiparte de choixélicitésindividuellement(maïeutique) etqui détermineune solutionacceptableConceptualiserla solution«acceptable»(sortir duNIMBY etautressyndromes)Extrêmité 0 Débat (Rappoport) : oppositions d’intérêtsapparentes, davantage liées à un déficit d’informationqu’à une réelle opposition88
Sur le niveau 1: algorithme dela solution ‘sans perte de face’Individu ipréférences élicitéesEnsemble Sde solutions sAgrégation despréférences(Arrow, 1952)Peu significatifici, +:En généralincompatibleavec carctèresminimaux degouvernancedémocratiquePartition par "profils"(structure des attributs)Noyau N idpropre à chaque individude niveaude signification dpour un ensemble S donné=solution(s)les meilleurespar profilselon le niveaude signification d N iv e a u m in im a l de significationpour lequel N On évite ainsi à chaque individu i de "perdre la face",ce qui arriverait si la solution retenue n'avait aucun attraità quelque niveau de significatio n que ce soit pourau m oins une catégorie d'acteurs, alors qu'elle serait"excellente" pour une autre... Faut-il encore que iidEPR I, Paris, 16 juin 2005, B.MunierPuisque chaque individu va ainsi diviser de façon différente l’ensemble dessolutions, ne peut-on pas arriver, quitte à faire varier le niveau de signification, àfaire en sorte de trouver une intersection de tous ces noyaux qui soit non vide ? Sion trouve une intersection non vide, c’est qu’il y a au moins une solution : en effet,cette solution sera, par définition, parmi les meilleures pour l'un ou l’autre desparticipants sans jamais être la pire pour aucun autre. Donc, personne ne perdra laface. Cette solution est acceptable.Certains conflits sont d’un niveau supérieur, et sont donc plus compliqués àrésoudre. Par exemple, sur les modalités de mitigation des inondations, il y areconnaissance identitaire mais pas de communication acceptée entre acteurs.Les gens se regardent en chiens de faïence. Il y a une méfiance réciproque (c’estle niveau 2 de conflit). L’objectif est alors de mettre les gens en communication parle moyen d’une modélisation simple, notamment par des diagrammes d’influence.On négocie d’abord sur une vision des problèmes d’une façon totalementindépendante des solutions. Puis, quand on s’est bien mis d’accord, on montre quecette vision du problème conduit à quelques solutions. Quand les gens n’acceptentpas cette conclusion immédiate parce qu'ils s’accrochent à une autre solution, onleur démontre, à partir de la problématique sur laquelle ils ont préalablementdonné leur accord, pourquoi leur solution ne peut être maintenue. Par exemple,pour une localisation d’école d’ingénieurs, différentes solutions étaient proposées.Quand on est arrivé à mettre les acteurs d’accord sur une modalité de réflexion,une vision du problème, une modélisation de base, on a fait admettre à ceux quitenaient à une certaine solution que pour y arriver, contenu de l’accord donnéauparavant, il aurait fallu admettre que le poids de leur intervention était de 75 ou80% alors qu’il y avait 6 ou 7 catégories d’acteurs. Ils ont admis qu’ils ne pouvaientpas l'exiger. On conduit ainsi à reconnaître que l’ensemble des solutions n’est pastrès différent, quel que soit l’acteur considéré, et on résout le conflit de façoncognitive : C'est le «collaborative learning», ou apprentissage collaboratif. Il fautévidemment que la négociation soit assistée d’un médiateur. La difficulté est que la89
modalité de gouvernance par décision participative à laquelle on a recours n’estpas toujours compatible avec ce niveau de conflit. Donc on risque, malgré toute labonne volonté que l’on peut déployer, d’arriver à une fausse consultation. (Tableau2)Tableau 2 : Niveau de conflit 2Niveaux deconflitsCaractérisationdu conflit ou dudésaccordObjectif derésolutionType desolutionpossibleDifficultés à prévoirNiveau 2Ex : (Conflitsrécurrentssur choix demitigation derisquesd’inondation)Reconnaissanceidentitaire maispas decommunicationacceptée entreacteursIntroduire unecommunicationpuis mettre enconfiance relativesans chercher deconsensus dansl’immédiat, maisfaire émergerdiversessolutions(proches sipossibles pourdésamorcer)«CollaborativeLearning»(apprentissagecollaboratif)assisté d’unmédiateur(ex : Daniels etWalker, 1997)Le recours au modèledegouvernance/décisionparticipative est-iltoujours compatibleavec ce niveau deconflit ?Risque de fausseconsultationPour les conflits de niveau 3, l’exemple est celui de l’usage de l’eau au Brésil. Il y ades conflits identitaires, c’est-à-dire que l’on met en cause les intérêts des diversacteurs vis-à-vis de l’eau. La solution que nous recommandons ici est une variantedu niveau précédent mais il faut faire une très longue pré-négociation. Il faut uneactivité de go-between très importante entre les acteurs et il faut faire admettre uncertain nombre d'éléments comme, par exemple, le fait que la quantité d’eau quisera délivrée à chacun n’est pas la demande que l'acteur exprime mais unequantité qui en tient compte en respectant l'équilibre entre la demande globale etce qu’on peut arriver à fournir. On procède alors à de la «méta-médiation» c’est-àdirequ’au lieu de conduire les gens à une conclusion logique qui dissipecognitivement leur conflit à partir de ce qu’ils ont convenu précédemment, on partdes solutions et à chaque fois, on leur montre comment ces solutionsenvisageables collectivement sont intéressantes et à quoi elles conduisent pour lesintérêts de chacun (Tableau 3).90
Tableau 3 : Niveau 3 de conflitNiveaux deconflitsCaractérisationdu conflit ou dudésaccordObjectif derésolutionType desolutionpossibleDifficultésà prévoirNiveau 3(ex : Usagede l’eau auBrésil,réforme desretraites)Conflit identitaire :on met en causeles intérêtsallégués desautres, et il y aopposition forteentre les intérêtsrespectifs desacteursPartir dessolutions etprovoquer unecommunicationréactive forcée :«dégeler» lasituation peu àpeu‘méta -médiateur’oriente partouchessuccessives versdes solutionscollectivementefficientes enmontrant lesconséquencespar typesd’acteurs (ne passe tirer une balledans le pied!)Lapréparationde lanégociationest longue,nécessiteune activitéde «gobetween»longue,coûteuseetcomplexe,sans qu’onsoit jamaissûr deparvenir àtrouver dessolutionsExtrêmité 3+Combat (Rappoport) : On ne saitplus pourquoi on veut en découdreLe caractère extrême du conflit est ce qu’Anatol Rappoport a appelé un «combat».En sus des ingrédients de conflit précédents, on est alors conduit à une situationoù les objectifs poursuivis par chacun n’ont plus guère d’importance. On ne saitplus pourquoi on veut en découdre. Toute négociation est alors vaine.Il reste que les résultats précédents permettent de dégager des préceptes simpleset d’écrire un manuel qui pourrait servir à chaque fonctionnaire chargé de gérerune négociation.Suzanne de CheveignéQuelle est la place post catastrophe de la société civile, quel rôle joue-t-elle dansles processus de réparation ?91
Le quidam engagé. La «catastrophe naturelle» commeexpérience démocratiqueJacques RouxCRESAL / CNRS6 rue des Basse des Rives, 42 033 Saint Etienne cedex 2Tél : 04 77 42 19 86jacques.roux@univ-st-etienne.frChristian Magro 9Philippe Brunet 10Sur le contenu, nous allons vous présenter le témoignage d'une personnerencontrée par Christian Magro, qui a réalisé des entretiens vidéo auprès d’unevingtaine de personnes dans la région de Cuxac d’Aude, trois ans après lesinondations de novembre 1999. Donc, un travail sur la durée de l’événement dansles mémoires et dans l’envie de restituer une expérience.La thématique générale, l’orientation, a été de se mettre en décalage au moins dedeux points de vue : un décalage par rapport aux institutions et un autre parrapport aux procédures de la mobilisation de la société civile, à partir du point devue du fameux «citoyen ordinaire». Nous l'avons rencontré chez lui, non pas dansles instances mais dans son lieu de vie. Donc, le premier décalage se situe parrapport à un discours et sa légitimité. Un autre décalage s'inscrit dans le choix despersonnes interviewées qui sont ni les victimes, ni les sinistrés appartenant déjà àdes associations. On s’est intéressé aux gens qui, dans leur choix de vie, n’ont paspris l’option d’être dans des associations, des gens qui sont doublement«ordinaires», bien que l'individu social ordinaire pour le sociologue n’existe pas. Eneffet, tout individu est relié dans un tissu de relations, de milieux, d’histoire,d’identité qui fait qu’il n’y a jamais une individualité pure, indépendante de touteson inscription sociale, donc de toute son appartenance à la société. L’individu estporteur de ce lien collectif. On rejoint alors ce qu’a dit Bernard Picon sur la désegmentation.Nous proposons un dispositif de recherche par le biais de l’entretienen singularité avec des personnes qui ont eu l’expérience d’une catastrophe et quisont porteuses de ré-intégration des dimensions segmentées dans le jeu social etaussi dans le jeu de recherche. Le dispositif que nous vous soumettons est unentretien avec une personne qui rend compte de son expérience. Ce propossingulier est également pris comme un acte de recherche partagé avec cettepersonne puisqu’il y a un contrat d’entretien. Les interviewés savent très bien,quand ils répondent, que leur témoignage sera utilisé dans les enceintesscientifiques.La société civile est pour nous la principale actrice, la première actrice de lasécurité civile, c’est-à-dire que la sécurité du territoire, la protection civile est, biensûr, composée des institutions et est prise en charge par l’État. Mais, les premiers9Étudiant géographie, Paris XIII10Centre Pierre Naville, Evry93
en tant que force, que ressource, que dispositif d’action, sont les gens sur place.Ils sont directement impliqués dans les événements et ils réagissent. Ilsn’attendent pas d’être sinistrés. Ils sont en action. En tant que porteurs d’affect etde transmission de cette expérience affective, ils sont les premiers répondants decette expérience et de sa transmission. Donc, ils incarnent l’événement et de cepoint de vue, ils sont irremplacelables. Ils sont porteurs d’une compétence àintervenir sur la discussion, sur le contenu.Prendre part au secours d’urgence revêt trois dimensions :- agir pour soi et ses proches, sa maison, sa famille, prendre en charge toutde suite, dans l’urgence, ce qui est de l’ordre d’un groupe basé surl’individualité et sur la famille.- se proposer en solidarité vis-à-vis d’un voisinage un peu plus éloigné, auvis-à-vis de la commune.- donner sens à la solidarité extérieure.On n’est pas seulement dans l’ordre de l’agir mais le fait que des gens dans unterritoire se mobilisent participe d’une dotation de sens à l’intervention extérieure.Un territoire qui ne serait pas habité ou qui serait habité par des genscomplètement anéantis par la catastrophe est très différent en termes de secourset de mise en place des dispositifs publics de secours. Par exemple, une maisonoù une veille dame n’arrive pas à surmonter sa détresse, demande beaucoup plusd’énergie pour les dispositifs de secours qu’une maison où les gens sont déjà àl’œuvre.Christian MagroLa zone étudiée de Cuxac d’Aude, et plus précisément le quartier des Garrigotsqui est situé environ à 2.5 km du fleuve Aude et à 5 km en aval du village deSallèles, se trouve dans les basses plaines de l’Aude. Cette précision estimportante car la rupture d’un ouvrage anthropique, un remblai de ligne de cheminde fer, a provoqué une inondation brutale.Séquence vidéo de Mr et Mme Pourtier, document pris le jour de l’inondation, 4minutes après.La particularité de cette séquence est que la personne diffuse cet extrait en mêmetemps que ses commentaires sont filmés, trois ans après la catastrophe. Le coursd’eau est à 2.5 km et est similaire à une vague, à un torrent qui arrive.Samedi matin à 8 heures; c’est le départ de l’inondation.Mme : Là, vous voyez, on voit encore le portail et le portillon du voisin. Il resteencore plus de 50 cm de mur.Mr : Le voisin filme de l’intérieur. Il est descendu des chambres. Il est dans sonjardin. Il est en combinaison de plongée. C’est après qu’il soit allé essayer desauver les voisins à côté. Il est revenu filmer. Là, on constate le torrent.Mme : Vous voyez le torrent, l’arrivée d’eau.94
Mr : Cela, c’est un autre voisin qui est derrière la cheminée et qui va êtrehélitreuillé par la suite.Mme : Il n’a pas d’étage. Je ne sais pas quelle heure il est. Cela doit être dans lamatinée, disons 11 heures du matin. On n’a pas encore vu l’hélico.Mr : Voilà notre ancien portail.Mme : Voilà notre mur et il n’y a plus de portillon. La tache noire, c’est le cumul detoutes les cuves à mazout.Mr. : C’est monté très très vite. Là, il filme de l’intérieur.Mme : A partir de là, l’eau ne monte plus. Le mur du voisin n’était pas crépi et oncomptait les parpaings.Mr : Ce sont les gens qui sont partis à cause de l’inondation. Il était d’Albi, cemonsieur et il en a profité pour retourner à Albi. Il a cassé son toit. Il est passé parses combles. Au plus fort de l’inondation, il est venu chercher les enfants.Mme : On ne peut pas bouger. Je lui ai dit coupe le plafond. Il y a des hélicoptèresqui vont venir. Ils ont coupé le plafond avec une hachette et après, il a coupé lestuiles.Mr : De là, on est parti se mettre en sécurité, ce qui était prévu à 350 m. de là.Jacques RouxCet extrait est intéressant pour deux points. L’image de télévision et descouvertures des journaux sur Cuxac d’Aude avec les hélitreuillages a été prise del’hélicoptère. C’est la même image montrée par ces habitants mais vue d’en bas.On a donc vraiment une coordination des points de vue sur le même événement.L’autre point est l’intervention des secours et la connexion. Tous ces gens ne sontpas en posture défensive par rapport à un secours extérieur, ils sont encomplémentarité. Ils prennent leur place par rapport à ce qui peut venir del’extérieur. Ils sont dans l’action elle-même. Ils sont complètement solidaires.Cette notion d’affect est très importante parce qu'elle nous permet en sociologuede récupérer des informations qui sont d’habitude renvoyées du côté despsychologues et du côté des personnes les plus atteintes, les personnes prises encharge. Or, avec cette notion d’affect, la notion de choc, de trauma dans toutes sesdimensions, pas seulement matérielle, physique mais aussi sociale et psychique,est intégrée et élargie au-delà des seules personnes prises en charge. La qualitémême du phénomène catastrophique touche l’ensemble d’un territoire et ne touchepas simplement des populations ou des personnes plus vulnérables. Le troisièmepoint est le souci du bien commun.Extraits d'un témoignageCe qui me navre, c’est que non seulement, cela s’est passé. On n’a pas le devoirde mémoire, de garder justement ce qui s’était passé. On a reconstruit àl’identique. Imaginez pour AZF, qu'on reconstruise la même usine au mêmeendroit. Maintenant, que quelqu’un m’explique pourquoi on a refait à l’identique ce95
qu’on n'aurait pas dû faire puisque c’était arrivé il y a 3-4-5-6 fois dans l’histoire dela localité récemment. C’est un non-sens.C’est là qu’on se dit que peut-être les systèmes qui régissent la vie encommunauté, les sociétés, sont dépassés parce que les responsables vivent dansune sorte de tour d’ivoire et ne sont pas sur le terrain. C’est là peut-être que le bâtblesse. On le retrouve dans le schéma politique où les gens ne vont plus voterparce qu’ils ne se reconnaissent plus dans leurs élus ou dans ce qu’ils décident etnous, dans les gens qui, pour nous, décident des aménagements, on se demandeà quoi ils pensent.Qu’ils viennent sur le terrain, qu’ils viennent voir. On va leur présenter lesdocuments. On va leur montrer qu’effectivement cela s’est passé. On leurmontrera comment se régule l’eau. On leur montrera ce qui est peut-être possiblede faire par des travaux. On a des canaux qui permettent d’aller sur une surface deretenue qui s’appelle l’étang de Capestan. Peut-être que l’on peut calibrer, que l’onpeut faire des choses qui permettraient à moindre coût de faire avancer la sécuritédes gens. Le travail se règlera dans la globalité, en amont, en aval. Il y a toute unesynergie à mettre en place. Mais est-ce que les politiques, qui sont souvent dedivers bords, pourront travailler ensemble pour le bien de la collectivité, pour lebien des gens. Je trouve que quand même, il y a quelque chose à faire. Il fautqu’ils prennent conscience, tous les décideurs, que malgré tout, nous sommesnous-mêmes conscients que rien ne fonctionne bien. Donc, il faut qu’ils fassentquelque chose. J’espère bien qu’au travers des problèmes locaux, ils arrivent àtrouver une solution. S’il faut, on pourra essayer de leur amener une pierre àl’édifice, leur expliquer que quelque part, il faudrait peut-être faire différemment.Moi, je pense qu’on n’est pas assez à l’écoute des gens du crû. L’éducation estune chose. Il y a derrière aussi ce qui fait la force d’un pays, c’est ceux qui lefaçonnent. Ceux qui le façonnent, souvent, on ne les écoute pas; ceux qui sont surplace, il faut écouter. Cela aussi, c’est un devoir. On ne le fait pas assez. En gros,c’est la catastrophe qui à mon avis au départ nous a surpris. Il y a x raisonsd’expliquer ce qui s’est passé.Ensuite, la reconstruction. La compréhension de ce qui s’est passé. Un peu decolère derrière. Il y a eu de la colère immédiate parce qu’on a senti qu’on était unpeu délaissé mais c’est comme dans toutes les catastrophes. Immédiatement, laréponse est qu’on se dit : «mais pourquoi cela nous arrive, pourquoi nous,pourquoi on n’a pas fait ci.» Mais, quand ensuite, le soufflé est retombé, que toutest redevenu un peu normal, quand on va chercher pourquoi c’est arrivé, là, onprend peur. On prend peur parce qu'on se rend compte de l’incurie. C’estchronique. On continue. Ce qui a été filmé, ce qu’on retrouve dans les documentsde 1930-1940-1999, on va les re-filmer. On va retrouver à l’identique, les mêmeschoses qui ont été refaites. A l’identique. Là, cela me dépasse.Jacques RouxUn ouvrage d’art en amont est mis en procès. Dans l’explication de Mr Pourtier etdu réseau local d’affinités rencontrés par Christian Magro, la cassure du pont dechemin de fer à Sallèles d’Aude est incriminée. Elle a déclenché sur une partie du96
territoire qui était déjà très inondée, un phénomène de vague qui a surfé sur lapremière eau. Ils ont fait une enquête, la presse aussi. Localement, le fait estconnu. Des mobilisations à Sallèles et à Cuxac ont eu lieu. Dans le mois qui a suivil'inondation, ce pont a été reconstruit à l’identique. L'interviewé indique que dansl’urgence la reconstruction a été réalisée, mais trois ans après, et alors qu’un débatpublic sur cette question de l’ouvrage d’art a été mené, aucune mesure n'a étéprise, ne serait-ce que pour percer des voies de passage pour l’eau en cas demaintien de ce pont. Il y a une mise en discussion au nom d’une expertise et d’unecapacité à comprendre, à expliquer l'attachement au fait d’habiter là. Cetteexpertise par accointance n’est pas celle des études, des ingénieurs. Elle estcréée par une opposition. Elle s'inscrit dans un processus, dans une revendicationde co-construction.Le dernier point soulevé est : «être de là». Il ne parle pas seulement en son nommais en tant que quelque chose qui est commun à tous les gens qui habitent ceterritoire.Les propositions de pistes de recherche reprennent ces trois points. Il estimportant :- que les sociologues et les chercheurs en général s’intéressent auxsituations de crise in vivo, c’est-à-dire qu’ils soient directement sur leterrain au moment où cela se passe et non pas deux mois, trois mois ouun an après, ou alors beaucoup plus tard. Mais il ne faut pas manquer lespremiers moments, là où on voit les choses en train de se passer.- de travailler sur la dimension psychique à long terme et pas seulement ducôté des gens les plus atteints, mais aussi globalement sur la population,sur un territoire.- d'étudier les réseaux de discussion, de mise en débat sur le terrain.Comment cette discussion sur la question du bien commun se pratique, seréalise ? Ces documents circulent, sont discutés, et cette discussion intraindividuelle,intra-famille, entre réseaux de sociabilité, est très importantepour notre sujet. Elle fonde une citoyenneté tangible par rapport auxquestions de crise.Suzanne de CheveignéIl était important pour nous d’avoir aussi des expériences de terrain. Cela rappellela réalité des questions.Paul Louis, ANCMRTMCe mariage entre chercheur et un homme de terrain est assez anachronique.L’ANCMRTM est une association composée uniquement de maires concernés parle risque technologique majeur. Notre association agit sous l’aval et le contrôle del’Association des Maires de France. Les maires qui font partie de l’association onttous sur leur territoire une usine, quelle soit de la chimie, du pétrole ou du gaz. Les97
problèmes sont nombreux et leur gestion est difficile. La frontière entre letechnologique et le naturel n'est pas bien délimitée. Par exemple, si à Lyon, leRhône déborde et inonde la raffinerie de Feyzin, sera-t-on sur un risque naturel ousur un risque technologique ? Nous avons une commune dans le centre de laFrance qui n’a pas respecté l’article 55 de la loi SRU qui oblige les communes àconstruire 25 à 30% de logements sociaux. Le préfet donne une pénalité de 2millions d’euros à la commune. Or, le maire ne peut pas construire, sa communeest grevée d’une zone ZADA puisqu’il a une usine qui est quasiment dans le centrede sa commune. Il y a une rivière, une zone inondable et un terrain d’aviation.Pourtant, l’État lui inflige quand même deux millions de pénalité parce qu’il n’a pasconstruit. Nous avons donc cette difficulté d’appréhension et les maires ne saventplus à quel saint se vouer. Mr Blancher parlait toute à l’heure des TMD. Pour nous,les TMD sont vraiment un problème crucial et difficile à gérer. Un exemple illustrecette difficulté. A Lyon, un BUS, boulevard urbain sud, a été créé. Il atterrit au piedde la raffinerie, passe au dessus d’Air liquide et surplombe un camp des gens duvoyage. Un jour, un camion de GPL s’est renversé et a brûlé. Heureusement, il n’ya pas eu de victimes. Donc, pour les maires, rien n’est évident. On n’a jamais lapossibilité d’avoir des adaptations mineures. Chaque fois que l’on va voirl’administration centrale, on nous dit «changez la loi. Il n’est pas possible de fairedes adaptations mineures en matière de risque.» Cependant nous avons despropositions. Seul le préfet en France a le pouvoir de décider. Les maires ne sontpas toujours surpuissants, contrairement à ce qui est énoncé.Concernant le programme, ne pourrions-nous pas avoir ces discours en province ?Si on parlait uranium dans le Limousin ? Des inondations à Nîmes ? Nous aurionsaimé que cette discussion se décentralise afin que la population découvre le travailque vous faites et celui que nous faisons.Suzanne de CheveignéJ’appuie cette proposition : sortir de ce lieu et revenir avec des résultats derecherches sur le terrain. Pourquoi ne pas demander aux chercheurs un retour surle terrain ? Pour l’avoir expérimenté, je peux vous garantir que c’est unenrichissement pour tous.98
Table ronde 2 :Intégrer la société civiledans la gestion du risque ?DébatPhilippe Huet, Président du comité d'orientation, IGEPremièrement, je voudrais réagir sur la présentation de Jacques Roux sur Cuxac.Vous avez bien fait d’insister sur le rôle de l’individu. Dans les retoursd’expérience, nous poussons les portes et nous parlons avec les uns et les autres.Encore faut-il que la «scène du risque» fonctionne, que l'information circule. Est-cele cas à Cuxac ? L'interviewé vous a-t-il dit par exemple que nous avons fait unrapport sur Cuxac, en particulier sur l’hydraulique ? Vous a-t-il dit que lesGarrigots, c’est 400 logements implantés dans le lit majeur de l’Aude à un endroitexposé; j'ai une superbe photo de station de pompage pour l’irrigation implantée àl’entrée des Garrigots qui est perchée à 3 mètres du sol. Ce n’est pas un hasard.Derrière, 400 logements de 20 ou 30 ans. Vous a-t-il dit que depuis l'inondation, leprix du foncier des Garrigots a augmenté ? Les habitations sont rachetées par desHollandais et des Anglais au prix fort. Cette question renvoie à ce que disait MrBayet : le PPR est fait pour négocier des compensations. C’est un vrai débat. Lesanciens habitants ont été indemnisés par les catastrophes naturelles, c’est-à-direpar nous tous, plutôt confortablement. Ils ont réalisé une plus-value foncière et ceschéma se reproduira d’ici 20 ou 30 ans. On nous a soumis des projetsd'endiguement élaborés par les collectivités et nous avons dit : «le remède est pireque le mal. Les Garrigots sont une faute d’urbanisme grave. Il faut réunir les gensdes Garrigots, leur expliquer. Les responsabilités sont partagées. Il faut arrêter dedire, «on nous a laissé nous mettre là, donc, nous ne sommes pas responsables».Cette discussion entre les différents partenaires de la population et les pouvoirspublics à Cuxac n’a pas, à ma connaissance, eu lieu. La question que je vouspose, à vous chercheurs, est la suivante : quels outils avons-nous pour mettreautour d’une même table des gens qui manifestement, pour des raisons sansdoute très locales, ne veulent pas se concerter ?Deuxièmement, la proposition de Mr Louis me paraît tout à fait intéressante. Votreproposition de décentralisation est essentielle. Avec une nuance. Nous avonsl’expérience de cette décentralisation dans deux domaines. Dans le domaine desinondations, à Nîmes, par exemple, la discussion sur place a été réussie et lesGardois ont un rendez-vous annuel au Pont du Gard où tout le monde se réunit etdébat sur le bilan. J’ai été invité deux fois et j’ai trouvé cela passionnant. Ledeuxième exemple concerne le nucléaire. Je peux témoigner de débats audeuxième sous-sol de l’Assemblée Nationale avec des députés et les associationsles plus virulentes. La même réunion tenue in situ est impossible. Les mêmesassociations, polies et courtoises à l’Assemblée Nationale, nient sur le terrain le99
jeu démocratique. Donc, cette décentralisation est à manier avec discernement.Par contre, sur le principe, il est important qu'elle ait lieu.Troisièmement, je suggère une action de valorisation. Les données sontsuffisantes pour monter une session de formation continue pour une écoled’ingénieurs où on vous réunirait avec des professionnels sur le thème, l’individu,les associations, les pouvoirs publics et le risque. On expliquerait les typologiesdes associations, les problèmes de déontologie, comment un responsable despouvoirs publics doit discuter avec les associations, quelle est la déontologie àrespecter pour les associations.Monique Cordier, Présidente du CARNACQ et de la ConfédérationGénérale des Comités de Quartiers de Marseille et des CommunesenvironnantesJe suis venue ici pleine d’espoir parce que nous sommes confrontés à la gestiondes risques majeurs, qu’ils soient naturels ou technologiques, au quotidien. Jepense représenter le citoyen, la société civile. Je suis venue ici pour améliorer cequi se passe sur mon terrain, Marseille où on a tous les risques (Seveso, TMD,inondation, feux de forêt, ..). J’ai eu une petite angoisse sur le titre de cette tableronde : «intégrer la société civile dans la gestion du risque ? », on aurait pu mettreun point et on a mis un point d’interrogation. Mr Bayet m’a encore plus angoisséeparce que j’ai eu le sentiment, dans le début de son exposé, qu’il ne fallait surtoutpas intégrer la société civile puisqu’elle ne visait que son intérêt particulier etqu’elle ne voulait pas qu’un périmètre soit établi, que des zones soientcaractérisées comme inondables. J’ai eu très peur, car ce n’est pas du tout notreméthode de fonctionnement et notre demande. Au contraire, nous demandons auxchercheurs, aux parlementaires, aux maires d’avoir le courage de faire unecartographie où soient désignés tous les risques pour que l’habitant sachevraiment où il habite et ce qu’il risque. Sur Marseille, nous avons un fonctionnairequi a su convaincre l’élu, avec les acteurs décisionnaires, de faire ce travail. Entant que comités de quartier, nous avons servi d’acteurs et de véhicules pour cetteinformation parce que, même si on se met tous autour de la table, on n'informe pasassez le citoyen. Il faut aller jusque chez lui pour lui dire quel est le risque. Vousavez exposé cet après midi le risque une fois qu’il s'est produit, mais je veux agiravant.Je m’attendais à améliorer l’information et vous ne m’avez pas apporté deréponse. Nous, les habitants, nous n’attendons pas que vous nous traitiez commedes enfants. Nous sommes majeurs. Nous sommes des citoyens, nous sommesdes acteurs, nous sommes capables de savoir quelle est la différence entre intérêtgénéral et intérêt particulier. Nous héritons parfois d’erreurs administratives, degens qui ont confondu le risque majeur avec le risque de ne pas se faire réélire.Tous les comités de quartier, toutes les associations qui sont pérennes - je signaleque les comités de quartier à Marseille existent depuis plus de 100 ans et que laconfédération a été créée il y a 80 ans- ne sont pas des NIMBY.Quand vous avez une zone où il y a des carrières, vous avez un risqued’effondrement et nous expliquons aux personnes que s’ils ont un incendie dans100
leur maison, ils ne pourront pas reconstruire sur leur terrain. Il faut le faireadmettre. Ce n’est pas seulement le rôle de l’élu et de l’administration. Toutes cesassociations et ces habitants doivent s'exprimer. Il faut commencer à avoir unautre dialogue. J’ai eu le sentiment aujourd’hui que la gestion du risque était celledes parlementaires et de chercheurs. Vous restez dans votre bulle et nous devonsnous débrouiller avec. Nous sommes demandeurs. Prenez aussi vosresponsabilités car nous sommes prêts à prendre les nôtres. Nous sommes prêts àvous épauler, vous chercheurs, car nous avons aussi besoin de vous. Nous aussi,nous avons ces écueils dans la concertation, nous ne savons pas comment yaller : ou on est manipulé, ou on se fait manipuler ou on manipule nous aussi, ouon nous donne juste la possibilité d’être contre sans être force de proposition.Donc, à un moment, j’aimerai bien que vous cherchiez comment nous aider.Suzanne de Cheveigné, CNRSLe point d’interrogation était là pour insister sur le fait que c’est compliqué. Il y ad’un côté, des associations qui, comme les vôtres, jouent un rôle socialextrêmement important depuis 100 ans. Vous avez par ailleurs, des associationsqui se créent pour des petits problèmes et qui ont une position plus étroite. C’estcette complexité qu’il faut arriver à décoder. Aller sur le terrain est aussi unemanière de pouvoir discuter. Toutes les associations n’ont pas les moyens demonter à Paris chaque fois qu’il y a un colloque intéressant.Jacques Roux, CRESALLe risque zéro me paraît justement à mettre en discussion entre chercheurs,décideurs et résidents, car précisément cette question assénée comme unerevendication pure, ne fait pas avancer la collaboration et la co-création d’unesécurité améliorée du territoire. Si on va trop dans le sens du risque zéro, on estdans une impasse.Monique Cordier, Présidente du CARNACQ et de la ConfédérationGénérale des Comités de Quartiers de Marseille et des CommunesenvironnantesNous avons une zone Seveso. Quand AZF s'est produit, la première réaction denotre maire a été de fermer l’usine. Il y a eu une forte discussion entre leshabitants et les employés de l’usine. On aurait pu tous monter au créneau endisant, il faut fermer. Ce risque, on a bien voulu le partager car on participe à desséances tous les mois dans cette usine. On pose des questions, on nous répond.On a fait des simulations de catastrophe, on s’est entraîné car il faut apprendre lesgestes qui sauvent. Quand il y a une catastrophe, c'est la mauvaise réaction dupublic qui crée le plus de morts. Quand il y a le feu, les gens vont dehors. Lespompiers ne savent plus où ils doivent aller en premier. Il y a une éducation à faire.Le risque zéro, on sait qu’il n’existe pas. Il faut que le citoyen en prenneconscience.101
Michel Bacou, DIREN PACAUne question pour Cyril Bayet vis-à-vis des PPR. Vous présentez la politique PPRcomme une réussite mitigée ou un demi-échec lié aux résidents dans les zonesinondables, notamment pour les PPR inondation. Ne pensez-vous pas que si cettepolitique est un demi-échec, c'est plutôt lié à la concertation et aux problèmes desmulticouches de contraintes imposées aux collectivités locales, donc aux élus surdes territoires qui sont d’ores et déjà contraints ? Ma deuxième remarque porte surles dispositifs de la vulnérabilité que vous présentez comme étant quasimentexistants dans les PPR inondation. Je n’ai qu’une vision partiale du territoire,travaillant sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces dispositions de réductionde la vulnérabilité limitée à 10% de la valeur du bien me semblent relativementprésentes mais la vraie question au-delà de cette existence dans le règlementPPR est la suivante : qui contrôle, avec quels outils ?Cyril Bayet, Université Paris 13Ce rapport portait sur les contestations associatives. Il est certain que les PPRposent davantage de problèmes aux élus locaux, mais ce n’était pas l’objet del'étude. On ne peut pas nier qu’il y a beaucoup de contestations locales des PPR.J’ai effectivement approfondi le dossier de la vallée de l’Oise, caractérisé par desconflits assez forts entre les pouvoirs publics et les riverains. Il y a d’autres cas oùil existe des mobilisations importantes contre les projets PPR.Suzanne de Cheveigné, CNRSLa question au fond est qu’à partir d’un exemple où se pose un problème, il esttrès important d’expliquer ce qui a été fait. Peut-on le généraliser ?Michel Bacou, DIREN PACAIl serait intéressant de se renseigner sur une étude lancée par le MEDDconcernant les PPR existant. Ils ont tiré au sort 400 PPR et ils ont travaillé sur 200PPR représentatifs pour voir justement quels étaient les problèmes.Cyril Bayet, Université Paris 13Il faut faire une distinction entre les associations. J’ai parlé d’associations qui semobilisent contre les PPR. Il existe aussi des associations qui se mobilisent ensens inverse. Ce sont des associations de défense de l’environnement qui fontpression sur les pouvoirs publics pour une politique de gestion des zonesinondables davantage contraignante et qui ont également un rôle en termes decontrôle, de surveillance des PPR. Je ne mets pas toutes les associations dans lamême catégorie. Par ailleurs, je n’enferme pas non plus, ce que j’ai essayé demontrer, les associations qui contestent les PPR dans le statut d’associationsnymbistes. J’ai voulu dire que c’était plutôt un discours tenu par les pouvoirspublics et que c’était un discours de délégitimation des revendications quipouvaient être par ailleurs tout à fait légitimes. On constate souvent une certaineévolution dans les intérêts défendus par les associations contestant les PPR. Au102
départ, elles se mobilisent pour défendre un intérêt local ponctuel et au fur et àmesure qu’elles instruisent le dossier, elles élargissent leurs intérêts à d’autresdomaines et plus largement aux problèmes de gestion des cours d’eau ou auproblème de l’influence de l’agriculture sur les inondations. On constate cetteévolution dans le cadre de la vallée de l’Oise.Michel Bacou, DIREN PACAIl ne me semble pas que les résidents habitant dans les zones inondables soientun frein. Le frein est plutôt le blocage du développement ultérieur.Daniel Berthery, CGGREF, ancien directeur de l’Etablissement PublicTerritorial de Bassin sur la vallée de l’Oise et de l’AisneJe réagirai aux propos de Mr Bayet et apporterai un témoignage sur cetteexpérience récente. Dans votre présentation, vous avez indiqué que cette chartede gestion du risque inondation qui a été signée en 2001 entre les principauxpartenaires du risque, est le résultat d’une négociation dans laquelle on a vouludonner des contreparties aux riverains pour faire passer les PPR, et ajouter uncertain nombre de choses comme sur l’annonce des crues. Ce n’est pas lesentiment que j’ai recueilli de cette expérience. Cette charte de gestion du risque,dont tout le monde se félicite, est la mise en musique des recommandations néesaprès les grandes crues de 1995, le rapport DUNGLAS, qui proposait un certainnombre d’actions dans différents domaines de la coordination des services allantde la prévention, de l’annonce des crues, à la prévision, l'action. Cette charte esten réalité l’ensemble des recommandations qui avaient été faites à l’époque surune forme programmatique avec des objectifs et des moyens. Par contre, vousn’avez pas précisé que la négociation a bien eu lieu entre les collectivitésterritoriales de ces départements et l’État, au travers de ses établissementspublics, Agence de l’eau ou VNF. Car, au moment où les collectivités territorialesétaient prêtes à s’engager sur un programme d’investissement, de ralentissementet de lutte contre les crues sur plusieurs années, elles souhaitaient que l’État et lesétablissements publics apportent un plus par rapport à ce qu’ils faisaientprécédemment, un plus en matière d’annonce des crues, de gestion des zoneshumides et surtout en matière de gestion des voies navigables. C’est plutôt souscet angle là que cette charte est le résultat d’une négociation.Mon témoignage concerne la participation de la société civile, des associationsdans les travaux. En charge d’un programme d’aménagement hydraulique destinéà ralentir les crues, nous avions à faire face, d’une part, à des associations nesouhaitant pas ces aménagement sur des terrains agricoles à la campagne loindes zones habitées que ces aménagements devaient protéger et d’autre part, àdes associations de zones inondées qui trouvaient que cela n’allait pas assez viteet ne comprenaient pas pourquoi. Donc, cette association des riverains, dessinistrés, est le résultat d’une volonté, d’un choix stratégique de l’institution car elleavait bien pris conscience que ce projet ne pourrait pas être conduit s’il n’était pasaccepté et soutenu par la population pour laquelle il était destiné. En outre, dans laconception même de ces projets, il y a beaucoup à gagner de l’apport desassociations de riverains. Plusieurs exemples montrent comment les projets ont103
évolué pour intégrer un certain nombre de mesures d’accompagnement, changerdes consignes de fonctionnement pour répondre aux souhaits des associations deriverains, donc améliorer leur qualité pour les rendre plus facilement acceptables etsortir de ce tir-croisé des associations face à l’établissement chargé de réaliser destravaux, car les associations de sinistrés et les établissements publics sont desalliés objectifs. A partir du moment où les échanges d’information permettent auxassociations de riverains de bien comprendre le problème et les obstacles qui seposent, nous pouvons avancer plus vite. J’ajouterais un dernier mot. Dans cetteconcertation et cette discussion qui s’expriment par la solidarité amont-aval, quandon a discuté entre des populations qui sont très éloignées, il est bon que lesassociations d’inondés puissent avoir en direct l’écho des autres associationsd’agriculteurs qui ne souhaitent pas que l’on sur-inonde leur terrain pour payer leserreurs du passé. Il est bon aussi que les associations de défense contre lesprojets qui sont souvent des associations d’agriculteurs entendent directementsans intermédiaire la voix des populations inondées qui attendent cetinvestissement. C’est ainsi une manière pour l’institution de se sortir de cetteaccusation et de ce tir-croisé.Bastien Affeltranger, Institut de l’Environnement et de la SécuritéHumaine, BonnL’intérêt du travail de Cyril Bayet est de jeter un éclairage supplémentaire sur lacarte des acteurs au niveau local et d’éclairer leur positionnement dans les débatsou dans les négociations sur les PPR. C’est une contribution, à mon sens, audéveloppement plus efficace de méthodologies participatives à la fois pournégocier les PPR, voir plus tard les PPRT par analogie, pour les projets locauxd’aménagement du territoire. C’est aussi cela les PPRI, mettre les élus et lesacteurs locaux face à des contraintes nouvelles. Ils les obligent à se poser laquestion du futur qu’ils veulent pour leur territoire. Connaît-on au niveau national lepourcentage des PPR notifiés qui ont fait l’objet d’un recours devant le tribunaladministratif, pour avoir une idée quantifiée des conflits locaux générés par lesPPR ?Cyril Bayet, Université de Paris 13Au niveau national, je ne connais pas les chiffres. Dans la vallée de l’Oise, surdeux départements par exemple, il y a eu environ une dizaine de recourscontentieux. Les PPR étaient parfois intercommunaux. Par exemple, pour le Vald’Oise, 22 communes étaient concernées, sur 70 communes. La politique des PPRtransforme la politique de prévention des inondations, donc une politiqued’aménagement dans le sens où elle affecte les destinations de certaines zones.C’est donc une politique qui suscite des gains et des pertes, donc potentiellementlourde de conflits.Jacques Bresson, initiateur de la FENVACLa FENVAC est une organisation fondée en 1994 par 8 associations de victimesde catastrophe et qui regroupe aujourd’hui les victimes de 53 accidents collectifs104
ou de catastrophes de toute nature, particulièrement technologiques, fort peunaturelles, les catastrophes naturelles ayant uniquement des implications pénales.Je voulais apporter un témoignage. Aujourd’hui, 11 ans après sa création, nousavons le sentiment de faire partie de cette société civile qui est intégrée dans laréflexion sur la prévention. Elle faisait partie dès l’origine des objectifs de cettefédération. Les objectifs étaient simples, au nombre de trois : la solidarité entre lesvictimes, la justice et la vérité sur les causes des accidents et la prévention. Pourtoutes les victimes, puisque le drame est arrivé, elles veulent surtout que cela nese reproduise pas et que les leurs ne soient pas morts pour rien. Dans notre esprità tous, la démarche pénale, c’est-à-dire la procédure, le procès, la sanctionpénale, fait partie de la prévention et constitue un élément essentiel de laprévention. Au point de vue de la recherche, de la prévention des accidents, nousavons mis en place avec les dirigeants des grandes entreprises nationalisées,EDF, SNCF, GDF ou avec les pouvoirs publics comme le ministère des Transportsou celui de l’Education Nationale, des réflexions sur certains points précis desécurité qui avaient, par le passé, entraîné des catastrophes.Par exemple, les sorties scolaires avaient provoqué, dans les années 1995 à 97,trois drames entraînant la création de trois associations de parents de victimes quiavaient rejoint notre fédération. Les enseignants, suite à l’affaire du Drac nesouhaitaient plus organiser de sorties scolaires et la Ministre de l’époque,Ségolène Royal avait créé une table ronde. A notre demande, les associations desparents des enfants victimes y ont participé et ont apporté des dispositions quifigurent maintenant dans la circulaire datée de 1999, concernant les sortiesscolaires. Voilà le genre d’action que peut faire non seulement une association devictimes mais une fédération d’associations de victimes car sa particularité est depérenniser l'effort des associations qui généralement s’arrête ou se ralentit trèsfortement après le procès. Mais, certains de ces membres continuent leur actionde prévention au sein de cette fédération nationale.Benoît Vergriette, Agence Française de Sécurité SanitaireEnvironnementaleJ’ai une question générale sur cette table ronde. L’intitulé de la table ronde est«intégrer la société civile dans la gestion du risque ?». Au travers des travauxprésentés, on voit bien que la société a différentes composantes avec des enjeuxdifférents et chacun de vos travaux illustre l’une ou l’autre de ces composantes. Lerisque est multiforme, il est une ressource pour les acteurs. Parmi les acteurs, il y ales décideurs, les gestionnaires du risque et on a l’impression que dans vostravaux, on prend les gestionnaires ou les décideurs comme une entité un peumonolithique. Alors que l’origine d’un certain nombre de risques, notamment lesrisques sanitaires d’origine environnementale, est chronique avec des effets à longterme. On n’est pas dans l’accidentel. Effectivement, c’est la résultante d’un certainnombre d’activités agricoles ou industrielles de différente nature qui font intervenirdifférentes composantes des pouvoirs publics qui, eux-mêmes, ont des intérêtsdivergents que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Comment dansces travaux, peut-on intégrer l’analyse et la prise en compte de ces divergences,de ces composantes de l’administration ou des collectivités locales ? N'est-ce pas105
une des clés de lecture qui permettrait de mieux comprendre les difficultés ou lesréticences à engager des procédures de dialogue avec la société civile sachantqu’effectivement selon les corps d’origine, on a des cultures différentes dans lamanière d’appréhender les problèmes ? En deuxième niveau, cela permettrait deréinterpréter pourquoi les résultats des débats ou des consultations ne sont pasensuite suivis d’effets. Cela rejoint la question du transcodage.Geneviève Decrop, Futur AntérieurJ’ai travaillé antérieurement sur la notion de scène du risque qui estnécessairement plurielle. Une multiplicité d’acteurs parle de multiples points devue. Même si les gestionnaires et les décideurs appartiennent plus ou moins à lasphère publique, ils sont très nettement différenciés. De nombreux travauxinsistent sur ce point. Mais ce n’est pas le thème choisi par cette table ronde.Nancy de Richemont, Université de Montpellier, Laboratoire GESTERJe voulais ajouter quelques remarques par rapport au thème de cette table ronde,indiquer quelques mises en perspective historiques parce que cela peut intéresserun certain nombre d’acteurs. Nous sommes encore en France sur un certainnombre de choix politiques qui ont été faits en toute connaissance de cause au17 ème siècle, qui ont été largement oubliés au 19 ème et qui suscitent aujourd’hui desblocages et sont peut-être à l’origine de l’inefficience de certains débats. Juste unexemple, au 17 ème siècle, le choix conscient des acteurs du risque et des agentsde l’État a été de confier la lutte contre les grandes inondations par débordementaux ingénieurs du roi puis aux ingénieurs des Ponts et Chaussées mais lespropriétaires, les habitants se chargeaient des inondations par ruissellement oudes inondations très locales. Il y avait un partage des rôles très précis. On retrouvedans les textes un dialogue qui existait déjà. Ce n’est plus le cas aujourd’hui oùune gestion du risque implique de plus en plus toutes les parties prenantes de lasociété, y compris la société civile; mais cette coupure entre l’État, desorganisations administratives et la société civile date en grande partie d’un partagedes rôles qui a été voulu en fonction d’un certain contexte. Dans beaucoup de cas,l’efficacité de ces mesures, de ces actions techniques a fait complètement oublierl’importance de ces choix. C’est peut-être un champ de recherche ou de réflexionimportant que chaque acteur retourne dans son passé pour comprendre quels sontles héritages qu’il porte en lui et qui peuvent constituer à l’heure actuelle des pointsde blocage, car ce sont des héritages qui correspondent à des enjeux ou desrapports de force qui aujourd’hui ne sont plus effectifs. On retrouve les propos deMr Picon sur le fait que des règlements pour les digues du Rhône sontcomplètement obsolètes et où la société civile a tellement évolué depuis un siècleque ces points de blocage nuisent au rétablissement d’un dialogue efficace. Tousles acteurs ont besoin de cet apport historique qui ne peut pas être fait uniquementpar les historiens puisqu’il s’agit de s’intéresser à la culture de chaque service etde chaque institution ou de chaque groupe, de comprendre d’où il vient et dans uncertain nombre de cas, il faut la compétence technique ou la connaissance, le suivide l’institution pour éclairer ce regard historique.106
Yves Cassayre, ONFJ’ai eu l’occasion dans mon passé professionnel de présenter quelques PPRauprès de communes, d’acteurs locaux ou d’écrire suite à des catastrophes. Jevoudrais rebondir sur le concept de Geneviève Decrop sur la scène du risque, enfaisant le constat que souvent deux pièces se jouent en même temps. Il y a leconcept des dégâts matériels et le risque pour les vies humaines. Ce n’est pas dutout pareil. Une fois qu’on a présenté la description du phénomène naturel, del’aléa et du risque qu’il peut produire, dès l’instant où on a identifié d’un côté desdégâts matériels potentiels ou des victimes potentielles -je parle de morts- les gensne réagissent plus de la même façon; que ce soit les élus, les services de l’État oules citoyens, les associations, etc. On a là deux types de réaction, qui sont tout àfait compréhensibles puisque pour caricaturer, quand on a des dégâts matériels,depuis la loi de 1982, on est relativement organisé pour indemniser les victimes.Ce n’est jamais parfait mais globalement, cela fonctionne. Quand on a des morts,c’est beaucoup plus compliqué. On a des décisions de justice qui ne sont pastoujours compréhensibles ou qui sont divergentes et on sent bien qu’on ne peutpas amener de réparations. Je regrette que cette différence des deux logiques nesoit pas apparue dans les exposés.Geneviève Decrop, Futur AntérieurCe que vous dites est tout à fait fondamental. Ce n’est pas apparu parce qu'on apeu de temps. Sur la scène locale de la prévention, la catastrophe est vraimentdans l’angle mort. Cet angle mort resurgit sous la forme de la victime, après. C’estlà où il faut faire le lien entre la scène de la prévention et les associations devictimes puisqu’elles reviennent, ce qui est nouveau et tout à fait intéressant, sur lechamp de la prévention et pas uniquement sur celui de la justice, par exemple. Il ya là quelque chose de fondamental qui prolonge votre réflexion et il faut continuerle travail sur cette question.107
Autour de la valorisationdu programme EPRSylvie Charron, MEDD, D4EComme Eric Vindimian vous l’a expliqué, la coordination du programme EPR a étéconfiée au Cemagref. Dans ce cadre, Anne-Paule Mettoux va vous exposer lesenjeux de la valorisation et les actions qui ont été développées.Anne-Paule MettouxCemagrefParc de Tourvoie, BP 44, 92163 Antony CedexTél : 01 64 46 72 87anne-paule.mettoux@wanadoo.frAvant de commencer, je voudrais remercier un certain nombre de personnes quiont participé à ce programme et qui sont à l‘origine de ce colloque. Je remerciedonc Gérard Brugnot et Jean-Paul Nobécourt qui m’ont investi de cette mission etles présidents du conseil scientifique, Claude Gilbert, et du comité d’orientation,Philippe Huet, pour le suivi de cette tâche. Je remercie vivement GenevièveBaumont pour son dynamisme et Jacques Joly pour sa confiance ainsi que LauraBelloni pour l’aide qu’elle nous a apportée notamment pour ce colloque. Voilà,j’ajoute des remerciements tout particuliers pour le séminaire organisé par l’équipede Pierre-Marie Sarant en Guadeloupe, qui a changé ma vie personnelle.Compte tenu des objectifs du programme EPR, Evaluation et Prise en compte desRisques naturels et technologiques, la valorisation des recherches constitue unedimension importante et essentielle de la réussite des actions engagées. Quelssont ces enjeux ? Quelles actions ont été engagées ? Quel bilan peut-on en tirer ?La valorisation d’un programme ministériel de recherche comme EPR a pourobjectif de favoriser l’exploitation des résultats de la recherche dans un cadreopérationnel. Elle est destinée aux différents acteurs, scientifiques, techniciens,experts, administrations, décideurs locaux, entreprises privées ou publiques,citoyens individuels ou associations. Elle a pour mission de mettre à dispositionl’information sur les résultats des recherches, de faciliter l’évolution des pratiqueset des comportements, de dépasser le cloisonnement des équipes et desdisciplines en favorisant une pluridisciplinarité, notamment en créant des échangesentre équipes et gestionnaires de risque, en résumé d’assurer une meilleurestructuration de la communauté du risque. Elle permet également une ouverturevers des partenariats.109
Deux volets ont été développés pour cette valorisation, un volet individuel propre àchaque action de recherche et un volet collectif.La valorisation individuelle se traduit sous la forme d’articles scientifiques, deguides ou manuels, de logiciels, de CD-Rom ou de films, de sites Internet, d'outilsde formation et d'information.La valorisation collective, «traditionnelle», correspond aux séminaires deprésentation, d’avancement des travaux ou de restitution. Ces séminaires sonthabituellement organisés lors des programmes ministériels. Par exemple, leprogramme Concertation-Décision et Environnement du MEDD propose desséminaires réguliers.Néanmoins, les actions de la valorisation EPR ne se sont pas réduites à cesformes classiques. En effet, après concertation avec le comité permanent et lesinstances de la D4E, trois orientations ont été définies. La première consistait àregrouper des informations disparates sur la communauté du risque; la deuxièmeconcernait la mise en place de séminaires et enfin, la troisième était centrée sur lapublication et la diffusion des principaux résultats.La socialisation des travauxLa valorisation collective s'est donc prolongée avec la socialisation des travauxqui permet de développer les relations sociales, d'adapter et d'intégrer lesrecherches à la communauté des risques. Elle a consisté dans un premier tempsen un recensement des thématiques et des membres des équipes de recherchetravaillant dans des programmes ministériels sur les risques. Cinq programmesétaient concernés : le programme Risques Collectifs et Situations de Crise duCNRS qui a abouti à la création d'un GIS et les programmes du ministère del'Écologie et du Développement du Durable : RIO, risque inondation; CDE,Concertation, Décision et Environnement; EPR, Evaluation et Prise en compte desRisques naturels et technologiques et RDT, Risques, Décisions et Territoires.Une bibliographie thématique sur le risque a également été élaborée à partir desdonnées fournies par chaque équipe du programme EPR dans sa réponse àl'appel à proposition et réajustées avec les bibliographies des rapports.Enfin, des sites Internet sur les risques naturels et technologiques ont étérecensés. Cette première approche, sous forme de liste, permet de différencierquelques thèmes et de proposer un système de classement.Les données recueillies dans le cadre du programme EPR sont en constanteévolution. Pour les compléter et en permettre une réelle exploitation, il est essentield'effectuer un suivi constant et d'avoir une mise à jour régulière, notamment en cequi concerne le «turn-over» des chercheurs, qu'il s'agisse d'un changement deposte ou de thématique, pour assurer la pérennité des informations. Cetteapproche est particulièrement intéressante, tant pour les gestionnaires que leschercheurs, pour établir une liste de contacts et un carnet d'adresses. Ainsi,lorsque vous travaillez sur un thème particulier, vous savez qui a déjà exploré lathématique. Donc, vous pouvez plus facilement vous référer à ces travaux ou110
prendre rendez-vous avec les intéressés et entamer des discussions pouréventuellement établir un partenariat.Une valorisation basée sur la concertationL’originalité de la valorisation de ce programme est la mise en place de séminairesdits «de transfert», qui sont liés à une équipe de recherche, et de séminaires dits«transversaux» qui recoupent soit différentes équipes, soit plusieurs programmes.Séminaires de transfertLes séminaires de «transfert» ont été réalisés dans le cadre de la recherchepropre à chaque équipe, au bénéfice des acteurs concernés, soit en tant queséminaire d’étape, c’est-à-dire un séminaire permettant d’avancer dans larecherche ou de la recadrer, ce qui répond plus à un enjeu scientifique, soit en tantque séminaire de restitution, favorisant la diffusion des résultats de rechercheauprès des acteurs concernés et le dialogue entre chercheurs et acteurs.Tableau 1 : Les séminaires de transfertTitre du séminaire Date Lieu ChercheursOrganisateursRisques naturels, informationpréventive et responsabilité02/12/02 NiceSophia-AntipolisValérie Godfrin, AnneLalo, Sandrine GlatronAssociations de victimes : del’affliction à la prévention04/10/03 Paris Geneviève Decrop,FENVACMéthode de retour d’Expériencesur l’Arc des Petites Antilles07 &08/10/03Les Abymes(Guadeloupe)Pierre-Marie SarantProposition pour une échelle dedommages liés aux cavitéssouterraines05/02/04 Paris Claire ArnalLe séminaire «Risques naturels, information préventive et responsabilité» a permisde montrer les difficultés de mise en place de l'information préventive dans lescommunes. Il était fondé sur la participation et les interventions d’acteurs de lagestion du risque tels que des élus, des pompiers, des services techniques, etc.De grandes différences sur la conception liée à la prévention ont été mises enévidence. Par exemple, la ville de Grasse privilégie la prévention des risques par laformation. Par contre, la ville de Nice choisit d’investir dans l’action militaire en casde crise.Le séminaire suivant, «Associations de victimes : de l’affliction à la prévention» aété centré sur le rôle des associations de victimes. Il a été foisonnant tant auniveau des interventions que de la richesse des débats. Les victimes absentes etprésentes ont donné un poids supplémentaire aux propos. La prévention est111
apparue comme essentielle par tous ces acteurs qui ont été touchés par unecatastrophe. Ces sujets restent d’actualité.Les séminaires «Méthode de retour d'expérience sur l'Arc des Petites Antilles» et«Proposition pour une échelle de dommages liés aux cavités souterraines» étaientdes séminaires scientifiques d'étape, qui ont permis de faire évoluer la recherchevers une meilleure prise en compte des préoccupations des acteurs et uneamélioration des connaissances, notamment par les réactions suscitées lors desdébats. Dans le premier, les acteurs n’étaient pas uniquement français. Il y avaitdes acteurs locaux mais également des îles voisines des Caraïbes, ce qui apermis de tendre vers un partenariat plus vaste et d’élargir la problématique audelà du cyclone Lenny. Dans le second, est apparu clairement un décalage entrela vision des gestionnaires et l’objectif de l’équipe de recherche. En effet, cedernier était d’élaborer un outil de concertation alors que certains décisionnaires leprenaient directement comme un outil d’appropriation pour justifier leur décision.Séminaires transversauxLes séminaires transversaux étaient destinés à accentuer le transfert des résultatset donc des connaissances vers les acteurs opérationnels en vue d’une coconstructiondes savoirs. Ils étaient conçus comme des lieux de discussion etd’échange. Ils ont associé utilisateurs et scientifiques sur des sujets concrets àpartir des cas de recherche. Cette approche peut concerner tous les aspects deco-gestion globale d’un risque ou des méthodologies communes à plusieurs typesde risques. Ils peuvent regrouper, dans le cadre de la valorisation, des chercheursissus de programmes ministériels différents.Tableau 2 : Les séminaires transversauxTitre du séminaireChercheurs EPR/RIOparticipantsDateLieuAtelier Risques,responsabilités etassociationsAtelier gestion du risqueet retour d’expérienceGeneviève Decrop, CyrilBayet, Bernadette deVanssay, Marie-FranceSteinlé-Feuerbarch,Jacques RouxPhilippe Blancher, GillesHubert, Bruno Ledoux,Bernard Picon, Jean-LucWybo17/02/03 Lyon(DIREN)08/10/03 Les AbymesGuadeloupeLes analyses socioéconomiquesdu risqueinondation : leurutilisation dans laréduction de lavulnérabilité et dans lesBernard Barraqué, Jean-Roland Barthélémy, GillesHubert, Bruno Ledoux,Claire Reliant04 &05/12/03Paris(ENGREF)112
systèmesd’indemnisationAllemagne, Angleterre,France, Italie, Pays-Bas,SuisseLes séminaires transversaux sont au nombre de trois. Le séminaire sur laresponsabilité, Atelier Risques, responsabilités et associations a été mis en place àla suite des réunions de concertation entre les chercheurs et les instances duprogramme, le thème de la responsabilité revenant constamment. Le séminaires'est déroulé sous la forme d’un atelier avec une vingtaine de personnes,chercheurs et associatifs autour du problème de la responsabilité, sur la perceptionde la responsabilité par les acteurs, notamment au niveau juridique. Les différentesconceptions liées à ce thème ont été mises en évidence entre les scientifiques etégalement entre les acteurs de terrain. Ce séminaire a montré l'intérêt deprolonger l'approche, avec des ateliers sur le vocabulaire de la responsabilité parexemple.«L'Atelier gestion du risque et retour d’expérience» a été proposé à la suite duséminaire scientifique d’étape organisé par PM Sarant en Guadeloupe. Il arassemblé des chercheurs EPR qui ont exposé leurs résultats aux personnesprésentes dans la salle. L'intérêt a été d'exposer des expériences différentes del'objet du séminaire d'origine. Celles-ci étaient parfois très éloignées du terrain surlequel se déroulait le séminaire et le débat a montré que, quels que soient lesrisques et le lieu, les problématiques se rejoignaient. A chaque fois, les débatsétaient très riches, tant au niveau des expériences qu'au niveau des solutionsproposées.Le dernier séminaire, Analyses socio-économiques du risque inondation, étaitinternational : l’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’Italie, les Pays-Bas et la Suissey étaient représentés. Il a montré l'importance de la comparaison au niveaueuropéen. Des conceptions différentes ont émergées avec en toile de fond, leproblème de transfert des connaissances et de méthodes d'un pays à un autre.Les caractéristiques géographiques, économiques, politiques, sociologiques ouculturelles, propres à chacun d'entre eux ont été mises en évidence. La carence dedonnées sur les systèmes assurantiels et le manque de recherches comparativesont également été mis en exergue.Pour conclure, les séminaires ont rempli leur mission, c’est-à-dire qu’ils ont permisde confronter des expériences, de créer des échanges et de partager desconnaissances. Ils ont, dans un certain nombre de cas, débouché sur desprémices de partenariats. La publication des rapports permettra une diffusion pluslarge. Enfin, la mise sur Internet de la production d’EPR (rapports, retranscriptiondes séminaires, bibliographie…) sur le site du ministère de l'Ecologie et duDéveloppement durable constitue un pas important vers une approche constructivede transfert de la valorisation. Malgré ces aspects positifs, cette démarche mériteun effort particulier et continu pour retirer tous les bénéfices d'un tel programme.113
En effet, fournir des rapports qui sommeillent dans un ministère et des outils sansutilisateurs demeurent un risque important. La valorisation effectuée jusqu'àprésent a permis de mettre en valeur la production du programme EPR. Sonprolongement devrait être assuré par la mise en place d'un nouveau programmesur les risques, RDT, Risques, Décisions, Territoires, même si les problématiquessont évidemment un peu différentes. Mais, ce nouveau développement sera-t-ilsuffisant ?Sylvie Charron, MEDD, D4ELe ministère de l’Équipement a également contribué à la valorisation duprogramme. Lionel Moulin se propose de présenter les retombées du programmedans le champ de compétences du ministère de l’équipement.Lionel Moulin, Ministère de l'équipement, des transports et du logement -DRASTJ’ai le privilège de terminer cette journée. Tout d’abord, en écho à quelquesinterventions, je précise que je parle au titre d’une administration centrale à Paris,je suis dans les sciences dites «dures», dans la sphère recherche et au ministèrede l’Équipement. Nous sommes engagés sur ce programme depuis 1999 parceque les risques sont un sujet interministériel. Le ministère de l’Équipement l’abordesuivant différents angles : les risques naturels, aussi bien le sismique que lesinondations, les mouvements de terrain, les risques météorologiques ou encore lesincendies de forêt, ou les risques industriels puisqu’ils sont en relation avec desproblématiques d’aménagement, d’urbanisme, ou aussi des problématiques sur laconception des infrastructures ou des bâtiments. Nous avons aussi d’autres typesde risque : le risque des transports, sur les constructions, le risque habitat avecplusieurs thématiques et maintenant une liaison avec les risques santé, les risquessur les réseaux aussi bien les réseaux d’eau, de télécommunications, l’énergie, etenfin les risques du travail pour les métiers du BTP.Comment cela s’exprime-t-il ? Ici, on parle directement des risques, naturels ouindustriels. Au ministère de l’Équipement, on va plutôt trouver le sujet risqueintégré dans les réflexions sur les transports ou sur les constructions, la sécuritédes transports et la sécurité des constructions. Il est vrai que c’est un point de vuequi est en train d’évoluer sous la pression de la montée de la problématique risque.On disait également tout à l’heure que dire le risque, c’est bien; mais la questionpourrait être, sur les sujets d’aujourd’hui, comment se raccrochent-ils à quelquechose de positif ? Il me semble qu’il y a là un aspect à approfondir.Que va-t-on faire de ces recherches ? D’ores et déjà, il y a des rapports qui nousintéressent en administration centrale pour des problèmes d’urbanisme et deconstruction. Par exemple, l’inspection générale est intéressée, car après chaquecrise, elle est souvent sollicitée pour des retours d’expérience, et il y a des étudesfort intéressantes de ce point de vue. Je crois que cela intéresse aussi les DDE. Ily a plusieurs interventions qui montrent que localement il faudrait pouvoir seréapproprier ces travaux, et nous avons la même préoccupation. Il y a desrecherches qui sont bien liées à un territoire. Si cela n’a pas déjà été fait, une114
estitution intéresserait la DDE ou les services de l’Équipement parce que si lecolloque d’aujourd’hui nous place dans une vision centrale, il y a sur le territoiredes initiatives qui se prennent avec les services déconcentrés, les collectivitésterritoriales, les administrés. L’Équipement a également besoin d’un retour de cecôté là.Ce travail nous est également utile parce que nous avons nos propresprogrammes de recherche et que cela nous aide à les orienter, à compléter lestermes des appels d’offres. De la même façon, cela contribue à définir les prioritéspour les organismes dans notre mouvance.Il y a quelque chose qui est quand même assez singulier dans ce programmeEPR. C’est qu’il est dédié entièrement aux sciences humaines et sociales. J’airegardé un peu si nous avions des approches similaires dans ce que l’on faisait.Souvent, les équipes telles que celles qui ont fait leur exposé ici, interviennentdans nos champs, en lien avec des objets technologiques. Elles vont souventintervenir pour accompagner des politiques techniques, sauf peut-être pour ledomaine de la sécurité routière qui développe plus largement une approchespécifique aux sciences humaines. Il y a d’ailleurs certaines personnes présentesqui sont également impliquées sur ces approches qui traitent des comportements,de la psychologie, etc… En dehors de ce cas, généralement, on ne fait pas unprogramme dédié aux sciences humaines et sociales, ou du moins il sera posé enlien avec des problématiques techniques relevant des sciences dites dures. Leprogramme EPR a donc une spécificité.Sur le bilan dressé par Claude Gilbert qui était de dire : «on n’a pas su faire ceci oucela». Effectivement, on est toujours un peu frustré par rapport à ce qu’on aurait puprévoir en 1999. Mais je ne suis pas aussi pessimiste. D’abord, parce qu'il y a deséquipes de recherche du programme qui ont aussi participé à d’autres actions surdes territoires et qui ont permis de faire avancer des choses. Il se fait des choseslocalement qui ne sont pas aussi segmentées. Il y a des projets intéressants. Uncertain nombre d’idées, qui apparaissent maintenant presque comme desévidences dans les discussions, viennent aussi de ce travail qui s’est fait enamont. Ces idées ont pu ensuite nourrir des initiatives locales exemplaires avecles mêmes équipes de recherche. Je pense par exemple à des travaux sur lesismique dans la région de Nice.J’ai deux demandes. Je souhaiterais que les services locaux de l’Équipementpuissent bénéficier des rapports ou d’une restitution. Je crois aussi que pour lesrapports où il y a des interviews de personnes, il faut qu’ils aient un retour ens’assurant aussi de leur accord si elles sont personnellement identifiables. Pour cequi est du retour d’information, il est probable que la restitution seule par le rapportd’étude, qui peut faire 100 ou 200 pages, n’est pas adaptée.Enfin, pour terminer, un dernier point reste à investiguer. On parle beaucoup dansce programme de la culture du risque et de la restitution auprès des citoyens, maisil y a aussi le monde professionnel. C’est une strate intermédiaire qui joue ungrand rôle dans l’information sur les risques et leur prise en compte, par exemplele milieu du bâtiment, le milieu du contrôle, le milieu notarial, etc… Il n’y a pas eud’études qui ont porté sur ces sujets. C’est quelque chose à faire parce que l’on se115
end compte qu’il peut aussi y avoir des baisses de connaissance ou de culturedans ces domaines. Pour nous, dans le milieu de la construction, c’est un sujet detravail. Je participe d’ailleurs à une autre structure sur les risques, qui s’appelle leGIS MR-Gency, au sein de laquelle cet aspect de la pratique des professionnelsest très fort. Cela concerne aussi bien la formation initiale que la formationcontinue.Il me reste à vous remercier pour ces travaux et les exposés d’aujourd’hui.Sylvie Charron, MEDD, D4EC’est intéressant d’avoir un éclairage interministériel sachant qu’au niveau mêmedu comité d’orientation, sont représentés différents ministères.François Serrand, CARNACQNous avons suivi avec intérêt les problèmes de la sécurité routière. C’est devenuun chantier national. Nous avons donc fait connaître que nous étions disposés àtravailler dans ce sens. Nous n’avons plus de nouvelles. Il y aurait peut-être unpartenariat intéressant à créer.Claude Gilbert, président du conseil scientifiqueJ’espère que mes propos ce matin ne sont pas apparus comme trop pessimistes.Les chercheurs qui présentent l’ensemble de leurs travaux sont dispersés du pointde vue de leur appartenance institutionnelle et c’est un souci. C’est unecommunauté qui ne se rencontre que dans ce type d’occasion. C’est beaucoupmoins vrai sur d’autres types de risques, c’est-à-dire par exemple ceux liés àl’incertitude, comme la vache folle, les OGM. Ils constituent une communauté quifonctionne plus en interaction, qui partage un certain nombre de concepts,d’approches. Bref, ils «s’éprouvent». Tandis qu’ici, cette communauté s’éprouve detemps en temps et c’est là où se situent essentiellement mes regrets. Lacommunauté qui travaille en sciences humaines et sociales sur les risques n’estpas énorme. Elle aussi subit un phénomène d’agenda scientifique. Or, les risquesnaturels ne sont pas mis au premier rang de l’agenda, les risques industrielsclassiques non plus et le risque nucléaire également. Il y a là un souci que jevoulais exprimer.J’ai été très sensible au discours : «dire le risque n’est pas une façon de le gérer».Cela veut dire qu’à un moment donné, peut-être faut-il penser que dire le risque etmettre en place des outils de gestion du risque sont deux choses complètementdifférentes. Il y a dire le risque et une fois que c’est mis en débat, il faut changer derégime et trouver l’ensemble des politiques qui permettent de gérer le risque avecle point que vous avez indiqué, en trouvant toutes les médiations nécessaires.Quand on parle du risque, on est dans un théâtre simplifié : les autorités, lesexperts, le public, les médias, la justice. Avec tous ces acteurs, on fait un théâtreextrême dans le sens où tout le monde est tendu dans une position extrême. Lesautorités sont absolument responsables, les experts doivent absolument maîtriserla connaissance, etc. Le public est dans un rôle «contre». En fait, quand on veutrentrer dans un espace de gestion, il faut faire baisser la pression, trouver desmédiations, etc. Dans les médiations, il y a un acteur que l’on oublie souvent, cesont les collectivités locales. Elles ne sont pas prises en compte complètement.116
Table ronde 3 : Permettrel'appropriation des outils de la gestiondes risques ?Cette table ronde se focalise sur la mise en place des outils dans lagestion des risques. Cette mise en place revêt parfois des limites.Comment ces outils sont-ils appropriés ? Quels sont les freins et lesatouts ?Co-animateurs :Christine King, BRGMPhilippe Hugodot, IGEIntervenants :Stéphane Couture, ENGREFDaniel Delahaye, Université de CaenOlivier Godard, Ecole PolytechniqueRichard Guillande, GSC ConsultingGilles Hubert, Université Cergy-PontoiseClaude Napoleone, CemagrefRachel Vanneuville, CNRSChristine King, BRGMDes équipes du programme EPR ont initialement couvert plusieurs champs etdivers risques principalement naturels mais aussi technologiques puisque ils ontabordé les inondations, les feux de forêt, la tempête, l'érosion et le risquetechnologique du type OGM. Mais on leur a demandé de resserrer le proposautour du thème de cette table ronde avec l’idée de mettre en valeur certains des117
aspects de ce programme qui en font l'originalité : l’appropriation des outils de lagestion du risque, les liens et les visions que les chercheurs peuvent offrir enfavorisant le dialogue vers la recherche-action. Derrière ce centrage, la question setermine par un point d’interrogation qui permet de balayer le tripode : quels outilsexistent ou sont à mettre au point ? Quels sont les acteurs qui se les approprient ?Quels sont les facteurs de cette appropriation ?118
Cartographie, évaluation économique et dispositifsadministratifs comme instruments d'une appropriationet d'une gestion collective du risque de ruissellement érosifDaniel Delahaye et David GaillardLaboratoire GEOPHEN, LETG-UMR 6554Université de Caen Basse-NormandieEsplanade de la Paix, BP 5186, 14032 Caen Cedex 5Tél : 02 31 56 65 94, Fax : 02 31 56 63 86daniel.delahaye@unicaen.frLaboratoire MTG, IDEES-FRE 2795Université de Rouen1 rue Thomas Becket, 76821 Mont Saint Aignan cedexTél : 02 35 14 60 56, Fax : 02 35 14 69 40David.Gaillard@univ-rouen.frL’objectif poursuivi par l’étude présentée ici était de développer une gestioncollective des risques de ruissellement érosif sur les bassins agricoles. Ce travail aété mené dans le département de la Seine-Maritime, mais les résultats peuvents’appliquer à l’ensemble des zones de grande culture du nord-ouest du bassinparisien. Nous sommes partis d’un constat simple : des processus de ruissellementtouchent ces zones cultivées; la plupart du temps, ils n’affectent que les zonesagricoles mais parfois, des phénomènes plus importants, appelés coulées deboue, touchent des zones habitées dans les basses vallées.Comment ce genre de problème est-il traité ? Classiquement, on a recours à desbassins de rétention qui permettent, par stockage temporaire de l’eau, d’étaler lapointe de crue, et donc d’éviter les inondations importantes. Il s’agit làprincipalement de déconnecter les espaces habités des espaces cultivés.Quelles sont les limites de ces aménagements ? Seul l’espace d’interface esttraité, le ruissellement et l’érosion dans les zones agricoles restent un problèmeentier. Ces ouvrages posent également le problème de leur coût, de leurcomblement, de leur calibrage. Très rapidement, les aménageurs ont senti lanécessité de développer des formes d’aménagements complémentaires et desprogrammes d’hydraulique douce se sont mis en place. L’hydraulique douceconsiste à gérer le problème de ruissellement à sa source, donc directement surles territoires agricoles afin d’aménager l’ensemble de l’espace. Une vision plusintégrée de l’aménagement traite aussi d’autres nuisances comme la pollutionassociée à ce ruissellement. Toutes ces mesures efficaces restent individuelles etponctuelles, associées à des cadres d‘aménagement type CAD (ex CTE).Globalement, il n’y avait pas de gestion intégrée des bassins versants, et lesméthodes n’associaient pas ou peu les acteurs locaux, notamment les agriculteurs.Or, le ruissellement et l’érosion sont principalement liés à un jeu d’interactionsspatiales entre les parcelles agricoles, dans les bassins versants, avec des zonesd’infiltration, des zones de ruissellement. L’organisation des parcelles conditionnela puissance et la grandeur du ruissellement. Nos objectifs ont donc été de119
promouvoir une gestion concertée pour réduire ces phénomènes, d’élaborer lesoutils de cette gestion concertée et de favoriser leur appropriation par lesagriculteurs, les collectivités.Quel était l’objectif de cette gestion concertée ? Il s’agissait de promouvoir unegestion collective des assolements afin de permettre une redistribution del’occupation du sol dans les parcelles et l’éclatement d’îlots cultivés responsablesdes phénomènes de ruissellement.Quels acteurs étaient concernés ? Les agriculteurs étaient les premiers intéressésmais pas seulement, puisque les animateurs de bassin, les collectivités locales ontété associés à la démarche.Quelle a été la démarche ? Dans un bassin versant il y a deux échelles defonctionnements spatiaux : une échelle hydrologique de circulation duruissellement et une échelle décisionnelle qui est l’exploitation agricole. Pourintervenir sur la première échelle (circulation) il faut passer par la seconde(exploitation). En premier lieu, un diagnostic basé sur les enquêtes auprès desagriculteurs croisé avec les outils de modélisation du ruissellement ont permis dediscuter avec les agriculteurs pour élaborer des scénarios de modification despratiques. Les propositions ont fait l’objet d’une évaluation financière. Celle-ci a undouble but : d'une part indiquer aux exploitants agricoles le coût de l’opération, etd’autre part, posséder un outil de discussion avec les collectivités en permettantune comparaison avec le coût d’un aménagement classique.Quel est l'intérêt du diagnostic ? Un point important de l’étude était de modéliser,de cartographier le ruissellement et l’érosion à l’échelle des bassins versants. Eneffet les agriculteurs ont une connaissance très locale du risque, de l’aléa et de lavulnérabilité. Or, les manifestations du ruissellement peuvent se faire sentir surplus de 10 km. Cette restitution de la globalité du risque, de l’aléa et de lavulnérabilité au sein du bassin était un argument de négociation important.Quelles sont les propositions faites aux agriculteurs ? Des mesures classiqueshéritées de l’hydraulique douce, zone enherbée, inter-culture ont été proposées.Mais la nouveauté réside dans les modifications de successions culturales qui ontété envisagées permettant ainsi une redistribution de l’occupation du sol dans lesbassins. Ce travail de prospection auprès des agriculteurs a été essentiel.120
DEMARCHE ET METHODEÉchelle hydrographiqueÉchelle décisionnelleBassin versant Exploitation agricoleRéduction des processus deruissellement et d’érosionModification despratiques?Automate cellulaireEnquêteDiagnosticBase dediscussionSolutionscollectives et/ouindividuellesValidationéconomiqueQuelle est la logistique d’action ? Nous avons choisi quelques bassins versants etnous avons travaillé principalement avec les agriculteurs, en étudiant quels étaientleurs modes de production, quelles étaient leurs marges de manœuvre. Ensuite,au sein de réunions individuelles et collectives avec ces agriculteurs, un groupeprincipal, où les problèmes étaient les plus importants en matière de ruissellement,a été sélectionné. Les connaissances des exploitations ont été approfondies(connaissance des moyens techniques et des stratégies de conduite des cultures,diagnostic financier…) afin d’aboutir au stade des propositions suivi d’unerestitution individuelle et collective.Quel est le bilan de cette étude ? Au niveau méthodologique, la cartographie et lamodélisation s'avèrent de bons outils de médiation. Un des points importants del’étude est la mise en évidence d'un réel besoin de nouveaux outils de négociation.Par ailleurs, des leviers spatiaux importants sont apparus. Au départ de l’étude,l’espace semblait très spécialisé, les itinéraires culturaux extrêmement précis,donc, les possibilités de déplacer les cultures paraissaient faibles. Dans les faits, lamarge de manœuvre reste importante. Le troisième point est l’intérêt et lanécessité de l’évaluation financière.Quelles sont les limites ? C’est une méthode lourde. L’investissement sur le terrainest difficilement compressible. Il faut avoir une connaissance intime dufonctionnement de ces espaces. Une évaluation des résultats reste peu aisée carl’aménagement est dilué dans l’espace. Au global, mesurer la valeur de ce typed’aménagement par rapport à un aménagement classique calibré s'avère difficile.121
La visibilité de ces aménagements est assez faible et c’est un point sensible pourles élus.En ce qui concerne l’appropriation par les acteurs, une participation active desexploitants et une forte sensibilité à l’approche individuelle sont remarquées. Ilsconsidèrent que c’est la première fois qu'ils sont consultés réellement, ce qui apermis une amélioration de la perception du risque, notamment de la perception durisque lointain et des effets globaux de leurs actions individuelles. Cette prise deconscience a poussé certains à la mise en place spontanée de mesuresproposées en autofinancement.L’effet échantillon est une limite et la transposabilité est difficile à envisager. Noussommes dans le cas présent au stade du prototype. La mise en routine de cegenre de méthode passe par une généralisation des postes d’animateurs debassin, c’est-à-dire des gens qui sont associés à un territoire, qui le connaissentbien et qui sont là au quotidien pour mener à bien ce type d’étude. L'appropriationest volatile parce que l’environnement ne sera jamais associé à part entière dansles activités agricoles. Il reste toujours un parent pauvre, car la variableéconomique reste toujours dominante. Enfin il ressort des entretiens une certainefrustration. Certains agriculteurs ont le sentiment que les procéduresd’aménagement (et les subventions qui les accompagnent) sont faites pourrésorber les effets des mauvaises pratiques, or ceux qui spontanément ontprivilégié des pratiques respectueuses de l’environnement ne se sentent passoutenus.Bastien Affeltranger, UNU-EHSUne question sur la modélisation comme outil qui accompagne cette démarcheparticipative avec les acteurs. Vous dites que c’est un outil intéressant. Souventdans des problématiques de risque, d’aménagement du territoire, il y a uneméfiance des acteurs locaux, agriculteurs, élus, habitants par rapport au modèle.Ils disent que c’est une boîte noire à qui on peut faire ce que l’on veut. Donc, laportée explicative des modèles est rapidement limitée. Est-ce une difficulté àlaquelle vous avez été exposé et si oui, comment l’avez-vous gérée ?Daniel Delahaye, GEOPHENNon, pour deux raisons. La première est qu’il ne s’agit pas d’une cartographieréglementaire. C’est à partir du moment où elle devient réglementaire qu’ellecommence à inquiéter les gens. Dans le cas présent il s’agit d’une «modélisationpour l’aide à la décision». La seconde est que nous ne sommes pas dans unelogique de boîte noire. La cartographie est orientée pour avoir de l’information entout point de l’espace, pour voir comment se construisent les hydrogrammes decrues au sein des bassins. Cette exhaustivité spatiale leur permet de voirexactement où ils se situent et dans quelle mesure leurs parcelles participent àl’aléa ruissellement sur le bassin.122
Liliane Besson, Institut des Risques MajeursDeux points. Le premier, combien a coûté cette étude, en particulier la phasediagnostic ? Deuxième point, je ne vous ai pas entendu citer la chambred’agriculture. L’avez-vous associée sans la citer ou a-t-elle été «écartée» dans lesdébats ? C’est important si on veut passer dans la phase «routine», puisque c’estelle qui va pouvoir porter la suite.Daniel Delahaye, GEOPHENC’est une omission. Globalement, cette étude s’est appuyée sur un groupe quiétait créé en Seine-Maritime, qui est une région très pilote sur ce type deproblématique. Ce groupe Sol et Eau intégrait tous les organismes. La chambred’agriculture a évidemment un rôle important dans la formation et l’encadrementdes animateurs de bassin. Enfin, l’étude a été financée par le ministère dans lecadre de ce programme et elle a été en partie réalisée dans le cadre d’un travail dethèse.Christine KingOn note que ce type d’outil est lié à la représentation et à l’aide à l’appréciation durisque en phase amont, que son intérêt est d’associer les acteurs locaux et qu’onest loin de l’aspect réglementaire. C’est pour cela que le débat est riche mais queson déploiement s’avère limité.123
Sensibilisation des PME/TPE à la réduction de leur vulnérabilitéface au risque de crue : un parcours long et sinueuxRichard GuillandeGEOSCIENCES CONSULTANTS sarl157 rue des Blains, 92220 BagneuxTél : 01 46 64 60 60, Fax : 01 46 64 61 61rg-gsc@wanadoo.frQuel est le sujet que nous avons traité ? On s’est intéressé aux PME-PMI-TPE,aux artisans, commerçants face au risque inondation. Pourquoi cette démarche ?A la fin des années 90, on a vu apparaître des méthodes d’audit et de diagnosticde vulnérabilité des entreprises face au risque de crue. C’était essentiellementdéveloppé sur la base d’entreprises à fort enjeu industriel et il s’est avéré quetoutes les entreprises ont besoin d’être protégées; elles sont toutes susceptiblesd’être victimes des inondations. Il est apparu vers 2000-2001 qu’il y avait peut-êtrequelque chose à faire pour préciser la manière d’informer ou de traiterspécifiquement les PME-PMI. J’entends PME-PMI, les entreprises en dessous de50 personnes jusqu’à l’individuel indépendant, le commerçant.C’est de cette idée qu’est parti le projet : voir quelle était leur perception, leursensibilité face à cette problématique du risque de crue, en traitant à la fois desentreprises qui avaient déjà été victimes d’inondation et d’autres pas encore. Leprojet a été divisé en deux phases. La première a été une analyse de la sensibilitédes entrepreneurs. Elle a consisté à interroger des entreprises sur la base d’unquestionnaire que nous avons préparé. Il s’agissait d’évaluer, d’une part, l'étatinitial des entreprises face au problème d’inondation et ensuite de voir commentpénétrer l’information préventive publique, celle du ministère de l’Environnement,en comparant également des situations variées à différents contextes d’aléa. On achoisi la région parisienne. On a beaucoup travaillé en Seine-Maritime, pour avoirun panorama diversifié de tailles, d’activités et de contextes géographiques etd’aléas. La deuxième partie a consisté à mettre en place, sur la base du recueil etde l’analyse des informations sur la perception et la sensibilité des entrepreneurs,un outil de sensibilisation. Il ne s’agissait pas de mettre en place un outil dediagnostic. On était plutôt, en tant que bureau d’étude sur l’intérêt commercial :existe-t-il un marché d’audit de vulnérabilité pour les PME-PMI ?On a développé un guide synthétique, didactique qui devait traiter tous les aspectsdu problème et informer toutes les PME-PMI. Qu'est-ce que l’aléa, quelles sont lesactions de l’État, comment aborder le problème, les types de solution en essayantde s’inspirer et d’utiliser les langages et de traiter les points les plus souventévoqués et les plus stratégiques, pour toucher la sensibilité des entrepreneurs.L’équipe était composée de deux entités : notre société et le GRID du ProfesseurMunier qui à l’époque était à l’ENS Cachan. On a fait travailler des ingénieurs cheznous et également des étudiants en DESS et masters, pour les enquêtes sur leterrain et l'analyse des données des résultats d’interviews.125
Le choix des PME a été fait parce qu’il y avait un manque et que c’est un énormepoids économique en termes d’emplois et de vulnérabilité. Elles sont beaucoupmoins bien préparées, beaucoup plus affectées par l’inondation jusqu’à disparaîtrecomplètement. Elles n’ont pas la logistique, l’ingénierie interne, elles sont malinformées. On a vraiment choisi des petites entreprises avec quelques exceptionsqui correspondaient à notre panel de représentativité. On a essayé d’impliquer lesacteurs dans le sens où on les a tous consultés pour savoir ce qu’ils faisaient,quelle était leur sensibilité, sachant que ce sont aussi des acteurs qui sont les plusappropriés pour aller dans les Chambres de commerce. Ces dernières sont encontact quotidien et constituent finalement l’accès le plus direct, le plus rapide;composées d'élus, elles ont la confiance des entreprises.Le travail effectué en 2001 a été la bibliographie, l’établissement des entretiens etles résultats. On est allé en Seine Maritime, dans le Val de Marne. En SeineMaritime, on avait ces problèmes de ruissellement rural mais aussi urbain,également le problème d’inondation de petits cours d’eau. Le Val de Marne était uncontexte différent avec de gros enjeux : grosses inondations peu fréquentes - ladernière étant relativement ancienne -, beaucoup de communication de la part desinstitutionnels avec un PPR établi précurseur. En Basse Normandie, où nousavons réalisé un PPR, s’est produit en 2001 au moment où on y travaillait, un grosorage avec du ruissellement urbain et il y a eu quelques dégâts.On a analysé près de 130 entreprises. On a vraiment essayé de toucher quelquechose de varié et représentatif en termes de contexte et d’entreprises. Uneentreprise sur trois contactée par téléphone acceptait de parler de ce sujet. Deuxsur trois n’avaient pas de motivation. Les contextes sont ruraux-urbains avec desinondations récentes, notamment dans le Calvados.Quelques résultats de la phase 1. Dans le Calvados, dans cette zone inondable, ily a un peu plus d’une entreprise sur deux qui en était informée. Dans le Val deMarne et la Seine Maritime, c’est moins de la moitié. On a traité également desdimensions socio-économiques, de la disposition à payer. On abordait le sujet parle biais de la taxe professionnelle qui sert à payer des aménagements d’ampleurmunicipale. Elle est relativement faible. Elle est croissante avec le fait que l’on aété exposé ou non à l'aléa, mais elle est aussi corrélée à l’information; dans le Valde Marne où les entreprises n’ont pas encore été touchées mais où il y a eu degrosses campagnes, très médiatisées, les entrepreneurs sont plus sensibilisés surle problème et plus ouverts pour l’aborder avec nous. Il y a un refus de payer destravaux pharaoniques dont l’intérêt immédiat ne serait pas perçu. Lesentrepreneurs sont prêts à financer des travaux qui paraissent réalistes, maisfinancer contre l’aléa centennal, ils savent bien qu’il n’y a rien à faire. Ils sont prêtsà la réalisation de travaux à visibilité locale et régionale, travaux dans l’entrepriseégalement, mais moins à la réalisation de travaux dont la fréquence est trop faible,pour lesquels ils se disent que l’investissement n’en vaut pas la chandelle.Le rôle des autorités est bien considéré, bien assimilé.Quelles sont les initiatives que les entrepreneurs sont prêts à prendre ? Ce sontdes initiatives essentiellement en interne. Les sommes que les entrepreneurs sontprêts à investir sont ridicules, probablement par méconnaissance de ce que peut126
coûter un audit ou une intervention. Il y a vraiment un manque d’information à ceniveau.Cette étude s’est donc traduite par un guide sous forme papier et également surInternet. Le papier est un média que les entrepreneurs pratiquent. On l'a mis endiffusion auprès des CCI avec un certain succès. Il est assez didactique, avec desfiches thématiques. On a essayé de traiter l’ensemble des problématiques et dessujets qui permettent d’appréhender les problèmes de vulnérabilité d’uneentreprise. C’est un rappel, mais ce n’est pas un outil de diagnostic.Il y a une méconnaissance des entrepreneurs sur l’impact que peuvent avoir lescrues sur leur activité. L’information publique préventive arrive peu ou pasjusqu’aux entrepreneurs. L’entrepreneur fait aussi beaucoup confiance à laproximité, le voisinage, l’entraide, les CCI. On a choisi de faire diffuser notre guidepar les CCI. L’absence d’obligation réglementaire fait que peu de gensdéclenchent spontanément un audit de vulnérabilité sauf si on a été touché ou sion a conscience d’être en réel danger de mort sur l’entreprise. Il y a très peu demoyens humains et financiers pour traiter ces problèmes dans les entreprises. Ilfaut les aider. Quinze mois après la fin du projet, le guide à bien fonctionné, il estbien diffusé. Je vais régulièrement faire des conférences en soutien de quelqueschambres de commerce pour expliquer la démarche du guide. C’est cette actionde proximité par les chambres consulaires, les Chambres de commerce et desmétiers qui va permettre une meilleure diffusion de l’information.On a travaillé à faire du diagnostic et de l’audit, préconisé des mesures de gestionde crise ou de réduction de la vulnérabilité mais c’est souvent dans les plusgrandes entreprises. Il reste peu de moyens et peu d’actions au niveau des PME.Elles ont besoin d’être aidées. Il y a donc cette nécessité de financement ou de cofinancementmais aussi de regroupement par bassin de risque probablement parcequ’individuellement elles ne peuvent pas le traiter, elles n’en ont pas les moyens. Ilfaut donc mutualiser les besoins et les moyens. Les CCI sont le porte-avions de cegenre de chose car elles vont les rassembler, monter les dossiers et les aider àlancer une procédure, sachant qu’il y a toujours des coûts incompressibles;notamment on s’aperçoit qu’au plan local, même s’il existe un PPR, on a souvent àrevoir la notion d’aléa, par exemple les hauteurs de submersion, qui sontfondamentales pour le niveau de dommages. C’est clair que pour une PME seule,on ne va pas refaire des études lourdes : manque de compétence en interne, etdonc besoin d’être aidée à la fois sur l’aspect méthodologique et l’aspectéconomique. On s’aperçoit aussi que des choses qui ont été faites par desentreprises non spécialisées dans le domaine des inondations sont à revoir. Il yaussi le fait que, de plus en plus, il va avoir obligation pour les entreprises deprévoir un plan de gestion de crise qui va être conditionné par la vulnérabilité.L’effet saisonnier est également à souligner. Cet hiver, il y a eu très peud’inondations majeures, et on a été très peu sollicité sur le sujet.127
Claire Arnal, BRGMAu delà de l’appui donné par les CCI, avez-vous examiné le contact à travers lesassureurs ? En effet, on peut penser à priori que le vecteur des assureurs devraitles aider à faire ce type de diagnostic.Richard Guillande, Geoscience ConsultantLe constat présenté date de fin 2003. Une évolution a pu se produire. Mais, fin2003, l’assureur est considéré comme devant être cantonné à un bonremboursement dans les temps. On ne lui demande pas plus. Cela relèveégalement du parapluie CAT NAT . Les entreprises connaissent le système. Ilsveulent qu’il fonctionne bien et vite. CAT NAT : dispositif réglementaire d'indemnisation des dégâts matériels provoqués par descatastrophes naturelles.128
Quelques éléments d’analyse sur les comportementsdes propriétaires forestiers face aux risques naturels encouruspar la forêtStéphane CoutureLaboratoire d’Economie ForestièreUMR ENGREF/INRA14 rue Girardet, CS 4216, 54 042 Nancy cedexTél : 03 83 39 68 60, Fax : 03 83 37 06 45couture@nancy-engref.inra.frNotre présentation expose les résultats d’un projet de recherche qui a été élaborépar le Laboratoire d’Economie Forestière (Anne Stenger, Dominique Normandin(†), Jean-Luc Peyron, Stéphane Couture) et qui a été réalisé en partenariat avecquatre équipes, principalement des économistes : Francis de Morogues(Laboratoire Economie et Compétitivité – LEC / AFOCEL), Olivier Picard (Antennede Toulouse de l’Institut pour le Développement Forestier - IDF), Christian Gollier(Laboratoire d’Economie des Ressources NAturelles - LERNA) et MaxBruciamacchie (Laboratoire d’Etude des Ressources FOrêt-Bois - LERFOB).On se place dans un cadre bien précis, à savoir l’analyse des comportements despropriétaires forestiers face à un risque naturel.Quels sont les risques naturels les plus dévastateurs pour la forêt ? Les risques detempête et d’incendie. Les derniers événements ont marqué tant les propriétairesque le grand public, notamment les tempêtes de 1999, la sécheresse et la caniculede l’été 2003, les incendies de 2004. Lorsqu’un type de risque se réalise, desassurances permettent de se couvrir. Ainsi, un propriétaire forestier, s’il a souscritune assurance recevra une indemnisation lorsqu’il y a un risque d’incendie ou unrisque de tempête. Dans une telle situation, on ne peut pas relever du régime decatastrophe naturelle ni de celui des calamités agricoles. C’est une caractéristiquede ce type de risques.On observe que très peu de propriétaires forestiers s’assurent. C’est environ 7%de la forêt privée française qui est couverte par un tel système d’assurance.Parallèlement, suite aux tempêtes, un bilan contradictoire peut être dressé.Certains propriétaires forestiers affirment qu’ils sont prêts à s’assurer contre cesévénements mais en pratique, on observe que les tempêtes n’ont rien changé àleur comportement.Il y a eu aussi un problème d’offre au niveau des compagnies d’assurance. Suiteaux tempêtes qui ont été une catastrophe financière pour les assureurs, certainescompagnies ont complètement arrêté d’assurer ce type de risque. Celles qui ontchoisi de rester ont revu leurs contrats en augmentant de façon importante lesprimes. L'offre a donc été réduite. A l’heure actuelle, l'offre d’assurance est trèslimitée et ne vise pas à s’étendre. Ce contexte incite les propriétaires forestiers àchercher d’autres mesures pour se couvrir contre ce type de risques.129
Parallèlement d’autres mesures ont été prises, collectives ou individuelles. L’Étatest intervenu pour couvrir ce type de risque de deux façons. Premièrement, destextes législatifs ont été proposés, par exemple la loi d’orientation forestière avec leplan de prévention sur les risques d’incendie. Deuxièmement, lors de la tempête,l’État est intervenu de façon indirecte pour essayer de couvrir les dommages : leplan Chablis a aidé les propriétaires fonciers à rétablir leur peuplement.Au niveau des propriétaires, quelles sont les mesures individuelles observées ? Lefait de l'offre limitée d’assurances souscrites contre ce risque pourrait tendre à ceque les propriétaires forestiers cherchent à réaliser des actions pour se couvrir.Mais, dans la réalité, ce type d’actions n’est pas observé. Peut-être est-ce lié aufait que les propriétaires forestiers savent que si un tel risque se produit, l’Étatintervient, ce qui peut biaiser leur prise de décision en matière de couverturecontre ces risques.Ainsi, le contexte est particulier. La remise en cause du système d’assuranceexistant en foresterie est clairement posée, notamment parce que les outilsexistants ne sont pas appropriés à la problématique de la couverture des risquesnaturels dans ce domaine.Avant de s’intéresser à l'aspect «comment déterminer les risques économiquesincitatifs visant à intégrer ces risques», il faut comprendre comment un propriétaireforestier, par sa gestion, par ses décisions, intègre ce type de risque. Tel estl’objectif de cette recherche. Nous avons cherché à répondre à ces questions :- comment obtenir une représentation statistique des risques naturels, enconsidérant que leur représentation est assez fiable ?- comment ces risques naturels influencent-ils la gestion forestière, c’est-à-direcomment les propriétaires forestiers intègrent-ils ces risques dans leur décisionet quelles sont les incidences en termes de gestion sylvicole ? Les actionsvisant à se couvrir et à se prémunir contre de tels risques les intéressent-ils ?Deux objectifs ont été définis : le premier s’intéresse à la production forestière -voircomment les risques naturels ont des incidences sur cette production - et l’autreaspect est de voir comment les propriétaires visent à se couvrir contre ce type derisques. En fonction de ces deux objectifs, nous avons adopté différentesapproches, sachant qu'à l’heure actuelle, très peu de données existent surl’observation des comportements des propriétaires forestiers face à un type derisque, notamment du fait de l’horizon temporel. En foresterie, la vision est à longterme. Les données manquent pour arriver à faire des calculs économétriques, desstatistiques, qui nous permettraient d’avoir une observation réelle descomportements. Pour cette raison, des approches indirectes ont été adoptées.En matière de gestion de la production en situation risquée, deux approches ontété privilégiées. Une première est plus analytique et explicative de la prise dedécision des propriétaires face à ce type de risque pour obtenir des informations.Quelles sont les incidences des risques naturels ? Quels sont leurscomportements ? Généralement, l’intégration des risques vise à diminuer l’âge decoupe. Une deuxième approche plus théorique se fonde sur la pratique. Elle utiliseune information pratique observée sur les comportements des propriétaires, parce130
qu'il est important d’essayer de fournir des outils de gestion, de décision, auxpropriétaires forestiers.Pour analyser le comportement des propriétaires en termes de couverture et deprévention, des approches indirectes par des enquêtes de terrain pour mesurer lademande d’assurance des propriétaires forestiers, leur comportement face àdifférentes situations de risque ont été réalisées. Des modèles d’économieexpérimentale ont ensuite été produits. Ils ont été complétés par desexpérimentations : des propriétaires forestiers ont été réunis dans une salle et ilsont été placés dans un certain contexte pour voir comment ils réagissaient face àdifférentes situations. Des modèles nous permettant d’affiner l’analyse obtenuelors des phases expérimentales ont été conçus. Les acteurs sont les propriétairesforestiers privés, les assureurs et l’État.Pour obtenir l’appropriation des outils existant à l’heure actuelle, il faut cibler surchacun des acteurs. Au niveau des propriétaires forestiers, il faut les inciter àaccroître leur demande d’assurance, donc définir tous les instrumentséconomiques visant à augmenter cette demande d’assurance. Il faut égalementessayer de leur fournir des outils de gestion pour leur faire prendre conscience quece type de risque doit être intégré dans leur gestion forestière.Concernant les assureurs, une enquête a également été réalisée. La plus grossedifficulté au niveau des assureurs, pour mettre en place leurs contrats, réside dansla quantification statistique du risque. Cette incertitude justifie le fait que peu decompagnies cherchent à proposer des contrats contre les risques tempête etincendie. Des informations dans ce domaine doivent être apportées. Par ailleurs,actuellement, il n’existe que deux compagnies d’assurance qui présentent uneoffre. Il est nécessaire de prendre des mesures pour que d’autres compagniesrentrent sur le marché et pour inciter à une diversification des risques entresociétés d’assurance. Il faut également leur imposer des contraintes de liquidité;lorsque la tempête est arrivée, les compagnies d’assurance ont en effet du faireface à un problème de fonds conséquent. Au niveau de l’État, définir précisémentson rôle et son intervention reste essentiel, bien que du fait du systèmed’assurance existant, l’État ne devrait pas intervenir pour couvrir ce type derisques. Les moyens d'action au niveau de la couverture en cas de dommages lorsde l’occurrence d’un risque, des actions des propriétaires forestiers et des activitésdes compagnies d’assurance sont également à déterminer.Les freins à cette étude sont la quantification du risque qui reste insuffisante et quine permet pas de valider les résultats obtenus et les observations sur lecomportement des propriétaires forestiers pour affiner les résultats.Daniel Terrasson, CemagrefIl faut comprendre les relations entre les propriétaires et leur forêt. Lapréoccupation économique des propriétaires forestiers est loin derrière d'autrescritères.131
Stéphane Couture, LEFLa cible visée était les propriétaires forestiers privés. D'autres aspects quel'économie ont aussi été traités.132
A trop bien défendre les maisons, on peut accroître le risqued’incendieClaude NapoleoneCemagrefBP 31, 13612 Aix en Provence Cedex 1Tél : 04 42 66 99 66Claude.napoleone@cemagref.frL’importance spatiale de l’urbanisme résidentiel de faible densité (Steinberg, 1991)dans les zones méditerranéennes où les incendies sont violents et fréquents, inviteà examiner si le risque d’incendie a une influence dans les choix individuels delocalisation résidentielle. Nous assistons en effet actuellement à deux phénomènesconcomitants :- les espaces forestiers des régions méditerranéennes connaissent unecroissance importante. La forêt méditerranéenne a augmenté en superficiede 11% en 10 ans, sans qu’une sylviculture y soit associée et garantisseun entretien minimal. A titre d’exemple 80% du département du Var estboisé.- l’étalement spatial de la ville observé depuis une trentaine d’année (Wiel,1999), favorise l’urbanisation de basse densité à la lisière ou à l'intérieurdes espaces forestiers ou de garrigues 11 . Les zones de basse densité (exzones NB des POS), sont très utilisées et représentent jusqu’au tiers de lasuperficie communale.Nous savons par ailleurs que le processus de mitage résidentiel favorise ledéveloppement d'incendies majeurs (Jappiot et al., 2001). Un paradoxe apparaîtalors : si nous faisons l’hypothèse d’une préférence commune pour un niveau derisque le plus bas possible, quel est le fonctionnement qui prévaut audéveloppement des zones de basse densité résidentielles les plus exposées ?Dans cette perspective, il y a lieu de nous interroger sur la nature du risque et sonincidence sur le comportement résidentiel des individus :- Si les individus peuvent probabiliser une perte de valeur ou d’utilité encas d’occurrence de l’aléa, une aversion au risque local pourra se formeret être répercutée dans les arbitrages de localisation (Capozza et Sick,1994).- S’il s’agit par contre d’un risque collectif dont les coûts ou les dommagesprévisibles sont répartis sur la collectivité, les individus n’ont pas lieud’intégrer le risque dans leur arbitrage résidentiel. Autant alors, lorsqu’onen a les moyens, se localiser dans les environnements les plusagréables… donc en forêt.11La cote méditerranéenne est marquée par une immigration importante de ménages ayant desrevenus médians et se positionnant plutôt sur le segment de l’immobilier de faible densité.133
Pour discuter de ce paradoxe, nous examinerons dans une première partie lanotion de risque localisé afin de déterminer la nature exacte du risque locald’incendie. Nous verrons notamment qu’il revêt un caractère collectif qui exonèreles individus de toute charge attachée à l’occurrence de l’aléa. Nous confronteronstoutefois, dans une seconde partie, l’hypothèse d’aversion au risque locald’incendie au marché immobilier. Nous verrons qu’aucune variation de valeur n’estassociée à la croissance théorique du risque local. Cela nous amènera à conclureen examinant l’endogénéité de la croissance du risque par rapport aux préférencesrésidentielles afin de nous interroger sur l’aléa moral et l’équité du financement dela prévention et de la lutte. Alors que les valeurs paysagères de la forêt sontcapitalisées dans les prix immobiliers (Tyrvainen, 1997; Morancho, 2003; Bolitzeret Netusil, 2000; Irwin et Bell, 2001; Geoghegan et al., 1997; Bell et Bockstael,1997), le coût inhérent à l’accroissement du risque représenté par l’habitation enforêt, est réparti sur la collectivité nationale.Le risque localisé d’incendieL'incendie de forêt est communément considéré comme un risque naturel et sonphénomène est décrit comme l'occurrence d'un événement (l'aléa), qui sedéveloppe dans un milieu particulier (les enjeux), sur lequel il provoque un certainnombre d'impacts (la vulnérabilité) (Jappiot et al., 2000). Dans le cas du risquelocal d’incendie de forêt, 96% des départs de feux recensés sont d’origineanthropique et localisés dans les zones d'habitat 12 . Plus qu’un risque strictementnaturel, l’incendie de forêt est un risque induit par l'anthropisation des milieuxnaturels dont un des ressorts est la préférence des individus pour lesenvironnements forestiers. Nous sommes dans un système où la localisationrésidentielle et la croissance du risque s'auto-alimentent en générant des coûtscollectifs de lutte et de prévention importants et croissants. Il y a donc uneambiguïté entre le caractère individuel de la genèse du risque et la naturecollective de la charge qu’il induit. Pour l’examiner, nous proposons de revenir à lanotion économique du risque.La notion de risque est proche de celle d’incertitude, à la différence près que lerisque est probabilisable. Il se traduit économiquement par une variation de lavaleur d’un actif ou de l’utilité individuelle, associée à l’occurrence d’un aléa. Dansl’hypothèse où les individus ont une information suffisante pour former leurspréférences, le risque correspond donc à la relation entre les facteurs d’incertitudeet les impacts (Kast et Lapied, 2002). Dans ce cadre, les individus attribuent uneplus ou moins grande valeur à la probabilité d’occurrence de l’aléa; exprimant parlà même une aversion au risque dans leurs décisions individuelles (Pratt, 1964). Ilapparaît ici assez clairement que l’existence ou l’expression d’une aversion aurisque est attachée à l’anticipation d’une perte de valeur ou d’utilité. C'est-à-direque la valeur des biens doit pouvoir être affectée par l’occurrence de l’aléa et queles coûts de réparation puissent être individualisés, au moins pour partie (parmécanisme d’assurance par exemple). A ce moment là, dès lors que la préférence1296% des causes connues de départs de feu sont issus des espaces urbanisés ou des réseauxd'échanges entre ces espaces, et près des 3/4 ont des causes involontaires dues à des imprudencesou à des accidents (sources : base de données Prométhée pour les Bouches-du-Rhône).134
individuelle concernant le risque est non nulle et partagée par un nombre importantd’individus, les prix de marché y sont sensibles. Or, un certain nombre d’élémentsplaident pour considérer que le risque local d’incendie n’est pas un risqueindividuel, mais un risque de nature collective :- de par son histoire. En zone méditerranéenne, les incendies sontrécurrents depuis des millénaires (Pons et al., 1984), détruisant les forêtspourvoyeuses d’énergie, de matériaux ou de pâtures nécessaires à lacollectivité dans son ensemble. Les sociétés méditerranéennes ont doncinscrit les dispositifs de lutte, ainsi qu’un imaginaire attaché à l’incendie,dans une dimension collective.- de par la structure de son financement. Actuellement, les budgets allouésà la prévention et à la lutte sont importants 13 et quasi exclusivementpublics et nationaux.- de par son mode de gestion. Les actions de prévention et de lutte sontgérées d’une manière administrée et centralisée au niveau de l’État. Seulle débroussaillage ressort d’une action individuelle, mais il estmédiocrement mis en œuvre.Dans cette perspective, nous pouvons supposer que la dimension collective durisque d’incendie est attachée à la notion de sécurité publique des personnes etdes biens, mais également à la valeur d’existence des forêts, eu égard à leur faiblevaleur marchande actuelle 14 . Apparaît alors un second paradoxe : lors d’unincendie, lorsqu’un arbitrage doit être fait entre la protection des forêts ou desbiens matériels (à fortiori des vies humaines), les services de lutte privilégient ladéfense des zones habitées. Il y a de fait une ambiguïté entre la dimensioncollective du risque local d’incendie et la nature individuelle des biens défendus(Winter et al., 2000). Ambiguïté remarquée dans d’autres situations nationalescomme par exemple aux États-Unis (Montgomery, 1996), mais qui interroge auregard de la relation d’endogénéité entre les préférences individuelles delocalisation résidentielle et les conséquences monétaires de l’occurrence d’unaléa.Evaluer le niveau de conscience individuelle du risque par l’analyse dumarché foncierLes individus qui résident en forêt ou à proximité immédiate, ont-ils conscience decette relation d’endogénéité de leur comportement avec le risque d’incendie ? Unedes façons pour évaluer le niveau de conscience individuelle du risque d’incendieest de décomposer les prix immobiliers. Par exemple, si on fait l’hypothèse d’uneaversion au risque, les individus tendent à reporter leur demande résidentielle surles localisations les moins exposées et un effet est mesurable sur les priximmobiliers. Une méthode existe depuis longtemps en économie pour décomposerles prix des biens : l’analyse hédonique. Elle permet de décomposer les biens en13Ils peuvent être estimés globalement à une charge annuelle de 30 millions d’euros pour les seulesactions de prévention et de 80 millions d’euros pour la lutte (sources : Ministère de l’agriculture).14Les données sur l’économie forestière sont relativement rares. Pour plus de détails, nous pouvonstoutefois nous reporter au tome 1 des orientations régionales forestières (DRAF PACA, 1999).135
un certain nombre de caractéristiques (Lancaster, 1966; Rosen, 1974). Elle reposesur un fonctionnement comparable au système des options en automobile : unevoiture achetée 15 000 euros n’est pas une voiture strictement identique à uneautre de même modèle, mais correspond peut être à un modèle de base à 14 000euros, plus une climatisation à 1 000 euros. Le bien acheté se décompose enl’occurrence en deux caractéristiques qui ont chacune leur valeur propre : lemodèle de base et la climatisation. Dans le cas du marché immobilier, il suffit deconsidérer qu’un individu qui achète une maison, acquiert en même temps lajouissance du paysage, l’accessibilité à son emploi… mais également une plus oumoins grande exposition au risque. Lorsque l’on dispose d’un nombre importantd’observations, on peut alors attribuer par une procédure statistique, une valeur àchacune des caractéristiques. Celles qui confèrent ou détruisent de la valeurcorrespondent à des préférences individuelles; celles qui n’ont pas de relationsstatistiquement significatives avec les prix ont de forte chance de ne pas rendrecompte d’éléments pris en compte par les individus.Le marché foncier face à l’incendie de forêtPour examiner la réaction du marché foncier face à l’incendie de forêt, nous avonsconstitué une base de données à partir de l'ensemble des informations disponiblesdans le département des Bouches-du-Rhône, dont le tableau suivant retrace lastructure principale (tableau 1). La liaison entre ces différents types de donnéesest assurée par un Système d'Information Géographique (SIG), qui permet enoutre de calculer un certain nombre de caractéristiques spatiales non disponiblespar ailleurs (par exemple la distance/temps entre une parcelle vendue et un pôled'activité).Tableau 1 : La base de données constituéeType de donnéesNature du renseignementDonnées quantifiées sur lemarché foncier et sonenvironnement- Ventes immobilières (urbain et rural)- Permis de construire- Comptages du trafic- Recensement Général de l'Agriculture- Recensement Général de la population (Bases Ilots te IRIS)- Fiscalité foncière et IRPPDonnées numériséesDonnées spatialesSections cadastrales du département des Bouches-du-Rhône- Géographie physique- Plans d'Occupation des Sols- Occupation du sol (géo-interprétation de données satellitaires)En faisant l’hypothèse que l’occurrence d’un incendie dans le passé apporte uneinformation suffisante sur le niveau de risque de la zone 15 , nous avons tout d’abord15Les statistiques des feux passés montrent sans ambiguïté que les incendies se développent dans deszones précises, souvent en contact avec les lieux les plus peuplés, qui ont connu jusqu’à quatreincendies dans les trente ans passés (source : base de données Prométhée).136
etenu un périmètre comptant sept communes et ayant connu un incendie majeuren 1997 16 , sur lesquelles 4 394 hectares ont été détruits. Nous y avons délimitédeux zones de référence :-la zone que nous avons appelée à risque, c’est-à-dire la zone de parcours du feu,ainsi qu'une bande de 100m directement contiguë au périmètre brûlé, afin de tenircompte des approximations dans le report cartographique,-le reste des territoires des sept communes (ou de l'arrondissement pourMarseille), où nous jugeons que la menace ne fut pas directe.Sur chacune des deux zones, nous avons observé le marché des maisonsindividuelles et des terrains constructibles (760 observations dans la zone à risqueet 4 439 observations dans le reste des sept communes). Les appartements ontété éliminés afin de ne pas estimer l'effet du risque d'incendie de forêt sur unsegment de marché non directement concerné par le risque d’incendie. Les terresagricoles ont également été éliminées afin d’accroître la probabilité de prise encompte du risque local d’incendie par les acquéreurs immobiliers. En considérantque le marché des terrains et des maisons individuelles est homogène entre lesdeux zones, une préférence pour les localisations les moins risquées devrait doncthéoriquement être perceptible sur les valeurs moyennes des biens vendus;particulièrement après 1997. Or, l'examen des valeurs moyennes des bienséchangés sur la zone à risque par rapport au reste de la commune, semble nerévéler aucune différence (figure 1).En revanche, le volume des transactions sur le marché local semble avoir étéinfluencé par l'occurrence de l'incendie. La tendance, pour le reste des septcommunes, comme pour la zone à risque, est croissante jusqu'en 1996. A partir de1997, une inversion de tendance est observable pour la seule zone brûlée alorsque le marché global continue à croître en volume (figure 2).Figure 1 : Montant moyen des ventes de maisons et terrains constructibles,selon localisation du bien(prix déflatés par l'indice de la construction, base 100 : 1989)900 000Francs8000007000006000005000004000003000002000001000001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999zone à risqueZone non m enacée16Marseille, Allauch, Mimet, Septèmes, Simiane-Collongue, Plan de Cuques et le Rove137
Figure 2 : Taille du marché des maisons et terrains constructibles, selon lalocalisation du bienM illie rs d efrancs90080070060050040030020010001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999nom bre de ventes dans la zone m enacée nom bre de ventes sur les com m unesEn gardant à l'esprit que le nombre d'observations n'est pas très élevé et renddélicat toute généralisation, il est possible que nous soyons en présence d’unmarché où d’un côté le risque d’incendie paraît assez neutre par rapport au prix, etd’un autre côté, les propriétaires opèreraient une rétention foncière pendant letemps du reverdissement de la zone.La demande immobilière individuelle face à l’incendie de forêtPour confronter les préférences individuelles concernant le risque d’incendie aumarché immobilier, c'est-à-dire pour évaluer l'effet de l'aversion au risque locald'incendie sur les prix, nous avons recensé les communes ayant connu des grandsincendies entre 1989-1999 17 ; soit onze communes 18 et 8 234 parcelles vendues.Sur ces onze communes, nous avons reporté les limites des incendies qui s’y sontdéroulés, afin de créer une première variable, appelée "sfeu1", selon que la venteconcerne un bien situé à l’intérieur d’un périmètre brûlé ou sur le reste desterritoires communaux. Il est à noter que la variable sfeu1 n’est pas datée, c’est-àdirequ’il n’y a pas d’indication certaine de l'occurrence de l'aléa avant l'acquisition.Il s’agit simplement de rendre compte d’une localisation à risque, en sachant queles incendies sont récurrents sur les mêmes zones. La variable sfeu1 estdichotomique et prend la valeur (1) si la section se situe à l'intérieur ou à moins de100 mètres du périmètre des feux et (0) si elle se situe au-delà. Nous avons alorsestimé un modèle économétrique standard :P 1 X Y Z Sfeu1ki1C ( 1 )17Sources : agence MTDA.18Allauch, Marseille (3 arrondissements : les 9 eme , 13 eme et 14 eme ), Plan de Cuques, Le Rove, Simiane-Collongue, Septemes pour l'incendie dit «de Marseille» de 1997 ; Carry pour l'incendie dit de «la côtebleue» de 97 ; Lambesc, Lançon, Pelissane et Salon pour l'incendie dit "des collines de Lançon" de1995. (sources : base Promethee).138
Où X rend compte des caractères physiques décrivant les biens fonciers(logtersurf : surface du terrain; loghabsurf : surface habitable), Y rend compte deséléments d'ambiance susceptibles de conférer de la valeur aux biens immobiliers(scompodiscont : habitat diffus; porient : exposition par rapport à l'ensoleillement),Z étant des éléments de classes tels que l'année de mutation, l'imposition, âge dubien, etc.), et C une variable muette pour les k communes du département, afin decontrôler les autres effets spatialisés sans avoir à les détailler. La variable Sfeu1fait partie des variables explicatives et la variable expliquée a subi unetransformation Box-Cox.Nous constatons tout d'abord que la variable sfeu1 n'est jamais significative à 5%.Que ce soit par rapport aux ventes qui se sont réalisées sur l'ensemble dudépartement (tableau 2) ou sur les 11 communes où un feu majeur s'est développépendant notre période d'observation (tableau 3).Tableau 2 : Résultats de la régression des prix immobiliers des Bouches-du-Rhône en prenant en compte la situation du bien par rapport au risque local.R2 Adj R2 Lambda F Value Liberal p0.5588 0.5544 0.3000 126.76 >= = = = = = = 0.0733 Localisation à risqueVariables de classe1992 -33 738.43 10.34 >= 0.0013 Année de la vente : 19921998 40 613.48 16.83 >= =
DEPENDO 69 683.35 157.88 >= = = 0.0040époque de la construction(1981/1991)époque de la construction(1790/1850)dicnbsdbzero -30 194.44 34.75 >= = = = = 0.1566MUTPTYPR -169 627.57 0.92 >= 0.3363LIBROCCO -42 861.06 16.24 >= = 0.0796 LibreVIAGO -152 549.93 65.11 >= = = = = = = = = 0.9290 Eloignement au Sud (en °)Sfeu1 -13 383.94 0.46 >= 0.4972 Localisation à risqueVariables de classe1992 -92 140.34 13.24 >= 0.0003 Année de la vente : 1992…/… …/… …/… …/… …/…1998 84 767.96 15.45 >= =
Com13107 70 479.80 5.74 >= 0.0167 N° INSEE de SimianeCODETVAH -27 162.12 0.38 >= 0.5388 CODE TVA H…/… …/… …/… …/… …/…CODETVAF -62 356.97 0.05 >= 0.8168 CODE TVA FUSAGEMI -13 393.01 0.08 >= 0.7838 Usage mixte professionnel/personnelUSAGEPR 517 187.30 26.04 >= = 0.0420 mutation onéreuseMOINS5ANSO -17 137.56 0.14 >= 0.7123 MOINS 5 ANS OuiDEPENDO 80 597.04 29.06 >= = 0.0243 époque de la construction (1992/1999)EPOQUEA -77 610.78 3.84 >= 0.0501 époque de la construction (1790/1850)MUTPTYPE -65 844.55 0.49 >= 0.4851 type de mutation précédente : échangeMUTPTYPD -64 076.13 2.01 >= 0.1566 type de mutation précédente : donationLIBROCCO -35 877.49 1.24 >= 0.2661 occupéLIBROCCP -74 933.29 1.49 >= 0.2231 libreVIAGO -174 080.54 7.36 >= 0.0067 viager OuiMAITYPmi -41 763.04 7.89 >= 0.0050 type de maison : maison individuelleMAITYPMV -53 671.87 4.51 >= 0.0337 type de maison : maison de villagePour isoler plus précisément l'effet d'un incendie sur le prix, il est possible deprendre en compte la date de la mutation par rapport à la date d’occurrence desincendies. La variable sfeu ainsi construite prend la valeur (1) si la vente se situe àl'intérieur de la zone à risque et a été conclue après le passage du feu. Sinon, elleprend la valeur (0). Nous pouvons donc supposer que quel que soit le niveau deconscience à priori du risque d'incendie par l'acheteur, l'information lui estdisponible, ne serait ce que par l'observation des traces physiques du feu surl'environnement. Or, que ce soit sur le département (tableau 4) ou sur 11communes ayant connu des incendies majeurs (tableau 5), il n'y a pas de validitésstatistiques avérées pour la variable sfeu. Le signe du coefficient est d’ailleurscontraire de celui des deux tableaux précédents.Tableau 4 : Résultats de la régression des prix immobiliers du départementdes Bouches-du-Rhône, en prenant en compte la situation du bien parrapport au risque local et la date de venteR2 Adj R2 Lambda F Value Liberal p0.5587 0.5544 0.3000 128.27 >= =
Logtersurf 78 060.16 2 722.30 >= = = = = 0.8614 Vente ayant eu lieu après l’incendieVariables de classe1992 -33 663.40 10.30 >= 0.0013 Année de la vente : 19921998 40 556.58 16.76 >= =
Tableau 5 : Résultats de la régression des prix immobiliers sur les 11communes ayant connu l'incendie, en prenant en compte la situation du bienpar rapport au risque local et la date de venteR2 Adj R2 Lambda F Value Liberal p0.5043 0.4926 0.4100 43.16 >= = = = = = 0.9430 Eloignement au Sud (en °)sfeu 27 174.51 0.40 >= 0.5281 Vente ayant eu lieu après l’incendieVariables de classe1992 -90291.88 12.65 >= 0.0004 Année de la vente : 19921998 85 493.59 15.73 >= =
Lutte contre l'incendie et aléa moralEn ayant vérifié l’absence de biais de répartition des individus sur le département(Napoléone et al., 2002), nous proposons de conclure, au sens de Pratt (1964),qu’il n’y a pas d’aversion au risque local d’incendie de forêt chez les propriétairesimmobiliers, puisque l’occurrence de l’aléa a une forte probabilité de ne pasaffecter les valeurs des biens les plus exposés (Winter et al., 2000). Plusexactement, en reprenant l’argument d’Arrow et Lind (1970), du fait que le risqueest distribué sur un grand nombre d’individus (en l’occurrence la collectiviténationale) et du fait que les dommages matériels potentiels sont faibles 19 , nouspouvons faire l’hypothèse que l’utilité espérée d’une acquisition immobilière neprend pas en compte le risque. Tout se passe comme s’il y avait un taux decouverture du risque proche de 100%. Les mécanismes compensateurs échouentdonc et il n’y a pas de raison pour que le marché répercute un risque dontl’occurrence ne génère pas de conséquences individuelles. Nous avons vu parailleurs que le niveau de risque local est mécaniquement lié à la nature et lalocalisation de l'habitat. D'une part les départs de feux sont très majoritairementlocalisés dans les zones habitées et l’implantation d’une résidence nouvelle accroîtla probabilité d’occurrence du risque. D'autre part, les valeurs susceptibles d'êtreaffectées par un incendie sont quasi exclusivement celles des constructions et desbiens qui leur sont attachés. Il n’y a donc pas indépendance entre l’urbanisme et lerisque local d’incendie. Enfin, nous savons que les localisations en habitat diffussont celles qui capitalisent le mieux la valeur des aménités paysagères.Les mécanismes de marché n'œuvrent donc pas dans le sens d'une régulation del'urbanisation en fonction du risque. Bien au contraire, l'existence d'une lutteefficace contre l'incendie correspond à une incitation à se localiser dans lesenvironnements les plus risqués : cela permet de capitaliser les aménitéspaysagères généralement attachées aux environnements naturels, tout enexternalisant les coûts de la prévention et de la lutte. Dans cette perspective, il estlégitime de nous interroger en termes d'équité de la gestion des budgets publics. Ilva de soi que dans la société où nous vivons, il n’est pas imaginable de laisser unincendie se développer. Ce n’est d’ailleurs pas le propos. Ce que nous voulonsproposer à la réflexion est que le fonctionnement normal des individus les pousseà se prémunir d’un risque qu’ils ressentent, quel qu’il soit. Lorsqu’ils ne se pensentpas soumis à un risque, il n’y a aucune raison pour qu’ils adoptent uncomportement de prévention. La totale collectivisation du coût de la lutte contrel'incendie revient donc à une incitation à se localiser dans les environnements lesplus risqués : les économistes parlent en la matière d’aléa moral, c'est-à-dire d’unecroissance d’un risque spécifiquement due à l’absence de conscience individuellede ce risque (Arnott et al., 1988; Henriet et al., 1991; Stewart, 1994). La solutionhabituellement proposée est d’individualiser une partie supportable localement ouindividuellement des coûts de la lutte, en complément des politiques zonales19Une interrogation directe de 10 sociétés d'assurances a montré que la destruction totale d'unehabitation par l'incendie n'y a jamais été enregistrée. Le niveau des remboursements inhérent à lacouverture du risque d'incendie de forêt est si bas qu'aucune statistique spécifique n'est réalisée; lesremboursements concernant les incendies de forêt sont confondus avec les autres incendies (devéhicule, domestiques, etc.) (Napoléone et al., 2002).144
d’urbanisme dont les limites doivent être stables sur un terme assez long. Celapeut passer par l’implication des communes, par des mécanismes d’assurancesindividuelles, par une «TDENS 20 Risque», par une amélioration des modes dedébroussaillage, etc. Cela reste à étudier, mais l’individualisation peut inciter àprendre le risque en compte dans son comportement résidentiel et donc réduirel’aléa moral (Fagart et al., 2004). Elle est en outre susceptible de générer uneinformation sur les valeurs des dommages individuels prévisibles et d’accroître parlà même l’efficacité des mécanismes d’assurance (Bouglet, 2002). Toutefois,l’individualisation des coûts de la lutte ne peut être que partielle. Le retrait del’action publique du champ de la lutte serait en effet injuste car seuls les plusriches pourraient se protéger. Le problème en l’occurrence est donc de calibrerl’action publique entre la nécessaire protection collective contre le risque etl’individualisation d’une partie de ses conséquences afin de favoriser uncomportement de prévention. La réponse n’est pas univoque et peut avoir desconséquences sociales ou politiques qui la complexifient encore.François Barthélémy, CG MinesPour les assureurs, les incendies de forêt de 2003 sont une bénédiction. Ils n'ontpas de problème. Par rapport au débroussaillage, les assureurs ne sont pasintéressés.Bernard Barraqué, LATTSConcernant le coût de transaction, peut-on résoudre les problèmes par laresponsabilisation des gens ?Claude Napoleone, CemagrefLe débat est large. Mettre en œuvre les préconisations a un coût. Ce n'est pas unemesure unique. Il n'est pas intéressant d'aller dans le sens de l'individualisation.Dans le processus spéculatif, le phénomène s'autoalimente avec lesprofessionnels du bâtiment qui cherchent à miter les forêts, ce qui entraîne unconflit d'intérêts. L'intérêt de ce processus est pervers au niveau financier. Est-ceque la collectivité ne peut pas garder une partie des rentes pour rentabiliser lescoûts induits ?Nicolas Camp'huis, Agence Loire-BretagneLe problème d'aménagement du territoire n'apparaît pas dans ce raisonnement.Claude Napoleone, CemagrefLa question de l'aménagement n'est pas traitée. Il existe un choix. Les élus et lesadministrations le réalisent avec des contraintes mais il est possible d'introduire lesquestions du risque; par exemple en Provence, un choix est à faire entre laminoration ou la majoration du risque et entre le risque et la rentabilité.20Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles.145
Le risque d’inondation et la cartographie réglementaire.Analyse de l’efficacité, des impacts et de l’appropriation localede la politique de préventionGilles HubertAnciennement : ENPC, Centre d’enseignement et de recherche Eau, Ville etEnvironnement6 et 8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs-sur-Marne77455 Marne la Vallée cedexActuellement : Laboratoire Mobilités, Réseaux, Territoires et EnvironnementUniversité de Cergy-Pontoise, 33 boulevard du port, 95011 Cergy-Pontoise cedexTél : 01 34 25 64 04, Fax : 01 34 25 64 48gilles.hubert@lsh.u-cergy.frBernadette de VanssayUniversité René DescartesLaboratoire de Psychologie Environnementale UMR 806971, avenue Edouard Vaillant, 92774 Boulogne cedexTél : 01 55 20 57 08, Fax : 01 55 20 57 40bdevanssay@psycho.univ-paris5.frCette recherche analyse la mise en œuvre de la politique de prévention desrisques d’inondation en s’appuyant plus particulièrement sur la cartographieréglementaire, destinée à maîtriser l’occupation des sols en zone inondable et àréduire la vulnérabilité des espaces sensibles. Elle comporte deux volets. Lepremier constitue une analyse à la fois sociale et politique du risque et de laréglementation. Le second correspond à une évaluation des effets du risque et dela réglementation sur le marché foncier en zone inondable (transactions et prix).Pour cette communication, nous traiterons uniquement du premier volet de larecherche car il associe les deux équipes (CEREVE et LPS), développe uneméthodologie originale et apporte des résultats significatifs. L’analyse du marchéfoncier reste une approche exploratoire dont l’intérêt pour la table ronde«appropriation des outils de la gestion du risque» est plus limité.Objectifs, méthodes et terrains de l’analyse «socio-politique»L’analyse «socio-politique» du risque et de la réglementation a été menéeconjointement par des chercheurs du CEREVE et de LPE à partir d’études de cas :différents sites soumis régulièrement à des inondations (rapides ou lentes selonles cas) et faisant l’objet d’une réglementation (dans la plupart des cas approuvéedepuis plus de cinq ans et parfois prescrite mais non encore aboutie au momentde la recherche).Sur chaque terrain d'analyse, des entretiens ont été réalisés auprès des acteursinstitutionnels (élus et techniciens des collectivités, agents des services147
instructeurs) afin d’appréhender leur perception des risques sur le territoire, leurpoint de vue sur la réglementation en vigueur (intérêts et limites, contraintes demise en place, efficacité perçue, difficultés d’application,…), leur regard sur leschangements liés à l’évolution des outils réglementaires (apports des PPR parrapport aux PER), leur implication dans la mise en œuvre d’une politique locale degestion des risques (information, prévention, protection, alerte, secours,…).Par ailleurs, des informations ont été recueillies, via une enquête par questionnaire(qualifiée d’analyse quantitative) et des entretiens semi-directifs (on parle alorsd’analyse qualitative), auprès des occupants des zones inondables et des acteursde la société civile pour connaître leur représentation du risque, leur niveau deconnaissance des risques auxquels ils sont potentiellement exposés et de laréglementation en place sur la commune habitée, les sources d’information à partirdesquelles ils se forgent une opinion (sur le risque et sur la réglementation), leurexpérience des inondations et leur attitude face aux événements vécus, lesmesures individuelles prises pour réduire leur vulnérabilité.Précisons que l’enquête par questionnaire a permis la constitution d’une base dedonnées de 950 ménages dont les réponses ont fait l’objet de traitementsstatistiques 21 . Soulignons également que les terrains de l’analyse quantitative (4communes des Pyrénées Orientales : Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Vernetles-Bainset Banyuls-sur-Mer) sont différents de ceux de l’analyse qualitative(Poitiers et Jaunay-Clan, Montmorillon, Saint-Michel-sur-Orge et Savigny-sur-Orge). Ce choix méthodologique a été fait dans le but d’avoir une plus grandediversité de situations à analyser et ainsi mieux mettre en évidence d’éventuelspoints communs, mais aussi souligner l’influence des facteurs contextuels sur lesdifférences observées.Les principaux résultats de ce volet de recherche sont présentés en considéranttout d’abord les autorités publiques locales puis les populations vivant en zonesinondables.Les autorités publiques face au risque et à la réglementationLes facteurs contextuels (géographie physique, nature et ampleur desphénomènes naturels, caractéristiques socio-économiques,…) et l’historique duPPR (les raisons de sa mise en œuvre, son processus d’élaboration,…)influencent notablement le regard que les acteurs publics ont sur une cartographieréglementaire dont la mise en place est souvent circonstancielle. Elle est dans biendes cas la conséquence d’un événement particulier, qui mobilise l’attention localesur le phénomène du risque et des inondations. Parfois le PPR inondation est lerésultat d’une initiative prise par le service instructeur à l’occasion d’un autre typed’événement (mouvement de terrain ou éboulement de falaise par exemple).21Les enquêtes ménages réalisées pour cette recherche (264 questionnaires exploités) sont venuesenrichir une base de données établie précédemment (par le CEREVE en 1997) selon le mêmeprotocole. Elles ont été conduites sur des sites de crues torrentielles, tandis que les premières avaientété réalisées sur des sites de plaine aux inondations lentes (Lagny-sur-Marne et Esbly; Villefranche-sur-Saône, Anse, Jassans-Riottier et Saint Bernard).148
Le temps écoulé entre prescription et approbation - bon révélateur de l’implicationdu maire dans la procédure et de sa volonté de la voir aboutir - est généralementlong (entre 4 et 8 ans). Dans quelques cas cependant, la réglementation est miseen place dans un temps «record» (entre 1 et 3 ans).Le positionnement des élus locaux vis-à-vis de la cartographie réglementaire estétroitement lié à leur perception du risque. Trois grands types de situations sontapparus : une appropriation locale de la réglementation qui conforte la politiquemunicipale en vigueur, une reconnaissance de l’utilité de la démarche mais desdemandes d’adaptations diverses, une opposition franche à la réglementation(conflit ouvert).Les maires rencontrés ont une représentation événementielle du risque (prise deconscience liée à des phénomènes survenus), mais aussi une connaissance finedes cours d’eau responsables des inondations comme des zones de débordement.Leur implication concrète dans la gestion du risque reste cependant très variabled’un site à l’autre (réalisation de mesures de protection rapprochée, d’opérationd’entretien du lit et des berges, mise en place d’un système d’alerte adapté auterritoire,…). Elle dépend non seulement de leur volonté politique mais aussi descaractéristiques institutionnelles locales. On constate en effet que si le maire gèrele risque en direct dans des communes rurales ou semi rurales, il n’est plusdirectement concerné dans les zones urbaines (communautés d’agglomération,communautés de communes), mais aussi dans les secteurs où existe un syndicatintercommunal d’aménagement de rivière.La protection des personnes et des biens est citée spontanément par tous lesmaires interrogés comme une de leur préoccupation essentielle. La réalisation detravaux de protection (soit par la commune elle-même, soit en partenariat avec lesservices de l’État, soit à titre intercommunal) est souvent considérée comme lameilleure solution. L’intérêt de la cartographie réglementaire est quant à luitoujours analysé en regard de l’organisation et de la gestion du territoire.Pour les élus locaux, ce type de document constitue en effet une contrainte fortesur l’occupation des sols. Nombre d’entre eux mettent en avant son impact sur lemarché foncier. Ils sont à la recherche de solutions pour que la réglementation nefreine pas le nécessaire développement de la commune. Certains mairesredoutent une perte de population (faute de terrains constructibles, la ville ne peutfaire face aux demandes). D’autres s’interrogent sur leur capacité financière (etcelle des administrés) à répondre aux surcoûts induits par les prescriptionsréglementaires (mesures de réduction de la vulnérabilité des biens immobiliers).Excepté quelques cas, le bien-fondé de la mise en place d’un PPR sur unecommune n’est pas contesté. Le caractère pérenne et officiel du document estmême régulièrement mis en exergue (pour mieux faire face aux demandesd’autorisation de construire en zone inondable). En revanche, la méthode defabrication et le contenu du document sont souvent critiqués. On soulignel’incohérence de certaines mesures, les anomalies ou erreurs constatées, lesdispositions jugées excessives et inapplicables… Les maires demandent auxservices instructeurs de tenir compte des spécificités locales et de chercher àcomprendre le terrain.149
On a pu constater que dans bien des cas, la commune obtient des«adoucissements» du règlement. Parfois même, le service instructeur lui proposede combiner le contrôle de l’occupation des sols à des mesures structurelles deprotection. L’articulation entre les modes d’action dépend en réalité de la nature del’aléa : face aux crues torrentielles, la réglementation à elle seule ne constitue pasune solution satisfaisante.Indépendamment de cet aspect, nous nous trouvons - au niveau des servicesinstructeurs - en présence de deux logiques administratives différentes : l’uneprivilégiant l’action réglementaire pour gérer le risque et l’autre préconisant lerecours à des mesures de protection. Ce positionnement renvoie à un désird’autodétermination face au ministère en charge de la prévention des risques (quiveut des résultats en termes de quantité de plans approuvés). Il montre ledécalage entre le niveau central et l’échelon local.Même si certains services prennent leur distance par rapport à la réglementation,ils considèrent néanmoins qu’il est de leur devoir d’élaborer ces documents. Enrevanche, ils prennent leurs distances pour les missions de contrôle et de suivi,qu’ils délégueraient volontiers aux assureurs. De leur point de vue, l’intérêt majeurde la cartographie réglementaire est de pouvoir stopper l’urbanisation future dansles zones à risques. Son principal défaut porte sur les difficultés d’application desprescriptions à l’urbanisation existante (d’où le souhait de déléguer le suivi de samise en œuvre).La faiblesse des moyens humains et financiers consacrés à la fabrication desdocuments réglementaires revient comme un leitmotiv pour l’ensemble des agentsrencontrés. Pour eux, cela se répercute sur la qualité des cartographies produites :les études sont insuffisamment poussées, les résultats sont imprécis et comportentde nombreuses incertitudes. Les documents sont discutables et les agents del’État ont de fait beaucoup de mal à construire un argumentaire pour défendre leprojet devant les élus. Face à cette situation, certains proposent de faire cofinancerles études nécessaires par les collectivités locales concernées, l’administrationassurant la réalisation des études de base et les communes complétant ledispositif pour avoir des résultats plus précis.Les services instructeurs réclament en outre une reconnaissance officielle de lanégociation pour favoriser l’acceptation de la cartographie par les élus locaux, touten déclarant être mal préparés à cette forme d’action. Aussi éprouvent-ils le besoinde se réfugier derrière une expertise solide. Au-delà, ils souhaitent être reconnusdans leur rôle de conseil, d’animation et d’information. Ils sont demandeurs d’uneaide au «management des procédures».En somme, les remarques exprimées par les acteurs des collectivités localescomme par ceux des services instructeurs montrent bien la difficulté de faireconverger les points de vue et d’établir un dialogue constructif dès l’élaboration dudocument réglementaire. Dans ce cadre très particulier, les positions de chacunsont prédéterminées et contraintes (le champ des possibles est réduit). En outre, leprocessus de décision - piloté par l’État et associant plus ou moins les élus locaux- met à l’écart les citoyens. Il entretient un climat de défiance, peu propice à unegestion efficace des risques.150
Les occupants des zones inondables, directement concernés par les phénomènesnaturels et par la réglementation, doivent pouvoir participer au débat. Mais pourque l’association des habitants à la démarche soit efficace et constructive, il estnécessaire de connaître leurs positionnements face aux situations de risque.Les populations face au risque et à la réglementationLes investigations menées auprès des populations exposées aux inondationsmettent en évidence un éventail de regards sur le risque et de comportements faceà des situations de crise. De multiples facteurs participent en outre à laconstruction d’une représentation du risque chez les personnes qui peuvent êtrepotentiellement touchées par une inondation. Il est intéressant de constaterl’absence de différences fondamentales de perception du risque entre les sitessoumis à des inondations torrentielles et ceux concernés par des inondations deplaine. Notons également que, sur les sites étudiés, le caractère inondable duterritoire ne semble pas être un facteur de ségrégation sociale.Un sentiment d’être ni à l’abri ni trop exposéLes habitants rencontrés lors des enquêtes de terrain sont, pour la plupart,convaincus que le risque «zéro» n’existe pas. Ils sont conscients que l’inondationpeut se manifester à tout moment dans le quartier où ils vivent. Sur nos terrains,on ne constate pas de peur excessive, ni d’inquiétude particulière vis-à-vis del’inondation (sans doute parce qu’il n’y a pas de dangers humains). Son existenceest connue mais sa «force» est sans doute sous-estimée. Nombreux sont ceux quirestent cependant persuadés que l’inondation est d’abord un problème technique àrésoudre et que les facteurs anthropiques sont à l’origine de l’aggravation durisque. Sont mis en avant les problèmes d’entretien des rivières ou de gestion desouvrages hydrauliques, mais la question de l’occupation des sols en zoneinondable est très rarement évoquée 22 . Quelques uns continuent de penser que lerisque peut être éradiqué du quartier grâce à des moyens de protection appropriés.Certains se sont installés en zone inondable en connaissance de cause. D’autresont appris l’existence du risque une fois sur place (parfois à leurs dépens). Maispour pratiquement tous, déménager à cause des inondations n’est pas une priorité.L’importance accordée au risque est bien entendue corrélée au nombred’inondations vécues et au niveau d’aléa auquel on est exposé. Les événementsvécus sont souvent des moments forts, laissant des traces dans les mémoires. Lesimpacts psychologiques (sentiment d’impuissance face aux éléments déchaînés)ne sont pas négligeables. Mais les personnes qui ont connu ces expériencesdeviennent aussi dépositaires d’un savoir.Chaque individu se construit sa représentation à partir de son propre vécu (avecune plus ou moins grande prise de distance selon le temps écoulé) et souvent enréférence à un événement particulier (pas nécessairement d’ailleurs uneinondation donnant lieu à une reconnaissance de l’état catastrophe naturelle).22D’une certaine manière, le risque est considéré par les habitants davantage à travers l’aléa que parrapport à la vulnérabilité.151
Cette représentation n’est pas seulement nourrie par des connaissances acquises(l’expérience individuelle). Elle se forge aussi avec le récit des autres et grâce auxinformations transmises par les médias (souvent des clichés et des stéréotypes).L’intervention de la collectivité appréciéeLe niveau d’exposition ressenti est fonction de l’implication des pouvoirs publicsdans des actions de gestion du risque. Quand la collectivité ne fait rien,l’inondation est très mal vécue par la population touchée. Son intervention, mêmemodeste (opérations de nettoyage ou d’entretien de rivière par exemple), confèreun sentiment de sécurité. La rivière est alors aussi considérée comme facteurd’agrément et non uniquement par rapport à ses excès. Pour les populations,l’action des collectivités locales dans la gestion du risque est une manifestationd’intérêt envers les personnes exposées. A l’inverse, son inaction provoque unsentiment d’abandon qui contribue à créer un climat conflictuel.Les occupants des zones inondables n’attendent pas des municipalités unegarantie de sécurité absolue mais leur engagement dans la gestion du risque.Plusieurs formes d’intervention sont demandées : information sur les risques,organisation d’une alerte locale, participation à l’organisation des secours,entretien des rivières, mise en œuvre de mesures de protection, …Soulignons que si la collectivité locale est identifiée par les habitants en tantqu’acteur majeur de la gestion des risques, tel n’est pas le cas pour l’État et sesservices dont le rôle en la matière est ignoré.L’engagement des individus : entre attentisme et activismeL’inondation est un puissant facteur d’isolement qui sépare les individus les unsdes autres et exacerbe les sentiments d’abandon. Mais elle aussi capable de créerde la solidarité et du lien social (pendant l’événement, les différends sont mis decôté, les conflits sont étouffés et des manifestations d’entraide apparaissent). On apu rencontrer sur le terrain à la fois des situations de rupture sociale et decohésion sociale, dont l’expression renvoie à des attitudes des occupants deszones inondables soit passives, soit actives.Les comportements passifs ou actifs des individus se manifestent dans différentsdomaines : la recherche d’information (sur les phénomènes, sur la cartographieréglementaire), la mise en œuvre de mesures de protection individuelle, ou encorela participation aux opérations de secours.Il n’est pas apparu de lien de cause à effet évident entre l’engagement despopulations et l’implication de la collectivité. En d’autres termes, l’interventiond’une municipalité dans la gestion du risque n’est pas forcément un facteurd’émulation pour les citoyens.Les actions collectives initiées par les citoyens sont centrées davantage sur ladéfense d’intérêts particuliers (création d’associations de riverains porteuses derevendications qui disparaissent après avoir obtenu gain de cause) que surl’entraide en période de crise (l’intervention des populations dans ce domaine estsouvent spontanée et ne passe pas par des systèmes organisés). Lescomportements actifs de type individuel quant à eux concernent essentiellement la152
éalisation de mesures destinées à réduire la vulnérabilité du bâtiment et lesdommages aux biens mobiliers. A titre exceptionnel, et surtout dans le cas desactivités, ils portent sur la préparation à la gestion de crise (exercices de simulationet organisation des tâches à accomplir).Sur les terrains soumis aux inondations de plaine, nombre d’occupants des zonesà risque ne font appel qu’à des mesures de protection temporaires (mise en placede batardeaux, déplacement du mobilier,….). Le développement des actionsd’urgence est proportionnel aux efforts réalisés par la collectivité locale pourannoncer la crue (signal d’alerte adapté au terrain).L’adoption de mesures temporaires et de conduites adaptées est surtout le fruit del’expérience et non le résultat de la transmission d’une information institutionnelle.En revanche, l’adaptation du bâtiment au risque est plutôt liée à l’informationapportée avant la construction ou lors de l’installation (de façon officielle ou demanière informelle). Elle dépend aussi du statut de l’occupant (propriétaire), deson âge et de ses revenus.La mise en œuvre de telles mesures pourrait être sensiblement améliorée grâce àdes aides financières spécifiques (prêts à taux zéro par exemple) et surtout à uneinformation technique spécialisée qui pourrait figurer dans le PPR (présentationdes mesures, information sur les coûts et leur efficacité,…) 23 .La politique de prévention, cette inconnue…Force est de constater que la population concernée par le risque d’inondation aune vision très restrictive de la politique de prévention. Elle est essentiellementconsidérée sous l’angle de la protection contre les événements majeurs et de lagestion de la crise (organisation de l’alerte et des secours).La majorité des personnes rencontrées réclame d’ailleurs davantage de protectionet continue d’accorder un niveau de confiance important aux mesures structurelles.La question de la maîtrise de l’occupation des sols en zone inondable n’est jamaisévoquée spontanément. L’idée de contrôler ou d’interdire l’urbanisation dans lessecteurs sensibles, voire même de sanctionner les élus locaux laxistes, estcependant admise par beaucoup.La cartographie réglementaire, un document trop confidentiel !L’enquête réalisée auprès des ménages installés en zone inondable a montré quemoins de 10% d’entre eux connaissaient l’existence du document réglementaire envigueur sur la commune depuis plus de cinq ans. La faiblesse des efforts despouvoirs publics pour faire connaître la procédure n’est pas le seul facteurexplicatif de ce résultat. Il faut mentionner aussi le manque d’intérêt que lesriverains manifestent envers ce type d’outil.Dans les faits, le rôle de sensibilisation et d’information que peut jouer un PPRn’est donc pas utilisé par les pouvoirs publics. Sa fonction de diffusion desrecommandations et des prescriptions techniques de réduction de la vulnérabilitén’est pas non plus exploitée comme il se doit.23Des efforts particuliers sont faits à ce sujet dans les PPR les plus récents.153
Des progrès à faire pour informer et promouvoir une culture du risqueL’information des populations, évoquée à de nombreuses reprises, reste un moteuressentiel pour faire progresser une culture du risque. Mais en la matière, notreconstat peut se résumer ainsi : «Si tu ne vas pas à l’information, l’information nevient pas à toi….» (sauf quand elle provient de l’événement lui-même ou lorsqu’àtitre exceptionnel, des campagnes de communication sont engagées).Dans nos enquêtes, les pouvoirs publics ne sont pas cités en premier commefournisseurs d’information 24 . Ils arrivent derrière les médias et les occupants deszones inondables eux-mêmes (relations de voisinage, entourage). L’interventionde personnes ressources peut s’avérer utile en termes de mémoire du risque. Maisconfier la mission de diffusion de connaissances aux seuls citoyens comporte desdangers (exagération ou minimisation des phénomènes, circulation d’idéesfausses et de rumeurs,…). Il est donc important que des efforts de formalisation etde diffusion d’informations soient réalisés par les acteurs publics. Les informationsattendues doivent être pratiques et opérationnelles, mais aussi territorialisées etadaptées aux populations concernées.On peut espérer que la loi du 30 juillet 2003 permettra des progrès dans cedomaine. Le texte prévoit en effet qu’une information périodique des populationssoit réalisée sur les communes disposant d’un PPR (organisée au moins tous lesdeux ans sous la responsabilité des maires, avec l’appui de l’État). Il rendégalement obligatoire l’information sur les risques à l’occasion des transactionsimmobilières (vente et location des biens).La culture du risque ne se réduit pas à un ensemble de règles de conduites ouencore à une liste de réflexes à acquérir pour réduire sa vulnérabilité lors de lasurvenance des événements. Elle est aussi ce qui permet de repérer les pratiques,de caractériser les positionnements des uns et des autres, de comprendre lesenjeux afin de pouvoir en débattre collectivement. Aussi peut-on regretter que lamise en place des comités locaux d’information et de concertation sur les risques,prévus par la loi de 2003, soit seulement réservée aux risques technologiques.Cette culture du risque - au cœur des questionnements qui jalonnent la réflexion -concerne l’ensemble des acteurs d’un territoire. Son existence participe àl’amélioration de l’efficacité des mesures de prévention et permet de faireconnaître les attitudes qu’il serait souhaitable d’adopter pour limiter lesconséquences des événements majeurs. Son développement suppose laproduction d’un langage commun aux acteurs concernés (élus, techniciens,citoyens,…) et la mise en place d’un référentiel collectif capable de faire évoluerles comportements face à une situation de risque, ce qui implique de favoriser ledialogue entre acteurs et de dynamiser la circulation d’information.24Comme le PPR, les documents spécialement dédiés à l’information sur les risques (DDRM, DCS,DICRIM) ne sont pas connus du grand public.154
Kamal Serrhini, Université de Technologie de CompiègneIl est important de revoir les processus de construction des outils de gestion duterritoire. Ils sont produits par des spécialistes de la question et ne sont pas à laportée de la population, ni même des élus. Ces derniers ne se sentent donc pasconcernés. Comment dépasser ce problème important et permettre une meilleureappropriation de ces documents ? De mon point de vue, une sémiologie est àmettre en place pour établir de meilleurs documents.Gilles Hubert, Université de Cergy-PontoiseTout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit. Pour revenir à la question de lacartographie réglementaire, il est regrettable que les destinataires finaux de cesoutils soient si peu associés à leur élaboration. Les différents exemples étudiés entémoignent; la participation citoyenne n’a pas été recherchée au cours de laconstruction des documents réglementaires et durant l’enquête publique, peud’habitants sont venus prendre connaissance du projet (il s’agit peut être là d’uneconséquence directe). Il est évident que l’on doit éviter de généraliser et que cesremarques sont à rapporter aux exemples étudiés lors de la recherche. On peutaussi espérer que des améliorations soient intervenues depuis 2002, période àlaquelle nous avons réalisé les enquêtes de terrain.En matière de participation à la «fabrication» des plans de prévention aux risquesnaturels, on pourrait s’inspirer de la démarche qui a été retenue pour élaborer lesschémas d’aménagement et de gestion des eaux, à savoir la mise en place d’unecommission locale de l’eau. Pourquoi ne pas imaginer la création d’unecommission locale des risques (rassemblant des représentants de l’État, desreprésentants des collectivités et des représentants des riverains concernés) quiserait chargée d’établir un projet de PPR, approuvé ensuite par le Préfet.Mais il y a sans doute une étape intermédiaire avant cela : la mise en place descomités locaux d’information et de concertation (CLIC) pour les risques naturelscomme c’est le cas pour les risques technologiques.Daniel Terrasson, CemagrefLes moyens de l'État sont insuffisants, notamment au niveau humain, et lesprocessus de réglementation sont de plus en plus longs.Gilles Hubert, Université de Cergy-PontoiseIl existe peut-être des moyens pour s'en sortir. Les coûts de l'élaboration d'un PPRpourraient être partagés entre l’État et les collectivités dont le territoire estconcerné. L'État établirait un document de base et les collectivités financeraientdes compléments en fonction de leurs exigences ou de leurs besoins de précision.Souvent les contestations sont alimentées par les imprécisions quant à laconnaissance de l’aléa.155
Richard Guillande, Geosciences consultantsCertains éléments ne sont pas pris en compte. Il existe des limitations techniqueset scientifiques. Ces limites sont rarement exploitées.Gilles Hubert, Université de Cergy-PontoiseElles sont aussi rarement annoncées par les experts qui entretiennent le mystère,c’est le phénomène de la boîte noire.Philippe Huet, IGE, président du comité d'orientationA partir de ce type de travail, dans une optique d'aide à la décision, que fait-on ?La responsabilité des PPR est confiée à l'État. La procédure des PPR n'est pas simauvaise. Les PPR ont le même succès que les PLU. Les comités d'élaborationdes PPR apparaissent dans la loi sur les risques technologiques. Il y a donc desavancées. Des propositions concrètes peuvent être avancées. Par exemple,présenter ce type de travail dans des clubs de risques de bassin avec lestechniciens de l'État et les collectivités locales.Bernard Barraqué, LATTSPourquoi ne pas faire des SAGE spécialement pour les risques ? Gilles Hubertavait donné un exemple de projet local dans ce domaine.Gilles Hubert, Université de Cergy-PontoiseLa grande majorité des SAGE s’intéresse aux inondations. Certains ont mêmecomme point de départ cette question. Il est de toutes les manières important dedévelopper des documents de planification capables d’aborder simultanémentdifférentes dimensions de la gestion des eaux et des milieux aquatiques.Différentes échelles spatiales sont à considérer : le bassin versant hydrographique,le bassin de risque, les zones inondables. Doit-on imaginer un document uniqueétabli sur le territoire le plus large ou plusieurs documents qu’il convient d’articulerentre eux ? Le SAGE ne présente t-il pas ce potentiel ?Daniel Berthery, CGGREFEn matière de gestion des risques d’inondation, l'hydraulique douce est unealternative. C'est une approche séduisante. Il est important de mesurer l'impacthydraulique.Daniel Delahaye, GEOPHENL'hydraulique douce existe depuis 20 ans. Les coûts des pratiques et les impactsen sont connus. Un corpus de connaissance a été accumulé. Le souci est lepassage d'un extrême à l'autre. Les méthodes sont complémentaires. Aujourd'hui,ces risques ont besoin d'être gérés en redistribuant les moyens de l'aménagement.156
Jacques Roux, CRESALLe singulier est important. Dans les questions de risque et d'expérience, il y a unpassage de position et d'interprétation. La contestation est comme la publicisationde ce qui est généralement proposé. Il existe une "dramatisation" des questionsqui sont en jeu.Olivier Godard, Laboratoire d'Econométrie, Ecole PolytechniqueEn économie, il y a un pont entre la contestation et les théories classiques. Lamanière classique de répondre n'est pas suffisante. Il faut déplacer l'attention.François Gillet, Pôle Grenoblois des risques naturelsIl est important de responsabiliser les individus en matière de risques naturels. Laquestion revient souvent. La loi vise plutôt à déresponsabiliser les individus. Laresponsabilisation existe-t-elle ?157
Le principe de précaution saisi par le juge administratif.Enjeux politiques et sociaux de la mobilisation juridiquedu principe de précautionRachel VanneuvilleAnciennement : CERAT-CNRS, BP 48, 38040 Grenoble Cedex 9Tél : 04 76 82 60 00, Fax : 04 76 82 60 98cerat@ccomm.grenet.frActuellement : CERAPS-CNRS1 Place Déliot, BP 629, 59024 Lille CedexTél : 03 20 90 74 51, Fax : 03 20 90 77 00ceraps@univ-lille2.fr«Qu’on le veuille ou non, ce principe [de précaution] s’est imposé comme unenorme essentielle de la gestion du risque environnemental» (Deflesselles B., 2004,p. 100). C’est en posant avec force cette assertion que le député BernardDeflesselles justifiait devant ses pairs de l’Assemblée Nationale en janvier 2004 lebien-fondé de l’inscription du principe de précaution dans la Charte del’environnement, poursuivant sa réflexion en notant que la Charte proposaitégalement une «nouvelle définition» du principe qui permettrait de clarifier seschamps et modalités d’application, mise au point nécessaire au vu de ses multiples– et «mauvais» (Ibid., p. 94) – usages.Ces propos constituent une parfaite illustration de la forme prise par les réflexionsfrançaises relatives au principe de précaution depuis une quinzaine d’années :celui-ci est présenté comme un outil incontournable de la gestion des risques maisson contenu reste néanmoins à définir. A ce titre, les débats autour de la Charte del’environnement ne sont qu’un épisode supplémentaire des controverses suscitéespar ce principe et sa constitutionnalisation peut difficilement être envisagée commeune clôture à venir des discussions tant, d’ores et déjà, les interprétations varientsur les usages qui découleront de cette mise en forme juridique (JurisclasseurEnvironnement, 2005).Le constat de la récurrence de ces controverses nous a conduits à nous interrogersur les enjeux qui les sous-tendaient. Plus particulièrement, et cela constituel’angle d’approche de notre travail, c’est le rôle et la place du droit dans cescontroverses qui ont attiré notre attention, dans la mesure où la question de lasaisie juridique du principe de précaution en est l’une des pierres angulaires. Leslignes qui suivent ont ainsi pour objectif de mettre en lumière la nature des enjeuxsoulevés par les réflexions sur le principe de précaution, afin de mieux comprendrele rôle qui est attribué au droit et surtout la manière dont les juristes - notamment lejuge administratif qui apparaît en première ligne des débats - se sont eux-mêmesappropriés ce principe. Il s’agit donc ici de prendre le droit comme un acteur à partentière dans ces controverses pour saisir en quoi il constitue un lieu de mise enforme et en actes du principe de précaution et s’interroger sur les effets et enjeuxsocio-politiques de la saisie juridique de cet «instrument» d’action publique.159
Principe de précaution et gouvernement des risquesL’utilisation du terme «instrument» renvoie à la problématique développée parPierre Lascoumes et Patrick Le Galès qui, refusant de considérer les choix desmodes d’opérationnalisation de l’action publique comme de simples choixtechniques, proposent au contraire d’envisager ces instruments comme desdispositifs à la fois techniques et sociaux porteurs d’une vision spécifique durapport gouvernants/gouvernés, et dont l’analyse permet de saisir les styles etchangements de l’action publique (Lascoumes P., Le Galès P., 2004). Même si laqualification d’«instrument» concernant le principe de précaution serait peut-être àdiscuter plus amplement 25 , l’approche de ces deux auteurs nous paraît cependantféconde pour rendre compte des enjeux qui se sont noués autour de la saisie dece principe.L’étude de la littérature traitant du principe de précaution 26 tend en effet à mettreau jour une configuration où il existe à la fois un consensus sur le bien-fondé durecours au principe de précaution, mais aussi des divergences quant auxdispositifs concrets qu’il emporte. La définition d’un instrument d’action publiquecomme forme de savoir sur le pouvoir social et les manières de l’exercer prend icitout son intérêt si l’on conçoit ces divergences comme des luttes entre des savoirs– et les acteurs qui les portent – qui revendiquent leur légitimité à participer augouvernement des risques; se multiplient ainsi les «points de vue» d’unéconomiste, d’un juriste, d’un sociologue, etc., chacun investissant de manièreparticulière le principe de précaution, en affirmant sa capacité à le définir et mettreen œuvre. Pour autant, si le flou conceptuel du principe est entretenu/généré parcette variété d’investissements savants, il n’en ressort pas moins que ces débatsde - et entre - spécialistes ont contribué à délimiter le champ du pensable enmatière de précaution, orientant ainsi la manière de traiter la question desrisques 27 . Pour le dire brièvement, la seule version jugée acceptable du principe deprécaution est la version «modérée», ou «médiane», qui correspond à la définitiondu rapport officiel de 1999 sur le principe de précaution qui fait office de référenceen la matière (Kourislky P., Viney G., 1999) 28 : elle propose de traiter le risqueincertain mais potentiel en l’état des connaissances scientifiques et techniques,afin de prévenir des dommages graves et irréversibles en adoptant des mesuresrévisables et proportionnées, prenant en compte les divers intérêts légitimes enprésence. Cette version est présentée comme la seule défendable parce que laseule «raisonnée», donc raisonnable, s’opposant ainsi légitimement aux versions«extrémistes» qui sont déclinées sous deux formes. La première, «maximaliste»,25Même s’il nous semble que le principe de précaution peut être appréhendé comme une «institution»,caractéristique essentielle des instruments tels que les définissent les deux auteurs, c’est-à-dire «unensemble plus ou moins coordonné de règles et de procédures qui gouvernent les interactions et lescomportements des acteurs et des organisations» (Lascoumes P., Le Galès P., 2004, p. 15).26L’étude s’est focalisée sur les interventions, écrites ou orales, des acteurs appartenant aux sphèresacadémiques, juridiques et politico-administratives.27Ce qui ne signifie pas que ce cadrage est définitif, mais il contribue cependant fortement àcontraindre le traitement des risques en stabilisant certaines représentations (Lascoumes P., Le GalèsP., 2004, p. 35).28Cette définition renvoie également grosso modo à celles données par la loi Barnier de 1995 sur laprotection de l’environnement et par la Charte de l’environnement de 2005, même si elles ne sont pasexactement superposables (Jurisclasseur Environnement, 2005).160
ferait du principe de précaution un principe d’abstention (dans le doute face auxconséquences d’une action, il faut s’abstenir de l’engager), ses porteurs attitrés et«réactionnaires» prenant l’apparence de «l’activiste» José Bové et du tenant de«l’heuristique de la peur» Hans Jonas; la deuxième, «minimaliste», reviendrait àassimiler principe de précaution et prévention, ne prenant ainsi pas la mesure de larupture – et du progrès - apportée par le premier dans l’appréhension des risques.Accompagnée de ces deux versions qui servent en quelque sorte de repoussoirs,la version «médiane» emporte ainsi avec elle une série de «prêt à penser»concernant le traitement des risques : essentiellement pragmatique, le principe deprécaution est assimilé à un ensemble de techniques de gouvernement; celles-cidoivent être guidées par la recherche de l’équilibre et de la pondération entre lesdivers intérêts en jeu; le traitement des risques relève avant tout d’une approcheau cas par cas. La casuistique est ainsi présentée comme la méthode la plusadaptée à la gestion des «nouveaux» risques : à chaque fois les intérêts doiventêtre mis à plat et débattus, les risques mis en balance, leurs coûts évalués, selondes procédures rigoureuses et contrôlées garantissant transparence, traçabilité,indépendance…. Les «scènes» de ces nouveaux risques, par nature globaux, sontdonc surtout circonscrites à des objets particuliers, elles sont multiples etfluctuantes, faisant intervenir des acteurs diversifiés. C’est aussi la notion de«gouvernance» qui se dresse à l’horizon des politiques du risque, alimentant lesdiscours sur le nécessaire dépassement de l’État-providence au profit d’un Étataux figures certes multiples (animateur, régulateur, contrôleur…) mais dont l’actionest mue par une rationalité de type procédural, où la charge de définir le contenudes politiques est déléguée aux acteurs engagés dans ces politiques.Pour brève qu’elle soit, cette présentation du cadrage des réflexions sur laprécaution indique qu’au delà d’une question de «gestion» 29 des risques, lamobilisation du principe de précaution met en jeu les modalités de recompositionde l’État contemporain, permettant alors de mieux saisir la place qu’y tient le droit.La précaution saisie par le droitCelui-ci est fortement présent dans les réflexions sur la précaution, à la fois parceque son rôle en la matière est l’un des enjeux de ces débats mais également parceque les professionnels du droit (professeurs de droit, avocats, juges) ont investi lathématique.La promotion du principe de précaution va en effet de pair avec la mise enévidence de l’insuffisance des modes de gestion «classiques» des risques, constatd’insuffisance alimenté par les «affaires» ou «scandales» sanitaires qu’a connus laFrance, au rang desquelles l’affaire du sang contaminé fait office de révélateur desdysfonctionnements politico-administratifs et du rôle du recours au juge pourréparer les «dérives» du système et clarifier les responsabilités. Si des oppositionsse font jour dans les débats sur la nature du rôle à confier au droit – les unsprésentant le juge comme l’acteur incontournable de la définition et mise en œuvredu principe de précaution, les autres renvoyant cette responsabilité au législateur29L’usage de ce terme issu du vocable économique renvoyant aussi aux modalités managériales dutraitement des risques (Nollet J., 2005).161
parlementaire en faisant du juge un simple contrôleur - ils convergent néanmoinsdans une promotion des mécanismes juridictionnels et du droit comme modes desécurisation des politiques du risque : le droit constitue à ce titre une sorte«d’institut de normalisation» 30 . Cette activité de contrôle de conformité et de miseaux normes est cependant, dans les faits, difficilement séparable d’une activité deproduction normative (Lochak D., 1998), et ce d’autant plus manifestement que lesparlementaires ont ouvert la voie au travail d’interprétation des juges en adoptantune formulation large du principe de précaution qui, depuis la loi Barnier de 1995,n’a pas été précisée par d’autres lois. Cet «appel au juge» est par ailleurs confortépar les juristes qui ont, de leur côté, œuvré à la juridicisation des débats et,partant, à leur cadrage.Le droit étant un instrument essentiel de régulation des rapports socio-politiques, ilest, tout comme les autres savoirs et techniques de gouvernement, concerné parcette thématique. L’analyse de la littérature juridique consacrée au principe deprécaution indique en effet que de nombreuses branches du droit s’en sontemparées pour faire valoir leur légitimité à se l’approprier et, du même coup, àpromouvoir leur propres concepts et catégories de pensée. Le principe deprécaution est ainsi l’objet de luttes internes au champ juridique – mais dont laportée est politique -, luttes dans lesquelles le droit administratif revendique uneposition prééminente : droit politique de l’État par nature (Chevallier J., 1989), il esten effet et tout à la fois chargé de garder l’État, en assurant la régularité et lapérennité de son fonctionnement, et sommé de l’adapter aux attentes d’unesociété qui l’a désenchanté. Objet de fortes critiques car accusé de constituer unfrein à la modernisation de l’État, le droit administratif trouve dans la thématique dela précaution l’opportunité de re-légitimer sa position dans la régulation et larecomposition de l’action publique : ainsi peuvent se comprendre les exhortationsdes juristes à ce que le juge administratif se saisisse d’un principe présentécomme «un nouveau mythe légitimant l’action publique», le vecteur d’une«nouvelle construction de l’État» (Deharbe D., 2002, p. 833) et d’unperfectionnement de l’État de droit, offrant alors au juge l’occasion d’affirmer sonrôle indispensable dans la modernisation étatique. Ces discours de justification ontainsi accompagné, en la légitimant, la saisie progressive du principe de précautionpar les juridictions administratives.L’analyse de la jurisprudence administrative montre en effet que la scènejuridictionnelle a bien été le lieu d’une consolidation du principe de précautioncomme instrument de gestion des risques. Cette consolidation prend deux formes,que nous dissocions pour la clarté de l’analyse mais qui sont indissociables dansles faits.Tout d’abord, le juge administratif a œuvré à établir la solidité juridique du principede précaution, non seulement en acceptant de juger d’affaires liées àl’environnement en mobilisant ce principe (OGM, insecticide «Gaucho»…) maiségalement et surtout en convoquant une logique de précaution en dehors destextes positifs le définissant. L’usage du principe s’est ainsi étendu à des cas30Pour reprendre, en étendant son sens, une expression utilisée par Bruno Latour à propos de l’activitéconsultative du Conseil d’État (Latour B., 2002, p. 75).162
elevant de questions de santé publique, et ce d’ailleurs avant qu’il ne soitconsacré par la loi, puisque d’aucuns voient dans le jugement de l’affaire du sangcontaminé, en 1993, une première manifestation du recours, implicite, au principe.Depuis cette date, les jurisprudences sur la «vache folle», les risques d’intoxicationalimentaire, la téléphonie mobile ou l’amiante ont été des lieux de mobilisation duprincipe de précaution. Si les exemples précités font référence à des risquessériels et sont plus ou moins reliés à des «affaires» ou des «scandales» - ce quipourrait conforter l’idée que le principe relève bien de risques collectifs et sertsurtout à gérer des «crises» - il appert cependant d’une part qu’il puisse y avoirextension de l’usage du principe à des risques individuels et hors du champ del’environnement et de la sécurité sanitaire 31 , et d’autre part que le principe estmobilisé en dehors de situations de crise (jurisprudence sur les déclarationsd’utilité publique notamment). Tous ces éléments concourent à conférer une portéenormative réelle au principe, qui devient ainsi invocable efficacement aucontentieux. Même si le juge administratif ne l’a jusqu’à présent pas expressémentconsacré comme «principe général du droit» (i. e. : un principe dégagé par le jugeapplicable même en l’absence de texte), l’usage qu’il en fait s’y apparente,indiquant une appropriation de sa définition et de son contenu.Le juge administratif a en effet, c’est le deuxième mode de consolidation, œuvré àmettre en forme un outillage conceptuel destiné à opérationnaliser le principe, viaun approfondissement du contrôle de légalité des actes administratifs. Le juge aainsi renforcé les obligations de procédure relatives au repérage et à l’évaluationdes risques : la jurisprudence a notamment contribué à étoffer le contenu desétudes d’impact, le juge pouvant également suspendre sa décision sur l’évaluationd’un projet en demandant à l’administration des études supplémentaires qui luipermettraient de statuer sur la nature des risques, encourageant ainsi le recours àl’expertise. Ceci indique également que le juge administratif a pénétré plus avantdans le contrôle de la décision administrative, tant en ce qui concerne le moded’évaluation des risques que le bien-fondé des mesures prises. Cela se traduitnotamment par le passage d’une obligation simple de moyen à une obligationrenforcée et par l’accroissement d’une exigence de proportionnalité des mesuresaux risques supposés, via une pesée des intérêts en jeu et leur mise en balance.La juridicisation des politiques du risque : quels effets politiques ?Ce rapide bilan de l’analyse jurisprudentielle permet de tirer quelquesconséquences de la saisie juridique du principe de précaution. Premièrement,celui-ci s’est imposé comme une norme devant guider l’action administrative : lefait de mentionner régulièrement la notion de précaution dans les décisions, que cesoit par le biais du principe énoncé dans le code rural ou par des formules moinsdirectes, a pour effet de renforcer la prise en considération de la précaution dansles politiques de gestion des risques. Même s’il ne conditionne pas directement lasolution, le principe de précaution se trouve renforcé dans sa dimension juridiquepar cette référence répétée : il intervient comme un signal pour l’administration,l’encourageant à raisonner en termes de précaution. En particulier, l’administrationest enjointe à respecter de manière plus rigoureuse les procédures d’évaluation31CE, Sect., 3 avril 1998, Corderoy du Tiers, n° 172554 ; CE, 5 juin 2002, Mlle B., n° 230533.163
des risques et, surtout, à étayer et développer les motivations de ses décisions. Ence sens le juge remplit un rôle pédagogique à l’égard de l’administration 32 , toutcomme à l’égard des requérants qui contestent son action puisque ceux-ci sonttout autant enjoints à expliciter le fondement du recours au principe de précaution,faute de voir ce moyen rejeté. Autant d’éléments qui concourent à affermir lesusages du principe. L’action du juge administratif contribue aussi, deuxièmement,à consolider le recours à l’expertise, la scène juridictionnelle devenant un lieud’exposition et de confrontation des opinions et savoirs. Ceci en fait également, ettroisièmement, un endroit où peuvent se trancher certains débats, comme lesaffaires d’installation d’antennes-relais de téléphonie mobile en fournissentl’exemple, le Conseil d’État ayant considéré qu’il s’agissait de risques non avérés.On touche ici à la question des effets plus «latents» de cette juridicisation.La poursuite des contestations en matière de téléphonie mobile pourrait signifierque cette clôture n’est que provisoire mais elle pose néanmoins la question descritères mis en œuvre par le juge pour trancher dans des contextes d’incertitudescientifique et technique. La lecture des conclusions des commissaires dugouvernement tend à indiquer, mais il faudrait affiner ce point, que l’appréciationde la validité et du sérieux des données scientifiques mobilisées conduit àprivilégier les paradigmes dominants. Ces critères d’appréciation semblent en effetreléguer à un rang secondaire les opinions dissidentes, pourtant théoriquementimportantes dans la mise en action du principe de précaution. Le refus de prendreen compte ce principe lorsque les requérants ne fournissent pas suffisamment deprécisions a la vertu pédagogique de pousser à la production et à la mise envisibilité des opinions minoritaires, mais cela suppose aussi des requérantspossédant les moyens, tant intellectuels que sociaux et financiers, de produireet/ou mobiliser des études et de les rendre audibles. De la même manière,l’exigence de proportionnalité des mesures aux risques que la jurisprudence acontribué à accroître conduit aussi à mettre en balance des intérêts dont le poidssocio-économique et politique n’est pas égal : confier au juge - mais aussi à desagences et à des comités d’experts, en vertu de la démarche casuistique adoptéepour penser la mise en œuvre du principe - le soin de trancher entre ces intérêtsrevient à placer les politiques du risque hors des débats politiques.En d’autres termes et pour conclure sous forme de question : dans quelle mesurela saisie juridique du principe contribue-t-elle à un cadrage silencieux de cespolitiques ? «Cadrage» car la jurisprudence consolide la version médiane duprincipe, notamment via le contrôle de proportionnalité, et qu’elle participe aussi,par l’interprétation qu’elle en donne, à «l’extension de la santé publique» commemode de légitimation de l’action publique 33 (Fassin D., 1996, p. 256 ; Nollet J.,2005) et, plus largement, à l’extension de l’appréhension des activités socio-32Ainsi que l’explique un commissaire du gouvernement au Conseil d’État : le principe de précaution doitpermettre «de changer les comportements de l’administration face à l’analyse des risques en renforçantl’expertise, la transparence ou l’anticipation» : Mignon E., Conclusions sous CE, 22 mai 2002, Sté SFR,n° 236223.33Conduisant à mettre l’accent sur l’usager-consommateur et sur les questions de responsabilitéindividuelle, ce qui se manifeste aussi dans le déploiement des analyses juridiques sur la notion de«risque acceptable» : (Noiville C., 2003; Conseil d’État, 2005)164
politiques en terme de risques 34 . «Silencieux» car c’est un processus qui sedéroule en grande partie hors des débats publics mais surtout parce que la logiquemême de fonctionnement du champ juridique conduit à «invisibiliser» lesévolutions en cours. Si les perpétuels rappels effectués par les juges quant à leurvolonté de ne pas se transformer en juges-administrateurs – c’est-à-dire à ne passortir de leur rôle de juriste - se comprennent par la nécessité de revendiquer uneneutralité politique garante de leur légitimité juridique, ils se traduisent aussiconcrètement par une euphémisation de la portée des mesures adoptées : celle-cise manifeste par exemple dans le fait qu’à l’expression «principe de précaution»soit préférée celle de «mesures de précaution» ou que les membres de lajuridiction administrative insistent pour interpréter le principe comme un simple«approfondissement» de la notion de prévention et donc de techniques juridiquesdéjà-là. Cela conduit à certes à minimiser le rôle politique du juge, qui ne créeraitdonc rien, mais contribue aussi à taire les enjeux relatifs à la recomposition desmodes d’action étatique qui s’y jouent. Ce processus de juridicisation invite ainsiplus généralement à s’interroger sur le sens de la persistance d’un décalage dansles registres de mobilisation du principe de précaution entre, d’un côté, un registrediscursif et «symbolique» constitué par des débats publics vifs et entretenus sur lecontenu à donner au principe et de l’autre un registre «pratique» qui voit ceprincipe s’imposer de manière «dépolitisée» dans les conduites 35 .Michel Turpin, PréventiqueUne dimension importante dans la maîtrise du risque est le rôle de la justice. Lajustice est une des voies par laquelle se constituent les règles. Traiter les risques aune influence. C'est également en relation avec les victimes. Que peut-il se passersi le droit pénal français évolue vers une forme plus radicale ?Stéphane Cartier, LGIT - CNRSIl existe aussi une pertinence dans les risques naturels.Rachel Vanneuville, CERAPSLe principe de précaution est producteur de risque. Il permet de penser plus loin,plus dans la prévention.34On peut remarquer que le juge civil participe de ce mouvement : depuis le 1 er octobre 2003, ladeuxième chambre civile de la Cour de Cassation regroupe les affaires de responsabilité, d’assuranceet de sécurité sociale, Guy Canivet, Premier président de la Cour, en parlant comme d’une «chambredu risque». D’aucuns voient dans cette démarche un premier pas vers une appréhension plus abstraitedu risque comme catégorie juridique (Frison-Roche M.A., 2004, p. 88). On peut se demander dansquelle mesure le choix du Conseil d’État de consacrer son dernier rapport public au thème«Responsabilité et socialisation du risque» ne constitue pas une réponse à cette «offensive» privatiste(Conseil d’État, 2005), révélatrice là encore de luttes internes au champ juridique mais qui alimententun processus général de saisie juridique du risque.35Une mise en regard avec l’histoire des politiques de discrimination positive aux États-Unis seraitcertainement éclairante à ce titre, la mise en œuvre de ces politiques fortement controversées ayant étélaissée aux mains des juges et d’agences administratives créées ad hoc, avec pour effet de masquerleur existence et d’évacuer la question de leurs effets socio-politiques (Sabbagh D., 2003).165
Les mécanismes de gestion contestable, vecteursde l’appropriation du risque par certains acteurs industriels.Contribution à une économie des OGMOlivier Godard et Thierry HommelLaboratoire d’économétrie de l’Ecole Polytechnique- UMR 7657 de l’EcolePolytechnique et CNRS1, rue Descartes, 75005 ParisTél : 01 55 55 82 15, Fax : 01 55 55 84 28olivier.godard@shs.polytechnique.frInstitut du développement durable et des relations internationales (Iddri)6, rue du Général Clergerie, 75116 ParisTél : 01 53 70 22 25thierry.hommel@iddri.orgLa recherche «Les mécanismes de gestion contestable, vecteurs de l’appropriationdu risque par certains acteurs industriels. Contribution à une économie des OGM»proposée dans le cadre du programme EPR portait sur la manière dont lesentreprises productrices d’OGM ont considéré par anticipation les possibilités decontestation de leurs produits. Ce travail a mobilisé une recherche plus théoriqueet normative engagée en 1997 sur ce qui avait été appelé les mécanismes de«légitimité contestable» (Godard, 1993) puis de «gestion contestable», paranalogie avec le concept de «marchés contestables» (Baumol et al., 1982) enéconomie industrielle.Le modèle de la gestion contestable cherche à rendre compte des conditionséconomiques dans lesquelles une menace de contestation sociale future d’uneactivité (technologie, produit), contestation prenant appui sur des risques collectifspour l’environnement et la santé, peut conduire des entreprises à prendre paranticipation des mesures de protection de l’environnement ou de sûreté qui ne luisont pas demandées par la réglementation en vigueur. Il s’agissait donc d’établirdans quelles conditions et de quelles façons les entreprises pouvaient êtreamenées à s’approprier volontairement ces risques de contestation de leursactivités, et sur quels instruments elles pouvaient s’appuyer pour y parvenir.Ce travail s’appuyait sur un constat. L’observation des stratégies industriellesdirigées vers l’amélioration de la qualité environnementale et sanitaire des sites deproduction et des produits laisse en effet entrevoir des démarches volontairesallant au-delà d’une simple réponse à la réglementation ou aux incitationséconomiques existantes. Ces comportements peuvent être qualifiés deparadoxaux pour l’analyse économique standard dans le champ del’environnement et des biens collectifs. Celle-ci, combinant des hypothèsesspécifiques de rationalité (self-interest et maximisation du profit espéré), considèreen effet qu’une firme rationnelle est supposée se déterminer en fonction des coûtsqu’elle supporte et des bénéfices qu’elle peut retirer d’une activité; a priori, uneentreprise ne serait pas prédisposée à assumer volontairement la charge167
financière d’effets externes sur l’environnement ou la santé ou plus généralementde coûts sociaux infligés à la collectivité. De ce point de vue, s’agissant de risquescollectifs d’environnement et de santé, les firmes industrielles sont supposéesréagir aux politiques publiques ou à l’état de droit, sans avoir de bonnes raisons deprendre en charge spontanément les effets externes de leurs activités. Dans uneéconomie concurrentielle, non seulement les agents ne sont pas tenus de prendreen compte leurs effets externes non régulés par la collectivité, ils sont dissuadésde le faire : cela les conduirait à dégrader leur position économique face à desconcurrents qui n’adopteraient pas cette attitude; ces derniers capteraientdavantage de parts de marché, et pourraient, ce faisant, parvenir à les exclure dumarché!L’idée directrice du modèle de la gestion contestable s’écarte sensiblement decette analyse : en améliorant volontairement sa performance environnementale etsanitaire, l’entreprise peut chercher à éviter qu’une contestation sociale ultérieurede son activité et/ou de ses produit ne se développe au point de déboucher surune restriction partielle ou totale de ses droits d’exploitation ou de développement,ou de lui imposer une sortie du marché dont les coûts seraient irrécupérables.C’est la perspective d’une mise en cause future, une menace, qui aurait ainsi uneffet disciplinant au regard de son comportement environnemental et sanitaireprésent.Cette hypothèse a été posée par analogie avec le positionnement de la «théoriedes marchés contestables». Dans des conditions de contestabilité parfaite desmarchés mise en évidence par Baumol, Panzar et Willig (1982), à savoir unefacilité d’entrée et de sortie sans coûts asymétriques sur un marché, la menaced’entrée discipline les pratiques tarifaires des entreprises en place, en les incitant àne pas s’écarter d’une tarification concurrentielle : si elles voulaient exploiter unerente de situation en pratiquant des tarifs plus élevés, elles déclencheraientl’entrée de concurrents qui prendraient le marché. Il nous est apparu que, de façonsimilaire, dans certaines conditions, la menace de contestation sociale à baseenvironnementale pouvait avoir un effet disciplinant pour ce qui concerne lecomportement environnemental de certaines entreprises.Ce modèle fait donc de l’état de contestabilité des entreprises –état d’expositionobjective et de sensibilité à une menace de contestation sociale de leurs activités,techniques, produits- un nouvel enjeu de gestion stratégique de la part decertaines d’entre-elles. Il a l’avantage de pointer les déterminants économiques -effets de taille, caractère redéployable ou non des actifs possédés, positionnementau sein des filières productives, type de produits proposés à la vente, étendue del’horizon d’engagement de l’entreprise dans une activité - qui donnent prise à lamenace de contestation et sensibilisent l’entreprise à la perspective de saréalisation. Des entreprises à l’horizon d’engagement court et parfaitementflexibles n’y seraient pas sensibles : ces dernières peuvent se dégager sans coûtsde leur domaine d’activité si d’aventure une menace de contestation sociale à baseenvironnementale venait à s’actualiser.A l’opposé, des firmes engagées durablement dans un domaine d’activité du faitde la possession d’actifs spécifiques et faiblement redéployables ont objectivement168
intérêt à anticiper sur la possibilité de contestation future de leur activité; ces firmesne peuvent en effet se soustraire à l’action de la menace en sortant, sans coût, dumarché incriminé. Faute de pouvoir se redéployer lorsque la menace devienteffective, elles ont donc intérêt à s’engager dans une prospective continue descontestations potentielles, à en évaluer la crédibilité et à choisir une stratégie afin,soit de réduire leur exposition à cette menace, soit d’atténuer les impactséconomiques et juridiques de sa réalisation éventuelle. Au croisement de cesdifférentes options stratégiques (tableau 1) et de leurs possibles modalités de miseen œuvre (tableau 2), les firmes disposent donc de différentes stratégiesd’appropriation de la menace de contestation et de gestion de leur contestabilité.Les stratégies ainsi modulées pourront parfois s’appuyer sur plusieurs options :celles-ci ne sont pas nécessairement exclusives les unes des autres. Il estpossible d’envisager des recours croisés à plusieurs d’entre elles. Le choixd’utiliser l’une ou l’autre de ces options ou de les combiner doit être analysé dansle contexte stratégique qui est celui de la firme. Le contexte stratégique désignel’ensemble des interlocuteurs, industriels fournisseurs, concurrents, pouvoirspublics et clients (consommateurs ou autres entreprises dans le cadre d’unerelation de filière), avec lesquels l’entreprise en question entretient des liens. Cecontexte, le type de configuration industrielle dans laquelle l’entreprise exerce sonactivité, et la manière dont l’entreprise se représente sa contestabilité àinternaliser, déterminent conjointement le champ des options stratégiquespossibles pour l’entreprise désireuse d’engager une gestion contestable.Tableau 1 : les options stratégiques disponibles pour limiter la crédibilité de lamenace de contestationStratégies visant à réduire l’horizon d’engagement via l’ajustementtechnique1. La sortie du marché ou l’abandon d’investissements amorcés(attentisme), l’abandon d’une gamme de produits durant la phasede recherche2. La prévention «à la source», calée sur une représentation desdangers possibles en fonction d’une démarche de précaution qui sejoue avant le temps d’engagement productif3. L’ingénierie end of pipe dans la phase de production etd’amortissement des équipements productifs existantsStratégies visant à limiter l’impact financier de la contestabilité4. Le recours à des techniques d’assurance du risque, la constitutionde fonds d’indemnisation privés, ou de la création de captivesStratégies visant à viabiliser l’activité sur l’horizon d’engagement5. Activités d’influence et de lobbying exercées auprès de l’instancede décision réglementaire en vue de l’élaboration d’uneréglementation qui délimitera les états acceptables au regard desrisques anticipés; il s’agit pour les firmes de stabiliser durablement169
le cadre d’activité de l’industrie et ainsi d’étendre son horizon deprévisibilité6. L’adhésion à des systèmes de normalisation et de certificationvolontaire attestant la qualité environnementale et sanitaire del’exploitation de sites de production et des produits développés7. L’adoption d’une politique de communication et de concertationenvers les porteurs potentiels de la contestation, dans le double butd’identifier les enjeux auxquels sont sensibles les porteurs demenaces et d’établir ex ante un rapport de connaissance mutuelleet, si possible, de confiance dont il est attendu qu’il modère lacontestation en cas d’accidents écologiques ou de crises sanitairesTableau 2 : modalités de mise en œuvre des options stratégique de gestioncontestableStratégie de brancheStratégie d’entrepriseAppui des pouvoirs publics ( a ) ( b )Action sans l’aide des pouvoirs publics ( c ) ( d )Compte tenu de la dynamique de la genèse et du développement d’un processusde contestation, la mobilisation des options stratégiques doit veiller à ne pasépuiser ou neutraliser d’un coup la gamme des options disponibles. Idéalement, ils’agit de l’élargir, et a minima, de veiller à maintenir ou renouveler un panierd’options mobilisables à l’avenir. L’ensemble des stratégies utilisables à un instantt dépend de la nature des options et de la façon dont elles sont mises en œuvre.L’un des constats opéré est le suivant : le choix d’une stratégie mal calibrée peutinterdire le recours ultérieur à d’autres options déployées selon les mêmesmodalités. Une option déployée à partir d’une modalité de mise en œuvre quis’avère ex post peu efficace en matière de couverture du risque de contestation nepourra pas être redéployée à l’identique. Dans ce cas, il faut envisager l’existenced’irréversibilités dans les trajectoires choisies au sein de l’espace des options etdes modalités de mise en œuvre disponibles.Inversement, un choix bien ajusté pourrait favoriser la mise en œuvre de nouvellesoptions stratégiques. Ainsi, l’option reposant sur l’adhésion à un système demanagement environnemental d’une activité ne pourra pas, par exemple, êtreutilisée par une firme qui n’est pas en conformité réglementaire et qui n’a pas decouverture assurantielle de son activité à raison des risques environnementaux etsanitaires qu’elle pourrait provoquer. La conformité réglementaire est alorsthéoriquement le déterminant critique de l’accès à l’assurance. L’assurabilité estelle-même un des déterminants de l’accès à la certification volontaire. L’imbricationest fine et fonctionne ici par pallier : dans l’exemple pris, l’accès à l’une des optionsélargit le champ des options ultérieurement disponibles.C’est avec ce cadre analytique que la recherche conduite dans le cadre duprogramme EPR a analysé les évènements observés en France et en Allemagne170
entre 1990 et 2000 dans le secteur de la production d’Organismes génétiquementmodifiés – OGM- à vocation agricole. Cette analyse conduit à interpréter lasituation des opérateurs industriels du secteur en 2000 comme le résultat detentatives partielles et inabouties de gestion de la contestabilité. Un diagnosticinitial erroné concernant les conditions sociales du développement économique dusecteur, des tentatives de réajustements malheureuses et engagées souvent troptardivement ont conduit à épuiser peu à peu la gamme des options stratégiques decouverture du risque de contestation. Sous la pression des marchés financiers, quicherchaient à dégager l’industrie pharmaceutique de ce qui était devenu le poidsreprésenté par l’application des biotechnologies au secteur agricole en Europe, lesgroupes des sciences de la vie qui s’étaient constitués au début des années 90 sesont démantelés quelques années plus tard.Cette recherche a permis de préciser certains traits relatifs à la genèse de lacontestation. Dans les prémisses de son développement, ce sont les controversesentre experts sur les risques en jeu et leur imputation à certaines sources qui, unefois divulguées dans le public, orientent le tour des évènements et nourrissent lespositions des acteurs sociaux. En prenant de l’ampleur, la contestation socialetend à s’écarter de son fondement initial, et peut viser à la fois la manière dontl’expertise est conduite et les procédures institutionnelles de décision. Enfin,lorsque les objets contestés deviennent, en eux-mêmes et non plus du fait desrisques qu’on leur impute, l’objet d’un combat social, la contestation tend à prendreson autonomie, tant vis-à-vis des données scientifiques que des procéduresd’expertise publique, débouchant sur un processus de stigmatisation. La situationtend à se bloquer à mesure que les coalitions d’acteurs se stabilisent.Claude Gilbert, CNRS, Président du conseil scientifiquePrenons l'exemple des nanosciences à Grenoble. Que constate-t-on ? Unestratégie bulldozer. Le dossier comporte de nombreuses données paradoxales.Thierry Hommel, IDDRILa donnée clé est le retour sur investissement. Le cas des OGM est très différent.Claude Gilbert, CNRS, Président du conseil scientifiqueLe schéma est plus compliqué. Les acteurs économiques et scientifiques ont unepression forte.Nicolas Camp'huis, Agence de l'eau Loire-BretagneIl y a une stigmatisation. Le poids des acteurs est essentiel. On le voit sur lesouvrages de protection.Philippe Hugodot, IGEL'expérience montre qu'il y a une forte interaction entre les intérêts économiques.Les débats ne sont pas forcément «purs».171
Claude Gilbert, CNRS, Président du conseil scientifiqueQuand les chercheurs interviennent dans le cadre du ministère del’Environnement, ils tendent à réfléchir en termes de gestion des risques. Or, si l’onprend en compte les jeux d’acteurs, comme le font habituellement les chercheurs,il devient difficile de parler en termes de gestion des risques. Le décideur avanttout soucieux du bien public et s’appuyant sur des experts pour prendre desdécisions rationnelles est une figure un peu trop idéale. La question est : commentavoir des approches en termes de gestion qui intègrent les jeux d’acteurs. Uneréflexion à ce sujet serait intéressante.Paul Henri Bourrelier, AFPCNOn veut que l’ensemble des acteurs s’approprie la gestion des risques de façonintelligente; de là, on passe à la volonté d'appropriation de tous les outils ou d'uncertain nombre d’outils. Le PPR est un instrument réglementaire, fait pour l’État. Jene vois pas pourquoi les gens s’approprieraient le PPR. Il faut réfléchir sur lesoutils. Il y a un outil plus appropriable, qui est le plan de représentation des risquesparce que, lui, il intéresse tout le monde, l’assureur, l’assuré, l’entreprise detravaux publics, le maire et l’État, c’est un instrument d’information. Mais, si onpasse à un outil qui est fait pour un acteur donné, on se met devant un objectifabsurde qui est de le faire approprier par des gens qui n’en veulent pas, qui sontdans l’opposition, qui le refusent. Ils ont raison, ce n’est pas fait pour eux.Probablement avec cette complexité et leur impureté qui est évidente, les acteurscherchent à éviter tout ennui. Il faut chercher des outils qui soient appropriablespar tous, c’est-à-dire remonter assez haut et ensuite admettre que chacun sefabrique ses outils pour ses controverses. Après, il appartient à l’État d’arbitrer. Jevois deux rôles à la politique publique, l’un qui est de fournir des outils assezgénéraux pour être compris par beaucoup d’acteurs, et l’autre, qui est d’organiserdes procédures d’arbitrage et de décision. Il faut vraiment réfléchir sur desquestions telles que : pourquoi les assureurs ne se sont-ils pas appropriés laprévention ? Là, il y a des vraies questions liées à leurs intérêts.Madame Cordier, CARNACQDans vos recherches, je n’ai pas vu une seule recherche sur la gestion du risque,c’est-à-dire la gestion de la crise. Quand la crise est arrivée à l’instant T, commentgérer la crise ? Comment éduquer, informer en amont la population pour qu’elle aitle bon réflexe pour qu’il n'y ait pas, au-delà des dégâts matériels, d'autres plusimportants, en termes de vies humaines.Philippe Hugodot, IGEPersonnellement, je suis un praticien puisqu’en tant qu’ancien du corps préfectoral,j’ai vécu en Calédonie un tremblement de terre, en Guadeloupe une éruptionvolcanique, à la Réunion un cyclone et même à Epernay dans la Marne la tempêtede 99. Je me situe bien sur le terrain et dans la gestion de crise. Je voudraissimplement conclure sur quelques illusions qui ont paru se dissiper ce matin parrapport à hier soir. Les illusions qui se sont dissipées sont au nombre de trois.172
La première est une illusion populiste. J’ai eu l’impression qu’on nous disait que lavérité était forcément en bas. Je crois que ce n’est pas parce qu’un certain nombrede gens sont interviewés et nous donnent leur sentiment sur la façon dont ilsauraient géré une situation par rapport aux élus ou aux représentants de l’Étatqu’ils ont forcément la parole d’évangile. En sens inverse, l’illusion démagogiquequi consiste à dire «tous pourris, tous médiocres» au niveau des décideurs meparaît tout aussi dangereuse. La vérité est entre les deux, c’est-à-dire dans laconfrontation entre le terrain et des décideurs publics dont une bonne partied’entre eux ne sont pas forcément purs mais ont quand même l’avantage d’êtrerelativement désintéressés et d’avoir gardé le sens du service public. La troisièmeest l’illusion scientiste. On ne sait pas mais comme on est chercheur, demain, onsaura. Le nucléaire et l’extraordinaire certitude en eux-mêmes des chercheursdans le nucléaire sont là pour constater que l’on ne sait pas tout et que demain onne saura pas régler tous les problèmes.Je voudrais terminer en abordant deux points. Le premier est que j’ai eu lesentiment pendant tous ces débats qu'on était mauvais partout. Ce n’est pas vrai.Je cite l’exemple du cyclone. S’il y a un secteur récurrent où on est très bon, c’estbien celui-là. Quelques chiffres : le dernier cyclone à la Réunion : 0 mort, 35 mortsà l’île Maurice. Un autre exemple celui des inondations entre la France et l’Italie.On est très bon en sécurité civile, peut-être moins en prévention : 50 morts enItalie et 2-3 morts en Languedoc-Roussillon. Cela démontre quand même quedans la gestion de crise, on n’est pas mauvais et dans la prévention, je ne suis pascertain qu’on ait forcément des leçons à prendre partout ailleurs. On a unedernière illusion : ailleurs, c’est forcément mieux que chez nous. Mais quand onvoit les incendies aux États Unis ou au Portugal et ceux en France, je ne suis pascertain que nous soyons les plus mauvais.Le dernier point est que j'ai été très surpris de ne pas avoir entendu les motsInternet, radio, télévision, et portable. Or, je suis convaincu, que l’on fasse travaillerdes chercheurs ou des professionnels, de l’apport que nous pourrions trouver dansces techniques d’information, à la fois sur des plans, sur des programmes, sur destravaux en cours et évidemment sur la gestion de crise. Dans le cadre du cycloneDina à la Réunion, on a eu un moyen d’information fabuleux qui est la radio;l’antenne TDF s’est effondrée après un vent de 360 km/h et si on a continué àinformer la population, c’est que là-bas, il y a 75% de personnes équipées d’unposte portable et qu’on a immédiatement pu transférer l’information du préfet et lesdirectives qu’il donnait à la population par le système des «sms». On n'a peut-êtrepas encore assez exploré, au niveau du corps public, des systèmes autres que lebulletin municipal ou la réunion.173
Table ronde 4 : Comment fairedes retours d'expérience ?Cette table ronde s'intéresse aux méthodes de retour d'expérience età l'apprentissage.Le retour d'expérience figure parmi les bonnes pratiques de lagestion des risques. Quels sont les résultats de l'expérimentation ?Comment l'intégrer dans la gestion des risques ?Co-animateurs :Bernard Barraqué, LATTSColonel Bernard Modéré, SDIS Meurthe et MoselleIntervenants :Emmanuelle Fauchart, CNAMPierre-Marie Sarant, Coris Risk ConsultingMartine Tabeaud, Université Paris 1Jean-Luc Wybo, ENSMPColonel Bernard ModéréLe retour d’expérience est une pratique qui tend à se développer. Il pose beaucoupde questions, notamment au niveau méthodologique. Il y a un certain nombre deproblèmes récurrents : le retour d’expérience et les médias, le retour d’expérienceet la justice, l’influence en interne d’un retour d’expérience. Avec les quatreintervenants, nous aurons sans doute un début de réponse.175
Quelles données pertinentes pour une évaluation globaleet intégrée du risque tempête en Île-de-France ?(Exemple du 26 décembre 1999)Martine TabeaudUniversité Paris Panthéon Sorbonne191 rue Saint-Jacques, 75005 ParisMartine.Tabeaud@univ-paris1.frA propos de la tempête en Ile-de-France et de la question qui m’était posée, cen’est pas vraiment un retour d’expérience qui a été réalisé dans le cadre de cetravail. Un livre a été produit et est sorti en 2003, ainsi qu'un CD-ROM de 2000documents d’archives sur la tempête (vidéos, audio, cartographique, rapportsd’experts…) et deux documents pédagogiques, un CD-Rom sur la vulnérabilité desgrandes villes face à la tempête et un film de 14 min.La question que je pose aujourd’hui pourrait s’exprimer ainsi : quand un retourd’expérience territorialisé n'a pas eu lieu, mais que des éléments documentairesont été créés, qui pourraient remplacer partiellement un retour d’expérience,comment les rendre plus efficients ?Je ne reviens pas sur le débat concernant la fréquence et l'importance dans lefutur des tempêtes, des éléments paroxysmaux en général. Ce n’est pas sur cesujet que je veux m’exprimer. Par contre, les vulnérabilités d’une régionprincipalement urbaine comme l’Ile-de-France sont au centre de nospréoccupations. Comment réduire les vulnérabilités ? Une des propositions est de«mettre en mémoire» l’événement tempête de 1999. Mais que mettre en mémoire?Pour qui et comment ?Les tempêtes sont des événements venteux, donc tout le monde pense à l’aléa, auvent, etc. Comme tout un chacun, je croyais trouver des banques de donnéeshistoriques qui me permettraient de comparer 1999 avec des tempêtes du passé.Or, il s’est avéré qu'au-delà d’une période de 60 ans, voire 100 ans, il n’est pluspossible de disposer d’une banque de données sur les vents très violents dans laFrance intérieure. Par ailleurs, si l’on a des données, le risque tempête n’était pasle même dans les hivers 1950-56 que maintenant. De même, sous Louis XIV, leclimat était différent, la vulnérabilité également. Pour remédier à ce manque dedonnées, Météo-France, postérieurement à la tempête, a commencé à constituerune banque d’événements extrêmes en remontant dans le passé. Par ailleurs,autre élément positif, avec des archivistes, des historiens de toute la France, leGroupe d’Histoire des Forêts Françaises, nous avons commencé à fabriquer unebanque de données depuis le 14 ème siècle des coups de vent à partir des dégâtsoccasionnés aux forêts et aux bâtiments. Cet inventaire est actuellement en coursde traitement.Comme le prospectif sans rétrospectif ne peut exister, cette étape était nécessaire.L’absence de rétrospectif en matière de tempête explique probablement pourquoi iln’y a pas eu de retour d’expérience, parce que tout concourrait à montrer que lesévénements étaient exceptionnels. Ce que les médias ont hélas trop souvent177
elayé. Ce qui fait que des travaux sur les risques en Ile-de-France parus depuisne mentionnent pas les tempêtes. A quoi bon se prémunir d’un événement«exceptionnel» ?Par ailleurs, quant à l’aléa, en milieu urbain, la mesure de la vitesse du vent dansune station météorologique est bien éloignée de celle qui est subie entre lesbâtiments, dans les avenues larges ou les rues étroites… Donc la vitesse du ventn’est qu’un élément de la mémoire de l’événement. Mettre en mémoirel’événement, c’est archiver tous les éléments disponibles sans faire de tri.Pourquoi ne pas avoir fait de tri, mettre aussi bien des déclarations d’assurance,des photographies, des pages de registre d’intervention de pompiers, des devis deréparation, des vidéos, des interviews, des cartographies, des expertises, etc ?Parce que la réalité est kaléidoscopique. Tous ces éléments appartiennent à lamémoire de la tempête, le savoir savant comme le savoir empirique. De plus, lerisque est fondamentalement territorialisé. Si la tempête n’était pas passée entre 5et 7 heures du matin, sur l’Ile-de-France, un dimanche alors qu’il y avait crainted’un bug informatique et donc veille dans bien des entreprises, les dommagesn’auraient pas été les mêmes. Le risque pour la Courneuve n’est pas le même quepour Versailles. Parce que les bâtiments n’y sont pas entretenus de la mêmefaçon. Et au-delà de la tempête, les dons des Américains pour replanter le parc deVersailles sont impensables pour le parc de La Courneuve… Donc, l’événementest conjoncturel, avec un espace et un temps bien définis.La récupération de ces données a été plus aisée que prévue, même si pardéfinition, elle ne sera jamais achevée. Plus de 2000 éléments de nature différenteont été classés et il est possible d’en ajouter. Des supports pour archiver, commeun site Internet ou bien un cd-rom avec un moteur de recherche sont facilementréalisables. Les géographes de l’université Paris Panthéon Sorbonne ont fait cetravail pour cet événement particulier. Mais je n’ai pas l’intention de ne faire quecela dans l’avenir. Donc, il conviendrait de réfléchir à une équipe qui fabriqueraitcet archivage à chaque crise, à la destination de cette banque de données, à quiva en être le dépositaire, la rendre vivante c’est-à-dire qu'elle soit consultée,augmentée… et cela pour tous les usagers.Ce document a été fabriqué pour des acteurs, des gestionnaires du risque avecpour but de créer un moteur de recherche dans le cd-rom qui permette de trouverce qu’on recherche en fonction du territoire, du thème,… Les mémoires et non pasla mémoire ont été privilégiées, de façon à ce tout le monde puisse se l’approprier.Lors de ce colloque, des images d’hélitreuillage ont été montrées, elles marquentplus qu’un long rapport d’expert vite oublié sur une étagère, elles font preuve.Pouvoir consulter des documents visuels permet de faire preuve. C'estindispensable pour construire un savoir qui sera partagé, parce qu’à partir dumoment où une banque de données existe, des débats peuvent se construire. Cesenrichissements mutuels peuvent éventuellement favoriser la démocratieparticipative, indispensable à une gestion des crises. Pour des événementscomme la tempête, il est important de montrer des effets du vent. Dans notresociété, tout le monde délègue aux météorologistes la prévision du temps. Etaucun francilien ne sait plus quels sont les effets d’un vent de 130km/h, personnene regarde plus le ciel. Si Météo-France se trompe de 10 à 15km/h, ou bien d’une178
demi-heure, ce sont les météorologistes qui sont rendus responsables desdégâts… Le partage de ces éléments de mémoire, donc leur accessibilité, pourraitaider à modifier cette déresponsabilisation.De la même manière, il n'y a pas une mémoire mais des mémoires, une culture durisque mais des cultures du risque, selon les récepteurs, selon leurs intérêts. Doncla boîte à outils que nous proposons a été conçue en fonction des récepteurs,puisque la mémoire et la culture sont diversifiées. En matière de risques, onconfond trop souvent l’information et la communication. Communiquer suppose dese préoccuper de la transmission du message. Or le véhicule du message, l’audio,le visuel ou l’audio-visuel suppose une mise en forme différente. C’est la raisonpour laquelle, alors que ce colloque s’est accompagné d’une présentation deposters tous identiques quant à leur structure et simples «coupé-collé» du textedes rapports, nous avons fabriqué un poster différent, informatif. Dans la mesureoù l’équipe avait réfléchi à la production de documents ciblés, un film pédagogique,de CD-Rom facilement utilisables par un élève du secondaire, par un élu, par unindustriel, etc, on ne pouvait pas se permettre d’avoir un placard subdivisé en«objectifs, méthodologie».Le programme incitait à fournir un outil quasi opérationnel. Aujourd’hui les outils nesont plus les mêmes qu’il y a 20 ans. Donc, l’Internet, les cd-rom, le film, font partiedes outils. Dans la société civile, beaucoup manipulent aisément ces outils. Lemonde de la recherche ne s’y est pas encore adapté. Il reste trop souvent figé surle verbe dans l’écrit ou l’exposé oral. Par exemple, puisque des posters ont étéréalisés, plutôt que de donner à chacun du temps à la tribune pour exposer sesrésultats, une séance de questions/réponses face au poster de chacun aurait puêtre efficace.En conclusion, les retours d’expérience de la tempête de 1999 ont été sectoriels :Météo-France a créé la carte de vigilance, l’ONF violemment attaqué s’est remisen cause, EDF a dressé un bilan… Mais sur les risques territorialisés, il n’y a rien.L’AURIF a publié en 2003 un cahier sur les risques naturels en Ile-de-France, où latempête n'apparaît pas. Comme la canicule venait d’avoir lieu, une demi-page aété ajoutée in extremis. L’accumulation de savoirs ne s’est pas transformée ensavoir-faire. Or, la constitution de banques de données est longue et fastidieuse.Pour quelles soient utiles, il faut qu’elles soient quelque part et que les gens lesachent pour l’utiliser. Donc, cela signifie qu’il faut penser à créer un lieu (leMEDD ?) qui rassemble la mémoire des crises, en Ile-de France et ailleurs sur leterritoire national. De plus, il faudra penser aux droits, qui est propriétaire de cettebanque de données ? Enfin, il faudrait imaginer une structure de diffusion, defaçon à ce que tous les outils produits ne restent pas dans un tiroir.179
Méthodologie de retour d’expérience interactif - REX InteractifRetour d’expérience sur la prise de décision et le jeudes acteurs : le cas du cyclone Lenny dans les Petites Antillesau regard du passéPierre-Marie SarantCoRisk International43 Résidence Port Madras, Bas du Fort, 97190 Le GosierTél : 06 90 55 87 93pmsarant@corisk-international.comMa présentation vous expose la méthode de retour d’expérience REX Interactif surl’Arc des Petites Antilles, méthode que nous avons développée avec une équipepluridisciplinaire très large. Cette équipe comprenait des physiciens del’atmosphère, des géographes, une psychologue environnementale, unesociologue environnementale et un expert de la gestion des crises, ainsi que desétudiants qui nous ont aidé à mener ce travail très lourd.Les outils de cette méthodologieNous avons procédé à une série d’entretiens de personnalités et d’acteurs durisque et de la prévention en fonction de leur disponibilité. Nous avons égalementréalisé une analyse documentaire importante, presse, documents, rapports sur lescyclones du passé, puisque nous devions mettre en perspective Lenny par rapportaux cyclones de la région. Nous avons effectué un nombre importants d’enquêtesauprès de la population, dans les zones sinistrées notamment dans les régions dela Guadeloupe et de la Martinique. Cette étude s’est déroulée sur l’Arc des PetitesAntilles. Un autre outil essentiel dans cette méthode est le séminaire d’étape quenous avons réalisé aux Abymes en octobre 2003, conjugué à un séminaire EPR.Cette méthodologie a été développée en 3 étapes : la reconstitution d’unechronologie et l’élaboration d’un modèle d’activités suivi de la construction d’unmodèle de communication. Cette méthodologie a été appliquée à l’étude Lenny,qui a été intitulée «Retour d’expérience sur la prise de décision et le jeu desacteurs. Le cas du cyclone Lenny dans les Petites Antilles au regard du passé.»Pour rappel, l’Arc des Petites Antilles est très vulnérable aux catastrophesnaturelles, aux cyclones en particulier. Le cyclone Lenny a un certain nombre departicularités : il est né très tard dans la saison et a eu une trajectoire d’ouest enest, ce qui est peu commun; son intensité a très rapidement gravi l’échelle de Saffiret Simpson. L’œil est passé sur le nord de l’Arc. L’attention s’est portée sur l’œil etsa proximité immédiate alors que des effets de houle et de pluie ont touchéd’autres régions, n’occasionnant pas d’alerte, les alertes étant surtout basées surles vitesses du vent.181
Les objectifs spécifiques de l’étude LennyLes objectifs scientifiques étaient :- au niveau sociologique et psychologique, d’améliorer l’alerte cyclonique;- de connaître et évaluer les représentations du cyclone et mesurer lesconnaissances des consignes;- au niveau organisationnel, de mettre en place cette méthodologie de retourd’expérience;- de développer un réseau d’acteurs sur l’Arc des Petites Antilles, avec unobjectif d’intégration régionale;- de tirer des enseignements d’un événement qui était difficile;- de comprendre les raisons des difficultés rencontrées;- de repérer les bonnes idées, les initiatives prises et de développer unecompréhension commune et partagée entre autorités et population.Cette étude a fait l’objet d’un rapport de 258 pages, très riche et encore aujourd’huipeu connu.Les principes de la méthodeNous avons procédé à l’examen de l’enchaînement des événements, descomportements et des actions générés, avec la mise en évidence de la chaîne desmessages, son interprétation lorsqu’elle est reçue par d’autres acteurs, et l’actionqui en découle. Puis, une synthèse avec les points forts et ceux qui sont àaméliorer est proposée.Les phases de la crise ont été reprises lors de notre séminaire aux Abymes auquelont participé environ 70 personnes de la Caraïbe, des ministères et un sociologueaméricain. La crise a été découpée en cinq phases :- la prévention, en amont du cyclone, période de mise en place de laprocédure et de la vigilance.- l’alerte et la mise en sécurité. Cette phase est très courte : à partir dudéclenchement de l’alerte jusqu’à la mise en sécurité de la population. Ilétait important de vérifier la représentation de la population par rapport àces alertes et comment elle s'était transformée en comportements.- la crise et le vécu des dangers. Cette période est la plus critique car on estdans la crise. Elle est courte bien qu’un peu plus longue que laprécédente. L'étude porte sur comment est traversée cette période decrise aiguë pour les populations et les autorités et quels moyens defonctionnement et de gestion de la crise sont mis en place.- la fin de la crise. Cette période est plus longue et quelques fois chevauchela précédente. Elle va de la période de confusion qui est la période où oncapte des informations (sur ce qu’il s’est réellement passé), les besoins182
(on commence à répondre aux attentes de la population), à la période derestauration des énergies et d’une vie plus normale.- la relance économique. Elle peut durer très longtemps et se mélange avecla phase 4. C’est celle de la reconstruction, des améliorations, desenseignements et quelques fois, elle dépasse la phase suivante deprévention.Pour illustrer ces phases, nous avons choisi des présentations visuelles. Uncertain nombre de pictogrammes sont utilisés. Les chronologies sont reconstituéeset sont mises en perspective par rapport à des actions et des décisions. Dans lecadre de ce séminaire, nous présentons ces chronologies aux acteurs pour unevision globale de la crise, afin de dédramatiser et leur faire comprendre commentune action peut générer des réactions en chaîne. Cette vision globale qui faiténormément défaut en période de crise permet, dans le calme, quelques mois plustard, de dédramatiser la problématique, de contourner tous les obstacles qui sedressent entre les acteurs pour communiquer, et surtout d'amener de l’expérience.L'essentiel se trouve dans les valorisations d’acteurs qui ont eu une priseparticulière sur la crise et qui ne viennent pas obligatoirement dans les réunionshabituelles de bilan. Ils peuvent amener des témoignages, voir des types desolution.Ces phases ont été retracées selon les différents types d’acteurs, les acteursmédias, les acteurs informels, les acteurs institutionnels, les acteurs sinistrés, etselon les relations ou les modes d’approche engendrés vis à vis d’eux. Lasynthèse que nous avons réalisée au milieu de l'étude nous a permis d’identifierles problèmes du système de gestion, par exemple, et de préconiser desaméliorations.A travers le séminaire, certains besoins ont été révélés, tels que des fiches guidespermettant de faire sortir de nouvelles procédures, les pièges à éviter, les actionsde formation spécifique, etc. Il y a eu une grosse demande notamment de la partdes collectivités locales qui se retrouvent en première ligne lorsque l'alerte n'estpas déclenchée, ni le plan ORSEC. Ces collectivités doivent faire face à desdemandes et elles ne savent pas toujours comment s’y prendre. Des propositionsde stratégie, de projets innovants, de travaux, notamment sur les scénarii de crise,ont également été réclamées. Nous avons tiré un bilan synthétique et partagé duséminaire, et nous l’avons largement diffusé auprès des personnes qui étaientconcernées.Notre méthode comporte trois points forts. Elle permet de décrisper sur le biland’une crise, ce qui est essentiel, de lever beaucoup de réticences par rapport à cesbilans qui sont souvent réalisés en milieu fermé. La participation au séminaired‘acteurs qui n’ont pas directement travaillé sur la crise ou avec un angle de vuedifférent, permet d’élargir le champ de vision et de trouver des réponses parfoisinattendues mais intéressantes. La deuxième qualité est la mise en évidence duvécu de la société civile, pour remettre en perspective ce que les décisionsamènent pour celle-ci. Les gens agissent, réagissent, se posent des questions etsurtout ont une vision particulière des acteurs. Il y a un décalage entre ce que lesacteurs institutionnels pensent de la société civile et ce que la société civile pense183
des acteurs institutionnels. Donc, ce rapprochement est intéressant et nécessairepour que les messages passent bien, d’autant que la société civile a ses propresréférents à qui elle accorde sa confiance. Il faut que cette confiance puisse êtrereçue de ses référents. Le troisième point fort est la restitution aux acteurs desactions réalisées dans leur globalité, ce qui permet de les inscrire dans une histoirecommune, de partager une expérience et une mémoire commune de l’évènement.Les résultatsLa question posée était «comment intégrer la gestion de crise ?». Un vraiproblème de culture entraîne le rejet du retour d’expérience, ou sa difficileacceptation. La valorisation prend du temps pour se mettre en place. Quand on entire des bénéfices, la culture devient partagée.Le retour d’expérience doit être intégré dans la gestion des risques, notammentpar la prise de décision rapide; c’est-à-dire qu'il faut que la décision de faire unretour d’expérience soit prise immédiatement pendant la crise, voire êtrepréalablement déterminée en amont. Les retours d’expérience doivent se mettreen place avec les systèmes de financement qui les accompagnent. Il faut desmoyens personnalisés d’accompagnement des équipes. Une stratégie claire doitêtre annoncée aux acteurs, incluant une note explicative de ce qu’est le retourd’expérience, préciser dans quel cadre il se fait, et prévoir la restitution destravaux. Par ailleurs il est essentiel que les équipes soient mixtes, publiques etprivées, parce que le privé peut permettre d’élargir les points de vue et dedépasser certains cloisonnements. Enfin, un acteur ne doit en aucun cas êtreoublié par le retour d’expérience : la société civile, les sinistrés, les bénévoles tousceux qui, confrontés à la crise, révèlent tant d’informations importantes à entendredans la perspective d’une autre crise.Pour terminer, il serait intéressant d’avoir recours à des méthodologies que l’onpuisse appliquer régulièrement afin d’avoir des points de référence entre lesdifférentes crises et d’en tirer plus d’enseignements. Le fonds de financement duretour d’expérience devrait être lié à la gestion de la crise, pour pourvoir tirer desrésultats rapides, locaux et suivis. Sur le terrain, c’est très important.184
185
Méthodologie de retour d’expérience des actions de gestiondes risquesJean-Luc WyboARMINES-ENSMPRue Claude Daunesse, 06904 Sophia Antipolis CedexTél : 04 93 95 74 29jean-luc.wybo@ensmp.frNotre étude était destinée à développer une méthodologie et à la valider sur le casd’une crise assez longue, puisque c’était la gestion de la pollution de l’Erika.On insiste beaucoup sur le retour d’expérience. En développant cetteméthodologie, nous nous sommes posés la question : qu'apprend-t-on del’expérience ? Les accidents apportent des connaissances très riches, mais,généralement, ces connaissances constituent des faiblesses. On cherche lescoupables, les personnes qui ont fait une erreur. Cette méthodologie va permettred’améliorer des plans, de savoir quelles ressources il faut acquérir, quelleformation il faut mettre en place. Mais il y aussi toute une partie que nous estimonsessentielle, c’est que dans les gestions de crise, on voit apparaître des choses quimarchent très bien. Le retour d’expérience est aussi destiné à les mettre enévidence. Dans la gestion de l’Erika, on voulait publier un article dans la revue dela gendarmerie, qui se serait intitulé «la gestion de la pollution de l’Erika : l’exempled’une réussite.» Le comité de rédaction a dit qu’il ne pouvait pas accepter ce titre.Donc, finalement c'est devenu : «la gestion de l’Erika» avec en dessous, la thèsedes auteurs selon laquelle c’est une réussite. Les forces du système sont lesbarrières de prévention. Par exemple, dans les Antilles, quand on dit aux gens«vous devez vous protéger, vous mettre dans des lieux protégés», les gens le fontet c’est pour cette raison qu’il y a très peu de victimes. Cette conscience du risque,c’est bien, chaque fois qu’on la constate, de la mettre en retour d’expérience. Demême, s’il y a des dispositifs de protection qui ont bien marché, il faut en parler.On s’intéresse beaucoup aux aspects organisationnels. Un aspect sur lequel oninsiste beaucoup et qui est une grande sortie de ce type de méthodologie, c’estque cela fait apparaître les réseaux d’acteurs qui ont émergé, et pas forcément lesacteurs institutionnels. Il y a tout un organigramme de ce qui devait fonctionner eten réalité, il y a des gens qui émergent, pas forcément parce que d’autres ont failli,mais tout simplement parce qu’à un moment, ils se sont sentis concernés. Ilsmettent souvent en place des modes d’organisation ad hoc qui s’avèrent efficaceset dès que la crise est finie, ces gens reviennent dans l’anonymat et tout cela estperdu. Or, c’est une connaissance importante qu’il faut garder.Quelles sont les conditions nécessaires. Il faut effectivement lors des retoursd’expérience, dissocier le récit de la sanction. Notre méthode est basée surl’anonymat, c’est-à-dire que nous interviewons individuellement les personnes.Une fois qu’elles nous ont donné leur récit et que nous l’avons validé, on enlève à187
partir de ce moment-là, la relation entre qui a dit quoi. Ensuite, nous remettons toutdans un rapport qui est une fusion de l’ensemble des connaissances et des récitset dans lequel chacun a gardé son anonymat et donc ne risque pas d’être mis encause parce qu’il a proposé une idée ou parce qu’il est apparu positionné parrapport à son chef. Deux aspects importants : rechercher les connaissances et lessavoirs de chacun. Il nous est arrivé d’intervenir en complément de l’IGE,notamment dans le Gard et d’entendre des histoires assez notablementcomplémentaires. Ce qui a fait échouer le retour d’expérience dans beaucoupd’entreprises est le fait que l’on prenne aux gens mais qu'on ne leur donne rien. Jepars du principe que le REX doit être une espèce d’auberge espagnole c’est-à-direqu'à l’acteur qui donne son récit, donne des propositions, on doit rendre plus quece qu’il a donné. Notre principe est que tous les acteurs participent à la réunionfinale de débriefing avec le préfet, le patron de l’entreprise, etc. et retrouventl’histoire complète. En plus, ils se retrouvent bien positionnés, dans ce qu'ils ontfait, dans ce qu'ils ont vu, par rapport à l’ensemble. Cela me paraît essentiel etdonne ce côté positif. Généralement, quand ils ont joué une fois, ils nousrappellent pour le prochain incident, pour les aider à comprendre ce qui s’estpassé.Puis, il faut évidemment tirer des leçons. Il y a un certain nombre d’écueils duREX. Il faut passer à travers. Le premier est la recherche de faute. Il est trèstentant d’utiliser le retour d’expérience. Si on rentre dans ce processus, pluspersonne ne parle. Le deuxième est le passage sous les projecteurs, c’est-à-dire leregard des autres sur ses propres actions. Dans toutes les professions, les actionsréussies sont valorisées et les erreurs minimisées ou cachées, d’où l’importancede l’anonymat. Le troisième est l’absence de retour, car si vous ne rendez pas auxgens ce que vous avez pris, c’est sûr que la fois suivante, ils ne participeront pas.L’objectif de notre méthode REX est le partage des connaissances. Il faut arriver àdes formats identiques des REX. Ce n’est pas le même contenu mais la mêmeforme. Ainsi, une fois que vous l’avez fait avec une entreprise, un service, unpréfet, on est capable de lire ceux qui ont été faits dans un autre département, unautre service parce que c’est la même forme. Ce qui est extrêmement gênant dansbeaucoup de domaines, c’est que les documents n’ont pas la même forme et vousêtes obligés de rentrer dans tout le document pour comprendre ce qui s’est passé.La méthode est fondée sur l’interview des personnes concernées, individuelle,anonyme. On sollicite la mémoire épisodique, c’est-à-dire qu’on laisse les gensraconter. On n’a pas un questionnaire type. On leur laisse raconter «leur truc» etaprès on revient. On a défini depuis quelques années un modèle relativementstable que l’on appelle l’atome d’expérience ou le cycle de décision. Dans votremémoire épisodique, vous vous rappelez ce qui a changé d’une situation à l’autre.On a découpé en 4 phases : comment l’acteur perçoit le nouveau contexte,comment il l’analyse, avec éventuellement plusieurs hypothèses. Il en choisit une,les décisions qu’il prend et éventuellement, s’il en a une évaluation, les effets decette décision et on arrive à une nouvelle situation. Une histoire se découpe en 5-6-10 atomes d’expérience.Quelles sont les étapes de cette méthode ? La collecte des données classiques,l’établissement du chronogramme, les entretiens individuels. Identifier les188
personnes concernées, c’est généralement hiérarchique. Le préfet appelle le mairequi lui-même désigne les personnes ayant participé à la cellule de crise, puis cespersonnes nous donnent à leur tour des noms. C’est ce processus qui permet dedescendre vers les acteurs de base qui ont un rôle important et qui, par la seuleapproche administrative, n’auraient jamais été identifiés. Pour le recueil du récit, àchaque fois, on demande aux acteurs : est-ce qu’on aurait pu faire autrement ?Est-ce qu’on aurait pu faire pire ? Aurait-on pu faire mieux ? Et vous-même, avezvousutilisé votre propre expérience ? Et de là, on remonte vers leur propreexpérience. C’est pour essayer d’avoir un peu de connaissance classique. A partirde là, on remonte ensuite vers les décisions et au fil conducteur qui est unenchaînement de ces décisions. L’objectif est de donner une image globale de lasuccession des événements et des décisions qui soit surtout compréhensible. Ilfaut avant tout définir les artefacts, les représentations. On essaie de faire quecette image globale soit facile à comprendre par tous les acteurs. Puis, on leurdonne ces éléments et on réunit tout le monde de manière à valider collectivementces connaissances et surtout à créer des opportunités de dialogue. Pour résumer,les gens «d’en haut», le patron d’usine, le préfet, on va plutôt leur poser desquestions en termes de «pourquoi avez-vous pris telle décision ?», parce quegénéralement, ils ne l’expliquent pas; ils prennent des décisions et les gens nesavent pas trop pourquoi ils l’ont prise, donc ils apprennent beaucoup. Et on vademander aux gens qui sont plutôt les exécutants comment ils ont fait les chosesce qui permet aux gens qui donnent les ordres de comprendre éventuellement lesdifficultés de mise en place des ordres qu’ils donnent. A partir de là, on tire desenseignements de cette analyse et éventuellement les suites à donner.L’étude est accessible sur le web. C’est l’exemple de Belle Isle; on a travaillé 5-6fois. Ce qu’il faut retenir, c’est le réseau d’acteurs qui s’est mis en place pour gérerla crise. Ce qui est important, c’est de voir tous les acteurs du plan POLMAR dansles cases marron, et tous ceux qui n'y étaient pas dans les cases blanches. Vousvoyez ainsi la réalité de l’organisation qui a émergé de cette gestion de crise, oùpour la première fois, un industriel intervenait dans sa propre pollution. La DDElocale, qui était sous-équipée par rapport à la quantité de problèmes à résoudre, amis en place des chantiers payés sur les fonds POLMAR mais dans le mêmetemps, la collectivité de communes a mis en place le recrutement de chefs dechantier en CDD, qui eux-mêmes, ont encadré des chantiers CDD. Total a financédes chantiers, le CEDRE est intervenu pour donner des conseils méthodologiqueset les pêcheurs, les associations ont agi. Une structure s'est mise en place. Ce quiest important, c’est que si demain, on doit refaire un plan POLMAR, il faut partir deces structures qui marchent et ne pas réinventer une structure administrativecalquée sur un modèle qui n’est pas forcément celui qui tiendra dans la réalité.L'arrivée de 600 bénévoles par jour par le bateau du matin, a vraiment été lasource de la crise, tout le monde voulait sauver la Bretagne. Ce sont les troissénateurs, retraités, qui se sont mis en mouvement spontanément pour résoudreles problèmes de nourriture, d'hébergement, etc. S’ils ne l’avaient pas fait, il yaurait eu une vraie crise. C’était pour vous montrer comment, à partir de cetteanalyse, on arrive à évaluer l’évolution du niveau de dégradation d’une situation.L’arrivée des volontaires a créé cette situation critique.189
Comment a-t-on valorisé ? Cette méthode a été étendue à d’autres domaines,notamment aux risques industriels et aux transports. On a défini une échelle deretour d’expérience en fonction de la déstabilisation de l’organisation. On met unREX de plus en plus lourd et de plus en plus coûteux en ressources, sachant quepour les événements où on n'apprend rien, ce n’est pas la peine d’aller faire duREX. On l’a étendu l’année dernière au REX d’exercice parce qu’heureusement, ily a très peu de crise et les exercices sont une source d’apprentissagecomplètement sous-évaluée. La plupart du temps, il y a juste un débriefing.Maintenant, on a adapté la méthode. L’avantage est que l’on n'interviewe pas lesgens après mais on intervient en temps réel. Donc, il y a trois points de vue : suivreun acteur particulier, par exemple le préfet, le pompier, suivre une activité ouobserver ce qui se passe dans un lieu. On a testé la méthode en Finlande. On l’afait deux fois en France. Surtout, il faut faire du transfert aux opérationnels; je faismaintenant régulièrement des formations de sapeurs-pompiers, et puis la Directionde la Sécurité Civile nous a demandé, à partir de cette méthode, de faire un guideméthodologique pour les préfectures, qui sera mis en place dès l’année prochaine.190
Production et diffusion des connaissances suite à un désastretechnologique : mécanismes incitatifs et institutionnelsEmmanuelle FauchartCNAM292, rue Saint Martin, 75141 Paris Cedex 03Tél : 01 40 27 25 05fauchart@cnam.frJ’ai travaillé avec trois Anglo-saxons sur ce projet, ce qui m’a obligé à voir le côtépositif et pragmatique. Cette intervention présente les différentes études réalisées,plutôt que de vous exposer des résultats particuliers.Nous avons fait une première étude qui a été financée par le programme EPR surles questions suivantes : apprend-on des désastres technologiques ou desaccidents technologiques ? Ces désastres technologiques sont-ils l’occasion deproduire des nouvelles connaissances ?Nous avons pris un cas particulier, celui de THERAC 25, une machine detraitement du cancer qui était une des premières machines médicales commandéepar logiciel alors qu’auparavant la commande était manuelle. Dans la nouvelleversion, un défaut de logiciel est apparu et la machine envoyait plus de rayons quenécessaire. Il y a eu quelques morts en Amérique du nord. Cet accident a étél’occasion d’apprendre beaucoup sur les machines contrôlées par ordinateur, surles logiciels, sur les aspects sécurité… Notre objectif a donc été de montrer quellessont les conditions au niveau de l’apprentissage de la firme elle-même et del’apprentissage collectif, puisqu’il y a des enjeux de bien-être collectif, de welfare,pour qu’un accident ou un désastre technologique soit l’occasion de produire desconnaissances. Nous avons constaté qu’au niveau de la firme, la propension, laprobabilité d’apprentissage est vraiment liée aux caractéristiques de l’entrepriseavant l’accident, c’est-à-dire que certaines entreprises ont instauré comme activitéroutinière l’apprentissage par la pratique, learning by doing. Ces entreprises sontplus capables, lorsqu’il y a un accident ou un incident, donc un événementimprévu, d’apprendre de la crise de l’accident alors que celles qui n’ont pas cetteculture sont moins aptes à apprendre et à produire des connaissances. Dans lecas de THERAC, la judiciarisation, liée au fait qu’il y ait eu des morts, a été propiceà l’apprentissage et à la production de connaissances puisque des experts ont étécommis. Une spécialiste du logiciel du MIT a eu accès à des informationsauxquelles elle n’aurait jamais eu accès s’il n’y a avait pas eu les procès. Elle apublié un article.Nous avons ensuite étudié la diffusion des connaissances produites par cedésastre grâce à une méthodologie inspirée des études de diffusion desconnaissances à partir des bases de brevet. Les citations, les patterns de cetarticle dans le domaine informatique, logiciel, médical ont été analysés et nous191
avons constaté des relations intéressantes sur les processus de diffusion entredomaines, temporel et géographique.La troisième recherche porte sur les bonnes propriétés des structures decommunication, c’est-à-dire les structures permettant de diffuser plus facilementles connaissances suite à un désastre. A partir de la notion de «petit monde» dansla littérature sur les réseaux de communication, l’un des participants à notre projeta montré quelle serait une bonne structure de communication pour favoriser ladiffusion des connaissances après un désastre technologique. Il s’agit que lesautres entreprises ou les autres agents qui peuvent être intéressés par lesinformations et par les connaissances produites par le désastre y aient accès, pourpouvoir les utiliser, pour éviter que ne se reproduisent des désastres ou accidentssimilaires. Ces études débouchent sur des propositions, sur des types destructures de communication qui pourraient favoriser cette diffusion.Un autre des participants qui est un Américain a fait un modèle de choixtechnologiques. Il est spécialiste du nucléaire. Il conseille des Gouvernements surles choix pour les prochaines générations sur les technologies nucléaires. Il aproduit un modèle qui est utilisé intégrant la notion de risque, les probabilitésd’accident, pour aider à choisir les prochaines technologies, pour faire des choixtechnologiques quand il y a des investissements majeurs considérables en jeu,mais également quand il y a des probabilités d’accidents…Le côté retour d’expérience de notre projet est le travail qui est en cours. J’étudiele partage d’information sur les problèmes de sécurité dans l’industrie du chlore enEurope. L'industrie du chlore a été choisie parce que c'est une industrie avec desrisques importants, mais connue aussi pour le partage d’information sur la sécurité,pour le retour d’expérience et le partage du retour d’expérience. L’hypothèse dedépart était qu'il y avait une relation entre le partage l’information entre les firmesconcurrentes dans ce secteur sur la sécurité et les bonnes performances entermes de sécurité. Comment l’information est-elle partagée ? Quelles sont lespropriétés du partage de l’information dans ce secteur ? Les firmes sont incitées àpartager parce qu’il y a des menaces lourdes sur le secteur, notamment par lasociété civile, les associations vertes. Par exemple, sur le site de Greenpeace, ontrouve des indications pour remplacer le chlore par d’autres produits. Les firmes del’industrie ont l’impression d’une menace qui pèse sur eux, c’est-à-dire que si unincident ou un accident grave se produit, leur propre survie est en danger. Unebonne motivation pour partager l’information sécurité est le risque collectif.Autrement dit, le problème d'une firme n’est pas seulement d’avoir un incident surun des sites mais s’il y a un incident sur un des sites concurrents, elle est menacéeaussi dans sa survie.J’étais à Bruxelles la semaine dernière à EuroChlor, à laquelle quasiment toutesles firmes européennes du chlore sont adhérentes. Cette association constate quel’information tend à être moins partagée aujourd’hui. Parmi les explications, il y a lefait que la fréquence des incidents est moins forte. Donc, quand les incidentsdiminuent, les firmes sont moins enclines à faire les investissements, les effortspour partager l’information, malgré la menace qui pèse sur l’industrie. Pourquoisupporter les coûts du partage ? Une autre explication est liée aux documents.192
EuroChlor essaie de développer un document standard leur permettant decomparer et de mettre les informations sur une base de données. Or, lesentreprises estiment qu'elles ont déjà des rapports à rédiger pour les autoritésnationales et pour leur propre entreprise. Dans un sens, la standardisation estnécessaire pour exploiter les informations mais de l’autre, un coût supplémentaireest généré pour les entreprises. De plus, elles estiment que depuis que ledocument standard est mis en place, le retour des rapports d’incident dans leurbase de données est retardé.J’ai réalisé un questionnaire qui sera distribué à tous les chloriers européens pourétudier les caractéristiques du partage d’information entre les employés de firmesdifférentes et au niveau d’EuroChlor, pour voir s’il existe plusieurs modes departage d’information. Si oui, quelles sont leurs caractéristiques, qu’est-ce qui lesdifférencie ? Ont-ils des efficacités différentes, c’est-à-dire est-ce que lesexternalités d’information diffèrent selon le mode de partage ? L’hypothèse est quele partage d’information peut être très organisé avec des investissements, desdocuments collectifs, une stratégie du partage ou au contraire il peut être informel,sans trace, sans document avec des externalités d’information très faibles. Ce sontdeux modes de partage mais l’efficacité économique n’est pas la même dans lesdeux cas.Bernard BarraquéJe vous rappelle que les questions que nous avions à traiter dans ce colloqueétaient : le retour d’expérience se développe, quels sont les obstacles ? Existe-t-ildes typologies de retour d’expérience pour différents types de risque ? Commentmieux intégrer le retour d’expérience dans la gestion des risques ? Des différencesculturelles apparaissent-elles ? Mr Hugodot a dit tout à l’heure, que les nouvellestechnologies ne sont pas assez étudiées. On a dans la salle Gabrielle De Brito quivient de réaliser une recherche sur la diffusion de l’information par les nouvellestechnologies de communication après la catastrophe d’AZF. Par ailleurs, des genssont très concernés par les retours d’expérience, notamment les inspectionsgénérales. La question que je voudrais leur poser est la suivante : est-ce que notreprogramme de recherche en matière de retour d’expérience vous est utile ? Est-ceque cela transforme la façon dont vous faites des inspections généralesnotamment après des catastrophes ?193
Table ronde 4 :Comment faire des retoursd'expérience ?Bastien Affeltranger, UNU-EHSDébatUne question qui porte sur la réception, l’accueil qui est fait au niveau du personneldans les sites industriels sur ces procédures de retour d’expérience. Vous semblet-ilque les différentes générations de professionnels, d’acteurs de l’entreprisetravaillant actuellement sur les sites ont des perceptions différentes de cesdémarches de retours d’expérience ? Quelqu’un qui travaille depuis 30 ans dansun site donné est-il plus réticent à réviser ses pratiques que quelqu’un quicommence sa carrière professionnelle dans ce domaine et qui a peut-être eu uneautre formation ? Si vous avez repéré des réticences de cette nature, commentsuggérez-vous qu’on réussisse à convaincre les plus anciens de ces sites àprendre part à ces démarches car ils sont aussi une part importante de la mémoireindustrielle.Jean-Luc Wybo, ENSMPVous êtes dans la ligne «monsieur, on va remettre en cause vos pratiques». Sivous partez de là, déjà, vous échouez. Par exemple, quand on s'entretient avec unacteur qui a fait une bêtise, on parle d’erreur de diagnostic, technique, de stratégieet non de faute. On lui demande : quelles sont vos propositions pour ne pas faired’erreurs et sortir du positif à la place. Dans le rapport, la seule chose qui apparaîtest la proposition qui n’est pas nominative. Je lui demande en tête à tête lors del’interview, si lors de la restitution, il est prêt à prendre la parole, donc à rendre, ànominer et à exposer sa proposition. 100% des gens m’ont répondu oui. Celadédramatise l’attitude. C’est un peu plus difficile pour les personnes qui ont 30 ansd’ancienneté car souvent, ils sont à l’origine de ces poches de résilience qui ontpermis à l’organisation de tenir, c’est-à-dire qu’ils ont appliqué des gestes.Patrick Chaskiel, LERASS, Université de Toulouse 3Une remarque sur l’absence de retour d’expérience de la catastrophe AZF. Cetteabsence peut en partie s’expliquer dans la mesure où la catastrophe d’AZF a étécomplexe sur le plan technique. Les causes de l’explosion n'ont toujours pas étéidentifiées formellement et un conflit s'est instauré entre les industriels qui étaientimplantés sur le lieu de la catastrophe. Il y a eu énormément de procéduresjudiciaires qui sont la plupart du temps en cours. Cette explication est possiblemais elle n’est pas fondamentale à mon sens. La catastrophe d’AZF a entraînéune crise civique que l’on n'observe pas en règle générale à la suite d’autres195
catastrophes comme par exemple les inondations, les tempêtes. De fait, cette crisecivique a mis au premier plan deux composantes de la société civile : une largepartie des associations qui existaient ou qui se sont constituées après lacatastrophe et également les syndicats du site. Sur le transparent projeté hier surla scène du risque, il manquait quand même cette composante syndicale. Lessyndicats, dans la plupart des cas, sont partie prenante du risque y compris durisque naturel, notamment quand le risque naturel peut se transformer en risqueindustriel. Il faudrait que l’on réfléchisse à l’absence à la fois de l’implication fortedes syndicats dans la question du risque et aussi à l’absence de la sollicitation desorganisations syndicales. Les éléments sont à double tranchant. S’il y avait eu unretour d’expérience dans les mois qui ont suivi la catastrophe, il faut imaginer quecelui-ci aurait été un enjeu du conflit. Toutes les interactions qui se sontdéveloppées après la catastrophe ont été conflictuelles à partir du moment oùl’issue du conflit n’était pas déterminée. Aujourd’hui les clameurs se sont-elles tuesbien qu’il y ait une hypersensibilité locale qui émerge de temps en temps ? Unretour d’expérience pourrait-il se tenir ? La question est de savoir comment. Je faisune spéculation. Il me semble que dans ces cas-là, le fait que le retourd'expérience soit mené par des acteurs du conflit aurait des effets négatifs. Quipourrait mener, dans une situation qui a été très conflictuelle, un retourd’expérience qui ne perpétue pas le conflit ?Claude Gilbert, Président du conseil scientifique, CNRSUne esquisse de réponse à ce qui vient d’être dit en me fondant sur les propos dePierre-Marie Sarant. Il est tout à fait clair que si le retour d’expérience n’est pasinscrit dans des procédures normales, il devient aussitôt un enjeu. Il suffit de voircomment sont nommées les commissions. Tout cela renvoie à un jeu politiquecomplexe. Concernant le Québec, il est évident que la culture est très différente dela nôtre, puisque des retours d’expérience sont faits à propos d’événementsimportants. Dans ces cas-là, ce sont plutôt les instances locales qui prennent desinitiatives, en intégrant le monde de l’université, le monde scientifique au senslarge. D’autres acteurs interviennent également. Or, dans le contexte français, lesinstances locales quelles qu’elles soient, n’ont pas cette capacité d’initiative. Quantaux universitaires et scientifiques, ils n’interviennent pas dans le retourd’expérience sinon de façon marginale en tant qu’expert ou bien, en étantauditionnés dans le cadre de commissions d’enquête. Il y a un autre dispositif àinventer. Dans le cas actuel, le dispositif étatique, toujours marqué par desprocédures exceptionnelles, est voué à l’échec : il tend à devenir en enjeu en tantque tel.Philippe Huet, président du comité d'orientation, IGETout ce que vous avez fait, tout ce que vous faîtes nous a beaucoup aidé etcontinue à beaucoup nous aider. On souhaite que cela continue et que cela serenforce. Les méthodes de Jean-Luc Wybo sont remarquables à condition quecela soit dans les mains de gens comme lui, de gens expérimentés, vu les enjeux.Nous avons pris l’habitude des retours d’expérience. Nous en avons réalisé unedizaine dans les dix dernières années et nous en avons dressé un bilan. Nous196
avons pris l’habitude de s’inspirer de vos méthodes et de mettre à côté de nous ungroupe d’expertise collective scientifique qui nous aide. Il fait l’état de l’art sur lesquestions que nous recevons sur le terrain. Il est indépendant. Il nous dit, lorsquec’est très conflictuel, quels sont les points d’accord entre scientifiques, les pointsqui font débat et quelles sont les voies de progrès. Nous avons mis en place sixfois ce dispositif, à partir duquel on demande qu’un bilan de ce type de grouped'expertise soit réalisé. Il y a là un exemple de coopération chercheurs /opérationnels. Est-ce que «quand c’est l’État, c’est voué à l’échec» est un vraidébat ? Cela dépend des cas. Il y a des cas où il ne faut surtout pas que cela soitl’État et il y a des cas où il n’y a que l’État qui puisse le faire.Jean-Luc Wybo, ENSMPSur AZF, il se trouve que j’avais une étudiante dans une usine proche de celle deToulouse et qui faisait un stage sur le retour d’expérience. J’ai proposé à ladirection d’ATOFINA de mettre à leur disposition cette étudiante et mon équipepour les aider à faire du REX. Ils nous ont dit «non, merci». La vraie question estque ce n’est pas une crise industrielle mais une crise de l’assurance. Il n’y a pasde crise industrielle. Il y a un accident industriel qui a créé une crise. La crise est lamauvaise gestion des dégâts de l’explosion.Jacques Roux, CRESALJ’ai l’impression que les modèles qui sont présentés sont tous centrés sur lescatastrophes majeures. On a parlé des exercices. C’est très intéressant que vouscommenciez à travailler sur des formes expérimentales qui ne sont pas forcémentdes formes abouties de la catastrophe, mais déjà totalement cristallisées avec desrisques de blocage. Donc, ne faudrait-il pas repenser la question del’aguerrissement ou de la vigilance face au risque ? Que l’on arrête de penser entermes de grandes crises, mais que l’on essaie de nourrir tout ce qui estintermédiaire, que j’appelle la pédagogie des petites crises ? Que l’on fasse duretour d’expérience et de la pédagogie sur ces événements, qu’on investissebeaucoup et qu’on pense aussi la qualité éducative et politique de ces expériencesde petite et moyenne dimensions ?Christine Blandel, Mairie de MarseilleLa notion de partage est essentielle. Quelles sont les conditions pour une mise enpratique ? La démarche a pour objectif un décloisonnement. Or, il n’y a pasvraiment de pluridisciplinarité.197
Table ronde 5 : Connaîtredes expériences étrangèresen matière de gestion des risques ?Cette table ronde traite de l'analyse comparative.L'analyse comparative est une richesse. Quels sont les élémentspertinents de comparaison ? Comment développer les approchescomparatives ?Co-animateurs :Marc Poumadère, ENS Cachan / GRIDYves Le Bars, CemagrefIntervenants :Bernard Barraqué, LATTSJean-Roland Barthélémy, Fondation des VillesNicolas Buclet, Université de Technologie de TroyesBruno Ledoux, Syndicat interdépartemental de VidourleMarc PoumadèreCette dernière table ronde traite des questions internationales. L’avantage d’être ladernière table ronde permet évidemment de faire des liens avec ce qui a précédé.Un point important dans cette perspective est apparu autour des notions de puretéet d’impureté. Une collègue anglaise Mary Douglas a écrit un livre qui s’appelaitDanger et purety, qui traite des fonctions symboliques et sociales de la gestion desrisques dans les sociétés traditionnelles en Afrique de l’Ouest. Voilà une brèveintroduction.Yves Le BarsConnaître les expériences étrangères revient à chercher à dépayser une questiondans le but de comprendre ce qui est intrinsèque et ce qui est relatif. C’est aussidécouvrir des dimensions invisibles, comprendre sa propre situation et profiter d’unréservoir de bonnes solutions. En même temps, l’expérience internationale estsouvent convoquée par intérêt ou par facilité. Il y a donc matière à construire une199
démarche scientifique dans le domaine de la comparaison internationale, d’où lesquestions : quel est le bilan des travaux de connaissance des expériencesétrangères, les secteurs couverts, les moyens d’investigation, l’ambition de lacomparaison internationale ? La monographie ou l’analyse comparative sont desméthodologies possibles. Quelles sont les méthodologies garantissant la prise dedistance pour que le travail de recherche puisse se construire ? Quels sont lesenseignements pour la situation française ? Quelle est l'insertion des résultatsdans le contexte français ?Un outil particulier de connaissance est celui des réseaux européens et mondiaux,dans lesquels les organismes de recherche savent maintenant s'impliquer. Dans lecas du Cemagref, ont été créés un réseau sur l’eau (Euraqua) et un réseau PEER,Partnership for European environmental research, le BRGM étant quant à luiégalement impliqué dans EurogeoSurveyPuisque cette introduction est surtout fondée sur une expérience de la gestion desdéchets radioactifs, j'ajoute qu'en tant que président de l'Andra, j'ai présidé le clubdes dirigeants mondiaux d’agences analogue à l’ANDRA, ainsi qu'un forum, leForum for Stakeholders Confidence (FSC) à l’OCDE. De plus, j’ai participé à unprogramme européen CoWaM «community waste management» qui examinaitcomment les communautés territoriales s'impliquent dans la gestion des déchetsradioactifs. Le constat de toutes ces comparaisons internationales est rapide. Unetrès bonne internationalisation des questions techniques a été réussie, avec desgroupes de l'OCDE, de l'AIEA, ou par des programmes bilatéraux. La division dutravail technique se décline assez bien au niveau européen et mondial. Par contre,on constate une plus grande hétérogénéité dans la capacité à travailler lesquestions de gouvernance. Sur ce sujet, des progrès faciles supposent que l'onsache tenir compte des particularités nationales.Voici un exemple de ce que peut apporter un regard international. En France, unecontroverse sur la méthodologie de l’inventaire des déchets radioactifs s'étaitengagée en 1976/77. Quand j’ai été nommé président de l’ANDRA, une missionsur la méthodologie de l’inventaire m'a été confiée. J’ai traversé la Manche pourvoir ce que faisaient nos homologues, et j'ai trouvé des éléments très structurantspour définir des solutions. En Belgique, l’agence analogue à l’ANDRA dressel’inventaire des déchets mais réalise aussi l’inventaire des «passifs», c’est-à-diredes financements à long terme que les entreprises doivent mettre en provisionpour la charge future de ces déchets. En France, cette forme de comptabilitéd'inventaire n'existe pas. Cette absence mérite d'être analysée : elle révèle un jeud'acteurs très particulier à la France, et certaines faiblesses…Le forum de l’OCDE (FSC) a conclu, que dans la gestion de ce type de risque(déchets radioactifs, risques biosociaux) mêlant à la fois les dimensions biologique,technique et sociale, il y avait besoin d’un processus bien établi par étapes, avecdes échéances, introduisant le dialogue avec les partenaires et impliquant larecherche avec une évaluation indépendante. Toujours en comparant au niveauinternational, on constate que la Suisse n’a pas la même manière que la Finlandeou la Grande-Bretagne pour décliner les différentes étapes dans le travail de lagestion des déchets radioactifs. La France a une position très particulière : elle n'a200
pas encore fait de choix stratégique, les différentes solutions pour la gestion à longterme des déchets radioactifs de haute activité restent ouvertes (transmutation,entreposage et stockage), mais en même temps, seule la France possède un sitepotentiel affiché, celui de Meuse-Haute Marne. Un deuxième aspect mis enévidence par le FSC concerne la structure des acteurs, dont le rôle doit être biendéfini. A l’intérieur, chaque organisation doit avoir un comportement adapté, ce quirevient à accepter le dialogue.Quand on regarde le statut des organismes qui traitent de la gestion des déchetsradioactifs, on constate aussi que les plus étatiques, ce sont les États-Unis : laFédération est propriétaire des déchets dès leur sortie des centrales nucléaires, etc'est une administration qui les prend en charge. D’autres pays ont desorganismes opérateurs qui sont des coopératives ou des filiales des électriciens,d’autres comme la France ont un organisme public. L’ANDRA, organisme encharge est un établissement public dépendant de l’État. Les configurations sonttrès différentes et reflètent une culture.L’implication des partenaires dans la définition et la mise en œuvre des solutionsexigent une nouvelle culture dans les organisations, ce qui suppose des valeurs etdes aptitudes nouvelles. Cela demande aussi que les acteurs principaux acceptenttous les aspects du nouveau contexte de la décision publique, où la controverse àune place, et où les éléments techniques sont accessibles dans un systèmedocumentaire exhaustif.Dernière exigence pour l'expert, qu'il soit au clair avec son propre irrationnel, avecses présupposés et ses attachements. Quand on voit en France le nombre detechniciens du nucléaire qui «aime» le nucléaire, ... On doit aimer son travail, maisgarder ses distances avec l'objet de son travail…201
La protection contre les inondations en Franceet en AngleterreDes mesures structurelles à la réduction des vulnérabilitésBernard BarraquéLATTS6-8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes Champs-sur-Marne77455 Marne la Vallée cedex 2Tél : 01 64 15 38 23barraque@latts.enpc.frDes financements européens ont permis de faire des comparaisons de politiquesdans le domaine de l’eau. Ainsi, un partenariat nommé Eurofloods, regroupant deséquipes de quatre pays a initié une recherche comparative, sur les procédures, auniveau de la modélisation des dommages, de la connaissance technique… Enrevanche, le coordinateur, aujourd’hui ministre de l’Environnement du Portugal,souffrait qu’il n’y ait pas de mise en contexte des différences : il manquait uneintelligence comparée des institutions de gestion de l’eau des différents pays. C’estpourquoi à la suite d’Eurofloods, il a lancé un autre projet, Eurowater, auquel notrelaboratoire, le LATTS, a participé. J’ai découvert l’importance fondamentale descomparaisons européennes pour comprendre l’amélioration possible despolitiques. C’est une chance historique d’être dans cette union européenne enconstruction puisqu'il faut fabriquer des choses nouvelles communes et en mêmetemps respecter les diversités. Nous voulions travailler dans cet état d’esprit.Le LATTS, Techniques, Territoire et Société, a systématiquement organisé sontravail autour d’une approche des objets socio-techniques dans une perspectivecomparative internationale et historique de longue durée. Il se trouve que danscertains cas, comme celui de la Loire, pour bien comprendre ce qui se passe, il estutile de remonter loin dans l’histoire. Une étudiante de DEA, géographe et juriste,voulait faire une thèse sur l’évolution des politiques de prévention des inondationset des feux de forêt. Nous avions tout de suite émis l’hypothèse que le feu de forêt,concernant des espaces terrestres, était lié à la propriété privée et son rapport àl’État, à une certaine approche de la valeur du foncier. Depuis la Révolution, lasociété française est construite sur une opposition structurelle entre propriétéprivée et État, elle-même redondante avec une autre opposition structurante, entreÉtat et collectivités locales. Nous avons décidé d’encadrer le sujet principal de lathèse qui était le risque d’inondation et sa prise en compte dans l’aménagement,en intégrant les recherches précédentes effectuées lors du DEA de l'étudiante surl’instauration des PIG par les préfets dans le Loiret et dans l’Indre-et-Loire, puis encomparant avec l’Angleterre.La différence entre l’inondation et le feu de forêt est que l'eau est un bienparticulier selon le droit français. Quand la loi de 1992 définit l’eau commepatrimoine commun, cela signifie que ce bien n’est pas sujet à appropriation, il PIG : Plan d'intérêt général203
échappe à la propriété et est donc du même statut qu’un communal ou descommons en anglais. Immédiatement, un lien s'établit avec l’Angleterre dont lesystème juridique est entièrement fondé sur un système de droit commungénéralisé avec quelques restrictions. La comparaison entre les deux systèmes,français et anglais, semblait intéressante. Le fait qu’il y ait moins de crispation surl’eau que sur les sols, lié au statut juridique et institutionnel de l’eau, conduirait àune émergence plus précoce, partout dans le monde, de formes de gestion multiniveaux.En revanche, très vite, nous nous sommes aperçus que l’Angleterren’était pas le seul point de comparaison, la France et l’Angleterre ayant pourcaractéristique d’avoir eu des politiques centralisées de gestion de l’eau et desinondations.Comme le financement était français et que la doctorante devait principalementtravailler sur la Loire, une ou deux missions ont été effectuées en Angleterre maisles cas n'ont pu être multipliés. Ainsi, nos propos aujourd’hui n'ont pas forcémentvaleur générale. Pour réaliser des comparaisons internationales, il faut du temps.Notre question de départ était centrée sur : quel type d’institution, de gouvernanceassure la prévention des inondations par l’urbanisme et l’aménagement ?A la suite des inondations de l’Elbe, nous avons organisé avec Anne-PauleMettoux, Jean-Roland Barthélémy, Bruno Ledoux et quelques autres personnes uncolloque de valorisation commun aux programmes EPR et RIO, en décembre2003, sur les aspects socio-économiques de l'inondation. La problématiquecommune était de répondre à ces trois questions en même temps : commentcouvre-t-on les dommages dans un pays donné ? Comment fait-on la prévention ?Les politiques précédentes sont-elles liées par une réflexion commune voire parune territorialisation commune ? Le colloque de 2003 s’est déroulé dans desconditions de préparation un peu difficiles d'où une certaine frustration, notammentparce que nous n’avons pas pu faire venir tous les intervenants que noussouhaitions. Le deuxième problème est que les enregistrements ont été réaliséssur les bandes des traducteurs, non pas sur les intervenants, et nous avonsrencontré les mêmes difficultés que les négociations internationales avec leproblème de traduction! Néanmoins, les actes de ce colloque pourront êtreconsultés avec profit, car il couvrait plusieurs pays, de l’Angleterre à l’Italie enpassant par l’Allemagne, les Pays Bas et la Suisse.Dans les deux pays France-Angleterre, une nouvelle structuration émerge à lasuite d’inondations inédites, mais dans un contexte de décentralisation. Lesmesures structurelles sont plus ou moins explicitement abandonnées et il apparaîtpar ailleurs difficile de passer d’une approche structurelle étatique à une approchepurement libérale fondée sur les risques assumés par les seuls habitants et lesystème assurantiel. Donc, il faut trouver des solutions d’aménagement, deprévention, qui passent par des formes habituelles. L’idée, notamment dans le casde la Loire, est que le discours du développement durable légitime un changementcomplet d’attitude de grands élus locaux qui jusque là étaient enfermés dans uneopposition stérile à l’État. Celui-ci était perçu comme un grand traître et unresponsable de l’abandon. Une nouvelle problématique de l’eau, prise en chargeplus localement grâce à un processus d’apprentissage collectif, permet aux élus dese re-légitimer sur le thème du développement durable : la zone inondable est204
valorisable en termes de bio-diversité, et on peut aussi lui trouver une fonctionpositive sue le plan économique, tout en réduisant la vulnérabilité : on retrouve làles trois dimensions du développement durable.Quand la France décide que l’eau est un patrimoine commun pour la Nation, ellene fait que se rapprocher du statut de l’eau dans la plupart des autres payseuropéens, statut de non appropriation et de chose commune. L’eau n’est pas undomaine public de l’État. On est alors obligé d’avoir des institutions degouvernance multi-niveaux qui servent à construire une intermédiation entreacteurs publics. En France, certains de nos EPTB ont déjà franchi le pas etdeviennent des institutions relais pour faire de l’apprentissage collectif (Loire,Dordogne). En Angleterre, il n’y a pas de tradition d’EPTB. Le grand problèmehistorique était le drainage comme aux Pays-Bas. Or, plus ces mesureshydrauliques étaient mises en œuvre (afin de gagner des terres rurales), plus lesvilles étaient soumises au risque d’inondation. La problématique a basculé aussidans les années 1980, avec une répétition d’inondations inconnues jusque là.Comme les Drainage boards n’ont jamais été véritablement intégrés à une gestionglobale de l’eau, des institutions tierces - les Comtés - s’emparent de la question,alors qu’elles n’étaient pas du tout impliquées dans le domaine de l’eau. Deux casont été étudiés où les Comtés se saisissent de l’occurrence de cruesexceptionnelles aux effets socio-économiques graves, pour rebondir et créer unepolitique de gestion intégrée de l’eau. En France, on a aussi une montée enpuissance de contrats de rivière, de SAGE, de politiques portées par les Conseilsgénéraux qui sont soutenues par les Agences de l’eau. Dans les deux pays, c’estnouveau et intéressant de le constater, même si ce n’est pas systématique nitoujours très réussi.205
Evaluation économique du risque d'inondation, comparaisonFrance / Pays BasJean-Roland BarthélémyFondation des Villes37 rue Huguerie, 33000 BordeauxTél : 05 56 44 72 06Jrb.fdv@wanadoo.frLa comparaison est évidemment toujours un problème. Le point de départ de notrerecherche était le fait que l’analyse socio-économique du risque inondation avaitété apparemment utilisée comme un outil de changement des approches enmatière de prévention aux Pays-Bas alors qu’en France, on constatait que lesétudes qui avaient été menées, même si elles étaient plus approfondies que cellesdes Pays-Bas, n’avaient pas abouti à des résultats aussi manifestes.La question institutionnelle est à prendre en compte. Aux Pays-Bas, descollectivités spécifiques gèrent les ouvrages de protection, les waterschapen. Cesont des collectivités de l’eau qui possèdent leur propre système d’imposition desménages et qui gèrent à une échelle géographique supracommunale, des routeset certains services publics. Un ministère, hérité de Napoléon, s’occupeégalement, au niveau national, de la protection du pays, dont toutes les dunesprotégeant de la mer, et de la politique de prévention des inondations. Ce systèmeest différent de celui de la France où l’État est responsable de bien des ouvragessur la plupart des grands cours d’eau. Par ailleurs, les collectivités locales,notamment les grandes villes ont des politiques propres, mais limitées à leurterritoire.Faire la comparaison était parfois assez difficile. L'objectif était de cerner le rôlejoué par les études économiques et les études sur les conséquences économiquesdes inondations. La remise en cause du pouvoir institutionnel de l'État dans laprotection n'est pas à l'origine de la comparaison entre ces évaluations et lesinvestissements éventuels de protection, voire le choix de telle ou telle modalitéd’investissement. En effet, la réflexion a commencé avec la réaction desassociations face à des politiques de renforcement programmées sur de longuespériodes suite aux inondations de 1953, inondations particulièrement meurtrièresavec une entrée de la mer dans le pays et une rupture de digues; face à desprotections qui prenaient une importance trop grande, notamment en matièred’environnement, de protection de zones historiques derrière les digues,l’hypothèse qui a été avancée était une alternative avec des techniques plusenvironnementales et intégrées, permettant de mieux gérer le cours de la rivièretelles que creuser les lits, mieux nettoyer les abords, retirer tous les obstacleslimitant le bon écoulement des eaux.La crise de la planification s’est ajoutée à ce point de départ. Des travaux avaientété envisagés à l'époque des grandes inondations et ils se sont retrouvés relayés àune cinquantaine d’années de distance par une nouvelle réflexion en raison de207
l’impossibilité d’atteindre l’objectif de protection totale, alors même que lesquestions du changement climatique, de la baisse du niveau de la terre et lamontée du niveau de la mer émergeaient. Ce phénomène double a amené às’interroger sur : «pourquoi continuer à rehausser les digues par rapport à cecontexte ?»Ces études économiques néerlandaises par rapport aux françaises semblent avoirété plus ouvertes du point de vue de la diffusion des résultats, des débats avec lesassociations et avec l’ensemble de la société civile. L’existence aux Pays-Bas debureaux d’études forts, qui sont liés à la fois à l’État et aux entreprises etdialoguant parfois avec les associations, a joué un rôle clé. Il y a toute une série decommissions intermédiaires entre l’État, les associations et les milieuxprofessionnels qui favorisent la circulation des informations. Ainsi, une étudecommandée par l’État ou par un organisme local entre rapidement dans ledomaine public et sera l’objet de contre-propositions. Sur la plupart des projetslocaux, des contre-propositions existent, donc un véritable débat technique sur lesujet du mode de protection peut s'instaurer.Le deuxième aspect concerne la forte défense des solutions alternatives, parexemple l’expansion des crues en amont de la Hollande (la Hollande n’est qu’unepetite partie des Pays-Bas) et de la Randstad. Toute la partie la plus densémenturbanisée se trouve à l’ouest et dans l’embouchure du Rhin. L’intérieur estconstitué d’un tissu urbain plus lâche avec des zones rurales relativementimportantes. L'idée était soit de détourner l’eau à partir de l’entrée du Rhin dans lesPays-Bas, soit de permettre, dès l’amont, des zones d’expansion prévuesd’avance avec des systèmes d’indemnisation des personnes inondées. Dessolutions parfois fantaisistes comme le déplacement des grandes villes à très longterme étaient proposées. Un véritable débat s'est ouvert, contrairement à lasituation française où parfois les études étaient très approfondies,géographiquement détaillées, mais sans débat public. Du point de vue technique,les études proposées aux Pays-Bas ont d'abord couvert l’ensemble du territoire,puis elles se sont affinées vers les niveaux locaux. Les données générales étaientapproximatives et petit à petit, des scénarios plus détaillés ont été mis en place parsous-zones, surtout dans les zones endiguées, où le fait qu’une digue cède peutavoir des conséquences relativement importantes sur toute la zone.Cela nous amène à une comparaison assez productive de solutions intéressantespour la France. Si une généralisation de ce type d’études sur toutes les zonesinondables en France, à peu près au même moment, avait été réalisée, unepolitique nationale plus pensée aurait émergé. Or, actuellement, le principal outilest le PPRI qui est essentiellement un outil juridique local et on ne connaît pas lacontrepartie possible en matière d’ouvrages de protection et en mesures deprévention. Aux Pays-Bas, au contraire, le choix entre la protection structurelle ouune solution alternative et éventuellement des solutions adaptées à l’aveniréconomique du pays, au type d’urbanisation envisagé, continue à être posé à tousles niveaux géographiques. Le rôle de l’aménagement du territoire dans laprospective à long terme, basé sur les inondations avec des véritables choix àl’échelle du pays sur les modalités d’organisation, sur le développement est au208
premier plan. En France, on reste sur du court terme dans les données, à dix ans,ce qui n’est pas le terme pour des enjeux aussi importants.Il est toujours utile de réaliser ce genre de comparaison, mais il faut du temps pouressayer de comprendre la situation du pays. Le contenu des débats estparticulièrement intéressant car l’enjeu des inondations relève d’échelles beaucoupplus vastes que celui du bassin versant et de la technique hydraulique. En ce quiconcerne les Pays-Bas, le problème des inondations est aujourd'hui relié à unensemble de questions économiques et d’aménagement comprenant notammentl’avenir économique du pays, sa tertiarisation, son rôle de pays de service, plaquetournante des échanges à l’échelle de toute l’Europe. Ces questionsn'apparaissent pas lorsqu’on discute d’un PPRI en France.209
Les pluies diluviennes au Saguenay des 19 et 20 juillet 1996.Un regard sur l'expérience québécoiseBruno LedouxAnciennement : LEDOUX ConsultantsLe Lauréat 3, 721 rue du Pré aux Clercs, 34090 MontpellierTél : 04 66 01 70 20ledoux.bruno@wanadoo.frActuellement : Syndicat Interdépartemental du VidourleConseil général du Gard, rue Guillemette, 30044 Nîmes CedexTél : 04 66 01 70 20b.ledoux@vidourle.orgPour la préparation de ce colloque, je me suis replongé dans une étude quicommence à être ancienne. Elle a été conduite en 1999 sur un événement qui aeu lieu en 1996 au Québec. La région du Saguenay se situe entre le lac Saint Jeanet le fleuve Saint Laurent à 150 km au nord de Québec et l’événement de 1996 aprovoqué des inondations exceptionnelles 36 sur les affluents de la rivièreSaguenay qui coulent du nord vers le sud.Sur la rivière Chicoutimi, un barrage a été contourné et la rivière est passée dansla ville. Tous les petits cours d’eau se sont mis en crue avec des transports solidesexceptionnels. Les alluvions sont fluvio-glaciaires, ces matériaux sont donc assezfacilement mobilisables. La largeur du lit mineur de la rivière a été multipliée par 10ou par 15. Un quartier entier a disparu sous les sédiments.Cet événement exceptionnel a lieu en juillet 1996. En 1997, j’ai rencontré auQuébec un certain nombre de gens qui m’ont parlé de cet événement, surtout de lafaçon dont les Québécois s’étaient mobilisés pour organiser la reconstruction. Cesujet m’a semblé intéressant et je l’ai proposé dans le cadre du programme EPR.J’ai fait un déplacement de deux semaines en décembre 1999. Quelquessemaines avant, une catastrophe d’une ampleur spatiale à peu près équivalentes’était produite dans le département de l’Aude et les départements voisins.Certaines comparaisons sont intéressantes. La rédaction du rapport s’est étaléeentre 2000 et 2002, me permettant de suivre les conséquences et les effets sur lalégislation de certains aspects de cette catastrophe au Québec. Le ministèrefrançais de l’environnement m’avait également passé commande, dans le secondtrimestre 2002, d’un exercice un peu similaire sur un retour d’expérience, six moisaprès la catastrophe dans l’Aude.Pourquoi le choix de cet événement au Saguenay ? C’est une catastrophemajeure. La tempête de glace a suivi. Elle a aussi été un événement exceptionnelau Québec. Jusqu’à 1996, c'est la plus grosse catastrophe naturelle que lesQuébécois aient eu à gérer et donc, la gestion de la crise et la reconstructionétaient sans précédent. L'événement était bien documenté. Des retours36 200 mm de pluie en 36 heures211
d’expérience ont été réalisés, ainsi que des productions scientifiques et desrapports. Cet événement a déclenché au sein de la société québécoise uneréflexion en profondeur sur les modifications à apporter à la gestion des risquesnaturels dans ce pays, plus particulièrement des inondations. Certainesmodifications dans la législation ont suivi sur quatre thématiques : la gestion desbarrages et plus généralement les aménagements hydrauliques, l’organisation dela sécurité civile, la gestion de l’eau et la gestion des inondations.La démarcheComment ai-je construit la démarche de ce retour d’expérience ? A partir de ladocumentation existante, j’ai identifié quels étaient les différents organismesinvestis dans le domaine de la crise et de la reconstruction. J’ai pris des rendezvousavec les acteurs, les personnes-clés au sein de ces organismes repérés.Dans un premier temps, à Québec, j’ai rencontré le niveau central, dans lesministères et chez Hydroquébec et des universitaires et des experts qui avaienttravaillé sur le sujet. Ensuite, j’ai passé du temps sur le terrain en rencontrant desgens des administrations, des collectivités locales, des organismes consulaires,etc. C’est la méthode boule de neige, c’est-à-dire que je ne me suis pas censuré,je me suis laissé la liberté de rencontrer les gens que l’on m’indiquait au fur et àmesure et je me suis intéressé à toutes les thématiques de la crise et surtout de lareconstruction.Les enseignementsAvec le recul, deux questions centrales peuvent être posées : la gestion de la crisepeut-elle être regardée comme une réussite ? Et sur la post crise ? L’alerte a ététrès mauvaise parce que cet événement n'était pas habituel. Les crues au Québecont lieu au printemps lors du dégel. Toutes les structures habituelles mobilisées enmatière de suivi des événements météo étaient endormies. Il y a donc eu une trèsmauvaise alerte et en même temps, la réactivité notamment au niveau descollectivités locales, a été remarquable, d'où ce regard assez positif sur la gestionde la crise. Plusieurs critères me paraissaient essentiels :- au niveau des collectivités, les personnes avaient une très bonneconnaissance de leur territoire, liée notamment à une culture des crues deprintemps. De nombreux fonctionnaires de ces collectivités avaient suivides formations de la sécurité civile. Quelques années plus tôt, unesimulation d’une crue forte avait eu lieu, même si la catastrophe en juillet1996 était sans commune mesure avec cette simulation.- pratiquement toutes les collectivités étaient dotées d’un plan d’urgence.Néanmoins, certains plans d’urgence n’avaient pas été renouvelés depuisplus de 5 ans. Le risque inondation était parfois minimisé.Pour la reconstruction, les critères de réussite me semblent être :- l’extrême rapidité de la mobilisation du Gouvernement face à l’événement.Deux jours plus tard, le premier ministre était sur place et six jours plustard, un conseil des ministres s’est tenu sur les lieux de la catastrophe.212
- une prise de conscience immédiate et une bonne mesure de l’ampleur dusinistre, c’est-à-dire que les autorités ont rapidement très bien mesurél’ampleur du sinistre. Par contre, ils ont sous-estimé le temps nécessairepour mobiliser les différentes administrations et gérer la reconstruction. Sixmois étaient prévus et la reconstruction a duré près de trois ans.- un affichage politique très fort à la hauteur de l’ampleur du sinistre, celasignifie que le Gouvernement n’a pas du tout minimisé la catastrophe. LeGouvernement québécois a tout de suite mis en place une structuredécentralisée de coordination et d’animation de la reconstruction avec unfonctionnement très particulier, c’est-à-dire que cette structure avait descapacités et des moyens d’expertise, des capacités de coordination etsurtout, elle était un relais direct entre les problèmes locaux et lesministères, en évitant toutes les strates administratives. Ainsi, leGouvernement québécois a pu réagir de manière rapide et adaptée au furet à mesure que les problèmes étaient rencontrés, en adaptant lesprogrammes d’aides financières par décret. En trois ans, trois loisspéciales et 70 décrets sont sortis pour gérer la reconstruction. Au fur et àmesure que les problèmes étaient rencontrés sur le terrain, ils étaientanalysés par cette structure, le bureau de la reconstruction et remontaientimmédiatement au plus haut niveau de l’État qui élaborait des décretspermettant d’adapter la reconstruction au terrain. Par exemple, pour lesmodalités et les critères d’indemnisation des particuliers, il n’y a pas desystème d’assurance, l’État québécois indemnise les victimes descatastrophes naturelles et met en place à chaque fois un dispositif ad hocsur des fonds publics. Les critères d’indemnisation de l’habitat desparticuliers risquaient de provoquer un exode rural dans certains secteurscar ils n’étaient pas du tout adaptés à la qualité du bâti, qui était médiocre.Le problème a été identifié et les décrets d’application ont été modifiés defaçon à permettre à ces habitants d’être indemnisés correctement pourreconstruire sur place.- un assouplissement des règles du fonctionnement administratif,notamment sur les études d’impact et l'intervention dans les rivières. Dansce dispositif de la reconstruction, les actions n’étaient pas planifiées maisune capacité d’adaptation aux inondations de la part du Gouvernement etde toutes les strates administratives a été développée.Quel apport cette démarche peut-elle avoir ? D'un point de vue de praticien,directeur d’un syndicat de rivière, je suis arrivé après une phase de postreconstruction et n’ai pas pu mettre en application les enseignements tirés de cetteexpérience. Le regard très positif que je porte sur cette gestion de crise et de postcrise, est-il finalement lié au cadre législatif et réglementaire et aux politiques degestion d’inondation au Québec ou à des caractéristiques de la sociétéquébécoise ? Aujourd’hui, mon point de vue penche plutôt vers la secondeexplication.213
De l’usage de l’incinération : une comparaisonFrance / Danemark / Pays-BasNicolas BucletChercheur au CREIDDUniversité de Technologie de Troyes12, rue Marie Curie, BP 2060, 10010 Troyes Cedexnicolas.buclet@utt.frMon objet est l’incinération des déchets ménagers, des déchets municipaux. Larecherche est née du constat de la perception de la persistance de l’existence d’unrisque sanitaire lié à une technologie. Cette problématique est légèrementdifférente par rapport à des risques qui peuvent être purement technologiques.L’hypothèse était que cette perception du risque se traduise par un problèmed’acceptabilité sociale des incinérateurs, du fait de l’impact de l’ampleur d’un telinvestissement pour une collectivité locale, par une sorte de risque de stabilitéinstitutionnelle de l’ensemble de la gestion des déchets ménagers, c’est-à-dire lerisque que l’acteur chargé de gérer la question ne soit plus en mesure de répondreà l’objet qui fonde son existence. Par rapport à ce constat, ce problèmed’acceptabilité sociale n’est ni constant dans le temps, ni dans l’espace. L’espaceest plus pertinent dans une logique de comparaison internationale. Donc, une desportes d’entrée par rapport au sujet a été de réfléchir à ce qui peut se passerailleurs en termes de politique publique sur la même question. On a choisid’étudier des pays où les solutions apparaissaient plus satisfaisantes qu’enFrance. Nous avons travaillé sur certains pays dans des programmes européenset donc, nous avions déjà une connaissance assez approfondie de la gestion desdéchets ménagers dans ces pays. Les Pays-Bas et le Danemark ont été choisisparce qu’ils ont des points communs, notamment le recours assez important àl’incinération. Les populations sont généralement bien sensibilisées àl’environnement, avec des modes culturels différents; plutôt une place très forte àla concertation aux Pays-Bas et une place beaucoup plus importante pour laplanification de la part de l’État au Danemark, avec dans les deux cas, dessituations de gestion des déchets, notamment d’acceptabilité sociale del’incinération, satisfaisantes.Ainsi, en ayant plusieurs éclairages sur l’étranger, on arrive à voir qu’il n’y a pasune seule solution permettant d’aboutir au résultat escompté, mais plusieursmanières d’agir en fonction des différences culturelles, et notamment en fonctionde la construction de la politique dans un pays. Les points communs entre cespays sont une ambition de prévention quantitative des flux de déchets, avec enparticulier la perception par les populations que les pouvoirs publics ont cetteambition, et qu’ils essaient de s’en donner les moyens. Par rapport à cette logique,l’incinération est importante mais elle est vue comme complémentaire. Le troisièmeaspect est l’attitude par rapport aux problèmes d’émission de dioxine. Les Pays-Bas ont été de ce point de vue remarquables. Entre la crise sanitaire à partir de1988 et la contamination du lait des vaches à proximité des incinérateurs, en 1994,donc en six ans de temps, la question a été réglée par l’édiction très rapide de215
normes réglementaires d’émission qui sont plus sévères, même aujourd’hui, quecelles successivement édictées au niveau européen en 2000, avec également lapossibilité d’obtenir tous les indicateurs autour des incinérateurs. Dès 1994, ladifférence de contamination entre un territoire proche d’un incinérateur ou éloignédisparaît. Un autre point important est que, dans les deux pays, on trouve desrelations de confiance entre les acteurs impliqués, notamment au Danemark, uneconfiance dans les pouvoirs publics. Au Danemark, par ailleurs, toujours danscette logique, depuis le début des années 90, la gestion des déchets est unepréoccupation qui est inscrite au sein d’une autre préoccupation plus générale quiest celle des technologies propres.La France, dès le départ, est un peu plus mal partie. D’abord, la politique publiquede gestion des déchets qui s’est constituée au début des années 90 est née avanttout comme une réaction face à la peur que le système allemand s’impose àl’ensemble de l’Europe. Puis, surtout, on a été essentiellement vers des solutionsaval. Dès le début, la prévention est évoquée mais aucune action concrète auniveau de la prévention quantitative des flux de déchets n'est réalisée. En France,l’autre aspect est que l’incinération avait été très favorisée par les mécanismesfinanciers d’Eco-emballages. Les collectivités locales ont constaté l'intérêt deconstruire des incinérateurs, y compris d’un point de vue financier tant et si bienqu’en 1997, l’ADEME a pu observer qu’à part deux départements, tous lesdépartements en France souhaitaient construire au moins un incinérateur. Lagestion de la crise des dioxines en France a été à l’envers de la situation auxPays-Bas, c’est-à-dire une gestion sans anticipation. Tant qu'une crise majeure àl’échelle des déchets n'a pas éclaté, les choses n’ont pas véritablement bougé.Lentement, la situation s'améliore en essayant de mettre progressivement lesincinérateurs aux normes par rapport aux dioxines. La fermeture par le préfet del’incinérateur de Gilly sur Isère, à côté d’Albertville, a enfin entraîné une réaction.Un procès est en cours. La situation est paroxysmique aujourd’hui. En effet, quandon parle d’un projet d’incinérateur, il est très facile aux opposants d’argumenter parrapport au passé. La situation a été mal gérée alors qu'elle était prévisible, puisqued’autres pays avaient géré la crise quelques temps auparavant. Un état de veillepar rapport aux crises qui peuvent surgir dans les autres pays, serait intéressant àmettre en place. La plupart des acteurs aux Pays-Bas et au Danemark ou enAllemagne ont une stratégie pro-active par rapport aux contraintesenvironnementales, c’est-à-dire que l’environnement est souvent un prétexte pourrepenser en termes de nouvelles activités. Le Danemark, dans le domaine deséoliennes, en est un exemple assez frappant, parvenant en peu de temps, et parune politique nationale intelligente, à devenir leader mondial du secteur. Cettelogique donne des repères suffisamment clairs sur le long terme aux acteurs,notamment aux industriels pour qu’ils puissent anticiper de futurs problèmes, etdonc éviter de gérer des crises telles que celle, en France, de Gilly sur Isère. Ainsiles acteurs économiques peuvent fonder leurs propres orientations stratégiques enfaisant des contraintes environnementales des atouts concurrentiels. Au niveau dela gestion française des déchets, l’objectif était de maintenir un statu quo. Parrapport à la crise des dioxines, la situation relevait surtout de l’attentisme, del’incapacité de faire respecter les normes par les collectivités locales et d'uneminimisation récurrente de l’affaire par rapport aux acteurs qui la soulevaient.216
Concernant les perspectives ouvertes, je continue à travailler sur ces questions.Vis-à-vis de celles que je n’ai pas abordées, de la démocratie participative commemoyen de sortir de ce type de crise que connaissent les collectivités locales entermes de gestion des déchets, nous avons répondu à un appel d’offres del’AFSSE avec Danièle Salomon, qui a été accepté. Nous étudierons des cas précisd’exemples de démocratie participative permettant de débloquer la situation danscertains contextes. Nous avons identifié des cas très intéressants. Par rapport à laquestion de l’appropriation, depuis que ce travail a été conclu, il y a environ deuxans, nous avons fréquemment des demandes de conseils par des collectivitéslocales qui se retrouvent dans des impasses. Face à cette demande, noussommes très intéressés à travailler, notamment sur l’aspect des moyens d’élaborerune démocratie participative qui aide à sortir de l’impasse.217
Table ronde 5 : Connaîtredes expériences étrangèresen matière de gestion des risques ?Bastien Affeltranger, UNU-EHSDébatMa question est pour Monsieur Buclet. Son intervention m’intéresse énormémentet j’aimerais la poursuivre sur des questions de risques accidentels et de systèmeinstitutionnel local, c’est-à-dire comment un risque tel que celui-ci, l'usined'incinération, les déchets, peut contribuer à déstabiliser des administrationsdécentralisées et des systèmes municipaux de collectivités locales. Vous ditesvous intéresser aux questions participatives, notamment sur la gestion des déchetset les modes de traitement à retenir. Au Québec, à la fin des années 90, enpartenariat avec la ville de Sherbrooke et l’université de la ville, un projetparticipatif a été développé sur la base d’une méthode développée au Danemarkqui visait, à la demande de la municipalité, à impliquer des comités d’habitantsdans le choix du mode de traitement pour les déchets ménagers, tri sélectif,enfouissement, incinération.Yves Le Bars, CemagrefJe suis surpris de la faiblesse des analyses en France. J'ai eu à travailler au seindu FSC de l'OCDE sur ce sujet, et je crois que l'on peut avancer assez vite : enquatre ans et quatre réunions d'examen de diverses situations, nous avons pupublier en français et en anglais, quelques brochures sur les outils disponibles, desréflexions sur l'approche participative, sur la nécessité d'établir un processus etune structure d’acteurs, sur les comportements adaptés. La recherche est trèsimpliquée dans certains pays, où des processus ont été renouvelés avec son appuien incluant une participation des acteurs. La récolte de la mobilisation de larecherche française est-elle bonne ?Geneviève Baumont, IRSNJe voulais demander aux différents participants un point sur la question de laconfiance envers les institutions et les gouvernements, ceux qui mettent en placeles politiques. Le baromètre des risques de l’IRSN pose pour 26 risques laquestion : le risque est-il élevé, avez-vous confiance dans les autorités et vous ditonla vérité ? Les réponses sur la confiance et la vérité sont terribles. Cinq risquesrecueillent la confiance aux autorités, sinon on est bien en dessous de la moyenne219
et en général on ne fait pas confiance. Je me posais la question de l’effet de lapérennité. Le même turn-over existe-t-il dans les différents pays, auprès desadministrations ou auprès des politiques ? Le programme EPR a connu sixministres et il n’y a maintenant plus personne de l’administration de départ. Lecomité d'orientation et le conseil scientifique ont étés le garant de la stabilité.Quand vous dites au Danemark, ils font confiance, est-ce lié à la stabilité ?Nicolas Buclet, CREIDAu Danemark, j’ai eu la chance d’avoir le même interlocuteur sur le même sujetmais je ne peux pas généraliser.Yves Le Bars, CemagrefQuelques comparaisons se retrouvent dans l’Eurobaromètre sur la question durisque nucléaire… Trois cas en Europe sont constatés : les pays nordiques et laGrande-Bretagne font confiance à leurs acteurs; l’Allemagne et la France font peuconfiance et les pays méditerranéens ne font pas du tout confiance.Jean-Roland Barthélémy, Fondation des VillesUne réponse en fonction des institutions concernées est possible, c’est-à-direqu’un certain nombre de pays, dont les Pays-Bas, ont des institutions chargées demener des enquêtes. Par exemple, aux Pays-Bas, c’est le RIBR qui s’occupe detout ce qui est santé, par rapport au risque nucléaire, au risque de dioxine, etc. Cetinstitut, bien que rattaché à un ministère, a le même statut que l’ADEME. Vis-à-visde l’ADEME en France, l’attitude serait peut-être moins négative que par rapport àun responsable politique. Les instituts font la continuité sur les risques liés àl’environnement.Bernard Barraqué, LATTSPour répondre à la question, partons d’un paradoxe apparent. Si on veut conduirede nouvelles politiques, il faut bien faire émerger de nouvelles institutions quifonctionneront sur l’apprentissage collectif. Ces institutions voient souvent le jourpour réaliser des projets. Mais la participation et la confiance qu’elles suscitents’émoussent au bout d’un temps, quelque soit la réussite ou l’échec des projets.Dans les nouvelles approches participatives et intégrées, il faut refabriquer laconfiance en permanence. On réélit bien nos élus tous les cinq ans, on ne voit paspourquoi les comités participatifs, les institutions multi-niveaux auraient unepermanence qui les ferait échapper aux questions qui ne cessent de se poser etde se reposer différemment chaque fois qu’il y a un enjeu comme un risque.Yves Le Bars, CemagrefJe vous recommande de visiter le site www.nea.fr, qui est celui de l’agence del’énergie nucléaire où se trouvent des documents sur la construction de laconfiance, avec des comparaisons internationales et qui tirent partie de différentesexpériences.220
Jean-Paul Chirouze, CemagrefYves Le Bars nous a rappelé que les échanges internationaux en termes detechnique sont anciens et fonctionnent bien en termes de gouvernance. Lesinterventions précédentes nous ont montré qu’il y a aussi des échanges. Je restesur ma faim en matière de droit. Il faudrait éventuellement recommander deséchanges internationaux sur l’aspect strictement juridique, notamment pourconfronter les cultures de droit anglo-saxon avec nos cultures de droit romain etfaire un exercice de prospective. L’évolution de l’Europe nous conduit à avoir uneévolution de nos droits et en termes de prospectives; n’est-ce pas intéressant surces questions de risque, où la responsabilité personnelle est très forte ?Yves Le Bars, CemagrefParfois, je me dis que l’Angleterre est tellement différente de nous que lescomparaisons sont impossibles à faire. Ils n’ont pas accepté Napoléon alors quel’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas…Bernard Barraqué, LATTSLes Pays-Bas ont adopté le code civil. Il y a un double sens du droit. Notrerecherche n’a pas porté sur le droit au sens pénal mais sur les régimes juridiqueset institutionnels de la ressource en eau qui conduisent à tel ou tel type dedispositif de gestion, à tel ou tel poids de la propriété privée, ou au contraire à desdroits d’usage, par rapport à l’eau. La réponse est aussi dans la façon dont on aposé la question du colloque 2003, c’est-à-dire que quand une catastrophe surgit,dispose-t-on de régimes de gestion de la crise, mais aussi de réduction desvulnérabilités, et d’indemnisation des dommages, qui dépassionnent le débat etévitent le procès ? Je crains que la comparaison avec la France ne soit difficile carpeu de pays ont un système CAT NAT comme nous. Ce programme comme celuisur Concertation, Décision et Environnement, était plus centré sur la constructionde solutions négociées que sur la question du juge. A plusieurs reprises, dans cecolloque, je me suis souvenu que certaines questions ont été traitées dans unautre programme de recherche, Concertation, Décision, Environnement. Parexemple, une recherche sur les commissions locales d’information et de sécuritédes incinérateurs; ou une autre recherche sur la mise en place de centres detraitement de déchets industriels spéciaux régionaux, qui montre les grandesdifférences entre les approches régionales; ou encore la thèse de Simone Schultz(Ecole des Mines, CERNA) sur la façon dont plusieurs pays ont appliqué ou n’ontpas appliqué la directive européenne sur la pollution toxique due aux incinérateurs.Il est indispensable de faire le point et croiser les résultats avec d’autresprogrammes.Nicolas Camp'huis, Agence de l’eau Loire-BretagneJ’aurai un éclairage un peu différent de celui de Jean-Roland Barthélémy sur lecas néerlandais. Le fait qu'aux Pays-Bas, ils soient «au bout du tuyau» me semblefondamental. Nous sommes au bout de notre propre tuyau en France, ce qui estextrêmement différent dans la gestion des inondations. Par ailleurs, ils ont une loi221
les obligeant à appliquer un niveau sécurité contre le risque inondation que nousn’avons pas en France. Un rapport proposait d’avoir une réflexion sur le niveaudes inondations contre lequel on se protège. C’est éminemment absent du débatfrançais. Quand dans un pays, vous avez en tous cas obligation, de par la loi, devous protéger contre un certain niveau d’inondation, les questions sont abordéesde façon différente. J’aurai une interpellation sur les trois expériences que vousavez présentées parce que je suis persuadé que les situations étrangères peuventapporter quelque chose aux décideurs en France. Mais je reste sur ma faim quantà votre proposition. Aujourd’hui, vous auriez en face de vous un présidentd’agglomération, qui veut agir pour gérer un problème d’inondation, que peut-on luidire de concret de vos rapports ?Yves Le Bars, CemagrefCette question renvoie à qui est le lecteur du rapport et comment il s’insère dansl’action quotidienne. Peut-il le faire directement ? Ou a-t-il besoin d’un médiateur,par exemple une agence de l’eau ?Pascal Belin, Direction de la Défense et de la Sécurité Civile, Ministère del’IntérieurCette question s’adresse à Bruno Ledoux. Au vu de son expérience actuelle et decelle du Québec, quels sont les enseignements qu’il tire de la reconstruction enFrance ? A-t-elle été bonne ou mauvaise ? Si elle a été mauvaise, quelles sont lespropositions d’amélioration qu’on pourrait en tirer ?Bruno Ledoux, Syndicat Interdépartemental du VidourleLe point central de cette expérience au Québec était justement la gestiondécentralisée de la reconstruction, avec un bureau spécialement mis en place àcet effet. A la suite de mon rapport sur le retour d’expérience dans l’Aude, j’avaissuggéré que ce type de structure ou d’organisation soit mis en place à la suited’une grande catastrophe d’ampleur spatiale très vaste. En France, le projet s’estesquissé à l’occasion de la catastrophe de l’Aude en 1999. J’en ai donné uneanalyse critique. Une petite cellule a été mise en place, assez modeste. Elle n’apas eu l’ampleur qu’il aurait fallu. Par contre, dans le Gard, une celluleinterministérielle de la reconstruction a été mise en place pendant un an et demi.Elle a joué un rôle essentiel dans la dynamique de la reconstruction. Je peux vousdire que le sous-préfet qui en était en charge est resté dans toutes les mémoiresdes Gardois comme quelqu’un qui a mis de l’huile dans les rouages, qui a faitavancer les dossiers… C’est un enseignement que j’ai tiré de mon expérience surle Québec et qui s’est mis en place. Le deuxième enseignement que j’essaie d’entirer de manière plus concrète aujourd’hui concerne les plans de sauvegardecommunaux, afin d’introduire ou de poser la question de la place de lareconstruction dans la planification, c’est-à-dire ne pas simplement s’occuper de lagestion de la crise. Je n’ai pas de réponse complète sur jusqu’où peut-on planifierdes situations qui sont extraordinaires et jamais les mêmes. Néanmoins cetteréflexion est introduite dans nos plans de sauvegarde actuels.222
Jean-Roland Barthélémy, Fondation des VillesL’aspect réglementaire n'a effectivement pas été traité. Le taux de probabilité deretour qui a été imposé comme norme pour les ouvrages de protection aux Pays-Bas a failli changer à la veille des inondations de 1993. En 1992, une commissiona été réunie. Elle estimait qu’il fallait supprimer ce retour standard sur la base desétudes économiques. L’inondation a provoqué un tel choc qu’ils sont repartis surune vague de travaux et la norme a été maintenue. Il y a effectivement dessolutions concrètes à mettre en place au niveau des bassins et non pas au niveaude la collectivité de base. De ce côté là, le fait d’avoir, par exemple,systématiquement, à l’échelle de tout un bassin, une connaissance de l’ensembledes enjeux, est un outil important de planification. Alors qu’actuellement, commedans le cas de la Garonne, une institution couvre bien tout cet ensemble mais ellen’est pas capable de traiter de manière identique les différents niveaux.Yves Le Bars, CemagrefPetite remarque par rapport à la capacité locale d’absorber les résultats derecherche. Pour absorber des résultats de recherche, il faut d’abord avoir soimêmeune politique de recherche. La question se transforme en : comment aiderune collectivité à avoir une politique de recherche et d’innovation ? C’est une destâches que s’est donné le groupe recherche du Conseil général du GREF avecd’autres ministères. Un autre aspect est les revues par les pairs. On a descomparaisons internationales qui sont uniquement faites par des Français.Comment sait-on tirer partie des comparaisons internationales réalisées par lesautres ?Jean-Claude Soumbo, Conseil Général de la MartiniqueUne contribution sur le débat de l’implication des citoyens dans la crise d’une façongénérale. Pour citer le cas de la Guadeloupe, à la suite du séisme du 21 janvierdernier, les maires de Gombert ont développé toute une série de réunions avec lapopulation, action qui connaît un succès croissant, ce qui montre qu'on discute desujets très difficiles notamment parce qu’aux Saintes, actuellement, il y a toute unesérie de répliques et que la population vit constamment sous cette pressionpsychologique. On peut peut-être prendre le problème sur le plan pragmatique.L’opportunité, lorsqu’il y a des outils, permet de faire avancer le débat etl’implication des citoyens. A telle enseigne qu’en Martinique, la contrepartie estqu’une recrudescence de la demande de dossiers concerne la mise en œuvre deprimes parasismiques pour les constructions de maison individuelle.Michel Chaduteau, Ponts et Chaussées MagazineUne question pour Mr Barthélémy : quel est le problème de l’évaluation socioéconomiqueen France ?223
Jean-Roland Bathélémy, Fondation des VillesLe problème est qu'elles sont peu nombreuses. De plus, la qualité des données quisont disponibles est toujours un problème. Pour trouver la moindre donnée à peuprès fiable, il faut des moyens considérables.AnonymeEn termes de reconstruction, quand je lis l’étude sur le Québec, j’ai l’impressionqu’on a réduit le risque en reconstruisant. Avez-vous ce sentiment au niveaufrançais ou a-t-on reconstruit à l’identique en France ?Bruno Ledoux, Syndicat Interdépartemental du VidourleBien sûr, il existe une obligation de construire à l’identique pour pouvoir bénéficierdes financements. Le problème est qu’il faut modifier les règles de l’attribution desaides à la reconstruction. C’est évident et un effet beaucoup plus pervers estconstaté aujourd’hui. Pour certaines collectivités, il n’y a pas d’impact de lareconstruction sur leur budget. On les a tellement aidées, à de tels niveaux definancement, qu’elles en ont «oublié» qu’elles avaient eu une catastrophe. On aaccéléré le phénomène de l’oubli avec l’ampleur des aides à la reconstruction.Valérie Renault, étudianteOn a beaucoup parlé de choses qui sont à la base du développement durable,c’est-à-dire la concertation, le dialogue, la médiation, le retour d’expérience, lagestion du conflit, la communication, etc. Par contre, l’éducation n'a pas étéabordée. Dans quelle mesure serait-il possible d’apprendre tous ces concepts àl’époque où les personnes ne sont pas encore élu, expert, chercheur, c'est-à-direlorsqu'elles appartiennent à la société civile et que l’on parle encore le mêmelangage, donc à l‘école. Dans les différences entre pays, l’éducation estimportante.Pierre-Marie Sarant, Coris Risk ConsultingUne remarque. Dans notre rapport qui est en ligne, on a travaillé aussi sur l’Arcdes Petites Antilles, donc sur des pays qui sont différents. On a comparé lessystèmes d’organisation en cas de crise, les moyens de prévention qui se mettenten place et les alertes. On se rend compte que sur une région qui est limitée, auniveau des cyclones, il est difficile d’apporter des aides de proximité. Les systèmessont différents et les alertes aussi. Certaines populations se déplacent, peuventregarder le même site Internet pour avoir des informations sur le cyclone, peuventrecevoir les mêmes types de chaînes de télévision. Or, par exemple sur la mêmeîle à Saint Martin, où on a la partie française et une partie hollandaise, des gensétaient en alerte, déjà confinés et d’autres étaient encore en train de vaquer à leursoccupations normales. Il y a des systèmes intéressants mais pas les mêmesmoyens.224
Gérard Brugnot, CemagrefJe regrette que nous n’ayons pas eu le temps d’aborder la question économique.Bernard Barraqué, LATTSLa France est un des pays d’Europe où on en sait le plus sur le chiffre d’affaires dela politique de l’eau. Pourquoi ? Parce que les agences, par le fait même qu’ellesprélèvent des redevances et qu’elles font des investissements, produisent toutnaturellement une incitation à avoir cette connaissance. Pour nous, remplir letableau de ce qu’il faut faire pour appliquer la directive cadre, ce n’est pas sidifficile sauf dans un domaine comme les inondations parce qu'il n'existe pas dedonnées. Si on veut connaître quel est le budget, quel est le coût des inondations,si on veut avoir une évaluation économique, il faut faire de l’économie del’inondation ou des risques.Yves Le Bars, CemagrefCette session sur les comparaisons internationales a permis de voir qu’il y en avaitune grande variété, très au-delà de celles qui ont été présentées. Il faudra voirquelle peut être la mobilisation de la recherche française sur la question de lagouvernance.225
Conclusions du colloque,perspectivesClaude Gilbert, Président du conseil scientifiquePour conclure, et en me situant dans une perspective de «passage de relais», jevoudrais pointer rapidement quelques interrogations à partir des débats engagéslors de ce colloque mais également à partir d’autres débats se développantaujourd’hui dans diverses enceintes au sujet de la question des risques.Dire les risques ou rendre évidentes les «négociations» dont ils sont l’objet ?Il apparaît encore difficile de nommer certains dangers, de les afficher. De même,malgré les manifestations répétées de phénomènes naturels dans certainesrégions (comme, par exemple, les inondations), les politiques de prévention, degestion de crises et de réparation semblent toujours insuffisantes. Les raisonshabituellement évoquées sont le manque de moyens, notamment concernant lespouvoirs publics, et la multiplicité des intérêts (privés et publics) contrariantl’engagement de politiques adéquates. Les limites pouvant être apportées àl’urbanisation, au développement d’activités économiques, touristiques, etc. ainsique la dévalorisation des patrimoines fonciers, immobiliers, etc., sont considéréescomme des freins puissants. Des remarques semblables sont faites à propos despolitiques en matière de risques industriels compte tenu de leurs effets possiblessur l’économie, l’emploi, le budget des collectivités locales, etc. Pour diversesraisons donc, il est considéré que «dire» le risque est parfois encore un problèmeet que tout ce qui aurait pu être fait ne l’a pas toujours été.Cette critique, habituelle et assez largement partagée, mérite cependant d’êtreinterrogée. Elle se fonde sur l’idée que la gestion des risques devrait être unepriorité absolue, avec l’attention et la mobilisation de moyens que cela suppose.Or, l’approche qui la sous-tend est discutable. La gestion des risques est certesune priorité, mais une priorité parmi d’autres. Leur prise en compte s’effectue dansle cadre de négociations globales. Dans tous les cas, dans toutes les situations,des arbitrages sont effectués dans l’attribution des ressources aux multiplesproblèmes que les collectivités ou sociétés doivent traités. La question n’est doncpas tant de savoir si la mise sur agenda des risques se fait à la hauteur desmenaces qu’ils font peser sur une collectivité ou une société mais, plutôt, d’établircomment, avec quel degré d’importance et de priorité, ils émergent commeproblèmes à régler compte tenu des arbitrages effectués entre divers impératifs.Se situer dans cette perspective, c’est donc admettre que la question des risquesfait normalement l’objet de négociations qui déterminent ce que sont effectivementles politiques dans ce domaine. Négociations de nature très variable qui, bien sûr,influent sur les états de sécurité.Les critiques habituellement faites à propos des politiques dans le domaine desrisques introduisent un autre biais. Ces politiques sont considérées comme227
étroitement déterminées par leur objet et comme devant s’imposer en tant quetelles. Or, peut-être plus encore que les autres politiques, celles relatives auxrisques naturels et industriels s’inscrivent dans de forts champs de contraintes.Ces politiques dépendent du mode de structuration des sphères scientifiques,administratives, politiques, économiques, etc. qui, de diverses façons, cadrent trèsfortement ces problèmes. Les risques naturels et les risques industriels sont cequ’ils sont comme problèmes publics au terme d’un processus complexe à traverslequel ils prennent forme. Là encore, il y a de multiples confrontations etajustements. La forme prise par un risque reflète les sélections qui s’opèrent dansles modes de connaissance et d’action ainsi que la nature des rapports entre lesacteurs qui participent à sa définition.Que l’on considère l’importance accordée aux politiques consacrées aux risquesou que l’on considère les formes prises par ces politiques, tout apparaît lié à diverstypes de négociation dont il est encore assez peu rendu compte. Un champd’investigation intéressant s’ouvre ainsi dès lors que l’on admet que les risques,comme problème à traiter, sont normalement «travaillés», «négociés»; dès quel’on admet aussi que la plus ou moins grande sécurité au sein de collectivités etsociétés données dépend de ces différentes négociations, de la manière dont elless’opèrent et du type de compromis auxquelles elles aboutissent. Il peut en effet yavoir de «bons» et de «mauvais» compromis (avec une large gamme decompromis intermédiaires).Développer des politiques spécifiques aux risques ou intégrer les risquesdans des politiques ordinaires ?La gestion des risques tend spontanément à renvoyer au traitement de problèmesexceptionnels. Cela tient au fait que les risques se comprennent largement àtravers la survenue subite d’événements fortement perturbateurs (phénomènesnaturels, accidents technologiques) et encore assez peu à travers l’ensemble desvulnérabilités. Or, dans les sociétés contemporaines modernes ce sont de plus enplus ces vulnérabilités qui font le risque, lui donnent toute son ampleur (si, biensûr, on ne réduit les vulnérabilités qu'aux possibilités d’endommagement). La forteurbanisation des sociétés actuelles, leur complexité organisationnelle, leurfonctionnement en réseaux, en flux tendus, etc. sont des éléments de très fortevulnérabilité. En changeant assez radicalement de perspective, on peut doncconsidérer que les phénomènes naturels, les accidents industriels, etc., fournissentaux vulnérabilités latentes des collectivités et sociétés «l’occasion» de s’exprimer,de produire véritablement des catastrophes.Sur ce point, il ne peut manquer d’y avoir débat. La tradition scientifique, politicoadministrativedans laquelle nous nous situons conduit à extérioriser le risque, à«faire face» à des risques par nature exceptionnels et non pas à considérer que lapart la plus importante du risque est désormais endogène via des vulnérabilitésordinaires. Ce débat, par essence interdisciplinaire, est aujourd’hui nécessaire. Ildevrait conduire à explorer les vulnérabilités avec la même intensité que les aléas.Il devrait aussi conduire à repenser l’articulation aléa/vulnérabilité, en intégrant parexemple dans l’aléa des aspects anthropiques, en admettant donc diverses formes228
d’hybridation de l’aléa. Bref, un travail important de redéfinition des notions etconcepts semble aujourd’hui s’imposer au-delà d’une prise en compte élargie de lanotion de vulnérabilité.Mais d’ores et déjà, ces modifications de perspective conduisent à modifiersensiblement l’approche des politiques des risques, de leur mise en œuvre. Sil’importance des risques tient de plus en plus à des vulnérabilités ordinaires, c’esten agissant sur ces vulnérabilités qu’il faut aussi concevoir une politique desrisques. Cela signifie donc déterminer en quoi les choix faits en matière dedéveloppement économique, de conception des grandes infrastructures, desgrands réseaux, d’urbanisation, etc. sont ou non des facteurs d’accroissement devulnérabilité. Or, faire l’analyse de ces choix et envisager de peser sur eux renvoiemoins à des politiques propres aux risques qu’à des politiques habituelles intégrantde diverses manières et dans ses diverses dimensions (aléas, vulnérabilités) laproblématique du risque. La gestion des risques n’apparaît donc plus uniquementliée à des questions exceptionnelles appelant des actions particulières et souventvolontaires. Elle doit être également intégrée dans des politiques ordinaires,routinières qui inscrivent durablement l’intérêt pour les risques dans lefonctionnement des organisations et institutions. Là encore, un champ prometteurd’investigation est ouvert.Associer la société civile ou/et démocratiser la gestion des risques ?La nécessaire participation des citoyens à la gestion des affaires publiques,notamment pour ce qui concerne les risques, devient un leitmotiv. Les séminaires,les colloques abondent sur ce thème. Or, l’engagement d’un tel débat contrasteavec la relative rareté des expériences de véritable association du public à lagestion des risques. Les obstacles au développement de telles expériences sontdivers. Ils tiennent tout d’abord à la réticence persistance d’un ensemble dedécideurs, acteurs et experts, à reconnaître la société civile ou ses représentantscomme «partie prenante». Si le principe de l’information est acquis, celle-ci se faitencore plus ou moins largement, en évitant souvent des questions sensibles. Laparticipation du public à des structures de concertation est également acquise,mais les nouvelles structures prévues par la loi tardent à être mises en place.L’examen par les représentants du public des actions engagées et des dispositionsprises est admis. Mais il s’avère encore difficile compte tenu des compétencestechniques ou scientifiques souvent exigées. Par contre, la participation de cesreprésentants à des processus d’expertise, à des décisions, est toujoursconsidérée comme inopportune. La séparation entre savants et profanes,gouvernants et gouvernés, est clairement réaffirmée. S’il semble désormaislégitime d’inviter le public ou ses représentants à débattre à propos des risquespouvant les affecter, il n’apparaît pas nécessaire d’aller plus avant.Un autre obstacle à la gestion des risques, moins fréquemment souligné, tient à lamobilisation même de la société civile (ou de ce que l’on désigne comme telle) enmatière de risques. Il est souvent présupposé que le public est fortement intéressépar les risques auxquels il est exposé; que les représentants du public sont prêts àse mobiliser, c’est-à-dire à consacrer du temps, de l’énergie, pour instruire des229
dossiers, susciter des débats publics, interpeller des acteurs, des autorités,manifester, générer des contre-expertises, etc. Or, et surtout en France, les«coûts» de la mobilisation sont tels que le maintien d’une attention, d’un intérêtpérenne pour des problèmes liés à des risques ne va de soi (au-delà descirconstances particulières provoquées par une catastrophe naturelle, un accidentindustriel ou l’identification d’une forte menace).Divers obstacles s’opposent donc à une démocratisation effective de la gestiondes risques. Pour y remédier, il est attendu une plus grande ouverture des acteurs,décideurs et experts déjà impliqués dans cette gestion ainsi qu’une plus grandeimplication du public a priori concerné. C’est le sens de nombreux discours,souvent emprunts de volontarisme. De fait, divers changements sont d’ores et déjàenvisageables. L’information en matière de risques pourrait être plus directe, plusfranche, les «discours de vérité» pouvant être entendus, y compris à propos desituations critiques. Comme c’est déjà le cas dans d’autres pays, les retoursd’expérience suite aux accidents industriels et aux catastrophes naturellespourraient servir de base à des actions d’information, de communication. Laparticipation du public ou de ses représentants à différents types de structure deconcertation pourrait être facilitée. C’est le cas lorsque les connaissances relativesaux risques et aux modalités de gestion sont rendues appropriables. C’estégalement le cas lorsque les dispositifs d’échange et de concertation sont conçusde manière à réduire l’asymétrie entre les différentes «parties prenantes», àréduire donc les «coûts d’entrée» dans de tels processus. Enfin, et de manièreplus large, les problèmes peuvent être présentés de façon à les rendre«discutables». Cela suppose que les choix (et non-choix) effectués soientexplicités, que les profanes puissent entendre les savants (et réciproquement).Bref, des voies de progrès sont rapidement envisageables, la recherche pouvant àdivers titres faciliter des réflexions dans ce sens (sans que cela ne soit réductible àde l’ingénierie sociale).Mais peut-être faut-il, si l’on s’attache à la démocratisation de la gestion desrisques, ne pas se focaliser uniquement sur la société civile. L'implication de cettedernière peut certes être facilitée. Mais, concernant les risques, on observe quecette implication est souvent ponctuelle, avec les problèmes de continuité, depérennité que cela pose (les «citoyens professionnels» ne pouvant assumer lesdifférentes représentations). La démocratisation pourrait donc également passerpar l’intéressement à la question des risques des différentes structures dereprésentation existant déjà. Si l’on se situe au plan territorial, les collectivitéslocales sont des partenaires incontournables, surtout les grandes villes, lescommunautés de commune, les agglomérations qui disposent aujourd’hui decapacités d’expertise et de moyens d’action importants. Il n’est plus possible dediscréditer ces acteurs sous le prétexte qu’ils sont soumis à des impératifscontradictoires (ce qui est le cas aujourd’hui de l’ensemble des acteurs). Demême, les représentations organisées au plan professionnel, économique, doiventêtre prises en compte. Les syndicats, par exemple, aussi bien ouvriers quepatronaux, sont trop souvent oubliés en raison, là encore, des intérêtscontradictoires qui leur sont attribués. D’une manière plus générale, l’ensembledes structures à travers lesquelles se développe la vie collective sur un territoire230
donné (entreprises, équipements collectifs dans le domaine de l’éducation, de lasanté, etc.) disposent d’instances pouvant être sollicitées. La démocratisation de lagestion des risques peut donc aussi passer par l’activation de diverses structuresde représentation grâce auxquelles divers types de médiation peuvent êtreréalisés. Elle peut aussi passer par une véritable saisie de la question des risquespar les instances politiques, notamment locales. Nombre d’arguments allant contreune telle orientation tombent si l'on admet que la gestion des risques faiteffectivement l’objet de négociations et que, dans une démocratie moderne,l’important est de rendre publiquement compte des arbitrages effectués entredifférentes contraintes, différents impératifs.Sur différents plans, on constate aujourd’hui des déplacements qui tendent àmodifier assez profondément l’approche des risques. Longtemps appréhendéscomme des menaces à la fois extérieures et exceptionnelles, ils apparaissentaujourd’hui comme des problèmes fortement endogènes qui renvoient auxvulnérabilités ordinaires de nos sociétés. Identifiés comme des questionsspécifiques devant faire l’objet de priorités absolues, notamment de la part despouvoirs publics, les risques apparaissent comme des impératifs parmi d’autres,dont l’importance dépend de multiples arbitrages et dont la gestion effective estfonction de leur prise en compte dans le cadre de politiques ordinaires. Enfin, alorsque la gestion des risques a traditionnellement favorisé l’expression du «régalien»,avec un fort croisement entre savoir et pouvoir, science et décision, elle estaujourd’hui au cœur des interrogations sur le renouvellement des démocratiesdans les sociétés modernes. Tous ces changements en cours sont sources denombreuses interrogations. Il revient à la recherche, notamment en scienceshumaines et sociales, de s’en saisir et, autant qu’elle le peut, d’en assurer la miseen débat, au sein du champ académique, au sein du champ politico-administratif,mais aussi en allant vigoureusement vers la société dans ses différents «états».Philippe Huet, Président du comité d'orientationJe représente le comité d’orientation. Trois points seront traités : les impressionsd’ensemble, les demandes de valorisation et les demandes de suite.La scène du risque du colloque a plutôt bien marché. Toutes les catégoriesd’acteurs annoncées sont venues. Je voudrai saluer Aurélie Picot qui représenteun parlementaire et qui sauve l’honneur de la représentation Nationale. Autrement,l’ensemble des partenaires du risque étaient là et sont tous intervenus. Cela aplutôt bien fonctionné grâce à l’opérateur, le Cemagref, aux animateurs, auxchercheurs et aux partenaires. Chacun a apprécié selon son goût. Un certainnombre de messages sont passés dans les deux sens, des chercheurs vers lesacteurs de la décision publique et de la décision publique vers les acteurs.231
Les impressions d'ensemble.Le programme a coûté environ 300 000 € par an. Si cette somme nous étaitdonnée aujourd’hui, qu'en ferions-nous ? Je n’affecterais pas cette somme pourrecruter des experts de haut niveau parce que nous n'aurions pas le panoramaremarquable que nous avons eu au cours de ces 48 heures. Deuxièmement, jeréserverais sûrement un budget pour des rencontres beaucoup plus fréquentes, lacohabitation dont a parlé Claude Gilbert doit vivre et demande un minimum demoyens. Se voir plus régulièrement permettrait d‘éviter des décalages et de savoirce que font les uns et les autres. Je réserverais un budget, non pas de rechercheavec appel à propositions, mais un budget d’expertise et d’études dédié enparticulier à l’économie du risque.Des demandes de valorisation.Une synthèse du programme devrait être présentée :- au groupe interministériel sur les risques que préside Thierry Trouvé, leDirecteur des risques, qui se réunit régulièrement.- dans les clubs régionaux de bassin de risques animés par la Direction desrisques, qui regroupent les agents techniques de l’État et parfois lescollectivités. Ce sont des bons relais vis-à-vis des agents publics.Il faudrait qu’à ces synthèses, soient annexées les coordonnées des chercheurs etque les informations soient ensuite régionalisées.De façon plus conséquente, je proposerais que des modules de formation continuesoient montés à partir de ces deux jours de colloque dans les écoles d’ingénieursou les universités. La table ronde d’hier et celle de ce matin ont les élémentsnécessaires pour monter un séminaire sur la scène du risque, la typologie desdifférents acteurs, comment négocier avec eux.Enfin, certaines recherches demandent encore un effort pour être opérationnelleset donc un budget supplémentaire. Je vais en citer trois :- l’échelle des risques dont Claire Arnal a parlé. Il faut l’échantillonner. Unefois cette opération réalisée, les inspections pourraient l’utiliser lors desretours d’expérience.- l’observatoire des alertes de Chateauraynaud. Ma proposition serait que,pour deux ou trois ans, avec un bilan annuel suspensif, une directionaccepte de financer la recherche sur les thèmes en train d'émerger, ceuxqui disparaissent, etc.- la documentation accumulée sur les retours d’expérience, les directionsdevant bâtir une doctrine en termes d’archivage et de diffusion.Des pistes pour la suite.Eric Vindimian a affirmé que les programmes RDT, ERANET, etc. assureraient lasuite au sein du MEDD. La DRAST est en train de lancer une grande enquête surles besoins de recherche en matière de risques.232
Trois suggestions :- Le président Louis, de l’Association des Communes soumises à desrisques majeurs, a souhaité hier que des rencontres comme celle-ci soientorganisées en province. Cette demande a été relayée par le colloque. Lesdirections compétentes ne pourraient-elles pas en parler avec lui ? Il nes’agirait pas d’ajouter encore un colloque, mais de cibler sur desrencontres.- Tous ont souligné la part trop modeste en économie. Je propose à la suitede l’expérience Séchilienne, où on a eu besoin d’économie, qu’une journéesoit organisée avec quelques économistes pour bien préciser quelle est lademande de l’État et quels outils peuvent être proposés, quelles sont lesméthodes disponibles. La Direction des Etudes Economiques pourraitprendre en compte cette initiative.- Grâce à des programmes comme EPR, RIO et d’autres, les inspectionsont pris l’habitude dans les situations difficiles des retours d’expérience demettre en place des groupes d’appui scientifique. Ce système a fonctionnénotamment grâce à Gérard Brugnot au moins six fois et il faut en tirer unbilan. Les chercheurs qui ont été mobilisés ainsi que les partenaires, dontl’État, devraient dire quels en sont les intérêts, les inconvénients afin derecadrer le système qui peut être exportable.Je reviens sur la scène du risque. Il y a un mot hébreu «Rouar'ch», qui signifie labonne distance entre les tentes. Nous sommes ici des acteurs et nous avonschacun notre tente. Les tentes des Hébreux ne devaient pas être trop près lesunes des autres pour éviter les confusions entre les familles et dans les esprits.Chacun devait garder son identité. En même temps, il ne fallait pas qu’elles soienttrop loin pour pouvoir échanger, veiller les unes sur les autres et interagir. Je vouspropose que notre scène du risque continue son chemin à distance de «Rouar'ch».Eric Vindimian, D4E, MEDDLes débats ont été riches et un réel dialogue s'est instauré. Les colloques sontimportants, surtout ce mode de colloque qui est basé sur le dialogue. Néanmoins,à la fin du programme EPR, il reste quelques questions.La recherche ne répond pas systématiquement sur tout. Elle ouvre autant deportes que de solutions. Des questions surgissent sur le fonctionnement de larecherche, l’exploitation des résultats de la recherche. Des avancées, desexpériences réussies, des relations entre la recherche et l’expertise, entre lefondamental et l’appliqué, des tentatives d’évasion des deux côtés sont observées.Je cite souvent l’article 13 de la charte des droits fondamentaux des Européens,«les arts et la recherche scientifique sont libres.» C’est tout à l’honneur desresponsables des politiques publiques et des gestionnaires d’apporter des sujetsqui conduisent les chercheurs à s’échapper vers la recherche fondamentale. Noussavons que les procédures ne vont pas du haut vers le bas. Parfois, c’est parcequ’on connaît le terrain, on trouve à faire des développements théoriques. Danstoute l’histoire, la science a ainsi fonctionné et de grands chercheurs sont partis de233
problèmes à résoudre et ont débouché sur des réelles découvertes scientifiquesqui n’étaient pas prévues. Le lien avec le problème à résoudre peut être ténu.Une question importante est la pérennité du réseau des scientifiques. Quand unprogramme de recherches est lancé, une communauté vit, une communauté secrée, souvent une communauté scientifique. Une demande de pérennité tient aufait que des interactions ont été réalisées. Comment la construire ? Ce sujet estimportant.La dernière question qui reste ouverte est celle de l’économie. On n’a pas vraimentréussi. On continuera. Je retiens l’idée d’un séminaire pour avancer, en comitéréduit, aller jusqu’au fond du problème pour arriver à comprendre pourquoi onn’arrive pas à le dénouer et trouver des solutions.Comment poursuivre ? On continue à travers le programme RDT. Le programmeRDT n’est pas un programme sciences dures. Les SHS ont leur place, elles vont latrouver. Nous avons délibérément adopté une posture dans mon service, celle dene plus séparer les sciences dures des sciences souples. Nous avons des objets,des questionnements de politique publique et nous cherchons à les résoudre avectoutes les disciplines. Certains économistes ne sont pas loin des mathématiciens.Personnellement, je reconnais de moins en moins cette distinction même si pourles scientifiques, chacun a son mode de classification. RDT est un programme. Lacaractéristique par rapport à EPR est qu'il s’intéresse au territoire, peut-être pourtrouver des solutions aux problèmes posés au cours de ce colloque parce quecette scène du risque a été nationale mais il y a des scènes partout. Par ailleurs,des expériences de concertation locale existent sur tout le territoire. Plus onconstruit la mondialisation, plus on construit l’Europe, plus on a besoin d’avoir desterritoires à échelle humaine. Dans les régions, on arrive à trouver des choses toutà fait intéressantes de ce point de vue là. Il est toujours impressionnant de voircomment on est capable d’innover et de former un creuset.La recherche comporte aussi une dimension européenne. Un des programmesERANET a démarré, le programme CRUE, et dès 2006, nous allons mettre encommun nos actions de recherche dans le domaine des inondations avec noshomologues européens sous le pilotage de nos collègues britanniques du DEFRA.C’est également une aventure. Ainsi, lorsque nous travaillerons sur la scènerégionale, nous ne viendrons peut-être pas dans tous les colloques et nousn'organiserons pas des colloques dans toutes les régions car nous sommes auniveau national en lien avec le niveau européen. On compte beaucoup sur leschercheurs, sur les acteurs de terrain pour monter des opérations locales. Onessayera de gérer ici le changement d’échelle.Je note bien les remarques : le souci d’aller plus loin, que les documents neservent pas à caler les bureaux. Les documents sont lus, le comité d’orientation ad’ailleurs fait un effort très intéressant. Quand on se propose de les publier, c’estbien qu’on se rend compte de leur intérêt. Nous allons aussi tout mettre sur notresite web. Dès la fin de ce mois, nous aurons une personne, un webmaster qui varelancer notre lettre mensuelle. Les rapports sont faits pour être disséminés.234
Thierry Trouvé, Directeur de la DPPR, MEDDQuand Eric Vindimian m’a demandé de clore ce colloque, j’ai accepté tout de suite.C’est un exercice auquel je me plie volontiers parce qu’en tant que DPPR, j’attacheune très grande importance à la place de la recherche dans le domaine de laprévention. On passe notre temps, dans ce domaine, à dire qu’un des piliers denotre politique est la connaissance, qu’il s’agisse de réduire le risque à la source,tout au long du processus de gestion des situations paroxystiques ou de tirer desenseignements nécessaires à l’amélioration de la prévention. Tout cela supposeun investissement permanent en matière de recherche et d’expertise, pour nousaider à la prise de décision et à la gestion des risques.La demande sociale refuse de plus en plus le risque. Il est assez frappant deconstater que dans le risque naturel, on est tout de suite renvoyé au champanthropique. Il y a un risque naturel mais c’est de toute façon la faute de l’homme.Que les risques soient naturels ou technologiques, très rapidement on basculedans la recherche des coupables. Pas des responsables, des coupables. Cettetendance ne fera que s’alourdir. L’importance croissante des enjeux, la perspectived’événements plus violents en particulier liés au changement climatique,…, neferont qu’accroître ces tendances. Aussi, à côté de démarches scientifiques ettechniques dures, les dimensions sociales et psychologiques doivent être prises encompte et valorisées, pour aider à l’adhésion de la société à une politique et uneculture de la prévention qui soient raisonnées.La prévention des risques est une composante de l’aménagement et dudéveloppement. Donc, sa prise en compte me paraît toujours difficile. En tantqu’opérationnel de la prévention des risques, il est difficile de faire valoir ce type depréoccupations. Une des raisons fondamentales reste notre faiblesse dansl’approche des dimensions économiques. Des progrès sont à réaliser sur ce sujet.La dimension de la vulnérabilité demeure à ce jour mal explorée. C'est un réelhandicap en termes de choix d’aménagement, d’attribution budgétaires deressources financières, d’être confrontés avec des personnes qui n’ont pas lamême vision que nous lorsqu’on établit un PPR ou lorsqu’il s’agit de diffuserl’information de prévention. On a besoin de progresser sur les approchessociologiques et économiques. Je suis sensible aux efforts qui sont faits. On aaussi besoin de progresser sur la question de la hiérarchisation des risques et detraiter cette notion du risque acceptable qui est difficile à aborder.Ma deuxième réflexion porte sur la question de l’accompagnement par larecherche de la politique de prévention sur le terrain. La recherche étaittraditionnellement une prérogative de l'État et aujourd’hui, elle se trouvebousculée. Dans sa dimension d’application, la recherche doit prendre en comptecette nouvelle donnée territoriale et se rapprocher de nouveaux foyers d’initiativeet de décision que sont les collectivités locales mais aussi les entreprises. Leprogramme de recherche RDT s’intéresse à l’appui scientifique apporté auxacteurs locaux en matière de gestion des risques. Cette proximité est de nature àrapprocher la recherche de la société civile et à favoriser ainsi la pédagogie, lacommunication et l’appropriation. Paul Louis a rappelé hier le souci du concret et235
du retour sur le terrain qui sont d’excellents moyens de valoriser la recherche et dela confronter au vécu.En troisième lieu, je voudrais souligner avec Philippe Huet et Claude Gilbert que laprévention des risques ne fait pas l’objet d’un programme de recherche globalidentifié. La prévention des risques bénéficie des retombées de plusieursprogrammes de recherche plus généraux. D’une certaine manière, c’est inévitable.Certains d’entre eux, très vastes comme par exemple, les domaines liés à la santé,restent prioritaires aux yeux de tous. Pour autant, l’intérêt de programmes commeEPR est évident. C’est un espace de rassemblement. Une des constatations de cecolloque est que ce réseau a fonctionné. Il a permis d’irriguer l’ensemble desmilieux concernés. Un nombre significatif des résultats des recherches qui ont étéprésentés pendant ces deux jours sont déjà intégrés dans les politiques publiquessans même qu’on en ait eu conscience. C’est seulement parce qu’on a passé deuxjours à réfléchir ensemble et à faire ce bilan qu’on s’en est rendu compte. Ce qui,d’une certaine manière, est un signe de la réussite.Et maintenant ? Je voudrais esquisser quelques pistes de travail.Une direction opérationnelle de ce ministère comme la DPPR ou la Direction del’eau doit pouvoir s’appuyer sur des programmes de recherche de type rechercheappliquée donc qui s’intéressent à des aspects opérationnels et qui nourrissentl’expertise publique.Cet effet réseau est extrêmement important. Il faut qu’il continue à exister. C’est unbut à viser. Les aspects de la vulnérabilité, les questions de place des risquesdans les priorités des collectivités territoriales et les questions économiquesdoivent être mieux prises en compte dans les programmes de recherche.L’apport de sensibilités extérieures, notamment de personnes issues d’autres paysest également important car il permet de prendre du recul, de distancier, derelativiser les choses et de progresser dans la réflexion.Pour être plus précis vis à vis des questions posées par Philippe Huet, il estindispensable de valoriser le travail accompli. Présenter les résultats duprogramme EPR au sein des différents clubs et des différents réseaux investisdans le domaine du risque est quelque chose de simple et qu’on pourrait faire,d’autant plus que les réseaux risques sont en cours d’élargissement.Il faut examiner, en liaison avec la D4E, les suites qui pourraient être réservées àcertaines recherches.Pour finir, un tel colloque nous permet aussi de montrer la vanité de certainesconstructions technocratiques. La technique est importante, certes, on en a besoin,elle est indispensable mais à elle seule, elle ne peut pas nous permettred’atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de travailler sur les comportements etla conviction profonde du risque dans les populations qui sont des vecteursimportants de la prévention. A l’issue de ces deux jours, je suis convaincu quenous avons besoin de travailler de cette manière symbiotique pour continuer àprogresser efficacement.236
Achevé d'imprimer au Cemagref le 1 er juin 2006Antony - France
L’objectif de ce colloque était de susciter les échanges entre les scientifiqueset les gestionnaires du risque, à partir des recherches effectuées dans le cadredu programme EPR ( Évaluation et Prise en compte des Risques naturelset technologiques) du MEDD.Cinq tables rondes ont été organisées, suivies d'un débat avec les participantsa utour de grands thèmes au cœur de la problématique des risques :– dire le risque– intégrer la société civile dans la gestion du risque– permettre l'appropriation des outils de la gestion des risques– comment faire des retours d'expérience– connaître des expériences étrangères en matière de gestion des risquesCemagref 2006ISBN 2-85362-660-1