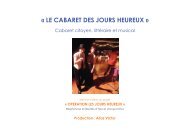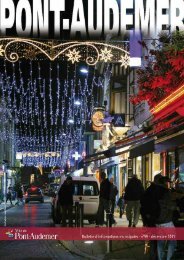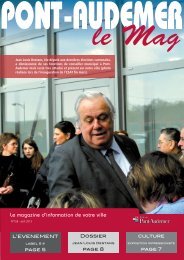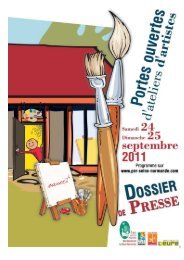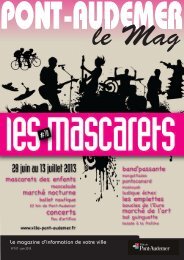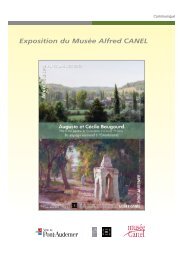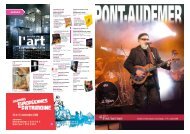Catherine Poncin explore les collections du Musée Canel
Catherine Poncin explore les collections du Musée Canel
Catherine Poncin explore les collections du Musée Canel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
moine urbain, rural, in<strong>du</strong>striel ou culturel, dans des gril<strong>les</strong> visuel<strong>les</strong> dont l’incarnation esttout aussi précaire que l'identité des êtres et des choses qui y sont cités, et que le tempsdans lequel ils existent ou ont existé. Leur confrontation au sein de ce tissu de photographiesredistribuées rend leur anonymat familier ; un réseau de correspondances entre instantsprésents, passés et dépassés fait de cette oeuvre une chambre d'échos inachevés oùl'homme, son histoire et ses objets se dissolvent dans une mémoire bégayante et démesurée.Quelle utopie agite cette tentative d’embrasser <strong>les</strong> reliefs <strong>du</strong> vivant dans un précipitésaisissant <strong>les</strong> vibrations de sa trace ? La démarche structurale de <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong>nourrit un système graphique ouvert dont <strong>les</strong> ressources et la profondeur évoquent cel<strong>les</strong>des « relations transtextuel<strong>les</strong> » théorisées par Gérard Genette en littérature. Ce dernierconsidère le texte dans « sa transcendance textuelle, à savoir tout ce qui le met en relation,manifeste ou secrète, avec d'autres textes. J'appelle cela la transtextualité, et j'yenglobe l'intertextualité au sens strict […], c'est-à-dire la présence littérale […] d'un textedans un autre: la citation, c'est-à-dire la convocation explicite d'un texte à la fois présentéet distancié par des guillemets […].». Métatextualité (relation de commentaire) ethypertextualité (relation de filiation) et paratextualité (relation de « voisinage » avec <strong>les</strong>seuils <strong>du</strong> texte, comme la préface) complètent un appareil poétique dont la transpositionrelative à l’analyse esthétique se prête à la découverte des régimes formels et symboliquesà l’oeuvre dans <strong>les</strong> compositions croisées de <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong>. Ses « emprunts » - visionset substances distraites de leurs usages et de leur destin particuliers – contribuent à l’élaborationd’une oeuvre-palimpseste où se peuvent se décharger <strong>les</strong> inconsciences <strong>les</strong> plusdiverses. Ce caractère polysémique est amplifié par la forme ternaire qui s’est stabiliséedans <strong>les</strong> polyptiques de <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong>. Au-delà des représentations canoniques portéespar le triptyque religieux, c’est dans la force dialectique et le mystère épiphanique del’assemblage qu’il faut situer ce choix. Philosophies et religions ont universellement attribuéà la triade une transcendance liée à une métaphysique de l’être composite et contingentdans son corps, son esprit et son âme. Des nombreuses associations qui en résultent,deux concepts essentiels s’imposent ici ; le temps pour le passé, le présent et l’avenir ; maisaussi la création, pour le créateur, l’acte de créer et la créature.Indissociable de la naissance, de l’existence et de la mort, l’oeuvre de la création, dans lavie comme dans l’art, est variable sur l’échelle <strong>du</strong> temps. De ces écarts naissent la différenceet le lien, la présence et l’absence, la peur et le désir ; la foi dans la continuité deleur relation se nomme l’espoir.Les ouvertures successives de boîtes, coffres, d’étuis et d’écrins matériels ou virtuels nefont pas chez <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong> l’économie <strong>du</strong> divertissement, en dépit des accents tragiquesqu’elle peut y trouver parfois. La mise en perspective qu’opère son travail procèdemoins de l’approche indicielle <strong>du</strong> photographe que de l’instinct opportuniste <strong>du</strong> collectionneur,de celui qui rassemble et assemble selon l’ordonnance de son envie et de sonplaisir. Victor Segalen, dans son Essai sur l’exotisme en 1912, pointe le goût pour <strong>les</strong> écartsqui fonde le principe d’une collection : « Réunir des objets qui parfois n’ont qu’une qualitéqui est de différer légèrement entre eux est encore un hommage – grossier parfois –ren<strong>du</strong> à la Différence. (…) C’est dans la différence que gît tout l’intérêt. Plus la différenceest fine, indiscernable, plus s’éveille et s’aiguise le sens <strong>du</strong> Divers. (…) Toute série, toutegradation, toute comparaison engendre la variété, la diversité. Séparés, <strong>les</strong> objets semblaientvaguement semblab<strong>les</strong>, homogènes ; réunis, ils s’opposent ou <strong>du</strong> moins « existent» avec d’autant plus de force que la matière, plus riche et plus souple, a davantage demoyens et de modalités nuancées. »Chercher la différence dans la pro<strong>du</strong>ction d’une usine peut sembler une gageure. Quandle lieu en question concerne une manufacture, où la main est en intelligence avec lamachine, et interprète l’essentiel de la partition, le pari a des chances d’être gagnant. Ainsila collecte de <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong> à la Manufacture de Gien a ren<strong>du</strong> sa moisson de fragmentsenchâssés en trinômes. Les termes génériques énoncés précédemment – sublimation,polysémie et transcendance – sont actifs sur un terrain qui s’est déplacé pour cetteoccasion dans <strong>les</strong> formes et la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail. Cet univers familier à <strong>Catherine</strong> <strong>Poncin</strong> sedéveloppe à Gien sur deux dimensions, l’une attachée à l’objet et l’autre à son décor. Lesprocessus de fabrication de la faïence et <strong>les</strong> techniques de façonnage structurent la première,dans l’alliance de l’artisanat et de l’in<strong>du</strong>strie ; la seconde relève, pour <strong>les</strong> motifs utilisés,<strong>du</strong> domaine patrimonial et de l’histoire des arts décoratifs. Les cas d’hybridation deces catégories ne sont pas rares, à l’inverse, aujourd’hui, des lieux où elle est pratiquée au22