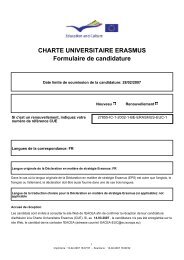CONTES ET METAPHORES EN TRAVAIL SOCIAL - HELMo
CONTES ET METAPHORES EN TRAVAIL SOCIAL - HELMo
CONTES ET METAPHORES EN TRAVAIL SOCIAL - HELMo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. RACONTER DES HISTOIRES« C’est l’humain qui fait l’histoire et non pas l’histoire qui fait l’humain. »Henri MASSIS1.1. Fondement de l’art narratifDepuis la préhistoire, depuis notre plus jeune âge et partout dans le monde, nousracontons des histoires, nous racontons les histoires de nos vies. Avant les traces écritesde ces histoires, cet art narratif s’est exprimé par la tradition orale. Certains maîtrisentdavantage « l’oralité » soit en que tant que « leadership » pour imposer ses valeurs etses idées, soit en tant que traducteur ou porte-parole des « non-dit », des « sansvoix»…Nous, intervenants sociaux, veillons à ce que chacun se réapproprie « cetteoralité ».Chercheur en psychologie culturelle et éducative, Jérôme BRUNIER explique le liennarratif entre individu et collectivité dans un contexte culturel : 1« Notre expérience est traduite sous forme narrative dans les conventions du récit, quipermet de convertir l’expérience individuelle en monnaie collective, qui en quelque sortepeut entrer en circulation sur une base plus large que la seule relationinterpersonnelle.(…) Et dans la mesure où le conte populaire et le récit en générals’articule autour de cette dialectique entre les normes attendues et porteuses d’unepart ; et d’autre part, l’évocation de transgressions possibles, il n’est pas surprenant quele récit, comme la culture elle-même soit à la fois la monnaie et la devise d’une culture. »Jérôme BRUNIER poursuit en expliquant l’art narratif qui consiste à construire deshistoires pour se raconter soi-même.« Cette construction très irrégulière procède à la fois de l’intérieur et de l’extérieur.L’intérieur, c’est la mémoire, les sentiments, les croyances, la subjectivité. Une part decette intériorité est très certainement innée, propre à notre espèce. (…) Mais une grandepartie du récit que nous faisons de nous-même est également fondée sur des sourcesextérieures ; sur l’apparente estime que les autres nous portent et sur les innombrablesattentes que nous avons très tôt puisées, sans même y penser dans la culture où noussommes immergés. »Transmises par les voies de la communication, les histoires évoquent un lien deréciprocité ; prendre la parole suscite le fait d’être écouté ; créer une œuvre d’artprovoque l’espérance d’être rejoint dans la contemplation ; offrir ses services attirel’accueil de ceux-ci…1 BRUNIER Jérôme, Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, éd. Retz, France, 112 pages, 2002, p.184 /25
D’après Patrick TRAUBE, psychothérapeute belge, donner et recevoir, demander etrefuser : quatre actions clés qui fondent les relations humaines épanouissantes etrespectueuses.Balancier entre réalité et imaginaire, le processus narratif remplit plusieurs fonctions tellesla transmission d’informations et de rituels de la vie quotidienne, le partage d’émotionsliées à des évènements de vie ou à des univers imaginaires, le passage de l’identitéindividuelle vers une identité collective ou encore la recherche de sens existentiels.« Peu importe les époques, les modes et les coutumes, le - dis, tu me racontes unehistoire – est une demande intemporelle, sans appartenance de lieux, ni de races. Chacunde nous a établi un rapport avec ces histoires et a créé un lien indélébile, ineffaçable,indestructible. Léger cordon ou amarre pesante, ce lien est là agissant dans notreimaginaire dont il est un des constituants. Le récit, ce lieu magique de tous les possiblesest l’endroit où on invente ou réinvente le passé, où l’on crée ou recrée le présent et où onl’on imagine l’avenir. C’est l’espace de l’apparente liberté d’où seraient bannies entraves etpressions, c’est le lieu où l’on déplace les contraintes de la vie vers celles, moins violentes,de la narration orale ou écrite. Personnages de fiction ou réels, quelle importance ? Lesens général qui se dégagera du récit est celui que l’auteur voudra bien lui conférer. » 2Durant leur croissance, les enfants s’identifient à leurs parents pour ensuite prendreconscience de leur individualité en découvrant entre autre leur reflet dans le miroir oul’écho de leur voix…Par le mimétisme et l’imaginaire, les enfants entrent très tôt dans lanarration, confrontés aux obstacles de la vie, aux processus inconscients liés auxpulsions, aux mécanismes défensifs, aux angoisses et fantasmes.« En matière d’histoires, les enfants sont de fameux conservateurs. Ils veulent lesréentendre avec les mêmes mots que la première fois, pour le plaisir de les reconnaîtrevoir de les apprendre par cœur avant de se lancer dans l’aventure des variantes ou del’improvisation. Les mots constituent l’ancrage des sentiments éprouvés. Lorsque l’enfantapprivoise un coin de son univers, il en refait le tour du propriétaire avant de se risquerailleurs. Ce n’est que plus tard qu’ils accepteront la surprise des variantes et d’une autreexploration du thème ; qu’un point de vue neuf en renouvellera l’intérêt. » 3L’étape suivante de socialisation permet soit le renforcement du modèle groupalidentitaire, soit l’altérité identitaire où l’autre est différent de soi. Toute cette évolutionest inscrite dans des histoires culturelles, des récits mythologiques aux parabolesbibliques, des contes populaires aux contes de fée ou encore récemment des histoiresmagiques destinées principalement aux adolescents, telles que les épisodes d’HarryPotter, du Seigneur des anneaux, Twilight…2 GRAITSON Isabelle avec la collaboration d’Elisabeth NEUFORGE, L’intervention narrative en travail social, essaiméthodologique à partir des récits de vie, éd. L’Harmattan, France, 219 pages, 2008, p.263 FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004, p.575 /25
Dans cet écrit et comme le titre l’indique, nous évoquerons davantage les formes narrativesdes contes et des métaphores.Les contes sont « des récits imaginaires et métaphoriques d’une aventure. Contrairement auxhistoires brèves, ils comportent des étapes et des rebondissements qui entretiennent curiositéet suspense jusqu’à sa conclusion. » 4 Pierre MOURLON BEERNART 5 précise que « les contesfont partie de la littérature populaire et sont transmis de bouche à oreille avant d’être consignésdans des livres ; c’est la raison pour laquelle dans des pays à civilisation orale comme en AfriqueNoire, ils demeurent aussi vivants, chaque conteur aménageant le récit à sa façon. »Tout comme il existe des bandes dessinées adaptées aux enfants et d’autres destinées auxadultes, des contes populaires sont particulièrement adressés aux adultes qui bercés parl’imaginaire de l’enfance cherchent souvent des significations multiples…Par contre les contesde fées, spécialement pour les enfants, simplifient les situations en typant les personnagesafin de maximiser l’écho.Dans son livre Psychanalyse des contes de fées, Bruno B<strong>ET</strong>TELHEIM, thérapeute autrichien,explique l’impact des contes de fées auprès des enfants, en aidant ceux-ci à donner du sensà leur vie. 6« Pour pouvoir régler les problèmes psychologiques de la croissance (c’est-à-dire surmonter lesdéceptions narcissiques, les problèmes œdipiens, les rivalités fraternelles ; être capable derenoncer aux dépendances de l’enfance ; affirmer sa personnalité ; prendre conscience de sapropre valeur et de ses obligations morales) ; l’enfant a besoin de comprendre ce qui se passedans son être conscient et, grâce à cela, de faire face également à ce qui se passe dans soninconscient.(…) C’est ici que l’on voit la valeur inégalée du conte de fées : il ouvre de nouvellesdimensions à l’imagination de l’enfant que celui-ci serait incapable de découvrir seul. Et, ce qui estencore plus important, la forme et la structure du conte de fées lui offre des images qu’il peutincorporer à ses rêves éveillés et qui aident à mieux orienter sa vie. »Beaucoup d’entre nous se souviennent du petit chaperon rouge naïf, qui se fait attraper dansle piège du grand méchant loup ; où le dénouement de l’histoire insiste sur la justice rétabliepar le chasseur tirant sur le grand méchant loup libérant ainsi le petit chaperon rouge et sagrand-mère. Ce conte intemporel marque les imaginaires des petits et des grands par laforce de ses messages : naïveté et insouciance de l’enfance, confrontation aux pertes de sesrepères, aux rencontres surprenantes sur le chemin,…mais veillons à ne pas sombrer dansune méfiance excessive face à l’inconnu ; en ciblant davantage les possibilités à éviter ou àcontourner les dangers.4 FEVRE Louis, Contes et métaphores, éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004, p1775 COLLECTIF, présenté par Pierre MOURLON BEERNART, Contes de Noël pour notre temps, éd. Lumen Vitae,Belgique, 151 pages, 1993, p186 B<strong>ET</strong>TELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, éd. Pocket, Robert Laffont, France, 477 pages, 1999,p.187 /25
Quant aux métaphores, elles sont définies par David GORDON « comme une façon de parlerdans laquelle une chose est exprimée en termes d’une autre, jetant par ce rapprochement unnouvel éclairage sur le caractère de ce qui est décrit. » 7Il poursuit en disant que les métaphores sont des représentations du vécu qui ne sont pasles expériences elles-mêmes. Face au malaise que nous pouvons ressentir, nous exprimonscertaines images fortes comme tomber dans le vide ou s’écraser contre un mur ou encoreêtre sur le bord du précipice…Ces images fortes évoquent l’intensité du malaise sans issue ;par contre, si nous imaginons être perdus dans un labyrinthe, ce n’est pas pour autant quenous vivons l’expérience réelle d’un labyrinthe. Ce parcours de vie est parsemé d’obstaclesapparaissant insurmontables. Soit nous concentrons notre regard sur les multiples impasseset les allées et venues infructueuses ; soit nous pouvons entrevoir l’issue possible de celabyrinthe, vers d’autres perspectives plus lumineuses…Cet exemple démontre une caractéristique essentielle des contes et des métaphores où lessignifications sont multiples : la polysémie que Louis FEVRE développe comme ceci : « celuiqui lit, dit, écoute, en capte ce qu’il peut sur le moment et il complète par la suite lessignifications qu’il porte aux évènements. » 8Il mentionne une autre caractéristique : l’isomorphisme. « Une métaphore isomorphiquetranspose presque trait pour trait les éléments du caractère, les choix fondamentaux, lessystèmes de valeurs, le type de problème vécu par le destinateur. Il s’agit d’une correspondancede structure et non d’un mimétisme. Le contexte, les personnages, l’aboutissement et surtout laressource à introduire doivent intriguer, voire dérouter l’intéressé. »7 GORDON David, Contes et métaphores thérapeutiques, apprendre à raconter des histoires qui font du bien, éd.Dunod, France, 191 pages, 2006, p.178 FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004, p.186 & p.1828 /25
« Madame Blanche venait de terminer ses courses. Au comptoir du self, elle acheta un bol desoupe, alla s’installer à une table, y posa son plateau et s’aperçut qu’elle avait oublié de prendreune cuillère. Elle repartit aussitôt en chercher une au comptoir. Revenant à sa place, une minuteplus tard, elle trouva Monsieur Noir installé devant le bol, trempant sa cuillère dans la soupe.Quel « sens gêne », pensa-t-elle ! Mais il n’a pas l’air méchant…Ne le brusquons pas ! Vouspermettez, lui dit-elle en tirant la soupe de son côté. Son interlocuteur ne répond que par unlarge sourire et elle commence à manger. A ce moment, Monsieur Noir retire un peu le bol vers luiet le laisse au milieu de la table. A son tour, il plonge sa cuillère et mange, mais avec tantd’amabilité dans le geste et le regard qu’elle le laisse faire. Ils mangent à tour de rôle. Sonindignation a fait place à la surprise, Madame Blanche se sent même un peu complice. La soupeterminée, Monsieur Noir se lève, lui fait signe de ne pas bouger et revient avec une abondanteportion de frites qu’il pose au milieu de la table. Il l’invite à se servir. Elle accepte et ilspartagent les frites. Puis, Monsieur Noir se lève pour prendre congé. Il lui offre un ample salutde la tête et prononce l’un de ses premiers mots : Merci ! Madame Blanche reste un momentpensive et songe à s’en aller. Elle cherche son sac à main qu’elle a accroché au dossier de sachaise. Plus de sac ! Mais alors se dit-elle Monsieur Noir n’était qu’un pickpocket ! Ses yeuxtombèrent alors sur un bol de soupe intact et froid, posé sur une table voisine, devant la chaiseoù est accroché son sac. Il manque une cuillère sur le plateau. » 92. TRANSFORMER LES REPRES<strong>EN</strong>TATIONS <strong>SOCIAL</strong>ES«L’expérience n’est pas ce qui arrive à l’individu, c’est ce que l’individu fait de ce qui lui arrive. »Aldous HUXLEYCet inconnu qui s’impose à notre table et s’en va avec notre sac est forcément unimposteur ! Cette histoire étonnante nous invite à prendre conscience de nos représentationssociales et à les modeler, tel un morceau d’argile, touché, pétri et orienté vers une autreforme…Surtout quand il s’agit d’un jugement de valeur si vite établi !9 Récit repris et adapté par FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages,2004, p. 1149 /25
2.1. Notions de représentations socialesEn 1961, MOSCOVISCI redéfinit la notion de représentations en soulignant le caractèresocial. Traduites dans des actions, ces façons d’appréhender le monde se fondent sur desvaleurs en tant que repères stables et hiérarchisées permettant de justifier des choix et desnormes en tant que règles communes sanctionnées quand elles sont transgressées.D’après Jean-Claude ABRIC 10 , les représentations sociales sont souvent inconscientes etsystématisées, partagées par des catégories de personnes. Elles remplissent diversesfonctions :1) Cognitive en permettant de comprendre et d’expliquer des réalités de vie ;2) Identitaire en définissant les identités individuelles et collectives ;3) Directive en orientant des comportements normatifs ;4) Justificatrice en argumentant les valeurs et les normes adaptées.D’une part, ces représentations sociales ont tendance à être stables par un triple ancrage :1) L’ancrage psychologique est constitué de mécanismes mentaux étroitement liés à sonhistoire personnelle. Edgar MORIN utilise l’expression « d’imprinting culturel » pouraborder les façonnages précoces de l’enfance.2) L’ancrage social est élaboré avec les routines sociales, les mécanismes d’influence etde subordination aux normes sociales.3) L’ancrage institutionnel où les représentations sociales sont relayées par desinstitutions publiques, politiques, médiatiques, religieuses, formatives,…D’autre part, ces représentations sociales sont amenées à évoluer pour s’ajuster aux réalitésrencontrées en fonction des expériences de vie. Ce processus de transformation personnelleet collective des représentations sociales dépend de deux facteurs : le premier contextuelconcerne l’environnement sociétal avec les progrès techniques, les politiques sociales,l’évolution des valeurs et des phénomènes de société. L’autre facteur identitaire faitréférence à notre façon de nous impliquer dans notre cheminement à la croisée d’autreschemins.Pour illustrer, prenons un fait social tel que le licenciement collectif de travailleurs dans uneentreprise. Selon le contexte socioéconomique de crise ou de prospérité économique, cetteréalité de licenciement collectif est vécue différemment selon les acteurs concernés. Auniveau des employeurs, le licenciement collectif est devenu une étape nécessaire pour éviterune faillite ou éventuellement augmenter le profit. Au niveau des travailleurs, un jeunehomme licencié après un an de travail n’a pas le même vécu (en considérant peut-être lelicenciement comme un passage ou un tremplin vers une autre orientation professionnelle)qu’un quinquagénaire travaillant depuis trente ans dans l’entreprise. Dans sa situation deprofessionnel confirmé, le licenciement bouscule les repères établis de longue date et signifieune chute, une injustice, une non reconnaissance de ses compétences, une disparition de lasécurité économique et une profonde angoisse face à l’inconnu…10 ABRIC Jean-Claude (sous la direction de), Pratiques sociales et représentations sociales, éd. PUF, France, 199410 /25
2.2. Evolution des représentations socialesCélèbre physicien et chimiste qui a reçu le prix Nobel en 1971, PRIGOGINE a découvert lesstructures dissipatives : « C’est loin de l’équilibre que les choses se créent. Chaque équilibre estvoué à disparaître pour donner naissance à un nouvel équilibre. » Cette découvertefondamentale est transférable en sciences sociales où un nouvel équilibre entraîne deschangements, où les représentations sociales évoluent, confrontées aux changements liésaux expériences de vie…Par exemple, la représentation sociale que certains couples ont développée de leur viecommune consiste à être fidèle, à conserver la répartition des rôles établis en début decontrat et de privilégier le cocoon amoureux en partageant ensemble un maximum detemps. A partir du moment où l’un des conjoints provoque des changements, par le débutd’une démarche de développement personnel, une nouvelle orientation professionnelle, desrencontres amicales, des passions créatives…ces changements provoquent chez l’autreconjoint un bouleversement de sa vision du couple où le contrat évolue vers un nouveléquilibre…Comment transformer les représentations sociales ?1) Première proposition en distinguant les faits des interprétations (inférences) :Dans la poursuite de l’exemple précédent sur le fonctionnement du couple de type fusionnel,des faits précis et objectifs sont observés comme la participation à des séminaires dedéveloppement personnel, le travail thérapeutique, la recherche d’un nouveau travail, larencontre de nouvelles connaissances…A l’inverse, les interprétations imprécises etsubjectives ou inférences présentent parfois une lecture parcellaire des évènements ;suivant sa carte du monde, l’un n’est plus désirable ni aimable puisque le temps à partagerensemble est réduit, l’autre n’est plus exclusif donc n’est plus aimant puisqu’il désirerencontrer d’autres personnes…Les inférences sont inéluctables. Elles constituent souventune invitation à changer de regard et à rechercher d’autres formesd’équilibre…L’épanouissement de l’un peut rayonner sur le couple, s’ouvrir à d’autreshorizons ne signifie pas nécessairement désinvestir la relation.Sortir du cadre et du système de fonctionnement est l’idée principale du changement de typedeux, reprise dans l’intervention systémique. Par exemple, de nombreuses femmes sesentent insatisfaites de leur apparence corporelle. Dès leur plus jeune âge, elles ont reçu desmessages de leur entourage soulignant leur corpulence souvent vécues comme unedisgrâce. Ce message s’est ancré avec l’influence des médias et notamment de la presseféminine qui valorise les multiples régimes alimentaires en vue des sveltes silhouettesidéalisées. Renforçant le fonctionnement du système, le changement de type un consiste àrépéter ce message normatif, à suivre ces régimes soit disant si faciles et efficaces pourvaincre les rondeurs indésirables. Ce bien être hypothétique est opéré au prix de douloureuxsacrifices pour s’approcher de l’idéal esthétique en renouvelant de nombreuses frustrationssans pour autant atteindre le but escompté. Par contre, le changement de type deux, suscite11 /25
un changement de système, un questionnement entre les pressions normatives et lesbesoins personnels, une analyse des rapports à la nourriture et aux rythmes de viesédentaire, une appropriation de son image corporelle…Au lieu de renforcer leur ancrage, leschangements de type deux modifient les représentations sociales des individus.2) Deuxième proposition par le modèle PNL (Programmation Neuro Linguistique)D’après Louis FEVRE, « la notion de programmation se base sur un enchainement précis ethabituellement acquis d’opérations sensorielles internes et externes. La notion deneurolinguistique provient du fait que cet enchaînement s’organise dans des circuitsneurologiques de notre cerveau et se traduit dans notre langage comme dans notre expressionphysiologique. » Il poursuit en disant que « La PNL fait fructifier nos ressources et prolongenos aptitudes. Elle nous permet de reprogrammer ceux de nos apprentissages insatisfaisants. » 11La PNL est fondée sur les principes suivants : « La carte n’est pas le territoire. » « Uneintention positive motive chaque comportement. » ou encore « L’échec est du feed-back. » Cesprincipes nous invitent à creuser les repères et les commentaires sur notre vécu, lesfondements de nos comportements et les significations de nos expériences.Anne LIND<strong>EN</strong> explique la PNL « comme une façon de penser, elle rend spécifique la manièredont notre esprit fonctionne, comment nous pensons. Quand nous réalisons que nous pensons enimages et en mots, il devient plus facile de changer notre pensée en changeant l’image ou lesmots. Nous pouvons façonner nos pensées qui conduisent à la motivation et à la créativité. Savoiret comprendre la différence entre nos perceptions et la réalité nous rend plus efficace etflexible dans la communication et dans la vie. » 12En modulant notre carte du monde constituée de représentations sociales, nous évoluonsdans la résolution de problèmes, vers de nouveaux équilibres et d’autres possibles…11 FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004, p 186 et p.2612 LIND<strong>EN</strong> Anne, A propos de la PNL, article sur le site internet http://www.annelinden.org12 /25
3. DEVELOPPER UN PROCESSUS D’APPLICATION <strong>ET</strong>/OU DE CREATION DE<strong>CONTES</strong> <strong>ET</strong> M<strong>ET</strong>APHORES« Nous sommes le produit d’une histoire dont nous cherchons à devenir les sujets. »Vincent DE GAUJELACSuite aux approches des formes diversifiées d’histoires et de la transformation desreprésentations sociales, nous allons approfondir le processus d’application et de création decontes et de métaphores.3.1. Application d’expressions métaphoriquesDeux secteurs d’intervention sociale développent principalement ces expressionsmétaphoriques : le culturel et le thérapeutique.Le secteur culturel se fonde sur les traditions orales du monde et particulièrement lanarration orale où le public découvre ou retrouve le plaisir des histoires à raconter etécouter ; nombreux stages et manifestations festives rencontrent un franc succès. Enutilisant diverses formes de narration, certains projets socioculturels visent l’expressioncréative et participent au processus d’identité collective…Une maison de jeunes a créé un CDmusical où les jeunes se sont exprimés en mots et en musique ; une maison de quartier apublié un recueil de recettes du monde où des femmes immigrées s’identifient culturellementdans un premier temps par l’art culinaire…L’autre secteur -thérapeutique- concerne de nombreux intervenants sociaux sensibles ouformés à la PNL, à l’intervention systémique, investis dans une relation de travail social ausens large, à visée thérapeutique ou non. « Les vertus thérapeutiques du conte de féesviennent de ce que le patient trouve ses propres solutions, en méditant ce que l’histoire donne àentendre sur lui-même et sur les conflits internes à un moment précis de sa vie. (…) La natureirréaliste de ces contes (qui leur est reprochée par les rationalistes obtus) est un élémentimportant qui prouve à l’évidence que les contes de fées ont pour but non pas de fournir desinformations utiles sur le monde extérieur mais de rendre compte des processus internes chezun individu. » 1414 B<strong>ET</strong>TELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, éd. Pocket Robert Laffont, France, 477 pages, 1999, p.2314 /25
Nous pourrions illustrer cet échange possible en travail social : « Mon conjoint vient dedécéder dans un accident de voiture, je n’ai pas de mot pour exprimer ce que je ressens.Vous ne pouvez pas comprendre si vous n’avez pas vécu ce drame…En tant qu’intervenantsocial, je tente de comprendre ce que vous vivez… j’imagine que vous avez le soufflecoupé... Je vous imagine comme un bateau à la dérive, suite à une tempête terrible, vousavez perdu la maitrise de votre gouvernail, vos voiles sont déchirées, vous êtes égarée dansl’océan de la vie aux frontières de la mort… » L’image du bateau à la dérive est facilementaccessible et saisit toute l’intensité du drame vécu avec les différentes perspectives à creuserdans le processus de deuil : les voiles déchirées évoquent la souffrance dévastatrice de laséparation brusque, la maitrise du gouvernail aborde le déséquilibre familial, l’égarementdans l’océan aborde la perte de repères et la recherche de sens inhérente auquestionnement existentiel sur les sens de la vie et de la mort…Nous sommes souventdésemparés face au deuil, présenter ses condoléances constitue souvent une forme depolitesse de circonstance mais toutefois impersonnelle…Parmi d’autres, une citationmétaphorique permet d’introduire un sens supplémentaire aux condoléances. « La mort estcomme un bateau qui disparait à l’horizon, ce n’est pas parce qu’on ne le voit plus qu’il n’existeplus. » citation reprise par Marie de H<strong>EN</strong>NEZEL dans son livre la mort intime. Ce senspourrait être la continuité du lien entre les personnes séparées ou de l’existence humaine audelàde la disparition du champ sensoriel…Toute expression métaphorique fait écho à différents niveaux chez chacun d’entre nous àcondition d’être rejoint dans notre « carte du monde ». David GORDON poursuit cette idéeen expliquant la résolution de problèmes avec l’outil des expressions métaphoriques.« Rencontrer le client dans son modèle du monde veut dire que la métaphore préserve lastructure de la situation problématique du client. Autrement dit, les facteurs significatifs de lamétaphore sont les relations interpersonnelles du client et les schémas répétitifs qu’il emploiepour faire face dans le contexte du problème. Le problème lui-même est secondaire. » 16Dans la résolution de problème, les intervenants sociaux peuvent faire référence à d’autresvécus ou inventer des scénarios respectant la trame problématique de la personne désireused’un changement.16 GORDON David, Contes et métaphores thérapeutiques, apprendre à raconter des histoires qui font du bien,éd. Inter éditions Dunod, France, 191 pages, 2006, p. 2716 /25
« C’est l’histoire d’un colibri qui était au milieu d’une forêt en feu.Tous les animaux fuyaient apeurés, pas lui.Ce petit oiseau prenait de petites gouttes d’eau dans un lac et les jetait sur le brasier.Il répétait inlassablement son manège quand une chouette intriguée lui demanda :Colibri, es-tu devenu fou ?Tu penses que tu vas éteindre l’incendie en jetant des gouttes sur le feu ?Il répondit alors avec le plus grand calme :Je n’éteindrai pas l’incendie mais je fais ma part ! »Histoire indienne, reprise par UNIPAZDans cette histoire où le contexte présente une nature animée, résonne l’idée de faire sapart, d’être renvoyé à sa responsabilité. Cette idée est amenée progressivement dans lastructure du récit en introduisant une situation problème : la forêt est en feu ; Les moyensdu petit oiseau sont limités et inadéquats pour éteindre l’incendie. Face à la faiblesse desmoyens, les autres s’enfuient. Un autre élément avec une conviction forte de sens quimaintient la responsabilité et évite un découragement excessif face à l’ampleur de la tâche.L’implication personnelle est à la fois limitée et complémentaire à celle des autres.3.2. Adaptation d’expressions métaphoriquesSi le public visé est peu réceptif à ce genre de conte métaphorique, si ces références netouchent pas sa carte du monde, il est toutefois possible de transférer cette structuresignificative dans un autre contexte, en s’inspirant éventuellement du vécu quotidien…Fairesa part au sein du système familial ou professionnel, dans son quartier en tant que citoyenactif…Voici donc une nouvelle version du conte sur l’incendie et le colibri.Dans notre société occidentalisée friande de consommation et de course occupationnelle, ilexiste un petit village parmi d’autres où certains villageois préfèrent la mobilisation citoyenneet festive plutôt que la plainte ou le repli sur soi…Un comité des fêtes s’est créé depuisquelques années et des membres se sont désistés pour passer le relais à d’autres. Créatricesde liens sociaux, quatre manifestations festives rythment les saisons d’une année en offrantà des voisins de proximité géographique l’occasion de se rencontrer, d’échanger et des’amuser ensemble. Selon ses compétences et ses disponibilités, chaque membre du comitéest invité à faire sa part pour que ces rencontres festives soient une réussite. Un appel estlancé aux autres villageois pour des coups de main ponctuels en évitant ainsi une surchargeaux membres organisateurs. Certains prennent davantage en charge les aspects17 /25
organisationnels mais l’implication de chacun est nécessaire pour que chacun puisse être enrelation et participer autour d’un repas festif, d’un spectacle, une course au trésor, unechasse aux œufs, une animation musicale, un « Blind test »…3.3. Processus créatif d’expression métaphoriques en trois étapes1 ère étape : comprendreDans une perspective de gestion d’insatisfaction ou de résolution de problème s’impose aupréalable un questionnement explorant des composantes indispensables à lacompréhension de la situation vécue :1) Quels sont les faits précis problématiques ou insatisfaisants ?2) Quel est le contexte du vécu ?3) Quel est l’élément déclencheur du désir de changement, de la résolution duproblème ?4) Quels sont les enjeux liés aux changements ? (gain/perte)5) Quels sont les obstacles à la concrétisation de ces changements ?6) Quels sont les ressources personnelles et de l’entourage encourageant leschangements ?En vue de créer une expression métaphorique adaptée, il s’agit de comprendre l’autre dansson vécu tout en respectant sa carte du monde. Louis FEVRE définit la carte du monde ou lemodèle du monde « comme un schéma d’ensemble permettant de nous représenter la réalité.Cette carte est à la fois l’image de notre environnement, large et restreint et le système derepères que nous avons établi pour en modifier les éléments et nous situer sur ce territoire.Personnelle et en partie consciente, elle détermine l’idée que nous nous faisons des êtres et deschoses. » 1717 FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004, p.17518 /25
Cette carte du monde n’est pas le territoire, c’est une représentation d’un espace de vie bienplus complexe encore, variant selon l’âge, les polarités féminines et masculines, la culture,les traits de caractère et la trajectoire de vie. Cette compréhension affinée permet deformuler des objectifs adéquats du changement sur lesquels l’autre exerce un certaincontrôle. Chacun est renvoyé à sa part de responsabilité, dépassant l’idée que le problèmece sont les autres ou le contexte ou encore les circonstances de la vie.Toute l’implication des intervenants sociaux réside dans la compréhension subtile de lasituation insatisfaisante intégrée dans une carte du monde, pour ensuite déterminer unobjectif d’évolution adéquat et d’élaborer des pistes d’action appropriées.2 ème étape : développer des stratégiesD’après David GORDON, « les personnes connaissent généralement les changements qu’ellessouhaitent effectuer. La difficulté réside au moment de la construction du pont entre leursituation présente insatisfaisante et leur situation future envisagée, plus satisfaisante. Il évoqueles stratégies de raccordement qui se définissent comme le pont entre le problème et ledénouement. » 181) Parmi les stratégies de raccordement, la recalibration permet de susciter la prisede conscience du fait que les évènements prennent des dimensions telles qu’ilsdeviennent problématiques et ensuite de les redimensionner avec des pistes desolution. L’exemple repris par David GORDON est celui des tensions relationnellesvécues dans un couple partageant peu de temps ensemble, compte tenu du travailaccaparant du compagnon. La recalibration permettrait de réaffirmer le lien d’amourles unissant, dépassant la peur d’être moqué ou rejeté en vue d’un dénouementdésiré où le couple concilierait vie professionnelle engageante et détente partagéesans reproche…2) Une autre stratégie de raccordement, le recadrage vise la création d’autres sensassociés aux mêmes faits. Dans son livre contes et métaphores page 187, LouisFEVRE définit cette technique comme une « intervention qui consiste à changer laréponse d’une personne devant un comportement ou une situation en modifiant le sensqu’elle lui accorde. » Un exemple développé par le thérapeute Mony ELKAÏM lors deses conférences, relate les perspectives possibles d’une métaphore apparemmentréductrice, en rebondissant sur l’expression de l’autre : Une dame vient enconsultation et lui exprime son sentiment d’incompétence, de manque de confianceen elle. Au sein de sa famille, elle ne sait pas réagir adéquatement avec ses enfants,elle se sent « gourde ». Au lieu de renforcer l’image négative de gourde maladroite,18 GORDON David, Contes et métaphores thérapeutiques, apprendre à raconter des histoires qui font du bien,éd. Inter éditions Dunod, France, 191 pages, 2006, p. 4419 /25
Mony ELKAÏM approfondit cette métaphore vers une autre signification positive telleune gourde contenant de l’eau rafraichissante, eau vive indispensable à l’équilibrefamilial…3) Une autre stratégie de raccordement abordée par Louis FEVRE page 100 de son livreContes et métaphores recherche la désactivation ou le renforcement de certainsancrages. L’ancrage est défini comme « un stimulus interne ou externe associé à unréflexe de l’organisme qui le reproduit automatiquement par la suite ». Un exempleexplicite du comportement raciste provient soit d’un stéréotype généralisateur lié àune expérience négative, soit d’une valorisation de son groupe d’appartenance, soitencore d’un mécanisme lié à la peur fondamentale de l’inconnu et desdifférences…Telle une femme se promenant seule dans la rue qui craint d’êtreharcelée par l’attitude insistante d’un homme d’une autre culture…Cette femme estinterpellée par ce genre de réplique : « Tu ne veux pas que je t’aborde parce que jesuis étranger… ». L’expression métaphorique d’une belle rencontre au-delà desapparences lui permettrait de dépasser cette crainte tout en veillant clairement à sepositionner face à un éventuel harcèlement de séduction…3 ème étape : créer des métaphoresSuivant ce présupposé fondamental de la PNL, abordé par Louis FEVRE page 101 de sonlivre Contes et métaphores, « Tout comportement obéit à une intention positive » signifie quela personne est bien plus que ses comportements ; son choix du moment est une solutionqu’il a trouvée à ce moment-là (automatisme ou développement d’une stratégie consciente)même si cette piste n’est pas la plus adéquate pour répondre à son insatisfaction. Il s’agit deproposer une métaphore bienveillante (sans jugement) et libératrice (non moralisatrice),considérant l’autre comme responsable de ses options éthiques.1) Déterminer un cadre acceptable pour l’autre en respectant sa carte du monde ;2) Laisser émerger l’inconscient et les associations d’idées ;3) Imaginer un élément nouveau qui soit recevable dans cette carte du monde etpermettant d’élargir les significations possibles ;4) Introduire des effets de surprise, d’humour, ou de suspense ;5) Raconter la métaphore en adaptant son langage, s’exprimer dans un vécu sensorielet inviter l’autre à meubler ce cadre à sa façon.20 /25
CONTE <strong>EN</strong>TRE EUX <strong>ET</strong> AILES…« Il était une fois,Dans la vallée des chakras, le serpent Kundalini qui veillait sur le pont entre les deux collines :l’une des villageois Masculins et l’autre des habitantes Féminines. Kundalini était le seul à être encontact direct avec ces deux populations. Les Masculins et les Féminines étaient au courant del’existence les uns des autres.Les Masculins avaient toujours considérés les Féminines comme inférieures parce que lesFéminines vivaient principalement la nuit et adoraient jouer à cache-cache avec les rayons de lunetandis que les Masculins préféraient la puissance du soleil et dormir leur nuit afin d’être aumaximum de leurs capacités le jour. La satisfaction principale des Masculins était de se rendrecompte qu’ils étaient structurés et induisaient leurs connaissances afin de fonctionner ensemble,étant ainsi le village le plus efficace de la vallée des chakras.Quant aux Féminines, elles parlaient beaucoup des Masculins et les trouvaient très ennuyeux ;elles développaient davantage leur intuition et déduisaient avec plaisir les enseignements de leursexpériences. Inspirées par le partage, les Féminines souhaitaient faire découvrir leurs plaisirsjoyeux aux Masculins trop raisonnables pour que ceux-ci puissent expérimenter leur façon devivre hédoniste, tel était leur vœu de rencontre.Un soir de pleine lune, une grande fête fût organisée sur le pont, entre les deux collines…LesMasculins répondirent à l’invitation des Féminines et tous ensemble, ils ont chanté, dansé, mangéet admiré leurs reflets enlacés dans la rivière illuminées par les rayons de lune. Au lever du soleil,les Masculins reprirent leurs occupations comme si rien ne c’était passé, ne tirant aucunenseignement de cette rencontre intense et festive…Les Féminines ne comprenaient pas quecette expérience ne change rien à leurs comportements…La Vie continua son chemin jusqu’au jour où, au crépuscule, juste avant que les Masculinss’endorment et que les Féminines se préparent à danser avec la lune…il y eut un bruit étrange quisurprit les Masculins et les Féminines. D’où venait ce bruit ? Vibrant à cet appel, les Fémininesreconnurent le son strident du serpent Kundalini veillant sur le pont entre les deux collines de lavallée des chakras...et elles se précipitèrent vers lui. Alertés également et prêts à bondir de leurlit, les Masculins se dirigèrent aussi vers ce bruit étrange. Sous un ciel étoilé, les Masculins etles Féminines se retrouvèrent sur le pont, entourant le serpent. Et Kundalini commença àparler… « Je suis le témoin de votre communication depuis très longtemps et maintenant est venule cap du changement…désormais, c’est à vous ; les Féminines et les Masculins, de veiller sur cepont. Ce pont tisse des liens entre les deux villages de la vallée…» 1919 Conte anonyme recrée le 26 octobre 2009 par Nicole GOUBILLE, suite au séminaire UNIPAZ sur l’art de vivre la vie.21 /25
CONCLUSIONNous voici au terme de ce voyage dans la perspective d’autres horizons à explorer encore etencore…Accompagner et permettre à l’autre de s’approprier l’expression de son vécu…En reprenant cette question posée dans l’introduction : comment favoriser l’expression, lacompréhension empathique et l’évolution de ses représentations afin d’envisager d’autrespossibles ? Voici quelques pistes à creuser pour chaque intervenant social:1) La recherche rapide de solutions pas spécialement adaptées est souvent vécuecomme prioritaire au détriment de l’expression de l’autre, jusqu’au bout de sonpositionnement identitaire.2) L’expression de soi s’inscrit davantage dans un cadre thérapeutique alors qu’elle estdéveloppée dans des contextes variés, créatifs et culturels, individuels et collectifs.3) La compréhension empathique rencontre des obstacles dont le manque deconscience de ses repères personnels en tant qu’intervenants sociaux.4) Le recours en travail social à des contes et des métaphores permet de transformerles représentations sociales et de développer d’autres significations, vers d’autrespossibles…5) La création d’un langage métaphorique explore des potentialités et tissent d’autresliens entre les acteurs : aidants-aidés, animateurs-animés, passeurs-passants, guidevoyageurs,entre nous intervenants sociaux et des explorateurs en quête de sens,d’identité et bien-être…22 /25
« Nous sommes nés avec un potentiel,Nous sommes nés pour la bonté et la confiance,Nous sommes nés avec des idéaux et des rêves,Nous sommes nés pour accomplir de grandes des choses,Nous sommes nés avec des ailes,Apprenons à les utiliser,Et envolons-nous ! »Auteur inconnu23 /25
BIBLIOGRAPHIEOUVRAGES :1. ABRIC Jean-Claude (sous la direction de), Pratiques sociales et représentations sociales, éd.PUF, France, 1994 ;2. B<strong>ET</strong>TELHEIM Bruno, Psychanalyse des contes de fées, éd. Pocket Robert Laffont, France, 477pages, 1999 ;3. BRUNIER Jérôme, Pourquoi nous racontons-nous des histoires ?, éd. Retz, France, 112 pages,2002 ;4. DREWERMANN Eugen, L’essentiel est invisible, une lecture psychanalytique du petit prince,éd. Cerf, France, 166 pages, 1992 ;5. FEVRE Louis, Contes et métaphores, 2 ème éd. Chronique Sociale, France, 192 pages, 2004 ;6. GORDON David, Contes et métaphores thérapeutiques, apprendre à raconter des histoires quifont du bien, éd. Inter édition, Dunod, France, 191 pages, 2006 ;7. GRAITSON Isabelle avec la collaboration d’Elisabeth NEUFORGE, L’intervention narrative entravail social, essai méthodologique à partir des récits de vie, éd. L’harmattan, France, 219pages, 2008 ;8. JOSSE Evelyne, Le pouvoir des histoires thérapeutiques, l’hypnose éricksonienne dans laguérison et des traumatismes psychiques, éd. Desclée de Brouwer, France, 281 pages, 2007 ;9. KEROUAC Michel, Métaphore : manuel de communication métaphorique, métaphores etcontes populaires, pédagogiques et thérapeutiques, éd. MKR, Canada, 550 pages, 2008 ;10. SECA Jean-Marie, Les représentations sociales, éd. Armand Colin, France, 211 pages, 2001.24 /25
ARTICLES :1. LANG<strong>EN</strong>FELD SERRANELLI Solange, Soigner avec les contes, 12 janvier 2008,http://www.mieux-etre.org/soigner-avec-descontes.html;2. LIND<strong>EN</strong> Anne, Les métaphores : votre vie est une histoire remplie d’histoires,http://www.mieux-etre.org/spip.phip?article2189;3. Site de LIND<strong>EN</strong> Anne, fondatrice et directrice du premier institut de PNLhttp://www.annelinden.org.ROMANS <strong>ET</strong> RECUEIL DE <strong>CONTES</strong> :1. BACH Richard, Jonathan le goéland, éd. J’ai lu, France, 124 pages,1983;2. BOBIN Christian, Le très bas, éd. Folio, France, 130 pages, 19953. COELHO Paulo, L’alchimiste, éd. Anne Carrière, France, 253 pages, 1994 ;4. Collectif présenté par BEERNAERT MOURION Pierre, Contes de Noël pour notre temps, éd.Lumen Vitae, Belgique, 151 pages, 1993 ;5. De SAINT EXUPERY Antoine, Le petit prince, éd. Folio Junior, France, 94 pages, 1990;6. GIONO Jean, L’homme qui plantait des arbres, éd. Folio, France, 72 pages, 1990 ;7. HARVEY André, Contes d’éveil (pour les adultes au cœur d’enfant et les enfants quirêvent…de le demeurer), éd. De Martagne, Canada, 346 pages, 1998 ;8. QU<strong>EN</strong>TRIC-SEGUY Martine, Contes des sages de l’Inde, éd. Du Seuil, France, 184 pages,2003 ;9. SALOME Jacques, Contes à guérir, contes à grandir, éd. Albin Michel, France, 374 pages, 1994JEUX DE CARTES :1. DEBAILLEUL Jean-Pascal, Le jeu de la voie des contes, puisez au cœur des contes l’inspirationpersonnelle et collective, éd. Le souffle d’or, France, 2007 ;2. LERNER Isha et LERNER Mark, Les cartes de l’enfance intérieur, une odyssée au cœur descontes de fées, des mythes et de la nature, éd. Souffle d’or, France, 1997.25 /25