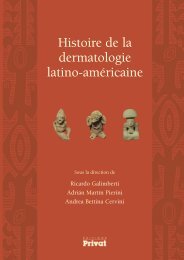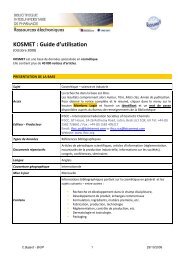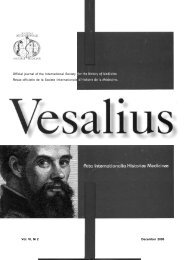La place d'Isaac Israeli dans la médecine médiévale - Bibliothèque ...
La place d'Isaac Israeli dans la médecine médiévale - Bibliothèque ...
La place d'Isaac Israeli dans la médecine médiévale - Bibliothèque ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, Spécial number, 19-27,1998<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong><strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévaleD. JacquartRésuméBien que quelques rares études lui aient été consacrées, <strong>la</strong> personnalité <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> gardedes contours assez flous <strong>dans</strong> l'histoire de <strong>la</strong> médecine. Caractérisé comme néo-p<strong>la</strong>tonicien pourses oeuvres philosophiques, ce savant - qui quitta l'Egypte pour Kairouan au début du Xe siècle -a <strong>la</strong>issé des traités médicaux en arabe d'une grande originalité, sur les fièvres, <strong>la</strong> diététique etl'urine. Originaire de <strong>la</strong> région de Tunis, Constantin l'Africain, un siècle plus tard, ne manqua pasde mettre en <strong>la</strong>tin <strong>la</strong> majeure partie de ces oeuvres, ce qui leur valut un succès durable. Pour tenterde cerner l'orginalité de cet auteur, nous analyserons ce que deux maîtres de <strong>la</strong> Faculté demédecine de Paris, Pierre de Saint-Flour et Jacques Despars, respectivement au XlVe et XVesiècle, en ont retenu. Ces deux médecins témoignent d'une vaste érudition et <strong>la</strong> manière dont ilsutilisent les traités <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> peut aider à caractériser l'apport de ceux-ci.SummaryDespite the fact that some few studies ha ve been made of Isaad <strong>Israeli</strong>, his personality remainsre<strong>la</strong>tively obscure to the medical historian. He is regarded as a neop<strong>la</strong>tonic philosopher. Hedeparted Egypt for Kairouan at the beginning of the 10th Century, leaving a series of medicaltreatises in Arabic, on fever, diets and urine showing great originality. Constantine the African, anative of Tunisia, trans<strong>la</strong>ted most of his works into <strong>La</strong>tin, a century <strong>la</strong>ter, thus ensuring theirenduringsuccess. In order to determine the originality of this author, we will analyse what Pierre de Saint-Flour and Jacques Despars, respectively of the 14thandthe 15th Century withheld about him. Boththese physicians exhibit vast erudition in the way they deal with the works of Isaac <strong>Israeli</strong> heritageenabling us to have a better understanding of them.Pour un historien de <strong>la</strong> médecine médiévale,<strong>la</strong> date de 1515 évoque en priorité l'édition àLyon des Omnia opéra Ysaac qui rassemblent,en deux volumes in-folio, des textes dont l'influencefut déterminante au moment du développementde l'enseignement médical <strong>dans</strong> l'Occidentchrétien, à partir du XIle siècle. Le nom<strong>d'Isaac</strong> accolé à ces œuvres prétendument complètes,éditées en 1515, réfère à celui que leMoyen Âge <strong>la</strong>tin appe<strong>la</strong> Isaac <strong>Israeli</strong> ou IsaacDanielle Jacquart, directeur d'études à l'Ecolepratique des Hautes Etudes de ParisJudaeus. Malgré son origine juive, il appartientpar son œuvre scientifique à l'histoire de <strong>la</strong>médecine arabe, en raison non seulement de <strong>la</strong><strong>la</strong>ngue qu'il choisit, mais de <strong>la</strong> tradition intellectuelleà <strong>la</strong>quelle il se rattacha. C'est donc sousun nom arabisé qu'il est le plus souvent cité :Ishaq ibn Su<strong>la</strong>iman (1). Il fait partie des quelquespersonnages auxquels les biographesanciens prêtent une vie centenaire; l'imprécisionre<strong>la</strong>tive aux dates de sa naissance et de samort rend impossible <strong>la</strong> vérification de cetteassertion, mais les quelques éléments avérésde sa biographie autorisent à lui octroyer unelongévité honorable.19
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> dlsaac <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, numéro spécial, 19-27,1998Né en Egypte vers le milieu du IX e siècle,Ishaq al Isra'ili meurt à Kairouan probablementen 955, date le plus souvent retenue, de préférenceà celle de 932 parfois avancée. Bien peunous est connu de sa vie avant son arrivée àKairouan, au temps du dernier prince de <strong>la</strong>dynastie agh<strong>la</strong>bide, Ziyadat Al<strong>la</strong>h III, qui régnade 903 à 909. Les biographes s'accordent pourlui attribuer en Egypte une activité d'oculiste,qu'il aurait exercée au Caire.Si l'ophtalmologie constitua un domaine remarquablementillustré <strong>dans</strong> <strong>la</strong> littérature savantede <strong>la</strong>ngue arabe, <strong>dans</strong> <strong>la</strong> pratique le soindes yeux — et en particulier les opérationsdélicates — relevait davantage de semi-char<strong>la</strong>tans,ou du moins de thérapeutes uniquementversés <strong>dans</strong> ce type d'interventions hasardeuses,qui les incitaient à choisir d'être itinérants,pour éviter les éventuelles représailles de patientssoumis à de malencontreux traitements(2). Il n'est donc pas impossible qu'lshaq aitacquis l'essentiel de son savoir théorique àKairouan et qu'il ait même entrepris ce voyage<strong>dans</strong> ce but. <strong>La</strong> ville connaissait, en effet, sousles émirs agh<strong>la</strong>bides son apogée et s'ouvraitaux influences les plus diverses, renfermantnotamment en son sein une importante communautéjuive et une école talmudique renommée.Comme l'avait déjà remarqué Max Meyerhof(3), l'Orient arabe ne connut guère de médecinslettrés d'origine juive avant les XI e et XII e siècles.Par exemple, aucun n'est mentionné parmi lespraticiens qui accompagnèrent <strong>la</strong> fondation del'hôpital de Bagdad en 987. Quant à <strong>la</strong> villedu Caire, où Ishaq est supposé avoir exercé,elle ne s'était pas encore illustrée, au X e siècle,<strong>dans</strong> le domaine de l'enseignement médical.Sans doute praticien de second ordre au Caire,al-lsra'ili commence sa véritable carrière scientifiqueen devenant le disciple d'Ishaq ibn Imran,médecin musulman venu à Bagdad à <strong>la</strong> couragh<strong>la</strong>bide. Passé lui-même au service du dernierémir de cette dynastie, le savant juif y avaitacquis une réputation suffisamment solide pourdemeurer le médecin du premierfatimide,'UbaidAl<strong>la</strong>h al-Mahdi. Resté célibataire, il mourut sansenfants. Au XIII e siècle, Ibn Abi Usaybi'a rapporteune anecdote que les historiens se p<strong>la</strong>isentà répéter (4) : alors qu'on lui faisait remarquerqu'il n'avait pas de fils, il répondit que seslivres assureraient davantage sa postérité. Deuxdisciples veillèrent aussi à celle-ci : l'un musulman,Ibn al-Gazzar, dont les œuvres furentexclusivement médicales; l'autre juif, Dunas ibnTamim, qui succéda à son maître à <strong>la</strong> cour ets'illustra également en mathématiques et enastronomie. Si Ishaq al-lsra'ili dut vraisemb<strong>la</strong>blementattendre son arrivée au Maghreb pouraffermir, auprès d'Ishaq ibn Imran, ses connaissancesthéoriques en médecine, on ne sait si cefut au Caire ou à Kairouan qu'il acquit sa formationphilosophique. Son œuvre en ce domainen'est pas négligeable, même si Maïmonide nel'appréciait guère (5). Caractérisée par un néop<strong>la</strong>tonismeassez marqué, elle exerça une influencenotable sur les cercles mystiques juifsde Gérone au XIII e siècle (6).C'est à <strong>la</strong> fortune des traductions <strong>la</strong>tines quenous nous attacherons en ce rapide survol.Retracer leur é<strong>la</strong>boration et l'usage qu'on en fitéquivaut à réaliser une sorte de coupe transversale<strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, qui fut loin deconstituer le bloc statique qu'une historiographiesuperficielle se p<strong>la</strong>ît encore à décrire. Nouscommencerons par le point d'aboutissement decette fortune, à savoir les Omnia opéra Ysaacde 1515, qui impriment l'ensemble des ouvragesd'Ishaq al-lsra'ili traduits en <strong>la</strong>tin. Sortis del'atelier lyonnais de Barthélémy Trot, imprimeurspécialisé <strong>dans</strong> <strong>la</strong> publication de textes scientifiqueset médicaux, ces deux volumes in-folioont <strong>la</strong> particu<strong>la</strong>rité d'adjoindre à des œuvresauthentiques, d'autres abusivement attribuéesau savant kairouannais. Sont ainsi principalementédités :— les traités médicaux d'Ishaq al Isra'ili traduits<strong>dans</strong> <strong>la</strong> seconde moitié du XI e siècle, auMont-Cassin par Constantin l'Africain, accom-20
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, Spécial number, 19-27,1998Première page de <strong>la</strong> traduction des oeuvresmédicales <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> par Ali Abbas etConstantinpagnés, pour certains, des commentaires réaliséspar Petrus Hispanus, devenu pape sous lenom de Jean XXI en 1276-1277.— les traductions d'œuvres philosophiquesdu même Ishaq (Des définitions (7), Des éléments)effectuées <strong>dans</strong> <strong>la</strong> seconde moitié duXII e siècle à Tolède par Gérard de Crémone.— deux oeuvres majeures de <strong>la</strong> médecinemédiévale, à savoir le Pantegni, ou premièreversion <strong>la</strong>tine du Kitabal-Ma<strong>la</strong>ki du médecind'origine persane 'Ali ibn al-Abbas al-Magasi etle Viaticum, traduction Zad al-Musafiz d'Ibn al-Gazzar,disciple musulman d'Ishaq.Ces deux dernières œuvres doivent leurinclusion <strong>dans</strong> l'édition de 1515 au fait d'avoirété traduites par Constantin l'Africain, à l'instardes traités médicaux authentiques du médecinjuif (8). Dans <strong>la</strong> lettre qu'il adresse, en guise depréface, au médecin Andréa Turino de Pescia(l'éditeurscientifique de l'ensemble), SymphorienChampier livre quelques précisions sur ce qu'ilcroit être <strong>la</strong> vérité historique et <strong>la</strong> paternité desœuvres rassemblées.N'ayant pas accès aux mises au point desbiographes arabes — dont les ouvrages n'étaientpas parvenus en Occident —, il se fonde sur derares indices g<strong>la</strong>nés <strong>dans</strong> des sources <strong>la</strong>tines. Ilse réfère d'abord à une œuvre médicale qu'i<strong>la</strong>ppréciait suffisamment pour <strong>la</strong> pourvoir d'unenouvelle édition quelques années plus tard(1525): le Conciliator de Pietro d'Abano (9).Terminée en 1310, cette vaste somme consistaiten un recueil de plus de deux cents questions,traitées de manière sco<strong>la</strong>stique, sur tousles sujets de <strong>la</strong> médecine théorique et pratique.Symphorien Champier relève ainsi que, selonPietro d'Abano, il y eut deux auteurs nommésIsaac, l'un philosophe, «HebenAmaran», l'autremédecin, «<strong>Israeli</strong>ta». En réalité Pietro d'Abanon'établit pas explicitement cette distinction mais,comme le remarque pertinemment SymphorienChampier, «l'insinue» (10).Le médecin du XIV e siècle a, en effet, l'habitudede <strong>p<strong>la</strong>ce</strong>r le livre Des définitions et celuiDes élémentssous l'autorité d'« Isaac Hamaran»,alors qu'il cite les traités médicaux sous le nomd'«lsaac <strong>Israeli</strong>ta» (11).Pietro d'Abano semble donc établir une distinctionqui n'a pas lieu d'être. <strong>La</strong> formu<strong>la</strong>tion«Isaac Hamaran» évoque probablement Ishaqibn 'Imran, le maître d'Ishaq al-Isra'ili, mais il estdifficile de préciser où Pietro d'Abano a trouvéce nom, puisque <strong>la</strong> seule œuvre traduite en <strong>la</strong>tinde cet auteur (l'opuscule sur <strong>la</strong> mé<strong>la</strong>ncolie) aessentiellement circulé sous l'autorité de Constantinl'Africain (12). C'est <strong>la</strong> méthode de travailde ce dernier qui a mené à l'anomalie fondamentaledes Omnia opéra Ysaac, consistant enune fausse attribution du Pantegnietdu Viaticum.Le moine du Mont-Cassin eut, en effet, l'habitudede s'approprier <strong>la</strong> plupart des textes qu'ilmettait en <strong>la</strong>tin, ce qui pouvait se justifier par <strong>la</strong>part de son intervention personnelle. SymphorienChampier se fonde sur un renvoi fait au Pantegni,qui apparaît sous <strong>la</strong> forme d'une auto-citation<strong>dans</strong> le traité Des fièvres <strong>d'Isaac</strong> (13), pourattribuer à ce dernier l'œuvre du médecin persandu X e siècle. Il s'agit, en réalité, d'une interpo<strong>la</strong>tiondue à Constantin l'Africain.En outre, il était bien connu, depuis <strong>la</strong> secondetraduction par Etienne d'Antioche du Kitabal-Ma<strong>la</strong>kique cette œuvre avait été écrite par uncertain «Haly Abbas». Symphorien Champierne l'ignore pas mais pense qu'Etienne d'Antioches'est trompé (14). L'attribution du Viaticumà Isaac repose sur une conjecture encore moins21
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, Spécial number, 19-27,1998sultan al-Afdal, en 1200 : <strong>la</strong> description de préparationsà base de vin (breuvage interdit aumusulman qu'était le sultan) ne devait pas êtreconsidérée comme une prescription sctricte; ilconvenait d'établir une différence entre les conseilsmédicaux et les prescriptions religieuses.Le rôle du médecin consistait seulement enl'indication de ce qui était jugé bon ou mauvaisdu point de vue de <strong>la</strong> santé du corps (18).<strong>La</strong> diététique d'Ishaq suit probablement ceprincipe, même s'il n'est pas explicitementénoncé. On y trouve donc <strong>la</strong> mention d'un grandnombre de nourritures interdites autant aux Juifsqu'aux Musulmans. On y relève aussi des viandesque l'auteur lui-même présente comme nonconsommées habituellement : l'âne, l'ours, lelion, par exemple. Le but visé n'est pas précisémentde prescrire, mais d'une part d'expliquercomment <strong>la</strong> nourriture assure le maintien ducorps, d'autre part de dresser une sorte d'inventairede tout ce qui est comestible, en indiquantles bienfaits et les méfaits de chaque ingrédient.Le dernier traité d'Ishaq traduit par Constantinl'Africain porte sur l'uroscopie. Il emprunte àdivers ouvrages du corpus hippocratique, maissurtout à un traité pseudo-galénique sur lesurines, d'origine byzantine. Comme <strong>la</strong> plupartdes auteurs médiévaux de <strong>la</strong>ngue arabe, Ishaqal-lsra'ili fut un lecteur assidu et avisé des sourcesantiques. L'originalité de chacun, <strong>dans</strong> cetteperspective, se manifeste par les sélectionsopérées et par l'agencement personnel d'informationsd'origine livresque que peut étayer iciou là une expérience de praticien.<strong>La</strong> fortune des œuvres médicales d'Ishaq allsra'ilisuivit celle de l'ensemble des traductionsde Constantin l'Africain (19). En un premiertemps, ces dernières assurèrent le développementd'une médecine qui se définissait commeune science, fondée sur des principes rationnelsissus de <strong>la</strong> philosophie naturelle. Pourmesurer l'importance des traductions é<strong>la</strong>boréesau Mont-Cassin, il faut se souvenir que <strong>dans</strong>l'Antiquité <strong>la</strong> théorie médicale, comme toutescience, s'est écrite en grec. Du fait de l'oubli decette <strong>la</strong>ngue en Europe occidentale, le hautMoyen Âge fut réduit au maigre héritage <strong>la</strong>tin.Après l'é<strong>la</strong>n donné par Constantin l'Africainet son introduction du galénisme arabe, l'effortde traduction, à <strong>la</strong> fois à partir du grec et del'arabe, fut ininterrompu jusqu'au milieu duXIV e siècle. Alors que le XII e siècle avait constituéune étape décisive pour le développementde <strong>la</strong> science médicale occidentale, en particulierà l'Ecole de Salerne, le début du XIII e sièclevit <strong>la</strong> mise en <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> de l'enseignement universitaire.Les œuvres médicales <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> firentalors partie des lectures obligatoires auxquellesétaient soumis les étudiants et les maîtresen rédigèrent des commentaires. Ce fut ence contexte que Petrus Hispanus composa,probablement à Paris, ceux qui bénéficièrentd'une édition en 1515.Tout au long du XIII e siècle, les œuvres<strong>d'Isaac</strong> remplirent ainsi <strong>la</strong> fonction de manuels<strong>dans</strong> les domaines de <strong>la</strong> pathologie fébrile, de <strong>la</strong>diététique et de l'uroscopie. L'appartenance religieusede leur auteur ne posait aucun problème,en un temps où — faut-il le rappeler ? —les Juifs n'étaient pas admis <strong>dans</strong> les universités: Isaac <strong>Israeli</strong> se trouvait, de ce point de vue,sur le même p<strong>la</strong>n que le musulman Avicenne oule païen Hippocrate.Bien qu'elles aient continué à être utiliées,les œuvres du médecin de Kairouan ne jouèrentplus le même rôle aux XIV e et XV e siècles.D'autres autorités arabes (Avicenne, Averroès)étaient venues considérablement enrichir lesavoir occidental, et, surtout, on découvrait lestraités authentiques de Galien (20). Isaac <strong>Israeli</strong>fut alors lu de manière plus sélective et ponctuelle.<strong>La</strong> sélection opérée révèle ainsi les pointssur lesquels il se montrait en désaccord avecles autres auteurs et, de ce fait, manifestaitune originalité. Nous en donnerons quelquesexemples.23
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, numéro spécial, 19-27,1998Dans le Conciliator de Pietro d'Abano, lescitations <strong>d'Isaac</strong> sont assez c<strong>la</strong>irsemées. L'uned'entre elles offre toutefois le point de départd'une question de type sco<strong>la</strong>stique : «Que lecerveau est chaud est montré par Isaac <strong>dans</strong> Dedietis» (21). Cette affirmation al<strong>la</strong>it à rencontrede l'opinion commune, qui dotait le cerveaud'une complexion froide.Dans Des diètes universelles, Isaac — dontle propos est ici diététique — part de <strong>la</strong> constatationque cet organe est du même genre que <strong>la</strong>graisse et <strong>la</strong> moelle pour en déduire qu'il est«naturellement» de complexion chaude et «accidentellement»froid par l'apport de l'air venude l'extérieur. Il est possible de supposer quel'auteur établit ici une distinction entre <strong>la</strong> cervellealimentaire et l'organe <strong>dans</strong> un être vivant. Pietrod'Abano juge cette opinion non conforme à <strong>la</strong>réalité. Il prend d'abord <strong>la</strong> défense du médecinkairouannais, en imaginant une erreur de <strong>la</strong> partde son traducteur, Constantin l'Africain. Il ajouteensuite que certains détracteurs <strong>d'Isaac</strong> lui prêtentun raisonnement de sophiste : cette critiquen'est pas sans rappeler celle portée parMaïmonide, qui le jugeait bon médecin maispiètre philosophe.Ecrites une quarantaine d'années aprèsl'achèvement du Conciliator de Pietro d'Abano,les «Concordances» du maître parisien Pierrede Saint-Flour offrent un excellent reflet desautorités considérées comme principales aumilieu du XIV e siècle (22). Sous le titre de Colligetflorum («recueil de fleurs») est présentée, parordre alphabétique de mots-vedettes, une sériede citations suivies <strong>dans</strong> certains cas de courtsdéveloppements. Isaac figure parmi les autoritésrégulièrement citées, même si les phrasestirées de ses œuvres sont beaucoup moinsnombreuses que celles émanant d'Hippocrate,de Galien, d'Avicenne, de Rhazès ou d'Averroès.A l'entrée «cerveau» (cerebrum) est transcrite<strong>la</strong> phrase du De dietis universalibus re<strong>la</strong>tiveà <strong>la</strong> nature chaude de cet organe (23). CommePierre de Saint-Flour ne <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> aucun développementpersonnel sur le cerveau, il est difficilede deviner sa prise de position sur le sujet. Enrevanche, à l'article «saignée» {flebotomia), ilnous indique qu'lsaac, à nouveau <strong>dans</strong> De dietisuniversalibus, contredit tous les auteurs à proposdu régime à suivre après l'intervention (24).Selon ce qu'il est dit <strong>dans</strong> cet ouvrage, lesAnciens auraient prescrit de boire plus qued'habitude et de manger moins, sous le prétexteque le vin renforce <strong>la</strong> chaleur naturelle, alors que<strong>la</strong> nourriture solide engendre une fatigue.Pierre de Saint-Flour n'admet pas cette assertion,tant elle s'oppose à l'enseignement desautres auteurs; il prescrit, quant à lui, de diminuerà <strong>la</strong> fois <strong>la</strong> boisson et l'alimentation. Lecrible sco<strong>la</strong>stique mit ainsi en valeur les quelquescas où Isaac <strong>Israeli</strong> prit des libertés avecl'enseignement des Anciens.Le dernier témoignage qui sera évoqué estcelui du maître parisien Jacques Despars <strong>dans</strong>son commentaire au Canon d'Avicenne, écritentre 1432 et 1453. Muni d'une solide érudition,il prend <strong>la</strong> peine d'énumérer, à <strong>la</strong> fin de sonœuvre, les auteurs fameux qu'il a principalementutilisés pour expliquer et commenter cettevaste somme du savoir médical que constitue leCanon d'Avicenne (25). Il s'enorgueillit de nepas s'en être tenu aux sources médiévales<strong>la</strong>tines, mais d'être revenu aux grands auteursgrecs, Hippocrate, Aristote, Galien et Alexandrede Tralles.Parmi les Arabes, il <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>dans</strong> son tableaud'honneur, outre Avicenne : Rhazès, Avenzoar(= Ibn Zuhr) et Sérapion (= Ibn Sarabiggan). Lenom <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> n'apparaît pas <strong>dans</strong> cettesélection. Si l'on parcourt les nombreuses citationsd'auteurs qui émaillent les trois imposantsvolumes in-folio du commentaire, <strong>dans</strong> l'éditionlyonnaise de 1498, <strong>la</strong> faiblesse de <strong>la</strong> représentationdes œuvres de Plsraeli est frappante. Lesdeux De dietis et le De febhbus ne sont qu'ex-24
<strong>La</strong> <strong>p<strong>la</strong>ce</strong> <strong>d'Isaac</strong> <strong>Israeli</strong> <strong>dans</strong> <strong>la</strong> médecine médiévale, Vesalius, numéro spécial, 19-27,19989. Sur Pietro d'Abano, médecin particulièrementversé en astronomie et astrologie, traducteurdu grec en <strong>la</strong>tin, voir <strong>la</strong> monographiede : E. Paschetto, Pietro d'Abano, medico efilosofo, Florence, 1984.10. «Différents enim III, XI, XXIV, XXXI, XXXIVet XUV facile nobis insinuavit duos fuisseYsaac, alterum Heben Amaran, alterum<strong>Israeli</strong>tam» (éd. Lyon 1515, fol Iv).11. Cette distinction apparaît c<strong>la</strong>irement au seind'une même phrase, comme <strong>dans</strong> <strong>la</strong>differentia 43 : «Isaac vero Hamaranelementorum tertio cum Isaac <strong>Israeli</strong>tafebrium quinto innuit...» (cit. d'après l'éd.Venise 1476).12. Edition du texte arabe et de <strong>la</strong> version deConstantin : K. Garbers, Ishaq ibn Imran,Maqa<strong>la</strong> fi al-Malikhuliya und ConstantiniAfricanilibriduo de me<strong>la</strong>ncholia, Hambourg,1977.13. «Sed causa diversitatis diei cretice duobusmodis est, aut propter debilitatem nature, autpropterdiversitatem figure lune inequali modolumen a sole recipientis, quod utrumqueexp<strong>la</strong>nabimus in nostrolibroPantegni» (Isaac,Defebribus, IV.6, éd. Lyon 1515, fol. CCXIV).<strong>La</strong> version médiévale castil<strong>la</strong>ne du traité Desfièvres a été éditée : Ishaq <strong>Israeli</strong>, Tratadosde <strong>la</strong>s fiebres, Ediciôn de <strong>la</strong> version castel<strong>la</strong>nay estudio por el P. José L<strong>la</strong>mas, O.S.A.,Madrid-Barcelone, 1945. L'original arabe et<strong>la</strong> version <strong>la</strong>tine du chapitre sur <strong>la</strong> fièvreéthiqueontégalementétéédités:J.D.<strong>La</strong>thamet H. D. Isaacs, Isaac Judaeus : On Fevers(The thirddiscourse : On Consumption), Cambridge,1981. Voiraussi : J. D. <strong>La</strong>tham, «Isaac<strong>Israeli</strong>'s Kitab al-hummayatar\â the <strong>La</strong>tin andCastil<strong>la</strong>n texts», <strong>dans</strong> Journal of semiticstudies, 14(1969), p. 80-95. Sur l'ouvraged'al-Magusi, voir : C. Burnett et D. Jacquart(éd.), Constantine the African and Ali ibnAbbas al-Magusi, The Pantegni and re<strong>la</strong>tedtexts, Leyde, 1994.14. «Nam liber qui complementum medicineappe<strong>la</strong>tus est non Halyabbati attribuenduserat, ut p<strong>la</strong>cuit Stephano philosophie discipulofrivolis rationibus» (éd. Lyon 1515, fol. Iv).15. «Addidimus multa Constantini opuscu<strong>la</strong>,verentes et il<strong>la</strong> furta esse, ut de Viatico manifestepatet. Nam si Mesuen legeris ipsiusYsaac remédia adducentem, plura eorum inViatico comperies» (ibid.).16. On trouvera aisément <strong>la</strong> liste de ceux-ci <strong>dans</strong> :H. Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages,Rome, 1986, vol. I, p. 127-134.17. Voir J. Shatzmiller, Jews, Medicine, andMédiéval Society, Berkeley-New York, 1994.18. Sur cette déc<strong>la</strong>ration de Maïmonide, voir M.Meyerhof, «MediaevalJewishPhysicians...»,p. 449.19. Sur cette question voir : D. Jacquart et F.Micheau, <strong>La</strong> médecine arabe et l'Occidentmédiéval, Paris, 1990 (réimpr. 1996), p. 87-129 et 167-176.20. Voir ibid. et D. Jacquart, «<strong>La</strong> sco<strong>la</strong>stiquemédicale», <strong>dans</strong> M. D. Grmek (éd.), Histoirede <strong>la</strong> pensée médicale en Occident, 1. Antiquitéet Moyen Age, Paris, 1995, p. 175-210.21. Pietro d'Abano, Conciliator, diff. 24 : « Quodcerebrum sit calidum ostenditur per Isaac indietis...Propter secundum vero sciendumquod Isaac solus ausus est pronunciarecerebrum calidum, inquiens : Quamviscerebrum sit naturaliter calidum ethumidum,quia ex generibus est pinguedinum etmedul<strong>la</strong>rum, accidentalitertamen estfrigidumpropter aerem multum frigidum caputpercutientem ac paucitatem carnis etpinguedinis super caput existentium»(éd.Venise 1476).22. Des extraits du Colliget florum ont été éditésd'après le ms Paris, Bibliothèque nationalede France, <strong>la</strong>tin 14734 : J. Pagel, Neuelitterarische Beitràge zur mitte<strong>la</strong>lterlichenMedizin, Berlin, 1896.23. Ms Paris, Sorbonne, 133, fol. 66r.24. Ibid., fol. 92r : «Quarta questio...an postflebotomiam débet minus potari solito velplus...Ad quartam questionem Ysaccontradicit aliis ut patet in littera. Dico tamenquod tam cibus quam potus debent minui dieflebotomie».25. Cf. D. Jacquart, «Le regard d'un médecin sur26