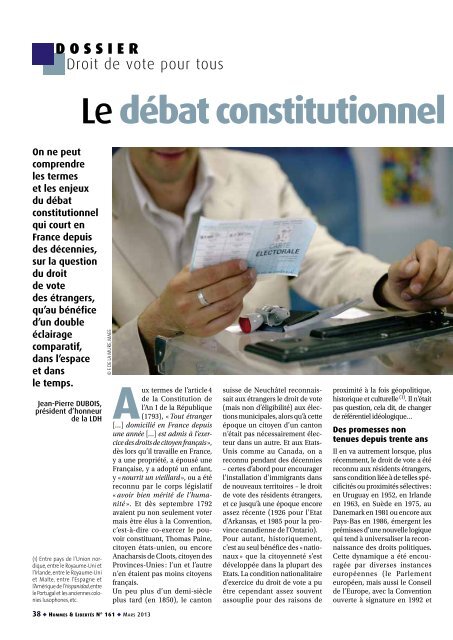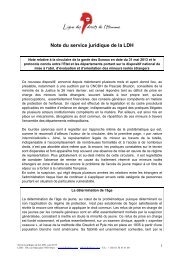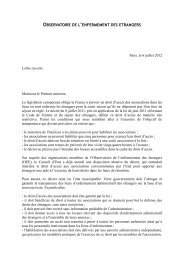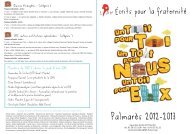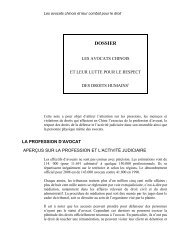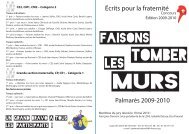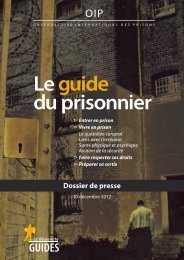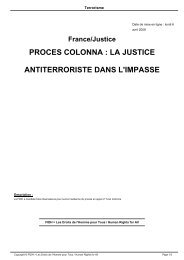Le débat constitutionnel en France - Ligue des droits de l'Homme
Le débat constitutionnel en France - Ligue des droits de l'Homme
Le débat constitutionnel en France - Ligue des droits de l'Homme
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
d o s s i e rDroit <strong>de</strong> vote pour tous<strong>Le</strong> débat <strong>constitutionnel</strong>On ne peutcompr<strong>en</strong>dreles termeset les <strong>en</strong>jeuxdu débat<strong>constitutionnel</strong>qui court <strong>en</strong><strong>France</strong> <strong>de</strong>puis<strong><strong>de</strong>s</strong> déc<strong>en</strong>nies,sur la questiondu droit<strong>de</strong> vote<strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers,qu’au bénéficed’un doubleéclairagecomparatif,dans l’espaceet dansle temps.Jean-Pierre DUBOIS,présid<strong>en</strong>t d’honneur<strong>de</strong> la LDH A(1) Entre pays <strong>de</strong> l’Union nordique,<strong>en</strong>tre le Royaume-Uni etl’Irlan<strong>de</strong>, <strong>en</strong>tre le Royaume-Uniet Malte, <strong>en</strong>tre l’Espagne etl’Amérique <strong>de</strong> l’hispanidad, <strong>en</strong>trele Portugal et les anci<strong>en</strong>nes colonieslusophones, etc.© F. <strong>de</strong> la Mure, MAEE38 u Hommes & Libertés N° 161 u Mars 2013ux termes <strong>de</strong> l’article 4<strong>de</strong> la Constitution <strong>de</strong>l’An I <strong>de</strong> la République(1793), « Tout étranger[…] domicilié <strong>en</strong> <strong>France</strong> <strong>de</strong>puisune année […] est admis à l’exercice<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> <strong>de</strong> citoy<strong>en</strong> français »,dès lors qu’il travaille <strong>en</strong> <strong>France</strong>,y a une propriété, a épousé uneFrançaise, y a adopté un <strong>en</strong>fant,y « nourrit un vieillard », ou a étéreconnu par le corps législatif« avoir bi<strong>en</strong> mérité <strong>de</strong> l’humanité». Et dès septembre 1792avai<strong>en</strong>t pu non seulem<strong>en</strong>t votermais être élus à la Conv<strong>en</strong>tion,c’est-à-dire co-exercer le pouvoirconstituant, Thomas Paine,citoy<strong>en</strong> états-uni<strong>en</strong>, ou <strong>en</strong>coreAnacharsis <strong>de</strong> Cloots, citoy<strong>en</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong>Provinces-Unies : l’un et l’autr<strong>en</strong>’<strong>en</strong> étai<strong>en</strong>t pas moins citoy<strong>en</strong>sfrançais.Un peu plus d’un <strong>de</strong>mi-siècleplus tard (<strong>en</strong> 1850), le cantonsuisse <strong>de</strong> Neuchâtel reconnaissaitaux étrangers le droit <strong>de</strong> vote(mais non d’éligibilité) aux électionsmunicipales, alors qu’à cetteépoque un citoy<strong>en</strong> d’un cantonn’était pas nécessairem<strong>en</strong>t électeurdans un autre. Et aux Etats-Unis comme au Canada, on areconnu p<strong>en</strong>dant <strong><strong>de</strong>s</strong> déc<strong>en</strong>nies– certes d’abord pour <strong>en</strong>couragerl’installation d’immigrants dans<strong>de</strong> nouveaux territoires – le droit<strong>de</strong> vote <strong><strong>de</strong>s</strong> résid<strong>en</strong>ts étrangers,et ce jusqu’à une époque <strong>en</strong>coreassez réc<strong>en</strong>te (1926 pour l’Etatd’Arkansas, et 1985 pour la provincecanadi<strong>en</strong>ne <strong>de</strong> l’Ontario).Pour autant, historiquem<strong>en</strong>t,c’est au seul bénéfice <strong><strong>de</strong>s</strong> « nationaux» que la citoy<strong>en</strong>neté s’estdéveloppée dans la plupart <strong><strong>de</strong>s</strong>Etats. La condition nationalitaired’exercice du droit <strong>de</strong> vote a puêtre cep<strong>en</strong>dant assez souv<strong>en</strong>tassouplie pour <strong><strong>de</strong>s</strong> raisons <strong>de</strong>proximité à la fois géopolitique,historique et culturelle (1) . Il n’étaitpas question, cela dit, <strong>de</strong> changer<strong>de</strong> référ<strong>en</strong>tiel idéologique…Des promesses nont<strong>en</strong>ues <strong>de</strong>puis tr<strong>en</strong>te ansIl <strong>en</strong> va autrem<strong>en</strong>t lorsque, plusrécemm<strong>en</strong>t, le droit <strong>de</strong> vote a étéreconnu aux résid<strong>en</strong>ts étrangers,sans condition liée à <strong>de</strong> telles spécificitésou proximités sélectives :<strong>en</strong> Uruguay <strong>en</strong> 1952, <strong>en</strong> Irlan<strong>de</strong><strong>en</strong> 1963, <strong>en</strong> Suè<strong>de</strong> <strong>en</strong> 1975, auDanemark <strong>en</strong> 1981 ou <strong>en</strong>core auxPays-Bas <strong>en</strong> 1986, émerg<strong>en</strong>t lesprémisses d’une nouvelle logiquequi t<strong>en</strong>d à universaliser la reconnaissance<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>droits</strong> politiques.Cette dynamique a été <strong>en</strong>couragéepar diverses instanceseuropé<strong>en</strong>nes (le Parlem<strong>en</strong>teuropé<strong>en</strong>, mais aussi le Conseil<strong>de</strong> l’Europe, avec la Conv<strong>en</strong>tionouverte à signature <strong>en</strong> 1992 et
<strong>en</strong> <strong>France</strong>Faut-il passer par leréfér<strong>en</strong>dum ou par leCongrès ? Par ailleursfaut-il une révision<strong>constitutionnel</strong>le ne portantque sur la question du droit<strong>de</strong> vote <strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers,ou ne vaut-il pas mieuxqu’elle concerne l’<strong>en</strong>semble<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>tsdu Présid<strong>en</strong>t ?<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> vigueur <strong>en</strong> 1997, ou<strong>en</strong>core la Confér<strong>en</strong>ce <strong><strong>de</strong>s</strong> pays<strong>de</strong> la Mer baltique), si bi<strong>en</strong> quel’on compte aujourd’hui dix-septEtats membres <strong>de</strong> l’Union europé<strong>en</strong>ne(UE) qui reconnaiss<strong>en</strong>t,au moins <strong>en</strong> principe, le droit <strong>de</strong>vote à <strong><strong>de</strong>s</strong> résid<strong>en</strong>ts étrangers,dont douze à l’égard <strong>de</strong> tous lesrésid<strong>en</strong>ts étrangers.Ainsi la <strong>France</strong> apparaît-elle à cetégard, comme ce fut le cas il y atrois quarts <strong>de</strong> siècle pour le vote<strong><strong>de</strong>s</strong> femmes (dix-neuf ans après laTurquie…), comme un pays retardatairequi répugne à l’universalisationréelle du suffrage, et ne s’yrésout que dans les <strong>de</strong>rniers.Ni la rev<strong>en</strong>dication ni les promessesne dat<strong>en</strong>t pour autantd’hier ou d’avant-hier. Il y a plus<strong>de</strong> tr<strong>en</strong>te ans que la LDH faitcampagne pour le droit <strong>de</strong> vote etd’éligibilité <strong><strong>de</strong>s</strong> résid<strong>en</strong>ts étrangersaux élections locales, et c’estlors <strong>de</strong> l’un <strong>de</strong> ses congrès (àParis, <strong>en</strong> 1985) que le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong>la République alors <strong>en</strong> exercice,qui avait fait figurer la reconnaissance<strong>de</strong> ce droit parmi les c<strong>en</strong>tdix propositions <strong>de</strong> sa campagneprésid<strong>en</strong>tielle du printemps 1981,affirma avec force maint<strong>en</strong>ir cet<strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>de</strong>mandant à sonauditoire <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>r à convaincreune majorité <strong>de</strong> ses concitoy<strong>en</strong>s.Quant à ses <strong>de</strong>ux successeurs,ils déclarèr<strong>en</strong>t que l’opinion neleur paraissait pas <strong>en</strong>core <strong>en</strong>état <strong>de</strong> l’accepter. Ainsi, <strong>de</strong>puis<strong><strong>de</strong>s</strong> déc<strong>en</strong>nies, la plus puissante<strong><strong>de</strong>s</strong> autorités à même <strong>de</strong> décl<strong>en</strong>cherla révision <strong>constitutionnel</strong>l<strong>en</strong>écessaire pour agir réellem<strong>en</strong>ta-t-elle laissé s’installer un décalagepersistant <strong>en</strong>tre les mots etles actes, les promesses et lesnormes.L’att<strong>en</strong>te d’une initiativeprésid<strong>en</strong>tielleL’<strong>en</strong>trée <strong>en</strong> vigueur, <strong>en</strong> 1992,du traité <strong>de</strong> Maastricht permitaux résid<strong>en</strong>ts <strong><strong>de</strong>s</strong> autresEtats membres <strong>de</strong> l’UE <strong>de</strong> voteraux élections europé<strong>en</strong>nes etmunicipales, dans une logiqued’adjonction <strong>de</strong> la citoy<strong>en</strong>netéeuropé<strong>en</strong>ne aux citoy<strong>en</strong>netésnationales, disjoignant cep<strong>en</strong>dant,pour la première fois <strong>de</strong>puis1793, citoy<strong>en</strong>neté et nationalité…Cela a <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dré <strong>en</strong> même tempsune situation spectaculairem<strong>en</strong>tdiscriminatoire : un citoy<strong>en</strong>allemand ou suédois installé<strong>en</strong> <strong>France</strong> <strong>de</strong>puis trois ans peutpr<strong>en</strong>dre part à un scrutin dontsont exclus <strong><strong>de</strong>s</strong> citoy<strong>en</strong>s algéri<strong>en</strong>sou sénégalais qui y résid<strong>en</strong>t<strong>de</strong>puis <strong><strong>de</strong>s</strong> déc<strong>en</strong>nies.Si cette situation difficilem<strong>en</strong>tjustifiable ne mit pas un terme àl’inertie présid<strong>en</strong>tielle, d’autresacteurs politiques fur<strong>en</strong>t plussoucieux <strong>de</strong> sortir du verbalisme,si bi<strong>en</strong> que l’Assemblée nationale«<strong>Le</strong> traité<strong>de</strong> Maastrichta <strong>en</strong>g<strong>en</strong>dréune situationfortem<strong>en</strong>tdiscriminatoire :un citoy<strong>en</strong>allemandou suédois,installé <strong>en</strong> <strong>France</strong><strong>de</strong>puis trois ans,peut pr<strong>en</strong>dre partà un scrutin dontsont exclus <strong><strong>de</strong>s</strong>citoy<strong>en</strong>s algéri<strong>en</strong>sou sénégalaisqui y résid<strong>en</strong>t<strong>de</strong>puis<strong><strong>de</strong>s</strong> déc<strong>en</strong>nies.adopta le 3 mai 2000 une proposition<strong>de</strong> loi <strong>constitutionnel</strong>le(déposée par <strong><strong>de</strong>s</strong> parlem<strong>en</strong>tairesécologistes), reconnaissant ledroit <strong>de</strong> vote et d’éligibilité auxélections municipales à ceux<strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers qui, n’étant pas« citoy<strong>en</strong>s europé<strong>en</strong>s », <strong>en</strong> sonttoujours privés. Aussitôt transmiseau Sénat par le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> l’Assemblé<strong>en</strong>ationale, cette propositiony fut bloquée p<strong>en</strong>dant <strong><strong>de</strong>s</strong>années pour <strong><strong>de</strong>s</strong> raisons politiques,mais le changem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> majoritésénatoriale permit son inscriptionà l’ordre du jour et son adoption,avec quelques modifications, le8 décembre 2011. La navette parlem<strong>en</strong>tairel’a ram<strong>en</strong>ée <strong>en</strong>suite àl’Assemblée nationale, où elle a ététransmise le 2 juillet 2012 à la Commission<strong><strong>de</strong>s</strong> lois.Entre temps, l’élection présid<strong>en</strong>tielle<strong>de</strong> mai 2012 a été remportéepar un candidat qui, commeFrançois Mitterrand <strong>en</strong> 1981, afait figurer la reconnaissance <strong>de</strong>ce droit au nombre <strong>de</strong> ses promesses<strong>de</strong> campagne, d’où l’att<strong>en</strong>ted’une initiative présid<strong>en</strong>tiellerepr<strong>en</strong>ant à son compte lecont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> la révision <strong>constitutionnel</strong>led’initiative parlem<strong>en</strong>taire<strong>en</strong> cours d’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong>puisdouze ans.«Eclairage sur les données<strong>constitutionnel</strong>lesAux termes du quatrième alinéa<strong>de</strong> l’article 3 <strong>de</strong> la Constitution du4 octobre 1958, « sont électeurs,dans les conditions déterminéespar la loi, tous les nationauxfrançais majeurs <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>de</strong>ux sexes,jouissant <strong>de</strong> leurs <strong>droits</strong> civils etpolitiques ».<strong>Le</strong> Conseil <strong>constitutionnel</strong>, saisi<strong>de</strong> la question <strong>de</strong> savoir si le traité<strong>de</strong> Maastricht, qui reconnaissaitle droit <strong>de</strong> vote et d’éligibilitéaux élections municipales auxrésid<strong>en</strong>ts citoy<strong>en</strong>s d’autres EtatsHommes & Libertés N° 161 u Mars 2013 u 39
d o s s i e rDroit <strong>de</strong> vote pour tousmembres <strong>de</strong> l’UE, pouvait êtreratifié sans révision préalable<strong>de</strong> la Constitution, a répondupar la négative le 9 avril 1992 (2) .C’est pourquoi a été introduitdans la Constitution (3) unarticle 88-3 permettant d’accor<strong>de</strong>rce droit « aux seuls citoy<strong>en</strong>s<strong>de</strong> l’Union [europé<strong>en</strong>ne] résidant<strong>en</strong> <strong>France</strong> », et dérogeant sur cepoint à l’article 3, sans que celuiciait été modifié. C’est le mêmeparti qui a été adopté par la proposition<strong>de</strong> loi <strong>constitutionnel</strong>le<strong>en</strong> cours d’exam<strong>en</strong> parlem<strong>en</strong>taireprécitée, laquelle prévoit l’insertion,dans la Constitution, d’unarticle 72-5 applicable aux seulesélections municipales.© Ecole élém<strong>en</strong>taire Felix Eboué<strong>Le</strong> Présid<strong>en</strong>t au cœurdu processus <strong>de</strong> révisionLa question est désormais <strong><strong>de</strong>s</strong>avoir, d’une part, dans quellesconditions cette initiative parlem<strong>en</strong>tairepourrait prospérer, et,d’autre part, dans quelles conditionsune initiative présid<strong>en</strong>tiellepourrait interv<strong>en</strong>ir <strong>en</strong> la matière.L’article 89 <strong>de</strong> la Constitution prévoitune initiative concurr<strong>en</strong>te duprésid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la République, « surproposition du Premier ministre »(projet <strong>de</strong> révision <strong>constitutionnel</strong>le)et <strong>de</strong> tout membre duParlem<strong>en</strong>t (proposition <strong>de</strong> révision<strong>constitutionnel</strong>le). Dansun cas comme dans l’autre, elleexige une adoption « par les <strong>de</strong>uxassemblées, <strong>en</strong> termes id<strong>en</strong>tiques ».Dès lors les députés ne peuv<strong>en</strong>tpas imposer leur point <strong>de</strong> vueaux sénateurs : la navette continuejusqu’à accord complet <strong>en</strong>treles <strong>de</strong>ux assemblées parlem<strong>en</strong>taires,débouchant sur un « voteconforme ».Une fois ce vote acquis, la révisiondoit être adoptée par référ<strong>en</strong>dum,si elle a été initialem<strong>en</strong>tproposée par un député ou parun sénateur. Si, <strong>en</strong> revanche,elle émane du présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> laRépublique, celui-ci peut la soumettresoit au référ<strong>en</strong>dum, soit auvote du Parlem<strong>en</strong>t convoqué <strong>en</strong>Congrès (les <strong>de</strong>ux assemblées sefondant <strong>en</strong> une seule), le projetLa démocratieeuropé<strong>en</strong>neà construire ne peuts’<strong>en</strong>raciner quedans la participationpolitique <strong>de</strong> toutescelles et <strong>de</strong> tousceux qui constitu<strong>en</strong>tla réalité <strong><strong>de</strong>s</strong> peuplesd’Europe, c’est-à-dire<strong>de</strong> tous les « résid<strong>en</strong>tsd’Europe », quellesque soi<strong>en</strong>tleurs nationalités.(2) Décision n° 92-308DC,Recueil page 55.(3) Par la loi <strong>constitutionnel</strong>l<strong>en</strong>° 92-554 du 25 juin 1992.<strong>de</strong> révision <strong>constitutionnel</strong>le nepouvant alors être adopté qu’à lamajorité <strong><strong>de</strong>s</strong> trois cinquièmes <strong><strong>de</strong>s</strong>suffrages exprimés.Enfin, si la « loi <strong>constitutionnel</strong>le »portant révision est adoptée, ellepeut être soumise à l’exam<strong>en</strong> duConseil <strong>constitutionnel</strong>, maiscelui-ci ne peut alors contrôlerque le respect <strong><strong>de</strong>s</strong> conditions <strong>de</strong>procédure posées par l’article89 <strong>de</strong> la Constitution (n’est pasconcerné le respect <strong><strong>de</strong>s</strong> autresdispositions <strong>de</strong> la Constitution,le principe même d’une révisionimpliquant que ces dispositionspuiss<strong>en</strong>t disparaître…).En d’autres termes, sur le fond, lepouvoir <strong>de</strong> révision est souverain.Ainsi, si le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Républiques’abst<strong>en</strong>ait <strong>de</strong> toute initiative,la proposition <strong>de</strong> révision<strong>constitutionnel</strong>le <strong>en</strong> cours d’exam<strong>en</strong>parlem<strong>en</strong>taire continueraità être soumise à la navette jusqu’àaccord complet <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>uxassemblées, puis serait nécessairem<strong>en</strong>tsoumise à référ<strong>en</strong>dum.Si, au contraire, le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong>la République décidait <strong>de</strong> déposer<strong>de</strong>vant le Parlem<strong>en</strong>t un projet<strong>de</strong> révision <strong>constitutionnel</strong>le (quipourrait parfaitem<strong>en</strong>t reproduireà l’id<strong>en</strong>tique le cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> la proposition<strong>de</strong> loi <strong>constitutionnel</strong>ledéjà examinée), il faudrait <strong>de</strong> lamême manière que ce projet soitvoté « <strong>en</strong> termes id<strong>en</strong>tiques » parles députés et par les sénateurs(et là <strong>en</strong>core la navette continueraitjusqu’à accord total). Mais<strong>en</strong>suite le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Républiquepourrait éviter le recoursau référ<strong>en</strong>dum, <strong>en</strong> convoquantle Congrès. <strong>Le</strong> projet <strong>de</strong>vrait alorsêtre adopté par au moins 60 %<strong><strong>de</strong>s</strong> suffrages exprimés.<strong>Le</strong>s stratégies procédurales<strong>en</strong>visageablesNotons <strong>en</strong>fin que la proposition<strong>de</strong> loi <strong>constitutionnel</strong>le t<strong>en</strong>dantà insérer un article 72-5 dans laConstitution, comme l’avait faitla loi <strong>constitutionnel</strong>le <strong>de</strong> 1992 yinsérant un article 88-3 à la suitedu traité <strong>de</strong> Maastricht, prévoitqu’« une loi organique détermineles conditions d’application duprés<strong>en</strong>t article », c’est-à-dire r<strong>en</strong>voieau Parlem<strong>en</strong>t la détermination<strong><strong>de</strong>s</strong> règles <strong>de</strong> mise <strong>en</strong> œuvre<strong>de</strong> la révision <strong>constitutionnel</strong>le.Or ces règles peuv<strong>en</strong>t être <strong>de</strong>gran<strong>de</strong> importance : la proposition<strong>de</strong> loi <strong>constitutionnel</strong>le votée40 u Hommes & Libertés N° 161 u Mars 2013
par le Parlem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> 2000 (Assemblé<strong>en</strong>ationale) puis <strong>en</strong> 2011(Sénat) ne fixait pas, par exemple,la durée <strong>de</strong> résid<strong>en</strong>ce exigiblepour l’exercice du droit <strong>de</strong> vote.Mais le constituant est seul juge<strong>de</strong> ce qu’il déci<strong>de</strong> lui-même et<strong>de</strong> ce qu’il laisse (implicitem<strong>en</strong>t)à l’appréciation du « législateurorganique »… si bi<strong>en</strong> qu’un év<strong>en</strong>tuelprojet présid<strong>en</strong>tiel pourraitêtre plus développé que l’actuelleproposition parlem<strong>en</strong>taire, et que<strong><strong>de</strong>s</strong> am<strong>en</strong><strong>de</strong>m<strong>en</strong>ts pourrai<strong>en</strong>t<strong>de</strong> surcroît <strong>en</strong>richir l’un commel’autre au premier sta<strong>de</strong> <strong>de</strong> la procédure(navette <strong>en</strong>tre les <strong>de</strong>uxassemblées).On l’a vu, le présid<strong>en</strong>t <strong>de</strong> la Républiquepeut soit laisser se poursuivrel’exam<strong>en</strong> <strong>de</strong> la proposition(parlem<strong>en</strong>taire) <strong>de</strong> révision<strong>constitutionnel</strong>le, soit pr<strong>en</strong>drel’initiative d’un projet <strong>de</strong> révision.Mais s’il adopte le second parti, ilpeut soit se borner à repr<strong>en</strong>dredans son projet le cont<strong>en</strong>u <strong>de</strong> laproposition <strong>en</strong> cours d’exam<strong>en</strong>parlem<strong>en</strong>taire (ce qui lui permettraitseulem<strong>en</strong>t d’éviter le recoursau référ<strong>en</strong>dum), soit faire figurerla reconnaissance du droit <strong>de</strong>vote et d’éligibilité <strong><strong>de</strong>s</strong> étrangersaux élections municipales dansun <strong>en</strong>semble <strong>de</strong> réformes <strong>constitutionnel</strong>les,t<strong>en</strong>dant à r<strong>en</strong>dreplus démocratiques les institutions<strong>de</strong> la V e République (suppressiondu cumul <strong><strong>de</strong>s</strong> mandats,indép<strong>en</strong>dance <strong><strong>de</strong>s</strong> magistrats duParquet vis-à-vis du pouvoir politique,amélioration <strong>de</strong> l’exercice<strong>de</strong> la déc<strong>en</strong>tralisation, etc.).Ainsi doit-on distinguer quatrestratégies possibles, <strong>en</strong> combinantles réponses à ces <strong>de</strong>uxquestions : faut-il passer, après levote par chaque assemblée parlem<strong>en</strong>taire,par le référ<strong>en</strong>dum oupar le Congrès ? Par ailleurs fautilune révision <strong>constitutionnel</strong>l<strong>en</strong>e portant que sur la question dudroit <strong>de</strong> vote <strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers, ou nevaut-il pas mieux qu’elle concernel’<strong>en</strong>semble <strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>ts duPrésid<strong>en</strong>t ? Procé<strong>de</strong>r à une révision« isolée » conduit très probablem<strong>en</strong>t,compte t<strong>en</strong>u <strong><strong>de</strong>s</strong> risques<strong>de</strong> démagogie xénophobe accruspar <strong>de</strong> longues années <strong>de</strong> « xénophobied’Etat », à privilégier la voiedu Congrès… et donc à rechercherun « appoint » du côté <strong>de</strong> l’actuelleopposition parlem<strong>en</strong>taire, soit par<strong><strong>de</strong>s</strong> votes favorables, soit par <strong><strong>de</strong>s</strong>abs<strong>en</strong>ces ou <strong><strong>de</strong>s</strong> abst<strong>en</strong>tions.En revanche, insérer cette réformedans une révision <strong>constitutionnel</strong>leplus large conduit plutôt àaller au référ<strong>en</strong>dum, procédurequi paraît souhaitable lorsqu’unerévision est <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> ampleur,et a fortiori lorsqu’elle concernel’expression du suffrage universel.La réformeet ses <strong>en</strong>jeux <strong>de</strong> fondCe qui se joue aujourd’hui estd’une autre ampleur principielle.<strong>Le</strong> mon<strong>de</strong> actuel n’est plus celui<strong>de</strong> souverainetés nationales« exclusives » et absolues, chaqueEtat définissant sa citoy<strong>en</strong>netéà l’abri <strong>de</strong> frontières étanches.L’accélération <strong>de</strong> la mondialisationamplifie la mobilité <strong><strong>de</strong>s</strong> êtreshumains et augm<strong>en</strong>te les interdép<strong>en</strong>dances,oblige à p<strong>en</strong>ser lasocialisation politique <strong><strong>de</strong>s</strong> individusdans <strong><strong>de</strong>s</strong> cadres plus complexeset plus ouverts. Tel est les<strong>en</strong>s <strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong> « citoy<strong>en</strong>neté <strong>de</strong>résid<strong>en</strong>ce », comme justificationfondam<strong>en</strong>tale <strong>de</strong> la reconnaissancedu droit <strong>de</strong> vote et d’éligibilité<strong><strong>de</strong>s</strong> résid<strong>en</strong>ts étrangers. Sil’on admet, avec Aristote, que lesêtres humains sont par nature<strong><strong>de</strong>s</strong> « animaux politiques », alorson doit leur reconnaître undroit universel à la citoy<strong>en</strong>neté,impliquant la reconnaissance<strong>de</strong> <strong>droits</strong> politiques à toute personnerésidant durablem<strong>en</strong>t surun territoire donné, et participant<strong>de</strong> ce fait à la vie sociale et àla construction d’un av<strong>en</strong>ir commun.D’où la nécessité <strong>de</strong> p<strong>en</strong>serune articulation « verticale » <strong><strong>de</strong>s</strong>citoy<strong>en</strong>netés (locale, nationale,europé<strong>en</strong>ne, voire à terme planétaire)comme condition d’effectivité<strong>de</strong> la démocratie, dans unmon<strong>de</strong> où les <strong>en</strong>jeux et les choixse jou<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t bi<strong>en</strong> au-<strong>de</strong>là<strong><strong>de</strong>s</strong> frontières <strong><strong>de</strong>s</strong> Etats-nations.«L’accélération<strong>de</strong> lamondialisationoblige à p<strong>en</strong>serla socialisationpolitique<strong><strong>de</strong>s</strong> individusdans <strong><strong>de</strong>s</strong> cadresplus complexeset plus ouverts.Tel est le s<strong>en</strong>s<strong>de</strong> l’idée <strong>de</strong>“citoy<strong>en</strong>neté<strong>de</strong> résid<strong>en</strong>ce”,commejustificationfondam<strong>en</strong>tale<strong>de</strong> lareconnaissancedu droit <strong>de</strong> voteet d’éligibilité<strong><strong>de</strong>s</strong> résid<strong>en</strong>tsétrangers.Dans cette perspective universaliste,il ne saurait être question<strong>de</strong> « trier » <strong>en</strong>tre les résid<strong>en</strong>tsétrangers, comme on l’a fait <strong>en</strong>1992, non seulem<strong>en</strong>t parce quecette conception « adjac<strong>en</strong>te » <strong>de</strong>la citoy<strong>en</strong>neté europé<strong>en</strong>ne <strong>en</strong> afait un ectoplasme privé <strong>de</strong> s<strong>en</strong>spour ceux-là mêmes qui étai<strong>en</strong>tappelés à la faire vivre, maisaussi parce que la démocratieeuropé<strong>en</strong>ne à construire ne peuts’<strong>en</strong>raciner que dans la participationpolitique <strong>de</strong> toutes celleset <strong>de</strong> tous ceux qui constitu<strong>en</strong>tla réalité <strong><strong>de</strong>s</strong> peuples d’Europe,c’est-à-dire <strong>de</strong> tous les « résid<strong>en</strong>tsd’Europe », quelles que soi<strong>en</strong>tleurs nationalités.«<strong>Le</strong> poids historique<strong>de</strong> la questionDe même, prét<strong>en</strong>dre conditionnerla reconnaissance du droit<strong>de</strong> vote <strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers à une« réciprocité » <strong>en</strong>tre les Etatsconcernés, c’est non seulem<strong>en</strong>tappliquer à celles et ceux qui ontquitté <strong><strong>de</strong>s</strong> terres soumises au<strong><strong>de</strong>s</strong>potisme une sorte <strong>de</strong> doublepeine, mais surtout raisonnerselon une logique interétatiquequi ignore les transformationsdu mon<strong>de</strong> et continue à faire <strong><strong>de</strong>s</strong>individus <strong><strong>de</strong>s</strong> sujets plus que <strong><strong>de</strong>s</strong>citoy<strong>en</strong>s.On mesure ainsi l’<strong>en</strong>jeu trèsfort du débat <strong>constitutionnel</strong>et politique qui se développeactuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> <strong>France</strong> surcette question du droit <strong>de</strong> vote<strong><strong>de</strong>s</strong> étrangers. Il s’agit à la foisd’éthique politique (après plus <strong>de</strong>tr<strong>en</strong>te ans <strong>de</strong> promesses restéesvaines), <strong>de</strong> réalisme démocratique(la démocratie ne vit qu’<strong>en</strong>racinéedans la réalité sociale) et<strong>de</strong> compréh<strong>en</strong>sion <strong><strong>de</strong>s</strong> logiqueshistoriques à l’œuvre (les dynamiquesd’universalisation <strong><strong>de</strong>s</strong><strong>droits</strong> <strong>en</strong>g<strong>en</strong>drées par les défis <strong>de</strong>la mondialisation). C’est dire quegouvernants, acteurs politiqueset société civile sont placés, dansles semaines et les mois qui vi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t,<strong>de</strong>vant une responsabilitéqu’il n’est pas exagéré <strong>de</strong> qualifierd’historique. ●Hommes & Libertés N° 161 u Mars 2013 u 41