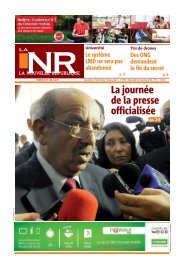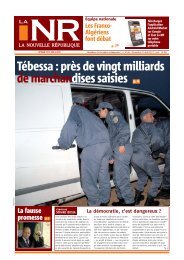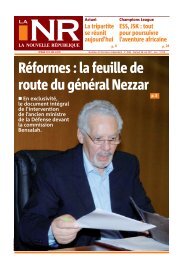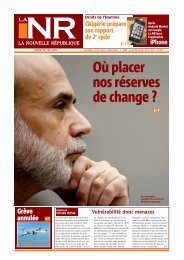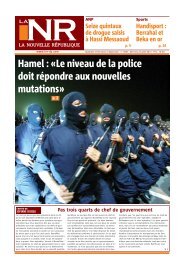Page 01-4607csearezki - La Nouvelle République
Page 01-4607csearezki - La Nouvelle République
Page 01-4607csearezki - La Nouvelle République
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
actuel<strong>La</strong> NR 4607 - Dimanche 14 avril 2<strong>01</strong>34Entretien avec Annie <strong>La</strong>croix-Riz, historienne française«Nous sommes entrés dans une phasede guerres impérialistes continues» (I), Annie <strong>La</strong>croix-Riz (née en 1947) est une historiennefrançaise, professeur émérite d'histoire contemporaineà l'université de Paris VII - Denis Diderot, ancienne élèvede l'Ecole normale supérieure de Sèvres, agrégée d'histoire,docteur ès lettres, spécialiste des relations internationalesdans la première moitié du XX e siècle et de lacollaboration. Ses travaux portent sur l'histoire politique,économique et sociale de la III e <strong>République</strong>, deVichy et de l’après Seconde Guerre mondiale, la politiqueextérieure du Vatican depuis la fin du XIX e siècle,les relations Europe-États-Unis au XX e siècle, et la stratégiedes élites politiques et économiques françaisesavant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale.Elle est également connue pour son engagement communiste,et membre du PRCF.<strong>La</strong> <strong>Nouvelle</strong> <strong>République</strong> : <strong>La</strong> criseéconomique actuelle nous renvoieà une page sombre de l’histoire del’humanité, en l’occurrence les années’30, sauf que l’on remarqueaujourd’hui l’absence flagrante deforces d’encadrement de la classeouvrière. Pouvez-vous nous expliquercet état de fait ?Annie <strong>La</strong>croix-Riz : Pour expliquercet état de fait, il faut revenir aumoins autant à la première crisesystémique du capitalisme qu’à ladeuxième, c'est-à-dire autant, sinonplus, à la très longue crise de 1873qui a débouché sur la PremièreGuerre mondiale et qui a duré plusde quarante ans. Elle a certes descaractéristiques communes aveccelle des années 1930, encore plusgrave, mais, à la différence de cettedernière, elle a été très longue, àcette date aussi longue que lanôtre. Que signifie une crise trèslongue ? C’est une crise qui, régléede manière drastique, c’est à direse traduisant par des baissesconsidérables de salaire, se déroulesans que le patronat soitconfronté à une situation sociopolitiqueintenable. Le fait que çan’explose pas démontre que le patronata, par une stratégie habile,réussi à la fois à casser les salaireset à le faire globalement accepterpar ses victimes. Cela nous ramèneévidemment à la manière dont lescrises se règlent à la phase impérialiste.A la veille de la PremièreGuerre mondiale, où l’on distinguaitdéjà de fait entre le «centre»(impérialiste) et la «périphérie»(colonisée), Lénine a montré quele patronat avait pu corrompre cequ’il appelait «l’aristocratie ouvrière»: sur la base d’une exploitationcoloniale extrêmement violente,plus violente encore quecelle qui résultait de la baisse drastiquedes salaires ouvriers du«centre», il était possible de dégagerdes miettes pour l’aristocratieouvrière, c’est à dire les cadresdu mouvement ouvrier. Ceux-cis’étaient recrutés dans la catégoriedes ouvriers qualifiés, syndiquésles premiers, et par conséquentau cours de cette crise pendantlaquelle la baisse drastique avaitété, malgré des révoltes ici ou là,globalement supportée, le patronatle plus concentré s’était trouvé enmesure de régler momentanémentla crise en maintenant voire enaugmentant son profit sans provoquerd’explosion sociale. Parexemple, en Italie qui connaissaitune situation sociale explosive, lacrise sociale majeure fut esquivéepar une émigration massive (jusqu’aumillion de départs annuels),comme l’ont montré un certainnombre d’historiens, dont Vera Zamagni,c’était la fuite, l’émigrationou la révolution (Vera Zamagni,Dalla periferia al centro: la secondarinascita economica dell’Italia1861-1981, Bologna, Il Mulino,1990). Cela n’a donc pas été la révolutionmais l’émigration : desmillions d’Italiens privés de terresont fui, ce qui a constitué parconséquent un moyen de maintenirles miettes pour l’aristocratieouvrière. Bref, nous sommes, à laveille de 1914, dans une situationoù, depuis vingt ans, et alors quela crise dure depuis quarante ans,le patronat concentré a pu obtenirun compromis social et politique.Il l’a contracté avec une fractiondes couches supérieures de laclasse ouvrière et des salariés, etces représentants de la classe ouvrièreet des salariés, à l’époque essentiellementde la classe ouvrière,ont été en mesure de convaincreleurs mandants de supporter lacrise. Ce compromis clandestin aservi de toile de fond avant 1914,à la naissance et au développementde ce que l’on a appelé le«réformisme» au sein des partis«sociaux démocrates» (terme qui,à l’origine, ne désignait pas un courantnon révolutionnaire ou réformiste: «social démocrate» avaitété le nom initial du parti qui sevoulait révolutionnaire, parexemple en Allemagne, ou encoreen Russie où le parti s’appelait audébut «parti ouvrier social démocrate»).C’est dans les vingt dernièresannées qui séparent laphase tardive de la crise de 1873du déclenchement de la PremièreGuerre mondiale que se dessineune forme d’acceptation très semblableà ce qui s’est produit aucours de la présente crise systématique.C’est ce qui a conduit leséléments révolutionnaires, en particulierLénine, à dresser l’acte dedécès du mouvement ouvrier international,puisque la Seconde Internationale,fondée en 1889, s’estécroulée dans le fiasco du consentementdonné, avec enthousiasme,par ses éléments nationaux constitutifsà la guerre impérialiste de1914. C’est ce qui l’amène à dénoncer,en termes extrêmementsévères depuis l’été 1914, la SecondeInternationale, à proclamerson décès et à lui réclamer un successeur: les partis dont elle estl’émanation doivent également êtretotalement transformés si la classeouvrière veut mener à bien satâche révolutionnaire, estime Lénine.Ce double mot d’ordre sedessine clairement depuis sa participationà la conférence de Zimmerwald(5-8 septembre 1915). <strong>La</strong>création d’une III e Internationale, Internationalerévolutionnaire, nedevient possible (en mai 1919)qu’après la prise du pouvoir parles Bolcheviks (novembre 1917).Donc quand on compare ce quevous appelez l’absence flagrantede forces d’encadrement de laclasse ouvrière d’aujourd’hui àcelle de 1914, on observe que laprésente et très durable troisièmecrise systémique du capitalismeparvenu à sa phase impérialistenous fait renouer, du point de vuede la structure du mouvement ouvrierinternational, avec ce quis’est passé entre les années 1890 et1914. <strong>La</strong> deuxième crise systémique,celle des années 1930, plusgrave encore que la précédente,entraîne une crise sociale d’uneprofondeur d’autant plus périlleuseà terme que l’URSS connaîtsimultanément un taux de développementexceptionnel. Dans certainscas, la résistance de la classeouvrière débouche sur des mouvementssociaux – notamment enBelgique, et plus encore en France– et rend plus délicat et précairel’usage patronal de l’aristocratieouvrière. <strong>La</strong> gravité et la violencede la crise imposent d’ouvrir lesmarchés par la voie militaire encoreplus rapidement que la premièrefois, d’autant plus que, sifaible qu’il demeure, le mouvementouvrier s’est renforcé. L’État prolétarien,auquel tous les pays impérialistestentent de régler soncompte depuis 1918, apporte ausurplus une aide considérable (dimensionfinancière incluse) auxmouvements révolutionnaires qu’ila aidés à se reconstituer partout.Mais, même dans les pays où, à lafin des années 1930, s’est sérieusementrenforcé le mouvement communiste– cas minoritaire, la phaseprécédant le déclenchement de laguerre permet aux classes dirigeantesde le paralyser. En France,il y a une fraction du mouvementouvrier correspondant à «l’aristocratieouvrière» dont parle Lénine,la SFIO ; le jeune Parti communistea certes fortement progressé sur lecourt terme (1934-1937) mais iln’est pas assez puissant pour pareraux divisions de la classe ouvrière.L’alliance entre le patronat, l’État etl’aristocratie ouvrière sous saforme politique de SFIO et sous saforme syndicale de CGT de Jouhaux,permet la mise hors la loi etl’arrestation des militants révolutionnaires: complètement neutralisésde 1939 à 1940, ils sont momentanémentaussi impuissantsque les rarissimes révolutionnairesde 1914, comme je l’ai montré dansDe Munich à Vichy. Finalement,même dans la crise de 1930 où laconfiguration n’était pas entièrementla même, parce que, aumoins dans certains pays, un mouvementrévolutionnaire s’était reconstitué,on aboutit à la veille dela nouvelle guerre générale à uneconfiguration assez semblable àcelle de 1914 : sur le court ou surle moyen terme, la crise systémiqueaffaiblit considérablement laclasse ouvrière et les salariés, etaboutit à leur quasi-paralysie. Ellen’a pas plus abouti à une révolutiongénérale que la précédente, àl’époque où l’impérialisme a absolumentbesoin de la guerre généralepour réaliser un nouveau partagedu monde.Mais les capacités de reconstitutiondu mouvement ouvrier ontété au cours de la Première Guerremondiale extrêmement rapides.En 1914 règne une paralysie totale,y compris en Russie d’ailleurs,mais la guerre débouche sur unerévolution sociale dans les troisans. <strong>La</strong> situation objective a étéen Russie remarquablement utiliséepar le mouvement révolutionnaire,extrêmement minoritaire jusqu’àl’été 1917. <strong>La</strong> «crise généralede l’impérialisme» dont parle Lénineet la guerre consécutive débouchentsur ce premier État ouvrier,c’est à dire la première ruptureavec la propriété privée desmoyens de production etd’échange.Actuellement, l’impérialisme,comme avant 1914, est confrontéà une crise extrêmement grave,extrêmement longue, qui dured’autant plus longtemps qu’il atrouvé des parades très efficacesà la baisse du taux de profit. Il a pubrutalement accroître ses sphèresd’exploitation, y compris par la liquidationde la propriété publiqueen Union soviétique et dans cequ’on appelait la sphère d’influencesoviétique. Sans parler del’aggravation extrême de l’exploitationdu travail salarié tant aucentre qu’à la périphérie de lasphère impérialiste traditionnelle(celle d’avant la chute de l’URSS),dans le cadre d’une intensificationde la mondialisation du capital. Jedis bien intensification, seulement,car il suffit de lire L’impérialisme,stade suprême du capitalisme deLénine (cf. infra) pour comprendreque la mondialisation du capitaldate de plus d’un siècle. Ainsi,mieux encore que dans les années1930, les fractions monopolistesdu capital ont-elles pu maintenirvoire augmenter considérablementleur profit depuis ces quaranteans.Bref, la conjoncture est aussi noirequ’en 1914. Mais ce qui s’est passéen 1917 autorise les plus grandesespérances.