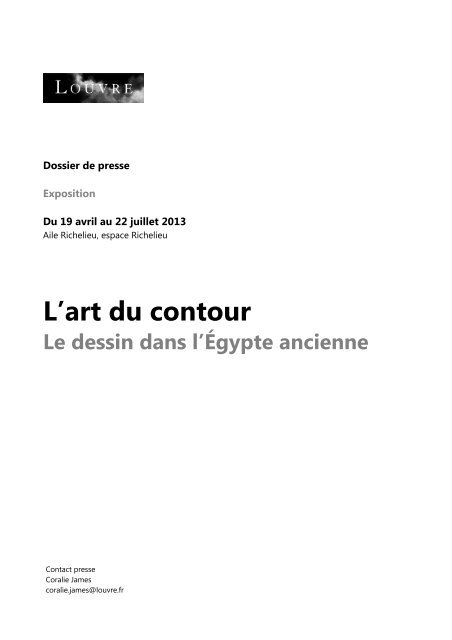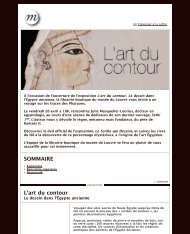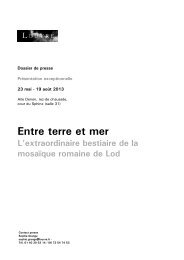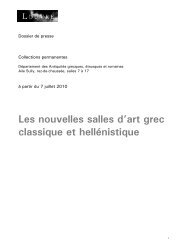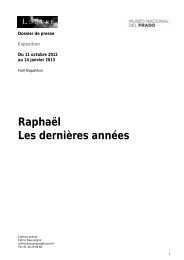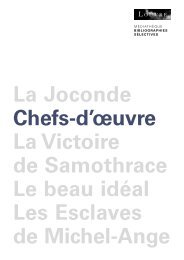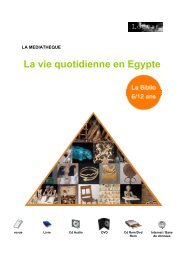Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre
Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre
Télécharger le dossier de presse > pdf - 1.88 Mo - Musée du Louvre
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Dossier <strong>de</strong> <strong>presse</strong>ExpositionDu 19 avril au 22 juil<strong>le</strong>t 2013Ai<strong>le</strong> Richelieu, espace RichelieuL’art <strong>du</strong> contourLe <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienneContact <strong>presse</strong>Coralie Jamescoralie.james@louvre.fr
SommaireCommuniqué <strong>de</strong> <strong>presse</strong> page 3Autour <strong>de</strong> l’exposition page 6Préface d’Henri Loyrette,prési<strong>de</strong>nt–directeur <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> page 8Intro<strong>du</strong>ction page 9par Guil<strong>le</strong>mette Andreu-LanoëParcours <strong>de</strong> l’exposition page 11Regard sur quelques œuvres page 15Publication page 20Liste <strong>de</strong>s œuvres exposées page 21Visuels disponib<strong>le</strong>s pour la <strong>presse</strong> page 39Mécènes page 432
Communiqué <strong>de</strong> <strong>presse</strong>Exposition19 avril - 22 juil<strong>le</strong>t 2013Ai<strong>le</strong> Richelieu, espace RichelieuL’exposition est organisée par <strong>le</strong>musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>. El<strong>le</strong> sera présentéeéga<strong>le</strong>ment aux <strong>Musée</strong>s royaux d’Art etd’Histoire <strong>de</strong> Bruxel<strong>le</strong>s <strong>du</strong> 13 septembre2013 au 19 janvier 2014.Cette expositionbénéficie <strong>du</strong> soutien <strong>de</strong> laL’art <strong>du</strong> contourLe <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienneLe thème <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin, tel qu'on peut l'observer dans l'artégyptien au temps <strong>de</strong>s Pharaons, n'a jamais fait l’objet d’uneexposition. Devant la difficulté pour <strong>le</strong>s égyptologues et <strong>le</strong>shistoriens d'art occi<strong>de</strong>ntaux à attribuer l'œuvre à une mainreconnue, <strong>le</strong>s créateurs <strong>de</strong> cette pro<strong>du</strong>ction plus <strong>de</strong> trois foismillénaire, admirée <strong>de</strong> tous, n’ont pas nécessairement acquis <strong>le</strong>rang d'artistes. Grâce à <strong>de</strong>s prêts exceptionnels (80 œuvresenviron), la définition <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin donnée par Giorgio Vasaricomme étant <strong>le</strong> « père <strong>de</strong> nos trois arts, l’architecture, lasculpture et la peinture » s’illustre parfaitement dans cestémoignages archéologiques.Le <strong>de</strong>ssin est en effet une composante essentiel<strong>le</strong> <strong>de</strong> l’art dansl’Égypte ancienne. Point <strong>de</strong> départ dans l’élaboration <strong>de</strong>sautres techniques artistiques comme la peinture, <strong>le</strong> relief, laron<strong>de</strong>-bosse, <strong>le</strong>s arts décoratifs et l’architecture, <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin estici considéré comme l’art <strong>du</strong> contour : <strong>de</strong>ssinateurs et peintressont usuel<strong>le</strong>ment désignés comme <strong>le</strong>s « scribes <strong>de</strong>s contours »ou « ceux qui tracent <strong>le</strong>s formes ».Ostracon figuré : Tête <strong>de</strong> Ramsès VI coiffé <strong>de</strong> lacouronne roya<strong>le</strong>, XX e dynastie. N 498, département<strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>© <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / ChristianDécamps.Cette exposition, riche <strong>de</strong> 200 œuvres, s’attache à explorertoute la comp<strong>le</strong>xité <strong>de</strong> l’art égyptien bi-dimensionnel, avec sesconventions, ses techniques, ses pratiques, ses fonctions et sesusages. Explorant <strong>le</strong>s liens étroits qu’entretiennent l’écriture et<strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne, el<strong>le</strong> permet d’analyser lanature comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong> la création égyptienne et <strong>le</strong>s spécificités <strong>de</strong>la civilisation qui a engendré ces œuvres et ainsi <strong>de</strong> lui rendreune place majeure dans l'Histoire <strong>de</strong> l'art universel.Les Égyptiens accor<strong>de</strong>nt toujours une place prépondérante auxformes et aux figures, remplies ou non d’aplats <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>urs. Lerapprochement dans « L’art <strong>du</strong> contour » <strong>de</strong> cet art formel et <strong>de</strong>l’écriture hiéroglyphique, composée <strong>de</strong> figures juxtaposées etinterconnectées permet <strong>de</strong> souligner et d’analyser <strong>le</strong>s liens et <strong>le</strong>sdifférences entre l’écriture et <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin égyptiens, entre <strong>le</strong>shommes <strong>de</strong> <strong>le</strong>ttres et <strong>le</strong>s artistes. Preuve <strong>de</strong> l’interpénétration <strong>de</strong>l’écrit et <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin, <strong>le</strong>s égyptiens ne possè<strong>de</strong>nt alors qu’un seulterme <strong>le</strong> verbe « sesh », soit « tracer /<strong>de</strong>ssiner » pour signifier« écrire », « <strong>de</strong>ssiner » et « peindre » preuve supplémentaire <strong>de</strong>cette articulation entre écriture et <strong>de</strong>ssin, symptomatique <strong>de</strong> l’art<strong>du</strong> contour en Égypte ancienne.Fragment <strong>de</strong> paroi <strong>de</strong> tombe roya<strong>le</strong> XIX edynastie, calcaire peint, n° A8, <strong>Musée</strong> Calvet,Avignon © <strong>Musée</strong> Calvet, Avignon.Commissaire <strong>de</strong> l’exposition : Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë,directeur <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes <strong>du</strong> musée <strong>du</strong><strong>Louvre</strong>.Direction <strong>de</strong> la communicationAnne-Laure BéatrixContact <strong>presse</strong>Coralie Jamescoralie.james@louvre.fr - T : 01 40 20 54 443
L’exposition interroge <strong>le</strong>s liens entre <strong>de</strong>ssin, écriture et magie,l’apprentissage <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin et <strong>le</strong>s étapes <strong>de</strong> réalisation <strong>de</strong>s tab<strong>le</strong>auxet <strong>de</strong>s papyrus illustrés. El<strong>le</strong> soulève <strong>de</strong>s questions quant à lamaîtrise <strong>de</strong> la <strong>le</strong>cture <strong>de</strong>s « scribes <strong>de</strong>s contours », supposésdépositaires <strong>de</strong> la mémoire écrite et sacrée, <strong>le</strong>ur inventivité dans laréalisation <strong>de</strong>s tab<strong>le</strong>aux religieux aux thèmes très canoniques ou<strong>le</strong>ur place dans la société, selon <strong>le</strong>s époques et <strong>le</strong>s circonstances.Coupe en faïence b<strong>le</strong>ue décorée <strong>de</strong> trois poissons ettrois nénuphars, AMP 4562, AntikensammlungAgyptisches Museum und Papyrussammlung,Berlin © Staatliche Museen zu Berlin, ÄgyptischesMuseum und Papyrussammlung, Foto Sandra Steiss.Fragments <strong>de</strong> papyrus avec esquisses préparatoirespour un sphinx, Ptolémaïque II e -I er sièc<strong>le</strong> av JC, AM11775, Antikensammlung Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, Berlin © Staatliche Museen zuBerlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,Foto Sandra Steiss.« L’art <strong>du</strong> contour » est l’occasion <strong>de</strong> mener une réf<strong>le</strong>xion sur <strong>le</strong>concept même d’art en Égypte, notion comp<strong>le</strong>xe puisqu’il n’existepas <strong>de</strong> terme précis dans <strong>le</strong> vocabulaire égyptien pour désigner ceque nous appelons « art » et qui se confond ainsi avec cel<strong>le</strong>d’artisanat. La problématique <strong>du</strong> beau (point <strong>de</strong> vue occi<strong>de</strong>ntal)est mise en perspective avec l’aspect fonctionnel <strong>de</strong> l’œuvre (point<strong>de</strong> vue égyptien).Le parcours <strong>de</strong> l’expositionL’exposition s’ouvre sur un hommage aux « scribes <strong>de</strong>scontours » : Qui étaient-ils véritab<strong>le</strong>ment ? Comment vivaientilset travaillaient-ils ? Quel <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> qualification littéraire etartistique possédaient-ils ? Les œuvres exposées : représentation<strong>de</strong>s seshqed au travail, <strong>de</strong>s famil<strong>le</strong>s <strong>de</strong> scribes, <strong>de</strong>s contoursmagistra<strong>le</strong>ment illustrés par la stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia mais aussi matérie<strong>le</strong>t différents supports utilisés par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs tel<strong>le</strong> que laCoupe en faïence b<strong>le</strong>ue décorée <strong>de</strong> trois poissons et troisnénuphars, éblouissante composition rayonnante d’une mo<strong>de</strong>rnitéconfondante, donnent <strong>de</strong>s c<strong>le</strong>fs pour répondre. La question <strong>de</strong>l’imbrication si comp<strong>le</strong>xe entre écriture et <strong>de</strong>ssin en Égypteancienne est centra<strong>le</strong>.Dans un <strong>de</strong>uxième temps, l’exposition propose un retour sur <strong>le</strong>spratiques et <strong>le</strong>s caractéristiques <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien et notammentla multiplication <strong>de</strong>s points <strong>de</strong> vue, <strong>le</strong> hiératisme <strong>de</strong>s figures ouencore l’absence <strong>de</strong> perspective qui déroutent beaucoupl’observateur occi<strong>de</strong>ntal. Ce décryptage fondamental <strong>de</strong> l’artégyptien, acquis <strong>de</strong> longue date par <strong>le</strong>s spécialistes, mais rarementprésenté <strong>de</strong> façon muséographique, permet d’analyser <strong>le</strong>s co<strong>de</strong>squi régissent <strong>le</strong>s figures <strong>de</strong> l’art officiel ainsi que <strong>de</strong>s œuvres plusspontanées. L’apprentissage <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin est illustré par <strong>de</strong>s exerciceset <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s, la mise en œuvre par <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s préparatoires et<strong>de</strong>s ébauches. L’importance <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin/modè<strong>le</strong> tracé pour ai<strong>de</strong>r <strong>le</strong>travail <strong>du</strong> sculpteur est particulièrement remarquab<strong>le</strong> sur <strong>le</strong>Fragments <strong>de</strong> papyrus avec esquisses préparatoires pour unsphinx, chaque détail est <strong>de</strong>ssiné à l’intérieur <strong>de</strong> gril<strong>le</strong>s <strong>de</strong> repères,qui servaient <strong>de</strong> gui<strong>de</strong>s au sculpteur chargé <strong>de</strong> repro<strong>du</strong>ire cemodè<strong>le</strong> en trois dimensions dans une pierre <strong>de</strong> tail<strong>le</strong>.Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> la dame Tachémès priant rê-Horakhty,XXII e dynastie. N3794, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>,dist. RMN-GP / Georges Poncet.4
Une série <strong>de</strong> peintures mura<strong>le</strong>s provenant <strong>de</strong> tombes montre lavariété <strong>de</strong>s pa<strong>le</strong>ttes <strong>de</strong>s peintres/<strong>de</strong>ssinateurs et l’usage trèsfréquent <strong>de</strong> cerner <strong>le</strong>s figures et <strong>le</strong>s objets peints d’un trait <strong>de</strong>contour. Enfin, quelques œuvres montrent <strong>le</strong>s limites <strong>du</strong> respect<strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s établis : <strong>de</strong>ssins atypiques, entorses aux proportionsclassiques, frontalité et vrai profil, sont là pour rappe<strong>le</strong>r lasoup<strong>le</strong>sse <strong>du</strong> trait et la créativité <strong>de</strong>s artistes égyptiens, quiéchappent ainsi aux conventions.Fragment <strong>de</strong> paroi peinte: femme respirant une f<strong>le</strong>ur(banquet). XVIII e dynastie. Kestner Museum 1962-69, Hanovre © Christian Tepper, Museum AugustKestner, Hanovre.Ostracon figuré satirique : la souris et <strong>le</strong> chat,Ramessi<strong>de</strong>, calcaire. E 6727, <strong>Musée</strong>s Royaux d’Artet d’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s © <strong>Musée</strong>s royaux d’Art etd’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s.L’exposition se clôt sur une section très riche présentant l’universégyptien en <strong>de</strong>ssin ou, plus exactement, l’univers <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ssinateurs.Une sé<strong>le</strong>ction d’ostraca, ces éclats <strong>de</strong> calcaire ou tessons <strong>de</strong>poterie qui ont servi <strong>de</strong> supports aux <strong>de</strong>ssins atteste d’unepro<strong>du</strong>ction intime et personnel<strong>le</strong>. Ils montrent l’extrême variété<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, permettent <strong>de</strong> pénétrer au cœur <strong>de</strong> l’inspiration qui aguidé <strong>le</strong>s artistes et offrent la possibilité d’entrevoir une créationindivi<strong>du</strong>el<strong>le</strong> étonnante. L’imaginaire <strong>de</strong>s Égyptiens est dévoilé, àcommencer par <strong>le</strong>urs dieux, ces créatures hybri<strong>de</strong>s quiprotégeaient la vie ici-bas et dans l’au-<strong>de</strong>là, notamment par lamagie <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins (textes et images) tracés sur <strong>le</strong> cercueil. Lamomie <strong>du</strong> défunt sera protégée et pourvue <strong>de</strong> tous <strong>le</strong>s biens dontel<strong>le</strong> aura besoin dans l’éternité. Les humains aussi sontreprésentés, au premier rang <strong>de</strong>squels apparaît <strong>le</strong> pharaon,majestueusement illustré par <strong>le</strong> grand ostracon <strong>de</strong> la Tête <strong>de</strong>Ramsès VI coiffé <strong>de</strong> la couronne qui figure Ramsès VI dans lamajesté <strong>de</strong> ses traits imposants, <strong>de</strong>ssinés d’abord à l’encre rougeet achevés à l’encre noire, aux joues délicatement rehausséesd’une peinture ocre rouge et aux lèvres peintes en rouge.Quelques représentations d’obèses, d’hommes hirsutes oud’étrangers caractérisés par un physique non-égyptien, témoignentd’une volonté <strong>de</strong> réalisme. Une place particulière est réservée aux<strong>de</strong>ssins satiriques et érotiques, dont l’exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> plus stupéfiantest <strong>le</strong> papyrus pornographique <strong>de</strong> Turin, qui mê<strong>le</strong> parodiesanimalières et scènes érotiques très audacieuses.Ces œuvres très inatten<strong>du</strong>es, qu’el<strong>le</strong>s soient humoristiques ouérotiques, sont bien loin <strong>de</strong>s canons égyptiens qui persistent dansl’imaginaire col<strong>le</strong>ctif occi<strong>de</strong>ntal.Informations pratiquesLieuEspace Richelieu, Ai<strong>le</strong> Richelieu.HorairesTous <strong>le</strong>s jours <strong>de</strong> 9h à 17h45, sauf <strong>le</strong> mardi.Nocturnes, mercredi et vendredi jusqu’à 21h45.TarifsAccès avec <strong>le</strong> bil<strong>le</strong>t d’entrée au musée : 11 €.Gratuit pour <strong>le</strong>s moins <strong>de</strong> 18 ans, <strong>le</strong>s moins <strong>de</strong>26 ans rési<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> l’U.E., <strong>le</strong>s enseignantstitulaires <strong>du</strong> pass é<strong>du</strong>cation, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ursd’emploi, <strong>le</strong>s adhérents <strong>de</strong>s cartes <strong>Louvre</strong>famil<strong>le</strong>s, <strong>Louvre</strong> jeunes, <strong>Louvre</strong> professionnelset Amis <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, ainsi que <strong>le</strong> premierdimanche <strong>du</strong> mois pour tous.Papyrus mythologique, XXI e -XXII e dynastie. N 3292, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Georges Poncet.RenseignementsTél. 01 40 20 53 17 - www.louvre.fr5
Autour <strong>de</strong> l’expositionPublicaonsCatalogue <strong>de</strong> l’expositionL’art <strong>du</strong> contour. Le <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne, sous la direction<strong>de</strong> Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë.Coédition Somogy / musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> éditions. 352 pages, 250illustrations, prix : 39 euros.Avec <strong>le</strong> soutien d’ARJOWIGGINS GRAPHIC.Figure d’hippopotame couvert <strong>de</strong> plantes <strong>de</strong>smarais, faïence siliceuse b<strong>le</strong>u, décor noir, fin <strong>du</strong><strong>Mo</strong>yen Empire, milieu <strong>de</strong> la XIII e dynastie, vers1750-1650 av. J.-C., Thèbes, Dra Aboul’Naga,tombe <strong>de</strong> Neferhotep, E 7709, département <strong>de</strong>sAntiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> © <strong>Musée</strong><strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Christian Décamps.FilmLe scribe qui <strong>de</strong>ssine <strong>de</strong> Bernard GeorgeVendredi 19 avril 2013 à 20hCopro<strong>du</strong>ction Arte Strasbourg, Arturo Mio et musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, 52mn, 2013.Diffusion dans l’alvéo<strong>le</strong> 7 <strong>de</strong> l’accueil <strong>de</strong>s groupes pendantl’exposition.Edition DVD – Editions <strong>Mo</strong>ntparnasse, <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> en vente àla librairieDurée : 52’13’’Auteur : Bernard GEORGERéalisateur : Bernard GEORGEImage : Jean-Louis LAFORÊTSon :Florent RAVALEC<strong>Mo</strong>ntage : Joseph LICIDÉMusique : BACCHERINIConseillère scientifique : Guil<strong>le</strong>mette ANDREU-LANOËÉtalonnage : Éric SALLERONMixage : Stéphane LARRATCopro<strong>du</strong>ction : ARTURO MIOPro<strong>du</strong>ctrice déléguée : Caroline ROUSSELCopro<strong>du</strong>ction : MUSÉE DU LOUVREPro<strong>du</strong>ctrice : Catherine DEROSIER-POUCHOUSCopro<strong>du</strong>ction/Diffusion : ARTE G.E.I.EAvec <strong>le</strong> soutien <strong>du</strong> Centre National <strong>de</strong> la Cinématographie et <strong>de</strong>l’image animée et <strong>de</strong> la Procirep, société <strong>de</strong>s Pro<strong>du</strong>cteurs et <strong>de</strong>l’Angoa-AgicoaFormat : HD CAM – 16/9 ÈME – STÉRÉORésumé :Contacts :Arturo Mio -Pro<strong>du</strong>ctrice déléguée : Caroline Roussel(caroussel@arturomio.com)<strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> - Pro<strong>du</strong>ction audiovisuel<strong>le</strong>cinéma et édition multimédia :Catherine Derosier-PouchousLe Scribe qui <strong>de</strong>ssine est une invitation à découvrir l'omniprésence<strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin dans l'Égypte ancienne.« L'art <strong>du</strong> contour » est en effet à la source <strong>de</strong> toutes <strong>le</strong>sreprésentations <strong>de</strong> l'époque pharaonique qu'il s'agisse <strong>de</strong> peintures,<strong>de</strong> bas-reliefs, <strong>de</strong> statues, ou même d'architecture, tout naît <strong>du</strong>simp<strong>le</strong> trait <strong>de</strong> calame ou <strong>de</strong> pinceau exécuté par <strong>le</strong> « scribe <strong>de</strong>scontours ». L'écriture el<strong>le</strong>-même n'est qu'une suite <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins.Répondant à <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>s précis, ce savoir-faire restera en place <strong>du</strong>rantprès <strong>de</strong> trois millénaires. De Saqqara à la Vallée <strong>de</strong>s Rois, jusqu'auxfoisonnantes col<strong>le</strong>ctions <strong>de</strong>s musées européens, <strong>le</strong> film propose unvoyage fascinant dans <strong>le</strong>s plus bel<strong>le</strong>s œuvres qui livrent <strong>le</strong>urs secrets<strong>de</strong> fabrication et la signification <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs fonctions cultuel<strong>le</strong>s,magiques et mystérieuses, si importantes dans la civilisation6
A l’auditoriumOstracon figuré : hyène attaquée par trois chiens,calcaire peint, Nouvel Empire, XIX e -XX e dynasties,vers 1295-1069 av. J.-C., Deir el-Medineh, E 14366,département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong><strong>Louvre</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist.RMN-GP / Christian Décamps.ColloqueLe <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne : pratiques, fonctions et usages.Samedi 8 Juin 2013, <strong>de</strong> 10h à 18hLes témoignages archéologiques visib<strong>le</strong>s en Égypte et dans <strong>le</strong>s muséesmontrent la permanence d’une tradition où <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin a une importanceprimordia<strong>le</strong> dans <strong>le</strong> processus <strong>de</strong> création. Des spécialistesprésenteront <strong>le</strong>urs <strong>de</strong>rniers travaux sur <strong>le</strong>s caractéristiques, <strong>le</strong>stechniques, <strong>le</strong>s liens avec l’écriture, <strong>le</strong>s fonctions et <strong>de</strong>s usages <strong>de</strong> cetart que, pendant plus <strong>de</strong> trois millénaires, <strong>le</strong>s « scribes <strong>de</strong>s formes »ont créé.10 h Ouverturepar Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë, département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes,musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>.10h10 La frontalité dans <strong>le</strong>s images égyptiennes : usages et va<strong>le</strong>urspar Youri Volokhine, université <strong>de</strong> Genève.10h50 « Ils sont drô<strong>le</strong>s ces Égyptiens ! » ou l’humour <strong>de</strong>s pharaonspar Pascal Vernus, EPHE, Paris.11h30 Écrire et <strong>de</strong>ssiner : sur la « fabrication » <strong>de</strong>s inscriptionshiéroglyphiquespar Ben J.J. Haring, université <strong>de</strong> Ley<strong>de</strong>.15h Artisans itinérants sous <strong>le</strong> règne <strong>de</strong> Sésostris I erpar Marcel Marée, British Museum, Londres.15h40 Technologie <strong>de</strong> la peinture égyptienne pharaonique. Une enquête aucœur <strong>du</strong> processus picturalpar Hugues Tavier, université <strong>de</strong> Liège.16h20 Ostraca figurés <strong>de</strong> la Vallée <strong>de</strong>s Rois : repro<strong>du</strong>ction, innovation,religionpar Andreas Dorn, université <strong>de</strong> Liège.Ostracon figuré : sept poissons <strong>du</strong> Nil, calcairepeint, Nouvel Empire, vers 1295-1069 av. J.-C., Deirel-Medineh, E 14307, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>© <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / ChristianDécamps.17h Tradition et créativité. Pour une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’«intericonicité» dans l’art <strong>de</strong>l’Égypte antiquepar Dimitri Laboury, université <strong>de</strong> Liège.Œuvre en scèneDessins à voir sur <strong>le</strong>s ostraca figurés égyptiensMercredi 22 mai 2013 à 12h30par Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>.La préparation <strong>de</strong> l’exposition L’art <strong>du</strong> contour. Le <strong>de</strong>ssin dansl’Égypte ancienne a été l’occasion d’engager une campagne <strong>de</strong>restauration systématique <strong>de</strong> la col<strong>le</strong>ction d’ostraca figurés conservésau département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes. Menées par <strong>le</strong>srestauratrices Sophie Duberson et Christine Parisel<strong>le</strong>, avec l’ai<strong>de</strong> et <strong>le</strong>soutien <strong>du</strong> C2RMF, ces opérations ont permis <strong>de</strong> rendre à ces <strong>de</strong>ssinssur pierre calcaire et terre cuite <strong>le</strong>ur tracé et <strong>le</strong>ur polychromieoriginels, révélant à l’occasion <strong>de</strong>s sujets insoupçonnés. Longtempsconsidérés comme <strong>de</strong>s brouillons ou <strong>de</strong>s esquisses préparatoires, <strong>le</strong>sostraca figurés peuvent désormais apparaître comme <strong>de</strong>s créationsartistiques à part entière et témoigner <strong>de</strong> l’univers personnel etintel<strong>le</strong>ctuel <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs auteurs, ajoutant ainsi cette documentation àl’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la société égyptienne au Nouvel Empire. Une sé<strong>le</strong>ctiond’ostraca sera présentée et filmée en direct sur la scène <strong>de</strong>l’auditorium.7
Préfacepar Henri Loyrette,prési<strong>de</strong>nt-directeur <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>Le musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> se réjouit d’être la première institution à organiser une exposition sur <strong>le</strong> thème <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin,tel qu’on peut <strong>le</strong> voir dans l’art égyptien au temps <strong>de</strong>s pharaons.Si <strong>le</strong>s vestiges architecturaux, au premier rang <strong>de</strong>squels se trouvent <strong>le</strong>s pyrami<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Giza et <strong>le</strong>s temp<strong>le</strong>s <strong>de</strong>Karnak ou d’Abou-Simbel, sont bien connus <strong>du</strong> public, la place <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin en tant que geste graphiquepréparatoire à ces réalisations ou, mieux encore, en tant que composition d’agrément, réalisée pour el<strong>le</strong>-même,méritait qu’on lui rendît hommage.C’est à cette approche nouvel<strong>le</strong>, qui démontre l’omniprésence <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin dans la pro<strong>du</strong>ction artistique <strong>de</strong>sÉgyptiens, qu’invite L’Art <strong>du</strong> contour. Le <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne dans l’espace Richelieu <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>,<strong>du</strong> 19 avril au 22 juil<strong>le</strong>t 2013, puis aux <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire <strong>de</strong> Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>du</strong> 13 septembre 2013au 19 janvier 2014. Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë, directrice <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes etcommissaire <strong>de</strong> l’exposition, a choisi <strong>de</strong> montrer <strong>de</strong>ux cents œuvres dont la mise en perspective révè<strong>le</strong> uneréalité souvent insoupçonnée et <strong>de</strong>s ta<strong>le</strong>nts <strong>de</strong> premier ordre. L’Art <strong>du</strong> contour soulève <strong>le</strong>s questions majeuresque sont la relation entre l’écriture et <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin, l’apprentissage, <strong>le</strong> statut <strong>de</strong>s hommes <strong>de</strong> <strong>le</strong>ttres et <strong>de</strong>s artistes,<strong>le</strong> respect <strong>de</strong>s conventions trois fois millénaires et <strong>le</strong>s nombreuses entorses que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs <strong>le</strong>ur ontinfligées. Tous <strong>le</strong>s sujets sont abordés pour mettre en relief la création <strong>de</strong> ces artistes et pour donner à admirerl’extrême variété <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur pro<strong>du</strong>ction, permettant <strong>de</strong> pénétrer au cœur <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs pratiques et <strong>de</strong> l’inspiration qui<strong>le</strong>s a guidés.8
Intro<strong>du</strong>ctionpar Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë,directeur <strong>du</strong> département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>Le thème <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin, tel qu’on peut l’observer dans l’art égyptien au temps <strong>de</strong>s pharaons, n’a encore jamais ététraité dans une exposition. Cela s’explique sans doute par ce qu’on peut appe<strong>le</strong>r la difficulté <strong>de</strong>s égyptologueset <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’art occi<strong>de</strong>ntaux à accor<strong>de</strong>r <strong>le</strong> statut d’artiste aux créateurs <strong>de</strong> cette pro<strong>du</strong>ction plus <strong>de</strong>trois fois millénaire, admirée <strong>de</strong> tous, mais rarement i<strong>de</strong>ntifiée comme étant l’œuvre d’une main reconnue. Ladéfinition <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin « père <strong>de</strong> nos trois arts, l’architecture, la sculpture et la peinture » donnée par l’artiste <strong>de</strong>la Renaissance italienne Giorgio Vasari s’illustre pourtant parfaitement dans <strong>le</strong>s témoignages archéologiquesvisib<strong>le</strong>s en Égypte et dans <strong>le</strong>s musées. Notre propos, en cette secon<strong>de</strong> décennie <strong>du</strong> XXI e sièc<strong>le</strong>, est <strong>de</strong> donner àvoir et d’expliquer comment <strong>le</strong>s gril<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>le</strong>cture <strong>de</strong>s historiens <strong>de</strong> l’art occi<strong>de</strong>ntal peuvent contribuer àanalyser <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien, à lui rendre sa place, que nous estimons majeure, dans l’histoire <strong>de</strong> l’art universel,tout en respectant et en rappelant bien évi<strong>de</strong>mment la nature comp<strong>le</strong>xe <strong>de</strong> la création égyptienne et <strong>le</strong>sspécificités <strong>de</strong> la civilisation qui a engendré ces œuvres.(…)Le <strong>de</strong>ssin et <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs dans l’Égypte ancienneCes <strong>de</strong>ssins sont <strong>le</strong>s œuvres d’artistes que <strong>le</strong>s textes égyptiens nomment sš qd.wt (se lit : SESH KEDOUT),expression tra<strong>du</strong>ite <strong>le</strong> plus souvent par « scribe <strong>de</strong>s contours » mais parfois par « scribe <strong>de</strong>s formes », cette<strong>de</strong>rnière tra<strong>du</strong>ction étant plus conforme au sens <strong>du</strong> vocab<strong>le</strong> égyptien qd.wt. Dérivant <strong>de</strong> la racine qd,« façonner, donner forme, tourner (geste <strong>du</strong> potier) », <strong>le</strong> mot qd .wt désigne la forme extérieure d’un sujet<strong>de</strong>ssiné par un homme dont <strong>le</strong> métier est <strong>de</strong> tracer et d’écrire. Cet homme est un sš (SESH), terme que l’onrend par « scribe » puisqu’il s’applique à celui qui, muni <strong>de</strong> sa pa<strong>le</strong>tte et <strong>de</strong> son pinceau (tige <strong>de</strong> joncmâchonnée et battue), d’un go<strong>de</strong>t à eau et <strong>de</strong> pains <strong>de</strong> pigments, trace textes et <strong>de</strong>ssins.(…)Dès l’Ancien Empire, <strong>le</strong> ta<strong>le</strong>nt <strong>de</strong> la société égyptienne pour s’organiser et dresser <strong>de</strong>s hiérarchies dédiées àl’encadrement <strong>de</strong>s groupes d’hommes au travail se retrouve naturel<strong>le</strong>ment dans <strong>le</strong> fonctionnement <strong>de</strong>scorporations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs-peintres. (…)Au Nouvel Empire, (…) l’organisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs-peintres en ateliers est confirmée par <strong>le</strong>s textes et par<strong>le</strong>ur appartenance au palais, à la Place <strong>de</strong> la Maât ou à un temp<strong>le</strong>, comme en témoigne la stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia,« directeur <strong>de</strong>s scribes <strong>de</strong>s contours d’Amon », qui décline sur une <strong>de</strong> ses faces <strong>le</strong>s noms et titres <strong>de</strong> ses aïeuxsur six générations d’hommes ayant exercé la fonction <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateur au service <strong>du</strong> dieu Amon. (…)Ces ateliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs sont éga<strong>le</strong>ment bien attestés par l’immense documentation textuel<strong>le</strong> eticonographique <strong>du</strong> site <strong>de</strong> Deir el-Médina et <strong>de</strong> la Vallée <strong>de</strong>s Rois, qui permet d’i<strong>de</strong>ntifier pour l’époqueramessi<strong>de</strong> <strong>de</strong>s famil<strong>le</strong>s et <strong>de</strong>s dynasties d’artistes au service <strong>de</strong> la Tombe <strong>du</strong> Roi et <strong>de</strong> <strong>le</strong>urs propres tombes.(…)Le titre « scribe <strong>de</strong>s contours/scribe <strong>de</strong>s formes » ne tombe pas en désuétu<strong>de</strong> au I er millénaire, mais sesattestations sont moins nombreuses. On <strong>le</strong> rencontre par exemp<strong>le</strong> à l’époque tardive (26 e dynastie, règne <strong>de</strong>Psammétique I er , 664-610 av. J.-C.) dans la tombe thébaine <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>utirdis et dans la littérature démotique.Quelques repères chronologiques et archéologiquesÀ l’époque thinite (vers 3100-2700 av. J.-C.), <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin s’applique tant au décor <strong>de</strong>s objets mobiliers qu’àl’écriture naissante, qui met au point un encodage graphique à base <strong>de</strong> pictogrammes <strong>de</strong> la langue parlée dansla vallée <strong>du</strong> Nil. Utilisant l’arsenal extraordinaire que présentent la faune, la flore, <strong>le</strong> paysage, <strong>le</strong>s humains, <strong>le</strong>sbâtiments et tous <strong>le</strong>s éléments <strong>de</strong> la nature, <strong>le</strong>s premiers scribes affectent à <strong>le</strong>urs signes/images <strong>de</strong>s sons quiper<strong>du</strong>reront et se multiplieront pendant plus <strong>de</strong> trois millénaires.Avec <strong>le</strong>s témoignages <strong>du</strong> temps <strong>de</strong>s pyrami<strong>de</strong>s (Ancien Empire, 2700-2200 av. J.-C.), qui voit <strong>le</strong>s gran<strong>de</strong>snécropo<strong>le</strong>s memphites se doter <strong>de</strong> pyrami<strong>de</strong>s roya<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> sépultures décorées <strong>de</strong> nombreuses scènessculptées en bas-relief au service <strong>de</strong> l’éternité <strong>de</strong> l’élite contemporaine, on comprend que toutes ces créationsn’ont pu être exécutées sans <strong>le</strong> tracé initial et préparatoire d’un <strong>de</strong>ssin. Tous <strong>le</strong>s procédés techniques (gril<strong>le</strong> <strong>de</strong>proportions, trait rouge corrigé en noir) sont en place, <strong>de</strong> même que <strong>le</strong>s caractéristiques <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien,parfois appelées « canons » ou conventions », que ce volume tend à analyser au fil <strong>de</strong> ses pages.(…)9
Le <strong>Mo</strong>yen Empire (vers 2030-1785) a laissé moins <strong>de</strong> témoignages <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssins, tels qu’on en a fait la typologieplus haut, par rapport à d’autres pério<strong>de</strong>s historiques <strong>de</strong> l’Égypte ancienne. C’est à cette époque que <strong>le</strong>s parois<strong>de</strong>s tombes ne sont plus systématiquement décorées et que <strong>le</strong>s artistes exercent <strong>le</strong>urs ta<strong>le</strong>nts sur <strong>le</strong> mobilierfunéraire déposé autour <strong>de</strong>s défunts. C’est plus précisément l’observation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins qui ornent <strong>le</strong>s cercueils<strong>du</strong> <strong>Mo</strong>yen Empire qui permet d’admirer <strong>le</strong> travail <strong>de</strong>s « scribes <strong>de</strong>s contours ». L’interaction <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin et <strong>de</strong>l’écriture est dans ce cas particulièrement sensib<strong>le</strong> : aux colonnes serrées <strong>de</strong>s formu<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s textes <strong>de</strong>ssarcophages, aux cartes figurées <strong>de</strong> l’au-<strong>de</strong>là, aux représentations d’éléments architecturaux s’ajoutent <strong>le</strong>s<strong>de</strong>ssins polychromes <strong>de</strong>s frises d’objets caractéristiques <strong>de</strong>s cercueils <strong>du</strong> <strong>Mo</strong>yen Empire. Ces objets sont làpour ai<strong>de</strong>r à la survie <strong>du</strong> défunt mais aussi pour l’assurer, par <strong>le</strong>urs seu<strong>le</strong>s figurations, <strong>de</strong> l’efficacitépermanente <strong>de</strong>s rituels funéraires qu’ils évoquent. C’est bien là une <strong>de</strong>s c<strong>le</strong>fs <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin dans la penséeégyptienne : par la magie <strong>de</strong> l’image, <strong>le</strong> sujet figuré est doté d’un pouvoir <strong>de</strong> réalité.Les vestiges <strong>du</strong> Nouvel Empire (vers 1550-1070 av. J.-C.) illustrent avec un éclat sans égal l’apogée <strong>de</strong> l’art <strong>du</strong><strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne. Les centaines <strong>de</strong> tombes, en particulier cel<strong>le</strong>s qui se trouvent sur la riveocci<strong>de</strong>nta<strong>le</strong> <strong>de</strong> Thèbes, sont assurément <strong>le</strong> plus grand musée égyptologique <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> dans <strong>le</strong> domaine <strong>de</strong> lapeinture et <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin qui la sous-tend. Exposer au musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> ou aux <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire<strong>de</strong> Bruxel<strong>le</strong>s <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienne relève d’un défi audacieux, puisqu’il faut s’y satisfaire d’œuvresqui donnent à imaginer la beauté et la diversité <strong>de</strong>s monuments bâtis et décorés sur <strong>le</strong>s rives <strong>du</strong> Nil. De cetteabondance d’exemp<strong>le</strong>s éblouissants, qui décrivent <strong>le</strong>s étapes <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin dans la décoration <strong>de</strong>s tombes, on peutretenir, mais cette sé<strong>le</strong>ction est très ré<strong>du</strong>ctrice, ceux <strong>de</strong>s tombes <strong>de</strong> Souemniout, Ramose, Nou et Nakhtmin ouencore, dans la Vallée <strong>de</strong>s Rois, s’arrêter sur <strong>le</strong> décor <strong>de</strong> la tombe <strong>du</strong> pharaon Horemheb (1323-1295 av. J.-C.).(…)Le temps <strong>de</strong>s Ramsès puis la pro<strong>du</strong>ction artistique qui suivit au I er millénaire avant notre ère témoignent d’unrespect relativement constant <strong>de</strong>s procédés mis en place par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux premiers millénaires <strong>de</strong>cette civilisation. Si <strong>le</strong>s ostraca figurés, auxquels on a fait une place <strong>de</strong> choix dans cet ouvrage, et toute ladocumentation issue <strong>de</strong>s fouil<strong>le</strong>s <strong>du</strong> site <strong>de</strong> Deir el-Médina <strong>de</strong>viennent pour l’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce sujet à l’époqueramessi<strong>de</strong> une matière <strong>de</strong> premier ordre, <strong>le</strong>s observations que l’on peut faire sur <strong>le</strong>s œuvres <strong>du</strong> I er millénaire nemodifient pas <strong>le</strong> discours sur <strong>le</strong> sujet. En préparant cette exposition, il est apparu qu’il était fina<strong>le</strong>ment assezmalaisé <strong>de</strong> montrer <strong>de</strong>s documents pertinents pour cette pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Égypte, à l’exception <strong>de</strong> papyri et <strong>de</strong>mobilier funéraire en bois polychromé. Ce qui n’était pas un choix délibéré est <strong>de</strong>venu une évi<strong>de</strong>nce : tant enÉgypte que dans <strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctions <strong>de</strong> musées, <strong>le</strong>s monuments et œuvres susceptib<strong>le</strong>s d’illustrer <strong>le</strong> thème <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinégyptien appartiennent majoritairement aux III e et II e millénaires avant notre ère.10
Parcours <strong>de</strong> l’expositionINTRODUCTIONL’ART DU CONTOUR. LE DESSIN DANS L’ÉGYPTE ANCIENNE« L’art <strong>du</strong> contour » invite à une réf<strong>le</strong>xion sur la notion d’art dans l’Égypte ancienne et propose d’accor<strong>de</strong>r <strong>le</strong>statut d’artiste aux créateurs <strong>de</strong> cette pro<strong>du</strong>ction plus <strong>de</strong> trois fois millénaire, admirée <strong>de</strong> tous, mais rarementi<strong>de</strong>ntifiée comme étant l’œuvre d’une main reconnue. Le mot « artiste », dans son acception mo<strong>de</strong>rne, n’existepas dans <strong>le</strong> vocabulaire hiéroglyphique, pas plus que la notion d’art pour l’art n’aurait eu <strong>de</strong> sens dans lamentalité égyptienne. Cependant, la définition <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin donnée par l’artiste <strong>de</strong> la Renaissance Giorgio Vasari(1511-1574) comme étant <strong>le</strong> « père <strong>de</strong> nos trois arts, l’architecture, la sculpture et la peinture » s’illustreparfaitement dans <strong>le</strong>s témoignages archéologiques <strong>du</strong> temps <strong>de</strong>s Pharaons, qu’ils se trouvent en Egypte ou dans<strong>le</strong>s musées. « L’art <strong>du</strong> contour » est l’occasion <strong>de</strong> montrer l’omniprésence <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin chez <strong>le</strong>s Egyptiens, chezqui l’obsession <strong>de</strong> l’efficacité a con<strong>du</strong>it l’exécutant à créer très souvent une œuvre d’art et, parfois, un chefd’œuvre universel.LE « SCRIBE DES CONTOURS »Les textes hiéroglyphiques désignent <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs/peintres par une expression composée que l’on prononcesech qédout et qui se tra<strong>du</strong>it régulièrement par « scribe <strong>de</strong>s contours ». Formé sur la racine qèd (qed)« façonner, donner forme, tourner (geste <strong>du</strong> potier) », <strong>le</strong> mot qédout s’applique à la forme extérieure d’un sujet<strong>de</strong>ssiné par un sech, c’est-à-dire un scribe qui, muni <strong>de</strong> sa pa<strong>le</strong>tte et <strong>de</strong> son pinceau, trace textes et <strong>de</strong>ssins. Pour<strong>de</strong>s raisons que <strong>le</strong> souci d’euphonie dans la langue française justifie, et parce qu’il est juste <strong>de</strong> considérer <strong>le</strong><strong>de</strong>ssin comme l’art <strong>du</strong> contour, la tra<strong>du</strong>ction adoptée ici est cel<strong>le</strong> <strong>de</strong> « scribe <strong>de</strong>s contours », tandis que d’autreségyptologues lui préfèrent « scribe <strong>de</strong>s formes ».Dès l’Ancien Empire, <strong>le</strong> ta<strong>le</strong>nt <strong>de</strong> la société égyptienne pour établir <strong>de</strong>s hiérarchies <strong>de</strong>stinées à encadrer <strong>le</strong>sgroupes d’hommes au travail s’exerce dans l’organigramme <strong>de</strong>s ateliers <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs/peintres. On ydistingue <strong>de</strong>s directeurs, <strong>de</strong>s administrateurs, <strong>de</strong>s inspecteurs, <strong>de</strong>s commandants et, à partir <strong>du</strong> Nouvel Empire,<strong>de</strong>s chefs. Les simp<strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs sont souvent <strong>le</strong>urs fils, qui reprendront <strong>le</strong>ur charge <strong>de</strong> direction à <strong>le</strong>ur suite.DESSIN ET ÉCRITURELe système hiéroglyphique qui enco<strong>de</strong> graphiquement la langue <strong>de</strong>s Égyptiens n’utilise que <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinsreprésentant l’humanité, la faune, la flore, <strong>le</strong> paysage et l’univers qu’ils avaient sous <strong>le</strong>s yeux et, pour <strong>le</strong> mon<strong>de</strong>divin, dans <strong>le</strong>urs pensées. Ces signes peuvent être employés dans un même texte tantôt pour <strong>le</strong>ur va<strong>le</strong>urphonétique (phonogramme), tantôt pour l’idée qu’ils suggèrent (idéogramme). Certains signes ne seprononcent pas et restent <strong>de</strong> purs <strong>de</strong>ssins que l’on trace comme déterminatifs <strong>du</strong> mot qui <strong>le</strong>s précè<strong>de</strong>, pour ai<strong>de</strong>rà <strong>le</strong>ur compréhension. Ce sont là <strong>le</strong>s exemp<strong>le</strong>s <strong>le</strong>s plus marquants <strong>de</strong> la relation intime entre écriture et image.Une scène sur une paroi <strong>de</strong> temp<strong>le</strong> ou <strong>de</strong> chapel<strong>le</strong> <strong>de</strong> tombe peut être considérée comme <strong>le</strong> déterminatifmonumental <strong>de</strong> la légen<strong>de</strong> qui l’accompagne. Le scribe <strong>de</strong>ssine l'écrit, <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateur écrit l'image, et <strong>le</strong>s <strong>de</strong>uxgestes sont souvent exécutés par <strong>le</strong> même homme.L’ÉQUIPEMENT DE L’ARTISTE ET LES SUPPORTS À SA DISPOSITIONDe l'ébauche à l'œuvre achevée, <strong>le</strong>s différentes étapes <strong>du</strong> travail vont déterminer l'utilisation d'outils, <strong>de</strong>matériaux et <strong>de</strong> supports, adaptés à la création <strong>de</strong> l'artiste <strong>de</strong>ssinateur. Sa pa<strong>le</strong>tte lui permet <strong>de</strong> ranger sespinceaux (fines tiges <strong>de</strong> jonc à l'extrémité mâchonnée) et <strong>de</strong> déposer dans ses cupu<strong>le</strong>s <strong>de</strong>s pains <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>urs. Ilré<strong>du</strong>it <strong>le</strong>s pigments colorés en poudre grâce à <strong>de</strong>s pilons et <strong>de</strong>s mortiers. Dans <strong>de</strong>s pots ou sur <strong>de</strong>s tessons <strong>de</strong>poterie incurvés il mélange ces cou<strong>le</strong>urs avec <strong>de</strong> l’eau conservée dans un go<strong>de</strong>t.On trouve <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins sur quasiment tous <strong>le</strong>s supports que <strong>le</strong>s ressources <strong>de</strong> l’Égypte offraient à ses artistes.Les plus soup<strong>le</strong>s sont <strong>le</strong> papyrus, <strong>le</strong>s tissus (lin) et la peau tannée. Les supports rigi<strong>de</strong>s sont <strong>le</strong> bois, la terrecuite, la mouna (pisé) étalée sur <strong>le</strong>s murs <strong>de</strong>s tombes et, bien sûr, la pierre, qu’el<strong>le</strong> soit monumenta<strong>le</strong> oufragmentaire (ostracon). Pour lisser <strong>le</strong>s surfaces (papyrus ou parois) <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateur utilise <strong>de</strong>s polissoirs, en boisou pierre <strong>du</strong>re.11
L'APPRENTISSAGE DU DESSINLe titre <strong>de</strong> « scribe <strong>de</strong>s contours/scribe <strong>de</strong>s formes » apparaît à Giza au milieu <strong>du</strong> III e millénaire avant notreère. Dès l’Ancien Empire, l’administration égyptienne met en place <strong>de</strong>s structures dotées d’une soli<strong>de</strong>hiérarchie pour encadrer la formation et <strong>le</strong> travail <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs. Le métier se transmet <strong>de</strong> maître à apprenti,qui sont souvent père et fils. Leur organisation en ateliers est confirmée par <strong>le</strong>s textes et par <strong>le</strong>ur appartenance à<strong>de</strong>s institutions <strong>de</strong> l’État, à une nécropo<strong>le</strong> ou à un temp<strong>le</strong>, comme en témoigne la stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia qui décline surune <strong>de</strong> ses faces <strong>le</strong>s noms et titres <strong>de</strong> ses aïeux sur six générations d’hommes ayant exercé cette fonction <strong>de</strong><strong>de</strong>ssinateur au service <strong>du</strong> dieu Amon.L’exercice <strong>de</strong> copie <strong>de</strong>s modè<strong>le</strong>s anciens est celui auquel s’adonne l’élève <strong>de</strong>ssinateur pour apprendre sonmétier, comme en témoignent <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins inachevés sur <strong>de</strong>s parois <strong>de</strong> tombes et <strong>de</strong> très nombreux ostraca. Leterme ostracon (plur. ostraca) est un mot grec qui désigne une coquil<strong>le</strong>. Les Grecs ont ainsi nommé tous <strong>le</strong>séclats <strong>de</strong> calcaire et <strong>le</strong>s tessons <strong>de</strong> poterie qui ont servi <strong>de</strong> support à l’écriture d’un texte ou au tracé d’un<strong>de</strong>ssin. Les ostraca n’avaient pas en principe vocation à être conservés. Les égyptologues ont maintenu ceterme dans <strong>le</strong>ur vocabulaire. Les exercices montrent que l’apprenti traçait à la peinture rouge son essai, que <strong>le</strong>maître rectifiait <strong>de</strong> son trait noir. Ce co<strong>de</strong> <strong>de</strong> correction a per<strong>du</strong>ré pendant trois millénaires.LE DESSIN COMME ESQUISSESi <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin peut souvent être considéré comme une œuvre d’art à part entière, il est aussi l’étape préalab<strong>le</strong> <strong>de</strong>l’exécution d’une œuvre <strong>de</strong>stinée à être réalisée selon une autre technique : peinture, sculpture (bas-relief etstatuaire), architecture. "Celui qui maîtrise la ligne atteindra la perfection en chacun <strong>de</strong> ces arts" disait l’artisteGiorgio Vasari (1511-1574) aux jeunes ta<strong>le</strong>nts <strong>de</strong> son temps.L’extrême régularité et <strong>le</strong> spectaculaire équilibre <strong>de</strong> la sculpture égyptienne en bas relief, tel<strong>le</strong> qu’on peutl’observer sur <strong>le</strong>s monuments égyptiens, qu’ils soient temp<strong>le</strong>s, tombes ou stè<strong>le</strong>s, sont <strong>du</strong>s au tracé <strong>du</strong><strong>de</strong>ssinateur. Intervient ensuite <strong>le</strong> sculpteur, qui, <strong>de</strong> son ciseau, suit <strong>le</strong>s lignes ainsi définies pour donnersoup<strong>le</strong>sse et mo<strong>de</strong>lé à son œuvre. Lorsque <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin précè<strong>de</strong> la peinture, il semb<strong>le</strong> acquis que c’est <strong>le</strong><strong>de</strong>ssinateur lui-même qui applique <strong>le</strong>s cou<strong>le</strong>urs.PEINTURE ET CONTOURLes fragments <strong>de</strong> peintures mura<strong>le</strong>s dans cette section exposés proviennent tous <strong>de</strong> tombes <strong>de</strong> la nécropo<strong>le</strong>thébaine, véritab<strong>le</strong> conservatoire <strong>de</strong> l’art <strong>de</strong> la peinture chez <strong>le</strong>s Égyptiens qui connait son apogée sous la18 e dynastie, à partir <strong>de</strong>s règnes <strong>de</strong> Thoutmosis IV ou Amenhotep III (vers 1398-1348 av. J.-C.). Les étapes <strong>de</strong>la pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> ces peintures, œuvres <strong>de</strong>s « scribes <strong>de</strong>s formes/scribes » <strong>de</strong>s contours sont visib<strong>le</strong>s sur <strong>de</strong>nombreux exemp<strong>le</strong>s et montrent que tour à tour ceux d’entre eux qui sont <strong>le</strong>s plus qualifiés peuvent êtrescribes, décorateurs, <strong>de</strong>ssinateurs et peintres.La « scène <strong>de</strong> navigation » prêtée par <strong>le</strong>s MRAH <strong>de</strong> Bruxel<strong>le</strong>s en est une brillante illustration. A cette époque,la pa<strong>le</strong>tte <strong>de</strong>s peintres égyptiens se libère <strong>de</strong>s cou<strong>le</strong>urs posées en à plat, qui étaient <strong>de</strong> rigueur au début <strong>de</strong> la18 e dynastie, et s’émancipe <strong>du</strong> carcan <strong>de</strong>s stricts traits <strong>de</strong> contour. Si <strong>le</strong>s corps <strong>de</strong>s personnages sont toujourscernés <strong>de</strong> lignes continues rouge foncé, tracées avec une gran<strong>de</strong> sûreté, <strong>le</strong>urs chevelures sont simp<strong>le</strong>mentbrossées <strong>de</strong> rapi<strong>de</strong>s coups <strong>de</strong> pinceau qui <strong>le</strong>ur confèrent volume et mouvement. De même, la transparence <strong>de</strong>svêtements <strong>de</strong>s p<strong>le</strong>ureurs, l’eau <strong>du</strong> f<strong>le</strong>uve, <strong>le</strong>s colonnettes <strong>de</strong>s kiosques ou <strong>le</strong>s grappes <strong>de</strong> raisins sont peintesavec spontanéité, d’une main rapi<strong>de</strong> et libre, et <strong>le</strong> peintre recourt volontiers à <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> dégradés, à <strong>de</strong>simp<strong>le</strong>s taches <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>urs ou à <strong>de</strong>s traits <strong>de</strong> pinceau soup<strong>le</strong>s et sinueux.12
L’UNIVERS ET L’IMAGINAIRE DES EGYPTIENSLes œuvres <strong>de</strong> ces vitrines dévoi<strong>le</strong>nt l’imaginaire <strong>de</strong>s Égyptiens, à commencer par <strong>le</strong>urs dieux, ces créatureshybri<strong>de</strong>s qui protégeaient la vie ici-bas et dans l’au-<strong>de</strong>là. Dessiner c’est donner vie au sujet, réalité à l’objet etefficacité à la divinité figurée. Par la magie <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins, textes et images entremêlés, <strong>le</strong> mon<strong>de</strong> égyptien segarantit d’être protégé <strong>de</strong>s forces <strong>du</strong> mal, ici-bas et dans l’au-<strong>de</strong>là.Les représentations d’êtres humains répon<strong>de</strong>nt <strong>le</strong> plus souvent au co<strong>de</strong> imposé <strong>de</strong> <strong>le</strong>s montrer selon un typeidéal, mettant en va<strong>le</strong>ur hommes et femmes sous un aspect jeune, svelte et sans défaut. Le Pharaon est enmajesté, illustré ici par <strong>le</strong> grand ostracon <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> qui figure Ramsès VI dans la perfection <strong>de</strong> ses traits,<strong>de</strong>ssinés d’abord à l’encre rouge et achevés à l’encre noire, tandis que ses joues sont délicatement rehausséesd’une peinture ocre rouge et ses lèvres peintes en rouge.Mais <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs ne se privèrent pas <strong>de</strong> montrer <strong>le</strong>urs congénères sans in<strong>du</strong>lgence pour <strong>le</strong>ur physiquedisgrâcieux. De nombreuses représentations d’obèses, <strong>de</strong> bossus, d’hommes âgés ou d’étrangers caractériséspar un physique non-égyptien, témoignent d’une volonté <strong>de</strong> réalisme et <strong>de</strong> naturalismePARODIES ET ÉROTISMEHumour et dérision caractérisent cette section, dédiée à <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssins d’inspiration satirique et pornographique,dont <strong>le</strong> papyrus <strong>de</strong> Turin est l’exemp<strong>le</strong> <strong>le</strong> plus fameux. Les scènes parodiques, sur papyrus et ostraca, sont <strong>de</strong>stab<strong>le</strong>aux en soi qui mettent en scène <strong>de</strong>s animaux (singes, chats, souris ou rats) dans <strong>de</strong>s situations risib<strong>le</strong>s,occupés à <strong>de</strong>s activités humaines qui sont ainsi caricaturées. La plus audacieuse est figurée sur l’ostracon quidonne à voir une parodie <strong>de</strong> la procession religieuse <strong>du</strong> culte d’Amenhotep I er .Les scènes érotiques sur ostraca montrent <strong>de</strong>s ébats sexuels qui se dérou<strong>le</strong>nt parfois en public, comme surl’ostracon sur <strong>le</strong>quel <strong>de</strong>ux enfants encadrent un coup<strong>le</strong> en p<strong>le</strong>ine action. Tant <strong>le</strong> papyrus <strong>de</strong> Turin que cettesérie d’ostraca proviennent <strong>du</strong> site <strong>de</strong> Deir el-Médina ; ils donnent une idée précise <strong>de</strong>s sujets qui inspiraientsans comp<strong>le</strong>xe <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs <strong>de</strong> la communauté d’artistes qui travaillaient sous <strong>le</strong>s Ramsès à la Tombe <strong>du</strong>Roi.SCÈNES DE VIE, SCÈNES DE GENREL’art égyptien n’est que rarement <strong>le</strong> ref<strong>le</strong>t exact <strong>de</strong> la réalité mais, plutôt, une composition élaborée à partird’éléments puisés dans cette réalité et porteuse <strong>de</strong> sens. À ce titre, il est régi par <strong>de</strong>s conventions et <strong>de</strong>s co<strong>de</strong>sprécis. Les images montrant une mère et son enfant obéissent à ces co<strong>de</strong>s et, au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la scène d’intimitétouchante, véhicu<strong>le</strong>nt un arrière-plan symbolique lié à la protection <strong>de</strong>s étapes <strong>le</strong>s plus vulnérab<strong>le</strong>s <strong>de</strong> la vie.Cette règ<strong>le</strong> souffre cependant <strong>de</strong>s exceptions, notamment lorsqu’il s’agit <strong>de</strong> montrer <strong>de</strong>s personnagessecondaires. Ainsi, serviteurs, artisans ou paysans dans l’exercice <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur activité sont généra<strong>le</strong>ment traitésavec une gran<strong>de</strong> liberté. Ils sont aussi souvent mis en scène avec beaucoup <strong>de</strong> naturel sur <strong>le</strong>s ostraca. Tail<strong>le</strong>ur<strong>de</strong> pierre rond et p<strong>le</strong>in d’entrain, gardien <strong>de</strong> troupeau famélique, harpiste au physique ingrat accroché à soninstrument ou enfant p<strong>le</strong>urant en présence d’un porc dévorant ses grains… Autant <strong>de</strong> petites scènes <strong>de</strong> viecroquées avec un réalisme non dénué d’humour où pointe éventuel<strong>le</strong>ment l’expression <strong>de</strong>s émotions.PAYSAGE, FAUNE ET FLORELes Égyptiens ont beaucoup représenté la nature qui <strong>le</strong>s entoure. Pendant plus <strong>de</strong> trois millénaires, ilsutiliseront <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssins <strong>du</strong> paysage, <strong>de</strong> la faune et <strong>de</strong> la flore comme signes d’écriture. Les parties <strong>de</strong> chasse et<strong>de</strong> pêche sont l’occasion pour <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs <strong>de</strong> figurer <strong>le</strong>s oiseaux en p<strong>le</strong>in vol et tous <strong>le</strong>s poissons ethabitants <strong>de</strong>s marais, donnant à voir <strong>de</strong>s scènes p<strong>le</strong>ines <strong>de</strong> vie. Chaque espèce est croquée avec <strong>de</strong>s détailsréalistes et peut être aisément i<strong>de</strong>ntifiée ; chaque arbre, palmier ou acacia, est <strong>de</strong>ssiné avec élégance. Les<strong>de</strong>ssins sur ostraca qui mettent en scène <strong>de</strong>s animaux familiers - chiens ou singes - sont courants. Ces œuvresdoivent être considérées comme <strong>de</strong>s petits tab<strong>le</strong>aux, pris sur <strong>le</strong> vif. L’ostracon <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> figurant trois chienspourchassant une hyène en est une illustration exemplaire. La nature peut aussi être ressentie comme unélément hosti<strong>le</strong> : <strong>le</strong>s animaux dangereux <strong>de</strong>s marais - tels <strong>le</strong>s hippopotames - menacent <strong>de</strong> ravager en une nuit<strong>le</strong>s cultures d'un champ. Les <strong>de</strong>ssiner sert alors souvent à <strong>le</strong>s empêcher <strong>de</strong> nuire.14
Regard sur quelques œuvresPapyrus mythologique <strong>de</strong> BakenmoutH. 22 ; l. 100 cm. Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire,21e dyn., 1069-945 av. J.-C., Thèbes.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>sAntiquités égyptiennes, N 3297.Ostracon figuré biface : portrait <strong>de</strong> Ramsès VI etesquissesCalcaire peint. H. 21,4 ; l. 22,8 ; ép. 3,9 cmNouvel Empire, 20e dyn., règne <strong>de</strong> Ramsès VI, XII esièc<strong>le</strong> av. J.-C., probab<strong>le</strong>ment Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Rois.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 498.Au recto <strong>de</strong> l’ostracon est représenté <strong>le</strong> profil <strong>de</strong>Ramsès VI, remarquab<strong>le</strong> par son nez puissant et courbequi lui donne ce <strong>de</strong>gré <strong>de</strong> personnalisation que l’artégyptien superpose parfois aux conventions <strong>de</strong> base. Letrait rouge, net et sûr, définit la plus gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> cevisage, bien qu’il ne tra<strong>du</strong>ise que <strong>le</strong> premier jet <strong>du</strong>peintre. Le trait noir, au contraire, qui représente laversion définitive <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin dans <strong>le</strong>s habitu<strong>de</strong>ségyptiennes, suit très étroitement la première esquisseet la complète là où c’est nécessaire. Le processusd’élaboration <strong>de</strong> l’image nous apparaît ici pris sur <strong>le</strong>vif. Le verso <strong>de</strong> l’ostracon n’est pas moins remarquab<strong>le</strong>puisqu’il conserve <strong>de</strong>ux très bel<strong>le</strong>s esquisses : à droite,au trait noir uniquement avec un peu <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>ur jaune,se voit l’arrière <strong>de</strong> la calotte lisse d’un roi munie d’unruban flottant, une coiffure en usage entre <strong>le</strong>s 19 e et 21 edynasties, tandis que l’amorce <strong>du</strong> collier <strong>du</strong> souverainse distingue encore en limite <strong>de</strong> cassure. À gauche,c’est un grand cobra uræus aux nombreux replis,<strong>de</strong>ssiné en rouge avec remplissage <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>ur jaune,qui s’offre à notre admiration. Ce grand éclat <strong>de</strong> pierrea donc servi d’ardoise à un artiste accompli.En prélu<strong>de</strong> à son entrée dans l’au-<strong>de</strong>là, <strong>le</strong>bienheureux Bakenmout adore Osiris et Isis. Puis,accompagné <strong>du</strong> dieu Anubis, il chemine librementvers l’au-<strong>de</strong>là, comme <strong>le</strong> texte l’y invite, et arriveen présence d’Harsiesis. Celui-ci tient en laisse unétrange serpent, pourvu d’une queue terminée parune tête <strong>de</strong> chien. Des ennemis décapités (<strong>le</strong>ur têteméthodiquement posée <strong>de</strong>vant eux) lui tiennentlieu <strong>de</strong> jambes. Huit génies à tête <strong>de</strong> lièvre, cobra,flamme, serpent, singe, chien, souris et oryctérope(au visage <strong>de</strong> face) sont assis au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> son dos.Armés <strong>de</strong> couteaux, ils sont <strong>le</strong>s gardiens <strong>de</strong> « l’au<strong>de</strong>làmystérieux ». L’image suivante montre <strong>le</strong>dieu <strong>de</strong> la Terre Geb supportant <strong>le</strong> corps d’un autregrand serpent, pourvu d’une tête à chacune <strong>de</strong> sesextrémités et doté <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux paires <strong>de</strong> jambes. Au<strong>de</strong>ssus<strong>de</strong> son dos, trois babouins assis, « seigneurs<strong>de</strong> l’au-<strong>de</strong>là », et <strong>de</strong>ux vautours séparés par <strong>de</strong>sflammes gar<strong>de</strong>nt cet espace mystérieux.La <strong>de</strong>rnière scène montre <strong>le</strong> Lac <strong>de</strong> feu, bassinrectangulaire entouré <strong>de</strong> flammes, à l’intérieur<strong>du</strong>quel flottent <strong>le</strong>s corps carbonisés <strong>de</strong>s ennemisqui ont péri dans son eau brûlante. Lieu <strong>de</strong> félicitépost mortem, l’au-<strong>de</strong>là égyptien, dans <strong>le</strong>quel rési<strong>de</strong>Osiris, est aussi un univers redoutab<strong>le</strong> traversé par<strong>de</strong>s rivières <strong>de</strong> feu, ponctué d’architecturesfabu<strong>le</strong>uses et peuplé d’inquiétantes créatures,incarnations <strong>de</strong>s puissances maléfiques quiguettent <strong>le</strong> mort engagé dans son périp<strong>le</strong> vers larenaissance. Ses gardiens ont eux-mêmes uneapparence et <strong>de</strong>s noms terrifiants, <strong>le</strong>ur permettant<strong>de</strong> repousser toute créature mal intentionnée àl’égard d’Osiris et donc <strong>de</strong> tout défunt. Lesimages, autant que <strong>le</strong>s textes, déroutent par <strong>le</strong>urétrangeté, toutefois, dans cet univers peuplé <strong>de</strong>lieux et <strong>de</strong> créatures hors normes, <strong>le</strong>s monstressont dominés, <strong>le</strong>s ennemis ont <strong>le</strong> sort qu’ilsméritent, l’ordre triomphe <strong>du</strong> chaos et ainsi <strong>le</strong>cyc<strong>le</strong> <strong>de</strong> la renaissance solaire est préservé. Làrési<strong>de</strong> la puissance magique <strong>de</strong> l’image.15
Plaque avec mise au carreau : chat, lion etbouquetinCalcaire. H. 20,5 (max.) ; l. 15,2 (max.) ; ép. 1,7 cm.Basse Époque, 26 e -30 e dyn., 664-332 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>sAntiquités égyptiennes, E 11335.Coupe aux trois poissonsFaïence siliceuse b<strong>le</strong>ue à décor noir. H. 3,5 ; D. 10 cm.Nouvel Empire, 18 e dyn., vers 1550-1295 av. J.-C.Ancienne col<strong>le</strong>ction Passalacqua. Berlin, ÄgyptischesMuseum und Papyrussammlung, ÄM 4562.Une gran<strong>de</strong> diversité règne dans la composition <strong>de</strong>s coupesornées <strong>de</strong> tilapias. Un seul poisson au centre, ou <strong>de</strong>ux têtebêcheou côte à côte, ou plusieurs tournoyant en manègeautour <strong>du</strong> motif central.Ces schémas <strong>de</strong> départ sont combinés avec toutes <strong>le</strong>spossibilités qu’offrent <strong>le</strong>s motifs <strong>du</strong> bassin ou <strong>de</strong> la rosette,toujours centrés, et <strong>de</strong>s plantes aquatiques, nénufars etpapyrus. Il n’y a pas <strong>de</strong>ux coupes semblab<strong>le</strong>s. Ici, <strong>le</strong>s troispoissons partagent la même tête, qui se trouve constituerl’élément central <strong>de</strong> la composition rayonnante. Cette fantaisievisuel<strong>le</strong> contredit une interprétation commune trop stricte <strong>de</strong>sprincipes <strong>de</strong> l’art égyptien. Certes <strong>le</strong>s représentations recréentune sorte <strong>de</strong> vie et <strong>le</strong>s images ne doivent pas tronquer la réalité<strong>du</strong> concept, mais une incarta<strong>de</strong> au principe n’est en aucun casun tabou inviolab<strong>le</strong>. Une tel<strong>le</strong> rigidité n’est pas dans l’espritégyptien.Ce <strong>de</strong>ssin s’inscrit parfaitement dans la série <strong>de</strong>s coupes enfaïence b<strong>le</strong>ue <strong>de</strong> la 18e dynastie, où la composition rayonnanteou tournoyante domine. El<strong>le</strong> en montre <strong>le</strong>s caractèresessentiels : occupation <strong>de</strong> tout <strong>le</strong> cadre disponib<strong>le</strong> jusqu’aubord souligné d’une ligne noire, alternance <strong>de</strong>s motifs <strong>de</strong>tilapias et <strong>de</strong>s nénufars, sans aucun réalisme dans <strong>le</strong>uragencement. Seu<strong>le</strong> compte la présence <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux symbo<strong>le</strong>s<strong>de</strong> renaissance que sont <strong>le</strong> tilapia, qui gar<strong>de</strong> ses oeufs dans sabouche, et <strong>le</strong> Nymphaea caeru<strong>le</strong>a (lotus b<strong>le</strong>u ou nénufar), laf<strong>le</strong>ur d’où est sorti <strong>le</strong> so<strong>le</strong>il au premier jour <strong>du</strong> mon<strong>de</strong>.Ces coupes furent interprétées comme <strong>de</strong>s évocations <strong>du</strong>milieu aquatique primordial, <strong>le</strong> Noun. On <strong>le</strong>s appel<strong>le</strong> aussi«marsh bowls» (coupes <strong>de</strong>s marais), une désignation plusneutre, qui tra<strong>du</strong>it bien <strong>le</strong> milieu <strong>de</strong> la régénération avant larenaissance.Les <strong>de</strong>ux faces <strong>de</strong> cette gran<strong>de</strong> plaque,originel<strong>le</strong>ment rectangulaire, ont étésoigneusement taillées et lissées pourrecevoir une gril<strong>le</strong> <strong>de</strong> mise au carreau dont<strong>le</strong>s lignes sont incisées dans <strong>le</strong> calcaire.Les carrés <strong>de</strong> la gril<strong>le</strong> sont plus petits et plusnombreux au recto. Une seu<strong>le</strong> face a étéutilisée pour <strong>de</strong>ssiner <strong>le</strong> profil <strong>de</strong> troisanimaux, placés <strong>le</strong>s uns au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s autreset tournés dans <strong>le</strong> même sens : en haut unchat assis, en bas un bouquetin qui marche et,dans l’espace laissé libre entre <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ux, unlion couché. Seuls <strong>le</strong> contour <strong>de</strong>s corps etquelques détails, comme <strong>le</strong>s yeux, <strong>le</strong>sarticulations <strong>de</strong> la patte avant <strong>du</strong> chat ou <strong>le</strong>scôtes <strong>du</strong> lion, ont été <strong>de</strong>ssinés en noir, aucalame. Chaque motif a été <strong>de</strong>ssiné pour luimême,il ne s’agit pas d’une scène <strong>de</strong>composition mais plutôt d’un exercice <strong>de</strong>copie. Il n’est pas tenu compte <strong>de</strong> l’échel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>chat est <strong>de</strong> la même hauteur que <strong>le</strong> bouquetinet <strong>le</strong> lion est tout petit. Si chaque animal esttout à fait reconnaissab<strong>le</strong> (<strong>le</strong> chat évoque <strong>le</strong>sstatuettes en bronze <strong>de</strong> Bastet, <strong>le</strong> bouquetin<strong>le</strong>s défilés d’offran<strong>de</strong>s gravés ou peints sur<strong>le</strong>s murs <strong>de</strong>s tombes), en regardant plusattentivement, on remarque que <strong>le</strong>sproportions ne sont pas respectées, <strong>le</strong> corps<strong>du</strong> bouquetin est trop long, la patte arrière<strong>du</strong> chat est ratée et la queue inexistante, <strong>le</strong>lion est tassé et étiré en longueur. Cetteardoise d’écolier antique a conservé <strong>le</strong>shésitations d’un apprenti <strong>de</strong>ssinateur.16
Bas-relief : artisans au travailCalcaire. H. 38 ; l. 94 cm.Basse Époque, 26edyn., 664-525 av. J.-C. Saqqara.Florence, Museo Egizio, 2606 – cat. 1589.Réputé provenir d’une tombe d’époque saïte <strong>de</strong> larégion memphite, ce bas-relief montre sur <strong>de</strong>uxregistres une scène particulièrement rare et vivantedans laquel<strong>le</strong> on i<strong>de</strong>ntifie cinq catégories d’artisansau travail. Cette scène se lit <strong>de</strong> haut en bas et <strong>de</strong>gauche à droite, si l’on suit l’orientation indiquée par<strong>le</strong>s légen<strong>de</strong>s hiéroglyphiques situées au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>chaque groupe d’artisans.El<strong>le</strong> se lit dans la continuité, chaque personnagemontrant très précisément son rô<strong>le</strong> dans l’activitéconcernée. Au registre supérieur : <strong>de</strong>ux « scribes <strong>de</strong>scontours », tenant pa<strong>le</strong>tte et pinceau, assis sur <strong>de</strong>stabourets cubiques, tracent <strong>de</strong>s décors sur <strong>de</strong>s objets.À gauche, <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateur décore un pied d’autel, sansdoute en pierre ou en terre cuite, tandis que soncollègue <strong>de</strong> droite s’affaire à orner ou à porter <strong>de</strong>sinscriptions sur <strong>le</strong> pilier dorsal d’une statue assise. Lascène qui occupe <strong>le</strong> reste <strong>de</strong> ce registre montre unatelier <strong>de</strong> « forgerons » (remarquer <strong>le</strong> premierpersonnage représenté <strong>de</strong> face), <strong>le</strong> tout exprimant uneactivité intense où chacun s’affaire sans répit à sapropre tâche.Au registre inférieur : <strong>le</strong> premier groupe à gauche estcelui <strong>de</strong>s « porteurs <strong>de</strong> ciseau », autrement dit <strong>le</strong>ssculpteurs. Assis sur <strong>de</strong>s tabourets tripo<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>uxd’entre eux fabriquent <strong>de</strong>s vases, tandis que <strong>le</strong>urcollègue scie <strong>du</strong> bois. Au centre, trois artisansspécialistes <strong>du</strong> cuir sont légendés comme <strong>de</strong>s «cordonniers ». Le <strong>de</strong>rnier d’entre eux coud unesanda<strong>le</strong> en tirant <strong>le</strong> fil avec ses <strong>de</strong>nts. Enfin, <strong>le</strong><strong>de</strong>rnier groupe montre un charron assis <strong>de</strong>vant unchar qui semb<strong>le</strong> terminé. Ironie <strong>de</strong> la scène : unhomme, épuisé par ces <strong>du</strong>rs travaux, s’est caché<strong>de</strong>rrière <strong>le</strong> char pour dormir. Cette succession <strong>de</strong>scènes artisana<strong>le</strong>s n’implique pas qu’el<strong>le</strong>s sedéroulaient dans un espace commun. Il s’agit plutôt<strong>de</strong> la somme <strong>de</strong>s ateliers d’artisans au service ou auxordres <strong>du</strong> propriétaire <strong>du</strong> tombeau, malheureusementinconnu. Retenons <strong>de</strong> la <strong>le</strong>cture <strong>de</strong> ce bas-relief que<strong>le</strong>s « scribes <strong>de</strong>s contours » sont ici considéréscomme <strong>de</strong>s artisans, au même titre que <strong>de</strong>ssculpteurs, <strong>de</strong>s forgerons ou <strong>de</strong>s cordonniers, donnantainsi matière à réfléchir sur <strong>le</strong> statut social <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ssinateurs.La statuette Turin, cat. 526 est sans doute <strong>le</strong> plusspectaculaire <strong>de</strong>s documents qui font connaîtrePrêhotep, frère aîné <strong>de</strong> Nebrê.Comme lui, il est « scribe <strong>de</strong>s contours », ainsi que ses<strong>de</strong>ux fils Pay et Ipou(y), cités sur <strong>le</strong> soc<strong>le</strong> <strong>de</strong> cettestatuette. Bien que frère aîné <strong>de</strong> Nebrê, Prêhotep alaissé moins <strong>de</strong> monuments et d’effigies que son ca<strong>de</strong>t.Sa maison a pu être i<strong>de</strong>ntifiée dans <strong>le</strong> secteur sud-ouest<strong>du</strong> village, un montant <strong>de</strong> porte inscrit à son nom ayantété trouvé dans l’embrasure <strong>de</strong> l’entrée <strong>de</strong> l’une d’el<strong>le</strong>s.Prêhotep apparaît volontiers auprès <strong>de</strong> collèguessculpteurs, en particulier auprès <strong>du</strong> sculpteur Qen,célèbre pour <strong>le</strong>s peintures rares <strong>de</strong> sa tombe (TT 4). Delà à imaginer que Prêhotep a participé à la mise encou<strong>le</strong>urs <strong>de</strong> cette chapel<strong>le</strong>… Conscient d’appartenir àune lignée puissante <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs à Deir el-Médina,Prêhotep a donné <strong>le</strong> nom <strong>de</strong> son père, Pay, à un <strong>de</strong> sesfils, qui eut comme fils <strong>le</strong> <strong>de</strong>rnier « scribe <strong>de</strong>s contours» <strong>de</strong> la dynastie, Amenemopé. La statuette méritequelques commentaires : là encore, on a affaire à uneeffigie zoomorphe d’une divinité domestique, la déesseTouéris. Se présentant sous la forme d’un hippopotamefemel<strong>le</strong> dressé <strong>de</strong>bout sur ses pattes arrière, doté <strong>de</strong>mains humaines, la tête coiffée d’une perruque tripartitequi se termine dans <strong>le</strong> dos par une queue <strong>de</strong> crocodi<strong>le</strong>,la gueu<strong>le</strong> entrouverte, ses mamel<strong>le</strong>s pendant sur sonventre gravi<strong>de</strong>, Touéris, dont il est plus juste <strong>de</strong> tra<strong>du</strong>ireson nom égyptien « Ta-ouret » par « la grosse » plutôtque par « la gran<strong>de</strong> », est connue pour protéger <strong>le</strong>sfemmes en couches et écarter <strong>le</strong>s puissances maléfiquesà sa seu<strong>le</strong> vue d’animal terrifiant. L’équipe <strong>de</strong> la Tomberoya<strong>le</strong> sous <strong>le</strong>s Ramsès lui vouait un culte fervent. C’està ce titre que <strong>le</strong>s <strong>de</strong>uxième et troisième générations <strong>de</strong> «scribes <strong>de</strong>s contours » <strong>de</strong> la famil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Pay se sontillustrées sur cette exceptionnel<strong>le</strong> statuette en boispolychrome. Au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la 19edynastie, vers 1190 avant notre ère, on perd la trace <strong>de</strong>cette gran<strong>de</strong> famil<strong>le</strong>.17
Ostracon figuré biface : cartouches <strong>du</strong> roi Amenhotep I erCalcaire, encres rouge et noire. H. 14 ; l. 14,5 cm.Nouvel Empire, 19 e -20 e dyn., 1295-1069 av. J.-C., Deirel-Médina.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14116.Stè<strong>le</strong> funéraire <strong>de</strong> Tachémès en prière <strong>de</strong>vantRê-HorakhtyBois stuqué et peint. H. 25,1 ; l. 18,2 ; ép. 2,2 cm.Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire, 22 e dyn., 945-715/713 av. J.-C., Thèbes (?). Paris, musée <strong>du</strong><strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, N3794.La stè<strong>le</strong> offre <strong>de</strong>s similitu<strong>de</strong>s avec un petit groupe<strong>de</strong> stè<strong>le</strong>s en bois datées <strong>de</strong> la 22 e dynastie etprovenant <strong>de</strong> la nécropo<strong>le</strong> thébaine. Le schéma esttoujours <strong>le</strong> même : un défunt ou une défuntereprésenté(e) en prière et faisant <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s audieu Rê-Horakhty, « Horus <strong>de</strong>s Deux Horizons »,dieu qui incarne la mort et la renaissance solaireperpétuel<strong>le</strong>. Un texte hiéroglyphique complète lascène : « au grand dieu, seigneur <strong>du</strong> ciel Rê-Horakhty » pour qu’il accor<strong>de</strong> « <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>snombreuses <strong>de</strong> toutes bonnes choses, pain, bière,vian<strong>de</strong>, tissus » à l’Osiris (la défunte) Tachémès. ÀThèbes, ce type <strong>de</strong> stè<strong>le</strong> émane généra<strong>le</strong>ment <strong>du</strong>milieu sacerdotal lié au service <strong>du</strong> dieu Amon ;avec <strong>le</strong> cercueil, il constitue souvent <strong>le</strong> seulmobilier <strong>de</strong>s tombes excavées dans la montagne. Si<strong>le</strong>s compositions sont assez répétitives d’une stè<strong>le</strong>à l’autre, la variation <strong>de</strong>s cou<strong>le</strong>urs et <strong>de</strong>s motifsdécoratifs – sur <strong>le</strong> trône ou <strong>le</strong> vêtement <strong>du</strong> dieu –montre la liberté laissée à chaque artiste (ou àchaque commanditaire ?). Ici, <strong>le</strong>s cou<strong>le</strong>urs auxtonalités douces dominent la pa<strong>le</strong>tte, tel <strong>le</strong> vertaman<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ai<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’Horus Béhedéty – disque ailéfiguré dans <strong>le</strong> cintre <strong>de</strong> la stè<strong>le</strong>. Le trône <strong>du</strong> dieu estposé sur un soc<strong>le</strong> peint en rose et vert, tacheté etponctué <strong>de</strong> lignes pour imiter la roche, sans douteen référence à la montagne thébaine comme inciteà <strong>le</strong> penser sa présence sur d’autres stè<strong>le</strong>s <strong>de</strong> mêmeprovenance. La défunte a <strong>de</strong>s formes généreuses.Le <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> ses cuisses très ron<strong>de</strong>s et <strong>le</strong> nombrilsouligné d’un pli <strong>de</strong> chair évoquent même <strong>le</strong>scanons <strong>de</strong> l’époque amarnienne (18 e dynastie) dont<strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateur a pu s’inspirer. D’autres stè<strong>le</strong>s <strong>de</strong>même époque et <strong>de</strong> même origine font unLa sphère roya<strong>le</strong> est un creuset d’inspiration sans finpour <strong>le</strong>s scribes égyptiens. Des mises en scènehéroïques aux caricatures en passant par <strong>le</strong>s portraits oula simp<strong>le</strong> illustration <strong>de</strong> regalia <strong>le</strong>s sujets ne manquentpas sur <strong>le</strong>s ostraca figurés. La particularité <strong>de</strong> cetexemplaire rési<strong>de</strong> non pas dans son contenu mais dansla manière dont il est traité : recto et verso portent eneffet la même représentation, visib<strong>le</strong>ment exécutée par<strong>de</strong>ux mains différentes.Au recto, <strong>le</strong>s noms <strong>de</strong> couronnement et <strong>de</strong> naissanced’Amenhotep I er sont inscrits dans <strong>de</strong>ux cartouchesaffrontés, couronnés <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux hautes plumes encadrantun disque solaire. Chacun repose sur un signe <strong>de</strong> l’orétabli sur une ligne <strong>de</strong> sol. Le trait est sûr, lacomposition calibrée, on a affaire à un <strong>de</strong>ssinateurexpérimenté.Au verso, <strong>le</strong>s éléments sont <strong>le</strong>s mêmes mais <strong>le</strong> sty<strong>le</strong>change : tracé hésitant, proportions hasar<strong>de</strong>uses,cartouches chancelants, tout se passe comme si on était<strong>de</strong>vant la copie d’un élève que l’on aurait chargé <strong>de</strong>repro<strong>du</strong>ire, <strong>de</strong> mémoire, <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> <strong>du</strong> recto.Le copiste malhabi<strong>le</strong> aurait commencé son <strong>de</strong>voir àl’encre rouge, puis repris quelques traits à l’encre noire,notamment sur <strong>le</strong> cartouche <strong>de</strong> gauche, mais auraitoublié l’essentiel : en inversant l’orientation <strong>du</strong> nom <strong>de</strong>naissance dans <strong>le</strong> cartouche <strong>de</strong> droite, il en fait <strong>le</strong>premier à <strong>de</strong>voir être lu, allant à l’encontre <strong>de</strong>s règ<strong>le</strong>s<strong>du</strong> protoco<strong>le</strong> royal égyptien.18
Papyrus dit « papyrus érotico-satirique » <strong>de</strong> Turin et sa copiea. Papyrus dit « papyrus érotico-satirique » <strong>de</strong> Turin.Actuel<strong>le</strong>ment en <strong>de</strong>ux morceaux encadrés séparément.Partie satirique : H. 21 ; l. 88 cm.Partie érotique : H. 22 ; l. 173 cm.Nouvel Empire, 19 e -20 e dyn., 1295-1069 av. J.-C. Deir el-Médina.Turin, Museo Egizio, cat. 55001.b. Copie <strong>du</strong> « papyrus érotico-satirique » <strong>de</strong> Turin. Papier vélin (filigrane coquil<strong>le</strong>),H. 21 (surface décorée) ; l. 283,5 cm.Deuxième quart <strong>du</strong> XIX e sièc<strong>le</strong> Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, E 11656.Un long commentaire <strong>de</strong> ce papyrus fameux <strong>de</strong> Pascal Vernus est donné dans <strong>le</strong> catalogue p. 108-117, sous <strong>le</strong>titre évocateur : « Le papyrus <strong>de</strong> Turin et la pornographie dans l’Égypte ancienne ».Sa copie, <strong>de</strong>ssinée au graphite et coloriée à la gouache, a été réalisée sur six feuil<strong>le</strong>s <strong>de</strong> papier vélin réuniespar <strong>de</strong>s joints. El<strong>le</strong> est infiniment précieuse pour <strong>le</strong>s savants qui étudient l’original. Achetée en janvier 1923par <strong>le</strong> département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes à l’arrière-petit-fils <strong>de</strong> Champollion-Figeac, frère aîné <strong>de</strong> Jean-François Champollion, el<strong>le</strong> est entrée dans cette famil<strong>le</strong> à une date inconnue. Portant un numéro (169) en basà l’extrême droite, suivi d’une signature commençant par un F ou un I, cette copie est peut-être <strong>du</strong>e à IppolitoRosellini (1800-1843), qui en réalisa une autre, aujourd’hui conservée à Pise, et qui fut l’ami et <strong>le</strong> compagnon<strong>de</strong> voyage <strong>de</strong> Champollion.La confrontation <strong>de</strong> l’original et <strong>de</strong> sa copie <strong>du</strong> XIX e sièc<strong>le</strong> témoigne <strong>de</strong> la fragilité <strong>du</strong> support et <strong>de</strong> l’usurequi l’a considérab<strong>le</strong>ment altéré, <strong>de</strong>puis son arrivée à Turin en 1825 avec la col<strong>le</strong>ction Drovetti. Cettecol<strong>le</strong>ction était riche d’un lot <strong>de</strong> papyri majeurs, tous issus <strong>de</strong> Deir el-Médina. Il est vraisemblab<strong>le</strong> que c’est àce site archéologique qu’il faut attribuer la provenance <strong>du</strong> « papyrus érotico-satirique », que l’on suggérerad’appe<strong>le</strong>r dorénavant « papyrus pornographique <strong>de</strong> Turin ».19
PublicationEn coédition avec Somogy.352 pages, relié, 24 x 30 cm,250 illustrations.EAN : 978‐2‐75720‐634‐8Distribution : UDParution : 17 avril 2013Le papier <strong>de</strong> ce catalogue est fabriqué parArjowiggins Graphic, et distribué parAntalis.SOMMAIREAvant-proposPréfaceIntro<strong>du</strong>ctionI – Les scribes/<strong>de</strong>ssinateursII – Le <strong>de</strong>ssin égyptien, apprentissageet modalités pratiques <strong>de</strong> l’art <strong>du</strong>contourL’art <strong>du</strong> contourLe <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte ancienneSous la direction <strong>de</strong> Guil<strong>le</strong>mette Andreu-Lanoë, égyptologuearchéologue française, conservateur général, directrice <strong>du</strong>département <strong>de</strong>s antiquités égyptiennes <strong>du</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>Nommés « scribes <strong>de</strong>s contours » par <strong>le</strong>s textes, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateursseront à l’honneur dans cette exposition qui tentera <strong>de</strong> <strong>le</strong>s situerdans la société égyptienne et d’en montrer <strong>de</strong>s réalisations, que ces<strong>de</strong>rnières soient <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s officiel<strong>le</strong>s ou <strong>de</strong>s oeuvresd’inspiration spontanée.Par « <strong>de</strong>ssin » en Égypte ancienne, s’enten<strong>de</strong>nt <strong>le</strong>s arts <strong>de</strong> surfaceou arts graphiques, à savoir <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin, la peinture et la gravure, paropposition aux arts <strong>du</strong> volume (l’architecture et la sculpture).Dessinateurs et peintres étant nommés <strong>le</strong>s « scribes <strong>de</strong>s contours » ;<strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin dans l’Égypte antique peut être considéré comme l’art <strong>du</strong>contour. Plus qu’au seul <strong>de</strong>ssin, l’exposition intro<strong>du</strong>ira <strong>le</strong> public àl’art égyptien bidimensionnel : ses conventions, ses techniques, sespratiques, ses fonctions et ses usages.Les Égyptiens accor<strong>de</strong>nt toujours une place prépondérante auxformes et aux figures, remplies ou non d’aplats <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>urs.Constatant cela, on ne peut s’empêcher <strong>de</strong> rapprocher cet art <strong>de</strong>sformes <strong>de</strong> l’écriture hiéroglyphique, composée <strong>de</strong> figuresjuxtaposées et interconnectées. En s’appuyant sur <strong>le</strong>s recherches <strong>le</strong>splus actuel<strong>le</strong>s, L’art <strong>du</strong> contour tentera <strong>de</strong> mettre en évi<strong>de</strong>nce <strong>le</strong>sliens et <strong>le</strong>s différences entre l’écriture et <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin égyptiens, entre<strong>le</strong>s hommes <strong>de</strong> <strong>le</strong>ttres et <strong>le</strong>s artistes. Le simp<strong>le</strong> fait que <strong>le</strong>sÉgyptiens utilisent <strong>le</strong> même terme pour « écrire » et « <strong>de</strong>ssiner », àsavoir <strong>le</strong> verbe sesh que l’on peut tra<strong>du</strong>ire plus généra<strong>le</strong>ment par« tracer », et donc que <strong>le</strong>s termes pour « scribe » et « <strong>de</strong>ssinateur »soient formés sur cette même racine, en dit long surl’interpénétration <strong>de</strong> l’écrit et <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin. Les œuvres et <strong>le</strong> discourstenteront sinon d’exposer, <strong>du</strong> moins <strong>de</strong> soumettre à l’étu<strong>de</strong> <strong>le</strong>niveau <strong>de</strong> qualification littéraire et artistique <strong>de</strong>s « scribes <strong>de</strong>scontours » selon <strong>le</strong>s époques et <strong>le</strong>s circonstances, et <strong>le</strong>ur place dansla société.Sachant qu’ils savaient incontestab<strong>le</strong>ment écrire, dans quel<strong>le</strong>mesure savaient-ils lire ? Étaient-ils <strong>le</strong>s seuls détenteurs <strong>du</strong> savoirfairepictural ? Quel était <strong>le</strong>ur part <strong>de</strong> responsabilité et d’inventivitédans la réalisation <strong>de</strong>s tab<strong>le</strong>aux religieux aux thèmes trèscanoniques, notamment vis-à-vis <strong>de</strong>s scribes que l’on imaginedépositaires <strong>de</strong> la mémoire écrite et sacrée ?20
Liste d’oeuvresCat. 1Bas-relief : Artisans au travail. En haut à gauche<strong>de</strong>ux <strong>de</strong>ssinateurs, tenant pa<strong>le</strong>tte et calame, décorent<strong>de</strong>s objets. Leurs collègues sont forgerons,sculpteurs, cordonniers, et charron. Il s’agit sansdoute <strong>de</strong>s divers ateliers d’artisans travaillant pour<strong>le</strong> propriétaire <strong>du</strong> tombeau, malheureusementinconnu.CalcaireBasse Époque, 26 e dynastie, 664-525 av. J.-C.SaqqaraFlorence, Museo Egizio, 2606 – cat. 1589Cat. 2Stè<strong>le</strong> <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur Maaninakhtef, ancêtre d’unedynastie <strong>de</strong> sept générations <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs à Deirel-Médina sous <strong>le</strong>s Ramsès, tenant sa pa<strong>le</strong>tte sousson bras et adorant Thot, patron <strong>de</strong> sa profession.CalcaireH. 26 ; l. 17 cmNouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès II,1279-1213 av. J.-C.Deir el-MédinaHanovre, Kestner Museum, ÄgyptischeAbteilung,2937Cat. 3Ostracon : Attestation <strong>de</strong> paiement par <strong>le</strong><strong>de</strong>ssinateur Hormin. pour son mobilier funéraireCalcaireNouvel Empire, 20 e dynastie, an 2 <strong>de</strong> Ramsès V ouVI, vers 1140 av J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 32942Cat. 4Ostracon : Célèbre texte littéraire dont la copie étaitun exercice pour Nebrê, <strong>de</strong>ssinateur, fils <strong>de</strong> PayCalcaireNouvel Empire, 19 e dynastie, an 25 à 32 <strong>de</strong> RamsèsII, 1254-1247 av J.-C.Deir el-MédinaTurin, Museo Egizio, S 9589 / CG N. 57431Cat. 5Lettre <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur Hormin à son père, <strong>le</strong> scribeHori, lui <strong>de</strong>mandant <strong>de</strong> faire remplacer son frèremala<strong>de</strong> pour finir <strong>le</strong> travail <strong>de</strong> décoration <strong>de</strong> latombe roya<strong>le</strong>PapyrusNouvel Empire, 20 e dynastie,1186-1069 av J.-C.Oxford, Ashmo<strong>le</strong>an Museum, AN 1958.112Cat.6Une dynastie <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs à Deir el MédinaNouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès II,1279-1213 av. J.-C. La famil<strong>le</strong> <strong>de</strong> Pay, <strong>de</strong>ssinateurdans la première moitié <strong>du</strong> règne <strong>de</strong> Ramsès II, estconnue sur quatre générations. Ostraca, graffiti,stè<strong>le</strong>s, tab<strong>le</strong>s d’offran<strong>de</strong>s, bassins, statues, vestigesarchitecturaux, ainsi que <strong>de</strong> nombreux décors <strong>de</strong>stombes in situ donnent vie et visages aux hommes <strong>de</strong>cette dynastie dont l’influence fut considérab<strong>le</strong>auprès <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong> Deir el-Médina, <strong>le</strong>splaçant sans aucun doute au cœur <strong>de</strong> son élite. Au<strong>de</strong>là<strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong> la 19 e dynastie, vers 1190avant notre ère, on perd la trace <strong>de</strong> cette gran<strong>de</strong>famil<strong>le</strong>.A : Stè<strong>le</strong> <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur Nebrê, fils <strong>de</strong> Pay, priant <strong>le</strong>dieu faucon HaroérisCalcaireLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 276B : Statuette <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur NebrêCalcaireLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 2292C : Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs Nebrê, Nakhtamon et KhâyCalcaireTurin, Museo Egizio, cat. 1591D : Stè<strong>le</strong> <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur Nakhtamon en prière <strong>de</strong>vantla déesse serpent Méresger-RénénoutetCalcaireParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 4194 (verso)E : Statuette <strong>de</strong> Touéris dédiée par <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateurPrêhotep et ses fils Pay et IpouBois peintTurin, Museo Egizio, cat. 526Cat. 7Livre <strong>de</strong>s morts par et pour Nebsény, <strong>de</strong>ssinateur etscribe-copiste, réalisé en <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong> contour et en noiret rouge.Papyrus, encres noire et rougeNouvel Empire, 18 e dynastie, règne <strong>de</strong> ThoutmosisIV, 1401-1391 av. J.-C.Provenance memphiteLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 9900.29 d21
Cat. 8Ostracon figuré, signé "Ipouy" : Accoup<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>renards.Calcaire.Nouvel Empire - 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14311.Cat. 9Fragment <strong>de</strong> paroi d’une tombe roya<strong>le</strong> :Les hiéroglyphes <strong>de</strong> ce texte, sculptés en relief <strong>le</strong>vé,ont gardé <strong>le</strong>ur polychromie. On peut observer <strong>le</strong>sdétails que la peinture permet d’ajouter à lasculpture, comme <strong>le</strong>s plis <strong>de</strong>s tissus ou <strong>le</strong> plumage<strong>de</strong>s oiseaux, mais aussi noter la constance aveclaquel<strong>le</strong> est <strong>de</strong>ssiné puis peint chaque signesimilaire.Calcaire, peintures noire, rouge, jaune, blanche etb<strong>le</strong>ue.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Rois.Avignon, musée Calvet, A 8.Cat. 10Coffret à serviteurs funéraires <strong>de</strong> Pa-ânkhes-imendont <strong>le</strong> nom, écrit à la fin <strong>du</strong> texte, a pour signedéterminatif l’image <strong>du</strong> défunt, à droite.Bois stuqué et peint.Troisième pério<strong>de</strong> intermédiaire, 21 e dynastie,1069-945 av. J.-C.Thèbes (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 2677.Cat. 11Coffret à serviteurs funéraires <strong>de</strong> Pypyia, dont <strong>le</strong>décor illustre la relation étroite <strong>de</strong> l’écriture et <strong>du</strong><strong>de</strong>ssin.Bois stuqué et peint.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 2643.Cat. 12Livre <strong>de</strong>s morts <strong>du</strong> scribe Mesemnétjer, rédigé enhiéroglyphes cursifs et en « rétrogra<strong>de</strong> », mise enforme qui consiste à écrire <strong>le</strong>s signes dans <strong>le</strong> sensnormal <strong>de</strong> <strong>le</strong>cture tout en inversant l’ordre <strong>de</strong>succession <strong>de</strong>s colonnes.Papyrus, encre noire et rouge, peinture noire, rouge,blanche et b<strong>le</strong>ue.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règnes d’Hatchepsoutet <strong>de</strong> Thoutmosis III, 1479-1425 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment Thèbes.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 21324 (5, verso).Cat. 13Ostracon figuré présentant sur ses <strong>de</strong>ux faces <strong>de</strong>sdécors indépendants (adoration au ba d’Amon-Rê etliste <strong>de</strong> mobilier funéraire), témoignant <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxutilisations et <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux mains différentes.Calcaire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment Deir el-Médina.Leipzig, Ägyptisches Museum, inv. 1657.Cat. 14Ostracon figuré : signes hiéroglyphiques détailléspar la main d’un maître.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14115.Cat. 15Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia, chef <strong>de</strong>s scribes-<strong>de</strong>ssinateursd’Amon.Diorite.Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Séthi I er ,1294-1279 av. J.-C.Peut-être Abydos.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, C 50.Ce monument comporte, au recto, la représentationen haut relief d’Osiris, Horus et Isis, la tria<strong>de</strong> <strong>de</strong> lavil<strong>le</strong> d’Abydos, tandis que <strong>le</strong> registre inférieurmontre <strong>le</strong> « chef <strong>de</strong>s scribes-<strong>de</strong>ssinateurs d’AmonDédia et son épouse « la maîtresse <strong>de</strong> maison etchanteuse d’Amon Iouy » <strong>le</strong>ur présentant <strong>de</strong>soffran<strong>de</strong>s.Le revers, gravé dans <strong>le</strong> creux, donne à lire <strong>le</strong>s titreset noms <strong>de</strong>s ancêtres <strong>de</strong> Dédia. On y découvre unedynastie <strong>de</strong> scribes-<strong>de</strong>ssinateurs d’Amon sur sixgénérations, dont la première remonte au règne <strong>de</strong>Thoutmosis III (1479-1425 av. J.-C.). Leurappartenance aux ateliers d’Amon confirme que <strong>le</strong>stemp<strong>le</strong>s entretenaient <strong>de</strong>s équipes d’artisansspécialisés.Cat. 16Pa<strong>le</strong>tte <strong>de</strong> peintre <strong>de</strong> Dédia munie d’une encoche,contenant quatre roseaux, et sept cupu<strong>le</strong>s.Bois et Roseau.Nouvel Empire, 19e dynastie, règne <strong>de</strong> Séthi I er ,1294-1279 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 2274.22
Cat. 18Broyeur.Porphyre rouge.Époque romaine, 30 av. J.-C. - 395 ap. J.-C. Esna.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3032.Cat. 19Go<strong>de</strong>t <strong>de</strong> scribe en barre à cupu<strong>le</strong>sFaïence égyptienne (faïence siliceuse)Basse Époque, 26 e -30 e dynastie, 664-332 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3033.Cat. 20Pains <strong>de</strong> pigments b<strong>le</strong>u et vert.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1190 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14538 b, c.Cat. 21Pinceaux <strong>de</strong> formes et d’épaisseurs différentes, enfonction <strong>de</strong>s besoins <strong>du</strong> peintre.Fibres végéta<strong>le</strong>s.Nouvel Empire, 18 e -19 e dynastie, 1550-1186 av. J.-C.Deir el-MédinaTurin, Museo Egizio, S. 7653, S. 7655, S. 7659, S. 7661,S. 7662.Cat. 22Fragment <strong>de</strong> tenture (?) en cuir dont il subsiste un ang<strong>le</strong>décoré d’une scène érotique montrant une femmeharpiste, assise sous une treil<strong>le</strong> et un homme nu.Cuir <strong>de</strong> chèvreNouvel Empire, début <strong>de</strong> la 18 e dynastie, 1550-1458av. J.-C. Deir el-Bahari.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, Rogers Fund, 1931(31.3.98)Cat. 23Premiers <strong>de</strong>ssins sur <strong>de</strong>ux vases d’époqueprédynastique : Personnages masculins dansant (A)et motifs <strong>de</strong> spira<strong>le</strong>s et <strong>de</strong> lignes on<strong>du</strong>lées (B).A :Vase à décor figuratif <strong>du</strong> type White cross-linedTerre cuite rouge polie à décor blancÉpoque prédynastique, fin Nagada I - début NagadaII, vers 3700-3450 av. J.-C.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 3002B :Vase à décor géométrique <strong>du</strong> type DecoratedTerre cuite beige-brun à décor rougeÉpoque prédynastique, fin Nagada II, vers 3450-3300 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11423Cat. 24Jarre décorée <strong>de</strong> scènes dans <strong>le</strong>s marais.Terre cuite polychrome.H. 34,6 ; D. 15 cm.Nouvel Empire, fin <strong>de</strong> la 18 e dynastie, vers 1390-1295 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11265.Cat.25Plat décoré à la peinture noire sur sa face intérieure<strong>de</strong> l’image <strong>du</strong> dieu « Amon-Rê » comme <strong>le</strong> précisela légen<strong>de</strong> hiéroglyphique.Terre cuite.Fin <strong>du</strong> Nouvel Empire ou Troisième Pério<strong>de</strong>intermédiaire, vers 1150-750 av. J.-C.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 5141.Cat. 26 et 27Dessins sur <strong>de</strong>s étoffes <strong>de</strong> lin : Ban<strong>de</strong><strong>le</strong>tte <strong>de</strong> momieet vignette d’un Livre <strong>de</strong>s morts.26 :Toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> lin à texture fine, encres noire et rougeÉpoque ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 305927 :Toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> lin, pigments blanc, b<strong>le</strong>u, rouge, noir, liantÉpoque ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 4402Cat. 28Coupe en faïence ornée d’un bassin entouré <strong>de</strong>papyrus et <strong>de</strong> nénufars alternés, considérée commela version graphique <strong>de</strong>s bassins consacrés à ladéesse Hathor.Faïence siliceuse b<strong>le</strong>ue à décor noirNouvel Empire, 18 e dynastie, règnes d’Hachepsoutet <strong>de</strong> Thoutmosis III, 1479-1425 av. J.-C.Deir el-Médina, cimetière est, tombe <strong>de</strong> MadjaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14562Cat. 29Coupe décorée <strong>de</strong> trois poissons qui partagent lamême tête, élément central d’une compositionrayonnante.Faïence siliceuse b<strong>le</strong>ue à décor noir.Nouvel Empire, 18 e dynastie, 1550-1295 av. J.-C.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 4562.23
Cat. 30Figurine <strong>de</strong> femme parée et tatouée, sans doutesymbo<strong>le</strong> <strong>de</strong>s promesses <strong>de</strong> la religion hathoriqueassurant une sexualité fécon<strong>de</strong> et la survie dans l’au<strong>de</strong>là.Faïence siliceuse b<strong>le</strong>u vif, peinte en noir.<strong>Mo</strong>yen Empire, fin <strong>de</strong> la 11 e – début <strong>de</strong> la12 e dynastie, vers 2000-1850 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 10942.Cat. 31Amphore miniature décorée <strong>de</strong> motifs floraux.Faïence siliceuse blanche mate à décor b<strong>le</strong>u et noirNouvel Empire, fin <strong>de</strong> la 18 e dynastie, 1390-1290 av. J.-C.Sésébi (Soudan).Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, 64041.Cat. 32Serviteur funéraire et son sarcophage miniatureinscrits et décorés à l’encre noire.Faïence égyptienne.Nouvel Empire, 20 e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès III,1184-1153 av. J.-C. ThèbesLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 53892.Cat. 33Coffret à ouchebtis avec décor imitant un bois d’uneespèce luxueuse.Bois stuqué et peint.H. 36 ; L. 16 ; ép. 13 cm.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Thèbes ( ?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 2641.Cat.34Eléments <strong>de</strong> mobilier : <strong>dossier</strong> <strong>de</strong> chaise décoréd’une scène d’offran<strong>de</strong>s funéraires et d’élémentsvégétaux.Bois stuqué et peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3312.Cat. 35Stè<strong>le</strong> d’Apis dédicacée par DjedptahioufânkhLes centaines <strong>de</strong> stè<strong>le</strong>s <strong>du</strong> Sérapeum retrouvéesauprès <strong>du</strong> cimetière <strong>de</strong>s taureaux Apis sont engénéral en calcaire, support d’un décor <strong>de</strong>ssiné,peint ou gravé.Calcaire peintBasse Époque, 25 e -26 e dynastie (?), 780-525 av. J.-C.Memphis, Sérapeum <strong>de</strong> SaqqaraParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 10529Cat. 36Deux scènes <strong>de</strong> peintures d’une tombe<strong>Mo</strong>una en<strong>du</strong>ite et peinte.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règnes <strong>de</strong> Thoutmosis IV,1401-1391 av. J.-C., et d’Amenhotep III, 1391-1353 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine, Dra Abou el-Naga, tombe <strong>de</strong>Nebamon.A : Scène <strong>de</strong> culte <strong>de</strong>vant <strong>le</strong> naos <strong>de</strong> RénénoutetBerlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 18532.B : Scène <strong>de</strong> banquetAvignon, musée Calvet, A 51.La nécropo<strong>le</strong> thébaine abrite près <strong>de</strong> cinq centstombes dont <strong>le</strong>s parois sont souvent recouvertes <strong>de</strong>mouna, mélange <strong>de</strong> limon <strong>du</strong> Nil et <strong>de</strong> végétaux quiétait appliqué en une couche que l’on recouvraitensuite d’une préparation blanche. L’artiste pouvaitalors tracer son <strong>de</strong>ssin et peindre l’intérieur <strong>de</strong>scontours, donnant vie et forme à <strong>de</strong>s peintureséclatantes.Cat. 37Deux ostraca figurés : exercices <strong>de</strong> têtes humaines,d’une oreil<strong>le</strong>, d’un cobra et d’une tête <strong>de</strong> fauconNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaA : Ostracon biface : Têtes humaines, oreil<strong>le</strong>,uræus (?), tête <strong>de</strong> faucon et chien couchéStockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14139.B : Profils d’hommeStockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14020.Cat. 38Ostracon figuré biface : noms <strong>de</strong> couronnement et <strong>de</strong>naissance (cartouches) <strong>du</strong> roi Amenhotep Ier écritsd’un côté par un maître et <strong>de</strong> l’autre par un élèvemalhabi<strong>le</strong> qui écrit <strong>de</strong> mémoire <strong>le</strong> modè<strong>le</strong> <strong>du</strong> recto.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14116.Cat. 39Ostracon figuré : adaptation <strong>du</strong> décor d’une paroi <strong>de</strong>la tombe d’Inherkhâouy (TT 359) qui montraitAmenhotep fils <strong>de</strong> Hapou pour représenter un scribenommé Houy. Ce genre <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin inspiré par unmodè<strong>le</strong> sans être fidè<strong>le</strong> ni satirique est très rare.Calcaire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, an 29 à 32 <strong>de</strong> RamsèsIII, 1157-1153 av. J.-C.. Deir el-Médina.Berlin, ÄgyptischesMuseum und Papyrussammlung,ÄM 2144724
Cat. 40Ostracon figuré : Copie d’un bas-relief <strong>du</strong> temp<strong>le</strong> <strong>de</strong>Deir el-Bahari représentant la reine <strong>de</strong> Pount,figurée sans in<strong>du</strong>lgence.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21442.Cat. 41Plaque avec représentations : attelage d’un charcon<strong>du</strong>it par un homme <strong>de</strong>bout inscrit dans une gril<strong>le</strong><strong>de</strong> proportions tracée en rouge.Calcaire, encres rouge, peinture rouge et noireFin <strong>de</strong> la Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire-fin <strong>de</strong> laBasse Époque, VIII e -IV e sièc<strong>le</strong> av. J.-C.Provenance inconnue.Hanovre, Kestner Museum, ÄgyptischeAbteilung,2952.Cat. 42Ostracon figuré biface : <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong> brouillonsd’animaux et d’une épithète divine.Calcaire, encre noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14096.Cat. 43Ostracon figuré : Cinq espèces différentesd’oiseaux.Calcaire, encres rouge et noire, peinture rouge, noireet jaune.Nouvel Empire, 19e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21770.Cat. 44Ostracon figuré biface : animaux et trône, <strong>de</strong>uxmotifs sans rapport.Calcaire, encres rouge et noire, peintures rouge etnoire.Nouvel Empire, 19e-20e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Thèbes (?)Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 26706.Cat. 45Fragment <strong>de</strong> papyrus : animaux disposés dans unquadrillage (fragment <strong>de</strong> carnet <strong>de</strong> modè<strong>le</strong>s ?)Papyrus, encre rouge et noireNouvel Empire, 1550-1069 av. J.-C.Provenance inconnueTurin, Museo Egizio, cat. 2036Cat. 46Ostracon figuré : <strong>de</strong>ux esquisses : un babouin assiset une tête <strong>de</strong> reine.Calcaire, encre noire.Nouvel Empire, 20e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Reines.Turin, Museo Egizio, S. 5692.Cat. 47Ostracon figuré : esquisse d’un prince en rougeCalcaire, encre rouge.Nouvel Empire, 20e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès III,1184-1153 av. J.-C.Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Reines.Turin, Museo Egizio, S. 5637.Cat. 48Ostracon figuré biface : esquisses.Calcaire, encres noire et rouge.Nouvel Empire, 18e-20e dynastie, 1550-1069 av. J.-C.Deir el-BahariLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 40969Cat. 49Ostracon figuré : procession <strong>de</strong> la barque d’Amon,<strong>de</strong>ssinée et esquissée en rouge à partir <strong>du</strong> bas <strong>de</strong>l’éclat -à la manière d’une ligne <strong>de</strong> sol- puiscorrigée en noir.Calcaire, encreNouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Séthi I er(1294-1279 av. J.-C.)Deir el-MédinaBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21446Cat. 50Ostracon figuré : procession <strong>du</strong> « féticheabydénien », emblème <strong>du</strong> dieu Osiris, <strong>de</strong>ssinéed’abord en rouge puis reprise en noir, d’un traitrapi<strong>de</strong> et schématique.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3958.Cat. 51Stè<strong>le</strong> inachevée dédiée à Amenhotep I er et AhmèsNéfertari, montrant un premier tracé en rouge, puiscorrigé en noir <strong>de</strong>stiné à gui<strong>de</strong>r <strong>le</strong> ciseau <strong>du</strong>sculpteur – qui n’est jamais intervenu – sans douteaprès que l’ang<strong>le</strong> gauche <strong>de</strong> la stè<strong>le</strong> eut été brisée.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès II,1279-1213 av. J.-C.. Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, C 315.25
Cat. 52Fragment <strong>de</strong> la tombe <strong>de</strong> Séthi I er en coursd’exécutionCalcaireNouvel Empire, début 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> SéthiI er , 1294-1279 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, AF 12757Cat. 53Ostracon figuré avec mise au carreau : composition<strong>de</strong> hiéroglyphesCalcaire, peintures rouge et noireNouvel Empire, 18 e dynastie, règnes d’Hatchepsoutet <strong>de</strong> Thoutmosis III, 1479-1425 av. J.-C.Deir el-BahariNew York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 23.3.4Cat. 54Plaque avec mise au carreau : chat, lion et bouquetinCalcaireBasse Époque, 26 e -30 e dynastie, 664-332 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11335Cat. 55Ostracon figuré : une colonneCalcaireNouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14315Cat. 56Fragments <strong>de</strong> papyrus : esquisses préparatoires pourun sphinx <strong>de</strong>ssiné <strong>de</strong> face et <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssus à l’intérieurd’une gril<strong>le</strong> <strong>de</strong> proportionPapyrusÉpoque ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.Provenance inconnueBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 11775Cat. 57Stè<strong>le</strong> inachevée <strong>du</strong> sculpteur OusirourCalcaire, sculpté dans <strong>le</strong> creux, encres rouge et noire<strong>Mo</strong>yen Empire, 12 e dynastie, 1963-1786 av. J.-C.Provenance inconnueLondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 579L’intérêt <strong>de</strong> cette stè<strong>le</strong> rési<strong>de</strong> dans la qualité <strong>de</strong>« sculpteur » <strong>de</strong> son propriétaire, ainsi que dansl’état d’inachèvement <strong>du</strong> monument, qui permetd’appréhen<strong>de</strong>r <strong>le</strong>s différentes étapes nécessaires à saréalisation.Plusieurs <strong>de</strong>grés dans <strong>le</strong> travail <strong>de</strong> sculpture peuventêtre discernés : <strong>le</strong> registre médian donne à voir <strong>le</strong>sdétails <strong>de</strong>s figures mo<strong>de</strong>lées, tandis qu’au registreinférieur <strong>le</strong>s figures sont à peine incisées : <strong>de</strong>uxfigures féminines sont « en cours » et <strong>le</strong>s <strong>de</strong>uxhommes fermant <strong>le</strong> cortège se limitent au contourpeint.Plusieurs mains se distinguent sur ce monument : lamain sûre <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur qui a tracé en noir <strong>le</strong>ssignes et <strong>le</strong>s figures, la main <strong>du</strong> graveur qui aensuite « découpé » <strong>le</strong>s signes et <strong>le</strong>s figures, enfin lamain <strong>du</strong> sculpteur qui a mo<strong>de</strong>lé <strong>le</strong>s détails ; il fautpeut-être y ajouter <strong>de</strong>ux mains différentes pour <strong>le</strong>ssignes hiéroglyphiques.Cat. 58Ostracon figuré : profil inachevé <strong>de</strong> la reineNéfertiti dont <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin préparatoire <strong>de</strong>vait gui<strong>de</strong>r <strong>le</strong>geste <strong>du</strong> sculpteur.Calcaire.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’AmenhotepIV-Akhénaton, 1353-1337 av. J.-C.Tell el-Amarna.Londres, Petrie Museum of Egyptian Archaeology,UC 011.Cat. 59Livre funéraire d’Imenemsaouf, dont <strong>le</strong>s vignettespolychromes et <strong>le</strong>s textes sont écrits, <strong>de</strong>ssinés etpeints avec un soin et une qualité remarquab<strong>le</strong>s.Papyrus polychrome.Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire, 21 e dynastie, 1069-945 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment région thébaine.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3292, feuil<strong>le</strong>t 2.Cat. 60Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> la reine Nédjemet, qui la montreà l’œuvre dans « <strong>le</strong>s champs d’Ialou ». Le <strong>de</strong>ssin estrustique mais <strong>le</strong>s cou<strong>le</strong>urs vives confèrent à cepapyrus une gran<strong>de</strong> beauté.Papyrus polychrome.Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire, 21 e dynastie, règned’Hérihor, 1080-1065 av. J.-C.Région thébaine.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 6258, feuil<strong>le</strong>t 3.Cat. 61Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> Kenna dont <strong>le</strong>s illustrations(vignettes et tab<strong>le</strong>aux) ont été <strong>de</strong>ssinées avantl’insertion <strong>de</strong>s textes, pour accompagner <strong>le</strong> défunt,dont la silhouette replète occupe la partie centra<strong>le</strong><strong>du</strong> feuil<strong>le</strong>t.PapyrusNouvel Empire, fin 18 e -19 e dynastie, 1336-1186 av. J.-C.Ley<strong>de</strong>, Rijksmuseum van Oudhe<strong>de</strong>n, SR-T226
Cat. 62Peinture mura<strong>le</strong> : scène <strong>de</strong> musique tracée et peinted’une main sûre.Calcaire peint.Nouvel Empire, milieu 18 e dynastie, 1427-1353 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine, Dra Abou el-Naga.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, D 60, N 3319.Cat. 63Peinture mura<strong>le</strong> : scène <strong>de</strong> navigation tracée et peinteavec <strong>de</strong>s jeux <strong>de</strong> dégradés, d’une main rapi<strong>de</strong> et libre,avec <strong>de</strong>s traits <strong>de</strong> pinceaux soup<strong>le</strong>s et sinueux.Stuc peint.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règnes <strong>de</strong> ThoutmosisIV et Amenhotep III, 1401-1353 av. J.-C. Nécropo<strong>le</strong>thébaine.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 2380.Cat. 64Plan <strong>de</strong> la tombe <strong>de</strong> Ramsès IV (r. 1153-1147 av. J.-C.)Papyrus.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Rois ou Deir el-Médina.Turin, Museo Egizio, cat. 1885.Lorsqu’il découvrit <strong>le</strong>s fragments <strong>de</strong> ce papyrus àTurin en 1824, <strong>de</strong>ux ans après son génialdéchiffrement <strong>de</strong>s hiéroglyphes, Jean-FrançoisChampollion écrivit à son frère son ravissement<strong>de</strong>vant « une <strong>de</strong>s pièces <strong>le</strong>s plus curieuses que l’onpuisse voir ». Sa sagacité l’avait effectivement con<strong>du</strong>ità y reconnaître <strong>le</strong> « plan d’une « catacombe roya<strong>le</strong> »,i<strong>de</strong>ntifiée <strong>de</strong>puis plus d’un sièc<strong>le</strong> par <strong>le</strong>s égyptologuescomme la tombe <strong>de</strong> Ramsès IV dans la Vallée <strong>de</strong>sRois. Ce papyrus, dont il manque malheureusement <strong>le</strong>début (<strong>le</strong> document se lit <strong>de</strong> droite à gauche) et lapartie inférieure, est un exemp<strong>le</strong> parfait <strong>de</strong> plusieursthèmes déclinés autour <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin. S’y conjuguent lanotion <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssin préparatoire à un travail ou à unecomman<strong>de</strong> architectura<strong>le</strong> et l’emploi par <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssinateur<strong>de</strong>s différents points <strong>de</strong> vue pour figurer chaque partie<strong>de</strong> la tombe en cours <strong>de</strong> construction, afin d’en noter<strong>le</strong>s éléments <strong>le</strong>s plus marquants et nécessaires à sonaménagement.Le plan conservé présente l’hypogée <strong>de</strong>puis <strong>le</strong> secondcouloir jusqu’à la <strong>de</strong>rnière sal<strong>le</strong> <strong>du</strong> fond. Le contour<strong>de</strong>s sal<strong>le</strong>s est tracé d’un doub<strong>le</strong> trait noir tandis que <strong>le</strong>sportes sont figurées « rabattues ». Les on<strong>du</strong>lations <strong>de</strong>la Vallée <strong>de</strong>s Rois entourent ce plan, tel un ruban rosepiqueté <strong>de</strong> grains rouges, signe conventionnel <strong>du</strong> sab<strong>le</strong>désertique.Il s’agit d’un plan donnant <strong>de</strong>s indications <strong>de</strong>stinées àl’équipe qui travail<strong>le</strong> au creusement et à la décoration<strong>de</strong> la tombe. Chaque sal<strong>le</strong> est légendée <strong>de</strong> courts textesindiquant <strong>le</strong>s mesures en coudées (équiva<strong>le</strong>nt à52 centimètres), précisant longueur, largeur et hauteur.La nature et la technique <strong>du</strong> décor (bas-relief sculptépuis peint) prévu dans <strong>le</strong>s sal<strong>le</strong>s sont éga<strong>le</strong>ment mentionnées; mais la mort prématurée <strong>du</strong> pharaon empêchal’équipe <strong>de</strong> réaliser tous ces projets. La sal<strong>le</strong> carrée<strong>du</strong> centre est cel<strong>le</strong> <strong>du</strong> sarcophage, dont on voit <strong>le</strong> couverc<strong>le</strong>en plan. Affectant la forme d’un cartoucheroyal, ce sarcophage est peint d’une manière imitant <strong>le</strong>granite rose. Tout est prévu pour la <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>meure<strong>du</strong> roi, que l’on voit sur <strong>le</strong> couverc<strong>le</strong>, flanqué <strong>de</strong>sdéesses Isis et Nephtys.Cat. 65Ostracon figuré : croquis d’une faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> temp<strong>le</strong>précisant ses éléments : escalier, porte, pylônes etcolonnes.Céramique, encre noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie,1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 21464.Cat. 66Ostracon figuré : plan <strong>de</strong> temp<strong>le</strong> avec son enceinte,une chapel<strong>le</strong> et <strong>de</strong>s indications <strong>de</strong> mesures.Céramique, encre noire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Bahari, temp<strong>le</strong> funéraire <strong>de</strong> <strong>Mo</strong>ntouhotep IILondres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 41228.Cat. 67Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> Néferoubenef illustré <strong>de</strong> vignettes<strong>de</strong>ssinées en multipliant <strong>le</strong>s points <strong>de</strong> vue : canaux vusd’en haut, « rabattus », représentations <strong>du</strong> défunt <strong>de</strong> manièreconventionnel<strong>le</strong>, tandis que <strong>le</strong>s personnages quiten<strong>de</strong>nt <strong>le</strong>s bras vers l’avant sont figurés <strong>le</strong>s épau<strong>le</strong>s envrai profil.Papyrus.Nouvel Empire, 18 e dynastie, 1550-1295 av. J.-C. Nécropo<strong>le</strong>thébaine.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3092.Cat. 68Tab<strong>le</strong>tte portant exercices et esquisses : pharaon assis<strong>de</strong>ssiné en noir sur un carroyage rouge avec son nomdans <strong>de</strong>s cartouches (Thoutmosis III), hiéroglyphes :poussin <strong>de</strong> cail<strong>le</strong> et sept bras.Bois stuqué (gesso). Nouvel Empire, 18 e dynastie,1550-1295 av. J.-C. Londres, British Museum, Departmentof Ancient Egypt and Sudan, EA 56.Cat. 69Tesson <strong>de</strong> vase prédynastique : un homme (tête etjambes <strong>de</strong> profil,torse <strong>de</strong> face)et une femme (<strong>de</strong>face) <strong>de</strong>bout, main dans la main.Terre cuite.Époque prédynastique, Nagada II, 3500-3100 av. J.-C. Gebel el-Silsila.Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationa<strong>le</strong>,77719. E.01.27
Cat. 70Ostracon figuré : portrait <strong>de</strong> Senenmout, grandintendant <strong>de</strong> la reine Hatchepsout, <strong>de</strong>ssiné en noirsur un quadrillage en rouge.Calcaire.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règnes d’Hatchepsoutet <strong>de</strong> Touthmosis III, 1479-1425 av. J.-C. Thèbes.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 36.3.252Cat. 71Peinture mura<strong>le</strong> : jeune femme élégante, tenant unbouquet <strong>de</strong> lotus, représentée dans <strong>le</strong> respect <strong>de</strong>srèg<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’art, <strong>de</strong>s proportions et <strong>du</strong> symbolismechromatique.En<strong>du</strong>it sur mouna.Nouvel Empire, 18 e dynastie, 1550-1295 av. J.-C.Thèbes, nécropo<strong>le</strong> <strong>de</strong> Khôkha.Hanovre, Kestner Museum, ÄgyptischeAbteilung,1962-69.Cat. 72Stè<strong>le</strong> fragmentaire et inachevée <strong>de</strong> Mahou : scèned’adoration à Amon, <strong>Mo</strong>ut et Méresger tracéed’abord en rouge et corrigée en noir.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e dynastie,1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Turin, Museo Egizio, cat. 1580.Cat. 73Ostracon figuré : femme en adoration.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie,1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25339.Cat. 74Ostracon figuré : <strong>de</strong>ssin modè<strong>le</strong> d’un lion couchésur un naos.Calcaire, encres rouge et noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie,1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25338.Cat. 75Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> Nebsény, aux vignettes <strong>de</strong>ssinéesau trait, sans aucun aplat <strong>de</strong> cou<strong>le</strong>ur. La premièrevignette au milieu <strong>du</strong> registre médian montre unpersonnage en vrai profil, penché vers une éten<strong>du</strong>ed’eau symbolisée par <strong>de</strong>s zigzags et figurée en plan.Papyrus, encres noire et rouge.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne <strong>de</strong> TouthmosisIV, 1401-1391 av. J.-C. Saqqara.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 9900.4 b.Cat. 76Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> la Première Pério<strong>de</strong> intermédiaire au sty<strong>le</strong>caractéristique <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> : contours <strong>de</strong>l’œuvre irréguliers, mélange <strong>de</strong> techniques(sculpture en bas relief et peinture), traitement <strong>de</strong>scorps angu<strong>le</strong>ux et linéaire, gestes rai<strong>de</strong>s etschématiques, visages très simplifiés avec <strong>de</strong> grandsyeux, offran<strong>de</strong>s flottant au-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong> la tab<strong>le</strong>.Calcaire peint, vers 2050 av. J.-C.Première Pério<strong>de</strong> intermédiaire .Naga ed-Deir.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 8244.Cat. 77Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> la Deuxième Pério<strong>de</strong> intermédiaire au sty<strong>le</strong>caractéristique <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong> : contours <strong>de</strong> la stè<strong>le</strong>irréguliers, proportions disgracieuses, membresgraci<strong>le</strong>s, absence <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>lé, naïveté <strong>de</strong>s têtes <strong>de</strong>sanimaux aux grands yeux ronds, offran<strong>de</strong>s flottanteset désordonnées.Calcaire peint, vers 1750-1650 av. J.-C. (?)Deuxième Pério<strong>de</strong> intermédiaire.El-Rizeiqât.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 22708.Cat. 78Stè<strong>le</strong> <strong>du</strong> Sérapeum montrant un <strong>de</strong>ssin simplifié etschématique : personnage figuré comme un profilré<strong>du</strong>it à <strong>de</strong>ux parallè<strong>le</strong>s et hiéroglyphessommairement écrits.Calcaire peint.Basse Époque, 26 e dynastie, an 20 à 21 <strong>du</strong> règne <strong>de</strong>Psammétique I er , 644-643 av. J.-C.Memphis, Sérapeum <strong>de</strong> Saqqara.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, cat. 242.Cat. 79Ostracon figuré : gracieuse musicienne représentée<strong>de</strong> face.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 21445.Cat. 80Toi<strong>le</strong> peinte : linceul avec représentation <strong>de</strong> face <strong>de</strong>la dame Tayt.Lin.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 848.28
Cat. 81Fragment <strong>de</strong> cercueil : portrait funéraire montrant <strong>le</strong>défunt <strong>de</strong> face flanqué <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux dieux fauconsBois <strong>de</strong> figuier, toi<strong>le</strong> <strong>de</strong> lin, peinture à la détrempe,320-350 ap. J.-C.Époque romaine.Touna el-Gebel (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 22309.Cat. 82Si<strong>le</strong>x aux reliefs soulignés : femme enceinteSi<strong>le</strong>x, pigments, liant.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25329.Cat. 83Tesson <strong>de</strong> poterie bombé et retaillé, portant un<strong>de</strong>ssin très schématique d’une femme nue, dotée <strong>de</strong>grands yeux, d’un collier et d’un petit pubis.Terre cuite, encre noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 16511 A.Cat. 84Quand l’aspect d’un si<strong>le</strong>x inspire un <strong>de</strong>ssin :a : Éclat <strong>de</strong> si<strong>le</strong>x en forme <strong>de</strong> tête d’hippopotamecomplétée au trait.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 16283.b : Éclat <strong>de</strong> si<strong>le</strong>x en forme <strong>de</strong> serpent complété autrait.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14132.Cat. 85Ostracon : Poème prononcé par <strong>de</strong>s poissons dont<strong>le</strong>s images illustrent et donnent vie au texte.Calcaire.Date inconnue.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 26708.Cat. 86Amu<strong>le</strong>tte illustrée contre <strong>le</strong> démon Séhéqeq, percéed’un trou pour être suspen<strong>du</strong>e au cou.Calcaire.Date inconnue.Leipzig, Ägyptisches Museum, inv. 5251Cat. 87Ostracon : bon <strong>de</strong> comman<strong>de</strong> avec <strong>de</strong>ssin <strong>du</strong> type <strong>de</strong>fenêtre à claire-voie souhaité précisant <strong>le</strong>sdimensions requises.Terre cuite.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 23554.Cat. 88Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> Rê : adoration d’Hathor et <strong>de</strong>Mehet-Ouret <strong>de</strong>bout sur une terrasse <strong>de</strong> lamontagne, figurée tel<strong>le</strong> une déesse hippopotame surses pattes arrière, brandissant une flamme.Papyrus.Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Séthi I er (?),1294-1279 av. J.-C.Ley<strong>de</strong>, Rijksmuseum van Oudhe<strong>de</strong>n, AMS 15-T5.Cat. 89Coupe ornée d’une déesse hippopotame, au ventregonflé, aux mamel<strong>le</strong>s pendantes, dressée sur sespattes arrière, affublée dans <strong>le</strong> dos d’une queue <strong>de</strong>crocodi<strong>le</strong> stylisée. Cette déesse, souvent figurée,peut représenter Ipet, Touéris ou Mehet-Ouret,comme on la voit sur <strong>le</strong> Livre <strong>de</strong>s morts exposé àcôté.Faïence siliceuse b<strong>le</strong>ue.Nouvel Empire, 18 e dynastie, 1550-1295 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 32649.Cat. 90Vignette à l’encre noire <strong>du</strong> chapitre 81 <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong>smorts.Papyrus, encre noire.Provenance inconnue.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3727.Cat. 91Stè<strong>le</strong> funéraire <strong>de</strong> Tachémès en prière <strong>de</strong>vant Rê-Horakhty.Bois stuqué et peint.Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire, 22 e dynastie, 945-715 av. J.-C.Thèbes (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3794.Cat. 92Ostracon figuré : scène d’offran<strong>de</strong> au dieu AmonCalcaire, encres noire et rouge.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14008.29
Cat. 93 : Ostracon figuré : la déesse Astarté, déesse<strong>de</strong> la guerre importée <strong>du</strong> panthéon proche-oriental,représentée à cheval.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine.Berlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21826.Cat. 94Dessins <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux dieux canidés.a : Ostracon figuré : <strong>le</strong> dieu Oupouaout sur unpavois.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e - 20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Région thébaine.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14091.b : Pectoral figurant Anubis.Faïence.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 2744.Cat. 95Ostracon figuré : esquisses <strong>de</strong> babouins et d’untaureau.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14303.Cat. 96La déesse serpent Méresger, modè<strong>le</strong> et copie (?)A : Un modè<strong>le</strong> parfait.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina ( ?).Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 6573.B : Exercice <strong>de</strong> copie (?)Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina ( ?)Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 6763.A : Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Tarekhân en adoration <strong>de</strong>vant MéresgerCalcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 13084.B : Ostracon figuré : Pennoub en adoration <strong>de</strong>vantMéresger.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 8508.Cat. 98Ostracon votif offert à la déesse Ânouket, adorée àÉléphantine et à Deir el-Médina, représentée iciavec une paire <strong>de</strong> gazel<strong>le</strong>s, son animal sacré.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14011.Cat. 99Ostracon figuré : Saynète ayant pour sujet unequerel<strong>le</strong> entre un chat abrité sous un perséa et uneoie se tenant sur une tab<strong>le</strong> d’offran<strong>de</strong>s.Calcaire peint.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaineBerlin, ÄgyptischesMuseum und Papyrussammlung,ÄM 3317.Cat. 100Disque magique placé sous la tête d’une momie(hypocépha<strong>le</strong>).Étoffe stuquée.Époque ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.Thèbes (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N3525 A.Cat. 101Vase factice en bois imitant la calcite.Bois.Nouvel Empire ou Troisième Pério<strong>de</strong> intermédiaire,19 e -21 e dynastie, 1295-945 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine ( ?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 931 B, AF 210.Cat. 97Deux objets votifs dédiés à Méresger, protectrice <strong>de</strong>la communauté d’artisans et d’artistes à Deir el-Médina, sous sa forme <strong>de</strong> déesse serpent.30
Cat. 102Ostracon figuré : <strong>le</strong> dieu Bès, <strong>de</strong> face, muni d’unpaire d’ai<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> visage léonin, <strong>le</strong>s jambes fléchies,portant <strong>de</strong>s symbo<strong>le</strong>s <strong>de</strong> force et d’intégrité.Calcaire.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’AmenhotepIII, 1391-1353 av. J.-C.Provenance inconnue.Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14010.Cat. 103Assiette magique: représentation <strong>de</strong> la barque <strong>de</strong> RêTerre cuite peinte, vers 400-200 av. J.-C.Époque tardive.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 944.Cat. 104Paroi <strong>de</strong> tête <strong>du</strong> cercueil <strong>de</strong> Nakht : par <strong>le</strong>us vertuscréatrices, <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssins <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s figurées doiventaccompagner <strong>le</strong> défunt dans l’au-<strong>de</strong>là.Bois peint.<strong>Mo</strong>yen Empire, 12 e dynastie, 1963-1786 av. J.-C.Assiout (?)Hil<strong>de</strong>sheim, Roemer-und-Pelizaeus-Museum, 5999.Cat. 105Chapitre 110 <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong>s morts d’Iâhmès, illustrépar <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin <strong>de</strong>s « champs d’Ialou », lieu <strong>de</strong> séjourparadisiaque, rêvé par <strong>le</strong>s Égyptiens pour <strong>le</strong>ur au<strong>de</strong>là.Papyrus.Basse Époque , 664-332 av. J.-C., ou ÉpoquePtolémaïque, 332-30 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3086.Cat. 106Papyrus mythologique <strong>de</strong> Bakenmout, qui décrit unmon<strong>de</strong> peuplé <strong>de</strong> créatures effrayantes dont ladéfaite garantit au défunt une éternité sans dangerTroisième Pério<strong>de</strong> Intermédiaire, 21 e dynastie, 1069-945 av. J.-C.Thèbes.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3297.Cat. 107Ostracon figuré : pharaon terrassant un ennemiCalcaire et <strong>de</strong>ssin à l’encre noireNouvel Empire, 19 e - 20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Turin, Museo Egizio, S. 6279.Cat. 108Ostracon figuré : Séthi I er assis sur une chaise àporteur, représenté d’un trait élégant et sûr.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Séthi I er ,1294-1279 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum, und Papyrussammmlung,AM 21435.Cat. 109Ostracon figuré biface : d’un côté <strong>le</strong> profilreconnaissab<strong>le</strong> <strong>de</strong> Ramsès VI ; <strong>de</strong> l’autre <strong>de</strong>sesquisses pour une coiffure roya<strong>le</strong> et un uræus(cobra dressé, protecteur <strong>de</strong> la royauté).Calcaire peint.Nouvel Empire, époque ramessi<strong>de</strong>, 20 e dynastie,règne <strong>de</strong> Ramsès VI, 1143-1136 av. J.–C.Vallée <strong>de</strong>s Rois (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 498.Cat. 110Ostracon figuré : profil d’un roi <strong>de</strong>ssiné avec unsoin extrême. Une barbe naissante suggère lamarque <strong>du</strong> <strong>de</strong>uil.Calcaire peint.Nouvel Empire, époque ramessi<strong>de</strong>, 19 e dynastie,1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14318.Cat. 111Peinture mura<strong>le</strong> : Représentation d'Amenhotep Ierdivinisé. Son corps, hormis son pagne, est soulignéd'une ligne noire nette et régulière.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e /20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaine.Berlin, Ägyptisches Museum, und Papyrussammmlung,ÄM 18546.Cat. 112Ostracon figuré : roi fabriquant ou reprisant un fi<strong>le</strong>t(?)Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25310.Cat.113Ostracon figuré : portrait d’une reine.Calcaire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25325.31
Cat. 114Ostracon figuré : Irynefer assis <strong>de</strong>vant <strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s<strong>de</strong> pain.Calcaire, encre noire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 12965.Cat. 115Ostracon figuré biface : doub<strong>le</strong> portrait <strong>de</strong>Senenmout et rat (?). Ce doub<strong>le</strong> portrait <strong>de</strong>l’intendant <strong>de</strong> la reine Hatchepsout est peut-êtrel’œuvre d’un maître et <strong>de</strong> son apprentiCalcaireNouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’Hatchepsout,1479-1457 av. J.C.Deir el-Bahari.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 31.4.2.Cat. 116Stè<strong>le</strong> funéraire d'un personnage obèse représenté <strong>de</strong>façon naturaliste, en vrai profil, agenouillé au sol, <strong>le</strong>visage ten<strong>du</strong>, marqué par l’âge et la dou<strong>le</strong>ur. Cettestè<strong>le</strong> est signée par l’artiste Seneb.Calcaire.<strong>Mo</strong>yen Empire, 12 e dynastie, 1963-1786 av. J.-C.Abydos.Ley<strong>de</strong>, Rijksmuseum van Oudhe<strong>de</strong>n, AP 34H. 53 ; l. 25,5 ; ép. 9 cm.Cat117Boîte ornée d’une représentation <strong>de</strong> Ptah patèque,décrit par l’inscription comme étant « Ptah sedjem,<strong>le</strong> nain ».Bois peint.Basse Époque, 664-332 av. J.-C.Provenance inconnueLyon, musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts, G 305 (IE 677)Cat. 118Ostracon figuré : nain armé.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Assassif, à l’est <strong>de</strong> la tombe <strong>de</strong> Pabasa.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 19.3.19.Cat.119Ostracon figuré : un visage royal et <strong>de</strong>uxpersonnages <strong>de</strong>bout ; l’un d’eux est doté d’unphysique disgracieux.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Rois.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 14.6.1.Cat. 120Peinture mura<strong>le</strong> : charpentier au travailCalcaire en<strong>du</strong>it et peintNouvel Empire, 18 e dynastie, 1550-1295 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaineBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21731Cat. 121Ostracon figuré : personnage bossuCalcaire peintNouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaHanovre, Kestner Museum, Ägyptische Abteilung,2001.297Cat. 122Ostracon figuré : homme aux baluchonsTerre cuiteNouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Thèbes, nord <strong>du</strong> pylône <strong>du</strong> temp<strong>le</strong> jubilaire <strong>de</strong>Thoutmosis IVLondres, Petrie Museum of Egyptian Archaeology,UC 2227Cat. 123Ostracon figuré : femme jouant <strong>du</strong> doub<strong>le</strong> hautboisCalcaire peintNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25315Cat. 124Ostracon figuré : <strong>de</strong>ux enfants polissant une jarreCalcaire, encre noire, ocre rougeNouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-MédinaBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21444Cat. 125Ostracon figuré : un enfantCalcaire, encre rouge, ocre rougeNouvel Empire, 18 e -20 e dynastie, 1550-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25334.Cat. 126Fragment <strong>de</strong> peinture mura<strong>le</strong> : parure <strong>de</strong> tab<strong>le</strong> enforme <strong>de</strong> forteresse asiatique.Grès polychrome.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Berlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21140.32
Cat. 127Ostracon figuré : un LibyenCalcaire, encres noire et rougeNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21775Cat. 128Ostracon figuré : tête d’un homme <strong>du</strong> Proche-OrientTerre cuite, encre noireNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25308Cat. 129Ostracon figuré biface : d’un côté <strong>de</strong>ux étrangers, <strong>de</strong>l’autre ébauches d’une tête <strong>de</strong> taureau et <strong>de</strong> troisvisages humains.Calcaire, encre noireNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaStockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14021Cat. 130Ostracon figuré : ennemi ligotéCalcaire peintNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment Deir el-MédinaBruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 6374Cat. 131Ostracon figuré : étranger combattant un taureausauvageCalcaire, encres noire et rougeNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25305Cat. 132Ostracon figuré : un NubienCalcaire, encre noireNouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaTurin, Museo Egizio, S. 6295aCat. 133Vignette <strong>du</strong> chapitre 71 <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong>s <strong>Mo</strong>rts <strong>de</strong>Khonsoumès montrant <strong>le</strong> défunt adorant lamontagne thébaine, nécropo<strong>le</strong> désertiquecaractérisée par sa cou<strong>le</strong>ur, ocre rose pointillée <strong>de</strong>rouge.PapyrusTroisième Pério<strong>de</strong> Intermédiaire, 21 e dynastie, 1069-945 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3070Cat. 134Chapitre 110 <strong>du</strong> Livre <strong>de</strong>s <strong>Mo</strong>rts <strong>de</strong> Nesptah :image <strong>du</strong> paradis, verdoyant et ferti<strong>le</strong>, dont <strong>le</strong>sparcel<strong>le</strong>s sont irriguées par <strong>de</strong>s canaux, quidélimitent <strong>le</strong>s trois registres d'activités où <strong>de</strong>vravaquer <strong>le</strong> défunt.PapyrusÉpoque ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 3100Cat. 135Peinture mura<strong>le</strong> : chasse aux oiseaux dans <strong>le</strong>smarais : papyrus disposés en éventail et désordredans l'envol <strong>de</strong>s oiseaux dont becs et plumages sontren<strong>du</strong>s avec précision. Détails anecdotiques : <strong>le</strong>soisillons qui crient famine et la genette prête à vo<strong>le</strong>r<strong>le</strong>s œufs d'un nid.<strong>Mo</strong>una en<strong>du</strong>ite et peinteNouvel Empire, 18 e dynastie, Thoutmosis III-Amenhotep II, 1479-1425 av. J.-C.Nécropo<strong>le</strong> thébaineParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 13101Cat. 136Ostracon figuré : rive d’un cours d’eau avec palmierCalcaire, encre noireNouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaBerlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, ÄM 21460Cat. 137Vase à oreil<strong>le</strong>s avec décor nilotique peint à la fin <strong>du</strong>IVe millénaire : bateaux et gazel<strong>le</strong>s disposés <strong>le</strong>s unsau-<strong>de</strong>ssus <strong>de</strong>s autres pour marquer la profon<strong>de</strong>ur.Terre cuite peinteNagada II, 3500-3100 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 27128Cat. 138Ostracon figuré : singes grimpant dans un palmierdoumCalcaire peintNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14298Cat. 139Ostracon figuré : trois chèvres dégustant <strong>le</strong>s goussesd’un acaciaCalcaire peintNouvel Empire, 19 e /20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 1434633
Cat. 140Ostracon figuré : singe frappant un sac.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14338.Cat. 141Ostracon figuré : un cormoran, une chatte-lionne etun singe. Illustration d'un conte ou d'un mythe (?)Calcaire peint.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Berlin, Ägyptisches Museum, und Papyrussammmlung,ÄM 21443.Cat. 142Deux ostraca figurés : babouin passant (a) et singemangeant une figue (b)a) Calcaire peint.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règned’Amenhotep IV-Akhénaton, 1353-1337 av. J.-C.Tell el-AmarnaLondres, Petrie Museum of Egyptian Archaeology,UC 1585.b) Calcaire peintNouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Provenance inconnue.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 22881.Cat. 143Ostracon figuré : bouvier chargé par un taureauCalcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14367.Cat. 144Ostracon figuré : composition dynamique etdramatique représentant une hyène attaquée partrois chiens. La hyène striée est poursuivie par troislévriers. La gueu<strong>le</strong> ouverte, <strong>le</strong> poil hérissé parl'agressivité et la peur, el<strong>le</strong> est acculée et bientôtvaincue.Ce <strong>de</strong>ssin polychrome est parfaitement adapté à laforme <strong>de</strong> l'ostracon.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e /20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14366.Cat. 145Ostracon figuré : tête d’âne.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 64395.Cat. 146Ostracon figuré : coq.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Thèbes, Vallée <strong>de</strong>s Rois.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 68539.Cat. 147Ostracon figuré : oie couvant ses œufs.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 56706.Cat. 148Ostracon figuré : tête <strong>de</strong> chien.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14090.Cat. 149Scène <strong>de</strong> genre : chienne allaitant ses petits, réaliséeavec <strong>de</strong> nombreux détails soulignés d’un trait <strong>de</strong>pinceau.Calcaire sculpté et peint.<strong>Mo</strong>yen Empire (?), 2033-1710 av. J.-C.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11557.Cat. 150Ostracon figuré : cheval attelé à un char léger.Proportions mal maitrisées : <strong>le</strong> cheval paraît troppetit par rapport au char et son aurige.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Berlin, Ägyptisches Museum, und Papyrussammmlung,ÄM 23678.Cat. 151Ostracon figuré : poisson (tilapia <strong>du</strong> Nil)Calcaire.Nouvel Empire, 18 e -20 e dynastie, 1550-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 3312.34
Cat. 152Ostracon figuré : trois poissons convergeant enéventail.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Thèbes.Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 50718.Cat. 153Ostracon figuré : poisson tilapia aux traits humains.Facétie <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinateur ?Calcaire peint.Nouvel Empire, 19e-20e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Probab<strong>le</strong>ment Deir el-Médina ; achat à Louxor,1930.Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire,Col<strong>le</strong>ction égyptienne, E 6373.Cat. 154Ostracon figuré : sept poissons <strong>du</strong> Nil.Calcaire.Nouvel Empire, 19e-20e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14307.Cat. 155Fragment <strong>de</strong> paroi <strong>de</strong> tombe : chasse et pêche dans<strong>le</strong>s marécages. La ligne on<strong>du</strong>lée <strong>de</strong> l'eau est undétail exceptionnel et original.Calcaire peint sculpté en bas relief.<strong>Mo</strong>yen Empire, 12e dynastie, 1963-1786 av. J.-C.Qaou el-Kébir.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11247 A.Cat. 156Ostracon figuré biface : jeune fil<strong>le</strong> naviguant dans<strong>le</strong>s marais (a, recto) et lion (b, verso)Calcaire, encre noire.Nouvel Empire, 19-20e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25299.Cat. 157Carreau <strong>de</strong> revêtement : une vache et un veau dans<strong>le</strong>s marais.Faïence égyptienne.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règne d’AmenhotepIV-Akhénaton, 1353-1337 av. J.-C.Provenant probab<strong>le</strong>ment Tell el-Amarna.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 17357.Cat. 158Figurine d’hippopotame couvert <strong>de</strong> plantes <strong>de</strong>smarais.Faïence.Fin <strong>du</strong> <strong>Mo</strong>yen Empire, secon<strong>de</strong> moitié <strong>de</strong> la 13 edynastie, 1750-1650 av. J.-C.Thèbes, Dra Abou el-Naga, tombe <strong>de</strong> NéferhotepParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 7709.Cat. 159Stè<strong>le</strong> miniature représentant un hippopotameCalcaire peint.Nouvel Empire, 19e-20e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 20677.Cat. 160Ostracon figuré : hippopotame.Calcaire peint.Nouvel Empire, 18 e dynastie, règnes d’Hatchepsoutet <strong>de</strong> Thoutmosis III, 1479-1425 av. J.-C.Deir el-Bahari, secteur <strong>du</strong> temp<strong>le</strong> d’Hatchepsout.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 23.3.6.Cat. 161Ostracon figuré : scène <strong>de</strong> genre représentant unelutte avec <strong>de</strong>s bâtons.Calcaire, pigments noir et rouge, liantNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25340.Cat. 162Ostracon figuré : con<strong>du</strong>cteur <strong>de</strong> bétail.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 27671.Cat. 163Ostracon figuré : gardien <strong>de</strong> troupeau.Terre cuite peinte.Nouvel Empire, 18 e -20 e dynastie, 1550-1069 av. J.-C.Provenance inconnue.Cambridge, Fitzwilliam Museum, E.GA.106.1949.Cat. 164Ostracon figuré : tail<strong>le</strong>ur <strong>de</strong> pierre au travail.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e dynastie, 1295-1186 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Cambridge, Fitzwilliam Museum, E.GA.4324a.1943.35
Cat. 165Ostracon figuré : harpiste disgracieux et âgé.Calcaire peint.Basse Époque, 26 e dynastie, 664-525 av. J.-C.Deir el-Bahari, tombe <strong>de</strong> Nespaqachouty.New York, The Metropolitan Museum of Art,Department of Egyptian Art, 23.3.31.Cat. 167Deux ostraca figurés : compositions montrant unefemme assise sur un lit allaitant un enfant (a) et unefemme assise sur un lit tenant une coupe (b).a : Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14005.b : Calcaire peintNouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaBerlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 21461Cat. 168Ostracon figuré : scène d’allaitement.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25333.Cat. 169Ostracon figuré : scène <strong>de</strong> genre montrant une jeunefil<strong>le</strong> accroupie attisant <strong>le</strong> feu d’un four.Céramique, encre noire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, 1186-1069 av. J.-C. (?)Provenance inconnue (probab<strong>le</strong>ment Deir el-Médina).Leipzig, Ägyptisches Museum, inv. 1894.Cat. 170Ostracon figuré : jeune garçon <strong>de</strong>vant un porc.Calcaire, pigments noir et rouge, liant.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 17117.Cat. 171Ostracon figuré : singe musicien et jeune fil<strong>le</strong>.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina ; don R. Streitz, 1952.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25309.Cat. 172Ostracon figuré : un singe gourmand dégustant <strong>de</strong>sfigues.Calcaire, encres noire et rouge.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 8507.Cat. 173Ostracon figuré parodique : une hyène, <strong>de</strong>bout, joue<strong>du</strong> doub<strong>le</strong> hautbois pour faire danser unbouquetin. Situation mettant en scène <strong>le</strong> prédateur etson gibier.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e /20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-MédinaParis, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 14368.Cat. 174Ostracon figuré parodique : chat et souris. Scènemettant en situation <strong>de</strong>s animaux dans <strong>de</strong>s attitu<strong>de</strong>shumaines, tout en inversant <strong>le</strong>ur hiérarchie naturel<strong>le</strong>.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av.J.-C.Deir el-Médina (?)Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire, E 6727.Cat. 175Ostracon figuré parodique : souris assistant à unconcert.Calcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14047.Cat. 176Ostracon figuré : scène parodique <strong>de</strong> guerre.Calcaire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, après l’an 5 <strong>du</strong> règne<strong>de</strong> Ramsès III, vers 1177 av. J.-C. (?)Deir el-Médina (?)Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14049.Cat. 177Ostracon figuré parodique : un singe jardinier, sonpetit sur l'épau<strong>le</strong>, arrose. Les parcel<strong>le</strong>s d’un champsur un chemin bordé d'arbres fruitiers.Calcaire peint.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Bruxel<strong>le</strong>s, <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire, E 6764.36
Cat. 178Ostracon figuré : scène domestique parodiquemontrant une souris bien vêtue cueillant <strong>de</strong>s noix ou<strong>de</strong>s figues <strong>de</strong>vant un coffre.Calcaire, encre rouge.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Stockholm, Me<strong>de</strong>lhavsmuseet, MM 14048.Cat. 179Ostracon figuré : scène domestique parodiquemontrant un chat <strong>de</strong>bout, habillé d’une longue robe,offrant une coupe à un autre chat assis dignementCalcaire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 32954.Cat. 180 et 181Procession <strong>de</strong> la statue d’Amenhotep I er diviniséportée par <strong>de</strong>s prêtres (a) et sa parodie sur unostracon figuré (b) sur <strong>le</strong>quel on voit quatre chiensportant une souris installée sur un palanquin ; <strong>de</strong>uxautres chiens jouent <strong>le</strong>s rô<strong>le</strong>s <strong>du</strong> prêtre puret <strong>du</strong> ritualiste.a) Fragment <strong>de</strong> stè<strong>le</strong>Calcaire.Nouvel Empire, 20 e dynastie, ans 23-28 <strong>de</strong>Ramsès III, 1161-1156 av. J.-C.Deir el-Médina.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, N 665.b) Ostracon figuré.Calcaire.Époque ramessi<strong>de</strong>, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av.J.-C.Deir el-Médina (?)Turin, Museo Egizio, S 6333.Cat. 182Ostracon figuré : scène pornographique montrantune femme, à tête <strong>de</strong> cynocépha<strong>le</strong> (?), écartant sonsexe <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux mains. Le phallus hypertrophié d’unhomme (en lacune) passe sous son bras et déchargeson liqui<strong>de</strong> séminal qui s’écou<strong>le</strong> ensuite entre sesjambes.Calcaire, encre noire.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 25335.Cat. 183Ostracon figuré : scène érotique représentant uncoup<strong>le</strong> dont la femme, <strong>de</strong> la main gauche, ai<strong>de</strong> à lapénétration en tenant <strong>le</strong>s testicu<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’homme. Àdroite et à gauche, <strong>de</strong>ux enfants poussent l’hommeet la femme l’un contre l’autre.Calcaire, <strong>de</strong>ssin à la peinture noire et rouge.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Berlin, Ägyptisches Museum und Papyrussammlung,ÄM 23676.Cat. 184Ostracon figuré biface : scènes d’accoup<strong>le</strong>ment.Calcaire, encre rouge.Biface ; haut <strong>du</strong> recto = bord gauche <strong>du</strong> verso.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 33023.Cat. 185Ostracon figuré : la femme s’appuie au sol <strong>de</strong>s <strong>de</strong>uxmains en tournant la tête vers l’arrière pour regar<strong>de</strong>rson partenaire qui la pénètre en lui tenant la tail<strong>le</strong>.Le texte peut se tra<strong>du</strong>ire : « Heureuse est Iné[h] » (nom <strong>de</strong> la dame).Calcaire.Nouvel Empire, 19 e dynastie, règne <strong>de</strong> Ramsès II(?), 1279-1213 av. J.-C.Deir el-Médina (?)Londres, British Museum, Department of AncientEgypt and Sudan, EA 50714.Cat. 186Papyrus dit « papyrus pornographique etparodique » <strong>de</strong> Turin et sa copie.a : Papyrus.Nouvel Empire, 19 e -20 e dynastie, 1295-1069 av. J.-C.Deir el-Médina.Turin, Museo Egizio, cat. 55001.b : Copie <strong>du</strong> papyrus.Papier vélin (filigrane coquil<strong>le</strong>)Deuxième quart <strong>du</strong> XIX e sièc<strong>le</strong>.Paris, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, E 11656.37
Visuels <strong>de</strong> l’expositionL’ART DU CONTOUR. LE DESSIN DANS L’EGYPTE ANCIENNEDu 19 avril-22 juil<strong>le</strong>t 2013, Richelieu,Les visuels sont téléchargeab<strong>le</strong>s sur <strong>le</strong> site <strong>Louvre</strong>.fr / PRESSE / Pack médiaL’utilisation <strong>de</strong>s visuels a été négociée par <strong>le</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, ils peuvent être utilisés avant, pendant et jusqu’à la fin<strong>de</strong> l’exposition, et uniquement dans <strong>le</strong> cadre <strong>de</strong> la promotion <strong>de</strong> l’exposition. Merci <strong>de</strong> mentionner <strong>le</strong> créditphotographique et <strong>de</strong> nous envoyer une copie <strong>de</strong> l’artic<strong>le</strong> à l’adresse coralie.james@louvre.fr.I. Le travail <strong>du</strong> peintre-<strong>de</strong>ssinateurA – Le Scribe <strong>de</strong> contour. Une famil<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ssinateurs sous Ramsès II1. Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs Nebrê, Nakhtimenet Khây : adoration <strong>de</strong> l’hiron<strong>de</strong>l<strong>le</strong> et <strong>de</strong>la chatte, XIX e dynastie (Ramsès II), Cat.1591, Museo Egizio, Turin © FondazioneMuseo <strong>de</strong>l<strong>le</strong> Antichità Egizie, Turin.B - Dessin et écriture2. Pa<strong>le</strong>tte <strong>de</strong> Dédia, directeur <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ssinateurs d’Amon dans Karnak,XIX e dynastie (Séthi 1 er ), N2274,département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes,musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris ©<strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP /Georges Poncet3. Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> Dédia directeur <strong>de</strong>s<strong>de</strong>ssinateurs d’Amon, XIX e dynastie(Séthi 1 er ), C 50, département<strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée<strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong><strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / GeorgesPoncet.4. Statuette <strong>de</strong> déesse hippopotamedédiée par <strong>le</strong>s <strong>de</strong>ssinateursParâhotep, Ipouy et Pay,XIX e dynastie (Ramsès II), Cat.526, Museo Egizio, Turin© Fondazione Museo <strong>de</strong>l<strong>le</strong>Antichità Egizie, Turin.5. Coffret à ouchebtis <strong>de</strong> Paankhesimenadorant Osiris trônant <strong>de</strong>vant <strong>le</strong> signe <strong>de</strong>l’occi<strong>de</strong>nt, 3 e pério<strong>de</strong> intermédiaire, boispeint. N2677, département <strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris © <strong>Musée</strong><strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / GeorgesPoncet.6. Fragment <strong>de</strong> paroi <strong>de</strong> tomberoya<strong>le</strong>, XIX e dynastie, calcairepeint. Inv. A8, <strong>Musée</strong> Calvet,Avignon © <strong>Musée</strong> Calvet, Avignon.
C - L’équipement <strong>de</strong> l’artiste et <strong>le</strong>s supports employés7. Vase à parfum décoré <strong>de</strong> motifsfloraux, Fin XVIII e dynastie,EA 64041, British Museum,Londres © The Trustees ofthe British Museum, Londres.8. Coupe en faïence b<strong>le</strong>ue décorée <strong>de</strong> trois poissonset trois nénuphars, XVIII e dynastie, faïence, AMP4562, Antikensammlung Ägyptisches Museumund Papyrussammlung, Berlin © StaatlicheMuseen zu Berlin, Ägyptisches Museum undPapyrussammlung, Foto Sandra Steiss.9. Shaouabti avec sarcophageinscrit au nom d’Amenmès,Ramessi<strong>de</strong>, BM EA 53892,British Museum, Londres© The Trustees of the BritishMuseum, Londres.II. L’Apprentissage et <strong>le</strong>s Pratiques <strong>de</strong> l’art <strong>du</strong> contourA - L’apprentissage <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinMises au carreauB - L’analyse mo<strong>de</strong>rne <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssin égyptien et ses limites10. Fragments <strong>de</strong> papyrus avec esquisses préparatoirespour un sphinx, Ptolémaïque II e -I er sièc<strong>le</strong> avJC, papyrus, AM 11775, Antikensammlung ÄgyptischesMuseum und Papyrussammlung, Berlin ©Staatliche Museen zu Berlin, Ägyptisches Museumund Papyrussammlung, Foto Sandra Steiss.11. Fragment <strong>de</strong> paroi peinte: scène <strong>de</strong> navigation sur <strong>de</strong>uxregistres, XVIII e dynastie, stuc peint, E2380, <strong>Musée</strong>s Royauxd’Arts et d’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s © <strong>Musée</strong>s royaux d’Art etd’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s.Le <strong>de</strong>ssin sous-jacent comme outil <strong>du</strong> graveuret <strong>du</strong> sculpteur12. Ostracon avecesquisse (<strong>de</strong>ssin enrelief dans <strong>le</strong> creux)<strong>du</strong> profil <strong>de</strong> Nefertiti,XVIII e dynastie(Amarna), pierre.UC 011, Petrie Museumof EgyptianArchaelogy, Londres© UCL, Petrie Museumof EgyptianArchaeology, Londres.13. Livre <strong>de</strong>s <strong>Mo</strong>rts <strong>de</strong> Kenna (adoration <strong>du</strong> so<strong>le</strong>il), finXVIII e - déb. XIX e dynastie, SR-cadre 17, Ley<strong>de</strong>, Rijksmuseumvan Oudhe<strong>de</strong>n © Rijksmuseum van Oudhe<strong>de</strong>n,Ley<strong>de</strong>.2
14. Stè<strong>le</strong> au décor seu<strong>le</strong>ment <strong>de</strong>ssiné: Mahou fait<strong>de</strong>s offran<strong>de</strong>s à Amon, <strong>Mo</strong>ut et Meresger, XIX edynastie, Cat. 1580, Museo Egizio, Turin© Fondazione Museo <strong>de</strong>l<strong>le</strong> Antichità Egizie, Turin.15. Portrait <strong>de</strong> Senenmout, XVIII e dynastie. Hatchepsout-Thoutmosis III, 31.4.2, New York, MMA © The MetropolitanMuseum of Art, Dist. RMN-GP / image of theMMA.Illustrer un papyrus16. Papyrus mythologique, XXI e -XXII e dynastie. N 3292, département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>,Paris © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Georges Poncet.C - Caractéristiques <strong>du</strong> <strong>de</strong>ssinLa représentation <strong>de</strong> l’espace : la perspective rabattue et l’association <strong>de</strong>s différents points <strong>de</strong> vue17. Livre <strong>de</strong>s morts <strong>de</strong> Néferoubenef (14) <strong>le</strong> champ <strong>de</strong>s roseaux. E 3092, département <strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes,musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Georges Poncet.3
Le corps : conventions et proportionsIII. L’univers égyptien en <strong>de</strong>ssin ;l’univers <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ssinateurs ?A- L’imaginaire18. Fragment <strong>de</strong> paroi peinte: femme respirantune f<strong>le</strong>ur (banquet). XVIII e dynastie, Kestner Museum1962-69, Hanovre © Christian Tepper, MuseumAugust Kestner, Hanovre.19. Stè<strong>le</strong> <strong>de</strong> ladame Tachémèspriant rê-Horakhty,XXII e dynastie.N3794, département<strong>de</strong>s Antiquitéségyptiennes,musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>,Paris © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong><strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Georges Poncet.B - L’humain : Pharaon / <strong>le</strong>s égyptiens / <strong>le</strong>s étrangersC - La nature : végétaux/ /animaux20. Ostracon figuré : Tête <strong>de</strong> Ramsès VI coiffé <strong>de</strong> lacouronne roya<strong>le</strong>, XVIII e dynastie. N 498, département<strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris© <strong>Musée</strong> <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Christian Décamps.D - Les scènes satiriques21. Fragment <strong>de</strong> mur peint: oiseaux au <strong>de</strong>ssus d’un fourré<strong>de</strong> papyrus, XVIII e dynastie, <strong>Louvre</strong> E 13101, département<strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, Paris © <strong>Musée</strong><strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Georges Poncet.22. Ostracon figuré satirique : la souris et <strong>le</strong>chat, Ramessi<strong>de</strong>, calcaire. E 6727, <strong>Musée</strong>sRoyaux d’Art et d’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s© <strong>Musée</strong>s royaux d’Art et d’Histoire, Bruxel<strong>le</strong>s.23. Ostracon figuré : hyène attaquée par trois chiens,calcaire peint, Nouvel Empire, XIX e -XX e dynasties, vers1295-1069 av. J.-C. Deir el-Medineh, E14366, département<strong>de</strong>s Antiquités égyptiennes, musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong> © <strong>Musée</strong> <strong>du</strong><strong>Louvre</strong>, dist. RMN-GP / Christian Décamps.4
MécénatL’exposition L’art <strong>du</strong> contour a été réalisée avec <strong>le</strong> soutien <strong>de</strong>Depuis vingt ans, une histoire singulière s’écrit entre la Fondation Total et <strong>le</strong> musée <strong>du</strong> <strong>Louvre</strong>. Au fil<strong>de</strong>s expositions, et grâce à notre engagement commun en faveur <strong>de</strong>s publics <strong>le</strong>s plus éloignés <strong>de</strong> laculture, nous œuvrons conjointement à célébrer la diversité culturel<strong>le</strong>. C’est dans cet esprit que laFondation Total apporte aujourd’hui son soutien à l’exposition L’art <strong>du</strong> contour : <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin en Egypteancienne, parfait écho à l’une <strong>de</strong>s missions que s’est donnée la Fondation Total : faire dialoguer <strong>le</strong>scultures. En illustrant à la fois <strong>le</strong>s liens et <strong>le</strong>s différences entre l’écriture et <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin, entre <strong>le</strong>s hommes <strong>de</strong><strong>le</strong>ttres et <strong>le</strong>s artistes L’art <strong>du</strong> contour : <strong>le</strong> <strong>de</strong>ssin en Egypte ancienne réussit à bouscu<strong>le</strong>r et enrichir notreé<strong>du</strong>cation et notre perception occi<strong>de</strong>nta<strong>le</strong>sA propos <strong>de</strong> la Fondation d’entreprise TotalCréée en 1992 au <strong>le</strong>n<strong>de</strong>main <strong>du</strong> Sommet <strong>de</strong> la Terre <strong>de</strong> Rio, la Fondation Total s’est consacrée pendant 16 ansà l’environnement, et plus particulièrement à la biodiversité marine. Depuis 2008, son engagement s’est élargiaux autres domaines <strong>du</strong> mécénat <strong>de</strong> Total et el<strong>le</strong> couvre aujourd’hui quatre champs d’activité : la culture, lasolidarité, la santé, et la biodiversité marine.Culture : La Fondation Total est partenaire <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s institutions culturel<strong>le</strong>s françaises dont el<strong>le</strong> accompagnerégulièrement <strong>le</strong>s expositions, avec <strong>le</strong> souhait <strong>de</strong> favoriser <strong>le</strong> dialogue <strong>de</strong>s cultures. El<strong>le</strong> a aussi pour objectif <strong>de</strong>développer <strong>de</strong>s passerel<strong>le</strong>s entre culture et solidarité, notamment en permettant l’accès aux musées à <strong>de</strong>spersonnes en situation <strong>de</strong> précarité socia<strong>le</strong> et économique. En partenariat avec la Fondation <strong>du</strong> Patrimoine, el<strong>le</strong>soutient éga<strong>le</strong>ment la restauration et la réhabilitation <strong>du</strong> patrimoine culturel, in<strong>du</strong>striel et artisanal français dans<strong>le</strong>s régions d’implantation <strong>du</strong> Groupe. Un programme qui permet aussi <strong>de</strong> soutenir la formation et l’insertionprofessionnel<strong>le</strong>s grâce à <strong>de</strong>s chantiers <strong>de</strong> restauration.Solidarité : La Fondation s’attache à i<strong>de</strong>ntifier et à promouvoir <strong>de</strong>s actions innovantes pour faciliter l’accès <strong>de</strong>sjeunes à l’emploi en France. El<strong>le</strong> est notamment engagée aux côtés <strong>du</strong> ministère en charge <strong>de</strong> la Jeunesse pour<strong>le</strong> développement <strong>de</strong> projets <strong>de</strong> terrain, et peut ainsi agir <strong>du</strong>rab<strong>le</strong>ment sur l’é<strong>du</strong>cation, la culture, la mobilité,l’égalité <strong>de</strong>s chances, l’orientation ou encore l’insertion professionnel<strong>le</strong>.Santé : La Fondation accompagne l’Institut Pasteur dans la prévention et <strong>le</strong> traitement <strong>de</strong>s maladiesinfectieuses dans <strong>le</strong>s pays en développement dans <strong>le</strong>squels <strong>le</strong> groupe Total est présent. Placé sous l’égi<strong>de</strong> <strong>de</strong>Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine, ce partenariat permet <strong>de</strong> soutenir <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong> recherche et<strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> terrain.Biodiversité marine : La Fondation encourage <strong>le</strong>s recherches ayant pour objectif une meil<strong>le</strong>ure connaissance<strong>de</strong>s espèces et <strong>de</strong>s écosystèmes marins et côtiers, et <strong>de</strong>s enjeux liés à <strong>le</strong>ur préservation. El<strong>le</strong> participe éga<strong>le</strong>mentà la réhabilitation d’écosystèmes fragi<strong>le</strong>s et contribue à la préservation <strong>de</strong>s espèces menacées qui y vivent.Enfin, el<strong>le</strong> se consacre à la diffusion <strong>de</strong>s connaissances par <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> sensibilisation et d’é<strong>du</strong>cation.Dans tous ces champs d’activité, la Fondation Total privilégie <strong>le</strong>s partenariats <strong>de</strong> long terme. Il s’agit, au-<strong>de</strong>là <strong>du</strong> soutien financier, <strong>de</strong> croiser <strong>le</strong>s expertises et <strong>de</strong> <strong>le</strong>s renforcer pour enrichir l’intelligencecol<strong>le</strong>ctive.Pour plus d’informations : www.fondation.total.com38